Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Une Europe qui vire au noir et au brun

Dans cet entretien, Éric Toussaint réalise un tour d'horizon du bilan des élections européennes, de la montée de l'extrême droite et des possibilités à gauche.
Tiré de Inprecor 721 - juin 2024
27 juin 2024
Par Éric Toussaint
Comment interpréter les résultats des élections européennes ?
Première observation, lors des élections européennes qui se sont déroulées dans les 27 pays membres de l'UE entre le 6 et le 9 juin 2024, le taux de participation a de nouveau été très faible. En moyenne, pour l'Union européenne, il s'est élevé à 51%. Il faut prendre en compte que des pays où le vote est obligatoire rentrent dans le calcul de cette moyenne, comme c'est le cas pour la Belgique, ou le taux de participation s'est élevé à 90% (1). Sans eux, le pourcentage de participation passerait en dessous de la barre des 50%. Sur les 27 pays membres de l'UE, 15 pays affichent un taux de participation inférieur à 50%. Et des pays récemment entrés dans l'UE ont connu des taux extrêmement faibles. En Italie on constate 6 points de pourcentage de moins qu'en 2019. En Croatie le taux de participation n'a atteint que 21,35%. A noter que la Croatie n'est rentrée dans l'UE qu'en 2013 et seulement en 2023 dans la zone Euro et l'espace Schengen. En Lituanie, qui a adhéré à l'UE en 2004, le taux de participation s'est élevé à 28,35%. Pour les deux autres républiques baltes, le taux s'élève pour la Lettonie à 34% et pour l'Estonie à 37,6%. Les autres pays où la participation a été faible : la Tchéquie avec 36,45%, la Slovaquie avec 34,40%, le Portugal avec 36,5%, la Finlande avec 40,4, la Bulgarie avec 33,8% et la Grèce avec 41,4% (alors que dans ces deux pays le vote est obligatoire !).
Parmi les grands pays de l'Union européenne, seule l'Allemagne dépasse les 50% de participation en atteignant 65%.
Conclusion : La majorité des citoyens et des citoyennes de l'Union européenne n'ont aucun engouement pour les institutions de l'UE et n'ont pas confiance dans l'utilité d'utiliser leur droit de vote. Les citoyens et les citoyennes des pays de l'ancien bloc de l'Est ou du Sud de l'Europe qui avaient beaucoup d'espoir au moment où leur pays à adhérer à l'UE ou plus tard à la zone euro ou à l'espace Schengen sont clairement déçu·es par les promesses non tenues d'amélioration des conditions de vie. La progression des droits sociaux ne s'est pas concrétisées, au contraire. S'il adopte quelques fois des résolutions relativement positives, le Parlement européen n'a pas de véritable pouvoir. C'est la Commission et le Conseil qui, au sein de l'UE, prennent véritablement les décisions et les grands pays comme l'Allemagne et la France y exercent une influence décisive. Il ne faut pas non plus oublier le rôle coercitif de la Banque centrale européenne qui a montré à plusieurs occasions, comme dans le cas de la Grèce en 2015, qu'elle voulait et pouvait déstabiliser un gouvernement qui ne suivait pas docilement la politique voulue par les dirigeant·es de l'UE. Une politique exigée par les gouvernements des pays qui dominent économiquement et politiquement l'Union et par les grandes entreprises privées, en particulier les grandes banques privées et lesfonds d'investissement. Les citoyens et citoyennes se sont aussi rendus compte que pendant la pandémie du coronavirus (2020-2021), les dirigeant·es de l'UE étaient incapables d'adopter des politiques sanitaires pour les protéger efficacement. Et depuis lors, l'UE n'a rien fait pour améliorer structurellement la situation, refusant de se doter d'une industrie pharmaceutique capable de répondre à une prochaine pandémie, refusant de soutenir la proposition avancée par 135 pays du sud Global de suspendre l'application des brevets, empêchant l'accès universel aux vaccins et préférant par contre soutenir l'industrie européenne d'armement et accroître les dépenses militaires.
Deuxième observation, il y a un renforcement très important des forces conservatrices de droite et des forces d'extrême droite. Les forces politiques qui se présentaient comme centristes, ou centre-droit, tout en menant une politique de droite dure par rapport aux migrant·es, aux candidat·es au droit d'asile, à la remilitarisation accélérée de l'Europe, ont souffert dans certains cas de lourdes pertes. C'est en particulier le cas du regroupement autour du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, qui a perdu 10 sièges, passant de 23 à 13. Autre exemple, l'Open VLD du premier ministre belge Alexander De Croo, qui a perdu la moitié de ses sièges. Les électeur·ices préfèrent l'original (d'extrême-droite ou de droite conservatrice dure) à la copie.
Les autres grands perdants sont les Verts européens qui ont payé leur compromission en matière de politique pour faire face au changement climatique, à la crise écologique, ou pour gérer les flux migratoires et la politique du droit d'asile. Ils ont également payé leur appui à la politique de remilitarisation de l'Europe et l'alignement sur l'OTAN. En effet, à certaines occasions, les Verts, ont joué un rôle fondamental dans la formation de majorités au Parlement et dans l'approbation des principales mesures de la législature 2019-2024 (Pacte vert, remilitarisation européenne, Pacte sur l'immigration et l'asile, etc.). Dans leurs pays respectifs, ils ont accompagné des politiques de droite comme en Allemagne et en Belgique. Comme l'écrit Miguel Urban : « Si, en 2019, ils se sont imposés, dans une certaine mesure, comme des forces de renouvellement et de modernisation d'une gouvernance bipartisane dépassée, leur incapacité à répondre aux attentes les a conduits à payer un coût électoral élevé. » (2). Le groupe des Verts européens perd 19 sièges, passant de 71 sièges à 52 sièges. De 4e groupe au sein du Parlement européen, ou il devançait les deux groupes parlementaires de l'extrême droite – ECR et ID (voir plus loin), il passe à la sixième place. Il est donc dorénavant devancé par ces deux groupes.
Troisième observation, la coalition de 3 groupes parlementaires qui gouvernent les institutions européennes, c'est-à-dire, le groupe du Parti Populaire européen, le groupe social-démocrate des partis socialistes et Renew Europe (qui inclut notamment Renaissance d'Emmanuel Macron, l'Open VLD d'Alexander de Croo - qui a démissionné le soir des élections suite à la défaite de son parti - et le VVD de Mark Rutte, ex-premier ministre hollandais), conserve une majorité même si elle est amoindrie, car elle passe de 417 sièges à 406 et peut continuer de gouverner l'UE. Mais le groupe dominant au sein de cette coalition, à savoir le groupe du Parti populaire européen, dans lequel prédomine la CDU-CSU de Ursula Vander Leyen et le Parti populaire espagnol est clairement tenté de tendre la main à Giorgia Meloni et à son parti d'extrême droite, les Fratellis d'Italie (membre du groupe parlementaire européen ECR) afin d'inclure l'Italie dans la gouvernance européenne. De son côté, Giorgia Meloni, s'appuie sur son succès électoral le 9 juin et sur la progression du groupe parlementaire d'extrême droite, sur lequel elle exerce un leadership, qui passe de 69 eurodéputé·es à 83. Elle exige un poste parmi ceux des principaux dirigeant·es de l'UE en arguant que Renew Europe est passé de 102 europarlementaires à 81. On verra fin juin, si elle obtient satisfaction.
Quatrième observation, le groupe de la « gauche radicale » – qui constitue le plus petit groupe au sein du parlement européen – malgré des pertes dans certains pays comme le Portugal où tant le Bloc de Gauche que le PCP perdent près de la moitié des voix et des sièges, se renforce globalement, passant de 37 sièges à 39. Il pourrait encore croître vu que des non-inscrit·es et des indépendant·es, qui représentent plus de 80 eurodéputé·es, pourraient le rejoindre. Au-delà de la composition et du nombre du groupe de la gauche radicale The Left, il faut relever certains succès. C'est le cas du bon résultat de la France Insoumise par rapport aux résultats de 2019, qui passe de 7 à 9 parlementaires, et qui atteint près de 10% des voix. Il faut ajouter également le résultat de la gauche radicale en Belgique, avec le progrès du PTB, qui double son score et sa représentation au Parlement européen (voir plus loin). Notons aussi le cas de l'Italie où l'alliance verte et de gauche atteint près de 7% des voix et obtient deux europarlementaires (voir plus loin).
Cinquième observation, la crise des régimes politiques continue à se traduire, outre le renforcement de l'extrême droite, par l'apparition et le succès de listes éphémères tirant avantage de leur impact sur les réseaux sociaux et de la recherche d'alternatives hors des partis politiques traditionnels ou même d'extrême-droite « classique ». Deux exemples de ce phénomène : la liste deFidias Panayiotou, un tiktoker chypriote de 24 ans, qui a été la troisième force remportant un siège au Parlement européen avec près de 20 % des voix, et Alvise Pérez, le candidat de Se Acabó La Fiesta (La fête est finie), l'une des nouveautés électorales en Espagne qui a obtenu trois députés européens avec 800 000 voix. Alvise Pérez est très actif sur les réseaux sociaux Telegram et Twiter / X sur lesquels ils diffusent des fakenews clairement orientées à droite. Dernièrement, X lui a retiré l'accès au réseau. Il fait l'objet de plusieurs poursuites pénales pour diffamation et espère bien profiter du statut d'eurodéputé pour y échapper durant la durée de son mandat.
Quelle est l'ampleur du renforcement de l'extrême-droite ?
Les deux groupes parlementaires d'extrême droite, qui ensemble regroupaient 118 député·es en 2019, sortent renforcés des élections de 2024. Ils comptent 134 député·es européen-nes. Cela monte à 149 parlementaires si on y ajoute les 15 parlementaires de l'extrême droite allemande Alternative für Deutschland AFD (qui, suite à des prises de positions pro nazie de son candidat principal pendant la campagne européenne, a été exclu en mai 2024 du groupe Identité et Démocratie -ID- dominé par le RN de Marine Le Pen). A noter que l'AFD est devenue le 9 juin 2024, avec 15 europarlementaires, la deuxième force politique en Allemagne alors qu'aux élections européennes de 2019, elle occupait la cinquième place avec 9 europarlementaires. Si on y ajoute le parti Fidesz-Union civique hongroise de Viktor Orban qui est venu en tête des élections hongroises et qui a remporté 10 sièges, cela donnerait 159 parlementaires.
Il faut noter effectivement qu'un certain nombre de non-inscrit·es et d'indépendant·es risquent aussi de rejoindre un des deux groupes parlementaires de l'extrême droite. L'extrême droite a réussi à devenir la première force politique en Italie (Frères d'Italie), en France (RN), en Hongrie (Fidesz-Union civique hongroise), aux Pays-Bas (PVV Partij voor de Vrijheid de Geert Wilders) et en Autriche (FPÖ). Et la deuxième force en Allemagne (AFD) et en Belgique (grâce au succès de Vlaams Belang dans la partie flamande du pays où il occupe la deuxième place derrière la NVA, un parti de droite radical). L'extrême droite n'a cessé de progresser en Europe depuis le début du siècle. Comme le souligne Miguel Urban, eurodéputé sortant d'anticapitalistas, il y a 20 ans, les parlementaires de l'extrême droite peinaient à constituer un groupe parlementaire dans le Parlement européen car cela impliquait d'avoir des élu·es dans 7 pays et d'atteindre au moins 23 sièges. Aujourd'hui, ils disposent de deux grands groupes parlementaires qui, s'ils s'unissaient, constitueraient la deuxième force politique dans le Parlement européen. Au cours des dix dernières années, l'extrême droite a fait son apparition dans certains pays où elle n'avait jusque-là aucun siège. C'est le cas du Portugal avec l'organisation d'extrême droite Chega, qui aux dernières élections parlementaires de mars 2024, a obtenu 18% des voix et pour la première fois fait son entrée dans le Parlement européen avec 2 sièges, après avoir recueilli 9,8% des voix le 9 juin.
Comment se répartissent les différents groupes politiques au sein du parlement européen et quelles sont leurs caractéristiques ?
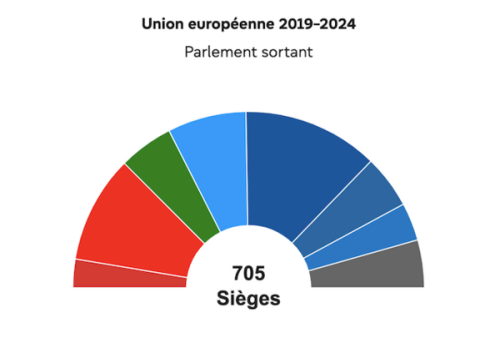

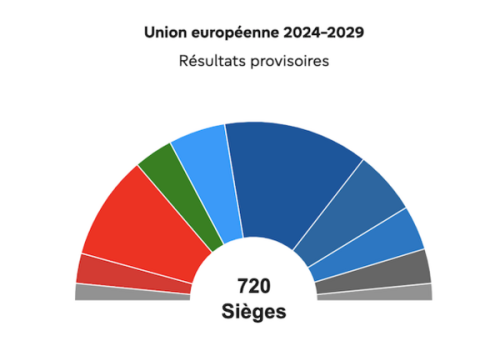

1. Le Parti Populaire Européen
Le premier groupe au sein du Parlement européen est le parti populaire européen, présent dans les 27 pays de l'Union européenne et disposant de 190 sièges. Il progresse de 14 sièges par rapport à 2019. En son sein, on retrouve des partis conservateurs avec une connotation chrétienne comme la CDU-CSU allemande de Ursula Van Der Leyen et Angela Merkel, comme le PP espagnol, la Coalition civique (en polonais : Koalicja Obywatelska, abrégé en KO) dirigée par Donald Tusk qui gouverne depuis fin 2023, le CDNV en Belgique, mais aussi le parti de feu Silvio Berlusconi, Forza Italia. Les partis nationaux qui soutiennent le groupe PP au parlement européen ont radicalisé leur positionnement à droite sur les thèmes liés aux droits des migrant·es et des réfugié·es, à la sécurité, à la guerre, à l'OTAN, à l'offensive contre les droits sociaux, au soutien gêné mais bien réel à la politique du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, à la poursuite et à l'approfondissement des politiques économiques néolibérales de privatisation et d'atteintes aux services publics,… Ils ont généralement intégré en leur sein des personnalités d'extrême droite comme c'est le cas du parti Nouvelle Démocratie qui gouverne la Grèce depuis 2019. Les partis membres du PPE font des alliances avec l'extrême droite comme c'est le cas en Espagne du PP avec Vox (membre du groupe européen ID) pour gouverner des régions ou des municipalités, ou en France d'une partie du parti Les Républicains (notamment leur président, le maire de Nice, Éric Ciotti) avec le RN de Marine Le Pen et de Jordan Bardella dans la campagne électorale des législatives du 30 juin 2024. En Autriche, le Parti populaire autrichien (en allemand : Österreichische Volkspartei, abrégé en ÖVP) a durant des années fait alliance avec le FPÖ, parti d'extrême-droite, jusqu'à ce qu'en 2019, un scandale mettant en cause le dirigeant principal de ce parti rende impossible la poursuite de la collaboration. Depuis lors, le Parti populaire autrichien est associé au Verts. En Italie, le parti membre du groupe Parti populaire au parlement européen est Forza Italia, parti conservateur de droite radicale, de feu Silvio Berlusconi. Il fait partie du gouvernement de la leader d'extrême-droite Giorgia Meloni des Frères d'Italie (Fratelli d'Italia) également alliée dans le gouvernement à un autre parti d'extrême droite italien, la Ligue du Nord de Matteo Salvini. En Finlande, le Parti de la Coalition nationale (Kokoomus, Kok) du premier ministre Petteri Orpo, membre du groupe PPE, a formé un gouvernement de coalition avec un parti d'extrême droite le Parti des Vrais Finlandais. En Suède, le parti d'extrême droite Démocrates de Suède (Sverigedemokraterna, SD) soutient, sans en faire partie, le gouvernement conservateur en place depuis 2022 composé notamment Parti modéré de rassemblement (Moderata samlingspartiet), membre du PPE. Ce gouvernement mène une politique répressive dure contre les migrant·es et a fait adhérer la Suède à l'OTAN en 2023. Ce qu'a fait également la Finlande. Ajoutons également que, en Hongrie, le parti d'extrême droite du président Viktor Orban, le Fidesz-Union civique hongroise (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség) a été membre du PPE jusque 2021. De toute manière, la liste des compromissions et des alliances de partis membre du PPE avec l'extrême droite est plus large que ce qui vient d'être mentionné et mériterait une étude complète.
2. S&D Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, fidèle allié du Parti populaire européen pour gouverner l'UE
Le deuxième groupe parlementaire en termes de nombre est celui del'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocratesqui compte 136 parlementaires alors qu'il en rassemblait 139 en 2019. Les socialistes espagnols et les Italiens du Parti démocratique obtiennent chacun le 21 europarlementaires mais les Espagnols perdent un siège (ils en avaient 22 en 2019) tandis que les Italiens en gagnent 6 en passant de 15 à 21. Les socialistes allemands ont perdu 2 sièges passant de 16 à 14. Au Portugal, le parti socialiste passe de 8 à 7 parlementaires. Les socialistes autrichiens gardent 5 sièges tout comme en 2019 mais passent de la deuxième force politique à la troisième. En Bulgarie les socialistes passent de 4 à 2 parlementaires. En Roumanie, les socialistes passent de 4 à 6 sièges. Les socialistes belges obtiennent 4 parlementaires contre 2 en 2019. En Croatie, les socialistes se maintiennent avec 4 sièges. Au Danemark les socialistes se maintiennent avec 3 sièges (sur 15 sièges) ; en Finlande, ils stagnent à 2 sièges (sur 21 sièges) ; en Suède, ils conservent leurs 5 sièges (sur 21). En France, ils connaissent une importante progression passant de 7 à 13 sièges et sont à égalité avec le parti de Macron qui, lui, perd 10 sièges (alors que le parti de Marine Le Pen gagne 12 sièges passant de 18 à 30). En Grèce ils passent de 2 en 2019 à 3 sièges en 2024. Aux Pays-Bas, les socialistes perdent et passent de 6 à 4 sièges. En Tchéquie et en Slovaquie, les socialistes n'ont aucun parlementaire. En Slovénie ils passent de 2 à 1 siège. En Estonie et en Lituanie, les socialistes se maintiennent à 2 sièges comme en 2019, en Lettonie, ils passent de 2 à 1.
Le groupe parlementaire socialiste européen a appuyé les même orientations et les mêmes politiques que le groupe du Parti Populaire européen, il n'y a eu aucune rupture entre eux sur les grandes questions au niveau des politiques économiques, de la politique migratoire, de l'augmentation des dépenses militaires, du renforcement de l'OTAN et de l'alignement sur Washington, du refus de prendre des sanctions contre Israël, du choix de ne pas appliquer un virage radical pour répondre à la crise écologique.
3. ECR Le groupe des Conservateurs et des Réformistes européens, le plus important regroupement d'extrême droite
Le groupe des Conservateurs et des Réformistes européens est à ce stade le principal groupe parlementaire d'extrême-droite et compte 83 eurodéputé·es. Par rapport aux élections de 2019, ce groupe a progressé de 14 sièges. Le parti de Giorgia Meloni, les Frères d'Italie (Fratelli d'Italia) constitue la principale force politique de ce groupe avec 24 parlementaires élu·es en 2024 contre 10 en 2019. Ensuite vient en Pologne le parti Loi et Justice (PIS est le sigle en polonais) qui a gouverné ce pays de 2015 à fin 2023 et qui compte 20 parlementaires contre 27 en 2019. A noter qu'en 2019, il constituait la principale force politique du pays et qu'en 2024, il a été dépassé par la Coalition civique (en polonais : Koalicja Obywatelska, abrégé en KO) dirigée par Donald Tusk, qui gouverne depuis fin 2023, comme nous l'avons vu en parlant du PPE. En Espagne, c'est le parti d'extrême-droite VOX qui fait partie du groupe ECR, il a obtenu 6 sièges en 2024 contre 4 en 2019. En France, les membres d'ECR se retrouvent plus ou moins dans la formation politique d'extrême-droite Reconquête du raciste Éric Zemmour, ils sont au nombre de 4 (3). En Belgique, la NVA, le principal parti nationaliste flamand ultra néolibéral et raciste fait partie d'ECR avec 3 parlementaires (le même chiffre qu'en 2019). La NVA a obtenu 22% de voix en Flandres et a devancé de peu le Vlaams Belang au cours des élections au parlement fédéral qui se déroulait en même temps que les européennes. C'est le dirigeant de la NVA qui conduit les négociations pour la constitution d'un nouveau gouvernement en Belgique, gouvernement qui sera entièrement composé par des partis de droite. Le Vlaams Belang, qui est encore plus à droite que la NVA, a dépassé celle-ci de peu aux élections européennes et compte également 3 eurodéputé·es. Le Vlaams Belang fait partie de l'autre grand groupe d'extrême droite dans le parlement européen, le groupe ID dominé par le RN de Marine Le Pen (voir plus loin). Lors de la campagne électorale pour le parlement fédéral belge la NVA a adopté un discours pas très éloigné du Vlaams Belang afin de ne pas perdre trop de voix en sa faveur. Bart de Wever, le dirigeant de la NVA, s'est présenté en quelque sorte comme un rempart face au danger que représente le Vlaams Blok. Néanmoins, lors de la soirée électorale du 9 juin, Bart de Wever content d'avoir dépassé (de peu) le Vlaams Blok a félicité celui-ci pour son résultat en progression. Le programme économique de la NVA est calqué sur le programme du patronat belge et flamand.
En Tchéquie, la coalition SPOLU qui fait partie du groupe ECR dispose de 3 député·es européen·nes. En Suède, fait partie de l'ECR le parti d'extrême droite les Démocrates de Suède (Sverigedemokraterna, SD), il dispose de 3 élu·es au Parlement européen comme en 2019. En Finlande, on trouve le parti des finlandais (PS Perussuomalaiset/Sannfinländarna) qui a perdu des voix en 2024 et n'a plus qu'1 parlementaire européen contre 2 en 2019. C'est une bonne nouvelle que ce parti paie sa participation au gouvernement finlandais dans lequel il a 7 ministres. En Grèce, le parti affilié à l'ECR est la Solution grecque qui a progressé lors des élections de 2024 et a obtenu 2 élus contre 1 en 2019. Tous les partis européens d'ECR sont clairement d'extrême droite.
En tout cas, il est important de retenir que dans au moins deux pays de l'UE, des partis membres de l'ECR dirigent ou vont diriger le gouvernement, c'est le cas de l'Italie et probablement de la Belgique dans les semaines ou les mois qui viennent. Ils sont aussi au gouvernement en Finlande.
4. RENEW Europe
Renew Europe est le quatrième groupe parlementaire européen en termes de poids. Sa force a été fortement amenuisée suite aux élections de 2024, il passe de 102 en 2019 à 81 parlementaires en 2024. Les principales formations politiques du groupe RENEW sont le parti du président français Emmanuel Macron, 3 partis de droites de Belgique – le MR dont est issu Charles Michel, le président du Conseil dont le mandat s'achève, l'Open VLD de l'ex-premier ministre belge Alexander De Croo, et les Engagés, un parti qui provient de la famille PPE et qui vient de rejoindre RENEW depuis les élections européennes de juin 2024 après avoir fait un bon score électoral. Aux Pays-Bas, également membre de RENEW, le VVD le parti de l'ex-premier ministre Mark Rutte, qui vient de devenir le nouveau chef de l'OTAN,fait désormais partie d'un gouvernement de coalition dirigé par le parti d'extrême-droitedu raciste Geert Wilders (du Parti pour la Liberté). C'est son parti qui a propulsé le nouveau premier ministre hollandaisDick Schoof, qui a été chef des services de renseignement et qui officiellement n'est membre d'aucun parti.
5. Identité et Démocratie (ID)
Le second groupe parlementaire d'extrême-droite est le groupe Identité et Démocratie (ID), il a également grandi depuis les élections de 2019, passant de 49 à 58 parlementaires européen·nes en 2024. Le groupe est présent dans 7 pays. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, qui est venu en tête des élections européennes en France en faisant le double des voix du parti d'Emmanuel Macron, y exerce le leadership avec 30 parlementaires contre 18 en 2019. Ensuite vient la Ligue du Nord de Matteo Salvini, qui a subi d'énormes pertes par rapport à 2019. Son groupe ne compte plus que 8 parlementaires, alors qu'il en comptait 22. Le parti de Salvini fait partie du gouvernement de Giorgia Meloni, dont il est le vice-premier ministre (poste qu'il a occupé également en 2018-2019). Le parti de Salvini intègre des personnalités d'extrême droite affichant leur sympathie pour Mussolini comme l'ancien général Vannacci. En Autriche le Parti de la liberté d'Autriche ou Parti libéral autrichien (en allemand : Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) a fait partie du gouvernement de 2000 à 2006, et ensuite de 2017 à 2019. Plusieurs de ses membres et dirigeants n'ont pas caché leurs sympathies nazies. Le parti n'a plus pu faire partie d'un gouvernement suite à un scandale ayant éclaté en 2019, qui a permis de révéler avec vidéo à la clé qu'un de ses dirigeants principaux avait négocié le financement du parti avec un oligarque russe. Ceci dit, entre 2019 et 2024, il a doublé ses voix et ses parlementaires européens passant de 3 à 6. Il est ainsi devenu le premier parti autrichien en 2024, devançant d'un siège au parlement européen le parti membre du groupe parti populaire européen et le parti socialiste.
Aux Pays-Bas, c'est le Parti pour la Liberté (en néerlandais Partij voor de Vrijheid) de Geert Wilders qui fait partie du groupe Identité et Démocratie, il est devenu la principale force politique du pays en novembre 2023 et vient de constituer un gouvernement avec le VVD qui fait partie de Renew (voir plus haut). Aux élections européennes, il a confirmé sa position de premier parti en obtenant 6 parlementaires tandis que le VVD de Mark Rutte en a obtenu 4. En Belgique, dans la partie flamande, le Vlaams Belang, qui est membre de Identité et Démocratie, a connu une forte progression électorale en juin 2024 en devenant le principal parti en termes de votes pour les élections européennes. Pour les élections au parlement belge, il est la deuxième force après la NVA qui, comme on l'a vu, fait partie de l'autre groupe parlementaire d'extrême droite, l'ECR. Le groupe ID est également présent en Estonie et en Tchéquie mais ce sont des forces marginales obtenant chacune seulement un parlementaire.
6. Le groupe des Verts européens (51 au lieu de 71 en 2019)
Le groupe des Verts européens a connu une importante défaite lors des élections de 2024, passe de 71 parlementaires à 51. Le groupe revient grosso modo à la taille qu'il avait entre 1999 et 2019 avant de connaître une forte croissance en 2019 pour la législature qui se termine. Maintenant, il passe de la 4e position à laquelle il s'était hissé en 2019 à la 6e position, dépassé par les deux groupes parlementaires d'extrême droite, le groupe ECR et le groupe ID. Les Verts allemands (= Grünen), partie prenante d'un gouvernement de grande coalition avec les socialistes et les libéraux, ont perdu près de la moitié des sièges, passant de 21 europarlementaires à 12. Si on ajoute les autres petites listes allemandes qui appartiennent également au groupe des Verts européens, l'ensemble passe de de 25 à 16. Les Verts allemands ont accepté l'orientation du gouvernement dirigé par le socialiste Scholtz, résolument favorable au gouvernement fasciste de Netanyahou, pro OTAN et favorable à une forte augmentation des dépenses d'armement. Les Verts de Belgique ont également subi une terrible défaite, en particulier dans la partie francophone du pays où ils ont payé un prix élevé pour leur participation gouvernementale avec deux partis de droite et les socialistes. Ils sont passés de 2 europarlementaires à 1. Les Verts flamands s'en tirent un peu mieux et gardent un europarlementaire. Les verts autrichiens qui sont au gouvernement depuis 2019 avec l'OVP, membre du PPE, sont aussi perdants et passent des 3 parlementaires à 2. Les Verts français, qui ont adopté une position de plus en plus modérée sans pour autant être dans le gouvernement, ont aussi perdu un grand nombre de voix passant de 10 europarlementaires à 5. L'exception à cette très importante chute se situe au Danemark : les Verts progressent et passent de 2 sièges à 3 sièges au PE. En Italie ils se maintiennent avec 3 sièges au PE de même qu'en Suède avec 3 sièges également. Dans les pays de l'Est ils sont quasi absents.
7. Le groupe parlementaire The Left (La Gauche)
Le septième groupe parlementaire européen est constitué par le groupe The Left (La Gauche) anciennement GUE/NL. Au départ, il y a 25 ans, il était composé de partis euro communistes auxquels s'ajoutaient notamment deux élus trotskystes Alain Krivine (Ligue Communiste révolutionnaire) et Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière). Il s'est élargi vers des partis de la gauche nordique (Danemark, Finlande et Suède) qui ne venaient pas de la tradition communiste. En 2004, il n'y a plus eu d'élu·es trotskystes mais se joignirent à la GUE, le Bloc de Gauche du Portugal (résultat d'une fusion entre eurocommunistes, maoistes, trotskystes,…) et le Sinn Fein irlandais ainsi que le Parti progressiste des travailleurs (AKEL) de Chypre et le Parti Communiste de Tchéquie. Suites aux élections de 2009 la GUE connu une chute importante car les différentes organisations communistes italiennes perdirent toute représentation alors qu'elles avaient 7 sièges européens dans la précédente législature. La GUE se réduisit à 35 parlementaires. Mais à partir de 2014, de nouvelles formations en plein développement ont renforcé la GUE, notamment Syriza de Grèce qui était à son apogée ou l'ont rejoint, comme Podemos en Espagne, qui venait d'être créé et fit élire sur une orientation radicale 5 parlementaires du premier coup. Izquierda Unida d'Espagne avait également des élu·es. En conséquence en 2014, la GUE connut une croissance importante en gagnant 18 sièges, passant de 35 à 53 sièges. Suite à la capitulation de Syriza en 2015, du virage modéré de Podemos et de Die Linke en Allemagne, la GUE/NL perdit des plumes et retomba à 37 sièges en 2019. Les résultats des élections de 2024 situent The Left, le nom qui remplace le sigle GUE/NL, à son niveau de 2009 et de 2019. À noter des résultats positifs en France où La France Insoumise gagne 4 sièges, passant de 5 à 9, en Belgique, où grâce au PTB, The Left gagne 1 eurodéputé, en Italie, avec la liste Alliance Verte et Gauche qui obtient 2 eurodéputé·es. Par contre, pour la première fois depuis longtemps, Izquierda Unida, dans lequel se trouve le PC espagnol (IU-PC fait partie de Sumar qui particpe au gouvernement du socialiste Pedro Sanchez) et le PC français seront absents du Parlement européen et AKEL à Chypre recule. Podemos, qui est sorti du gouvernement de Pedro Sanchez et de Sumar en 2023, sur une ligne gauche a obtenu 2 sièges (alors qu'en 2019, il en avait 5). Anticapitalistas, qui avait un siège, ne s'est pas représenté. Die Linke obtient seulement 2,7% des voix et perd 2 sièges, il passe de 5 parlementaires à 3, ayant souffert d'une scission organisée par une de ses anciennes dirigeantes qui a créé un mouvement qui porte son nom : le Rassemblement Sarah Wagenknecht (Bündnis Sahra Wagenknecht).
Ce nouveau parti, qui a obtenu 6,2% des votes (près de deux millions de voix) et 6 europarlementaires du premier coup, ne fera probablement pas partie de The Left. Affaire à suivre. Le Rassemblement Sarah Wagenknecht a obtenu d'importants résultats sur le territoire de l'ex-Allemagne de l'Est obtenant parfois 15% des voix et arrivant en troisième place derrière le parti d'extrême-droite AFD et le parti de Usurla von der Leyen CDU/CSU, membre du PPE. Il n'exclut de faire un accord avec ce parti (et le parti socialiste SPD) pour gouverner des provinces de l'Est et ainsi éviter que l'AFD n'arrive au gouvernement. Le nouveau parti de Sarah Wagenknecht a gagné des voix au détriment du parti social-démocrate du chancelier Scholtz, de Die Linke, de l'AFD, des Libéraux, des Verts et de la CDU-CSU. Selon Reuters, dans l'ordre, cela donne 500 000 venues du SPD, 400 000 venues de Die Linke et 140 000 de l'AFD. Sarah Wagenknecht et son parti ont adopté une position favorable au contrôle des flux migratoires, le refus d'envoyer des armes pour soutenir l'Ukraine envahie par la Russie et la nécessité de l'ouverture de négociations pour mettre fin à la guerre,… Ils ne se prononcent pas pour des mesures anticapitalistes. La question de l'environnement occupe une place marginale dans le programme, de même que la question des droits des LGBTQI+. On ne peut dès lors pas mettre ce nouveau parti dans la catégorie des partis de gauche radicale mais ce serait une erreur de le ranger dans la droite. Son programme fait penser d'une certaine manière au programme des Parti Communistes des années 1960-1970 (comme le Parti communiste français) : une importante dose de protectionnisme pour défendre les acquis sociaux, une recherche d'une alliance avec les classes moyennes, les chefs d'entreprise qui investissent dans la production nationale et créent des emplois, contre le grand capital globalisé, internationalisé et monopoliste. Une ligne anti-monopoliste plutôt qu'anticapitaliste. Il faudra suivre de près son évolution sans diaboliser le Rassemblement Sarah Wagenknecht tout en critiquant et en débattant sur tous les points qui exigent une orientation claire de gauche radicale, internationaliste, écologiste socialiste et féministe.
Parmi les succès de partis ou de listes qui font partie de The Left, il faut signaler les bons résultats du PTB (Parti du Travail de Belgique) en Belgique, parti d'origine maoïste et stalinienne ayant renoncé publiquement à ces références depuis une vingtaine d'années (4). Dans la partie flamande du pays, le PTB a doublé ses voix pour atteindre 8,2 % et obtenir son premier parlementaire européen élu dans le collège flamand. Dans la région francophone (Wallonie et Bruxelles francophone), il a obtenu 15,4 % et maintient un europarlementaire. Pendant que se déroulaient les élections européennes, avaient également lieu les élections fédérales et régionales. Pour les élections au parlement flamand, le PTB a obtenu 8,3%, en forte hausse. En Wallonie, le PTB a connu un léger tassement et a obtenu 12,1% (-1,5% par rapport à 2019) et à Bruxelles francophone, le PTB a progressé et a obtenu 21 % (alors que le PS obtient 22%). Dans certaines municipalités du cœur populaire de Bruxelles, le PTB dépasse 25% des voix comme à Anderlecht (28%), à Molenbeek (27%), ou à Bruxelles ville (26%). A Liège centre, il obtient 16,5%, dans la banlieue industrielle de Liège, à Herstal, le PTB obtient 24,3%. À Charleroi, il obtient 20%. Le PTB a une orientation de gauche radicale et est internationaliste mais évite de proposer des mesures anti-capitalistes.
A noter qu'il y avait également une liste Anticapitaliste (IV Internationale) qui se présentait en Belgique francophone aux élections européennes. En Wallonie, elle a obtenu 2,5%.
La bonne surprise vient d'Italie où la liste de l'Alliance Verte et Gauche a obtenu 6,8% des voix et a gagné 5 sièges de parlementaires européens, passant de 1 siège à 6. 2 des 6 sièges vont renforcer The Left, 3 reviennent au groupe des Verts européens et 1 siège fait partie de la catégorie des non inscrit·es.
L'Italienne Ilaria Salis, enseignante de 39 ans, détenue en Hongrie parce qu'accusée de violences contre des néofascistes lors d'une manifestation antifa début 2022. Elle a été arrêtée début 2023 à Budapest et emprisonnée depuis lors et risquait une condamnation qui pouvait aller jusqu'à 24 ans de prison. Elle était candidate sur la liste d'Alleanza Verdi e Sinistra, et a été élue au parlement européen et en conséquence elle a été libérée. C'est une très bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'un maire italien Mimmo Lucano qui avait été menacé de prison par le gouvernement de Matteo Salvini en 2019 pour avoir autorisé l'arrivée d'un bateau de migrants dans le port de sa petite ville Riacea lui aussi été élu au parlement européen sur la même liste qu'Ilaria Salis.
Miguel Urban, eurodéputé sortant, a grandement raison dans sa réflexion sur la crise de la gauche. J'y adhère sans restriction et je reprends une longue citation d'un de ses articles récents :
« Alors que l'extrême droite semble se développer partout en Europe, la gauche reste bloquée dans une crise existentielle en tant que plus petit groupe au Parlement européen, et doit se demander ce qu'elle a fait de mal pour que l'extrême droite soit perçue comme l'expression d'un malaise et un vecteur de protestation électorale. Pourquoi la gauche a-t-elle cessé d'être un outil de fédération du mécontentement et de la contestation, de protestation de l'establishment, de l'illusion de ceux et celles qui sont au bas de l'échelle ? Et, surtout, comment pouvons-nous le redevenir ?
Parce qu'il y a tout juste dix ans, la coalition de gauche radicale SYRIZA remportait les élections européennes de juin 2014 en Grèce, précurseur de sa victoire, un an plus tard, aux élections législatives, prenant, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le contrôle d'un gouvernement d'un pays de l'UE par une force située à la gauche des sociaux-démocrates. Il y a seulement dix ans, une nouvelle force politique, Podemos, a fait irruption au Parlement européen et, en un peu plus d'un an, a presque réussi à dépasser le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) avec plus de cinq millions et 21 % des voix.
Avec quelques années de recul, on ne peut s'empêcher de rappeler la thèse classique de Walter Benjamin : « Chaque montée du fascisme témoigne de l'échec d'une révolution ». Une affirmation qui, si on l'extrapole de son sens littéral, est toujours d'actualité pour comprendre comment la montée du néolibéralisme autoritaire et/ou de l'extrême droite, n'est pas exclusivement, mais aussi liée aux faiblesses actuelles de la gauche. Une thèse utile pour garder à l'esprit les risques de modération des gouvernements de gauche et leur incapacité à répondre aux attentes de changement des classes populaires, comme cela s'est produit avec Syriza en Grèce ou comme cela se produit en Espagne avec le PSOE et Sumar. Car lorsque les attentes sont déçues, l'insatisfaction et la frustration apparaissent, et la logique du « c'est impossible », du « ils sont tous les mêmes », de l'anti-politique néolibérale qui alimente les passions sombres sur lesquelles se construit l'internationale réactionnaire, l'emporte.
La majorité de la gauche institutionnelle européenne n'a pas encore tiré les leçons de la défaite de l'expérience du gouvernement Syriza, des limites d'un projet réformiste dans un contexte de crise de régime où il n'y a pas de place pour les réformes, et du rôle joué par l'UE en tant qu'expression concentrée du constitutionnalisme de marché néolibéral où l'ensemble des soi-disant règles de l'UE prévaut sur le droit des États nationaux et donc sur la souveraineté populaire. L'expérience du premier gouvernement Syriza, le référendum contre l'austérité en juillet 2015 et l'imposition du mémorandum d'austérité par la Troïka l'ont clairement démontré.
En fin de compte, si la gauche n'offre pas d'alternatives au désordre, à la crise climatique, à l'insécurité sociale, à la gestion des migrations et aux inégalités croissantes, ces espaces seront occupés par l'extrême droite dans une perspective d'exclusion, de punitivisme et de criminalisation de ceux qui sont différents. La gauche doit comprendre le moment de crise du régime capitaliste dans lequel nous nous trouvons, qui génère un mécontentement croissant parmi de plus en plus de secteurs sociaux. A de nombreuses occasions, la gauche est considérée comme faisant partie du système et donc du problème.
Il ne fait aucun doute qu'en temps de crise comme aujourd'hui, la gauche doit se repenser, une tâche qui, en aucun cas, ne peut la conduire sur une voie très dangereuse, une tendance à une certaine fascination pour les questions soulevées par l'extrême droite : protectionnisme, souveraineté d'exclusion et politiques anti-immigration. Souvent, en n'abordant pas ces problèmes dans le cadre de la reconstruction d'un projet basé sur l'auto-organisation autonome de la classe ouvrière, aux aspirations hégémoniques et porteur d'une proposition de société écosocialiste et féministe, il peut sembler que l'on cherche à « contester » les propositions de l'extrême droite, dans un de ces exercices sans lendemain consistant à mimer l'adversaire pour lui « voler » ses succès. Cette tactique peut fonctionner pour la droite lorsqu'elle copie les aspects les plus superficiels de la gauche, mais elle conduit la gauche à l'impuissance totale et à l'autodestruction ». (Fin du long extrait de l'article de Miguel Urban à paraître dans sa version intégrale prochainement)
Conclusions
La Commission, le Conseil et la BCE vont augmenter la pression pour aggraver le tour de vis qui sera donné aux dépenses sociales par les gouvernements des pays de l'UE
L'orientation à droite des institutions qui gouvernent l'UE va être nettement accentuée. La Commission, le Conseil et la BCE vont augmenter la pression pour aggraver le tour de vis qui sera donné aux dépenses sociales par les gouvernements des pays de l'UE. La dette publique, qui a fortement augmenté, va servir d'argument pour imposer des politiques austéritaires de plus en plus fortes. Dans la bataille des idées, il faudra expliquer que les gouvernements, la Commission et la BCE ont voulu une augmentation de la dette publique pour financer les dépenses face à la pandémie de coronavirus et à la crise économico sociale qui a été amplifiée par celle-ci. Les dirigeant·es européens et les gouvernements nationaux n'ont pas voulu taxer les super profits des grandes entreprises pharmaceutiques – en particulier celles produisant des vaccins – qui se sont scandaleusement enrichies sur le dos de la société. De même que les entreprises de distribution – en particulier celles spécialisées dans les ventes en ligne et dans les services informatiques – qui ont fait d'énormes bénéfices. Ensuite, quand les prix du gaz a explosé dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les gouvernements n'ont pas voulu contrôler les prix de l'énergie et les geler, ce qui a permis aux entreprises spécialisées dans les combustibles fossiles et celle productrices d'énergie de faire à leur tour d'énormes profits sur le dos de la société. Enfin, quand les prix des aliments ont explosé suite à la guerre en Ukraine et à laspéculation sur les céréales, les entreprises céréalières ont fait des super profits. Tout comme les grandes chaînes de distribution qui ont augmenté le prix des aliments au détail de manière disproportionnée et abusive, provoquant une hausse très forte de l'inflation et une perte du pouvoir d'achat des classes populaires. Les gouvernements ont refusé de taxer de manière extraordinaire leurs bénéfices. Les entreprises de productions d'armes voient également leurs bénéfices augmenter grâce à la guerre en Ukraine et au Proche-Orient.
Dans cette situation et avec cette posture de refus de faire des prélèvements sur les entreprises qui profitaient de la crise et sur les plus riches, les États ont eu de plus en plus recours au financement par l'endettement au lieu de se financer via des recettes fiscales, sauf celles provenant des impôts indirects sur la consommation (Taxe sur la valeur ajoutée – TVA) qui sont particulièrement négatifs pour la grande majorité de la population et en particulier les secteurs aux revenus les plus bas.
Dans la bataille des idées, il faudra montrer qu'une grande partie de la dette publique est en conséquence illégitime et qu'elle doit être auditée et annulée.
La politique des dirigeant·es européen·nes et des gouvernements nationaux en matière migratoire va également être durcie et les atteintes portées aux droits humains vont augmenter. Les violations de ces droits vont se multiplier alors qu'elles sont dénoncées par laCour européenne des droits de l'homme et les associations de défenses des droits humains.
L'inaction climatique des gouvernements et des institutions européennes va aussi s'approfondir.
Le réarmement va s'accélérer.
Les discours d'extrême-droite et les politiques qui leur sont favorables risquent de continuer à se répandre.
En conséquence, la lutte anti fasciste et les actions de protestation contre la montée de l'extrême-droite prendront de plus en plus d'importance.
Les mouvements sociaux et les partis politiques de gauche doivent reprendre l'initiative sur un programme résolu de rupture avec le capitalisme et avec une pratique non moins résolument unitaire.
L'auteur remercie Peter Wahl, Angela Klein, Roland Kulke, Fiona Dove, Thies Gleiss, Gerhard Klas, Manuel Kellner, Tord Björk, Raffaella Bollini, Franco Turigliatto, Gigi Malabarba, Miguel Urban, Alex De Jong, Roberto Firenze, Gippo Mugandu, Roland Zarzycki qui ont bien voulu répondre à ses questions concernant les résultats des élections européennes. Merci à Maxime Perriot pour sa relecture. L'auteur est seul responsable des opinions émises dans cet article et des erreurs qu'il contient éventuellement.
Publié par le CADTM le 24 juin 2024.
1. Outre la Belgique, c'est le cas de la Bulgarie, de la Grèce et du Luxembourg.
2. Miguel Urban, « Qui sème des politiques d'extrême droite... récolte des politiques d'extrême droite », publié le 17 juin 2024.
3. Les 4 eurodéputé-es sont Marion Maréchal qui est encore plus à droite que sa tante Marine Le Pen. Les 3 autres sont Guillaume Peltier ainsi que Laurence Trochu, qui a quitté Reconquête pour former un nouveau parti conservateur avec Nicolas Bay.
4. Au début des années 1980, le PTB dénonçait le social impérialisme soviétique comme aussi dangereux que l'impérialisme des Etats-Unis, il dénonçait Cuba comme le bras armé du social-impérialisme soviétique opérant notamment en Angola. En mai 1989, le PTB a soutenu la répression par les autorités chinoises contre l'occupation de la place Tienanmen. Des auteurs du PTB affirmaient que les procès de Moscou des années 1930 étaient justifiés et n'avaient pas été assez loin dans l'épuration des éléments traitres à la cause communiste. Le PTB a essayé de reconstruire le mouvement communiste international en collaboration puis en concurrence avec le Parti Communiste philippin de Jo Maria Sison et de Sentier Lumineux d'Abismael Guzman. Son virage date des années 2000. Il garde une référence marxiste-léniniste.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Rassemblement national comme mouvement néo-fasciste

Le RN, en tant que héritier du Front National de Jean-Marie Le Pen a gardé certains aspects essentiels de celui-ci, qui plonge ses racines dans le régime de Vichy et la collaboration.
Michael Lowy, directeur de recherche émérite au CNRS.
5 juillet 2024 | blogue de l'auteur
Comme plusieurs autres partis européens – Fratelli d'Italia, l'AFD en Allemagne, etc - le Rassemblement national peut être defini comme un mouvement de type néo-fasciste. Le préfixe neo signifie qu'il ne s'agit pas d'un phenomène identique aux fascismes des années 1930 ou 1940. L'histoire ne se répète pas : les phénomènes actuels sont assez différents des modèles du passé. Surtout, nous n'avons pas – encore – des Etats totalitaires comparables à ceux d'avant-guerre. L'analyse marxiste classique du fascisme le définissait comme une réaction du grand capital, avec le soutien de la petite-bourgeoise, face à une menace révolutionnaire du mouvement ouvrier. On peut s'interroger si cette interprétation rend vraiment compte de l'essor du fascisme en Italie, Allemagne et Espagne, dans les années 20 et 30. En tout cas, elle n'est pas pertinente dans le monde actuel, ou l'on ne voit, nulle part, de “menace revolutionnaire ».
Les gouvernements ou partis de type néo-fasciste actuels se distinguent radicalement de ceux des années 1930, qui étaient national-corporatistes du point de vue économique, par leur néo-libéralisme extrême. Ils n'ont pas, comme dans le passé, des puissants partis de masses et des sections d'assaut uniformisées. Et ils n'ont pas la possibilité, au moins jusqu'à maintenant, de supprimer totalement la démocratie et créer un Etat totalitaire.
Le RN, en tant que héritier du Front National de Jean-Marie Le Pen, a gardé certains aspects essentiels de celui-ci, qui plonge ses racines dans le régime de Vichy et la collaboration. Quels sont les principaux éléments de continuité ?
- Tout d'abord le racisme, la haine des non-blancs, des non-européens, des immigrés et de leurs descendants. Malgré les efforts de ravalement de la façade, l'anti-sémitisme continue à faire partie du DNA de ce mouvement. Chassez le naturel, il revient par la fenêtre : on l'a vu souvent dans des déclarations de tel ou tel candidat adoubé par le RN. D'ailleurs, Jordan Bardella lui-même a expliqué que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite…Mais c'est sans doute le racisme anti-arabe, anti-noir, et l'islamophobie qui occupent la place centrale du discours du RN.
- Le nationalisme « biologique », fondé sur le « droit du sang ». D'où la proposition d'abolir le droit du sol, comme l'avait fait le Marechal Petain. D'où la « Préférence nationale », d'où sont exclus les immigrants, les bi-nationaux et autres racisés.
- Le « securitarisme », le tout pouvoir et l'impunité aux « forces de l'ordre », la criminalisation des mouvements sociaux, la répression comme seule réponse aux problèmes sociaux des quartiers populaires. Sous Macron/Darmanin ce tournant sécuritaire a déjà été amorcé. Sous le RN on risque de basculer dans un Etat policier beaucoup plus violent.
- La mise au pas des medias, des Universités, des Centres de Recherche, au nom de la lutte contre le « wokisme ». Ici aussi Macron/Darmanin ont preparé le terrain, mais avec un gouvernement RN la repression de toute pensée critique serait beaucoup plus radicale et systématique.
- Le RN n'a pas, comme ses ancêtres fascistes, des milices uniformisées et armées. Mais il entretien des liens étroits avec des groupuscules violents, suprémacistes blancs ou néo-nazis. Après la spectaculaire montée du RN au premier tour des élections législatives, les agressions racistes ou contre des militants de gauche se sont intensifiées dans toute la France. On peut facilement imaginer ce qui arriverait en cas de victoire du RN au deuxième tour et formation d'un gouvernement présidé par Bardella.
- Un aspect nouveau, qu'on ne trouvait pas dans les fascismes anciens, parce que la question ne se posait pas encore : le RN - comme ses équivalents dans d'autres pays (Trump, Bolsonaro) - est systématiquement hostile à toute mesure écologique, presentée comme « punitive ». Le changement climatique ne l'interesse pas et on peut compter sur lui pour reprimer brutalement tout mouvement écologique.
La difference entre le néo-libéralisme autoritaire de Macron/Darmanin et le néo-fascisme n'est pas de degré mais qualitative. Ce sont deux régimes de nature sociale et politique distincte. Un régime néo-fasciste viderait la république démocratique de tout contenu, en gardant ses aparences extérieures.
7 juillet 2024 : la seule alternative au néo-fascisme est, comme en France et en Espagne en 1936, le Nouveau Front Populaire. Il est encore temps pour éviter le pire. No Pasaran !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Démocratie ressentie, dictature réelle

Début juin dernier, Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée Nationale et la tenue d'élections législatives dans un délai excessivement court (trois semaines). Espérant jeter une “grenade dégoupillée” dans les jambes de ses adversaires, comme il le disait lui-même, le vent lui a ramené dans la tronche puisque non seulement son parti a perdu lamentablement ces élections, arrivant troisième en nombre de voix, mais en plus ce n'est pas son adversaire préféré, le RN, qui l'a finalement emporté, mais l'union de la gauche. Un mois après la dénouement de ce scrutin – la majorité relative du Nouveau Front Populaire – rien n'a changé : le gouvernement nommé par Macron est toujours au pouvoir. Il s'agit ni plus ni moins d'un coup d'Etat, ou plutôt d'un auto-Coup d'Etat : lorsque les personnes au pouvoir décident de ne plus jamais le rendre. Cette réalité est cependant totalement ignorée par la majeure partie des médias et peine à s'imposer dans le débat public. Comment est-ce possible ?
6 Août 2024 | Édito | tiré du site de Frustrations
https://www.frustrationmagazine.fr/democratie-coup-d-etat/
“Quand l'extrême-droite obtient le pouvoir, elle ne le rend jamais”. Cette phrase est devenue un cliché de l'analyse journalistique et intellectuelle du risque RN au cours de cette année. Historiquement, elle est erronée : il y a des régimes d'extrême-droite qui ont fini par rendre le pouvoir (le régime de Pinochet au Chili a mis en place un référendum qui a mis fin au régime, par exemple ; le premier mandat de Trump s'est terminé – tant bien que mal) et il y a des régimes non labellisés extrême-droite qui ont tout fait pour le garder (les régimes dit communistes mais aussi les deux Bonaparte en France, par exemple). Surtout, comme beaucoup d'inquiétudes portant exclusivement sur le RN, cette phrase s'applique désormais pleinement au régime macroniste, qui s'est toujours présenté comme le seul rempart contre l'extrême-droite. Ainsi, Macron ne veut pas rendre le pouvoir, ou du moins le partager.
Le message des Français a été limpide : deux ans après une élection présidentielle où ils ont joué le jeu du “barrage” en choisissant Macron contre Le Pen, ils ne veulent plus de gouvernement pour le premier.
Tout d'abord, il refuse de nommer la candidate de gauche au poste de Premier ministre. Ensuite, il a transformé le résultat des élections en décrétant, lors de sa dernière allocution télévisée, qu'il n'y avait pas de gagnant. Il y a une part de vérité dans cette déclaration : en nombre de voix, le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National font jeu égal. Mais en nombre de sièges, le premier est nettement en tête grâce à la mise en place d'un cordon sanitaire anti-RN au second tour des élections législatives, ce qui ne le rend pas moins légitime : ce sont les règles du jeu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un perdant, et Macron feint de l'ignorer : lui, son parti, son gouvernement. Le message des Français a été limpide : deux ans après une élection présidentielle où ils ont joué le jeu du “barrage” en choisissant Macron contre Le Pen, ils ne veulent plus de gouvernement pour le premier.
Et pourtant, le gouvernement reste. Pire, il continue de prendre des décisions qui affectent la vie des gens alors qu'ils n'ont plus de légitimité démocratique pour le faire : législation du droit du travail, taux d'intérêts du livret A, politique sécuritaire, budget, apparitions publiques et tentative de récupération des Jeux Olympiques de Paris : nous n'avons pas à faire un gouvernement “démissionnaire”, comme la presse mainstream le dit pour tenter de masquer le scandale, mais bien à un gouvernement qui reste en place malgré une défaite électorale.
Les défenseurs du putsch présidentiel s'appuient scolairement sur la constitution : ce texte conçu par les partisans de l'autoritaire Charles de Gaulle (qui jouit d'une aura de prestige avec le recul mais qui n'avait rien d'un démocrate) ne prévoit pas de règle stricte pour la nomination d'un gouvernement. C'est le président de la République qui nomme le premier ministre. Et seul l'usage veut qu'il le fasse parmi le groupe politique victorieux aux élections législatives, ce qu'il s'est produit lors de toutes les précédentes cohabitations. Usage que Macron piétine allègrement. En termes de légitimité démocratique, on ne voit pas bien au nom de quoi un gouvernement macroniste pourrait se maintenir après une défaite électorale et sans être capable, à ce jour, de produire la moindre majorité alternative à celle du NFP.
Le journal Le Monde expose le plan de Macron sans s'en émouvoir, alors qu'il y aurait pourtant matière : mais dès les premières lignes de l'article, on sent que les journalistes n'ont pas particulièrement le seum de voir un président conserver à tout prix le pouvoir : “Emmanuel Macron est parti prendre l'air de la mer. Quoi de mieux que de laisser son regard filer sur l'horizon pour réfléchir, seul, à la fin de son quinquennat ?”. On suppose que ce genre de lyrisme béat devait être utilisé par les journalistes de la Pravda quand il s'agissait de parler des réflexions profondes de Staline ou de ceux de la presse collabo pour parler des décisions du Maréchal Pétain.
Macron “laisse son regard filer sur l'horizon pour réfléchir, seul.”
En bon SAV zélé d'un déni de démocratie, Le Monde tente de nous rassurer : le chef de l'Etat aurait admis sa défaite, et “cet aveu conduit le président de la République à imaginer le profil du nouveau chef du gouvernement comme un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite tout en offrant, affirme l'Elysée, « un parfum de cohabitation »”. On se demande bien pourquoi parler “d'aveu”, comme si le président se rabaissait, pour nos beaux yeux, à accepter la réalité électorale, mais tout l'article du Monde respire ce vocabulaire monarchiste, où tous les choix du président sont présentés comme des concessions qu'il daigne accorder à la populace.
Ses riches soutiens ne supporteraient pas la moindre avancée en terme de justice fiscale et sociale. Le 25 juillet, le président a même organisé un dîner avec les plus riches patrons du monde pour leur assurer que rien ne changerait.
Mais attention, prévient le chef de l'Etat et Le Monde en écho : “L'Elysée s'agace de la posture jugée vindicative de la trentenaire (Lucie Castets, la candidate du NFP au poste de première ministre) qui entend appliquer le programme du NFP, comprenant le rétablissement de l'impôt sur la fortune ou l'abrogation de la réforme des retraites. « L'urgence du pays n'est pas de détruire ce qu'on vient de faire, mais de bâtir et d'avancer », a cinglé, le 23 juillet, le chef de l'Etat.” Macron prévoit plutôt que son prochain premier ministre fantoche respecte un “pacte”, qui tient “sur cinq pages”, nous informe Le Monde (c'est-à-dire pas beaucoup plus que son programme complètement creux de 2017) et qui “propose une série de dispositifs – pour le respect de la laïcité, la défense du pouvoir d'achat, la justice fiscale, la défense des services publics, l'écologie ou le renforcement de la sécurité – en proposant des mesures dans la droite la ligne de celles pensées par le gouvernement précédent (réforme de l'assurance-chômage, lutte contre les discriminations, mesures contre la délinquance des mineurs…) en y ajoutant quelques innovations (référendum tous les ans pour réfléchir aux institutions).”
En lisant ces lignes, on se demande si pour pouvoir les écrire sans rire, la mention “serpillère” est requise sur sa carte de presse ? Car oser écrire “référendum tous les ans pour réfléchir aux institutions”, alors qu'un référendum est fait pour décider, pas pour réfléchir, et que Macron a déjà battu le record de fausses consultations bidons depuis 2018 sans rajouter “LOL”, c'est vraiment le stade Swiffer du journalisme politique. Un tapis de bain Ikea aurait été plus critique, vraiment.
Sans avoir besoin de lire loin entre les lignes, les choses sont plutôt claires : malgré sa défaite à plate couture, Macron ne veut rien changer à la politique menée depuis 2017. Ses riches soutiens ne supporteraient pas la moindre avancée en termes de justice fiscale et sociale. Le 25 juillet, le président a même organisé un dîner avec les plus riches patrons du monde pour leur assurer que rien ne changerait.
Oser écrire “référendum tous les ans pour réfléchir aux institutions”, alors qu'un référendum est fait pour décider, pas pour réfléchir, et que Macron a déjà battu le record de fausses consultations bidons depuis 2018 sans rajouter “LOL”, c'est vraiment le stade Swiffer du journalisme politique.
En 2015, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker disait au nouveau gouvernement grec, alors très à gauche, “il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens”. Macron a en fait donné aux patrons reçus à l'Elysée un message similaire “il n'y a pas de choix démocratique contre l'intérêt économique des grandes fortunes”. Depuis le début, la gauche n'était pas une option : dans le régime autoritaire français, les citoyens ont le choix entre la droite et l'extrême-droite. Le reste, c'est du “hors-jeu”.
Il doit maintenant s'assurer que ses règles soient respectées et prend donc le temps de chercher cette personne consensuelle (parmi la classe politique hors gauche) pour nous “offrir”, accrochez-vous, un “parfum de cohabitation”. Car c'est à ça que nous allons avoir droit, désormais : une apparence de respect de ces élections, un parfum de concession de la part du pouvoir, bref une démocratie “ressentie”, comme il y a la température réelle et la température ressentie.
“La température ressentie, explique Météo France, est différente de la température de l'air, elle correspond à la sensation de froid ou de chaleur ressentie par une personne. Cet indice dépend de conditions météorologiques, mais aussi de facteurs personnels tels que les vêtements portés, le type d'activité pratiquée et l'acclimatation à un certain milieu.”
L'équation est donc, pour l'Elysée et les journalistes de la presse milliardaire qui le soutient, la suivante : comment faire en sorte de modifier notre sensation de démocratie au milieu d'un authentique virage dictatorial ? Quels vêtements porter pour nous faire croire à cette mascarade ? Quel type d'activité pratiquer pour parfaire l'illusion ?
Cette dernière question a trouvé sa réponse, ces derniers jours : Macron s'empresse d'aller embrasser, serrer, sécher les larmes, et pousser les enfants des champions olympiques pour espérer sans doute obtenir, par contamination, un peu de leur popularité. Il espère que la “trêve olympique” qu'il a lui-même décrétée fonctionne pour masquer la réalité de ce qu'il vient de se produire : un auto-Coup d'Etat, un putsch du garant constitutionnel des institutions démocratiques contre ses propres institutions.
Pour cela, il peut compter sur les médias mainstream : les Jeux Olympiques fonctionnent comme un véritable piège à guêpe pour des journalistes majoritairement parisiens qui rivalisent d'enthousiasme pour décrire leur bonheur de vivre dans une capitale devenue parc à jeuxpour bourgeois petits et grands. En ce moment, ils n'ont pas le temps de parler du Coup d'Etat : le summum de leurs investigations consiste à se demander si leurs copains parisiens qui ont quitté la ville pour éviter le chaos des JO le regrettent maintenant, krkrkr.
Journalisme d'investigation en temps de régime autoritaire
Paris, devenu immense bac à sable à riches, délesté de 12 000 sans-abri qui gâchaient la vue à cette classe qui n'aime rien de mieux que de vivre dans une fiction autoproduite, leur procure une joie intense qu'ils labellisent “populaire” parce qu'il est question de sport et, qu'on le sait, “le sport c'est populaire”.
S'il est une règle intangible du journalisme en régime bourgeois, c'est que les membres de cette corporation sont nettement plus prompts à qualifier de dictature les régimes qui se situent hors de leurs frontières.
Le bon réflexe à avoir, quand on vit dans un régime autoritaire, est d'aller voir ce que dit la presse étrangère de notre pays. Car s'il est une règle intangible du journalisme en régime bourgeois, c'est que les membres de cette corporation sont nettement plus prompts à qualifier de dictature les régimes qui se situent hors de leurs frontières. C'est logique : ils ont moins peur de vexer leur classe politique ou leurs milliardaires. Comme l'ont relevé nos confrères de Contre Attaque, le journal allemand centriste Die Zeit dit par exemple les termes : « Mais qui commande désormais, lors des Jeux Olympiques, qui sont regardés par des milliards de personnes à travers le monde ? Qui commande la police dans les stades ? Qui donne d'innombrables interviews en tant que ministre des Sports ? Qui, en tant que Premier ministre, a commenté les actes de sabotage massifs sur le réseau ferroviaire français ? C'est l'ancien gouvernement. La faction qui a reçu le moins de voix parmi les trois principaux blocs politiques au premier et au deuxième tour des élections législatives. » Tandis que le New York Times s'inquiète des germes d'une dérive autocratique (l'euphémisme reste de mise).
Les Jeux Olympiques ne dureront pas éternellement : la “magie” tant vantée par la presse bourgeoise, et qui consiste donc à faire disparaître les pauvres d'un coup de baguette et lancer un sort d'oubli contre le putsch de leur chef d'Etat préféré, va disparaître. Bientôt, comme à l'automne 2018, Macron et ses fans vont se retrouver nus et seuls face à la colère populaire. Ils ne pourront plus faire grand chose pour que leur déni décomplexé de démocratie n'apparaisse au grand jour. Nul doute qu'alors, à Paris comme ailleurs, la température ressentie par Macron et ses sbires augmentera sensiblement.
Nicolas Framont
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’horreur au cœur de la farce. Sur les émeutes racistes au Royaume-Uni

Depuis une dizaine de jours, plusieurs villes du Royaume-Uni sont le théâtre d'émeutes racistes qui ciblent les mosquées, les commerces tenus par des musulmans et les lieux d'accueil de réfugié·es. Ces émeutes ont commencé après le meurtre, le 29 juillet, de trois jeunes filles dans la ville côtière de Southport et la diffusion de fausses informations attribuant le crime à un migrant musulman.
8 août 2024 | trié du site de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/emeutes-racistes-royaume-uni/
S'il existe outre-Manche une longue tradition d'émeutes racistes et d'action de rue de l'extrême droite, ces émeutes ont pourtant surpris et inquiété à plusieurs titres. Tout d'abord par leur ampleur, leur durée et le niveau de violence à l'encontre de personnes et de biens. Ensuite, par la relative faiblesse, dans un premier temps, de la riposte antiraciste, même si les mobilisations du 7 août semblent indiquer une inversion de tendance. Enfin, et peut-être surtout, parce que, contrairement à la version véhiculée par les médias (britanniques ou autres), mais aussi par certains canaux militants, ces émeutes ne se réduisent pas à la mobilisation des groupes d'extrême droite, en particulier la constellation issue de la English Defence League de Tommy Robinson (active de 2009 au milieu des années 2010) – même si ceux-ci sont présents et totalement hégémoniques sur le plan politique.
Dans ce texte, Richard Seymour, fondateur de la revue Salvage et auteur de nombreux essais sur la politique britannique, l'extrême droite contemporaine et le nationalisme, analyse la spécificité de ces émeutes et le contexte politique et idéologique qui les a rendues possibles. Il souligne le rôle des affects racistes et islamophobes dans une mobilisation qui déborde largement l'extrême droite organisée mais dont celle-ci est la première bénéficiaire.
*
La Grande-Bretagne rêve de sa propre chute. En l'espace de quelques jours, le pays a été plongé dans deux séquences de réactions hallucinées, basées sur de fausses suppositions concernant l'identité d'une personne. Dans le cas de la victoire de la boxeuse algérienne Imane Khelif sur l'Italienne Angela Carini, le réseau réactionnaire autour de Mumsnet [forum de discussion en ligne entre parents] a décidé que Khelif était une intruse masculine dans un espace réservé aux femmes. La ministre britannique de la culture, Lisa Nandy, a déclaré se sentir « mal à l'aise » à propos du match et a vaguement évoqué les complexités de la biologie. Même certaines personnes de gauche crédules se sont laissées entraîner dans ces fureurs.
Plus inquiétant encore, en réponse à une terrifiante attaque au couteau à l'encontre de onze enfants et de deux adultes lors d'un cours de danse sur le thème de Taylor Swift à Southport, au cours de laquelle trois de ces enfants ont été tués, des milliers de personnes à travers le Royaume-Uni ont supposé que le suspect était un migrant arrivé par un « small boat » [embarcation de fortune avec laquelle les migrant·es traversent la Manche] et qu'il figurait sur une « liste de personnes sous surveillance du MI6 » [service de renseignements britannique]. Le suspect étant âgé de moins de dix-huit ans, son identité n'a pas été rendue publique dans un premier temps. En moins de 24 heures, les rumeurs provenant des comptes habituels de désinformation de la droite se sont propagées, amplifiées par Tommy Robinson [ancien dirigeant de la English Defence League] et Andrew Tate [figure de l'extrême droite sur les réseaux sociaux], et largement diffusées par des comptes basés aux États-Unis.
Ce schéma de vagues convergentes d'agitation en ligne qui culminent vers des points de ralliement momentanés pour la droite est typique du fonctionnement des réseaux sociaux. Mais après des années de guerre culturelle délibérée, pendant lesquelles les conservateurs ont dénoncé une « invasion » de migrant·es et se sont engagés à « arrêter les small boats », et où la presse de droite a déversé un discours anxiogène sur la menace d'une « immigration de masse », après une campagne électorale au cours de laquelle l'opposition travailliste a accusé le gouvernement d'être trop « laxiste » en matière d'immigration et a promis d'intensifier les expulsions, et à la suite d'un grand rassemblement d'extrême droite dans le centre de Londres auquel s'est adressé Tommy Robinson, tout ce merdier s'est répandu dans l'espace réel.
Comme l'émeute raciste de Knowsley l'année dernière, ou les violences de Southport, au cours desquelles des bandes ont attaqué une mosquée locale, les émeutes récentes n'étaient pas dirigées ou organisées par des fascistes, bien que des membres de groupes tels que Patriotic Alternative aient été présents. La majorité des participant·es étaient des personnes racistes non-organisées des communautés locales. Le cycle d'émeutes qui a suivi a touché Whitehall, Hull, Sunderland, Rotherham, Liverpool, Aldershot, Leeds, Middlesborough, Tamworth, Belfast, Bolton, Doncaster et Manchester. À Rotherham, les émeutier·es ont mis le feu à un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile. À Middlesborough, ils ont bloqué des routes et n'ont laissé passer que les conducteurs « blancs » et « Anglais ». À Tamworth, ils ont saccagé des logements pour réfugié·es et les ont couverts de graffitis sur lesquels on pouvait lire : « England », « Fuck Pakis » et « Get Out » [Dehors !]. À Hull, alors que la foule traînait un homme hors de sa voiture pour le battre, les participant·s ont crié « Tuez-les ! » À Belfast, où une femme portant le hijab a été frappée au visage alors qu'elle tenait son bébé, les manifestant·es ont détruit des magasins musulmans et tenté de prendre d'assaut la mosquée locale en scandant « Get them out » [Virez-les !]. À Crosby, près de Liverpool, un musulman a été poignardé.
Les débris de l'extrême droite qui subsistent ont joué un rôle d'organisation, mais celui-ci était secondaire. La plupart des manifestations auxquelles ils ont appelé ont été peu suivies et elles ont été aisément débordées par la riposte antifasciste. À Doncaster, une seule personne s'est présentée à la manifestation prévue. La sinistre réalité est que, loin d'être provoquées par l'extrême droite, les émeutes lui ont fourni sa meilleure occasion de recrutement et de radicalisation depuis des années. Les manifestations ont attiré des foules de grands-mères déboussolées, politiquement aliénées et racistes et des jeunes perméables à l'ambiance du moment, souvent originaires de régions en déclin, dont la plupart sont certainement bien plus mal lotis que les escrocs et millionnaires qui les incitent à agir. Beaucoup n'ont pas voté lors des dernières élections (où le taux d'abstention a atteint un niveau record) ou ont voté pour Reform UK [le parti de Nigel Farage, figure politique de la droite radicale issue du mouvement pro-Brexit] en raison d'un désir ancré depuis longtemps de punir les migrant·es et les rebelles. Tous·tes n'étaient pas là pour participer à des émeutes ou des pogroms, et une partie de la base de l'extrême droite est encore respectueuse de l'ordre public, malgré les récriminations de Nigel Farage au sujet d'un « deux poids, deux mesures en matière de maintien de l'ordre ». C'est pourquoi Tommy Robinson a ressenti le besoin de prendre ses distances avec les émeutes, alors qu'il les avait initialement défendues. Cependant, pour les éléments fascistes présents, et qui savaient ce qu'ils faisaient, le facteur décisif a été la découverte d'une masse critique de jeunes hommes prêts à s'engager dans la voie de la violence.
Comme toujours, parmi ceux qui ont déclaré que les émeutier·es expriment des « préoccupations légitimes » on trouve une fraction du « lumpen-commentariat », incarnée par Carole Malone, Matthew Goodwin, Dan Wootton et Allison Pearson. Il est à noter toutefois que ces « préoccupations » ne portent pas sur les questions de « fins de mois » [bread and butter issues] dont beaucoup à gauche semblent penser qu'elles désamorceront l'agitation raciste : comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, ce n'est pas l'économie qui est ici en cause. Ce que les deux récentes paniques morales ont en commun, c'est l'image coprologique d'un « matériau qui n'est pas à sa place » : des frontières et des barrières qui s'érodent et des gens qui se trouvent là où ils ne devraient pas être. Les « faits » importent peu, comme cela a été prouvé par le fait que les émeutes se sont poursuivies même lorsque la justice a révélé que le suspect était en fait un mineur britannique. Le « fact-checking » ne peut faire disparaître ce phénomène. Il serait instructif de demander à l'un·e de ces émeutier·es « Blanc·hes » ou « Anglais·es » ce qu'il ou elle aurait fait si le suspect avait été Blanc. L'un des arguments de rationalisation des émeutier·es qui prétendent ne pas être racistes est que, comme le suspect a tué des enfants, il n'est pas « vraiment » britannique, car tuer des enfants va à l'encontre des « valeurs britanniques ». Mais même si on suppose que les émeutier·es auraient agi ainsi si un homme blanc avait tué des enfants, qu'auraient-ils ou elles défendu dans ce cas ? Et quelles auraient été leurs cibles ? Le pub Wetherspoons [chaîne de pubs] du coin ?
Il est intéressant de se pencher sur le fonctionnement historique de ces rumeurs. En 1919, à East St Louis, dans l'Illinois, un massacre raciste a été déclenché par la fausse rumeur selon laquelle les Noirs de la ville complotaient pour assassiner et violer des milliers de Blanc·hes. À Orléans, en 1969, des magasins juifs ont été attaqués par des émeutiers enflammés par la rumeur salace selon laquelle des commerçants juifs droguaient leurs clientes et les vendaient comme esclaves. En 2002, l'affirmation infondée selon laquelle des musulmans avaient incendié un train avec des pèlerins hindous à bord a servi de prétexte à un effroyable déchaînement de meurtres et de viols de masse islamophobes. Comme l'a montré Terry Ann Knopf dans son histoire des rumeurs et émeutes racistes aux États-Unis, ces mobilisations fonctionnent précisément en se passant de « critères de preuves », car les détails et les spéculations concernant des événements extraordinaires – réels ou imaginaires – fonctionnent comme des nœuds autour desquels se cristallise un fantasme raciste déjà actif. Dans ces circonstances exceptionnelles, réelles ou supposées, on rejette les sources officielles (seuls les « moutons » font confiance aux « grands médias ») tandis que les « témoins oculaires » ou « experts » non-officiels acquièrent un statut momentanément indiscutable. La distorsion systématique des faits devient une méthode. Ce qui compte, c'est ce que le fantasme autorise, ce qu'il permet de faire. Dans le cas présent, il a permis aux gens de réaliser leurs fantasmes de vengeance.
Et pourtant, ces mouvements dépendent entièrement des sources officielles dont ils se méfient. Après tout, comment se fait-il que la BBC puisse parler d'une de ces manifestations à la sauce Tommy Robinson comme d'une « marche pro-britannique » et qualifier à plusieurs reprises les émeutier·es de « manifestant·es », alors que sur ITV, Zarah Sultana [députée de Coventry et figure de l'aile gauche du parti travailliste] est traitée avec mépris par un panel blanc pour avoir évoqué l'islamophobie et le fait que les présentateurs de l'émission décrivent des musulman.es en position d'autodéfense comme des « personnes masquées criant Allah Akbar » ? Comment se fait-il que, comme en France, les moments les plus « populistes » de l'extrême-centre néolibéral soient ceux où il tente de déborder les fascistes sur la race, l'immigration et la « question musulmane » ? Rien n'est plus impeccablement bourgeois et conformiste à notre époque que la métaphysique raciale de l'extrême droite.
Le cœur vibrant de l'idéologie qui interpelle et rassemble ces foules racistes est l'idée de frontière. L'extrême droite européenne de l'entre-deux-guerres avait une vision coloniale, son utopie se nourrissait de l'idée d'expansion territoriale. L'extrême droite ethnonationaliste d'aujourd'hui est essentiellement sur la défensive, préoccupée par le déclin et la victimisation et, en Europe et en Amérique du Nord, par la perspective de « l'extinction des Blanc·hes ». Pourtant, nombre de ses principales innovations tactiques et idéologiques proviennent non pas des centres historiques d'accumulation du capital mais du Sud : l'événement qui a servi de signe annonciateur n'a pas été le drame régional du Brexit, mais le pogrom du Gujarat. Il est temps, une fois de plus, de provincialiser l'Europe ; cette horrible saga fait, en effet, partie du processus d'auto-provincialisation de l'Europe, alors même que celle-ci lutte pour conserver son pouvoir mondial. Il existe une relation directe entre les frontières sanglantes de la forteresse Europe, son militarisme croissant et le reflux ethno-chauvin. Et il n'y a pas d'exemple plus provincial qu'une « Grande »-Bretagne en déclin qui tente pathétiquement de « jouer dans la cour des Grandes Puissances », alors même qu'elle développe les instruments d'un processus de frontiérisation sadique et s'adresse à ses sujets dans le langage de l'absolutisme ethnique.
Pendant que ces événements nauséabonds se déroulaient en Angleterre, je me trouvais en Irlande, dans un camp d'été écosocialiste à Glendalough. J'ai entendu des militant·es antifascistes qui avaient récemment dû faire face à des troubles similaires, également favorisés par les politicien·nes et les médias bourgeois.
Il semble qu'il y ait trois points communs entre les deux situations.
Le premier était que, tactiquement, lorsqu'on essayait de séparer les fascistes du public raciste qui les suit, il n'est pas utile de parler de « l'extrême droite ». La question du fascisme peut difficilement être évitée, mais il faut parler concrètement de ce que ces gens représentent réellement. Sinon, beaucoup parmi celles et ceux que l'on veut convaincre prendront cela pour de l'intimidation moralisatrice et adopteront même fièrement des termes comme « extrême droite » pour se définir elles et eux-mêmes.
Le deuxième point est qu'en termes d'intervention politique immédiate, il est plus utile d'avoir des comités enracinés dans les communautés locales et capables de réagir rapidement et de défendre les personnes attaquées avec les moyens appropriés que de faire venir des villes des militant·es que personne ne connaît sur place. Nous avons bien sûr besoin de grandes mobilisations, mais elles doivent servir de points de ralliement pour des actions ultérieures.
Enfin, il est absolument inutile de décoder la violence raciste plébéienne comme une expression déformée d'« intérêts matériels » et d'essayer de la contourner en s'organisant sur un autre sujet, comme l'eau ou le logement, car cela ne permet pas de s'attaquer au racisme sous- jacent.
C'est sur ce dernier point que je souhaite conclure. J'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait que nous devons cesser de penser que les questions « de fin de mois » [bread and butter issues : questions de pain et de beurre] résoudront le problème. Le pain et le beurre, c'est bien. Nous l'apprécions tous mais nous ne l'aimons pas. Si vous aimez vos enfants, ce n'est pas parce qu'ils augmentent votre pouvoir d'achat, votre énergie et votre temps libre. Vous les aimez, entre autres, à cause de leurs besoins, à cause des sacrifices que vous devez faire pour eux. Inversement, il n'est pas surprenant que la plupart des gens ne votent pas, la plupart du temps, en fonction de leur portefeuille. L'idée qu'il s'agit d'une pathologie particulière qui ne se manifeste que chez les partisans du Brexit ou les électeurs de Trump est absurde. Ce que nous détestons, ce n'est pas le sacrifice, mais le sentiment écrasant d'humiliation, de défaite et d'échec. Face à cela, nous sommes prêt·es à presque tout pour gagner quelque chose. Il faut revenir à la théorie des passions ou, en termes marxistes, à la relation de l'humanité à son objet.
Plus précisément, dans un contexte qui est celui d'une compétition sociale incessante, d'une inégalité de classe croissante, d'une culture de célébration des gagnant·es et de sadisme envers les perdant·es, et des conséquences psychologiques de plus en plus toxiques de l'échec, nous devons prendre en compte les passions persécutrices et vengeresses sécrétées par le corps social. Plutôt que de blâmer simplement la désinformation, ou de désigner comme bouc-émissaire l'ingérence russe ou le « lobby israélien », nous devons réfléchir à la manière dont les campagnes de désinformation exploitent ces passions incontrôlables et les transforment en armes politiques. Nous devons nous demander comment l'excitation débordante de ces émeutier·es, leur enthousiasme face au spectre de la catastrophe et de l'anéantissement, est en partie une alternative aux affects omniprésents de paralysie et de dépression nés d'une civilisation moribonde.
*
Ce texte est initialement paru le 6 août 2024 sur le blog Patreon de Richard Seymour.
Traduction Contretemps.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En Inde, aux élections le pire a été évité

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a emporté une demi-victoire aux élections législatives qui se sont conclues le 5 juin dernier. Il est réélu pour la troisième fois consécutive, mais il en sort aussi affaibli, alors qu'il espérait renforcer son pouvoir autocratique.
Tiré de Inprecor
24 juin 2024
Par Pierre Rousset
© Prime Minister's Office (GODL-India)
La chambre basse du Parlement indien, la Lok Sabha, comprend 543 sièges. Modi visait une majorité écrasante, comme le proclamait son slogan de campagne : « Ab ki baar, 400 paar » (« cette fois-ci, 400 plus »). Son parti, le BJP, n'en a obtenu que 240 (contre 303 en 2019). L'alliance démocratique nationale (DNA) qu'il dirigeait en a gagné 293, alors que le bloc d'opposition INDIA, constitué par 26 formations politiques, en a emporté 234.
À lui seul, le BJP n'a donc plus la majorité absolue à la chambre basse et il a dû former un gouvernement de coalition avec des partis régionaux. L'affaire est d'importance car Modi voulait une majorité permettant de modifier la Constitution et de mettre en œuvre sans entraves sa politique nationaliste suprémaciste hindoue (Hindutva) à l'encontre des minorités religieuses (musulmanes, chrétiennes), voire de se déifier.
Emblème de la récession démocratique mondiale
Le BJP est une émanation du RSS, un puissant mouvement à caractère fasciste, implanté notamment dans le nord du pays. Ce parti a déjà pris le contrôle de nombreux médias et institutions. Il bénéficie de financements (licites ou illicites) considérables, notamment de la part d'entreprises. Il persécute les opposantEs. La Commission électorale ne dispose de fait que d'une indépendance très limitée, placée sous l'influence du pouvoir… Ainsi, l'Inde a été classée comme une « autocratie électorale » par le projet Varieties of Democracy (V-Dem) et elle occupe la 161e place sur 180 pays concernant la liberté de la presse. Pour l'activiste et analyste Sushovan Dhar, elle est devenue l'un des principaux exemples de la récession démocratique mondiale.
Aujourd'hui, cependant, la rhétorique religieuse de Narendra Modi patine. Comme le relève le journaliste de Mediapart Côme Bastin, le BJP a été battu dans la circonscription d'Ayodhya, là même où le Premier ministre a inauguré sa campagne électorale, là où un temple géant dédié au dieu Ram a été construit sur les décombres d'une mosquée (et là où s'est produit en 1992 un massacre antimusulman).
Inégalités sociales abyssales
Dans une interview accordée à The Conversation, le professeur Sumit Ganguly, de l'université d'Indiana, note avec humour que le BJP n'a pas compris que la « fierté hindoue » ne se mange pas et que, ultimement, c'est le prix des pommes de terre et d'autres produits de première nécessité qui compte dans un pays où seulement 11,3 % des enfants bénéficient d'une alimentation adéquate. Le chômage des jeunes est l'un des plus élevés au monde. Le (réel) développement économique de l'Inde a fait couler beaucoup d'encre, mais il s'accompagne d'inégalités sociales abyssales.
Comme le relève Sushovan Dhar, le BJP gagne des élections dominées par la rhétorique communaliste et chauvine, il les perd quand elles le sont, plus ou moins directement, par des questions de classe.
Malgré ses inconsistances et l'absence de personnalités marquantes pour l'incarner, le bloc d'opposition INDIA a réussi à ébranler l'aura et le sentiment d'invincibilité du Premier ministre. Il n'offre pas une alternative au fond, le parti du Congrès ne remettant pas en cause l'ordre dominant néolibéral. Cependant, le demi-échec de Modi offre un peu de répit aux mouvements sociaux et à la gauche pour se réorganiser et se réorienter.
Publié par L'Anticapitaliste le 20 juin 2024.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le nouveau président iranien Massoud Pezeshkan face à des défis majeurs

Tout comme Keir Starmer (au Royaume-Uni), Massoud Pezeshkian, le nouveau président réformateur de l'Iran, n'a pas fait beaucoup de promesses concrètes lors de sa candidature, d'où son commentaire de cette semaine selon lequel il n'a rien promis qu'il ne puisse tenir. Les 16,4 millions de bulletins de vote – 54,76% des voix sur les 30,5 millions d'électeurs, avec un taux de participation de 49,68%, plus élevé que les 39,93 du premier tour du 28 juin – qu'il a reçus étaient autant contre Saïd Jalili, son rival au second tour des élections présidentielles le 5 juillet, qu'en faveur de ses politiques.
Tiré d'À l'encontre.
Saïd Jalili était considéré comme le successeur de l'ancien président Ebrahim Raïssi [mort accidentellement le 19 mai 2024], ultra-conservateur et très détesté. Il était et reste un opposant au pacte nucléaire de Téhéran de 2015 [Accord de Vienne sur le nucléaire iranien-JCPOA-Joint Comprehensive Plan of Action] avec les grandes puissances, négocié du côté iranien par le ministre des Affaires étrangères de Hassan Rohani [2013-2021], Mohammad Djavad Zarif. Quelques années avant l'accord, Saïd Jalili avait été le principal négociateur sur le nucléaire de l'Iran pendant cinq ans à partir de 2007, une période au cours de laquelle l'Iran a adopté une approche agressive et intransigeante dans les discussions avec l'Occident. Cette période coïncidait avec la première série de sanctions majeures imposées au pays. Toutefois, comme de nombreuses personnes l'ont souligné ces dernières semaines, les sanctions, loin de punir les dirigeants politiques iraniens, ont créé des possibilités pour nombre d'entre eux et leurs proches de devenir multimillionnaires, voire milliardaires dans certains cas. La plupart de ces personnes transfèrent régulièrement leurs gains mal acquis à l'étranger, sur des comptes détenus par des proches ou sur des comptes bancaires offshore, sans risque de se voir imposer des sanctions.
Pendant ce temps, les Iraniens ordinaires souffrent de la hausse des prix et du chômage ou du sous-emploi endémique qui rendent la vie extrêmement difficile.
Samedi matin, 6 juillet, la plupart de ceux qui célébraient la victoire en Iran semblaient soulagés que les deux principaux candidats conservateurs, Mohammad Ghalibaf [candidat lors du premier tour ayant réuni 14,41% des votes] et Saïd Jalili, représentants d'une bande de réactionnaires corrompus, aient été battus. Peu après l'élection, les différentes factions du camp conservateur ont entamé des récriminations, reprochant aux deux concurrents de ne pas s'être unis. Selon le site web Amwaj :
« Des personnalités politiques conservatrices ont confirmé l'intervention du commandant de la Force Al-Qods (la branche internationale du commandement des Gardiens de la révolution islamique) avant les élections. Esmail Qaani [occupant ce poste depuis janvier 2020] aurait tenté de convaincre Jalili de se retirer en faveur de Qalibaf – une décision qui pourrait venir accabler le commandant militaire. »
Il ne fait aucun doute que Qalibaf était le candidat du très détesté Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Toutefois, comme je l'ai déjà écrit, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de la part de la nouvelle administration présidentielle. Les partisans des factions réformistes de la République islamique nous disent que le fait que Massoud Pezeshkian ait été autorisé à se présenter et que les votes n'aient pas été « manipulés » pour donner une victoire aux conservateurs prouve que le Guide suprême Ali Khamenei est désireux de conclure un accord avec les Etats-Unis et l'Occident. Il ne fait aucun doute qu'avec un gouvernement dirigé par des réformateurs, Khamenei peut faire preuve de souplesse en matière de politique étrangère sans perdre la face. Cela était plus difficile sous Raïssi, qui était prudent en raison de son mandat limité. Toutefois, dans sa déclaration félicitant Massoud Pezeshkian pour son succès électoral, le Guide suprême a « conseillé » au président élu de « suivre la voie » d'Ebrahim Raïssi et « d'utiliser les ressources abondantes du pays ».
Cette déclaration a été suivie d'une réunion de cinq heures entre le Guide suprême et le président nouvellement élu. Nous en saurons plus sur l'orientation de l'Iran lorsque Pezeshkian aura nommé son cabinet. Les spéculations vont bon train sur le fait qu'étant donné le rôle important joué par Mohammad Djavad Zarif lors des élections présidentielles, il pourrait se voir offrir le poste de ministre des Affaires étrangères,
Lors d'un rassemblement de campagne en faveur de Pezeshkian le 3 juillet, Zarif a demandé aux électeurs de « renvoyer chez eux ceux qui n'ont rien accompli pour le pays, si ce n'est des sanctions, de l'humiliation et de la misère ». Le lendemain des résultats, Zarif a écrit sur Twitter que l'Iran de Pezeshkian serait « plus unifié, plus résolu et plus préparé que jamais à relever ses défis, à renforcer ses relations avec les pays voisins et à réaffirmer son rôle dans l'ordre mondial émergent ».
Toutefois, il est peu probable que Zarif soit accepté par le Majles (parlement) iranien, actuellement dominé par les conservateurs et dirigé par Mohammad Ghalibaf. A moins d'une intervention directe du Guide suprême. Le président élu a également rencontré son ancien rival, Qalibaf. Nous supposons dès lors que le rôle du Majles dans l'approbation ou le rejet des nominations ministérielles (cabinet) a été discuté.
Des défis à relever
Pezeshkian découvrira bientôt les limites du poste exécutif le plus élevé de la République islamique d'Iran. Les expériences de ses prédécesseurs, les réformateurs Mohammad Khatami [1997-2005] et Hassan Rohani, nous fournissent de nombreux exemples.
Tout d'abord, Pezeshkian devra être prêt à affronter les obstacles créés par les factions les plus conservatrices. Pendant sa présidence, Mohammad Khatami a été régulièrement confronté à des protestations et à des manifestations de groupes comme Ansar-e Hezbollah [Partisans du Parti de Dieu, organisation paramilitaire], de manifestants portant le voile et de motocyclistes de la « Bassidj » (milice islamique fondée par Khomeini en novembre 1979), en colère contre ce qu'ils appelaient la tolérance du gouvernement à l'égard des comportements « anti-islamiques », allant jusqu'à l'arrestation et à l'emprisonnement de journalistes – même de certains partisans du président – et de détracteurs, ce qui a créé des problèmes pour le gouvernement.
L'un des défis les plus importants a été une lettre adressée au président de l'époque par de hauts commandants des Gardiens de la révolution. Après un incident survenu dans les dortoirs de l'université de Téhéran le 9 juillet 1999, 24 commandants ont averti le président que « notre patience était à bout » et que s'il n'était pas mis fin aux manifestations étudiantes, ils prendraient des mesures. Le contenu de cette lettre menaçait le deuxième personnage le plus puissant de la République islamique d'Iran et a été considéré par certains comme une allusion à un « coup d'Etat ».
Pendant la présidence de Hassan Rohani [2017-2021], les problèmes et les défis se sont manifestés différemment. Les groupes de pression sont devenus actifs dans l'arène politique de l'Iran dans ce qui a été décrit comme des groupes « autonomes ». L'incompétence du gouvernement iranien à y répondre a conduit aux manifestations sanglantes de 2017 et 2019, ainsi qu'à une série de grèves et de protestations de retraités, de travailleurs et d'enseignant·e·s.
Les échecs économiques s'expliquent en partie par le fait que le gouvernement de l'époque avait basé ses plans sur l'accord nucléaire, et une fois que celui-ci a échoué à la suite du retrait des Etats-Unis de l'accord [mai 2018], le président a été confronté à une résolution parlementaire (le Plan d'action stratégique pour la levée des sanctions) qui a bloqué la voie au retour et à la relance du JCPOA.
Bien que Pezeshkian n'ait pas fait beaucoup de promesses au cours de sa campagne, il a déclaré : « Je garantis que l'ensemble du gouvernement s'opposera fermement aux patrouilles de moralité, aux mesures de censure et d'anti-censure, ainsi qu'aux pressions extérieures dans toutes les réunions. »
Ceux qui ont voté pour lui s'attendent à ce qu'il s'attaque à la police de la moralité et à la censure, ce qui devrait être une priorité pour le président élu. Cependant, il n'est pas facile de réussir dans ces domaines car, selon les responsables, des questions telles que l'opposition au hijab obligatoire sont une « obligation gouvernementale » et une exigence d'Ali Khamenei. Ce dernier a souligné à plusieurs reprises qu'il ne ferait pas de compromis sur la question du hijab. Au début de l'année 2022, Ebrahim Raïssi a publié un décret intitulé « Plan pour le hijab et la chasteté » à l'intention de l'exécutif et des organismes chargés de l'application de la loi, et un projet de loi portant le même nom a été approuvé à l'issue de plusieurs cycles entre le parlement (Majles) et le Conseil des Gardiens de la Constitution. Sa mise en œuvre n'a été que retardée en raison des élections législatives de l'année dernière et de la récente élection présidentielle.
En ce qui concerne la censure, selon le ministre des Communications et des Technologies de l'information du précédent gouvernement, la question n'est pas du ressort du gouvernement. Bien que six des treize membres du comité qui régit le filtrage d'Internet et des médias sociaux soient issus du gouvernement, les autres membres nommés par des agences non élues semblent avoir plus d'influence. Le 15 mai, le ministre des Communications a déclaré lors d'une interview avec le journal Shargh à propos de la censure : « Les restrictions d'Internet ne sont pas entre nos mains, et le comité de filtrage doit être responsable de la levée des blocages des sites Web et des plateformes de médias sociaux. » Dans ces conditions, on ne voit pas comment Pezeshkian peut surmonter ces « pressions extérieures ».
Sur la question de la « police de la moralité », si elle continue à réprimer les femmes qui refusent de porter le hijab dans la rue, comment le président réagira-t-il ? Comment tiendra-t-il sa promesse ?
Au-delà des défis immédiats auxquels le président élu s'affronte, il doit également faire face à une longue liste de questions politiques et économiques à moyen et long terme, dont certaines sont liées aux relations extérieures de l'Iran. Des problèmes très similaires ont persisté sous l'administration d'Hassan Rohani et n'ont pas été résolus jusqu'à la fin de son mandat.
Avant les élections présidentielles, Saeed Laylaz, professeur d'économie, a fait remarquer que la candidature de Massoud Pezeshkian avait été approuvée en raison de sa capacité à « résoudre les graves déséquilibres économiques de l'Iran ». Saeed Laylaz a déclaré à l'agence de presse Eco que la résolution des problèmes économiques nécessitait un gouvernement jouissant d'une légitimité maximale, et que l'émergence d'un gouvernement de préférence réformiste faciliterait la résolution des problèmes économiques. Pendant la campagne, Pezeshkian a lié certaines de ses promesses économiques à l'amélioration des relations extérieures, visant une croissance économique de 8% qui dépendrait de l'arrivée de 200 milliards de dollars d'investissements étrangers par an.
La relance du JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), le contournement des sanctions et la résolution des problèmes avec les banques mondiales (GAFI) font partie des défis importants que devra relever le président élu. Bien que Pezeshkian se soit engagé à faire tout son possible pour retirer le nom de l'Iran de la liste noire du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Selon mon interprétation, ce changement du GAFI est lié à une modification du soutien financier de l'Iran au Hezbollah (du Liban). Compte tenu du conflit actuel au Moyen-Orient et de la possible escalade du conflit entre Israël et le Hezbollah, il est difficile de voir comment le nouveau président parviendra à réduire ou à mettre fin aux contributions financières de l'Iran au groupe chiite.
En ce qui concerne les relations avec les Etats-Unis, Ali Abdolalizadeh [il faut ministre du Logement et du Développement urbain de 1997 à 2005 sous la présidence de Khatami], le chef de la campagne de Pezeshkian, a promis de « négocier avec Trump pour lever les sanctions. C'est un homme d'affaires, et nous comprenons bien le langage du commerce. » Il se pourrait qu'ils aient reçu le feu vert de Khamenei, mais sans sa volonté, les relations étrangères resteront limitées, poursuivant probablement les relations de l'Iran avec la Chine et la Russie.
Hadi Kahalzadeh, un expert économique, a déclaré à BBC Persian que l'un des défis majeurs de Pezeshkian est que le gouvernement a pratiquement été dépouillé de son pouvoir de décision dans les domaines de l'économie, du l'aide sociale, de la santé et de la société, nous laissant dans un état de « non-gouvernement » où il n'y a pas de gouvernement unifié. Hadi Kahalzadeh note que la capacité du gouvernement iranien à élaborer des politiques et à résoudre des problèmes nationaux a considérablement diminué, politiques désormais contrôlées par de nombreuses institutions extérieures au gouvernement.
Les ressources financières du gouvernement sont en effet limitées et ses dépenses sont très élevées, ce qui entraîne un déficit budgétaire. L'Etat alloue des ressources aux subventions, aux salaires et aux pensions, ce qui laisse très peu d'argent pour les investissements. Cette situation a réduit les dépenses de développement du gouvernement, ce qui a mené à un gouvernement inefficace, coûteux et improductif, incapable de créer du « bien-être social ». Pezeshkian fera-t-il donc ce que d'autres présidents iraniens ont fait et empruntera-t-il à la Banque centrale, ce qui provoquera de l'inflation ?
Un autre défi consistera à affronter les « profiteurs de sanctions ». Il s'agit d'individus et de groupes possédant de grandes fortunes qui ont acquis des rentes susceptibles de causer des problèmes au gouvernement, principalement parce que leur richesse leur a donné un pouvoir politique qui échappe au contrôle du gouvernement. Par le passé, ces groupes ont réussi à déclencher des vagues de protestations de rue contre le gouvernement, partant de villes religieuses et s'étendant à l'ensemble du pays.
L'opposition et le régime iranien
Vendredi dernier 5 juillet, les manifestant·e·s de droite qui se trouvaient devant les ambassades iraniennes en Europe et aux Etats-Unis disaient à ceux qui étaient allés voter qu'ils prolongeaient la vie de la République islamique, sans doute parce qu'ils pensaient que Pezeshkian pourrait améliorer la situation, ne serait-ce que pour une courte période.
Ces mêmes royalistes nous disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a eu une révolution en 1979 alors que la situation économique de l'Iran était très bonne ! Tout d'abord, il y a une contradiction évidente dans de telles affirmations, mais plus important encore, les révolutions ne se produisent pas simplement parce que la situation d'un pays est terrible, qu'il y a de la famine et de la dévastation, sinon nous aurions assisté à des révolutions dans plusieurs pays du Sud.
Deuxièmement, comme je ne cesse de le répéter, la République islamique d'Iran n'est pas sur le point d'être renversée par un véritable soulèvement populaire. Bien sûr, la possibilité d'un changement de régime par le haut est organisée par les Etats-Unis et leurs alliés, mais cela ne semble pas être à l'ordre du jour, même si Trump arrive au pouvoir en janvier 2025. Le régime clérical a perdu un soutien considérable parmi les Iraniens et Iraniennes ordinaires, mais il dispose d'incroyables capacités, se réinventant et trompant beaucoup de monde. Le fait que près de 30 millions d'Iraniens aient voté vendredi le prouve et au lieu de faire l'autruche en prétendant que rien ne s'est passé, comme semble le faire la majeure partie de la gauche en exil, nous devrions nous demander pourquoi nous sommes dans cette terrible situation et ce que nous pouvons faire pour ne pas nous retrouver dans une situation similaire dans les années à venir.
Réactions régionales à l'élection de Pezeshkian
Le soutien chaleureux des alliés de l'Iran en Irak et en Syrie était attendu, mais le ton amical des messages du roi Abdallah d'Arabie saoudite et de Ben Salman (MBS) a été un peu plus surprenant.
L'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran étaient en conflit depuis des décennies, l'Iran soutenant l'Arménie chrétienne dans le conflit du Haut-Karabakh. La République islamique a changé de position et le président Ilham Aliyev a été l'un des premiers à féliciter son compatriote azéri, Massoud Pezeshkian : « Je vous félicite chaleureusement pour votre élection à la présidence de la République islamique d'Iran. Nous attachons une grande importance aux relations entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran, qui reposent sur des bases solides telles que des racines religieuses et culturelles communes, l'amitié et la fraternité. »
Dans le même temps, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a félicité le président élu iranien Pezeshkian pour avoir remporté le second tour de scrutin vendredi, ajoutant : « Les relations avec le pays frère de la République islamique d'Iran revêtent une importance particulière pour le gouvernement et le peuple de la République d'Arménie, relations qui n'ont cessé de se développer depuis la déclaration d'indépendance de l'Arménie. » (Article publié par le site Academia.edu, juillet 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
– Yassamine Mather est chercheuse dans le cadre du Middle East Centre de l'Université d'Oxford, rédactrice de Critique : Journal of Socialist Theory.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bangladesh : Qui est Muhammad Yunus, le nouveau Premier ministre ?

Suite au puissant et courageux mouvement de protestation lancé par les étudiant-es, la première ministre autocratique a dû précipitamment abandonner le pouvoir et chercher refuge en Inde. À la demande des étudiant-es, Muhammad Yunus, un opposant au régime, a été nommé premier ministre. Qui est-il ? Ne risque-t-il pas de poursuivre le même type de politique économique et sociale que le régime précédent ? Afin de répondre partiellement à cette question nous republions un article de Denise Comanne, une des fondatrices du CADTM, écrit en 2009.
Tiré du site du CADTM.
En 2006, Muhammad Yunus et la Grameen Bank ont reçu et accepté le prix Nobel de la Paix. Yunus correspondait en tous points au profil du candidat idéal : suffisamment de social et aucune odeur de soufre ! A l'époque déjà, nous savions que l'œuvre de Yunus n'était pas aussi claire et révolutionnaire qu'on le prétendait. Un livre paru sous son nom en 2007, Vers un nouveau capitalisme | [1], nous permet d'aller plus loin dans l'analyse et la compréhension du « phénomène » Yunus ainsi que de la Grameen Bank.
Quelques mots tout d'abord pour faire savoir comment ce livre est tombé entre nos mains : c'est révélateur en soi. En mai 2008, nous accompagnons Philippe Diaz au Festival de Cannes où son film, « The End of Poverty ? », a été sélectionné dans le cadre de la Semaine de la Critique internationale. Là-bas, Philippe nous invite à nous rendre à une réunion dédiée à la Grameen Bank et à son créateur Muhammad Yunus. Cette réunion convoquée par une fondation philanthropique doit avoir lieu sur un bateau. Elle sera consacrée à la lutte contre la pauvreté. Avec Philippe Diaz, nous nous préparions justement ce jour-là à participer à une petite manifestation de rue sur la Croisette avec ATTAC et d'autres associations locales, histoire de rappeler les priorités dans la cacophonie friquée qu'est le Festival de Cannes. Arrivés au lieu du rendez-vous, nous réalisons avec surprise que la rencontre en l'honneur de Yunus a lieu sur un yacht de milliardaire loué pour la circonstance. Grimpant aux étages (c'est une véritable villa de luxe flottante), parmi les fauteuils de cuir, les milliers d'euros de fleurs blanches, de mets coûteux, nous prenons un exemplaire des quelques livres de Yunus trônant parmi les coupes de champagne. Personne n'a l'air de s'y intéresser vraiment et il n'y eut aucune prise de parole pour présenter ce livre, Yunus et/ou son œuvre. Philippe Diaz n'aura pas une seule opportunité de parler de son film : les personnes présentes ont l'air de se soucier de la pauvreté comme du dernier de leur souci. Alors ce livre, quid ? Sa lecture allait-elle contrebalancer le choc éprouvé sur le yacht ?
Des partenariats explicites
Pas vraiment. Le livre commence par un coup de foudre et la décision d'un partenariat entre Mohamad Yunus et l'entreprise multinationale Danone [2]. Les capitalistes adorent ce type de partenariat « social », code de conduite et autres fumisteries, cela permet de garder la main à la fois sur le cœur et sur le portefeuille : il existe plusieurs fondations dédiées à la promotion de l'entreprenariat social comme la Fondation Skoll, fondée par Jeff Skoll (le premier employé et l'ancien président d'Ebay), et la Fondation Schwab (le fondateur du Forum économique mondial de Davos) (p. 67) ; en septembre 2007, Intel et Grameen Solutions ont signé un protocole d'accord (p. 142 ) ; le Grameen Trust reçoit une donation de la Fondation MacArthur, puis des dons supplémentaires de la Banque mondiale, de la Fondation Rockefeller, de l'USAID (p. 143) ; le même trust a signé un accord de partenariat avec le Crédit Agricole (p. 144) : Grameen Capital India est créée en partenariat avec Citibank India et ICICI Bank (p. 266). Tout au long du livre, on retrouve donc, autour de Yunus et de ses créations, des acteurs clé du capitalisme… et pas du nouveau capitalisme !
Le social-business remplace la responsabilité collective
Yunus a la parole onctueuse d'un évêque mondain. Il se gargarise à tout bout de champ du mot « social », témoigne de ses bons sentiments, abuse de proclamations idéalistes … et fait des affaires. Le livre veut expliquer et promouvoir le social-business. Quelle en est sa définition ? « C'est une entreprise créée pour répondre à des objectifs sociaux. Un social-business est une société qui ne distribue pas de dividendes. Elle vend ses produits à des prix qui lui permettent de s'autofinancer. Ses propriétaires peuvent récupérer la somme qu'ils ont investie dans l'entreprise après un certain temps mais nulle part de profit ne leur est versée sous forme de dividendes. Au lieu de cela, les profits réalisés par l'entreprise restent en son sein afin de financer son expansion, de créer de nouveaux produits ou services, et de faire davantage de bien dans le monde » (p. 18-19). Il faut noter que des régies d'Etat, des services publics, pourraient fonctionner sur ce principe, les contribuables étant les « investisseurs » de la chose publique.
Cette réflexion, on peut la faire tout au long de la lecture du livre : Yunus n'envisage à aucun moment de réaliser son action « sociale » en passant par l'Etat ou en partenariat avec l'Etat. Il critique le service public et l'Etat qu'il considère incapables de régler les problèmes par manque d'argent (il ne se demande pas à quoi est dû ce manque), à cause de l'indifférence publique (les mouvements sociaux en lutte contre les privatisations comptent pour du beurre) et d'autres dysfonctionnements (p. 64). Les exemples de social-business qu'il donne entraînent ce même questionnement (p. 54) : « un social-business qui conçoit et commercialise des polices d'assurance maladie permettant aux pauvres d'accéder à des soins médicaux abordables » : pourquoi pas la sécurité sociale de l'Etat ? « un social-business qui développe des systèmes de production d'énergie renouvelable et les vend à un prix raisonnable aux communautés rurales qui, autrement, ne pourraient financer leur accès à l'énergie » : « un social-business recyclant les ordures, eaux usées et autres déchets »… Des tâches de cet ordre peuvent relever de la responsabilité de l'Etat et sont réalisables sous forme de services publics si l'Etat en possède les moyens financiers et la volonté politique.
Pourquoi les investisseurs placeraient-ils leur argent dans un social-business ? Par philanthropie (p. 57) à large échelle mais avec l'avantage, après avoir récupéré la mise de départ, de rester propriétaire de l'entreprise avec la seule perspective « excitante » (sic) de déterminer son activité future.
Les développements suivants commencent à montrer combien est fine la couche de social qui recouvre le projet (le fond de teint craquelle : l'effet cosmétique n'est pas garanti) et combien le « nouveau » capitalisme ressemble furieusement à l' « ancien » !
Nouveau capitalisme ?
Les social-business opèrent sur le même marché (p. 59) que les entreprises traditionnelles. Donc, non seulement ils entrent en concurrence avec ces entreprises mais ils sont en concurrence entre eux… et que le meilleur gagne ! Il y a donc des perdants quelque part et ces perdants, ce ne sont pas seulement un patron, un investisseur, ce sont des travailleurs et leurs familles De plus, la concurrence entre les social-business les obligera à accroître leur efficacité. Dans le cadre capitaliste, puisqu'il n'est à aucun moment question de le remettre en cause, cela ne peut que se réaliser par l'exploitation des travailleurs, des producteurs de matières premières.
Pour Yunus, la compétition reste le moteur, les prix diminuent et les consommateurs sont ravis. L'augmentation des cadences de travail, la diminution des coûts salariaux et du nombre d'emplois…, cela n'existe pas sur la planète yunusienne. Il rétorque que la concurrence entre les social-business sera différente de celle entre les entreprises dont l'objectif est de maximiser les profits. Pour celles-ci, l'enjeu est exclusivement financier tandis que la concurrence entre social-business est une question de fierté (!) (p. 61). Les compétiteurs resteront amis (encore !) : ils appendront les uns des autres, ils pourront fusionner, ils se réjouiront de voir d'autres social-business arriver sur le marché (toujours !).
Les choses continuent à s'éclaircir quand on apprend qu'en fait, il y a un second type de social-business : ceux-là sont détenus par les pauvres (ce processus n'est détaillé nulle part), cherchent à maximiser le profit et à donner des dividendes.
Le premier type de social-business (décrit plus haut) pouvait recouvrir la notion de service public, tout en excluant l'Etat du projet ; le second type, c'est en fait la privatisation tous azimuts en ce sens qu'elle se réalise à tous les niveaux d'échelle, de la production de biens ainsi que de services (santé, éducation…), mais en tout bien tout honneur puisque ce sont les pauvres qui sont censés en profiter.
Quelle est la logique de ce deuxième type de social-business ? C'est très simple : la propriété de la société est attribuée aux habitants à bas revenu en leur vendant des actions à bas prix qu'ils achètent grâce à des prêts émanant d'organisations de micro-crédit qu'ils remboursent avec les profits. La boucle est bouclée.
Yunus reconnaît quand même au détour d'une phrase que ce qu'il propose ne tient pas la route (p. 69) : « Un modèle économique combinant la recherche du profit et la motivation altruiste pourrait-il exister ? Cela pourrait se concevoir : 60% d'objectifs sociaux et 40% d'objectifs liés à la recherche de gains privés. Mais dans le monde réel, il sera très difficile de gérer des entreprises ayant des objectifs conflictuels. » En effet, c'est conflictuel.
Pour rendre les choses moins conflictuelles, le vocabulaire peut aider. « Afin d'attirer les investisseurs, je propose de créer une bourse spécialisée qui pourrait porter le nom de ‘bourse sociale' » (p. 62). Des institutions financières d'un genre nouveau (?) pourront enfin être créées pour répondre aux besoins financiers des social-business : des fonds sociaux de capital à risque, des fonds sociaux et, bien sûr, un marché boursier social (p. 269). Des agences de notation spécialisées pourraient être créées pour évaluer certains aspects des entreprises à vocation sociale (p. 278). La création d'une instance de régulation et d'information pour les social-business… (p. 279) Chaque jour, le Social Wall Street Journal donnera les dernières nouvelles des progrès et des revers des social business (p. 287). Il y aura un indice Dow Jones social qui reflètera la valeur des actions de quelques-uns des plus importants social-business du monde (p. 289). Alors, à ce stade, on ne sait plus trop que penser : est-ce de l'humour, de la bêtise, de l'inconséquence ou de la malhonnêteté ?
Le système de Yunus tend d'ailleurs à ce que ce second type de social-business prenne le pas sur le premier : « Bien que nombre d'entre elles aient un statut d'organisation à but non lucratif, nous avons progressivement entrepris de rapprocher leur mode de fonctionnement de celui d'une entreprise classique. Elles ont ainsi été encouragées à entrer dans le monde des affaires tout en conservant leurs objectifs sociaux » (p. 141).
Le social-business basé sur l'endettement
La Grameen Bank est-elle un social-business ? En tous les cas, elle fait des bénéfices et distribue des dividendes. Essayons de voir comment Yunus combine cela avec la volonté de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Car certains passages du livre témoignent de la mégalomanie galopante qui frappe Yunus quand il parle de son action contre la pauvreté : « Nous avons juré que nos efforts auraient un impact important et mesurable sur la pauvreté. Plus spécifiquement, nous nous sommes engagés à aider 100 millions de familles à sortir de la pauvreté grâce au microcrédit et à d'autres services financiers. En nous fondant sur les estimations selon lesquelles environ 5 personnes bénéficient des effets positifs du microcrédit lorsqu'il concerne une famille (chiffre que l'expérience du monde en développement permet de considérer comme approximativement exact), nous pouvons espérer qu'un demi milliard d'individus sortiront de la pauvreté au cours de la prochaine décennie – ce qui correspond aux objectifs du millénaire pour le développement » (p.121). Les Nations unies peuvent aller se rhabiller, Yunus fait le travail à lui tout seul !
La question principale pour Yunus est : « comment autoriser la moitié la plus fragile de la population du globe à rejoindre le courant principal de l'économie mondiale et à acquérir la capacité de participer aux libres marchés ? » (p. 31). Yunus part du postulat que l'économie mondiale fonctionne bien via le libre marché : le seul problème des pauvres, c'est d'avoir le pied à l'étrier. Accéder à un premier prêt leur ouvrira la voie. Les banques considèrent que les pauvres ne sont pas solvables ? Elles refusent de leur accorder des prêts ? Lui, va tester le prêt aux pauvres. Yunus et ses équipes réalisent un véritable forcing à ce sujet : « Quand un emprunteur tente d'esquiver une offre de prêt en prétextant qu'il n'a pas d'expérience des affaires et ne veut pas prendre cet argent, nous cherchons à le convaincre qu'il peut avoir une idée d'activité économique à créer » (p. 40) Endettez-vous d'abord, on verra après ce que vous arriverez à faire…
En fait, cela ressemble étrangement aux propositions avantageuses des IFI qui, pendant les années 1950 et 1960, pour créer un marché de clients, ont appâté les gouvernements du Sud. Quand ceux-ci ont été ferrés et que les règles du jeu ont été modifiées, ils ont dû payer de plus en plus. Les gouvernements remboursent, ils n'arrêtent pas de le faire, mais leurs pays sont plus que jamais pris dans la spirale de l'endettement, de la dépendance et de la pauvreté. Yunus et toutes les institutions de microcrédit qui ont imité la Grameen Bank proclament haut et fort, avec admiration même, que les taux de remboursement des femmes, des pauvres, sont irréprochables. Les institutions du Nord sont plus discrètes à ce sujet, mais c'est la même réalité.
Quel est le bilan de la Grameen Bank ? « Aujourd'hui, la Grameen Bank accorde des prêts à plus de 7 millions de pauvres, dont 97% de femmes, dans 78.000 villages du Bangladesh. Depuis son ouverture, la banque a distribué des prêts pour un montant total équivalant à 6 milliards de dollars. Le taux de remboursement est actuellement de 98,6%. Comme toute banque bien gérée, la Grameen Bank réalise habituellement un profit. Elle est financièrement autonome et n'a pas eu recours à des dons depuis 1995. Les dépôts et les autres ressources de la Grameen Bank représentent aujourd'hui 156% de son encours de crédit. La banque a été rentable depuis qu'elle existe sauf en 1983, 1991 et 1992. Mais ce qui importe plus que tout, c'est que, selon une enquête interne, 64% de ceux qui ont été nos emprunteurs durant au moins cinq ans ont dépassé le seuil de la pauvreté » (p. 96-97).
Les remboursements effectués par les pauvres peuvent certainement être vérifiés dans les livres de comptes de la Grameen Bank. Mais ce qui reste plus difficile à évaluer, c'est le dépassement du seuil de pauvreté. Tout d'abord, dès qu'on gagne par jour 1 cent de dollar au-dessus du seuil de pauvreté (quelle que soit la manière dont ce seuil est calculé), on n'est plus comptabilisé comme pauvre alors que la vie réellement vécue n'a pas changé. Ensuite, on peut se poser d'autres questions : si un pauvre continue à emprunter au-delà de 5 ans, quelle en est la cause ? Yunus considérerait sans doute qu'il est sur la route des affaires, qu'il est entré de plain pied dans l'économie mondiale. Mais cela peut être le résultat de l'obligation et de la difficulté, voire l'impossibilité, de rembourser définitivement le capital emprunté (les prêts sont flexibles, les dettes peuvent être rééchelonnées, restructurées comme dans le cas des pays emprunteurs). C'est une situation qui doit se présenter régulièrement quand on sait que, pour Yunus, 20%, c'est un taux d'intérêt tout à fait habituel, que ses programmes de micro-crédit centrés sur la pauvreté proposent deux zones de prêt : la zone verte qui correspond au taux du marché plus jusqu'à 10 points et la zone jaune au coût du marché plus 10 à 15 points.
« Si vous passez suffisamment de temps parmi les pauvres, vous découvrirez que leur pauvreté vient de ce qu'ils ne peuvent conserver le fruit de leurs efforts. La raison en est claire : ils ne contrôlent pas le capital. Les pauvres travaillent au profit de quelqu'un d'autre qui détient le capital » (p. 190). Yunus découvre donc l'existence des classes et du prolétariat. Pour ne plus être pauvre, une seule solution : devenir capitaliste !
Les multinationales et le show-social-business
Le livre commençait en évoquant le partenariat avec Danone, revenons-y. « Vendre des yaourts Grameen Danone à des familles aisées, ce n'est pas dans les objectifs d'un social-business… » Donc, si on veut garder le label, « la solution consiste à accroître notre production et à vendre nos yaourts à tout le monde ». A la page suivante, on tient toutefois à préciser que « c'est un projet qui ne présentait guère d'intérêt financier pour Danone…. » et, plus sidérant encore, deux pages plus loin, on note en passant que « les spécialistes de Danone étudiaient l'environnement concurrentiel de Grameen Danone : comment fonctionnaient les producteurs locaux d'aliments et de boissons » (p. 220-227). Point très intéressant : il y avait là, avant Danone, des gens qui vendaient ce type de produits et qui ont donc subi la concurrence de l'association entre la Grameen Bank et Danone. Que sont-ils devenus ? Les nouveaux pauvres du nouveau capitalisme de Yunus ?
On arrive vite à parler (petit) profit et (petits) dividendes car, alors que les deux partenaires (Yunus et Danone) s'entendent sur la définition du social-business, à la dernière minute, on ajoute au protocole d'accord une clause prévoyant un dividende symbolique de 1%. Yunus prétend ne plus être d'accord avec cette clause. Pourtant, il semble régulièrement confronté à ce type de problème (p. 157-159) : « La propriété de Grameen Phone est actuellement partagée entre deux sociétés : Telenor, Norvège, (62% des parts) et Grameen Telecom (38%). (…) Grameen Phone est devenue l'entreprise la plus importante du Bangladesh avec plus de 16 millions d'abonnés (…) j'avais l'intention de transformer Grameen Phone en social-business en transférant aux pauvres la majorité des parts de la société. Mais Telenor refuse de céder ses parts [ben, tiens] alors qu'il devait réduire sa participation à moins de 35% après 6 ans… ». Conflictuelles, disions-nous plus haut, la recherche du profit et la motivation altruiste ?
Pour Yunus, « le social-business est la pièce manquante du système capitaliste. Son introduction peut permettre de sauver le système » (p. 171). Le tout est de savoir s'il faut sauver un système mortifère. Yunus essaye de nous présenter des fausses solutions. Ne tombons pas dans le piège.
Lire ce livre vous met constamment au bord de la nausée, du dégoût et de l'indignation. C'est donc un livre à conseiller pour comprendre le monde… et s'indigner. Finalement, le yacht de milliardaire à Cannes était bien adapté pour accueillir un tel ouvrage…
Denise Comanne
Notes
[1] Muhammad Yunus, Vers un nouveau capitalisme, Editeur J-C Lattès, 2007, 280 pages. ISBN / EAN : 9782709629140.
[2] Voir le site http://www.danonecommunities.com/«-vers-un-nouveau-capitalisme-»-de-muhammad-yunus-un-livre-evenement/
Pour continuer sur le sujet
Article disponible sur ESSF Muhammad Yunus : Prix Nobel de l'ambiguïté ou du cynisme ? et reproduit ci-dessous.
Les institutions de microcrédit, basées sur le profit, continuent d'exploiter la pauvreté faisant de terribles dégâts et enfonçant les victimes dans la misère et le désespoir.
Il est bon de faire un petit retour sur l'origine, et le concepteur, de ce système.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

(Re)contextualiser la Palestine : Israël, les pays du Golfe et la puissance US au Moyen-Orient

Adam Hanieh analyse la façon dont le capitalisme fossile a configuré les rapports de force et les relations entre États au Moyen orient, sous la férule des États-Unis. Il peut alors situer le colonialisme israélien en Palestine dans une perspective régionale plus large, explicitant les stratégies états-uniennes vis-à-vis d'Israël et des pays du Golfe.
Tiré de la revue Contretemps
8 juillet 2024
Par Adam Hanieh
Adam Hanieh est professeur d'économie politique et de développement international à l'Institut d'études arabes et islamiques de l'université d'Exeter. Ses travaux portent sur le rôle des États du Golfe dans le capitalisme mondial, ainsi que sur la manière dont l'accumulation de capital dans le Golfe influe sur les questions plus générales de développement au Moyen-Orient.
Cet article a été d'abord publié en anglais sur le site du Transnational Institute.
***
Au cours des sept derniers mois, la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza a suscité une vague sans précédent de protestations et de sensibilisation à la cause palestinienne. Des millions de personnes sont descendues dans la rue, des campements ont surgi sur les campus des universités du monde entier, des militant·e∙s ont bloqué des ports et des usines d'armement, et la nécessité d'une campagne mondiale de boycott, de désinvestissement et de sanctions à l'encontre d'Israël semble faire plus que jamais consensus. La plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël à la Cour internationale de justice (CIJ) a renforcé l'ardeur de ces mouvements populaires. Cette affaire a non seulement mis en lumière non seulement la réalité du génocide perpétré par Israël, mais aussi le soutien indéfectible des principaux États occidentaux à l'État hébreu, malgré ses agissements dans la bande de Gaza et au-delà.
Néanmoins, malgré cette vague mondiale de solidarité avec la Palestine, certaines idées fausses ont la peau dure dans les débats et les analyses au sujet de la Palestine. Trop souvent, la dimension politique de la question palestinienne n'est considérée qu'à travers le prisme d'Israël, de la Cisjordanie et de Gaza, en omettant la dynamique régionale plus large du Moyen-Orient et le contexte international dans lequel se déploie le colonialisme israélien. D'autre part, la solidarité avec la Palestine est souvent réduite à la contestation des graves violations de droits humains commises par Israël, ainsi que ses violations incessantes du droit international, à savoir les meurtres, les arrestations et la dépossession que les Palestinien·nes subissent depuis près de huit décennies. Cette conception des droits humains est problématique en ce qu'elle dépolitise la lutte des Palestinien·nes, et n'explique pas pourquoi les États occidentaux continuent d'offrir leur soutien inconditionnel à Israël. Et, lorsque la question centrale du soutien occidental est soulevée, beaucoup en attribuent la cause à un « lobby pro-israélien » opérant en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Cette perception est erronée et politiquement dangereuse, car elle occulte profondément la relation entre les États occidentaux et Israël.
L'objectif de cet article est de proposer une approche alternative pour comprendre les enjeux autour de la question palestinienne, une approche replacée dans son contexte régional, prenant en compte le rôle central du Moyen-Orient dans un monde dominé par les combustibles fossiles. L'argument principal ici est que l'on ne peut comprendre le soutien indéfectible des États-Unis et des principaux États européens à Israël sans considérer ce contexte. En tant que colonie de peuplement, Israël a joué un rôle de premier plan dans le maintien des intérêts impérialistes occidentaux, notamment des États-Unis, au Moyen-Orient. L'État hébreu a endossé ce rôle aux côtés des monarchies arabes du Golfe riches en pétrole, lesquelles constituent l'autre pilier majeur des intérêts américains dans la région, avec l'Arabie saoudite à leur tête. L'évolution rapide des relations entre les pays du Golfe, Israël et les États-Unis est essentielle pour comprendre la situation actuelle, en particulier du fait de l'affaiblissement relatif des États-Unis en tant que puissance mondiale.
Les mutations de l'après-guerre et le Moyen-Orient [1]
Deux transformations majeures ont façonné l'évolution de l'ordre mondial dans les années qui ont immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale. La première a été une révolution du système énergétique mondial, avec l'émergence du pétrole en tant que principal combustible fossile, remplaçant le charbon et d'autres sources d'énergie pour les grandes puissances industrialisées. Cette transition vers les combustibles fossiles s'est d'abord produite aux États-Unis, où la consommation de pétrole a dépassé celle du charbon en 1950, puis en Europe occidentale et au Japon dans les années 1960. Dans les pays riches représentés au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le pétrole représentait moins de 28 % de la consommation totale de combustibles fossiles en 1950 ; à la fin des années 1960, sa part dépassait les 50%. Grâce à sa plus grande densité énergétique, sa plasticité et sa facilité de transport, le pétrole a alimenté le capitalisme florissant de l'après-guerre, soutenant le développement de toute une série de nouvelles technologies, industries et infrastructures. Ce fut le début de ce que les scientifiques décriront plus tard comme la « grande accélération », à savoir l'expansion considérable et continue de la consommation de combustibles fossiles débutée au milieu du 20ᵉ siècle, et qui a irrémédiablement mené à la situation d'urgence climatique que l'on connaît aujourd'hui.
Cette transition globale vers le pétrole est étroitement liée à une deuxième transformation majeure de l'après-guerre, à savoir l'avènement des États-Unis comme première puissance économique et politique mondiale. L'ascension économique des États-Unis a commencé dans les premières décennies du 20ᵉ siècle, mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui a permis leur émergence en tant que première puissance incontestable du capitalisme mondial, à laquelle ne s'opposaient alors que l'Union soviétique et son bloc allié. La puissance américaine est née de la destruction de l'Europe occidentale pendant la guerre et de l'affaiblissement de la domination coloniale européenne sur une grande partie de ce que l'on a appelé le tiers-monde. Tandis que la Grande-Bretagne et la France se fragilisaient, les États-Unis ont joué un rôle de premier plan dans l'architecture politique et économique de l'après-guerre, notamment au moyen d'un nouveau système financier mondial centré sur le dollar américain. Au milieu des années 1950, les États-Unis détenaient 60 % de la production manufacturière mondiale et un peu plus d'un quart du PIB mondial, et 42 des 50 premières entreprises industrielles du monde étaient américaines.
Ces deux tournants mondiaux majeurs, la transition vers le pétrole et l'affirmation de la toute puissance américaine, ont eu de profondes répercussions au Moyen-Orient. D'une part, la région a joué un rôle décisif dans la transition mondiale vers le pétrole. Elle disposait en effet de ressources pétrolières abondantes, représentant près de 40 % des réserves mondiales avérées au milieu des années 1950. En outre, le pétrole du Moyen-Orient était situé à proximité de nombreux pays européens, et les coûts de production y étaient bien plus bas que partout ailleurs dans le monde. Des quantités apparemment illimitées de pétrole pouvaient ainsi être vendues à l'Europe à des prix inférieurs à ceux du charbon, tout en garantissant que les marchés pétroliers américains restent à l'abri des effets de l'augmentation de la demande européenne. Le recentrage de l'approvisionnement pétrolier de l'Europe sur le Moyen-Orient a été extrêmement rapide : entre 1947 et 1960, la part du pétrole européen provenant de cette région a doublé, passant de 43 % à 85 %. Cela a permis non seulement l'émergence de nouvelles industries, comme la pétrochimie, mais aussi le développement de nouvelles techniques de transport, et de guerre. Ainsi, sans le Moyen-Orient, la transition pétrolière en Europe occidentale n'aurait peut-être jamais eu lieu.
La majorité des réserves pétrolières du Moyen-Orient se trouve dans la région du Golfe, principalement en Arabie saoudite et dans les petits États arabes du Golfe, ainsi qu'en Iran et en Irak. Pendant la première moitié du 20ᵉ siècle, ces pays ont été gouvernés par des monarchies autocratiques soutenues par l'Empire britannique (à l'exception de l'Arabie saoudite, qui restait théoriquement non soumise au colonialisme anglais). La production de pétrole dans la région était contrôlée par une poignée de grandes compagnies pétrolières occidentales, qui payaient des loyers et des redevances aux dirigeants de ces États pour pouvoir y extraire le pétrole. Ces sociétés pétrolières étaient intégrées verticalement, ce qui signifie qu'elles contrôlaient non seulement l'extraction du pétrole brut, mais aussi le raffinage, le transport et la vente du pétrole dans le monde entier. Le pouvoir de ces entreprises était immense, le contrôle des infrastructures de circulation du pétrole leur permettant d'en exclure tout concurrent potentiel. La concentration de la propriété dans l'industrie pétrolière dépassait de loin celle observée dans toute autre industrie ; en effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 80 % de toutes les réserves pétrolières mondiales en dehors des États-Unis et de l'URSS étaient contrôlées par seulement sept grandes entreprises américaines et européennes, baptisées les « Sept Sœurs ».
Israël et les révoltes anticoloniales
Malgré leur immense pouvoir, ces compagnies pétrolières ont été confrontées à un défi de taille lorsqu'au cours des années 1950 et 1960, le Moyen-Orient est devenu le centre des marchés pétroliers mondiaux. Comme ailleurs dans le monde, une série de puissants mouvements nationalistes, communistes et autres mouvements de gauche ont commencé à contester les dirigeants soutenus par les colonialismes britannique et français, menaçant de bouleverser l'ordre régional soigneusement établi. C'est en Égypte que ce phénomène s'est manifesté avec le plus d'ardeur, lorsque le roi Farouk, monarque soutenu par les Britanniques, a été renversé en 1952 par un coup d'État militaire mené par un officier apprécié de la population, Gamal Abdel Nasser. L'arrivée au pouvoir de Nasser a entraîné le retrait des troupes britanniques d'Égypte et permis au Soudan d'obtenir son indépendance en 1956. La souveraineté nouvellement acquise de l'Égypte s'est vue couronnée cette même année par la nationalisation du canal de Suez, jusqu'alors contrôlé par les Britanniques et les Français. Célébrée par des millions de personnes dans tout le Moyen-Orient, cette mesure a provoqué l'invasion ratée de l'Égypte par les Britanniques, les Français et les Israéliens. Tandis que Nasser s'engageait dans la voie de la nationalisation, les luttes anticoloniales ont pris de l'ampleur ailleurs dans la région, notamment en Algérie, où une guérilla pour l'indépendance a débuté en 1954 contre l'occupation française.
Bien qu'on l'ignore encore souvent de nos jours, ces menaces contre une domination coloniale de longue date ont eu des répercussions dans les pétromonarchies du Golfe. En Arabie saoudite et dans les petits États du Golfe, le soutien à Nasser était significatif et divers mouvements de gauche ont protesté contre la vénalité, la corruption et la position pro-occidentale des monarchies au pouvoir. Les conséquences potentielles de ces contestations se sont matérialisées non loin de là, en Iran, où un leader national populaire, Mohammed Mossadegh, est arrivé au pouvoir en 1951. L'une des premières mesures mises en place par Mossadegh a été de prendre le contrôle de l'Anglo-Iranian Oil Company (prédécesseur de l'actuelle BP), compagnie pétrolière contrôlée jusqu'alors par les Britanniques. Ce qui constituait le premier cas de nationalisation du pétrole au Moyen-Orient a eu une forte résonance dans les États arabes voisins, où le slogan « Le pétrole arabe pour les Arabes » a gagné en popularité dans un climat général anticolonialiste.
En réponse à la nationalisation du pétrole iranien, les services secrets américains et britanniques ont orchestré un coup d'État contre Mossadegh en 1953, portant au pouvoir un gouvernement pro-occidental fidèle au monarque iranien, Mohammad Reza Shah Pahlavi. Ce coup d'État a été le point de départ d'une vague contre-révolutionnaire dirigée contre tous les mouvements radicaux et nationalistes de la région. Le renversement de Mossadegh a également mis en évidence un changement majeur dans l'ordre régional : si la Grande-Bretagne a joué un rôle important dans le coup d'État, ce sont les États-Unis qui ont pris la tête de la planification et de l'exécution de l'opération. C'était la première fois que le gouvernement américain déposait un dirigeant étranger en temps de paix, et l'implication de la CIA dans le coup d'État a été déterminante pour les interventions américaines ultérieures, telles que le coup d'État de 1954 au Guatemala et le renversement du président chilien Salvador Allende en 1973.
C'est dans ce contexte qu'Israël est devenu un rempart majeur pour la sauvegarde des intérêts américains au Moyen-Orient. Au tout début du 20ᵉ siècle, la Grande-Bretagne avait été le principal soutien de la colonisation sioniste de la Palestine et, après la création d'Israël en 1948, les Britanniques ont continué à soutenir le projet sioniste de construction d'un État juif. Mais lorsque les États-Unis ont supplanté la domination coloniale britannique et française au Moyen-Orient pendant l'après-guerre, le soutien américain à Israël est apparu comme la clé de voûte d'un nouvel ordre sécuritaire régional. La guerre de 1967 entre Israël et les principaux États arabes a constitué un tournant majeur, après que l'armée israélienne a détruit les forces aériennes égyptiennes et syriennes et lancé l'occupation de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, de la péninsule du Sinaï en Égypte et du plateau du Golan en Syrie. La victoire d'Israël a brisé les mouvements panarabes, d'indépendance et de résistance anticoloniale qui s'étaient cristallisés le plus fortement dans l'Égypte de Nasser. Cette victoire a également encouragé les États-Unis à supplanter la Grande-Bretagne en tant que principal mécène du pays. À partir de ce moment, les États-Unis ont commencé à fournir chaque année à Israël du matériel militaire et un soutien financier d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.
Le colonialisme de peuplement, un facteur décisif
La guerre de 1967 a démontré qu'Israël était une entité suffisamment puissante pour être utilisée contre toute menace pesant sur les intérêts américains dans la région. Mais il faut souligner ici un élément crucial qui passe souvent inaperçu, à savoir que la place particulière qu'occupe Israël dans le soutien à la puissance américaine est directement liée à son caractère intrinsèque de colonie de peuplement, fondée sur la dépossession croissante de la population palestinienne. Les colonies de peuplement doivent continuellement s'efforcer de renforcer leurs structures d'oppression raciale, d'exploitation de classe et de dépossession. En conséquence, il s'agit généralement de sociétés hautement militarisées et violentes, qui ont tendance à dépendre d'un soutien extérieur leur permettant de maintenir leurs privilèges matériels dans un environnement régional hostile. Dans ce type de société, une proportion importante de la population profite de l'oppression de la population autochtone et considère ses privilèges dans une perspective raciale et militariste. C'est pourquoi les colonies de peuplement sont des partenaires beaucoup plus sûrs pour les intérêts impérialistes occidentaux que les États clients « normaux ». [2] C'est aussi la raison pour laquelle le colonialisme britannique a soutenu le sionisme en tant que mouvement politique au début du 20ᵉ siècle, et que les États-Unis ont embrassé Israël après 1967.
Bien sûr, cela ne signifie pas que les États-Unis « contrôlent » Israël, ou qu'il n'y ait jamais de divergences d'opinion entre les gouvernements américain et israélien sur la manière dont cette relation doit se maintenir. Mais la capacité d'Israël à imposer un état permanent de guerre, d'occupation et d'oppression serait profondément mise en péril sans le soutien continu des États-Unis, tant sur le plan matériel que politique. En retour, Israël est un partenaire fidèle et un bouclier contre les menaces qui pèsent sur les intérêts américains dans la région. Le pays est également intervenu à l'échelle mondiale en apportant son soutien à des régimes répressifs appuyés par les États-Unis, de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid aux dictatures militaires d'Amérique latine. Alexander Haig, secrétaire d'État américain sous Richard Nixon, a affirmé sans détour qu' « Israël est le plus grand porte-avions américain au monde qui ne peut être coulé, qui ne transporte pas un seul soldat américain et qui est situé dans une région hautement stratégique pour la sécurité nationale américaine. » [3]
Le lien entre les caractéristiques intrinsèques de l'État israélien et la place particulière qu'il occupe dans la stratégie américaine s'apparente au rôle que l'apartheid sud-africain a joué pour soutenir les intérêts occidentaux sur l'ensemble du continent africain. Il existe des différences importantes entre l'apartheid sud-africain et l'apartheid israélien – notamment la part prépondérante des populations noires d'Afrique du Sud dans la classe ouvrière du pays, contrairement aux Palestinien·nes en Israël – mais en tant que colonies de peuplement, les deux États sont devenus largement structurants pour le pouvoir occidental dans leurs voisinages respectifs. Si nous examinons l'histoire du soutien occidental à l'apartheid sud-africain, nous constatons que ses justifications relevaient du même ordre que celles que nous entendons aujourd'hui à propos d'Israël, et nous observons les mêmes tentatives pour bloquer les sanctions internationales et criminaliser les mouvements de protestation. Ces parallèles se retrouvent dans le rôle joué par certains individus. Un exemple peu connu est le voyage qu'un jeune membre du parti conservateur britannique a effectué en Afrique du Sud en 1989, au cours duquel il a plaidé contre les sanctions internationales à l'encontre de l'Afrique du Sud et expliqué pourquoi la Grande-Bretagne devait continuer à soutenir le régime d'apartheid. Des décennies plus tard, ce jeune conservateur, David Cameron, occupe aujourd'hui le poste de ministre britannique des affaires étrangères et est l'un des premiers dirigeants du monde à encourager le génocide israélien à Gaza.
Le rôle central que détient le Moyen-Orient dans l'économie mondiale du pétrole confère à Israël une place plus importante dans le pouvoir impérialiste occidental que celle qu'occupait l'Afrique du Sud de l'apartheid. Mais les deux cas démontrent pourquoi il est si important de réfléchir à la manière dont les facteurs régionaux et mondiaux se conjuguent aux dynamiques internes de classe et de race qui caractérisent les colonies de peuplement.
L'intégration économique d'Israël au Moyen-Orient
Le Moyen-Orient est devenu d'autant plus important pour le pouvoir américain après la nationalisation des réserves de pétrole brut un peu partout dans la région – et ailleurs – au cours des années 1970 et 1980. La nationalisation a mis fin au contrôle occidental historique direct sur les approvisionnements en pétrole brut au Moyen-Orient, bien que les entreprises américaines et européennes aient continué à contrôler la majeure partie du raffinage, du transport et de la vente de ce pétrole à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, les intérêts américains dans la région consistaient à garantir un approvisionnement stable du marché mondial en pétrole – libellé en dollars américains – et à s'assurer que le pétrole ne serait pas utilisé comme une « arme » pour déstabiliser un système mondial centré sur les États-Unis. En outre, les producteurs de pétrole du Golfe ayant commencé à gagner des billions de dollars grâce à l'exportation de pétrole brut, les États-Unis étaient très préoccupés par la manière dont ces « pétrodollars » circulaient dans le système financier mondial, avec une incidence directe sur la prédominance du dollar américain.
Dans la poursuite de ses intérêts, la stratégie américaine s'est entièrement consacrée à maintenir en place les monarchies du Golfe, dirigées par l'Arabie saoudite, car elles s'avéraient être des alliées régionales indispensables, particulièrement après le renversement de la monarchie iranienne des Pahlavi en 1979, qui constituait un autre pilier des intérêts américains dans le Golfe depuis le coup d'État de 1953. Le soutien des États-Unis aux monarques du Golfe s'est manifesté de diverses manières, notamment par la vente d'énormes quantités de matériel militaire, qui a fait de la région du Golfe le plus grand marché d'armes au monde, ainsi que par des mesures économiques qui ont canalisé l'afflux des pétrodollars du Golfe vers les marchés financiers américains, et par une présence militaire américaine permanente, laquelle continue d'être le meilleur garant du pouvoir monarchique. La guerre Iran-Irak, qui a duré de 1980 à 1988 et qui est considérée comme l'un des conflits les plus destructeurs du 20ᵉ siècle (près d'un demi-million de morts), a marqué un tournant dans les relations entre les États-Unis et les pays du Golfe. Pendant cette guerre, les États-Unis ont fournides armes, des fonds et des renseignements aux deux parties, considérant qu'il s'agissait d'un moyen d'affaiblir la puissance de ces deux grands pays voisins et d'assurer la sécurité des monarques du Golfe.
C'est ainsi que la puissance américaine au Moyen-Orient a fini par reposer sur deux piliers essentiels : Israël d'une part, les monarchies du Golfe de l'autre. Ces deux piliers restent aujourd'hui la clé de voûte de la puissance américaine dans la région ; toutefois, la manière dont ils sont liés l'un à l'autre a sensiblement évolué. Depuis les années 1990 et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement américain a cherché à réunir ces deux pôles stratégiques – ainsi que d'autres États arabes importants, tels que la Jordanie et l'Égypte – au sein d'une sphère unique liée à la puissance économique et politique des États-Unis. Pour y parvenir, il fallait intégrer Israël au Moyen-Orient élargi en normalisant ses relations économiques, politiques et diplomatiques avec les États arabes. Plus important encore, il s'agissait d'en finir avec les boycotts arabes officiels d'Israël qui ont perduré pendant des décennies.
Du point de vue d'Israël, la normalisation ne consistait pas simplement à permettre le développement du commerce avec les États arabes et les investissements dans les économies de ces derniers. Après une récession majeure au milieu des années 1980, l'économie israéliennes'est détournée de secteurs tels que la construction et l'agriculture pour mettre davantage l'accent sur la haute technologie, la finance et les exportations militaires. Toutefois, de nombreuses grandes entreprises internationales hésitaient à faire des affaires avec des entreprises israéliennes (ou en Israël même) en raison des « boycotts secondaires » imposés par les gouvernements arabes. [4] Mettre fin à ces boycotts était essentiel pour attirer les grandes entreprises occidentales en Israël, et pour permettre aux sociétés israéliennes d'accéder aux marchés étrangers aux États-Unis et ailleurs. En d'autres termes, la normalisation économique visait tout autant à garantir la place du capitalisme israélien dans l'économie mondiale qu'à permettre à Israël d'accéder aux marchés du Moyen-Orient.
À cette fin, les États-Unis et leurs alliés européens ont eu recours, à partir des années 1990, à divers mécanismes visant à favoriser l'intégration économique d'Israël dans le Moyen-Orient élargi. L'un de ces mécanismes a été l'intensification des réformes économiques, à savoir une ouverture aux investissements étrangers et aux flux commerciaux qui se sont rapidement déployés dans la région. Dans ce contexte, les États-Unis ont proposé une série de mesures économiques visant à connecter les marchés israéliens et arabes les uns aux autres, puis à l'économie américaine. L'un des principaux projets concernait les « Qualifying Industrial Zones » (QIZ), des zones franches de production à bas salaires créées en Jordanie et en Égypte à la fin des années 1990. Les marchandises produites dans les QIZ (principalement des textiles et des vêtements) bénéficiaient d'un accès en franchise de droits aux États-Unis, à condition qu'une certaine proportion des intrants pour leur fabrication provienne d'Israël. Les QIZ ont joué un rôle précoce et décisif en rassemblant des capitaux israéliens, jordaniens et égyptiens dans des structures de propriété conjointe, normalisant ainsi les relations économiques entre deux des États arabes voisins d'Israël. En 2007, le gouvernement américain signalait que plus de 70 % des exportations jordaniennes vers les États-Unis provenaient des QIZ ; pour l'Égypte, 30 % des exportations vers les États-Unis étaient produites dans les QIZ en 2008. [5]
Conjointement au programme des QIZ, les États-Unis ont également proposé le projet de zone de libre-échange du Moyen-Orient (Middle East Free Trade Area – MEFTA) en 2003. La MEFTA visait à établir une zone de libre-échange couvrant l'ensemble de la région d'ici 2013. La stratégie américaine consistait à négocier individuellement avec des pays « amis » en suivant un processus graduel en six étapes, qui devait aboutir à un véritable accord de libre-échange (ALE) entre les États-Unis et le pays en question. Ces accords ont été conçus de manière à ce que les pays puissent associer leurs propres accords bilatéraux de libre-échange avec les États-Unis aux accords bilatéraux signés avec d'autres pays, établissant ainsi des accords au niveau sous-régional dans l'ensemble du Moyen-Orient. Ces accords sous-régionaux pourraient être rattachés au fil du temps, jusqu'à ce qu'ils couvrent l'ensemble de la région. Il est important de noter que ces accords de libre-échange seraient également utilisés pour encourager l'intégration d'Israël dans les marchés arabes, chaque accord contenant une clause engageant le signataire à normaliser ses relations avec Israël et interdisant tout boycott des relations commerciales. Bien que les États-Unis n'aient pas atteint l'objectif qu'ils s'étaient fixé en 2013 pour la mise en place du MEFTA, cette politique a permis d'étendre l'influence économique américaine dans la région, grâce à la normalisation entre Israël et les principaux États arabes. Il est frappant de constater qu'aujourd'hui, les États-Unis ont conclu 14 accords de libre-échange avec des pays du monde entier, dont cinq avec des États du Moyen-Orient (Israël, Bahreïn, Maroc, Jordanie et Oman).
Les accords d'Oslo
Toutefois, le succès de la normalisation économique allait dépendre avant tout d'un changement de conjoncture politique qui donnerait le « feu vert » de la Palestine à l'intégration économique d'Israël dans l'ensemble de la région. À cet égard, les accords d'Oslo, signés entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) sous les auspices du gouvernement américain sur la pelouse de la Maison Blanche en 1993 ont constitué un tournant décisif. Ces accords se sont fortement appuyés sur les pratiques coloniales établies au cours des décennies précédentes. Depuis les années 1970, Israël avait tenté de trouver une force palestinienne capable d'administrer la Cisjordanie et la bande de Gaza en son nom, c'est-à-dire un mandataire palestinien de l'occupation israélienne qui pourrait minimiser les contacts quotidiens entre la population palestinienne et l'armée israélienne. Les premières tentatives avaient échoué lors de la première Intifada, un soulèvement populaire de grande ampleur déclenché dans la bande de Gaza en 1987. Les accords d'Oslo ont mis fin à cette première Intifada.
Dans le cadre de ces accords, l'OLP a accepté de constituer une nouvelle entité politique, appelée Autorité palestinienne (AP), qui se verrait accorder des pouvoirs limités sur des zones fragmentées de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. L'AP dépendrait entièrement des financements extérieurs pour sa survie, en particulier des prêts, de l'aide et des taxes à l'importation perçues par Israël et qui seraient ensuite reversées à l'AP. Puisque la plupart de ses sources de financement provenaient en fin de compte des États occidentaux et d'Israël, l'Autorité palestinienne s'est rapidement trouvée subordonnée sur le plan politique. En outre, Israël a conservé un contrôle total sur l'économie et les ressources palestiniennes, ainsi que sur la circulation des personnes et des biens. Après la division territoriale de Gaza et de la Cisjordanie en 2007, l'AP a établi son siège à Ramallah, en Cisjordanie. Elle est dirigée aujourd'hui par Mahmoud Abbas. [6]
Malgré la façon dont les accords d'Oslo et les négociations qui ont suivi sont généralement dépeints, il n'a jamais été question de paix ni d'un quelconque processus de libération de la Palestine. C'est au lendemain de ces accords que l'expansion des colonies israéliennes a explosé en Cisjordanie, que le mur de l'apartheid a été construit, et qu'ont été instaurées les inextricables restrictions de mouvement qui régissent depuis lors la vie des Palestinien·nes. Les accords d'Oslo ont permis d'exclure des composantes essentielles de la population palestinienne – les réfugié·es et les citoyen·nes palestinien·nes d'Israël – de la lutte politique, réduisant la question de la Palestine à des négociations autour de portions de territoire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Plus important encore, les accords ont apporté la bénédiction palestinienne à l'intégration d'Israël dans le Moyen-Orient élargi, ouvrant la voie aux gouvernements arabes, menés par la Jordanie et l'Égypte, vers une normalisation avec Israël sous l'égide des États-Unis.
C'est après ces accords que sont apparues les restrictions de circulation, les barrières, les checkpoints et les zones militaires qui cernent aujourd'hui Gaza. En ce sens, la prison à ciel ouvert qu'est devenue la bande de Gaza est elle-même une création du processus d'Oslo ; un lien direct relie les négociations d'Oslo au génocide actuel. Ce point est fondamental aux discussions en cours sur les scénarios possibles de l'après-guerre. La stratégie israélienne a toujours consisté à recourir périodiquement à une violence extrême, assortie de fausses promesses de négociations soutenues par la communauté internationale. Ces deux outils servent la même stratégie qui consiste à intensifier la fragmentation territoriale et la dépossession continues du peuple palestinien. Toute négociation d'après-guerre dirigée par les États-Unis verra certainement des tentatives similaires d'assurer la domination pérenne d'Israël sur les vies et les terres palestiniennes.
Penser l'avenir
Le rôle stratégique que joue le Moyen-Orient, riche en pétrole, pour la puissance mondiale américaine explique pourquoi Israël est aujourd'hui le plus grand bénéficiaire cumulé de l'aide étrangère américaine dans le monde, bien que le pays se classe au 13ᵉ rang des économies les plus riches du monde en termes de PIB par habitant·e (plus que le Royaume-Uni, l'Allemagne ou le Japon). Cela explique également le soutien sans faille apporté à Israël par les élites politiques américaines (et britanniques). En 2021, sous la présidence Trump et avant la guerre actuelle, Israël a reçu plus de financement militaire de la part des États-Unis que tous les autres pays du monde réunis. Ce facteur est primordial car, comme les huit derniers mois l'ont démontré, le soutien américain va bien au-delà du soutien financier et matériel, puisque les États-Unis endossent le rôle d'ultime défenseur politique d'Israël sur la scène internationale. [7]
Comme nous l'avons vu, cette alliance américaine avec Israël n'est pas sans rapport avec la dépossession du peuple palestinien ; elle s'ancre même dans cette dépossession. C'est la nature coloniale de l'État d'Israël qui explique son rôle prépondérant dans le renforcement de la puissance américaine dans la région. On comprend ainsi pourquoi la lutte des Palestiniens est un élément essentiel des mutations politiques au Moyen-Orient, la région aujourd'hui la plus polarisée socialement, la plus inégale économiquement et la plus touchée par les conflits dans le monde. Inversement, cela explique aussi pourquoi la lutte pour la libération de la Palestine est intimement liée aux succès (et aux échecs) d'autres luttes sociales progressistes dans la région.
L'axe central de cette dynamique interrégionale reste le lien entre Israël et les États du Golfe. Au cours des deux décennies qui ont suivi les accords d'Oslo, la stratégie américaine au Moyen-Orient a continué à favoriser l'intégration économique et politique d'Israël avec les États du Golfe. Dans le cadre des accords d'Abraham en 2020, les Émirats arabes unis (EAU) et Bahreïn ont accepté de normaliser leurs relations avec Israël, ce qui a constitué une avancée majeure dans ce processus.
Ces accords ont ouvert la voie à un accord de libre-échange entre les Émirats arabes unis et Israël. Signé en 2022, il a été le premier accord de libre-échange liant Israël à un État arabe. La valeur des échanges commerciaux entre Israël et les Émirats arabes unis a dépassé les 2,5 milliards de dollars en 2022, alors qu'elle n'était que de 150 millions de dollars en 2020. Le Soudan et le Maroc ont également conclu des accords similaires avec Israël, répondant ainsi à de fortes incitations de la part des États-Unis. [8]
Après les accords d'Abraham, cinq États arabes entretiennent désormais des relations diplomatiques officielles avec Israël. Ces pays représentent environ 40 % de la population du monde arabe et comptent parmi les principales puissances politiques et économiques de la région. Mais une question reste déterminante : quand l'Arabie saoudite rejoindra-t-elle ce club ? S'il est impossible que les Émirats arabes unis et Bahreïn aient pu accepter les accords d'Abraham sans le consentement de l'Arabie saoudite, le Royaume saoudien n'a jusqu'à présent pas officiellement normalisé ses liens avec Israël, malgré la multitude de réunions et de relations informelles qui se sont tenues entre les deux États ces dernières années.
Dans le contexte actuel du génocide en cours, un accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël constitue sans aucun doute l'objectif principal de la stratégie américaine pour l'après-guerre. Il est très probable que le gouvernement saoudien accepterait un tel accord, ce qui a potentiellement déjà été confirmé à l'administration Biden, à condition qu'il obtienne une sorte de feu vert de la part de l'Autorité palestinienne à Ramallah. Cette approbation pourrait possiblement être obtenue dans le cas d'une reconnaissance internationale d'un pseudo-État palestinien dans certaines parties de la Cisjordanie. Ce scénario se heurte évidemment à des obstacles de taille, notamment le refus persistant des Palestinien·nes de Gaza de se soumettre, et la question des modalités d'administration du territoire de Gaza après la guerre. Mais le projet américain de créer une puissance arabe conjointe multi-États pour assurer le contrôle de la bande de Gaza, dirigée par certains des principaux États normalisateurs comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et le Maroc, dépendrait probablement d'une normalisation israélo-saoudienne.
Le rapprochement entre les États du Golfe et Israël s'avère de plus en plus crucial pour les intérêts américains dans la région, en raison des fortes rivalités et des tensions géopolitiques qui émergent à l'échelle mondiale, en particulier avec la Chine. Bien qu'aucune autre « grande puissance » ne soit prête à remplacer la domination américaine au Moyen-Orient, l'influence politique, économique et militaire des États-Unis dans la région a connu un déclin relatif au cours des dernières années. Preuve en sont les interdépendances croissantes entre les États du Golfe d'une part et la Chine et l'Asie de l'Estde l'autre, interdépendances qui vont désormais bien au-delà de l'exportation du pétrole brut du Moyen-Orient. Dans ce contexte et compte tenu de la place qu'occupe depuis longtemps Israël dans le maintien de la puissance américaine dans la région, tout processus de normalisation piloté par les États-Unis contribuerait à réaffirmer le pouvoir américain au Moyen-Orient et pourrait contrer l'influence de la Chine dans la région.
Néanmoins, malgré les débats actuels sur les scénarios d'après-guerre, les 76 dernières années ont démontré à maintes reprises que les tentatives visant à éradiquer la détermination et la résistance des Palestinien·nes continueront d'échouer. La Palestine se trouve aujourd'hui sur le front d'un réveil politique mondial qui dépasse tout ce qui a pu être observé depuis les années 1960. Dans ce contexte de prise de conscience globale de la condition palestinienne, notre analyse doit aller au-delà de l'opposition formelle aux violences perpétrées par Israël dans la bande de Gaza. La lutte pour la libération de la Palestine est au cœur de toute tentative sérieuse de contestation des intérêts impérialistes au Moyen-Orient, et ces mouvements de résistance nécessitent un meilleur ancrage dans une dynamique régionale plus large, en particulier vis-à-vis du rôle central joué par les monarchies du Golfe. Nous devons également mieux comprendre comment le Moyen-Orient s'inscrit dans l'histoire du capitalisme fossile, et dans les luttes contemporaines pour la justice climatique. La question de la Palestine est indissociable de ces réalités. En ce sens, l'extraordinaire combat pour la survie que mène aujourd'hui la population palestinienne dans la bande de Gaza représente l'avant-garde de la lutte pour l'avenir de la planète.
*
Traduit de l'anglais par Johanne Fontaine. Révisé par Nellie Epinat.
Notes
[1] Pour plus de précisions sur les enjeux soulevés dans cette partie, voir le prochain livre de l'auteur, Crude Capitalism : Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market, à paraître aux éditions Verso Books en septembre 2024.
[2] Les régimes arabes clients des États-Unis, tels que l'Égypte, la Jordanie et désormais le Maroc, doivent faire face à la persistance des mouvements politiques de contestation à l'intérieur de leurs propres frontières, et sont toujours obligés de s'adapter et de répondre aux pressions exercées par certains segments de leurs populations.
[3] Fait révélateur, la source de cette citation figure dans un article écrit en 2011 par l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Oren, intitulé « The Ultimate Ally » (L'allié suprême).
[4] Les « boycotts secondaires » signifiaient qu'une entreprise installée en Israël, comme Microsoft par exemple, prenait le risque d'être exclue des marchés arabes.
[5] Pour une analyse plus approfondie des QIZ, du MEFTA et de l'économie politique autour de la normalisation d'Israël, voir Adam Hanieh, Lineages of Revolt : Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East, Haymarket Books, 2013. Voir surtout pp. 36-38 [En anglais].
[6] En 2006, le Hamas avait largement remporté les élections du Conseil législatif palestinien avec 74 des 132 sièges contestés. Un gouvernement d'unité nationale avait été constitué, réunissant des membres du Hamas et du Fatah, le parti palestinien majoritaire contrôlant l'Autorité palestinienne. Mais ce gouvernement a été dissous par le Fatah après que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007. Depuis lors, Gaza et la Cisjordanie sont sous le contrôle de deux autorités distinctes.
[7] Au-delà de l'aide militaire et financière directe, le soutien des États-Unis s'exprime par de nombreux autres moyens. Le gouvernement américain fournit par exemple des milliards de dollars en garanties de prêt à Israël, ce qui permet à ce dernier d'emprunter à moindre coût sur le marché mondial. Israël est l'un des six pays au monde à avoir reçu de telles garanties au cours des dix dernières années, avec l'Ukraine, l'Irak, la Jordanie, la Tunisie et l'Égypte.
[8] Dans le cas du Soudan, les États-Unis ont accepté d'accorder un prêt de 1,2 milliard de dollars et de retirer le pays de la liste des États soutenant le terrorisme, bien que l'accord de normalisation n'ait pas encore été ratifié. Pour le Maroc, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations avec Israël.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza. L’escorte médiatique d’un génocide

« Depuis 90 jours, je ne comprends pas. Des milliers de personnes meurent et sont mutilées, submergées par un flot de violence qu'on ne peut qualifier de guerre, sauf par paresse ». Dans sa lettre de démission après douze ans de bons et loyaux services, le journaliste Raffaele Oriani du supplément hebdomadaire du quotidien italien La Repubblica entend protester contre la manière dont son journal couvre la situation à Gaza. Il dénonce « l'incroyable circonspection d'une grande partie de la presse européenne, y compris La Repubblica – aujourd'hui deux familles massacrées ne figurent qu'à la dernière ligne de la page 15 », et évoque « l'escorte médiatique » qui rend ces massacres possibles.
Tiré d'Orient XXI.
Il fut un temps où les médias occidentaux n'avaient pas ce type de pudeur. Personne n'avait de réticence à dénoncer l'invasion russe et il ne serait venu à l'idée de personne d'évoquer « l'opération spéciale russe », sinon par dérision. Aujourd'hui s'est imposée l'expression israélienne de « guerre Israël-Hamas », comme si deux parties égales s'affrontaient, ou que les victimes étaient principalement des soldats des Brigades d'Al-Qassam.
Les formules dans les journaux varient, mais le Hamas est presque toujours désigné comme « organisation terroriste » — rappelons que seuls l'Union européenne et les États-Unis le considèrent comme tel — ce qui exonère par avance Israël de tous ses crimes. Face au Mal absolu, tout n'est-il pas permis ? Un journaliste de CNN rapportait les consignes de sa rédaction :
- Les mots « crime de guerre » et « génocide » sont tabous. Les bombardements israéliens à Gaza seront rapportés comme des « explosions » dont personne n'est responsable, jusqu'à ce que l'armée israélienne en accepte ou en nie la responsabilité. Les citations et les informations fournies par l'armée israélienne et les représentants du gouvernement ont tendance à être approuvées rapidement, tandis que celles provenant des Palestiniens ont tendance à être attentivement examinées et traitées précautionneusement (1).
« Selon le Hamas »
On sait la suspicion qui a accompagné les chiffres du nombre de morts donnés par le ministère de la santé à Gaza, jusqu'à aujourd'hui accompagnés de l'expression « selon le Hamas », alors qu'ils semblent inférieurs à la réalité. Le traitement réservé aux otages palestiniens, déshabillés, humiliés, torturés, est relativisé, la suspicion d'appartenir au Hamas justifiant l'état d'exception. En revanche, les fake news colportées après le 7 octobre sur les femmes éventrées, les bébés décapités ou brûlés dans des fours ont été reprises, car elles avaient été entérinées par des responsables israéliens. Une fois la supercherie révélée, aucune rédaction n'a cru nécessaire de faire son mea culpa pour avoir contribué à colporter la propagande israélienne. En France, le porte-parole de l'armée israélienne a micro ouvert sur les chaînes d'information, et quand un journaliste se décide de faire son métier et de l'interroger vraiment, il est rappelé à l'ordre par sa direction. Pendant ce temps, des propos d'un racisme éhonté, qui frisent l'incitation à la haine ou à la violence à l'encontre des critiques de l'armée israélienne sont à peine relevés. Sans parler de la suspicion qui frappe les journalistes racisé·es coupables de « communautarisme » quand ils offrent une autre vision2.
Alors qu'Israël refuse l'entrée de journalistes étrangers à Gaza — sauf à ceux qu'ils choisissent d'« embarquer » dans un tour guidé, ce que de nombreux correspondants acceptent sans le moindre recul critique —, peu de protestations se sont élevées contre ce bannissement. La profession ne s'est guère mobilisée contre l'assassinat de 109 journalistes palestiniens, un nombre jamais atteint dans tout autre conflit récent. Si ces reporters avaient été européens, que n'aurait-on pas entendu ? Pire, dans son bilan annuel publié le 15 décembre 2023, l'organisation Reporters sans frontières (RSF) parle de « 17 journalistes [palestiniens] tués dans l'exercice de leur fonction », information reprise par plusieurs médias nationaux. La formulation choque par son indécence, surtout quand on sait que cibler volontairement les journalistes est une pratique courante de l'armée israélienne, à Gaza et en Cisjordanie, comme nous le rappelle l'assassinat de la journaliste Shirin Abou Akleh. Le dimanche 7 janvier, deux confrères palestiniens ont encore été tués après qu'un missile israélien a ciblé leur voiture, à l'ouest de Khan Younes. L'un des deux n'est autre que le fils de Wael Dahdouh, le chef du bureau d'Al-Jazira à Gaza. La moitié de sa famille a été décimée par l'armée israélienne, et son caméraman a été tué.
Or, on doit à ces journalistes palestiniens la plupart des images qui nous parviennent. Et bien que certains d'entre eux aient déjà travaillé comme « fixeurs » pour des journalistes français, ils restent a priori suspects parce que Palestiniens. Pendant ce temps, leurs confrères israéliens qui, à quelques exceptions près (+972, certains journalistes de Haaretz) reprennent les éléments de langage de l'armée sont accueillis avec révérence.
Le nettoyage ethnique, une option comme une autre
Ces derniers jours on a assisté à des débats surréalistes. Peut-on vraiment discuter, sereinement, calmement, « normalement » sur des plateaux de radio et de télévision des propositions de déplacement de la population palestinienne vers le Congo, le Rwanda ou l'Europe, sans marteler que ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ? Sans dire que ceux qui les profèrent, ici ou là-bas, devraient être inculpés d'apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ?
Selon les Nations unies, la bande de Gaza est devenue « un lieu de mort, inhabitable ». Chaque jour s'accumulent les informations sur les morts (plus de 23 000), les blessés (plus de 58 000), les structures médicales bombardées, les exécutions sommaires, les tortures à grande échelle (3), les écoles et universités pulvérisées, les domiciles détruits. À tel point que l'on crée un nouveau terme, « domicide » pour désigner cette destruction systématique des habitations. Tous ces crimes font rarement l'objet d'enquêtes journalistiques. Pourtant le mémorandum soumis par l'Afrique du Sud le 29 décembre 2023 à la Cour internationale de justice de La Haye (4) suffirait aux médias à produire des dizaines de scoops. Ils contribueraient à donner aux victimes (pas seulement celles du 7 octobre) un visage, un nom, une identité. À contraindre Israël et les États-Unis qui les arment sans barguigner, à mettre aussi les autres pays occidentaux et en particulier la France devant leurs responsabilités, et pour cela il ne suffit pas de parachuter quelques vivres sur une population en train d'agoniser, ou d'exprimer sa « préoccupation » à la faveur d'un communiqué.
Pour la première fois, un génocide a lieu en direct, littéralement en live stream sur certaines chaînes d'information panarabes ou sur les réseaux sociaux, ce qui n'a été le cas ni pour le Rwanda ni pour Srebrenica. Face à cela, la facilité avec laquelle ce massacre quitte petit à petit la une des journaux et l'ouverture des journaux télévisés dans nos pays pour être relégué comme information secondaire est déconcertante. Pourtant, autant que les États signataires de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, les journalistes ont la responsabilité morale de se mobiliser pour arrêter ce crime en cours.
Pour ne pas se rendre complice de génocide, la France peut contribuer à l'arrêter : suspendre la coopération militaire avec Israël, prendre des sanctions contre les Français qui participent aux crimes à Gaza, suspendre le droit des colons d'entrer dans notre pays, voire suspendre l'importation de marchandises israéliennes, dont certaines viennent des colonies et sont donc commercialisées en contravention avec les décisions européennes.
Fin décembre, à la suite d'une attaque russe sur les villes ukrainiennes qui avait fait une trentaine de morts, le gouvernement américain condamnait « ces bombardements épouvantables », tandis que celui de Paris dénonçait « la stratégie de terreur russe ». Le quotidien Le Monde titrait sur la « campagne de terreur russe ». Combien de temps faudra-t-il pour qualifier de terrorisme la guerre israélienne contre Gaza ?
Notes
1- « Cnn Runs Gaza Coverage Past Jerusalem Team Operating Under Shadow of Idf Censor », The Intercept, Daniel Boguslaw, 4 janvier 2024.
2- Nassira Al-Moaddem, « TV5 Monde : "l'affaire Kaci" secoue la rédaction », Arrêt sur image, 30 novembre 2023.
3- Lire l'enquête du magazine israélien +972, Yuval Abraham, « Inside Israel's torture camp for Gaza detainees »
4- Application Instituting Proceedings.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza. Des armes qui maximisent le nombre de victimes. Des médecins témoignent

Les obus et missiles de fabrication israélienne conçues pour projeter de grandes quantités de mitrailles causent d'horribles blessures aux civils de Gaza et touchent les enfants de manière disproportionnée, ont déclaré au Guardian des chirurgiens étrangers qui ont travaillé dans le territoire au cours des derniers mois.
Tiré de A l'encontre
13 juillet 2024 .
Par Chris McGreal
Les médecins affirment qu'un grand nombre des décès, des amputations et des blessures qui ont changé la vie des enfants qu'ils ont soignés sont dus aux tirs de missiles et d'obus – dans des zones peuplées de civils – qui explose en libérant des milliers d'éclats (bombes à fragmentation).
Les médecins volontaires de deux hôpitaux de Gaza ont déclaré que la majorité de leurs interventions concernaient des enfants touchés par de petits éclats d'obus qui laissent des blessures à peine perceptibles à l'entrée, mais qui provoquent des destructions considérables à l'intérieur du corps. Amnesty International a déclaré que les armes semblent conçues pour maximiser le nombre de victimes.
Feroze Sidhwa, chirurgien californien spécialisé dans les traumatismes, a travaillé à l'Hôpital européen du sud de Gaza en avril. « Près de la moitié des blessures dont je me suis occupé concernaient de jeunes enfants. Nous avons vu beaucoup de blessures dites par éclats qui étaient très, très petites, au point qu'on pouvait facilement les manquer en examinant un patient. Elles sont beaucoup plus petites que tout ce que j'ai vu auparavant, mais elles ont causé d'énormes dégâts à l'intérieur. »
Les experts en armement ont déclaré que les éclats d'obus et les blessures correspondaient à des armes de fabrication israélienne conçues pour faire un grand nombre de victimes, contrairement aux armes plus conventionnelles utilisées pour détruire des bâtiments. Les experts s'interrogent sur les raisons pour lesquelles ces armes sont tirées sur des zones peuplées de civils.
***
Le Guardian s'est entretenu avec six médecins étrangers qui ont travaillé dans deux hôpitaux de Gaza, l'Hôpital européen et l'Hôpital al-Aqsa, au cours des trois derniers mois. Tous ont déclaré avoir été confrontés à des blessures graves causées par des armes à « fragmentation », qui, selon eux, ont contribué au taux alarmant d'amputations depuis le début de la guerre. Ils ont indiqué que les blessures étaient observées chez les adultes et les enfants, mais que les dommages causés étaient probablement plus graves pour les corps plus jeunes.
« Les enfants sont plus vulnérables à toute blessure pénétrante car leur corps est plus petit. Leurs parties vitales sont plus petites et plus faciles à perturber. Lorsque les enfants ont des vaisseaux sanguins lacérés, ils sont déjà si petits qu'il est très difficile de les reconstituer. L'artère qui alimente la jambe, l'artère fémorale, n'a que l'épaisseur d'une nouille chez un petit enfant. Elle est très, très petite. Il est donc très difficile de la réparer et de maintenir le membre de l'enfant attaché à lui », explique Feroze Sidhwa.
Mark Perlmutter, chirurgien orthopédiste de Caroline du Nord, a travaillé dans le même hôpital que Feroze Sidhwa. « Les blessures les plus courantes sont des plaies d'entrée et de sortie d'un ou deux millimètres. Les radiographies montrent des os démolis avec une blessure en trou d'épingle d'un côté, un trou d'épingle de l'autre, et un os qui semble avoir été écrasé par un tracteur. La plupart des enfants que nous avons opérés présentaient ces petits points d'entrée et de sortie. »
Selon Mark Perlmutter, les enfants frappés par de multiples morceaux de minuscules éclats sont souvent morts et ceux qui ont survécu ont perdu des membres. « La plupart des enfants qui ont survécu présentaient des lésions neurologiques et vasculaires, une cause majeure d'amputation. Les vaisseaux sanguins ou les nerfs sont touchés, et ils reviennent un jour plus tard et la jambe ou le bras est mort. »
Sanjay Adusumilli, un chirurgien australien qui a travaillé à l'Hôpital al-Aqsa dans le centre de Gaza en avril, a retrouvé des éclats d'obus constitués de petits cubes de métal d'environ trois millimètres de large alors qu'il opérait un jeune garçon. Il a décrit des blessures causées par des armes à fragmentation qui se distinguent par le fait que les éclats détruisent les os et les organes tout en ne laissant qu'une égratignure sur la peau.
***
Les experts en explosifs qui ont examiné les photos de ces éclats et les descriptions des blessures faites par les médecins ont déclaré qu'elles correspondaient à des bombes et des obus équipés d'un « manchon à fragmentation » autour de l'ogive explosive afin de maximiser le nombre de victimes. Leur utilisation a également été documentée lors de précédentes offensives israéliennes à Gaza.
Trevor Ball, ancien technicien de l'armée des Etats-Unis chargé de la neutralisation des explosifs et munitions, a déclaré que l'explosif pulvérise des cubes de tungstène et des roulements à billes qui sont bien plus mortels que l'explosion elle-même.
« Ces billes et ces cubes constituent le principal effet de fragmentation de ces munitions, l'enveloppe de la munition ne fournissant qu'une part beaucoup plus faible de l'effet de fragmentation. La plupart des obus et bombes d'artillerie traditionnels reposent sur l'enveloppe de la munition elle-même plutôt que sur l'ajout d'un revêtement de fragmentation », a-t-il déclaré.

Cubes retirés d'un enfant par Sanjay Adusumilli, un chirurgien australien travaillant à l'Hôpital al-Aqsa dans le centre de Gaza. (The Guardian)
Trevor Ball a indiqué que les cubes métalliques retrouvés par Sanjay Adusumilli se trouvent généralement dans les armes fabriquées par Israël, comme certains types de missiles Spike tirés par des drones. Il a ajouté que les récits des médecins faisant état de minuscules plaies d'entrée sont également caractéristiques des bombes planantes et des obus de chars équipés de manchons à fragmentation tels que l'obus M329 APAM, conçu pour pénétrer les bâtiments, et l'obus M339 que son fabricant, Elbit Systems de Haïfa, décrit comme « hautement létal contre l'infanterie débarquée ».
Certaines de ces armes sont conçues pour pénétrer dans les bâtiments et tuer tous ceux qui se trouvent à l'intérieur des murs. Mais lorsqu'elles sont larguées dans les rues ou parmi les tentes, il n'y a pas de limitation.
« Le problème réside dans la manière dont ces petites munitions sont utilisées », a déclaré Trevor Ball. « Même une munition relativement petite utilisée dans un espace surpeuplé, en particulier un espace avec peu ou pas de protection contre la fragmentation, comme un camp de réfugiés avec des tentes, peut entraîner un nombre important de morts et de blessés. »
C'est en 2009 qu'Amnesty International a identifié pour la première fois des munitions contenant les cubes métalliques utilisés dans les missiles Spike à Gaza.
« Ils semblent conçus pour causer un maximum de blessures et, à certains égards, semblent être une version plus sophistiquée des roulements à billes ou des clous et des boulons que les groupes armés placent souvent dans des roquettes rudimentaires et des bombes suicides », a déclaré Amnesty International dans un rapport publié à l'époque.
Trevor Ball a déclaré que les armes équipées de douilles de fragmentation sont des « munitions relativement petites » par rapport aux bombes qui ont une large zone d'explosion et qui ont endommagé ou détruit plus de la moitié des bâtiments de Gaza. Mais comme elles contiennent du métal supplémentaire, elles sont très meurtrières dans les environs immédiats. Les éclats d'un missile Spike tuent et blessent gravement dans un rayon de 20 mètres.
Un autre expert en armement, qui a refusé d'être nommé parce qu'il travaille parfois pour le gouvernement des Etats-Unis, s'est interrogé sur l'utilisation de telles armes dans des zones de Gaza peuplées de civils. « On prétend que ces armes sont plus précises et qu'elles limitent le nombre de victimes à une zone plus restreinte. Mais lorsqu'elles sont tirées sur des zones à forte concentration de civils vivant en plein air et n'ayant nulle part où s'abriter, l'armée sait que la plupart des victimes seront ces civils. »
***
En réponse à des questions sur l'utilisation d'armes à fragmentation dans des zones à forte concentration de civils, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que les commandants militaires sont tenus « d'examiner les différents moyens de guerre qui sont également capables d'atteindre un objectif militaire défini, et de choisir le moyen qui devrait causer le moins de dommages accidentels dans les circonstances actuelles. Les FDI s'efforcent de réduire les dommages causés aux civils dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances opérationnelles qui prévalent au moment de la frappe. Les FDI examinent les cibles avant les frappes et choisissent la munition appropriée conformément aux considérations opérationnelles et humanitaires, en tenant compte d'une évaluation des caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes de la cible, de l'environnement de la cible, des effets possibles sur les civils à proximité, de l'infrastructure critique dans le voisinage, etc. »
L'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, a déclaré qu'un nombre « stupéfiant » d'enfants avaient été blessés lors de l'assaut israélien sur Gaza. Les Nations unies estiment qu'Israël a tué plus de 38 000 personnes à Gaza au cours de la guerre actuelle, dont au moins 8000 enfants, bien que le chiffre réel soit probablement beaucoup plus élevé. Des dizaines de milliers de personnes ont été blessées.
En juin, les Nations unies ont ajouté Israël à la liste des Etats qui commettent des violations visant des enfants pendant les conflits, décrivant l'ampleur des tueries à Gaza comme « une échelle et une intensité sans précédent de violations graves à l'égard d'enfants », principalement par les forces israéliennes.
***
La plupart des cas évoqués par les chirurgiens concernent des enfants gravement blessés par des missiles tombés dans ou à proximité de zones où des centaines de milliers de Palestiniens vivent dans des tentes après avoir été chassés de chez eux par l'attaque israélienne.
Le docteur Mark Perlmutter a expliqué qu'il avait été confronté à plusieurs reprises à des blessures similaires. « La plupart de nos patients avaient moins de 16 ans. La blessure de sortie ne fait que quelques millimètres. La blessure d'entrée est de la même taille ou plus petite. Mais vous pouvez voir qu'il s'agit d'une vitesse extrêmement élevée en raison des dégâts qu'elle provoque à l'intérieur. Lorsque plusieurs petits fragments se déplacent à une vitesse folle, les dommages causés aux tissus mous dépassent de loin la taille du fragment. »
Sanjay Adusumilli a décrit le traitement d'un garçon de six ans qui est arrivé à l'hôpital après un tir de missile israélien près de la tente où vivait sa famille après avoir fui leur maison suite aux bombardements israéliens. Le chirurgien a déclaré que l'enfant avait des blessures en forme de trou d'épingle qui ne donnaient aucune indication sur l'ampleur des dégâts sous la peau. « J'ai dû ouvrir son abdomen et sa poitrine. Il avait des lacérations aux poumons, au cœur et des trous dans l'intestin. Nous avons dû tout réparer. Il a eu de la chance qu'il y ait un lit dans l'unité de soins intensifs. Malgré cela, ce jeune garçon est décédé deux jours plus tard. »
Un médecin urgentiste états-unien travaillant actuellement dans le centre de Gaza, qui n'a pas voulu être nommé de peur de compromettre son travail, a déclaré que les médecins continuaient à traiter les blessures profondément pénétrantes créées par les éclats de fragmentation. Le médecin a indiqué qu'il venait de soigner un enfant qui souffrait de blessures au cœur et aux principaux vaisseaux sanguins, et d'une accumulation de sang entre ses côtes et ses poumons qui rendait sa respiration difficile.
Selon le docteur Feroze Sidhwa, « environ la moitié des patients dont nous nous sommes occupés étaient des enfants ». Il a pris des notes à propos de plusieurs d'entre eux, dont une fillette de neuf ans, Jouri, gravement blessée par des éclats d'obus lors d'une frappe aérienne sur Rafah. « Nous avons trouvé Jouri mourant de septicémie dans un coin. Nous l'avons emmenée en salle d'opération et avons constaté que ses deux fesses avaient été complètement écorchées. L'os le plus bas de son bassin était même exposé. Ces blessures étaient couvertes d'asticots. A sa jambe gauche, il manquait une grande partie des muscles à l'avant et à l'arrière de la jambe, et environ deux pouces de son fémur. L'os de la jambe avait disparu », a-t-il déclaré.
Selon Feroze Sidhwa, les médecins ont réussi à sauver la vie de Jouri et à traiter le choc septique. Mais pour sauver ce qui restait de sa jambe, les chirurgiens l'ont réduite au cours d'opérations répétées.
Le problème, selon Feroze Sidhwa, c'est que Jouri aura besoin de soins constants pendant des années et qu'il est peu probable qu'elle les trouve à Gaza. « Elle a besoin d'une intervention chirurgicale avancée tous les ans ou tous les deux ans, à mesure qu'elle grandit, pour ramener son fémur gauche à la longueur nécessaire pour qu'il corresponde à sa jambe droite, faute de quoi il lui sera impossible de marcher. Si elle ne sort pas de Gaza, si elle survit, elle sera définitivement et complètement infirme. »
Selon Sanjay Adusumilli, les armes à fragmentation ont entraîné un grand nombre d'amputations chez les enfants qui ont survécu. « Le nombre d'amputations que nous avons dû pratiquer, en particulier sur des enfants, est incroyable. L'option qui s'offre à vous pour sauver leur vie est d'amputer leur jambe, leur main ou leur bras. C'était un flux constant d'amputations chaque jour. »
Sanjay Adusumilli a opéré une fillette de sept ans qui avait été touchée par des éclats d'obus provenant d'un missile qui avait atterri près de la tente de sa famille. « Elle est arrivée avec le bras gauche complètement arraché. Sa famille a apporté le bras enveloppé dans une serviette et dans un sac. Elle avait des blessures à l'abdomen causées par des éclats d'obus et j'ai dû lui ouvrir l'abdomen et contrôler l'hémorragie. Elle a fini par être amputée du bras gauche. Elle a survécu, mais si je me souviens d'elle, c'est parce que lorsque je me précipitais dans la salle d'opération, elle me rappelait ma propre fille et c'était en quelque sorte très difficile à accepter sur le plan émotionnel. »
L'Unicef estime qu'au cours des dix premières semaines du conflit, environ 1000 enfants ont été amputés d'une jambe ou des deux.
***
Les médecins ont déclaré que de nombreux membres auraient pu être sauvés dans des circonstances plus normales, mais que la pénurie de médicaments et de salles d'opération limitait les chirurgiens à effectuer des procédures d'urgence pour sauver des vies. Certains enfants ont subi des amputations sans anesthésie ni analgésiques, ce qui a entravé leur rétablissement, sans compter les infections endémiques dues à l'insalubrité et au manque d'antibiotiques.
Sanjay Adusumilli a déclaré que, par conséquent, certains enfants sauvés sur la table d'opération sont morts plus tard alors qu'ils auraient pu être sauvés dans d'autres conditions.
« Ce qui est triste, c'est que l'on fait ce que l'on peut pour essayer d'aider ces enfants. Mais en fin de compte, le fait que l'hôpital soit si surpeuplé et ne dispose pas des ressources nécessaires en matière de soins intensifs fait qu'ils finissent par mourir plus tard. » (Article publié par The Guardian le 11 juillet 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Chris McGreal écrit pour le Guardian US et a été correspondant du Guardian à Washington, Johannesburg et Jérusalem. Il est l'auteur de American Overdose, The Opioid Tragedy in Three Acts (Guardian Faber Publishing, 2018).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












