Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Inde : au nom des droits des femmes

Depuis 2014, Modi promet l'égalité et la protection des femmes. Les violences continuent toutefois de croître, la participation des femmes au marché du travail est faible et les initiatives du BJP, comme les quotas parlementaires, servent davantage des objectifs politiques qu'émanciper les femmes. Au final, les inégalités et la violence de genre persistent et la culture de l'impunité règne.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Vient de paraître : Dissidences dans la « nouvelle » Inde, le dernier volume d'Alternatives Sud.
Une analyse d'Aurélie Leroy [1], chercheuse au CETRI – Centre tricontinental.
En ce printemps 2024, un huitième de la population mondiale s'est rendu aux urnes, faisant de ce scrutin, le plus grand exercice électoral de la planète. Un scrutin aux allures titanesques, qui ne fait toutefois pas de l'Inde « la plus grande démocratie du monde ». Plusieurs organisations internationales tels que V-dem (2023), Freedom House (2023) et Economist Intelligence Unit (2023) soulignent l'érosion démocratique et les dérives autoritaires. L'hindouisation du pays à marche forcée, qui cherche à établir une suprématie de la communauté majoritaire hindoue au détriment du sécularisme et des minorités, en est la première manifestation. La tendance à l'illibéralisme due à la neutralisation des institutions indépendantes et démocratiques, à la mise au pas des principaux contre-pouvoirs et à la répression des oppositions, en constitue la seconde.
Bilan du gouvernement Modi en matière de droits des femmes
Le Bharatiya Janata Party (BJP) dirigé par Narendra Modi s'est toujours dit mobilisé en faveur des femmes, déclarant que celles-ci étaient au centre de ses préoccupations. En 2014 déjà, le programme du parti [2] promettait d'œuvrer à l'« empowerment des femmes ». Il insistait sur leur sécurité et leur protection, considérées comme des conditions préalables à leur autonomisation. Le manifeste énumérait des actions à entreprendre pour lutter contre les violences commises à leur égard ainsi que des engagements en matière d'éducation, d'emplois et de participation économique et politique.
Violences de genre et impunité
Au cours de la dernière décennie cependant, les crimes contre les femmes n'ont cessé d'augmenter, alors que les taux atteignaient déjà des niveaux jugés « inacceptables » par le BJP lorsqu'il est monté au gouvernement en 2014. Selon le rapport annuel du National Crime Records Bureau, environ 4,45 millions de crimes contre les femmes ont été enregistrés en 2022 (Frontline, 2023). Une majorité d'entre eux étaient des actes de cruauté commis par des maris ou des proches (31%), des enlèvements de femmes (19%), des agressions et des attentats à la pudeur (19%) et des viols (7%).
La violence sexuelle est traitée avec complaisance en Inde et une culture de l'impunité l'entoure, en dépit des sursauts causés notamment par des mobilisations massives à la suite du viol collectif de Jyoti Singh, en 2012 (Leroy, 2013) et de la vague Me too indienne. Les statistiques officielles sont en outre peu fiables en raison de la sous-déclaration des agressions, mais aussi du fait de pratiques d'enregistrement inadaptées et d'une collusion institutionnelle. Les corps des femmes, en particulier ceux appartenant à des communautés marginalisées, sont la cible d'un continuum de violence, du ventre à la tombe, qui contribue à la perpétuation de la domination masculine et au maintien de hiérarchies fondées sur la caste, la religion, la classe sociale, la parenté, etc. (Alternatives Sud, 2021).
Aujourd'hui avec le « parti du peuple » au pouvoir, comme hier avec d'autres partis, les violences ne reçoivent pas une attention suffisante de la part des autorités. Les forces de police et de sécurité peuvent mêmes être les premières à laisser faire les bourreaux ou à brutaliser les femmes dans la rue ou dans les manifestations pacifiques. L'impunité est encore plus forte dans des régions militarisées telles que le Cachemire, le Manipur ou les États du Nord-Est. Dans ces zones de conflit, l'isolement et le manque de transparence permettent aux agressions sexuelles et aux abus de proliférer.
Les institutions façonnées par l'État concourent à la (re)production d'un ordre symbolique et social. On pourrait s'attendre à ce qu'elles participent de la solution mais elles perpétuent souvent, au contraire, des formes de violence contre les femmes. Les forces de l'ordre, tout comme la justice ne sont pas des organes « neutres », au-dessus des rapports de dominations. Elles y participent. Le système judiciaire indien échoue ainsi à rendre justice aux femmes et témoigne trop souvent d'une forme de complicité des autorités (depuis les chefs de village jusqu'au sommet de l'État) avec les auteurs de violences sexistes [3].
Participation économique des femmes
Le taux de participation des femmes à la population active, déjà bas en 2014, a quant à lui, encore baissé au cours des deux mandats de Modi. Il est l'un des plus bas de la planète (The Wire, 2023), soulignant la marginalisation croissante de la main-d'œuvre féminine dans l'économie indienne. Depuis la libéralisation des années 1990, ce taux est en chute libre, passant de près de 30%, il y a trois décennies, à environ 17% en 2018.
Depuis 4-5 ans, la tendance est à la hausse, mais cette évolution ne constitue pas de facto une bonne nouvelle. Elle est due au travail que de plus en plus de jeunes femmes réalisent à leur compte dans des zones rurales. Leur inscription sur le marché de travail est cyclique. Elle s'intensifie en période de crise pour compenser les pertes de revenus. Les femmes y acceptent alors des boulots mal payés aux conditions pénibles, qu'elles quittent aussitôt que la situation des ménages s'améliore et que l'économie rebondit.
Ces entrées et sorties soulignent le rôle d'amortisseur joué par les femmes dans les ménages pauvres durant les périodes de détresse économique (Bhandare, 2024). La contribution croissante des femmes au marché du travail incarne donc « un mode de vie difficile et un stress sur les moyens de subsistance, plutôt qu'une situation de progrès et d'abondance. Cette tendance reflète aussi le phénomène de ruralisation, à savoir la diminution de la proportion d'emplois dans les secteurs urbains de l'industrie et des services, qui se traduit par une dépendance croissante à l'égard des secteurs ruraux » (Sinha, 2023).
Les femmes sont en outre confrontées au « piège patrilocal » (« Patrilocal Trap ») (Evans, 2023) qui empêche les femmes célibataires de travailler à l'extérieur du foyer, en raison de « contacts non supervisés avec des hommes qui pourraient entacher leur réputation » (Taub, 2023). Sans moyen de gagner leur vie, faute de disponibilité d'« un travail convenable », de nombreuses femmes finissent par se marier, sous la contrainte sociale, se retrouvant du même coup attachée à une belle famille et sous l'emprise d'un mari parfois violent.
Représentation politique des femmes
Les nationalistes hindous du BJP ont aussi répété à l'envi qu'ils se différenciaient des autres partis en matière de représentation politique des femmes. Ils en voulaient pour preuves notamment, l'élection de Droupadi Murmu, première femme présidente [4] issue d'une communauté adivasi, la représentation féminine plus élevée que de coutume dans les 16e et 17e Lok Sabhas (la chambre basse du parlement) à majorité BJP, et l'adoption d'un amendement constitutionnel réservant 33% des sièges parlementaires au femmes, en septembre 2023.
Les ultranationalistes ont déployé des efforts pour pousser les femmes à intégrer le parti ou le cercle des organisations nationalistes hindoues proches du pouvoir, notamment le comité national des femmes volontaires. Des initiatives ont aussi été prises pour qu'elles soient davantage considérées comme une base électorale cruciale. La popularité de Modi et le succès de son parti ont ainsi grandi auprès des Indiennes au fil des années, au point que, lors des élections générales de 2019, le BJP est devenu le parti avec le plus grand nombre de voix féminines. Lors des élections régionales de 2022, qui se sont déroulées dans cinq états, les femmes ont voté davantage que les hommes pour le BJP (Barooah Pisharoty, 2022).
L'intérêt que le BJP porte aux femmes est indéniable, mais celui-ci ne signifie pas pour autant que ce parti œuvre à leur « libération » ou entende concrétiser l'égalité entre les sexes. Les droits des femmes ont été instrumentalisés et les questions sexuelles accaparées par les dirigeants indiens afin de légitimer leur discours, asseoir leur autorité et servir leur agenda politique.
Instrumentalisation politique des droits des femmes
Des quotas pour les femmes au parlement
L'adoption du projet de loi réservant des quotas aux femmes dans les assemblées parlementaires est un exemple édifiant des usages paradoxaux qui peuvent être fait de « la cause des femmes ». Introduit pour la première fois en 1996, le projet de loi a fait, au cours de ces trois dernières décennies, l'objet de débats acharnés sans que jamais une majorité n'en permette son adoption. En dépit de cette trajectoire longue et mouvementée, il a finalement été adopté à la quasi-unanimité, en septembre 2023, à peine deux jours après son introduction.
Ce résultat n'est pas le fait d'une subite convergence de vues sur le texte. Il relève d'un « coup » politique orchestré par le gouvernement Modi au plus grand bénéfice de ce dernier. Aucun échange ou consultation n'a pu avoir lieu anticipativement autour de cette loi en raison du manque de transparence sur l'ordre du jour des discussions à la Lok Sabha. Le dossier ne figurait pas sur le « Business bulletin », le matin même de son introduction. Cette loi est donc passée, comme beaucoup d'autres, « au bulldozer », parce que le gouvernement Modi en avait décidé ainsi, révélant l'affaiblissement du parlement et la mainmise de l'exécutif sur le législatif.
Si l'adoption de cette loi a, a priori, de quoi réjouir, elle pose plusieurs questions. Tout d'abord celle de la représentativité des femmes dans un Parlement affaibli aux marges de manœuvre réduites. Quels changements politiques espérer en faveur de l'égalité dans un contexte peu favorable au respect des droits humains et démocratiques où la direction du pays est passée maître dans l'art du parler démocratique et de l'agir autocratique. Ensuite, celle de la mise en œuvre de la loi qui n'est pas sans poser problème. L'établissement de quotas est en effet lié à l'exercice d'un recensement général dont la date n'est pas fixée et qui fait débat entre partis majoritaire et de l'opposition. Enfin, dernière question : pourquoi un tel empressement à faire adopter cette loi ?
Les raisons qui ont poussé le Premier ministre à agir de la sorte sont avant tout opportunistes et électoralistes. Des quotas en faveur des femmes sont une promesse électorale ancienne du BJP et l'adoptien du texte est survenu à la veille du scrutin de 2024. Le calendrier était donc parfait. Modi tenait également à proposer une mesure phare et rassembleuse à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment du parlement pour les 75 ans de l'indépendance. Quoi de mieux que le Women's Reservation Bill ? Cette loi est en outre emblématique de son agenda politique et de son programme « civilisationnel ». Elle alimente le récit d'une « nouvelle Inde » à l'« avenir glorieux » dans lequel les femmes ont une place. Mais quelle est-elle, cette place ? Quelles sont les représentations que le BJP a des femmes et quelle est son approche en matière d'égalité des sexes ?
Discours normatifs et ordre moral
L'homme fort du pays – qui bénéficie d'un très large soutien populaire – postule l'existence d'un modèle sexuel indien qui renvoie les femmes et les hommes à des spécificités traditionnelles et culturelles. Le nationalisme hindou défend un programme « civilisationnel » qui politise les questions sexuelles et s'appuie sur des normes de genre régressives et sur un modèle traditionnel patriarcal. Il met en avant une identité féminine hindoue « respectable », censée incarner la moralité et la pureté de la famille et de la nation.
Les femmes du groupe majoritaire ont ainsi reçu comme injonction de se conformer aux codes traditionnels et de jouer un rôle de gardiennes face à la dépravation des mœurs. Afin de préserver une identité prétendument menacée, de nombreux hommes mais aussi femmes militantes ont estimé qu'il était du « devoir divin des femmes hindoues non seulement de donner naissance à des enfants, qui serviront le Rashtra (État) hindou, mais aussi de leur donner le « samskar », ou les « valeurs sociales », qui contribueront au processus d'édification de la nation hindoue » (Dhingra, 2023).
La dépravation des mœurs et la bataille des valeurs sont des thèmes porteurs, mobilisés par le régime autoritaire indien, afin de gagner en statut et en légitimité. Elles permettent à Modi non seulement de se dresser en rempart de l'identité indienne face à la propagation de valeurs occidentales jugées « décadentes » et « néocoloniales », mais aussi de se lever contre la prétendue « menace » que représenterait l'islam pour les droits des femmes. Dans ses discours, les femmes musulmanes sont ainsi systématiquement stigmatisées comme des victimes sans défense, maltraitées par des hommes musulmans, présentés comme des êtres misogynes aux comportements prédateurs.
Prenons deux exemples d'usages détournés des droits des femmes. Tout d'abord, la loi absurde du « triple talaq » qui a criminalisé une forme de divorce chez les musulmans (Leroy, 2018). Ce texte n'a jamais eu pour but de protéger les femmes musulmanes, vu que ce procédé avait déjà été déclaré invalide et rendu juridiquement nul ! Cette initiative, soutenue par Modi, visait davantage à dénigrer la tradition islamique présentée comme opprimante et sexiste, au contraire d'une culture hindoue décrite comme vertueuse et garantissant le respect de « ses » femmes.
Ensuite, des opérations ont été menées par des groupes vigilantistes hindous d'extrême droite contre le « love jihad ». Elles reposent sur l'idée que les hommes musulmans sont des êtres perfides et hostiles qui ont l'intention de séduire des femmes hindoues pour les convertir et islamiser la société indienne. Dans cette croisade islamophobe, des hommes musulmans ont été lynchés et tués en public sans que les auteurs de ces crimes de haine ne soient jamais poursuivis.
Conclusion
Les discours dans lesquels Modi s'auto-désigne comme « sauveur des femmes » s'inscrivent dans un agenda nationaliste excluant. Les droits des femmes ne sont pas sa priorité, mais sont pris en compte tant qu'ils servent les intérêts de son parti et de son gouvernement. Agir au nom des femmes s'est ainsi souvent révélé pour le BJP, « un discours légitimateur particulièrement efficace » (Idem). Toutefois, lorsque des mouvements de femmes (de toutes religions, castes ou classes) ont contesté l'agenda politique du parti au pouvoir, les élans « protecteurs » du gouvernement se sont, sans surprise, mus en une répression féroce. Cela s'est vu à Shaheen Bagh, lorsque des femmes musulmanes ont refusé d'endosser le rôle de la « bonne victime » en luttant contre la modification de la loi sur la citoyenneté, ou lorsque des femmes du groupe majoritaire ont rejeté les normes sociales et de genre qu'on voulait leur imposer.
La réélection de Modi à un troisième mandat soulève des questions cruciales pour les droits des femmes. Alors que l'homme fort du pays va continuer à prôner le suprémacisme hindou et l'exclusion des minorités, les mouvements de femmes devront redoubler d'efforts pour faire entendre leurs voix, créer des solidarités et des dynamiques unificatrices afin de défendre leurs droits et résister aux politiques discriminatoires.
Bibliographie
Alternatives Sud (2021), « Violences de genre et résistances »
https://cetri.be/Violences-de-genre-et-resistances.
Barooah Pisharoty S. (2022), « Interview : It's Time BJP Walks the Talk on the Women's Reservation Bill », The Wire, avril
https://thewire.in/women/interview-its-time-bjp-walks-the-talk-on-the-womens-reservation-bill.
Bhandare (2024), « Women in the workforce part I and II », IDR
https://idronline.org/.
Dhingra (2023), « India's Militant Hindu Nationalist Women Leaders », New Lines Magazine, 17 avril
https://newlinesmag.com/reportage/indias-militant-hindu-nationalist-women-leaders/.
EIU (2023), « Democracy Index 2023 ».
Evans A. (2023), « The Patrilocal Trap »
https://www.ggd.world/p/the-patrilocal-trap.
Freedom House (2024), « Freedom in the World 2024 – India country report »
www.freedomhouse.org.
Frontline (2023), « Over 4.45 lakh crimes against women in 2022, one every 51 minutes : NCRB »
https://frontline.thehindu.com/.
Leroy A. (2013), « Des violences sexuelles comme stratégies de domination »
https://cetri.be/Des-violences-sexuelles-comme
Leroy A. (2018), « De l'usage du genre », Alternatives Sud, n°25/2, juin.
Leroy A. (2024), « La politique antimusulmane de la “nouvelle Inde” »,
https://www.cetri.be/La-politique-antimusulmane-de-la
The Wire (2023), « Big Talk, Small Action : Modi Govt's Work on Women's Empowerment in the Last 9 Years »
https://thewire.in/women/big-talk-small-action-modi-govts-work-on-womens-empowerment-in-the-last-9-years.
Sinha D. (2023), « Rising Female Work Participation Signals Stressed Livelihoods, Not Progress », The Wire
https://thewire.in/labour/rising-female-work-participation-signals-stressed-livelihoods-not-progress.
Taub A. (2023), « A Major Economic Challenge », NY Times
https://www.nytimes.com/2023/11/20/briefing/india-economy-gender-inequality.html
V-Dem Institute (2023), Democracy Report 2023. Defiance in the face of autocratization, University of Gothenburg.
[1] Chargée d'étude au Cetri, coordinatrice de « Dissidences dans la ‘nouvelle Inde' », Alternatives Sud, 2024, 2, Cetri-Syllepse.
[2] https://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf.
[3] Parmi de trop nombreux exemples, la libération des violeurs de Bilkis Bani, victime d'un viol collectif lors du pogrom musulman au Gujarat en 2002, le silence de Modi par rapport aux agressions sexuelles au Manipur, l'intimidation dont ont été la cible les lutteuses indiennes qui dénonçaient le harcèlement du président de la fédération indienne de lutte, par ailleurs aussi député du BJP, etc.
[4] Le pouvoir de la présidence est honorifique car son/sa titulaire est tenu·e de suivre les avis du Premier ministre, responsable devant le parlement et détenteur du pouvoir exécutif avec le gouvernement.
CETRI – Centre tricontinental
Le Centre tricontinental est un centre d'étude, de publication et de formation sur le développement, les rapports Nord-Sud, les enjeux de la mondialisation et les mouvements sociaux en Afrique, Asie et Amérique latine
https://blogs.mediapart.fr/cetri-centre-tricontinental/blog/180624/inde-au-nom-des-droits-des-femmes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
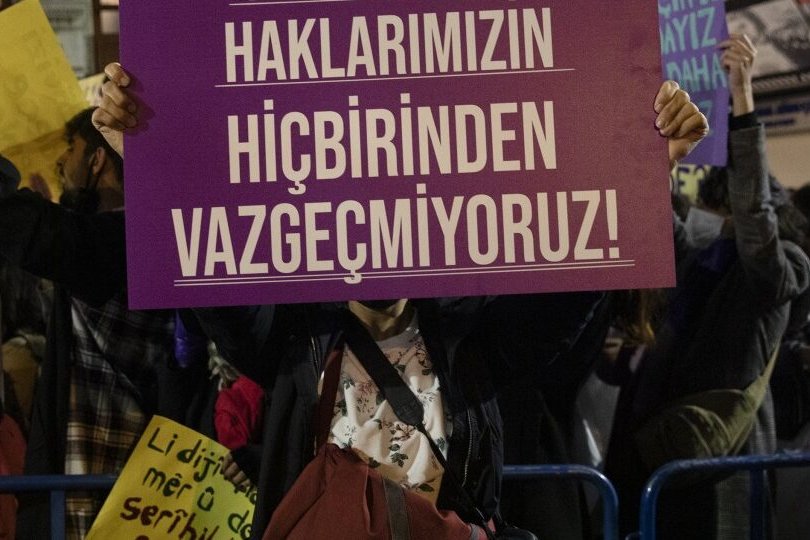
La lutte pour le nom de famille des femmes mariées en Turquie

Découvrez l'histoire et le contexte actuel de la lutte pour le droit de choisir son propre nom de famille
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/06/la-lutte-pour-le-nom-de-famille-des-femmes-mariees-en-turquie/
En Turquie, la pratique consistant à changer le nom de famille d'une femme après le mariage et l'obligation d'adopter le nom de famille de son mari est une question urgente pour les féministes. Les femmes du pays ont obtenu les droits civiques, le droit de vote et le droit de se présenter et d'être élues au cours de plus de cent ans de lutte, en disant : « nous sommes égales ». Le droit des femmes mariées à choisir leur propre nom de famille a été obtenu dans le pays après 30 ans de batailles juridiques. Cependant, les femmes ne sont pas encore en mesure d'exercer pleinement ce droit. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il ne permet pas ce choix. Le combat continue. À cet égard, il est essentiel de reconnaître la résilience, la résistance et la conscience unifiée du mouvement des femmes en Turquie.
Bien que cela puisse sembler un problème mineur pour ceux qui ne considèrent pas l'aspect des droits, il s'agit en fait d'une question ayant de fortes implications politiques dans toutes les dimensions. Le nom de famille d'une femme mariée sert d'espace symbolique entouré de barbelés, conçu pour protéger le pouvoir enraciné du patriarcat. Surmonter ces barbelés par des moyens légaux pendant plus de trente ans a été une réalisation pertinente pour les femmes dans l'effort de démanteler le « mythe de la Sainte Famille ».
Le nom de famille, en tant que composante de l'espace individuel et autonome dans lequel une femme se perçoit, relève du droit à la vie privée en vertu de la législation sur les droits humains. En d'autres termes, la femme est une personne autonome avec sa propre identité et ne peut être réduite à une simple extension de l'homme, ni confinée dans les limites de la « Sainte Famille » à travers le mariage. L'imposition patriarcale à la femme mariée d'adopter le nom de famille de son mari est un outil qui vise à subordonner les femmes. Exiger des femmes qu'elles renoncent à leur identité et à leur autonomie lorsqu'elles fondent une famille, c'est se soumettre au pouvoir excessif du patriarcat. Résister à cette exigence, c'est affronter le patriarcat et contribuer à la diminution de son pouvoir – une contestation que le patriarcat n'est pas disposé à accepter.
Les institutions patriarcales ont résisté aux efforts du mouvement des femmes pour faire progresser les acquis et les droits garantis par le Code civil turc, c'est pourquoi elles refusent de reconnaître et d'appliquer la décision de la Cour constitutionnelle. Le Patriarcat perçoit toute demande d'égalité comme un « excès » qui confronte son pouvoir, en particulier en ce qui concerne la « Sainte Famille » et le « principe d'unité dans le nom de famille ».
La lutte au fil des ans
Lorsque nous examinons la trajectoire historique des mouvements luttant pour les droits humains, il est évident que les avancées ne se produisent pas de manière linéaire ou continue, et que les mouvements progressistes sont souvent confrontés à la brutalité de la répression. Le mouvement en faveur des droits humains des femmes a également progressé à travers d'intenses luttes, malgré la répression. Il y a donc des moments décisifs où les progrès deviennent irréversibles. Nous sommes actuellement à ce stade pour le mouvement des droits des femmes en Turquie. Malgré des années de répression gouvernementale et d'interventions systémiques et structurelles, la lutte qui a débuté il y a 30 ans pour modifier le Code civil en ce qui concerne le nom de famille des femmes mariées a atteint un point critique.
La Cour constitutionnelle turque a rejeté deux demandes d'annulation de l'article 187 du Code civil turc, qui oblige les femmes à adopter le nom de famille de leur mari après le mariage. La première a été déposée en 1998 au motif que la loi était inconstitutionnelle. Cependant, la Cour constitutionnelle n'a pas considéré que l'obligation violait le principe d'égalité consacré par la Constitution et a donc rejeté la demande d'annulation. Imperturbables, les femmes ont continué dans la lutte. Après un délai d'attente de dix ans requis par la Constitution, elles ont déposé une nouvelle requête auprès de la Cour constitutionnelle. En 2011, le tribunal a statué, pour la deuxième fois, que le maintien d'un nom de famille commun était obligatoire pour protéger l'intégrité de la famille et la paternité des enfants, déclarant qu'il est nécessaire d'adopter le nom de famille de l'homme, et que cette exigence ne serait pas contraire au principe d'égalité de la Constitution. Ainsi, la Cour constitutionnelle a maintenu la position constante sur cette « patate chaude » qu'elle reçoit du patriarcat à intervalles réguliers.
Encore une fois, le mouvement des femmes n'a pas abandonné. Après une autre période d'attente de dix ans, une nouvelle demande a été présentée au tribunal pour la troisième fois. En 2023, la Cour constitutionnelle a finalement annulé des décisions antérieures, car il n'était plus possible d'ignorer le caractère contraignant des conventions relatives aux droits humains dont la Turquie est signataire, telles que la Convention européenne des droits de l'Homme et la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. En outre, la lutte du mouvement des femmes, parallèlement aux avancées juridiques dans la promotion de l'égalité des sexes, a contribué à la décision du tribunal turc, aux améliorations mises en œuvre dans la Constitution, à la mise en place du droit depétition individuelle en appel, au niveau national, pour prévenir les violations des droits, et des décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme sur les violations en ce qui concerne le nom de famille adopté par les femmes mariées. La Cour constitutionnelle a éliminé le problème qui persistait depuis 30 ans, à savoir le problème du nom de famille des femmes mariées. Juridiquement, cette question n'existe plus en Turquie, puisque la loi pertinente sur cet aspect a été annulée.
En conséquence, selon la décision du 24 avril 2023, les femmes mariées devraient avoir trois options : adopter uniquement le nom de famille du mari ; adopter le nom de famille du mari avec le nom de jeune fille ; ou n'adopter que le nom de famille qu'elles avaient déjà avant le mariage.
L'inscription de cette dernière option dans la décision de la Cour constitutionnelle est une réalisation juridique d'une grande pertinence.
Le contexte actuel
L'obligation pour les femmes mariées d'adopter le nom de famille de leur mari a été légalement abolie le 28 janvier 2024, lorsque la décision de la Cour constitutionnelle turque est entrée en vigueur. Cependant, une intense dispute politique a commencé à la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui était censée être en vacances pendant la période de chaleur estivale extrême, et devrait reprendre ses activités à l'automne dans le pays. La bataille actuelle découle du refus du gouvernement de reconnaître la décision de la Cour constitutionnelle, malgré son caractère définitif, après 30 ans d'articulation des femmes. La question a dégénéré en un différend qui remet en question le maintien de l'obligation d'adoption du nom de famille du mari par la femme après le mariage, malgré la décision contraignante d'annuler la règle par la Cour constitutionnelle.
Aujourd'hui, les organes exécutifs et législatifs se sont chargés de protéger la forteresse du patriarcat en ce qui concerne le nom de famille des femmes mariées. La lutte des femmes et la victoire juridique reconnue par la Cour constitutionnelle sont ignorées. Le gouvernement a inclus le nom de famille des femmes mariées dans le 9e « paquet » judiciaire, qui est un vaste projet de loi, comme si un changement de législation était nécessaire. Selon le projet de loi, les femmes mariées ne pourront pas adopter uniquement le nom de famille qu'elles avaient déjà avant le mariage. Le texte du PL cherche à rétablir le dispositif déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle. La discussion sur le projet de loi, qui a débuté le 11 juillet 2024, a duré 20,5 heures et s'est terminée le 12 juillet. Un débat ininterrompu a eu lieu à la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui a été contrainte de reporter les vacances d'été et de reprendre ses activités. Ankara a connu l'été le plus chaud et le plus cruel en termes de droits des femmes. Malgré la discussion intense dans la Commission, la plupart n'étaient pas convaincus. Le projet n'a pas été présenté à la plénière pour le traitement final et a été reporté à la fin de la pause estivale.
Bien qu'il y ait des rapports selon lesquels le projet de loi pourrait être retiré grâce aux efforts de communication et aux luttes du mouvement des femmes, dirigé par l'Articulation des femmes pour l'égalité (Women's Platform for Equality – EŞIK), certains dirigeants du parti au pouvoir et du ministère de la Famille et des Services sociaux, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée. Dans la nouvelle législature, qui commence en octobre après la fin des vacances d'été, il reste la possibilité que le gouvernement demande l'approbation de la loi en plénière de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Il est clair qu'il y aura une bataille difficile, prolongée et persistante au Parlement. Les organisations de défense des droits de la femme et les associations d'avocats en Turquie suivent la situation de près. Ce combat est un effort unifié : protéger l'État de droit appliquant les décisions judiciaires, résister à un législatif contrôlé par les puissances dominantes qui veut saper les victoires dans le domaine juridique et affronter le patriarcat en défendant l'existence et l'identité des femmes.
Nezahat Demiray
Nezahat Doğan Demiray est titulaire d'un doctorat en droit constitutionnel et travaille sur les droits humains des femmes, la pauvreté et l'inégalité entre les sexes. Elle est membre de la Marche Mondiale des Femmes en Turquie.
Édition par Bianca Pessoa et Helena Zelic
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
Langue originale : anglais
https://capiremov.org/fr/analyse/la-lutte-pour-le-nom-de-famille-des-femmes-mariees-en-turquie/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Conférence internationale sur la prostitution au Liban avec DoubleX

En juillet, DoubleX, association féministe libanaise tout juste créée, a organisé à Beyrouth une grande conférence sur la lutte contre le système prostitutionnel, premier événement de ce type dans le monde arabe. Alexine, survivante française, y est intervenue.
Tiré de Entre les ligne et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/14/conference-internationale-sur-la-prostitution-au-liban-avec-doublex/
« Notre objectif ? Mettre fin à l'exploitation sexuelle », peut-on lire en arrivant sur le site de la toute nouvelle association féministe abolitionniste libanaise, DoubleX. Fondée par Ghada Jabbour, qui luttait contre laprostitution au sein de Kafa, association membre de CAP international, cette association est la première à centrer son action sur la lutte contre le système prostitutionnel, dans une optique féministe et abolitionniste.
En juillet, elle a organisé conjointement avec Kafa une grande conférence de deux jours, pour faire savoir en quoi la prostitution, y compris filmée est une violence contre les femmes et un obstacle à l'égalité, et comment le modèle abolitionniste est le mieux à même de le combattre.
Dans son introduction, Ghada Jabbour a rappelé que les droits des femmes devaient être reconnus comme indissociables des droits humains, et a fait part des constats de terrain sur le système prostitutionnel :
« Nous voyons bien comment la prostitution est une conséquence des violences et des discriminations mais aussi comment le système de la prostitution recouvre de nombreuses violences, en particulier les violences sexuelles. Nous sommes toutes concernées par la prostitution, directement ou indirectement, parce qu'elle déshumanise les femmes et en font des objets de plaisir pour les hommes ».
DoubleX invite survivantes, expertes, activistes
Pour en parler, DoubleX a fait venir du monde entier des intervenantes prestigieuses, et en premier lieu des survivantes. Parmi elles, Alexine Solis, survivante française et une des autrices du podcast La vie en rouge, a expliqué en quoi la prostitution était « la forme la plus flagrante de violence masculine contre les femmes », et était contraire à l'égalité, et par essence une atteinte aux droits humains.
« C'est précisément parce que vous ne voulez pas de cet acte sexuel que les prostitueurs veulent vous payer pour passer outre à votre consentement », a-t-elle expliqué. Cherie Jimenez, présidente de CAP international et elle même survivante, et Mia D Foite, survivante irlandaise, étaient également présentes.
Par ailleurs, des expertes étaient invitées, en particulier Reem Alsalem, rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'Onu, qui a publié au printemps un rapport majeur sur la prostitution qui reconnaît l'analyse abolitionniste comme la seule pertinente pour s'attaquer à cette violence patriarcale qu'est la prostitution.
Melissa Farley, psychologue et chercheuse états-unienne qui a fait de multiples études sur les « clients » prostitueurs et récemment une étude majeure sur les liens pornographie-prostitution, est venue parler de prostitution filmée, tout comme Alyssa Ahrabare pour Osez le féminisme ! Le Réseau européen des femmes migrantes était également présent, pour parler de la façon dont le système prostitueur cible toujours les plus vulnérables.
Une très belle conférence de lancement pour DoubleX, à qui l'on souhaite longue vie. L'association est déjà présente sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, sous le nom doubleXleb), et a un site Internet : https://doublex.org
A lire également :
« Ghada Jabbour, Au Liban, la prostitution doit être reconnue comme une violence faite aux femmes »
Ghada Jabbour est une des fondatrices de Kafa (enough) Violence and Exploitation, une ONG leader de la lutte contre les violences faites aux femmes au Liban, Elle a dirigé « EXIT », une précieuse recherche de terrain menée en 2019 et la commente pour nous, au regard de la situation du système prostitueur au Liban.
Kafa (enough) Violence and Exploitation est une ONG leader de la lutte contre les violences faites aux femmes au Liban, membre de la coalition abolitionniste dont le Mouvement du Nid est membre fondateur.
Sandrine Goldschmidt
Sandrine Goldschmidt est chargée de communication au Mouvement du Nid et militante féministe. Journaliste pendant 25 ans, elle a tenu un blog consacré aux questions féministes (A dire d'elles – sandrine70.wordpress.com) et organise depuis quinze ans le festival féministe de documentaires “Femmes en résistance”. Aujourd'hui elle écrit régulièrement dans Prostitution et Société.
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/actus/liban-doublex/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Socialiser le travail du care, transformer l’économie

Lisez le résumé du séminaire « Socialiser le travail du care : expériences et luttes féministes »
Après des décennies d'organisation, de mobilisation et de lutte, ayant récemment traversé la pandémie de covid-19, il est aujourd'hui possible d'affirmer que le travail du care est entré dans l'agenda public dans différentes parties du monde. Les horizons et perspectives mobilisé.e.s autour de ce même agenda sont divers – et même antagonistes. Les expériences de mouvement-pensée féministe nous aident à comprendre les différends autour des soins.
Ce texte est une synthèse du séminaire « Socialiser le travail du care : expériences et luttes féministes », qui s'est tenu virtuellement le 4 juin 2024, avec la participation d'Amanda Verrone, du Syndicat LAB du Pays Basque, Cecília Kitombe, d'Ondjango Feminista d'Angola, Dory Capera, de la Confédération Syndicale des Amériques, Magdalena León, du Réseau latinoaméricain des femmes pour la transformation de l'économie (Remte), d'Équateur, et Yessica Restrepo, de la Confluencia de Mujeres, de Colombie.
Points de départ
La perspective qui nous guide considère le travail du care comme un vrai travail, une pratique et des relations qui façonnent la durabilité de la vie. C'est une compréhension qui ne se limite pas aux soins directs d'une personne, mais qui implique l'ensemble des conditions de possibilité de vie, c'est-à-dire les personnes, la nourriture, les semences et les biens communs, ainsi que les différentes formes de relation économique qui vont au-delà de ce qui est acheté et vendu sur le marché. Nous situons les soins dans des relations interdépendantes, affirmant l'autonomie et l'autodétermination comme principes. Nous considérons également les soins comme faisant partie de l'écodépendance, allant au-delà de la vie humaine.
Comme partagé par le Réseau lationoaméricain des femmes pour la transformation de l'économie (Remte), le travail du care est une expérience économique et intégrale des femmes. C'est un travail féminisé et racialisé qui se déroule dans différents contextes, espaces et circonstances et qui est imprégné de contradictions. Bien qu'elle puisse mobiliser et créer des principes éthiques pour vivre ensemble (tels que la solidarité et la réciprocité), la responsabilité des soins est immergée dans des relations oppressives de genre, de race et de classe. Un défi de départ est de récupérer cette expérience comme catalyseur de transformations structurelles dans les manières de (re)produire la vie en commun.
Ce qu'on appelle maintenant le travail du care a ses racines dans ce que le féminisme socialiste a élaboré pendant des décennies en termes de reproduction et que l'économie féministe a systématisé dans le pari sur la durabilité de la vie. Cette perspective est également liée à l'élargissement de la notion de conflit capital-travail à la notion de conflit capital-vie, expliquant que la logique de l'accumulation du capital est incompatible avec la logique du soin et du maintien de la vie.
Le soin à l'ordre du jour de la construction du mouvement
Il existe plusieurs stratégies et outils pour placer le travail du care au centre de l'agenda politique. En Angola, par exemple, Ondjango Feminista a organisé une enquête auprès des femmes pour introduire ce thème dans la société. Sur les places, sur les marchés et dans les écoles, le groupe a parlé aux femmes de la façon dont elles utilisent leur temps. Avec un taux de fécondité supérieur à la moyenne mondiale (5,3 en Angola ; 2,2 dans la moyenne mondiale), les femmes ont déclaré que s'occuper de leurs enfants fait partie des responsabilités qui les accablent le plus dans leur vie quotidienne. Elles ont conclu que même sans politique de soins, il existe effectivement un système de soins soutenu par le travail non rémunéré des femmes.
En Amérique latine, le travail du care a été au centre des réponses des femmes aux offensives néolibérales visant à privatiser l'éducation publique et les services de santé, par exemple. La mémoire et l'actualité de ces luttes sont la référence pour se méfier des propositions d'organisations telles que le Fonds monétaire international (FMI) autour des soins. Les prélèvements du FMI sur les politiques économiques des pays endettés augmentent le coût de la vie et réduisent les investissements de l'État dans les services publics, ce qui implique davantage de travail non rémunéré pour les femmes. Le FMI considère que la responsabilité accrue des femmes en matière de soins constitue un obstacle à leur participation au marché du travail. Sans changer ses conditions, il encourage de fausses solutions basées sur le secteur privé et la précarité. Il s'agit d'une perspective d'inclusion des femmes dans ce système, sans transformer les structures d'oppression. Il ne convient donc pas à la majorité des femmes de la classe ouvrière.
Les luttes territorialisées pour le droit à la garderie et aux espaces collectifs pour la nourriture sont à la base des élaborations autour du droit aux soins – qui implique à la fois les droits de ceux qui sont soignés et de ceux qui soignent. Dans cette perspective, il existe un mouvement simultané de reconnaissance, de redistribution et de valorisation sociale et économique du travail du care, comme le rapportent les camarades de la Confédération Syndicale des Amériques. À ce titre, nous comprenons que le travail n'est pas seulement un travail rémunéré – ce qui a été fondamental dans les luttes des personnes qui s'occupent des autres à domicile.
La division sexuelle du travail, toujours articulée avec la division raciale du travail, constitue la base matérielle de l'oppression des femmes. En plus de séparer le travail des hommes et des femmes, la production et la reproduction, cette division hiérarchise encore ces sphères. Qu'ils soient non rémunérés ou mal rémunérés, le travail domestique et de soins et les personnes qui le font – femmes, noires, immigrées – sont dévalorisées. Lorsqu'ils sont payés, ces travaux sont effectuées en conditions de précarité et sans protection sociale.
Les camarades du Syndicat LAB ont partagé le chemin de la mobilisation d'une grève générale pour la socialisation du travail du care au Pays Basque en novembre 2023. Menée par le mouvement féministe, il s'agissait d'une construction qui impliquait différents secteurs du syndicalisme, y compris les travailleurs de l'industrie et des télécommunications. La grève a des antécédents dans un processus de recomposition de la classe ouvrière dans le syndicat. Les soins ont ainsi été mis à l'ordre du jour des luttes contre la privatisation.
Les syndicalistes féministes ont placé la lutte pour les conditions de vie et de travail des travailleuses domestiques et des soignantes au centre de leurs revendications, ainsi que la perspective de lutter pour le temps de soins pour l'ensemble de la classe ouvrière. Ces axes sont liés à la lutte pour un système de soins public-communautaire. Cela s'est fait par l'auto-organisation des femmes dans un secrétariat féministe, la consolidation d'une perspective antiraciste, la construction d'alliances et une combinaison d'outils de mobilisation et de formation.
En organisant une grève générale avec de telles revendications, il est devenu clair que toutes les travailleuses n'ont pas le droit de grève, car il y a des emplois qui ne peuvent tout simplement pas être laissés de côté, comme c'est le cas avec le travail du care. Ce processus a été historique pour le mouvement syndical et a reformulé, dans la pratique, le concept classique de grève, car il élargit la notion de travail.
Il est nécessaire d'avancer dans l'élaboration de la réalité concrète du travail du care. Une grande partie de ce qui est compris sur le travail du care est comme un miroir du travail salarié. Il y a eu des progrès dans les discussions sur la redistribution, les temps et les droits, mais on discute peu de la logique de ce travail. Cela ne peut être débattu qu'en considérant les expériences des femmes, leurs réseaux, leurs relations et aussi les technologies. Cela s'articule nécessairement avec les conditions de travail et les possibilités de socialisation, articulant les dimensions publique et communautaire. Un indice partagé était de retrouver les principes, les relations et la dynamique des soins qui sont au cœur de la durabilité de la vie – et donc de l'économie – pour la transformer.
Des politiques publiques pour réorganiser les soins et mettre la vie au centre
Différentes expériences de construction de politiques nationales de travail du care sont en cours, notamment en Amérique latine, comme c'est le cas du Brésil. Certaines d'entre elles prennent la forme de systèmes nationaux de soins. Ces constructions sont plus susceptibles de contribuer à transformer les fondements de l'inégalité lorsqu'elles sont en phase avec les politiques redistributives des gouvernements en question.
Les camarades de la Confluence des femmes de Colombie ont partagé leur expérience actuelle. Dans le pays, l'État a soutenu la création d'un système de soins qui combine des politiques pour les femmes et des expériences de politiques territorialisées. L'exemple principal est les Manzanas de Cuidado, des espaces publics de soins qui favorisent également l'autonomie des femmes. Ils créent les possibilités de collectiviser le travail et d'effectuer des tâches qui seraient réalisées dans les foyers, comme laver les vêtements. Cela contribue à ce que les femmes aient le temps de se reposer, de socialiser et d'avoir plus d'autonomie. Dans un territoire affecté par de nombreuses années de conflits armés et de forces paramilitaires et par l'avancée des sociétés minières transnationales, les femmes partagent cet engagement car elles comprennent que, à la campagne et en ville, les soins communautaires sont un travail et une pratique de leadership féminin, ce qui implique des besoins en temps et en organisation.
Effectivement, il y a les systèmes de soins idéaux et les systèmes de soins de facto, où il y a simultanément surcharge et protagonisme des femmes. Prendre soin implique du temps de travail, l'organisation de réseaux de soins et la mobilisation de diverses ressources autour du soin de la vie en commun.
Face à la limite de survie de l'humanité et de la planète, il est nécessaire de construire les conditions pour rompre avec la logique d'accumulation, transformer la reproduction mais aussi changer la production (qu'est-ce qui est produit, comment, pour quoi et pour qui ?) de la logique du soin et de la durabilité de la vie. C'est là que réside le pouvoir de transformer toute l'économie de la logique et des temps de soins.
Le webinaire a été organisé par l'organisation féministe SOF Sempreviva, la Marche mondiale des femmes du Brésil et Capire, avec le soutien du Ministère des femmes du Gouvernement fédéral du Brésil par le financement public n°954083/2023.
Écrit par Tica Moreno
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
https://capiremov.org/fr/analyse/socialiser-le-travail-du-care-transformer-leconomie/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Géopolitique du commerce des armes

La récente décision britannique de suspendre une partie de ses ventes d'armes à Israël intervient à quelques jours du dixième anniversaire de la signature du Traité des Nations unies sur le commerce des armes. L'occasion de faire le point sur la géopolitique du trafic d'armes et la législation à cet égard. Ainsi que sur la responsabilité des États.
Tiré du blogue de l'auteur.
La décision du gouvernement britannique de faire une « pause » dans la livraison d'armes à Israël, pour symbolique qu'elle soit – elle ne concerne qu'une partie des armes livrées et les exportations britanniques ne représentent qu'un pourcent des importations israéliennes –, remet au-devant de la scène la responsabilité des États ; leur incohérence et leur cynisme. Le 20 juin dernier, les experts et expertes de l'ONU réitéraient ainsi leur demande que les États et les entreprises cessent immédiatement leur transfert d'armes vers l'État israélien [1]. Cela revenait simplement à exiger que les règles et les lois soient respectées.
Le 2 avril 2013, 155 États ont adopté le Traité des Nations unies sur le commerce des armes. À l'heure actuelle, à l'exception de la Russie, les plus grands exportateurs d'armes au monde en sont signataires. Mais les États-Unis ne l'ont pas ratifié. Or les articles 6 et 7 du traité obligent à interdire la fourniture d'armes à des pays qui pourraient les utiliser pour commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou d'autres crimes de guerre, ou qui pourraient s'en servir pour commettre ou faciliter des violations graves des droits humains ou du droit humanitaire international [2].
Tout transfert vers l'État israélien – qui, à l'instar des États-Unis, a signé mais non ratifié ce Traité – est donc interdit. Une interdiction violée par ceux-là même qui ont fixé les règles. Malheureusement, au cours de la dernière décennie, les articles 6 et 7 du Traité (de même que la quinzaine d'embargos de l'ONU sur les armes vers certains pays) ont été enfreints à maintes reprises et en toute impunité [3]. La force prime et foule au pied le droit. Et la double logique du profit et de la militarisation hypothèque toute solution.
Géopolitique de l'armement
Le niveau de l'armement mondial peut être mesuré sous trois angles : dépenses militaires, import-export, part du budget militaire dans les économies nationales. Ces dix dernières années, et tout particulièrement avec les conflits armés en Ukraine et à Gaza, les dépenses militaires mondiales n'ont cessé d'augmenter. Les États-Unis en absorbent 37% et la Chine 12%, soit à eux deux quasiment la moitié du total. Dix États représentent les trois-quarts de ces dépenses au niveau du monde. La Russie, l'Inde et l'Arabie saoudite sont dans le top 5, tandis que la Grande-Bretagne est, en Europe, le pays le plus dépensier en la matière.
En 2023, par rapport à l'année précédente, les dépenses militaires d'Israël et de l'Ukraine – tous les deux engagés dans une guerre dévastatrice – ont augmenté respectivement de 24% et de 51%. Mais, la hausse la plus spectaculaire s'est produite en République démocratique du Congo qui, confrontée au conflit armé dans l'Est du pays et aux tensions grandissantes avec le Rwanda, a plus que doublé ses dépenses militaires. La Belgique, quant à elle, est classée 34ème et ses dépenses militaires représentent 0,3% du total mondial [4].
Le commerce des armes est encore plus concentré que les dépenses militaires : pour la période 2019-2023, les États-Unis ont assuré 42% des exportations mondiales d'armes [5]. Loin derrière, la France et la Russie occupent respectivement les deuxième et troisième places, avec chacune 11% des parts du marché. Avec la Chine et l'Allemagne, ces pays constituent les principaux exportateurs d'armes et concentrent ensemble plus des trois-quarts des exportations. À l'autre bout de la chaîne, du côté des importateurs, l'Inde occupe la première place, représentant près de 10% des importations mondiales de l'armement. Les tensions avec ses voisins, le Pakistan et la Chine, ainsi que des choix stratégiques, expliquent en grande partie cette position. L'Arabie saoudite, le Qatar, l'Ukraine et le Pakistan figurent parmi les cinq plus grands importateurs. Ils totalisent ensemble 35% des importations.
Plusieurs États, dont certains sont parties prenantes de conflits armés, dépendent très largement d'une ou deux sources pour leur approvisionnement en armes. Par exemple, Israël, quinzième importateur mondial d'armement, s'appuie presque exclusivement sur les États-Unis (69%) et l'Allemagne (30%) pour ses importations d'armes. De même, 75% des armes importées d'Arabie saoudite proviennent des États-Unis ; 77% de l'armement russe importé est chinois.
Une autre manière d'appréhender le poids des armes dans l'économie est de mesurer la part des dépenses militaires dans le produit intérieur brut (PIB) d'un État. Sous cet angle-là, ce ne sont pas les États-Unis qui sont en tête – avec des dépenses militaires qui représentent 3,4% du PIB, le pays est classé 9ème –, mais bien l'Ukraine, où plus d'un tiers du PIB est consacré à l'armement. Les dépenses militaires de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de la Russie, d'Oman et d'Israël dépassent les 5% du PIB.
Militarisation et « sécuritisation »
Au lendemain de l'invasion russe en Ukraine, puis, à nouveau, après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, les actions en bourse des grandes entreprises de la défense américaine ont connu une soudaine hausse. Les guerres profitent à quelques-uns… L'industrie de l'armement alimente les conflits armés qui génèrent en retour d'importants profits pour ce secteur, étroitement imbriquée aux intérêts et stratégies des États. Il est d'autant plus difficile de briser ce cercle vicieux que les États-Unis poussent à une militarisation, par le biais notamment de l'OTAN. Cette alliance internationale – qui regroupe trente-deux membres, principalement européens – s'est ainsi fixé pour objectif que chaque État partie consacre au moins 2% de son PIB aux dépenses militaires (ce qui est déjà le cas de la Grande-Bretagne, de la France, de la Pologne, de la Grèce et de la Finlande). En revanche, des pays comme La Belgique où « seulement » 1,2% du PIB est consacré aux dépenses militaires (1,5% en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas) devraient ainsi consacrer beaucoup plus d'argent à ce poste, au détriment de services sociaux tels que l'éducation et la santé, secteurs autrement plus stratégiques.
De manière plus organique, la militarisation est catalysée par un narratif et une logique, qu'elle alimente. Le terme de « sécuritisation » a été introduit pour rendre compte du « processus par lequel un problème politique est identifié et traité comme une question de sécurité », donnant une signification particulière, socialement construite, à la menace et à l'(in)sécurité [6]. Ce phénomène est particulièrement évident dans la politique européenne face à la migration, à travers notamment la militarisation des frontières.
La célèbre formule de Clausewitz, « la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens », doit dès lors être corrigée et complexifiée en ce sens que la guerre change la signification de la politique, en la réduisant à un jeu stratégique. Et ces « autres moyens » – dont l'armement – participent de cette reconfiguration des conflits en termes (uniquement) sécuritaires, tendant à hypothéquer de la sorte toute solution politique et, à terme, la perspective d'une paix juste et digne.
Notes
[1] UN, « States and companies must end arms transfers to Israel immediately or risk responsibility for human rights violations : UN experts », 20 juin 2024, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/06/states-and-companies-must-end-arms-transfers-israel-immediately-or-risk.
[2] Le texte intégral du Traité est accessible ici : https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf. Voir également NTI, Arms Trade Treaty (ATT), https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/arms-trade-treaty-att/.
[3] Amnesty International, « Le terrible bilan humain du total mépris des règles du Traité sur le commerce des armes de la part des États », 19 août 2024, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2024/08/global-governments-brazen-flouting-of-arms-trade-treaty-rules-leading-to-devastating-loss-of-life/. Lire aussi The companies arming Israel and their financiers, juin 2024, https://www.cncd.be/IMG/pdf/report_-_the_companies_arming_israel_and_their_financiers_-_june_2024-2.pdf.
[4] Sipri, Spiri fact sheet. Trends in world military expenditure, 2023, avril 2024, https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf. Sauf mentions contraires, tous les chiffres proviennent de cette étude.
[5] Sipri, Spiri fact sheet. Trends in international arms transfers, 2023, mars 2024, https://www.sipri.org/publications/2024/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2023. Sauf mentions contraires, tous les chiffres proviennent de cette étude.
[6] ENAAT, Rosa Luxembourg Stiftoung, Une Union militarisée. Comprendre et affronter la militarisation de l'Union européenne, 2021, https://rosalux.eu/en/2021/import-1981/.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
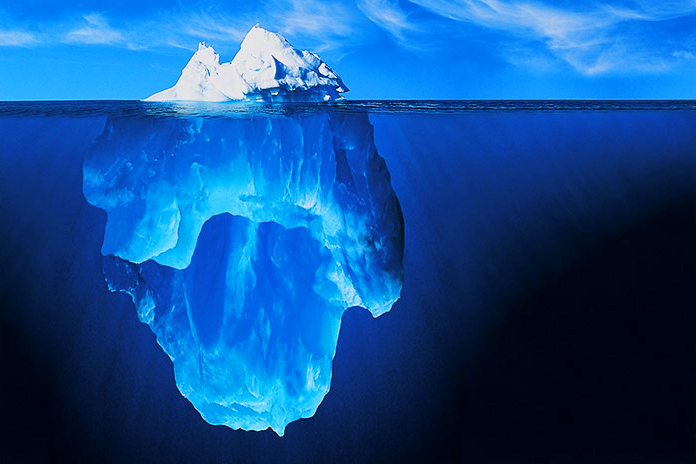
Parole politique et bloc social
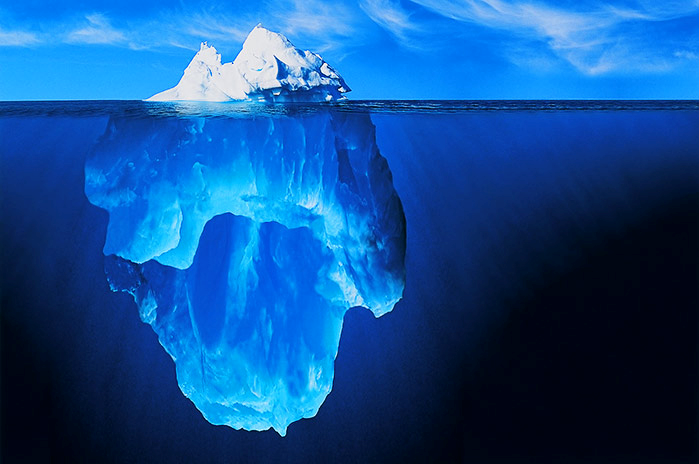
Dans cette tribune, André Prone, environnementaliste, poète et essayiste, analyse la dynamique de fascisation des droites néolibérales et sociales-libérales à l'échelle nationale et internationale.
Tiré de L'Humanité
5 septembre 2024
Des personnalités comme Le Pen, Meloni, Trump et d'autres, ainsi que leurs mouvements, ne sont que la partie émergée de l'iceberg de ce « nouveau bloc bourgeois ».
La situation politique actuelle est marquée par la montée de mouvements et de figures politiques que l'on peut qualifier de fascisantes, telles que Marine Le Pen en France, Giorgia Meloni en Italie ou Donald Trump aux États-Unis, parmi d'autres. Mais, pour comprendre ce phénomène, il importe d'analyser la dynamique de fascisation des droites néolibérales et sociales-libérales à l'échelle nationale et internationale, ainsi que ce
que cela implique pour les forces de gauche, les mouvements sociaux et
les problématiques écologiques.
Il serait naïf ou contre-productif de se concentrer uniquement sur les figures de l'extrême droite sans examiner le phénomène plus large de fascisation qui touche toutes les droites néolibérales et sociales-libérales, dont la Macronie et ses équivalents occidentaux sont parmi les principaux protagonistes.
Ce processus, théorisé par von Hayek et Milton Friedman au cours de la grande dépression des années 1930, et que l'on peut qualifier de néolibéralisme factieux, n'a d'autre but que de renflouer le capitalisme.
Des personnalités comme Le Pen, Meloni, Trump et d'autres, ainsi que leurs mouvements, ne sont que la partie émergée de l'iceberg de ce « nouveau bloc bourgeois » qui œuvre à sortir le capital décadent de sa crise systémique et environnementale.
En effet, derrière ces figures fascisantes se cache, notamment depuis la prétendue crise pétrolière des années 1970, ce bloc bourgeois incarné par les droites classiques et les courants sociaux-libéraux qui cherchent à protéger le capitalisme à tout prix, tout en faisant mine de combattre certains mouvements ouvertement fascistes. Ce soutien implicite entre l'extrême droite, la droite classique et certaines branches du social-libéralisme se manifeste principalement dans la défense du « soldat
Capital ».
Leurs objectifs communs, parfois dissimulés, sont d'autant plus importants qu'ils sont soutenus par des institutions supranationales telles que le FMI, l'OMC, l'Union européenne et l'Otan, dont le rôle crucial dans le maintien de l'ordre néolibéral factieux mondial est à souligner.
Par conséquent, attaquer les figures politiques de l'extrême droite et leurs mouvements, sans analyser l'ensemble des objectifs capitalistes qui les sous-tendent, peut conduire à une compréhension superficielle des enjeux idéologiques et géopolitiques en cours. Pour construire une riposte politique et écologique efficace, il importe de distinguer entre le bloc
électoral et le bloc social. Bien que l'importance du premier ne doive pas être négligée, la priorité doit être donnée à la construction d'un bloc social capable de mener des luttes sociales et écologiques de grande envergure, tout en travaillant à construire des solidarités de classe et des pratiques relevant de ce que nous pourrions qualifier de « quotidienneté
écomuniste ». C'est particulièrement pertinent face à une social-démocratie qui, tout en se réclamant de la gauche, est loin d'être une force de transformation et agit avant tout comme un accompagnateur du néolibéralisme.
La question centrale consiste donc à savoir comment contenir et renverser ce « nouveau bloc bourgeois fascisant », notamment avec la faiblesse des forces qui prétendent incarner un bloc électoral de rupture.
La construction d'un bloc social solide et organisé est indispensable pour contrer efficacement les dynamiques fascisantes. Cela nécessite une mobilisation intense, une éducation politique approfondie et la formation d'alliances stratégiques au sein des mouvements de gauche et progressistes, des forces syndicales, associatives, écologiques et citoyennes, sur de véritables positions de classe. Voilà pourquoi l'analyse
politique de la situation actuelle doit se situer au-delà des figures individuelles et examiner les dynamiques systémiques et idéologiques qui sous-tendent la montée des droites fascisantes.
Quant à la riposte, elle nécessite une claire distinction entre le bloc électoral et le bloc social, capable de porter une véritable transformation politique, sociale, culturelle et écologique. Le rôle du Nord global dans ce processus doit également être pris en compte, car les pays qui le composent jouent un rôle de premier plan dans la perpétuation des
politiques néolibérales factieuses du nouveau front bourgeois à l'échelle
nationale et internationale.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un changement de période historique : crise structurelle et montée de l’extrême droite

Nous vivons une période marquée par la montée des guerres et des violences. Les contradictions sociales, écologiques, politiques, idéologiques, toujours très présentes, s'approfondissent dans chaque pays et à l'échelle mondiale. L'extrême droite progresse, sous différentes formes, dans un grand nombre de régions du monde.
25 août 2024 | Source : https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article71911
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/12/un-changement-de-periode-historique/#more-85532
Les mouvements sociaux et citoyens sont toujours présents et actifs, mais ils sont à la recherche de la définition de nouvelles perspectives et de nouvelles stratégies. L'hypothèse est que nous sommes dans une crise structurelle qui nous rappelle, par certains côtés, celle des années 1930. Elle marque un changement de période au niveau de l'organisation du monde. Même si les situations ne se reproduisent jamais pareillement, la référence permet de réfléchir à certaines caractéristiques de la situation actuelle avec l'approfondissement d'une crise économique et sociale, des guerres, des alliances entre les droites et les extrêmes droites, des changements géopolitiques et idéologiques[3]. L'interrogation porte sur la définition de la situation et de la période que nous vivons. Elle rappelle une des dernières anecdotes soviétiques ; celle d'un homme hagard qui, en 1989, sur la place Rouge, interpelle les passants en demandant à chacun : quelle heure est-il ? Traduisons sa question : qu'est-ce qui se passe ? dans quelle période sommes-nous ?
Les grandes contradictions à l'œuvre sont toujours celles qui caractérisent le capitalisme contemporain même si leur caractérisation change suivant les périodes. Les changements concernent toutes les dimensions. Trois grands types de contradictions sont à l'œuvre. La première est la question sociale, les rapports entre les classes sociales, avec l'importance considérable des inégalités et des discriminations. La deuxième est un élément nouveau et déterminant, la rupture écologique, et la manière de penser le climat, la biodiversité, la Nature. La prise de conscience de cette contradiction est plus récente, la question est toujours controversée. La phase sécuritaire du néolibéralisme est accentuée par la rupture écologique qui introduit une très grande discontinuité, déjà sensible, avec la crise climatique et ses conséquences sur la biodiversité. La troisième concerne les guerres et la démocratie, locale, nationale et internationale. La démocratie interroge les rapports entre le politique et l'idéologique. La démocratie locale intègre les territoires et les différentes formes de régionalisme et de municipalisme. La démocratie nationale interroge les rapports entre les peuples, les nations et les États. La démocratie mondiale passe par la démocratie internationale qui, dans sa forme existante, se réfère à un système international qui doit être radicalement réformé et réinventé.
L'hypothèse est que la période actuelle correspond à une nouvelle crise structurelle du capitalisme. Ces crises préparent et définissent une nouvelle phase du mode de production capitaliste. Elles soulèvent aussi la question du dépassement du capitalisme. De nouveaux réaménagements des rapports de production se définissent et s'imposent. Les structures sociales se transforment et les contradictions sociales s'aiguisent et changent de nature. Dans chacune de ces périodes, les classes sociales se redéfinissent ainsi que les rapports entre elles. Nous analyserons la période actuelle à partir de la crise de 2007- 2008. Nous commencerons par rappeler deux périodes de crises antérieures, celle de la crise financière de 1873, qui va en fait de 1860 à 1880, et la crise financière de 1929, qui va de 1914 à 1945. Nous aborderons ensuite la crise des années 1970 et la domination du néolibéralisme. Ces périodes ont commencé par des périodes de montée des conservatismes et des droites extrêmes ; mais, ensuite, les contradictions sociales et politiques se sont accrues et ont conduit à des redéfinitions majeures. Ainsi, en France, la période de crise de 1873 a vu la guerre franco-allemande et Thiers, mais aussi la 1ère Internationale et la Commune. Et pour la crise de 1929, il y a eu, en France, les manifestations massives de l'extrême droite, en1934 ; mais aussi, le Front Populaire, en 1936. Ce sont des périodes de fortes luttes sociales et de guerres. C'est ce qui devrait marquer la période à venir.
Retour sur quelques leçons de deux des crises structurelles précédentes
De 1860 à 1880, la crise de la deuxième révolution industrielle et la première internationale
La période 1860 à 1880 est une période de crise structurelle du capitalisme[4]. On y retrouve des mutations structurelles du mode de production capitaliste, des guerres, des luttes sociales radicales et révolutionnaires, des bouleversements politiques, un débat idéologique et théorique intense. La période est marquée par l'arrivée au pouvoir en Europe de partis qui se rattachent au conservatisme radical et à la droite extrême, mais les contradictions sociales et politiques se traduisent aussi par des actions et une pensée révolutionnaire renouvelée qui dépasseront la période.
La période de 1860 à 1880 est celle de la deuxième révolution industrielle, celle du capitalisme industriel et du capitalisme marchand, celle des doctrines libérales. C'est une période des grandes usines et de l'urbanisation. L'innovation technologique est intense dans les nouvelles machines et les processus de production. Les secteurs en expansion sont l'électricité, le pétrole, le moteur à combustion, l'acier, les moyens de communication avec le téléphone et le télégraphe et les câbles intercontinentaux. La production de masse s'appuie sur les nouvelles chaînes de montage. Elle prépare le taylorisme à partir des années 1880. C'est aussi, avec l'urbanisation, la nouvelle classe ouvrière, le syndicalisme, les classes moyennes et l'accès à la consommation.
La période est marquée par le krach boursier de 1873, la fermeture de banques, la dépression économique et le chômage. La spéculation sur les chemins de fer accompagne la baisse des prix, les faillites d'entreprise et le chômage. Plusieurs guerres marquent cette époque. La guerre de sécession en 1861-1865 et la crise économique mondiale qui l'accompagne. L'unification de l'Italie, de 1859 à 1871, redessine les frontières de l'Europe. La guerre franco-prussienne, 1870-1871, entraîne la chute de Napoléon III et la proclamation de l'empire allemand à Versailles. L'influence ottomane baisse en Europe. La colonisation européenne s'étend en Afrique et en Asie ; elle est formalisée par la Conférence de Berlin en 1884.
En réponse à cette situation, les mouvements sociaux connaissent un essor remarquable. La Première internationale, l'AIT, Association internationale des travailleurs est créée en 1864, à Londres. Elle sera active de 1864 à 1876 et regroupera des syndicalistes et des intellectuels, dont Marx, Engels, Proudhon, Bakounine, Louise Michel. En 1871, La Commune de Paris va bouleverser la pensée révolutionnaire avec son pouvoir autogéré et ses principes démocratiques et sociaux, jusqu'à la Semaine sanglante de mai 1871. A la lumière de cette extraordinaire insurrection, Marx redéfinira sa conception de l'Etat.
Les conservateurs radicaux et la droite extrême dominent toute la période. Au début de la période, ils se partagent, et s'affrontent entre bonapartistes et royalistes légitimistes. Après la Commune, ce sera la République de Thiers et de Mac Mahon. Entre droite et extrême droite, il y a des contradictions mais un accord contre l'ennemi socialiste. À la fin de la période, se forment des petites organisations qui préfigurent les organisations de l'extrême droite du XXème siècle, comme, par exemple, l'Action française et, déjà, Charles Maurras. Malgré une hégémonie apparente des droites réactionnaires, les luttes révolutionnaires ont culminé avec la Commune ; les luttes sociales ont continué avec les Bourses du Travail qui ont préparé le syndicalisme moderne. Et la 1e internationale a jeté les bases de l'affirmation et de l'organisation de la classe ouvrière.
De 1913 à 1945, la crise du capitalisme fordiste ; le keynésianisme, le soviétisme et la décolonisation
La crise de 1929 est marquée par un krach boursier, la chute de la production, la baisse de l'investissement, la déflation et l'accroissement du chômage. Le krach boursier de 1929 bouleverse les marchés financiers à l'échelle mondiale. Il se traduit par la tendance à la surproduction et par la baisse des taux de profit. La crise financière de 1929 est la première crise du capitalisme fordiste. Le capitalisme fordiste s'est construit et s'est développé à partir du secteur de l'automobile. Il combine le travail à la chaîne, la standardisation des produits et la consommation de masse. Ford lance la première chaîne de montage en 1913 et double les salaires en 1914 pour permettre aux salariés d'acheter ses produits et stimuler la demande intérieure. Le fordisme nécessite un marché de l'emploi stable et des salaires relativement élevés. La crise fordiste accélère l'effondrement de la demande, la surproduction, des faillites d'entreprises et une crise de l'emploi. La consommation de masse repose sur le recours au crédit. L'endettement des ménages se traduit par une consommation insuffisante, le non-remboursement des dettes et des déséquilibres économiques. La crise fordiste est aggravée par les politiques monétaires et fiscales, les déséquilibres commerciaux internationaux et les spéculations financières.
Le keynésianisme, le capitalisme keynésien, est une réponse à la crise fordiste. La période du capitalisme keynésien est dominante depuis les années 1930 jusqu'aux années 1970. Le keynésianisme complète le capitalisme fordiste après la crise des années 1930. Keynes propose l'intervention de l'État pour gérer la demande et stabiliser l'économie à partir des dépenses publiques. Roosevelt fait adopter en 1934, sous le nom de New-Deal, un nouveau modèle de développement, fordiste et keynésien. Ce modèle sera surtout appliqué en 1945, après la guerre mondiale. Il implique des concessions sociales importantes, formalise le rôle de l'État et la protection sociale. Du début du 20ème jusqu'aux années 1970, le fordisme va associer la production de masse, l'amélioration des salaires, la consommation de masse et l'intervention de l'État. Le keynésianisme, à partir des années 1930, le complétera par la régulation assurée par l'État, le soutien de l'emploi et des salaires, les dépenses publiques et les investissements dans les infrastructures. La régulation passe par les accords collectifs et les négociations avec les syndicats. Plusieurs caractéristiques de cette période restent encore actuelles aujourd'hui dans la période du capitalisme mondialisé qui commence en 1970.
Le capitalisme fordiste, puis fordiste et keynésien, développe plusieurs branches industrielles ; l'automobile, l'électroménager, la sidérurgie et la métallurgie, la chimie et la pétrochimie, le textile, l'agroalimentaire, la construction. Les grandes entreprises sont les acteurs économiques et politiques dominants. La classe dominante allie les dirigeants des entreprises, surtout des grandes entreprises privées, et une bourgeoisie d'État, acquise à la préservation du capitalisme, qui gère l'État et les entreprises publiques et les transforme dans le sens des intérêts du capitalisme privé. L'État développe un secteur public composé des administrations et des entreprises publiques qui sont transformées suivant la logique des entreprises privées. Les deux classes principales du capitalisme fordiste et keynésien opposent la classe ouvrière et la classe capitaliste, avec ses deux composantes, les actionnaires et les chefs d'entreprise d'un côté, et les cadres de la bourgeoisie d'état de l'autre. Une catégorie de cadres, ingénieurs et techniciens, de plus en plus nombreuse assure la gestion du système. Une petite bourgeoisie traditionnelle prolonge les catégories sociales précapitalistes, Les paysans se partagent entre les capitalistes agricoles et les paysans travailleurs, prolétarisés. Et, déterminant, il y a toujours le travail des femmes invisibilisées et prolétarisées.
La crise financière de 1929 est significative de la crise structurelle du capitalisme. La réponse keynésienne se caractérise par une intervention de l'Etat et la régulation des marchés financiers. La période est marquée par les guerres qui caractérisent toute période de crise structurelle. Celle-ci l'a été particulièrement. La période, de 1913 à 1945, est marquée par les deux guerres mondiales[5]. La première guerre mondiale de 1914 à 1918 ; et la deuxième guerre mondiale de 1939 à 1945. Il y a eu beaucoup d'autres guerres qui marquent la scène politique mondiale. Certaines étaient liées à des révolutions. Rappelons, parmi d'autres, la guerre civile russe de 1917 à 1923, la guerre gréco-turque de 1919 à 1922, la guerre civile finlandaise en 1918, la guerre civile irlandaise en 1922, la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, la guerre sino-japonaise de 1937 à 1945, la guerre civile chinoise de 1927 à 1945, la révolution mexicaine de 1910 à 1920.
La révolution soviétique en Russie, en 1917, et la révolution chinoise de 1927 à 1949, vont complètement bouleverser l'état du monde. Le rôle de l'Union soviétique pendant la guerre de 1939 à 1945 va lui donner une place centrale dans l'ordre mondial ; on entre dans un monde à deux blocs qui va caractériser l'état de la planète jusqu'en 1989. Cette situation va déterminer les débats politiques et idéologiques qui seront intenses. Le capitalisme fordiste et keynésien ne manque pas de penseurs très actifs dans les universités et les centres de recherches occidentaux. En contrepartie, de nombreux penseurs défendent une pensée socialiste très diverse ; comme par exemple Lénine, Mao, Trotski, Gramsci et bien d'autres. Il y a des tentatives de relier le marxisme et le keynésianisme, notamment, celles de Joan Robinson et Michal Kalecki.
La période est marquée par la montée en puissance de la décolonisation. Les luttes de résistance à la colonisation n'ont jamais cessé ; les peuples ont toujours résisté et ont été très violemment réprimés. Parmi les grands mouvements qui ont marqué l'Histoire, rappelons la révolution anticolonialiste, antiesclavagiste et anti ségrégationniste à Haiti, en 1804 et la révolution paysanne mexicaine avec Zapata en 1905. En 1920, à Bakou, au Congrès des Peuples d'Orient, une alliance stratégique est passée entre les mouvements de libération nationale et les mouvements communistes de 1917. Cette alliance va permettre l'encerclement des impérialismes et l'essor des libérations nationales. En 1927, se tient à Bruxelles le premier Congrès contre le colonialisme et l'impérialisme présidé par Albert Einstein et Madame Sun Yat-Sen, autour du mot d'ordre « Liberté nationale, égalité sociale ». À partir de 1945 commence le mouvement des indépendances nationales. L'Indonésie et le Vietnam proclament leur indépendance. La Jordanie, les Philippines, la Syrie le font en 1946. En 1955, à Bandung, le président d'Indonésie, Soekarno, invite les chefs d'Etat des dix-sept premiers pays indépendants d'Afrique et d'Asie[6] et notamment Tito, Nasser, Nehru et Chou en Lai. Chou en Lai résume la situation en ces termes : « les États veulent leur indépendance, les nations veulent leur libération, les peuples veulent la révolution ». Les participants définissent une orientation, celle du non-alignement. La révolution cubaine, amorcée en 1953, est victorieuse en 1956. La conférence Tricontinentale, en 1966, à La Havane, amorce l'émergence d'un Sud par rapport aux deux blocs de l'Ouest et de l'Est.
Le mouvement des non-alignés va tenter de définir un modèle de développement[7] qui prenne à la fois en compte le modèle keynésien, sur les formes étatiques de régulation, et le modèle soviétique, notamment sur l'industrie lourde et l'agro-industrie. Il met en avant le rôle prédominant de l'Etat dans la conduite de l'économie. Ce modèle trouvera en partie son expression dans la déclaration sur le droit au développement qui sera adopté en 1986 par l'Assemblée des Nations Unies[8]. Mais depuis la fin des années 1970, une autre notion du développement s'est imposée, celle du néolibéralisme.
La droite et l'extrême droite ont joué un rôle déterminant de 1913 à 1945. Pour l'extrême droite, les fascistes en Italie, les nazis en Allemagne, les franquistes en Espagne sont suivis par des mouvements nationalistes radicaux dans toute l'Europe et sur d'autres continents. L'idéologie d'extrême droite se caractérise par un nationalisme radical, la xénophobie, l'opposition à la démocratie libérale, le soutien à l'autoritarisme et au fascisme, les références au racisme, à l'antisémitisme et au militarisme. Les partis de droite comprennent les conservateurs, les monarchistes et les libéraux économiques. Ils défendent l'ordre, l'autorité, le conservatisme social et le libre marché économique. Il est intéressant de rappeler la période de 1934 à 1936 en France, celle des affrontements violents entre extrême droite et Front populaire. Les Ligues d'extrême droite organisent les manifestations du 6 février 1934. En réponse, les partis de gauche forment le Front Populaire, une alliance électorale, qui gagne les élections en 1936.
De la crise des années 1970 au néolibéralisme
Le capitalisme a fortement évolué après 1945. De 1945 jusqu'aux années 1970, on est dans un prolongement du capitalisme fordiste et keynésien, dans un contexte géopolitique d'un monde bipolaire partagé entre l'Occident (Amérique du nord, Europe, Japon) et l'Union soviétique et ses alliés. Dans les années 1970, le capitalisme mondialisé a pris le relais du capitalisme keynésien en tant que forme dominante du capitalisme et a mis en place le capitalisme néolibéral.[9]
Les relations du capitalisme fordiste et keynésien au marché national et à la mondialisation sont complexes. Pour le capitalisme keynésien, la production de masse est orientée vers le marché domestique, ce qui justifie les augmentations de salaires et qui légitime la régulation et le protectionnisme. La mondialisation est limitée, les exportations sont sélectives et la priorité est donnée au marché national. Les investissements directs étrangers sont contrôlés. Le post-fordisme va accélérer la transition vers une mondialisation accélérée. La crise des années 1970 est marquée par les chocs pétroliers et une stagflation. La mondialisation accrue se traduit par la priorité donnée à la réduction des coûts et à la flexibilité pour s'adapter à l'environnement économique mondial, à la délocalisation vers les faibles coûts de main d'œuvre, à l'explosion du commerce mondial, à la domination des chaînes d'approvisionnement mondiales, à l'imposition de la flexibilité pour répondre à la priorité de la demande mondiale.
Un affrontement Nord-Sud, postcolonial, avait commencé, en 1953, avec la nationalisation en Iran du pétrole par Mossadegh. Il a été renversé. L'affrontement aura lieu en 1973 avec le quadruplement du prix du pétrole et en 1979, à la suite de la révolution islamique en Iran, avec un nouveau doublement du prix du pétrole. Mais les États pétroliers ne préservent pas l'unité des pays du Sud et laissent les pays occidentaux retourner la situation en leur faveur. En 1975 est créé le G5, qui deviendra le G7, qui regroupe les pays dirigeants occidentaux. Ils lancent, en organisant l'endettement des pays du Sud, une contre-offensive qui réussit et qui rallie certains pays pétroliers à l'offensive occidentale. Les institutions de Breton-Woods, FMI et Banque Mondiale, vont imposer, à partir d'une gestion inique de la dette, les Programmes d'Ajustement Structurel, les PAS. C'est une entreprise de recolonisation des pays du Sud. De nombreux mouvements contre la dette vont se développer dans les pays du sud, avec des mouvements de soutien dans des pays du nord, mais sans réussir à sortir de ce piège qui va fonctionner de 1979 jusqu'à aujourd'hui. Le capitalisme réussit une nouvelle mutation avec la mise en place du capitalisme financier et sa stratégie : marchandisation, privatisation, financiarisation.
La poussée de la droite et de l'extrême droite a commencé, pendant quarante ans, par une bataille pour l'hégémonie culturelle autour de cinq offensives. La première offensive, idéologique, a porté d'abord sur trois questions : contre les droits et particulièrement contre l'égalité, les inégalités seraient justifiées parce que « naturelles » ; contre la solidarité, le racisme et la xénophobie s'imposent ; contre l'insécurité, l'idéologie sécuritaire serait la seule réponse possible. La deuxième offensive est militaire et policière ; elle a pris la forme de la déstabilisation des territoires rétifs, de la multiplication des guerres, de l'instrumentalisation du terrorisme. La troisième offensive a porté sur le travail, avec la remise en cause de la sécurité de l'emploi et la précarisation généralisée, par la subordination de la science et de la technologie, notamment du numérique, à la logique de la financiarisation. La quatrième offensive a été menée contre l'Etat social par la financiarisation, la marchandisation et la privatisation ; elle a conduit à la corruption systématique des classes politiques. La cinquième offensive, dans le prolongement de la chute du mur de Berlin en 1989, a porté sur la disqualification des projets progressistes, socialistes ou communistes.
A partir de 1977, commence une nouvelle phase du capitalisme en réponse aux difficultés du capitalisme keynésien et au danger géopolitique de montée en puissance d'un Sud postcolonial. La réponse est à la fois économique et géopolitique. Sur le plan économique, le keynésianisme n'étant pas applicable à l'ensemble de la planète, on proposera de promouvoir une nouvelle forme d'organisation capitaliste et impérialiste, le néolibéralisme. Sur le plan géopolitique, on s'attachera à marginaliser les Nations Unies et à promouvoir les institutions de Breton-Woods (FMI, Banque Mondiale et OMC). Pour imposer cette nouvelle orientation, la stratégie est claire : l'endettement des pays du Sud.
Le capitalisme néolibéral
Le capitalisme néolibéral est précisé et expérimenté au Chili, à partir du coup d'État fomenté par Pinochet en 1973 qui a permis de mettre en place une politique, appliquée par un régime fasciste, définie à l'Université de Chicago par Milton Friedman. Le président français Giscard d'Estaing crée en 1975, le G5, qui deviendra G7, pour répondre au choc pétrolier. La stratégie est claire : endetter les pays du Tiers-monde ! Et, pour assurer le remboursement de la dette, imposer des PAS, des programmes d'ajustement structurel, organisés en fonction d'une doxa néolibérale et gérés par le FMI et la Banque Mondiale. Encore une fois, l'extrême droite est présente et active dans une période de crise du capitalisme. Le néolibéralisme est expérimenté et imposé par un régime fasciste celui de Pinochet au Chili. A partir de la nouvelle théorie des Chicago-boys ! Elle sera reprise, perfectionnée et imposée par Mme Thatcher en Grande Bretagne, Ronald Reagan aux États Unis et Giscard d'Estaing en France.
Le modèle s'impose du fait des difficultés et des échecs des politiques liées aux modèles d'indépendance nationale. La construction de l'État, au départ moyen du développement, est devenue une fin en soi. La fonctionnarisation accélérée et l'urbanisation galopante ont provoqué un déséquilibre structurel des fondamentaux économiques (budget, balance commerciale, balance des paiements). La bureaucratie et la corruption ont gangrené les sociétés. Le déni des droits fondamentaux et l'absence de libertés ont achevé de réduire fortement la crédibilité de ces régimes. La crise de la décolonisation, de sa première phase, celle de l'indépendance des États, est ouverte.
Un mouvement altermondialiste émerge en réponse à cette stratégie du capitalisme et de la financiarisation. En réponse à l'affirmation de Madame Thatcher, « il n'y a pas d'alternative », il affirme « un autre monde est possible ». La première phase de ce mouvement commence, dès 1979, avec les mouvements contre la dette et contre les programmes d'ajustement structurel. Le mouvement ATTAC, pour la taxation des transactions financières et le CADTM, Comité pour l'annulation des Dettes du Tiers-Monde, relayent et élargissent, dans le monde, les mouvements des pays du Sud contre la dette. A partir de1989, la situation évolue avec la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique et le passage à un monde unipolaire sous la direction des États Unis et du G7. Le G7 va chercher à construire un nouveau système international, conforme à son projet, en complétant les institutions de Breton-Woods, le FMI et a Banque Mondiale, par l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Des grandes manifestations internationales de 1989 à 1999, ont lieu contre ces institutions et le G7, à Paris, Madrid, Washington, Gênes et partout dans le monde autour du mot d'ordre, « le droit international ne doit pas être subordonné au droit des affaires ». La réunion de l'OMC à Seattle en 1999 qui devait confirmer l'ordre mondial se heurte à l'opposition des mouvements et aux contradictions internes entre les différents pays.
Les Forums Sociaux Mondiaux se succèdent, après Seattle, et laissent la parole aux mouvements sociaux et citoyens. Le Forum de Belém en 2009 regroupe 4500 associations, plus de cent mille personnes. Par rapport à la crise financière ouverte en 2008, il avance des propositions immédiates : le contrôle de la finance, la suppression des paradis fiscaux et judiciaires, la taxe sur les transactions financières, l'urgence climatique, la redistribution… A Belém, un ensemble de mouvements, les femmes, les paysans, les écologistes et les peuples indigènes, surtout amazoniens, ont pris la parole pour affirmer : il s'agit d'une remise en cause des rapports entre l'espèce humaine et la Nature, il ne s'agit pas d'une simple crise du néolibéralisme, ni même du capitalisme ; il s'agit d'une crise de civilisation, celle qui dès 1492 a préparé une nouvelle géopolitique et certains fondements de la science contemporaine dans l'exploitation illimitée de la Nature et de la planète. C'est depuis les forums sociaux mondiaux que date la définition d'un projet alternatif, celui de la transition sociale, écologique et démocratique. Cette transition s'appuie sur de nouvelles notions et de nouveaux concepts : les biens communs, la propriété sociale, le buen vivir, la démocratisation radicale de la démocratie.
Le mouvement de solidarité international se recompose. Il organise des manifestations contre la guerre. En 1989, à Paris, deux grandes manifestations en réponse au G7 qui se réunit à Versailles : « dette, colonies, apartheid, ça suffat comme çi » et le Sommet des sept peuples parmi les plus pauvres. Se succéderont alors, en 1994, l'affirmation des zapatistes au Mexique ; en 1995, à Madrid, le sommet contre le FMI et la Banque Mondiale, 50 ans ça suffit ; la création d'ATTAC en 1998 ; en 2001 les manifestations de Gènes. Et, à partir de 2001 la succession des Forums Sociaux Mondiaux
La crise financière de 2008 est une nouvelle crise profonde du capitalisme. La crise financière démontre la fragilité du système. Le néolibéralisme est réaménagé en adoptant une stratégie austéritaire qui combine l'austérité et le sécuritaire. Les luttes sociales se durcissent en réponse à cet austéritarisme. L'extrême droite se renforce dans de nombreux pays et revendique, dans cette situation, le nationalisme, l'identité, la sécurité et la lutte contre les migrants. La situation s'aggrave avec la pandémie de Covid. Ce n'est pas la première fois dans l'Histoire que la pandémie et le climat s'invitent pour rappeler la fragilité de la situation.[10] Cette pandémie rend plus sensible la crise climatique et l'actualité des contradictions sociales, écologiques et démocratiques.
Nous sommes dans un changement de période qui se caractérise par le durcissement des contradictions. La montée des alliances entre les droites et les extrêmes droites sont générales ; elles instrumentalisent la question des migrations et la question des identités nationales. Les mouvements sociaux, féministes, antiracistes, écologistes, des peuples premiers, sont porteurs de nouvelles radicalités mais n'ont pas encore de projet commun. Le mouvement social, ouvrier et paysan, est fortement combattu. L'autoritarisme se présente comme une solution par rapport à la méfiance sur les formes contestées de démocratie[11]. Les Forums sociaux mondiaux continuent à exister mais ils doivent être renouvelés. De nouveaux mouvements explorent de nouvelles perspectives, comme les zapatistes, les femmes du Rojava, les jeunes iraniennes. Ces mouvements mettent en avant le féminisme, l'écologie, la démocratie locale. Ils explorent les voies d'avenir.
Le coup de tonnerre de 1989, avec l'autodissolution de l'empire soviétique semble accélérer l'hégémonie du capitalisme mondialisé. Plus rien ne paraît s'y opposer. On voit fleurir les odes au capitalisme éternel ; ce serait la fin de l'Histoire ! La crise financière de 2007-2008 va interrompre l'euphorie. Il n'est pas sûr que ce soit la crise centrale de la période, comme l'a été celle de 1929 ; une autre crise centrale viendra probablement ponctuer le processus. Deux éléments nouveaux sont venus compléter les crises sociales et démocratiques ; la pandémie et la crise du covid ont bouleversé la scène mondiale, la crise climatique rappelle l'actualité et l'urgence de la crise écologique.
À partir de 2007 - 2008, une nouvelle crise structurelle du capitalisme
En fonction de l'analyse des crises précédentes, et en faisant l'hypothèse que nous sommes dans une crise structurelle du capitalisme, nous analyserons l'évolution et la crise du mode de production capitaliste, les luttes sociales, les guerres, la décolonisation, les débats idéologiques et politiques, la droite et l'extrême droite.
La crise actuelle du mode de production capitaliste
De nombreux changements se traduisent par des fortes évolutions dans les rapports de production. Retenons-en deux : la progression exponentielle du numérique, les interrogations sur l'extractivisme.
Reprenons quelques données pour apprécier l'explosion du numérique. La croissance financière des entreprises du numérique est considérable, elle se compte en milliards de dollars[12]. C'est le cas des géants technologiques : Apple, Google, Amazon, Facebook. Apple a atteint 2000 milliards de dollars en 2020. Leurs revenus ont explosé, Amazon est passé de 19 milliards de dollars en 2008 à 469 milliards de dollars en 2021. Les investissements de Recherche-développement se sont multipliés, Google est passé de 2,8 milliards de dollars en 2008 à 31,6 milliards de dollars en 2021. Les innovations technologiques se sont imposées avec l'IA, l'intelligence artificielle, le blockchain, le cloud computing. Elles ont été facilitées par la progression des start-ups. Les utilisateurs d'internet sont passés de 1,5 milliards de personnes en 2008 à plus de 5 milliards en 2023 ; les smartphones sont passés de 200 millions de personnes en 2008 à plus de 3,8 milliards en 2021 ; la fréquentation des réseaux sociaux de 1 milliard en 2008 à 4,5 milliards en 2021 ; le commerce électronique de 1 milliard d'utilisateurs en 2008 à 4,5 milliards en 2021. La part du commerce électronique dans le commerce de détail est passé de 3,6% en 2008 à 19,6% en 2021. La numérisation des services transforme les secteurs traditionnels du commerce, des finances, de la santé, des médias. L'éducation en ligne a explosé. L'impact culturel est visible dans la communication, les messageries, les cultures numériques, la multiplication des influenceurs et des créateurs de contenus.
Les industries extractives et pétrolières doivent s'adapter à un environnement en mutation rapide marqué par la transition énergétique et la volatilité des marchés. La récession économique qui a suivi la crise financière de 2008 s'est traduite par une récession économique, la chute de la demande des minéraux et du pétrole et une baisse brutale des prix des matières premières. Le prix du pétrole a chuté à 30$ en 2009, contre 150$ en 2008 ; la surproduction a provoqué une nouvelle baisse en 2014 et la pandémie du COVID, en 2020, a provoqué une chute historique des prix. Avec le pétrole de schiste, les États-Unis sont devenus un des principaux producteurs de pétrole. Les crises géopolitiques au Moyen-Orient, en Russie et en Afrique ont eu des répercussions sur les prix et les approvisionnements en pétrole. La demande mondiale en énergie et en matières premières devrait être affectée par les interrogations sur une nécessaire transition énergétique mondiale cherchant à privilégier des sources d'énergie durables, la diversification économique des pays producteurs, les enjeux environnementaux pour la réduction des émissions carbone et les investissements dans les énergies renouvelables. Cette évolution, qui correspond à des enjeux majeurs, aura des conséquences considérables.
Le capitalisme des plateformes utilise les technologies numériques pour maîtriser les transactions en connectant les utilisateurs. Les plateformes redéfinissent les relations, les modèles d'affaires et les marchés. Elles modifient les formes de régulation et de concentration des pouvoirs. Elles concentrent le pouvoir économique. Elles exacerbent les inégalités et mettent en danger la sécurité de l'emploi. Elles stimulent l'innovation et aggravent la compétition, multipliant les emplois d'indépendants et de temporaires. Les premières plateformes datent des années 1990 à 2000 avec internet. Elles sont boostées par les smartphones et les applications mobiles. L'épidémie du covid a renforcé les plateformes numériques, et leurs compléments avec les services de livraison, le commerce électronique et le télétravail. Le capitalisme de plateformes crée un nouveau modèle économique ou les plateformes numériques servent d'intermédiaires pour faciliter les interactions entre les groupes d'utilisateurs à l'exemple de Amazon, Airbnb, Facebook.
La crise du COVID a aussi accéléré l'adoption du télétravail et transformé profondément le rapport au travail pour les travailleurs et pour les entreprises. Les entreprises modifient leur organisation du travail pour s'adapter aux nouvelles formes du travail en profitant du travail à domicile et de l'individualisation des travailleurs. Le télétravail renforce la flexibilité du travail et réduit les formes d'organisation collective des travailleurs. La productivité à l'échelle mondiale est affectée par le ralentissement du temps de travail, l'impact de la crise du Covid et le ralentissement démographique dans les pays développés. Après 2008, la baisse de la croissance de la productivité a affecté l'économie mondiale et a pesé sur la croissance économique, les inégalités, la compétitivité des entreprises et les niveaux de vie. Elle s'est traduite par une croissance des salaires ralentie et une productivité réduite qui a conduit à une stagnation et à une baisse du niveau de vie pour une partie de la population. Les tensions sociales ont accompagné la stagnation des revenus et les inégalités croissantes. L'instrumentalisation de la crise a permis de renforcer les politiques de réduction des salaires et des droits collectifs
La crise de la pandémie et du climat renforce cette tendance de reprise en main par des États autoritaires. Elle bouleverse les situations et les équilibres ; elle interroge la solidarité internationale, l'internationalisme et l'altermondialisme. A une crise par définition mondiale, les réponses sont surtout nationales et étatiques. Les institutions internationales sont peu écoutées et marginalisées. Les mouvements répondent par des actions de solidarité locale et par la résistance à leurs États. Les contradictions s'accentuent. Les affrontements opposent dans beaucoup de pays des alliances sécuritaires et de droite populiste, aux mouvements qui revendiquent les libertés démocratiques, la défense des droits sociaux, l'urgence écologique. L'austéritarisme s'est imposé. Le néolibéralisme ne cherche pas à convaincre ; il revendique la conjonction de l'austérité et de l'autoritarisme. Près de vingt ans après la chute du mur de Berlin, le néolibéralisme abandonne ses références aux libertés. Il ne cherche plus à convaincre, il ne cherche plus qu'à imposer. L'austéritarisme marque les limites du néolibéralisme en tant que système stable.
Il est probable que nous vivrons le passage à une nouvelle phase du mode de production capitaliste, comme entre 1914 et 1945, la rupture avec le passage au capitalisme fordiste et keynésien, formalisé à partir de 1929, avec le New Deal. L'hypothèse du passage à une nouvelle phase du mode de production capitaliste est très probable ; elle est amorcée avec les nouvelles formes de production, notamment le numérique. Elle est aussi interpellée par les changements dans les classes principales. Nous en avons quelques éléments. Dans la classe dominante, par la contradiction entre la financiarisation de la bourgeoisie et la culture des nouveaux dirigeants, cadres et managers du numérique. Dans la classe ouvrière, par les contradictions dans l'évolution des formes du salariat et avec le précariat.
L'hypothèse n'est peut-être pas seulement celle d'un changement de phase du capitalisme. Immanuel Wallerstein avance l'hypothèse qu'il s'agit d'une crise structurelle qui met en cause les fondements du mode de production capitaliste[13]. Il considère que le mode de production capitaliste est épuisé et que dans les trente prochaines années, il ne devrait plus être dominant. Mais, cette crise du capitalisme ne déboucherait pas sur le socialisme. Un autre mode de production, inégalitaire mais différent, lui succéderait. Il estimait qu'un nouveau mode de production allait succéder au capitalisme dans les trente ou quarante prochaines années. Mais, il soulignait que, si la fin du capitalisme est historiquement certaine, cela n'entraînait pas automatiquement l'avènement d'un monde idéal. Il pensait qu'un nouveau mode de production « post-capitaliste » pourrait être inégalitaire. Il voyait la possibilité de plusieurs bifurcations : « celle débouchant sur un système non capitaliste conservant du capitalisme ses pires caractéristiques (hiérarchie, exploitation et polarisation), et celle posant les bases d'un système fondé sur une démocratisation relative et un égalitarisme relatif, c'est-à-dire un système d'un type qui n'a jamais encore existé.
Dans cette hypothèse, le capitalisme ne disparaîtrait pas, mais il ne serait plus le mode de production dominant dans les formations sociales, un peu comme l'aristocratie n'a pas disparu en laissant la première place à la bourgeoisie. De nouvelles classes sociales principales seraient en gestation dans nos sociétés. Le nouveau prolétariat viendrait du précariat et associerait les précaires et certaines formes de salariat. Les nouvelles classes dirigeantes pourraient être issues des techniciens et des cadres comme on peut le voir à travers les mutations sociales entrainées par le numérique. Les bourgeoisies, parasitaires et rentières, ne seraient plus dominantes et pourraient laisser la place à de nouvelles classes dirigeantes. Le néolibéralisme pourrait être toujours présent, mais ne serait plus dominant. Il a déjà perdu une large part de sa légitimité et il a besoin de durcir ses moyens de répression pour maintenir son pouvoir.
Quelle que soit l'hypothèse, celle du passage à une nouvelle phase du mode de production capitaliste ou celle du passage à un nouveau mode de production, les changements seront considérables et se traduiront par des années de transition marquées par des bouleversements sociaux et idéologiques. Les conséquences seront considérables au niveau de l'écologie et du changement climatique, au niveau social pour les inégalités et les discriminations, au niveau des guerres et de la nature des régimes politiques, au niveau de la définition même des démocraties.
Les luttes sociales, les guerres et la deuxième phase de la décolonisation
Les luttes sociales
Les luttes sociales, sous des formes diverses, sont toujours présentes et déterminantes. Elles sont très présentes au niveau local et elles sont plus visibles au niveau national quand elles interpellent l'État. Elles sont moins visibles au niveau international du fait des remises en cause du champ géopolitique. Elles concernent surtout les inégalités sociales de plus en plus grandes et partout présentes. Les luttes pour la démocratie sont aussi très présentes mais sont plus spécifiques en fonction des situations locales ; elles convergent très rarement au niveau des grandes régions ou au niveau mondial. Les luttes sur les questions écologiques sont très pertinentes mais se heurtent à une contre-offensive très déterminée pour éviter la jonction avec la critique radicale du néolibéralisme qui exacerbe les inégalités.
Les inégalités sociales sont considérables[14]. En France, avec un taux de pauvreté de 15%, le Smic, salaire minimum, est de 17000 euros par an et la rémunération moyenne d'un PDG du CAC 40 est de 5,5 millions d'euros par an, soit 331 fois le smic. Cette situation est accentuée par la réduction des impôts sur les revenus du capital. Au niveau mondial, les 1% les plus riches possèdent 45% de la richesse mondiale en termes de patrimoine net. Oxfam a calculé que les 1% les plus riches possèdent, en patrimoine net, plus de deux fois la richesse de 6,9 milliards de personnes les moins dotées (sur 7,8 milliards de la population mondiale). Il y a une claire conscience de l'ampleur des profits des grandes entreprises et des grands actionnaires et de l'injustice du système ; mais cette prise de conscience ne se traduit pourtant pas par une remise en cause globale du capitalisme.
Les grandes luttes sociales ont été très fortes depuis 2008. Rappelons, en France
Les luttes contre la réforme des retraites en 2010, 2019 et 2023 ; celles contre la loi travail en 2016 ; l'émergence des Gilets jaunes en 2018 ; les luttes pour le climat depuis 2018 ; contre les violences policières et le racisme en 2020. Dans le monde, après 2008, il y a eu des mouvements d'ampleur dans plus de 59 pays. Parmi eux, rappelons les Printemps arabes en 2010 et 2011 ; les Indignés en Espagne en 2011, Occupy Wall Street en 2011 ; Black lives matter, contre la violence policière et le racisme, depuis 2013 ; les mobilisations à Hong Kong, pour les libertés démocratiques en 2019 ; les grèves mondiales pour le climat, depuis 2018 ; les mouvements au Chili, en Colombie, en Bolivie, en 2019 – 2020…
Les luttes sociales dépendent de l'évolution des rapports entre les classes sociales. La classe ouvrière demeure centrale mais elle a évolué et cette évolution s'accélère. La généralisation du salariat rend moins visible les rapports sociaux capitalistes. Ce qui est accentué par la numérisation et, depuis la pandémie du COVID, par la progression du télétravail. Il faut aussi noter l'importance des classes moyennes, malgré l'affaiblissement de leur situation, et le rapprochement des conditions de vie liées à l'urbanisation. Le précariat, les travailleurs précaires, les secteurs informels, l'ubérisation, le micro-entrepreneuriat représentent de nouvelles formes d'organisation du travail ; il s'est développé dans le Sud et aussi en Europe. La scolarisation modifie aussi les rapports entre les classes[15]. Le taux de scolarisation était, en 2020, de 95% en France et de 76% dans le monde. Il y avait 2,7 millions d'étudiants dans le supérieur en 2021. Dans le monde, le taux de scolarisation dans le secondaire était, en 2020, de 70% en Chine et Corée du Sud, de 50% en Amérique Latine, au Moyen Orient et en Afrique du Nord, de 9 à 10% en Afrique. Pour se rendre compte de l'évolution et des conséquences pour une société, il y avait trois bacheliers en République démocratique du Congo, au moment de l'indépendance, en 1960, dont 2 à Bruxelles ; il y en avait 235000 en 2008 et plus de 700000 en 2023. Ce n'est plus la même société !
Les luttes sociales ont toujours été très fortes et n'ont jamais cessé. Les crises structurelles sont toujours des moments de réaménagements géopolitiques majeurs. Elles s'accompagnent des guerres et des aménagements du système international.
La géopolitique, les guerres et le système international
Les crises structurelles sont toujours des moments de réaménagements géopolitiques majeurs. Et ces réaménagements géopolitiques passent par les guerres, par des affrontements, par les nouvelles frontières et les aménagements du système international qui concrétisent les règlements des conflits.
Après 1945, il y a de nombreuses guerres pour la décolonisation qui se prolongent dans des guerres de recomposition régionale au Moyen-Orient, en Asie et par des guerres d'intervention des États-Unis et de l'Union Soviétique. Parmi les principales guerres et les confrontations, citons : la guerre d'Indochine, de 1946 à 1954 et du Vietnam de 1955 à 1975 ; la crise de Suez en 1956 ; la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962 ; les guerres entre Israël et les pays arabes en 1967 et 1973 ; la guerre civile du Liban en 1975 jusqu'en 1990 ; la guerre du Cambodge en 1970 ; l'invasion soviétique en Afghanistan en 1979 ; les Malouines en 1982 ; la guerre du Golfe en 1990 ; le génocide rwandais en 1994 ; la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988 ; la guerre de Yougoslavie de 1991 à 2001 ; la guerre d'Afghanistan de 2001 à 2021 ; les guerres en Irak de 2003 à 2011, la guerre de Lybie en 2011 et depuis 2014 ; les guerres en République démocratique du Congo depuis 1994 …
Après 2008, il y a de nombreuses guerres qui prolongent les guerres de la période récente ou qui annoncent le passage à une nouvelle période. On compte ainsi, la guerre entre la Géorgie et la Russie en 2008 ; la guerre civile syrienne depuis 2011 ; l'intervention militaire au Yémen depuis 2015 ; la guerre contre l'État islamique en 2014 ; la guerre en Ukraine depuis 2014 ; la guerre civile en Lybie depuis 2014 ; le conflit au Mali depuis 2012 ; le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en 2020 ; la guerre civile au Soudan du Sud de 2013 à 2018 ; le conflit en République Centre Africaine depuis 2012 ; la guerre au Tigré depuis 2020.
Les régions en guerre se multiplient. Mais deux guerres occupent une place centrale dans la période et sont porteuses de graves conséquences à l'échelle mondiale ; la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la guerre entre Israël et la Palestine. Le conflit au Donbass, depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, a pris une nouvelle dimension avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Dans un premier temps, l'Ukraine a réagi de manière assez efficace et a contenu l'invasion russe. Le front s'est stabilisé dans le Donbass ; l'armée russe impose une très forte pression malgré l'armement considérable, mais insuffisant, apporté par les États-Unis et l'Europe à l'Ukraine. Cette guerre interpelle l'ordre international sur plusieurs aspects : d'abord, la nécessaire réaffirmation de l'interdiction des invasions armées comme forme d'intervention dans un conflit politique. Ensuite la question du nucléaire, du point de vue de la sécurité des installations et aussi des possibilités de dérive et d'utilisation des armes nucléaires. La troisième question est celle du rôle de l'OTAN dans la recomposition géostratégique et dans la redéfinition des alliances et du système international.
La guerre israélo-palestinienne est le conflit majeur de la période. Il résume et exacerbe, d'une certaine façon, l'affrontement entre le Sud et l'Occident ; en mettant aussi en évidence la différence de positionnement entre les gouvernements des pays du Sud et les opinions publiques de ces pays. Il est marqué par la place dirigeante de l'extrême droite israélienne dans la gestion du conflit et sa capacité à imposer son point de vue aux États-Unis et à l'Europe. L'intervention du Hamas, marquée par certaines actions terroristes, a modifié le paysage. Une des questions clés va être celle de la définition d'une stratégie commune par l'ensemble des organisations palestiniennes. La reconnaissance d'un État palestinien pose une question immédiate, celle de la remise en cause de la présence des colons en Cisjordanie qui risque de conduire, comme le soulignent plusieurs Israéliens, à une guerre civile en Israël. Dans un temps futur, des solutions peuvent émerger dans la construction d'une grande région impliquant de nouvelles relations entre le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Palestine et un Israël qui ne serait plus colonial.
La géopolitique est aujourd'hui organisée autour des États-nations. L'évolution récente a renforcé cette organisation. La montée des extrêmes droites dans le monde renforce cette imposition d'un monde organisé par les seuls États-nations. Il y a toutefois une tendance à l'émergence d'un autre aménagement géopolitique avec l'organisation de grandes régions qui ne remplaceraient pas les États mais qui les intégreraient dans des ensembles plus larges. Il y a une quinzaine de grandes régions qui pourraient émerger avec la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est y compris le Japon et la Corée, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale avec le Mexique, l'Amérique du Sud avec le Brésil et l'Argentine, les Caraïbes, l'Afrique du Nord, le Moyen Orient, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'Afrique de l'Est, l'Europe, la Russie, l'Océanie.
Le système international est organisé aujourd'hui autour des Nations unies. Il comprend l'ONU et les institutions internationales qui lui sont rattachées et qui jouent un rôle considérable dans le fonctionnement du système international. L'ONU devra être réorganisée[16] ; une sortie de crise structurelle géopolitique rend nécessaire cette réorganisation. L'ouverture d'un débat sur la reconfiguration d'un système international peut faciliter la mise en avant de propositions pour un système démocratique mondial plus avancé.
La deuxième phase de la décolonisation
Avec l'évolution démographique, la décroissance démographique sur plusieurs continents et la croissance démographique en Afrique, on va vers un nouvel équilibre démographique mondial en 2050. La période peut être aussi caractérisée comme celle à la fois d'un renforcement et d'une crise des impérialismes. Elle est celle de la décolonisation qui a commencé dans les années 1920 et qui s'est traduite par les indépendances nationales, à partir de 1944. Nous avons déjà rappelé la conférence de Bandung, en 1955, et la formule sur l'indépendance des États, la libération des nations et la révolution pour les peuples. Aujourd'hui, l'évolution des nouveaux États indépendants et la domination de la scène mondiale par les États occidentaux rappelle que la décolonisation est inachevée. Les réorganisations géopolitiques sont à l'œuvre dans le monde. Elles accompagnent une revendication des peuples à une désoccidentalisation du monde.
À l'identification des peuples à l'État-nation, la période qui vient approfondira et enrichira les rapports entre les peuples, les États et les nations. On voit bien les difficultés quand on pense aux Nations Unies. La Charte, des nations, commence par « Nous les peuples », et en réalité, il s'agit d'une union d'États. Au niveau de la Ligue internationale pour les droits des peuples, nous donnons la priorité aux peuples et nous mettons en avant la définition, donnée par le juriste Charles Chaumont, « un peuple se définit par l'histoire de ses luttes ». Le rapport entre peuple et territoire ne peut pas être réduit au rapport entre nation et territoire. Elle confirme aussi que la langue et la culture caractérisent le peuple. Et que l'internationalisme relève des peuples et non des nations.
Nous entrons dans la deuxième phase de la décolonisation. La première phase est celle de l'indépendance des États colonisés. Elle a été largement entamée avec l'indépendance des colonies et la création des nouveaux États. Mais, il reste encore un certain nombre de situations coloniales, comme vient le rappeler, notamment, la Kanaky. La question de la Palestine est déterminante pour clore cette première étape des indépendances. La deuxième phase de la décolonisation concerne la possibilité pour chaque pays de définir et de maîtriser son développement et pour chaque peuple de construire des institutions lui assurant les libertés et des formes démocratiques. Elle concerne aussi la possibilité pour chaque pays de participer à l'organisation et la gestion de leur grande région et des institutions internationales.
Cette perspective est confirmée par les bouleversements géopolitiques qui sont en cours. Ils concernent directement les guerres qui accompagnent les bouleversements de l'ordre mondial et notamment la nature des régimes politiques et la démocratie. Les États-Unis sont toujours dominants économiquement et militairement, mais leur hégémonie est de plus en plus contestée. La confrontation principale se déplace vers l'Asie et oppose les États-Unis et la Chine. L'Europe est marginalisée et la guerre accroît ses divisions. Les États-Unis explorent une alliance avec l'Australie et le Japon qui inclurait la Grande-Bretagne. La Chine renforce les BRICS avec le Brésil, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud et entame son élargissement avec, notamment, les pays du Golfe, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Iran. De nouvelles puissances renforcent leurs positions régionales. L'Inde en Asie du Sud, la Thaïlande et l'Indonésie en Asie du Sud-Est, l'Australie dans le Pacifique, la Turquie et l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya en Afrique, le Brésil, le Mexique et le Canada en Amérique. Dans cette première phase des indépendances, nous pouvons distinguer trois sous-périodes : de 1944 à 1965, les luttes de libération nationale ; de 1966 à 1973, les « mai 1968 » dans le monde ; de 1973 à 1977, l'offensive pétrolière de pays du Sud.
La souveraineté est une valeur de référence de plus en plus prisée. Elle renforce les identitarismes et le poids des intégrismes dans les religions. Elle se traduit par la montée des autoritarismes[17] de différentes natures. Les libertés et la démocratie restent des valeurs de référence, mais en tant que valeurs abstraites. La méfiance par rapport aux régimes politiques est devenue générale. Elle se traduit par une grande défiance par rapport aux institutions internationales.
La situation est caractérisée par la montée en puissance de nouveaux blocs émergents. Ce sont des situations qui se traduisent historiquement par des périodes de tensions, de conflits et aussi de guerres. D'autant que cette évolution est très rapide à l'échelle historique, en quelques dizaines d'années et non en quelques siècles[18], comme dans les transitions précédentes. Le Sud global se présente à la fois comme un bloc émergent et comme une diversité des États-nations du Sud et de leurs intérêts nationaux. Depuis 2013, la Chine, l'Inde et le Brésil sont collectivement en train de dépasser les pays occidentaux en termes de commerce et de production mondiale.[19] L'affirmation politique d'un Sud global et la volonté du multilatéralisme coexistent avec le renforcement des grandes régions géoculturelles dans l'ordre mondial. Il y a un besoin urgent de réformes pour faire face à un monde en évolution rapide, pour arriver à une architecture globale. Il faut répondre aux défis principaux : le maintien de la paix ; la réduction des inégalités et des discriminations ; le défi écologique ; la redéfinition de la démocratie. L'ONU, si elle est réformée, pourrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de ces réformes nécessaires.
Les débats idéologiques et politiques et la montée de l'extrême droite
L'idéologie renvoie à un système d'idées, elle propose un idéalisme opposé au réalisme politique. Marx introduit le terme quand il rédige, avec Engels, « L'idéologie allemande », en1846 (la publication attendra 1932). Il critique une vision de classe à dépasser par la science ; de là découle une vision négative des idéologies. Cette vision est renforcée par la liaison entre les idéologies et les utopies. Cette conception part de la Révolution française qui va marquer le débat d'idées depuis le XIXème siècle ; elle intègre la science newtonienne de la Nature du XVIIème et l'idée d'un progrès historique du XVIIIème siècle.
Immanuel Wallerstein propose de définir le débat idéologique à partir de trois idéologies politiques, toujours présentes, qui suivent la Révolution française : le conservatisme, le libéralisme et le socialisme[20]. Aucune n'a trouvé de configuration définitive ; elles s'opposent et s'influencent et se recomposent avec la prééminence actuelle du libéralisme. Le conservatisme est une réaction au rejet de l'ancien par la modernité qui met en avant, depuis la révolution industrielle, le culte du changement et du progrès qu'il cherche à refuser ou à limiter. Pour cela, il s'agit de garder ou de reconquérir le pouvoir dans l'État. C'est l'objectif depuis la Restauration qui remet en cause la Révolution. Le libéralisme est certain de la vérité de la modernité ; il est universaliste et propose de moderniser les institutions, de supprimer l'irrationnel du passé et les idéologies conservatrices. Son programme politique est d'imposer le progrès. Le socialisme se veut l'héritier de la Révolution ; il se différencie des conservateurs par sa volonté d'accélérer le processus historique pour faire avancer le progrès. Il se différencie des libéraux en prônant la révolution plus que la réforme pour affronter la résistance au progrès.
L'idéologie libérale propose un sujet, un acteur politique principal ; elle soulève la question de la souveraineté. La souveraineté du peuple succède à la souveraineté du monarque. Qui est le peuple ? Pour les libéraux, le peuple est l'ensemble des individus qui sont dépositaires de tous les droits politiques, économiques et culturels. L'individu est le sujet historique de la modernité, tous les individus sont égaux. Comment prendre des décisions collectives et réconcilier les positions ? C'est la question de la démocratie politique. Le néolibéralisme introduit une rupture avec le libéralisme en se détournant des préoccupations de souveraineté et de démocratie.
La question de l'individu et de la souveraineté est moins explicite chez les conservateurs et les socialistes. Pour les conservateurs, les individus passent, le bien public, le « commonwealth », restent identiques. Le sujet politique se retrouve dans la famille, les corporations, les Églises, les ordres. Pour les socialistes, le sujet principal, c'est le peuple ; la question reste : comment reconnaître la volonté générale du peuple ? Quel sujet incarne la souveraineté du peuple ? Pour les libéraux, ce sont les individus dit libres, pour les conservateurs, ce sont les groupes traditionnels, pour les socialistes, c'est le groupe entier formant société.
Le sujet, le peuple, a une représentation privilégiée, c'est l'État. C'est par l'État que le peuple exerce sa souveraineté, qu'il est souverain. Le peuple forme une société ; quel est le rapport entre État et société ? C'est la question de la modernité. En fait, Les trois idéologies prennent le parti de la Société contre l'État mais de manière différente. Pour les libéraux, il s'agit de dissocier État et vie économique. Et, pour la plupart des libéraux, de réduire l'État au minimum ; l'État est le veilleur de nuit. Pour les conservateurs, le sujet, le peuple, a un soutien privilégié, l'État. Il s'agit de concilier individualisme et étatisme en soutenant et appuyant les groupes intermédiaires traditionnels : famille, Eglise, corporations. Pour les socialistes, la bourgeoisie s'est emparée de la souveraineté politique en s'assurant le contrôle exclusif de l'État. La position par rapport à l'évolution de l'État en grand État bureaucratique et moderne se différencie. Pour les conservateurs, l'État doit protéger les droits traditionnels ; pour les libéraux, l'État doit permettre aux droits traditionnels de s'épanouir ; pour les socialistes l'État doit réaliser la volonté générale.
Les rapports entre les trois idéologies ont évolué. De la Révolution française à 1848, les libéraux s'opposent aux conservateurs. Ils considèrent que le Progrès est inévitable et souhaitable alors que pour les conservateurs, le progrès est néfaste. Les socialistes sont, au début, alliés des libéraux. L'alliance entre socialistes et libéraux soutient la pensée libérale et égalitariste du XVIIIe contre la monarchie absolue. Les deux courants défendent la productivité, base de la politique sociale de l'État moderne. Ils défendent aussi l'utilitarisme. À partir de 1830, et plus nettement après 1848, il y a une séparation entre libéraux et socialistes. Le marxisme ne se limite pas à la pauvreté, il condamne la déshumanisation par le capitalisme. Il y a un rapprochement entre conservateurs et libéraux, il s'agit de protéger la propriété et de combattre la révolution. Un libéralisme modéré divise, chez les socialistes les modérés, qu'on appellera sociaux-démocrates, qui défendent une action politique et des réformes et les radicaux qui appellent à l'insurrection. De 1848 à 1914, ou 1917, le libéralisme domine et l'idéologie socialiste se réfère au marxisme. Le libéralisme s'impose, avec une variante libérale socialiste qui affiche sa foi dans le progrès et la productivité et une variante libérale conservatrice. On peut considérer que les totalitarismes du XXème siècle ont tenté une approche entre conservateurs et socialistes en alliant socialisation et populisme. À partir de 1917 jusqu'à 1968, ou 1989, c'est la domination du libéralisme à l'échelle mondiale, avec un moment de débat particulier avec le léninisme et avec les tentatives récurrentes de plusieurs appels à dépasser les idéologies.
Peut-on dépasser l'idéologie libérale dominante ? C'est la question posée depuis les années 1968. A partir de 1989, la version socialiste est impactée par la chute du marxisme soviétique. Les conservateurs se soumettent à la direction néolibérale. La liaison entre libéralisme et modernité est remise en cause pour la première fois ; elle s'effondr

Une gauche qui ne prend pas la tête de la lutte contre la catastrophe climatique n’a pas de raison d’exister !

Ce qui suit ne s'adresse pas à la droite et à ses soutiens (économiques, sociaux et autres) qui – malheureusement – font très bien leur travail. Ce qui suit s'adresse avant tout à la gauche qui – malheureusement – ne fait pas du tout bien le sien…
6 septembre 2024 | tiré du site entre les ligens entre les mots | Dessin de Sonia Mitralia
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/09/une-gauche-qui-ne-prend-pas-la-tete-de-la-lutte-contre-la-catastrophe-climatique-na-pas-de-raison-dexister/
Voici donc ce que nous écrivions l'an dernier à la même époque, juste après les terribles inondations de Thessalie, dans un texte resté inachevé et jamais publié :
« Le choc des deux « ouragans méditerranéens » successifs Daniel et Elias a été assez fort pour provoquer les premières fortes secousses dans les croyances climato-sceptiques des Grecs. Bien sûr, ce ne sont que les premières fissures qui ne s'élargiront que s'il y a le suivi que les circonstances exigent de la seule force politique qui peut, potentiellement, non seulement expliquer scientifiquement la catastrophe climatique mais aussi agir massivement et concrètement pour y faire face ».
Bien sûr, cette « seule force politique qui peut, potentiellement, non seulement expliquer scientifiquement la catastrophe climatique mais aussi agir massivement et concrètement pour y faire face » doit être la gauche. Pourtant, un an plus tard, alors que le spectre de la pénurie d'eau plane plus que jamais sur Athènes et ses quatre millions d'habitants, alors que de nouvelles sécheresses extrêmes, de nouveaux méga-incendies dévastateurs, de nouveaux records historiques successifs de température et de nouvelles canicules encore pires sont intervenus, cette gauche est toujours invisible, toujours absente du front de la catastrophe climatique galopante. Et le pire, c'est qu'elle continue en grand partie à dénoncer la droite néolibérale au gouvernement non pas pour son refus d'agir à temps contre ce désastre climatique, mais pour son insistance à l'invoquer pour couvrir ses péchés !
Voici donc comment que nous avons poursuivi notre texte de l'année dernière, en essayant – en vain – de convaincre qu'il est urgent de mobiliser ceux « d'en bas » car notre pays est littéralement dans l'œil du cyclone de la catastrophe climatique :
« Parlons donc de la catastrophe climatique et de notre pays, puisque l'intensité et le volume des précipitations des deux « ouragans méditerranéens » (medicanes) qui l'ont frappé consécutivement en l'espace de trois semaines (!), confirment les conclusions scientifiques, que la Méditerranée et en particulier son bassin oriental et … la Grèce constituent un hot point, c'est-à-dire un point de grande intensité et de dangerosité de crise climatique. Plus précisément, les 889 mm de pluie – au moins – reçus par Zagora et les 886 mm reçus par Portaria sur le Mont Pélion le 5 septembre, non seulement dépassent de loin tout précédent dans notre pays, mais sont 3 et 4 fois plus importants que ceux qui sont tombés en Libye le jour des inondations meurtrières quelques semaines plus tard. De même, les 1235 mm de précipitations reçus par Makrinitsa en septembre dernier constituent un record européen de précipitations mensuelles, alors que l'intensité terrifiante de l'averse du « medicane » Elias qui a ensuite frappé le nord de l'Eubée était ensemble avec les incendies gigantesques de plus en plus fréquents, les canicules et la désertification galopante, une autre indication que notre pays constitue bien un hot point de la catastrophe climatique planétaire « pour les décennies à venir ». »
Et nous concluions avec ces mots :
« Qu'est-ce que cela signifie ? Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et plusieurs autres organisations scientifiques, cela signifie que « l'augmentation de température observée en Méditerranée est supérieure à la moyenne mondiale ». En d'autres termes, « la planète se réchauffe et la Méditerranée le fait un peu plus vite » ! Les conséquences ne sont pas seulement prévisibles, elles sont déjà établies de manière empirique : parmi beaucoup d'autres choses, comme l'élévation du niveau de la mer, nous avons des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et de plus en plus intenses, des incendies de forêt de plus en plus fréquents et de plus en plus monstrueusement destructeurs, des précipitations et des inondations sans précédent, mais aussi une réduction drastique des précipitations, avec pour conséquence des pénuries d'eau croissantes, des sécheresses, la désertification galopante de zones de plus en plus étendues, une réduction de la productivité agricole, etc. En d'autres termes, nous sommes confrontés à la menace la plus grave pour la qualité de vie et l'existence même que les habitants de ce que nous appelons aujourd'hui le territoire grec aient jamais eu à affronter. Et comme il est évident, tous les autres problèmes de la population grecque mais aussi mondiale sont directement affectés et subordonnés à ce qui est leur plus grand problème existentiel… »
Et la gauche grecque ? Où sont ses manifestations, ses grèves et ses occupations contre les politiques climatiques des gouvernements grecs, de l'Union européenne et des capitalistes Où sont ses réflexions et sa production d'idées, d'analyses et de propositions programmatiques et de mesures à prendre urgemment ? Où est sa participation aux grandes mobilisations internationales de la jeunesse et autres luttes contre la catastrophe climatique et ceux qui la causent, qui passent en permanence inaperçues dans notre pays ? Où est sa lutte contre les théories obscurantistes et conspirationnistes sur la crise climatique qui font un tabac dans la population grecque ? Où est sa conception du changement radical de nos sociétés et de nos vies que nécessite la lutte effective contre la catastrophe climatique (voir Pour une décroissance écosocialiste). Et surtout, où est sa mobilisation contre la racine du mal, les multinationales du pétrole et du gaz, les constructeurs automobiles et tous ceux qui sont impliqués dans les énergies fossiles, qui sont responsables de l'écrasante majorité des émissions de gaz à effet de serre ?
Au lieu de tout cela, la gauche grecque préfère accuser Mitsotakis et son gouvernement « de simples délits comparés au véritable crime qu'il commet lorsque non seulement il ne fait rien contre la crise climatique, mais qu'il ne cesse de l'aggraver par ses politiques ». Et de temps en temps, elle préfère s'adonner à des combats chimériques contre les impérialistes qui convoitent « nos » (d'ailleurs inexistants)… gisements de pétrole, qui deviendraient comme par miracle… des combustibles fossiles propres parce que… « grecs ». Ou de se moquer et de calomnier la jeune Greta Thunberg qui inspire le mouvement international de jeunesse le plus massif et le plus radical contre la crise climatique. Ou, pire encore, d'accueillir dans ses rangs des « gens de gauche » qui continuent sans relâche à qualifier le changement climatique de … « plus grande fraude impérialiste » !
La conclusion est tragique : lorsque le très grand capital international, et par conséquent le système capitaliste, responsables de la catastrophe climatique, ont de tels ennemis de gauche, ils n'ont pas besoin d'amis ! Ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles quand ces gens de gauche – en Grèce et dans le monde – dénoncent tout et n'importe quoi sauf les vrais criminels, et avec eux leurs patrons, leurs filiales locales, leurs porte-voix, leurs représentants politiques, c'est-à-dire leur système capitaliste. Comme par exemple « Les vingt plus grandes entreprises qui ont contribué ensemble à l'émission de 480 milliards de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone et de méthane, provenant principalement de la combustion de leurs produits, ce qui équivaut à 35% de toutes les émissions de combustibles fossiles et de ciment dans le monde depuis 1965 » (voir le tableau ci-dessous) :
2024-09-06_02_pinakas-01
Conclusion : la grande tragédie de la crise climatique, c'est que huit milliards d'êtres humains sont contraints de payer cher – au prix de leur santé, de leur vie, de la santé et de la vie de leurs descendants, de la destruction de la nature et d'une planète de plus en plus dégradée – la cupidité de quelques dizaines de multinationales polluantes qui continuent à faire des profits monstrueux.
Pire encore, au moins une partie de notre gauche répète et diffuse, souvent mot pour mot (!), la propagande « climatonégationiste » produite par la véritable fabrique de propagande de ces multinationales polluantes géantes. Et, signe de l'importance que ces multinationales attachent à saper et à dénigrer les thèses scientifiques sur la crise climatique, seulement cinq d'entre elles ont dépensé au cours de la dernière décennie au moins 200 millions de dollars par an pour promouvoir leur propagande et leur désinformation en faveur des combustibles fossiles (voir le tableau correspondant pour l'année 2018).
2024-09-06_03_pinakas-spend-on-climate-lobbying-2018
Un cas typique de ce genre de propagande est l'article intitulé « Crise climatique : croyance religieuse ou vérité scientifique ? « de ancien ministre islamophobe Andreas Andrianopoulos, qui a quitté le parti de la Nouvelle Démocratie parce qu'il ne la trouvait pas assez… néolibérale. Le fait que M. Andrianopoulos ait été « conseiller » de M. Poutine et du président (à vie) de l'Azerbaïdjan, M. Aliyev, n'a évidemment rien à voir avec le contenu délirant de ses articles « climatonégationistes ». Rien à voir non plus avec les déclarations et les articles d'autres « conseillers » célèbres de M. Poutine, comme l'ancien chancelier allemand Schröder ou l'ancien Premier ministre français Fillon… mais aussi des gens de gauche moins célèbres – grecs et étrangers – connus pour leur soutien au locataire du Kremlin.
Bien entendu, ici on n'a pas affaire à des simples « coïncidences ». M. Poutine et ses amis de par le monde Trump, Orban, Bolsonaro, Milei, etc. sont tous des « climato-sceptiques » fanatiques, comme le sont d'ailleurs leurs partisans d'extrême droite et néofascistes de par le monde. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard si tous ces braves gens, aidés par le grand capital international, qui a tout intérêt à perpétuer l'économie dépendante des énergies fossiles, financent généreusement les armées de climato-négationnistes de tout genre, qui n'ont qu'un seul objectif : empêcher l'adoption et surtout la mise en œuvre de mesures pour faire face à la catastrophe climatique….
Par conséquent, puisque la crise climatique, qui – malheureusement – s'intensifiera et atteindra bientôt des points de bascule, prend désormais des dimensions existentielles pour l'humanité, et puisqu'il n'y a personne d'autre que nous pour la combattre, le conflit avec ceux et leurs intérêts qui l'ont créée et l'alimentent, en refusant obstinément de l'empêcher, ne peut être qu'un conflit de vie et de mort. Plus que jamais, c'est donc maintenant que la gauche peut justifier son existence en faisant de la lutte contre la catastrophe climatique sa priorité absolue et sa première tâche militante…
Yorgos Mitralias
Ecosocialismo e sinistra
https://andream94.wordpress.com/2024/09/09/ecosocialismo-e-sinistra/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le peuple algérien réitère son rejet du régime militaire

Malgré la confusion qui a accompagné l'annonce des résultats des récentes élections présidentielles en Algérie, une chose est claire et certaine : le peuple algérien rejette massivement le régime militaire...
11 septembre 2024
Gilbert Achcar
Professeur, SOAS, Université de Londres
Abonné·e de Mediapart
Malgré la confusion qui a accompagné l'annonce des résultats des récentes élections présidentielles en Algérie, une chose est claire et certaine : le peuple algérien rejette massivement le régime militaire, après avoir consacré son Hirak il y a cinq ans à exiger la fin de ce régime et son remplacement par un pouvoir civil démocratique. En effet, la confusion elle-même est une conséquence directe de ce fait, qui a émergé à travers le véritable enjeu de ces élections, personne n'ayant le moindre doute quant à la victoire du candidat de l'institution militaire, Abdelmadjid Tebboune. Ce qui était vraiment en jeu, c'était l'ampleur de la participation du peuple algérien à ces élections, par rapport aux précédentes organisées fin 2019, que l'institution militaire avait imposées face au rejet et au boycott du Hirak. Le résultat ne fut pas alors celui escompté par les militaires, puisque le taux de participation fut inférieur à 40% (39,51% pour être exact, avec 9 755 340 personnes ayant voté, selon les chiffres officiels, sur 24 474 161 inscrites). Ce faible taux de participation s'est produit alors que les autorités avaient permis une plus grande diversité des candidats, avec cinq candidats en lice en 2019.
Quant aux élections de samedi dernier, le taux de participation y a été inférieur à celui de 2019, qui était lui-même inférieur aux chiffres officiels des élections précédentes. Selon le décompte officiel, le nombre total de votes exprimés samedi dernier pour les trois candidats en lice n'a été que de 5 630 196, une baisse importante par rapport au total des votes exprimés il y a cinq ans, tandis que le nombre des inscrits était presque inchangé (24 351 551), de sorte que le taux de participation est tombé à 23,12% seulement ! La tentative du chef de l'Autorité nationale « indépendante » des élections, Mohamed Charfi, de camoufler la défaite du gouvernement en affirmant que le taux de participation « moyen » était de 48 %, chiffre obtenu en divisant le taux de participation par le nombre de circonscriptions électorales (comme dire que le taux de participation moyen entre 10 % dans une ville de 100 000 électeurs et 90 % dans une ville de moins de 1000 électeurs est de 50 %) a échoué au point que la propre campagne de Tebboune a dû protester contre la confusion ainsi causée.
Face à cette défaite politique désastreuse, les 94,65% des voix obtenues par Abdelmadjid Tebboune, selon les chiffres officiels, semblent bien maigres, sans parler du fait que les deux autres candidats n'ont pas tardé à accuser les autorités d'avoir falsifié les résultats. Selon le décompte officiel, Tebboune a reçu 5 329 253 voix, contre 4 947 523 en 2019, soit une légère augmentation. Mais contrairement à certains commentaires qui ont vu dans le pourcentage obtenu par Tebboune une imitation de la tradition bien connue des dictatures régionales, qui exige d'accorder au président plus de 90% des voix, le pourcentage de 94,65% aux dernières élections algériennes n'a pas été combiné avec un taux de participation élevé comme c'est généralement le cas dans les dictatures, que ce soit en falsifiant les chiffres ou en imposant la participation à la population, ou les deux.
Au contraire, la faible participation a confirmé que le Hirak de 2019 – même si le régime militaire et les services de sécurité ont pu l'écraser par la répression et les arrestations arbitraires, saisissant initialement l'opportunité offerte par la pandémie de Covid en 2020 et poursuivant la même approche jusqu'à ce jour – le Hirak est toujours vivant comme un feu sous les cendres, attendant une occasion de s'enflammer à nouveau. Il ne fait aucun doute que l'establishment militaro-sécuritaire au pouvoir considérera le résultat des élections comme une source d'inquiétude, surtout qu'il s'est produit bien que le gouvernement ait augmenté les dépenses sociales avec lesquelles il tente d'acheter l'assentiment du peuple, en profitant de la hausse des prix des hydrocarbures et de l'augmentation de ses revenus qui s'en est suivie, avec le besoin européen croissant de gaz algérien pour compenser le gaz russe. Les hydrocarbures représentent en effet plus de 90% de la valeur des exportations algériennes, un pourcentage bien plus important que tous les pourcentages électoraux, car il indique l'échec lamentable des militaires à industrialiser le pays et à développer son agriculture, un objectif qu'ils ont déclaré prioritaire depuis qu'ils ont pris le pouvoir en 1965 sous la houlette de Houari Boumediene, notamment après la nationalisation du secteur des hydrocarbures en 1971.
Il est à craindre que la réaction de l'institution au pouvoir à son échec politique évident ne se traduise par une nouvelle restriction des libertés et ne conduise le pays sur la voie traditionnelle des dictatures régionales, avec davantage de fraude électorale, au lieu de répondre au désir clair du peuple algérien de voir les militaires retourner dans leurs casernes et faire place à un gouvernement civil démocratique issu d'élections libres et équitables. Au contraire, des faits indiquent que le pays suit le modèle égyptien en élargissant le champ d'intervention de l'institution militaire dans la société civile, comme en témoigne la décision prise par la présidence au début de l'été de permettre aux officiers de l'armée d'occuper des postes dans l'administration civile sous prétexte de bénéficier de leurs qualifications.
En fin de compte, des deux vagues de soulèvements qu'a connues la région arabophone en 2011 et 2019, les régimes en place n'ont tiré que des leçons répressives en resserrant leur emprise sur les sociétés. Ce faisant, ils ne font qu'ouvrir la voie à des explosions encore plus grandes et plus dangereuses que ce que la région a connu jusqu'à présent, alors que la crise économique et sociale structurelle qui a constitué la base des deux vagues révolutionnaires précédentes continue de s'aggraver et s'aggravera inévitablement tant que les régimes de tyrannie et de corruption resteront en place.
Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 10 septembre en ligne et dans le numéro imprimé du 11 septembre. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Série Soudan (4/4), Arabie Saoudite et Émirats, ces alliés devenus adversaires

Généralement partenaires et même alliés, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis font preuve en réalité d'une rivalité très vive au Soudan, où la guerre civile fait rage. Les deux royaumes soutiennent des camps opposés.
Tiré de Mondeafrique
26 août 2024
Par la rédaction de Mondafrique
Un article de Mateo Gomez

Le chef d'État du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, qui a dégagé le dictateur Omar al-Bashir en 2019, fait face à son ancien second surnommé Hemeti, qui dirige le groupe paramilitaire Forces de Soutien Rapide (FSR). Mais ce conflit n'est pas qu'une embrouille domestique. Le Soudan, lien entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne, est riche en ressources naturelles. Du coup, ce pays attire les convoitises régionales.
Ainsi, l'Arabie Saoudite comme les Émirats Arabes Unis (EAU) voient tous deux la guerre comme une opportunité pour étendre leur influence dans la région. Les Saoudiens soutiennent le gouvernement internationalement reconnu d'Abdel Fattah, alors que les Émiratis penchent pour le chef des rebelles et ex numéro deux du régime.
Ces derniers n'espèrent pas une victoire complète des FSR, de toute façon hautement improbable au vu de la force et la légitimité de Fattah. Mais un cas probable serait une situation similaire à celle de la Libye, où divers groupes se battent pour des zones d'influences sur le territoire. Un tel cas de figure permettrait aux Émirats d'être une perpétuelle épine dans le pied Saoudien, et d'en extraire ainsi des concessions.
Généralement partenaires et même alliés, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis font preuve en réalité d'une rivalité très vive au Soudan, où la guerre civile fait rage. Les deux royaumes soutiennent des camps opposés.
Le groupe Wagner (1) dans la boucle
Ces monarchies du golfe ont joué un rôle significatif au Soudan depuis la chute de la dictature d'al-Bashir en 2019, envoyant des milliards de dollars à la junte d'Abdel Fattah en aide et investissements. Leurs intérêts étaient à l'époque alignés. Mais le rapprochement du Soudan avec le Qatar, rival des EAU, fut vu d'un mauvais œil par Abu Dhabi. Et lorsque les FSR, qui avaient déjà soutenu les intérêts émiratis au Yémen et en Libye, s'affirmèrent comme la première force d'opposition à Fattah en 2023, le patron des Émirats, MBZ, sauta sur l'occasion.
Sans manifester une hostilité trop évidente à l'égard des saoudiens, les émiratis ont collaboré avec la Russie pour soutenir le groupe Wagner, qui a offert ses services aux FSR. Les paramilitaires soudanais protègent les intérêts miniers des paramilitaires russes, qui envoient des ressources à la Russie… en passant par les Émirats. En juin 2023 la trésorerie américaine à sanctionné Al Junaid et Tradive, deux entreprises minières associées à Hemeti et basées au Soudan et aux Émirats.
Les Saoudiens, de leur côté, travaillent sans relâche pour se présenter comme un médiateur de paix crédible et comme un soutien humanitaire conséquent pour les soudanais. Mais la perspective de la paix est encore lointaine. Si elle venait à se réaliser, les saoudiens pourraient renforcer leur image de leader du monde arabe et musulman. Mais si une situation similaire à celle en Libye s'installe, les Emirats pourraient durablement fragiliser l'influence saoudienne dans la région – une victoire pour le petit royaume.
Les Américains convoités
Cette compétition entre les deux royaumes n'est pas nouvelle. Les Émirats n'hésitent pas à nouer des liens diplomatiques avec tout le monde, y compris l'Iran, l'ennemi juré des saoudiens. Au Yémen, les tensions sont palpables. Riyad soutient le gouvernement reconnu internationalement d'Abed Rabbo Mansour ; Abu Dhabi en revanche soutient le groupe rebelle du Conseil de Transition du Sud (2), qui lui offre un accès privilégié aux ports du pays mais qui bloque le développement d'infrastructures pétrolières saoudiennes.
Dernièrement, la compétition entre les deux pays pour mettre les États-Unis de leur coté a été intense. Depuis la scandale de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi par les saoudiens, les relations entre le royaume et les États-Unis se sont refroidies considérablement, ouvrant la porte aux Émiratis qui voudraient devenir le partenaire privilégié de la superpuissance dans la région à coup d'achats d'armes.
Cerise sur le gâteau, la signature des accords d'Abrahams avec les Israéliens a renforcé encore la crédibilité de MBZ, le chef tout puissant des Émiratis, auprès des Américains, alliés constants de Tel Aviv.
(1) Malgré sa rébellion ratée, le groupe Wagner est toujours présent en Ukraine, en Biélorussie et en Afrique. Il a été intégré à l'armée régulière russe et doit répondre aux ordres d'Andreï Trochev, qui a été directement nommé par Vladimir Poutine.
(2) Les autorités séparatistes du Sud accusent le gouvernement d'Abd Rabbo Hadi – appuyé par une coalition militaire conduite par l'Arabie saoudite – de ne pas avoir rempli ses obligations et d'avoir même « conspiré » contre leur cause. En principe, tous sont alliés au sein du camp « loyaliste » contre la rébellion houthi au nord. Dans la réalité, l'accord qu'ils ont signé – contraints et forcés – début novembre à Riyad ne s'est jamais traduit dans les faits.
***Source : Mohammad, Talal. “How Sudan Became a Saudi-UAE Proxy War”, Foreign Policy, Fall 2023, pp. 24-26
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :













