Derniers articles

Vive la sécurité alimentaire !

Le Champ d'actions Collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke a organisé, le 7 octobre dernier à l'Aréna Julien-Ducharme, une journée complète de conférences et de discussions sur le thème de la sécurité alimentaire. Cet événement a réuni environ 80 participants. Voici un résumé de ma participation à cette activité.
Tiré du Journal Entrée Libre
https://www.entreelibre.info/vive-la-securite-alimentaire/
Date : 1 décembre 2024
| Chroniqueur.es : Claude Saint-Jarre
Contexte et enjeux de la sécurité alimentaire
Cette rencontre avait pour objectif de contribuer à éliminer toute forme de vulnérabilité alimentaire, alors que près de 13 % de la population de notre région vit dans l'insécurité alimentaire. Bien que le manque de nourriture soit un problème bien réel, Estelle Richard, dans son livre Pour en finir avec le gaspillage alimentaire, estime que nous jetons plus de 50 % de la nourriture produite, ce qui génère des quantités significatives de gaz à effet de serre, préoccupant ainsi les climatologues.
Les causes de cette insécurité sont multiples, notamment le libre-échange, qui met en difficulté nos maraîchers locaux.
Initiatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Le glanage, par exemple, fait partie des initiatives pour réduire le gaspillage. Le projet Glanage Sherbrooke a même lancé une bière de la sécurité alimentaire, produite à partir de petits fruits pour financer ses activités.
Les cuisines collectives jouent également un rôle important. Elles visent à partager des connaissances culinaires et des pratiques innovantes pour préparer des repas à la fois sains et savoureux. À Sherbrooke, Le Blé d'Or est un bel exemple de ce type d'initiative.
Programmes et projets inspirants
J'ai aussi découvert le projet Cantine pour tous, un programme qui s'inscrit dans le Programme alimentaire scolaire universel du Québec. Ce projet nourrit chaque matin 87 000 enfants à travers la province, avec 33 membres répartis dans 12 régions, dont 4 en Estrie. Une belle réussite qui mérite d'être saluée !
Ateliers de réflexion et priorités locales
L'après-midi a été consacré à des ateliers où, par tables, nous avons partagé nos idées et priorités pour améliorer la sécurité alimentaire de manière durable et accessible pour tous. Chaque groupe était invité à proposer son coup de cœur. Notre table a suggéré la création de maisons de quartier dédiées à la littératie alimentaire — un concept qui englobe l'éducation, le soutien, et des pratiques concrètes pour nourrir à la fois le corps et l'esprit.
Contributions locales et engagements politiques
Madame Audet, représentante de la Ville de Sherbrooke, a présenté les efforts entrepris dans le cadre du PDZA (Plan de Développement de la Zone Agricole) et du PDCN (Plan de Développement d'une Communauté Nourricière) pour renforcer notre système alimentaire local.
De son côté, Jessica Dufresne, docteure en droit, a évoqué l'idée ambitieuse de faire reconnaître le droit à l'alimentation. Elle a également mis en lumière le réseau des cuisines collectives du Québec.
Madame Colin, quant à elle, a partagé avec enthousiasme les réussites des Complices alimentaires de la Montérégie Ouest. Grâce à leur travail acharné, ils ont réussi à récupérer 72 tonnes d'aliments, soit l'équivalent de six autobus scolaires remplis de denrées sauvées. Leur objectif est d'atteindre 125 tonnes, un défi qui dépendra de la gouvernance innovante qu'elle sait mettre en place.
Une dynamique locale porteuse d'espoir
Depuis des millénaires, la quête de la sécurité alimentaire est ancrée dans nos sociétés. Ici, à Sherbrooke, je perçois une réelle compétence, un engagement sincère, et un fort esprit d'entraide et de solidarité.
Monsieur Boutin, directeur de la Grande Table, a annoncé qu'une nouvelle journée de discussions se tiendra en janvier, avec l'ambition de faire avancer les initiatives et d'envisager la création d'une Charte de l'alimentation pour Sherbrooke.
Initiatives complémentaires
Enfin, les 7 et 8 novembre, un radiothon organisé par CFAK a permis de récolter des fonds pour Moisson Estrie. De plus, un balado sur la sécurité alimentaire, avec des intervenants locaux, est disponible dans l'émission À nous le futur.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Au Canada, les Wet’suwet’en veulent sauver les forêts au nom des “générations futures”

La Première Nation Wet'suwet'en lutte pour reprendre possession de forêts anciennes de Colombie-Britannique que les autorités se sont appropriées et louent sans son accord à des entreprises forestières, rapporte “The Guardian”, qui les a accompagnés sur le terrain. Un article publié à l'occasion de la campagne “Changez leur histoire” d'Amnesty nternational.
Tiré de Courrier international. Publié à l'origine dans The Guardian.
Guidés par David DeWit, un des chefs du peuple wet'suwet'en, nous avons survolé des carrés de terres déboisées et des plantations de conifères de différentes teintes de vert dans le centre-nord de la Colombie-Britannique. Les repères sur la carte de David DeWit, qui a retracé les sentiers ancestraux de son peuple, correspondaient à des marques visibles du sol : des cercles gravés dans les arbres, preuve s'il en est de la longue histoire des Premières Nations dans la région.
L'hélicoptère s'est approché de Caas Tl'aat Kwah (également connu sous le nom de “Serb Creek”), un bassin-versant de 15 000 hectares. La forêt s'est alors transformée en une dense étendue d'un vert profond, entrecoupée de zones humides vert-jaune où serpentent des cours d'eau bleu turquoise. “Nous voulons préserver tout cela pour les générations futures, explique Charlotte Euverman, la meneuse de la lutte des Wet'suwet'en pour la défense de ces terres, où se tiennent des festins traditionnels. Nous devons au moins leur laisser cela.”
Comme la plupart des Premières Nations de la région, les Wet'suwet'en n'ont jamais signé de traité avec le gouvernement canadien ou provincial, et pourtant ce dernier s'est approprié ces terres et les loue désormais à des entreprises forestières. Aujourd'hui, en Colombie-Britannique, il ne reste plus que 20 % des forêts anciennes de la région [c'est-à-dire des forêts âgées de plus de 250 ans].
150 000 km2 de terres brûlées
En 2020, après plusieurs décennies de mobilisation, la province a publié un rapport [intitulé Examen stratégique des forêts anciennes] qui signalait qu'environ un quart des forêts anciennes restantes étaient exposées à un risque élevé de déboisement. Elle recommandait alors de cesser l'exploitation forestière de ces terres en attendant de décider de leur sort. Pourtant, à ce jour, les activités d'exploitation ont été reportées dans moins de la moitié de ces zones à haut risque.
Aujourd'hui, Caas Tl'aat Kwah est au cœur d'un débat sur le domaine de compétence des Premières Nations, la perte et la protection de la biodiversité, et le rôle joué par l'exploitation forestière industrielle dans l'intensification des feux de forêt au Canada, qui ont des répercussions dans le monde entier. Durant l'été 2023, plus de 150 000 km² de terres ont brûlé dans tout le pays, un record absolu. Ces incendies ont dégagé de la fumée à travers tout le continent américain et ont entraîné une pollution atmosphérique jusqu'en Europe et en Chine.
Avec ce vol en hélicoptère, Sandra Harris a enfin pu se rendre à Caas Tl'aat Kwah, car la zone n'est pas encore accessible par la route. C'était une grande première pour cette membre des Premières Nations dont l'arrière-grand-père, Jack Joseph, possédait jadis une cabane dans la région. Le pilote a posé l'hélicoptère sur une prairie marécageuse et David DeWit, qui dirige le Bureau des Wet'suwet'en [un organe chargé de gérer certaines questions territoriales et sociales], nous a guidés à travers les arbres jusqu'à une cabane plus récente, où il a accroché une photo encadrée de Jack Joseph.
Les dégâts de l'exploitation forestière
Selon certaines idées reçues, l'augmentation de la gravité des incendies ne serait pas seulement due au réchauffement climatique, mais aussi à la croissance dense des forêts permise par la lutte contre les incendies. La solution longtemps défendue a alors été de réduire la “charge en combustible” des forêts par des coupes rases et des brûlages dirigés, [sorte de débroussaillages par de petits incendies volontaires, qui permettent d'assainir la forêt]. Cependant, de plus en plus de scientifiques affirment que cette approche néglige le rôle de l'exploitation forestière industrielle dans l'intensification des feux de forêts – ces activités détruisent les écosystèmes complexes qui stabilisent le cycle de l'eau.
Le déboisement d'une zone assèche énormément la terre, et les entreprises forestières laissent souvent derrière elles des tas de copeaux très secs et inflammables. Bien que la Colombie-Britannique exige des entreprises forestières qu'elles replantent des arbres dans l'année suivant la coupe, ces jeunes plantations restent extrêmement inflammables.
Une étude scientifique a étudié 1 500 incendies qui se sont produits dans les États de l'ouest des États-Unis sur une période de trente ans. Elle montre que les forêts protégées avec une forte densité de croissance ont été moins touchées par les incendies que les forêts soumises à l'exploitation forestière intensive. Une autre étude a conclu que les forêts plantées à la suite de l'exploitation forestière “étaient un élément majeur de la gravité des feux de forêts”, contrairement aux forêts anciennes et denses. Enfin, une dernière a constaté que la coupe rase était un des principaux facteurs à l'origine des “incendies fréquents et de grande ampleur”.
Aucun droit de veto
Les flancs des montagnes qui s'élèvent à partir des zones humides de Serb Creek abritent un écosystème de cèdres, de pruches du Canada, d'épinettes d'Engelmann et de sapins subalpins, avec des arbres parfois vieux de 350 ans. D'après la province, le bassin-versant relève de la compétence du British Columbia Timber Sales (BCTS), la branche commerciale du ministère des Forêts.
En vertu du plan pour les forêts anciennes de 2020, les Wet'suwet'en ont fait savoir au BCTS qu'ils étaient favorables au report des activités d'exploitation forestière, ce que le ministère des Forêts a reconnu dans une lettre en 2023.
Cependant, de récentes cartes dévoilées par l'organisation [de protection de l'environnement] Sierra Club BC ont révélé que le BCTS avait déjà cartographié une partie de la région pour d'éventuelles coupes d'arbres. Le ministère des Forêts n'a pas souhaité nous accorder d'interview, mais son représentant nous a répondu par courriel :
- “Les reports [d'exploitation] seront maintenus tant qu'une stratégie de gestion à long terme des forêts n'aura pas été mise en œuvre.”
Ces dernières années, la Colombie-Britannique et le Canada ont tous les deux adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), qui requiert leur “consentement préalable, libre et éclairé”. Pourtant, ils n'ont pas accordé de droit de veto aux Premières Nations concernant les projets développés sur leurs terres.
“Les feux de forêts continuent”
Les populations locales sont préoccupées par la possibilité que le BCTS décide un jour d'exploiter Caas Tl'aat Kwah. Le porte-parole du ministère a répondu à ces inquiétudes : “Si les reports temporaires sont levés […], le BCTS […] organisera toute exploitation forestière potentielle en veillant à préserver la biodiversité, la faune, la richesse culturelle et les possibilités de loisir dans la région.”
D'après Sandra Harris, un des principaux défis auxquels est confronté son peuple est le fait que la ligne politique de la province change tous les quatre ans, à chaque nouveau gouvernement, alors que les lois wet'suwet'en restent inchangées. “Nos histoires nous aident à connaître nos lois et à comprendre nos responsabilités. Ça, ça ne change pas”, ajoute-t-elle.
Jens Wieting, responsable de la campagne de protection du climat et de la forêt pour le Sierra Club BC, a vu “d'innombrables exemples” de cette réalité. Il explique :
- “Quand une [Première] Nation réussit à s'opposer à l'exploitation forestière, elle doit reprendre cette lutte quelques années après, et parfois elle perd.”
David DeWit doute que le plan de la province pour les forêts anciennes suffise à protéger la région, et souhaite que les Wet'suwet'en assurent la protection de Caas Tl'aat Kwah en accord avec leurs propres traditions. Les membres de Kwen Bea Yex [littéralement, la “Maison près du feu”, une des maisons wet'suwet'en, à qui reviendrait cette responsabilité] pourraient alors décider que la région est indispensable sur les plans culturel et écologique, et y interdire toute exploitation forestière, résume-t-il. Cette maison devrait obtenir l'accord de son clan, puis de tous les autres clans, et l'accord serait ratifié par un grand festin.
Mais, en attendant, les feux de forêt continuent. En août 2024, 353 incendies se sont déclarés en Colombie-Britannique, dont un “particulièrement important” sur le territoire des Wet'suwet'en. Pour Sandra Harris, le racisme et le colonialisme ont laissé des plaies profondes, mais David DeWit reste optimiste : “En soignant la terre, nous nous guérirons nous-mêmes.”
Erica Gies
La Première Nation Wet'suwet'en
Pour s'être opposés, en 2020, à un projet de gazoduc sur leurs terres ancestrales de Colombie-Britannique, plus de 75 militants pour les droits fonciers des Wet'suwet'en ont été arrêtés par les autorités canadiennes. Une vingtaine d'entre eux font l'objet de poursuites pénales depuis 2022, et trois ont été déclarés coupables d'outrage criminel en 2024. D'autres sont victimes de surveillance ciblée, de harcèlement et d'intimidation. Amnesty International demande la fin de telles pratiques, menées contre des militants qui défendent leur territoire pacifiquement.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Canada ne respecte pas la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien : CJPMO

Montréal, 29 novembre 2024 - En cette Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) considère que le gouvernement Trudeau a fait preuve d'une négligence totale en termes de soutien à la vie, aux moyens de subsistance et aux droits du peuple palestinien.
CJPMO demande depuis longtemps au gouvernement canadien de prendre des mesures immédiates pour mettre fin au génocide israélien à Gaza et à l'annexion de la Cisjordanie, qui visent à détruire le peuple palestinien. CJPMO demande au Premier ministre Trudeau de soutenir pleinement les efforts internationaux visant à tenir Israël responsable, notamment par le biais de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice, et d'imposer une série de sanctions visant à mettre fin immédiatement aux actes criminels d'Israël.
« Depuis 1948, l'avenir de la Palestine n'a jamais été aussi incertain », a déclaré Thomas Woodley, président de CJPMO. « Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination est attaqué de toutes parts, tandis que les ministres israéliens discutent ouvertement de l'effacement complet du peuple palestinien. Il est temps que le Canada adopte une position honnête en faveur du droit international, qu'il défende la vie et les droits du peuple palestinien et qu'il cesse de donner la priorité à ses relations diplomatiques et économiques avec un État génocidaire », a ajouté M. Woodley.
Depuis plus d'un an, Israël mène à Gaza une guerre génocidaire qui a conduit le territoire au bord de l'anéantissement. Israël a ignoré les ordres de la CIJ d'empêcher les actes génocidaires à Gaza, alors que la CPI a accusé le Premier ministre israélien Netanyahu et l'ancien ministre de la défense Gallant d'avoir sciemment et délibérément « créé des conditions de vie calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population civile à Gaza ». Le ministre israélien des finances, M. Smotrich, a déclaré cette semaine qu'il était possible « d'occuper Gaza et de réduire la population de moitié en l'espace de deux ans » et considère cela comme un précédent pour le dépeuplement de la Cisjordanie. Entre-temps, les propositions visant à annexer officiellement des parties de Gaza et de la Cisjordanie sont susceptibles d'obtenir le feu vert de la future administration Trump.
Malgré les horreurs du moment, l'année écoulée a vu les institutions du droit international offrir une lueur d'espoir que les dirigeants israéliens puissent un jour être tenus pour responsables. L'affaire contre Israël devant la CIJ pour crime de génocide, l'avis consultatif de la CIJ selon lequel Israël doit mettre fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé, et les mandats d'arrêtde la CPI contre Netanyahou et Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, offrent tous de modestes perspectives de justice et de soulagement. Cependant, CJPMO note que ces jugements et décisions n'arrêteront pas Israël à eux seuls, mais qu'ils nécessitent que la communauté internationale les applique et agisse en conséquence. « Le Canada doit agir pour s'assurer que le droit international s'applique à tous, et compléter cette action en soutenant les appels de la société civile canadienne en faveur de sanctions et d'embargos contre Israël », a ajouté Mme Woodley.
En cette journée de solidarité, CJPMO exhorte le gouvernement canadien à répondre à l'urgence du moment en prenant les mesures suivantes :
– Imposer des sanctions aux dirigeants politiques et militaires israéliens pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide ;
– Imposer un embargo complet sur les armes dans les deux sens en utilisant la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES),
– Exprimer un soutien total aux mandats d'arrêt de la CPI et promettre de coopérer activement avec la Cour pour l'arrestation et la poursuite de Netanyahu et Gallant ;
– Exprimer un soutien total à la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ ;
– reconnaître l'État de Palestine
– aligner ses votes sur les droits de la personnes des Palestiniens et soutenir les initiatives visant à suspendre la participation d'Israël à l'Assemblée générale des Nations unies.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Victoire ! La Cour fédérale confirme la fin du statut d’organisme de bienfaisance du FNJ

Vendredi dernier, le 8 novembre, l'appel du Fonds national juif (FNJ) du Canada contre la décision de l'Agence du revenu du Canada (ARC) de révoquer son statut d'organisme de bienfaisance a été sommairement rejeté par la Cour fédérale. Il s'agit de la première grande bataille perdue par le FNJ dans sa tentative de renverser la décision historique de l'ARC du mois d'août dernier.
13 novembre 2024
Depuis sa création, le FNJ Canada est un pilier fondamental de la complicité canadienne dans le nettoyage ethnique israélien du peuple palestinien et le vol des terres palestiniennes. Le FNJ a été un moteur de la colonisation et de l'occupation sionistes avant même la création d'Israël, grâce à sa mission déclarée de « racheter la terre d'Israël pour le peuple juif ». Cette « rédemption » signifiait en réalité le déplacement forcé de masse et le nettoyage ethnique des Palestiniens. Le JNF poursuit depuis longtemps son objectif de « faire fleurir le désert » par l'expropriation de terres, ouvrant ainsi la voie à l'expansion de la colonisation sioniste. Malheureusement pour le JNF, le peuple palestinien a toujours habité ces terres et résiste encore aujourd'hui à l'effacement de sa présence et de son histoire par Israël.
FNJ Canada a participé à plusieurs grandes campagnes de « reboisement » sur des terres palestiniennes occupées. Cette action a été menée en totale contradiction avec le droit canadien et international, utilisant l'environnement comme arme pour déplacer les Palestinien.ne.s et assurer la consolidation du contrôle d'Israël sur les terres palestiniennes.
L'un des projets d'écoblanchiment les plus tristement célèbres du FNJ Canada est le parc Ayalon Canada, situé en Cisjordanie occupée. Bernard Bloomfield, de Montréal, alors président du FNJ Canada, a mené une campagne en 1972 pour collecter plus de 15 millions de dollars au sein de la communauté juive canadienne afin d'assurer l'établissement du parc. Pour créer le parc, trois villages palestiniens – Imwas, Yalu et Deir Aiyub – ont vu leurs terres confisquées et leurs habitants expulsés. L'un des survivants, le Dr Ismail Zayid, deviendra par la suite une voix puissante au Canada pour dénoncer la complicité du FNJ Canada dans les crimes commis par Israël.
Pour les défenseur.euse.s palestinien.ne.s des droits de la personne, la défaite judiciaire du FNJ est une victoire importante. FNJ Canada ne peut plus délivrer de reçus fiscaux pour les dons de bienfaisance et devra donc mettre fin à ses activités. L'ARC a également reconnu que FNJ Canada violait les normes juridiques canadiennes et internationales, dont une grande partie était résumée dans la plainte déposée par VJI en 2017.
Bien qu'il s'agisse d'une victoire importante et d'un couronnement pour VJI et le mouvement de solidarité avec la Palestine plus largement, la lutte pour assurer la fin de la complicité du FNJ est loin d'être terminée. FNJ Canada dispose encore de plusieurs voies juridiques pour contester la décision de l'ARC – notamment en faisant appel de la décision devant la Cour d'appel fédérale. Pendant ce temps, le FNJ en Israël continue d'accaparer des terres palestiniennes en Cisjordanie et de financer des projets liés à la violence des colons. Tout en continuant à lutter contre l'exploitation du secteur caritatif pour financer l'apartheid israélien, nous demandons au Canada d'aller au-delà de la révocation du statut et de sanctionner directement le FNJ en Israël.
Dans les prochains mois, le FNJ Canada aura la possibilité de céder à l'ARC ses actifs restants (évalués à environ 31 millions de dollars en 2023) ou de les donner à un autre organisme de bienfaisance agréé. Compte tenu de la conduite antérieure de la FNJ Canada et de la manière dont des organismes de bienfaisance similaires se sont départis de leurs actifs lorsque leur statut a été révoqué, il est possible qu'elle s'efforce de transférer ses fonds à une organisation qui se livre à des pratiques tout aussi préjudiciables à l'égard des Palestinien.ne.s – et il en reste encore beaucoup de ce type d'organisations actives au Canada.
Comme le détaille notre rapport le plus récent, co-publié par Just Peace Advocates et le Dr. Miles Howe, des millions de dollars des contribuables canadien.ne.s continuent de financer le nettoyage ethnique, l'occupation, l'apartheid et le génocide israéliens par le biais de dons « caritatifs ». Le Canada a clairement l'obligation légale, en vertu du droit international et ainsi que du droit interne Canadien, de mettre fin à cette complicité.
C'est pourquoi nous demandons à tous les Canadien.ne.s d'écrire dès maintenant à l'Agence du revenu du Canada, à la ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, et à d'autres député.e.s pour leur demander de suspendre immédiatement le statut d'organisme de bienfaisance des organisations qui se rendent complices de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et de les poursuivre en justice en vertu du Code criminel.
Nous devons poursuivre notre lutte pour que, comme l'a déclaré la députée néo-démocrate Niki Ashton, pas un centime de l'argent des contribuables canadiens ne serve à financer un génocide.
Pas d'allègements fiscaux pour les crimes de guerre en Palestine !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
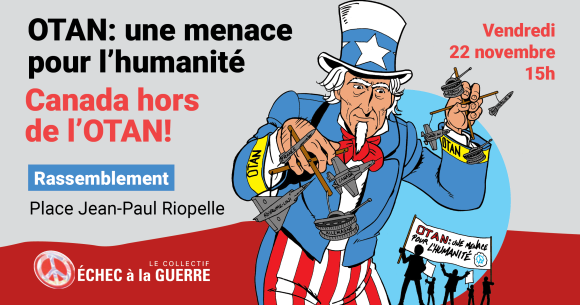
La violence à Montréal reflète celle de l’OTAN
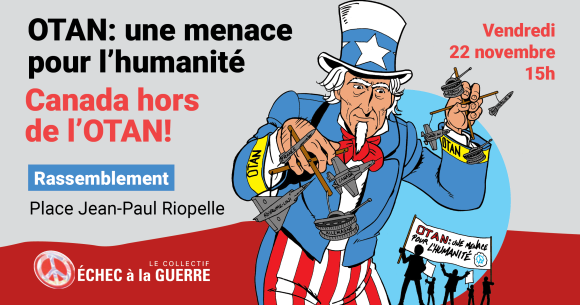
Poilièvre a blâmé Trudeau d'avoir assisté à « un spectacle artistique de Taylor Swift pendant que Montréal brûlait » (sic).
Par Pierre Jasmin, secrétaire des Artistes pour la Paix
et Izabella Marengo, participante le 24 novembre au Contre-sommet vs l'OTAN
MONTRÉAL BRÛLE-T-ELLE ?
La mairesse de Montréal Valérie Plante et son chef de police Fady Dagher ont très bien défendu le 25 novembre la réputation de leur ville en disant avoir contrôlé la violence en ciblant les casseurs qui « ont fait vendredi ce que font depuis toujours les casseurs, c'est-à-dire confisquer une autre cause ». Il s'agissait de la cause anti-OTAN chère à des protagonistes non-violents, tel Échec à la guerre qui était alors dans la rue.
La violence n'est pas que dans les hyperboles conservatrices lassantes, elle est surtout dans la répression absurde par notre classe politique et médiatique des références à la réalité d'un GÉNOCIDE, le plus monstrueux depuis l'Holocauste de la 2e Guerre mondiale ! Et c'est ce qui exaspère les pauvres Palestiniens et leurs alliés tel Haroun Bouazzi (i), qui doivent subir jour après jour cette énorme injustice tant gouvernementale que médiatique qui ose taire la mort de 55 000 de leurs compatriotes à 70% femmes et enfants, rappelons-le en cette Journée contre la violence faite aux femmes, par des machos fascistes armés ! Combien de temps encore nos médias vont tenter de cacher ce génocide perpétré à Gaza, débordant en Palestine et au Liban, exécuté par Tsahal aux ordres de Nétanyahou, surtout après sa dénonciation mondiale par la Cour Internationale de Justice de l'ONU (en janvier) et, enfin !, depuis jeudi, par sa Cour Pénale Internationale (ii) ?
NOTRE CONTRE-SOMMET AUX PROPOS BRÛLANTS DE VÉRITÉ
Comme l'a bien dit la coordonnatrice du Réseau pancanadien pour la Paix et la Justice Janine Solanki, venue de Vancouver pour animer avec Azza Rojbi le Contre-sommet vs l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, avec son slogan reproduit sur plusieurs banderoles Non à l'OTAN, oui à la paix, que signifient les dérapages des Trudeau, Poilièvre et autres maquilleurs professionnels ? Ils sont un signe évident de leur désespoir à voir la réalité mondiale leur échapper complètement. En a fait foi la teneur des discours des deux principales oratrices du contre-sommet, Medea Benjamin et Sevim Dagdelen présentées ci-haut, qui ont de plus en plus l'écoute de l'ONU. Le professeur Jeffrey Sachs, qui dirige et enseigne à l'Institut de la Terre de l'université Columbia, est justement consultant spécial auprès du secrétaire général des Nations unies António Guterres. Ce dernier a pu constater à Bakou, avec la fin abrupte de la COP29 dans la nuit du 23 au 24 novembre, combien les pays de l'OTAN, si prêts à gaspiller des centaines de milliards de $ de plus dans leurs guerres en Ukraine et au service du criminel Nétanyahou, se voient condamnés par le Sud-Global entier (sans compter les autres pays du BRICS), pour leur avarice coupable dans un sommet qui a illustré la détérioration écologique du monde. Les Artistes pour la Paix souffrent avec les habitants menacés d'être engloutis par la montée des eaux ou d'être meurtris par des feux de forêts incontrôlables.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Déclaration du contre-sommet anti-OTAN à Tio’tia :ke/Montréal – 24 novembre 2024

Nous nous engageons à rassembler d'autres Canadiens et Canadiennes partageant les mêmes objectifs de paix lors de piquets de grève, rassemblements, manifestations, campagnes épistolaires et sur les médias sociaux, en activant un lobbying citoyen persistant auprès des députés/députées et lors d'élections pour que le gouvernement canadien se retire de l'OTAN et crée une nouvelle politique étrangère indépendante et pacifique pour le Canada.
Alors que :
• Le Canada est parmi les membres fondateurs de l'alliance militaire nommée l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) crée en 1949 ;
• l'OTAN est une alliance militaire offensive dominée par les États-Unis, qui empêche le Canada d'exercer sa souveraineté et le contrôle civil domestique de sa politique étrangère et de ses forces armées ;
• l'OTAN ne respecte pas respecté l'article 1 de sa charte « de régler tout différend international dans lequel elle pourrait être impliquée par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ne soient pas mises en danger » ;
• l'OTAN a lancé des interventions illégales – sans rendre de comptes – contre la Yougoslavie en 1999, l'Afghanistan en 2001 et la Libye en 2011, qui ont toutes provoqué des morts massives de civils, la destruction d'infrastructures, une crise de personnes réfugiées sans précédent dans l'histoire de l'humanité et une dégradation de l'environnement naturel, avec des mines terrestres, de l'uranium appauvri et des armes à sous-munitions ;
• l'OTAN et ses pays membres ont provoqué le conflit actuel en Ukraine
a) en s'étendant sur 800 km vers l'est en direction de la Russie, malgré les promesses contraires faites à M. Gorbatchev lors de la chute du mur de Berlin ;
b) en soutenant à Kyiv la junte Banderite installée par un coup d'État inspiré par les États-Unis en 2014 contre le gouvernement démocratiquement élu Ianoukovitch ;
c) en armant au mépris de l'ONU et des Traités de Minsk le gouvernement putschiste dans sa guerre contre la région russophone du Donbass ;
d) en sollicitant activement l'adhésion à l'OTAN de l'État ukrainien auparavant neutre ;
• l'OTAN s'est constamment opposée aux luttes de libération nationale de l'après Seconde Guerre mondiale, entre autres, dans les pays du Sud et aide. L'Alliance contribue actuellement au génocide à Gaza par Israël, partenaire stratégique de l'OTAN ;
• l'OTAN a au Canada terrorisé les Innus du Labrador-Nitassinan pendant un demi siècle (1955 – 2005) avec ses vols d'entraînement de chasseurs à réaction à basse altitude pour lesquels la Nation Innue a été impactée mais n'a jamais été rémunérée ;
• selon le rapport sur les dépenses de défense de l'OTAN, les dépenses militaires du Canada sont passées de $ 20 milliards en 2014 à $41 milliards en 2024 (et, selon le directeur parlementaire du budget, devraient doubler d'ici 2032), ce qui détournerait le financement des programmes sociaux et de l'action climatique (COP29, GIECC...) ;
• tout au long de l'année, l'OTAN participe à des exercices-opérations impliquant des dizaines de milliers de soldats, de véhicules, de frégates, de porte-avions et d'avions
supersoniques ayant un fort impact négatif sur le climat et l'environnement ;
• l'OTAN s'appuie sur la doctrine dangereuse MAD-Mutual Assured Destruction, sans
remettre en question un premier recours à l'arme nucléaire (alors que la Chine et d'autres pays l'ont exclu) ;
• les 32 pays adhérents de l'OTAN, dont le Canada, ont refusé, par complicité militariste, d'adhérer au Traité sur l'Interdiction des Armes Nucléaires ratifié par 73 pays de l'ONU et signé par 50 autres (ICAN.org) ;
• le Canada dirige la présence avancée renforcée de l'OTAN, un groupement tactique sis en Lettonie qui envenime le conflit avec la Russie, et maintient aussi une flotte de chasseurs à réaction en Roumanie ;
Nous, participants au Contre-Sommet à Montréal le 24 novembre 2024, appelons le gouvernement Trudeau du Canada à :
1- se retirer de l'OTAN et d'exercer une politique étrangère qui mette de l'avant la paix, le désarmement et la solidarité internationale ;
2- cesser d'alimenter la guerre en Ukraine et rechercher plutôt une fin négociée au conflit ;
3- réduire drastiquement les dépenses militaires en rejetant les 2% du PIB prescrits par l'OTAN et en consacrant les milliards économisés aux programmes sociaux et environnementaux, ainsi qu'à la réconciliation avec les peuples autochtones ;
4- mener des consultations publiques sur une nouvelle politique étrangère post adhésion à l'OTAN, qui soit non pas basée sur le rôle traditionnel du Canada de soutenir l'expansion des empires britannique et américain, mais plutôt sur la paix, la justice climatique, le désarmement et la coopération internationale ;
5- cesser tout soutien à la politique génocidaire d'Israël à Gaza, ainsi qu'aux agressions de Tsahal au Liban et en d'autres pays d'Asie occidentale en :
a) suspendant immédiatement toutes les relations diplomatiques et commerciales avec Israël jusqu'à ce qu'Israël reconnaisse l'État palestinien avec ses pleins droits ;
b) appuyant la cause de l'Afrique du Sud à la Cour Internationale de Justice - ONU en respectant les ordonnances et les lois en force qui interdisent le soutien au génocide ;
c) supprimant le statut d'organisme de bienfaisance des organismes canadiens qui collectent des fonds pour l'État d'Israël par l'application des lois actuelles ;
d) appliquant strictement le Traité de Commerce des Armes de l'ONU qui lie 130 États, par un embargo bidirectionnel total sur les armes d'Israël ;
e) soutenant les résolutions pro-palestiniennes à l'Assemblée générale des Nations Unies ;
f) et en fermant le bureau de Québec à Tel-Aviv ;
6- retirer les troupes canadiennes de la Lettonie et les chasseurs à réaction de Roumanie ;
7- signer et ratifier le Traité sur l'Interdiction des Armes Nucléaires (UNIDIR-ONU) et faire pression sur d'autres puissances pour le désarmement.
Nous nous engageons à rassembler d'autres Canadiens et Canadiennes partageant les mêmes objectifs de paix lors de piquets de grève, rassemblements, manifestations, campagnes épistolaires et sur les médias sociaux, en activant un lobbying citoyen persistant auprès des députés/députées et lors d'élections pour que le gouvernement canadien se retire de l'OTAN et crée une nouvelle politique étrangère indépendante et pacifique pour le Canada.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La Marche Mondiale des Femmes : une force féministe pour transformer le monde !

En 2023, nous avons célébré le 25ème anniversaire de la première Rencontre Internationale de la Marche mondiale des femmes, notre mouvement d'action féministe qui a vu le jour en octobre 1998 à Montréal, au Québec. Nous sommes devenues un mouvement social international-féministe, anticapitaliste et anti-impérialiste enraciné dans les luttes et contextes locaux, lié à la lutte des classes. Nous sommes aujourd'hui organisées en coordinations nationales dans 61 pays.
Tiré du site de la Marche mondiale des femmes
Nos valeurs et actions visent un changement politique, économique et social pour une transformation radicale du monde. Ces valeurs sont axées sur la mondialisation de la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples, le respect et la reconnaissance de la diversité entre les femmes et la force des alliances entre les femmes et avec d'autres mouvements sociaux progressistes.
Aujourd'hui, l'avancée de nouvelles formes de colonialisme, de racisme, de misogynie, d'accumulation par dépossession et les impacts du changement climatique nous obligent à développer de nouvelles formes de résistance et à forger des alternatives en mesure de soutenir les luttes des femmes et les possibilités de solutions transformatrices.
Lors de la 13ème Rencontre Internationale en 2023, quatre domaines d'action ont émergé, inspirés par les luttes locales des femmes, autour desquels la MMF entend approfondir son analyse et renforcer son action jusqu'en 2025 :
*La défense des biens communs contre les entreprises transnationales
*L'économie féministe basée sur la viabilité de la vie et la souveraineté alimentaire
*L'autonomie au regard du corps et de la sexualité
*La paix et la démilitarisation
Nous œuvrons pour renforcer l'analyse, les pratiques et les secteurs du mouvement féministe en vue d'un changement structurel, de l'égalité et de l'autonomie réelles de toutes les femmes.
Tous les cinq ans, une action internationale de la Marche mondiale des femmes nous appelle et nous mobilise toutes, reliant nos processus d'organisation et nos luttes au niveau local à la force mondiale du féminisme en mouvement.
Les actions internationales sont des moments de construction et d'expression de notre synthèse politique, lorsque nous présentons nos dénonciations et nos propositions articulées aux niveaux local, régional et international. Notre résistance avance avec nos propositions et nos pratiques de construction de la force, d'auto-organisation des femmes, du féminisme comme axe d'alternatives systémiques.
En 2025, du 8 mars au 17 octobre, nous marcherons dans le monde entier contre les guerres et le capitalisme et pour le « buen-vivir » et la souveraineté de nos corps et de nos territoires.
La 6ème Action Internationale débutera au Sahara Occidental le 8 mars avec des marches et des actions simultanées dans le monde entier et se terminera par un rassemblement international au Népal le 17 octobre.
Nous lions notre lutte contre les sociétés transnationales à la lutte pour la justice sociale en organisant une semaine, laquelle débutera le 24 avril, lors de la journée de solidarité féministe contre les sociétés transnationales, et s'achèvera le 1er mai.
Rejoignez la Marche mondiale des femmes
Vous êtes un groupe de femmes ou un comité de femmes dans un groupe mixte et souhaitez rejoindre à la Marche mondiale des femmes ? Vous pouvez contacter le
Secrétariat international de la Marche mondiale des femmes.
Kızılırmak Cad. No:13/8 Kavaklıdere 06420 – Ankara – Turquie
Tél : +90 533 138 60 73
Courriel : info@marchemondiale.org
Site Web : www.marchemondiale.org
NOUS RÉSISTONS POUR VIVRE, NOUS MARCHONS POUR TRANSFORMER !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Antiféminisme, ou la chasse aux sorcières

La diffusion du documentaire ALPHAS sur Télé-Québec, combinée à la conférence de l'UPOP sur l'antiféminisme et le masculinisme, met en lumière un phénomène sociétal préoccupant : la résurgence d'un discours antiféministe dans l'espace public québécois. Ce retour du bâton contre les avancées féministes ne se limite pas au Québec, mais semble s'inscrire dans une dynamique mondiale.
Tiré de Journal des Alternatives
https://alter.quebec/antifeminisme-ou-la-chasse-aux-sorcieres/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=JdA-PA-2024-11-27
Par Lina Al Khatib -21 novembre 2024
Photo :Manifestation du 8 mars 2020 à Paris lors de la Journée internationale des droits des femmes (CC BY 2.0 par Jeanne Menjoulet)
Doit-on normaliser l'antiféminisme ?
Le visionnement d'ALPHAS témoigne le réveil d'une bête longtemps restée en sommeil. Ce documentaire aurait presque mérité d'être diffusé en noir et blanc, tant il fait écho à des débats d'un autre âge. Je suis stupéfaite de constater, en 2024, la résurgence d'un débat public qui semble tout droit sorti d'un livre d'histoire. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, certains hommes continuent de promouvoir des rôles genrés stricts, où l'homme est cantonné à celui de « provider » (pourvoyeur) et la femme à celui de « nurturer » (nourricière). Simon Coutu a fait preuve d'un grand sang-froid face à des individus qui veulent éduquer une future génération d'hommes qui écraseront les femmes de tout genre.
Au nom de la liberté d'expression, doit-on normaliser un discours dégradant et misogyne ? La question a été ressassée sur les divers plateaux télés ces dernières semaines. La réponse est pourtant claire : non. Alors que les hommes traversent ce que le professeur Francis Dupuis-Déri qualifie de « crise de la masculinité », la légitimation de l'antiféminisme dans l'espace public constitue un danger croissant. Ce discours, sous couvert de liberté, menace les progrès réalisés en matière d'égalité des genres et risque de nourrir davantage les tensions sociales. Le documentaire le montre bien : ces pseudo-influenceurs ont déjà touché une partie de la jeune génération d'hommes, en quête de projet personnel. Il est temps de renvoyer ces hommes-là où ils doivent rester : la salle de sport.
Antiféminisme, synonyme de conservatisme ?
Coïncidence, le sujet de la conférence UPOP du 13 novembre dernier était « Antiféminisme et masculinisme : Anatomie d'une idéologie ». La rencontre entre la rhétorique populaire et académique s'inscrit dans un panorama d'avis diversifiés qui reflètent la complexité de cet enjeu contemporain. À UPOP, Diane Lamoureux a mis un point d'honneur à définir l'antiféminisme et le masculinisme. La professeure émérite de l'Université de Laval conçoit l'antiféminisme comme une opposition au féminisme et à ses objectifs de transformation des rapports sociaux. Le mouvement a pris ses racines dans les idéologies misogyne (mépris ou haine des femmes, souvent confondues avec l'antiféminisme) et sexiste (système sociétal structurant les inégalités entre hommes et femmes).
Pour Diane Lamoureux, la tuerie de Polytechnique en 1989 constitue un tournant marquant dans l'histoire de l'antiféminisme au Québec. Cet acte de violence a exposé la virulence des discours antiféministes. Pourtant, la reconnaissance publique de cet événement comme un acte antiféministe a été longue et difficile, illustrant la réticence à aborder de front la violence inhérente à l'antiféminisme.
L'antiféminisme s'inscrit naturellement dans le cadre du discours conservateur. Diane Lamoureux propose une analyse des caractéristiques fondamentales du conservatisme, mettant en lumière les liens étroits entre ces deux courants. Le conservatisme repose sur des principes tels que la valorisation des hiérarchies sociales, la méfiance envers les transformations rapides et une forte adhésion aux traditions. Il s'oppose à l'individualisme, privilégie une liberté encadrée par des normes morales, et accorde une importance centrale à la propriété privée.
Mais ce qui rattache fondamentalement les deux courants, c'est leur vénération du modèle familial traditionnel. Ce lien, mis en évidence par Diane Lamoureux, explique à la fois le combat mené contre l'avortement et l'opposition aux unions homosexuelles sur les deux fronts. Alors que le monde change et évolue vers une reconnaissance accrue des diversités familiales et des droits individuels, les antiféministes et les conservateurs s'accrochent à une nostalgie idéalisée d'un passé où les rôles genrés étaient rigides et incontestés.
Un phénomène international ?
Qu'en est-il du reste du monde ? La haine des féministes est-elle aussi présente ? Il serait pertinent d'effectuer un parallèle entre le conservatisme, qui nourrit les discours antiféministes, et l'autoritarisme qui impose sa vision masculiniste rigide. Tandis que le conservatisme véhicule des valeurs traditionnelles, l'autoritarisme agit de manière coercitive pour légitimer un contrôle accru sur les femmes. On pourrait presque dire qu'il en est le grand frère dans ce sens, amplifiant et imposant, par la force ou la contrainte, les principes que le conservatisme diffuse de manière plus insidieuse.
Le paysage international est inquiétant, entre Milei en Argentine qui affiche publiquement ses positions anti-avortement, les talibans qui interdisent les femmes de parler entre elles et l'Iran qui continue d'emprisonner les femmes au nom des mœurs. Le degré d'autoritarisme peut varier, mais le constat est universel : les femmes sont systématiquement les premières victimes des régimes autoritaires. Des exemples de répression féminine, je pourrais en citer plein. Mais le fondement même de ces politiques autoritaires découle de l'absence des femmes dans la sphère politique. Cette exclusion favorise un monopole masculin des décisions, où les droits des femmes ne sont ni représentés ni défendus. Au 1er octobre 2024, seulement 30 femmes occupaient le poste de cheffe d'État ou de gouvernement dans 29 pays, soit une proportion de 15,5 % des 193 États membres des Nations Unies
Les femmes sont alors perdantes dans les deux hémisphères. Au Nord, elle est confrontée à la montée de politiciens extrémistes qui exploitent sa dévalorisation pour mobiliser un électorat conservateur et populiste. Au Sud, ses droits fondamentaux sont constamment remis en question, oscillant au gré des régimes autoritaires qui jouent au yoyo avec des acquis essentiels. Dans les deux cas, elle devient l'otage de systèmes qui capitalisent sur leur marginalisation pour renforcer leurs idéologies et asseoir leur pouvoir.
Bien que la diffusion d'ALPHAS ait rouvert des blessures profondes, je garde l'espoir de voir émerger une prise de conscience collective. Ce documentaire, en mettant en lumière des réalités souvent ignorées ou minimisées, a le potentiel de provoquer un électrochoc et d'inciter chacun à réfléchir aux implications des discours misogynes et des dynamiques de pouvoir inégalitaires. C'est dans ces moments d'inconfort que naissent les transformations les plus profondes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Ni en ligne, Ni hors ligne, luttons contre les cyberviolences genrées

Les cyberviolences genrées constituent un fléau discret, mais pernicieux, touchant les femmes, les personnes 2ELGBTQI+, les femmes voilées et les femmes en situation de handicap, dans tous les aspects de leur vie quotidienne.
Avec l'essor massif du numérique, ces violences se multiplient et prennent des formes variées, se manifestant dans les espaces publics virtuels tels que les réseaux sociaux, les jeux en ligne et les forums, ainsi qu'au sein d'échanges privés.
Pourquoi maintenant ?
Les cinq dernières années ont vu une augmentation alarmante des cyberviolences basées sur le genre, exacerbée par plusieurs facteurs clés :
– Prolifération d'espaces numériques non régulés : Les plateformes en ligne, sans régulations adéquates, permettent à la violence de se propager librement. Entre 2016 et 2020, les discours racistes, sexistes et intolérants sur les plateformes en ligne ont augmenté de 600 % au Canada, ce qui démontre une dérive inquiétante des espaces numériques.
YWCA Canada (2022), Bloquons La Haine : Rapport national
– Lois insuffisantes et inadaptées :
Les lois encadrant les cyberviolences sont souvent insuffisantes et mal adaptées aux défis de l'ère numérique. De plus, leur mise en œuvre est souvent inadéquate en raison d'un manque de formation et de sensibilisation des acteurs du système judiciaire, qui ne prennent pas toujours ces violences au sérieux.
Ce déficit de réaction, combiné à d'autres failles dans le système de justice, crée un climat d'impunité, où les cyberviolences sont banalisées et se multiplient sans conséquences. Ainsi, une normalisation de ces comportements violents s'installe aggravant la situation.
Statistiques : l'ampleur des cyberviolences genrées
Les chiffres suivants illustrent l'ampleur des cyberviolences basées sur le genre et leur impact disproportionné sur les femmes et les personnes issues de diverses identités de genre, en particulier celles confrontées à des discriminations croisées :
– 60 % des jeunes femmes et des personnes de diverses identités de genre au Canada sont victimes de haine en ligne au moins une fois par mois, et certaines y font face quotidiennement. Cette réalité est également observée à l'échelle mondiale, avec des conséquences psychologiques graves pour les victimes. – YWCA Canada (2022), Bloquons La Haine : Rapport national
– Entre 74 % et 80 % des victimes de harcèlement criminel en ligne, ainsi que 71 % à 91 % des victimes de publication non consensuelle d'images intimes, sont des femmes. Ces chiffres montrent l'ampleur du problème, particulièrement pour les femmes dans le cyberespace. – Conseil du statut de la femme (2022). L'hostilité en ligne envers les femmes.
En outre, les groupes les plus vulnérables à ces violences sont souvent ceux à l'intersection de plusieurs formes de marginalisations, comme les femmes racisées, les personnes 2ELGBTQI+, les personnes en situation de handicap et les minorités religieuses.
Par exemple, selon le Rapport National intitulé Bloquons La Haine de YWCA Canada publié en 2022 :
Les personnes racisées au Canada sont trois fois plus susceptibles d'être victimes de haine en ligne que leurs homologues non racisés.
Les jeunes en situation de handicap sont 70 % plus susceptibles d'être victimes de haine en ligne, tandis que les jeunes des communautés 2SLGBTQIA+ et autochtones sont environ 60 % plus susceptibles d'être ciblés.
Les impacts de la cyberviolence
Les cyberviolences ont des conséquences profondes, souvent invisibles, qui affectent le bien-être psychologique et social des victimes, ainsi que leur liberté d'expression :
– Isolement social :
La peur d'autres agressions incite les victimes à se retirer des espaces numériques. 41 % des femmes de 15 à 29 ans aux États-Unis s'autocensurent pour éviter le harcèlement en ligne, limitant ainsi leur capacité à s'exprimer librement. Conseil du statut de la femme (2022). L'hostilité en ligne envers les femmes
– Détresse psychologique :
La peur constante et le harcèlement en ligne conduisent à des troubles tels que l'anxiété, des troubles du sommeil, une perte de confiance en soi et un sentiment général d'impuissance. Les victimes au Québec rapportent également une détérioration de leurs relations sociales et une atteinte à leur réputation, dont la réparation est difficile en raison de la durabilité des contenus dans le cyberespace.
Ministère de la Famille et Ministère de la Sécurité publique, 2015
– Réduction de la participation publique :
De nombreuses femmes et minorités de genre se limitent dans leur engagement en ligne de peur des attaques, ce qui aggrave le déficit de diversité et d'inclusivité dans les débats publics.
Conseil du statut de la femme (2022). L'hostilité en ligne envers les femmes
En refusant d'agir, nous normalisons
L'inaction face aux cyberviolences crée une normalisation de comportements dangereux et destructeurs dans l'espace numérique. En refusant d'agir, nous permettons :
– Le harcèlement systémique :
Le manque de régulation et de mesures dissuasives permet à ces comportements de se multiplier sans conséquences.
– La prolifération de discours sexistes et haineux :
La tolérance de ces discours détruit l'espace public numérique, le rendant hostile et dangereux pour de nombreuses personnes.
– Le contrôle numérique dans la sphère privée :
Les violences en ligne s'infiltrent également dans la sphère privée, devenant un outil d'oppression.
Un système défaillant
Les législations actuelles sur les cyberviolences sont inadaptées et les structures de soutien sont souvent insuffisantes pour répondre efficacement aux besoins des victimes. L'absence de mesures dissuasives et le manque de sensibilisation dans le système judiciaire créent un climat d'impunité qui encourage la multiplication des agressions.
Les données des corps policiers, recueillies entre 2015 et 2020, montrent qu'une majorité des personnes présumées auteures des infractions commises envers des femmes sont de sexe masculin. Cette proportion atteint jusqu'à 85 % pour les infractions liées à la publication non consensuelle d'images intimes et au harcèlement criminel.
Conseil du statut de la femme (2022). L'hostilité en ligne envers les femmes
Un appel à l'action pour les 12 jours d'action
Cette campagne vise à informer le public sur les différentes formes de cyberviolences genrées, à encourager des actions collectives pour contrer ces violences et soutenir les personnes touchées, promouvoir les initiatives des différentes organisations de l'écosystème à travers un calendrier centralisé afin de lutter efficacement contre ces violences en ligne.
Ensemble, nous pouvons faire la différence.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne reconnait pas le travail des centres de femmes en violence

Le printemps dernier, un appel de projets a été lancé pour mieux répondre aux besoins des victimes et des auteurs de violence sexuelle et conjugale. L'occasion aurait été excellente pour soutenir le travail des centres de femmes en violence. Pourtant, sur l'ensemble des projets déposés, tous ceux des centres de femmes ont été refusés !
Une gestion budgétaire déficiente et excluant les centres de femmes
Les annonces des refus soulignaient que, si tous les projets déposés avaient été acceptés par l'ensemble des organismes œuvrant ou non en violence, une dépense de 104 M$ aurait été nécessaire, or il n'y avait que 18 M$ de disponible. Bien que le site annonce une dépense de 13 635 667 $ pour l'ensemble des projets retenus. Qu'en est-il du 4 364 333 M$ restant ?
L'apport des centres de femmes du Québec en violence
Les centres de femmes œuvrent en violence depuis plus de 40 ans, voire 50 ans pour certains d'entre eux. Ils sont parmi les ressources que les femmes fréquentent lorsqu'elles se sentent prises par des évènements de leur vie, afin de l'améliorer. Dont les violences faites aux femmes.
La beauté de ces ressources, c'est que personne ne peut savoir pourquoi une femme va dans un centre de femmes. Elle peut y aller pour boire un café, avoir du soutien pour ses démarches d'emploi, parler de ses petits-enfants, de ses parents vieillissants. Elle peut y aller aussi pour partager ses idées pour changer le monde et s'impliquer dans une action collective pour défendre ses droits.
Les femmes fréquentent leur centre de femmes aussi parce que parfois, elles vivent des violences
Si la violence qu'une femme vit est conjugale et qu'il n'est pas dans ses choix de quitter son domicile, le centre de femmes peut la soutenir. Elle y trouvera d'autres femmes pour en parler, des ateliers pour améliorer son estime de soi, des intervenantes pour faire un plan avec elle et pour assurer sa sécurité si la violence s'exacerbe. Notre intervention est féministe et intersectionnelle ; on s'adapte aux réalités des femmes.
Masculinistes et féminicides en expansion au Québec
À l'heure où les féminicides se multiplient et où les discours haineux des masculinistes prennent de plus en plus de place dans l'espace public, il semble inapproprié de faire de telles coupures sur la base d'une méconnaissance du travail des centres de femmes en violence. Ce sont les femmes qui en paieront le prix !
Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes
En ces 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, L'R des centres de femmes du Québec veut porter à l'attention du ministre responsable des Services sociaux, M. Carmant, et de la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Biron, que les centres de femmes, dans leur mission de redonner du pouvoir à celles-ci, travaillent nécessairement en violence. Une reconnaissance financière en ce sens est attendue !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pierre Poilievre, l’ami des travailleuses et des travailleurs ? L’épreuve des faits

Ce texte est tiré du Monde ouvrier, journal de la FTQ, dont le dossier du numéro d'hiver 2025 porte sur les élections fédérales à venir. Il s'agit d'une étude de l'IRIS portant sur les rapports du parti de Pierre Polièvre au mouvement ouvrier et à la classe elle-même.
Tiré du Monde ouvrier numéro 149 hiver 2025.
Pierre Poilièvre se présente régulièrement comme le défenseur de la classe ouvrière face à des élites libérales déconnectées – un classique du programme populiste, stratégiquement mobilisé à droite.
Le Congrès du travail du Canada (CTC), auquel est affiliée la FTQ, a de son côté dénoncé la « fraude » aux travailleuses et travailleurs que constitue Pierre Poilievre. Ses pratiques politiques parlent pour lui.
Le chef conservateur défend-il vraiment les intérêts des travailleuses et travailleurs ? Une analyse de la plateforme politique du Parti conservateur du Canada (PCC), adoptée en septembre 2023, illustre les risques réels que celle-ci pose pour les intérêts socioéconomiques des travailleuses et travailleurs canadiens et pour la liberté syndicale.
La compétence est partagée entre Québec et Ottawa en matière de droit du travail. Le Parlement du Canada légifère sur les relations de travail dans les secteurs d'activité qui relèvent de sa compétence, soit les banques, les entreprises de transport maritime et aérien, les entreprises de radiodiffusion et de télédiffusion comme Radio-Canada, mais aussi la plupart des sociétés d'État fédérales ainsi que les ministères et autres organismes du gouvernement fédéral.
Le PCC face aux droits du travail
La plateforme politique du PCC insiste sur la protection des libertés individuelles avant tout ; cela fait craindre que les droits et libertés collectives en ressortent érodés.
Les conservateurs proposent de rendre l'adhésion syndicale facultative, remettant ainsi en question la formule Rand, qui garantit le paiement obligatoire des cotisations syndicales pour toutes les personnes salariées d'une unité de négociation. Cette mesure pourrait affaiblir les syndicats, limitant leur capacité à défendre efficacement les membres et menant potentiellement à des conditions de travail défavorables.
Le PCC insiste aussi sur « l'obligation des syndicats de […] ne pas sanctionner les travailleurs qui ne participeraient pas ». Pourtant, légalement, les travailleuses et les travailleurs sont déjà libres de participer ou non aux activités licites de leur syndicat. Cette formule mystérieuse reviendrait-elle, par exemple, à reconnaître à des travailleuses et travailleurs le droit de ne pas participer aux grèves votées ? Ou cela signifie t-il que le PCC pourrait bloquer ou réviser la très récente loi contre les briseurs de grève ? C'est à suivre.
Sans surprise, en matière d'emploi, le PCC souhaite faciliter le cumul emploi-retraite pour les plus de 65 ans par la mise en place d'incitatifs fiscaux. Au Québec, une idée similaire a la faveur de la CAQ. Or, selon toute vraisemblance économique, cette liberté nouvelle devrait contribuer à l'appauvrissement des aînés comme cela se produit dans l'Union européenne (UE), où des législations similaires ont été adoptées. Le taux de pauvreté des personnes retraitées y est en constante hausse (de 12 % en 2014 à plus de 16 % en 2022, pour toute l'UE).
La liberté économique contre la protection sociale
Les autres propositions de Poilièvre se résument à une défense classique de la liberté économique individuelle, à un soutien au secteur privé et à la libre compétition économique, et plus généralement à une réduction drastique des services publics. Le PCC s'en dit « convaincu » : « un dollar dans la main d'un citoyen canadien vaut mieux qu'un dollar dans la main d'une bureaucratie gouvernementale. […] la réduction des impôts et de l'ingérence de l'État dans l'économie se traduira par une augmentation du pouvoir d'achat des Canadiens […] ».
Les prochaines élections fédérales peuvent avoir lieu à tout moment, au plus tard en octobre 2025. « Si la tendance se maintient », Pierre Poilièvre pourrait former un gouvernement majoritaire en 2025. Au regard des enjeux profonds qui traversent le monde du travail – crise environnementale, crise de sens du travail et pénuries de maind'oeuvre –, il s'agit d'un programme au mieux limité, au pire inquiétant, aligné sur la politique antisyndicale de son prédécesseur, Stephen Harper.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Santé Québec : un chaos annoncé

Centralisation, privatisation, austérité… voilà les ingrédients d'un vieux remède maintes fois servi au réseau public et n'ayant jamais amélioré son état !
À quelques jours du 1er décembre, date à laquelle Santé Québec deviendra l'employeur unique des salarié-es du réseau public de la santé et des services sociaux, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) constate que la naissance de l'agence de gestion s'accompagne d'un nuage d'incertitude, d'improvisation… et de coupes budgétaires imposées par le gouvernement.
« Il n'y a personne, que ce soit parmi le personnel, les organismes communautaires, les chercheurs ou les représentants des patients, qui croit vraiment que cette réforme-là va améliorer les services ou le réseau », explique la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Les Québécoises et les Québécois non plus ne le pensent pas, en grande majorité. Cette réforme, comme celles qui l'ont précédée, c'est plus de centralisation et plus de privatisation. La CAQ ne fait que répéter les erreurs du passé. »
De plus, le tout se déroule alors que le gouvernement impose une cure d'austérité aux soins de santé et aux services sociaux. Sans aucune transparence, des objectifs de coupes totalisant au moins 1,5 milliard $ ont déjà été identifiés.
Comme les autres réformes hyper centralisatrices imposées ces 20 dernières années, celle-ci s'accompagne d'une ronde de compressions budgétaires, avec pour conséquence assurée un secteur public encore plus mal en point. Par le fait même, le privé poursuivra son essor pour occuper l'espace laissé vacant par le secteur public.
Centralisation, privatisation, austérité… voilà les ingrédients d'un vieux remède maintes fois servi au réseau public et n'ayant jamais amélioré son état !
Des choix politiques de la CAQ
Dès lundi, Santé Québec devra jongler avec les nombreux cadeaux empoisonnés que lui lègue le gouvernement. Des commandes d'austérité aux retards de paiements de l'équité salariale en passant par le gel d'embauche, c'est bien le gouvernement de la CAQ qui a fait tous ces choix politiques. Pour la CSN, agence ou pas, le gouvernement devra répondre de ses choix.
« Depuis que le ministre a annoncé sa réforme centralisatrice, nous avons soulevé les problèmes qui nous attendent et nous avons des pistes de solutions. Or, le ministre fonce sans nous écouter et sans nous parler, déplore le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, Réjean Leclerc. Présentement, Santé Québec nage dans l'improvisation complète et l'employeur n'a pas de réponse à nos questions. Il y a 350 000 personnes qui se demandent ce qui va changer ou pas pour elles à compter de lundi et elles n'ont aucune réponse. Leurs gestionnaires eux-mêmes n'en savent souvent rien. C'est inadmissible. »
Responsabilité gouvernementale
« Le gouvernement joue un jeu dangereux », renchérit la vice-présidente de la Fédération des professionnèles, Jessica Goldschleger. « Notre réseau public de la santé et des services sociaux n'est pas un jouet qu'on peut s'amuser à démolir et à rebâtir. Les conséquences de cette improvisation peuvent être désastreuses, non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan humain. Le gouvernement aura beau tenter de refiler la responsabilité de cet échec aux dirigeants de Santé Québec, le personnel du réseau et la population québécoise ne sont pas dupes. Nous savons très bien que c'est lui qui en est véritablement responsable. »
Pour un réseau vraiment public
Rappelons que la CSN propose un plan d'urgence pour stopper l'hémorragie vers le privé :
– en mettant fin à l'exode des médecins vers le secteur privé ;
– en cessant d'octroyer des permis de cliniques privées à but lucratif ;
– en décrétant un moratoire sur tous les projets de privatisation du travail et des tâches effectués par le personnel du réseau public.
« À la CSN, nous continuerons de travailler sans relâche pour assurer des emplois et des services de qualité dans le secteur public », conclut Caroline Senneville. « Pour nous, c'est très clair : Pas de profit sur la maladie ! »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
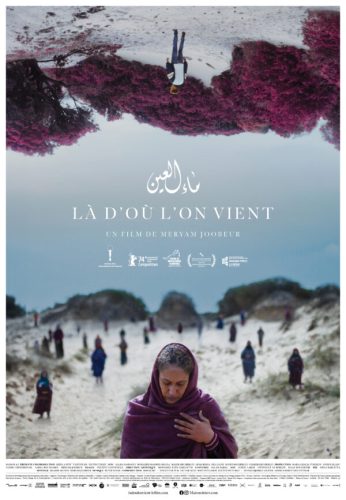
Désespérances d’idéaux déchus
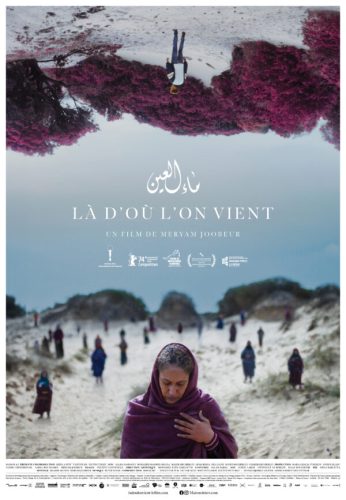
La Mère Courage du film étreignant son fils cadet, croyant lui épargner le sort de ses aînés Meryam Joobeur nous offre un long métrage de 118 minutes d'une très grande intensité dramatique dont on se remettra à grand peine, surtout dans cette ère trumpienne de génocide palestinien.
Par Pierre Jasmin, artiste pour la paix
Nos idéaux battus en brèche par le capitalisme décadent triomphant dans les laideurs télévisuelles de héros violeurs nous font revivre une chute abrupte d'idéaux tellement forte qu'elle me ramène à un monde théâtral auquel j'avais collaboré à Vienne, un mois avant mon année à Moscou en 1978 : je contribuai alors à la pièce Grandeur et décadence de Mahagonny de Kurt Weil et Bertold Brecht, qui préfigurait à sa première en 1930 l'arrivée obscène du nazisme.
Grâce à l'art exigeant et poétique de la fabuleuse réalisatrice tunisienne établie à Montréal, Là d'où l'on vient raconte un retour d'idéal déchu, qu'on devine être le Djihad islamique entrepris par deux frères, dont le désespoir si noir ne saurait être accablé davantage par quelque jugement que ce soit : se dégage, en un enchaînement de dérapages, le rachat entrevu de leurs âmes pourtant alourdies de meurtres, cette fois à la manière de Robert Bresson.
Les images magnifiquement cadrées avec d'innombrables gros plans, dans des paysages de prairies et de bords de mer tunisiens hantés par des comédiens dévorés par leurs personnages, nous plongent dans le sujet éternel de la dévastation guerrière, rarement aussi magistralement exploitée, y compris par une musique lancinante, mais pas par des violences de champs de bataille. Madame Joobeur porte son regard aiguisé sur les hommes intérieurement déchirés.
La grande majorité de nos politiciens jugent les immigrants avec arrogance, morgue et insensibilité, les envisageant au mieux comme des contributeurs à la petite économie commerciale. Quant à leur passé, on préfère ignorer leurs parcours parsemés d'embûches, que le film Io, Capitano avait choisi d'illustrer d'une façon épique avec deux acteurs flamboyants. Tout le contraire dans ce film humble où les acteurs quoiqu'éteints réussissent inexplicablement à faire vivre ce nouvel exemple magique de l'art cinématographique féminin : on pense à Mariloup Wolfe dans Jouliks, à Barbeau-Lavalette dans Chien blanc, à Maryse Legagneur dans Le dernier repas ou au tandem Danielle Trottier-Fabienne Larouche dans Cœur battant pour leurs explorations implosives de l'intimité, ici le huis-clos implacable de réfugiés dans leur propre pays, prostrés dans la désillusion de retour d'un exil qu'on devine entrepris par l'illusion d'une croisade religieuse genre Daesh.
Mais la réalisatrice ne porte jamais de jugement, elle se contente de témoigner des douloureux ravages d'un milieu d'extrême-pauvreté rurale avec des bergers bien différents de celui volontaire sympathique du film de Deraspe. Ceux de Joobeur sont acculés à la dure, très dure tâche de survie élémentaire. Nous contemplons, proies médusées, les tensions intrafamiliales insoutenables qu'une femme que j'ai appelée Mère Courage dans un élan brechtien, tente de calmer, en cherchant fermement à réconcilier un mari aux rigides principes traditionnels avec ses trois fils encore en vie, le plus jeune encore dans les jupes de sa mère aimante.
Mais l'un d'entre eux a ramené de Syrie une femme non musulmane pourtant vêtue d'une burka pour échapper aux regards inquisiteurs qui veulent pour la plupart la juger, une trop infime minorité cherchant à comprendre et à aimer l'étrangère impie. On s'achemine alors, inexorablement, vers un dénouement qu'on pressent sacrificiel. Ainsi, l'œuvre de Meryam Joobeur fait office de miroir embarrassant et inversé pour notre société hypnotisée par le faux glamour américain.
.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Le grand basculement
Le présent épisode de l'interminable conflit israélo-palestinien met en lumière un phénomène inédit ou du moins sa relative généralisation : une coupure croissante entre les opinions publiques occidentales sympathisantes envers les Palestiniens d'une part, et d'autre part les classes politiques d'autre part, celles-ci toujours fondamentalement sionistes. Malgré cela, elles se sentent désormais obligées de prendre une certaine distance vis-à-vis de leur protégé israélien, comme en témoigne la volonté que plusieurs (dont Ottawa) affichent d'appliquer le mandat d'arrêt lancé contre deux hauts responsables israéliens : Benyamin Netanyahou, premier ministre et l'ancien ministre de la défense, Yoav Gallant. En principe, ces derniers ne peuvent remettre les pieds dans ces pays sans être appréhendés et déférés devant la Cour pénale internationale. Le gouvernement américain, indéfectible allié de l'État hébreu est un des rares à s'y opposer.
À long terme, ce retournement actif d'une ampleur inédite d'une bonne partie des populations occidentales en faveur d'une paix juste et honorable entre les deux parties en conflit peut éroder l'appui que leurs gouvernements apportent à Israël. En effet, les populations occidentales s'impatientent sérieusement devant l'ampleur et la durée de la contre-offensive du cabinet Netanyahou à l'endroit du Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban-Sud.
Même si la majorité des classes politiques occidentales conservent encore une bonne marge de manoeuvre dans leurs relations avec Israël, elles ne pourront pas ignorer indéfiniment le sentiment de leurs administrés. Seul le gouvernement américain maintient un soutien sans failles à son allié du Proche-Orient. Avec l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, ce soutien ne s'effritera sans doute pas, malgré sa volonté déclarée de mettre fin aux conflits qui déchirent le Proche-Orient. Il reste à connaître son plan pour régler le noyau dur de ces conflits, c'est-à-dire l'affrontement continuel entre Israël et la Palestine. Il présentera sans doute un plan tordu, mais que le réalisme le plus élémentaire obligerait le nouveau président à modifier quelque peu en faveur des Palestiniens. Au pire, la situation continuera à se dégrader et peut-être à aboutir à une embrasement régional. Au mieux, les Palestiniens y gagneront éventuellement un début de véritable autonomie sur la majeure partie de la Cisjordanie et sur Jérusalem-Est. La partie s'annonce rude.
Même les politiciens américains commencent à être divisés là-dessus. Par exemple le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders a présenté des résolutions pour restreindre la vente d'armes à Israël et contre une aide de 21 milliards de dollars à l'État hébreu. Lors du dernier débat là-dessus au Sénat le 19 novembre dernier, entre 17 et 19 membres du Parti démocrate l'ont suivi (sur 51 membres) Même si une majorité a voté pour la vente de ces armes, une minorité non négligeable menée par un tête d'affiche de la gauche s'y est donc opposée. Il est notoire que l'aile progressiste du Parti démocrate est mal à l'aise devant le conflit depuis au moins janvier. Ce n'est peut-être que le début d'un mouvement susceptible d'aller croissant, qui sait ?
Par ailleurs, rien ne permet de penser que la population américaine dans son ensemble se distingue des autres populations occidentales sur ce problème. Après tout, il s'est produit des manifestations d'envergure sur plusieurs campus au printemps dernier en soutien à la cause palestinienne. Elles reprendront peut-être si la guerre là-bas s'éternise et que continueront de s'accumuler les victimes palestiniennes et libanaises.
En tout état de cause, celle de la Palestine a beaucoup gagné en légitimité auprès des Occidentaux. Les organisateurs du Hamas à Gaza ont donc gagné leur pari improbable de remettre au premier plan sur la scène internationale la cause de leur peuple. À l'opposé, le cabinet Netanyahou a commis une grave erreur politique en lançant une contre-offensive vengeresse démesurée. Il s'est aliéné certains de ses soutiens internationaux qu'il croyait acquis. Le coût humain de sa guerre contre Gaza et son obstination à la poursuivre l'ont discrédité auprès d'une bonne partie des opinions publiques occidentales et par ricochet, de leurs gouvernements, du moins jusqu'à un certain point.
Ce n'est certes pas la première fois que des opérations militaires israéliennes font beaucoup de victimes parmi les Palestiniens, mais cette fois la coupe déborde. Il s'agit peut-être de l'erreur de trop commise par le gouvernement de ce pays... la suite des événements nous le dira.
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Alliances terrestres », le film qui retrace la lutte contre l’A69

Dans son documentaire, Isabelle Haelvoët raconte l'histoire de la lutte contre l'autoroute A69, qui doit relier Toulouse à Castres. Militants, paysans et scientifiques parlent de leur combat pour sauver les terres menacées par l'autoroute.
Tiré de Reporterre
Photo : Alexandra, la dernière habitante sur le tracé de l'autoroute A69, a quitté son domicile de Verfeil le 16 septembre 2024, après de longues négociations. - © Antoine Berlioz / Hans Lucas / Reporterre
Des militants perchés dans les arbres, des recours juridiques, des zad, une commission d'enquête, des projets alternatifs… Depuis presque deux ans et le début des travaux de l'A69 , qui doit relier Toulouse à Castres, la lutte contre cette infrastructure bat son plein dans le Tarn et en Haute-Garonne.
Largement médiatisée à l'échelle nationale, notamment grâce aux trois grands rassemblements organisés près de Castres à l'appel des Soulèvements de la Terre, la lutte contre l'A69 revêt plusieurs formes, plusieurs modes d'action et rassemble de multiples collectifs ou associations. C'est justement cela qu'Isabelle Haelvoët, réalisatrice du documentaire Alliances terrestres, a voulu raconter dans ce film de 89 minutes.
Le titre du documentaire reflète une réalité essentielle : la création d'alliances entre des acteurs variés — militants, paysans, scientifiques et citoyens — unis par une même volonté de protéger ce territoire et ses ressources. La réalisatrice illustre avec sensibilité la solidarité qui se construit dans la résistance, malgré les tensions et les pressions exercées par les préfectures et les forces de l'État.
Le film célèbre ainsi l'intelligence collective et l'ingéniosité déployée pour faire face à des moyens disproportionnés mis en œuvre par l'État. Des militants plus radicaux dans les zad luttent ainsi aux côtés de citoyens, des grimpeurs et grimpeuses s'allient à des scientifiques… Le documentaire est une ode à la complémentarité des modes d'action.
Force de la lutte
Au cœur du documentaire, bien entendu, l'autoroute A69. Un projet qui symbolise l'affrontement entre deux visions du monde. D'un côté, celle d'un développement économique basé sur la bétonisation, la croissance et l'expansion routière ; de l'autre, une conception plus collective, respectueuse des écosystèmes et des modes de vie locaux.
Le documentaire met en avant les conséquences directes de ce projet : destruction de terres agricoles, fragmentation des habitats naturels et impacts écologiques durables. Les images des paysages menacés, entrecoupées de témoignages poignants, soulignent l'absurdité de ce projet au regard des défis climatiques actuels. Isabelle Haelvoët s'appuie sur ses propres images, mais également sur des archives ou des vidéos tournées par des militants.
Le documentaire ne se limite pas à la simple dénonciation d'un projet d'infrastructure controversé, mais propose une réflexion approfondie sur les enjeux environnementaux, sociaux et humains qui en découlent. À travers un récit poétique et documenté, il donne une voix à celles et ceux qui s'élèvent contre ce projet et, plus largement, contre une logique productiviste menaçant nos écosystèmes.
Alternant entre des plans larges des paysages menacés et des scènes plus intimes de rassemblements, la réalisation joue sur une dualité entre la fragilité de la nature et la force de la lutte. Aux scènes d'arbres abattus et de zones terrassées par d'énormes machines viennent s'opposer celles de liesse collective entre militants. Le film est ponctué par des lectures poétiques, presque méditatives, tirées du livre de l'économisteGeneviève Azam Lettre à la Terre — Et la Terre répond.
Hymne à la résistance
Ce documentaire dépasse également le cadre d'un simple combat local, pour s'inscrire dans une réflexion globale. On retrouve ainsi tout au long du film la sociologue Geneviève Pruvost, qui évoque la nécessité de « repolitiser notre quotidien » et revient sur les notions de subsistance et de liberté avec un éclairage écoféministe. Des ponts sont également établis avec d'autres luttes pour la préservation du vivant, notamment le mouvement Chipko, né en Inde dans les années 1970 et porté par l'écoféministe Vandana Shiva, ou plus récemment la défense de la forêt de Hambach, en Allemagne.
Le tournage du documentaire s'est poursuivi jusqu'à fin mars dernier, et la victoire provisoire des militants sur le site de la Crem'Arbre qui ont obtenu une trêve pour l'abattage des arbres. Quelques mois plus tard, la zone fut rasée, mais d'autres occupations se multipliaient partout le long des 53 km de tracé, entraînant une répression toujours plus intense à l'encontre des militants.
Le film d'Isabelle Haelvoët est finalement un hymne à la résistance, où se relaient des citoyens, scientifiques, militants aguerris, sociologues ou agriculteurs. La lutte est un moyen, comme ils le confient, de s'émanciper, de passer du désespoir à l'action collective, de se rassembler et d'espérer construire un monde plus respectueux des êtres humains et de la nature.
Le documentaire est régulièrement projeté partout en France, souvent accompagné d'une discussion à l'issue de la projection. Les projections sont à retrouver ici.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Note aux PEUPLES Haitiens.
Ce dimanche 01 décembre 2024
La FEDOFEDH invite la population à se mobiliser pour leurs droits et la sécurité.
FEDOFEDH rappelle à chaque Haïtienne et Haïtien que le 10 décembre, Journée internationale des droits humains, est bien plus qu'un simple symbole. C'est un appel à l'action, un rappel que la paix, la justice et la sécurité ne peuvent exister sans notre mobilisation collective.
L'insécurité croissante menace nos familles, nos rêves, et notre avenir. Nos enfants ne peuvent apprendre dans la peur, nos pères de famille désespèrent de nourrir leurs proches, et nos femmes subissent des violences sans recours. Mais cette réalité peut changer si nous décidons d'agir.
Le bien-être de nos familles dépend de notre engagement. Organisons-nous pour exiger des solutions concrètes des autorités, travaillons ensemble pour créer des communautés solidaires où chacun est protégé. Chaque action compte : élevez votre voix, rejoignez des initiatives locales, et refusez de céder à la peur.
Au cours de cette semaine, en pleine campagne des 16 jours d'activismes, une femme nourrice a reçu une projectile au sein chez elle, au moins 5 femmes enceintes sont morts a cause des problèmes de médecins, des centaines de PVVIH dans les régions n'ont pas accès à leurs médicaments à cause de l'insécurité, des enfants ne peuvent plus se rendre à l'école car leurs écoles servent d'abri pour les déplacés. Fort de tout cela, nos dirigeants se battent pour plus de pouvoirs, ils renforcent leur sécurité et celle de leur famille avec le peu de policier qui nous reste. Les soldats étrangers, sont pour la plupart affectés à des VIP.
Le 10 décembre, ne soyons pas spectateurs. Soyons les acteurs d'un changement durable, pour nous et pour les générations à venir. La sécurité et la dignité sont des droits, mais elles ne deviendront réalité que si nous nous battons ensemble.
Personne ne viendra nous sauver, nos dirigeants et nous sommes deux lignes droites qui ne se rencontreront jamais si on ne les force pas se tourner vers nous.
Avril à Décembre 2024 : quel bilan pour un CPT de 9 conseillers presidents ?
Depuis 2016, presque 10 ans sans élection ? Dans quel pays dans le monde avons-nous déjà entendu ces bêtises ?L'impunité et la justice n'ont jamais été invitée à une même fête.
FEDOFEDH – Ensemble, bâtissons une Haïti sûre et prospère.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Rabia » de Mareike Engelhardt

Que s'est-il passé dans la tête de Jessica et de Laïla, deux amies parties tout soudain de France pour gagner Raqqa en quittant sans prévenir leur travail et leur famille ? Rabia, premier long métrage, très documenté au réalisme halluciné, nous plonge dans le quotidien d'une ‘madafa', une maison regroupant exclusivement les femmes étrangères, célibataires ou veuves, destinées au mariage.
Tiré du site Le café pédagogique
27 novembre 2024
Lecture suggérée par André Cloutier
En choisissant de représenter au cinéma la ‘madafa' de sinistre mémoire (jamais photographiée ni filmée à l'époque), suggérant le huis clos d'un lieu d'enfermement, d'oppression et de conditionnement à la soumission des femmes, un espace étouffant dirigé d'une main de fer par une femme fanatique, la réalisatrice Mareike Engelhardt, tente de répondre à la question initiale et en soulève bien d'autres, intimes et universelles. Elle en formule la portée en ces termes : « Ce n'est pas un film sur l'islam, sur le djiadisme mais sur l'embrigadement de masse, les mécanismes de déshumanisation… ». D'où vient, en effet, que Jessica puisse choisir la voie des bourreaux ?
Aux origines de la fiction, contexte historique, témoignages, expertises
C'est à la suite de la prise de la ville de Raqqa en 2014 que l'Etat islamique impose la charia à tous les habitants et lance un appel à venir de toutes parts soutenir la création d'un ‘Califat'. Alors que Daech (autre appellation de l'organisation terroriste islamiste) conforte son emprise sur Raqqa dans la Syrie en guerre, des milliers de jeunes radicalisés (en quelques mois pour certains) venus du monde entier, issus de milieux divers, rejoignent ce ‘pays' idyllique dans l'illusion d'un engagement total et la promesse d'une nouvelle vie.
Des filles, parfois très jeunes, en perte de sens, partent en cachette de leurs parents vers une terre inconnue, aveuglées par l'absolutisme de leur croyance. Un imaginaire romanesque (allant jusqu'à désirer pour époux un combattant du Djiad) et un embrigadement idéologique tels que certaines n'en sont jamais sorties, même celles qui sont revenues dans leur pays d'origine.
Le caractère totalitaire de cette folle entreprise criminelle, et l'implication singulière des femmes en son sein, conduisent la cinéaste à une investigation approfondie devant ce qu'elle nomme ‘l'incompréhensible'. Rencontres avec des femmes ayant séjourné un certain temps à Raqqa auprès de l'Etat islamique et demeurant, après leur retour, remplies de haine de l'autre et d'esprit de vengeance, présence aux audiences des procès de e certaines filles au Tribunal de Paris, recoupements des informations concernant le statut et le mode de vie des femmes dans les ‘madafas', enquête sur la personnalité de la tristement célèbre Fathia Mejjaati (dite Oum Adam), dominatrice rigoriste et sadique, toujours en fuite aujourd'hui, laquelle a inspiré le personnage de Madame (magistralement interprétée par la grande Lubna Azabal), recours à l'expertise de deux spécialistes du djihadisme féminin, Céline Martelet et Edith Bouvier, lesquelles ont enrichi par leurs connaissances le travail des comédiennes durant la préparation. Sans oublier les confrontations encadrées avec d'anciennes ‘pensionnaires' de ces lieux d'enfermement et d'endoctrinement.
Du soleil radieux aux ténèbres, esthétique de la lumière, partis-pris
Dans l'avion qui les emporte vers Raqqa, Jessica (Megan Northam, comédienne impressionnante par sa présence et la puissance de son jeu) et Laïla (émouvante incarnation de Natacha Krief) contemplent au dessus des nuages blancs le soleil éclatant, avec des sourires radieux et des rires de petites filles, elles font des allusions au paradis qui les attend. Les nuages se fondent ensemble en une masse crémeuse envahissant tout notre champ de vision.
Puis, avant l'atterrissage, les nuages changent de couleur. Et nous entrons avec elles dans une maison en forme de forteresse et décelons vite les premiers signes d'un cadre d'asservissement, des signes que nos deux copines enthousiastes ne voient pas.
Ainsi suivons-nous les rituels imposés à l'intérieur de cet étrange gynécée : les femmes entre elles, sur ordre, sont peu à peu dépouillées de leur ancienne identité (et de leurs vêtements d'origine) pour être préparées à la fois psychologiquement à la soumission aux préceptes et aux interdits religieux édictés par l'état islamique ; et physiquement (changement de sous-vêtements pour une semi-nudité aguicheuse et maquillage, bientôt masqués sous un voile recouvrant corps et chevelure) pour devenir des objets sexuels à la merci des pulsions des guerriers et futurs époux ; des maris qu'on leur choisit pour une rencontre de quelques heures lors d'un retour du front.
Un premier contact qui peut se transformer, après quelques préliminaires (enlève ton voile ! Veux-tu des enfants ? Aimes-tu les abricots ?), en tentative de viol comme Jessica en fait la précoce expérience.
Une épreuve marquante qui la conduit à repousser brutalement l'agresseur et à s'échapper. Prélude cependant à un retournement majeur. Au lieu de sortir de son aveuglement, progressivement elle passe dans le camp de la dominatrice, adepte des châtiments corporels, des diktats humiliants et autres injonctions au respect de la supériorité masculine, violences conjugales comprises ; une maîtresse fanatique et manipulatrice qui la forme pour que celle-ci devienne à son tour une arme de dressage des nouvelles arrivantes.
Au fil du temps, dans une atmosphère de guerre dont le champ de bataille (et les morts) reste hors champ comme les violences physiques faites aux femmes à l'intérieur sont exclues du cadre même si nous en entendons les coups et les cris étouffés, le blanc du ciel au dessus de la forteresse et la blancheur ocre du lointain sans hommes en armes visibles disparaissent de plus en plus.
Dominent alors les lumières indirectes et voilées descendant des fenêtres et les lueurs tamisées des espaces intérieurs de la madafa jusqu'aux appartements de Madame un temps plus lumineux et spacieux. Avant que de clairs-obscurs en lumières biaisées au cœur de ce lieu dont il est interdit de sortir sous la clarté des étoiles, la forêt de voiles noirs, ceux des femmes opprimées, se fondent dans le noir des bombardements annonciateurs de la chute de Raqqa, jusqu'à l'entrée dans les ténèbres.
Espace mental de Rabia et questionnement universel
Avec Agnès Godard, la directrice de la photographie, et Daniel Bevan pour le décor, la cinéaste crée ainsi un espace mental favorable à la figuration de la ‘révolution' intime qui se produit chez Jessica, devenue Rabia à la faveur de ce basculement dans le camp des bourreaux. La réalisatrice tente par cette recherche formelle de nous donner accès, sans complaisance, à la trajectoire de Rabia et d'autres femmes qui lui ressemblent dans le rapport maîtres.ses/esclaves, dans la relation ambigüe à la domination.
Mareike Engelhardt revendique son origine allemande et son appartenance à ‘la dernière génération qui a connu ceux qui ont participé à l'un des pires crimes de l'humanité'.
Tout en refusant clairement les raccourcis entre le terrorisme islamiste et le nazisme, à partir d'une histoire imaginée avec le scénariste Samuel Doux, la fiction tranchante qui glace le sang nous contraint à une réflexion profondément dérangeante à laquelle la cinéaste nous incite ainsi : ‘Qu'est-ce qui fait qu'au cours d'une vie on bascule du mauvais côté ? Comment est-ce possible de se faire absorber par un système qui nous enlève notre humanité ? Et surtout, pourquoi les gens y restent-ils ?'.
La dernière scène du film voit Jessica/Rabia, un enfant dans les bras, se réduire à une silhouette lointaine et minuscule, sur le point de se confondre avec le sol aride d'une terre sans vie.
Samra Bonvoisin
« Rabia », film de Mareike Engelhardt-sortie le 27 novembre 2024
Festivals et Prix 2024 : FFA, Angoulême (Compétition), Deauville (Prix d'Ornano-Valenti), Valenciennes (Prix du Jury), War on screen (Prix du Public), Arte Mare (Prix du Public et Mention Spéciale Jury jeune), Effervescence de Mâcon (Prix du Public).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Jour sombre pour le système public de santé et des services sociaux au Québec

Saint-Lin-Laurentides, le 1ᵉʳ décembre 2024 - La Coalition des Tables Régionales d'Organismes Communautaires (CTROC) partage ses vives inquiétudes face à l'entrée en fonction officielle de la nouvelle société d'État, Santé Québec.
À compter du 1ᵉʳ décembre, cette instance devient responsable de gérer les activités du réseau public de la santé et des services sociaux sous l'égide de Mme Geneviève Biron alors que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en déterminera le orientations.
Rappelons que l'entrée en poste de Mme Biron en mai dernier a été vivement critiquée, notamment en raison de ses liens étroits avec l'industrie privée de la santé, de sa méconnaissance du réseau public et les enjeux qui en découlent, ainsi que de son manque d'expérience en matière de gestion d'une telle mégastructure.
La mise en place de Santé Québec entraîne la fusion d'une trentaine d'établissements du réseau public, qui devient ainsi le plus gros employeur du Canada avec ses 350 000 personnes salariées. Cette nouvelle structure engendrera inévitablement un changement de culture organisationnelle dont il est difficile à ce moment-ci d'en évaluer les impacts. Cependant, il va de soi que plus les structures sont imposantes et centralisées, plus l gestion est hiérarchisée et entraîne un risque de déshumanisation éloignée de la réalité du terrain.
De surcroît, la réforme Dubé ouvre grand la porte à la privatisation et à la marchandisation de la santé et des services sociaux. Le ministre de la Santé affirme que l'ouverture au privé est la solution aux problèmes d'accessibilité alors que l'on sait qu'il est en bonne partie à l'origine de ces difficultés. Le gouvernement Legault choisit consciemment d'orchestrer un système où l'État subventionne des compagnies privées pour qu'elles dispensent des soins alors que celles-ci coûtent plus cher, privent le réseau public de main-d'œuvre, contribuent à l'effritement des services publics et entravent l'accès gratuit et universel aux soins.
Dans le cadre de cette réforme, les organismes communautaires autonomes sont aussi vus comme une partie prenante du réseau de la santé et des services sociaux alors qu'ils sont des entités autonomes. Leur sous-financement chronique et l'accroissement notoire des demandes d'aide auxquelles ils font face fragilisent déjà le mouvement communautaire depuis plusieurs années. Dans le contexte d'une société d'État, l'instrumentalisation des organismes communautaires risque de s'accroître et de se cristalliser, les rendant ainsi plus vulnérables aux velléités du gouvernement.
Alors que le salaire des gestionnaires de Santé Québec a récemment été augmenté de 10% dans un contexte d'équilibre budgétaire imposé, où le déficit à résorber en santé pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars, la CTROC appréhende l'impact sur les services publics, les programmes sociaux et les organismes communautaires.
Rappelons que les besoins exprimés par plus de 3 000 organismes communautaires
intervenant en santé et services sociaux s'élèvent à 830 M$ en financement à la mission globale en 2024-2025.
Quels sont les engagements que l'État est prêt à prendre afin de préserver l'autonomie et les pratiques du mouvement communautaire autonome en santé et services sociaux ?
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La France dans la tourmente d’une crise institutionnelle et étrangère

La Gauche précipite la chute du Gouvernement en déposant avec le RN une motion de censure. Macron s'acquitte à merveille de la perche réclamée par Netanyahou, damant le pion à la bonne cause de Gaza pour mieux marcher sur le statut de Rome.
De Paris, Omar HADDADOU
Dans une sainte alliance avec les Puissants, Macron, protée patentée dont le pays traverse actuellement une crise institutionnelle gravissime et un effet récessif majeur sur le plan économique, a déclaré hier, à partir de l'Arabie Saoudite, que « La stabilité est entre les mains de l'Assemblée nationale ». Lui qui est à l'origine de sa dissolution, le 9 juin 2024. Cette manœuvre à la hussarde plongea le pays dans l'incertitude. La Gauche, victime d'un hold - up aux Législatives, savait que l'arbitraire ne ferait pas long feu et qu'elle reviendrait aux affaires.
Nommé Premier ministre, le 5 septembre 2024, Michel Barnier tombe dans le piège de la déshérence, tant la situation est explosive. La République sort de son axe orbital. C'est la Chienlit !
« Qui est à l'origine du chaos politique ? C'est bien le Président de la République en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale » s'insurge le Rapporteur Général du Budget, Charles de Courson.
Le bruit qui court ici, est que les Français ne sont jamais contents(es). Réponse des plus éclairés : « Il y a eu main basse sur le vote du Peuple ! »
L'actuelle faillite politico économique a acculé, ce 2 décembre, le locataire de l'Hôtel Matignon à activer le 49.3 pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale. La France Insoumise ( LFI) et le Rassemblement national (RN) ont déposé chacun une motion de censure. Avec ce vote sous 24 heures (mercredi), la chute du Gouvernement deviendrait effective !
Conscient de l'issue ubuesque de sa sortie dans une « France décousue », livrée à tous les errements, Michel Barnier déclare : « Nous sommes dans un moment de vérité. Chacun doit prendre ses responsabilités et je prendrais la mienne ».
Aussitôt, le Parti socialiste a appelé à nommer un Premier ministre de la Gauche. Dans sa chaumière, le Peuple observe à quelle sauce il sera mariné, tendant l'oreille avec incrédulité. Le politique serait-il- le parfait bonimenteur à passer par les armes ? Le Nouveau Front populaire (NFP) a une revanche à tenir « Il faut que le Président démissionne ! » somme Jean-Luc Mélenchon. Et Mathilde Panot de tempêter « Il aura à la fois le déshonneur et la censure ! ». Partie prenante de la stratégie de la « mise à mort » du Gouvernement, Marine le Pen menace : « Nous déposerons et nous voterons une motion de censure »
Ce cataclysme politique n'a pas empêché Emmanuel Macron de surfer sur l'imbroglio juridique de l'article 98-1 du Statut de Rome pour valider une injustice, aux fins de sauver sa peau, celle de Nétanyahou et les zones d'influence de la France !
Pleutre ! Au crépuscule de son quinquennat, le Président français avilit les fondements de la République et ceux de la Gauche française par ses ondoiements versatiles à estomaquer l'Histoire.
Pis, il tourne le dos aux flammes qui lèchent la maison France et joue au Messie providentiel de Netanyahou.
Du coup, la géopolitique ne sait plus où donner de la tête. La Cour Pénale Internationale (CPI) se heurte aux injonctions des puissances occidentales dont l'Amérique et ses sommations à la planète de danser le Charleston sur des cadavres palestiniens et Africains !
Les Occidentaux peuvent se vanter d'avoir réduit en cendres, à coups de milliards de dollars, le Moyen-Orient et sa Civilisation qui les a sortis des limbes.
Alors que le bilan des victimes des attaques israéliennes s'élève à 44 000 personnes, la France de Macron a annoncé, mercredi 27 novembre, qu'elle ferait valoir un principe « Immunité diplomatique » pour ne pas appliquer le mandat d'arrêt de la Cour Pénale Internationale (CPI) à l'encontre du Premier ministre Netanyahou pour crime de guerre, crime contre l'Humanité.
Des chefs d'accusation notifiés aussi à son ministre de la Défense et un responsable du Hamas.
Fort de son hégémonie, Donald Trump promet de châtier ipso facto le Hamas : « Le prix à payer sera terrible si les otages ne sont pas libérés (es) ! »
La CPI joue sa survie, comme Bibi !
O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
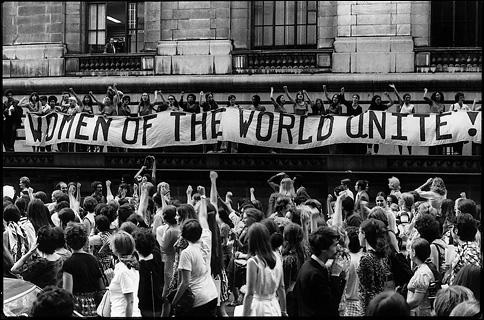
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les syndicats face aux procédures-baillons
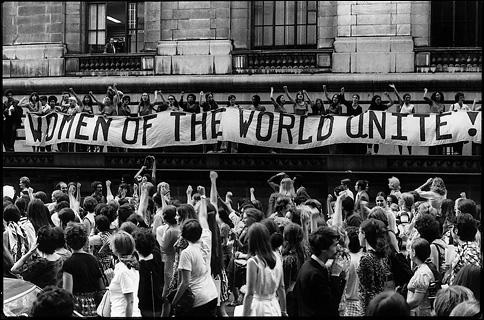
La manifestation de novembre contre les violences faites aux femmes sera cette année suivie de peu par l'ouverture du procès pour atteinte à la vie privée intenté par Benjamin Amar à l'AVFT et à la CGT.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Les 30 septembre et 1er octobre dernier, Christine, ex-membre du collectif Femmes Mixité de l'Union Syndicale CGT ville de Paris, devait, elle aussi, être jugée pour diffamation pour avoir rendu compte dans un congrès de l'Union Départementale CGT 75, des actions menées par ce collectif contre des faits de harcèlement et/ou d'agressions imputés à des membres de leur organisation. Régis Vieceli, alors secrétaire général du syndicat CGT déchets et assainissement a porté plainte contre elle et contre Philippe Martinez (secrétaire général confédéral au moment des faits).
Dans un contexte de multiplication de procédures visant des militantes et collectifs de lutte contre les violences de genre et dans la dynamique des mobilisations annuelles du 25 novembre contre les violences faites aux femmes et aux minorisés de genre, Contretemps a rencontré Resyfem, un collectif organisant des militantes syndicalistes et féministes qui militent pour un #MeToo syndical, et qui appellent à la solidarité le 27 novembre 2024 devant le Palais de justice de Paris ainsi que le 16 octobre prochain (date de report de l'audience de Christine).
Contretemps – Pouvez-vous présenter rapidement le collectif ?
Resyfem – Le collectif naît à l'hiver 2020-2021 de la rencontre de plusieurs militantes cégétistes de la ville de Paris avec d'autres femmes syndicalistes ayant subi une répression en interne du fait de leur engagement contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).
De cette rencontre est né le constat assez frappant des similitudes entre les situations vécues par ces militantes, de mécanismes analogues aussi bien dans la manière dont les agresseurs procèdent et se défendent que dans la manière dont les organisations syndicales (OS) ne parvenaient pas à prendre en charge ces violences. Si les syndicats peuvent mettre en avant des sujets féministes quand il s'agit de pointer du doigt les violences commises sur le lieu de travail par exemple, c'était beaucoup plus compliqué lorsqu'un syndicaliste était l'agresseur. Et pire encore, lorsque des militantes prenaient sur elles de lutter contre l'impunité des agresseurs syndicalistes en interne, les obstacles et les backlashs s'avéraient très violents.
Parce que pour nous le syndicat est un outil de lutte essentiel contre le capitalisme, et parce que les VSS en chassent trop de militantes ou dégoûtent par avance des femmes qui auraient pu vouloir s'y engager mais qui perçoivent les syndicats comme des organisations machistes, on a estimé qu'un espace d'organisation spécifique était nécessaire.
Et puis parce que nos organisations ne peuvent pas prétendre être des moteurs de changement social sur ces questions sans balayer devant leur porte, sans être exemplaires en interne.
Nous avons fait le choix de s'auto organiser en « intersyndicale » (on est des militantes de la CGT, de FO, de SUD, de la FSU, du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France) ce qui présente différents avantages : toutes les OS étant concernées par ce problème, le fait de travailler en inter-organisations, en plus d'avoir du sens dans la pratique, permet de montrer qu'on s'attaque à un problème transversal, systémique et non à une organisation ou une autre dans le cadre d'un « conflit de chapelles ». Cela permet de dépasser les accusations faites de manière récurrente aux militantes féministes de miner le syndicat et de le mettre en danger (comme si c'était la lutte contre les VSS qui menaçaient nos organisations et non les VSS elles-mêmes). Cela permet aussi d'avoir des appuis extérieurs face aux pressions internes et de surmonter une partie des difficultés que l'on peut rencontrer à s'affronter à des camarades parfois proches.
À ce stade, le collectif constitue pour nous (et toutes celles qui voudraient le rejoindre) un espace de réflexion collective (sur ce qui manque à nos OS, sur les stratégies des agresseurs, etc.) ; il est aussi un espace d'organisation face à des situations de violence dont on entend parler, en mettant comme on peut la pression sur les OS concernées pour qu'elle assument les responsabilités qu'elles ont envers leurs adhérentes et militantes ; et puis il représente un espace de soutien des femmes isolées souvent dans leur organisation face à la machine agresseur ; parce que l'agresseur lui, n'est jamais seul, il a des soutiens, il a en général une position hiérarchique, il se présente comme essentiel au bon fonctionnement du syndicat, il représente parfois une opposition politique ce qui lui permet, si on en vient à le mettre en cause pour les violences commises, de crier au complot politique, etc.
Depuis qu'on existe, on a suivi le procès de FO à Brest intenté par des copines victimes d'un secrétaire général de FO puis l'affaire Amar – qui connaitra prochainement un nouveau rebondissement avec l'ouverture, ce 27 novembre, du procès intenté pour atteinte à l'intimité de la vie privée à l'AVFT et à la CGT.
Dernièrement, il nous a paru nécessaire de soutenir Christine dans le procès initialement prévu le 30 septembre.
Contretemps – Pourriez-vous revenir rapidement sur les enjeux de ce procès ?
Resyfem – Lors d'un congrès de l'UD 75 début 2020, Christine a lu le bilan d'activité du collectif femmes-mixité des trois années de lutte contre les VSS en interne de la CGT Ville de Paris. Elle est poursuivie par l'ancien secrétaire général de la CGT déchets et assainissement (FTDNEEA) – Régis Vieceli – pour diffamation publique alors même qu'elle n'a pas cité de noms et qu'il s'agissait d'un congrès réunissant uniquement des cégétistes. Et c'est là l'un des enjeux de ce procès : si les propos tenus en interne d'une organisation par des camarades sont poursuivis pour diffamation, ça empêchera les débats et les avancées sur ces questions.
A FO Brest par exemple, si les camarades n'avaient pas gagné au pénal, les militantes auraient également pu être poursuivies en diffamation.
Plusieurs militantes ont en effet dénoncé des violences sexuelles, un tract signé du syndicat a été rédigé, aucun nom n'était cité mais l'agresseur a écrit à la secrétaire du syndicat pour dire qu'il y avait des propos diffamatoires à son encontre : c'était de l'intimidation.
Si ce procès est gagné par Régis Vieceli, ça constituera un précédent catastrophique, pour l'ensemble des militantes féministes et syndicalistes qui essayent quotidiennement de faire cesser l'impunité qui subsiste.
D'autant qu'on rappelle qu'aux côtés de Christine, l'action de la cellule de veille confédérale de la CGT est également visée : non seulement on cherche à intimider toutes les victimes et leurs soutiens, à décourager toutes les prises de parole futures, mais en plus on s'attaque aux instances internes que les militantes féministes ont conquis de haute lutte dans les OS. Une condamnation enverrait le pire des messages aux organisations qui commencent à faire des pas dans le bon sens.
Contretemps – Ça irait à l'encontre de la dynamique actuelle où la parole des victimes est davantage entendue ?
Resyfem – Oui, certaines d'entre nous avions assisté au procès pour diffamation intenté par Denis Baupin et c'est vrai que ça a été un moment important, ça a constitué une forme de reconnaissance pour les femmes victimes de violences sexuelles dans le cercle militant. Une inter-organisations nationale existe maintenant et permet de travailler sur l'itinérance des agresseurs entre des syndicats et des partis politiques.
Mais, des progrès restent à faire, notamment sur « l'itinérance des victimes » : bien que Christine soit confrontée à tout cela du fait de son action en tant que militante de la CGT, ses frais d'avocat ne sont pas financés par cette dernière, ni la réparation de l'ensemble des préjudices subis, tout comme ses camarades du Collectif femmes mixité.
En effet, la plupart des militantes, dont Christine, qui se sont battues en interne ont dû quitter le syndicat, avec un véritable préjudice moral. Par ailleurs, cette lutte a impacté la santé de la majorité des camarades avec des frais qui restent aussi à leur charge. La double peine existe encore dans nos syndicats.
Il nous semble donc qu'une revendication importante serait le remboursement de tous les frais et préjudices (moraux, de santé, juridiques…) pour les victimes, que ce soit lorsqu'elles portent elles-mêmes plaintes contre un agresseur, luttent contre lui ou lorsqu'elles font l'objet d'une procédure-bâillon.
Plus largement, si des protocoles (parfois assez bons) commencent à exister dans la plupart des OS, beaucoup de choses allant dans le sens d'une meilleure connaissance des VSS restent non contraignantes et donc soumises dans leur application à la bonne volonté des militant·es. Le rapport de force féministe en interne est donc décisif, aussi bien pour rendre effectives les mesures de prévention, de protection et de sanctions, que pour obtenir des mesures plus solides dans les statuts des OS. Il faut aussi revoir nos fonctionnements collectifs car un agresseur dans un syndicat tout comme au travail s'appuie sur des organisations du travail qui dysfonctionnent. C'est bien un enjeu collectif au-delà de la sanction individuelle (suspension, gradation des sanctions) qu'il faut porter.
Ce type de procès est une étape pour nous dans la dynamique en cours pour débattre et avancer sur des moyens de combattre les violences en interne. La CGT souhaite se saisir de ce procès avec un rassemblement et une conférence de presse pour réaffirmer l'importance du travail de la cellule de veille et le défendre contre cette attaque sans précédent. Elle était rejointe par d'autres syndicats nationaux comme la FSU, Solidaires… pour montrer une détermination unitaire dans le soutien aux victimes et dans leur action de lutte contre les violences.
Nous savons que d'autres procédures judiciaires sont en cours, notamment intentées par Benjamin Amar contre la CGT, sa cellule de veille et des militant·es. L'enjeu est donc important que le procès contre Christine et P. Martinez se solde par une relaxe générale !
De notre côté, nous appelions à un rassemblement le 30 septembre devant le Palais de justice pour soutenir Christine, pour défendre le droit des victimes et de leurs soutiens à parler et à se défendre, et interpeller nos OS sur ces sujets. Mais le procès est malheureusement reporté. Nous devons rester solidaires. Nous serons à ses côtés les 16 et 17 octobre 2025 pour relancer une présence collective féministe et syndicale les deux jours d'audience.
D'ici là, d'autres procédures judiciaires sont en cours et chacune est susceptible d'envoyer un signal qui pèsera dans la résolution des suivantes. Nous pensons notamment aux plaintes intentées par Benjamin Amar contre la CGT et sa cellule de veille, envers des militantes mais aussi envers des médias et collectifs divers. Ce 27 novembre se tiendra le procès pour atteinte à l'intimité de la vie privée contre l'AVFT notamment. Régis Vieceli et Benjamin Amar participent ainsi à un même mouvement de backlash généralisé qui rend ce moment particulièrement charnière pour nos luttes. Il est décisif de ne céder aucun terrain à ces entreprises de musellement. Dans le cas des procédures bâillon initiées par Amar comme de celles intentées par Vieceli, nous devons faire bloc pour éviter l'enclenchement d'un effet domino jurisprudentiel catastrophique pour le futur de la lutte contre les VSS dans les syndicats et les organisations politiques plus largement. Nous appelons nos OS à prendre la mesure de ce qui se joue avec ces audiences. Et nous appelons à la solidarité à l'occasion de celles-ci (ce 27 novembre et les 16 et 17 octobre 2025) pour soutenir les camarades attaquée.es, pour défendre le droit des victimes et de leurs soutiens à parler et à se défendre, et pour interpeller nos OS sur ces sujets.
Resyfem
Blog Résyfem : https://blogs.mediapart.fr/resyfem/blog
Contact : resyfem@riseup.net
https://www.contretemps.eu/lutte-vss-syndicats-procedures-baillons/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« L’affaire Assange crée un dangereux précédent pour tous les journalistes » : Kristinn Hrafnsson et Stella Assange témoignent

Stella Assange, l'épouse de Julian Assange, et Kristinn Hrafnsson, rédacteur en chef de WikiLeaks, témoignent du combat mené durant quatorze années par le journaliste australien, Julian Assange, pour sa libération. Conscient du climat d'autocensure que sa condamnation instaure au sein de la profession, le lanceur d'alerte entend continuer la lutte.
Tiré de l'Humanité
Publié le 22 novembre 2024
Vadim Kamenka
Lecture suggérée par André Cloutier
Photo :
« Je suis libre aujourd'hui parce que j'ai plaidé coupable de journalisme », a déclaré Julian Assange, à Strasbourg, devant le Conseil de l'Europe, le 1er octobre.
©️ JOHANNES SIMON / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP
Depuis sa libération le 26 juin, Julian Assange a tenu à réaliser sa première visite hors d'Australie en France, à Strasbourg. « C'est bon d'être de retour », a même souligné le cofondateur de WikiLeaks. Le journaliste de 52 ans a voulu surtout témoigner devant le Conseil de l'Europe et tenir son premier discours public depuis 2019. Julian Assange a soutenu la résolution adoptée qui en fait un prisonnier politique et alerte sur le dangereux précédent que son affaire crée à l'encontre de la presse.
L'extraterritorialité des lois, notamment états-uniennes, permet désormais à n'importe quel éditeur, journaliste, d'être poursuivi. Une situation insupportable pour le Conseil de l'Europe et Julian Assange, qui a rappelé : « Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui parce que, après des années d'incarcération, j'ai plaidé coupable de journalisme. »
L'Australien en effet a pu retrouver la liberté en plaidant coupable afin d'éviterl'extradition aux États-Uniset une procédure lancée en 2019 qui lui faisait encourir 175 ans de prison, pour 18 chefs d'inculpation en vertu des lois anti-espionnage, après une détention arbitraire entamée le 7 décembre 2010 et 1 901 jours de prison à Belmarsh. Le rédacteur en chef de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, et sa femme, Stella Assange, témoignent de son quotidien et d'un combat qui doit se poursuivre.
Après quatorze années de détention au Royaume-Uni, dont 1 901 jours dans une prison de haute sécurité à Belmarsh, dans quel état de santé se trouve Julian Assange ?
Stella Assange
Son état de santé s'améliore, mais il a manifestement besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer. Je pense que tous ceux qui ont écouté Julian, à Strasbourg devant le Conseil de l'Europe, ont pu constater que son intelligence était intacte. Son témoignage durant plus d'une heure a confirmé que sa passion pour la vérité et les droits de l'homme n'a pas faibli. Mais il est évident que les années d'emprisonnement ont eu un impact considérable sur lui et qu'il a besoin de retrouver ses forces, et il n'en est qu'au début de ce processus.
Il a donc pris le temps d'interrompre sa convalescence en Australie et pris le risque d'un long périple de quarante-huit heures en raison de l'importance capitale du rapport rédigé par la commission des Questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée du Conseil de l'Europe sur son cas et les conséquences pour d'autres. La résolution votée est complète.
Elle reconnaît le statut de prisonnier politique, son traitement disproportionné, les persécutions vicieuses et dégradantes et les implications plus vastes enmatière de liberté de la presse. Après le plaider-coupable, Julian ne peut demander réparation à aucune instance judiciaire, mais il peut répondre à des initiatives politiques, notamment à une Assemblée parlementaire qui représente 46 nations. Cela permet d'informer les élus et de les sensibiliser à ces graves précédents.
Depuis sa libération en juin dernier, à quoi ressemble le quotidien de Julian Assange ?
Stella Assange : II peut enfin profiter de la vie d'un homme libre en Australie après quatorze années de détention. Il se rend à l'océan presque chaque jour pour nager et surfer. Julian apprend aussi à être un père de famille et à vivre avec les siens, notamment ses deux enfants. Il lit et s'informe sur tout ce qu'il a pu rater avec l'évolution prise par l'intelligence artificielle. Il prend le temps de se ressourcer et de redécouvrir le plaisir de manger.
Quel message a voulu défendre Julian Assange en prenant pour la première fois la parole en public, en France ?
Kristinn Hrafnsson
Ce rapport et le fait que Julian Assange ait été reconnu comme prisonnier politique par l'Assemblée plénière s'avèrent primordiaux. C'est une étape fondamentale pour la protection des journalistes. La résolution a pu dévoiler les persécutions subies sur la base de motifs politiques par Julian Assange au Royaume-Uni. Il a été poursuivi pour son travail journalistique et ses révélations sur les crimes de guerre commis par les armées américaine et britannique en Irak ou en Afghanistan.
Son cas et le plaider-coupable nécessaire à sa libérationcréent un précédent très dangereux pour les rédacteurs, reporters, journalistes d'investigation, éditeurs dans le monde entier. Face à ce danger, le signal envoyé par le Conseil de l'Europe s'avère très important pour tous les États. Car il s'agit d'une institution qui incarne une forme de conscience et de vigie face aux dérives antidémocratiques des nations et aux attaques contre les droits de l'homme. Il s'agit de défendre le droit à la liberté d'expression, sans ingérence. C'est pour cette raison que Julian Assange a souhaité entreprendre ce voyage éprouvant vers l'Europe.
Depuis cette résolution adoptée le 2 octobre, les autorités britanniques ont-elles réagi ?
Stella Assange : Le gouvernement n'a rien fait. Il entend étouffer l'affaire, comme seul un coupable le ferait en faisant obstruction au rapport indépendant du Conseil de l'Europe. Son Assemblée parlementaire, dont le Royaume-Uni est membre, a réclamé que les autorités britanniques procèdent à un examen « en vue d'établir s'il (Assange) a été exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément à leurs obligations internationales ».
Aucune enquête n'a été lancée et aucune réaction n'a été exprimée. D'ailleurs, nous savons que le Crown Prosecution Service, qui est chargé des poursuites judiciaires, a fait disparaître des documents clés relatifs à l'emprisonnement de Julian, et a refusé de fournir des informations au tribunal, qui pourraient faire la lumière sur l'aspect politique de la persécution de Julian au Royaume-Uni.
Malgré le plaider-coupable qui a clos l'affaire judiciaire avec les États-Unis, Julian Assange est-il prêt à poursuivre la lutte pour éviter que d'autres affaires, d'autres cas se répètent afin de contraindre la liberté de la presse ?
Kristinn Hrafnsson : Oui, comme il l'a mentionné lui-même, Julian va continuer ce combat pour que cela ne se reproduise plus jamais. Le Conseil de l'Europe a été clair sur l'impact de cette procédure, qui « crée un effet dissuasif dangereux et un climat d'autocensure affectant tous les journalistes, éditeurs et autres personnes qui signalent des questions essentielles au fonctionnement d'une société démocratique ».
Aujourd'hui, nous devons encourager les législateurs et les organisations à s'unir et à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais, par le biais de leurs processus législatifs, d'accords internationaux, etc. Nous savons tous qu'un précédent a été créé : Julian est le premier journaliste à être condamné sur la base de l'Espionage Act (loi sur l'espionnage). Il ne sera certainement pas le dernier, à moins qu'il n'y ait une forte réaction et une influence politique exercée sur les États-Unis pour dissocier l'Espionage Act de toute possibilité d'abus contre les journalistes.
Mais il faut également mettre en place des garanties dans les pays européens, car il y va de l'intérêt des journalistes du monde entier. Vous ne voulez pas que les journalistes européens risquent d'être extradés ou même appréhendés n'importe où dans le monde parce qu'ils ont enfreint une loi aux États-Unis pour avoir fait leur métier. Il faut neutraliser cette possibilité.
Le manque de protection de la presse vis-à-vis des États-Unis et de leur extraterritorialité est-il un danger suffisamment pris en compte par l'Europe ?
Stella Assange : Je pense qu'il est très important que la commission des Questions juridiques et des droits de l'homme ait produit ce rapport, parce qu'il crée non seulement une enquête indépendante sur ce qui s'est passé, mais aussi un consensus politique sur l'urgence avec laquelle les législateurs doivent examiner le danger que pose ce précédent. En fait, comme Julian l'a dit dans sa déclaration, s'il est libre, ce n'est pas parce que le système a fonctionné, mais parce qu'il n'a pas voulu sacrifier d'autres années de sa vie pour un système qui ne fonctionnait pas et qui n'allait pas lui permettre de retrouver la liberté.
C'est à cela qu'il faut s'attaquer : à la fois l'absence de garanties efficaces en cas de répression transnationale lorsqu'un État étranger abuse du système juridique pour harceler un journaliste en représailles de ce qu'il a publié, ainsi que le fait que l'espace européen n'est pas équipé pour protéger les journalistes victimes d'une répression transnationale. Et le cas de Julian, je pense, est le cas emblématique de la répression transnationale, parce que vous avez non seulement des outils juridiques, mais aussi une criminalité extralégale et étatique utilisée contre lui et documentée.
Et si nous en savons autant sur cette affaire, c'est grâce aux lanceurs d'alerte, parce qu'elle a été très médiatisée. Il y a donc beaucoup à en apprendre, mais il y a aussi d'autres cas, moins sous les feux des projecteurs, où des individus sont tout aussi vulnérables. Les ONG européennes, les hommes politiques, etc., doivent donc se réveiller et s'attaquer à ce problème. Le système européen prétend offrir un lieu sûr pour la publication, l'exposition de la vérité, etc. En réalité, son incapacité à mettre en œuvre les garanties qui étaient sur le papier a conduit à l'incarcération de Julian.
Est-ce que Julian Assange pourrait reprendre ses fonctions au sein de WiliLeaks ?
Kristinn Hrafnsson : Aujourd'hui, l'accent est mis sur son rétablissement, qui n'a commencé qu'il y a quelques semaines, et Julian a besoin de plus de temps. Il lui faut rassembler des informations sur le monde d'aujourd'hui. Cela fait quatorze ans qu'il est privé de liberté. Cela fait cinq ans qu'il n'est pas au courant de l'évolution du monde. Il pourra prendre position sur la direction à prendre après cela.
Bien sûr, cela prendra un peu de temps, mais je suppose que cela se fera sur la base des mêmes principes et des valeurs qui ont toujours motivé Julian, la justice et la rigueur journalistique. Oui, je pense que Julian a émergé dans un monde très différent et qu'il entame seulement son rétablissement, mais il y a beaucoup de travail à accomplir.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

À propos d’"escalade guerrière" : quand le mouvement ouvrier international livrait des armes... en Russie

Cela fait maintenant plus de deux ans, plus de 1 000 jours que le mouvement ouvrier ukrainien, les syndicats, les militant·es socialistes, anarchistes, féministes etc., tout en luttant contre les atteintes constantes au droit du travail et aux services publics par le Gouvernement néolibéral de Zelensky, ne cessent de réclamer de leurs camarades hors Ukraine un soutien armé pour se défendre contre l'agression Russe déclenchée le 24 février 2022.
Jusqu'à présent, à de rares exceptions près, les directions des partis ouvriers ou syndicales hors Ukraine, s'opposent à cette revendication ou l'ignorent et dans tous les cas refusent de simplement la relayer. Elles s'accordent en revanche pour lancer des appels à la paix, à des négociations, à un soutien humanitaire et à la fin de "l'escalade guerrière" en Ukraine.
Ce n'est bien évidemment pas la première fois que des travailleurs et travailleuses en lutte sollicitent un soutien armé, que cette demande suscite d'importantes controverses et une farouche opposition des pacifistes (convaincu·es ou campistes).
Il est même difficile ici de ne pas faire un rapprochement entre la posture pacifiste et charitable des directions ouvrières actuelles face à l'agression russe de février 2022 et la pusillanimité des dirigeants ouvriers britanniques qui pendant toute la guerre civile espagnole, de 1936 à 1938, vont obstinément s'opposer à un quelconque soutien armé aux républicains de peur de froisser les fascistes et... de l'escalade guerrière.
Ainsi, pendant que les dirigeants ouvriers britanniques vont organiser des collectes de dons pour fournir du lait aux enfants espagnols affamés, la classe ouvrière internationale va de son côté s'organiser pour apporter des armes, des munitions et des brigades de volontaires internationaux pour combattre les fascistes. Depuis, le mouvement ouvrier a oublié le Milk for Spain' programme et le nom des dirigeants britanniques charitables. En revanche, le soutien armé aux républicains espagnols et les volontaires internationaux du POUM, de la colonne Durruti ou des brigades internationales sont devenus des symboles de l'internationalisme, des mythes de la solidarité ouvrière internationale et de la lutte contre le fascisme.
Il est vrai que ce soutien humain et armé aux Républicains espagnols est un évènement exceptionnel dans l'histoire de l'internationalisme. Les cas où la classe ouvrière internationale s'est organisée pour soutenir et financer des livraisons d'armes ou envoyer des volontaires armés semblent relativement peu nombreux. Et jusqu'à la guerre civile espagnole, la solidarité armée internationale s'était davantage exprimée à travers des campagnes de boycotts ou des blocages de livraisons d'armes (comme par exemple la campagne de boycott des livraisons d'armes à la Hongrie d'Horty ou à la Pologne blanche en 1919, au Japon suite à l'invasion de la Mandchourie en 1932 ou à l'Italie lors de l'invasion de l'Éthiopie en 1935).
La guerre civile espagnole n'est toutefois pas le seul ni le premier exemple où le mouvement ouvrier international s'est organisé pour favoriser des livraisons d'armes à des camarades en lutte.
En ce sens on peut notamment rappeler que le 18 février 1905, alors que la Révolution Russe vient de débuter et qu'elle est déjà violemment réprimée, le Bureau socialiste international (BSI), le tout nouvel organe de coordination de la Seconde Internationale, lance un appel européen à l'ouverture de souscriptions en soutien des révolutionnaires Russes et Polonais. Le BSI centralise alors dans un « fonds Russe » les importantes sommes reçues d'un peu partout dans le monde mais surtout du puissant mouvement ouvrier allemand. Nicolas Delalande, qui a documenté cette action, souligne que c'est d'ailleurs « l'un des rares exemples de constitution d'un fonds de souscription par l'instance centrale du socialisme international ». C'est aussi l'un des tout premier exemples d'action coordonnée du mouvement ouvrier international, afin d'apporter un soutien armé à des camarades en luttes.
En effet, suite à cette souscription, le BSI reçoit « de nombreux appels » d'organisations membres appelant à favoriser l'armement des révolutionnaires russes. On sait ainsi que dès le mois d'avril 1905, des Arméniens ouvrent une souscription qui précise que l'argent collecté doit favoriser l'armement des révolutionnaires Russes. Le SPD allemand aurait également favorisé l'achat d'armes à destination de la Russie. En novembre 1905, une résolution de militants Russes exilés à San Francisco – signée par Jack London également – appelle à son tour le mouvement ouvrier à s'organiser pour fournir et favoriser les livraisons d'armes :
« [l]e prolétariat russe ne doit pas attendre un jour de plus les livres et les armes que les socialistes du monde entier peuvent lui donner. Nous sommes aux côtés du peuple russe dans sa lutte pour la liberté. La cause des travailleurs russes est aussi la nôtre ».
Ainsi, avec cette souscription la mission du BSI évolue. Jusqu'à présent l'action des instances internationales du socialisme, que ce soit la Première internationale et son Conseil général ou la Seconde internationale et son BSI, était principalement centrée sur la documentation, le réseautage et le soutien financier ponctuel en cas de grève. Désormais, « sans le reconnaître ouvertement », le BSI et son secrétaire Camille Huysmans en particulier, participent directement au soutien armé :
« La violence de la répression tsariste entraîne une diversification de l'aide et des secours. Il ne s'agit plus seulement de venir en aide pour apporter des subsistances et de quoi tenir pendant une grève, mais bien d'armer les partis politiques et les révolutionnaires, dans ce qui s'apparente à une véritable guerre civile », note ainsi N. Delalande.
Et ce soutien armé du BSI aux révolutionnaires Russes s'inscrit dans la durée alors qu'à la même époque, Camille Huysman développe une collaboration « franche et cordiale » avec le représentant Bolchevik du POSDR , Vladimir Illitch Lénine et d'autres bolcheviks. Ainsi, entre 1906 et 1907, Camille Huysmans aide également Maxime Litvinov, futur commissaire du peuple aux Affaires étrangères de Staline, « dans ses achats d'armes pour la révolution russe, ainsi que pour le transfert des sommes nécessaires aux organisations révolutionnaires en Russie » .
Le secrétaire du BSI aurait notamment récupéré les sommes obtenues suites aux très controversées « expropriations », c'est-à-dire suite aux braquages pratiqués par les bolcheviks au Caucase pour financer la révolution . M. Litvinov aurait notamment remis à C. Huysmans les sommes obtenues suite au braquage meurtrier de la banque de Tiflis du 13 juin 1907, auquel aurait participé, selon certaines sources, Staline (alors Koba). On soulignera que cette pratique de brigandage pour financer l'armement des révolutionnaires russes fut vivement critiquée et dénoncée. Ce braquage, très médiatisé à l'époque, a de fait lieu quelques jours à peine après que la très grande majorité des membres du Congrès des socialistes russes réunis à Londres, ait adopté une résolution dénonçant le recours aux pratiques de hold up et terroristes pour financer la révolution. Le braquage est ainsi réalisé contre l'avis de la majorité des socialistes et apparait rapidement comme étant contreproductif. Trotsky jugera ainsi que ce braquage « comporte une bonne part d'aventurisme », que « le butin de Tiflis n'apporte rien de bon » et que cette action a surtout contribué à diviser et à discréditer le mouvement ouvrier russe.
Quoiqu'il en soit, conclut Nicolas Delalande, la solidarité ouvrière et syndicale internationale prend en 1905, « une coloration paramilitaire ». Le mouvement ouvrier international se saisit alors de la question des armes, lance des souscriptions et centralise des fonds pour les financer, au nom de la lutte contre l'exploitation, contre le tsarisme et contre les Cents-Noirs antisémites. Et force est de constater qu'une telle orientation tranche avec la posture pacifiste de la grande majorité des directions actuelles du mouvement ouvrier.
De fait, à la fin du mois de novembre 2024, alors que les missiles et les drones russes pleuvent continuellement sur l'Ukraine, que la Russie fait désormais appel aux soldats Nords Coréens pour poursuivre son projet colonial, que V. Poutine menace la planète d'une guerre nucléaire si l'Ukraine n'accepte pas de céder son territoire, la plupart des parlementaires européens du Groupe The Left (La France Insoumise, Mouvement cinq étoiles, Die Linke, Parti du travail de Belgique etc.) et les dirigeants syndicaux internationaux refusent toujours de simplement relayer les appels à la solidarité armée des travailleurs et travailleuses ukrainien·nes, considérant que ce soutien à la résistance ukrainienne contribue à... l'escalade guerrière.
Bref, ceux et celles qui tentent de se défendre contre les néofascistes sont accusé·es de contribuer à la militarisation de la planète. Georges Orwell, qui lutta dans les rangs du POUM avant d'écrire 1984, aurait surement pu prendre cet exemple de novlangue.
Martin Gallié
Illustration : Peinture de Valentin Serov, "Soldats, héros, où est passée votre gloire ?", 1905

À propos d’escalades guerrières : quand le mouvement ouvrier international livrait des armes... en Russie

Cela fait maintenant plus de deux ans, plus de 1 000 jours que le mouvement ouvrier ukrainien, les syndicats, les militant·es socialistes, anarchistes, féministes etc., tout en luttant contre les atteintes constantes au droit du travail et aux services publics par le Gouvernement néolibéral de Zelensky, ne cessent de réclamer à leurs camarades hors Ukraine un soutien armé pour se défendre contre l'agression Russe déclenchée le 24 février 2022.
Jusqu'à présent, à de rares exceptions près, les directions des partis ouvriers ou syndicales hors Ukraine, s'opposent à cette revendication ou l'ignorent et dans tous les cas refusent de simplement la relayer. Elles s'accordent en revanche pour lancer des appels à la paix, à des négociations, à un soutien humanitaire et à la fin de "l'escalade guerrière" en Ukraine.
Ce n'est bien évidemment pas la première fois que des travailleurs et travailleuses en lutte sollicitent un soutien armé, que cette demande suscite d'importantes controverses et une farouche opposition des pacifistes (convaincu·es ou campistes).
Il est même difficile ici de ne pas faire un rapprochement entre la posture pacifiste et charitable des directions ouvrières actuelles face à l'agression russe de février 2022 et la pusillanimité des dirigeants ouvriers britanniques qui pendant toute la guerre civile espagnole, de 1936 à 1938, vont obstinément s'opposer à un quelconque soutien armé aux républicains de peur de froisser les fascistes et... de l'escalade guerrière.
Ainsi, pendant que les dirigeants ouvriers britanniques vont organiser des collectes de dons pour fournir du lait aux enfants espagnols affamés, la classe ouvrière internationale va de son côté s'organiser pour apporter des armes, des munitions et des brigades de volontaires internationaux pour combattre les fascistes. Depuis, le mouvement ouvrier a oublié le Milk for Spain' programme et le nom des dirigeants britanniques charitables. En revanche, le soutien armé aux républicains espagnols et les volontaires internationaux du POUM, de la colonne Durruti ou des brigades internationales sont devenus des symboles de l'internationalisme, des mythes de la solidarité ouvrière internationale et de la lutte contre le fascisme.
Il est vrai que ce soutien humain et armé aux Républicains espagnols est un évènement exceptionnel dans l'histoire de l'internationalisme. Les cas où la classe ouvrière internationale s'est organisée pour soutenir et financer des livraisons d'armes ou envoyer des volontaires armés semblent relativement peu nombreux. Et jusqu'à la guerre civile espagnole, la solidarité armée internationale s'était davantage exprimée à travers des campagnes de boycotts ou des blocages de livraisons d'armes (comme par exemple la campagne de boycott des livraisons d'armes à la Hongrie d'Horty ou à la Pologne blanche en 1919, au Japon suite à l'invasion de la Mandchourie en 1932 ou à l'Italie lors de l'invasion de l'Éthiopie en 1935).
La guerre civile espagnole n'est toutefois pas le seul ni le premier exemple où le mouvement ouvrier international s'est organisé pour favoriser des livraisons d'armes à des camarades en lutte.
En ce sens on peut notamment rappeler que le 18 février 1905, alors que la Révolution Russe vient de débuter et qu'elle est déjà violemment réprimée, le Bureau socialiste international (BSI), le tout nouvel organe de coordination de la Seconde Internationale, lance un appel européen à l'ouverture de souscriptions en soutien des révolutionnaires Russes et Polonais. Le BSI centralise alors dans un « fonds Russe » les importantes sommes reçues d'un peu partout dans le monde mais surtout du puissant mouvement ouvrier allemand. Nicolas Delalande, qui a documenté cette action, souligne que c'est d'ailleurs « l'un des rares exemples de constitution d'un fonds de souscription par l'instance centrale du socialisme international ». C'est aussi l'un des tout premier exemples d'action coordonnée du mouvement ouvrier international, afin d'apporter un soutien armé à des camarades en luttes.
En effet, suite à cette souscription, le BSI reçoit « de nombreux appels » d'organisations membres appelant à favoriser l'armement des révolutionnaires russes. On sait ainsi que dès le mois d'avril 1905, des Arméniens ouvrent une souscription qui précise que l'argent collecté doit favoriser l'armement des révolutionnaires Russes. Le SPD allemand aurait également favorisé l'achat d'armes à destination de la Russie. En novembre 1905, une résolution de militants Russes exilés à San Francisco – signée par Jack London également – appelle à son tour le mouvement ouvrier à s'organiser pour fournir et favoriser les livraisons d'armes :
« [l]e prolétariat russe ne doit pas attendre un jour de plus les livres et les armes que les socialistes du monde entier peuvent lui donner. Nous sommes aux côtés du peuple russe dans sa lutte pour la liberté. La cause des travailleurs russes est aussi la nôtre ».
Ainsi, avec cette souscription la mission du BSI évolue. Jusqu'à présent l'action des instances internationales du socialisme, que ce soit la Première internationale et son Conseil général ou la Seconde internationale et son BSI, était principalement centrée sur la documentation, le réseautage et le soutien financier ponctuel en cas de grève. Désormais, « sans le reconnaître ouvertement », le BSI et son secrétaire Camille Huysmans en particulier, participent directement au soutien armé :
« La violence de la répression tsariste entraîne une diversification de l'aide et des secours. Il ne s'agit plus seulement de venir en aide pour apporter des subsistances et de quoi tenir pendant une grève, mais bien d'armer les partis politiques et les révolutionnaires, dans ce qui s'apparente à une véritable guerre civile », note ainsi N. Delalande.
Et ce soutien armé du BSI aux révolutionnaires Russes s'inscrit dans la durée alors qu'à la même époque, Camille Huysman développe une collaboration « franche et cordiale » avec le représentant Bolchevik du POSDR , Vladimir Illitch Lénine et d'autres bolcheviks. Ainsi, entre 1906 et 1907, Camille Huysmans aide également Maxime Litvinov, futur commissaire du peuple aux Affaires étrangères de Staline, « dans ses achats d'armes pour la révolution russe, ainsi que pour le transfert des sommes nécessaires aux organisations révolutionnaires en Russie » .
Le secrétaire du BSI aurait notamment récupéré les sommes obtenues suites aux très controversées « expropriations », c'est-à-dire suite aux braquages pratiqués par les bolcheviks au Caucase pour financer la révolution . M. Litvinov aurait notamment remis à C. Huysmans les sommes obtenues suite au braquage meurtrier de la banque de Tiflis du 13 juin 1907, auquel aurait participé, selon certaines sources, Staline (alors Koba). On soulignera que cette pratique de brigandage pour financer l'armement des révolutionnaires russes fut vivement critiquée et dénoncée. Ce braquage, très médiatisé à l'époque, a de fait lieu quelques jours à peine après que la très grande majorité des membres du Congrès des socialistes russes réunis à Londres, ait adopté une résolution dénonçant le recours aux pratiques de hold up et terroristes pour financer la révolution. Le braquage est ainsi réalisé contre l'avis de la majorité des socialistes et apparait rapidement comme étant contreproductif. Trotsky jugera ainsi que ce braquage « comporte une bonne part d'aventurisme », que « le butin de Tiflis n'apporte rien de bon » et que cette action a surtout contribué à diviser et à discréditer le mouvement ouvrier russe.
Quoiqu'il en soit, conclut Nicolas Delalande, la solidarité ouvrière et syndicale internationale prend en 1905, « une coloration paramilitaire ». Le mouvement ouvrier international se saisit alors de la question des armes, lance des souscriptions et centralise des fonds pour les financer, au nom de la lutte contre l'exploitation, contre le tsarisme et contre les Cents-Noirs antisémites. Et force est de constater qu'une telle orientation tranche avec la posture pacifiste de la grande majorité des directions actuelles du mouvement ouvrier.
De fait, à la fin du mois de novembre 2024, alors que les missiles et les drones russes pleuvent continuellement sur l'Ukraine, que la Russie fait désormais appel aux soldats Nords Coréens pour poursuivre son projet colonial, que V. Poutine menace la planète d'une guerre nucléaire si l'Ukraine n'accepte pas de céder son territoire, la plupart des parlementaires européens du Groupe The Left (La France Insoumise, Mouvement cinq étoiles, Die Linke, Parti du travail de Belgique etc.) et les dirigeants syndicaux internationaux refusent toujours de simplement relayer les appels à la solidarité armée des travailleurs et travailleuses ukrainien·nes, considérant que ce soutien à la résistance ukrainienne contribue à... l'escalade guerrière.
Bref, aujourd'hui, ceux et celles qui tentent de se défendre contre une invasion coloniale et de lutter contre des néofascistes sont accusé·es de contribuer à la militarisation de la planète et de participer de l'escalade guerrière. Georges Orwell, qui prit les armes au côté des militant·es du POUM avant d'écrire 1984, aurait surement pu prendre cet exemple de novlangue.
Martin Gallié
Illustration : Peinture de Valentin Serov, "Soldats, héros, où est passée votre gloire ?", 1905
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Trump et Musk nous mènent vers un monde glacial, dominé par l’IA »

Donald Trump et Elon Musk prônent un antihumanisme décomplexé, géré par l'intelligence artificielle et « vidé de ses corps », explique le philosophe Éric Sadin. Une idéologie déjà à l'œuvre en France.
Tiré de Reporterre
28 novembre 2024
Par Scandola Graziani
Éric Sadin est philosophe spécialiste de la critique du numérique et son monde. Ses nombreux ouvrages, dont La Siliconisation du monde (2016), L'Ère de l'individu Tyran (2020) ou La Vie spectrale (2023), abordent les conséquences de l'avènement des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle (IA), sur l'organisation de nos sociétés.
Reporterre — Le milliardaire Elon Musk a été nommé par Donald Trump au ministère de « l'efficacité gouvernementale ». Que cela révèle-t-il ?
Éric Sadin — Elon Musk incarne le mythe de l'entrepreneur visionnaire qui a tout saisi de la vérité de l'époque. Sa figure fait penser à celle de John Galt, le héros de La Grève, le fameux roman d'Ayn Rand publié en 1957, devenu depuis la référence majeure du courant libertarien. John Galt est un ingénieur, caractérisé par sa puissance inventive, qui décide d'organiser une fronde de grands entrepreneurs contre l'inertie de l'État. Ensemble, ils brandissent la menace de cesser leur activité, affirmant que le pays finira alors exsangue. C'est exactement ce à quoi nous avons affaire avec Elon Musk : l'image d'un génie semblant dorénavant indispensable à la bonne santé économique de la nation. Donald Trump a récemment déclaré à son propos : « C'est un super génie, il faut qu'on les protège, nous n'en avons pas tant que ça. »
Quelle est l'idéologie derrière cette figure de « l'entrepreneur visionnaire » ?
Cette idéologie, à l'œuvre depuis une trentaine d'années dans la Silicon Valley, est fondée sur le postulat que Dieu n'a pas parachevé la création. Le monde est truffé de défauts et l'humain étant fondamentalement imparfait, il en est le premier vecteur. Toutefois, un miracle a lieu désormais : les technologies dites de « l'exponentiel », qui sont vouées à racheter toutes nos insuffisances. C'est là que l'intelligence artificielle donne corps à ce projet, en réalisant de façon infiniment plus rapide, prétendument plus fiable et à moindre coût, un nombre sans cesse extensif de tâches.
L'humain étant alors appelé à être évacué des affaires qui le regardent, pour n'être plus réduit qu'à une cible continuellement marchande, assaillie par des offres automatisées et hyperpersonnalisées. Voit-on l'antihumanisme radical à l'œuvre ? Celui cherchant à instaurer une société hygiéniste, délivrée de tout défaut, et une marchandisation intégrale de la vie.
Comment cette idéologie prônée par Elon Musk et la Silicon Valley trouve-t-elle un écho auprès de Donald Trump ?
Trump et Musk se rejoignent dans une sorte d'iconoclasme radical et décomplexé. Leur point commun est le refus des intermédiaires, des instances centrales, supposés être des facteurs d'inertie. C'est pour cela que Musk a vite été un adepte des cryptomonnaies, ambitionnant de se débarrasser de tous les maillons de régulation de la valeur. Du côté de Trump, les intermédiaires, ce sont l'État fédéral, Washington, les institutions, le prétendu « État profond », et les élites qu'il entend renverser, au profit d'un lien plus direct avec les Américains. C'est aussi le fantasme d'une parfaite transparence.
« Un monde glacial, vidé de ses corps »
On parle de possibles conflits d'intérêts, des contrats publics d'Elon Musk, de sa cotation en bourse qui a grimpé depuis l'élection de Trump… Ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'ils trouvent dans cette alliance la certitude que leur vision du monde va s'appliquer sans aucune limite.
Concrètement, que compte faire Elon Musk à ce poste de « l'efficacité gouvernementale » ?
Je donnerais un autre nom à ce poste : celui de « l'automatisation des affaires publiques ». Il existe aujourd'hui des systèmes d'intelligence artificielle capables de gérer quantité de dossiers administratifs et publics, à un point que l'on n'aurait plus besoin d'autant d'humains dans ces domaines. Elon Musk risque d'y aller à la hache. Et celle-ci va s'appuyer sur un levier principal : l'automatisation par l'IA. Des systèmes se substitueront à l'humain.
Le paradoxe, c'est qu'en voulant éradiquer la bureaucratie, on en arrive à des effets d'hyper bureaucratie, semblables aux récits kafkaïens, où personne ne sait où se trouvent les interlocuteurs. On s'imagine que l'IA va fluidifier les choses, en réalité c'est l'opposé ! Ce sera le règne de la « technocratie algorithmique ». Un monde glacial, vidé de ses corps.
Dans un entretien accordé au Mondeen 2020, vous déclariez : « Il est probable qu'un fascisme d'un nouveau genre émerge dans les années post-coronavirus. » Sommes-nous arrivés à cela ?
Les dictateurs entendent asseoir leur pouvoir en muselant et en contrôlant les populations. Ici, il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas « big brother » ou le « crédit social » chinois. En revanche, ce qui vient, c'est le bannissement de l'humain des affaires qui le regardent. C'est ce que j'avais appelé dans La Silicolonisation du monde le « soft-totalitarisme numérique », à savoir que les algorithmes prévalent sur l'humain dans l'organisation de la société. C'est la fin du politique.
D'ailleurs, en encourageant l'automatisation des affaires humaines, le monde politique scie la branche sur laquelle il est assis ! Les États-Unis sont avant-coureurs d'une situation appelée, à terme, à devenir globale.
Où en est-on en France ?
Cette automatisation est en vigueur depuis une dizaine d'années en France. Le fait que le ministre de la Fonction publique Guillaume Kasbarian ait salué la nomination d'Elon Musk n'est pas anodin. Le projet porté par Emmanuel Macron est exactement le même que celui de Musk et Trump, mais à la française, c'est-à-dire un cran en dessous. Il a twitté pour se réjouir de l'installation d'un bureau à Paris du géant de l'IA générative, OpenAI.
Macron est un adepte du technopositivisme, qui a pour ennemi l'inertie, et doit conduire vers un monde conçu comme une horloge parfaitement réglée. Lui aussi honnit les corps intermédiaires, qui empêchent supposément la rapidité et l'efficacité de l'action…
« Il suffit d'ouvrir le capot de ses Tesla pour voir que c'est de l'esbroufe totale »
Cette idéologie est déjà à l'œuvre dans la plupart des démocraties libérales, avec le distinguo qu'elle n'est pas encore radicale. Avec Trump et Musk, ce projet prendra forme de façon totalement décomplexée.
Quels effets cela aura-t-il sur l'environnement ?
Les technologies numériques, plus encore l'intelligence artificielle et les IA génératives, entraînent de gigantesques conséquences énergétiques. Le besoin en électricité est tel qu'Amazon et autres Big Tech entendent alimenter leurs serveurs avec de petits réacteurs nucléaires. Il y a une forme de dissonance cognitive troublante d'un côté, avec la question écologique de plus en plus présente et, de l'autre, l'usage sans cesse extensif par des milliards d'individus de systèmes numériques.
Elon Musk est-il aussi dans cette dissonance cognitive ?
Oui, comme tous les gourous du numérique. Prenez sa voiture électrique prétendument vertueuse pour le climat. Il suffit d'ouvrir le capot de ses Tesla pour voir que c'est de l'esbroufe totale ! En réalité, ses véhicules sont aux antipodes de l'écologie. Ils vont encourager les transports, et le recyclage des batteries n'est pas encore possible. Un pragmatisme écologique consisterait tout simplement à ne concevoir ni voiture ni fusée, mais d'œuvrer à d'autres formes d'organisation — réellement vertueuses et écologiques — en commun.
« Allons interroger les salariés dans les entrepôts d'Amazon »
Il y a quelques années, les grands patrons de la Silicon Valley se disaient préoccupés par la question climatique, et soutenaient plutôt le camp démocrate…
Nous sommes naïfs. Nous accordons beaucoup trop d'attention à ce que disent ces personnes. Regardez la place qu'ils ont dans la presse, ces entrepreneurs et ingénieurs du numérique : elle est outrageusement importante ! Ce ne sont pas leurs discours qu'il faut écouter, il faut observer les conséquences de leurs systèmes. Ce n'est pas eux qu'on devrait interroger dans les médias : mais ceux qui subissent les conséquences de ce qu'ils font.
Allons interroger les salariés dans les entrepôts d'Amazon, là où des systèmes d'IA instaurent des modes managériaux indignes, réduisant des humains à des robots de chair et de sang. Allons interroger les professeurs dans les écoles publiques qui subissent de plein fouet les effets de la numérisation à marche forcée. Allons voir dans l'hôpital public l'implantation des systèmes d'IA qui coûtent une fortune et ne servent à rien, alors qu'on s'est rendu compte pendant le Covid que ce n'était pas d'IA dont on avait besoin, mais de personnel et de matériel élémentaire, de respirateurs, etc. En faisant cela, nous aurions une tout autre compréhension des phénomènes, et la société serait davantage transparente à elle-même.
Aujourd'hui, le discours d'Elon Musk flirte avec le climatoscepticisme. Comment expliquer ce revirement ?
Selon lui, ceux qui travaillent sur les questions environnementales se perdent dans des négociations sans fin, pour déboucher sur des projets d'accord, tels ceux de la COP, qui ne feraient rien avancer. Tout ceci peut donner l'impression d'être laborieux et surtout élitiste. Pour Musk, c'est une manne ! Ça lui permet de dire : « Nous, on va faire de la véritable écologie. Des systèmes vont résoudre la crise climatique. » Autrement dit, la solution viendra de la technologie : fini les discussions, la contradiction, la pluralité de points de vue, tout cela n'étant que de la perte de temps et des dépenses inutiles.
Quelles alternatives à la vision d'Elon Musk pouvons-nous proposer ?
La solution, c'est d'être partie prenante des affaires qui nous regardent. C'est un projet de société : que tout le monde ait la chance de pouvoir vivre d'autres modalités d'existence plus vertueuses, s'il le souhaite. Avec des relations entre les êtres plus équitables, et l'usage de matériaux qui ne bafouent pas la biosphère.
Nous devrions pouvoir expérimenter des modes d'organisation — via la mise en place de collectifs — dans le soin, l'éducation, l'artisanat, l'architecture… Pour l'instant, ces expériences sont marginales, presque héroïques. Il faudrait que la puissance publique soutienne ces projets, qu'ils puissent essaimer ! C'est ce que j'appelle le « printemps des collectifs ».
Je ne vois pas d'autre solution que de défendre le vivant. Celui des éléments, mais aussi celui qui est en nous et qui ne demande qu'à s'épanouir. Appelons cela un puissant et joyeux désir de vie ; contre la pulsion de mort qui, aujourd'hui, semble être devenue notre monnaie bien trop courante.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Brésil : le MST sur le harcèlement dans les mouvements #25Nov24

Dans ce court texte, je voudrais apporter quelques notes sur le harcèlement, en particulier dans les lieux de militantisme politique.
J'écris en étant consciente de ceux qui liront ces lignes : les femmes activistes dans un mouvement social consolidé. Je n'ai pas l'intention d'épuiser le débat ici, ne serait-ce qu'en raison de l'espace limité qui m'est imparti. Je comprends la sensibilité du sujet, ainsi que son potentiel de controverse. Alors, allons-y ! Sans prétention…
Les données les plus diverses montrent que le harcèlement, sous toutes ses formes, est un phénomène basé sur des relations de pouvoir et qui réaffirme les inégalités de genre dans les divers domaines sociaux. Dans une relation où il y a harcèlement, le fondement est la croyance que l'autre personne se trouve dans une situation hiérarchiquement inférieure à celle de l'agresseur.
Ainsi, la conduite définit des types de harcèlement : si c'est sexuel, il s'agit du délit (Code pénal, art. 216-A), « humilier quelqu'un dans le but d'obtenir un avantage ou une faveur sexuelle » ; si c'est moral, il s'agit d'une conduite abusive et intentionnelle visant à nuire à la dignité, à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Le harcèlement sexuel est un comportement qui porte atteinte à la liberté et à la dignité sexuelle des individus ; c'est-à-dire des baisers volés, des attouchements, des caresses, des léchages, toucher des parties intimes, éjaculer et/ou se masturber devant des personnes sans consentement – cela peut entraîner une peine de prison allant de un à cinq ans.
Le harcèlement se produit le plus souvent contre les femmes, car il est une action résultant de l'incidence sociale des relations patriarcales. Ou pour citer une intellectuelle bien connue de beaucoup d'entre nous, Heleieth Saffioti : là où l'accès au corps d'une femme fait partie du « contrat sexuel » qui configure les relations de genre inégales (Gender Patriarchy Violence – Saffioti, 2015). Il existe des rôles sociaux qui ont été construits pour les femmes dans le contrat social sous-jacent aux sociétés capitalistes modernes. Et dans ces rôles, les femmes sont des corps « disponibles » pour les hommes pour le travail domestique, les soins et la soumission sexuelle.
C'est dans ce contexte plus sociologique et politique que le harcèlement se « justifie » dans le monde du travail, un lieu construit pour les masculinités, pour les hommes occupant des positions de pouvoir. Cependant, pas seulement. Que dire du harcèlement dans les organisations politiques et les mouvements sociaux ? Ou même lorsqu'il s'agit de femmes occupant des postes de direction, à l'égal des autres hommes ?
Les femmes militantes doivent surmonter des obstacles dans leurs organisations politiques, tout comme dans tout autre domaine social. Mais, qui parmi nous n'a jamais dû quitter une réunion plus tôt parce que notre enfant avait besoin de soins ? Les conversations informelles, en dehors des forums « officiels », courantes en politique, tiennent-elles compte de ce qui est sécuritaire pour les femmes ? Combien de jeunes femmes ont été interrogées sur leurs activités politiques ou leurs relations affectives ? Si nous abordons des sujets sociaux, n'est-il pas à prévoir que des cas de harcèlement se produisent également dans nos espaces politiques ? Malheureusement, oui.
Cependant, il existe un sentiment de légitimation du harcèlement comme une situation banale. Les femmes militantes se voient souvent obligées de « s'en sortir », de ne pas soulever la question pour ne pas se rendre vulnérables aux conflits politiques, ou même pour ne pas exposer l'organisation politique et les organes de gouvernance dont elles font partie. Il y a une forme de honte à partager l'inconfort et même un certain retard dans la compréhension de la frontière – qui n'est pas mince – entre la « blague » et la situation de harcèlement.
Il est difficile de concevoir que les corps des femmes ne puissent pas être respectés dans des espaces où la confiance politique est placée. Et la manière voilée et individualisée dont cela se manifeste contribue à cette « légitimation » d'une situation « superflue », sans importance. Cependant, lorsque nous nous connectons à la réflexion sur les inégalités de genre, il devient évident que le harcèlement est une forme de violence qui, étant si courante, devrait recevoir davantage d'attention.
Lorsque nous analysons les espaces de militantisme politique, nous prenons en compte la préservation de la camaraderie. C'est dans cet espace que l'observation devient la plus difficile, car ne pas reconnaître le harcèlement comme une pratique violente conduit à un manque de prise en compte. Ce manque d'enregistrement complique la compréhension. L'absence de connaissance rend plus difficile la mise en place de mesures de lutte adéquates. Et même s'il existe une relation professionnelle, on ne s'attend pas à ce que les espaces qui cultivent des valeurs visant l'émancipation humaine causent la moindre forme de violence envers quiconque.
Le harcèlement interfère directement avec le pouvoir militant des femmes, en restreignant leur performance corporelle et psychologique. La notion de solidarité mutuelle qui nous pousse à avancer et à lutter pour une cause quelconque se brise lorsque le corps et l'identité féminine ne sont pas respectés dans leurs spécificités. Allons-y étape par étape, mais jamais entièrement.
Dans le cas des femmes noires, cela est encore plus sensible, car la race se croise, c'est-à-dire qu'elle interagit et se superpose à d'autres facteurs sociaux. La définition du rôle de la femme noire se situe encore plus bas dans l'échelle de valorisation de ce qui est considéré comme digne dans la société. Je prends l'exemple des femmes noires victimes de violences, parfois par des femmes blanches, en raison des rôles encore plus subordonnés qui leur ont été historiquement attribués. Ou même le corps sexualisé dans les réflexions issues de la culture esclavagiste et des souvenirs de corps violés auparavant par les maîtres et les propriétaires terriens.
Ce qui nous intéresse ici, c'est la déconstruction nécessaire et permanente de l'accès au corps des femmes comme étant quelque chose de public. Cela parle aussi de changements culturels dans la compréhension de ce que signifie être une femme dans la société, sous les dimensions du genre, de la race et même de la sexualité. Évidemment, le harcèlement n'est pas un viol. Mais la violence, aussi « douce » soit-elle, reste de la violence. Et si l'objectif est de surmonter les relations de domination, cela s'applique également aux espaces où nous exerçons la politique.
Les relations de camaraderie au sein d'une organisation politique doivent normaliser des attitudes, des actes et des comportements qui reflètent ce que l'on cherche à obtenir à travers un projet politique. Un projet politique émancipateur nécessite, à son tour, des hommes et des femmes solidaires, dans des relations de pleine égalité. Maintenir des relations et des organisations politiques en taisant la violence, y compris le harcèlement, c'est maintenir des structures ancrées dans la durabilité de cette même violence. Mais « laisser faire » a des conséquences : cela se traduit par la disparition de la militance féminine, le changement de direction, de perspectives politiques, et le affaiblissement de tout projet politique émancipateur.
Lutter contre le harcèlement, chers amis, est une tâche qui demande de la résistance et une posture militante. C'est une tâche politique collective. Une organisation politique qui cherche réellement à émanciper les sujets ne peut être un espace pour la répétition de la violence, quelle qu'elle soit. Car la violence, lorsqu'elle est normalisée, a le pouvoir de détruire les rêves, les passions, ce qui pousse les gens à s'engager.
La recherche d'espaces de confiance entre femmes permet ce qui est souvent perçu comme un élan. D'autre part, il est essentiel de sensibiliser au sein de l'organisation politique à une éducation militante dans laquelle l'égalité des genres est une construction constante ; où hommes et femmes comprennent et apprennent des attitudes, des actes et des comportements qui doivent être reflétés pour être perçus et rejetés simplement parce qu'ils sont des violences.
Quels sont les mécanismes d'action pour lutter contre le harcèlement ? Il me semble que la première tâche est de reconnaître que c'est de la violence. Accueillir avec attention et sérieux. Comprendre les effets des harcèlements les plus variés sur l'action politique des femmes à partir du recueil des témoignages. Après tout, il faut savoir trouver des solutions et ne pas permettre que d'autres femmes perdent la lutte parce que nous n'avons pas réussi à établir des espaces sûrs pour agir en toute confiance.
Peut-être qu'il n'est même pas nécessaire de réinventer la roue : mais plutôt de promouvoir le débat collectif et public au quotidien. Enlever le harcèlement de ce voile qui le couvre et qui manifeste des conditions insalubres qui ne contribuent pas à la lutte politique. En fait, cela nous freine simplement en tant qu'êtres humains.
Notes
[1] Je remercie les commentaires bienveillants de Liu Durães (BA), Laryssa Sampaio (CE) et Lucineia Freitas (MT) pour la formulation de ce texte.
[2] L'utilisation répétée du mot « violence » est intentionnelle.
Mayrá Lima
Depuis la page du MST
Mayrá Lima est politologue / Secteur de communication du MST / Brigade Adão Pretto
Édité par Fernanda Alcántara
Cette publication est également disponible en Español.
https://viacampesina.org/fr/bresil-le-mst-sur-le-harcelement-dans-les-mouvements-25nov24/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les travailleurs et travailleuses d’Amazon vont se mobiliser le jour du Black Friday, dans 20 pays

Des milliers de travailleurs et travailleuses d'Amazon devraient manifester ou faire grève dans plus de 20 pays à l'occasion du « Black Friday », ce vendredi 29 novembre, afin d'inciter la firme états-unienne à mieux respecter leurs droits et à prendre des mesures en faveur du climat.
25 novembre 2024 A\ tiré du site alencontre.org
http://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/les-travailleurs-et-travailleuses-damazon-vont-se-mobiliser-le-jour-du-black-friday-dans-20-pays.html
Des salarié·e·s et des représentants de syndicats et de groupes de travailleurs ont l'intention de se joindre aux manifestations contre les pratiques de l'entreprise basée à Seattle entre le Black Friday et le Ciber Monday (2 décembre – journée créée par les entreprises pour encourager les achats en ligne), l'un des plus grands week-ends d'achats de l'année.
Au cours de cette période annuelle de rabais, Amazon et de nombreux autres enseignent proposent des offres aux acheteurs, et le personnel des entrepôts est occupé à exécuter les commandes.
Des actions sont prévues dans les grandes villes des Etats-Unis, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Turquie, du Canada, d'Inde, du Japon, du Brésil et d'autres pays. Elles sont coordonnées par la campagne « Make Amazon Pay », qui demande à Amazon, fondée par Jeff Bezos – un des hommes les plus riches du monde avec une fortune de quelque 214 milliards de dollars –, de rémunérer équitablement ses salarié·e·s et de respecter leur droit de se syndiquer, de payer sa juste part d'impôts et de s'engager en faveur d'un environnement durable.
Sous l'égide de l'UNI Global Union pour les industries de services, basée en Suisse [siège à Nyon, canton de Vaud], et du groupe militant Progressive International, la campagne « Make Amazon Pay » regroupe plus de 80 syndicats, d'associations de lutte contre la pauvreté et de défense des droits des travailleurs et travailleuses du secteur de l'habillement, etc.
Des manifestations sont prévues devant le siège d'Amazon au Royaume-Uni, à Bishopsgate, rue de Londres, le jour du Black Friday. Des militant·e·s britanniques pour la justice fiscale et d'autres groupes remettront à l'entreprise une pétition portant plus de 110 000 signatures, suivie d'une marche jusqu'au 11 Downing Street [résidence de la chancelière de l'Echiquier Rachel Reeves]. Les pétitionnaires demandent à la chancelière de mettre fin aux avantages fiscaux accordés à Amazon UK et à d'autres grandes entreprises.
L'année dernière, la principale division britannique d'Amazon a payé l'impôt sur les sociétés pour la première fois depuis 2020, après la fin d'une « super-déduction » introduite par l'ancien premier ministre conservateur Rishi Sunak.
Le syndicat britannique GMB [qui réunit 560'000 membres présents dans tous les secteurs, entre autres dans la vente de détail] prévoit d'organiser un rassemblement en ligne des travailleurs d'Amazon à l'occasion du « Black Friday ». L'année dernière, des centaines de grévistes devant l'entrepôt d'Amazon à Coventry ont été rejoints le jour du Black Friday par des syndicalistes d'Allemagne, d'Italie et de Californie dans le cadre d'une campagne internationale réclamant de meilleures conditions de travail et la reconnaissance des syndicats.
Amanda Gearing, responsable de l'organisation chez GMB, a déclaré : « Ici, au Royaume-Uni, Amazon représente tout ce qui est cassé dans notre économie. Travail précaire, salaires de misère et conditions de travail souvent dangereuses : le GMB ne laissera pas ces pratiques façonner le monde du travail pour la prochaine décennie. »
En Allemagne, des milliers de membres du syndicat Ver.di feront grève dans les entrepôts de Dortmund, Leipzig, Coblence, Graben, Werne, Bad Hersfeld et Rheinberg.
En France, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (ATTAC), qui promeut la justice fiscale, organisera des manifestations dans plusieurs villes. C'est la cinquième année des manifestations « Make Amazon Pay ».
« La recherche acharnée du profit par Amazon se fait au détriment des travailleurs et travailleuses, de l'environnement et de la démocratie », a déclaré Christy Hoffman, secrétaire générale d'UNI Global Union.
« La firme de Bezos a dépensé d'innombrables millions pour empêcher les travailleurs et travailleuses de s'organiser, mais les grèves et les manifestations qui se déroulent dans le monde entier montrent que leur désir de justice – pour une représentation syndicale – ne peut pas être arrêté. Nous sommes unis pour exiger qu'Amazon traite ses travailleurs et travailleuses équitablement, respecte les droits fondamentaux et cesse de saper les systèmes censés nous protéger tous. »
Un porte-parole d'Amazon a déclaré : « Ces groupes représentent des intérêts divers et, bien que nous soyons toujours à l'écoute et que nous cherchions des moyens de nous améliorer, nous restons fiers des salaires compétitifs, des prestations sociales étendus et de l'expérience de travail stimulante et sûre que nous offrons à nos équipes. »
Amazon affirme être le plus grand acheteur d'énergie renouvelable au monde et que, l'année dernière, toute son électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables. L'entreprise affirme que son salaire de départ au Royaume-Uni est d'au moins 28 000 livres sterling [33'544 euros] par an pour des postes de quatre jours par semaine.
Le groupe de campagne « Amazon Employees for Climate Justice » affirme que l'entreprise n'a pas d'objectifs intermédiaires pour atteindre son objectif d'émissions nettes nulles d'ici 2040, et que ses émissions annuelles de carbone ont augmenté de 34,5% depuis 2019.
Dans l'entrepôt d'Amazon à Coventry, les travailleurs ont voté de justesse contre la reconnaissance syndicale en juillet, mais le Trade Union Congress (TUC) a insisté sur le fait que la bataille pour la reconnaissance syndicale se poursuivrait. (Article publié par The Guardian du 25 novembre 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Intégrer l’ethnicité à la démocratie politique »

La notion d'ethnie, au croisement de filiations culturelles, de pouvoir et de sang, devrait être davantage intégrée dans une analyse marxiste, notamment pour ce que les liens ethniques impliquent comme choix spontanés pour les populations et comme nécessités démocratiques.
Lorsque l'on parle de l'Afrique, on évoque souvent la notion d'ethnie, tant dans les journaux généralistes que parmi les chercheurs/ses en sciences sociales. Comment peut-on définir ce concept ?
26 novembre 2024 par Michel Cahen
Une peinture ancienne de la première migration des Fengu, l'un des peuples affectés par le Mfecane, au 18e siècle. Domaine public.
Lorsque l'on parle de l'Afrique, on évoque souvent la notion d'ethnie, tant dans les journaux généralistes que parmi les chercheurs/ses en sciences sociales. Comment peut-on définir ce concept ?
En France dans les années 1930, on a commencé à employer le mot ethnie comme un cache-sexe du mot race. Mais ce mot lui-même n'avait pas tout à fait le même sens que celui auquel il est réduit aujourd'hui. Par exemple, Ernest Renan, le grand théoricien de la nation française du 19e siècle, qui a écrit Qu'est-ce qu'une nation ?, parle très couramment de « race française ». Cela signifie communauté, ou nation, mais avec l'idée que la culture est dans le sang. C'est une espèce d'essentialisme. L'Internationale communiste parlait de « nègre », ce qu'on ne fait plus aujourd'hui.
Dans les années 1930, on a commencé à utiliser le mot ethnie de façon aussi essentialiste. En France, dans les sciences sociales, les deux moments fondateurs de la discussion plus moderne du mot et du concept d'ethnie sont, d'abord, le livre de Jean-Loup Amselle et d'Elikia M'Bokolo Au cœur de l'ethnie, publié pour la première fois en 1985, et puis quelques années plus tard le livre de Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prunier Les ethnies ont une histoire, publié en 1989. La thèse est que l'ethnie n'est pas simplement une manipulation des colonisateurs, que les Africain·es n'ont pas attendu les Européens pour ressentir des identités – qu'on peut appeler ethnie ou nation – qui sont des constructions sociales et par conséquent fluctuantes. Il y a des identités pluriséculaires en Afrique, je pense par exemple à la nation Kongo, initialement fruit d'une construction politique. Le royaume Kongo existait depuis deux siècles avant l'arrivée des Portugais dans la région en 1482 et l'identité Kongo existe toujours, bien que les frontières coloniales l'aient divisée en cinq morceaux : l'ouest du Congo Brazzaville, l'ouest du Congo « démocratique », l'extrême-sud du Gabon, l'enclave de Cabinda qui appartient à l'Angola et les deux provinces nord de ce pays qui s'appellent d'ailleurs Congo et Zaíre. C'est une entité qui continue d'exister, qui a sa propre langue, ses propres rites, son roi comme dignitaire culturel – même s'il possède un rôle mineur – et dont la capitale est Mbanza-Kongo en Angola.
En tant que marxiste, ce qui m'a toujours frappé, c'est la difficulté à appréhender le phénomène ethnique. Il y avait eu un peu le même débat en Europe sur la question nationale. On se rappelle qu'Engels était en faveur de l'indépendance de l'Irlande et de la Pologne alors que Rosa Luxembourg était contre l'indépendance de cette dernière parce qu'elle considérait que cela allait diviser le prolétariat qui était unifié par la force au sein de l'Empire allemand. Engels expliquait qu'un prolétaire, pour entrer dans la lutte, devait d'abord savoir sur quel territoire il marchait, ce qui relevait de lui : pour qu'un prolétaire irlandais puisse s'allier au prolétaire anglais, il fallait que la question nationale soit résolue. Engels accordait de l'importance à l'Irlande et à la Pologne parce qu'elles étaient colonisées respectivement par l'Angleterre et l'Allemagne, deux grands pays industriels. Il avait une sympathie que je qualifierais d'un peu instrumentale. Et le même Engels eut des phrases épouvantables sur les États des Balkans, petits, avec des peuples « sans histoire ». Comme il ne s'agissait pas de pays industriels, il les considérait comme retardataires. Or, d'un point de vue matérialiste, l'ethnicité est une formation sociale subjective qui exprime des sociétés selon des trajectoires identitaires qui sont les leurs et doivent intégrer notre réflexion.
Peux-tu préciser la notion d'ethnicité ?
Quand je parle d'ethnicité je ne parle pas simplement d'ethnie mais aussi de nation, que contrairement à la tradition jacobine je ne confonds pas avec la République et avec l'État. Par exemple la nation française ne peut pas être définie autrement que de la manière suivante : la nation est l'ensemble des gens qui se sentent Français, point final. De ce point de vue il n'y a strictement aucune raison de faire une différence de nature entre nation et ethnie, si ce n'est un degré d'ethnicité. La nation serait le degré le plus élevé en termes d'intensité de la cristallisation identitaire et de sa durée.
Je ne vois pas pourquoi on utiliserait le terme « nation » pour l'identité française – je suis persuadé que la nation française existe car il y a des gens qui se reconnaissent comme tels – et le terme ethnie pour l'identité Kongo, alors qu'à l'arrivée des Portugais, il y avait déjà un peuple Kongo avec son identité et sa langue. Serait-ce parce qu'on est en Afrique ? Je suis extrêmement méfiant par rapport à la hiérarchisation sémantique que l'on établit entre nations et ethnies. Toutes les nations sont des ethnies mais toutes les ethnies ne sont pas des nations, si on l'accepte mon idée de degrés d'ethnicité, c'est-à-dire que l'ethnie serait un degré moindre, plus fluide, moins cristallisé, peut-être moins durable d'identité. Il y a des ethnies qui ont disparu et d'autres qui sont apparues en raison du colonialisme. Cela ne veut pas dire que ce sont les colonisateurs qui ont créé les ethnies, dans la fameuse idée du diviser pour régner. Les colonisateurs ont classifié les gens, les missionnaires ont traduit la Bible dans les langues les plus efficaces pour eux – et cela a eu des effets très importants – mais ils se sont servis de ce qui existait déjà. On ne peut pas manipuler quelque chose qui n'existe pas.
Pourtant dans le livre Au cœur de l'ethnie, sous la direction de Jean-Loup Amselle et Elikia M'Bokolo, auquel tu faisais référence, un chapitre écrit par Jean-Pierre Dozon est intitulé : « Les Bete : une création coloniale ».
Je ne suis pas du tout spécialiste de cette région. Il a peut-être raison, s'il prouve qu'un administrateur colonial a défini des gens et les a regroupés dans une circonscription qu'il a organisée, et que petit à petit ces gens se sont habitués à cette structuration coloniale qui serait devenue ethnique. Il est possible que ça ait marché mais on ne peut en déduire une loi générale selon laquelle les ethnies auraient été inventées par le colonisateur. Cela signifierait que les Africain·e·s auraient dû attendre l'arrivée des colonisateurs pour ressentir des identités communautaires qui n'étaient pas simplement lignage et clan.
Prenons le cas de deux pays très différents, les îles du Cap-Vert et le Mozambique. Le Mozambique est un pays du cône sud de l'Afrique, riverain de l'océan Indien, et dont la population fait partie de la grande famille des Bantous. Le Cap-Vert est un archipel créole situé dans l'océan Atlantique, 500 km à l'ouest de Dakar, qui n'était pas peuplé quand les Portugais sont arrivés. Il a été peuplé intégralement d'esclaves venus de différents endroits d'Afrique, qui n'avaient pas les mêmes identités, les mêmes religions, qui ne parlaient pas la même langue, et c'est pourquoi ils ont dû forger la langue créole. Une nouvelle identité est donc apparue, l'identité créole, circonscrite territorialement par l'archipel. On peut dire qu'historiquement il y a eu la formation d'une nation tout à fait comparable à nos nations en Europe. Il n'y a pas de problème majeur d'identification entre le Capverdien le plus pauvre et l'État capverdien.
Pour le Mozambique, c'est différent, car on est dans l'Afrique continentale. Le pays a été également colonisé par les Portugais au tout début du 17e siècle, même si la majeure partie du territoire n'a été occupée qu'à la fin du 19e. C'est l'Afrique bantoue avec ses lignages, ses chefferies traditionnelles, ses nations africaines précoloniales, de grands États qui ont été vaincus militairement par les Portugais. Il y avait des identités africaines, mais ce n'était pas forcément des États-nations : le nkosi (roi/chef) de l'une des principales formations politiques au sud du Mozambique, l'empire de Gaza, était un immigrant zoulou lié au Mfecane (grands mouvements des migrations des Zoulous à partir de la fin du 18e siècle). C'était un État tout à esclavagiste et violent qui a partiellement « zouloufié » ces populations. Même ainsi, sa population était loin d'être homogène, ce n'était pas un État-nation précolonial. Mais d'autres entités politiques relevaient de populations bien plus homogènes. Pourquoi ne pas les appeler nations ?
Dans le centre du pays on avait un phénomène très différent, les prazos. Il s'agissait d'anciennes féodalités portugaises qui s'étaient largement africanisées sans se « retraditionnaliser ». Des chefs noirs ou goanais possédaient des terres au nom du roi du Portugal. Ces structures politiques se surimposèrent à des identités existant préalablement. Ces entités étaient des clans ou des lignages, parfois des identités très marquées, dans le nord du pays, notamment chez les Makonde et les Makua. Les Portugais occupant la totalité du territoire à la fin du 19e siècle n'ont pas transformé la population en « Portugais noirs », les gens naturellement ont continué d'être africains. Le Front de libération du Mozambique (Frelimo), prenant le pouvoir en 1975 après dix ans de lutte armée, a refusé de tenir compte de l'existence de nations africaines précoloniales, considérées en bloc comme « tribalisme », n'a pas promu leur culture et leur langue. Mais il n'a pas non plus réussi à être un État social pour les 80% de la population qui était rurale, qui aurait pu mener tous ces groupes à s'identifier au « Mozambique », ce nouvel espace territorial qui fait officiellement nation. À l'inverse, « Pour que la nation vive, la tribu doit mourir », telle fut la politique du Frelimo. L'emploi du mot tribu était fortement contestable et cette politique anti-ethnique eut des conséquences pratiques, comme des campagnes d'alphabétisation menées exclusivement en portugais – avec un taux d'échec gigantesque –, avec l'interdiction des chefs traditionnels, des rituels de la pluie, etc. Cela a été, selon moi, une espèce de tentative de « portugalisation » ou de « lusophonisation » du pays avec l'idée de l'Homme Nouveau, empruntant un jargon un peu maoïsant.
En France, il s'est passé un peu la même chose, avec une très forte répression ethnique ; Napoléon, puis Napoléon III, et surtout la Troisième République ont francisé la France : tout le monde se rappelle des écriteaux « il est interdit de cracher et de parler basque ou breton à la récréation ». Mais cet État français qui réprimait les ethnicités créait en même temps l'école publique obligatoire, des hôpitaux, des routes, des ponts, il apportait le progrès et il y eut ainsi une identification politique à l'État social français, et petit à petit cela devint une identification nationale. Cet échange entre progrès social et répression ethnique – je ne dis pas que ce fut bien – put fonctionner.
L'État capitaliste de la périphérie ou de l'ultra périphérie, comme le sont les États africains, n'est pas, sauf à de rares exceptions, un État social, c'est un État néocolonial, kleptocrate 1 qui opprime socialement, économiquement mais aussi ethniquement bien qu'il ait des pratiques ethno-clientéliste. Des ministres construisent la route qui va à leur village en détournant le budget de leur ministère, mais ce n'est pas du tout une politique de conjugaison des identités africaines pour construire une nation de nations.
Si l'on prend le cas de la Grande-Bretagne, elle n'est pas la fédération de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Ce n'est pas un État fédéral, il y a une supra-identité britannique. C'est une identité au singulier d'identités au pluriel. Un Écossais peut admettre qu'il est un Britannique, mais il ne lui plaira pas d'être confondu avec un Anglais. Les États africains n'ont pas suivi ce modèle de l'emboîtement des identités et ils ont opposé des nations africaines précoloniales à la nouvelle nation qui devait être une rupture au lieu d'être cette conjugaison coagulée par un État social.
Le système en Éthiopie tient compte, du moins officiellement, des différentes ethnies.
C'est presque une exception, et qui n'a pas fonctionné du tout. Dans ce pays, on a le fédéralisme identitaire. En principe, chaque nation constitutive dispose d'un territoire avec une province autonome, mais le pays est régi par une dictature et les autonomies n'ont jamais été respectées. Ce qu'il y avait de bien dans la Constitution n'a ainsi pas été matérialisé.
Je ne dis pas qu'il faut le fédéralisme partout au sein de chaque pays en Afrique. Le fédéralisme interne aux pays africains risque de mener à la définition de provinces mono-ethniques. Or en Afrique les provinces mono-ethniques sont très rares. Dans la région Makua, il y a aussi des Makonde, des Yao, un peuple majoritaire et des peuples minoritaires. La question n'est pas de faire du fédéralisme, il faudrait plutôt regarder du côté de la Bolivie d'Evo Morales qui en 2009 a proclamé la Constitution de l'État unitaire plurinational de Bolivie.
Le fait ethnique en Afrique n'est pas un ennemi pour nous, marxistes. C'est tout simplement quelque chose qui existe dans la société, qu'il faut se garder d'essentialiser. Ce sont des identités qui peuvent devenir ou non des nations mais parfois le mécontentement social va s'exprimer selon des alignements ethniques. En général, il n'y a jamais de guerre civile dont la caractéristique serait uniquement inter-ethnique. Par exemple dans le cas du Rwanda, les Hutu et les Tutsi ne sont pas deux ethnies. S'il faut leur donner un nom, ce sont plutôt des castes, deux regroupements ayant la même langue, les mêmes mythes d'origine, le même royaume, mais certains étaient considérés professionnellement comme des agriculteurs et d'autres comme des éleveurs. Tout le monde sera d'accord pour dire que la manipulation coloniale a porté ses fruits, mais ce ne fut pas une guerre ethnique.
Quand il y a un conflit ethnique, c'est souvent qu'il y a des problèmes sociaux. En ce moment, dans le nord du Mozambique, il y a une guérilla djihadiste. Un groupe qui existait préalablement comme secte religieuse s'est militarisé puis s'est affilié à l'État Islamique. Il recrute parmi le groupe côtier Mwani, et parmi les Makua – un grand groupe qui a été assez maltraité par les colonisateurs portugais puis par le Frelimo. Enfin, il y a à la frontière de la Tanzanie le groupe makonde. C'est là qu'a commencé la guerre de libération en 1964. Le groupe makonde, quoique minoritaire dans la région, a été extrêmement important dans la guerre de libération anticoloniale 2. Comme ses membres ont été des acteurs majeurs dans la guerre de libération, ils ont accaparé des rôles de direction importants. De généraux dans la guérilla, ils sont devenus ministres. Bien que très nettement minoritaires à l'échelle du pays (2 % de la population, et à peu près 10 % à l'échelle de la province-nord Cabo Delgado), ils ont accaparé la plupart des postes qui permettent de devenir riche. Aujourd'hui, il y a une expression ethnique du mécontentement social contre les Makonde de la part des Mwani ou des Makua, mais c'est en raison de l'inégalité provoquée par un pouvoir d'État accaparé par une ethnicité particulière en raison des circonstances historiques.
La difficulté en Afrique est qu'on est à la périphérie du capitalisme. Les États ne sont pas des États sociaux mais des États prébendiers, des États compradores, des États qui manipulent les clientélismes ethniques, qui souvent promeuvent une seule ethnicité. Au Sénégal, en ce moment, il y a une « ouolofisation » accentuée et les autres langues africaines sont en déclin et pourraient disparaître à l'avenir. Cela a provoqué une guérilla endémique en Casamance 3 et petit à petit il y pourra y avoir d'autres révoltes (pas forcément sous la même forme), surtout si le développement reste très inégal selon les régions du pays. Derrière tout cela, il y a toujours des conditions matérielles et sociales, ce n'est pas de l'économisme de dire cela : l'identité ne vient jamais seule, elle est l'expression de positionnements face à des changements ressentis comme agressifs ou inquiétants.
Je l'ai bien vu au Mozambique : à l'époque coloniale – donc jusqu'en 1975 – les anthropologues pouvaient repérer une grande zone dans le nord du Mozambique où les gens parlaient une famille de langue appelée makhuwa-lómwè. Après l'arrivée au pouvoir du Frelimo, la politique menée a profité principalement aux sudistes, à la capitale et aux grandes villes. Les gens se sentirent agressés par cet État de modernisation autoritaire, et la rébellion soutenue par l'Afrique du Sud allait prendre beaucoup de poids dans ces zones-là. Les gens ont alors commencé à se dire Makua en réaction. Ils le ressentaient vraiment, et cela n'avance en rien de dire qu'il s'agissait d'une « fausse conscience ».
Comment traiter à la fois les problèmes d'ethnicité et les problèmes sociaux quand les questions d'ethnicité sont totalement manipulées et recouvrent l'ensemble des sujets sociaux ? Certains groupes trotskistes nigérians sous-estiment la question de l'ethnicité, me semble-t-il.
Il y a des entrepreneurs politiques qui manipulent ouvertement l'identité, et pas forcément des identités ethniques. Ils peuvent manipuler des identités noires dans un pays où il y a des métis. On peut manipuler n'importe quoi si cette chose existe. En revanche, il est clair que les problèmes sociaux ont des effets ethniques. Je donnais ainsi tout à l'heure l'exemple du nord du Mozambique, où la guérilla djihadiste n'a pas de mal à recruter de jeunes garçons contre le pouvoir du Frelimo. Même si cela ne concerne naturellement pas toute la population makonde, celle-ci, bien que minoritaire dans la province, a un meilleur accès à la rente de l'État. Cette question d'inégalité socio-économique s'exprime alors de manière ethnique : les Mwani disent « nous, on n'a rien, les Makone mangent tout ». Ce n'est pas une manipulation ethnique, c'est l'expression ethnique d'une inégalité sociale.
Cela me rappelle le fameux débat que Trotsky eut avec ses rares partisans, déjà exclus du Parti communiste, en Afrique du Sud. Le PC et la IIIe Internationale déjà stalinisés défendaient le slogan de République noire et les jeunes trotskistes d'Afrique du Sud étaient pour une république sans couleur, si ce n'est rouge. Il s'agissait de leur part d'un universalisme bien abstrait parce que la règle de la majorité signifiait une république noire. Cela ne voulait pas dire que les Blancs devaient partir, mais qu'ils devaient perdre leurs privilèges de Blancs et Trotsky avait défendu le slogan de République noire.
Nous marxistes, devons comprendre ce que signifie l'expression fameuse « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes ». Elle ne signifie pas qu'il n'y a que la lutte des classes, que la conscience de classe. Une personne peut être blanche, noire ou métisse, elle peut être homme ou femme, elle peut être de gauche ou de droite, elle peut aimer le cidre ou la bière, elle peut préférer le rugby au football, elle peut avoir des tas d'identités, et le seul endroit où toutes les identités se mélangent c'est en elle-même, dans l'individu, le seul endroit indivisible sous peine de mourir. À un moment donné ce n'est pas nécessairement la question de classe qui va être la plus importante pour la mise en mouvement de cette personne : cela peut être le fait d'être musulmane, parce que la mosquée a été incendiée par des racistes, qui la met en mouvement, non pas en tant que prolétaire de religion musulmane mais en tant que personne musulmane tout court.
Ces camarades nigérian·es font des efforts pour dépasser les divisions mais c'est d'autant plus abstrait que précisément, dans l'histoire du Nigeria, la limite entre la zone musulmane et la zone animiste – plus christianisée parce que les missions chrétiennes n'ont réussi qu'en terre non musulmane –, correspond à l'ancien émirat de Sokoto, le grand État précolonial africain. Ces divisions n'ont pas été inventées par le colonisateur, elles sont historiquement produites. Le Nigeria est une construction artificielle comme beaucoup d'États postcoloniaux mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas fonctionner : si c'était un État social et hautement respectueux des différentes identités ethniques historiquement produites sur le territoire du Nigeria actuel. Le Nigeria justement est un État fédéral mais cela ne signifie pas en soi un meilleur respect social, économique et culturel pour les populations, du fait de l'existence de l'État capitaliste de la périphérie et de la catastrophe pétrolière.
La « révolution » de 1959 au Rwanda, où le pouvoir absolu de l'élite tutsi a été mis à bas, au lieu de prendre une trajectoire sociale, a au contraire pris une trajectoire ethniciste avec les conséquences dramatiques que l'on connaît.
Une mobilisation sociale peut s'exprimer selon une polarisation ethnique (plutôt castiste à mon avis dans ce cas) parce que ce sont les lignes d'entendement les plus disponibles pour les gens. Ce sentiment ethnique/castiste prend ensuite son autonomie : même si le problème social d'où il vient est résolu, la question ethnique ne pas disparait pas comme par enchantement. Si une identité est massivement ressentie, le problème social qui l'a nourrie peut disparaître, cela peut éviter des massacres, mais cela n'évitera pas la perpétuation de cette identité sur plusieurs générations et la démocratie politique devrait en tenir compte.
Le cas de la Somalie est intéressant car c'est un État-nation ethniquement homogène, mais dont deux régions demandent leur indépendance, le Somaliland et Puntland.
En effet, il n'y a pas que la question ethnique, il existe en Somalie ce qui est appelé « clans » qui correspondent à ce que l'on appellerait des tribus dans le monde arabe, par exemple. Ce sont des structures politiques, en général pas des identités ethniques. Mais il ne faut pas avoir de l'ethnicité une vision statique. Des gens pouvaient se sentir somaliens auparavant et ne plus se sentir somaliens demain. Le Somaliland réclame son indépendance, et de fait l'a obtenue. C'est un État qui n'est reconnu par personne mais c'est la partie de la Somalie qui fonctionne le mieux ! Il y a même eu des élections qui ont été surveillées par des observateurs internationaux. La domination coloniale a eu aussi des effets identitaires. Je reprends mon exemple du nord du Mozambique avec les Makonde, ce groupe qui a été si important dans la lutte anticoloniale et qui a accaparé les postes de pouvoir. Il y a des Makonde des deux côtés de la frontière : au nord du fleuve Rovuma, on est en Tanzanie et au sud au Mozambique. 120 ans de colonisation, anglaise d'un côté, et portugaise de l'autre, ont eu des effets identitaires. Aujourd'hui, même s'ils reconnaissent que ce sont des cousins, les Makonde du sud savent très bien qu'ils ne sont plus tout à fait identiques aux Makonde du nord.
En Somalie, les ethnologues ont beau parler d'un seul pays, cela n'empêchera pas des contradictions internes qui font que certaines régions vont demander leur indépendance. Mais cette recherche d'indépendance n'est pas nécessairement ethno-nationale, elle peut être motivée par l'absence de fonctionnement de l'État, qui n'est pas démocratique, qui n'apporte pas de progrès social ou qui a été accaparé par un clan alors qu'il y en a une bonne quinzaine, etc.
La Somalie montre deux choses. Premièrement, ce n'est pas parce qu'on a une identité, une homogénéité ethnique, que tout se passera bien, parce qu'il y a d'autres problèmes. Deuxièmement, l'identité change selon des trajectoires qui peuvent provoquer des disparités au sein de la population. L'identité n'est qu'une communauté de gens qui ressentent telle chose à un moment de la trajectoire identitaire.
Et concernant les tribus et les clans ?
On peut parfaitement employer le mot tribu sans paternalisme colonial. Une tribu est l'organisation politique d'une fraction de la population, avec une chefferie, des chefs délégués dans différentes régions. Il y en a dans le monde arabo-berbère, en Somalie (sous le nom de clans).
Au Mozambique par exemple, il y a de nombreuses ethnicités mais il n'y a pas de tribus parce qu'elles ont été brisées par le colonisateur portugais. Contrairement aux Anglais, les Portugais ont pratiqué l'administration directe, ils n'ont pas remis en selle les chefs traditionnels puissants mais vaincus, désormais dociles et gestionnaires locaux de l'État impérial européen.
Le clan est une organisation imaginaire (en tout cas dans les territoires que je connais). Une certaine catégorie de la population, sur la base de mythes animaliers, dit qu'elle descend de la tortue, ou du singe. Il ne faut pas oublier que le mot « Bantou », avant de désigner une famille de civilisations africaines, voulait simplement « être humain » (opposé au règne animal). Ces origines animales mythiques impliquent des tabous alimentaires, par exemple ne pas manger de tortue si on descend de la tortue.
Les lignages sont l'organisation de la parenté – patrilinéaire si la descendance se fait par le père, et matrilinéaire par la mère. Dans ce dernier cas, cela ne désigne pas un pouvoir matriarcal mais une organisation sociale dans laquelle ce n'est pas le mari de la femme qui a le pouvoir mais le frère de la femme. Le lignage est défini par la mère, un peu comme dans le judaïsme classique.
Peut-être un mot de conclusion ?
Pour nous marxistes, il est grand temps de réfléchir pour intégrer l'ethnicité à la démocratie politique. Certes, il n'y a pas que les luttes pour la démocratie, il y a aussi des luttes sociales, les luttes de classes bien sûr, mais ces dernières ont besoin de démocratie et la démocratie politique a besoin qu'on y intègre l'ethnicité plutôt que de la combattre. Il ne s'agit pas de défendre la tradition, telle n'est pas la question. Si des choses sont bien dans la tradition, on les défend, et si des choses y sont mauvaises on les combat. Mais attention de ne pas désigner de faux coupables : par exemple l'excision féminine ne vient pas de l'islam, cela existait bien avant. Et on ne peut lutter contre cette « tradition » qu'avec les gens, pas contre eux.
Derrière le droit à l'identité, il y a le droit à l'égalité. J'ai le droit d'être Yoruba, d'être Makua ou autre, j'ai le droit qu'à l'école mes enfants soient alphabétisés dans cette langue, que le territoire de ma province soit dessiné selon les endroits où les gens qui parlent comme moi sont majoritaires, j'ai le droit que l'État soit localement bilingue. L'État peut être de langue anglaise, swahili ou portugaise mais il doit y avoir un bilinguisme officiel. Les fonctionnaires nommé·es ne doivent pas forcément être de l'ethnicité du lieu mais doivent savoir en parler la langue pour un service public respectueux des gens.
Pour les marxistes, je pense que c'est un enjeu très important en raison de l'évolution socio-économique de l'Afrique. Cette dernière connaît actuellement une urbanisation galopante sans prolétarisation. Les gens qui n'arrivent plus à vivre à la campagne viennent en ville mais n'arrivent généralement pas à entrer dans le mode de production capitaliste. Ils n'arrivent pas à devenir ouvrier·e·, salarié·es. Pour devenir fonctionnaires, il faut des accointances ethno-clientélistes… Ces personnes ont alors besoin, pour leur survie sociale, de sauvegarder des liens de solidarité horizontale comme l'ethnicité. Ce n'est que plus tard peut-être, qu'ils ressentiront les liens de solidarité verticale, c'est-à-dire classe contre classe, prolétariat contre bourgeoisie. Mais l'immense majorité des pauvres en Afrique ne relèvent pas du prolétariat.
En effet, le prolétariat est loin d'y être majoritaire (ni n'est nécessairement le milieu social le plus misérable), face à la plèbe urbaine. La plèbe n'est pas une classe, c'est une formation sociale instable de gens parfaitement inutiles pour le capitalisme puisqu'ils représentent à peine un marché 4. Ils peuvent mourir du sida, du Covid ou dans une guerre civile, ce n'est pas un problème pour le capitalisme. Mais ce sont des gens que les marxistes doivent défendre. Souvent, la question principale en Afrique n'est pas prolétarienne mais plébéienne et il n'est pas facile de définir des revendications transitoires pour ce genre de population. Nous n'avons pas de réelle tradition politique pour défendre ces gens mais il faudra qu'on l'invente. Les actuelles évolutions politiques en Afrique occidentale, par exemple (le raz-de-marée électoral du PASTEF aux élections sénégalaises de 2024, les coups d'État « anti-français » au Mali, au Burkina, au Niger avec, au début, un indéniable appui populaire, etc.) sont l'expression indirecte de la plébéiennisation de la population, de surcroît extrêmement jeune. n
Le 18 août 2024
Notes
1. Une kleptocratie est un terme désignant un système politique au sein duquel une ou plusieurs personnes, à la tête d'un pays, pratiquent à une très grande échelle la corruption, souvent avec des proches et membres de leur famille.
2. Je ne l'appelle pas personnellement nationale mais anticoloniale, puisqu'il n'y avait pas à proprement parler de nation pré-existant à la guerre de libération.
3. La Casamance, parfois appelée casa-di-mansa (« la terre des rois »), est une région historique et naturelle du Sénégal, située au sud du pays et bordant le fleuve Casamance.
4. Je ne confonds pas la plèbe et lce qu'on appelle « secteur informel ». Le secteur informel est une classification qui recouvre une large partie de la population dont l'activité économique n'est pas « légalisée » dans un cadre juridico-légal. Ce secteur informel recouvre diverses classes et formations sociales (prolétariat de petites entreprises elles-mêmes informelles, plèbe, milieux artisanaux, petits et moyens commerçants…). Je désigne par plèbe la population principalement urbaine qui ne fait plus partie du mode de production domestique de la campagne mais ne peut s'intégrer au mode de production capitaliste du fait du caractère périphérique du capitalisme dans ces pays.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Unifier une classe ouvrière divisée

Plus de vingt ans après la signature de l'accord du Vendredi saint, la « question nationale » en Irlande occupe à nouveau le devant de la scène. Cela est dû à plusieurs facteurs se combinant : les évolutions démographiques dans le Nord, le Brexit, ainsi que la montée du Sinn Féin dans le Sud.
24 novembre 2024 | tiré d'inprecor.org | Photo : Des habitants cherchent des objets de valeur dans les décombres de Dublin, en Irlande, après l'insurrection de Pâques irlandaise, du 24 au 30 avril 1916. Domaine public.
https://inprecor.fr/node/4445
La question nationale pose d'innombrables questions aux socialistes qui luttent pour unir la classe ouvrière, au Nord comme au Sud, et mettre fin au système capitaliste. Nous sommes aujourd'hui confrontés aux effets, 100 ans après, du « carnival of reaction » 1 pressenti par James Connolly à la suite de la partition de l'Irlande par l'impérialisme britannique.
Depuis le lancement de RISE, nous avons débattu de la position que le mouvement socialiste devrait défendre et de la manière dont nous devrions proposer une réponse socialiste à la question nationale en Irlande. Cet article contient certaines des conclusions de cette discussion, en particulier en ce qui concerne la manière dont les socialistes devraient répondre au sondage sur les frontières*.
Une brève histoire de l'oppression nationale
La question nationale est le terme employé par les marxistes pour aborder un problème d'oppression nationale non résolu. Par exemple, il existe de multiples questions nationales dans l'État espagnol, notamment l'oppression des peuples basque et catalan. Reconnaître l'existence d'une question nationale n'est cependant pas la même chose qu'identifier précisément quel est le problème. Chaque question nationale possède ses propres caractéristiques.
La plupart des théories marxistes sur l'impérialisme traitaient principalement des empires coloniaux qui étaient à leur apogée au 19e et au début du 20e siècle. D'autres écrits sur la question nationale traitaient principalement des pays européens qui avaient été incorporés dans des États plus vastes à travers diverses structures politiques dynastiques féodales. La question nationale irlandaise, telle qu'elle s'est développée au fil des siècles, présentait des caractéristiques de ces deux types 2.
La première incursion « britannique » (bien qu'en réalité antérieure au concept de Grande-Bretagne) fut l'invasion anglo-normande de 1169, destinée à empêcher que l'Irlande ne serve de base pour fomenter une rébellion contre la monarchie féodale. Au cours des siècles suivants, bien que le contrôle territorial ait été maintenu sur le « Pale » (la région comprenant Dublin et ses environs), les Normands se sont largement assimilés à la culture gaélique dans le reste de l'île. Vint ensuite la conquête des Tudor et des Stuart, qui parvint à rétablir le contrôle direct de toute l'Irlande au début du 17e siècle. Dans le cadre de cette conquête, une politique brutale de « défrichement et de plantation » a été mise en place : les terres ont été confisquées aux chefs irlandais et vendues aux enchères à des propriétaires terriens anglais. La Plantation de l'Ulster a été la plus importante et la plus achevée, elle visait à établir une population fiable et loyale parmi des colons protestants principalement écossais.
Lorsque la monarchie et l'Église catholique, qui était au cœur de la réaction féodale, ont été vaincues lors de la révolution anglaise 3, l'Angleterre est devenue une économie essentiellement capitaliste. Oliver Cromwell a fondé et dirigé la New Model Army, qui a joué un rôle décisif dans la défaite des royalistes. En 1649, il entreprend une nouvelle conquête brutale de l'Irlande, largement contrôlée par la Fédération catholique irlandaise, qui s'était alliée aux royalistes. La classe des propriétaires terriens catholiques fut dépossédée et la population catholique fit l'objet d'une discrimination systématique. En 1775, alors que les catholiques représentaient les deux tiers de la population, ils n'avaient plus que 5 % des terres. Christopher Hill a décrit la conquête cromwellienne comme « le premier grand triomphe de l'impérialisme anglais et la première grande défaite de la démocratie anglaise »4
L'Irlande s'est alors développée comme une colonie spécifique d'une Grande-Bretagne capitaliste, fonctionnant comme une partie arriérée du Royaume-Uni, devenant le « grenier de la Grande-Bretagne », avec d'importantes exportations de céréales. Celles-ci se sont poursuivies même pendant la Grande Famine de 1845 à 1849, qui a fait plus d'un million de victimes. Comme l'a dit James Connolly, « toutes ces personnes ont été sacrifiées sur l'autel de la pensée capitaliste » 5. Le nord-est de l'Irlande, qui a connu un véritable développement industriel, en particulier autour de Belfast, constitue une exception notable à ce sous-développement.
Inspiré·es par les révolutions américaine et française, et avec l'aide matérielle de cette dernière, les Irlandais·es se sont soulevé·es à plusieurs reprises pour tenter de mettre fin à la domination coloniale (et à leur oppression). La rébellion de 1798 des United Irishmen, qui a réussi à unir catholiques et protestants sous la direction de Wolfe Tone, a été la plus proche de la réussite.
Confrontée à ce qui aurait pu être une défaite, la stratégie britannique s'est orientée vers l'unification des anglicans et des presbytériens au sein d'un bloc protestant commun, puis vers la création consciente de divisions entre protestants et catholiques afin d'empêcher la réapparition d'un tel mouvement uni. L'Acte d'Union de 1801, qui continuait d'interdire aux catholiques l'accès aux fonctions publiques et excluait l'« émancipation des catholiques », en est l'illustration. Cela n'a pas empêché des tentatives répétées de soulèvement tout au long du 19e siècle, puis lors de l'insurrection de Pâques en 1916. Alors que les demandes de « Home Rule » (une forme de dévolution du pouvoir) se multipliaient, les conservateurs en particulier décidèrent que « la carte Orange serait celle à jouer », selon les termes de Lord Randolph Churchill 6.
Au lendemain de la révolution russe, l'impérialisme britannique est confronté à un mouvement révolutionnaire irlandais qui ne se contente pas de mettre sur la table la possibilité d'une libération nationale, mais qui met également à l'ordre du jour les rapports de classe. Le développement du militantisme ouvrier, les occupations de lieux de travail et de terres ainsi que des événements tels que la grève générale contre la conscription en 1918 et le soviet de Limerick en 1919 ont semé l'effroi au sein du gouvernement britannique. L'incapacité du mouvement ouvrier à contester l'hégémonie des nationalistes issus de la classe moyenne du Sinn Féin, et l'idée largement partagée que « le travail doit attendre » ont malheureusement conduit à ce que le potentiel de cette période n'ait pas été atteint.
En réponse à cette menace, l'impérialisme britannique, tout en tentant de vaincre militairement et de réprimer les mouvements auxquels il était confronté, a poursuivi la stratégie du « diviser pour mieux régner » de manière toujours plus cynique. Il a entrepris de diviser l'Irlande en 1920 et a insisté sur cette partition dans le traité anglo-irlandais de 1921. Cette période de révolution irlandaise s'est achevée en 1922 par une contre-révolution qui a vu la création de l'« État libre », une société réactionnaire dominée par l'Église catholique, où les républicains et les socialistes opposés au traité ont été exécutés sans procès, où la littérature subversive a été interdite et où les femmes ont été exclues de toute participation à la vie publique. Au nord de la frontière, la discrimination ouverte et l'oppression de la minorité catholique étaient la norme, avec une Royal Ulster Constabulary (RUC, Police royale de l'Ulster) sectaire, ainsi que des groupes paramilitaires loyalistes, et le gerrymandering, un découpage des circonscriptions électorales visant à minimiser la représentation catholique.
Dans le Sud, une classe capitaliste faible et ses représentants politiques ont continué à s'appuyer sur l'autorité de l'Église catholique, tout en agissant pour faciliter l'exploitation des populations et des ressources par des capitaux étrangers, d'abord britanniques, puis américains et européens. Dans le Nord, la discrimination systématique s'est poursuivie, le logement s'avérant l'élément clé qui a déclenché le mouvement des droits civiques dans les années 1960.
Toute possibilité d'un mouvement de classe uni pour les droits civils et économiques a été rejetée par les dirigeants nationalistes conservateurs, qui ont fait le choix de l'« unité anti-Unioniste » (c'est-à-dire l'unité catholique) plutôt que celui de l'unité de classe. Lorsque les manifestations pour les droits civiques ont été violemment attaquées par des gangs loyalistes, protégés par la RUC, et que des manifestant·es pacifiques ont été abattu·es par des parachutistes britanniques lors du Bloody Sunday, une partie importante de la jeunesse catholique, lassée de l'oppression et sans mouvement socialiste de classe conséquent à sa disposition, s'est tournée vers la lutte armée et vers l'IRA Provisoire. Il était compréhensible que les jeunes catholiques veuillent riposter à la situation à laquelle ils étaient confrontés. Cependant, la campagne de l'IRA a toujours été une impasse. Bien qu'elle soit fondamentalement différente des campagnes ouvertement sectaires des paramilitaires loyalistes, elle n'a pas pu vaincre militairement l'État britannique et a eu pour effet d'aggraver les divisions sectaires.
L'accord du Vendredi saint (accord de Belfast de 1998, NDLR), qui a mis fin aux Troubles, n'a pas résolu la question nationale ni mis fin à la profonde division de la société du Nord. L'accord de partage du pouvoir n'a fait que masquer le fossé historique entre les communautés, tout en institutionnalisant le sectarisme au sommet.
Les principaux partis politiques des deux côtés du fossé se sont unis pour mettre en œuvre des politiques néolibérales de réduction des dépenses et de privatisation, tout en se présentant comme les meilleurs représentants des intérêts de « leur » communauté pour se faire réélire.
Quelle est la nature de la question nationale aujourd'hui ?
Sans les actions de l'impérialisme britannique durant des siècles, il n'y aurait pas de question nationale en Irlande. En particulier, la partition de l'Irlande est responsable de la forme spécifique que prend la question nationale aujourd'hui. Cependant, l'une des conséquences des actions de l'impérialisme britannique est aujourd'hui l'existence de deux communautés distinctes dans le Nord avec des aspirations nationales conflictuelles.
Les catholiques ont été historiquement constamment discriminés au sein de l'État du Nord par les politiciens unionistes de droite et par un État britannique heureux de pouvoir compter sur le soutien d'une majorité protestante. Bien que la discrimination économique active appartienne désormais en grande partie au passé, des résidus subsistent. Même si les vestiges des discriminations en matière d'emploi ou de logement disparaissaient, les catholiques resteraient certainement opprimés au niveau national, car leur souhait d'être dans un pays qui correspond à leur identité nationale est entravé et ils sont emprisonnés dans un État du Nord auquel ils ne s'identifient pas.
En raison de l'exclusion des catholiques d'une grande partie de l'industrie, ce sont les protestants qui, historiquement, ont occupé la grande majorité des emplois qualifiés et syndiqués. Cet accès préférentiel aux emplois qualifiés et, dans le domaine de la reproduction sociale, au logement, a constitué une partie de la base historique du bloc politique unioniste. Cependant, les théories qui traitent les protestants comme une « aristocratie ouvrière » super-privilégiée ou, pire encore, comme des « colons » équivalents aux Sud-Africains blancs, ne reposent sur aucun fait concret. La classe ouvrière protestante, même si les catholiques subissaient une discrimination directe en termes de logement et d'emploi, souffrait également de taux de pauvreté et de privation parmi les plus élevés du Royaume-Uni, comme en témoigne à Belfast la misère régnant autant dans Shankill Road que dans Falls Road 7.
Ce n'est pas l'avantage économique seul qui a permis de lier une partie des travailleurs à l'État britannique, c'est l'idéologie unioniste. Cependant, la stratégie du « diviser pour mieux régner » du capitalisme et de l'État britannique s'est effondrée à des moments cruciaux, lorsque de puissantes luttes conjointes de travailleur·ses catholiques et protestants ont surmonté la division, comme lors de la grève des ingénieurs de Belfast en 1919 et lors du mouvement de lutte contre le chômage dans les années 1930. Il existe de nombreux exemples contemporains, même s'ils sont plus modestes, d'une telle lutte commune, comme la puissante grève du secteur public en 2015. Ils démontrent le pouvoir de la lutte unie de la classe ouvrière et la possibilité de la redévelopper, en dépassant les divisions sectaires dont dépendent la classe dirigeante et les partis de l'establishment.
Cependant, en dépit de ces luttes, la persistance des divisions et leur capacité à être exploitées par une classe capitaliste cynique et impitoyable sont évidentes. La grève de 1919, qui comportait des éléments importants d'une grève générale, a été suivie d'une période de pogroms anticatholiques en 1920, sciemment attisés par des employeurs désireux d'éviter une répétition de la grève de 1919. Jusqu'à 7 000 catholiques et 3 000 rotten Prods (socialistes et syndicalistes protestants) ont été expulsés des lieux de travail.
Approches socialistes de la question nationale
Pour déterminer comment aborder cette division, il convient d'étudier les contributions des marxistes sur la manière de répondre à la question nationale. Bien que Marx et Engels aient énoncé un principe internationaliste clair avec leur message vibrant selon lequel « les travailleurs n'ont pas de patrie » 8et qu'ils aient même anticipé les innovations programmatiques ultérieures de Lénine en soutenant l'indépendance de l'Irlande et de la Pologne, ils n'ont pas réussi à définir une approche globale. Engels, en particulier, a introduit un concept confus et non matérialiste de « nations sans histoire ».
Il n'est donc pas surprenant que cette question complexe ait fait l'objet de débats animés au sein du mouvement socialiste après leur mort. Au sein de la Deuxième Internationale, la droite prônait une forme de « colonialisme socialiste », avec une argumentation horriblement raciste illustrée par l'argument d'Eduard Bernstein au congrès de Stuttgart de 1907, selon lequel « les socialistes devraient eux aussi reconnaître la nécessité pour les peuples civilisés d'agir en quelque sorte comme les gardiens des non-civilisés » 9.
Bien que la motion de la droite ait été rejetée au congrès de Stuttgart par un bloc du centre et de la gauche, le fait qu'elle n'ait été rejetée que de justesse, par 127 voix contre 108, illustre à la fois l'opportunisme déjà présent au sein de la social-démocratie et le manque de clarté quant à la manière d'aborder cette question. Même parmi ceux qui s'opposaient clairement au colonialisme, il y avait souvent une approche aveugle à l'oppression. Eugene Debs l'a bien illustré en parlant de l'oppression raciale, quand il écrivit : « Nous n'avons rien de spécial à offrir aux Nègres et nous ne pouvons pas lancer d'appel pour toutes les races. Le parti socialiste est le parti de la classe ouvrière, quelle que soit sa couleur – l'ensemble de la classe ouvrière du monde entier ». 10
En revanche, Lénine a insisté sur le fait que le mouvement marxiste devait avoir quelque chose de « spécial » à offrir aux Noirs des États-Unis et aux nationalités opprimées du monde entier. Ce quelque chose de « spécial » n'est rien d'autre qu'un engagement ferme à mettre fin à leur oppression spécifique (sous toutes ses formes, indépendamment des classes sociales), qui est au-delà de l'exploitation et de l'oppression, inhérentes au capitalisme, de tous les membres de la classe ouvrière.
Il reconnaissait que l'unité de la classe ouvrière ne pouvait être construite en ignorant ou en minimisant les formes d'oppression qui affectent des groupes spécifiques plutôt que l'ensemble des travailleur·ses. Ignorer l'oppression ne la fait pas disparaître, ni la division qu'elle provoque, mais permet au contraire à l'oppression d'exister et de se reproduire au sein du mouvement ouvrier. Au contraire, il a défendu l'idée d'une unité basée sur une opposition explicite à l'oppression et sur l'engagement à y mettre fin.
C'est à partir de cette analyse que la défense du droit à l'autodétermination s'est imposée. Il s'agissait d'un outil permettant à la classe ouvrière de la nation oppressive de démontrer qu'elle n'avait aucun intérêt à ce que l'oppression se poursuive et de contribuer à la construction d'une lutte unie de la classe ouvrière. Elle a également permis aux révolutionnaires d'une nation opprimée d'engager la lutte contre l'impérialisme, tout en cherchant à établir un lien entre la lutte contre l'oppression et la nécessité d'un changement socialiste.
Les bolcheviks ont clairement indiqué que les peuples de Géorgie, de Pologne, d'Ukraine, de Finlande et de toutes les autres nations historiquement opprimées par la Russie tsariste avaient le droit de déterminer leur propre avenir, y compris jusqu'au droit à l'indépendance. Dans le contexte d'un empire tsariste composé de multiples nationalités, avec une majorité de non-Russes, cet aspect était crucial dans la lutte pour gagner le soutien des masses. Comme le dit Trotsky dans son Histoire de la Révolution Russe, « c'est seulement par cette voie que le prolétariat russe put graduellement conquérir la confiance des nationalités opprimées » 11.
Appliquer la méthode de Lénine à l'Irlande
Il s'agit d'une véritable innovation dans la manière dont les socialistes doivent appréhender les oppressions nationales (et les autres oppressions) et cela éclaire l'approche que nous cherchons à adopter aujourd'hui. Toutefois, le slogan du « droit à l'autodétermination » ne peut pas être simplement appliqué à n'importe quelle situation et constituer une réponse générique. Dans le contexte irlandais, qui a précisément droit à l'autodétermination ? Le peuple irlandais dans son ensemble ? Les catholiques du Nord, les protestants ou les deux ? Comment cette autodétermination peut-elle être exercée ?
En tentant d'aborder la question nationale en Irlande par ce biais, la gauche s'est engagée dans une impasse analytique due à une pensée schématique basée sur comment déterminer quel groupe de personnes répond à la définition d'une « nation ». Ils auraient pu commencer par une liste de critères comme celle, tristement célèbre, établie par Staline – un homme qui allait déporter des nationalités opprimées entières – dans Le marxisme et la question nationale : « une communauté stable, historiquement constituée, de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychique [quoi que cela signifie !], qui se traduit dans la communauté de culture ». 12En utilisant cette liste, les marxistes auraient pu alors décider si un groupe spécifique de personnes peut être ou non qualifié de nation…
Dans le contexte irlandais, qui a précisément droit à l'autodétermination ?
Cette approche mécanique ne nous aide pas vraiment à comprendre l'oppression nationale telle qu'elle existe dans le monde auquel nous sommes réellement confrontés, plutôt que dans des conditions imaginaires de laboratoire. Par exemple, le peuple Kurde ne serait pas considéré comme une nation selon la définition de Staline, car il n'a pas de « vie économique commune ». Pourtant, pour la plupart des marxistes, il semble évident que les Kurdes constituent une nation ayant le droit à l'autodétermination.
Au lieu de répéter ces erreurs, nous devrions utiliser la méthode fondamentale qui sous-tend le concept de « droit à l'autodétermination », plutôt que la formule elle-même. En d'autres termes, il s'agit de trouver un moyen d'unir la classe ouvrière, malgré ses divisions réelles, et de lui indiquer une voie à suivre pour prendre le pouvoir, afin qu'elle puisse résoudre la question nationale. Cela signifie analyser les réalités politiques existantes et s'y référer, plutôt que de s'engager dans une argumentation historique sur la question de savoir qui constitue une nation ou non. Comme l'a dit Trotsky à propos de l'oppression des Noirs aux États-Unis, « Un critère abstrait ne tranche pas cette question, mais beaucoup plus décisifs sont la conscience historique d'un groupe, ses sentiments et ses volontés » 13.
Les nations ne sont pas des catégories anhistoriques immuables, mais des groupes qui se composent, se décomposent et se recomposent en permanence. La composition même de ce qui est généralement considéré comme la nation irlandaise en est la preuve, avec les vagues de colons s'intégrant au fil du temps dans ce qui est devenu la nation irlandaise.
La grande majorité des protestant·es du Nord ne s'identifient pas comme faisant partie de la nation irlandaise ; seuls une infime minorité d'entre eux s'identifient comme Irlandais selon diverses enquêtes. Bien qu'ils ne constituent pas une nation à part entière, ils forment une communauté distincte, avec des aspirations nationales différentes de celles des habitant·es du Sud et des catholiques du Nord. Les catholiques du Nord ne constituent pas une nation autonome, mais font partie de la nation irlandaise, incluant la grande majorité des habitant·es du Sud.
Une autre réalité politique est que, compte tenu des données géographiques et démographiques du Nord, l'exercice du droit à l'autodétermination des protestants ou des catholiques signifierait le refus de l'autodétermination à l'autre. Les deux communautés sont interpénétrées dans le nord-est de l'Irlande de telle sorte qu'il n'y a pas de redécoupage possible qui n'emprisonnerait pas d'importantes minorités dans un État auquel elles ne s'identifient pas.
Le capitalisme peut-il résoudre la question nationale en Irlande ?
C'est précisément parce que la question nationale en Irlande implique l'existence de deux communautés distinctes dans le Nord qu'elle est insoluble. S'il s'agissait simplement de la présence de l'armée britannique dans le Nord, elle pourrait être résolue relativement facilement par son retrait. Mais ce n'est pas le cas. Le résultat d'un siècle de partition et de division dans l'intérêt du capital signifie que ces communautés et identités distinctes ont une existence réelle qui ne peut être activée ou désactivée selon les besoins de l'impérialisme britannique.
Cependant, il ne s'ensuit pas, comme certains le prétendent, que la forme sous laquelle la question nationale est posée ne peut être modifiée au sein du capitalisme. En effet, la forme des différentes questions nationales dans le monde a changé à plusieurs reprises. Nous vivons dans une époque de changements considérables, mais avec une classe ouvrière affaiblie en termes de conscience de classe, d'organisation de masse et de direction, et donc souvent incapable d'imprimer sa marque sur les événements de manière décisive.
De nombreux résultats sont possibles dans le cadre du capitalisme. Nous ne devons pas sous-estimer le potentiel d'une réaction violente d'une partie de la population protestante contre la réunification de l'Irlande, la reprise d'un conflit sectaire important et même la possibilité de déboucher sur une guerre civile. Ce n'est pas la seule variante, cependant, et des alternatives où la pression de la classe ouvrière ainsi que les intérêts des États capitalistes impliqués sont suffisants pour éviter une telle guerre civile, sans être suffisants pour poser la question d'une révolution ouvrière, sont également possibles.
Dans ces situations, une Irlande unie sur une base capitaliste peut devenir une possibilité. Des solutions intermédiaires, telles que l'autorité conjointe des gouvernements irlandais et britannique pour une période déterminée, peuvent également exister. Au lieu d'être normatifs sur ce qui peut théoriquement se produire dans le cadre du capitalisme, nous devrions être ouverts à diverses possibilités.
Cependant, aucune de ces « solutions » dans le cadre du capitalisme ne fera disparaître la question nationale. Il y aurait probablement de la discrimination ou au moins une dynamique de concurrence des communautés sur l'allocation de ressources rares (logement et services publics par exemple) au niveau du conseil local ou de l'assemblée décentralisée. En tout état de cause, même sans discrimination directe, l'identité communautaire ne s'efface pas ou ne s'oublie pas rapidement. Les protestant·es constitueraient une communauté nettement minoritaire dans un État auquel ils ne s'identifient pas.
La classe ouvrière pourrait résoudre la question nationale
Ce n'est pas un vœu pieux de considérer que, si la classe ouvrière était aux commandes, les choses seraient différentes. En contrôlant fermement les ressources, avec la participation démocratique des travailleur·ses de toutes les communautés, une société socialiste poserait les bases d'un recul des conflits nationaux au fil du temps, grâce à deux facteurs cruciaux.
Premièrement, en garantissant à chacun l'accès à un niveau de vie décent, avec des emplois, des logements et des services publics de qualité, elle éliminerait en grande partie les conflits, entre les différentes couches de la classe ouvrière, liés à l'insuffisance des ressources. Ces conflits, et la volonté de la classe capitaliste au pouvoir de les exploiter, sont un facteur crucial dans l'exacerbation des conflits nationaux.
Deuxièmement, en partant de la reconnaissance des droits des minorités nationales, y compris le droit à l'autodétermination, et en luttant pour l'unité de la classe ouvrière, la classe ouvrière au pouvoir serait en mesure de satisfaire des droits et des aspirations actuellement contradictoires. La Yougoslavie, bien qu'illustrant les possibilités de génocide lorsque les questions nationales explosent, donne également un exemple de la façon dont un État ouvrier (même déformé par le stalinisme) peut réduire les conflits nationaux. Sous Tito, grâce à la croissance économique et à l'autonomie des nations qui composaient la Yougoslavie, la question nationale a été atténuée. Bien entendu, la réapparition de la question nationale en Yougoslavie, avec l'éclatement sanglant de cet État, prouve que ces questions n'ont pas été « résolues » sous le stalinisme, elles ont simplement été limitées pendant un certain temps.
Il existe de nombreuses voies que la classe ouvrière au pouvoir pourrait mettre en œuvre pour atténuer et finalement résoudre la question nationale en Irlande. La plus simple et la plus facile de ces solutions est la constitution d'un État socialiste en Irlande, lié au développement d'un mouvement socialiste à travers l'Europe. La minorité protestante aurait joué un rôle dans le combat pour cet État, pour sa construction, elle ne souffrirait donc d'aucune discrimination et jouirait de tous les droits démocratiques en son sein.
Avec le temps, les protestant·es du Nord pourraient se considérer comme faisant partie intégrante de la nation irlandaise, à l'instar des protestant·es du Sud. D'autres solutions, y compris l'autonomie de la communauté protestante du Nord au sein d'une Irlande socialiste, ou l'autonomie pour la région du nord-est de l'Irlande, sont également possibles et il appartiendra à la future classe ouvrière, en construisant une lutte unie contre le capitalisme, et une fois au pouvoir, de décider démocratiquement de la manière de résoudre cette question.
La question clé pour nous est de savoir comment unifier la classe ouvrière, aujourd'hui, contre la classe capitaliste, de manière à poser la possibilité pour la classe ouvrière de prendre le pouvoir et d'avoir l'opportunité de résoudre la question nationale. Notre analyse et notre stratégie pour l'avenir doivent donc reconnaître et s'opposer à l'oppression nationale existante des catholiques du Nord, tout en rassurant les protestants du Nord sur le fait que non seulement ils n'ont rien à craindre dans un futur État socialiste, mais qu'ils ont aussi beaucoup à y gagner.
Sondage sur la frontière
L'évolution démographique en Irlande du Nord est le principal facteur de changement dans la manière dont la question nationale est posée et perçue. Le fait que, d'ici quelques années, les personnes d'origine catholique représenteront probablement un pourcentage plus élevé de la population du Nord que celles d'origine protestante est d'une importance capitale. En 2016 déjà, il y avait plus de personnes en âge de travailler d'origine catholique (44 %) que d'origine protestante (40 %). Parmi les élèves, l'écart est encore plus important avec 51 % de personnes d'origine catholique contre 37 % d'origine protestante.
Depuis sa fondation, l'État du Nord est un État à majorité protestante (et présumée unioniste) et à minorité catholique. La disparition de cette majorité protestante et la tendance démographique claire vers une majorité catholique ébranlent la base de l'État du Nord.
De plus, ce fait démographique a une signification légale dans l'accord du Vendredi saint. Il contient une clause chargeant le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord d'ordonner la tenue d'un scrutin « si, à un moment, il lui apparaît probable qu'une majorité des votants exprimerait le souhait que l'Irlande du Nord cesse de faire partie du Royaume-Uni et fasse partie d'une Irlande unie ». Simultanément, un scrutin équivalent serait organisé dans le sud de l'Irlande.
Si le recensement de 2021 indique un pourcentage plus élevé de catholiques que de protestants, la pression en faveur de l'organisation d'un scrutin sur la frontière augmentera considérablement. Il semble très probable que d'ici dix ans, les sondages d'opinion indiqueront la nécessité de déclencher un scrutin sur cette question de la frontière.
Toutefois, avant l'organisation d'un tel scrutin, cette question (et la question nationale en général) sera placée sur le devant de la scène politique. Outre le compte à rebours de l'horloge démographique, la montée en puissance du Sinn Féin dans le Sud donne un élan à ce processus. Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils ont systématiquement essayé d'utiliser le Brexit comme une opportunité de mettre en avant l'unification irlandaise. S'ils entrent dans un gouvernement de droite avec le Fianna Fáil ou le Fine Gael, ils profiteront sans aucun doute de l'occasion pour réclamer un scrutin sur la frontière, à la fois parce qu'il s'agit d'un élément central de leur existence politique et pour détourner l'attention de leur rôle probable dans la gestion du capitalisme et la mise en œuvre de l'austérité. C'est précisément ce qu'ils ont déjà fait dans le Nord.
Le Brexit et un nouveau référendum écossais pour l'indépendance sont des facteurs supplémentaires qui influencent le débat et la trajectoire de la question nationale en Irlande. L'État britannique en général est sur la voie de la désintégration. La sortie de la Grande-Bretagne de l'UE a souligné le déclin relatif de la position de l'impérialisme britannique, tout en posant avec acuité la question du positionnement d'une frontière renforcée – soit entre le Sud et le Nord de l'Irlande, soit entre l'Irlande dans son ensemble et la Grande-Bretagne.
D'une part, ces éléments peuvent renforcer le sentiment des communautés ouvrières protestantes d'être assiégées par une population catholique de plus en plus confiante. D'autre part, si les catholiques ont le sentiment que leurs aspirations à faire partie d'une Irlande unie seraient bloquées par l'État britannique ou d'autres, même dans des circonstances où ils seraient majoritaires, en dépit du fait que l'accord du Vendredi saint est clair sur ce qui devrait se passer, le résultat pourrait être explosif.
La configuration politique de cette île est incroyablement complexe. Néanmoins, pour tracer une voie vers l'avenir, il faut aborder la situation politique telle qu'elle est, et non pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Partant du point de départ compliqué d'aujourd'hui, les socialistes doivent formuler une approche pour s'opposer à l'oppression et unifier la classe ouvrière dans une lutte contre l'exploitation capitaliste et pour un changement socialiste.
Que devraient dire les socialistes à propos d'un référendum sur la frontière ?
Ce référendum est, à bien des égards, la manière la plus tranchante dont la question nationale nous est posée aujourd'hui. Un référendum des deux côtés de la frontière avec une réponse Oui/Non (ou la possibilité de s'abstenir) ne permet pas d'esquives ou de réponses interminables. Il n'est pas possible d'y répondre simplement en se référant à la solution socialiste que nous privilégions. Il exige une réponse concrète. Dans le cadre de l'élaboration d'un programme visant à unir la classe ouvrière et à lutter pour renverser le capitalisme, la manière dont nous répondons à un référendum sur la frontière est cruciale.
Un référendum frontalier dans le cadre de l'accord du Vendredi saint n'est pas notre réponse à la question nationale, tout comme l'accord du Vendredi saint n'était pas notre réponse au conflit sectaire dans le Nord. Il s'agit d'une « solution » créée par les partis politiques et les États capitalistes, qui comporte de nombreux dangers du point de vue de la lutte pour l'unification de la classe ouvrière et la défaite de l'impérialisme et du capitalisme.
Cependant, elle existe légalement et – en conséquence – politiquement, en tant que point de référence pour les personnes issues de communautés catholiques qui cherchent à mettre fin à leur oppression nationale. Les socialistes devraient reconnaître qu'il est tout à fait raisonnable que les catholiques du Nord, qui ont été forcés d'entrer dans un État qui les opprime au motif qu'ils sont une minorité, s'attendent à ce que leur oppression prenne fin lorsqu'ils deviendront une majorité. Le référendum est déjà perçu comme le moyen le plus évident d'y parvenir, et le sera probablement de plus en plus.
D'autre part, les protestants de la classe ouvrière considèrent avec inquiétude un sondage frontalier. Cela s'explique à la fois par l'augmentation des tensions sectaires qui pourrait en résulter et par les conséquences d'un vote en faveur du oui, qui signifierait qu'ils sont forcés d'entrer dans un État dont ils ne veulent pas faire partie.
La possibilité que cela devienne un tournant vers une escalade de la violence et des affrontements sectaires est réelle. Cependant, pour les socialistes, qui sont une petite minorité à ce stade, répondre qu'ils « s'opposent » à un référendum sur la frontière équivaudrait à souffler sur un ouragan pour essayer de le faire disparaître. Cette situation va se produire, que nous le voulions ou non, et les socialistes doivent s'y engager.
S'opposer à l'idée d'un référendum frontalier, ou prôner l'abstention ou le boycott d'un scrutin s'il est organisé, n'est pas une stratégie susceptible d'unir une partie importante de la classe ouvrière et de lui indiquer la voie à suivre pour accéder au pouvoir. Pire encore, cela reviendrait à commenter depuis la ligne de touche. Cela laisserait le champ libre aux nationalistes des deux camps pour prendre la direction du débat et des résultats.
Les socialistes devraient donc reconnaître la réalité politique qu'est l'imminence d'un référendum frontalier. Au lieu de créer une barrière entre eux et la majorité de la classe ouvrière de l'île en s'y « opposant », ils devraient chercher à intervenir pour façonner les termes du débat et le résultat.
Campagne indépendante de la classe ouvrière
Le référendum sur la frontière ne résoudra pas la question nationale et nous ne devrions pas le prétendre. En fait, comme nous l'avons souligné, il pourrait exacerber le sectarisme et les tensions entre les communautés. Cependant, nous ne pouvons pas dire aux catholiques, qui d'une position minoritaire sont sur le point de devenir une majorité, qu'ils devraient accepter ce statu quo jusqu'à ce que la lutte pour le socialisme soit prête à résoudre la question nationale.
Au contraire, nous devrions soutenir la tenue d'un référendum frontalier, à la fois comme un droit démocratique et comme un mécanisme permettant aux catholiques de mettre fin à leur oppression nationale. Nous devrions prendre parti sur la question concrète du référendum frontalier – conformément aux souhaits de la grande majorité des travailleur·ses irlandais·es, avec un contenu progressiste pour la plupart – en faveur de la réunification de l'île. Ce faisant, nous nous mettrions dans une bien meilleure position pour présenter nos arguments plus généraux en faveur de la nécessité d'un changement socialiste, notamment en mettant l'accent sur les droits de la minorité protestante.
Tout en soutenant un tel référendum et en appelant à voter oui, les socialistes doivent mettre en garde contre les dangers qu'il comporte. Il contient un risque significatif d'augmentation des tensions et même de conflit ouvert, dans la période entourant un tel scrutin. S'il avait lieu et que l'unification de l'île était majoritaire, il pourrait simplement changer la dynamique de l'oppression, les protestant·es se sentant contraint·es d'adhérer à un État auquel ils ne s'identifient pas, dans des circonstances de tensions communautaires accrues.
Pour éviter ces conséquences, il faut mettre en place une campagne anti-sectaire basée sur les communautés catholiques et protestantes de la classe ouvrière, indépendante des forces nationalistes, y compris le Sinn Féin qui plaidera en faveur d'un référendum frontalier et d'un vote en faveur du Oui. Dans le Sud, les socialistes ont le devoir particulier de sensibiliser à la crainte des protestant·es de devenir une minorité opprimée au sein d'un État unifié, en expliquant leurs préoccupations de perdre non seulement leur identité, mais aussi des services publics supérieurs à ceux du Sud. Nous devons insister sur la nécessité de protéger les droits de la minorité protestante, ainsi que d'autres minorités, au sein de cet État.
Il faudra argumenter que l'on ne veut pas l'unification de deux États capitalistes et sectaires, mais la création d'une Irlande laïque et socialiste, au sein de laquelle les droits des protestant·es, y compris le droit permanent à la double citoyenneté, seraient protégés. Au lieu de l'harmonisation à la baisse de l'impôt sur les sociétés envisagée par le Sinn Féin et de la création d'un paradis fiscal dans toute l'Irlande, nous devrions préconiser la propriété publique démocratique des principales sources de richesse de l'île, en les utilisant pour garantir un service national de santé de qualité dans toute l'île, des investissements dans des logements publics décents et des services pour tous, ainsi que des améliorations spectaculaires du niveau de vie de la population.
Ce changement socialiste ne peut être soutenu sur l'île d'Irlande seule. Il doit s'inscrire dans un mouvement international visant à mettre fin à la domination par la classe capitaliste et à remettre le pouvoir entre les mains de la classe ouvrière. La construction d'une Europe socialiste démocratique, qui inclurait une coopération et des relations étroites avec les travailleur·ses de tout le continent, est un élément crucial de ce mouvement.
Le 27 janvier 2021
* Les termes « protestant » et « catholique » seront utilisés tout au long de cet article pour désigner les personnes issues des communautés protestantes et catholiques. Bien que ce choix linguistique pose des problèmes, notamment parce qu'il implique qu'il s'agit d'une manière ou d'une autre d'un conflit « religieux », l'alternative consistant à décrire les personnes comme nationalistes et unionistes applique des étiquettes politiques à des personnes uniquement en fonction de leurs origines et ne parvient pas à saisir la nature communautaire de la division sectaire.
Notes
1. James Connolly, Labour and Partition, 1914.
2. La brève histoire décrite ici est principalement tirée de T.A. Jackson, Ireland Her Own, 1946, et de D. R. O'Connor Lysaght, « British Imperialism in Ireland », contenu dans Ireland : Divided Nation, Divided Class, 1987.
3. Pour en savoir plus, Christopher Hill, The English Revolution 1640, 1940.
4. Idem.
5. James Connolly, Labour in Irish History, 1910.
6. Lettre à Lord Justice Fitzgibbon, 16 février 1886. L'ordre Orange est une société protestante, fondée en Irlande, dont le but est de favoriser les objectifs du protestantisme. En 1911, un certain nombre d'orangistes commencent à s'armer et à suivre un entraînement militaire. Le Conseil unioniste d'Ulster décide de mettre sous contrôle ces groupes armés, en créant une milice protestante, l'Ulster Volonteer Force, déterminée à s'opposer au Home Rule. L'appartenance aux loges orangistes et à l'UVF se recouvraient partiellement.
7. Falls Road est la route principale traversant l'ouest de Belfast. Son nom évoque la communauté républicaine catholique de la ville, tandis que la Shankill Road voisine est majoritairement loyaliste et protestante, séparée de Falls Road par les Murs de la paix.
8. Marx et Engels, Manifeste du Parti communiste, 1848.
9. John Riddell, Lenin's Struggle for a Revolutionary International, 2002, p. 40.
10. Eugene V. Debs, The Negro In the Class Struggle, 1903.
11. Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe, 1930.
12. Joseph Staline, Le marxisme et la question nationale, 1913.
13. « La question noire aux États-Unis », 28 février 1933.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Marxisme et question nationale, de Marx à Eric Hobsbawm

L'articulation entre internationalisme et question nationale, entre revendications démocratiques et révolution, est l'enjeu d'un débat entre marxistes depuis le milieu du 19e siècle, débat dont Michael Löwy raconte l'évolution.
23 novembre 2024 | tire du site d'Inprecor, numéro 726, novembre 2024 | Photo : Rosa Luxemburg au Congrès socialiste international d'Amsterdam.
Marx et Engels n'ont proposé ni une théorie systématique de la question nationale, ni une définition précise du concept de « nation », ni une stratégie politique générale pour les socialistes dans ce domaine. Leurs articles sur le sujet étaient, pour la plupart, des déclarations politiques concrètes relatives à des cas spécifiques. En ce qui concerne les textes théoriques proprement dits, les plus connus et les plus influents sont sans doute les passages assez sibyllins du Manifeste concernant les communistes et la nation. Ces passages ont la valeur historique de proclamer de manière audacieuse et intransigeante la nature internationaliste du mouvement prolétarien, mais ils ne sont pas toujours exempts d'un certain économisme et d'un surprenant optimisme libre-échangiste. Cela se voit notamment dans la suggestion que le prolétariat victorieux poursuivra simplement la tâche d'abolir les antagonismes nationaux qui a été commencée avec « le développement de la bourgeoisie, le libre-échange, le marché mondial », etc. Cette idée est cependant contredite dans d'autres textes de la même époque, dans lesquels Marx souligne que « tandis que la bourgeoisie de chaque nation conserve encore des intérêts nationaux particuliers, la grande industrie créa une classe dont les intérêts sont les mêmes dans toutes les nations et pour laquelle la nationalité est déjà abolie » 1.
Dans ses écrits ultérieurs (notamment sur la question de l'Irlande), Marx a montré que non seulement la bourgeoisie tend à entretenir les antagonismes nationaux, mais qu'elle tend même à les accroître, car : 1. la lutte pour le contrôle des marchés crée des conflits entre les puissances capitalistes ; 2. l'exploitation d'une nation par une autre produit l'hostilité nationale ; 3. le chauvinisme est un des outils idéologiques qui permettent à la bourgeoisie de maintenir sa domination sur le prolétariat.
Marx et Engels ont souligné avec force l'internationalisation de l'économie par le mode de production capitaliste : l'émergence du marché mondial qui « a enlevé à l'industrie sa base nationale » en créant « une interdépendance généralisée des nations ». Cependant, il y a une tendance à l'économisme dans son idée que « l'uniformité de la production industrielle et les conditions d'existence qu'ils entraînent » aide à dissoudre les barrières nationales (Absonderungen) et les antagonismes, comme si les différences nationales pouvaient être assimilées à de simples différences dans le processus de production2.
Des principes généraux
Si le Manifeste communiste a jeté les bases de l'internationalisme prolétarien, il n'a guère donné d'indications sur une stratégie politique concrète par rapport à la question nationale. Une telle stratégie n'a été développée que plus tard, notamment dans les écrits de Marx sur la Pologne et l'Irlande (ainsi que dans la lutte qu'il a menée au sein de l'Internationale contre le nationalisme libéral-démocrate de Mazzini et le nihilisme national des Proudhoniens). Marx et Engels ont soutenu la Pologne non seulement au nom du principe démocratique général de l'autodétermination des nations, mais surtout en raison de la lutte des Polonais·es contre la Russie tsariste, le principal bastion de la réaction en Europe et la bête noire des pères fondateurs du socialisme scientifique.
Les écrits sur l'Irlande, en revanche, ont une application beaucoup plus large et énoncent, implicitement, certains principes généraux sur la question des nations opprimées. Dans une première phase, Marx était favorable à l'autonomie de l'Irlande au sein d'une union avec la Grande-Bretagne et pensait que la solution à l'oppression des Irlandais (par les grands propriétaires terriens anglais) passerait par une victoire de la classe ouvrière (chartiste) en Angleterre. Dans les années 1860, en revanche, il considère la libération de l'Irlande comme la condition de la libération du prolétariat anglais. Ses écrits sur l'Irlande à cette époque développent trois thèmes qui seront importants pour le développement futur de la théorie marxiste de l'autodétermination nationale, dans sa relation dialectique avec l'internationalisme prolétarien :
1. Seule la libération nationale de la nation opprimée permet de surmonter les divisions et les antagonismes nationaux et permet à la classe ouvrière des deux nations de s'unir contre leur ennemi commun, les capitalistes ;
2. La libération de la nation opprimée est une condition préalable à la libération du prolétariat anglais. L'oppression d'une autre nation contribue à renforcer l'hégémonie idéologique de la bourgeoisie sur les travailleurs de la nation opprimée : toute nation qui en opprime une autre forge ses propres chaînes ;
3. L'émancipation de la nation opprimée affaiblit les bases économiques, politiques, militaires et idéologiques des classes dominantes de la nation opprimée, ce qui contribue à la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière de cette nation.
Les positions de Friedrich Engels sur la Pologne et l'Irlande étaient largement similaires à celles de Marx. Toutefois, on trouve dans ses écrits un curieux concept théorique, la doctrine des « nations non historiques » – une catégorie dans laquelle il inclut, pêle-mêle, les Slaves du Sud (Tchèques, Slovaques, Croates, Serbes, etc.), les Bretons, les Écossais et les Basques. Selon Engels, « ces survivances d'une nation impitoyablement piétinée par la marche de l'histoire, comme le dit Hegel, ces “déchets de peuples” deviennent chaque fois les soutiens fanatiques de la contre-révolution, et ils le restent jusqu'à leur extermination et leur dénationalisation définitive ; leur existence même n'est-elle pas déjà une protestation contre une grande révolution historique ? » 3.
Engels a développé cet argument métaphysique pseudo-historique dans un article de 1855, qui affirmait que « le panslavisme est un mouvement qui s'efforce d'effacer ce qu'ont créé mille ans d'histoire, et qui ne peut se réaliser sans rayer de la carte la Turquie, la Hongrie et la moitié de l'Allemagne » 4.
Paradoxalement, le même Engels, dans un article de la même époque (1853), avait souligné que l'Empire turc était destiné à se désintégrer à la suite de la libération des nations balkaniques, ce qui ne l'étonnait nullement car, en bon dialecticien, il admirait dans l'histoire « les changements éternels de la destinée humaine [...] où rien n'est stable que l'instabilité, rien n'est immobile, que le mouvement » 5.
Pour la défense d'Engels, on pourrait avancer qu'il s'agissait d'articles de journaux, dépourvus du caractère rigoureux d'un travail scientifique, et qu'ils avaient donc un statut différent de celui de ses écrits théoriques proprement dits.
Le débat marxiste classique au sein de la IIe Internationale : la question nationale au tournant du siècle
C'est à la fin du 19e siècle et au début du 20e que se déroule la discussion la plus importante sur la question nationale parmi les marxistes de la Deuxième Internationale. Des contributions intéressantes traitent de questions spécifiques : la question juive – du bundiste Vladimir Medem au sioniste Ber Borochov – ou la question irlandaise, avec James Connolly. Mais les réflexions théoriques les plus générales sont celles des marxistes des Empires austro-hongrois et russe (tsariste) multinationaux : Otto Bauer, Rosa Luxemburg, Staline, Lénine, Trotsky.
La gauche radicale contre le séparatisme national : Rosa Luxemburg, Léon Trotsky
Le courant de la « gauche radicale » (Linksradikale) représenté par Luxemburg, Pannekoek, Trotsky (avant 1917) et Strasser se caractérisait, à des degrés divers et sous des formes parfois très différentes, par son opposition au séparatisme national, au nom du principe de l'internationalisme prolétarien. Si les marxistes occidentaux Pannekoek et Strasser ont eu peu d'influence, il n'en va pas de même pour la marxiste polonaise Rosa Luxemburg.
En 1893, Rosa Luxemburg fonde le Parti social-démocrate du Royaume de Pologne (PSDK), avec un programme marxiste et internationaliste, pour contrer le Parti socialiste polonais (PPS), dont l'objectif est de lutter pour l'indépendance de la Pologne. Dénonçant le PPS (avec une certaine justesse) comme un parti social-patriotique, Rosa et ses camarades du SDKP étaient résolument opposés au slogan de l'indépendance de la Pologne et soulignaient, au contraire, le lien étroit entre les prolétariats russe et polonais et leur destin commun.
En 1896, Luxemburg représenta le SDKP au congrès de la Deuxième Internationale. Les positions qu'elle défendit dans son intervention furent exposées dans un article ultérieur : « la libération de la Pologne est aussi utopique que la libération de la Tchécoslovaquie, de l'Irlande ou de l'Alsace-Lorraine […]. La lutte politique unificatrice du prolétariat ne doit pas être supplantée par une “série de luttes nationales stériles” ». 6.
Les bases théoriques de cette position seront fournies par les recherches qu'elle a effectuées pour sa thèse de doctorat, Le développement industriel de la Pologne (1898). Le thème central de ce travail était que, du point de vue économique, la Pologne était déjà intégrée à la Russie. Seules la petite bourgeoisie et les couches précapitalistes nourrissaient encore le rêve utopique d'une Pologne unie et indépendante.
Sa déclaration la plus controversée sur la question nationale (que Lénine, en particulier, a attaquée) est la série d'articles publiés en 1908 sous le titre « La question nationale et l'autonomie » dans le journal du Parti social-démocrate polonais (devenu le SDKPiL, après l'adhésion d'un groupe marxiste lituanien). Les principales idées avancées dans ces articles sont les suivantes : 1. le droit à l'autodétermination est un droit abstrait et métaphysique, comme le soi-disant « droit au travail » prôné par les utopistes du 19e siècle ; 2. Le soutien au droit de sécession de chaque nation implique en réalité le soutien au nationalisme bourgeois : la nation en tant qu'entité uniforme et homogène n'existe pas – chaque classe de la nation a des intérêts et des « droits » conflictuels ; 3. l'indépendance des petites nations en général, et de la Pologne en particulier, est utopique du point de vue économique et condamnée par les lois de l'histoire. Pour Luxemburg, il n'y a qu'une seule exception à cette règle : les nations balkaniques de l'Empire turc (Grecs, Serbes, Bulgares, Arméniens). Ces nations avaient atteint un degré de développement économique, social et culturel supérieur à celui de la Turquie, empire décadent dont le poids mort les opprimait.
Pour étayer son point de vue sur le manque d'avenir des petites nations, Luxemburg utilise les articles d'Engels sur les « nations non historiques » (bien qu'elle les attribue à Marx : leur véritable paternité n'a en fait été établie qu'en 1913, avec la découverte de lettres inédites de Marx/Engels) (6).
Des approches concrètes
Comme on le sait, en 1914 Luxemburg fut l'une des rares dirigeant·es de la IIe Internationale à ne pas succomber à la grande vague de social-patriotisme qui submergea l'Europe avec l'avènement de la guerre. Emprisonnée par les autorités allemandes pour sa propagande internationaliste et antimilitariste, elle rédigea en 1915 et fit sortir clandestinement de prison son célèbre Brochure de Junius. Dans ce texte, Luxemburg adopte dans une certaine mesure le principe de l'autodétermination : « le socialisme reconnait à chaque peuple le droit à l'indépendance et à la liberté, à la libre disposition de son propre destin ». Cependant, pour elle, cette autodétermination ne pouvait être exercée au sein des États capitalistes existants, en particulier les États colonialistes. À l'ère de l'impérialisme, la lutte pour « l'intérêt national » est une mystification, non seulement par rapport aux grandes puissances coloniales, mais aussi pour les petites nations qui ne sont « que des pions sur l'échiquier impérialiste des grandes puissances ». 7
Toutefois, dans un article, Luxemburg expose le problème dans des termes très proches de ceux de Lénine : l'introduction de 1905 au recueil La question polonaise et le mouvement socialiste. Dans cet essai, Luxemburg distingue soigneusement le droit indéniable de chaque nation à l'indépendance (« qui découle des principes élémentaires du socialisme »), qu'elle reconnaît, et l'opportunité de cette indépendance pour la Pologne, qu'elle nie. C'est aussi l'un des rares textes où elle reconnaît l'importance, la profondeur et même la justification des sentiments nationaux (tout en les traitant comme un simple phénomène « culturel »), et où elle souligne que l'oppression nationale est « l'oppression la plus intolérable dans sa barbarie » et ne peut que susciter « hostilité et rébellion »…8
Les écrits de Léon Trotsky sur la question nationale avant 1917 peuvent être qualifiés d'« éclectiques » (terme utilisé par Lénine pour les critiquer), occupant une position à mi-chemin entre Luxemburg et Lénine. C'est surtout après 1914 que Trotsky s'est intéressé à la question nationale. Il l'aborde dans sa brochure La guerre et l'Internationale 9 ouvrage polémique dirigé contre le social-patriotisme, sous deux angles différents, voire contradictoires :
1. Une approche historique et économique. La guerre mondiale est le produit de la contradiction entre les forces productives, qui tendent vers une économie mondiale, et le cadre contraignant de l'État-nation. Trotsky annonçait donc « la destruction de l'État-nation en tant qu'entité économique indépendante », ce qui, d'un point de vue strictement économique, était une proposition justifiable. Mais il en déduit l'« effondrement » et la « destruction » de l'État-nation dans son ensemble ; l'État-nation en tant que tel, le concept même de nation, ne pourra plus exister à l'avenir que comme « fait culturel, idéologique et psychologique ».
2. Une approche politique concrète. Contrairement à Luxemburg, Trotsky proclame explicitement le droit des nations à l'autodétermination comme l'une des conditions de la « paix entre les nations », qu'il oppose à la « paix des diplomates ». En outre, il soutient la perspective d'une Pologne indépendante et unie (c'est-à-dire libérée de la domination tsariste, autrichienne et allemande) ainsi que l'indépendance de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Serbie, de la Bohême, etc. C'est dans la libération de ces nations et leur association dans une fédération balkanique qu'il voyait la meilleure barrière contre le tsarisme en Europe. En outre, Trotsky défendait une relation dialectique entre l'internationalisme prolétarien et les droits nationaux : la destruction de l'Internationale par les social-patriotes était un crime non seulement contre le socialisme, mais aussi contre « l'intérêt national, dans son sens le plus large et le plus correct », puisqu'elle dissolvait la seule force capable de reconstruire l'Europe sur la base des principes démocratiques et du droit des nations à l'autodétermination.
Après 1917, Trotsky adopte la conception léniniste de la question nationale, qu'il défend à Brest-Litovsk (1918) en tant que commissaire du peuple aux affaires étrangères.
Les austro-marxistes et l'autonomie culturelle
L'idée principale des austro-marxistes – Karl Renner et Otto Bauer – par rapport à la question nationale, notamment dans le contexte de l'Empire austro-hongrois, est l'autonomie culturelle dans le cadre d'un État plurinational, par le biais de l'organisation des nationalités en corporations juridiques publiques, dotées de toute une série de pouvoirs culturels, administratifs et juridiques. Ils souhaitaient à la fois reconnaître les droits des minorités nationales et maintenir l'unité de l'État austro-hongrois.
Le grand ouvrage d'Otto Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie (1907), partageait le postulat fondamental de Karl Renner et des autres austro-marxistes : la préservation de l'État plurinational, en accordant une autonomie nationale culturelle aux différentes communautés ethniques…
La particularité de l'analyse de Bauer réside dans la dimension psycho-culturelle de sa théorie sur la question nationale, construite sur la base du concept de « caractère national », défini en termes psychologiques : « la diversité des objectifs, le fait qu'un même stimulus peut provoquer des mouvements différents et qu'une même situation extérieure peut conduire à des décisions différentes ». Ce concept d'origine néo-kantienne a été sévèrement critiqué par les adversaires marxistes de Bauer (Kautsky, Pannekoek, Strasser, etc.) 10
L'œuvre de Bauer a une valeur théorique indéniable, notamment en ce qui concerne le caractère historiciste de sa méthode. En définissant la nation comme le produit d'un destin historique commun, comme « l'aboutissement jamais achevé d'un processus constant », comme une cristallisation d'événements passés, un « morceau d'histoire figé », Bauer se place résolument sur le terrain du matérialisme historique et en opposition frontale avec les mythes réactionnaires de la « nation éternelle » et de l'idéologie raciste. Cette approche historique confère au livre de Bauer une réelle supériorité méthodologique sur la plupart des auteurs marxistes de l'époque, dont les écrits sur la question nationale avaient souvent un caractère abstrait et rigide. Dans la mesure où la méthode de Bauer impliquait non seulement une explication historique des structures nationales existantes, mais aussi une conception de la nation comme un processus, un mouvement en perpétuelle transformation, il a pu éviter l'erreur d'Engels en 1848-49 : le fait qu'une nation (comme les Tchèques) « n'ait pas eu d'histoire » ne signifie pas nécessairement qu'elle n'aura pas d'avenir. Le développement du capitalisme en Europe centrale et dans les Balkans ne conduit pas à l'assimilation mais à l'éveil de nations « non historiques » 11.
Il convient d'ajouter que le programme d'autonomie culturelle de Bauer avait une valeur significative en tant que complément – et non alternative – à une politique fondée sur la reconnaissance du droit à l'autodétermination. En effet, la première Constitution de l'Union soviétique intégrait en quelque sorte le principe de l'autonomie culturelle des minorités nationales.
Lénine, Staline et le droit à l'autodétermination
Staline a été le premier dirigeant bolchevique à écrire sur la question nationale. C'est Lénine qui l'a envoyé à Vienne pour étudier la question et, dans une lettre adressée à Gorki en février 1913, il a parlé du « merveilleux Géorgien qui s'est fait connaître dans le monde entier » 12. Mais une fois l'article de Staline « Le marxisme et la question nationale » 13 terminé, il ne semble pas que Lénine ait été particulièrement enthousiaste à son sujet, car il ne le mentionne dans aucun de ses nombreux écrits sur la question nationale, à l'exception d'une brève référence entre parenthèses dans un article daté du 28 décembre 1913. Il est évident que les idées principales de l'œuvre de Staline sont celles du parti bolchevique et de Lénine. Cela dit, la suggestion de Trotsky selon laquelle l'article a été inspiré, supervisé et corrigé « ligne par ligne » par Lénine semble discutable 14.
Au contraire, sur un certain nombre de points assez importants, l'ouvrage de Staline diffère implicitement et explicitement des écrits de Lénine, voire les contredit.
1. Le concept de « caractère national », de « constitution psychologique commune » ou de « particularité psychologique » des nations n'est pas du tout léniniste. Cette problématique est un héritage de Bauer, que Lénine a explicitement critiqué pour sa « théorie psychologique ». 15 En affirmant sans ambages que « ce n'est que lorsque toutes ces caractéristiques [langue commune, territoire, vie économique et formation psychique] sont réunies que nous avons une nation », Staline a donné à sa théorie un caractère dogmatique, restrictif et rigide que l'on ne retrouve jamais chez Lénine. La conception stalinienne de la nation était un véritable lit de Procuste 16 idéologique. Selon Staline, la Géorgie d'avant la seconde moitié du 19e siècle n'était pas une nation car elle n'avait pas de « vie économique commune », étant divisée en principautés économiquement indépendantes. Selon ce critère, l'Allemagne, avant l'Union douanière, n'aurait pas été une nation non plus… On ne trouve nulle part dans les écrits de Lénine une « définition » aussi rigide et arbitraire de la nation.
2. Staline a explicitement refusé d'admettre la possibilité d'une unité ou d'une association de groupes nationaux dispersés au sein d'un État multinational : la question se pose de savoir s'il est possible d'unir en une seule union nationale des groupes qui sont devenus si distincts. Est-il concevable, par exemple, que les Allemands des provinces baltes et les Allemands de Transcaucasie puissent être « réunis en une seule nation » ? La réponse donnée, bien sûr, était que tout cela n'était « pas concevable », « pas possible » et « utopique » 17.
Lénine, en revanche, défendait vigoureusement la « liberté d'association, y compris l'association de toutes les communautés, quelle que soit leur nationalité, dans un État donné », citant précisément en exemple les Allemands du Caucase, de la Baltique et de la région de Petrograd. Il ajoutait que la liberté d'association de toute nature entre les membres de la nation, dispersés dans différentes parties du pays ou même du globe, était « indiscutable et ne pouvait être contestée que du point de vue bureaucratique et borné » 18.
3. Staline ne faisait aucune distinction entre le nationalisme oppressif tsariste grand-russe et le nationalisme des nations opprimées. Dans un paragraphe très révélateur de son article, il rejette d'un même souffle « la vague de nationalisme belliqueux, partie d'en haut, tout une suite de répressions de la part des “détenteurs du pouvoir” » et la « vague de nationalisme montant d'en bas, qui se transformait parfois en un grossier chauvinisme » des Polonais, des juifs, des Tatars, des Géorgiens, des Ukrainiens, etc. Non seulement il ne fait aucune distinction entre les nationalismes « d'en haut » et « d'en bas », mais il adresse ses critiques les plus sévères aux sociaux-démocrates des pays opprimés qui n'ont pas « tenu bon » face au mouvement nationaliste.
Lénine, la question nationale et la stratégie
Le point de départ de Lénine pour élaborer une stratégie sur la question nationale était le même que pour Luxemburg et Trotsky : l'internationalisme prolétarien. Cependant, contrairement à ses camarades de la gauche révolutionnaire, il insiste sur la relation dialectique entre l'internationalisme et le droit à l'autodétermination nationale. Il estime, premièrement, que seule la liberté de faire sécession rend possible l'union libre et volontaire, l'association, la coopération et, à long terme, la fusion entre les nations. Deuxièmement, seule la reconnaissance par le mouvement ouvrier de la nation oppressive du droit de la nation opprimée à l'autodétermination peut contribuer à éliminer l'hostilité et la suspicion des opprimé·es et à unir le prolétariat des deux nations dans la lutte internationale contre la bourgeoisie.
D'un point de vue méthodologique, Lénine se distingue de la plupart de ses contemporains par sa tentative de « mettre la politique aux commandes », c'est-à-dire par sa tendance obstinée et inébranlable à saisir et à mettre en évidence l'aspect politique de chaque problème et de chaque contradiction. En ce qui concerne la question nationale, alors que la plupart des autres auteurs marxistes voyaient principalement la dimension économique, culturelle ou « psychologique » du problème, Lénine estimait que la question de l'autodétermination « appartient entièrement et exclusivement [au domaine de la démocratie politique] »19, c'est-à-dire au domaine du droit à la sécession politique et à l'établissement d'un État-nation indépendant.
Il va sans dire que l'aspect politique de la question nationale pour Lénine n'est pas du tout celui dont se préoccupent les gouvernements, les diplomates et les armées. Que telle ou telle nation ait un État indépendant ou que les frontières soient entre deux États lui est totalement indifférent. Son objectif est la démocratie et l'unité internationaliste du prolétariat, qui passent toutes deux, selon lui, par la reconnaissance du droit des nations à disposer d'elles-mêmes. De plus, précisément parce qu'elle se concentre sur l'aspect politique, sa théorie de l'autodétermination ne fait aucune concession au nationalisme. Elle se situe uniquement dans la sphère de la lutte démocratique et de la révolution prolétarienne.
Le principal défaut de la conception léniniste de la question nationale est que l'accent exclusif mis sur le choix entre l'unification et la sécession laisse peu de place à des alternatives telles que l'autonomie nationale et culturelle. Mais dans la pratique, Lénine et les bolcheviks y auront recours, par exemple en ce qui concerne les communautés nationales telles que les juifs en URSS.
Réflexions contemporaines, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm
Dans les décennies qui ont suivi la Révolution russe d'octobre 1917, la plupart des discussions sur la question nationale ont porté sur des problèmes nationaux spécifiques. En 1922, Lénine et Staline se sont affrontés sur la question de l'autonomie de la Géorgie soviétique – un conflit décrit par l'historien Moshe Lewin comme Le dernier combat de Lénine. Dans les années 1930, Léon Trotsky écrit sur le droit à l'autodétermination de l'Ukraine soviétique. La question juive continue de susciter des controverses, avec, entre autres, la contribution d'un jeune disciple de Trotsky, Abraham Leon. Plusieurs marxistes noirs publient d'importantes analyses sur la minorité afro-américaine aux États-Unis (W.E.B. Du Bois, CLR James). En 1935, le marxiste catalan Andreu Nin a publié un livre sur les mouvements d'émancipation nationale, mais il s'agit essentiellement d'un résumé du débat classique, de Marx et Engels aux révolutionnaires russes. Bien entendu, il existe une vaste littérature marxiste sur les mouvements coloniaux de libération nationale.
Ce n'est qu'à la fin du 20e siècle que de nouvelles réflexions théoriques marxistes générales sur la question nationale ont vu le jour. Deux d'entre eux sont les plus influents : Benedict Anderson et Eric Hobsbawm.
Dans son livre novateur de 1983, Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (L'imaginaire national : réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme), Benedict Anderson définit la nation comme « une communauté politique imaginée ». Il explique qu'une nation « est imaginée parce que les membres de la plus petite nation ne connaîtront jamais la plupart de leurs confrères, ne les rencontreront jamais, ni même n'entendront parler d'eux, mais dans l'esprit de chacun d'eux vit l'image de leur communion ». Les membres de la communauté ne connaîtront probablement jamais chacun des autres membres face à face ; cependant, ils peuvent avoir des intérêts similaires ou s'identifier comme faisant partie de la même nation.
Enfin, une nation est une communauté parce que, « indépendamment de l'inégalité et de l'exploitation réelles qui peuvent prévaloir dans chacune d'elles, la nation est toujours conçue comme une camaraderie profonde et horizontale. En fin de compte, c'est cette fraternité qui a permis, au cours des deux derniers siècles, à tant de millions de personnes, non pas tant de tuer, mais de mourir volontairement pour des objectifs aussi limités ».
Selon Anderson, la langue joue un rôle important dans la consolidation des « communautés imaginées » nationales. Commençant avec une petite élite cultivée, la langue devient de plus en plus importante avec la généralisation de l'imprimé après le 18e siècle et, après le 19e siècle, avec la diffusion de la langue à travers l'éducation publique et l'administration. – On peut considérer que l'accent mis par Anderson sur l'imaginaire est trop unilatéral, mais son livre est sans aucun doute l'une des contributions les plus novatrices à la réflexion marxiste sur la question nationale.
Le livre d'Eric Hobsbawm en 1991, Nations and Nationalism since 1780 (Nations et nationalismes depuis 1780 : programmes, mythe et réalité) est peut-être l'étude la plus importante de la question après les grands classiques de la Deuxième Internationale. En examinant les différents critères proposés pour définir une nation, tels que la langue, l'ethnicité, le territoire, etc., il conclut que ces définitions « objectives » ont échoué, car il y a toujours des exceptions évidentes. En outre, les critères adoptés à cette fin sont eux-mêmes changeants et ambigus. Il propose donc une attitude d'« agnosticisme » et refuse toute définition a priori de ce qui constitue une nation. La seule définition qu'il accepte comme hypothèse de travail initiale pour son livre est que « tout ensemble suffisamment important de personnes dont les membres se considèrent comme membres d'une “nation” sera traité comme tel ». Bien sûr, il reste la question du « seuil » : qu'est-ce qu'un « groupe suffisamment important » ? Au 19e siècle, comme le montre Hobsbawm, seules les grandes nations étaient considérées comme lebensfähig (viables) : non seulement les libéraux, mais même Marx et Engels considéraient les petits peuples comme des survivances du passé et des obstacles au progrès historique…
Pour Hobsbawm, les nations sont des formations modernes, c'est-à-dire relativement récentes, produites par l'idéologie nationaliste et par « l'invention de la tradition » – un concept qui n'est pas sans similitude avec les « communautés imaginées » de Benedict Anderson. Hobsbawm est d'accord avec le spécialiste (non marxiste) du nationalisme Ernest Gellner pour dire que les nations comportent un élément d'artefact, d'invention et d'ingénierie sociale, et il cite le commentaire ironique suivant de cet anthropologue britannique : « Les nations en tant que moyen naturel, donné par Dieu, de classer les hommes, en tant que destin politique inhérent, sont un mythe ; le nationalisme, qui parfois prend des cultures préexistantes et les transforme en nations, parfois les invente… : c'est une réalité ». Mais il n'est pas d'accord avec Gellner sur l'accent unilatéral qu'il met sur la modernisation nationale par le haut, en ignorant les développements populaires « par le bas » 20
Internationaliste impénitent, Eric Hobsbawm est sceptique quant au principe wilsonien d'autodétermination nationale : la tentative (après le traité de Versailles) de faire coïncider les frontières de l'État avec les frontières de la nationalité et de la langue. Il estime que cette politique, visant à créer des États ethniquement homogènes, a conduit, inévitablement, à l'expulsion massive ou à l'extermination des minorités : « Telle était et telle est la réduction meurtrière à l'absurde du nationalisme dans sa version territoriale, bien que cela n'ait pas été pleinement démontré avant les années 1940 » 21.
L'analyse historique de Hobsbawm est remarquable, mais sa conclusion selon laquelle, à la fin du 20e siècle, la nation et le nationalisme sont de moins en moins importants est douteuse. Si l'on peut admettre avec lui que l'État-nation a perdu une grande partie de son importance économique, il est beaucoup moins évident que, comme il l'affirme, « le nationalisme n'est plus un vecteur majeur du développement historique » et qu'il a une « signification historique déclinante ». Les exemples qu'il donne pour illustrer son argumentation, au moment où il écrit son livre (1988-89), ont été démentis par le cours des événements dans les années qui ont suivi. Ainsi, il souligne que les tensions nationales en Yougoslavie « n'ont pas encore fait un seul mort » et, à propos de la montée des groupes nationalistes xénophobes tels que le Front national en France, il insiste sur leur « instabilité et leur impermanence » 22.
Si l'internationalisme est la seule perspective cohérente, d'un point de vue marxiste, pour considérer la question nationale, cela ne doit pas conduire, comme cela a souvent été le cas, à sous-estimer la force, l'influence et la capacité de nuisance des nations et du nationalisme.
Le 21 mai 2024
Bibliographie
B. Anderson, L'imaginaire national : réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme, La Découverte, 1996, 212 pages ; réédition poche 2006.
O. Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie, Paris, EDI, 1987, vol. 1 ; La question des nationalités, éditions Syllepse, 660 pages, 2017
F. Engels, « The Magyar Struggle » (1848), in Marx, Engels, The Revolutions of 1848, Londres, Penguin 1973.
F. Engels, « What is to Become of Turkey in Europe ? » New York Daily Tribune, 1853, et « Deutschland und der Panslawismus », Neue Oder Zeitung, 1855, dans Marx, Engels Werke, Berlin, Dietz Verlag, 1968, vol. XI.
E. Hobsbawm, Nations et nationalismes depuis 1780 : programmes, mythe et réalité, Gallimard, 1992, édition poche 2001.
V.I. Lénine, « The National Program of the RSDLP », Collected Works, Moskow, Progress, 1958, Vol. 19 ; V.I. Lénine, « The Right of Nations to Self-Determination », et « Critical Remarks on the National Question » in Collected Works, Vol. 20 ; V.I. Lénine, « The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination », Collected Works, Vol. 22 ; V.I. Lénine, Collected Works, Vol. 35. En ligne sur marxists.org : « La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes ».
M. Löwy, « Marxists and the National Question », New Left Review, Londres, avril 1976.
R. Luxemburg, « Thèses sur les tâches de la social-démocratie internationale » (1915), « La Brochure de Junius, La guerre et l'Internationale », Œuvres complètes, Tome IV, Agone, 256 pages.
R. Luxemburg, « Die Polnische Frage auf dem Internationalen Kongress in London », (1896), « Vorwort zu dem Sammelband “Die polnische Frage und die sozialistische Bewegung” » (1905), « Nationalität und Autonomie » (1908), in Internationalismus und Klassenkampf, Berlin, Luchterhand, 1971 (Rosa Luxemburg, la Question nationale et l'autonomie, Le temps des cerises, 2001 - épuisé).
K. Marx, F. Engels, L'idéologie allemande, 1845.
R. Rosdolsky, Friedrich Engels et les peuples « sans histoire », 384 pages, Syllepse, 2018.
J. Staline, Le marxisme et la question nationale.
L. Trotsky, Les Bolcheviks et la paix mondiale.
L. Trotsky, Staline, Syllepse, 2021, 1008 pages.
Notes
1. Marx, F. Engels, L'idéologie allemande, 1845, .
2. K.Marx, F. Engels, Manifeste du Parti communiste, 1848.
3. F. Engels, La Nouvelle Gazette Rhénane, 13 janvier 1849.
4. F. Engels, “Deutschland und der Panslawismus”, Neue Oder Zeitung, 1855, cité par R. Rosdolsky, Friedrich Engels et les peuples « sans histoire », Syllepse, 2018.
5. F. Engels , “What is to Become of Turkey in Europe ?”, New York Daily Tribune, 1853, cité par R. Rosdolsky, op.cit. p. 174.
6. R. Luxemburg, “Die polnische Frage auf dem Internationalen Kongress in London”, 1896, Internationalismus und Klassenkampf, Berlin, Luchterhand, 1971, pp. 142-143 et pp. 236, 239.
7. R. Luxemburg, La Brochure de Junius, La guerre et l'Internationale, Œuvres complètes, Tome IV, Agone.
8. R. Luxemburg, voir note 6, pp. 192, 217-218).
9. Trotsky, Der Krieg und die Internationale (1914) Zürich, Verlag der Grütlibuchhandlung, 1918, pp. 21, 230-231.
10. O. Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie, Paris, EDI, 1987, vol. 1, p. 139, réédité par Syllepse en 2017.
11. Otto Bauer, 1987, vol. 1, p. 149, voir note 10.
12. Lénine, édition 1958, vol.35:84.
13. Staline, 1913.
14. Trotsky, Staline, édition 1969:233.
15. Lénine, édition 1958, vol. 20:31.
16. ans la mythologie grecque, Procuste (littéralement « celui qui martèle pour allonger ») est le surnom d'un brigand de l'Attique connu pour ne vouloir héberger chez lui que des personnes d'une taille donnée : il contraignait les voyageurs à s'allonger sur un lit ; il leur coupait les membres trop grands et qui dépassaient le lit, et étirait les pieds de ceux qui étaient trop petits. On parlait couramment de « lit de Procuste » pour désigner les tentatives de contraindre les choses à un seul modèle, une seule façon de penser ou d'agir, en référence aux pratiques de ce personnage.
17. Staline, Le marxisme et la question nationale, édition 1953 : 306-7, 309, 305, 339.
18. Lénine, 1958, 19 : 543 et Lénine, 1958, 20 : 39, 50.
19. Lénine, « La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes », édition 1958, 22:145.
20. Hobsbawm, édition 1991 : 8-11.
21. Hobsbawm, édition 1991 : 133.
22. Hobsbawm, édition 1991 : 163, 170, 173,
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le méga-courant de l’Atlantique pourrait s’effondrer plus tôt que prévu

L'affaiblissement des courants dans l'Atlantique aura des effets « dévastateurs et irréversibles » sur de nombreux pays. La fonte rapide des glaciers arctiques pourrait précipiter leur effondrement.
Tiré de Reporterre
25 novembre 2024
Par Vincent Lucchese
On le compare parfois à un titanesque tapis roulant. Un ensemble complexe de courants océaniques qui traversent l'Atlantique — dont le fameux Gulf Stream — et qui charrient environ18 millions de m³ d'eau par seconde, soit plus de dix fois le débit cumulé de tous les fleuves du monde. Appelé « circulation méridienne de retournement de l'Atlantique », ou Amoc selon son acronyme anglophone, ce système joue un rôle crucial pour réguler le climat.
Une inquiétude grandit cependant depuis quelques années dans la littérature scientifique : nous aurions sous-estimé son affaiblissement, voire son effondrement à venir. La dernière étude en date, publiée le 18 novembre dans la revue Nature Geoscience par des chercheurs de l'université australienne de Nouvelle-Galles du Sud, conclut que l'Amoc pourrait perdre 30 % de sa puissance dès 2040, soit vingt ans plus tôt que les précédentes estimations.
« Cela pourrait entraîner de gros changements pour le climat et les écosystèmes, dont un réchauffement accéléré dans l'hémisphère sud, des hivers plus rigoureux en Europe et un affaiblissement des moussons tropicales dans l'hémisphère nord », préviennent les auteurs.
La fonte des glaciers perturbe l'océan
En 2023, une étude publiée dans Nature Communicationsestimait quant à elle que l'Amoc avait carrément une probabilité de 95 % de s'effondrer d'ici 2095. Et le 21 octobre dernier, une quarantaine de chercheurs issus de nombreux pays signaient une lettre ouvertealertant les pays du Conseil nordique du risque que nous ayons « grandement sous-estimé » la possibilité d'un affaiblissement, voire d'un effondrement de l'Amoc, lequel aurait des impacts « dévastateurs et irréversibles » pour de nombreux pays.
Dans son sixième rapport d'évaluation, publié en 2021 et résumant l'état de la science en la matière, le Giec [1] notait pourtant, avec un degré de confiance « moyen », que l'Amoc ne s'effondrerait pas d'ici 2100. Mais une « confiance moyenne » laisse planer un risque inquiétant, soulignent les scientifiques dans leur lettre ouverte. Et les recherches récentes publiées depuis tendent à faire remonter ce risque à la hausse, écrivent-ils.
À l'heure actuelle, la communauté scientifique peine à faire émerger une analyse consensuelle de la situation. Il est généralement admis que lechangement climatiquedevrait affaiblir l'Amoc. Mais à quelle échéance et avec quelle intensité ? Les incertitudes et divergences de vues sur cette question sont à la mesure de l'extrême complexité du phénomène étudié.
Revenons, pour le comprendre, sur le fonctionnement schématique de l'Amoc. L'un de ses moteurs est la plongée vers les abysses des eaux de surface, dans les hautes latitudes. Lorsque les courants chauds venus des tropiques rencontrent les masses d'air froides dans le nord, une partie de l'eau de mer gèle, laissant son sel derrière elle. L'eau restante voit ainsi sa concentration en sel augmenter. L'eau plus froide et plus salée étant plus dense, elle coule, entraînant le « tapis roulant » de l'Amoc. Cette eau profonde retourne ensuite boucler la boucle vers le sud, où elle remonte et chauffe de nouveau à la surface.

On voit, sur ce schéma de l'Amoc, en rouge les courants de surface, chauds, et en bleu les courants froids circulant en profondeur. © NOAA
Ce système joue un rôle crucial pour redistribuer la chaleur sur le globe, via les échanges entre l'océan et l'atmosphère, et contribue également à la santé des écosystèmes, en transférant des nutriments, du carbone et de l'oxygène à travers l'Atlantique. Le changement climatique perturbe tout cela, notamment en entraînant la fonte massive des glaciers arctiques, au Groenland et au Canada. En se déversant dans l'océan, ce surcroît d'eau douce réduit la salinité, donc la densité et enraye ce moteur de l'Amoc qu'est la plongée des eaux froides en profondeur.
Or, les modèles climatiques actuels ne prennent pas en compte cette fonte additionnelle provoquée par les activités humaines et peinent à reproduire le comportement observé de l'Amoc. C'est en intégrant cette fonte à leur modèle que les chercheurs australiens prétendent aujourd'hui obtenir de meilleures estimations.
D'inquiétantes incertitudes
Plusieurs chercheurs interrogés par Reporterre sont toutefois sceptiques quant aux conclusions péremptoires de cette étude, dont la méthodologie pourrait manquer de rigueur, notamment dans l'estimation du volume d'eau douce issu de la fonte à venir des glaciers. Les travaux de 2023 étaient de même loin de faire l'unanimité.
« Il est très probable que le changement climatique ralentisse l'Amoc au cours du siècle, mais cet affaiblissement est estimé de -10 à -70 % selon les modèles, l'incertitude est énorme », rappelle Didier Swingedouw, directeur de recherche au CNRS, qui étudie de près ces courants atlantiques.
Les simulations numériques modélisant le futur de l'Amoc sont d'autant plus délicates que l'on n'arrive toujours pas à bien représenter le comportement « normal » du phénomène, sans prendre en compte le changement climatique. « L'Amoc résulte d'un équilibre très subtil entre de nombreuses influences. Les zones de mélange entre les eaux chaudes et froides sont en soi difficiles à modéliser. Il faut aussi réussir à représenter les vents qui vont influer sur cette convection, les précipitations et les niveaux d'évaporation qui jouent aussi un rôle sur les caractéristiques de ces eaux », nous liste Didier Swingedouw.
Les facteurs évoluant, il existe une « cascade d'incertitudes ». Pexels/CC/Laura Otte
Pour anticiper le futur, il faut ajouter au défi de la modélisation l'évolution de ces facteurs : comment les tropiques de plus en plus chauds vont augmenter l'évaporation et donc la salinité des eaux chaudes, comment les précipitations vont évoluer aux hautes latitudes et faire à leur tour varier la salinité… « Une cascade d'incertitudes », soupire le chercheur.
Le simple fait de savoir si l'Amoc a d'ores et déjà commencé à ralentir n'est pas établi. D'après la modélisation de l'étude australienne, l'affaiblissement serait de 20 % depuis 1950. Mais ces résultats sont le fruit de reconstitutions numériques : les observations in situ ne sont possibles que depuis 2004, et aucune tendance claire ne s'en dégage. « À partir des observations directes de l'Amoc, ce que nous mesurons est uniquement une forte variabilité saisonnière, interannuelle et interdécennale », mais aucun signal clair lié au climat n'est identifié souligne Sabrina Speich, océanographe au Laboratoire de météorologie dynamique.
Menaces sur l'Afrique et l'Europe
Reste que la tendance semble aller vers des estimations de plus en plus pessimistes. « Avant, on était sur une “confiance forte” que l'Amoc ne s'effondrerait brutalement pas d'ici 2100. Le dernier rapport du Giec est passé à une “confiance moyenne”. Et puis s'arrêter à 2100 est arbitraire. L'Amoc pourrait s'effondrer en 2150. C'est un système lent, son temps d'effondrement est probablement de l'ordre du siècle », souligne Didier Swingedouw, signataire de la lettre ouverte publiée en octobre.
L'enjeu est donc moins aujourd'hui de comprendre si l'Amoc s'affaiblira drastiquement, mais quand il le fera exactement. Dans tous les cas, cela pourrait considérablement refroidir le nord de l'Europe, encerclé par des régions, elles, toujours plus chaudes, conduisant à des « climats extrêmes sans précédent », interpelle la lettre des scientifiques. Cela pourrait « potentiellement menacer la viabilité de l'agriculture du nord-ouest de l'Europe ».
« Les pays de l'Afrique de l'Ouest seraient surtout en première ligne, s'inquiète Didier Swingedouw. Le Sahel pourrait devenir un désert, avec jusqu'à 30 % de baisse de précipitations, et la zone aujourd'hui plus verte au sud du Sahel deviendraient sahéliennes. »
Il y a doublement urgence : à limiter autant que possible l'ampleur du changement climatique, mais aussi à s'y adapter. Pour l'instant, les catastrophes liées à l'Amoc et ses conséquences sur nos sociétés ne sont aujourd'hui ni anticipées ni même sérieusement évaluées, déplorent les auteurs de la lettre ouverte.
La prise de conscience montera peut-être à mesure que les projections climatiques s'affineront à propos de ces phénomènes. Les chercheurs plaident unanimement pour l'accumulation de données et travaux supplémentaires. Les principaux systèmes de mesure in situ de l'Amoc impliquent massivement des instituts de recherches étasuniens, dont l'avenir est suspendu à l'investiture de Donald Trump. Le président étasunien élu envisage de démanteler les agences environnementales, dont la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












