Derniers articles

Israël a assassiné 10% des journalistes de Gaza

Depuis plus d'un an à Gaza, l'armée israélienne assassine des journalistes à Gaza et détruit leurs infrastructures. Aux frontières de l'enclave palestinienne, Israël interdit l'entrée aux journalistes internationaux qui demandent à couvrir l'actualité gazaouie, arrête massivement les journalistes palestiniens en Cisjordanie et dans les territoires de 48, et interdit des médias internationaux comme Al-Jazeera, qui couvre en continu les attaques israéliennes.
Tiré de Agence média palestine
https://agencemediapalestine.fr/blog/2024/11/26/israel-a-assassine-10-des-journalistes-de-gaza/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=israel_a_assassine_10_des_journalistes_de_gaza&utm_term=2024-11-28
Suggestion de lesture d'André Clutier
Par l'Agence Média Palestine, le 26 novembre 2024
Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), qui cite des données du Syndicat des journalistes (PJS) palestiniens, près de 10 % des journalistes opérant à Gaza ont été tués depuis le début des hostilités. Contactée par l'Agence Média Palestine, la porte-parole du PJS Suruq As'ad confirme que le nombre de journalistes palestinien-nes tué-es à Gaza s'élève à 182, auxquels s'ajoutent 164 blessé-es. 136 journalistes ont été arrêté-es à Gaza et en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023, dont 58 sont toujours en détention. 88 établissements de presse palestiniens ont été détruits, dont 73 dans la bande de Gaza.
Dans son allocution au séminaire international des médias sur la paix au Moyen-Orient, qui s'est tenu le 1er novembre à Genève, le secrétaire général des Nations unies a fait remarquer que « le nombre de journalistes tués à Gaza a atteint un niveau sans précédent dans les conflits modernes ». Il a qualifié d'« inacceptable » l'interdiction faite aux journalistes internationaux d'entrer dans la bande de Gaza, soulignant que « les voix des journalistes doivent être protégées et la liberté de la presse défendue ».
Le 16 novembre, le journaliste Mohammed Saleh Al-Sharif a été assassiné par un drone israélien, qui lui a tiré dessus près de l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, rapportent le syndicat des journalistes palestiniens (PJS).
Al-Sharif avait récemment été contraint d'évacuer sa maison dans le quartier de Tal Al-Zaatar, à l'est de Jabalia, en raison des bombardements israéliens en cours, et s'était réfugié chez un parent à Beit Lahia. Les médias locaux indiquent que le journaliste et son cousin rentraient chez eux pour évaluer les dégâts lorsqu'un drone israélien les a pris pour cible. Al-Sharif a saigné pendant deux heures avant de succomber à ses blessures, tandis que son cousin a été tué sur le coup.
Le 19 novembre, l'agence WAFA annonçait la mort violente dans un bombardement israélien d'une enfant et du journaliste Ahmed Abu Sharia, à proximité de la mosquée Al-Iman dans le sud de la ville de Gaza.
Le 23 novembre, le bureau des médias de Gaza a déclaré dans un communiqué de presse la mort du journaliste Wael Ibrahim Abu Quffa, professeur au département du journalisme et des médias de l'Université islamique, qui travaillait également comme journaliste pour la radio éducative du Coran – la Voix de l'Université islamique.
Crimes de guerre
Le comité de protection des journaliste (CPJ) affirmait au début du mois enquêter sur plus de 130 cas de journalistes tué·es par Israël à Gaza, dont la mort semble avoir été délibérée et directement liée à leur profession, ce qui constitue un crime de guerre. Le CPJ ajoute que ces enquêtes sontextrêmement difficiles à réaliser en raison des conditions du terrain.
Une enquête du Guardian révélait hier qu'Israël avait utilisé une munition américaine pour cibler et tuer trois journalistes et en blesser trois autres lors d'une attaque menée le 25 octobre dans le sud du Liban, que des experts juridiques ont qualifiée de crime de guerre potentiel.
Tous trois ont été tués dans leur sommeil lors de l'attaque, qui a également blessé trois autres journalistes de différents médias qui se trouvaient à proximité. L'enquête précise qu'il n'y a pas eu de combats dans la zone avant ou au moment de l'attaque.
« Tout indique qu'il s'agissait d'un ciblage délibéré de journalistes : un crime de guerre. Il était clairement indiqué qu'il s'agissait d'un lieu où séjournaient des journalistes », a déclaré Nadim Houry, avocat spécialisé dans les droits de l'homme et directeur exécutif de Arab Reform Initiative.
Janina Dill, codirectrice de l'Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict (Institut d'Oxford pour l'éthique, le droit et les conflits armés), a déclaré : « Il s'agit d'une tendance dangereuse déjà observée à Gaza : des journalistes sont associé·es à des opérations militaires en raison de leur affiliation supposée ou de leurs tendances politiques, puis semblent devenir la cible d'attaques. Cela n'est pas compatible avec le droit international. »
Cette enquête, qui n'aurait pas pu être réalisée à Gaza en raison des bombardements constants et de l'interdiction faite aux journalistes internationaux de pénétrer dans l'enclave, démontre la dangerosité, l'illégalité des pratiques d'Israël ainsi que la complicité des États-Unis.
Irene Khan, rapporteure spéciale des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, a déclaré : « Le récit du Guardian sur ce qui s'est passé au Sud-Liban correspond au schéma des meurtres et des attaques des forces israéliennes contre les journalistes à Gaza. Les assassinats ciblés, l'excuse selon laquelle les attaques étaient dirigées contre des groupes armés sans fournir aucune preuve à l'appui, l'absence d'enquêtes approfondies, tout cela semble faire partie d'une stratégie délibérée de l'armée israélienne pour réduire au silence les reportages critiques sur la guerre et faire obstacle à la documentation d'éventuels crimes de guerre internationaux »
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Cessez-le-feu au Liban : Quand la guerre asymétrique redéfinit les conflits modernes !

Le mercredi 26 novembre 2024 un cessez-le-feu a été annoncé et entré en vigueur par médiation américaine et française, entre l'armée israélienne et le groupe armé militant Hezbollah « parti du dieu », situé principalement au sud du Liban. Région hostile et théâtre de conflits armés historiques de « guérilla urbaine » entre les deux camps.
Photo Serge d'Ignazio
Cette zone géographique qui s'étend sur les frontières nord de l'Israël est depuis deux mois un champ de bataille ouvert, lors de l'invasion terrestre le 23 septembre 2024 sous le nom « flèches du nord », Dans le contexte de l'intensification de guerre au bande du gaza qui s'été déclenché le 7 octobre 2023, et les tentions amplifiés entre L'Iran et l'état hébreu, qui considère le hezbollah comme un bras armé de l'Iran à la région et sur ses frontières nordiques. Deux puissances régionales antagoniques risquent à mener toute la région du moyen orient dans une guerre sanglante et une situation chaotique à long terme notamment avec les derniers affrontements militaires directe entre Téhéran et Tel-Aviv.
Cet accord aborde un cessez-le-feu de 60 jours durant laquelle le mouvement rébellion doit se retirer des frontières sud vers le nord de la rivière « Litani » à la faveur de l'armée libanaise qui s'y déploie et l'armée israélienne quitte le territoire libanais, un accord sous la surveillance des États Unis.
En effet près 3800 morts selon les chiffres de ministère libanais de la santé depuis le 7 octobre 2023, la majorité depuis fin septembre.
Un défi asymétrique insurmontable ?
L'asymétrie c'est l'opposition de deux adversaires disposant des moyens totalement différents et déséquilibrés où le faible surprend le fort, c'est généralement considérée comme un effort du faible afin d'obtenir une capacité de nuisance supérieure à moindre frais, se positionnant ainsi comme l'égal du puissant. Cas de l'échec israélien durant la guerre du 2006 contre le mouvement rébellion hezbollah également appelé la guerre du Liban. Une redéfinition du conflit, laquelle dans sa version moderne les guerres asymétriques ont bien modifié la perception de la puissance des Etats. La nature de la victoire a elle aussi été modifiée. L'histoire se répète, un mouvement de quelques milliers de soldats peu armés, peu développé technologiquement, mais qui porte une doctrine d'un mouvement insurrectionnelle ayant pour objectif la résistance, avec sa mobilité, connaissance du terrain, soutien local réussit à maintenir en place pour la deuxième fois malgré l'assistanat de ses principaux leaders « Hassan Nasrallah » et « Hachem Safieddine » le 27 octobre 2024 par des bombardements aériens à la banlieue sud de Bierut.
L'armée d'Israël selon les règles de la guérilla est face à un problème de détermination du combattant. Pour elle, tout civil est un insurgé potentiel, ce qui limite sa capacité d'action, la densité du peuple sur les zones de guerre a mis la situation à une grande complexité sans atteindre les objectifs ultimes de son opération militaire qui est la destruction totale des infrastructures militaires du hezbollah, l'élimination de tous ces membres et sécuriser la frontière nord. créant de pertes humains et matérielles ainsi que des critiques de la communauté internationale et la majorité des états membres de l'Organisation des Nations Unies tout en accusant l'Israël par la violation du droit international et de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment avec le gouvernement d'extrême droite de « Benjamin Netanyahou » condamné pour les mêmes accusations par la cour pénale internationale.
Conséquences lourdes :
Selon les chiffres officiels de l'office international des Nations Unies à Genève et Amnesty international plus 3300 personnes ont été tués lors de ce conflit dont 203 enfants et 644 femmes ont perdu la vie, Le déplacement forcé est un enjeu majeur engendrant une crise migratoire en plus de crise humanitaire.
Près de 880 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du Liban, tandis que plus de 510 000 ont fui vers la Syrie, aggravant une crise humanitaire régionale déjà critique.
Le respect du droit international humanitaire suscite vivement des inquiétudes en raison des violations des droits humains et des frappes disproportionnées dans des zones densément peuplées.
Malgré la multiplication des appels à un cessez-le-feu et à la protection des civils, la situation sur le terrain demeure tragique, alimentant une crise humanitaire qui pourrait se prolonger dans les semaines à venir.
Des défis de reconstruction de Liban et de maintenir une paix durable émergent maintenant pour la communauté internationale, mais quelle sera la capacité de ce système peut être obsolète à pacifier la région et apaiser les tensions géopolitiques ?...
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La révolution syrienne est de retour et elle défie l’ordre macabre des Trump, des Poutine et des Netanyahou !

Jeudi 28 était signé, sous l'égide des États-Unis, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, célébré de part et d'autre comme une victoire, en fait une trêve jusqu'à l'investiture de Trump. C'est sans doute le moment qui fut choisi, le Hezbollah ébranlé tentant de reconstituer son emprise sur le Liban que rejette la plus grande partie de la population, par le HTS, Hayat Tahir al-Cham, pour tenter une percée sur les casernes du régime située à l'ouest d'Alep.
30 novembre 2024 | tiré d'aplutsoc | Photo : Liesse populaire après la libération d'Alep
https://aplutsoc.org/2024/11/30/la-revolution-syrienne-est-de-retour-et-elle-defie-lordre-macabre-des-trump-des-poutine-et-des-netanyahou/
Le HTS est principalement issu d'al-Nosra, armée islamiste apparue postérieurement à l'éclatement de la révolution lorsque celle-ci était privée d'armes. Il était alors liée à al-Qaida et aux monarchies du golfe, qui a alors tenté soit de prendre à revers, soit de contrôler, la révolution – et échouèrent en fait. Par la suite, Daesh, mouvement ennemi du HTS structuré par les anciennes polices politiques formées par le FSB notamment en Irak, a pris le relais de ce rôle contre-révolutionnaire direct, et le HTS, formé en 2017, a à la fois assuré la protection de zones insurgées, tenté de les encadrer tout en reculant sur l'essentiel de l'application de la charia, et servi de relais à l'influence de la Turquie d'Erdogan. Le HTS est puissant dans l'enclave d'Idlib peuplée par les réfugiés mais y est aussi très contesté.
L'opération initiée au matin du 28 a très rapidement connu un succès gigantesque et imprévu. La raison principale en est le degré avancé de décomposition d'un État et d'une armée qui ne paient pas ses hommes, tous conduits à trafiquer et à piller, qui ont immédiatement déserté ou décampé. Des stocks d'armes, y compris russes, ont été saisis tout de suite et ont rendu l'offensive militairement puissante. Et des dizaines de milliers d'hommes, habitants d'Alep qui avaient fui en 2016, dont ceux qui ont à plusieurs reprises manifesté contre le HTS, sont alors arrivés en se réclamant, eux, de l'ASL, Armée Syrienne Libre, le vieux sigle né dans la révolution lorsqu'elle cherchait à s'armer, en 2011. Ce sont eux qui ont investi Alep et ont libéré le centre-ville dans la nuit du 28 au 29.
Ouverture d'une prison pour femmes à Alep : des centaines de femmes détenues retrouvent la liberté.
La libération des prisons a commencé par une prison de centaines de femmes. La foule en liesse, femmes comprises, a rempli les rues, avant que le HTS ne décrète un couvre-feu, accepté en raison des bombardements russes qui ont fait au moins 18 morts, et motivé par le risque d'affrontements avec les FDS – Forces Démocratiques Syriennes, coalition armée formée sous l'égide des États-Unis autour du parti kurde PYD, lié au PKK de Turquie, et à ses milices YPG. FDS qui, au Nord d'Alep, sont imbriquées avec des troupes russes, qui ont effectivement tenté de prendre l'aéroport mais ont renoncé.
Dans la journée du vendredi 29 novembre, l'onde de choc de la libération d'Alep a littéralement fait s'effondrer un peu partout l'armée du régime. En fin d'après-midi, l'Armée syrienne libre était à Hama, et des manifestations insurrectionnelles éclataient dans les régions de Homs et de Deraa. Bachar el Assad s'est rendu à Moscou dès le 28 et y a placé sa famille à l'abri. Des rumeurs contradictoires parlent de son retour, d'affrontements entre garde prétorienne et secteurs de l'armée à Damas, ceci non confirmé à cette heure.
Tels sont, succinctement et pour s'y retrouver, les faits à cette heure.
Maintenant, leur signification : elle est énorme. L'effondrement du régime tortionnaire et cleptomane syrien n'était prévu ni par Téhéran, ni par Tel-Aviv, ni par Washington, ni, surtout, par Moscou. Les Ukrainiens protègent de fait les Syriens d'une intervention russe plus massive, et les Syriens apportent aux Ukrainiens la plus grande aide qu'ils aient en réalité reçue, le jour même où la renonciation à la libération du Donbass dans la guerre actuelle est ouvertement endossée par Volodomyr Zelenski … mais où un Maïdan s'amorce à Tbilissi en Géorgie !
Autant dire que la révolution syrienne contredit tout ce qui se passe, de Gaza au Donbass ! Car Alep, le martyr d'Alep, avait en fait été le départ de ceux de Marioupol puis de Gaza. C'est cette unité de la lutte des classes que le campisme et la « géopolitique » veulent interdire de comprendre.
Les chaînes télé et la grande presse françaises en sont au maximum de la désinformation contre la Syrie. Relent colonial du temps où ils parlaient des fellagas en Algérie, peur de la révolution, inertie de l'appareil d'État français qui aimait les régimes « nationalistes arabes » après 1962, désinformation poutinienne profonde et prolongée, et pure et simple bêtise se rejoignent pour raconter partout qu'Alep a été prise par Daesh ou par un équivalent !
Ce mensonge est du même niveau que celui sur les « nazis ukrainiens » et nous allons le retrouver dans la « gauche » campiste qui, rappelons-le, a applaudi au martyre d'Alep en 2015.
Mais ce niveau de mensonge interroge tout de même. La révolution syrienne qui refait irruption, et avec une telle force, un tel panache, est quelque chose d'insupportable à tous les impérialistes – seul Erdogan tentera, avec des contradictions qui se retourneront contre lui, de se renforcer dans le cadre nouveau qu'elle annonce pour toute la région, y compris pour la lutte démocratique et nationale du peuple palestinien. Poutine, Trump, et tous les autres, ne peuvent accepter ce peuple trouble-fête, ce peuple admirable.
Nous devons donc conclure par un avertissement solennel. Si les grands de ce monde, avec l'aide de fait des campistes jusqu'aux anarchistes hypnotisés par « le Rojava » compris, préparent un crime de masse, une intervention armée, un bombardement à la Poutine, ils devront trouver sur leur chemin tous les partisans de la démocratie et de l'émancipation :
BAS LES PATTES DEVANT LA RÉVOLUTION SYRIENNE !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Israël renforce le régime d’apartheid : Les colons juifs bénéficient de l’immunité de détention sans procès

Renforçant le régime d'apartheid israélien, le ministre de la défense, Israël Katz, a annoncé que les colons juifs de la Cisjordanie illégalement occupée ne seraient plus soumis à la détention administrative, un système d'emprisonnement sans procès qui continue d'être largement utilisé contre les Palestiniens.
Tiré d'Israël Palestine Solidarité. Photo : Les colons israéliens mènent des raids à Masafer Yatta © Mohammad Hureini
Cette décision, condamnée par les organisations de défense des droits humains, met en évidence la disparité flagrante entre le traitement réservé par Israël aux Juifs et aux non-Juifs dans les territoires palestiniens occupés. Depuis le 7 octobre 2023, Israël a émis 9 500 ordres de détention administrative à l'encontre de Palestiniens. En revanche, seuls huit colons illégaux ont été détenus en novembre dans le cadre du système d'apartheid israélien.
Selon Haaretz, en juillet, la Knesset a approuvé lors d'un vote préliminaire un projet de loi qui interdirait effectivement la détention administrative, ou la détention sans procès, pour les Juifs, mais autoriserait son utilisation contre les Palestiniens.
La Paix Maintenant, un organisme israélien de surveillance des colonies, a averti que la suppression de cet outil juridique éliminerait effectivement l'un des rares mécanismes disponibles pour freiner la violence des colons. « L'annulation des ordres de détention administrative pour les seuls colons est une mesure cynique qui blanchit et normalise l'escalade du terrorisme juif sous le couvert de la guerre », a déclaré l'organisation, faisant référence à la recrudescence des attaques de colons pendant le conflit entre Israël et le Hamas.
Le ministre de la défense, M. Katz, a justifié cette décision en affirmant qu'il était « inapproprié » de recourir à la détention administrative contre des colons. Cette décision intervient alors que les gouvernements occidentaux, y compris les États-Unis, ont imposé des sanctions aux colons israéliens et aux organisations de colonisation en raison des violences commises à l'encontre des Palestiniens.
Yonatan Mizrahi, directeur de la surveillance des colonies pour Peace Now, a déclaré à l'AFP que si la détention administrative était principalement utilisée contre les Palestiniens, elle constituait l'un des rares outils efficaces pour éloigner temporairement les colons violents des communautés palestiniennes.
Cette décision a été critiquée parce qu'elle renforce le système juridique d'apartheid d'Israël en Cisjordanie occupée, où 3 millions de Palestiniens vivent sous le régime de la loi militaire tandis qu'environ 700 000 colons israéliens bénéficient de la protection de la loi civile israélienne - une situation que les experts juridiques internationaux et les principaux groupes de défense des droits humains qualifient depuis longtemps d'apartheid.
Cette décision intervient alors que la violence des colons fait l'objet d'une attention accrue de la part de la communauté internationale. Le Trésor américain a récemment sanctionné Amana, une importante organisation de développement des colonies, la décrivant comme « un élément clé du mouvement extrémiste israélien de colonisation » ayant des liens avec des acteurs violents en Cisjordanie.
D'anciens responsables militaires israéliens ont également fait part de leur inquiétude, un ancien chef de l'armée israélienne qualifiant cette décision de « grave erreur » qui pourrait conforter les colons extrémistes qui ont intensifié leurs attaques contre les communautés palestiniennes depuis le mois d'octobre 2023.
Aidés par le gouvernement d'extrême droite, les violences et les pogroms perpétrés par les colons israéliens ont déclenché le « plus grand transfert forcé » de Palestiniens depuis le 7 octobre.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Guerre contre Ghaza : Israël continue de semer la mort

De nouveaux bombardements israéliens ont tué au moins 15 personnes dans la bande de Ghaza, a rapporté, hier, l'agence de presse Reuters.
Tiré d'El Watan.
Une frappe sur une maison du camp de Nusseirat, dans le centre de l'enclave palestinienne, a fait 6 morts, et une autre en a fait 3 dans la ville de Ghaza, selon le personnel médical palestinien cité par l'agence de presse. Alors que 2 enfants ont été tués par un missile tiré sur un camp de tentes à Khan Younès, dans le sud de la bande de Ghaza, 4 autres personnes sont mortes dans un bombardement à Rafah, près de la frontière avec l'Egypte.
D'après des habitants, l'armée israélienne a fait exploser des blocs de maisons dans les secteurs de Djabaliya, Beit Lahya et Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Ghaza, où l'armée mène, depuis début octobre, des bombardements intenses et ordonne des évacuations forcées, tout en privant la zone d'aide humanitaire.
Dans la nuit de vendredi à samedi, des frappes israéliennes ont tué aussi au moins 32 personnes à Ghaza, selon l'agence Reuters citant des sources médicales. Le ministère de la Santé a annoncé, hier, un nouveau bilan de 44 429 morts dans le territoire palestinien depuis octobre 2023. Au moins 47 personnes ont été tuées au cours des dernières vingt-quatre heures, a-t-il indiqué dans un communiqué.
L'UNRWA suspend la livraison d'aide…
L'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a annoncé, hier, suspendre la livraison d'aide dans la bande de Ghaza depuis un point de passage clé avec Israël, l'acheminement étant devenue « impossible ». « Nous suspendons l'acheminement de l'aide par Kerem Shalom, le principal point de passage de l'aide humanitaire à Ghaza. » « C'est une décision difficile (...) alors que la faim s'aggrave rapidement », a indiqué, sur X, le chef de l'Unrwa, Philippe Lazzarini. La plupart des camions contenant de l'aide humanitaire entrent par le point de passage de Kerem Shalom à la frontière entre Israël et le sud de la bande de Ghaza. Or, « la route qui sort de ce point de passage n'est pas sûre depuis des mois.
Le 16 novembre, un important convoi de camions d'aide a été volé par des bandes armées », a ajouté Philippe Lazzarini. « Nous avons essayé d'acheminer quelques camions de nourritures sur cette même route. Ils ont tous été pris », a-t-il écrit. « L'opération humanitaire est devenue impossible », en cause notamment, selon Lazzarini, le « siège en cours, les obstacles posés par les autorités israéliennes » et le « manque de sécurité » sur les itinéraires. « La responsabilité de la protection des travailleurs humanitaires et du matériel incombe à l'Etat d'Israël en tant que puissance occupante.
Il doit veiller à ce que l'aide parvienne à Ghaza en toute sécurité et s'abstenir d'attaquer les travailleurs humanitaires », a estimé le chef de l'Unrwa, qui appelle à un cessez-le-feu. La bande de Ghaza a sombré dans l'anarchie, avec une hausse de la famine, des pillages généralisés et des viols de plus en plus fréquents dans les camps de réfugiés, alors que l'ordre public s'est effondré, alertaient, vendredi dernier, des responsables onusiens. La plupart des camions entrent par Kerem Shalom avant d'être contrôlés pour des raisons de sécurité. Ces contrôles sont l'une des raisons de la lenteur des livraisons, selon des ONG, mais les autorités israéliennes évoquent l'incapacité de ces organisations à prendre en charge les quantités d'aide.
La pénurie de carburant pour les camions, le mauvais état des routes et les combats dans des zones très denses ajoutent à la complexité des opérations. L'arrêt temporaire des livraisons par l'Unrwa est donc de « très mauvais augure » et « dramatique dans un contexte qui l'était déjà » a réagi Jean-François Corty, président de Médecins du monde, selon lequel « les indicateurs de mortalité sont exponentiels et hallucinants », du fait notamment du manque de nourriture, de médicaments et d'accès à l'eau. Pour Claire Nicolet, chef de mission pour Médecins sans frontières, c'est « catastrophique ». Les livraisons « commerciales ont été arrêtées, il n'y a plus de boulangerie, et l'agence onusienne est la colonne vertébrale de l'aide pour l'approvisionnement en nourriture et matériel », et une partie du médical.
Efforts pour un cessez-le-feu
Sur le front diplomatique, les Etats-Unis « travaillent activement » à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Ghaza, mais « nous n'y sommes pas encore », a déclaré Jake Sullivan, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche. « Il y aura d'autres discussions et consultations, et nous espérons pouvoir conclure un cessez-le-feu avec un accord sur les otages, mais nous n'y sommes pas encore », a déclaré ce conseiller du président américain Joe Biden, sur NBC, selon une retranscription de l'entretien publiée par la chaîne. « Nous travaillons activement pour que cela se produise. Nous sommes très impliqués auprès des acteurs clés dans la région, et il y a de l'activité même aujourd'hui », a-t-il encore déclaré.
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a estimé qu'il y avait des « indications » que des progrès pourraient être faits vers un accord. « Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des signes qu'on pourrait voir à un plus grand degré de flexibilité de la part du Hamas en raison des circonstances, dont l'accord au Liban, mais pas seulement », a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Le gouvernement israélien « a la volonté d'avancer à ce sujet », a ajouté le ministre.
De son côté, l'émir du Koweït a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza lors d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG). « Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat (à Ghaza), à fournir une protection internationale pour les civils innocents et à garantir l'ouverture de corridors sûrs et l'arrivée d'une aide humanitaire urgente » a déclaré l'émir du Koweït, Michal Al Ahmad Al Sabah, aux six membres du Conseil des Etats du Golfe réunis dans son pays. L'émir du Koweït a critiqué une politique de « deux poids, deux mesures dans l'application des lois, chartes et résolutions internationales » ayant « entraîné l'extension de l'occupation israélienne et la déstabilisation » de la région. Pour sa part, le Hamas est « prêt » à discuter « toute proposition » de trêve dans la bande de Ghaza, a assuré, avant-hier, un responsable du groupe palestinien, alors qu'une délégation se trouvait au Caire pour rencontrer des médiateurs égyptiens.
La Maison-Blanche a annoncé, mercredi dernier, un nouvel effort diplomatique des Etats-Unis, avec l'aide de la Turquie, du Qatar et de l'Égypte, en vue d'arracher un accord portant sur un cessez-le-feu à Ghaza et la libération des otages qui y sont retenus. Depuis le début de l'année, une médiation menée par Washington, Doha et Le Caire a multiplié les efforts en vue d'un nouvel accord de trêve et de libération d'otages, mais jusque-là en vain.
« Nettoyage ethnique »
Dans un rare témoignage, l'ancien ministre de la Défense israélien, Moshé Yaalon, a affirmé que l'armée israélienne menait un « nettoyage ethnique » dans la bande de Ghaza, provoquant un tollé au sein de la classe politique. « La route sur laquelle on est entraînés, c'est la conquête, l'annexion et le nettoyage ethnique », a déclaré Yaalon lors d'une interview sur la chaîne privée DemocratTV.
Relancée par la journaliste qui lui a demandé s'il pensait qu'Israël se dirigeait vers un « nettoyage ethnique », Yaalon a répondu : « Que se passe-t-il là-bas ? Il n'y a plus de Beit Lahia, plus de Beit Hanoun, l'armée intervient à Jabaliya et en réalité on nettoie le terrain des Arabes. »
Les réactions n'ont pas manqué de fuser, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qualifiant de « honte » le fait qu'Israël ait eu « un tel personnage comme chef de l'armée et ministre de la Défense ». Le Likoud, le parti du Premier ministre, Benyamin Netanyahu, a réagi dans un communiqué fustigeant Yaalon « dont les propos (…) mensongers sont un cadeau à la CPI et au camp des ennemis d'Israël ».
Moshé Yaalon a été le chef de l'armée israélienne entre 2002 et 2005, juste avant le retrait unilatéral d'Israël de la bande de Ghaza. Entré au Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahu, il a été ministre de la Défense et vice-Premier ministre, avant de démissionner en 2016, à la suite de différends avec Netanyahu.
Israël n'a « aucune excuse » sur l'aide humanitaire, selon Berlin
Israël n'a « aucune excuse » pour empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Ghaza, a affirmé, hier, un haut représentant de la diplomatie allemande, à la veille d'une conférence sur le sujet au Caire. Israël doit « tenir enfin ses promesses de fluidifier l'aide humanitaire vers Ghaza et d'accorder un accès humanitaire suffisant à tout moment », a demandé Tobias Lindner, le ministre adjoint aux Affaires étrangères, dans un communiqué publié en amont de son déplacement en Egypte. « Il n'y a aucune excuse pour cela. Le droit d'Israël à la légitime défense trouve ses limites dans le droit international humanitaire », a-t-il souligné. La ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avait tenu des propos similaires début novembre, reprochant à Israël d'échapper « constamment » à ses engagements. L'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a annoncé, hier, suspendre la livraison d'aide dans la bande de Ghaza depuis un point de passage clé avec Israël, l'acheminement étant devenu « impossible ». R. I."
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Toute l’histoire des injustices du sionisme dans un village bédouin

La destruction d'Umm Al-Hiran illustre la vision sioniste des Palestiniens, considérés comme des pièces d'échecs mobiles dans un jeu d'ingénierie démographique.
Tiré d'Agence médias Palestine.
La semaine dernière, l'État d'Israël a accroché à sa ceinture le scalp d'une autre communauté palestinienne après avoir achevé la démolition d'Umm Al-Hiran. Le matin du 14 novembre, des centaines de policiers ont pris d'assaut le village bédouin – situé dans le désert du Néguev/Naqab, dans le sud d'Israël – accompagnés d'officiers des forces spéciales et d'hélicoptères. Les habitants, des citoyens israéliens qui craignaient depuis longtemps que ce jour arrive, avaient déjà démoli eux-mêmes la plupart des structures du village pour éviter d'avoir à payer de lourdes amendes. Il ne restait plus à la police qu'à détruire la mosquée.
C'est ainsi que deux décennies et demie de lutte juridique pour sauver le village ont pris fin et que les habitants se sont retrouvés sans abri. Si vous voulez comprendre toute l'histoire des injustices commises par le sionisme à l'encontre des Palestiniens – avec toute la discrimination, le racisme, la dépossession et la violence, fondés sur une vision de la suprématie juive et une obsession concomitante de l'ingénierie démographique – vous n'avez qu'à regarder Umm Al-Hiran.
Dans le discours israélo-juif, la destruction d'une communauté bédouine fait à peine sourciller, et encore moins la une des journaux. Après tout, il s'agissait d'un « village non reconnu » – un artifice linguistique qu'Israël déploie pour dépeindre les citoyens bédouins comme des envahisseurs sur leurs propres terres. Le public israélien perçoit la destruction systématique de ces communautés comme une simple mesure de répression à l'encontre de contrevenants. Or, non seulement les habitants d'Umm Al-Hiran n'étaient pas des envahisseurs, mais ils y ont été installés par l'État israélien lui-même.
Avant la création d'Israël, la communauté qui est devenue Umm Al-Hiran vivait dans le nord-ouest du Néguev. En 1952, le gouvernement militaire israélien les a déplacés de force plus à l'est afin de confisquer leurs terres pour la construction du kibboutz Shoval. Quatre ans plus tard, l'État a décidé de les déraciner à nouveau, les poussant vers une zone située juste à l'intérieur de la ligne verte, près de l'extrémité sud-ouest de la Cisjordanie, où ils sont restés jusqu'à la semaine dernière.
Pendant toutes ces décennies, l'État n'a pas pris la peine de réglementer le statut du village. Il n'a pas fourni aux habitants l'infrastructure ou les services de base tels que l'électricité, l'eau, l'éducation ou l'assainissement. C'est la sournoiserie du sionisme mise à nu : priver les habitants palestiniens du Néguev des conditions de vie les plus élémentaires pendant des générations, avant de les remplacer un jour par une communauté juive au nom de la « floraison du désert ».
Le Néguev constitue plus de la moitié du territoire de l'État d'Israël, et de vastes zones sont inhabitées. Pourtant, l'État s'obstine à détruire des villages arabes « non reconnus » pour en construire de nouveaux, juifs. Dans le cas d'Umm Al-Hiran, la nouvelle communauté devait à l'origine porter une version judaïsée du nom du village qu'elle remplaçait : Hiran. Quelqu'un a eu une meilleure idée et elle s'appellera désormais Dror – « liberté ».
Il ne s'agit bien sûr pas d'une nouveauté. Depuis sa création, Israël détruit des communautés palestiniennes et installe des Juifs à leur place. Il a dépeuplé des centaines de villes et de villages palestiniens rien que pendant la Nakba de 1948. Mais l'histoire d'Umm Al-Hiran contient une autre couche de l'attitude d'Israël envers les Palestiniens, qui est essentielle pour comprendre le modus operandi du sionisme : la perception de la présence des Palestiniens comme étant temporaire.
C'est l'une des expressions les plus violentes de la suprématie juive. Les Palestiniens sont considérés comme une poussière humaine qui peut être simplement balayée, ou comme des pièces d'échecs qui peuvent être déplacées d'une case à l'autre conformément au projet interminable d'ingénierie démographique d'Israël entre le fleuve et la mer. C'est un élément essentiel de la déshumanisation de ceux dont l'État lorgne les terres : la conviction profonde que ces personnes n'ont pas de racines et que, par conséquent, les déplacer d'un endroit à l'autre ne peut être considéré comme un déplacement.
De cette manière, il est possible de continuer à ignorer les demandes des habitants des villages d'Iqrit et de Bir'em en Galilée, plus d'un demi-siècle après que la Haute Cour a statué qu'ils devraient être autorisés à retourner sur leurs terres après avoir été expulsés pendant la Nakba ; il est possible de procéder à un nettoyage ethnique généralisé en Cisjordanie sous le prétexte de la sécurité et de l'État de droit ; et il est possible d'ordonner à des centaines de milliers d'habitants de Gaza d'évacuer encore et encore, les transformant en éternels nomades comme le voulait le sionisme – et, pour couronner le tout, de considérer qu'il s'agit d'un acte humanitaire.
L'ingénierie démographique du sionisme ne se limite pas aux Palestiniens. L'histoire de Givat Amal, un quartier mizrahi de Tel Aviv qui a été expulsé de force et démoli en 2021, présente de nombreux parallèles avec l'histoire d'Umm al-Hiran ; là aussi, l'État a contraint une communauté marginalisée à s'installer dans une zone frontalière, sans jamais réglementer son statut ou ses droits sur la terre, et dès que la valeur de cette terre a augmenté, il en a expulsé les résidents par cupidité. Pendant ce temps, des « comités d'admission » approuvés par l'État continuent de faire respecter l'apartheid dans des centaines de communautés juives à travers le Néguev et la Galilée, en veillant à ce que les « bonnes personnes » vivent aux bons endroits.
Mais ce sont les Palestiniens que le sionisme a transformés en un peuple temporaire à l'identité éphémère. C'est l'hypothèse qui est au cœur du plan d'échange de terres défendu il y a dix ans par Avigdor Liberman, qui verrait plusieurs communautés palestiniennes à l'intérieur d'Israël délocalisées en Cisjordanie tandis qu'Israël annexerait certaines colonies : aujourd'hui, les Palestiniens peuvent être citoyens d'Israël, mais demain, d'un simple geste du doigt, ils peuvent cesser de l'être. (Liberman, autrefois considéré comme étant à l'extrême droite de la politique israélienne, est récemment devenu une sorte de héros du centre gauche).
Cette détermination sioniste à arracher les Palestiniens à leur terre est peut-être sous-tendue par une peur intériorisée de leur attachement profond à la terre. C'est peut-être l'illusion que s'ils sont déracinés et jetés d'un endroit à l'autre suffisamment de fois – que ce soit par les marches de la mort à Gaza, le nettoyage ethnique en Cisjordanie, ou la destruction et l'expulsion dans le Néguev – ils finiront par abandonner et partir.
Il y a huit ans, le leader de l'opposition israélienne Yair Lapid écrivait une ode au mouvement Hashomer Hachadash, dans laquelle il disait avec humour qu'« un homme qui plante un arbre ne va nulle part ». Il y a quelque chose de remarquable dans la manière dont le subconscient jaillit parfois du stylo, en dépit de la personne qui le tient. Après tout, l'État sait exactement qui a planté les oliviers que l'armée bombarde à Gaza et que les colons incendient en Cisjordanie. Mais même après des décennies de destruction, d'expulsion et de carnage, le sionisme refuse d'accepter qu'ils ne vont nulle part.
Orly Noy est rédactrice à Local Call, activiste politique et traductrice de poésie et de prose en farsi. Elle est présidente du conseil d'administration de B'Tselem et militante au sein du parti politique Balad. Ses écrits traitent des lignes qui se croisent et définissent son identité en tant que Mizrahi, femme de gauche, femme, migrante temporaire vivant à l'intérieur d'une immigrante perpétuelle, et du dialogue constant entre elles.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : +972
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’ONU a failli à sa mission sur Gaza. Nous devons radicalement décoloniser et réformer cette organisation

Par décolonisation, j'entends un processus de transformation qui intègre les points de vue des communautés marginalisées et les plus touchées.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Bien avant l'investiture du président américain élu Donald Trump en janvier 2025, l'ONU a vu son propre pouvoir, sa crédibilité et même sa pertinence s'atrophier. L'organisation internationale a été confrontée à de nombreux défis depuis sa création en 1945, dans le contexte du chapitre le plus horrible de notre histoire moderne. Pourtant, peu de chapitres de l'ONU ont été plus sombres que celui de son regard docile tandis qu'Israël diffuse en direct le génocide contre 2,3 millions de Palestiniens à Gaza en toute « impunité ».
Le fait que le génocide perpétré par Israël soit armé, financé et protégé de toute responsabilité par de puissants États occidentaux (avec les États-Unis en tête), a rendu cette impunité plus flagrante que jamais. L'hypocrisie occidentale qui consiste à infliger à la Russie un régime de sanctions des plus sévères après son invasion de l'Ukraine en 2022, tout en autorisant pleinement le génocide israélien, vieux de plusieurs décennies de colonialisme, d'apartheid et d'occupation militaire illégale, a également atteint des niveaux sans précédent, rendant dérisoire la prétention de l'Occident à se préoccuper des droits de l'Homme universels. Lors d'un récent débat à l'ONU sur Gaza, le ministre des affaires étrangères indonésien a appelé les États membres à ne pas « enterrer les principes de la Charte des Nations unies et du droit international sous les décombres du double standard, du déficit de confiance et du jeu à somme nulle ».
Le sociologue congolais-américain Pierre van den Berghe a inventé le terme de « démocratie herrenvolk », qui est « démocratique pour la race dominante mais tyrannique pour les groupes subordonnés ». Le principe dystopique que « la force fait le droit » planant sur les ruines et au sein des interminables cadavres palestiniens à Gaza, ainsi que la montée du fascisme aux États-Unis, en Europe et ailleurs, représentent une menace crédible d'un dérapage du monde vers une ère de législation internationale herrenvolk – exercée exclusivement par les puissants oppresseurs contre les dispensables et les opprimés qui osent résister à la soumission et cherchent à s'émanciper. Cette année, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a donné un premier aperçu d'une telle situation en déclarant : « Si vous n'êtes pas à la table du système international, vous serez sur le menu ».
Dans ce contexte, la délivrance de mandats d'arrêt par la Cour pénale internationale (CPI) à l'encontre de Benjamin Netanyahou et de l'ancien ministre du cabinet de guerre Yoav Gallant, le 21 novembre, n'aurait pas pu arriver à un moment plus opportun. Bien qu'elle fasse suite à des dizaines de milliers de cadavres palestiniens, la décision de la CPI donne une lueur d'espoir que les Palestiniens puissent encore obtenir un semblant de justice de La Haye après des années de tergiversations et d'apathie mortelle. De plus, cette décision de la CPI, qui résiste à des années de menaces et d'intimidations de la part d'Israël et des États-Unis, pourrait également contribuer à restaurer, au moins partiellement, la discipline du droit international, alors que de nombreuses parties, en particulier dans le sud mondial, ont quasiment abandonné toute confiance en elle.
Mais il serait irréaliste, voire complètement illusoire, de considérer la décision tardive de la CPI comme le triomphe ultime de la justice sur la force brute. Cela nous transformerait également en témoins d'un spectacle d'inévitabilité déterministe dans lequel notre volonté ne joue aucun rôle. Parmi les nombreuses choses à régler dans ce monde pour mettre fin au génocide à Gaza et empêcher toute puissance de refaire « un Gaza » sur quelconque communauté vulnérable, la décolonisation de l'ONU est peut-être la priorité absolue. L'arrivée imminente d'un destructeur en chef à la Maison Blanche rend cette tâche des plus urgentes.
Par décolonisation de l'ONU, j'entends un processus de transformation qui intègre les perspectives des communautés et des nations marginalisées et les plus touchées, en particulier celles qui souffrent encore du poids de l'héritage colonial, qui se manifeste sous forme de dettes, de développement inégal et de pillage pur et simple des ressources naturelles. Ce processus radical mais progressif vise à réclamer l'ONU en tant qu'héritage de l'humanité au sens large et en tant que seule organisation capable d'incarner les principes de justice, de paix, de dignité humaine et de salut collectif.
Ce processus multi-facettes et exceptionnellement exigeant impliquerait d'aborder les questions d'une représentation véritablement démocratique et inclusive, de l'élimination du pouvoir de veto et de la réorganisation de la structure grossièrement démesurée de l'ONU, pour la rendre plus légère, plus agile, plus efficace et, par conséquent, moins corrompue et moins dépendante des largesses conditionnées de Washington et d'autres capitales occidentales. Après tout, les salaires et les avantages ridiculement élevés que touchent les hauts fonctionnaires de l'ONU, qui sont pour la plupart occidentaux, peuvent contribuer à réduire la pauvreté dans des petites nations.
Le transfert du siège de l'ONU du territoire qui sera bientôt gouverné par Trump vers un territoire plus démocratique et moins autoritaire comme l'Afrique du Sud pourrait être essentiel dans ce processus. Certes, l'Afrique du Sud n'est pas une utopie, mais elle symbolise la victoire de l'humanité et de la démocratie sur une ère impitoyable de colonialisme occidental et d'apartheid, malgré le long chemin qui reste à parcourir pour mettre fin à l'injustice économique et sociale.
En prévision de l'inévitable colère de l'empereur à Washington et de la réduction sévère attendue des contributions américaines à l'ONU, et dans un esprit de décolonisation et de démocratisation, je propose une taxe annuelle progressive de l'ONU qui serait prélevée sur chaque adulte dans le monde, calculée en fonction du PIB par habitant de chaque pays et payée par les États membres au nom de leurs citoyens.
Un citoyen de Singapour ou du Qatar, par exemple, devrait payer beaucoup plus qu'un citoyen du Sud-Soudan ou de l'Afghanistan, mais tout le monde contribue au gouvernement mondial. Cette contribution s'accompagne d'un droit à la parole sur la gouvernance et l'efficacité des Nations unies, afin de préserver leur indépendance et leur pertinence face aux défis les plus persistants de l'humanité, et de refléter véritablement l'aspiration de la majorité de l'humanité pour un monde plus propre, plus sûr, plus durable, moins militarisé, plus juste et plus en paix. Les multinationales seraient régies par des règles strictes qui privilégieraient les peuples et la planète avant la cupidité et les profits sanglants.
Tout cela peut sembler assez idéaliste, voire impossible, vu la dynamique de pouvoir qui règne au sein des Nations unies et dans le monde en général. Mais de nombreux changements dans l'histoire ont commencé par des idées originales, non orthodoxes, qui peuvent sembler impossibles jusqu'à ce qu'elles deviennent possibles. Nous, avec notre autonomie, pouvons les rendre possibles. Avant que la vague montante de fascisme et de folie impériale ne transforme l'ONU en un véritable organisme comateux, avant que davantage de nations ne se retrouvent sur le « menu », nous devons tous imaginer une réalité différente et nous efforcer avec tout notre pouvoir d'y parvenir. Nous n'avons qu'un seul monde.
Source : The guardian
Traduction : SP pour l'Agence Média Palestine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les 49 fois où les États-Unis ont utilisé leur pouvoir de veto contre des résolutions de l’ONU concernant Israël

Rien que pour cette dernière année, Washington a mis son veto à quatre résolutions du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu à Gaza.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Les États-Unis ont mis mercredi dernier leur veto face à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Cette décision marque la 49e utilisation des États-Unis de leur pouvoir de veto à l'encontre de projets de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies concernant Israël.
Le projet de résolution a été présenté par les dix membres élus du Conseil de sécurité et tous les membres, à l'exception des États-Unis, ont voté en sa faveur.
Ce veto marque plus d'un an de soutien diplomatique des États-Unis à Israël dans sa guerre contre Gaza, qui s'est poursuivie le mois dernier par l'invasion du Liban par Israël.
Toutefois, ce soutien diplomatique de Washington à Israël n'est pas nouveau et se poursuit sur une base bipartisane depuis des décennies.
Outre l'aide militaire d'un montant d'environ 3 milliards de dollars qu'ils lui accordent chaque année, les États-Unis sont également le principal allié d'Israël au sein des institutions internationales et ont souvent utilisé leur pouvoir de veto au Conseil de sécurité pour bloquer les mesures diplomatiques visant Israël en raison de leur traitement des Palestiniens.
Premier veto
Selon la Jewish Virtual Library, les États-Unis ont déjà utilisé leur pouvoir de veto 48 fois contre des projets de résolution du Conseil de sécurité concernant Israël depuis qu'ils ont commencé à l'utiliser en 1970.
La première, la résolution S/10784, exprimait une profonde inquiétude « face à la détérioration de la situation au Moyen-Orient » et visait l'agression israélienne à la frontière libanaise.
Rédigée par la Guinée, l'ancien pays de la Yougoslavie et la Somalie, les États-Unis ont été les seuls à s'opposer à la résolution. Le Panama s'est abstenu.
Plusieurs résolutions similaires ont également fait l'objet d'un veto américain au cours des années suivantes. En 1975, année où la guerre civile a éclaté au Liban, la résolution S/11898 demandait à « Israël de renoncer immédiatement à toute attaque militaire contre le Liban ». Là encore, les États-Unis ont été les seuls à voter contre.
En 1982, année qui a vu certaines des plus féroces attaques israéliennes contre le Liban, l'Espagne a présenté un projet de résolution exigeant qu'Israël « retire toutes ses forces militaires immédiatement et sans condition jusqu'aux frontières internationalement reconnues du Liban » dans un délai de six heures. Les États-Unis y ont posé leur veto.
Les États-Unis se sont opposés à des résolutions similaires en 1985, 1986 et 1988. La guerre civile libanaise a pris fin en 1990, mais Israël ne s'est pas retiré du sud du pays avant l'an 2000.
Jerusalem
La question du statut définitif de Jérusalem, dont les accords d'Oslo stipulaient qu'elle ne serait discutée qu'à la fin d'un éventuel accord de paix entre Israël et la Palestine, est depuis longtemps la cible du veto américain à l'ONU.
Le projet de résolution S/12022, présenté en 1976, appelait Israël à protéger les « Lieux saints qui sont sous son occupation ».
La résolution se déclare « profondément préoccupée par les mesures prises par les autorités israéliennes qui ont conduit à la grave situation actuelle, y compris les mesures visant à modifier le caractère physique, culturel, démographique et religieux des territoires occupés ».
Les États-Unis ont été le seul pays à voter contre le projet de texte.
En 1982, le Maroc, l'Iran, la Jordanie et l'Ouganda ont présenté un projet de résolution après qu'un soldat israélien ait tiré sur des croyants, tuant au moins deux d'entre eux, dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.
Ce projet demandait à « la puissance occupante (Israël) d'observer et d'appliquer scrupuleusement les termes de la quatrième Convention de Genève et les principes du droit international concernant l'occupation militaire, et de s'abstenir de toute entrave à l'accomplissement des fonctions établies du Conseil supérieur islamique à Jérusalem ».
Se référant au complexe de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem, le texte qualifie le site de « l'un des lieux les plus saints de l'humanité ».
Le texte a également décrit le « statut unique de Jérusalem et, en particulier, la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse des lieux saints de la ville ».
Un autre projet de texte appelant Israël à respecter les lieux saints musulmans a fait l'objet d'un veto américain en 1986.
Palestine
En 1976, les États-Unis se sont opposés à une résolution appelant Israël à se retirer de tous les territoires palestiniens – dans ce cas, le Royaume-Uni, la Suède et l'Italie se sont abstenus.
Le projet de texte présenté par la Tunisie en 1980 soulignait les « droits inaliénables du peuple palestinien ». Les États-Unis ont voté contre et le Royaume-Uni, la France, la Norvège et le Portugal se sont abstenus.
Les résolutions condamnant les colonies israéliennes (considérées comme illégales selon le droit international), n'ont été bloquées en 1983, 1997 et 2011 qu'uniquement par les États-Unis.
En 2004 et 2006, les États-Unis ont refusé d'appeler Israël à mettre fin aux guerres contre Gaza, qui ont tué des centaines de personnes.
Le dernier combat d'Obama
Fin 2016, après l'élection de Donald Trump mais avant qu'il ne prenne ses fonctions, l'administration américaine de l'ancien président Barack Obama s'est abstenue lors d'un vote sur les colonies israéliennes.
C'était la première fois en quarante ans qu'une résolution de l'ONU condamnant Israël était adoptée.
Les États-Unis avaient pourtant utilisé leur pouvoir de veto contre un vote similaire en 2011, et c'était la seule fois que l'administration Obama avait exercé ce pourvoir lors de sa présidence.
Évoquant l'absence de progrès visible dans le processus de paix, l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Samantha Power, a déclaré : « On ne peut pas à la fois défendre l'expansion des colonies israéliennes et défendre une solution viable à deux États qui mettrait fin au conflit. Un choix s'impose entre les colonies et la séparation ».
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que cette décision était « honteuse » de la part des États-Unis.
Trump attaque l'ONU
La précédente administration Trump a inauguré une nouvelle ère de diplomatie pro-israélienne à l'ONU.
En juin 2018, les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, l'accusant d'avoir un « parti pris chronique » contre Israël.
L'administration Trump a également posé son veto à plusieurs résolutions de l'ONU concernant Israël.
Le 19 décembre 2017, les États-Unis se sont opposés à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui rejetait la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.
Plusieurs mois plus tard, en juin 2018, les États-Unis ont posé leur veto face à une mesure rédigée par le Koweït qui condamnait l'usage de la force par Israël envers les Palestiniens. Les forces israéliennes avaient tué des dizaines de manifestants non violents à Gaza lors des manifestations de la Marche du retour.
Comme dans de nombreux autres cas, les États-Unis ont été les seuls à s'opposer à la résolution.
La guerre d'Israël contre Gaza
Le 7 octobre 2023, le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens de Gaza ont lancé une attaque surprise contre le sud d'Israël, tuant environ 1,140 personnes et en prenant 240 autres en otage.
Israël a répondu en guerre totale et a lancé une violente offensive de bombardements aériens, suivie d'une invasion terrestre de Gaza. À ce jour, les forces israéliennes ont tué plus de 44,000 Palestiniens, selon le bilan officiel communiqué par le ministère palestinien de la santé.
Toutefois, d'autres estimations prudentes estiment que le nombre de morts est beaucoup plus élevé. Une étude publiée dans la revue Lancet estime que le nombre de morts pourrait dépasser les 186,000 personnes.
Depuis le début de la guerre, les membres du Conseil de sécurité ont tenté d'introduire des résolutions appelant à un cessez-le-feu et à la fin des combats à Gaza.
Cependant, ces efforts ont été bloqués à de nombreuses reprises par les États-Unis. Depuis le début de la guerre, Washington a bloqué quatre résolutions différentes appelant au cessez-le-feu.
En outre, les États-Unis ont bloqué une résolution visant à reconnaître la Palestine comme membre à part entière des Nations unies.
De nombreux dirigeants mondiaux ont dénoncé les efforts déployés par les États-Unis pour bloquer un appel au cessez-le-feu au sein de l'administration internationale, et les alliés occidentaux de Washington ont également exprimé leur regret face à la non-adoption de ces mesures.
Source : The Middle East Eye
Traduction : SP pour l'Agence Média Palestine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’UNRWA déclare que seuls 6 % des besoins alimentaires de Gaza sont satisfaits

L'Agence de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a confirmé que les denrées alimentaires qui entrent dans la bande de Gaza ne couvrent que 6% des besoins de la population, a rapporté hier le Centre d'information palestinien.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : La famine sévère se répand au sud de Gaza en raison des attaques et du blocus intensifié d'Israël, empêchant l'entrée des denrées alimentaires essentielles, 23 octobre 2024 © Quds News Network
L'UNRWA a déclaré que l'armée israélienne autorise des quantités limitées de farine et de nourriture à travers les points de passage, qui ne couvrent que 6% des besoins. L'agence a souligné que cette situation a entraîné une grave crise à Gaza, notamment en ce qui concerne l'accès au pain, ce qui a contraint la plupart des boulangeries du sud de l'enclave à fermer leurs portes.
L'agence a ajouté que plus de deux millions de personnes déplacées à Gaza souffrent de la faim, de la soif, de la maladie et de la peur. Les familles sont dans l'impossibilité de se procurer des repas, car les conditions dans les camps de déplacés et les abris restent désastreuses en raison de la faim, du froid et de l'incapacité des organisations internationales à fournir une aide humanitaire adéquate dans un contexte de graves pénuries alimentaires. Elle a appelé à la réouverture totale des points de passage pour permettre l'acheminement des fournitures essentielles afin d'éviter une famine généralisée, la malnutrition et les maladies étant déjà présentes.
Le nord de Gaza subit des conditions particulièrement difficiles, a déclaré l'UNRWA, avec une pénurie critique d'eau potable, de médicaments et de nourriture. La poursuite du blocus de l'aide humanitaire, associée aux frappes aériennes, aux tirs d'artillerie, au nivellement des terres et aux démolitions, a aggravé la crise humanitaire.
L'armée d'occupation israélienne poursuit sa guerre agressive contre Gaza depuis 415 jours consécutifs. Au moins 44 000 Palestiniens ont été tués et 105 000 blessés, principalement des femmes et des enfants. On estime à 11 000 le nombre de personnes disparues, présumées mortes sous les décombres de leurs maisons et autres infrastructures civiles détruites par les forces d'occupation.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Michel Seymour à Upop : reconnaître le peuple comme une entité au-delà des individus
Santé Québec est là, qu’est-ce que ça va changer ?
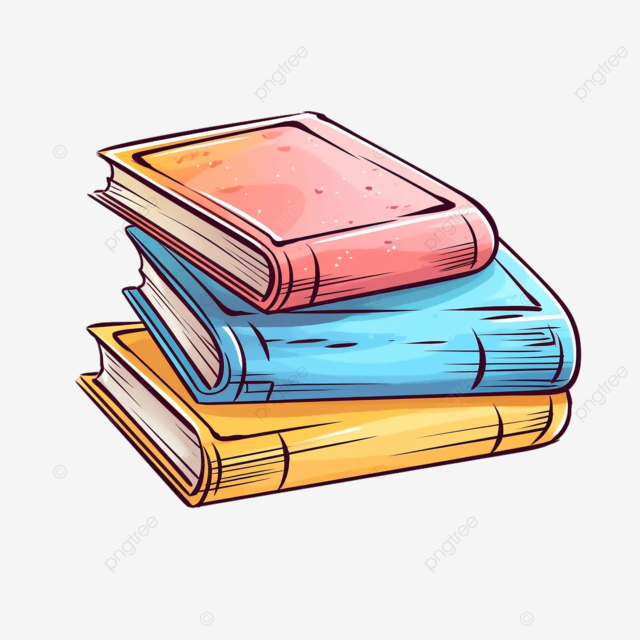
Comptes rendus de lecture du mardi 3 décembre 2024
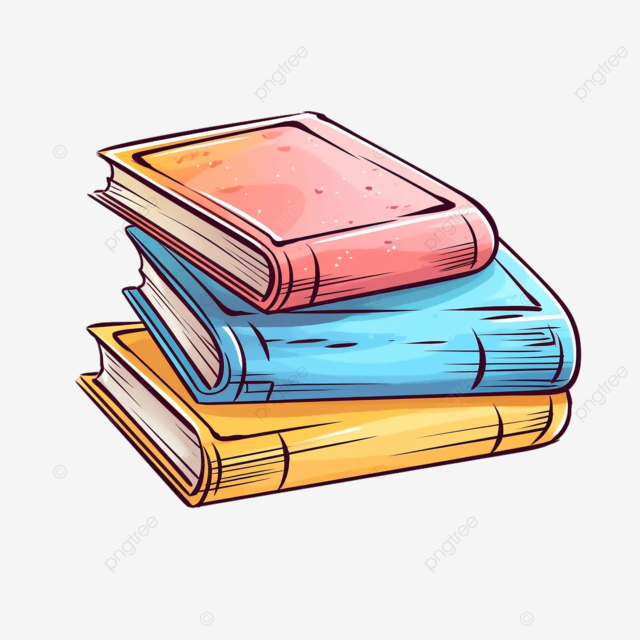

Le mage du Kremlin
Giuliano da Empoli
Ce roman, qui s'est mérité il y a deux ans le Grand prix du roman de l'Académie française et qui aurait dû à coup sûr se mériter le prix Goncourt, est un roman captivant qui nous éclaire avec une lucidité surprenante en cette ère manichéenne sur l'accession au pouvoir du président russe Vladimir Poutine. Il a été achevé en 2021, avant que n'éclate la guerre en Ukraine. Vadim Baranov, personnage fictif parmi de nombreux personnages réels, l'éminence grise du président, nous y confie son histoire jusqu'à ce qu'il se retire de la politique. Une vision un peu exotique et stéréotypée de la vraie Russie peut-être par endroit, selon le chercheur Antoine Nicolle, l'un de ses rares détracteurs, mais un livre éclairant sur les réalités du pouvoir, en Russie et ailleurs, et sur les tractations et véritables intérêts de la politique internationale.
Extrait :
Il faudrait toujours regarder l'origine des choses. Toutes les technologies qui ont fait irruption dans nos vies ces dernières années ont une origine militaire. Les ordinateurs ont été développés pendant la Deuxième guerre mondiale pour déchiffrer les codes ennemis. Internet comme moyen de communication en cas de guerre nucléaire, le GPS pour localiser les unités de combat, et ainsi de suite. Ce sont toutes des technologies de contrôle conçues pour asservir, pas pour rendre libre.

La société de provocation
Dahlia Namian
Je vous recommande vivement la lecture de cet essai sur l'obscénité des riches. L'auteure y fustige leur exhibitionnisme, leur démesure, leur luxe ostentatoire, leur aveuglement et leur parfait égoïsme, attitudes qui contribuent à priver de plus en plus les populations des moyens de satisfaire leurs besoins souvent fondamentaux et à détruire notre environnement commun. L'essai, qui foisonne d'exemples, nous incite assurément à rompre avec cette société de provocation.
Extrait :
Le consumérisme, pur produit exportable de l'American way of life, prône un modèle hédoniste de capitalisme où l'atteinte du bonheur se définit non seulement par la capacité d'accumuler des biens matériels, mais également de fermer les yeux devant l'exploitation des êtres et des ressources qui rendent possible cette consommation effrénée.

Propaganda
Edward Bernays
Traduit de l'anglais
C'est un ami qui m'a ramené ce livre à l'esprit il y a quelques temps. « Propaganda » d'Edward Bernays est un livre essentiel pour bien comprendre la politique et la manipulation. Véritable petit guide pratique écrit en 1928 par Edward Bernays, neveu américain de Sigmund Freud, il expose sans détours les grands principes de la manipulation mentale de masse utilisée depuis et que l'auteur appelait déjà en son temps la fabrique du consentement. Ce document fort instructif nous apprend que la propagande politique moderne n'est pas née dans les régimes totalitaires, mais au cœur même de ce que l'on considère trompeusement la « démocratie américaine » Je me répète, mais « Propagande » est une œuvre essentielle, surtout en cette époque ou tout devient une affaire de perception.
Extrait de la préface de Normand Baillargeon :
Il est crucial de rappeler combien ce qui est proposé ici contredit l'idéal démocratique moderne, celui que les Lumières nous ont légué, de rappeler à quel point Bernays, comme l'industrie qu'il a façonnée, doit faire preuve d'une étonnante aptitude à la duplicité mentale pour simultanément proclamer son souci de la vérité et de la libre discussion et accepter que la vérité sera énoncée par un client au début d'une campagne, laquelle devra mettre tout en oeuvre - y compris, s'il le faut absolument, la vérité elle-même - pour susciter une adhésion à une thèse ou des comportement chez des gens dont on a postulé par avance qu'ils sont incapables de comprendre réellement ce qui est en jeu et auxquels on ne sent donc en droit de servir ce que Platon appelait de « pieux mensonges ».

La dictature du bonheur
Marie-Claude Élie-Morin
J'ai pris connaissance de cet essai sur la dictature du bonheur dans l'un des feuilletons théoriques d'Alain Deneault sur l'économie. J'ai par la suite été agréablement surpris par l'analyse éclairée que l'auteure y fait de cette société du « bonheur » à tout prix que l'on nous vend sous forme de livres, de formations, de « coachs de vie » et de toute une ribambelle de moyens et de principes ou théories, souvent simplistes, souvent fumeuses et non fondées, non confirmées ou même démenties par des études scientifiques. Marie-Claude Élie-Morin nous y expose aussi les vicissitudes de cette manière de penser qui fait que beaucoup d'entre nous en arrivent à se blâmer d'être malades, malheureux, seuls ou pauvres. Une œuvre fouillée dont je vous recommande la lecture.
Extrait :
La peur aiguise nos sens, nous rend plus alertes et nous aide à trouver des solutions. Sans elle, notre jugement est altéré et nous prenons des risques exagérés, comme conduire ivre, financer des prêts hypothécaires douteux qui mèneront à une crise économique, ou ignorer les changements climatiques… Les émotions dites « négatives » sont essentielles dans nos vies, même si elles n'ont pas bonne réputation et nous font parfois passer un mauvais quart d'heure.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Le livre noir de Gaza », un acte de résistance contre l’indifférence

Un an après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël et la riposte implacable de Tsahal, un ouvrage collectif, coordonné par Agnès Levallois – vice-présidente de l'Institut de Recherche et Études Méditerranée Moyen-Orient –, se dresse comme un monument de papier contre l'oubli. Le Livre noir de Gaza – titre évocateur d'un genre littéraire né des cendres de la Shoah, et utilisé ensuite pour documenter les génocides au Cambodge et au Rwanda – se veut le gardien d'une mémoire fragile : celle du peuple palestinien dont les dirigeants de l'État d'Israël souhaitent effacer, non seulement les souffrances, mais l'existence même.
Tiré de MondAfrique.
Ce Livre noir est un ouvrage exigeant, dur, parfois accablant. En nous mettant face à notre propre responsabilité, à notre humanité devant l'inacceptable et à l'injustice, il doit être pas seulement lu, mais aussi entendu et compris. Cet ouvrage nous lance ce défi : et si l'indifférence était le pire des génocides ; l'oubli la plus grande victoire de l'oppresseur ? Les génocidaires ont déjà perdu la bataille contre l'oubli. Notre résistance mémorielle sera la plus forte.
Documenter l'indicible
Face à l'immonde barbarie subie le 7 octobre 2023, crime abominable qui ne peut être ni excusé, ni oublié, l'État d'Israël avait le devoir de se défendre face aux attaques du Hamas : « Pourtant comme l'a sobrement résumé Jean‑Louis Bourlanges, président de la commission des Affaires étrangères du Parlement français, « la violence du Hamas est sans excuse, mais pas sans cause ». Remarque de bon sens, bien souvent ignorée, voire criminalisée en tant que justification du terrorisme. » Nonobstant, ce droit est en principe encadré par le droit international, qui impose des limites à l'usage de la force. Les crimes de guerre commis à Gaza, et désormais au Liban (bien que les conflits soient très différents), ne sont pas seulement une tragédie humaine : ils constituent une violation flagrante de ce droit international, dont les dirigeants de l'État israélien devront rendre compte selon l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024. Mais c'est déjà peine perdue : les États-Unis, la Chine, l'Arabie saoudite n'ont jamais ratifié le Statut de Rome ; la Russie a retiré sa signature en 2016. Tous ces pays ont violé – ou violent encore – de manière manifeste ce droit international, sans être le moins du monde inquiétés par la Cour pénale. Et nous ne parlerons même pas de la trentaine de résolutions de l'ONU qu'Israël a violé ! La vengeance aveugle et la destruction massive n'ont jamais été légitimes. Elles ne font qu'alimenter la spirale de la violence et de la haine, rendant la paix encore plus inaccessible. Mais qu'importe ! Machiavel avait déjà fixé les règles : « Dès l'instant que le salut de l'État est en jeu, aucune considération de justice ou d'injustice, d'humanité ou de cruauté, de gloire ou d'ignominie, ne doit plus intervenir. Tout moyen est bon qui sauve l'État et maintient sa liberté. » Ou, mieux encore, comme le disait Henry Kissinger : « l'illégal, nous le faisons immédiatement ; l'inconstitutionnel, nous y réfléchissons. »

Le brouillard de la guerre
Dès les premières pages, nous sommes frappés par l'ampleur du projet de d'Agnès Levallois : rendre compte d'un événement d'une telle brutalité, survenu dans un territoire étroitement contrôlé et hermétiquement fermé à la presse internationale, relève d'un véritable tour de force. En organisant cet ouvrage, la spécialiste du Moyen-Orient se positionne en archiviste d'un massacre, en gardienne d'une mémoire collective qu'elle refuse de laisser sombrer dans l'oubli, ou d'être déformée par les récits simplificateurs d'une géopolitique manichéenne. Et c'est là toute la force de ce livre collectif : il nous contraint à regarder la réalité de Gaza en face, à la fois dans sa quotidienneté insupportable, et dans l'immensité de ses souffrances.
Au cœur d'un conflit marqué par une propagande intense et la manipulation de l'information, Le Livre noir de Gaza s'impose donc comme un contrepoint nécessaire, une quête de vérité au milieu du brouillard de la guerre. L'ouvrage se propose de documenter méthodiquement les violences infligées à la population civile palestinienne, en s'appuyant sur des sources incontestables : rapports d'ONG telles qu'Amnesty International, Human Rights Watch, Médecins Sans Frontières et Reporters Sans Frontières, enquêtes d'experts indépendants et témoignages de journalistes qui risquent leur vie pour rendre compte de l'horreur quotidienne. L'ouvrage se démarque donc des récits manichéens, des simplifications médiatiques et du sentimentalisme facile. Le choix est fait d'une objectivité chirurgicale : la violence est exposée sans fard ni complaisance, à travers la froideur des chiffres, la précision des rapports et la puissance brute des témoignages, laissant au lecteur la liberté de juger et de se forger sa propre opinion.
Le Livre noir souligne également l'importance de documenter les crimes commis dans l'ombre du silence, non seulement pour rendre justice aux victimes, mais aussi pour empêcher que l'impunité ne devienne la norme, et que l'oubli ne s'abatte sur la conscience collective. Il s'agit d'un acte de résistance contre l'effacement, celui des victimes, celui de la mémoire, et celui de la légitime identité palestinienne.

La polyphonie des voix
Le Livre noir de Gaza se nourrit de la richesse et de la complexité des points de vue recueillis. Ce n'est pas seulement le récit des ONG occidentales qui nourrissent ces pages, mais aussi les voix des ONG palestiniennes et israéliennes, des analystes et des experts issus de divers horizons géopolitiques, offrant une palette de perspectives aussi instructives que nécessaires. Dans Le Livre noir de Gaza, chaque contributeur apporte une perspective unique et essentielle à la compréhension du conflit, enrichissant l'ouvrage par la diversité de ses angles d'analyse.
Par exemple, les contributions sur les droits des enfants mettent en lumière l'impact dévastateur du blocus et des bombardements sur les plus vulnérables, détaillant la souffrance psychologique et physique des jeunes Gazaouis. D'autres textes se concentrent sur l'impact humanitaire, soulignant la difficulté pour les ONG d'accéder à une population coupée du monde et documentant les violations flagrantes du droit international humanitaire. Enfin, l'analyse géopolitique replace la situation de Gaza dans un cadre plus large, expliquant comment ce conflit s'articule avec les dynamiques de pouvoir au Moyen-Orient, les intérêts stratégiques internationaux, et les jeux d'alliances qui perpétuent ce cycle de violence. Ces voix plurielles permettent de dresser un tableau complet et nuancé de la réalité sur le terrain, et leur juxtaposition crée un récit polyphonique qui refuse toute simplification réductrice. Mais ne nous méprenons pas : ce n'est pas le Hamas qui parle ici, ni les dirigeants politiques ou les militants armés, mais les civils ordinaires : des mères de famille, des enseignants, des étudiants qui décrivent comment, jour après jour, ils tentent de préserver un semblant de normalité au milieu de l'horreur. Ils parlent de la difficulté d'envoyer les enfants à l'école lorsque chaque bâtiment peut s'effondrer à tout instant, de l'impossibilité de trouver un emploi lorsque le blocus asphyxie l'économie, de la douleur d'enterrer ses proches sans espoir de justice.
« Gaza, une prison à ciel ouvert. » Cette expression, tant de fois répétée, semble avoir perdu de son sens tant elle est devenue un cliché ; au-dessus de Gaza s'étend le regard impitoyable des drones israéliens, les frappes soudaines et meurtrières de l'aviation, et cette chape de terreur ne laisse aucun répit aux habitants de ce territoire minuscule, compressé entre la mer et la barrière de sécurité. Le livre ne se contente pas de présenter une accumulation de faits. Il s'interroge sur les causes profondes de la violence, et ouvre la réflexion sur les obstacles à une paix juste et durable : le manque de confiance mutuelle, la radicalisation croissante des deux côtés, et l'inaction complice de la communauté internationale, notamment des pays occidentaux, soutiens inconditionnels d'Israël. Le texte se veut également une réflexion sur les modalités de l'information en temps de guerre. L'usage des réseaux sociaux est analysé : ils jouent un rôle ambigu dans ce conflit en permettant à la fois la diffusion d'informations censurées, et la propagation rapide de la propagande et des fausses nouvelles.
L'œil de celui qui a vu, Rony Brauman
La préface d'un ouvrage est comme un seuil ; elle nous invite à franchir une porte, à nous engager sur un chemin parfois ardu, et nous prépare à ce que nous allons découvrir. Dans Le Livre noir de Gaza, c'est Rony Brauman, ancien Président de Médecins Sans Frontières et figure incontournable de l'humanitaire, qui se charge de cet accueil du lecteur. Son regard, forgé par des années d'engagement auprès des victimes de conflits et de crises humanitaires partout dans le monde, est empreint d'une lucidité acérée et d'une profonde humanité. Rony Brauman n'est pas un observateur distant et froid ; c'est un homme qui a vu de ses propres yeux l'horreur, la souffrance, la violence. Et cette expérience l'autorise à parler avec une autorité morale qui ne souffre aucune contestation.
Dès les premières lignes, Rony Brauman déconstruit le récit dominant sur la guerre à Gaza. Il pointe du doigt la tendance médiatique à occulter la réalité quotidienne de l'occupation israélienne et à passer sous silence les violences et les crimes commis contre les Palestiniens « en temps de paix ».
Ce qui est souvent décrit comme une « période calme » en Israël-Palestine – caractérisée par l'absence de morts israéliens – est en réalité une période de violences insidieuses et quotidiennes, que subit la population palestinienne sans pouvoir se défendre : harcèlement des paysans par les colons, destructions de récoltes et d'habitations, expulsions, assassinats arbitraires et arrestations sans procès.
Rony Brauman nous interpelle : comment le monde peut accepter de fermer les yeux sur cette injustice, au nom d'une « stabilité » illusoire et précaire ?
Face à la déshumanisation des Palestiniens, Rony Brauman plaide pour une approche basée sur l'empathie et la reconnaissance de leur souffrance. Il nous rappelle que la victime, avant d'être Palestinienne ou Israélienne, est d'abord humaine. Il dénonce la tendance à juger les Gazaouis à travers le prisme du terrorisme et de l'islam, à oublier que l'histoire et la géopolitique jouent un rôle déterminant dans le cycle de la violence. Il invite à replacer l'attaque du 7 octobre 2023 dans le contexte de l'occupation, du déni des droits des Palestiniens et de l'humiliation qu'ils subissent au quotidien, soulignant ainsi les frustrations et les désespoirs qui conduisent à la radicalisation et à la violence. Cette préface de Rony Brauman n'est pas seulement un plaidoyer pour les victimes, c'est aussi un appel à la conscience. Il interpelle directement le lecteur et le met face à ses propres responsabilités. Sommes-nous prêts à accepter que notre silence et notre inaction nourrissent l'impunité et la barbarie ? Il dénonce l'hypocrisie des gouvernements occidentaux qui se contentent de déplorer les victimes, tout en continuant de livrer des armes à Israël, et en fermant les yeux sur les violations du droit international.
Rony Brauman souligne l'urgence d'un changement radical de l'approche internationale face au conflit. Le soutien aveugle à l'un des belligérants et la minimisation systématique de la souffrance de l'autre sont contre productifs et contribuent à enkyster le conflit dans un cycle sans fin de vengeance et de haine.

L'architecture d'un réquisitoire
Le Livre noir de Gaza ne se veut pas seulement un ouvrage d'information, mais aussi un outil de compréhension, une invitation à la réflexion critique et un appel à la mobilisation contre l'injustice. Sa structure est donc délibérément conçue pour créer un impact sur le lecteur et l'inciter à agir. N'imaginons pas que nous sommes impuissants : La responsabilité cosmopolite, concept philosophique puissant, affirme que chaque individu, en tant que citoyen du monde, possède le devoir moral et la capacité d'agir concrètement contre les injustices internationales, transcendant ainsi les frontières et l'impuissance apparente face aux défis globaux.
Le recueil est donc divisé en sept chapitres thématiques qui détaillent les différentes facettes du drame vécu par les Gazaouis : l'asphyxie progressive d'un territoire en état de siège ; l'effondrement du système de santé et la mort programmée des civils ; la manipulation de l'information et l'éradication du journalisme (ce que la municipalité RN de Perpignan ne s'est pas gênée de faire en refusant de remettre un Prix à un photoreporter palestinien sous un motif fallacieux) ; le ciblage délibéré de la population civile ; la violence démesurée des armes employées et l'invisibilisation calculée des victimes ; la destruction systématique de l'environnement et les perspectives, hélas, sombres pour l'avenir.
Cette architecture savante permet de confronter les analyses, de donner la parole à des voix diverses et de montrer la complexité de la réalité. Le livre se déroule comme une partition musicale, où les notes graves des chiffres et des rapports s'entrelacent avec la mélodie plaintive des témoignages individuels et la puissance percutante de certaines analyses géopolitiques, créant ainsi un réquisitoire implacable contre la violence étatique et l'indifférence du monde. L'ouvrage ne cherche surtout pas à minimiser les violences commises par le Hamas — elle les documente au contraire avec une rigueur impitoyable, mettant en lumière les exactions du mouvement islamiste, ses attaques aveugles et souvent suicidaires contre Israël. Mais ce qui transparaît ici, c'est avant tout l'immense disproportion entre les forces en présence. D'un côté, une milice armée, certes puissante localement, mais dépourvue de moyens militaires sophistiqués ; de l'autre, une armée régulière suréquipée, bénéficiant d'un soutien logistique et diplomatique massif de la part des États-Unis et de l'Europe.
Cette asymétrie, l'ouvrage la décortique en s'appuyant sur des chiffres édifiants : le nombre de victimes civiles, les infrastructures détruites, les écoles et les hôpitaux réduits en cendres sous le prétexte de « frappes ciblées ». La lecture de ces chapitres est accablante : elle dévoile une machine de guerre implacable, guidée par une stratégie qui ne laisse aucune place à la modération ou à la proportionnalité. On s'interroge face à cette logique du « moindre mal » revendiquée par l'armée israélienne, qui prétend minimiser les pertes civiles, tout en infligeant des destructions massives.
Le Livre noir de Gaza s'intéresse aussi à la dimension psychologique de cette guerre. Elle cite les propos glaçants de Yoav Gallant, ministre de la Défense israélien, qui qualifie les Gazaouis d'« animaux humains ». Ce type de déshumanisation n'est pas nouveau, mais dans le contexte actuel, et au regard de l'histoire du peuple juif, il résonne avec une intensité particulière. Le discours officiel israélien, loin de simplement viser le Hamas, s'attaque à l'existence même de Gaza en tant que communauté humaine. La population civile devient un dommage collatéral acceptable dans la « guerre contre la terreur ». Et cette rhétorique trouve un écho dans certaines déclarations de responsables occidentaux, prêts à justifier l'injustifiable au nom de la lutte contre l'extrémisme. Combien Gilles Kepel a été inspiré d'écrire par ailleurs que : « les génocidés sont devenus les génocidaires »…

No pasarán de la mémoire
Le Livre noir de Gaza dépasse le cadre strict du conflit israélo-palestinien pour nous interroger sur des questions d'une portée universelle, telles que : le respect des droits humains dans les zones de conflit ; la légitimité de la force dans les relations internationales ; le rôle et la responsabilité de la communauté internationale face aux crimes de guerre et aux violations du droit international humanitaire ; et enfin les fondements mêmes d'une éthique de la guerre dans un monde gouverné par la loi du plus fort et les intérêts géostratégiques. Car vivre à Gaza, c'est ne pas vivre. C'est survivre dans une condition de vulnérabilité extrême, où la mort est omniprésente, où chaque espace, chaque recoin, peut devenir une cible potentielle. Le Livre noir de Gaza est un cri de résistance qui, face aux forces implacables de l'oubli et de la déshumanisation, résonne comme le « No pasarán » de La Pasionaria : une barrière de mots dressée contre l'avancée inexorable du silence, affirmant haut et fort que, malgré le siège de la mémoire, ceux qui tentent d'effacer l'histoire ne passeront pas.

Bouleversante Ahou Daryaei et toutes les autres aussi !

Même si l'étudiante iranienne Ahou Daryaei a été « libérée » il y a peu, la scène émouvante et tragique où on la voit déambuler crânement en sous-vêtements parmi une foule en apparence indifférente, me bouleverse toujours autant à chaque visionnement. Mais pourquoi donc cette histoire vient-elle tant me chercher, n'ai-je cessé de me demander ? Surtout à notre époque d'instantanéité, où les myriades d'images qui traversent nos écrans fondent aussi vite que des flocons de neige au sol, pourquoi celle-là ?
Sont-ce mes valeurs de justicier social qui sont en cause ? Ma détestation de l'islamisme et toute autre doctrine religieuse intégriste ? Ma fibre d'homme solidaire devant le courage têtu et la détresse palpable de cette femme seule et maltraitée par les milices iraniennes (basij) ?
Chose certaine, et c'est probablement ça, le fait de se déshabiller devant ses assaillants m'est apparu comme un des plus authentiques gestes de révolte et de résistance qui soient. « Vous me voulez bande de salauds ? Eh bien prenez-moi et prenez donc en même temps ma rage et mon mépris ! »
Un geste extrême donc, une parade ultime, qui m'a profondément ému et rappelé (dans une autre vie) le même genre de furieux déshabillages d'amis-es en désintoxication ou en psychiatrie. « Vous me voulez ? Eh bien prenez-moi comme je suis ! » hurlaient ces personnes, chacune à son désespoir et à sa nudité.
Dans la foulée, et même si c'est à un degré beaucoup moindre, la scène d'Ahou m'a rappelé « Olga », une étudiante du temps de mon cégep qui avait été surnommée ainsi à cause de son panache et de ses allures de blonde walkyrie. Cette fille-là était l'une des très rares qui osaient intervenir en assemblée générale et, en dépit des sifflets et des moqueries, elle finissait toujours par amener quelque objection pertinente aux propositions de grève de notre petite clique de contestataires. À force, elle a fini par gagner le respect de tout le monde, et je n'ai jamais oublié ce cran et cette détermination dont elle faisait preuve dans ce monde de gars qu'était le nôtre, au Cégep, il y a plus de cinquante ans. Une brave !
Femmes d'espoir …
De fil en aiguille, c'est l'image d'Olympe de Gouges (Marie Gouze), guillotinée par la Terreur en 1793, qui s'est invitée. Olympe est cette femme politique et dramaturge française à qui on doit notamment la Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne (une critique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen établie en 1789). Non, mais … Sans qu'elle ait nécessairement à se déshabiller devant ces messieurs de la Constituante, lui en fallait-il du courage pensez-vous à cette pionnière du féminisme pour intervenir comme elle en avait l'habitude dans des enceintes où pleuvaient si souvent les insultes et les railleries de toutes sortes ?
Un courage, on l'imagine, qui allait de pair avec son idéal de justice et d'humanisme, le même qui a fait émerger au cours de l'histoire récente les Simone Veil, Rosa Parks, Gisèle Halimi, Anna Politkovskaïa, Mahsa Amini, Malaya Yousafzai, Narges Mohammadi, Manahel al-Otaibi et toutes ces autres femmes qui n'ont jamais craint de déshabiller leur âme pour aller au bout de leurs principes de justice sociale. Des femmes qui sont comme une traînée lumineuse dans un monde obscurci par l'arbitraire et l'injustice et qui n'ont de cesse de nous montrer le chemin de l'espoir, quand sur tous les champs l'avenir s'annonce plus sombre que jamais.
Enfin, même si nous sommes en pleine période des douze jours d'action contre la violence faite aux femmes, le but de ce billet n'était pas de faire une démonstration de vertu ou de pureté morale, que non, mais bien, comme dans la légende du colibri, d'apporter ma goutte de solidarité à toutes ces femmes opprimées de par le vaste le monde. Et puisque que nous avons le « privilège » de vivre en démocratie, plutôt que le cynisme, la lâcheté ou l'indifférence, je nous souhaite simplement de demeurer le plus longtemps possible « bouleversables » face aux iniquités de ce monde.
Sensibles aux injustices, et solidaires de celles et ceux qui ont le courage de s'y opposer !
Gilles Simard, auteur et retraité.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Lettre à ma bergerie : DPJ – Demain Pour Jadis
Se réapproprier le silence dans nos villes
Liban : heureuse trêve ou doux mirage ?
L’indignation, encore et toujours
Éditorial
Le droit à la justice pour les communautés dalits, adivasis et musulmanes en Inde
Entrevue
Jean Morisset : Sur la piste du Canada errant : Essai : Éditions du Boréal : 2018 : 360 pages (recension)
Une langue nouvelle suivi de Nuit étoilée sur Gaza
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











