Derniers articles

Pour un « désarmement mondial synchronisé »

À l'heure où tout s'emballe à l'Est, où des alliances aussi maléfiques que le duo Donald Trump et Vladimir Poutine se nouent, et où nos dirigeants prônent le réarmement, on a voulu prendre le temps d'y réfléchir. Avec Gilbert Achcar, spécialiste en relations internationales et prof à l'Université de Londres, on a parlé des moyens de soutenir l'Ukraine tout en rejetant une guerre généralisée.
Paru dans CQFD n°240 (avril 2025) | Illustré par Alex Less
https://cqfd-journal.org/Pour-un-desarmement-mondial
Les États-Unis, sous la présidence de Trump, menacent de se retirer du Vieux continent. La Russie ne tarit pas d'ambitions impérialistes. La guerre en Ukraine dure depuis plus de trois ans. Et les Européens sont sous pression. Comment analysez-vous la situation ?
« Effectivement c'est un grand chambardement. L'invasion russe de l'Ukraine en 2022 avait initialement redonné vigueur à l'OTAN. Mais on peut aujourd'hui interpréter ce regain comme le chant du cygne d'une organisation déclinante depuis déjà une dizaine d'années. Cela souligne toutefois cruellement la dépendance vis-à-vis des États-Unis dans ce conflit. Et celle-ci concerne autant les Européens que les Ukrainiens.
Côté Russie, depuis trois ans, cet immense pays aux moyens militaires considérables hérités de l'Union soviétique – seul domaine où l'URSS rivalisait vraiment avec l'Occident – n'a toujours pas réussi à s'emparer de tous les territoires annexés en Ukraine. Ce n'est pas une défaite puisque les troupes russes continuent d'avancer à pas de tortue, mais ce n'est clairement pas une victoire.
« Il serait absurde d'envisager sérieusement une invasion russe de l'Europe »
Quant à la menace russe qui pèserait sur l'Europe, rappelons seulement que l'Union européenne (UE) dispose d'une population plus de trois fois plus nombreuse, d'une économie plus de dix fois supérieure et que ses dépenses militaires, en incluant le Royaume-Uni, sont trois fois plus importantes que celle de la Russie – cela malgré le fait que celle-ci soit directement engagée dans une guerre de grande envergure et donc au maximum de ses capacités, contrairement à l'Europe. Dans ces conditions, il serait absurde d'envisager sérieusement une invasion russe de l'Europe. »
Pourtant, à entendre Emmanuel Macron, il existerait une « menace existentielle russe ».
« L'idée avancée par Emmanuel Macron relève davantage d'une manœuvre politique visant à positionner la France comme leader stratégique et protecteur exclusif de l'Europe. Ce positionnement flatte son rôle présidentiel tout en bénéficiant directement à l'industrie militaire française. Mais cette rhétorique est dangereuse car elle nous rapproche précisément des périls qu'elle prétend prévenir. »
Mais il est vrai que la Russie de Poutine, autoritaire, multiplie les ingérences : cyberattaques, tentatives d'influences dans les élections des États européens... Et de l'autre côté de l'Europe, les pays baltes, eux, craignent pour leurs frontières.
« Moscou mène une guerre psychologique et une campagne de désinformation. Mais la meilleure option serait une riposte équivalente : une campagne de rétablissement des faits, à l'adresse de la population russe. En tant que puissance impérialiste, la Russie a certainement des ambitions vis-à-vis des pays baltes. Mais Poutine s'est brûlé les doigts en Ukraine. Même en cas de désengagement américain, il sait qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour affronter l'Europe sur le terrain. »
Un autre argument avancé pour justifier le réarmement européen consiste à affirmer que cela réduirait notre dépendance vis-à-vis des États-Unis.
« C'est vrai. Et vu comme cela, ça paraît positif. D'autant que l'administration étatsunienne prend un virage politique de plus en plus inquiétant et qu'elle multiplie les ingérences en soutenant ouvertement les extrêmes droites européennes.
Mais l'argument est hypocrite. D'abord parce que ceux qui parlent le plus de relocaliser la production en Europe sont les pays possédant déjà une industrie d'armement avancée, comme la France. Pour eux, c'est une aubaine ! Ensuite, les investissements annoncés ne vont pas remplacer les armes américaines par des équipements européens. En réalité, se passer de composants venant des États-Unis ne se fait pas en un claquement de doigts. Ces fonds vont donc surtout servir à augmenter la production !
Enfin, le terme de “réarmement” est en lui-même problématique. Il suggère faussement que l'Europe serait désarmée, ce qui est loin d'être le cas : chaque pays consacre déjà en moyenne 2 % de son PIB à la défense – la Pologne et les pays baltes, bien davantage encore.
Une approche véritablement progressiste consisterait plutôt à œuvrer pour un désarmement mondial synchronisé, comme l'ont préconisé une cinquantaine de prix Nobel de sciences de la nature1, afin d'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pauvreté. »
« Plus qu'une invasion, c'est la possibilité d'une confrontation nucléaire qui m'inquiète »
L'Europe est-elle en train de franchir une ligne rouge qui pourrait entraîner une confrontation plus directe avec la Russie ?
« L'escalade rhétorique et la course à l'armement augmentent les tensions et le risque d'incidents à telle ou telle frontière. Une erreur de trajectoire d'un missile ou une violation accidentelle d'un espace aérien pourrait vite dégénérer.
Mais, plus qu'une invasion, c'est la possibilité d'une confrontation nucléaire qui m'inquiète. Face à ses difficultés en Ukraine, Poutine a déjà menacé plusieurs fois d'utiliser son arsenal nucléaire. Il sait que son pays est la première puissance nucléaire du monde. En face, la puissance nucléaire européenne se résume aux arsenaux de la France et de la Grande-Bretagne. Pas de quoi rivaliser. Poutine pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques (aux impacts plus limités), estimant qu'aucun de ses adversaires n'osera une riposte stratégique (capable de détruire des surfaces immenses). Dans le cadre de la dissuasion nucléaire, c'est surtout la Russie qui dissuade ! »
Vous avez appelé à un référendum dans les territoires ukrainiens annexés afin que les populations décident par elles-mêmes de leur destin. Pouvez-vous en dire plus ?
« Le droit international interdit l'acquisition de territoires par la force, ce que la Russie a pourtant fait en Crimée en 2014 et dans l'est de l'Ukraine en 2022. Mais sur le terrain, la situation est complexe. Dans ces régions, des russophones et des Russes manifestent parfois un sentiment d'appartenance plus fort envers la Russie qu'envers l'Ukraine. En Crimée par exemple, on n'a pas vu de résistance populaire notoire lors de l'entrée des forces russes. Pour éviter davantage d'effusion de sang, je suis donc pour un référendum d'autodétermination, organisé sous l'égide des Nations unies, avec des garanties et sur la base du registre électoral des populations présentes avant l'invasion.
Concrètement, il faudrait que les troupes russes se retirent dans leurs bases durant toute la durée du processus et soient remplacées par celles de l'ONU. Il ne serait pas réaliste d'exiger leur retour préalable aux frontières antérieures à 2022 ou 2014 : un tel scénario serait inacceptable pour la Russie et empêcherait un règlement politique du conflit au long terme. Enfin, le déploiement d'observateurs internationaux garantirait la transparence du scrutin. C'est, à mon sens, le seul moyen pour éviter les rancœurs productrices d'irrédentisme au long cours. Cette approche est démocratique et conforme au droit international. »
Comment conserver une ligne critique vis-à-vis de l'OTAN tout en maintenant une solidarité active envers les Ukrainiens victimes des bombardements ?
« Je pense qu'il faut dans un premier temps reconnaître la légitimité des Ukrainiens à défendre leur pays et les soutenir. Reconnaître et soutenir leur droit à s'armer. Ne pas s'opposer à la livraison d'armes défensives. Et j'insiste sur le terme “défensif” : il s'agit de toutes les armes “anti” – antimissiles, antichars, antiaériennes. Enfin, s'engager dans une pression internationale pour l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination des régions de l'Est ukrainien et de la Crimée.
J'ajoute qu'il serait temps d'arrêter d'ignorer l'éléphant au milieu de la pièce : la Chine. Celle-ci a très tôt manifesté son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais Washington a préféré ignorer cette main tendue et d'emblée accuser la Chine d'être de mèche avec la Russie. Aujourd'hui, les négociations sont menées en Arabie Saoudite entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. Volodymyr Zelensky est isolé, soumis à des pressions qui le poussent à accepter des conditions de paix bien pires que celles que j'ai évoquées. Or la Chine, qui n'a pas intérêt à voir ce conflit se prolonger en tant que grand importateur d'hydrocarbures, pourrait être un allié de taille pour inciter les acteurs à revenir à la table des Nations unies. »
Propos recueillis par Gaëlle Desnos
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Narcissisme et stupidité

Divers mouvements ont contribué à transformer l'ère moderne, notamment une sécularisation, une mondialisation, une métropolisation, une spécialisation accrue, une technologisation et ainsi de suite, reflétant des changements sociétaux et sociaux d'envergure.
L'arrivée de l'Internet constitue assurément un important agent d'impact sur les communications, mais aussi sur la possibilité d'ouvrir les écrans à n'importe qui sur n'importe quoi, peu importe la classe, le genre, la couleur, le niveau d'instruction et de richesse. Dans un retournement de situation perçu comme étant drastique, alors que l'individu s'élève dans le groupe ou plutôt aspire à se réaliser, l'image de soi à partager semble être idolâtrée. En même temps, l'abondance de ces images semble ouvrir autant sur le talent que la stupidité. Mais au narcissisme de l'individu se joint un narcissisme collectif, car ce qui se ressemble s'assemble.
Deux ou trois petites choses au sujet de Narcisse
Narcisse est un personnage de la mythologie grecque. Il était jeune et d'une si grande beauté, qu'il attirait toutes les femmes qu'il croisait. Il était également orgueilleux au point qu'il repoussait l'amour qu'on lui manifestait avec dédain et mépris. Un jour Narcisse voulut se désaltérer à une fontaine. C'est alors qu'en apercevant son reflet dans l'eau, il tomba amoureux, sur le coup, de son propre visage. L'histoire raconte qu'il s'y prit à plusieurs reprises pour saisir cette image de lui-même, mais en vain. Nous reviendrons en conclusion sur le sort que connut Narcisse.
Le règne de Narcisse
Que ce soit dans le vedettariat, l'art, la politique, le sport, une forme de séduction s'impose afin d'attirer le regard et de glorifier des prestations. Il y a toutefois une distinction à apporter entre la performance et l'image. Si dans la société actuelle, la puissance est valorisée, tandis que l'impuissance fait craindre, cela s'explique sur la base d'une image dépeinte dépassant la prestation. Plus encore, elle sert à personnifier la valeur débattue, à élever une personne qui incarnera donc cette image. Mais ce culte de l'image provoque chez le fidèle son pendant pervers : la peur de déplaire, la peur de perdre ses supporters, la peur de ne plus refléter cette puissance. À ce titre s'entrevoit d'ailleurs la valorisation de la jeunesse (de la beauté, de la rigueur, de la force) en voulant ainsi s'éloigner le plus possible de la vieillesse (de la laideur, de l'atonie, de l'impuissance). Selon Gilles Lipovetsky (1993), nous sommes entrés depuis les années quatre-vingt-dix dans l'hyper individualisme. Autrement dit, ce nouveau stade se nomme le « narcissisme », c'est-à-dire « le surgissement d'un profil inédit de l'individu dans ses rapports avec lui-même et son corps, avec autrui, le monde et le temps, au moment où le ‘‘capitalisme'' autoritaire cède le pas à un capitalisme hédoniste et persuasif » (Lipovetsky, 1993, p. 72).
Dans l'ère des écrans et des communications, ce narcissisme s'expose dans la pléthore des diffusions de toute nature, alors que l'acte de communiquer devient plus important que son contenu, alourdissant la masse de propos insignifiants, dans le simple but manifeste de s'exprimer pour s'exprimer. Lipovetsky (1993, p. 23) le dit lui-même à sa façon : « Communiquer pour communiquer, s'exprimer sans autre but que de s'exprimer et d'être enregistré par un micropublic, le narcissisme relève ici comme ailleurs sa connivence avec la désubstantialisation post-moderne, avec la logique du vide ». Or, il y a lieu d'élargir le micropublic, lorsque l'individu possède une position sociale enviée. C'est alors que ses propos prennent des proportions inimaginables et risquent de créer des effets néfastes pour plusieurs individus, voire même des communautés et des sociétés. Narcisse est ainsi placé dans un réseau, cherche à rendre universels ses idéaux et souhaite regrouper sous une force de frappe les individus qui les partagent. Mais la montée des différents Narcisse, dans une société d'individus où chacun peut être en guerre avec chacun, semble faire apparaître de plus en plus des discours extrêmes, intolérants, à la rigueur stupides.
La stupidité humaine
Il faut toutefois relativiser cette précédente impression, dans la mesure où peut-être n'y a-t-il pas plus de stupidité dans notre monde qu'auparavant, mais seulement les moyens de communication et de diffusion permettent de la rendre davantage visible. Néanmoins, nous ne pouvons passer sous silence les avertissements de Carlo M. Cipolla (2012[1976]), exprimés sous la forme de « Lois fondamentales de la Stupidité humaine ». Autrement dit, il ne faut pas sous-estimer le nombre d'individus stupides dans le monde et leur puissance destructrice, mais accepter le fait que la stupidité est la chose la « mieux partagée et répartie dans une proportion constante », éviter de s'y allier et surtout avoir en tête que l'individu stupide est le type le plus dangereux.
Selon Cipolla (2012[1976]), l'humanité se divise entre les crétins, les gens intelligents, les bandits et les stupides. Pour les distinguer, il faut tenir compte des conséquences des actes de chacun : le crétin pose des gestes qui créent un gain pour les autres et non pour lui-même, le bandit vise le gain pour soi au détriment des autres, tandis que la personne intelligente agit de manière à créer un rapport gagnant-gagnant. Et le stupide ? Non seulement crée-t-il une perte (des ennuis, des embarras, des difficultés, du mal) aux autres, mais se nuit en plus à lui-même. Mais il importe de considérer des variantes, par exemple un bandit peut être intelligent ou encore il agit, selon les circonstances, en stupide. De la même façon qu'une personne intelligente peut poser des actes crétins ou bandits, le crétin parvient à agir intelligemment, tout en sombrant aussi dans la stupidité. Peut-on alors envisager un stupide intelligent, bandit ou crétin ? Non. Car il est foncièrement stupide. Cipolla (2012[1976], p. 69) explique ensuite comment la stupidité se veut dangereuse : « Les créatures essentiellement stupides sont dangereuses et redoutables parce que les individus raisonnables ont du mal à imaginer et à comprendre les comportements déraisonnables. Un être intelligent peut comprendre la logique d'un bandit. Les actions du bandit obéissent à un modèle rationnel ; d'une rationalité déplaisante, peut-être, mais rationnel tout de même. » Ce côté rationnel disparaît devant le stupide, capable d'attaquer, sans que nous puissions savoir quand, comment et pourquoi : « Parce que les actions des gens stupides ne sont pas conformes aux règles de la rationalité, il s'ensuit que : a) Leur attaque nous prend en général au dépourvu ; b) Même lorsqu'on prend conscience de l'attaque, nous ne pouvons organiser aucune défense rationnelle, parce que l'attaque est elle-même dépourvue de toute structure rationnelle » (Cipolla, 2012[1976], pp. 70-71). Voilà donc pourquoi l'individu stupide est dangereux, surtout s'il détient le pouvoir.
Comment un stupide atteint le pouvoir
C'est ici que le narcissisme de Lipovetsky se joint à la théorie de Cipolla. Si par le passé, la classe ou toute autre structure sociale (et/ou religieuse) assurait la continuité du gouvernement dans une catégorie comportant un nombre restreint de stupides (royauté, aristocratie), la démocratisation et la politisation de plusieurs groupes ont ouvert la voie à une réalité d'élections. Et l'hyper individualisme fragilise les anciennes mentalités, de façon à donner la parole à des individus prêchant leurs idéaux qu'ils souhaitent généraliser ; d'où aussi une tendance populiste évoquant surtout l'orientation que doit prendre, selon eux, la population afin de réclamer ses aspirations. Mais dans une démocratie, « les élections générales sont un instrument tout à fait efficace pour garantir le maintien d'une fraction […] [proportionnelle de stupides GB et YP] parmi les puissants », soutient Cipolla (2012[1976], pp. 65-66) qui rajoute : « N'oublions pas […] [qu']un pourcentage […] [proportionnel GB et YP] des électeurs est composé d'individus stupides et que les élections leur offrent à tous à la fois une occasion formidable de nuire à tous les autres sans rien y gagner ». Autrement dit, les élections offrent l'occasion à tous les groupes (crétins, intelligents, bandits et stupides) de dire leur mot, et les élu.e.s contiennent aussi leur part de stupides, d'où les chances d'en retrouver un au sommet. Or, il faut aussi additionner dans le camp des stupides, les crétins et les bandits à tendance stupide, ce qui augmente leur puissance.
Un contexte sociétal mérite aussi une attention : les sociétés moins performantes laissent davantage de marges de manoeuvre aux gens stupides. Cipolla (2012[1976], p. 87) souligne en ce sens :
« Que l'on envisage l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes ou l'époque contemporaine, on est frappé de constater que tout pays sur la pente ascendante a son inévitable fraction […] d'individus stupides. Les pays en plein essor comptent aussi un très fort pourcentage de gens intelligents qui réussissent à tenir en respect la fraction […] [proportionnelle de stupides GB et YP] et en même temps à garantir le progrès en produisant assez de gains pour eux-mêmes et pour les autres membres de la communauté. Dans un pays sur la pente descendante, la fraction d'être stupides reste égale à [la proportion de stupides GB et YP] ; cependant, dans le reste de la population, on remarque parmi ceux qui détiennent le pouvoir une prolifération inquiétante de bandits à tendance stupide […] et, parmi ceux qui ne sont pas au pouvoir, une augmentation tout aussi inquiétante du nombre de crétins […] ».
S'il y a un peu de positif, c'est du côté d'un constat historique qui sous-entend un monde actuel pas si différent du passé.
Conclusion
Face à une société plus narcissique, plus ouverte aux propos pouvant même être dérangeants, discriminatoires, intolérants, extrêmes, cela n'empêche point de créer des regroupements… bien que narcissiques. Mais dans une civilisation qui vacille de la sorte, une interprétation complémentaire peut porter sur l'occasion des écrans rendant ainsi visibles des discours crétins, bandits et stupides. Donner le pouvoir à un être stupide est dangereux, redoutable et annonce des périodes très difficiles. Parce que le stupide fait du tort à autrui et à lui-même, se perd dans ses illusions (souvent narcissiques), créant de ce fait une imprévisibilité nuisant à tout le monde. C'est dans la mort que Narcisse se libéra de l'amour de sa propre beauté, de son propre moi. Et aujourd'hui, face à un tel personnage narcissique, peu de choses peuvent servir à le contrer, au point de retenir ce propos de Cipolla (2012[1976], p. 71) citant l'écrivain allemand Friedrich von Schiller : « ‘‘contre la stupidité les dieux mêmes luttent en vains'' ».
Nous, les personnes humaines, sommes inaptes à vaincre au jeu des prédictions face à l'avenir. Nous ne connaissons pas le sort qui attend Donald Trump. Une chose par contre semble certaine à son sujet, à ce moment-ci : il est un être qui colle parfaitement à son époque hyper moderne et en ce sens il est un hyper narcissique.
Guylain Bernier
Yvan Perrier
10 avril 2025
10h50
Références
Cipolla, Carlo M. (2012[1976]). Les lois fondamentales de la stupidité humaine. Paris, France : Presses Universitaires de France.
Hamilton, Edith. (1997[1940]). La mythologie : Ses dieux, ses héros, ses légendes. Paris, France : Marabout.
Lipovetsky, Gilles. (1993). L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain. Paris, France : Gallimard.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le défaitisme révolutionnaire, hier et aujourd’hui

Simon Hannah examine les différentes positions de la gauche après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et la position de Lénine sur le « défaitisme révolutionnaire » au regard de cette guerre en cours.
Tiré de Inprecor 731 - avril 2025
9 avril 2025
Par Simon Hannah
Fraternisation de la foule avec les soldats dans les rues de Petrograd, 1917. © Paris Berlin
Le débat au sein de la gauche à propos de la guerre en Ukraine a mis en lumière de sérieux désaccords sur les questions internationales, dont certains couvaient et se sont approfondis depuis plus d'une décennie. Entre 2001 et 2011, il y avait une unité globale au sein de la gauche sur la question de l'impérialisme et la manière d'y répondre. C'était une période d'attaques explicites et évidentes contre la souveraineté de pays comme l'Afghanistan ou l'Irak par les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres forces impérialistes. Cette agression impérialiste à visage découvert a provoqué des mouvements de masse dans le monde entier contre la prétendue « guerre contre le terrorisme ».
Pour les socialistes, l'attitude face à l'invasion de l'Afghanistan ou de l'Irak était aussi simple que face à l'invasion étatsunienne du Vietnam : s'opposer à la guerre et aussi soutenir le droit de ce peuple à résister à la colonisation. Nous ne choisissons pas si nous défendons (ou non) un pays en raison de la nature de son gouvernement ou de la direction de son mouvement de résistance nationale, pas plus que nous ne rejetons les aspirations nationales des Palestinien·nes à cause de la politique réactionnaire du Hamas. C'est là une position de base, pas même de gauche, mais simplement démocratique bourgeoise : toute nation a le droit à l'autodétermination et aucune autre nation ne peut imposer un changement de régime en utilisant des missiles et des tanks. Ce sont des principes clairs et évidents, tellement évidents que la grande majorité de la gauche s'est unifiée autour d'eux à l'époque.
Une nouvelle forme de campisme
Mais on a connu un début de divergence et une fracturation de la perspective générale à propos de la Lybie en 2011. Au cours du Printemps arabe, il y a eu un soulèvement armé contre Mouammar Kadhafi, mené par différents groupes ethniques, soulèvement dans un premier temps désorganisé et chaotique. C'était la première guerre du 21e siècle, dans laquelle division et subdivision impérialistes sont devenues plus compliquées. Au départ, cela s'expliquait par le rôle joué par les mouvements démocratiques contre des dictatures « anti-impérialistes ». Alors, progressivement, certains au sein de la gauche ont commencé à minimiser le rôle des puissances impérialistes qui ne se situaient pas en Europe occidentale ou en Amérique du Nord, plus précisément la Russie et la Chine.
Sentant l'opportunité de renverser un régime qui avait parfois été une épine dans le flanc de l'Occident, l'OTAN est intervenue pour soutenir le soulèvement et lui fournir un appui aérien pour éviter qu'il ne soit complètement anéanti par les troupes de Kadhafi. Ce n'était pas la célébration d'une révolte populaire par l'impérialisme occidental, mais un calcul pragmatique selon lequel le renversement de Kadhafi était conforme aux intérêts des impérialistes occidentaux. C'était également conforme aux intérêts des Libyen·nes, bien sûr.
Une vision déformée
Et puis, il y a eu la Syrie. Le mouvement pour les droits démocratiques a été brutalement réprimé par le régime de Bachar el-Assad, plongeant le pays dans une guerre civile qui a duré 10 ans. Les impérialistes occidentaux étaient beaucoup moins réticents à intervenir dans cette affaire, alors que l'impérialisme russe aidait généreusement son allié Assad, en fournissant du matériel, des mercenaires, des conseillers militaires et en soutenant financièrement le gouvernement. L'Iran et le Hezbollah sont également intervenus pour écraser le soulèvement populaire. Les États-Unis sont intervenus dans le nord de la Syrie pour prêter main-forte aux Kurdes du YPG (Unités de défense du peuple) en ciblant l'État islamique, tout en se gardant de contribuer à détruire l'armée du gouvernement syrien. Ce conflit a provoqué une énorme scission au sein de la gauche internationale, certains se rangeant du côté du soulèvement des Kurdes, et d'autres du côté du régime d'Assad parce qu'il serait « anti-impérialiste », alors qu'il était en réalité dépendant de l'impérialisme russe. Certains au sein de la gauche étaient ambivalents en ce qui concerne le soulèvement arabe contre Assad, mais très favorables aux Kurdes parce qu'ils les considéraient comme un authentique mouvement de libération nationale doté d'une orientation politique de gauche. Au final, la révolution populaire a été écrasée et certains à gauche ont acclamé la chute d'Alep, le même type de gens « de gauche » que ceux qui ont soutenu l'invasion de la Hongrie par les tanks russes en 1956 pour y renverser le soulèvement des ouvriers.
Le cas de l'Ukraine
La guerre en Ukraine a suscité une vive polémique sur la tactique et la stratégie, et un complet désaccord sur le rôle de l'impérialisme dans ce conflit. Le désaccord essentiel porte sur jusqu'à quel degré l'Ukraine a le droit de se défendre contre l'invasion par une puissance impérialiste. Certains au sein de la « gauche » encouragent la Russie et croient que c'est une guerre engagée par la Russie pour dénazifier l'Ukraine. Je ne vais pas traiter cet argument tellement il est manifestement ridicule. Mais d'autres concluent que parce que l'Ukraine est dans l'orbite occidentale – par exemple, elle a demandé à rejoindre l'OTAN – alors Volodymyr Zelensky et son gouvernement sont des agents par procuration de Washington, Londres, Paris et Berlin. Ils voient donc le conflit comme l'exemple d'une guerre inter-impérialiste entre la Russie et l'Occident qui se bat à travers son subordonné de Kiev.
Les socialistes qui refusent à l'Ukraine le droit de se défendre contre l'invasion par une puissance impérialiste à cause de l'orientation politique du gouvernement ukrainien ont perdu toute compréhension de la question nationale et de la façon dont le peuple d'Ukraine a réellement répondu à l'invasion russe. En pratique, ils s'opposent au droit à l'autodétermination parce qu'ils n'aiment pas le gouvernement ukrainien, ce qui n'est pas pertinent par rapport à la discussion sur les principes. Avec un tel raisonnement, personne ne devrait soutenir les Tigres tamouls, les combattants du Hamas ni même les Républicains irlandais, tous ces mouvements qui ont eu (et ont encore) des positions réactionnaires sur nombre de sujets et étaient pro-capitalistes. Ils se servent aussi de l'excuse selon laquelle l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN pour suggérer qu'elle est elle-même une puissance impérialiste.
Comme l'Ukraine est vue comme agissant par procuration pour l'Occident et qu'elle reçoit des missiles contre les tanks et les avions, certains tracent un signe d'égalité entre la Russie et l'Ukraine et en concluent que les deux côtés doivent perdre. Comment les deux côtés peuvent-ils perdre ? En réalité, ce serait une impasse de longue durée qui durerait des années, avec d'innombrables morts.
Mythes et réalités
D'autres essaient d'être plus nuancés et disent que les peuples d'Ukraine devraient résister, mais qu'ils devraient d'abord renverser leur gouvernement parce que leur gouvernement soutient l'impérialisme américain. Ainsi, prétendent-ils, en face de l'invasion actuelle, alors que les tanks et les véhicules blindés russes foncent sur ses principales villes, la classe ouvrière ukrainienne aurait besoin de former un mouvement des masses avec une conscience de classe. Ils présument qu'un tel mouvement serait révolutionnaire par nature, serait doté d'une compréhension complète du rôle réactionnaire de l'OTAN et de l'impérialisme occidental et réussirait à renverser le gouvernement avant de proclamer un nouveau gouvernement du type de celui de la Commune de Paris. Alors seulement il serait légitime d'impulser une « défense socialiste » du pays. En quoi est-il utile pour le peuple ukrainien qu'en Occident des socialistes souhaitent que sa situation politique soit totalement différente et beaucoup plus favorable ?
En réponse à l'invasion d'une armée, sous le commandement de ceux qui ont supervisé le massacre de la révolution syrienne et la destruction de Grosny, il est pourtant compréhensible que le peuple ukrainien – même ceux qui n'aiment pas Zelensky et se sont opposés à lui et à sa politique – défende son pays et ses communautés contre l'occupation russe. Comme le dit Lénine : « quand le travailleur dit qu'il veut défendre son pays, c'est l'instinct d'un homme opprimé qui parle en lui » (1).
La militarisation
Cependant, c'est clair que le gouvernement Zelenski doit être renversé, exactement comme celui de Poutine, ou celui de Joe Biden, ou celui de Boris Johnson ou celui de Victor Orban, de même que tous les autres gouvernements bourgeois. Et la guerre en Ukraine fournit une chance d'explosion révolutionnaire contre l'ordre existant (2). Mais pour passer de « les Russes sont les envahisseurs, nous devons défendre nos foyers » à « tout le pouvoir au soviet d'Ukraine », il faut un sérieux travail de front unique au côté de la grande masse du peuple ukrainien mobilisé par le gouvernement dans le cadre des unités de défense populaire. Cela signifie être un pas en avant des masses, pas quinze kilomètres en avant.
La création d'unités de défense populaire signifie qu'il existe désormais une milice en Ukraine, milice qui est armée mais avec un entrainement militaire terriblement rudimentaire. Les socialistes qui défendent l'idée de boycotter ces unités sont des pacifistes, même s'ils citent Lénine pour justifier leur position. En réalité, Lénine défendait que la « militarisation » de la société au cours d'une guerre en est l'un des rares aspects positifs : « Actuellement, la bourgeoisie impérialiste militarise, non seulement l'ensemble du peuple, mais même la jeunesse. Demain, elle entreprendra peut-être de militariser les femmes. Nous devons dire à ce propos : tant mieux ! Qu'on se hâte ! Plus vite cela se fera, et plus sera proche l'insurrection armée contre le capitalisme. Comment les social-démocrates pourraient-ils se laisser effrayer par la militarisation de la jeunesse, etc., s'ils n'oubliaient pas l'exemple de la Commune de Paris ? » (3)
Ici Lénine évoque l'armement d'une nation impérialiste, pas d'une semi-colonie ou d'une colonie.
Sur les armes et leur origine
Certains socialistes ont défendu le droit des Ukrainien·nes à résister à l'occupation, mais aussi que les nations impérialistes occidentales ne devraient pas fournir de matériel et d'armements pour les combats. Leur position est que la fourniture d'armes antitanks par Londres modifie fondamentalement le caractère de classe de la résistance nationale et qu'il n'est donc pas possible de fournir des armes aux Ukrainiens. D'autres affirment que les armes ne doivent être fournies qu'aux organisations ouvrières ukrainiennes mais, si ces organisations ne sont pas identifiées et ne sont pas une réalité concrète, il ne s'agit que d'un prétexte pour ne pas fournir un armement plus important au pays. Lorsque l'on est confronté à l'armée russe, l'appel à désarmer l'Ukraine est essentiellement un appel à ce que la Russie puisse triompher plus facilement.
Il faut répéter que l'identité de ceux qui fournissent des armes à un mouvement de libération nationale ou à un pays qui résiste à une invasion impérialiste est secondaire par rapport à la légitimité du combat lui-même. Il était justifié que les Kosovars obtiennent des armes fournies par l'Occident dans les années 90. Il était justifié que la résistance syrienne et les Kurdes obtiennent des armes pendant la révolution syrienne. Ces armes ont-elles été livrées avec des contraintes ? Parfois oui, mais on ne peut ignorer l'autonomie d'un peuple qui mène un combat légitime pour la liberté, au motif des manipulations impérialistes.
Impérialismes et pays dominés
Certains à gauche tiennent apparemment pour acquis que dans le système du monde moderne, l'impérialisme, chaque semi-colonie parmi les plus pauvres se situe dans l'orbite d'un autre pays impérialiste et qu'en conséquence la question nationale est superflue. Il ne s'agit pas là d'une idée nouvelle. Dans la brochure de Junius (4), Rosa Luxemburg affirme que le monde a d'ores et déjà été divisé par l'impérialisme et que, en conséquence, tous les conflits sont à un degré ou à un autre des conflits inter-impérialistes. La question nationale est donc renvoyée au passé et seul le socialisme est maintenant à l'ordre du jour. Le problème est que cette approche ignore totalement toutes les authentiques questions nationales qui pourraient exister, par exemple lorsque votre pays est envahi par une nation beaucoup plus puissante qui se situe juste à votre frontière et dont les dirigeants ont publié des textes affirmant que votre pays est une erreur et ne devrait pas exister (5).
Dans des écrits de 1916, pour partie en réponse à ce type de positions, Lénine affirmait :
« Le fait que la lutte contre une puissance impérialiste pour la liberté nationale peut, dans certaines conditions, être exploitée par une autre « grande » puissance dans ses propres buts également impérialistes, ne peut pas plus obliger la social-démocratie à renoncer au droit des nations à disposer d'elles-mêmes, que les nombreux exemples d'utilisation par la bourgeoisie des mots d'ordre républicains dans un but de duperie politique et de pillage financier, par exemple dans les pays latins, ne peuvent obliger les socio-démocrates à renier leur républicanisme » (6).
Ces questions sont cruciales car nous entrons dans un monde multipolaire dans lequel une analyse basée sur la guerre froide ne fonctionne plus. Alors que la Russie et la Chine déploient leur puissance impérialiste, il y aura de plus en plus de conflits dans lesquels un pays très pauvre ou un groupe ethnique cherchera du secours auprès de l'Occident. Si les socialistes utilisent alors une vision simpliste des relations internationales pour orienter leur réflexion, alors nous serons pris à contre-pied. Nous ne pouvons pas simplement mettre un signe moins là où la bourgeoise occidentale met un signe plus. Nous devons utiliser la théorie pour éclaircir et expliquer, pas pour ériger des barrières en face de la réalité.
Le conflit en Ukraine a aussi vu certains socialistes appeler à la défaite pour les deux côtés du conflit, faisant reposer leur position sur celle défendue par Lénine entre 1914 et 1916. La suite de cet article va examiner ce que cette politique signifie – et ce qu'elle ne signifie pas – en pratique et son utilité pour développer aujourd'hui une politique socialiste cohérente à propos de l'Ukraine.
Que signifie « défaitisme révolutionnaire » ?
Le point de vue de Lénine sur les guerres inter-impérialistes semble assez simple :
« La bourgeoisie de toutes les grandes puissances impérialistes : Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Russie, Italie, Japon, États-Unis, est devenue tellement réactionnaire, elle est tellement animée du désir de dominer le monde que toute guerre de la part de la bourgeoisie de ces pays ne peut être que réactionnaire. Le prolétariat ne doit pas seulement être opposé à toute guerre de ce genre, il doit encore souhaiter la défaite de “son” gouvernement dans ces guerres et les mettre à profit pour déclencher une insurrection révolutionnaire si l'insurrection en vue d'empêcher la guerre n'a pas réussi » (7).
Tout·e travailleur·se ayant une conscience de classe se méfiera des actions de son gouvernement et de sa classe capitaliste dans le cadre d'une guerre, que cette nation soit une nation impérialiste ou non. Dans une guerre impérialiste, tout·e travailleur·se ayant une conscience de classe méprisera les politiciens bellicistes et les appels des patrons à « l'unité dans l'effort de guerre », à travailler plus, à accroître la production, à travailler gratuitement le week-end, à interdire les grèves et les réunions publiques, etc. Vous ne souhaitez pas la victoire de votre gouvernement parce que vous savez qu'il en résultera nationalisme, patriotisme et chauvinisme débridés, qui sont les ennemis du socialisme. Cela lierait les masses à leur bourgeoisie à travers la glorification des succès de la nation, toutes choses qui sapent et diluent la conscience de classe.
Il y a du vrai dans l'idée qu'une guerre impérialiste qui tourne mal contribue à développer la contestation radicale contre un gouvernement. La révolution russe de 1917 a été largement rendue possible parce que la guerre était si désastreuse pour la Russie qu'elle causait une misère indicible dans le pays et que les paysans, envoyés se battre et mourir sur le front, étaient excédés et désiraient la paix. Si la guerre avait bien tourné et que la Russie avait pénétré dans d'autres pays et s'était emparée de nouveaux territoires, tout cela sous la brillante direction du tsar, cela aurait alors créé au sein du peuple un sentiment nationaliste plus important. Et les révolutions de Février et d'Octobre n'auraient sans doute pas eu lieu.
De même, lorsque la guerre du Vietnam a mal tourné pour les États-Unis, le sentiment d'une crise nationale grandissante s'est exacerbé et a approfondi les autres contradictions sociales, s'est articulé avec d'autres thématiques en les radicalisant, et particulièrement la lutte contre le racisme. Le sentiment que le gouvernement est en crise et que son pouvoir impérial faiblit donne un sentiment de force à la classe ouvrière et aux opprimés pour s'organiser et riposter sur d'autres fronts – bien que cela rende aussi la classe dominante encore plus brutale et violente sur le plan intérieur afin de maintenir l'ordre.
Le problème qui surgit, si l'on considère chacun des slogans formulés aux différents moments de la guerre comme un appel pratique et immédiat à l'action, est que cela télescope différents niveaux d'analyse et d'activité. La position de Lénine sur le défaitisme était en grande partie une réaction propagandiste à la trahison du socialisme qu'était la position défensiste, particulièrement lorsque, dans toute l'Europe, les socio-démocrates ont soudainement commencé à soutenir les objectifs de guerre de leur propre gouvernement sous prétexte qu'il s'agissait de conflits « défensifs ». On devait alors contester le slogan de « défense de la mère-patrie » parce qu'il s'agissait clairement d'un mensonge pour promouvoir une guerre d'expansion et d'agression. Une grande partie de la propagande impérialiste à propos de la Première Guerre mondiale reposait sur l'idée que cette guerre avait été déclenchée par quelqu'un d'autre et que chaque pays belligérant ne faisait que se défendre face aux actions de ses voisins belligérants. C'est la capitulation des socialistes devant les buts de guerre impérialistes de leur propre classe dominante que combattait Lénine avec sa politique du défaitisme.
Les formes concrètes du slogan
Il y a une interprétation souple et une interprétation stricte des conclusions pratiques induites par le défaitisme révolutionnaire. Dans une guerre impérialiste, l'interprétation souple consiste à ne pas encourager les buts de guerre de son propre gouvernement et à défendre des slogans principiels comme « pas un sou ni un homme pour la machine de guerre ». Dans l'agitation, on utilise chaque défaite militaire pour souligner que la guerre est vaine, qu'elle provoque un bain de sang inutile, et que le gouvernement doit être renversé pour nous avoir plongés dans ce chaos au profit des grands industriels. On poursuit la lutte des classes – on l'intensifie même, si c'est possible – sans tenir compte des appels à l'unité nationale lancés par des dirigeants syndicaux et des politiciens bourgeois.
Il existe une interprétation plus stricte, à laquelle Lénine a parfois eu recours et qui, pour certains socialistes, est devenue une sorte d'orthodoxie, essentiellement à cause du combat fractionnel qui s'est déroulé au sein du Parti communiste russe dans les années 20. Dans cette conception, vous ne souhaitez pas seulement la défaite de votre gouvernement, vous travaillez activement à la défaite militaire de l'effort de guerre par le sabotage, « l'exécution des officiers », etc. Ainsi, Lénine défendait l'idée que la défaite de la Russie devant l'armée allemande était un « moindre mal » par rapport à une victoire du tsarisme que Lénine considérait comme le gouvernement le plus barbare et le plus réactionnaire d'Europe.
Le problème avec cette vision, comme l'a souligné Hal Draper (8), c'est qu'elle ne correspond pas vraiment à ce que disaient les bolcheviks en Russie ni aux conséquences pratiques du slogan de défaitisme. D'abord, il n'y avait pas réellement d'unité chez les bolcheviks sur la question du défaitisme, dont la signification a varié selon les périodes dans les écrits de Lénine. Beaucoup d'entre eux ont utilisé la formulation souple, sur laquelle il y avait peu de désaccords avec les autres socialistes opposés à la guerre. Mais, dans sa forme plus stricte, le défaitisme n'est pas une politique opérationnelle pour le travail d'agitation au sein de la masse des soldats, mais une réaction polémique à la faillite de tant de socialistes en faveur d'une politique de « défense de la mère-patrie ». Imaginez-vous distribuer des tracts à des conscrits âgés de 19 ans pour leur expliquer que votre politique, pour ce qui les concerne directement, consiste à ce qu'ils rentrent à la maison dans des sacs mortuaires…
Étudions plutôt les positions pratiques que les bolcheviks ont défendues lors des conférences internationales contre la guerre, dont la plus importante fut celle de Zimmerwald : il n'y était pas fait mention du « défaitisme révolutionnaire » et le propos était concentré sur la poursuite de la guerre de classe dans le pays et la politisation de toutes les luttes ouvrières en luttes plus générales contre le capitalisme et l'impérialisme.
« Le prélude à ce combat [pour le socialisme] est le combat contre la guerre mondiale et pour une fin rapide au massacre des peuples. Ce combat nécessite le rejet des crédits de guerre, la sortie des gouvernements, la dénonciation du caractère capitaliste et antisocialiste de la guerre, dans l'arène parlementaire, dans les colonnes des publications légales et, si nécessaire, illégales, en parallèle avec une lutte franche contre le social-patriotisme. On doit s'appuyer sur chaque mouvement populaire qui naît des conséquences de la guerre (appauvrissement, lourdes pertes, etc.) pour organiser des manifestations de rue contre les gouvernements, pour développer une propagande en faveur de la fraternisation dans les tranchées, pour mettre en avant des revendications pour des grèves économiques, et pour redoubler les efforts pour transformer de telles grèves, lorsque c'est possible, en luttes politiques. Le mot d'ordre, c'est : guerre civile, pas paix civile ! » (9)
Théorie et pratique
Si la position de Lénine sur le défaitisme révolutionnaire apporte une certaine clarté, quelle est sa signification sur le terrain ? Lénine met en garde : « Il n'est nullement question de “faire sauter des ponts”, d'organiser des mutineries vouées à l'échec et, en général, d'aider le gouvernement à écraser les révolutionnaires » (10). Qu'en est-il de l'agitation dans l'armée ? C'est un point de vue populaire chez certains socialistes : l'agitation bolchévique dans l'armée aurait été focalisée sur des actions radicales, y compris des appels aux soldats à fusiller leurs officiers ou des appels à ce que des régiments entiers se soulèvent et combattent les troupes loyales au gouvernement et non les puissances étrangères.
Le mot d'ordre de « transformation de la guerre impérialiste en guerre civile » est compris comme une revendication immédiate en direction des soldats et des travailleurs pour qu'ils ouvrent un second front dans leur pays, et luttent pour renverser le gouvernement alors que leur pays est envahi. Néanmoins, c'est une démarche que les socialistes d'aujourd'hui envisagent rarement en termes concrets, tactiques. Ils proclament ce slogan comme un principe, comme si dès le premier jour la revendication immédiate des soldats était de tourner leurs armes contre leur gouvernement. Mais transformer ce slogan révolutionnaire général en revendication tactique lors du déclenchement de la guerre est une posture ultragauche. Tenter de lancer une guerre civile, alors que la conscience de la classe ouvrière est très majoritairement focalisée par le désir de défendre ses droits nationaux, conduit à l'isolement et à la mort de la gauche.
À l'inverse, la politique pratique des bolcheviks dans l'armée était concentrée sur une agitation générale contre le caractère de classe de la guerre, en instruisant les ouvrier·es et les soldats sur ce que signifiait l'impérialisme et en dénonçant les buts de guerre du gouvernement. De la fin 1916 jusqu'à l'été 1917, les bolcheviks ont de plus en plus centré leurs revendications sur les droits des soldats.
De l'antimilitarisme à la révolution
Pour les bolcheviques, en Russie, le point de bascule majeur s'est produit après février 1917 lorsque le tsarisme a été renversé par une révolution populaire et qu'un régime démocratique dirigé par Alexandre Kerenski l'a remplacé et a annoncé qu'il voulait poursuivre la guerre. À gauche, certains sont rentrés dans le rang après Février, défendant l'idée que la tâche était désormais de défendre une Russie plus démocratique contre le Kaiser allemand, maintenant que le caractère du gouvernement avait changé. Cependant, Lénine et ses camarades ont renforcé leur opposition et, quand la guerre a continué, et mal continué, sous Kerenski, c'est cette orientation principielle qui leur a finalement permis d'arracher le pouvoir aux capitalistes en Octobre 1917.
Quel était le matériel que les bolcheviks distribuaient à la veille du Congrès panrusse des soviets en avril 1917 ?
« Tout le pouvoir au Soviet des députés ouvriers et soldats ! Ce qui ne veut pas dire qu'il faille rompre tout de suite avec le gouvernement actuel et le renverser. Tant qu'il est suivi de la majorité du peuple […] nous ne pouvons pas diviser nos propres forces par des mutineries isolées. Jamais ! Ménagez vos forces ! Réunissez des meetings ! Adoptez des résolutions ! » (11)
Il est clair que la stratégie révolutionnaire ne consistait pas en une mutinerie immédiate, ni au refus de combattre débouchant sur un combat révolutionnaire contre le gouvernement bourgeois, mais en un travail patient de construction du soutien aux idées révolutionnaires et anti-guerre.
Finalement, la classe ouvrière, dirigée par des forces révolutionnaires, est arrivée au pouvoir en Octobre, grâce à une politique qui n'était pas « fusillez vos officiers ! » ou une agitation active pour la défaite de l'armée, mais une politique qui réclamait « le pain, la paix, la terre ». De telles revendications ne pouvaient être satisfaites qu'en prenant le pouvoir aux capitalistes russes et aux politiciens libéraux afin d'assurer la paix à un pays épuisé et détruit par la guerre. Pour sortir la Russie de la guerre, les bolchéviks ont immédiatement fait la paix avec l'Allemagne, signant le traité de Brest-Litovsk, un traité très défavorable concédant de vastes territoires pour prix de la paix. Dans le cadre des débats à propos de la ratification du traité de Brest-Litovsk, Lénine a fait la remarque suivante :
« [Kamkov] a entendu dire que nous avons été défaitistes et s'en souvient au moment où nous avons cessé de l'être. […] Nous étions défaitistes sous le tsar, nous ne l'étions plus sous Tsérételi et Tchernov [ministres du gouvernement Kerenski] » (12).
Après la révolution de Février, Lénine a défendu l'idée que les bolcheviks devaient abandonner les slogans en faveur du défaitisme, bien qu'en pratique de tels slogans n'aient existé qu'au niveau propagandiste entre 1914 et 1916 et aient été mis de côté dès 1917. Ils avaient été remplacés par des appels plus concrets et pratiques en faveur des droits démocratiques des soldats et une avancée vers le double pouvoir dans l'institution militaire à mesure que le soulèvement révolutionnaire radicalisait de plus en plus de régiments.
La guerre révolutionnaire de défense
En septembre 1917, même Lénine faisait des déclarations qui n'étaient plus fondées sur le défaitisme révolutionnaire mais qui, pour l'essentiel, plaidaient pour une guerre révolutionnaire de défense, et expliquait comment défendre avec succès le pays contre l'invasion :
« Il est impossible de rendre le pays apte à se défendre sans un sublime héroïsme du peuple accomplissant avec hardiesse et résolution de grandes réformes économiques. Et il est impossible de faire naître l'héroïsme dans les masses sans rompre avec l'impérialisme, sans proposer à tous les peuples une paix démocratique, sans transformer ainsi la guerre criminelle de conquête et de rapine en une guerre juste, défensive, révolutionnaire. » (13)
Cela démontre une fois de plus que Lénine utilisait le mot d'ordre de défaitisme révolutionnaire essentiellement face au tsarisme et avait l'idée qu'une défaite de l'armée du tsar créerait les conditions de son remplacement par un régime plus radical et démocratique. Et sur ce point, il avait raison.
En temps de guerre, les choses vont vite. Lorsque Lénine revient d'exil et commence à parler aux ouvriers et aux soldats russes, il découvre un autre état d'esprit, il est parfaitement raisonnable de ne pas vouloir que son pays soit envahi et occupé, et c'est ce sentiment que Lénine exprime alors, utilisant même le vocabulaire de la guerre révolutionnaire défensive qu'il avait rejeté en avril 1917. Le point crucial était alors de s'opposer aux buts de guerre expansionnistes et impérialistes de la classe bourgeoise.
Conclusions pratiques
Quand un pays impérialiste envahit un pays plus pauvre pour redécouper le monde, défendre le droit de ce pays à résister et défendre son droit à l'autodétermination est une revendication démocratique de base. Même dire que l'on est pour la victoire de la nation la plus petite est une position correcte et de principe.
Même lorsque l'on se situe dans une nation impérialiste et que l'on est envahi par une autre nation impérialiste, alors il est inévitable que la population veuille ne pas être envahie et ne pas être occupée par une puissance étrangère.
Dans les deux cas, les socialistes devraient mener une agitation et une propagande contre la guerre, faire ressortir les contradictions de classe entre d'un côté ce que veulent les impérialistes et de l'autre les travailleurs qui sont envoyés s'entretuer. Nous devrions tisser des liens avec les socialistes qui se trouvent dans le pays envahisseur, organiser des collectifs de base dans l'armée et dans les syndicats et construire des liens entre les ouvriers et les soldats, tout en affirmant clairement que le gouvernement ne parle pas au nom du peuple, qu'il faut mettre fin à cette guerre barbare et que seul un gouvernement socialiste peut l'arrêter.
Le 19 mai 2022
Cet article est paru dans le magazine en ligne Tempest. Traduit par François Coustal. Le terme « socialist », qui signifie pour l'auteur la gauche hors du Labor Party, est tantôt traduite par « la gauche », tantôt par « les socialistes ».
1. « Report at a meeting of bolshevik delegates to the all-russia conference of soviets of workers' and soldiers' deputies april 4 (17), 1917 », Lénine, publié dans la Pravda le 7 novembre 1924.
2. « A strategy for the working class in ukraine », Simon Hannah, Anticapitalist Resistance, 10 mars 2022.
3. « Le programme militaire de la révolution prolétarienne », Lénine, septembre 1916.
4. « La crise de la social-démocratie », Rosa Luxemburg, 1915. Le texte deviendra célèbre sous le nom de « brochure de Junius », pseudonyme utilisé par l'autrice, en référence à un pamphlétaire anti-absolutiste anglais.
5. Article de Vladimir Poutine « sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens », 12 juillet 2021.
6. « La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes », Lénine, janvier-février 1916.
7. « Le programme militaire de la révolution prolétarienne », idem.
8. « Le mythe du “défaitisme révolutionnaire” de Lénine », Hal Draper, 1953-195, New International.
9. « Projet de résolution sur la guerre mondiale et les tâches de la social-démocratie » présenté par la gauche de Zimmerwald, 1915.
10. « De la défaite de son propre gouvernement dans la guerre impérialiste », Lénine, Le Social-Démocrate n°32, 26 juillet 1915, Œuvres complètes, tome 21, p. 284.
11. « Le bolchévisme et la « désagrégations de l'armée », Lénine, Pravda n°72, 16 juin 1917, Œuvres complètes, tome 24, p. 589
12. « Discours de clôture sur le rapport concernant la ratification du traité de paix », 15 mars 1918, Pravda n°49 (19 mars 1918), Œuvres complètes, tome 27, p. 198.
13. « La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer », Lénine, septembre 1917, Œuvres complètes, tome 25, p. 347.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La gauche face à la course européenne aux armements

« Réarmer l'Europe » est le nouveau mot d'ordre des élites politiques européennes. Un nouveau centre d'intérêt qui a même dépassé les vieux dogmes des limites de l'endettement public. Dans ce dossier, Esquerda.net explore une pluralité d'analyses provenant de différents points de la gauche européenne sur cette nouvelle course aux armements. Un dossier organisé par Carlos Carujo.
Tiré de Inprecor
9 avril 2025
Par Carlos Carujo
Soudainement, la politique institutionnelle européenne a trouvé un centre d'intérêt : la course aux armements. Avec Poutine et Trump négociant les dépouilles de guerre en Ukraine et ce dernier indiquant clairement que l'ancienne mission atlantiste des États-Unis ne cadrait pas avec ses nouveaux plans impérialistes, un sentiment de désorientation semblait s'être emparé des classes politiques dominantes du continent. Ce vide a été comblé lorsque la Commission européenne a présenté un plan pour « réarmer l'Europe » au nom de la « sécurité » et contre une menace russe présentée comme imminente. Une décision qui a ouvert une exception millionnaire aux vieux dogmes des limites du déficit et de l'investissement public qui ont dominé le centre continental.
Ce dossier porte sur les réponses de la gauche à ce virage stratégique de la politique de l'Union européenne vers les dépenses liées au commerce des armes. Il comprend ainsi des visions diverses, avec des centres d'intérêt et des portées différenciés, que nous présentons comme des moments d'un débat en cours sur la nature de ce qui est vécu. Les articles présentés ici ne prétendent pas résumer toutes les positions existantes, et ce dossier ne prétend pas être une synthèse. Encore moins a-t-il été pensé comme un recueil d'opinions favorables dans le même sens. Ainsi, comme dans tous les cas d'articles signés, mais à plus forte raison dans ce cas particulier, il convient de souligner que les idées exprimées dans ces textes ne reflètent pas nécessairement les positions d'Esquerda.net.
En outre, il est important de souligner que l'objectif n'était pas de se concentrer sur les spécificités des débats internes aux gauches de chaque pays, mais de visiter des analyses et des arguments plus généraux sur la question. C'est pourquoi sont exclus, par exemple, les débats au sein de la gauche espagnole où le gouvernement est divisé, avec le PSOE s'engageant dans l'armement européen et son partenaire de l'exécutif, Sumar, votant ce jeudi en faveur d'une résolution présentée par le député du Bloc nationaliste galicien, Néstor Rego, contre le plan européen d'augmentation des dépenses militaires et pour la sortie de l'OTAN, auquel se sont joints Bildu et Podemos, avec l'abstention de la Gauche républicaine de Catalogne concernant le point sur l'OTAN.
Est également exclue la polémique suscitée par le vote favorable, ce vendredi, des représentants de Die Linke à la Chambre haute du parlement allemand, le Bundesrat, aux amendements constitutionnels qui mettent fin au frein à l'endettement public dans le cas des dépenses de « défense » et de « sécurité », c'est-à-dire dans les politiques d'armement. Cela va à l'encontre de la position adoptée par la direction du parti et du sens du vote de ses députés à la Chambre basse, le Bundestag.
Il convient de rappeler que le Bundesrat représente indirectement les différents États du pays et est composé de membres nommés par les gouvernements des Länder. En Mecklembourg-Poméranie occidentale et à Brême, Die Linke fait partie de ces gouvernements aux côtés du SPD, et ce sont ces sénateurs qui ont voté, justifiant leur décision par les conséquences en termes de « marge de manœuvre financière » pour la gouvernabilité locale et jurant qu'ils continueront à lutter, non pas contre le paquet d'investissement militaire mais pour l'extension de la fin du frein à la dette aux dépenses sociales.
Cette décision a suscité la révolte des bases (par exemple, une lettre ouverteenvoyée aux sénateurs la veille du vote a rassemblé des milliers de signatures plaidant pour le rejet des modifications constitutionnelles) et ses conséquences politiques ne sont pas encore claires dans un parti qui avait été donné pour mort politiquement et qui a fait un retour politique impressionnant lors des élections législatives du mois dernier à partir d'une campagne de proximité.
La première pièce de ce dossier est la résolution du Bureau national du Bloc de gauchesur la politique internationale, approuvée aujourd'hui, qui voit « l'Europe dans le piège de l'axe Trump-Poutine » et qui défend que « l'impérialisme des États-Unis est encore le plus agressif et constitue une superpuissance que d'autres puissances impérialistes cherchent à combiner avec l'existence de pôles mondiaux » , un processus qui « avance, tantôt par le conflit, tantôt par la coopération entre les pouvoirs et par l'intégration capitaliste transnationale ». Pour le Bloc de gauche, il existe plusieurs impérialismes et « aucun d'entre eux n'aura un rôle progressiste car tous agissent en fonction des intérêts de leurs élites capitalistes ». Par conséquent, « reconnaître cette réalité est vital dans l'élaboration d'une proposition internationaliste capable d'offrir un avenir à l'humanité et de concevoir un ordre démocratique des peuples ».
Pour la compléter, une réflexion de Luís Fazenda sur la façon d'échapper à la spirale du militarisme créée « oblige à une position de rupture avec l'OTAN qui est le cancer du bellicisme ». Pour lui, le contexte rend « beaucoup plus clair pour les Européens que celle-ci ne leur sert pas de protection ».
Miguel Urbán, quant à lui, voit dans cette remilitarisation un « changement de paradigme » et une « stratégie de choc » utilisée « non seulement pour accomplir son objectif de longue date d'intégration militaire européenne, mais aussi pour renforcer un modèle de fédéralisme oligarchique et technocratique » et pour « promouvoir une réindustrialisation européenne selon des lignes militaires ».
La spécialiste de la culture de la paix Ana Villellaspréfère critiquer une militarisation qui ne s'efforce même pas de présenter des preuves qu'elle peut répondre aux menaces qu'elle énonce comme justifications. Selon elle, « s'éloigner de la logique de la force militaire et promouvoir d'autres formes de relations internationales et une architecture de sécurité sur le continent basée sur la sécurité partagée et le droit international exige du courage politique, une vision à court et à long terme et beaucoup de travail de chœur, avec les citoyens eux-mêmes et aussi avec d'autres acteurs d'autres continents ».
La perspective de Daniel Tanurose concentre sur l'idée que le pacte Trump-Poutine vise à diviser l'Europe et à imposer des régimes autoritaires-austéritaires-réactionnaires et belliqueux dans leurs zones d'influence respectives. Et sur la façon dont cela remet en question l'avenir des droits démocratiques et sociaux qui sont nés en Europe aux XIXe et XXe siècles à la suite de la lutte des travailleurs contre l'exploitation capitaliste.
Dans le même sens, Franco Turigliatto croit qu'en ces temps de résurgence du slogan de l'empire romain « si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre », l'unité d'une « Europe différente de la capitaliste et impérialiste » est nécessaire « plus que jamais », ce qui « n'est possible que par l'activité et l'unité des classes travailleuses ».
Pour sa part, Jean-Luc Mélenchon ironise en posant la question : l'après-Trump consiste-t-il à obéir à ses exigences ? Car, révèle-t-il, ce qui a été annoncé comme dépense militaire européenne par von der Leyen est en fait exactement le montant exigé par Trump pour l'augmentation des dépenses militaires des Européens. Il souligne également que la situation tant aux États-Unis qu'en Europe est celle d'une « transition vers une économie de guerre » avec pour objectif d'« inaugurer une ère d'expansion et d'accumulation sans risques pour le capital flottant mondial et pour l'énorme réserve d'épargne disponible » et de « reconstituer la capacité de production industrielle ».
L'idée que nous sommes face à une économie de guerre est contredite par les chiffres dans l'analyse d'Adam Tooze. À travers les graphiques qu'il nous présente, nous suivons l'histoire des dépenses militaires de l'Europe et des États-Unis tout au long de l'histoire contemporaine. Des données avec lesquelles il entend illustrer la conclusion que « cela ne nous servira à rien si nous aggravons notre anxiété en superposant à la réalité actuelle des fantômes et des visions d'une époque dont l'histoire de la violence militaire était encore plus sombre que la nôtre ».
Également du point de vue économique, Thomas Pikettys'efforce de démonter un autre aspect qu'il considère comme un mythe : l'idée du déclin de l'Europe qui aurait besoin de se serrer la ceinture et de réduire les dépenses sociales pour miser sur les dépenses militaires. L'économiste français montre que l'Europe « enregistre des excédents solides de la balance des paiements depuis des années » et que « plus qu'une cure d'austérité, ce dont elle a réellement besoin, c'est d'une cure d'investissement ». Un investissement qui doit être prioritairement dans le bien-être humain, le développement durable et les infrastructures collectives.
Encore un autre économiste, Michael Roberts, se consacre à démonter l'une des versions qui, même à gauche, finit par se convaincre avec le projet de « réarmement ». Il s'agit de l'idée qu'un keynésianisme militaire européen arrive qui améliorerait les conditions de vie de la classe ouvrière, en réindustrialisant le continent. Il montre que, contrairement à ce que disent ses partisans, non seulement ce n'est pas un keynésianisme militaire qui a sorti l'économie des États-Unis de la Grande Dépression, mais que cela ne fonctionne pas comme le pensent ses partisans. Et, en plus et surtout, cela est, au fond, « contre les intérêts des travailleurs et de l'humanité ».
Entre économie et politique, Yanis Varoufakis défend une restructuration institutionnelle européenne face à un système dans lequel « personne n'a de légitimité démocratique pour décider quoi que ce soit ». Concluant que « en l'absence d'institutions pour mettre en œuvre un keynésianisme militaire, la seule façon dont l'Europe peut se réarmer aujourd'hui est de détourner des fonds de son infrastructure sociale et physique en ruine » qui « mènera presque certainement l'UE à un déclin économique encore plus profond ».
En dehors de l'UE, les Britanniques assistent également à une course aux armements. Le député et ancien leader travailliste Jeremy Corbyn dénonce les mesures du gouvernement du parti qui l'a exclu de la militance. Il utilise pour cela le Yémen, où en plus des attaques directes, les armes fabriquées par les Britanniques tuent des civils. Et il plaide pour une « approche adulte de la politique étrangère » qui « analyserait les causes sous-jacentes de la guerre et les atténuerait » au lieu de « choisir d'accélérer le cycle de l'insécurité et de la guerre » et de soutenir « ceux qui profitent de la destruction ».
À partir du même point géographique, Chris Bamberyconsidère que le prix que les Européens devront payer est clair : « plus d'austérité » et « des économies qui ne vont nulle part rapidement », ce qui fera augmenter le rejet des gouvernements centristes qui disaient jusqu'à présent qu'il n'y avait pas d'argent pour les politiques sociales et peut bénéficier à l'extrême droite. Dans sa lecture, il est évident que « Poutine ne va pas envahir la Pologne, les États baltes et encore moins l'Europe occidentale ».
D'un point de vue ukrainien, Hanna Perekhodan'est pas d'accord avec cette considération et entre en polémique directe avec la France Insoumise de Mélenchon. Comme certaines autres positions venant de la gauche nordique et de l'est, l'historienne prend très au sérieux la menace russe : « alors que la France, l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne peuvent ne pas faire face à une menace militaire immédiate, pour la Pologne, les États baltes et les pays nordiques, le danger est direct », évalue-t-elle, puisque la Russie est l'une des plus grandes puissances militaires du monde « qui a violé tous les principaux accords internationaux de la dernière décennie », « bombarde quotidiennement les villes ukrainiennes » et « dépasse tous les pays européens en dépenses militaires ».
Sa critique se concentre sur le fait qu'elle trouve « isolationniste » la position de certaines gauches qui chercheraient seulement à préserver de manière égoïste leur modèle social, ignorant les « menaces à la sécurité » et refusant de voir l'Europe comme un projet commun. Elle défend au contraire « une stratégie de défense dans laquelle la sécurité ne soit pas financée par des coupes dans les programmes sociaux, mais par l'augmentation des impôts sur les ultra-riches ».
Christian Zeller lui répond directement en disant que nous ne pouvons en aucun cas approuver l'armement des puissances impérialistes européennes qui utiliseront la puissance pour faire valoir leurs revendications par la force dans le contexte d'une rivalité croissante pour les minéraux rares et coûteux, les terres rares, les terres agricoles et même l'eau, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Europe ou ailleurs.
Il soutient que « la rivalité impérialiste et la consommation matérielle d'armement provoqueront une augmentation massive des émissions de gaz à effet de serre » et que ce « réarmement » conduira à une distribution encore plus inégale des ressources et à l'enrichissement des secteurs les plus pervers du capital.
Traduit pour l'ESSF par Adam Novak, publié par Esquerda.net
Pas de licence spécifique (droits par défaut)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les effets de l’IA sur le travail

La complexification et la requalification du travail à partir de l'usage des nouvelles technologies ne forment qu'une des facettes du phénomène de l'automation.
10 avril 2025 |Hebdo L'Anticapitaliste - 749 | Crédit Photo : Wikimedia Commons
Le chercheur Antonio Casilli refuse la prophétie de la disparition du travail qui remonte à l'aube de l'industrialisation et met l'accent sur la quantité de travail qui se cache derrière l'automation ainsi que sur son processus de digitalisation.
« En attendant les robots », l'expansion du digital labor
Il s'agit pour lui d'une métamorphose du geste productif humain en micro-opérations sous-payées ou non payées afin d'alimenter une économie informationnelle qui se base principalement sur l'extraction des données. Le « digital labor » est défini comme un « travail tâcheronnisé et datafié (mouvement de mise en tâche et de mise en donnée) des activités productives humaines à l'heure de l'application de solutions d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique au contexte économique » 1. Celui-ci sert donc à entraîner les systèmes automatiques et est rendu possible par deux phénomènes : l'externalisation et la fragmentation du travail, deux tendances réconciliées par les technologies de l'information et de la communication. Il se situe au croisement complexe de formes d'emplois non standard, de free lancing, du travail à la pièce micro-rémunéré (notamment sur des plateformes comme Mechanical Turk), de l'amateurisme professionnalisé (comme celui des créateurEs de contenus sur les réseaux sociaux), de loisirs monétisés et de la production plus ou moins visible de données. Le digital labor est destiné à se développer d'une façon croissante car les IA ont besoin d'être calibrées, dressées et entretenues par les humains.
Le travail des usagé-es
Dans ce nouveau modèle économique, le travail des usagers permet de produire trois typologies de valeur : la valeur de qualification (tri de l'information, commentaires, évaluation de services et produits) ; la valeur de monétisation (prélèvement des commissions sur des plateformes de travail à la demande comme Etsy, Uber ou Airbnb ou revente des données aux annonceurs sur Facebook ou YouTube) et, enfin, la valeur d'automation (l'utilisation des données et des contenus produits par les usagers pour entraîner les IA).
Antonio Casilli affirme qu'au final, ce ne sont pas les machines qui travaillent pour les hommes mais ce sont les hommes qui réalisent du « digital labor » pour les machines : un travail du doigt, du « digitus », qui clique, pointe, compte, en tant que tâche fragmentée d'entraînement de la machine. L'IA accélère alors une forme particulière de gestion des activités productives qui consiste à mettre au travail un nombre croissant de personnes, tout en les mettant en même temps hors travail et hors protections sociales.
Le digital labor s'articule à des pratiques professionnelles plus traditionnelles en les reconfigurant : celles des enseignantEs qui saisissent les résultats des épreuves nationales dans les plateformes ministérielles, qui trient les dossiers sur Parcoursup ou encore celles des radiologues qui interprètent les images des patientEs afin de produire de nouveaux exemples pour l'IA.
La persistance des divisions sociale et raciale du travail à l'heure de l'IA
Une étude comparative de l'OCDE menée en 2016 montrait que si 50 % des tâches s'apprêtaient à être considérablement modifiées par l'automatisation, seulement 9 % des emplois seraient réellement susceptibles d'être éliminés par l'introduction des IA et des processus automatiques. C'est le scénario qui semble se dessiner aujourd'hui.
L'IA accélère donc le processus de division du travail qui avait déjà été identifié à la fin des années 1990 par M. Castells. Il parlait d'une séparation entre l'espace des flux et l'espace des lieux, entre le travail d'une minorité d'ingénieurs des réseaux et de manipulateurs de symboles et celui, automatisé, de la masse de la main-d'œuvre jetable, qui peut être licenciée, précarisée et délocalisée dans le Sud global 2. La flexibilité, favorable à la diffusion des connaissances et des innovations dans la Silicon Valley, est synonyme de précarité pour la plupart des autres travailleurEs de la planète.
Organiser le prolétariat numérique en pleine expansion, construire une conscience écosocialiste, deviennent des tâches centrales de la période. Notre projet de société est celui d'une victoire des communs, numériques et naturels, sur les processus d'accaparement et de prédation du capitalisme, quels que soient ses nouveaux habits.
Hélène Marra
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le corps dans tous ses états

La nouvelle génération, qui a grandi avec les médias sociaux, est-elle plus complexée ou a-t-elle accès à davantage de modèles qui favorisent une meilleure estime de soi ?
L'essai *Le corps dans tous ses états *de *Jessica Beauplat *publié dans la collection Radar aux éditions Écosociété arrivera en librairie le *30 avril. *
*En bref *
On ne l'a pas choisi et pourtant il nous suit partout : notre corps. Qu'il soit source de complexes, d'inconforts ou de plaisirs, accepter notre corps peut représenter tout un défi. Dans notre culture de l'image, l'apparence physique est devenue un haut lieu de performance où il n'y a qu'un pas
entre le bien-être et l'obsession.
*À propos du livre*
On voudrait ressembler aux corps qu'on voit sur Instagram, TikTok ou dans les magazines et les publicités. Cette médiatisation des corps dicte les critères du beau et du laid et impose des normes rigides.
Pour contrer cette culture de l'image parfaite, Jessica Beauplat donne la parole à des personnes qui posent un regard positif sur leur corps : danseuse, poète, athlète, entraineur, neurologue, comédien, mannequin, etc. Ces témoignages proposent des manières créatives d'habiter son corps, d'exploiter son pouvoir et d'en prendre soin. Ils nous invitent à regarder autrement notre corps et celui des autres en créant de nouvelles lignes de désir ; à dépasser les restrictions imposées par notre couleur de peau, notre physionomie, notre type de cheveux et toutes les contraintes culturelles.
Si les réseaux sociaux regorgent de personnes dont les corps répondent aux idéaux de l'époque, heureusement, on peut aussi y trouver plusieurs modèles alternatifs et des espaces pour rencontrer des gens qui nous ressemblent. En somme, Jessica Beauplat propose un essai inspirant qui permet de voir les corps de manière plus libérée.
*À propos de l'autrice *
*Jessica Beauplat* est scénariste, autrice et chroniqueuse. Sa pièce *Touche pas à mes cheveux (et autres principes de base) *a permis à plusieurs de découvrir son travail. Ses textes sont parus dans La Presse, Le Devoir, The Toronto Star et The Globe & Mail. *Le corps dans tous ses états* est son premier essai.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

“Sonia ou l’avant-garde”

Voici la parution de mon roman “Sonia ou l'avant-garde” (Editions Infimes). Très peu de fictions abordent sérieusement la politique, et notamment le projet communiste (et non pas le stalinisme) en allant au fond des choses. Ce livre pourrait intéresser tous ceux et celles qui s'intéressent à
l'idée collectiviste.
« Un mouvement profond attaquait le corps social et sapait ses fondations, entraînant l'ensemble dans un effrayant glissement. Ces camarades avaient toutes les raisons de proclamer l'urgence du combat. La nécessité de s'affranchir de la bestiale loi des plus forts était en train d'être effacée - et l'humanité, fragile vaisseau, dérivait sans défense.
Le plus terrible était que l'ennemi s'était incorporé à la société ; l'agent infectieux était d'origine humaine. Il avait perfusé dans les organes principaux, les esprits, et gagné tous les continents, il avait investi les institutions, les lois, la pensée. Le projet de débarrasser la société de ce poison paraissait un défi vertigineux. Certains qui autrefois avaient lutté se réfugiaient dans une résignation lassée, ou se drapaient d'un mépris ricanant du genre humain, d'autres fuyaient dans le déni au prix de ces sombres mensonges qu'on se fait à soi-même. »
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’indomptable Mammouth

L'indomptable Mammouth
De l'assurance-maladie à Santé Québec : un demi-siècle de réformes en santé
un essai de Marie-Michèle Sioui et Pascal Mailhot
En librairie le 29 avril
Écrit dans un style clair et accessible, cet essai journalistique immensément humain nous permet de découvrir les coulisses du système de santé québécois.
Depuis l'entrée en vigueur de l'assurance maladie en 1970, le réseau de la santé québécois est étudié par des commissions, disséqué dans des rapports et bouleversé par des réformes. Dans _L'indomptable Mammouth_, l'ex-conseiller politique Pascal Mailhot et la journaliste Marie-Michèle Sioui explorent les multiples tentatives de réforme du mastodonte qu'est devenu le système de santé québécois.
À travers des entrevues avec 30 personnalités, dont trois premiers ministres : François Legault, Philippe Couillard et Pauline Marois, leur récit raconte la récente création de _Santé Québec_ et met en lumière un réseau façonné par les ambitions politiques, les résistances corporatistes et les rêves de ceux qui ont voulu, chacun à leur manière, mettre au pas le « mammouth » de la santé.
On y retrouve plusieurs jeux de coulisses, des documents inédits, des révélations et des faits méconnus.
LES AUTEUR·ICE·S
Marie-Michèle Sioui est journaliste depuis 2011 et correspondante parlementaire pour _Le Devoir_ à Québec depuis mars 2017. En 2021, elle a remporté le prix _Judith-Jasmin_ de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec dans la catégorie « Enquête » pour son travail sur les relations entre les Autochtones et le système de santé québécois.
Pascal Mailhot a occupé des postes au cabinet du premier ministre pendant les mandats de Lucien Bouchard, Bernard Landry et François Legault. Il a coécrit _À la conquête du pouvoir : Comment une troisième voie politique s'est imposée au Québec_, publié aux Éditions du Boréal en 2024
Extrait – _L'indomptable Mammouth_
« Le premier ministre François Legault s'apprête à plonger le Québec en campagne électorale. Avec le slogan « Continuons », la CAQ réclame, en cette fin de l'été 2022, un deuxième « mandat fort ». Mais un poids lourd du gouvernement sortant hésite, lui, à « continuer »... Christian Dubé est catégorique : il ne sera pas sur les rangs si le gouvernement ne met pas sur pied une entité indépendante chargée de gérer les opérations dans le réseau de la santé. « Oui, oui… », lui assurent mollement des membres de l'entourage du premier ministre. Dubé les juge trop évasifs. Pour lui, pas question de partir en campagne électorale sans avoir annoncé l'intention du gouvernement de créer Santé Québec. » Marie-Michèle Sioui et Pascal Mailhot
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
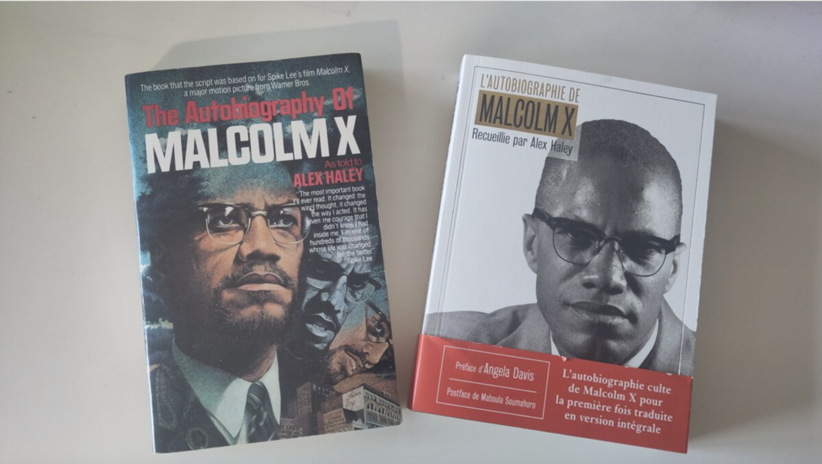
« L’Autobiographie de Malcolm X » : retour sur une histoire éditoriale (1965 - 2025)
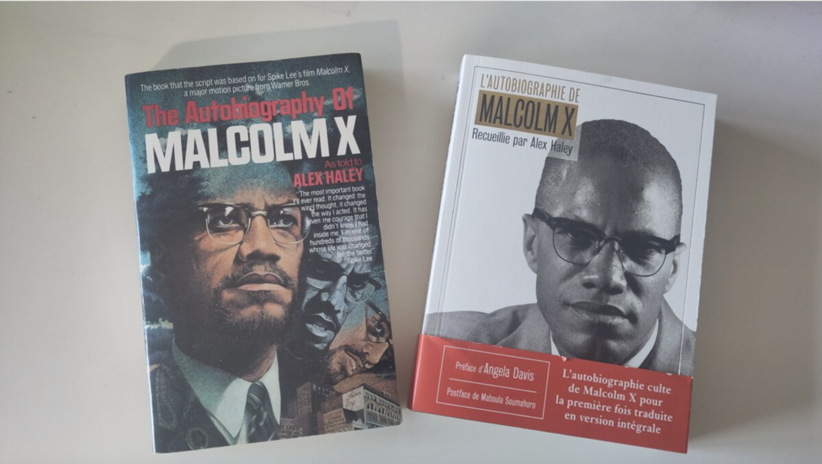
Publié pour la première fois en octobre 1965, et indisponible en français depuis plus de 30 ans, « L'Autobiographie de Malcolm X » a été rééditée en janvier en français aux éditions Hors d'atteinte. L'occasion de se replonger dans l'histoire de ce livre emblématique coécrit par le journaliste Alex Haley, au moment où l'on célèbre le centenaire de la naissance de Malcolm X.
Tiré du blogue de l'auteur.
L'après-midi du 21 février 1965, Malcolm X appelle le journaliste Alex Haley pour faire le point sur un projet de livre sur lequel ils travaillent ensemble depuis plus de deux ans.
Au téléphone, le journaliste informe le leader afro-américain que le manuscrit est quasiment terminé et sera envoyé à la maison d'édition à la fin de la semaine suivante. Ce soir-là, Malcolm X est invité à prononcer un discours au Audubon Ballroom à Harlem. Peu après son entrée sur scène, un tumulte éclate dans la salle. Trois hommes armés se précipitent vers la scène et tirent 21 balles à bout portant. Transporté d'urgence à l'hôpital, Malcolm X est déclaré mort peu après.
L'Autobiographie de Malcolm X paraît neuf mois plus tard, en octobre 1965. Le livre devint un best-seller dès les premières années de sa publication. Pièce centrale de l'héritage politique de Malcolm X, L'Autobiographie explore les multiples facettes de sa vie : son enfance marquée par la violence raciale, son passé de délinquant, sa conversion à l'islam, son engagement (puis sa rupture) au sein de la Nation of Islam, et son combat pour les droits des Noirs Américains.
Aujourd'hui largement reconnue comme une œuvre essentielle dans l'histoire de la lutte pour les droits des Noirs au XXe siècle aux États-Unis, L'Autobiographie de Malcolm X figure au programme de nombreux lycées et universités à travers le pays. En 1998, le magazine Time le classait même parmi les dix ouvrages de non-fiction les plus influents du XXe siècle.
Aux origines du livre
À l'origine de ce livre se trouve une rencontre. En mars 1960, Alex Haley réalise une interview de Malcolm X pour un article du Reader's Digest. À l'époque, Malcolm X était déjà une figure montante de la Nation de l'Islam, une organisation nationaliste noire. Haley, quant à lui, venait de quitter les garde-côtes américains après vingt ans de service et nourrissait l'ambition de devenir écrivain à plein temps. Tout dans leurs parcours et leurs convictions politiques les opposait.
Alex Haley raconte que cette première rencontre avec Malcolm X fut assez tendue. Ce dernier était méfiant envers les journalistes, et il lui aurait déclaré : « Vous êtes une marionnette de l'Homme Blanc envoyée pour m'espionner ! ». La méfiance de Malcolm X peut se comprendre, quand on sait qu'il était surveillé depuis plusieurs années par le FBI. Alex Haley raconte que lorsqu'il invitait Malcolm X chez lui, ce dernier criait : « Tests ! Tests ! » quand il entrait, car il était convaincu que le FBI avait mis son studio sur écoute.
Mais petit à petit, Alex Haley réussit à gagner sa confiance. Il réalisa deux autres interviews avec lui [The Saturday Evening Post et Playboy], et cette collaboration attira l'attention de la maison d'édition Doubleday[1]., qui demanda en 1963 à Haley s'il voulait bien essayer d'obtenir l'autobiographie exclusive de Malcolm X. Quand Haley transmit la proposition à Malcolm X, ce dernier l'accueillit avec réserve. « Ce fut l'une des rares fois où je le vis hésiter » se rappelle Alex Haley. Il finit par accepter, mais posa plusieurs conditions : il voulait que les droits d'auteur soient versés à la Nation of Islam (ce qui ne sera finalement pas le cas, puisqu'il quittera le mouvement l'année suivante), et insista pour que le livre soit une véritable œuvre collaborative : « Je veux un écrivain, pas un interprète ».
Le contrat d'édition fut finalement signé le 27 mai 1963, et l'à-valoir divisé en deux parts égales entre les deux co-auteurs.
Pendant les deux années suivantes, Alex Haley a recueilli les confidences de Malcolm X lors d'entretiens réguliers, organisés trois à quatre soirs par semaine dans son studio de Greenwich Village. Entre 1963 et l'assassinat de Malcolm X au début de l'année 1965, les deux hommes ont ainsi passé près de mille heures à échanger dans ce petit appartement.
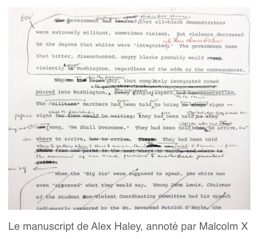
Au fil des entretiens, Haley dactylographie les paroles de Malcolm X, puis les réorganise et rédige le texte à la première personne, comme si Malcolm X racontait lui-même sa vie. Malgré son agenda chargé, ce dernier prend le temps de lire les ébauches du manuscrit au fur et à mesure qu'il les reçoit, qu'il corrige soigneusement à la main.
Alex Haley était convaincu du potentiel commercial du livre. Avant même sa publication il écrit à son éditeur « Messieurs, il n'y a pas eu depuis plus de dix ans, et peut-être plus encore, un livre comme celui-là qui embrasera le marché telle une traînée de poudre comme celui-ci le fera [...] Ce livre est riche de millions de ventes potentielles, voire davantage ».
Son intuition était juste : L'Autobiographie de Malcolm X s'est vendu à six millions d'exemplaires en vingt ans. Et son impact a largement dépassé les frontières des États-Unis.
1965 - 1993 : Les premières éditions françaises
Au moment où L'Autobiographie paraît aux Etats-Unis, Malcolm X a déjà un public en France. En novembre 1964, le leader nationaliste fait escale à Paris. Il donne une interview dans les locaux de la libraire Présence Africaine, rue des Ecoles (où elle existe toujours), et réalise une conférence à La Mutualité. Sa présence est même redoutée par les autorités françaises. En février 1965, alors qu'il tente de revenir en France, il est refoulé à son arrivée à l'aéroport. Jugé « indésirable » par le ministère de l'Intérieur, il est interdit d'entrée sur le territoire en raison des risques de « troubles à l'ordre public » que sa participation à une manifestation aurait pu engendrer.
En 1966, L'Autobiographie de Malcolm X paraît pour la première fois en France, dans une traduction de Anne Guérin, et connaît une réception très positive. L'ancien directeur du Monde déclare ainsi à son sujet : « Voici certainement l'un des livres les plus extraordinaires qui aient paru depuis longtemps. »
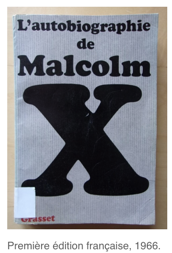
Toutefois, cette première édition française est incomplète – Le Monde parle d'un « texte mutilé » –, omettant un chapitre entier et plusieurs passages de l'œuvre originale.
En 1993, le livre est réédité en grand format par Grasset et en poche par Pocket, à l'occasion de la sortie en France du film Malcolm X de Spike Lee (Ces rééditions reprennent toutefois la version tronquée de 1966).
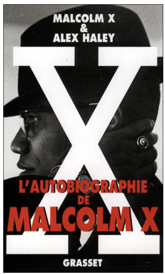
Mais suite à ces rééditions en 1993, l'ouvrage n'est plus réédité. Dés lors, L'Autobiographie de Malcolm X devient indisponible jusqu'à cette année. Un mystère. Comment expliquer qu'un livre aussi culte ait pu disparaître en France pendant plus de 30 ans ?
Années 1990 - 2025 : L'Autobiographie indisponible en France
« Mon interprétation, c'est qu'il y avait un désintérêt complet des éditeurs français, affirme Pierre Fourniaud, éditeur à La Manufacture de livres. Tout le monde a pensé que c'est à l'occasion du film que le livre a pu avoir du succès. Et donc le film étant de l'histoire ancienne, peu d'éditeurs ont songé à rééditer le livre ».
Il compare cette situation à celle de la biographie de J. Edgar Hoover, qu'il a réédité en 2020. « C'est un peu la même histoire : le livre avait eu une première édition au Seuil il y a 20 ans. Il a été réédité en poche au moment de la sortie du film avec DiCaprio, et ensuite les éditeurs ont laissé tomber les droits. Les éditeurs grand format ont considéré que ce livre n'avait plus d'actualité dans la mesure où il n'y avait plus de film. Alors que la biographie vaut par elle-même. C'est un personnage historique majeur, comme Malcolm X. »
Au sujet de L'Autobiographie de Malcolm X, Pierre Fourniaud raconte qu'il a découvert en 2020 que le livre était indisponible. « Ce qui m'a étonné, c'est que personne ne s'intéresse à republier Malcolm X au moment des manifestations Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd », explique-t-il. Il contacte alors les éditions Pocket à ce sujet, et leur propose de leur racheter la traduction. Parallèlement, il se rapproche d'une agence littéraire et, par leur intermédiaire, il fait une proposition aux ayants-droit. Mais sans succès. « Je suis revenu à la charge une fois, deux fois... J'étais monté jusqu'à 10 000 euros, mais mon offre restait insuffisante pour eux », explique-t-il.
Le nombre important d'ayants-droit rend la négociation complexe. Les droits de L'Autobiographie sont détenus par les successions des deux co-auteurs et un grand nombre de parts signifie qu'il faut un plus grand gâteau à partager. D'où une réticence de leur part à accepter des offres trop faibles. Au bout du compte, Pierre Fourniaud renonce à rééditer le livre. « J'ai été très déçu de ne pas avoir pû le faire, mais ce sont des choses qui arrivent ».
Il n'est pas le seul à avoir buté sur la question des ayants-droits. Quelques années plus tôt, le rappeur Disiz a lui aussi essayé d'obtenir les droits afin de rééditer L'Autobiographie de Malcolm X. À l'époque, il racontait : « Je voulais offrir son bouquin à un petit de chez moi qui est en prison pour une affaire de stupéfiants. Je pensais que ça serait simple de trouver le bouquin, mais au final après une semaine de recherche, impossible. Il n'est plus édité depuis 93. Comme j'ai écrit des romans, j'ai pu discuter avec Grasset qui avait acheté le livre en 1965 au moment de sa sortie. Ils l'ont réédité en 93 pour la sortie du film de Spike Lee. Et depuis, ils n'ont pas refait de tirage. En voyant le contrat, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient plus le droit de le faire. Donc j'étais libre de proposer aux ayants droit de Malcolm X une nouvelle traduction. »
Après deux années passées à tenter, en vain, de contacter les ayants droit, Disiz reçoit enfin une réponse : le représentant de la famille de Malcolm X lui propose d'organiser un concert pour célébrer le 90e anniversaire de la naissance de Malcolm X. Pour Disiz, cette réponse sonne comme un défi à relever. Le 19 mai 2015, il met sur pied un concert hommage au Bataclan, à Paris, avec l'espoir que le succès de cet événement l'aide à plaider sa cause. Si le concert a bien eu lieu, le projet de réédition de L'Autobiographie n'a jamais abouti. Disiz aurait finalement abandonné le projet à cause de problèmes juridiques.
Au moment de sa publication en 1965, toutes les éditions du livre mentionnaient Alex Haley et Betty Shabazz, la veuve de Malcolm X, comme détenteurs des droits d'auteur. Mais en 1997, le décès de Betty Shabazz a provoqué une rupture familiale. Son héritage, estimé à environ un million d'euros, devient source de discorde entre trois de ses filles — Malikah, Ilyasah et Malaak — qui s'accusent mutuellement de mauvaise gestion. Cette situation a entraîné une accumulation de dettes fiscales et de pénalités, atteignant deux millions de dollars, soit bien au-delà de la valeur initiale de la succession. Ces disputes autour de l'héritage entre les filles de Malcolm X pourraient expliquer en partie les difficultés des éditeurs français à récupérer les droits, ces 30 dernières années.
2025 : L'Autobiographie enfin rééditée
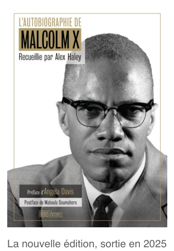
Le 24 janvier 2025, le livre est enfin réédité aux éditions Hors d'atteinte. Cette nouvelle édition est « publiée pour la première fois dans sa version intégrale » en rétablissant les parties absentes des éditions précédentes. Marie Hermann, fondatrice et directrice des éditions Hors d'atteinte explique : « Dans les précédentes éditions, il manquait un chapitre, mais ce n'est pas le seul problème. Beaucoup de passages ont été coupés. Il est difficile d'en comprendre la logique. Ce n'était manifestement pas une censure politique, mais peut-être une volonté de traduire au plus vite. Il y a des passages où Malcolm X parle de jazz par exemple, et ce sont d'assez longues listes, donc il y a peut-être eu une tentative de rendre le texte plus lisible. Nous, il nous a paru indispensable de restituer le texte dans son intégralité en tant qu'objet historique ».
La maison d'édition a choisi de repartir de la traduction originale d'Anne Guérin, parue en 1966. Un choix motivé à la fois par le respect du travail initial et par la difficulté de désigner un nouveau traducteur perçu comme légitime pour un texte aussi symbolique. Marie Hermann explique avoir « longuement hésité sur la manière de procéder », mais a finalement choisi de conserver cette base pour « rendre hommage à Anne Guérin, qui a beaucoup œuvré pour la circulation du livre ».
Cette version a toutefois été largement remaniée par la traductrice Gaëlle Differt et par Marie Hermann elle-même. « Pour la compléter, puisque il manquait en réalité la moitié du texte, on a tout revu, on a vraiment modernisé la traduction. À l'époque, la traduction a été faite au passé simple, on est passé au présent. On a ajouté tout un appareil de notes, totalement absent de la 1re version. On a veillé à contextualiser les événements, les personnages dont il est question dans le livre. On s'est beaucoup questionné sur les mots à utiliser, notamment le mot "nègre", le mot "indien. On a fait une note au début, on est revenu dessus aussi dans l'ouvrage. C'est une traduction totalement fidèle au texte original. »
[1]. Doubleday a finalement rompu le contrat d'édition au moment de l'assassinat de Malcolm X, par crainte pour la sécurité de ses employés. L'Autobiographie de Malcolm X fut finalement publiée Grove Press.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Palestine, 1947-1949 : la guerre de l’histoire. À propos du livre d’Ilan Pappé

Le philosophe Matthieu Renault discute le grand livre de l'historien Ilan Pappé, Le Nettoyage ethnique de la Palestine, initialement paru aux éditions Fayard mais que cette maison a décidé – quelques semaines après le 7 octobre – de retirer des ventes. Les éditions La Fabrique ont pris l'initiative, ô combien salutaire, de mettre à disposition ce livre fondamental.
8 avril 2025 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/palestine-guerre-histoire-ilan-pappe-nettoyage-ethnique/
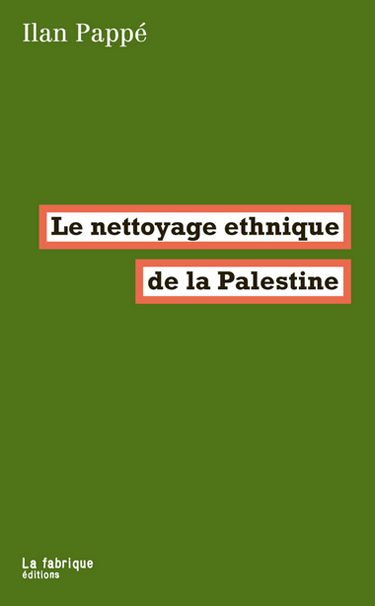
Ilan Pappé, Le Nettoyage ethnique de la Palestine (trad. Paul Chemla), Paris, La fabrique, 2024 (2006)
Le 13 mai 2024, Ilan Pappé, historien israélien, Professeur à l'Université d'Exeter au Royaume-Uni, est retenu à l'aéroport de Détroit et interrogé pendant deux heures par deux membres du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis à propos de ses opinions sur le Hamas et sur la riposte israélienne à l'attaque sanglante du 7 octobre 2023, ainsi que sur ses liens avec les communautés arabe et musulmane américaines[1].
« Saviez-vous, écrit-il dans un message posté deux jours plus tard sur le réseau social Facebook, qu'un professeur d'histoire âgé de 70 ans pouvait constituer une menace pour la sécurité nationale américaine ? ».
Nulle participation à une quelconque conspiration politique contre Israël ou les États-Unis ne pouvait en effet justifier cet interrogatoire dans les règles de l'art, et force est de reconnaître que c'est en tant qu'historien, critique et engagé certes, que Pappé faisait figure de suspect idéal pour les autorités étasuniennes. Son délit : avoir inlassablement remis en cause le « roman national » israélien-sioniste, contesté le récit officiel de la guerre de 1947-1948 et de la naissance de l'État d'Israël, en s'efforçant de mettre au jour les mécanismes politiques et les opérations militaires qui, au lendemain du vote du Plan de partage de l'ONU et de l'annonce du retrait des troupes britanniques, avaient conduit à l'expropriation et l'expulsion d'environ 800 000 Palestiniens, soit deux tiers de la population arabe (musulmane et chrétienne) qui peuplait alors le territoire de la Palestine historique.
On imagine mal, à l'heure qu'il est du moins, un épisode comme celui qui vient d'être relaté se produire à l'aéroport Charles de Gaulle ou ailleurs sur le territoire français. Heureusement, il existe d'autres manières, plus douces, de tenter de réduire au silence des voix dissidentes comme celles de Pappé : il suffit, comme l'ont fait les éditions Fayard le 7 novembre 2023, un mois jour pour jour après l'attaque sanglante du Hamas et alors que la guerre de représailles mené par Israël ne faisait que commencer, de déclarer « épuisé pour cause d'arrêt de commercialisation » un livre phare de l'auteur, Le nettoyage ethnique de la Palestine, publié en anglais en 2006 et qui était disponible en traduction française depuis 2008.
Si l'éditeur a prétexté d'un contrat devenu « caduc », les chiffres de vente de l'ouvrage après le 7 octobre laissent penser qu'avec un peu de bonne volonté, et ne serait-ce que pour des raisons commerciales, le problème aurait pu être résolu, et que la soudaine indisponibilité du livre avait d'autres motivations, de nature politique, même si celles-ci sont condamnées à rester obscures[2]. On doit aux éditions La fabrique[3] d'avoir depuis acquis les droits du livre et assuré au Nettoyage ethnique de la Palestine une seconde vie à un nouveau moment crucial du combat pour la cause palestinienne, en tant que celui-ci est aussi et inséparablement – et c'est sur cet dimension que se centrera la présente lecture – un combat historiographique.
Il convient à ce titre de souligner que les conclusions de Pappé ne sont pas l'œuvre d'un franc-tireur isolé, mais le résultat de l'effort collectif mené, depuis 1978 et l'ouverture des archives israéliennes et britanniques de la guerre de 1948, par les « nouveaux historiens » israéliens, lesquels se sont patiemment attachés à déboulonner les mythes entourant la fondation d'Israël.
Ces historiens ont notamment remis en cause la représentation consacrée de la lutte héroïque du David israélien contre le Goliath arabe en démontrant que les forces juives-sionistes étaient en réalité bien mieux préparées, armées et organisées que leurs adversaires arabes, sur lesquelles elles disposaient en outre, si ce n'est pendant un court laps de temps, d'un notable avantage numérique. Mais le véritable tour de force des « nouveaux historiens » est d'avoir réfuté, preuves implacables à l'appui, l'idée selon laquelle l'exode massif de la population palestinienne aurait résulté de l'appel des dirigeants arabes à déserter les zones d'affrontement ; idée qui présentait cet insigne avantage d'exonérer l'armée et l'État israéliens de toute responsabilité dans les souffrances vécues par les exilé.es palestinien·nes[4].
Il revient ainsi à Benny Morris d'avoir posé en 1987 la première pierre de cette édifice critique dans son ouvrage séminal The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949[5], en montrant que l'expulsion des Palestiniens avait été littéralement orchestrée par les armées sionistes et s'était accompagnée de pillage des biens, d'expropriation et de destruction des habitations, voire à l'occasion d'exécutions sommaires.
Il y a toutefois un pas que Morris, au risque de se contredire, s'est toujours refusé à faire ; c'est celui qui consistait à soutenir que le déplacement forcé de la population palestinienne n'avait pas été un malheureux aléas de la guerre, une stratégie adoptée dans le feu du combat, mais le fruit, intentionnel, de l'exécution d'un programme mûrement réfléchi ; autrement dit, qu'une telle « évacuation » avait été soigneusement préméditée et coordonnée par les hautes sphères de l'Agence juive puis du jeune État israélien et de son organe paramilitaire, la Haganah, avec David Ben Gourion en maître d'oeuvre.
C'est précisément ce pas que fait témérairement Pappé. Celui-ci souligne en ce sens la fonction pratique endossée par les fichiers de villages arabes constitués dès avant la Seconde Guerre mondiale par la Haganah, et interprète le document établi en mars 1948 et connu sous le nom de Plan Daleth (« D » en hébreu), comme un véritable blueprint qui, scrupuleusement appliqué, aurait conduit au « transfert » de la population palestinienne et à la destruction de 500 villages et 11 agglomérations urbaines, avec pour point de non-retour le massacre de Deir Yassin du 9 avril 1948.
C'est depuis cette perspective que, sur quelques centaines de pages, Pappé, accumulant des faits plus accablants les uns que les autres, réexamine méticuleusement les opérations conduites entre décembre 1947 et janvier 1949 par la Haganah, et ses alliés inavoués pendant cette séquence, l'Irgoun et le groupe Stern en particulier.
Ce récit de violences vient nourrir la thèse centrale du livre, à savoir que ce qui a eu lieu sur le territoire de la Palestine, et à l'encontre des Palestinien·nes, sur cette période d'à peine plus d'un an, n'est rien d'autre qu'un nettoyage ethnique au sens strict que le terme a recouvert dans le contexte des guerres de Yougoslavie des années 1990 ; guerres dont Pappé cite en épigraphe de plusieurs chapitres des documents et analyses, notamment cet essai de définition donnée par le juriste Dražen Petrović :
« [L]e nettoyage ethnique est une politique bien définie d'un groupe particulier de personnes, visant à éliminer systématiquement d'un territoire donné un autre groupe sur la base de l'origine religieuse, ethnique ou nationale. Cette politique […] est à exécuter par tous les moyens possibles, de la discrimination à l'extermination, et implique des violations des droits humains et du droit humanitaire international. » (p. 25)[6].
C'est sur le déni du mal délibérément causé à la population palestinienne, et qui nourrit chez cette dernière un profond traumatisme, que vit selon Pappé la société israélienne toute entière, en sorte qu'il ne pourra y avoir d'issue, non seulement sur le plan (géo)politique, mais aussi sur le plan moral et existentiel, qu'à condition que « les Juifs israéliens [admettent] qu'ils sont devenus le miroir de leur proche cauchemar » (p. 302).
On ne s'étonnera guère que ces thèses aient suscité l'ire des historiens sionistes, qu'il suffise de citer une recension du Nettoyage ethnique de la Palestine publiée dans le Journal of Israeli History sous le titre « Cleansing History of its content » (Nettoyer l'histoire de son contenu) par Mordechai Bar-On, historien qui avait auparavant offert ses services à Tsahal et siégé à la Knesset. Déclarant que Pappé « ne mérite certainement pas le titre d'“historien” », lui reprochant de falsifier et fabriquer les faits, l'auteur ajoute : « Pappé ne cherche pas la vérité, comme un historien devrait au moins essayer de le faire, mais il prête sa plume aux efforts de propagande des éléments palestiniens les plus extrêmes pour tenter de délégitimer Israël et le sionisme. »
On pourrait simplement ignorer ce jugement lapidaire s'il n'émanait pas de quelqu'un qui, argument de façade ou non, en appelle dans le même temps Israël à reconnaître « le prix terrible que les Palestiniens ont dû payer pour la réalisation des aspirations juives en Palestine, mais aussi son propre rôle dans ce processus » [7], et s'il ne rejoignait pas ce faisant les arguments formulés par Benny Morris après son tournant (au début des années 2000 et à la suite de l'échec du sommet de Camp-David) vers un sionisme décomplexé, ouvertement anti-arabe, qui l'a conduit à assumer sans vergogne la nécessité de l'expulsion de la population palestinienne jusqu'à regretter que Ben Gourion n'ait pas osé prendre l'initiative de mener cette entreprise jusqu'au bout en vidant entièrement le territoire israélien de la présence palestinienne.
Dans une recension du livre précédent de Pappé, A History of Modern Palestine. One Land, Two Peoples (2004) publié dans The New Republic, Morris écrivait ainsi :
« Pappé est un fier postmoderniste. Il pense qu'il n'existe pas de vérité historique, mais seulement un ensemble de récits aussi nombreux que les participants à un événement ou à un processus donné ; et chaque récit, chaque perspective serait aussi valable et légitime, aussi vrai, que les autres[8]. »
Ce qui est reproché à Pappé, ainsi repeint en disciple d'Haydn White (ou de sa caricature), est en substance un mépris de l'objectivité induisant un relativisme extrême qui, certes, n'invaliderait pas sa restitution et son interprétation des faits comme telles, mais les rendraient ni moins ni plus crédibles que toutes les autres, dans une irréductible multiplicité à laquelle n'échapperaient en somme que des historiens de la trempe de Morris capables de surplomber le théâtre de la lutte et d'observer cette dernière à distance, avec un regard détaché et désintéressé.
Pappé ne tarda pas à répondre à Morris en retraçant les véritables coordonnées d'un conflit indissociablement historiographique et politique :
« Le débat qui nous oppose se situe à un certain niveau entre les historiens qui croient reconstruire purement objectivement le passé, comme Morris, et ceux qui revendiquent leur statut d'êtres humains subjectifs s'efforçant de raconter leur propre version du passé, comme moi. Lorsque nous écrivons des histoires, nous construisons des arcs sur une longue période de temps et nous forgeons un récit à partir du matériel que nous avons sous les yeux. Nous croyons et espérons que ce récit est une reconstruction fidèle de ce qui s'est passé, quoique […] nous ne puissions pas remonter dans le temps pour le vérifier. »[9]
Pappé poursuit en soulignant que les historiens israéliens qui produisent des récits historiques sur la genèse d'Israël et plus largement sur le conflit israélo-palestinien sont par nécessité « profondément impliqués dans le sujet sur lequel ils écrivent » ; qu'ils le veuillent ou nous, ils en font eux-mêmes partie, ce qui ne doit pas être considéré comme un « défaut » mais plutôt comme une « bénédiction ».
Ce n'est pas donc la reconnaissance et l'assomption de ce positionnement, mais au contraire sa négation, son refoulement, qui constitue une grave entorse à la probité intellectuelle de l'historien. Plus encore, il n'y a aucune honte à affirmer qu'un tel effort historiographique, visant à faire « valoir un point de vue » par rapport à d'autres, a toujours de manière avouée ou inavouée un soubassement « idéologique » ou « politique » ; en témoignent de manière éloquente les prises de position publiques de Morris lui-même, que celui-ci ne peut qu'avec une mauvaise foi avérée déclarer indépendantes de son travail scientifique, et réciproquement[10].
Un tel conflit de points de vue n'est nulle part plus manifeste, plus tranché, selon Pappé, que dans l'opposition entre l'historiographie sioniste et l'historiographie palestinienne :
« Les historiens sionistes voulaient prouver que le sionisme était valable, moral et juste, et les historiens palestiniens voulaient montrer qu'ils étaient des victimes et avaient été lésés[11]. »
Nous en arrivons à un des principaux points de contentieux entre Pappé et Morris, à savoir leurs rapports respectifs à la parole palestinienne, et en l'occurrence au (contre-)récit de la Nakba, terme introduit dès 1948 dans un livre de de l'historien et théoricien du nationalisme arabe Constantin Zureik : Ma'na al Nakba (La signification de la catastrophe). Sans rien dénier de l'apport des « nouveaux historiens » israéliens, scientifiquement en tant qu'historien, et politiquement en tant qu'Israéliens, force est de constater que la découverte de l'expulsion des Arabes n'en était nullement une du point de vue palestinien. Comme le dit Edward Said dans un entretien donné en novembre 2000, au lendemain du déclenchement de la seconde Intifada :
« Les archives sionistes sont très claires à ce propos, et plusieurs historiens israéliens ont écrit à ce sujet. Bien sûr, les Arabes n'ont jamais cessé de le dire[12]. »
Traduction d'une expérience traumatique, à la première personne, ce récit a nourri la littérature palestinienne et arabe post-1948 – voir par exemple les romans de Ghassan Kanafani Des hommes sous le soleil et Retour à Haïfa – mais a également fait l'objet fait d'une riche élaboration historiographique, et cela dès les années 1960, bien avant l'ouverture des archives, ainsi qu'en atteste l'essai pionnier « Plan Dalet. Master Plan for the Conquest of Palestine »[13] signé par Walid Khalidi, historien palestinien qui a documenté sans relâche les épisodes de la Nakba[14].
S'il arrivait à Morris de se référer au travail de Khalidi, ne se manifeste pas moins chez lui, comme chez d'autres une défiance tenace à l'égard des sources palestiniennes, là où Pappé, lui, n'hésite pas à affirmer qu'elles lui semblent souvent « plus fiables » que les sources israéliennes, et souligne ce qu'est susceptible d'apporter une connaissance de « terrain » de la vie dans les territoires occupés couplée à des contacts étroits avec des interlocuteur.ices palestinien.nes[15].
Bien qu'il ne le formule pas en ces termes, la relecture qu'il opère de la séquence 1947-1949 est indissociable d'un geste épistémologico-politique de refus de ce qu'on peut désigner comme un apartheid historiographique, dont tout un ensemble de perspectives sur l'histoire d'Israël, aussi critiques soient-elles, continuent de respecter et de reproduire scrupuleusement les frontières ; geste qui suppose, simplement, de reconnaître à l'autre, la capacité, à parts égales, de dire l'histoire ; geste enfin qui n'est pas sans implication politique puisqu'elle conduit Pappé dans Le nettoyage ethnique de la Palestine, à endosser, comme condition préalable à tout « processus de paix », une revendication fondamentale des Palestinien.es depuis la Nakba : le « droit au retour », qui « a été reconnu par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 1948 » et est « ancré dans le droit international » et est « en harmonie avec toutes les idées de justice universelle » (p. 311).
Pappé ne sous-estime pas l'ampleur de la tâche tant le « problème démographique », soulevé dès la fin du XIXe siècle par les idéologues sionistes, demeure prégnant en Israël, où les Palestiniens « ne peuvent pas ne pas comprendre qu'ils sont considérés comme un problème », voire comme un « danger » (p. 309-311). Ils le sont depuis le début dans la mesure où le projet sioniste s'est donné « pour objectif de construire puis de défendre une forteresse “blanche” (occidentale) dans un monde “noir” (arabe) », similaire à celle qu'avaient bâti les « colons blancs d'Afrique du Sud », avec pour paroxysme le régime d'Apartheid ; en sorte qu'Israël fait aujourd'hui figures de « dernière enclave européenne postcoloniale dans le monde arabe » (p. 315).
Ces thèses ne sont pas nouvelles en soi : les filiations entre les projets coloniaux-« civilisationnels » des puissances européennes des XIXe-XXe siècles, et l'idéologie sioniste, dans sa codification par Theodor Herzl déjà, ont été établies de longue date. Mais il n'en reste pas moins notable, et salutaire, qu'un historien israélien s'efforce de briser ce qu'Edward Said, amateur lui aussi de parallèles entre Israël et l'Afrique du Sud, a désigné comme une épistémologie de la séparation, corrélative de la séparation politico-légale des populations juive et arabe, et qui, visant à rendre par avance nulle et non avenue toute tentative de comparaison critique du conflit israélo-palestinien avec d'autres situations géo-historiques (conquête des Amériques, Algérie française ou autres), constitue une pièce nodale de l' « idéologie de la différence » sur laquelle a reposé jusqu'à ce jour l'existence d'Israël[16].
Le livre de Pappé peut en définitive être lu comme une invitation à resituer systématiquement le cas israélo-palestinien, au sein d'une histoire globale des colonialismes, de peuplement plus spécifiquement, sans rien avoir à dénier de sa singularité. Mais c'est plus encore dans le sillage d'une riche tradition, celle des historiographies anticoloniales et antiracistes, historiographies de combat par excellence, que gagnerait à être réinscrit Le nettoyage ethnique de la Palestine ; un livre qui, pour ne prendre qu'un exemple, aussi étrange qu'il puisse paraître au premier abord, trouverait à dialoguer fructueusement avec l'œuvre de l'intellectuel africain-américain W.E.B. Du Bois, dont la pensée était toute entière gouvernée par une question lancinante : « quel effet ça fait [pour le Noir] d'être un problème ?[17] »
Pour Du Bois, prendre le contrepied des déformations et dénégations imposées par une historiographie dominante (blanche) masquant les logiques de pouvoir qui la sous-tendent, imposait d'assumer la particularité d'un point de vue situé, minoritaire, de s'engager sur le champ de bataille de l'écriture de l'histoire en rejetant la possibilité même de la neutralité sinon de l'impartialité, et in fine de se livrer à une authentique « propagande de la vérité »[18]. Mis à part le fait qu'il est lui-même issu de la « majorité », Pappé dit-il et fait-il aujourd'hui réellement autre chose que ce que disait et faisait Du Bois hier ?
Ce qu'il s'agit en définitive de (re)lier pour les éclairer mutuellement et ainsi miner l'idée de l'absolue exceptionnalité d'Israël, ce sont donc non seulement les formes d'oppression, coloniales, raciales ou autres, mais aussi les pratiques de résistance, et en l'occurrence de résistance historiographique, au passé et au présent, en œuvrant à ce qu'il conviendrait d'appeler une épistémologie de la connexion des luttes.
Notes
[1] « Ilan Pappé : « Pourquoi j'ai été arrêté et interrogé sur Israël et Gaza dans un aéroport américain », publié le 22 mai 2024.
[2] Voir Hocine Bouhadjera, « Fayard éclipse en catimini un de ses ouvrages sur la Palestine », publié le 8 décembre 2023.
[3] Les éditions La Fabrique avaient déjà fait paraître de manière précoce deux ouvrages d'Ilan Pappé : La guerre de 1948 en Palestine. Aux origines du conflit israélo-arabe en 2000 et Les démons de la Nakbah. Les libertés fondamentales dans l'université israélienne en 2004.
[4] Voir en français sur les « nouveaux historiens » israéliens, le travail de « passeur » joué en France par le journaliste Dominique Vidal : avec Joseph Agalzy, Le péché originel d'Israël. L'expulsion des Palestiniens revisitée par les “nouveaux historiens” israéliens, Paris, Les éditions de l'Atelier, 1998.
[5] Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge et New York, Cambridge University Press, 2004 (1986).
[6] Faisons remarquer que Pappé n'a pas eu de scrupules à qualifier de « génocide » les opérations militaires israélienne de fin 2023-2024 sur la bande de Gaza (Rachida El Azzouzi, Entretien avec Ilan Pappé, « La guerre à Gaza n'est pas de l'autodéfense, mais un génocide », publié le 24 juin 2024).
[7] Mordechai Bar-On, « Cleansing history of its content : Some critical comments on Ilan Pappe's The Ethnic Cleansing of Palestine », The Journal of Israeli History, vol. 27, no 2, septembre 2008, p. 269-270. On notera que la pure attitude de déni de l'expulsion des Palestiniens n'a pas disparu en Israël. Ne citons qu'un exemple éloquent : Eliezer Tauber The Massacre That Never Was. The Myth of Deir Yassin and the Creation of the Palestinian Refugee Problem, Washington, ASMEA et New Milford, The Toby Press, 2021.
[8] Benny Morris, « reviewing A History of Modern Palestine : One Land, Two Peoples by Ilan Pappe », The New Republic, publié le 22 mars 2004.
[9] Ilan Pappé, « Benny Morris's Lie about my book », History News Network, publié le 5 avril 2004. Exerçant son droit de réponse, Pappé avait initialement adressé son texte à The New Republic, qui refusa de le publier.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] « Intifada 2000. The Palestinian Uprising » (2000), in David Barsamiam et Edward Said, Culture and Resistance. Conversations with Edward Said, Cambridge, South End Press, 2003, p. 31.
[13] Walid Khalidi, « Plan Dalet. Master Plan for the Conquest of Palestine » (1961), reproduit in Journal of Palestinian Studies, vol. 18, no 1, automne 1988, p. 4-33.
[14] Voir en français, Walid Khalidi, Nakba, 1947-1948, Beyrouth, Institut d'études palestiniennes et Arles, Sindbad-Actes Sud, 2012.
[15] Ilan Pappé, « Benny Morris's Lie about my book », loc. cit.
[16] Edward Said, « An Ideology of Difference », Critical Inquiry, vol. 12, no 1, automne 1985, « “Race, Writing, and Difference », p. 38-58, reproduit in The Politics of Dispossession. The Struggle for Palestinian Self-Determination, 1969-1994, New York, Pantheon Books, 1994, p. 78-100.
[17] W. E. B. Du Bois, Les Âmes du peuple noir, trad. fr. M. Bessone, Paris, La Découverte, 2007, p. 11.
[18] W. E. B. Du Bois, Dusk of Dawn. An Essay Toward an Autobiography of a Concept of Race, New York, Oxford University Press, 2007 (1940), p. 113. Sur la pratique duboisienne de l'histoire, voir en particulier W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America. An Essay Toward a History of the Part Which Black Folk Played in the Attempt to Reconstruct Democracy in America, 1860-1880 , NewYork, Oxford University Press, 2007 (1935).

Comptes rendus de lecture du mardi 15 avril 2025


Zones sacrifiées
Oeuvre collective sous la direction d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Véronique Côté, Isabelle Fortin-Rondeau, Steve Gagnon et Jennifer Ricard Turcotte
Cet ouvrage à plusieurs voix s'inscrit dans la lutte contre les émissions toxiques émises par la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda avec leurs effets délétères sur la population. Le complexe industriel rejette en effet sur la ville depuis plusieurs décennies un véritable cocktail de polluants comprenant des métaux lourds, comme de l'arsenic, du plomb, du nickel et du cadmium. Il émet par exemple jusqu'à 100 nanogrammes d'arsenic par mètre cube, ce qui est de loin supérieur à la norme prévue par le gouvernement du Québec, qui est de 3 nanogrammes par mètre cube. Un véritable cri du coeur... auquel nous devrions joindre notre voix.
Extrait :
Depuis des décennies, les gouvernements connaissent la vérité. Pourtant, ils laissent faire la compagnie, et la population qui leur demande des comptes est trop peu nombreuse, trop loin, trop isolée pour être considérée. Mais il n'est pas trop tard pour faire corps.

Les lettres de prison de Nelson Mandela
Nelson Mandela
Versions originales en afrikaans, en isiXhosa et en anglais
Je n'étais pas né quand Nelson Mandela a été emprisonné en 1962, et j'en avais presque vingt-sept lorsqu'il a enfin été libéré en février 1990. La lecture de cette sélection de 255 lettres de prison à sa femme Winnie, à ses enfants et à ses proches et amis, mais aussi aux autorités des prisons et à des officiels gouvernementaux, sur une si longue période de temps – et de ma propre vie – m'a permis de bien mesurer la détermination et l'héroïsme de ce grand combattant pour l'égalité des populations noires et blanches sous le sinistre régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Un recueil de précieuses lettres qui disent toute la vérité sur une société profondément raciste !
Extrait :
En 1968, la mère de Mandela, Nosekeni, mourut. On refuse à Mandela l'autorisation d'assister à l'enterrement. L'année suivante, son fils aîné, Thembi, fut tué dans un accident de voiture. À nouveau, sa demande d'aller sur sa tombe fut ignorée. Il resta incarcéré pendant que ses amis et ses parents tenaient sa place à l'enterrement. Les lettres qu'il écrivit à cette époque disent sa profonde angoisse devant ces pertes terribles.

La saga des Béothuks
Bernard Assiniwi
C'est le plus connu des trois romans de Bernard Assiniwi et assurément le plus significatif. Il nous raconte l'histoire des Béothuks, cette nation amérindienne qui occupait l'île de Terre-Neuve et qui fut exterminée par les Anglais au XIXe siècle - sa dernière représentante, Shanawditith, mourant en 1829. Il se divise en trois parties : la première, qui commence vers l'an 1000 avec un jeune Béothuk, Anin, qui part à la découverte de l'île et y fait entre autres la découverte des Vikings ; c'est la plus agréable, puisqu'elle correspond en quelque sorte à l'âge d'or de la nation ; la seconde couvre plus ou moins les XVIe et XVIIe siècles et voit l'arrivée dans les eaux entourant l'île des navires européens – portugais, espagnols, français et anglais - à la découverte et à la conquête du monde ; la dernière couvre les deux siècles suivants avec l'implantation des Anglais dans l'île et le triste sort réservé aux Béothuks ; c'est alors pour ceux-ci la longue décente aux enfers… Le roman est jalonné de faits et de personnages réels. C'est assurément un roman à lire pour tous ceux qui s'intéressent à la véritable histoire des peuples autochtones et à leur triste – et continuel – asservissement.
Extrait :
Comment pouvez-vous même oser dire que vous êtes Béothuks si vous affichez de telles mines de morts vivants ? Vous n'avez pas le droit de laisser tomber. Vous devez continuer à vous battre, ou alors ayez le courage de vous suicider tous, sans exception. Lorsqu'on n'a plus la force de vivre, il faut au moins avoir le courage de mourir. C'est la seule dignité qui vous reste. Ayez au moins la dignité, si vous n'avez pas de courage. Moi, j'ai décidé de vivre. Que ceux qui ne désirent plus voir le ciel, les rivières et les arbres se retirent de ma vie. Je ne veux voir près de moi que des gens qui veulent vivre. Les autres, allez tous vous jeter devant les fusils des Anglais. Vous ne méritez pas mieux.
Les mots
Jean-Paul Sartre
Jean-Paul Sartre nous raconte ici son enfance. Il ne nous la raconte pas avec nostalgie, comme la plupart l'ont fait avant lui, en nous faisant l'éloge de leurs belles années perdues. Il nous raconte plutôt, avec sagacité, comment, à travers les mots, il a découvert l'existence, Il le fait sans complaisance et avec lucidité, et c'est ce qui donne toute sa richesse au récit.
Extrait :
J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute : au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout ; défense était faite de les épousseter sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées : droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque ou noblement espacées en allées de menhirs, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière mais je ne savais pas trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait : mon grand-père si maladroit, d'habitude, que ma mère lui boutonnait ses gants – maniait ces objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu mille fois soulevé d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en deux enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter en regagnant son fauteuil, par un mouvement combiné du pouce et de l'index puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec « à la bonne page » en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées couvertes de veinules noires qui buvaient l'encre et sentaient le champignon.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Écofacisme, la menace fantôme

Le terme d « écofascisme », qui désigne une tendance à l'écologisation de l'extrême droite. Les récents événements politiques en France et ailleurs tendent pourtant à montrer tout le contraire : c'est un bien un carbofascisme » qui monte en puissance, accro aux combustibles fossiles et totalement indifférent, sinon hostile, aux impératifs écologiques.
tiré de Fracas, Le média des combats écologiques, no. 2, Hiver 2025 | Illustration Asis percales
Assistons-nous au retour du fascisme' ? Pour les uns, la réponse ne fait aucun doute, comme en témoignent la percée électorale des extrême droites européennes, la stabilisation du trumpisme au pouvoir, ou encore la naturalisation dans le débat public d'idées naguère considérées comme racistes ou attentatoires aux libertés publiques et à la démocratie. Pour les autres, goguenards, la gauche continuerait de crier au loup dans un accès de panurgisme incantatoire, et le mot de fascisme n'aurait plus aucune substance. D'ailleurs, nous disent-ils, on voit bien qu'il y a peu de ressemblance entre un Jordan Bardella cravaté et un Waffen SS botté. Nul besoin, pourtant, que le néo-fascisme soit un duplicata du fascisme du XXe siècle : celui-ci émerge, en temps que force historique, d'une époque particulière et d'une crise qui détermine sa forme.
L'historien du fascisme Robert Paxton nous adressait ainsi cette mise en garde, il y a tout juste 20 ans, alors que le libéralisme triomphant pérorait encore avec Fukuyama sur une supposée « fin de l'histoire » : « Le fascisme du futur - réaction en catastrophe à quelque crise non encore imaginée- n'a nul besoin de ressembler craie pour craie, par ses signes extérieurs et ses symboles, au fascisme classique. Un mouvement qui, dans une société en proie à des troubles, voudrait "se débarrasser des institutions libres « afin d'assurer les mêmes fonctions de mobilisation des masses pour sa réunification, sa purification et sa régénération, prendrait sans aucun doute un autre nom, et adopterait de nouveaux symboles. Il n'en serait pas moins dangereux. » [1]
Il est évidemment tentant de voir dans la catastrophe écologique cette « crise encore non imaginée » qui viendrait, en interaction avec d'autres crises, mettre sous pression les systèmes politiques et sociaux, et contribuer à modeler un corps nouveau au fascisme. De plus en plus d'observateurs osent en tout cas l'affirmer. « Tout semble en place pour une réinvention du vieux fascisme européen autour de la question environnementale », écrit ainsi le journaliste au Monde et spécialiste de l'écologie Stéphane Foucart [2]. Et effectivement, non seulement est-il difficile de concevoir que le fascisme au XXIe siècle puisse s'abstraire de la catastrophe écologique, mais l'enjeu écologique est, par définition, un défi lancé à toutes les traditions politiques, du socialisme au capitalisme, et qui leur impose de se réinventer à l'aune de contraintes nouvelles.
D'où l'émergence progressive dans l'arène politique de deux approches : l' « écofascisme" et le « fascisme fossile »- ou le « carbofascisme », comme l'a aussi désigné l'historien de l'énergie Jean-Baptiste Fressoz. [3] Là où l'écofascisme entend régler la question écologique en s'y adaptant, l'autre la rejette entièrement. Comme deux frères siamois ... mais il ne pourra pourtant en rester qu'un.
Écofascisme ou carbofascisme
Les deux courants répondent aux impératifs caractéristiques du fascisme théorique : réunifier un peuple menacé, le régénérer en retrouvant un âge d'or fantasmé, le purifier par le nettoyage de l'ennemi intérieur et la défense contre l'ennemi extérieur. De là, leurs approches diffèrent pourtant radicalement. L'écofascisme pense avant tout depuis le local ct le terroir. Selon l'idéologie écofasciste, la communauté autochtone fait corps avec son environnement direct auquel elle serait adaptée, et ce lien organique serait menacé par l'arrivée de populations « allochtones », étrangères, inadaptées culturellement comme biologiquement. Le « grand remplacement », concept raciste et paranoïaque de l'idéologue d'extrême droite Renaud Camus, devient aussi un écocide, où l'on peut critiquer à la fois le musulman qui n'aurait aucun respect pour la terre qu'il vient occuper et l'artificialisation des terres nécessaire à son accueil. Le théoricien écofasciste Pierre Vial se sent ainsi autorisé à écrire : « Est-il hérétique de dire qu'il y a quelque raison pour qu'un Congolais soit plus à l'aise au bord de son fleuve que dans les forêts de Haute Savoie ? ». C'est donc un exercice de synthèse que tente de mener l'écofascisme, prétendant à l'instar d'Alexandre de Galzain, le rédacteur en chef du média d'extrême droite Livre Noir, qu'il « n'y a rien d'incompatible à lutter à la fois contre le grand remplacement et contre le grand réchauffement ». Voire même de prétendre, toute honte bue, comme l'influenceur d'extrême droite Julien Rochedy, que l'écologie aurait été dérobée à la droite par la gauche. [4]
Le carbofascisme, lui, se pense avant tout à partir du cadre national, et en épousant une logique de puissance et de domination. li faut « déchaîner la domination énergétique des Etats-Unis », a ainsi déclaré l'élu Lee Zeldin dès sa nomination par Trump comme nouveau directeur de l'Agence de protection de l'environnement, l'organe gouvernemental chargé de lutter contre les émissions et la pollution. De la nature, du terroir, des liens organiques qui lieraient un peuple et son biotope, le carbofascisme n'en a cure, sauf lorsqu'il s'agit d'instrumentaliser la figure de l'agriculteur ou les survivances d'un passé mythifié. « Contrairement aux fascismes européens du début du XXe siècle, qui prospéraient sur un Etat fort et valorisaient le terroir, le paysage et la nature comme des éléments précieux de l'identité nationale, les fascismes émergents sont devenus les compagnons d'une idéologie libertarienne qui prône le démantèlement de l'État, la dérégulation totale de l'activité industrielle, et la poursuite sans entraves de la destruction de la nature et du climat », remarque Stéphane Foucart. Un rapport à l'enjeu écologique qui se réduit à l'enjeu climatique, que le carbofascisme nie- un « canular » et une « escroquerie », selon le 47e président des États-Unis - en alimentant par tous les moyens la machine du doute sur la réalité du changement climatique et son ampleur. « Le carbofascisme implique une fuite en avant à tous les niveaux, résume l'essayiste Pierre Madelin. Accra aux combustibles fossiles, totalement indifférent aux conditions écologiques de sa survie, il est disposé à emporter dans sa tombe le legs de plusieurs milliards d'années d'évolution. » [5]
Plus qu'un refus de comprendre, certains voient même dans l'éloge débridé des énergies fossiles et du mode de vie écocidaire qu'elles soutiennent le signe d'un coup d'État climatique. Le philosophe Mark Alizart identifie le carbofascisme comme « une nécessité plus perverse qui est tout simplement celle de faire en sorte que la crise écologique ait lieu, et dans les plus grandes proportions possibles » [6]. Le philosophe y voit une volonté de régénération du capitalisme, et s'en réfère à l'analyse de Léon Trotski, presque un siècle plus tôt : « Le fascisme est le visage monstrueux que le capitalisme prend quand il ne peut plus se perpétuer qu'à la condition de liquider ses stocks. »
L'IDIOT (UTILE) DU VILLAGE
S'il est toujours hasardeux de se laisser aller à l'exercice de la prospective, difficile de croire, dans un avenir proche, que l'écofascisme puisse l'emporter sur son alter ego accro aux hydro-carbures. li bénéficie certes d'une histoire plus longue, d'un corpus théorique plus solide, de figures. li a aussi pu avoir quelque influence sur des partis, comme les « Localistes » Pierre Juvin et Andréa Kotarac, un temps écoutés au RN, mais sans impact décisif Bref, l'écofascisme n'a pas réussi à dépasser le pittoresque ...
« L'écofascisme, s'interroge Pierre Madelin, aussi sincères puissent être certains de ses idéologues dans leur volonté de décroître et de préserver la nature, n'est-il pas appelé à devenir l'idiot utile, l'apparat idéologique d'une extrême droite qui en ferait un usage stratégique pour parvenir au pouvoir avant d'en revenir, une fois celui-ci conquis, à une politique carbofasciste ? » [7]. Le village, le terroir, les travailleurs au champ ... de belles images à convoquer opportunément contre la dilution « mondialiste », comme l'a mis en lumière l'instrumentalisation par l'extrême droite en France et en Europe de la crise agricole de l'hiver 2024.
Car c'est bien le carbofascisme qui, partout, progresse ou triomphe. L'AfD, le parti allemand d'extrême droite qui remporte victoires sur victoires, s'emportait en 2023 contre l'« hystérie irrationnelle du CO2, qui détruit structurellement notre société, notre culture et nos modes de vie » [8] , et faisait l'apologie, sur ses affiches, du diesel, en revendiquant de pouvoir « rouler avec sa bagnole comme on veut. En France mais aussi en Italie, où l'extrême droite est déjà au pouvoir, on veut serrer les freins sur la transition énergétique et masquer sa politique écocidaire derrière le voile d'une relance nucléaire irréaliste. En Pologne, premier producteur européen de charbon, le parti d'extrême droite Confédération Liberté et Indépendance a choisi pour slogan : « une maison, une pelouse, un barbecue, deux voitures, des vacances ». Que dire de Donald Trump qui vient de nommer Chris Wright, ex-patron de l'entreprise d'exploration et de production pétrolière Stroud Energy, comme ministre de l'Energie, mais s'est aussi engagé à lever toutes les limitations au forage, fait l'éloge de la fracturation hydraulique, et veut maintenir le statut des États-Unis de premières puissance pétrolière du monde. Difficile, pour les forces écologistes et de gauche, de se tromper d'adversaire. « Partout dans le monde, remarque Mark Alizart, le véritable affrontement politique de notre temps se décante et se cristallise : ce n'est pas celui entre le centre mou libéral et le souverainisme conservateur, mais entre l'écosocialisme et le carbofascisme. [9]
[1] Robert Paxton, Le fascisme en action, Paris, Seuil, 2004
[2] Stéphane Foucart, Tout semble en place pour la réinvention du fascisme autour de la question environnementale », Le Monde, 17 novembre 2024.
[3] Jean-Baptiste Fressoz, « Bolsonaro, Trump, Duterte…, La montée de l'écofascisme », Libération, 18 octobre 2018.
[4] Pour se document sur l'écofascisme, ses théoriciens issus de la Nouvelle droite, ses courants et figure en France et aux États-Unis, se rapporter à l'ouvrage de Pierre Mandelin, La tentation écofasciste, Écosociaété 2023.
[5] Pierre Madelin, La tentation écofasciste, Écosociété, 2023
[6] Mark Alizart, Le coup d'État climatique, PUF, 2020
[7] Op.cit.
[8] Grégory Rzepski, Droites en fusion. Le Monde diplomatique, juin 2024.
[9] Op.cit

La grande hypocrisie « verte » nord-sud

L'édito de la dernière parution de la collection Alternatives Sud, Business vert en pays pauvres.
9 avril 2025 - Source : Alternatives sud
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/09/la-grande-hypocrisie-verte-nord-sud/
Quatre ou cinq brèves assertions pour entamer cet éditorial. Quatre ou cinq truismes certes, mais que l'on se sent l'obligation de rappeler avant d'aller plus loin. L'ampleur du désastre écologique d'abord, sa centralité, son urgence. Annoncé par les scientifiques et les activistes depuis des lustres, il explose aujourd'hui dans toute son irréversibilité, par l'hypothèque qu'il fait peser sur la préservation de la biodiversité et des équilibres naturels. Son injustice ensuite, les premières et principales victimes de la crise environnementale et climatique n'étant pas ses premiers et principaux responsables. Les populations vulnérables et les pays pauvres d'un côté, les populations aisées et les pays riches de l'autre. En cause, les répercussions du productivisme et du consumérisme abusifs de ces derniers, la couche démographique la plus opulente – et donc la plus pollueuse – de la planète, moins d'un quart de l'humanité.
D'où, troisième point, la « dette écologique » considérable [1]… dont les « gros mangeurs » sont redevables aujourd'hui envers les nations ou les personnes qui font les frais du festin auquel elles n'ont pas pris part. Or, quatrième évidence, au lieu de l'honorer à la hauteur et à la vitesse requises, cette dette écologique, les grandes puissances économiques, publiques et privées, sont occupées à la creuser davantage encore. En menant des politiques dites de « développement durable » ou de « Green Growth », qui tendent à aggraver les fractures sociales et environnementales. Business vert en pays pauvres, c'est précisément l'objet de ce livre, la grande hypocrisie Nord-Sud consistant à « déplorer les effets dont on continue à chérir les causes », selon la formule consacrée. Prétendre contrer l'effondrement en l'empirant. Qu'en pensent celles et ceux, au Sud, qui y voient du « néocolonialisme vert » ? Tel est le propos des pages et des articles qui suivent.
Néocolonialisme vert
Et d'ailleurs, que faut-il entendre par « néocolonialisme vert » ? À quoi renvoie, au Sud, la notion de néocolonialisme vert ? Ou plutôt, à quoi cette notion renvoie-t-elle en pays pauvres, car au Sud, depuis quelques décennies déjà, ont émergé de nouveaux pays industrialisés (NPI), de nouvelles puissances plus ou moins dominantes, des pays riches… qui, aux yeux des pays pauvres, se rendent également responsables de néocolonialisme vert. Et ce, sur le même mode ou presque que les pays du Nord, soit les pays d'ancienne industrialisation, les premiers grands pollueurs historiques, ainsi que leurs multinationales qui, mondialisation aidant, ont pris pied aux quatre coins du Sud global.
Le colonialisme, le néocolonialisme, on connaît, mais en fonction de quoi peut-on désormais le taxer de « vert » ? À partir de quel moment doit-on colorier en vert de très actuelles entreprises d'exploitation de territoires étrangers ou de nouvelles dynamiques d'assujettissement politico-économique d'anciennes colonies ? La réponse est simple : dès que ces entreprises et dynamiques invoquent des motifs écologiques pour justifier leur ingérence. En d'autres mots, dès qu'un acteur dominant, public ou privé, mobilise des raisons de préservation de la biodiversité ou de sauvegarde des équilibres climatiques pour légitimer ses interventions intéressées en terrain dominé, l'utilisation de la formule « néocolonialisme vert » prend tout son sens.
Pour autant, au Sud, en pays pauvres, il n'y a pas nécessairement consensus quant à ce qui doit être dénoncé (ou pas) comme du néocolonialisme vert. Les opinions publiques, les États, les gouvernements, les entreprises privées, les organisations sociales divergent, forcément. Différentes formes de conservatisme vs de progressisme prévalent, différents degrés de nationalisme ou de souverainisme également, l'aspiration à l'amélioration urgente des conditions matérielles de vie demeurant centrale, tandis que la sensibilité « écosocialiste » – partagée par la plupart des « Points de vue du Sud » réunis dans cet Alternatives Sud – y est plutôt minoritaire. Et même chez ces derniers, intellectuel·les et militant·es plus ou moins critiques de l'Occident ou du capitalisme ou du productivisme…, la cible « néocoloniale verte » peut varier sensiblement.
Pour beaucoup, c'est l'instrumentalisation de l'impératif écologique par les pays riches qui pose problème, qu'elle soit convictionnelle ou concurrentielle, c'est-à-dire qu'elle ait pour objectif prioritaire de « sauver la planète » ou de « grossir les taux de profit ». Ainsi, le protectionnisme vert aux frontières occidentales, l'imposition de normes « durables » aux échanges commerciaux ; les réticences ou les conditionnalités mises au transfert des technologies propres ou aux financements des politiques d'atténuation des catastrophes environnementales, mais surtout de réparation et d'adaptation à leurs effets déjà irréversibles ; la ruée vers « les minerais de la transition » ou la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières agroforestières, nécessaires au verdissement des économies dominantes ; ainsi que d'autres mesures encore, liées au marché du carbone notamment, apparaissent comme les principaux vecteurs du néocolonialisme écologique pratiqué par les pays les plus puissants à l'égard des pays pauvres.
Comme le soulignent Audrey Gaughran et Bart-Jaap Verbeek (2024) du centre d'étude SOMO, cette tendance protéiforme est l'expression de la « course géopolitique » que se livrent les premières économies mondiales – les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, auxquelles on ajoutera les pétromonarchies du Golfe notamment – « pour gagner la transition verte ». Prioritairement, les grandes puissances « s'efforcent de s'assurer qu'elles et leurs entreprises arrivent en tête, en contrôlant les technologies vertes et en accroissant leurs économies. Elles partent avec des avantages considérables – fondés sur de profondes injustices historiques, surtout pour le pôle occidental – et leurs approches compétitives sapent les perspectives de développement durable de la plupart des autres pays. »
La concurrence entre géants économiques surdétermine l'ensemble. Les grands cadres politiques et législatifs prétendument « durables » définis par les États-Unis et l'Union européenne dans l'après-pandémie – tels que l'Inflation Reduction Act en 2022 à Washington ou l'European Green Deal et le Critical Raw Materials Act à Bruxelles en 2023 et 2024 – sont d'ailleurs à considérer d'abord comme des réponses à la politique du Made in China lancée dès 2015 par Pékin. Dans tous les cas, il s'agit de donner « un coup de pouce massif à leurs industries et entreprises » par le biais « de subventions et d'aides publiques diverses », en exerçant « une influence sur la politique étrangère en leur nom » et en s'appuyant sur « un ensemble de lois inéquitables en matière de commerce, d'investissement et de fiscalité, rédigées de manière à favoriser les intérêts du Nord global » (Gaughran et Verbeek, 2024) ou ceux des nouvelles puissances du Sud global.
Même dénonciation du néocolonialisme vert chez Jomo Kwame Sundaram, économiste malaisien, figure tiers-mondiste et chercheur associé au CETRI, selon lequel les nouvelles politiques affichées « équitables et durables » du Nord global sont empreintes d'une hypocrisie qui laisse intacts les mécanismes de domination, dont les effets aggravent tant les inégalités sociales que les dérèglements écologiques. Il en va ainsi, par exemple, du « Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) » dont s'est récemment doté l'Union européenne. Mécanisme qui va lui permettre d'imposer un surcoût une « taxe carbone » – aux importations de fer, d'acier, de ciment, d'engrais, d'aluminium, d'électricité et d'hydrogène produites hors Europe par des entreprises non soumises, comme leurs concurrentes européennes, à des normes environnementales les contraignant à payer un prix pour les gaz à effet de serre émis. Pour Sundaram, cet instrument qui vise officiellement à réduire les émissions ne va qu'accentuer les fractures Nord-Sud (Sundaram, 2024).
Dans cette configuration de rapports asymétriques qui tend à prévaloir en matière de politiques « écologiques », de nombreux pays, africains, asiatiques et latino-américains pour la plupart, se voient confirmer, d'une part, leur rôle historique de fournisseurs de matières premières – des matières premières toujours transformées ailleurs, mais à des fins de préservation de la nature cette fois – et d'autre part, leur destin subalterne d'acheteurs – incités à l'être, pour le moins – de technologies vertes vendues par les États-Unis, l'Union européenne et la Chine pour l'essentiel. Kudakwashe Manjonjo et Karabo Mokgonyana du groupe de réflexion Power Shift Africa y voient aussi les marqueurs du green neo-colonialism à l'œuvre dans les rapports Nord-Sud. Les mesures prises ces dernières années par ces trois géants mondiaux « renforcent l'inégalité des échanges commerciaux, qui empêche l'Afrique et les autres pays en développement de développer leurs propres économies vertes » (2024).
La priorité des grandes puissances est de « gagner la course aux énergies renouvelables, la guerre économique mondiale de l'industrialisation verte. Or, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. L'Union européenne, les États-Unis et la Chine sont déterminés à l'emporter, à sortir vainqueurs, et se moquent de savoir qui perd, tant que ce n'est pas eux. Dans cet affrontement, il semble que l'Afrique soit une fois de plus l'herbe qui souffre. (…) Les ‘partenariats verts' injustes entre le Nord et le Sud amplifient la dégradation de l'environnement et aggravent les inégalités. Les puissances extérieures profitent d'accords commerciaux inéquitables et des schémas historiques d'extraction des richesses, tandis que les communautés africaines supportent l'essentiel des coûts » (Manjonjo et Mokgonyana, 2024).
Parmi les principaux contempteurs du « néocolonialisme vert » des pays dominants, on le devine, figurent une bonne part des gouvernements du Sud, lesquels mettent davantage en cause l'imposition de régulations écologiques – hautement préjudiciables par exemple à l'Afrique du Sud, où le charbon reste une source d'énergie majeure – que la logique même du capitalisme mondialisé. Fortes d'un des grands principes d'équité Nord-Sud entérinés par la communauté internationale dès le Sommet de la Terre de 1992 – celui des « responsabilités communes mais différenciées », qui octroie aux « pays développés », en vertu de leur passif (environnemental) et de leurs actifs (financiers et technologiques), le plus grand devoir de résolution des crises écologiques –, ces voix officielles du Sud dénoncent urbi et orbi tout obstacle mis par les économies du Nord, au nom de la décarbonation énergétique, à la libre circulation de leurs exportations. « À vous de faire les efforts, pas à nous », l'empreinte environnementale d'un individu africain moyen étant encore sept fois moindre que celle de son équivalent européen.
C'est ce même discours que le président Lula notamment, poussé par les grands groupes du business brésilien, martèle dans les enceintes internationales. Une exacte copie inversée du plaidoyer libre-échangiste/protectionniste de Trump, Xi Jinping, von der Leyen et consorts pour « plus de libéralisation chez eux et moins chez nous ». Ouvrez vos frontières, nous protégeons les nôtres. Un « anticolonialisme de marché » en quelque sorte, pour paraphraser la caractérisation que fait Le Monde diplomatique (24 octobre 2024) du positionnement des BRICS+, le nouvel héraut autoproclamé du Sud global. Peu ou pas de mise en cause en tout cas des fondamentaux du modèle conventionnel de développement tiré par les investissements transnationaux, l'afflux de capitaux étrangers et les exportations. En témoigne une nouvelle fois, exemple parmi d'autres, la tonalité anti-clauses sociales et environnementales des positions des pays du cône sud de l'Amérique latine dans les négociations de l'accord commercial entre le Mercosur et l'Union européenne (Wintgens, 2024).
En cela, note l'organisation asiatico-africaine IBON lors d'un webinaire consacré aux alternatives locales aux politiques climatiques mainstream (https://climatejusticehub.org, 30 septembre 2024), le bras de fer Sud-Nord sur ces questions renforce, davantage qu'il ne questionne, les solutions par le marché et la pleine subordination au commerce mondial. Incidemment, quand elle se focalise sur les seules tentatives de régulation environnementale, cette dénonciation par le Sud du néocolonialisme vert peut aussi coïncider, si pas converger, avec le bashing systématique de l'écologie dite « punitive » et le déni climatique auquel se livrent, avec force approbation populaire, les droites nationales-populistes occidentales [2]. Et partant, participer de la perpétuation d'un modèle de développement capitaliste prédateur, quand bien même le productivisme effréné et le consumérisme des privilégiés qu'il nourrit sont responsables des écarts sociaux et des catastrophes écologiques qui affectent d'abord les couches sociales et les pays les plus vulnérables.
À relever enfin le peu de réceptivité des opinions publiques du Sud, en particulier dans les milieux démunis, à l'« éco-anxiété » occidentale ou, plus concrètement, aux campagnes « écoresponsables » de gestion des déchets par exemple, lancées là-bas par les institutions internationales concernées (PNUE, etc.) et relayées par les autorités locales. Là où les besoins matériels de base – accès à l'électricité, à l'eau courante… – ne sont pas assouvis, peu de place forcément pour les préoccupations « postmatérialistes » sur l'état de la biodiversité et les dérèglements climatiques. La sensibilité écologique, on le sait, reste très située socialement et culturellement (CETRI, 2020). Comment s'émouvoir de « la fin du monde » quand « la fin du mois », de la semaine, de la journée requiert toutes les énergies mentales et physiques ? Peu d'anticapitalisme non plus, dès lors, dans les allergies populaires au néocolonialisme vert, et encore moins d'antiproductivisme ou d'appels à une sobriété postdéveloppementiste, mais un rejet épidermique de toute norme « durable » ou frein politiquement correct à l'accès à la consommation… vitale.
Fausses solutions
Dans les articles qui composent cet Alternatives Sud en revanche, le réquisitoire contre le « néocolonialisme vert » pratiqué en pays étrangers par les acteurs économiques dominants, publics et privés, colle de près à la critique du système capitaliste et/ou du développement productiviste. Elle en est même le corrélat, la condition. La supposée « transition » climatique ou énergétique « hégémonique » menée par ces acteurs n'est pas « juste », ni socialement ni écologiquement. Elle repose sur l'implémentation d'un éventail de « fausses solutions » en pays pauvres qui, les unes ajoutées aux autres, perpétuent la logique antédiluvienne du modèle de développement prédateur, repeint en « nouveau pacte durable », administré par les empires coloniaux et postcoloniaux dans leurs zones d'influence tropicales.
Sous ce leitmotiv de « fausses solutions », on trouve en vrac : les mégaprojets de compensation carbone en échange de droits de polluer, la mise sous cloche conservationniste d'aires protégées à distance des populations locales (mais pas des « écotouristes »…), les politiques de dépossession des terres, de privatisation, d'extraction de minerais, les accords commerciaux sur les ressources [3], les monocultures d'agrocarburants, la financiarisation du vivant, la marchandisation des services écosystémiques, le green businessdu capital naturel, etc. L'ensemble procède d'une absorption de l'écologie par la combinaison d'une double logique : celle, libérale, d'accumulation privative et celle, néocoloniale, d'emprise contrainte. La tendance grève d'autant la dette écologique des pays riches à l'égard des pays pauvres. Et éloigne les uns et les autres des voies d'un développement partagé, juste et équilibré.
La chercheuse et militante Mary Ann Manahan, également associée au CETRI et qui signe l'un des articles de cet Alternatives Sud, ne disait pas autre chose lors d'une conférence de l'organisation Focus on the Global South l'été dernier aux Philippines. « Dans la course des grandes puissances mondiales à la primauté géoéconomique, la rhétorique des Green Deals qui se succèdent évoque des ‘alliances vertes' et des ‘matières premières durables', mais sans jamais nous expliquer comment l'extractivisme le deviendrait, durable, et les relations Nord-Sud, moins asymétriques. En réalité, ces politiques ‘environnementales' présentent deux caractéristiques. Premièrement, elles ne sont pas axées sur la préservation des écosystèmes naturels, mais sur l'accumulation de capital. Deuxièmement, partant du principe que certaines régions du monde et certaines populations sont naturellement au service des autres, elles ont une portée coloniale. »
La façon dont ces deux dimensions structurent les différentes politiques dites « vertes » menées en pays à bas revenus ou vis-à-vis de ceux-ci est illustrée à l'envi dans cet Alternatives Sud, au fil des analyses critiques présentées. Ce que Maristella Svampa et Breno Bringel y appellent « le consensus de la décarbonation » donne le « la ». Cette nouvelle source mondiale de légitimité du modèle capitaliste vise officiellement à transformer le système énergétique basé sur les combustibles fossiles en un système à émissions de carbone faibles, basé sur les énergies renouvelables. Réduisant en cela la crise écologique à une seule de ses pourtant multiples causes – le CO₂ rejeté dans l'atmosphère [4] –, elle entend lutter contre les dérèglements climatiques en promouvant une transition énergétique tirée par l'électrification de la consommation et la numérisation.
Ce faisant, le consensus de la décarbonation entraîne une double dynamique délétère en pays pauvres, qui englobe une part importante des « fausses solutions » dénoncées par les autrices et auteurs de cet ouvrage. Il s'agit, d'une part, de l'extractivisme à des fins « durables », qui consiste à s'assurer de l'approvisionnement en quantités considérables de matières premières critiques (minières, agricoles ou forestières, tels le bois de balsa, le lithium, le cobalt, le nickel, l'huile de palme, etc.), nécessaires à la production ou au fonctionnement des technologies « propres » de la transition énergétique (CETRI, 2011, 2013b, 2023). Il s'agit, d'autre part, du conservationnisme à des fins de « neutralité carbone », qui consiste à considérer comme puits de CO₂ sûrs et quantifiables de nouveaux territoires (sols, sous-sols, eaux, forêts…), précisément utilisés pour les « valoriser » en zones de capture et de stockage, naturels ou artificiels, d'émissions polluantes.
Les marchés du carbone et les mécanismes visant à en compenser la surproduction, discutés par plusieurs des articles de cet Alternatives Sud, jouent à plein dans ce volet conservationniste des dynamiques induites par le consensus de la décarbonation. Régulés ou volontaires, ils offrent la possibilité aux États, entreprises et individus pollueurs qui peinent à réduire leurs émissions, de s'acheter des « crédits carbone » qui compensent leurs excès supposés « irrépressibles », en finançant des projets (conservation de forêts ou reboisement, technologies de séquestration, mais aussi parcs éoliens, etc.) censés réduire, éviter ou retirer une quantité équivalente de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Or ces projets prennent l'eau de toutes parts : en raison, au mieux, de leur « inutilité » [5], des réductions fictives d'émissions qu'ils mettent en vente, de l'exonération à bas coûts des pollueurs et de l'enrichissement de sociétés courtières qu'ils autorisent ; au pire, en raison des impacts négatifs de ce green grabing pour les populations locales, souvent dépossédées de leur souveraineté sur leurs propres ressources. [6]
Le tout a été rappelé lors de la dernière COP Climat de Bakou face au nouvel accord, bancal, adopté en la matière, qui prétend mieux réguler une partie des crédits carbone mais qui ne rassure pas sur l'effectivité, la durabilité et la fiabilité des mécanismes validés. « Commencer la COP29 par l'adoption de règles risquées et pleines de lacunes sur les marchés du carbone, c'est un signal clair envoyé au monde : les gens et la planète ne sont pas la priorité. On légitime un mécanisme défectueux dont on a constaté à maintes reprises qu'il causait des dommages et qu'il ne fonctionnait tout simplement pas. Cette décision aura des effets désastreux » (Rachel Rose Jackson, https://corporateaccountability.org). Proclamer que « les compensations carbone constituent une solution viable au chaos climatique est l'un des récits mondiaux les plus préjudiciables. Elles sont devenues un obstacle au changement structurel, en permettant à l'économie dépendante des combustibles fossiles de se maintenir dans l'illusion de l'action climatique, (…) en truquant les chiffres » (Joanna Cabello & Ilona Hartlief, https://www.somo.nl).
Plus globalement, au-delà de ce que ces « fausses solutions » discutées dans cet ouvrage induisent concrètement en matière d'extractivisme, de conservationnisme ou de productivisme « verts », le principal trait commun des politiques « écologiques » menées par les acteurs les plus puissants en pays pauvres, généralement avec l'assentiment intéressé des élites nationales, renvoie à la marchandisation, à la privatisation et à l'accaparement du vivant. Ce que Manahan appelle dans ces pages « la financiarisation de la question environnementale » : la mise en vente des ressources naturelles, biologiques, génétiques… au plus offrant, pour mieux « sauver la planète ». Car, le dogme est formel, la valorisation du « capital naturel » (l'attribution d'un prix – le coût de la conservation – à telle ou telle fonction écosystémique) a pour vertu de le sortir de son invisibilité économique, de le préserver, voire de le faire fructifier, le marché mondial étant mieux à même que les autorités publiques ou les populations locales d'assurer la durabilité d'un bien dont dépendent ses taux de profit.
Rappelons-nous, c'était déjà le credo de « l'économie verte » célébrée à Rio+20 en 2012, seule en mesure selon ses promoteurs (du PNUE à l'Union européenne, en passant par le Forum de Davos, la Banque mondiale, le G20, PricewaterhouseCooper, etc.) de « découpler » croissance de l'économie et hausse des pollutions. Ou, mieux dit, de réconcilier capacité à faire du profit et capacité à protéger l'environnement, en valorisant la nature comme actif monétaire ou financier dans les stratégies d'accumulation (CETRI, 2013a). À ce stade pourtant, force est de constater que ces politiques menées depuis une trentaine d'années au nom du « développement durable » d'abord, de la « Green Growth » ensuite ou encore de tel ou tel « nouveau pacte vert » – qui, selon les mots du président du Conseil européen en 2020, « convertissent une nécessité existentielle pour la planète en opportunités économiques » – n'ont fait la preuve ni d'un renversement de logique ni même d'une inversion de tendances. Le « capitalisme vert » est un oxymore, la quantification de ses impacts écocidaires n'en finit pas de le confirmer.
Solutions postcapitalistes ou postdéveloppementistes ?
À gauche, au Sud comme au Nord, parmi les forces politiques réellement préoccupées et mobilisées par le désastre socio-environnemental en cours, on trouve divers courants qui – en simplifiant pour mieux les distinguer – situent les causes premières des déséquilibres soit dans la perpétuation d'un mode d'exploitation économique source de toutes les dominations, soit dans la quête infinie d'une croissance forcément insoutenable sur le plan écologique. Les premiers s'attaquent au néolibéralisme ou, pour les plus conséquents, au capitalisme, fût-il estampillé « responsable », « vert » ou « inclusif » ; les seconds entendent déconstruire le développementisme, souvent associé à l'occidentalisme, voire à l'idée même de progrès ou de modernisation.
Ces courants sont-ils irréconciliables ? Leurs divergences sont-elles rédhibitoires ? Paradoxalement peut-être, le dépassement de leurs désaccords, même fondamentaux, apparaît moins difficile à atteindre que ne devrait l'être le ralliement dans les opinions publiques d'une « masse critique ». C'est-à-dire le franchissement du seuil d'adhésion populaire à partir duquel l'inévitabilité et le bienfondé des ruptures préconisées et des propositions avancées rendront ces dernières démocratiquement applicables. Dit encore autrement, des deux défis à relever – « accorder les violons » puis « remplir la salle du concert » –, si l'un n'est pas gagné, l'autre semble plus laborieux encore à envisager.
Certes, ce qui divise anticapitalistes et antidéveloppementistes – y compris parmi les autrices et auteurs de cet Alternatives Sud – n'est pas à sous-estimer. Les premiers, plus socialistes qu'écologistes, reprochent aux seconds, plus écologistes que socialistes, leurs tergiversations à l'égard du capitalisme, ainsi que l'incongruité des concepts de sobriété et de décroissance dans les couches sociales qui peinent à assouvir leurs besoins de base. À l'inverse, les seconds réprouvent les atermoiements des premiers à l'égard du productivisme, ainsi que l'impudence des droits au développement et à l'industrialisation face à la finitude et à l'état de la planète. D'un côté, l'exploitation capitaliste, responsable de toutes les injustices socio-environnementales, est la mère des forteresses à vaincre ; de l'autre, c'est le rapport suprémaciste et utilitariste des modernes à la nature qui recèle en lui, intrinsèquement, les racines de l'inéluctable effondrement. La porte de sortie devra donc être postcapitaliste et/ou postdéveloppementiste.
Ce qui réunit ces deux pôles ne peut non plus être sous-estimé. Et permet de penser à l'articulation de la gauche égalitariste et de l'écologie politique, voire de l'« écosocialisme » et de la « décroissance » dont, parmi d'autres, Daniel Tanuro, auteur de L'impossible capitalisme vert et Timothée Parrique, auteur de Ralentir ou périr : l'économie de la décroissance, envisagent sérieusement la possibilité (Tanuro préfacé par Parrique, 2024). Des deux côtés, c'est sûr, on partage la conscience que l'augmentation des financements climat et l'accélération de l'application des politiques vertes mainstream ne suffiront pas. Que les solutions technologiques et de géo-ingénierie que l'on nous annonce depuis des lustres ne seront, pour les plus réalistes et les moins néfastes d'entre elles, que très partiellement à la hauteur des défis. Et surtout que la résolution de la crise écologique passe nécessairement par une transformation en profondeur des modes de production, de transport et de consommation actuellement à l'œuvre.
Les deux courants convergent dans la priorité à donner à l'indispensable « justice sociale et environnementale », ainsi que sur les principaux mécanismes politiques à mobiliser pour l'atteindre. Et ce, parce qu'en amont, ils réussissent également à s'accorder sur les justifications éthiques de cette convergence, ramassées ici par Jacques Bouveresse. « Qu'il puisse se révéler nécessaire d'imposer des limites même à l'aspect qui est le plus tangible et le moins contestable du progrès – à savoir l'amélioration des conditions et du niveau de vie des êtres humains – devrait être une chose tout à fait logique. Et c'est une idée qui, contrairement à ce que les défenseurs du progrès affectent généralement de croire, est tout à fait compatible avec la conviction qu'il est impératif et urgent d'améliorer sérieusement les conditions d'existence des millions de personnes qui vivent aujourd'hui de façon misérable » (2023).
Découlant de ces convictions partagées, les solutions préconisées par les autrices et auteurs de cet Alternatives Sud sont autant de ruptures avec la plupart des politiques « vertes » imposées à ce jour. Du global au local, elles parient sur le respect d'un ensemble de lignes de force, de principes génériques tous déclinables et d'ailleurs déclinés en un grand nombre de mesures à prendre, considérées comme « faisables », immédiatement opérationnelles… en fonction des situations et de rapports de force plus ou moins favorables à l'intérêt général, plutôt que dominés par des intérêts privés. Ces propositions alternatives vont de la planification écologique et de la relocalisation économique à la démocratisation sociale, la redistribution agraire, la justice fiscale, l'équité commerciale, le protectionnisme solidaire, la souveraineté alimentaire, la multipolarité internationale, l'autodétermination politique, la démondialisation, etc.
Ces solutions de rupture passent dès lors nécessairement et peut-être d'abord par le remboursement intégral de la dette écologique (Kolinjivadi et Vansintjan, 2024), la restriction draconienne des activités polluantes liées au productivisme et au consumérisme, l'interdiction de toute subsidiation publique des secteurs nuisibles à l'environnement, la régulation drastique des marchés financiers et la sanction de tout placement socialement et écologiquement toxique, la déspécialisation des territoires, la démarchandisation des biens communs, la limitation des droits des uns (élites patrimoniales, financières, industrielles, transnationales…) là où ils empiètent sur les droits des autres et de la biodiversité, l'instauration d'un revenu maximum autorisé, etc.
Pour bien la distinguer de l'idée de transition (et même de transition juste) cooptée ces dernières années (et vidée de son sens transformateur) par le capitalisme vert et les institutions internationales alignées, les « points de vue du Sud » réunis dans cet ouvrage invitent et réinvitent à comprendre la « transition écosociale » à mener comme un processus de réélaboration radicale tant du rapport à la nature des sociétés contemporaines que des rapports sociaux, des rationalités politiques et du modèle économique. Cette transition est « déjà à l'œuvre dans de multiples expériences communautaires localisées tant en zones rurales qu'urbaines », insistent Lang, Bringel et Manahan dans leur article commun. « C'est dans ces éco-utopies de ‘réexistence' territorialisées – collectifs populaires d'énergie propre, maraîchages participatifs urbains, économies locales circulaires diversifiées, dynamiques agroécologiques redistributives… – que résident les alternatives les plus concrètes au colonialisme vert. »
Le principal obstacle à leur articulation régionale, nationale et internationale et à la constitution de forces politiques à même de les relayer et de les orchestrer réside précisément, selon la philosophe Nancy Fraser entre autres, dans le développementisme dominant et l'hégémonie du capitalisme. Une hégémonie qui « en soumettant de vastes aspects de la vie sociale à la ‘loi du marché' (c'est-à-dire aux grandes entreprises), nous prive de la capacité de décider collectivement ce que nous voulons produire et en quelle quantité, sur quel principe énergétique et selon quels modes de relations sociales. Elle nous prive également des moyens de décider de l'emploi du surplus social produit collectivement, de la relation que nous voulons avec la nature et les générations futures, de l'organisation du travail de reproduction sociale et de son rapport à la production » (Fraser, 2025).
Reste dès lors un grand nombre de défis et de questions irrésolues, dont celles posées par Barbesgaard, Zhang, Hertanti, Gagyi et Vervest en fin de leur contribution dans cet Alternatives Sud. Quelle est le poids populaire réel des alternatives pratiques déjà en marche ? Quelles sont les bases sociales potentielles d'un modèle postcapitaliste ou postdéveloppementiste, au Sud et au Nord ? Quelles coordinations ou confluences politiques entre ces dernières ont-elles réussi à prendre forme et à déployer leurs orientations ? Quelle articulation envisager par exemple, très concrètement, entre syndicats de travailleur·euses du secteur des véhicules électriques, luttes des populations affectées par l'exploitation minière nécessaire à cette industrie et revendications sociales des mineurs eux-mêmes ?
Au-delà, quelle politique industrielle verte en pays pauvre sera-t-elle capable de maximiser, nationaliser et socialiser les bénéfices socioéconomiques locaux, tout en minimisant les dégâts causés à la biodiversité ? Avec quels acteurs, quels mouvements sociaux et quels États mettre en œuvre, dans les relations commerciales, les configurations guerrières et les bras de fer inter-impériaux en cours, un programme de meilleure répartition des richesses, juste et équitable, et des manières de faire indolores sur le plan écologique, c'est-à-dire qui, globalement, produisent, transportent et consomment nettement moins ? Et enfin, en deçà, au sein même des résistances au néocolonialisme vert, comment arbitrer entre les accents mis sur la notion de « souveraineté » ou sur celle d'« autonomie », de « public » ou de « commun », sur l'étatisme ou le communalisme, sur le progressisme, l'universalisme ou la revalorisation des cultures indigènes, ou encore sur le matérialisme ou le postmatérialisme ? Pour sûr, la sortie de la catastrophe écologique ne sera ni un dîner de gala ni un long fleuve tranquille.
Notes
[1] Lire CETRI, « Le Nord remboursera-t-il un jour sa ‘dette écologique' au Sud ? », 18 juin 2024, Equal Times
[2] À l'heure d'écrire ces lignes, un membre du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) rappelle publiquement (https://auvio.rtbf.be/media/matin-premiere) que, d'après une étude publiée en 2024 (https://www.carbonbrief.org/analysis-trump-election-win-could-add-4bn-tonnes-to-us-emissions-by-2030/), la réélection du républicain Donald Trump à la présidence des États-Unis va coûter à l'humanité, rien qu'en émissions carbone, en quatre ans et sur le plan strictement domestique, plus du double de ce que la « transition énergétique mondiale » est parvenue à épargner ces cinq dernières années.
[3] Dans cet Alternatives Sud, l'article de González et Verbeek notamment explique par le détail les différents instruments politiques et juridiques utilisés par l'Union européenne dans les négociations commerciales pour assurer le caractère asymétrique des accords conclus. Des accords qui, par exemple, illégalisent les restrictions à l'exportation des minéraux critiques que nombre de pays du Sud tentent d'imposer pour en promouvoir le traitement sur leur territoire, y créer de la valeur ajoutée et développer sur cette base leur propre industrie verte.
[4] Laissant donc de côté, par exemple, la dissémination en hausse des plastiques dans l'environnement, l'arrosage tous azimuts de pesticides chimiques, la production de quantités toujours plus considérables de déchets, peu ou mal recyclés, l'artificialisation croissante des sols, la pollution de l'air par les particules fines, la contamination des eaux par un cocktail de nouveaux polluants, la surexploitation des nappes phréatiques, des terres et des mers, l'impact délétère grandissant de la ruée minière, etc.
[5] « La majorité des projets de compensation qui ont vendu le plus grand nombre de crédits carbone sont ‘vraisemblablement de la camelote' (likely junk) » conclut entre autres une étude de Corporate Accountability relayée par The Guardian du 19 septembre 2023 : « Revealed : top carbon offset projects may not cut planet-heating emissions ».
[6] Pour une analyse fouillée et balancée des conditions d'efficacité, des risques et des effets pervers des multiples instruments de marché (techniques, financiers et juridiques : compensation biodiversité, certifications, fiscalité écologique, processus REDD+, paiements pour services environnementaux, Green Bonds, fonds fiduciaires conservationnistes, accès et partage des avantages (APA) des ressources génétiques, droits de propriété intellectuelle, etc.) mis à la disposition des grands pollueurs afin de concevoir leurs politiques environnementales, lire notamment les travaux d'Alain Karsenty du CIRAD (https://catalogue-formation.cirad.fr/formation/136/instruments-economiques-et-financiers-pour-le-climat-et-la-biodiversite/175).
Bibliographie
Bouveresse J. (2023), Le mythe moderne du progrès, Marseille, Agone, collection Éléments.
CETRI (2011), Agrocarburants : impacts au Sud ? , Paris, Syllepse, collection Alternatives Sud.
CETRI (2013a), Économie verte : marchandiser la planète pour la sauver ?, Paris, Syllepse, collection Alternatives Sud.
CETRI (2013b), Industries minières – Extraire à tout prix ?, Paris, Syllepse, collection Alternatives Sud.
CETRI (2020), L'urgence écologique vue du Sud, Paris, Syllepse, collection Alternatives Sud.
CETRI (2023), Transition verte et métaux critiques, Paris, Syllepse, collection Alternatives Sud.
Fraser N. (2025), Le capitalisme est un cannibalisme, Marseille, Agone, collection Contre-feux.
Gaughran A. et Verbeek B-J. (2024), « Green Industrial Policies – The ‘win-lose' approach of major economic powers undermines any hope of a just transition », SOMO, 26 août.
Gelin R. (2024), « La décroissance, nouveau sens commun ? », GRESEA, 18 mars.
Kolinjivadi V. et Vansintjan A. (2024), « Nothing can be ‘green' or ‘eco-friendly' until the ecological debt is paid », CETRI, 19 décembre.
Manjonjo K. et Mokgonyana K. (2024), « Foreign countries are lining up to exploit Africa's critical minerals », Other News, 29 octobre.
Merlant M. et al. (2021), L'écologie, un problème de riches ?, Paris, Ritimo.
Steinfort L. et al. (2023), Les multinationales « vertes » démasquées, Common Findings Report, TNI, CorpWatch, ODM, ODG, ENCO.
Sundaram J.K. (2024), « Rich Nation Hypocrisy Accelerating Global Heating », CETRI, 24 avril.
Tanuro D. & (préface de) Parrique T. (2024), Écologie, luttes sociales et révolution, Paris, La Dispute.
Wintgens S. (2024), UE-Mercosur : faire de l'accord commercial un levier de développement durable, Note politique, Bruxelles, CNCD.
Bernard Duterme
https://www.cetri.be/La-grande-hypocrisie-verte-Nord
https://www.syllepse.net/business-vert-en-pays-pauvres-_r_22_i_1114.html
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les talibans arrêtent et torturent des militantes LGBT

Kaboul Afghanistan – Les talibans ont arrêté et emprisonné deux militantes LGBT+ afghanes de premier plan, Maryam Ravish, une lesbienne, et Abdul Ghafoor Sabery, une femme transgenre qui se fait appeler Maeve Alcina Pieescu. Leur vie est gravement menacée.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Mariam, 19 ans, et Maeve, 23 ans, devaient s'enfuir de Kaboul à bord d'un vol de Mahan Airlines à destination de l'Iran avec Parwen Hussaini, 20 ans, la partenaire de même sexe de Mariam, le 20 mars 2025, avec l'aide de Roshaniya, le réseau LGBT+ afghan.
Roshaniya travaille avec la Fondation Peter Tatchell à Londres pour faire connaître leur situation et faire pression pour leur libération.
Nemat Sadat, directeur général de Roshaniya, a déclaré :
« Lorsque Maryam et Maeve sont montées à bord de l'avion, elles ont été arrêtées par l'unité de renseignement des talibans qui a fouillé leurs téléphones et découvert des contenus LGBT+. Maeve et Maryam ont été battues par les talibans. On s'attend à ce qu'elles soient torturées pour révéler les noms d'autres LGBT et qu'elles soient condamnées à une longue peine de prison, voire exécutées.
Parwen Hussaini, la partenaire lesbienne de Maryam, a réussi à prendre le vol et se trouve maintenant en Iran, mais sans l'amour de sa vie. Parwen et Maryam avaient prévu de se marier dans une ville européenne.
Parwen Hussaini a enregistré une vidéo documentant en farsi ce qui s'est passé. En voici la traduction :
« Salaam. Je m'appelle Parwen, j'ai 20 ans et je viens de Kaboul. Je suis l'une des LGBT afghanes, je défends les droits des êtres humains et je suis membre de l'organisation LGBT+ Roshaniya, dirigée par Nemat Sadat. (Depuis que Maryam et Maeve ont été capturées par les talibans, la famille de Maryam est entrée en contact avec moi et a menacé ma vie et celle de ma propre famille.
« Maeve et Maryam sont toujours retenues en captivité par les talibans et elles ont été très violemment battues. La famille de Maeve n'a pas pris contact avec nous et n'a pas essayé de faire libérer Maeve… Iels ont rejeté notre demande de collaboration. Nous n'avons pas de nouvelles de Maryam, nous ne savons pas dans quelle situation elles se trouvent maintenant. Il est possible qu'elles soient placées à l'isolement et lapidées à mort – il est possible qu'elles soient condamnées à la peine de mort.
« Je vous demande de bien vouloir nous aider, de travailler avec Nemat Sadat et notre équipe à Roshaniya, afin que nous puissions être relogées dans un endroit sûr – moi, Maryam et Maeve – pour échapper aux menaces existentielles auxquelles nous sommes confrontées de la part des talibans et de nos proches. Nous demandons aux organisations de défense des droits des êtres humains et aux organisations internationales LGBT+ qui s'efforcent d'aider les personnes LGBT+ de nous aider à retrouver notre liberté et à sauver nos proches », a déclaré Mme Hussaini.
Susan Battaglia, la sœur de Maeve, qui vit aujourd'hui dans le Michigan (États-Unis), a déclaré :
« Maeve est ma sœur et je suis bouleversée par son emprisonnement. Ma famille en Afghanistan est très inquiète à l'idée que Maeve soit torturée et tuée. Au cours de l'interrogatoire des talibans, Maeve a avoué qu'elle n'était pas musulmane et qu'elle ne croyait pas en l'islam. C'est effrayant pour notre famille, car l'apostasie est passible de la peine de mort en vertu de la charia. Nous demandons aux gouvernements du monde entier d'exiger que Maeve soit libérée de prison et qu'elle puisse quitter le pays en toute sécurité ».
Nemat Sadat, directeur général de Roshaniya :
« Dans le cas de Maryam, sa famille a refusé d'accepter sa sexualité en tant que lesbienne et l'a forcée à épouser un homme. Elle a tenté de s'échapper et Maeve, une personne transgenre, l'a aidée au péril de sa vie. Maryam et Maeve risquent aujourd'hui la peine de mort pour avoir simplement voulu être libres et heureuses. Unissez-vous à nous pour exiger la libération immédiate de Maryam Ravish et de Maeve Alcina Pieescu ».
« La source réelle de ce problème est enracinée dans l'interprétation par les talibans de la charia islamique, qui considère que l'homosexualité est interdite et que la place d'une femme est à la maison, ce qui explique pourquoi les femmes afghanes doivent être accompagnées d'un chaperon masculin si elles souhaitent quitter la maison et voyager seules », a déclaré M. Sadat.
Nous demandons à toutes les organisations de défense des droits des êtres humains (en particulier Human Rights Watch et Amnesty International) et aux organisations LGBT+ (en particulier OutRight International, ILGA Asia, Stonewall, Rainbow Railroad et Human Rights Campaign) de nous aider à faire connaître l'arrestation de Mariam et Maeve et de faire pression sur le régime taliban pour qu'il libère ces deux courageuses défenseures afghanes des droits des êtres humains LGBT+ », a ajouté M. Sadat.
31 mars 2025
https://www.petertatchellfoundation.org/taliban-arrest-torture-lgbt-activists/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les lesbiennes ripostent également en Australie Questions à poser au sujet sur les lesbiennes

Discours
prononcé le 21 mars 2025 au Forum de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies 69/Beijing+30
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/01/les-lesbiennes-ripostent-egalement-en-australie/?jetpack_skip_subscription_popup
Aujourd'hui, je m'adresse à vous depuis le pays aborigène de Djiru, situé dans l'extrême nord du Queensland, où je vis et travaille, et je reconnais respectueusement leurs droits de possession de leurs terres et leurs voies navigables. Je salue également les nombreuses femmes qui, tout au long de l'histoire, ont lutté pour la liberté des femmes et des lesbiennes, souvent au prix de leur vie.
Je vais entamer mon discours aujourd'hui par quelques citations de lesbiennes qui ont été victimes de violences, notamment de viols correctifs, de tortures, de grossesses et de mariages forcés, d'emprisonnements et du châtiment ultime, le meurtre. Je rends hommage à toutes ces lesbiennes pour leur force, leur résistance et leur amour pour les lesbiennes. Et je soulève des questions en leur nom et au nom de toutes les lesbiennes.
Je présente ce matériel qui provient de recherches que j'ai menées depuis 2003. Si vous souhaitez en savoir plus, ces histoires et bien d'autres sont racontées dans les essais suivants :
Vortex : The Crisis of Patriarchy (Spinifex Press, 2020)
Lesbian : Politics, Culture, Existence (Spinifex Press, 2024)
Passons maintenant aux paroles des lesbiennes
En Sierra Leone, le 29 septembre 2004, FannyAnn Eddy a été retrouvée morte après avoir été violée à plusieurs reprises. Elle venait de témoigner devant la Commission des droits de l'homme des Nations unies en 2004, quelques mois seulement avant son meurtre :
Le silence crée de la vulnérabilité. Vous, membres de la Commission des droits de l'homme, pouvez briser le silence. Vous pouvez reconnaître que nous existons, dans toute l'Afrique et sur tous les continents, et que des violations des droits de l'homme fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre sont commises chaque jour. Vous pouvez nous aider à lutter contre ces violations et à obtenir la pleine jouissance de nos droits et libertés, dans toutes les sociétés, y compris dans ma chère Sierra Leone. (Eddy, 2004).
Elle travaillait dans les bureaux de l'Association des lesbiennes et des gays de la Sierra Leone le jour de son assassinat. Quelles mesures la Commission des droits de l'homme des Nations unies a-t-elle alors prises ? Quelles mesures sont prises actuellement ?
Je pose la question : pourrions-nous essayer de ressentir l'horreur de ce qui est arrivé aux lesbiennes ? (Hawthorne 2020, p.106).
En 1976, sous le régime de Pinochet au Chili, Consuelo Rivera-Fuentes a été torturée et s'est ensuite réfugiée en Angleterre….
aucune séance d'entraînement ne m'avait préparée à cette douleur intense … ma douleur … celle que je n'ai pas choisie … toute cette aliénation, ce vide … mon corps, mon esprit, ma douleur … ce n'est pas en train d'arriver … je suis un petit point dans l'univers … quel univers ? … le monde n'est plus … Je suis … en train de me désintégrer … petit à petit … cri après cri … électrode après électrode … La douleur … toute cette douleur ici et là, là-bas dans mon vagin … l'agonie … où suis-je ? Où est mon moi ? (Rivera-Fuentes et Birke, 2001, p.655 ; italiques et ellipses dans l'original).
« Où est mon moi ? » demande Consuelo Rivera-Fuentes après avoir été torturée. Elle demande aussi où est mon moi de lesbienne. Où le caractère central du vécu des lesbiennes est-il enregistré et reconnu ? Où est la reconnaissance du fait que la violation des lesbiennes se poursuit jour après jour, et que personne n'en parle ?
Une réfugiée lesbienne iranienne anonyme parle d'expérience :
À Kashan, ils m'ont attachée à une voiture et m'ont traînée sur le sol. Que dois-je dire, à qui dois-je le dire ? … Pourquoi personne ne nous écoute ? Où sont ces « droits de l'homme » ? (Darya et Baran, 2007).
Ou, comme le dit une lesbienne péruvienne anonyme :
Quand je parle de mon droit à ma propre culture et à ma propre langue en tant que femme indigène, tout le monde est d'accord avec mon autodétermination. Mais quand je parle de mon autre identité, mon identité lesbienne, mon droit d'aimer, de déterminer ma propre sexualité, personne ne veut écouter.(Bulletin de l'ILIS, 1994, p.13)
Au Zimbabwe, au milieu des années 1980, Tina Machida raconte :
Ils m'ont enfermée dans une pièce et ont fait venir cet homme tous les jours pour me violer afin que je tombe enceinte et m'ont forcé à l'épouser. Ils m'ont fait ça jusqu'à ce que je devienne enceinte. (Machida, 1996).
Dans mon livreVortex : The Crisis of Patriarchy, je documente également les meurtres de lesbiennes en Afrique du Sud (bien que l'orientation sexuelle soit une caractéristique protégée par la Constitution sud-africaine) ainsi que les meurtres de lesbiennes aux États-Unis (voir Brownworth, 2015 ; Gartrell, 2023).
Quels sont les éléments qui, réunis, rendent si difficile la réussite des campagnes en faveur des lesbiennes ?
Voici quelques dimensions et caractéristiques de la façon dont les lesbiennes sont traitées et dont l'oppression se manifeste dans leur vie.
* Lorsque les colonisateurs conquièrent un territoire, leurs premiers comptes rendus à l'empire contiennent généralement des propos du genre « les indigènes n'ont pas de culture ». Ils s'excusent ainsi pour la conquête et la dépossession des autres. C'est de la même manière que l'on dit des lesbiennes qu'elles n'ont pas de culture.
* Déni de l'existence lesbienne, qui est une façon de leur briser l'âme.
* Destruction des connaissances et de la culture lesbiennes.
* Hétérosexualité imposée.
* Isolement, un problème particulier pour les jeunes lesbiennes, les lesbiennes handicapées et les lesbiennes âgées.
* Criminalisation des lesbiennes : les sanctions vont jusqu'à la peine de mort, de longues peines d'emprisonnement et de la torture, y compris le viol et les violences sexuelles humiliantes.
* Meurtre, crimes dits « d'honneur » et viols répétés, de sorte que la lesbienne tombe enceinte contre son gré.
* Viol dit « correctif » par des bandes de jeunes hommes, des gardiens de prison et des membres de la famille.
* Services médicaux de qualité inférieure, tels que la non-reconnaissance de nos partenaires comme proches parents.
* Traitement en tant que citoyennes de seconde zone, discrimination directe ou indirecte.
* Refus des gouvernements à reconnaître les lesbiennes dans le droit en tant que groupe distinct soumis à la discrimination.
* Si une lesbienne parvient à intenter une action en justice contre un agresseur, il y a de fortes chances qu'elle soit contrainte de signer un accord de non-divulgation. Cela a pour conséquence de rendre des crimes invisibles en tant que crimes commis contre des lesbiennes.
* Les lesbiennes sont humiliées et on attend d'elles qu'elles deviennent hétérosexuelles ou qu'elles changent de sexe.
* La honte crée l'isolement, l'ostracisme peut entraîner des brimades, des railleries et des coups. Tout cela crée ce que l'écrivaine indienne Maya Sharma appelle « un discours de catastrophe » (Sharma 2006, p.38, cité dans Hawthorne 2020 p.176).
* Les lesbiennes sont déclarées folles.
* Les lesbiennes qui résistent de manière publique sont attaquées à la fois en ligne et dans la vie réelle.
* Si une lesbienne devient célèbre, soit on se souviendra d'elle soit pour sa sexualité (auquel cas ses réalisations restent cachées), soit pour ses réalisations alors que sa sexualité sera occultée. Tout cela découle de la honte infligée et rend très difficile la documentation de l'histoire lesbienne.
Est-il étonnant, donc, que les lesbiennes réfugiées ont un trajet si pénible à parcourir pour acquérir un statut de réfugiées ?
En 1987, onze ans après sa sortie de prison et alors que le Chili était connaissait désormais en apparence un régime démocratique, un piège a été tendu à Consuelo Rivera-Fuentes. Un policier s'est rendu sur son lieu de travail au Commissariat britannique et lui a dit qu'il devait l'accompagner au commissariat après l'avoir convaincue qu'elle n'avait rien à craindre. Il l'a conduite à travers le bâtiment où elle avait été torturée et dans une pièce où un officier était assis à une table. Cet officier voulait lui imposer des relations sexuelles avec sa maîtresse. Consuelo a compris qu'il s'agissait d'un piège et a accepté de ne le revoir que deux semaines plus tard. Elle a quitté le Chili cinq jours plus tard. Elle avait déjà prévu de se rendre au Royaume-Uni et s'était inscrite à un cours d'études féministes là-bas.
L'activiste nigériane Aderonke Apata n'a pas eu autant de chance. Il lui a fallu 13 ans pour obtenir l'asile au Royaume-Uni. L'un des points de friction, selon Theresa May, qui dirigeait alors le ministère de l'Intérieur, était qu'Aderonke avait prétendu être lesbienne pour obtenir l'asile au R.U. Elle a été placée en isolement pendant une semaine au centre de rétention de Yarl's Wood en 2012. L'accusation de prétention était due au fait qu'elle était mère d'un enfant, et l'hypothèse a donc été qu'elle devait être hétérosexuelle. Mais, comme nous le savons, de nombreuses lesbiennes sont mères. Certaines se sont mariées parce que c'était une protection temporaire pour elles, ou elles ont été mariées de force. De même, si une lesbienne n'a pas de partenaire féminine (actuelle), la question que l'on pose devient : est-elle VRAIMENT lesbienne ? Une lesbienne sans partenaire féminine glisse par défaut vers le statut d'hétérosexuelle.
Au camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, les lesbiennes sont placées dans le bloc 13, réservé aux personnes LGBT, un groupe qui n'est pas nécessairement sécuritaire pour les lesbiennes. Les lesbiennes sont régulièrement maltraitées et persécutées au sein du camp. Cela ressemble à ce qui arrive aux lesbiennes incarcérées. Christine, une lesbienne ougandaise, a non seulement été torturée par les gardiens, mais aussi violée par d'autres prisonniers.
Une réfugiée lesbienne qui souhaite obtenir l'asile en Australie se heurte à un parcours difficile. Les obstacles sont innombrables. Parmi eux, la nécessité de fournir une documentation interminable sur les abus et les traumatismes qu'une lesbienne a subis de la part de sa famille, de sa communauté, de groupes religieux, de la police et du gouvernement. Certains gouvernements ne maintiennent pas une distance suffisante entre ceux qui évaluent les demandes de statut de réfugié et ceux qui appliquent les lois pénales contre les lesbiennes. Il en résulte que la demandeuse d'asile lesbienne est vulnérable aux sanctions dans le pays qu'elle tente de fuir. Avec un système bureaucratique aux délais énormes dans le pays où elle souhaite s'installer, son existence même est constamment menacée. Les frais juridiques liés à l'engagement d'un-e avocat -e spécialisé-e en droit de l'immigration sont considérables (des milliers de dollars) et chaque demandeuse a besoin de lettres de soutien qui confirment l'importance de son besoin d'asile.
Le mot « lesbienne » n'est même pas mentionné par le gouvernement australien dans son neuvième rapport périodique au CEDAW de janvier 2025. Si l'on utilise l'expression vide de sens « identité de genre », comment les lesbiennes ayant une orientation sexuelle de femme à femme peuvent-elles être protégées par la loi ou obtenir l'accès à l'Australie lorsqu'elles demandent l'asile en tant que réfugiées lesbiennes ?
Les membres de la Coalition of Activist Lesbians (CoAL), une très petite organisation non financée, tentent actuellement d'aider deux lesbiennes qui demandent l'asile en Australie. On nous dit que la période d'attente sera probablement de six ans avant qu'une décision ne soit prise. Voir à ce sujet le site web de la CoAL, auhttps://coal.org.au/
Lignes directrices pour les fonctionnaires qui interrogent les réfugiées lesbiennes
* Certaines femmes peuvent être persécutées en raison de leur association avec des hommes menacés. Si elles sont lesbiennes, leur niveau de risque peut être accru.
* Il ne faut pas supposer qu'une femme mariée ne peut pas être lesbienne. Dans certains pays, le mariage est le tout premier niveau de protection qu'une lesbienne peut rechercher.
* Les lesbiennes qui demandent l'asile sont susceptibles d'être politiquement actives, mais même les lesbiennes qui ne le sont pas sont menacées dans certains pays.
* Ne présumez pas que, parce qu'une femme n'utilise pas le mot lesbienne pour se décrire, elle n'est pas lesbienne. Il se peut qu'il ait été trop dangereux pour elle, pendant trop longtemps, de prononcer à haute voix le mot lesbienne (ou l'équivalent dans sa langue).
* Ne présumez pas que, parce qu'il n'y a pas de mot pour désigner les lesbiennes dans une langue donnée, il n'existe pas de lesbiennes dans cette société ou ce groupe linguistique.
* Ne présumez pas que si une femme vient d'un pays où il n'est pas illégal d'être lesbienne, elle ne peut pas prétendre avoir été torturée ou avoir été en danger de torture ou d'autres préjudices externes.
* Ne supposez pas que votre interprète est réceptif à son expérience. L'interprète peut s'avérer hostile à sa requête.
* Les lesbiennes qui ont été torturées auront du mal à parler de leur expérience. Parler à un étranger est difficile, parler à un homme étranger peut être impossible. Les hommes en uniforme peuvent précipiter des souvenirs de l'expérience de torture.
* En raison du traumatisme, certaines lesbiennes peuvent être incapables de raconter cette expérience ou peuvent sembler détachées et sans émotion. Cela ne doit pas être interprété comme une preuve de faux témoignage.
* Les lesbiennes réfugiées peuvent également être en danger du fait de leur famille, en particulier des hommes de leur famille. Le témoignage confidentiel d'une lesbienne ne doit pas être partagé en posant des questions sur son orientation sexuelle à des membres de sa famille. (Voir Hawthorne, 2020, pp. 164-165)
Si l'on est indifférent à l'enjeu des violences infligées aux lesbiennes, et si les lesbiennes restent extérieures au champ d'application de la réforme de la justice sociale, alors les droits civils et politiques de tout le monde restent menacés. Les réformes politiques les plus difficiles à mettre en œuvre sont, à long terme, les plus importantes, car elles nous informent sur les limites de notre disposition à vivre une existence éthique. Si nous sommes incapables de nous préoccuper de la vie et du bien-être des personnes les plus différentes, alors nous sommes incapables de défendre la justice pour tous et pour toutes, même au niveau le plus élémentaire, celui de la liberté d'association, de la liberté d'aimer (Hawthorne 2024, p. 141-142).
Je soutiendrais que lorsque des lesbiennes sont victimes d'une agression, leur cas constitue un signal d'alarme. Elles jouent le rôle de canaris dans la mine. Et si les auteurs de ces agressions s'en tirent à bon compte, d'autres agressions suivront. Nous devons donc protester contre chaque agression infligée à des lesbiennes, car c'est le signe d'une haine présente dans le système social. Si les lesbiennes ne sont pas protégées, les personnes qui ne correspondent pas à une autre dimension sociale ne seront pas non plus à l'abri d'agressions. Protégez votre sœur lesbienne et observez l'effet que cela a sur la société (Hawthorne 2020, pp. 171-172).
Susan Hawthorne
Notes :
Brownworth, Victoria A. 2015. ‘Erasing Our Lesbian Dead : Why don't murdered lesbians make the news ?' Curve.
http://www.curvemag.com/News/Erasing-Our-Lesbian-Dead-510/ (Accessed 17/7/2015).
Darya and Baran. 2007. ‘Interview with Iranian Lesbian in order to convey her protest to the world'. p. 2. Iranian Queer Organization. Translated by Ava.
http//irqo.net/IRQO/English/pages/071.htm Accessed 17 August 2007.
Eddy, FannyAnn. 2004.. ‘Testimony by FannyAnn Eddy at the UN Commission on Human Rights.
Item 14 – 60th session, UN Commission on Human Rights
http://hrw.org/english/docs/2004/10/04/sierra9439.htm
Gartrell, Nate (June 14, 2023).
« ‘The most depraved crime I ever handled' : Transgender activist gets life in prison for murdering Oakland family ». The Mercury News.
Hawthorne, Susan. 2020. Vortex : The Crisis of Patriarchy. Mission Beach : Spinifex Press.
Hawthorne, Susan. 2024. Lesbian : Politics, Culture, Existence. Mission Beach : Spinifex Press.
ILIS Newsletter, 1994. Vol 15, No. 2.
Machida, Tina. 1996. ‘Sisters of Mercy' in Monika Reinfelder (ed.) Amazon to Zami : Toward a global lesbian feminism. London : Cassell, pp. 118-129.
Rivera-Fuentes, Consuelo and Lynda Birke. 2001. ‘Talking With/In Pain : Reflections on Bodies under Torture'. Women's Studies International Forum. Vol. 24, No. 6, pp. 653-668.
Sharma, Maya. 2006. Loving Women : Being Lesbian in Underprivileged India. New Delhi : Yoda Press.
Remerciements
Merci au Comité et aux membres de la Coalition of Activist Lesbians (CoAL) pour leurs réactions et leurs suggestions touchant cette présentation. J'adresse des remerciements particuliers à Viviane Morrigan, Deborah Staines et Barbary Clarke. Merci également à Sand Hall pour des éléments d'histoire, aux membres du groupe Lesbian Action for Visibility Aotearoa (LAVA) pour leur combativité et à The Feminist Legal Clinic pour leur défense active des lesbiennes en Australie. Merci à Consuelo Rivera-Fuentes pour son amitié et à toutes les lesbiennes qui tiennent tête aux obstacles bureaucratiques qu'implique une demande d'asile. Merci enfin aux lesbiennes de partout dans le monde qui continuent à résister aux horreurs de la violence et à combattre pour toutes les personnes sont les vies ont été directement impactées par la violence.
CoAL (Coalition of Activist Lesbians) Inc Australia
A Lesbian Feminist U.N. Accredited Human Rights Advocacy Group
Address : 81-83 Campbell Street, Surry Hills, NSW 2010
Email : admin@coal.org.au
Website : coal.org.au
Susan Hawthorne
Traduction : TRADFEM
https://tradfem.wordpress.com/2025/03/27/les-lesbiennes-ripostent-egalement-en-australie/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Procès de Mazan, analyse féministe

Ce texte est basé sur près d'une centaine d'articles que j'ai consultés sur ce procès, parus dans Libération (les 50 biographies des accusés), Mediapart, l'Obs, l'Express et sur les deux livres de la fille de Gisèle Pelicot, Caroline Darian « Et j'ai cessé de t'appeler papa », Harper Collins Poche, éditions Jean-Claude Lattès, 2022, et « Pour que l'on se souvienne », éditions Jean-Claude Lattès, 2025 (kindle). Dans ce texte écrit pour un public anglophone, j'ai essayé de fournir les informations de base sur l'affaire de Mazan mais aussi de donner des détails et des points de vue que les médias ont peu couvert ou ignoré.
Traduction française de la version longue de la présentation/webinar du 02/03/2025 pour Women's Declaration International.
Source : https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/06/proces-de-mazan-analyse-feministe/
Rappel, quelques chiffres
Mazan est une petite ville d'environ 7 000 habitants dans le département du Vaucluse. La plus proche ville moyenne est Avignon, où le procès a eu lieu. Jusqu'à ce procès, Mazan était surtout connu parce que le château local, maintenant en ruine, a été la propriété du marquis de Sade et de sa famille.
Il y avait 51 hommes sur le banc des accusés mais 54 ont été identifiés, sur 73 violeurs possibles. L'un d'entre eux (Hassan O.) s'est échappé au Maroc et a été jugé in absentia, un autre est décédé entretemps et deux autres relâchés faute de preuves. Si 73 hommes ont été identifiés comme ayant participé aux viols, la police n'a pas pu retrouver la trace de 18 d'entre eux, « qui eux continuent à mener leur vie sans être inquiétés » (DarianPQL 2). Les hommes qui ont été arrêtés avaient de 21 à 63 ans quand ils ont violé. Au moins deux d'entre eux étaient des homosexuels qui ont dit qu'ils étaient venus à Mazan pour avoir des rapports sexuels avec Dominique Pelicot en échange de violer sa femme. Le premier viol recensé date du 23 juillet 2011 en région parisienne (Darian 142) et ils ont pris fin en 2020. D'après le commissaire de police Jérémie Bosse-Plattière, comme certains violeurs sont revenus plusieurs fois, le nombre total de viols pourrait se situer autour de 200. Gisèle Pelicot était endormie principalement avec du Temesta et du Zolpidem, deux médicaments de la famille des benzodiazépines (tranquillisants). Ce sont des médicaments délivrés sur ordonnance, et ils ont été initialement prescrits à Gisèle ou Dominique par le frère de Dominique, Joël Pelicot, qui était médecin, et ensuite par des médecins locaux. Pas moins de 780 comprimés de Temesta ont été administrés à Gisèle.
Tous ces hommes venaient d'une zone à distance de 30 à 40 km autour de Mazan. On n'avait pas affaire ici à une grande ville « décadente » comme Paris ou Marseille, Mazan est une petite ville, un bourg de campagne, et dans cette petite zone autour de Mazan, il y avait au moins 73 hommes qui étaient volontaires pour violer une femme de 60 ans inconnue et inconsciente proposée par son mari.
Ces hommes sont entrés en contact avec Dominique Pelicot sur le site pornographique Coco qui a été fermé depuis, et qui abritait toutes sortes de perversions « de niche » et de trafics, ainsi que des annonces prostitutionnelles. Sur ce site, des échangistes et autres libertins pouvaient discuter de leurs fantasmes, proposer des scénarios et inviter d'autres hommes à les réaliser avec eux. Tous les hommes impliqués fréquentaient le site Coco et d'autres sites pornographiques. 13 d'entre eux évoluaient dans les milieux échangistes, 5 avaient des images pédopornographiques sur leur téléphone ou leur ordinateur (voir annexe). Ce procès a été baptisé « le procès de la soumission chimique » mais on pourrait aussi le nommer « procès de la (consommation de) pornographie ».
Violences sexuelles étant enfant
Sur un total de la cinquantaine d'« invités » de Pelicot, 7 disent qu'ils ont été victimes de violences sexuelles quand ils étaient enfants – viol, inceste, « attouchements sexuels » – (voir annexe). Tous les perpétrateurs de ces violences étaient des hommes. 4 autres d'entre eux auraient été victimes de violences non-sexuelles par des pères autoritaires. Pour certains, ces violences sexuelles sont attestées par des membres de leur famille ou des amis, pour d'autres, c'est juste ce qu'ils disent – il est connu que l'explication du « violeur violé » (les hommes violent parce qu'ils ont été violés étant enfant) est invoquée dans presque tous les procès pour viol par les accusés et les avocats de la défense. 7 violeurs disent avoir été victimes de violences sexuelles quand ils étaient enfants. Cela ne met pas en évidence un déterminisme clair et rigide entre le fait d'avoir été victime de ces violences dans l'enfance et la reproduction de ces violences une fois adulte : le pourcentage est ici de 14% (si aucun de ces hommes ne mentait). Ce chiffre n'est pas loin de l'estimation du pourcentage de garçons victimes de violences sexuelles dans la population générale de garçons, qui est de 17% [1]. Et un nombre presque égal de violeurs déclare avoir eu une enfance heureuse, « choyée », avoir grandi dans « une famille unie » (voir annexe). Un expert psychiatre nommé pour ce procès, Laurent Layet, déclare : « il n'y pas de relation de cause à effet. Ce n'est pas parce qu'on a été victime qu'on devient perpétrateur, il n'y a aucune littérature scientifique qui le prouve [2].
Sur la base du fait qu'il y avait 9 conducteurs de camion impliqués dans ces viols, on pourrait aussi bien dire qu'être camionneur implique le même risque (en fait légèrement supérieur) de commettre des violences sexuelles que celui d'en avoir été victime étant enfant. Mais corrélation n'est pas causalité ; ce que les personnes cherchant des explications sensées devraient plutôt examiner est le nombre de ces hommes qui étaient des consommateurs de porno. C'est-à-dire tous, puisqu'ils ont rencontré Pelicot et discutaient avec lui sur un site porno.
D'après ce que certains de ces violeurs qui ont violé Gisèle P. « une seule fois » ont dit, après avoir passé quelque temps avec Pelicot et sa femme inconsciente, ils ont réalisé que la situation était bizarre, que quelque chose ne collait pas. C'est pourquoi ils auraient refusé quand Pelicot a mis la pression sur eux pour qu'ils reviennent. Un de ces hommes, Charly A. accro au porno, est venu pas moins de 6 fois. Il envisageait de violer sa mère sous sédatif et a dit que Pelicot l'aurait encouragé à le faire (« et ta mère, quand est-ce qu'on la baise ? » « si ce n'est pas ce week end, ça sera pour le week end prochain »). Il dit qu'il ne l'a pas fait, mais a dit à Pelicot qu'il le ferait, pour que celui-ci lui fiche la paix. Il est venu 6 fois, et il a prétendu que c'est seulement à la quatrième fois qu'il a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. 4 des accusés sont venus 6 fois.
Chronologie
Le 12 septembre 2020, Dominique Pelicot a été pris en train de filmer sous la jupe de 3 femmes (upskirting) avec son portable caché dans un sac au supermarché Leclerc de la ville voisine de Carpentras. D'après ce que j'ai lu initialement, c'est Thibaut Rey, un agent de sécurité du supermarché qui a remarqué le comportement de Pelicot, l'a arrêté, a saisi son portable contenant les images incriminantes avant que Pelicot puisse les supprimer et a incité les 3 femmes à porter plainte. Au départ, ces femmes ne voulaient pas porter plainte, mais il les a convaincues. Il a été présenté comme un héros de cette affaire, l'homme sans qui le procès de Mazan n'aurait pas eu lieu, et a été décoré de la Légion d'honneur pour son intervention.
Mais des amies féministes (merci à elles) ont attiré mon attention sur cette information, qui a été presque complètement ignorée par les médias : c'est en fait une femme, un autre membre du personnel de sécurité qui surveillait les écrans de sécurité, qui a remarqué le manège de Pelicot la première. Elle devait rester à surveiller les écrans, elle a donc alerté un agent de sécurité masculin, qui a arrêté Pelicot immédiatement (la vidéo de cette arrestation est en ligne). C'est typique que la bonne réaction de l'agent de sécurité masculin ait été mentionnée et louée dans les médias mais que la bonne réaction de la femme agente de sécurité ait été ignorée. Sans ces deux personnes, Pelicot et ses complices courraient encore…
Evidemment, un autre élément qui a changé la plainte initiale des 3 femmes de Carpentras en quelque chose de bien plus grave a été le fait que Pelicot ait filmé les viols qu'il a organisés et a enregistré ces images dans son ordinateur. Ces vidéos ont fait toute la différence : dans la plupart des affaires de viol, on n'a pas ce genre de preuves, on ne croit pas ce que dit la femme parce que c'est une situation de « parole contre parole ». Là, il y avait 94 vidéos de viols et environ 20 000 images pornographiques. Elles étaient soigneusement classées par date, genre d'actes sexuels, noms des participants, etc. Le classement était si méthodique que les policiers ont pensé initialement à une affaire de chantage. Pelicot a aussi pris des photos de sa fille inconsciente et dénudée, Caroline, et de ses deux belles-filles, Céline et Aurore, éveillées et nues ou presque nues, grâce à des caméras cachées dans les chambres et les salles de bain et les a postées sur Coco assorties de commentaires orduriers : « la fille de la salope » (Darian PQL 2). Suite à la découverte de ces vidéos, Gisèle et Pelicot sont convoqués par la police le 2 novembre 2020, et il est arrêté et placé en garde à vue.
« le procès de la soumission chimique »
Les médias ont nommé ce procès « le procès de la soumission chimique ». Des féministes ont souligné que c'était une façon de faire disparaître les violeurs, dans la même ligne que cette stratégie qui consiste à utiliser la forme passive quand les médias parlent d'affaires de viols : « une femme a été violée ». On ne voit jamais des titres de journaux annonçant « un homme a violé une femme ». Comme une féministe l'a dit, le viol est un crime avec victimes mais sans criminels ».
Dominique Pelicot
Dominique Pelicot est né en 1952, comme sa femme. Il décrit son père comme dominateur et maltraitant envers une mère soumise. Il dit que celui-ci aurait eu des relations incestueuses avec une fille adoptée par la famille, qu'il aurait été violé à l'âge de 9 ans par un infirmier de sexe masculin lors d'un séjour en hôpital, et que plus tard, il aurait été forcé à participer à un viol collectif à l'âge de 14 ans, alors qu'il était apprenti dans le bâtiment. Le frère de Pelicot, Joël, parle d'une famille aimante et de parents faisant de leur mieux pour donner une bonne éducation à leurs enfants – il est lui-même devenu médecin – mais ayant parfois recours aux punitions corporelles, comme c'était l'usage dans les années 50. S'il a fini par accepter que son père ait pu violer une petite fille adoptée, il doute du viol allégué par son frère, qu'il décrit comme un menteur et un manipulateur précoce, doué pour moduler son discours en fonction de son public. D'après lui, sa famille était consciente de sa personnalité manipulatrice mais il était le plus jeune enfant, le « chouchou », et rarement puni. Dominique ayant raconté à ses parents les agissements dont il dit avoir été victime à l'hôpital, ceux-ci prennent contact avec l'hôpital qui leur signale que, contrairement à ce que leur a raconté leur fils, il n'y avait que des infirmières en service, raconte Joël Pelicot [3]. Difficile de savoir qui dit la vérité.
A l'école, Pelicot était un élève médiocre et il a abandonné ses études en 5ème. Il a travaillé pendant un moment dans le bâtiment, comme électricien, et plus tard a décidé de lancer sa propre affaire, d'abord une agence immobilière, ensuite une entreprise de téléphonie. Les deux ont fait faillite, et c'est Gisèle, avec son job stable dans une compagnie liée à EDF, qui faisait marcher la maison financièrement. Quand elle était en activité, ils ont vécu dans différentes villes de la région parisienne (Brunoy, Combs la Ville, Gournay sur Marne…), et se sont installés dans le Vaucluse quand elle a pris sa retraite. Leur relation n‘a pas été sans heurts : Gisèle a eu une liaison avec un collègue de travail marié dans les années 80, et Dominique l'a quittée pour une femme plus jeune. Ils ont divorcé (surtout pour une question de dettes) en 2007, ils se sont remariés et ont divorcé de nouveau en août 2024.
D'après différentes sources, le succès professionnel de Gisèle semble avoir suscité humiliation et ressentiment chez son mari : la « castration » du mari dont la femme gagne plus d'argent que lui ? Caroline écrit que « plus d'une fois, nous l'avons senti frustré et envieux (Darian EJC 102). Pelicot était financièrement et professionnellement un raté, un loser, qui avait une revanche personnelle et sociale à prendre sur sa femme. Les mots dégradants qu'il utilisait à son propos durant les viols et dans les commentaires qu'il postait sur Coco sont révélateurs : « salope de bourgeoise ! » [4]. Aussi, pour expliquer les viols, il a dit qu'il voulait « soumettre une femme insoumise » [5]. Gisèle n'avait rien d'une femme insoumise : elle est revenue à son mari après sa liaison avec un collègue, elle l'a repris après qu'il l'ait abandonnée pour une femme plus jeune et elle a fermé les yeux pendant longtemps sur ses déviances sexuelles, comme on va le voir plus loin.
Mais le peu de limites qu'elle lui posait, c'était encore trop pour lui : elle a refusé d'accepter de pratiquer l'échangisme comme il le lui demandait. Comme elle a eu cette liaison avec un collègue de travail, des avocats de la défense ont avancé l'argument que Pelicot aurait organisé ces viols pour se venger de l'infidélité de sa femme – mais les viols ont eu lieu 30 ans après cette infidélité.
Pelicot apparait comme un manipulateur qui ment et se contredit sans vergogne jusqu'à ce qu'on le confronte à des preuves irréfutables : en ce qui concerne les photos de sa fille Caroline en slip, il a changé plusieurs fois de versions : d'abord, selon lui, ce n'était pas Caroline mais Gisèle sur les photos, ensuite, c'était bien Caroline mais ce n'était pas lui qui avait pris les photos, puis c'était bien lui mais il n'a rien fait à sa fille (Darian PQL 5) . Mais Caroline s'est reconnue, les policiers l'ont reconnue, son mari Pierre l'a reconnue et Pelicot avait créé lui-même un dossier pour ces photos, intitulé « ma fille à poil » [6].
Comme je l'ai mentionné, Pelicot a aussi violé d'autres femmes, celles des hommes qu'il rencontrait sur Coco : Pelicot leur faisait violer sa femme et en échange ils lui laissaient violer la leur. Et surtout il pourrait aussi être un meurtrier et même un serial killer : suite à l'enquête lancée en 2020, son ADN enregistré en 2010 dans le fichier national des empreintes génétiques (FNEG) a matché avec celui recueilli suite au viol de Marion, une jeune fille de 19 ans, à Villeparisis en 1999. Le mode opératoire de ce viol était le suivant : un homme appelle une agence immobilière et demande à visiter une maison ou un appartement sous un faux nom, une agente lui donne rendez-vous sur place, une fois dans la place il lui met un bâillon imprégné d'éther sur le visage, la pousse à terre, la frappe, l'étrangle et essaie de la violer. Dans cette affaire de Villeparisis, l'agente s'est défendue, est arrivée à s'échapper et s'est enfermée dans une des pièces, attendant qu'il parte. Elle a formellement reconnu Pelicot comme l'auteur de l'agression, dit qu'elle a craint pour sa vie et pense que si elle ne s'était pas échappée, son violeur l'aurait tuée. Et la police s'intéresse aussi à d'autres cold cases similaires, des viols ou tentatives avec le même mode opératoire. Lors de l'un d'eux, une agente immobilière nommée Sophie Narme, agée de 23 ans, a été violée et assassinée à Paris, rue Manin dans le 19ème arrondissement en décembre 1991. Il est regrettable que le sperme prélevé lors de l'autopsie post mortem ait été perdu, ce qui n'a pas permis de savoir avec certitude si Pelicot était le meurtrier en comparant avec son ADN. En tout cas, il était dans la région à la date du meurtre et une enquête est en cours sur la base d'indices nombreux et convergents, dont le mode opératoire [7]. Les viols de Mazan ont commencé en 2011, mais qu'a fait Pelicot entre 1999 et 2010 ? Il est peu probable qu'il n'ait commis aucune agression sexuelle durant cette période.
Examiné par des experts psychiatres désignés par la cour, il a été évalué comme n'ayant aucune pathologie ou anomalie mentale mais présentant diverses déviances sexuelles et paraphilies : voyeurisme, exhibitionnisme, candaulisme (regarder sa femme avoir des relations sexuelles avec un autre homme), somnophilie (violer une femme endormie ou inconsciente). Ces experts ont noté une personnalité perverse, manipulatrice, egocentrique, sans empathie, manifestant un grand sang-froid en toutes circonstances :« le voyeurisme fait partie de sa dynamique psychosexuelle, il y a chez lui « une propension à considérer l'autre comme un objet qu'on peut manipuler » (Annabelle Montagné). Et il cultivait « le mensonge et le secret » (Marianne Douteau).
Gisele P.
L'intérêt pour la psychologie de Gisèle n'a pas été tout à fait aussi vif que pour celle de son mari, comme c'est le cas dans la plupart des affaires criminelles : l'assomption implicite pour ce moindre intérêt est que les victimes sont souvent vues comme ordinaires, sans histoire, ennuyeuses et ternes, alors que les meurtriers sont exceptionnels, excitants et audacieux – les victimes sont vues comme des perdantes. Et l'immense majorité des criminels sont des hommes, et les hommes sont généralement vus comme plus intéressants que les femmes.
Gisèle Pelicot est la fille d'un militaire qu'elle décrit comme strict. Sa mère est morte quand elle avait 9 ans, elle a rencontré son mari quand elle avait 18 ans, c'était son premier amour et ils se sont mariés peu après. Ils ont eu trois enfants : David en 1973, Caroline en 1978 et Florian en 1986. A 30 ans, Gisèle a rejoint une entreprise associée à EDF, et a eu ensuite une belle carrière, comme cadre (préparatrice logistique) dans cette compagnie qui intervenait dans les centrales nucléaires.
À première vue, Gisèle P. apparait comme une femme gentille qui s'est généralement conformée aux normes sociales en vigueur : elle s'est mariée jeune avec son premier amour, elle a eu trois enfants et les a élevés comme une mère aimante. Elle a décroché un travail stable à l'âge de 30 ans et gagnait confortablement sa vie alors que son mari lançait de petites entreprises qui ont toutes fait faillite. Elle était le soutien de la famille, c'était elle qui faisait rentrer l'argent alors que son mari accumulait les dettes. Mais elle l'aimait et elle était persuadée qu'il était un homme bien et un bon père. Quand la police l'a convoquée après avoir trouvé les vidéos, un policier lui a posé des questions sur sa relation avec son mari. Sa réponse a été : « mon mari est une personne bienveillante, attentionnée, toujours prête à rendre service. Il est très apprécié par nos relations. Nous avons eu des hauts et des bas mais nous avons toujours réussi à les surmonter » (Darian EJC 47).
Mais quand on lit le livre de sa fille, c'est une image très différente de la version à l'eau de rose de Gisèle P. qui émerge : elle a été manipulée et sous l'emprise de son mari pendant 50 ans. Quand Caroline trie le contenu de la maison de ses parents avant le déménagement de sa mère, elle trouve un tableau peint par son père, une femme nue qui pourrait être sa mère. Au dos du tableau, son titre, glaçant : « L'emprise, août 2016 » (EJC 51).
Pelicot a fait subir à sa femme toutes sortes de violences : physiques et psychologiques, sexuelles et économiques.
Violence economique
L'exploitation financière était présente dès le début de la relation : Gisèle et Dominique Pelicot se sont rencontrés quand ils avaient 18 ans et se sont mariés environ 2 ans après. Se marier aussi jeune n'est généralement pas de bon augure pour ce qui est de l'autonomie féminine. Peu après leur rencontre, Pelicot s'est plaint à Gisèle que son père lui prenait tout l'argent qu'il gagnait comme apprenti. Gisèle, compatissante, a proposé de l'aider. Quand son mari a décidé d'abandonner son job stable d'électricien et de lancer sa propre entreprise, c'est encore elle qui lui a fourni une partie des fonds nécessaires. Mais Dominique était un piètre businessman, il s'est associé avec des individus véreux et ses deux entreprises ont mordu la poussière. Elle a dû payer pour le sortir d'affaire, ainsi que ses enfants et son frère Joël. A plusieurs reprises, il a contracté des emprunts auprès de différentes banques, et il a souscrit ces prêts au nom de jeune fille de sa femme – ce qui fait qu'elle en était légalement responsable.
Comme Pelicot ne gagnait pratiquement pas d'argent, c'est elle qui faisait vivre la famille, elle qui travaillait dur pour nourrir tout le monde. Son job de cadre pour cette compagnie associée à EDF lui donnait droit à un logement de fonction, une grande villa près de la Marne. Ces viols en série et l'administration massive de tranquillisants ont probablement commencé plus tard, quand Gisèle est partie en retraite : quand elle était en activité, elle avait besoin de toute sa tête pour faire son travail. Psychopathe mais pas fou : Pelicot savait d'où venait l'argent.
Il a ainsi accumulé une dette énorme, que sa femme a découverte quand la police a fouillé dans son ordinateur : elle a alors appris qu'elle avait été violée et ruinée. Comme beaucoup de femmes qui font confiance à leur conjoint, elle lui avait laissé l'entière responsabilité de la gestion de leurs finances. Dans son livre, Caroline dit ne pas pouvoir comprendre comment sa mère a pu laisser la gestion de tout ce qu'ils possédaient à un aussi mauvais manager, sans jamais rien vérifier. À un moment, leurs meubles ont fait l'objet d'une saisie par huissier. Comment Gisèle a-t-elle pu voir tout son mobilier emmené par un huissier et continuer à faire confiance aveuglément à son mari, s'interroge Caroline ? Qui écrit à son propos : « tu as monté des entreprises, elles ont toujours coulé, tu avais toujours une embrouille quelque part » (Darian EJC 24).
Violences conjugales
Gisèle a donné une image presque idyllique de son mariage mais, derrière les portes closes, la réalité était différente. Sa fille rapporte des disputes fréquentes entre sa mère et son père, pendant lesquelles elle se réfugiait chez des ami/es. Elle a entendu son père mal parler à sa mère : « il pouvait même rembarrer maman » (Darian EJC 42). Elle a vu une fois son père agresser physiquement sa mère : « j'ai vu mon père soulever ma mère de ses deux mains par le col de sa chemise. Elle était plaquée contre le mur de la salle de bains, à quelques centimètres du sol. À cette époque, je crois que ma mère souhaitait le quitter » (Darian EJC 99). Il est typique que ces violences aient eu lieu au moment où Gisèle voulait quitter son mari. Elle a elle-même reconnu ces violences mais elle les a minimisées, en précisant qu'elles n'avaient eu lieu « que » lorsque son mari avait découvert son infidélité : quand celui-ci apprend que sa femme a eu une aventure avec un collègue ingénieur marié, il y a une violente dispute et Gisèle P. se réfugie en Bretagne, chez ses parents. Pelicot « arrive comme un fou » pour la récupérer de force mais elle l'aime, elle lui pardonne et revient à lui [8].
Dans une des lettres illégales (non visées par l'administration judiciaire) qu'il a envoyées à sa femme lorsqu'il était en prison, Pelicot pleure sur lui-même, se plaint qu'il souffre horriblement, lui demande d'être « indulgente », la supplie de lui pardonner, et il conclut que sa femme est « une sainte ». On a l'impression que c'est justement parce qu'elle est une sainte, une personne gentille, généreuse et pardonnante qu'il l'a tellement abusée : Pelicot se comporte comme les personnages du marquis de Sade, le seigneur de Mazan et auteur de « Les infortunes de la vertu », qui ont besoin d'une jeune fille pure, douce, innocente et naïve (l'orpheline Justine dans ce livre) pour augmenter l'excitation qu'ils ressentent à dégrader les femmes et à les transformer en goules débauchées : on ne peut pas dégrader une « femme tombée », une putain. Dans les scénarios pervers de son mari, Gisèle était la Vertu martyrisée par le Vice : en la faisant violer par des dizaines d'hommes, il transformait la sainte en putain et en tirait une excitation sadique.
Violences sexuelles
Pelicot a filmé 94 viols, commis par lui-même ou par des étrangers. Il emmenait aussi Gisèle sur des aires de routiers pour la faire violer par des camionneurs. Son mode opératoire pour organiser ces viols était le suivant : il postait des photos de sa femme en tenue porno sur le forum de discussion « à son insu » qu'il avait créé sur le site Coco et il offrait aux hommes qui venaient sur ce forum de violer sa femme, seuls ou avec d'autres hommes : « cherche des complices pervers pour abuser de ma femme endormie par mes soins en tournante à deux chez moi » était sa proposition (Darian PQL 11). Les instructions qu'il donnait confirmaient qu'elle serait inconsciente : pas de parfum, interdiction de fumer, pas de portable, interdiction de parler à voix haute, pas de mains froides, se laver les mains avec de l'eau chaude, rien qui puisse la réveiller. Seulement 30% des hommes contactés ont décliné sa proposition de violer sa femme inconsciente. Caroline Darian ajoute à propos des vidéos de ces viols : « lorsqu'ils constatent qu'elle est inconsciente, ça ne semble pas les freiner, au contraire » (Darian EJC 95). Sur Coco, quand Pelicot planifiait des visites chez d'autres hommes pour violer leur femme, il précisait que, s'il y avait des enfants dans la maison, ils sont « à shooter au diner » (Darian EJC 93), c'est-à-dire que leur père devait leur administrer des sédatifs pour les endormir.
Destruction de sa santé
Pelicot a détruit sa santé, et c'est un miracle qu'elle ait survécu : les quantités énormes de Temesta et de Zolpidem qu'il lui a fait avaler plongeaient fréquemment sa femme dans un état comateux. Elle avait des pertes de mémoire effrayantes : d'un jour à l'autre, elle oubliait qu'elle avait parlé au téléphone avec sa fille. Elle ne se souvenait plus d'avoir été chez le coiffeur. Elle parlait de façon incohérente, comme si elle était ivre. Elle pensait qu'elle avait Alzheimer. Elle s'effondrait comme une poupée de chiffon, elle perdait connaissance. En 8 ans, elle a perdu 10 kg, elle perdait ses cheveux. Elle aurait pu mourir d'une overdose, d'une crise cardiaque. Elle a consulté des médecins pour cette intoxication causée par cette administration massive d'anxiolytiques. Un premier médecin lui a diagnostiqué un « ictus amnésique », un autre a parlé d'un « terrain anxieux ». Et lui a prescrit un calmant ! Il est typique que, quand des docteurs ne peuvent identifier le problème médical d'une patiente, ils lui prescrivent des calmants. Aucun d'entre eux n'a envisagé qu'elle aurait pu être droguée. Elle a attrapé 4 STDs, y compris le papillomavirus qui requiert des examens médicaux réguliers parce qu'il peut déclencher un cancer de l'utérus (cervix). Un des violeurs était séropositif [9] mais heureusement non-contagieux (elle a été testée négative au HIV) : son mari non seulement n'exigeait pas le port du préservatif mais même parfois l'interdisait, d'après ce que rapporte Caroline. Et pendant tout ce temps, cet homme qui la tuait à petit feu était attentionné, aux petits soins pour elle, disait s'inquiéter pour sa santé, lui recommandait de ne pas se surmener quand elle s'occupait de ses petits-enfants, la conduisait chez le docteur…
Red flags et avertissements
Il y en a eu beaucoup. Une première fois, en 2010, Pelicot a été pris en train de filmer sous les jupes des femmes au Carrefour de Collégien en Seine et Marne (Damian PQL 64). Il a été emmené au commissariat, son ADN a été enregistré au fichier national des empreintes génétiques des délinquants et criminels (FNEG) et il a reçu une amende de 100 Euros. Il se masturbait devant son ordinateur en regardant du porno dans son bureau, porte grande ouverte, une de ses belles-filles l'a surpris et a alerté son mari (Darian EJC 108). Ses fils ont remarqué qu'il regardait beaucoup de porno [10]. Il proposait à ses petits-enfants de « jouer au docteur » et il est passé à l'acte avec l'un d'eux, Nathan, à qui il imposait des « caresses forcées » et de se doucher devant lui, rapporte Caroline (Darian PQL 25). Comme Caroline, Nathan a porté plainte contre lui. Les filles d'Aurore (la femme de Florian), lui ont parlé du jeu que leur a proposé Pelicot : « elles auraient des bonbons si elles acceptaient de soulever leur t-shirt dans un supermarché » (Darian PQL 26).
Son fils Florian ne voulait plus le laisser seul avec ses enfants [11]. Pelicot prenait des photos de ses belles-filles nues, avec des caméras cachées dans les chambres ou la salle de bains, et Caroline en a informé sa mère. Pour Céline, la femme de David, il y a eu une centaine de clichés s'échelonnant sur des années, postés en ligne avec des commentaires obscènes (Darian PQL 25). La police a aussi trouvé dans l'ordinateur de Pelicot des images où il se masturbait dans les sous-vêtements d'Aurore [12]. Il a mis la pression sur sa femme pour qu'elle accepte de pratiquer l'échangisme, mais elle a refusé. Il prenait des photos d'elle nue quand elle s'habillait ou se déshabillait. Il consommait des quantités massives de Viagra. Gisèle a attrapé 4 fois des MSTs. Des avocats de la défense ont posé la question : « comment ne pouvait-elle pas s'étonner qu'elle ait attrapé des MSTs 4 fois ? » Comment ne pouvait-elle pas réaliser, quand elle dormait 18 heures d'affilée, qu'elle avait été droguée ? Elle a fini par avoir des soupçons et a demandé une fois à son mari : « est-ce que tu m'as droguée ? » Il est probable que les quantités massives de tranquillisants que lui administrait son mari aient contribué à son aveuglement.
La meilleure amie de Gisèle, la marraine d'une de ses fils, une amie de 20 ans qui était comme un membre de la famille (dans son livre, Caroline Darian la nomme Pascale) avertit Gisèle que Pelicot lui faisait des avances : « tu ne sais pas avec qui tu vis. Il serait temps d'ouvrir les yeux. Ton mari n'est pas celui que tu crois » (Darian EJC 38). Bien entendu, Pelicot a nié. Furieuse de cette révélation, Gisèle a rompu avec son amie. Pour expliquer cette rupture, elle a dit que c'était au contraire Pascale qui s'intéressait de trop près à son mari. Réaction typique de nombreuses épouses aveugles : quand leur conjoint infidèle fait des avances à une autre femme, c'est la femme qui l'a provoqué.
Pelicot a été pris une deuxième fois en train de filmer sous les jupes des femmes en 2020. Il s'est confessé à Gisèle mais il lui a menti : il lui a parlé de deux femmes et n'a pas mentionné qu'il filmait (Darian EJC 45). Gisèle lui a pardonné mais lui a dit que s'il recommençait, elle le quitterait, et qu'il fallait qu'il se fasse soigner. Ensuite, la police les a convoqués pour leur faire visionner les vidéos et entendre ce qu'ils avaient à dire là-dessus. Caroline note que, quand Pelicot s'est rendu à cette convocation, il ne parait nullement inquiet : « il pense qu'il va passer entre les mailles du filet » (une fois de plus) et qu'il ne s'agit que d'une « simple formalité administrative » (Darian EJC 47). La chronologie des événements montre qu'il a même organisé un dernier viol après la première convocation par la police.
Deni et syndrome de Stockholm
Lorsque Gisèle voit les vidéos où elle est violée, sa première réaction est l'incrédulité et le déni : « êtes-vous sûrs qu'il n'y a pas une erreur sur la personne » ? (Darian EJC 48). Quand son mari est en garde-à-vue (GAV), après les révélations des vidéos, « elle lave, sèche et repasse les vêtements de mon père, lui prépare un sac de rechange pour lui apporter au commissariat » (Darian EJC 50). Même déni quand elle voit les photos de sa fille, endormie, en slip, prises à deux endroits différents avec le même slip. Caroline remarque que ce slip ne lui appartient pas, elle ne croit pas qu'elle dorme naturellement, avec une lumière très forte, dans une position bizarre et alors qu'elle ne dort jamais en slip. Et elle aussi a eu des problèmes gynécologiques récurrents. Elle pense qu'elle a été droguée par son père, et qu'elle a été victime d'inceste. Quand elle en parle à sa mère, Gisèle refuse d'envisager cette possibilité. Bien sûr, Pelicot nie tout, et Gisèle le croit. Caroline déteste la façon dont sa mère se fait manipuler par son père, dont elle s'apitoie sur lui quand il est en prison et qu'elle se sente même coupable des viols qu'il lui a fait subir : « ton père n'est pas bien là où il est, il souffre, j'ai sans doute dû rater quelque chose durant ces dernières années ». Ces sentiments de culpabilité sont typiques des victimes de violences sexuelles. Et Caroline diagnostique : « ok, empathie avec le bourreau. Syndrome de Stockholm » (Darian EJC 83).
Les lettres illégales envoyées par Pelicot de sa prison augmentent l'irritation de Caroline. Dans la première, Pelicot se plaint de ses conditions de détention, pleure sur lui-même : « ici, c'est affreux (…) Je vous demande d'être indulgents (…) C'est assez dur pour moi (…) Je n'en dors pas la nuit, je perds du poids (…) Dites-leur que je leur demande pardon ». (Darian EJC 86-87). Et Caroline commente : « tout tourne autour de lui, de ses besoins et de sa petite personne » (Darian EJC 87).
Les droits de Pelicot sont tels qu'il ne réalise même pas l'incongruité, l'obscénité qu'il y a à demander le pardon d'une femme qu'il a fait violer et violée des centaines de fois. Gisèle cache ces lettres à sa fille. Caroline se pose la question : « qui cherche-t-elle à protéger au juste ? Si je récapitule, ma mère est au courant pour les photos de moi dénudée (…) Elle ne m'a pas accompagnée à l'hôpital psychiatrique et elle me cache maintenant l'existence de ce courrier. À croire qu'elle se range du côté de son débauché de mari. À cause de mon père, je suis en train de perdre ma mère » (Darian EJC 84). Gisèle n'a pas non plus rendu visite à sa fille quand celle-ci était en hôpital psychiatrique, effondrée après avoir vu ces photos, elle ne voit pas que son mari veut la monter contre Caroline. Désormais, il y a deux camps dans la famille.
Syndrome st
Incompréhensiblement, après avoir vu ces vidéos où Pelicot la fait violer par des dizaines d'inconnus, Gisèle continue à se soucier des besoins de son mari emprisonné : « maman veut que mon père puisse disposer de ses affaires en prison. Elle lui a donc préparé un sac, avec des vêtements chauds, et quelques effets personnels qu'elle va laisser à la loge du centre pénitentiaire du Pontet » (Darian EJC 104).
Dans une seconde lettre illégale, Pelicot va encore plus loin dans le mensonge et la manipulation : il écrit à sa femme qu'il est en danger… à cause de Caroline. Selon lui, « Caroline a tout raconté aux parents de mon codétenu qui ne veut plus être avec moi. Essayez de la calmer car on va me lyncher ici, ça ne pardonne pas, c'est urgent » (Darian EJC 122). Caroline commente : « il veut nous dresser les uns contre les autres » ; sa mère ne voit toujours pas son manège, elle trouve des circonstances atténuantes à son mari. Quand Caroline évoque la possibilité de l'inceste, elle lui déclare : « arrête de te faire du mal, ton père n'a pas pu faire une chose pareille. Je ne peux m'y résoudre sinon cela achèverait de me détruire » (Darian EJC 137). Venant d'une femme qui a vu les 94 vidéos de ses viols, et les images dénudées de sa fille et de ses belles-filles, le niveau de déni est stupéfiant. Caroline « en veut à sa mère qui se laisse duper », qui lui reproche son « ingratitude » envers son père et qui lui rappelle qu'« il a beaucoup fait pour toi mais aussi pour tes frères ». Et qui conclut par « j'ai été heureuse avec lui, je l'ai tant aimé, je préfère garder en mémoire les bons moments » (Darian EJC 158). Et elle demeure convaincue que l'homme qui l'a fait violer au moins 94 fois l'aimait…
À la date du procès, Gisèle ne reconnait toujours pas la possibilité de l'inceste (bien que ses avocats lui aient recommandé de dire qu'elle ne l'exclut pas). Caroline voit dans ce déni un « abandon de trop » (Darian PQL 43) et en conclut qu'elle devra se « passer d'une relation-mère fille qui lui tenait tant à cœur » (Darian PQL 43). Et quand elle explose face à son père qui ment, change plusieurs fois de version et se contredit face aux juges, sa mère lui dit de « ne pas se donner en spectacle » (Darian PQL 45)…
Nous savons que le déni est une stratégie de survie : elle permet à celleux qui l'utilisent d'ignorer un aspect de la réalité trop douloureux pour qu'iels puissent l'admettre. Nous savons aussi que l'identification à l'agresseur est aussi un mécanisme de défense. Les deux sont clairement présents chez Gisèle : elle s'identifie à son mari, contre sa fille. Une avocate s'adresse ainsi à Pelicot : « entre Caroline et vous, M. Pelicot, elle (Gisèle) vous a incontestablement choisi vous » (Darian PQL 44).
Les médias ont présenté Gisèle Pelicot comme une icône féministe. Est-elle une icône féministe ? Elle a eu le courage de porter plainte, alors que la plupart des femmes violées par leur conjoint n'osent même pas y penser – mais son cas était à une toute autre échelle – il s'agissait de dizaines de viols par des inconnus. Elle a refusé le huis-clos habituel et a décidé de rendre ce procès public, dans l'intérêt de la protection des femmes, a-t-elle déclaré. En discutant avec les intrépides féministes locales qui sont venues en masse pour la soutenir, elle a exprimé un intérêt pour les idées féministes. À cause des vidéos, il ne pouvait y avoir aucun doute sur la réalité des viols, donc Gisèle a été qualifiée de « victime parfaite ».
L'expression signifie que, vu les preuves écrasantes découvertes dans l'ordinateur de Pelicot, personne ne pouvait douter de la réalité de ces viols. Mais cette expression a un autre sens, plus dérangeant : dans les sociétés patriarcales, les femmes sont censées être des victimes, des « long suffering wives », des machines à souffrir. C'est aussi parce que des femmes comme Marilyn Monroe ou Gisèle P. sont des « victimes parfaites » qu'elles suscitent un tel intérêt : elles ont été victimes des hommes tout au long de leur vie, elles ont été complètement détruites par les hommes. Le patriarcat aime ces femmes détruites qui ont enduré d'énormes violences de la part des hommes, et qui pourtant survivent, le fait qu'elles aient supporté toutes ces violences étant la preuve qu'elles sont de bonnes femmes, de bonnes épouses, des « stand by your man women » qui restent avec leur homme quoi qu'il leur fasse, même en cas de violences physiques et sexuelles, même s'il les rend malade et les a presque tuées, même s'il se fait entretenir par elles et qu'il les a ruinées. C'est un spectacle inspirant quand une femme piétinée par un homme pendant des années finit par se révolter et le traîne en justice mais on peut aussi considérer qu'une femme qui ne se laisse pas détruire par un homme est une meilleure icône féministe. Le patriarcat aime ces femmes détruites par les hommes et célèbre leur « résilience » mais les flots d'empathie qu'il leur témoigne sont teintés d'excitation sadique. Lola Lafon dit qu'elle « voudrait qu'on arrête de célébrer le courage et la force des femmes (…) Qu'on cesse enfin de glorifier leur capacité à encaisser » [13].
Les épreuves que Gisèle P. a subies et son attitude digne et courageuse pendant le procès forcent l'empathie et le respect mais son déni face aux comportements sexuellement déviants de son mari doit être passé au crible de l'analyse féministe : il ne s'agit pas de lui jeter la pierre individuellement pour son aveuglement mais de mettre en lumière le contexte socio-culturel qui l'a produit, à savoir la socialisation féminine conventionnelle qu'elle a profondément intériorisée, et les croyances et illusions dangereuses qu'elle véhicule et autour desquelles elle a construit sa vie : l'amour doit être central dans la vie des femmes et tous les clichés qui vont avec cette assertion ( « l'amour triomphe de tout », le mariage et la maternité sont la vocation naturelle des femmes et elles doivent tout faire et tout accepter pour sauver leur couple). Gisèle a été si totalement aveuglée par l'amour qu'elle portait à son mari qu'elle n'a pas voulu voir ce qu'elle voyait, entendre ce qu'on lui disait. Mazan, « procès de la soumission chimique », procès de la pornographie, procès de l'emprise, du contrôle physique et psychologique de Pelicot sur sa femme mais surtout, procès des illusions et des mystifications auxquelles les femmes sont conditionnées – et de l'aveuglement qui en résulte et qui permet aux hommes de se comporter horriblement sans qu'elles se rebellent, sauf à la toute dernière extrémité. Autrement dit, c'est l'adhésion de Gisèle à ces mythes de l'amour et du couple comme valeurs suprêmes et suprêmes accomplissements des femmes qui a préparé le terrain aux manipulations de son mari et à sa mise sous emprise. Et l'aveuglement dont elle a fait preuve n'est pas exceptionnel : les femmes des accusés de Mazan ne se doutaient pas de la double vie criminelle de leurs maris, et beaucoup les ont défendus et leur ont pardonné.
Enfin, 7 accusés (soit 14%) ont dit avoir été victimes de violences sexuelles étant enfant, contre un nombre presqu'égal qui disent avoir eu une enfance heureuse : ces hommes, les ex-enfants choyés comme les ex-enfants agressés, ont pareillement violé Gisèle Pelicot. Sur la base de ces chiffres, (et comme l'a signalé l'expert psychiatre Laurent Layet cité plus haut), on ne peut donc pas avancer que le fait d'avoir été victime de violences sexuelles étant enfant est un facteur déterminant dans la reproduction de ces violences une fois adulte. Cette théorie du « violeur violé » est un mythe patriarcal utilisé de façon récurrente par les avocats de la défense et les agresseurs eux-mêmes et un élément de la culture de l'excuse qui les protège et qui, en leur trouvant des circonstances atténuantes, vise à minimiser leur responsabilité dans les crimes qu'ils commettent. Mais surtout l'explication des violences sexuelles masculines par des circonstances biographiques individuelles permet d'en gommer le caractère systémique.
Par contre, au moins 10 de ces hommes fréquentaient les milieux « libertins » (soit 20%), 18 (soit 36%) avaient déjà été condamnés pour des délits ou/et crimes avant le procès (dont 8 pour des violences sexuelles ou physiques envers leurs femmes et enfants), 4 étaient détenteurs d'images pédopornographiques et 2 étaient des clients réguliers de la prostitution. L'explication de leur passage à l'acte est sans doute multifactorielle, mais il y a un de ces facteurs que tous ces hommes avaient en commun, c'est leur consommation régulière de porno.
Mazan est le procès de la soumission chimique mais c'est aussi le procès du biberonnage de ces hommes au porno : visiteurs réguliers de sites pornos, ils exposaient leurs fantasmes pornos sur un site porno, Coco, où ils cherchaient des complices pour les réaliser. Mazan est aussi le procès du soi-disant « libertinage » qui, sous l'alibi du « libre » consentement des parties intéressées, n'est le plus souvent que le consentement des femmes à des pratiques dégradantes et dangereuses sous la pression insistante de leur conjoint, si même ces femmes ne sont pas droguées, comme dans le cas de Mazan.
Mais le plus évident dénominateur commun des accusés, c'est qu'ils sont tous des hommes, des hommes ayant profondément intériorisé les normes comportementales de la masculinité patriarcale. Comme tel, Mazan est finalement le procès de la masculinité : « les accusés qui défilent à la barre apportent la preuve que notre société est structurellement sexiste et malade de sa domination masculine » [14]. « Ils rejettent la culpabilité partout et sur tout le monde, sauf sur eux-mêmes ». Sur leur enfance malheureuse, sur leur ignorance, sur leur consommation d'alcool ou de cannabis, sur Pelicot et parfois même sur Gisèle elle-même, que certains ont accusée d'être complice de son mari [15]. Quand ils sont venus à Mazan pour la violer, certains de ces hommes ne l'ont même pas regardée, n'ont même pas vu son visage, « n'ont pas prêté attention ». Presque tous « expriment un désintérêt total pour la victime au moment des faits » et, durant le procès, ils ne pensent qu'à eux-mêmes [16]. Ce que tous les hommes de Mazan ont en commun, en plus de leur consommation de porno, c'est leur désastreuse image de la femme : Gisèle était une femme « réduite à un corps et un corps réduit au rang d'objet à disposition pour le seul plaisir des hommes » [17]. Et depuis ce procès, et face à la double vie criminelle des accusés et à l'aveuglement de leurs compagnes, quelle femme en couple hétérosexuel ne se demande pas si elle connait vraiment l'homme avec qui elle vit…
En conclusion : est ce que les violeurs sont des monstres ou est-ce que ce sont des Monsieur Tout le Monde, des hommes ordinaires ? La réponse est : les deux. Parce ce que dans le patriarcat, les hommes sont (socialisés à être) des monstres.
Francine Sporenda
[1] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/affaire-des-viols-de-mazan/comment-le-garcon-que-j-ai-connu-a-pu-devenir-cette-chose-la-au-proces-des-viols-de-mazan-joel-pelicot-regle-ses-comptes-avec-son-frere_6825956.html
[2] https://www.mediapart.fr/journal/france/161124/laurent-layet-expert-au-proces-mazan-ce-n-est-pas-parce-qu-ete-victime-qu-devient-auteur
[3] https://www.bfmtv.com/police-justice/affaire-des-viols-de-mazan-le-frere-de-l-accuse-temoigne-pour-la-premiere-fois_AN-202311160524.html
[4] https://www.laprovence.com/article/region/1236183214288415/proces-des-viols-de-mazan-12-ans-requis-contre-jean-t-employe
[5] https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/proces-des-viols-de-mazan-soumettre-une-femme-insoumise-c-etait-mon-fantasme-avoue-dominique-pelicot-3834300
[6] https://www.ladepeche.fr/2024/11/19/proces-de-mazan-ma-fille-a-poil-jouer-au-docteur-avec-son-petit-fils-dominique-pelicot-est-il-aussi-coupable-dinceste-12332977.php
[7] https://www.20minutes.fr/faits_divers/4130459-20241221-proces-viols-mazan-meurtre-sophie-narme-tentative-viol-dominique-pelicot-vise-autres-affaires
[8] https://www.slate.fr/societe/quand-vient-la-nuit/affaire-viols-mazan-dans-cette-famille-cache-larmes-partage-rires-proces-avignon-vaucluse-gisele-dominique-pelicot
[9] https://www.europe1.fr/Police-Justice/viols-de-mazan-un-seropositif-un-menteur-invetere-huit-nouveaux-accuses-passes-au-crible-4276927
[10] https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/il-droguait-sa-femme-pour-que-des-hommes-la-violent-quel-est-le-profil-de-dominique-p-juge-aux-cotes-de-50-accuses-a-partir-de-ce-lundi-2-septembre-2024-2317350.html
[11] https://www.ladepeche.fr/2024/11/19/proces-de-mazan-ma-fille-a-poil-jouer-au-docteur-avec-son-petit-fils-dominique-pelicot-est-il-aussi-coupable-dinceste-12332977.php
[12] https://www.ladepeche.fr/2024/11/19/proces-de-mazan-ma-fille-a-poil-jouer-au-docteur-avec-son-petit-fils-dominique-pelicot-est-il-aussi-coupable-dinceste-12332977.php
[13] Laurence Rosier, « La Riposte », 75.
[14] https://www.mediapart.fr/journal/france/161124/proces-des-viols-de-mazan-le-grand-deballage-de-la-masculinite
[15] Idem
[16] Idem
[17] https://www.mediapart.fr/journal/france/091124/au-proces-des-viols-de-mazan-la-terrible-image-de-la-femme-des-accuses?at_medium=rs-cm&at_campaign=mastodon&at_account=mediapart
Voir les annexes sur le site : Révolution féministe
https://revolutionfeministe.wordpress.com/2025/03/29/proces-de-mazan-analyse-feministe/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Commission de la condition de la femme : « le poison du patriarcat est de retour »

À l'ouverture de la nouvelle session de la Commission de la condition de la femme, qui se réunit au siège de l'ONU à New York du 10 au 21 mars, des hauts responsables des Nations Unies ont, lundi, déploré la lenteur des progrès visant à résorber les inégalités entre hommes et femmes.
Tiré de Entre les lignes et les mots
La 69e session de cet événement annuel, organisé par l'ONU pour dénoncer la violence et les discriminations dont font l'objet les femmes dans le monde, coïncide avec le trentième anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, qui avaient fixé des objectifs ambitieux en matière d'égalité entre les genres.
« Nous avons toujours su que cela ne se ferait pas du jour au lendemain, ni même au bout de plusieurs années », a souligné le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, à la tribune de l'Assemblée générale de l'organisation.
« Mais trois décennies plus tard, cette promesse semble plus lointaine que nous n'aurions jamais pu l'imaginer », a-t-il reconnu.
Selon le Président de l'Assemblée générale, Philémon Yang, au rythme actuel, il faudra 137 ans pour sortir toutes les femmes de l'extrême pauvreté et 68 ans pour mettre fin au mariage des enfants.
« Ces réalités sont inacceptables et devraient tous nous alarmer », a dénoncé M. Yang lors de la cérémonie d'ouverture de la session.
Des progrès « significatifs »…
Le Président de l'Assemblée générale a toutefois salué les progrès selon lui « significatifs » enregistrés au fil des décennies.
Davantage de pays disposent notamment de lois visant à promouvoir l'égalité des sexes, à sanctionner la violence à l'égard des femmes et à lutter contre la discrimination.
Sur le plan politique, M. Yang a noté que, même si la parité totale reste difficile à atteindre, il y a désormais beaucoup plus de femmes parlementaires.
En 30 ans, leur proportion est ainsi passée de 11 à 20% à l'échelle mondiale. Davantage de filles sont également scolarisées qu'en 1995.
Ces avancées, quoique positives, sont insuffisantes.
…mais « en recul »
Pire encore, selon le Secrétaire général de l'ONU, « les progrès difficilement réalisés sont en recul ».
Il a notamment cité la menace qui pèse sur les droits reproductifs et l'abandon de nombreuses initiatives en faveur de l'égalité entre les sexes partout dans le monde.
En Afghanistan, a-t-il constaté, les femmes ont à nouveau été privées de leurs droits fondamentaux et il leur est désormais interdit de faire entendre leur voix en public.
Parallèlement, le développement de l'intelligence artificielle (IA) normalise la misogynie et le « revenge porn ».
« Jusqu'à 95% des deepfakes en ligne sont des images pornographiques non consensuelles et 90% représentent des femmes », a-t-il dénoncé.
-* Retour du « poison patriarcal »
Pour M. Guterres, ce qui est à l'œuvre n'est ni plus ni moins qu'une contre-révolution.
« Le poison patriarcal est de retour », a-t-il estimé.
Un retour en force caractérisé selon le chef de l'ONU par les disparités salariales, à hauteur de 20% d'écart entre hommes et femmes, et par les violences que subit un tiers des femmes dans le monde, notamment en période de conflit, où elles font souvent l'objets d'abus sexuels systématiques, comme c'est le cas actuellement en Haïti et au Soudan.
M. Guterres a rappelé que les femmes sont toujours privées de droits fondamentaux dans de nombreux pays, comme le droit de ne pas être violée par son mari, de posséder des biens, d'obtenir la citoyenneté sur un pied d'égalité avec les hommes ou encore d'accéder au crédit sans devoir obtenir la permission de son mari.
Obstacles structurels
Selon M. Guterres, la pandémie deCOVID-19 a entraîné une recrudescence des violences à l'encontre des femmes et une baisse de leur participation sur le marché du travail.
La crise de la dette, l'aggravation des catastrophes climatiques, la multiplication des conflits dans le monde et l'absence de perspective de genre dans les législations nationales sont autant d'obstacles structurels qui frappent plus durement les femmes que les hommes.
Raviver le Programme d'action de Beijing
Le Secrétaire général a appelé à redynamiser la Commission de la condition de la femme afin de favoriser la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing.
C'est l'un des volets, a-t-il rappelé, du Pacte pour l'avenir signé en septembre dernier par les gouvernements mondiaux, qui se sont engagés à aider à mobiliser 300 millions de dollars pour les organisations de femmes touchées par les conflits et les situations de crise.
« En ces temps périlleux pour les droits des femmes, nous devons nous rassembler autour de la Déclaration de Beijing », a insisté M. Guterres, « pour faire de la promesse du respect des droits, de l'égalité et de l'autonomisation une réalité pour chaque femme et chaque fille, dans le monde entier ».
Six priorités, selon ONU Femmes
Pour accélérer ces transformations, ONU Femmes, l'agence des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, a entrepris un examen rigoureux des rapports des Etats membres sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing.
Sur cette base, l'agence a identifié six domaines d'action prioritaires, à commencer par la nécessité d'exploiter la technologie au service de l'égalité.
« La fracture numérique est désormais la frontière de l'inégalité », a estimé la Directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Bahous, qui participait à l'ouverture de cette 69e session de la Commission de la condition de la femme.
Mme Bahous a appelé à combler l'écart actuel pour les 259 millions de femmes qui n'ont toujours pas accès à Internet, afin de parvenir à l'égalité d'accès aux compétences numériques, services financiers numériques et marchés de l'emploi.
Par ailleurs, la Directrice exécutive a souligné la nécessité d'investir dans l'autonomisation économique des femmes, dont près d'une sur dix vit aujourd'hui dans l'extrême pauvreté.
Elle a également appelé à renforcer l'application des lois contre les violences à l'égard des femmes et l'accès aux services à destination des survivantes.
« L'investissement dans la prévention de la violence ne permet pas seulement de construire des communautés plus sûres, il crée également les bases de l'égalité et du bien-être pour tous », a insisté Mme Bahous.
Rappelant que les trois quarts des sièges parlementaires dans le monde sont occupés par des hommes, la cheffe d'ONU Femmes a en outre demandé davantage de parité sur le plan de la représentation politique.
« Les démocraties sont plus fortes lorsque les femmes sont au cœur de la prise de décision », a-t-elle dit.
De la même façon, lorsque les femmes ont une voix égale dans les processus de paix, la paix dure plus longtemps, a déclaré Mme Bahous, rappelant que ces dernières représentent moins de 10% des négociateurs de paix dans le monde.
Face à la crise climatique, elle a insisté sur l'importance d'investir dans des emplois verts pour les femmes, afin de créer 24 millions d'emplois d'ici 2030, alimentant à la fois l'économie mondiale et la durabilité environnementale.
« Une nouvelle vague d'activisme courageux et mené par des jeunes monte partout dans le monde », a-t-elle déclaré avec enthousiasme.
https://news.un.org/fr/story/2025/03/1153796
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Rojava : Une délégation internationale de femmes rencontre les YPJ

SYRIE / ROJAVA – Une délégation composée de femmes venues du Canada, d'Espagne et de Catalogne a rencontré les Unités de protection des femmes (YPJ) et a discuté avec les dirigeantes des YPJ de la lutte des femmes combattantes, de l'approche du régime syrien et du concept d'extrémisme religieux ciblant les femmes.
Tiré de Entre les lignes et les mots
La délégation, qui comprenait des responsables de défense des droits humains, de l'Union des femmes, l'Union pour les droits des travailleurs et les droits sociaux, une députée et plusieurs avocates, a visité le nord et l'est de la Syrie et a rencontré les unités de protection des femmes (en kurde : Yekîneyên Parastina Jin, YPJ).
La délégation a été reçue par Sozdar Dêrik, membre du commandement général du YPJ, ainsi que par des membres du Conseil militaire du YPJ, dont Destina Halab, la responsable de la sécurité Israa et le membre du Conseil arménien Talin.
La délégation en visite a discuté de plusieurs questions, notamment de l'acquisition d'une meilleure compréhension des unités de protection des femmes, ainsi que de la lutte des femmes contre la domination patriarcale.
« Les femmes se sentent libres grâce à la lutte »
Sozdar Dêrik, membre du commandement général des YPJ accueillant la délégation, a déclaré : « Nous sommes en contact avec toutes les femmes et toutes les communautés de la région. En tant que femmes, nous souhaitons connaître toutes les communautés et leur faire connaître notre combat, qui inclut la défense des libertés des femmes et des droits des différentes nationalités. »
« Nous ne permettrons pas que la Syrie devienne l'Afghanistan »
La réunion s'est poursuivie par des discussions sur l'évolution de la situation en Syrie et la lutte des femmes contre l'extrémisme religieux. Suzdar Dêrik a déclaré à ce sujet : « En tant que femmes, nous nous opposons au fanatisme national et religieux. Nous rejetons la mentalité d'une nation, d'une religion, d'une langue, d'une idéologie et d'une secte. Le régime Baas a imposé une idéologie nationaliste au peuple, et le régime actuel applique la charia aux femmes. En Afghanistan, la charia est appliquée, et nous ne permettrons pas que la Syrie devienne un autre Afghanistan. Nous nous opposons à la charia et sommes convaincues que les nations démocratiques garantissent une vie paisible et sûre. »
Sozdar Dêrik a conclu en réaffirmant son engagement à poursuivre son combat politique et militaire pour une société libre et égalitaire : « Nous souhaitons que toutes les femmes et toutes les communautés de la région débattent du modèle idéal pour la Syrie. Le Kongra et le Rassemblement des femmes de Zenobia déploient des efforts conjoints pour étudier la représentation des femmes dans la nouvelle constitution syrienne. Nous ferons tout notre possible pour protéger et préserver nos acquis. » (ANHA)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les 85 ans de San Isidro : les femmes au cœur de la résistance paysanne

Le petit ejido [1] de San Isidro, au Mexique, est un symbole de la propriété collective des terres depuis les années 1940, lorsque l'ancien président Lázaro Cárdenas a accordé 536 hectares aux paysan·nes de la localité qui s'étaient organisé·es et avaient revendiqué le droit d'autogérer leurs terres.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Aujourd'hui, San Isidro fait partie des plus de 29 000 ejidos et autres 2 400 communautés enregistrées comme « propriété sociale » au Mexique, un héritage des réformes agraires nées de la révolution mexicaine et inscrites dans la Constitution de 1917. Ces réformes ont limité la propriété foncière privée à 100 hectares etont placé plus de 50% du territoire national (82% d'ejidos et 17% de terres communales) sous propriété collective, les protégeant ainsi de la vente ou de la saisie par les banques.
Mais l'histoire de San Isidro ne se limite pas à la terre ; elle concerne aussi l'eau, les forêts et les habitant·es qui ont lutté pour les préserver. Les ejidos comme celui de San Isidro détiennent 70% des forêts du Mexique et deux tiers de ses ressources en eau. Pourtant, depuis les années 1990, ces terres communales sont menacées. La réforme constitutionnelle de 1992, la crise économique et l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ont ouvert la voie à la privatisation, permettant la conversion des terres d'ejidos en propriétés privées. Plus de 22% des parcelles de propriété sociale ont depuis été privatisées, souvent sous le couvert de l'autonomisation des femmes.
« Ce sont les femmes qui seront propriétaires » devint le cri de ralliement des partisans de la privatisation, notamment la Banque mondiale et la FAO. Mais les femmes de San Isidro savaient qu'il s'agissait de promesses trompeuses.
Dans les campagnes mexicaines, les inégalités de genre sont flagrantes. Les femmes représentent plus de la moitié de la population rurale, mais elles ne détiennent que 28% des titres de propriété sociale. Les femmes rurales sont également confrontées à des conditions de travail plus difficiles : 46 % d'entre elles gagnent le salaire minimum ou moins, contre 32% des hommes.
En 2024, les exportations agricoles du Mexique ont atteint un niveau record, les cultures gourmandes en eau, comme les avocats et les petits fruits figurant parmi les principales exportations. Ces monocultures, motivées par la demande mondiale, ont eu un coût élevé pour des communautés comme San Isidro.
Pour Trinidad de la Cruz, une ejidataria vivant depuis toujours à San Isidro, l'arrivée des fermes d'avocats et des serres a eu des effets dévastateurs. « Nous continuons à planter la milpa et les cuamiles (maïs, haricots, courges, nopal et piments), mais ce n'est plus comme avant », explique-t-elle. « Nous ne sommes plus soutenus par des politiques ou des crédits, de sorte que de nombreux ejidatarios louent leurs terres à des étrangers pour y produire des avocats, des agaves et des cultures horticoles. »
San Isidro est aujourd'hui entourée de plantations d'avocats, et même si peu de membres de la communauté louent leurs terres à des étrangers, la pression monte. « Beaucoup partent en ville ou aux États-Unis pour trouver du travail », explique Trinidad. « Je loue mes 4 hectares à un voisin qui cultive du maïs et du sorgho parce que je suis âgée et que je ne peux pas travailler la terre seule. Mais je ne louerai pas aux entreprises de culture d'avocats. Nous devons préserver l'ejido. »
Dans l'ejido voisin d'Alista, la situation est encore pire. « Environ 80% des terres sont louées pour la culture d'avocats, d'agave et de raisins », explique Ilma María Cruz, une habitante d'Alista. « Les vignes sont irriguées jour et nuit, ce qui ne laisse pas d'eau pour la communauté. Nous avions une source dans les collines, mais maintenant l'eau ne coule plus que deux jours par semaine, pendant environ trois heures. Comment pouvons-nous produire de la nourriture dans ces conditions ? »
La privatisation des terres et de l'eau s'est accélérée après l'ALENA, explique Evangelina Robles, une avocate qui travaille en étroite collaboration avec la communauté de San Isidro. « Les concessions d'eau sont devenues beaucoup plus rapides et les entreprises se sont facilement emparées des ressources. » L'une des premières à s'installer a été l'entreprise étasunienne Amway/Nutrilite, qui a acheté des terres destinées à l'ejido de San Isidro et a commencé à y installer des serres pour la production horticole.
« Ils ont promis des emplois et des salaires équitables », explique Trinidad. « Mais dans les serres, toute la main d'œuvre vient de l'extérieur. Les gens travaillent de longues heures, paient eux-mêmes leur transport et leur hébergement, et accumulent les dettes. Les femmes s'occupent de couper et de nettoyer les fruits, tandis que les hommes et les enfants travaillent dans les champs. C'est de l'exploitation. »
Ilma, une camarade de lutte de Trinidad, ajoute que les impacts sur la santé sont graves. Bien qu'elle ne soit pas elle-même une ejidataria, Ilma est devenue une figure clé de la communauté. « Les pesticides sont partout. On peut les sentir dans l'air, comme du piment. Beaucoup de gens tombent malades, mais les entreprises s'en moquent. »
La résistance
Malgré les difficultés, des femmes comme Trinidad et Ilma sont à l'avant-garde de la résistance. « J'ai été l'une des premières femmes ejidatarias à San Isidro », explique Trinidad. « À la mort de mon mari, le titre de propriété est resté à mon nom et j'ai obtenu le droit de participer aux assemblées. Aujourd'hui, sur environ 80 ejidatarios, près de 25 sont des femmes. C'est à nous qu'incombe la responsabilité de prendre soin de la terre, des enfants et des personnes âgées. »
« Nous avons décidé d'arrêter de louer nos terres et de nous lancer dans la culture agroécologique », explique Ilma. « Nous utilisons des semences indigènes, nous récupérons l'eau de pluie et nous cultivons du maïs, des haricots, des courges et des arbres fruitiers. C'est plus sain et plus durable. »
Leurs efforts s'inscrivent dans une lutte plus large visant à récupérer les terres et l'eau accaparées par l'agrobusiness. En juin 2022, San Isidro a remporté une victoire juridique contre Amway, qui était censée restituer 280 hectares de terres acquises illégalement. Mais l'entreprise a fait appel et a même porté l'affaire devant la Banque mondiale, réclamant 3 millions de dollars des États-Unis à l'État mexicain.
« La communauté a maintenant accès à environ 60 hectares, mais ce n'est pas simple », explique Eva Robles. « Elle doit faire face à des menaces et à une présence armée. Mais des femmes comme Trinidad et Ilma sont les piliers de cette résistance. Elles incarnent la permanence de la communauté face à la spoliation. »
Pour les femmes de San Isidro, la lutte dépasse la simple question des terres : il s'agit de préserver un mode de vie. « Nous nous battons pour nos enfants, pour notre communauté et pour l'avenir », déclare Trinidad. « Cette terre est notre héritage et nous ne laisserons personne nous l'enlever. »
Tandis que les monocultures s'étendent et que l'eau se raréfie, les femmes de San Isidro incarnent la puissance de la résistance collective. Leur histoire nous rappelle que la lutte pour la terre, l'eau et la dignité est loin d'être terminée, mais qu'elle est également loin d'être perdue.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

USAID : L’Afrique dûrement frappée par la suspension du financement vital

L'Agence américaine pour le développement international (USAID) annonçait, le 26 février dernier, la réduction dramatique de 92 % de ses programmes d'aide internationale. Une semaine plus tard, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, confirmait cette décision en précisant que 83 % des programmes d'aide humanitaire seraient supprimés. Une grande partie de cette aide était offerte aux pays africains, où elle jouait un rôle crucial pour la survie de millions d'individus en situation précaire.
Tiré du Journal des alternatives.
Dès son retour à la Maison-BlancheDépartement de l'efficacité gouvernementale — DOGE, Elon Musk qualifiait USAID d'« organisation criminelle » sur son réseau X : il était « temps pour elle de mourir » !
USAID, c'est 42 % de l'aide au développement dans le monde
Fondée en 1961 par John Kennedy, l'USAID est une agence américaine qui assumait 42 % de l'aide humanitaire mondiale, avec un budget annuel de 42,8 milliards de dollars. En 2023, les États-Unis ont consacré. 64 milliards de dollars à l'aide au développement auprès de 209 pays, ce qui représentait seulement 1 % du budget des États-Unis.

Le décret gelant l'aide humanitaire s'inscrit dans la politique extrémiste de l'administration Trump de « réévaluer les intérêts américains », qui met de l'avant l'« America First ». USAID avait pour mission de promouvoir la démocratie et le développement au sein des pays les plus défavorisés du monde, et ce par une politique américaine de « soft power ». Aujourd'hui anéantie par une idéologie nationaliste, le programme connaît un tournant historique dans la politique étrangère des États-Unis avec des conséquences désastreuses pour les populations les plus marginalisées des pays dépendants de cette aide étrangère.
Le démantèlement soudain de USAID laisse le secteur de l'aide humanitaire complètement mutilé et réduit presque à néant le financement de milliers d'ONG, leur laissant la seule option de licencier leur personnel et d'interrompre leurs services. L'effet domino impacte drastiquement les populations les plus vulnérables comme les enfants, les femmes, les minorités religieuses, les individus appartenant à la communauté 2ELGBTQI+ et plusieurs autres groupes.
Une fatalité pour les pays africains
Plusieurs pays africains tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme, soulignant que des millions de personnes dépendent de cette aide pour survivre. De nombreux pays africains dépendent de USAID pour financer une part importante de leur budget, parfois jusqu'à 50 %. La suspension de cette aide a des conséquences immédiates sans précédentes où des millions de personnes se retrouvent privées de programmes vitaux, tandis que les économies les plus fragiles, déjà en situation de précarité, sont menacées d'effondrement.
Selon les données de 2023 du gouvernement américain, les bénéficiaires de l'USAID en Afrique étaient l'Éthiopie, la Somalie, le Nigeria, la République démocratique du Congo (RDC), le Kenya, le Mozambique et le Soudan du Sud. L'USAID assurait ainsi au sein de ces pays l'accès aux médicaments pour les personnes séropositives, le financement de camps de personnes réfugiées, la garantie d'une sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation, le service d'eau potable, la lutte contre les épidémies et plus encore.
La fin du programme contre le SIDA et des soins de santé vitaux
L'arrêt du financement de l'USAID entraîne ainsi la suspension du Plan présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le VIH/sida (PEPFAR), un programme lancé en 2003 par le président George W. Bush. En deux décennies seulement, celui-ci a sauvé plus de 20 millions de vies dans le monde atteint par le VIH. En 2024, le PEPFAR permettait encore à 20,6 millions de personnes dans plus de 55 pays d'accéder aux traitements antirétroviraux.
En Afrique du Sud, ce sont six millions de personnes qui vivent avec le VIH, soit le taux le plus élevé au monde. Le gel du financement de USAID oblige la fermeture de cliniques. Les stocks de médicaments s'épuisent et des millions de vies sont en danger du jour au lendemain. Cette situation ne concerne pas seulement l'Afrique du Sud, mais aussi plusieurs autres pays africains dont l'Éthiopie, la RDC, le Malawi, le Mozambique, le Kenya. Ce n'est que la pointe de l'iceberg dans ces pays touchés par cette infection fatale sans traitements.
En République démocratique du Congo (RDC) en 2025, la contribution attendue du PEPFAR s'élevait à 105 millions de dollars, un montant crucial nécessaire pour traiter la moitié des 520 000 personnes qui vivent avec le VIH dans ce pays. Au Mozambique, ce sont plus de deux millions de personnes qui dépendent de la fourniture régulière de médicaments antirétroviraux pour prévenir la propagation du sida.
Insécurité alimentaire
L'Éthiopie est le plus grand bénéficiaire de l'USAID en Afrique subsaharienne, recevant plus d'un milliard de dollars en 2023. Ce soutien était crucial pour contrer l'insécurité alimentaire qui plonge des millions de personnes dans la famine. Avec la suspension soudaine de l'aide étrangère, c'est 34 880 tonnes d'huile végétale, de légumineuses et de sorgho qui sont bloquées au port de Djibouti. Cette cargaison aurait pu nourrir près de 2,1 millions de personnes pendant un mois. Selon la Commission de gestion des risques de catastrophe du Tigré, l'aide alimentaire a été arrêtée pour un million de personnes vivant en Éthiopie.
Déchiré par une guerre qui perdure depuis près de deux ans, le Soudan traverse l'une des pires crises humanitaires de son histoire, plongeant des millions de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire. En 2023, les États-Unis avaient alloué plus de 500 millions de dollars d'aide d'urgence au Soudan. La fermeture soudaine des cuisines collectives prive ainsi le pays d'un outil essentiel au sein de sa lutte contre la malnutrition où l'aide américaine finançait près de 80 % de ces cuisines communales. La fermeture de ce service provoque l'inaccessibilité à la nourriture pour un demi-million de Soudanaises et de Soudanais selon l'International Rescue Committee.
La crise alimentaire heurte aussi en RDC où une grande partie de la population souffre également de malnutrition et où des milliers d'enfants se retrouvent maintenant en danger de mort. En 2023, le pays avait reçu près d'un milliard de dollars d'aide humanitaire de USAID. Le pays est également confronté à un afflux massif de déplacés, conséquence des affrontements entre l'armée et le groupe rebelle M23. Selon l'International Rescue Committee, c'est 25 000 enfants au Nigeria qui souffrent de malnutrition et qui perdront l'accès à l'aide alimentaire.
Les populations réfugiées abandonnées
Terre d'accueil, l'Éthiopie reçoit un grand nombre de personnes réfugiées issues du Soudan, de la Somalie et de l'Érythrée. Sans l'aide internationale, il devient presque impossible d'offrir des services essentiels à la survie de cette population déplacée.
En Somalie, l'annonce du gel de l'aide américaine a provoqué une onde de choc, tant pour les ONG que pour les personnes séropositives qui dépendaient également des traitements antirétroviraux. L'interruption brutale de ce soutien met en péril les programmes d'assistance médicale ainsi que l'aide humanitaire apportée aux trois millions de personnes réfugiées au pays.
Au Soudan du Sud, c'est plus de 60 % de la population qui souffre de la famine. En parallèle, l'afflux de réfugié.es aggrave la situation, rendant l'approvisionnement alimentaire encore plus difficile. Selon l'ONU, le pays est au bord d'une nouvelle guerre civile, plongeant la nation dans une instabilité politique et humanitaire croissante. D'après M. Haysom, chef de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), les violences armées et politiques ont déjà contraint 63 000 personnes à fuir leurs domiciles. La suspension de l'aide représente un coup dur pour la plus jeune nation du monde. Selon l'International Rescue Committee, c'est plus de 115 000 personnes qui n'auront plus accès à des soins de santé et à des services de nutrition de qualité.
Repenser la solidarité internationale
Il est encore trop tôt pour mesurer pleinement les conséquences du démantèlement de l'USAID. Chose est certaine, cette décision aura un coût humain tragique. Face à cette crise, il devient urgent de repenser la solidarité internationale. Le rôle du Canada dans cette nouvelle configuration internationale mérite d'être interrogé. La déstabilisation suite à l'arrêt de l'influence américaine dans le monde ouvre et un espace à l'influence géopolitique accrue de la Chine et de la Russie. La communauté internationale ne peut rester passive face au désastre humanitaire en cours, elle doit tout mettre en œuvre pour agir et se responsabiliser, car il s'agit d'une question de vie ou de mort.
Sources
– U.S. Foreign Assistance Agency (2025) https://foreignassistance.gov/agencies
– Faruk, F. (2025), Le gel des fonds de l'USAID paralyse l'aide humanitaire en Somalie, notamment L'Actualité, 11 février 2025 https://lactualite.com/actualites/le-gel-des-fonds-de-lusaid-paralyse-laide-humanitaire-en-somalie-notamment/
– Harter F. (2025), The impact has been devastating' : how USAid freeze sent shockwaves through Ethiopia, The Guardian, 25 février 2025. https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2025/feb/21/the-impact-has-been-devastating-how-usaid-freeze-sent-shockwaves-through-ethiopia
– ONU (2025), Le Soudan du Sud au bord de la guerre civile, selon l'ONU. 24 mars 2025 https://news.un.org/fr/story/2025/03/1154246
– Silveiro, C. (2025), En RDC, l'interruption de l'aide américaine à la réponse au VIH pourrait coûter des milliers de vies, ONU, 12 mars 2025 https://news.un.org/fr/story/2025/03/1153896
– Mednick S., Mcmakin, W. et Pronczuk, M. (2025), USAID cuts are already hitting countries around the world. Here are 20 projects that have closed, Associated Press, 1er mars 2025 https://apnews.com/article/usaid-cuts-hunger-sickness-288b1d3f80d85ad749a6d758a778a5b2
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La place de l’Afrique dans le nouvel ordre mondial

L'Afrique se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, coincée entre des crises internes, une évolution des rapports de force internationaux et le lent délitement de l'ordre politique post-libéral. Sur l'ensemble du continent, les partis au pouvoir qui ont autrefois acquis une légitimité en tant que forces de libération nationale perdent peu à peu leur emprise ; pourtant, l'offre gouvernementale alternative de l'opposition reste fragmentée et peu convaincante.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière. Source - Amandla !, mercredi 2 avril 2025.
Les élections mozambicaines de 2024 sont l'un des exemples les plus frappants de ce déclin, le parti au pouvoir, le Frelimo, ayant proclamé sa victoire dans le prolongement d'un scrutin largement dénoncé comme frauduleux. Le chef de l'opposition, Venâncio Mondlane, se présentait sous la bannière du nouveau parti Podemos. Il a accusé le gouvernement d'avoir orchestré une manipulation électorale massive après que des comptages parallèles des voix eurent fait apparaître qu'il avait en réalité gagné. Le parti au pouvoir a répondu aux manifestations de masse par une répression violente. Cela s'inscrit dans une tendance à la répression de la dissidence politique par des moyens de plus en plus autoritaires.
L'illégitimité croissante de ces gouvernements issus de l'après-guerre de libération ne se limite pas au Mozambique. En Afrique du Sud, l'ANC a perdu sa majorité absolue pour la première fois depuis 1994, ne recueillant qu'environ 40 % des voix aux élections de 2024. Après des décennies de domination politique, le parti se retrouve désormais dans une coalition précaire et extrêmement fragile avec l'Alliance démocratique (DA), son rival de longue date. Cela a contraint l'ANC à adopter une position gouvernementale plus centriste, limitant sa capacité à poursuivre les politiques que sa base traditionnelle pouvait attendre.
Si certains au sein de l'ANC considèrent cette coalition comme un compromis nécessaire pour maintenir la stabilité, d'autres y voient une trahison de la mission historique du parti, en particulier compte tenu de l'orientation politique néolibérale de la DA. Les conséquences de cette entente restent incertaines : la coalition durera-t-elle, provoquera-t-elle une nouvelle fracture au sein de l'ANC ou donnera-t-elle naissance à des mouvements d'opposition plus forts en dehors du processus électoral traditionnel ?
Le déclin de l'ANC s'inscrit dans une tendance plus large en Afrique australe. Au Zimbabwe, le Zanu-PF reste bien ancré grâce à la répression plutôt qu'au soutien populaire, s'appuyant sur le pouvoir judiciaire et la commission électorale pour écarter toute concurrence sérieuse de l'opposition. Parallèlement, le Swapo namibien et le BDP botswanais ont tous deux fait face à des défis électoraux sans précédent (le BDP ayant perdu une élection pour la première fois depuis l'indépendance), ce qui montre que même les partis au pouvoir autrefois stables ne sont plus assurés de victoires faciles. Le délitement de ces mouvements suggère que les références à la lutte de libération, autrefois si efficaces, ne suffisent plus pour asseoir leur légitimité au pouvoir.
Conflit
L'essoufflement de ces gouvernements s'inscrit dans un contexte de conflits et d'instabilité croissants ailleurs sur le continent.
Le Soudan demeure plongé dans une guerre dévastatrice entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de soutien rapide. Ce conflit a entraîné le déplacement de millions de personnes et s'est de plus en plus internationalisé, l'Égypte et les Émirats arabes unis soutenant les camps opposés. La guerre a non seulement exacerbé l'effondrement économique du Soudan, mais menace également la stabilité régionale, avec des retombées au Tchad, au Soudan du Sud et en Éthiopie.
La République démocratique du Congo (RDC) continue de faire face à des insurrections armées, en particulier à la résurgence du M23, dont le soutien de la part du Rwanda a attisé les tensions régionales. Les accusations d'ingérence transfrontalière mettent encore plus à mal les relations diplomatiques.
Ces crises ne sont pas isolées ; elles témoignent d'un échec plus profond des gouvernements dans toute l'Afrique, où l'État est souvent incapable de trouver des solutions aux revendications sociales et économiques sans recourir à la violence.
L'effet Trump
En plus de ces crises, l'Afrique est également confrontée à un ordre international en pleine mutation. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a déjà commencé à remodeler les relations entre les États-Unis et l'Afrique. On observe un mouvement vers une approche plus axée sur les transactions et un regain d'intérêt pour la sécurité au détriment du développement. L'une des premières mesures importantes de Trump en matière de politique étrangère a été de réduire considérablement l'aide étrangère, de démanteler l'USAID et de couper les financements de grands programmes dans le domaine de la santé, dont le PEPFAR. Des millions de personnes se sont ainsi retrouvées privées d'accès au traitement du VIH et à d'autres services essentiels.
Les pays où les systèmes de santé sont déjà très en difficulté ont été les plus touchés, ce qui a exacerbé les crises de santé publique et pourrait avoir des effets déstabilisateurs à long terme. La justification de ces coupes budgétaires par l'actuelle administration s'enracine dans son principe général « America First ». L'aide étrangère y est considérée comme une dépense inutile plutôt que comme un investissement stratégique dans la stabilité.
Et cela a coïncidé avec un durcissement de la politique américaine en matière d'immigration. L'actuelle administration envisage une suppression généralisée des visas qui pourrait affecter des dizaines de pays africains, limitant les déplacements des étudiants, des travailleurs et des touristes. Cette politique rappelle les restrictions aux déplacements imposées par Trump lors de son premier mandat. Elle traduit un isolationnisme croissant des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique, le continent étant davantage considéré comme un risque en matière de sécurité et de migration que comme un partenaire diplomatique ou économique.
Trump et l'Afrique du Sud
L'hostilité de l'administration envers l'Afrique du Sud est particulièrement frappante. Trump a expulsé l'ambassadeur sud-africain et imposé des sanctions. Il s'agissait d'une réaction aux mesures d'expropriation foncières de Pretoria et à ses positions en matière de politique étrangère, en particulier à ses initiatives visant à exiger d'Israël qu'il rende des comptes pour les actes de génocide commis à Gaza. L'administration Trump accuse l'Afrique du Sud de sympathie envers le Hamas et l'Iran.
Ces mesures punitives reflètent le malaise plus général de cette administration à l'égard des gouvernements qui remettent en question l'hégémonie américaine, en particulier ceux des BRICS. En qualifiant les positions politiques de l'Afrique du Sud d'« antiaméricaines », Trump a effectivement rompu les liens diplomatiques les plus étroits qui existaient entre les États-Unis et une puissance africaine. Cela s'inscrit également dans la volonté plus générale de son administration de privilégier les États de droite, aux tendances autoritaires, tout en isolant les gouvernements perçus comme étant de gauche ou indépendants.
Les ressources des États-Unis, de la Chine et de l'Afrique
Dans le même temps, l'administration Trump privilégie un type d'échanges différent avec d'autres États africains, notamment dans le secteur des ressources. Elle négocie actuellement un accord « minerais contre sécurité » avec la RDC. Elle propose une assistance militaire en échange d'un contrôle exclusif sur des minerais essentiels aux industries de pointe américaines, notamment dans les secteurs de la technologie et de la défense. Cet accord permettrait aux entreprises américaines d'exercer un contrôle étendu sur le cobalt et d'autres minerais essentiels. Cela reflète un changement de stratégie des États-Unis, qui passent de l'aide au développement à une activité directe d'extraction.
L'administration affirme que ce partenariat contribuera à stabiliser la RDC en lui apportant une aide en matière de sécurité. Les détracteurs mettent en garde contre le risque d'une aggravation de la dynamique néocoloniale qui reviendrait à privilégier l'extraction des ressources au détriment d'un véritable développement économique.
Dans le même temps, l'approche de la Chine à l'égard de l'Afrique est également en train de changer. Pendant deux décennies, Pékin a été le principal partenaire économique du continent, finançant les infrastructures et le commerce à une échelle inégalée par toute autre puissance extérieure. Cependant, avec le ralentissement que connaît l'économie chinoise, la propension de Pékin à accorder des prêts à grande échelle aux gouvernements africains s'amenuise. Des pays comme la Zambie et le Kenya, fortement endettés envers la Chine, ont déjà ressenti les effets de la nouvelle stratégie chinoise en matière de prêts. Il se pourrait que l'époque où la Chine octroyait facilement des crédits pour de grands projets d'infrastructure soit sur le point de prendre fin, laissant les États africains dans une position précaire. De nombreux gouvernements, qui ont organisé leur économie tout entière autour de la poursuite des investissements chinois, ont désormais du mal à s'adapter à cette nouvelle réalité. Ce tournant a pour effet de réduire les possibilités de financement extérieur de l'Afrique, les institutions financières occidentales ayant également durci leurs conditions de prêt, en particulier pour les pays fortement endettés.
Une nouvelle politique possible ?
Pour les gouvernements africains, ces évolutions soulèvent des questions difficiles en matière de stratégie politique et économique. Le déclin des mouvements de libération nationale n'a pas encore abouti à l'émergence d'alternatives progressistes crédibles. Dans toute la région, les partis d'opposition ont largement adopté des modèles de gouvernance néolibérale au lieu de définir de nouvelles perspectives de transformation économique. Loin d'évoluer vers un renouveau démocratique, une grande partie du continent semble osciller entre une répression étatique accrue et des oppositions fragmentées. De nombreux partis d'opposition, bien que critiques envers les gouvernements au pouvoir, n'ont pas réussi à proposer des programmes économiques qui rompent avec le paradigme néolibéral dominant. Ainsi, même lorsque les partis au pouvoir sont confrontés à un déclin électoral, rien n'indique que leurs remplaçants soient susceptibles de modifier fondamentalement le paysage politique ou économique.
Alors que les mouvements enracinés dans les luttes ouvrières et populaires continuent de faire pression pour le changement, leur capacité à remettre en question les pouvoirs bien établis reste incertaine. La faiblesse des alternatives de gauche en Afrique aujourd'hui reflète des tendances mondiales plus larges, où les forces socialistes et social-démocrates peinent à s'affirmer dans un monde façonné par le capital financier et le pouvoir des grandes entreprises.
Cependant, certains signes indiquent que cela pourrait changer. Sur tout le continent, on assiste à une montée des exigences de souveraineté économique et de renforcement des programmes de protection sociale, ainsi qu'à une résistance accrue aux diktats financiers extérieurs. Si ces luttes finissent par se cristalliser en formations politiques plus cohérentes, elles pourraient constituer le fondement d'un nouveau type de projet politique, rompant à la fois avec les échecs des partis issus des luttes de libération et les limites des forces d'opposition libérales.
L'ordre politique post-libéral en Afrique est en train de s'effondrer, mais ce qui va suivre est loin d'être clairement défini. L'érosion de la légitimité des partis au pouvoir ne s'est pas encore traduite par une transformation significative du système. Dans de nombreux cas, elle a simplement ouvert la porte à de nouvelles formes de manœuvres des élites. En cette période de transition, la véritable bataille ne porte pas seulement sur les élections, mais sur la nature même de l'État, de l'exercice du pouvoir économique et de la place de l'Afrique dans un ordre mondial en pleine mutation. Tant que des modèles alternatifs ne remettront pas en question la dépendance du continent vis-à-vis de la finance mondiale, de l'extraction des ressources et de la croissance induite par la dette, l'Afrique restera enfermée dans des cycles d'instabilité, avec ou sans les anciens mouvements de libération à sa tête.
Will Shoki
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Génocide au Soudan : les reflets d’un passé violent à l’horizon

Les Forces armées soudanaises (FAS) ont repris en mars le contrôle de la capitale du pays, Khartoum, qui était aux mains de la milice des Forces de support rapide (FSR) depuis le début de la guerre en 2023. Il s'agit d'un moment décisif du conflit qui arrive à la suite d'une série de gains clés récents des FAS, mais la sécurité de la population soudanaise sur le terrain reste en péril.
Tiré du Journal des alternatives.
Selon Awad Ibrahim, professeur titulaire à la faculté d'éducation et vice-recteur en matière d'équité, de diversité et d'inclusion à l'Université d'Ottawa, « ce qui se passe dans les médias et [la réalité] sur le terrain sont deux choses complètement différentes » au Soudan.
Notamment, les Forces armées soudanaises bénéficient d'une légitimation plus grande que les Forces de support rapide étant donné leur rôle d'armée nationale, leur place dans les médias et l'appui de pays tels que la Turquie, l'Iran, la Russie et l'Ukraine. Awad Ibrahim considère cependant qu'une victoire des FAS, dirigés par le général Abdel Fattah al-Burhan, n'assurerait pas pour autant la sécurité et la défense des intérêts du peuple soudanais.
Les FSR sont néanmoins responsables d'attaques sur la population plus violentes et plus fréquentes que leurs adversaires. En janvier 2025, les États-Unis ont d'ailleurs déclaré que les FSR avaient commis un génocide au Soudan pendant le conflit, plus particulièrement dans la région du Darfour. En mars le Soudan a intenté devant la Cour internationale de justice une requête accusant les Émirats arabes unis d'avoir facilité le génocide contre le peuple Masalit en offrant aux FSR du financement, des armes et leurs propres agents.
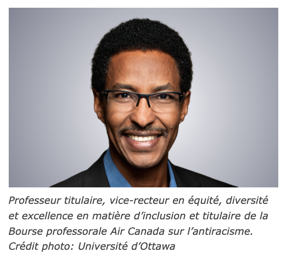
Cependant, les FAS et les FSR sont tous deux accusés d'avoir commis des attaques ciblant des groupes minoritaires.
La violence ethnique, mode opératoire des FSR depuis les premiers jours
Au début de cette guerre, des mois d'avril à novembre 2023, des attaques répétées ciblant le peuple Masalit, largement situé dans l'état du Darfour de l'Ouest, ont fait des milliers de victimes et ont forcé des centaines de milliers à fuir la région. Le chef des FSR, connu sous le nom de Hemetti, et son frère, Abdel Raheem Hamdan Dagalo, sont accusés d'avoir orchestré la décimation de villages en majorité masalit. Dans la ville de Al-Genaïna seulement, 10 à 15 milliers de personnes avaient été tués par les FSR à la fin de 2024.
Dans l'état du Darfour du Nord, toujours à l'ouest du pays, les FSR détiennent le contrôle de la majorité du territoire depuis novembre 2023. De nombreuses attaques commises par ce groupe et des milices arabes associées ciblent délibérément des groupes africains minoritaires depuis, notamment les peuples Fur et Zaghawa.
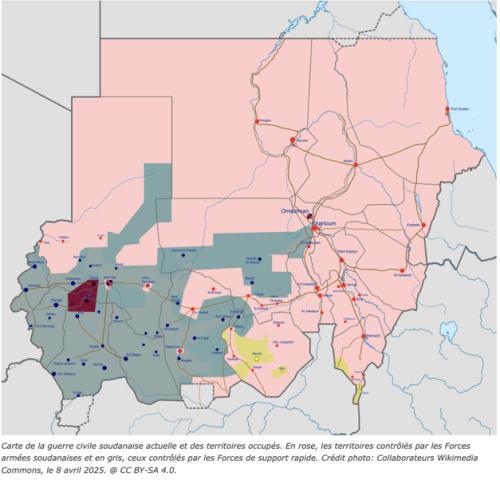
En janvier, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a lancé l'alerte par rapport à l'augmentation des violences ciblées envers certains groupes ethniques minoritaires au Soudan. Cette fois-ci, ce sont les FAS qui auraient commis des actes de violence à caractère ethnique. Dans l'état d'Al Jazira, des attaques visées contre les Kanabis, un groupe marginalisé, ont fait au moins 21 victimes cette année. Dans des vidéos témoignant de l'attaque, les victimes sont sujettes à des insultes déshumanisantes et les exactions sommaires sont qualifiées de « nettoyage », alors que des hommes vêtus d'uniformes des FAS sont présents.
Des actes faisant écho au passé
Pour Awad Ibrahim, le génocide actuel au Soudan suggère que les leçons du passé n'ont pas été apprises. « On est en train de répéter pas seulement la même chose, mais [aussi] de la même façon ».
Au début des années 2000, les autorités soudanaises se sont alliées aux Janjawids, des milices arabes, en réponse au soulèvement de groupes rebelles de la région du Darfour qui dénonçaient la marginalisation économique de la région par la capitale. Le gouvernement soudanais et les Janjawids ont lancé des attaques sanglantes ciblées envers les peuples Fur, Zaghawa et Masalit dont étaient issus les groupes dissidents. Le viol a également couramment servi d'arme de guerre contre les femmes et les filles du Darfour lors du génocide. Pendant la période de 2003 à 2005, plus de 200 000 civiles ont été tué.es et deux millions ont été.es déplacé.es de force.
Les actes de violence à caractère ethnique au Darfour commis lors du conflit actuel rappellent à la fois ce génocide peu lointain, mais aussi les racines politiques des chefs des FSR et des FAS. Tous deux ont eu leur part à jouer dans les violences précédentes aux Darfour. Lors du conflit de 2003 à 2005, Hemetti est devenu un des dirigeants des milices janjawid, alors que Al-Burhan était un colonel responsable des renseignements militaires et de la planification des attaques en concert avec les Janjawids.
Quelles solutions pour la population soudanaise ?
La reprise de Khartoum par les FAS, qui aurait pu annoncer un certain répit pour les Soudanais.es, est pourtant teintée par ses actions récentes dans la même région.
« On s'attendait à ce que les choses s'améliorent si l'armée pousse les FSR, mais malheureusement on a vu des incidents où elle a montré que les gens continuent à souffrir », soutient Awad Ibrahim. Depuis la reprise du nord de Khartoum en janvier, qui précède la prise officielle du palais présidentiel, près d'une vingtaine de civil.es ont été la cible d'exactions sommaires perpétrées par des militaires associés aux FAS.
Pour Awad Ibrahim, c'est la preuve qu'au Soudan, « Ce qu'on appelle “l'armée”, ce n'est pas vraiment ce qu'on pense [être] l'armée ».
« Malheureusement, ils sont tellement infiltrés par les Frères musulmans et les extrémistes, qu'on peut [les désigner comme] “armée”, mais seulement entre guillemets », ajoute-t-il. Les Frères musulmans, une organisation islamiste transnationale, possède une présence et une influence de longue date au pays. Ces accusations d'infiltration du groupe au sein des FAS inquiètent, puisqu'un gouvernement islamiste pourrait exacerber la persécution subie par les groupes religieux minoritaires.
Le professeur titulaire considère que les Forces armées soudanaises doivent d'abord changer de chef, car avec la poursuite des pratiques du général Abdel Fattah al-Burhan, « l'armée risque de répéter [les actes du passé], de continuer la guerre et même de diviser le pays ».
« Il faut absolument garder l'espoir, mais l'espoir réaliste », soutient Awad Ibrahim. Pour ce dernier, cet espoir réaliste signifie notamment d'abord de retracer les fondements de la guerre pour comprendre comment les événements des deux dernières années ont pu se produire afin d'éviter qu'ils surviennent à nouveau. Il s'agirait également ensuite de mener une analyse qui permettra d'arriver à un consensus de l'identité soudanaise qui conserve la diversité culturelle, linguistique et religieuse du pays.
Une résistance en attente
La résistance soudanaise a par le passé su montrer sa résilience et sa capacité de bousculer les forces au pouvoir, mais la précarité de la situation actuelle entrave les rassemblements collectifs. En effet, en 2018 et 2019, les soulèvements populaires avaient grandement contribué à mettre un terme au règne d'Omar el-Bechir, qui était à la tête du pays depuis 30 ans. Cependant, en 2019, les FAS et les FSR, qui formaient alors une coalition gouvernementale militaire de transition, ont tué plus de 120 militant.es qui appelaient à la formation d'un gouvernement civil.
Après le coup d'État de 2021, grâce auquel al-Burhan a obtenu le pouvoir de force et s'est défait de toute forme de gouvernement civil, des centaines de milliers de manifestant.es sont descendus dans les rues. Encore une fois, la répression de l'armée face à ces manifestations fut violente. Si les soulèvements populaires se sont poursuivis en 2022, le déplacement de la population, la violence et la famine qu'a amenés la guerre civile découragent aujourd'hui la révolte.
« Dès qu'il y a une forme de paix, il y a pas mal de gens qui sont prêts à entrer tout de suite, [peut-être] pas en confrontation avec l'armée, mais à commencer à reconstruire le pays », affirme Awad Ibrahim. « Il y a une continuation quand même de cette rébellion de 2018-2019, qui a été amenée par les jeunes. On a encore des jeunes, je le vois et je le sais », précise-t-il néanmoins.

Soudan, l’impunité des Emirats arabes unis

L'armée soudanaise a poursuivi ses avancées et libéré Khartoum, ce qui a donné lieu à des scènes de liesse dans tous les pays où se trouvent des réfugiés, principalement au Caire où ils sont les plus nombreux. Des centaines de milliers d'entre eux sont déjà rentrés. Mais la joie du retour a un goût de cendres devant l'ampleur des exactions commises par les Forces de soutien rapide dirigées par Hemedti et soutneus par les Émirats Arabes Unis.
Tiré de MondAfrique.
Les FSR jouent leurs dernières cartes en attaquant Al-Fasher, la capitale du Darfour. Il espère ainsi compter encore politiquement en faisant de cette région une base de repli. Mais avant même que la guerre ne soit terminée, le gouvernement soudanais, dirigé par le général Al-Burhan, a ouvert un nouveau front en poursuivant les Emirats arabes unis, soutiens de cette milice, devant la Cour de Justice internationale. Khartoum s'attaque à forte partie…

C'est un bien triste anniversaire que le Soudan fête ce 15 avril. Depuis deux ans jour pour jour, les forces armées soudanaises dirigées par le général Al-Burhan combattent les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Dogolo dit Hemedti. Si au début du conflit, les deux généraux putschistes pouvaient être renvoyés dos à dos, au fil du temps, Al-Burhan a incarné l'Etat soudanais, la légalité en dirigeant l'armée soudanaise, puis la légitimité en étant soutenu par une majorité de la population en grande partie en raison des exactions commises par les FSR, ces successeurs des Janjawid de sinistre mémoire[i].
Les supplétifs des FSR sans foi ni loi
Il est vrai que ces derniers se sont surpassés. Lors des libérations des villes où des villages, les rescapés des camps de tortures, des prisons improvisées, racontent lorsqu'ils le peuvent encore, les privations, les tortures moyenâgeuses, les humiliations. Leurs corps décharnés et leurs regards hagards laissent sans voix. Par dignité, ils omettent de décrire les viols qu'ils ont subis.

Le 10 avril, Amnesty international a publié un rapport sur les violences sexuelles commises envers les femmes, cependant cette pratique a concerné également les hommes, preuve qu'elle a été utilisée comme arme de guerre. D'autres témoignages reçus de Soudanais relatent parfois l'indicible comme l'enfermement de dizaines de personnes vivantes dans des containers saupoudrés de piment jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dans quels cerveaux malades peut naître une telle imagination macabre ?
Si ces faits sont mis en lumière par la force des témoignages des survivants, les exactions des FSR ne sont pas nouvelles, de nombreuses étaient déjà fort bien documentées. Cependant, tout au long de ces deux années, les condamnations n'ont pas été à la hauteur des drames humanitaires vécus par le peuple soudanais. Cette frilosité s'explique par le soutien que le groupe paramilitaire reçoit des Emirats arabes unis, un pays qui, pour plusieurs raisons, jouit d'une incontestable impunité.
Le 6 mars, afin de mettre la pression sur Abou Dhabi pour qu'elle cesse son soutien au FSR, le gouvernement soudanais a engagé une procédure devant la Cour Internationale de Justice. Khartoum accuse les Emirats de complicité de génocide au Darfour envers la communauté Massalit. Lors de la première journée d'audience, le 10 avril, les Emiratis ont balayé ses accusations d'un revers de main en les qualifiant de « de théâtre politique ». Ils ont nié les faits bien qu'ils soient indéniables, établis, documentés(1)[ii]. Comme l'écrit le gouverneur du Darfour Mini Minawi sur X ; « Le monde n'a pas besoin de preuves supplémentaires pour condamner les FSR et l'Etat qui les finance. » Mais même si cette Cour se déclarait compétente et prenait des décisions contraignantes, elle ne dispose d'aucun moyen de les faire respecter, comme l'a démontré le cas de la Palestine.
L'impunité de MBZ
Mohamed Ben Zayed, le chef de l'Etat de ce pays du golfe, ne craint donc pas la justice internationale et pas non plus les réactions de ses partenaires et alliés occidentaux. Depuis deux ans, les Etats-Unis, comme l'Union européenne et la France se sont bien gardés de les pointer du doigt. L'administration Biden a toujours pris soin de renvoyer les deux camps dos à dos. Et avant lui, Donald Trump avait fait, durant son premier mandant, son interlocteur privilégié au Moyen Orient.

Si Bruxelles, a plaidé pour un renforcement des enquêtes de la Cour Pénale internationale ou a exhorté au respect de l'embargo sur les armes, violé sans interruption depuis deux ans par les Emirats, aucun document officiel ne les mentionne. Idem à Paris, qui a condamné à plusieurs reprises les attaques des FSR contre les civils et soutenu les sanctions du Conseil de Sécurité contre les généraux d'Hemedti, mais sans jamais nommer leurs parrains. Cette hypocrisie, ces doubles standards ne sont pas nouveaux, cependant ils renforcent la crise de légitimité que vivent aujourd'hui les Occidentaux.
Ces dizaines de milliards qui ruissellent
Cette difficulté à prononcer un nom s'explique par la puissance tentaculaire du soft power émirati et de leurs fonds qui irriguent les économies dans tous les secteurs. Pour ne prendre que le cas de la France, les 30 à 50 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle pour la construction de data center dans l'Hexagone, promis en février dernier, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Paris a signé des partenariats avec Abu Dhabi dans la culture avec le Louvre, l'université avec la Sorbonne, la Défense avec la base militaire et les ventes de matériels militaires etc. Les situations sont identiques au Royaume-Uni, en Allemagne, à Bruxelles, aux Etats-Unis. Qui prendrait le risque de fâcher un si puissant partenaire et ainsi tuer la poule aux œufs d'or ?

L'impunité des Emirats s'explique également par des raisons géopolitiques. Le Soudan occupe une position stratégique en Afrique à la croisée de la mer Rouge et du monde arabe. Si la guerre qui fait rage depuis deux ans a bien évidemment des dynamiques internes, elle a aussi des influences extérieures avec des enjeux pour nombre de puissances. Ce conflit est un prolongement des crises du Proche et Moyen-Orient. D'ailleurs, comme l'a rappelé le professeur Jeffrey Sachs devant le Parlement européen en mars, puis de nouveau cette semaine lors d'un colloque en Turquie, le Soudan figurait sur la liste des sept pays avec l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye et la Somalie, à attaquer et à détruire selon un responsable du Pentagone (1)[iii].
Si les raisons économiques sont invoquées pour justifier l'implication des Emirats, leur poids réel reste limité. Ils achetaient l'or et la gomme du Soudan avant 2023, ils n'avaient pas besoin d'un conflit pour continuer à le faire. En revanche, comme lors de la guerre au Yémen, les Emirats cherchent à étendre leur influence sur les ports stratégiques de la mer rouge, une région clé pour le commerce mondial et les routes pétrolières et pour leurs ambitions maritimes. Abu Dhabi cherche également à renforcer sa position dans la Corne de l'Afrique et à contrer d'autres puissances régionales comme la Turquie ou l'Egypte qui soutiennent l'armée soudanaise.
Les Israéliens courtisés
Dans cette stratégie, comme pendant les dix ans de guerre au Yémen, ils bénéficient du soutien à minima tacite de leurs alliés occidentaux. Tout comme ils bénéficient de leur alliance avec Israël. Signataires des accords d'Abraham depuis 2020, ils entretiennent des liens économiques et stratégiques avec ce pays qui n'est jamais très loin lorsqu'il s'agit du Soudan, comme de tous les Etats qui ont accès à la mer rouge. Bien conscient de ces enjeux, le général Al-Burhan a envoyé un émissaire à Tel-Aviv dans la première semaine d'avril. Cette rencontre avait plusieurs objectifs : demander des livraisons d'armes en échange d'une normalisation avec Israël ; justifier la récente coopération soudano-iranienne ; demander une médiation avec les Emirats arabes unis et enfin obtenir le soutien des Etats-Unis. Cette réunion qui devait être secrète a néanmoins largement été médiatisée par la presse israélienne (2)[iv].
Dans cette équation où la normalisation avec Israël, comme les data center en France, financent l'hypocrisie des capitales occidentales et où les alliances stratégiques priment sur le droit international, l'impunité reste encore une monnaie d'échange diplomatique. Dans ce grand jeu où tout est permis, qui arrêtera les Emirats ? Hier la tragédie yéménite, aujourd'hui le drame soudanais et demain ?
Notes
I- Les Janjawid sont une milice soudanaise qui s'est illustrée par sa violence lors des guerres du Darfour à partir de 2003. Soutenues alors par le gouvernement soudanais elle a perpétré massacres, viols, pillages et déplacement forcés contre les populations non-arabes de la région.
II- https://adf-magazine.com/2024/11/uae-support-for-rsf-blamed-for-prolonging-war-in-sudan/
https://www.middleeastmonitor.com/20250304-the-uae-should-stop-its-violations-of-the-un-arms-embargo-in-darfur/
https://x.com/SudanTrends/status/1910716777094668378
https://www.middleeastmonitor.com/20250304-the-uae-should-stop-its-violations-of-the-un-arms-embargo-in-darfur/
https://adf-magazine.com/2024/11/uae-support-for-rsf-blamed-for-prolonging-war-in-sudan/
III- https://x.com/KevorkAlmassian/status/1911494598708379802
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-849304
https://www.radioj.fr/actualite-27417-l-envoye-du-dirigeant-soudanais-s-est-rendu-en-israel-pour-des-discussions-secretes
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les généraux de l’horreur : la Jep accuse des hauts gradés de l’armée colombienne pour le meurtre de 604 civils – les « faux positifs »

Parmi les victimes, on compte 31 Autochtones des peuples Wiwa, Wayúu et Kankuamo, 26 mineurs et 14 femmes, dont une était enceinte.
Par : Isabel Cortés
Dans une décision qui marque l'histoire, la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) de Colombie a porté des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité contre 28 militaires à la retraite, dont trois majors généraux et deux brigadiers généraux, pour leur rôle dans 604 assassinats extrajudiciaires, surnommés « faux positifs », sur la côte caraïbe entre 2002 et 2008. Ces décès, faussement présentés comme des pertes au combat, dévoilent un chapitre noir du conflit armé colombien, teinté d'une violence systématique contre des civils pour gonfler les résultats militaires. Ce jugement représente une avancée majeure vers la justice, mais pour les familles des victimes – incluant 31 Autochtones, 26 enfants et 14 femmes – la quête de vérité et de réparation reste une plaie vive.
Un système de tromperie et de mort
La Chambre de reconnaissance de la vérité de la JEP a analysé 796 décès rapportés comme des résultats opérationnels par 19 unités militaires sur la côte caraïbe de la Colombie, concluant que 604 – près de 76 % – étaient des exécutions illégales de civils. L'enquête a mis au jour un stratagème macabre : des commandants militaires, sous pression pour afficher des résultats dans leur lutte contre les groupes armés, ont orchestré des assassinats et des camouflages. Les victimes étaient attirées par de fausses promesses d'emploi, exécutées, puis présentées comme des guérilleros pour simuler des victoires opérationnelles.
Parmi les accusés, on retrouve les majors généraux à la retraite Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth et Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, qui ont dirigé des unités comme la Xᵉ Brigade blindée et le Bataillon d'artillerie n° 2 La Popa. S'ajoutent les brigadiers généraux à la retraite Fabricio Cabrera Ortiz et Adolfo León Hernández Martínez, sept colonels, dont William Hernán Peña Forero, ainsi que 16 officiers et sous-officiers. La JEP a établi que ces militaires ont soit propagé cette politique d'exécutions, soit participé directement à des crimes comme l'homicide, la disparition forcée et la torture.
L'enquête a révélé un système d'incitatifs tordu. Les commandants offraient des récompenses – promotions, congés ou argent – pour un grand nombre de « pertes » ennemies, tandis que ceux qui échouaient risquaient des sanctions ou le renvoi. Un message consigné sommait : « Un soldat qui ne produit pas de résultats, on l'élimine du système. » Cette pression s'est accentuée après la démobilisation paramilitaire de 2004, lorsque les unités militaires se sont tournées vers des civils pour maintenir leurs chiffres.
Un impact dévastateur sur les peuples autochtones
Le bilan humain est bouleversant. Parmi les 604 victimes, 31 étaient des Autochtones des peuples Wiwa, Wayúu et Kankuamo, dont les communautés ont subi des dommages disproportionnés. Les assassinats ont provoqué des déplacements forcés, une insécurité alimentaire et la fracture des liens culturels. Dans ces communautés, les femmes sont des piliers de la tradition, et leur perte – comme celle de Yajaira Cristina Nieves Oñate, une mère Wiwa enceinte tuée en 2006 – a frappé durement les générations futures.
Les enfants n'ont pas été épargnés. La JEP a recensé 26 cas, dont une adolescente Wiwa de 16 ans et deux frères de 13 et 15 ans, attirés par des promesses mensongères et exécutés. Ces actes violent le droit international humanitaire, qui exige la protection des mineurs. À ce jour, 122 victimes demeurent non identifiées, laissant leurs familles dans une attente déchirante. La JEP a réussi à identifier et remettre 14 corps, un pas modeste, mais significatif, vers la dignité.
Un système macrocriminel
La JEP a qualifié ces assassinats de partie intégrante d'un « modèle macrocriminel » reposant sur trois piliers : une pression implacable pour obtenir des résultats, des récompenses pour ceux qui s'y pliaient et un camouflage systématique. Les unités militaires collaboraient avec des recruteurs civils pour cibler des personnes vulnérables, comme des jeunes sans emploi ou en situation de pauvreté. Dans un cas marquant, 11 jeunes de Tolú Viejo, dans le département de Sucre, ont été dupés en 2007 avec des promesses de travail dans des fermes, pour ensuite être tués et déclarés comme insurgés par l'unité Gaula Córdoba.
Les camouflages étaient sophistiqués. Les scènes étaient truquées avec des armes placées sur les lieux, et les plaintes étaient balayées du revers de la main, qualifiées de « guerre juridique » menée par des groupes subversifs. Cela garantissait l'impunité, permettant aux exécutions de se propager dans sept départements : Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena et Sucre.
Ces constats s'inscrivent dans un contexte plus large du conflit colombien. Entre 2002 et 2008, sous la présidence d'Álvaro Uribe, la JEP estime qu'il y a eu 6 402 faux positifs à l'échelle nationale. Le cas de la côte caraïbe fait partie du dossier 03, qui enquête sur ces exécutions dans plusieurs régions. Jusqu'à maintenant, plus de 100 officiers ont été accusés, dont 92 ont reconnu leur responsabilité.
Et après ?
Les 28 accusés ont 30 jours pour accepter ou rejeter les accusations. S'ils reconnaissent leur responsabilité et livrent une vérité complète, ils pourraient écoper de sanctions restauratives, comme des travaux communautaires, après des audiences publiques avec les victimes. S'ils nient les faits, ils feront face à un procès qui pourrait mener à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Le processus met l'accent sur la vérité et la réparation, conformément au mandat de la JEP issu des accords de paix de 2016.
Les victimes, dont 4 271 sont reconnues dans le dossier 03, peuvent soumettre des observations. Leurs voix sont cruciales, car elles réclament non seulement la justice, mais aussi le retour des dépouilles de leurs proches. Pour les communautés autochtones, cela inclut le rétablissement des pratiques culturelles perturbées par les déplacements forcés.
Un appel mondial à la justice
Les faux positifs de la Colombie rappellent à quel point des politiques étatiques peuvent dégénérer en atrocités. Le travail de la JEP propose un modèle de justice transitionnelle, alliant reddition de comptes et quête de vérité. Mais les défis persistent : des victimes toujours non identifiées, des menaces pesant sur les survivants et ceux qui dénoncent, ainsi que des résistances politiques au processus de paix.
À l'échelle mondiale, ce cas trouve un écho dans les débats sur la responsabilité militaire, que ce soit en Ukraine ou au Myanmar. Il souligne l'urgence de mettre en place des mécanismes solides pour protéger les civils dans les conflits. Alors que la Colombie fait face à son passé, le monde doit amplifier la voix des victimes.
Source : Communiqué officiel de la JEP, 8 avril 2025.
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/jep-imputa-crimenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-28-miembros-retirados-del-ejercito-nacional-entre-ellos-tres-generales.aspx


Foire aux questions (FAQ) sur les « faux positifs » en Colombie.
1. C'est quoi, les « faux positifs » en Colombie ?
Les « faux positifs » sont des assassinats extrajudiciaires commis par des membres de l'armée colombienne, surtout entre 2002 et 2008, sous la présidence d'Álvaro Uribe Vélez. Dans ce système, des civils innocents étaient tués et présentés à tort comme des guérilleros ou des insurgés abattus au combat pour gonfler les résultats militaires et faire croire à des « succès » dans la lutte contre les groupes armés. Les victimes, souvent des gens vulnérables comme des jeunes sans emploi, étaient attirées par de fausses promesses de travail, exécutées, puis déguisées avec des uniformes ou des armes pour faire semblant qu'il y avait eu un affrontement.
2. Quelles sont les principales chiffres des « faux positifs » dans ce cas et à l'échelle nationale ?
À l'échelle nationale, sous le gouvernement d'Álvaro Uribe, la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) estime qu'il y a eu 6 402 « faux positifs ». Dans le dossier 03, qui couvre plusieurs régions, des accusations ont été portées contre plus de 100 officiers de l'armée colombienne, dont 92 ont plaidé coupable et assumé leur responsabilité. Ces chiffres montrent l'ampleur d'une « politique de sécurité » qui mettait les résultats militaires avant la vie et les droits des citoyens. Les Colombiens comptaient sur leur armée pour les protéger dans un contexte de conflit armé, mais au lieu de la sécurité, plusieurs communautés ont été trahies et frappées par la mort. C'est scandaleux et bouleversant de savoir que des soldats, en quête de médailles, de promotions et de reconnaissance dans leur carrière militaire, ont assassiné des innocents, transformant les forces armées en une menace pour les gens qu'elles devaient protéger. Ce cas-là met en lumière l'importance de surveiller l'usage du pouvoir militaire partout dans le monde.
3. Comment la Colombie s'y prend-elle pour réparer les torts causés aux victimes de ces crimes ?
La JEP, mise sur pied après les accords de paix de 2016, est à la tête des efforts pour garantir justice et réparation. Dans le cas de la côte caraïbe, 14 corps ont été identifiés et remis aux familles, une étape vers la dignité, même si 122 victimes restent toujours sans nom. Les victimes, incluant 4 271 personnes reconnues dans le dossier 03, peuvent prendre part au processus pour exiger la vérité, la justice et le retour des dépouilles de leurs proches. Pour les communautés autochtones, la réparation passe aussi par le rétablissement des pratiques culturelles bousculées par les déplacements forcés.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

République Dominicaine : Quand la peur dicte le retour des Haïtiens sans papiers

Dans les quartiers de Friusa et de Mata Mosquitos, à l'est de la République Dominicaine, un étrange silence s'est installé.
Là où, jusqu'à récemment, les rues vibraient de l'activité des travailleurs haïtiens, l'ambiance est désormais marquée par l'absence et l'angoisse. En l'espace de 48 heures, plus de 600 ressortissants haïtiens en situation irrégulière ont quitté volontairement le territoire, poussés par la montée en puissance des opérations migratoires menées par la Direction Générale des Migrations, épaulée par les Forces Armées dominicaines.
Officiellement, il s'agit de départs « volontaires ». Mais dans les témoignages recueillis, le terme prête à débat. « On n'a pas été frappés, mais on nous a dit que si on ne partait pas maintenant, ce serait pire », confie un jeune ouvrier de la construction croisé à la frontière de Dajabón. La peur d'être arrêté, enfermé, voire renvoyé de force, pousse beaucoup à devancer l'appel. D'autres fuient simplement pour préserver ce qui leur reste de dignité.
Ces opérations massives s'inscrivent dans une dynamique plus large : une politique migratoire de plus en plus stricte prônée par les autorités dominicaines, dans un contexte électoral tendu et de crispations identitaires croissantes. Le président Luis Abinader a fait de la régulation de l'immigration un pilier de son programme. Mais à quel prix humain ?
Du côté haïtien, ces retours précipités mettent sous tension des villes frontalières déjà débordées, sans aucun mécanisme d'accueil structuré. Aucun soutien, aucune coordination entre les deux États pour encadrer ces flux. Les autorités haïtiennes, embourbées dans leurs propres crises, restent spectatrices de cette tragédie silencieuse.
À Friusa, certains locaux dominicains se disent soulagés. Mais d'autres s'inquiètent : « Ce sont eux qui faisaient tourner nos chantiers et nos hôtels. On ne sait pas comment on va faire », murmure un entrepreneur. Le départ des Haïtiens, au-delà du choc humain, pourrait bien avoir des répercussions économiques imprévues pour la République voisine.
Entre politique migratoire, enjeux de sécurité et humanité bafouée, ce « retour » massif des Haïtiens sans papiers est le symptôme d'une fracture profonde que seule une coopération binationale sérieuse pourra commencer à réparer.
Smith PRINVIL
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La gauche en ordre dispersé

Les pays d'Amérique du Sud sont frappés de manière inégale par la hausse des taxes imposée par les États-Unis et doivent en outre gérer les expulsions de migrants ordonnées par l'administration. Désunis, les dirigeants agissent de façon isolée tout en évitant la confrontation avec Donald Trump. Désunis, les dirigeants agissent de façon isolée tout en évitant la confrontation avec Donald Trump.
10 avril 2025 | tiré de Politis
https://www.politis.fr/articles/2025/04/monde-en-amerique-latine-face-a-trump-droits-de-douane-gauche-ordre-disperse/
Expulsions massives de migrants et tarifs douaniers inédits depuis des décennies sur les exportations des pays latino-américains : telles sont les principales menaces brandies par Donald Trump contre l'Amérique centrale et du Sud. Des promesses qui se concrétisent aux cent premiers jours à la Maison Blanche, à un rythme effréné. Le retour au pouvoir de Trump coïncide avec la présence de gouverne- ments progressistes dans plusieurs pays clés de la région. Pourtant, leur réponse demeure loin d'être unanime, et la coordination entre les pays menacés ne dépasse pas les déclarations de protestation.
Lors de son discours d'investiture, le nouveau président avait annoncé une vague d'expulsions de migrants en situation irrégulière, majoritaire- ment latino-américains. « C'est une exacerba- tion des politiques traditionnelles des États-Unis. La sécurité et l'immigration ont toujours été une obsession des derniers gouvernements, analyse Anna Ayuso, chercheuse au Barcelona Centre for International Affairs (Cidob). Joe Biden menait une politique tout aussi dure en matière migra- toire. » Durant sa dernière année au pouvoir, l'administration Biden a expulsé, en moyenne, 57 000 personnes par mois, soit 35 % de plus que les déportations ordonnées par Trump lors de son premier mois à la présidence.
La véritable nouveauté réside dans la guerre commerciale lancée par le président milliardaire contre le monde entier, y compris l'Amérique latine. Après les tarifs douaniers imposés aux exportations provenant du Mexique – pourtant lié aux États-Unis et au Canada par un accord de libre-échange –, une nouvelle vague de mesures a été annoncée le 2 avril. Des droits de douane de 10 % ont été instaurés pour la plupart des pays de la région, à laquelle la nouvelle admi - nistration états-unienne porte une attention accrue comparée à ses prédécesseurs. « Pour sa première visite officielle, le secrétaire d'État Marco Rubio est allé au Panama, au Costa Rica, en République dominicaine et au Salvador, ce qui était une première, souligne Anna Ayuso. Hormis le Mexique, la région était reléguée au second plan de la politique étrangère américaine ces dernières années. Désormais, on observe un intérêt spécifique… mais en mal. »
Pour Luciana Cadahia, professeure de philo - sophie à l'Université nationale de Córdoba, en Argentine, il faut distinguer politiques migra - toires et commerciales. « Les premières ont une teinte strictement idéologique et visent son électorat. Trump sait que ses soutiens sont majoritairement des Blancs de classe moyenne et populaire, imprégnés d'une logique supré - maciste. Montrer qu'on expulse des Latinos renforce cet esprit. » À l'inverse, « les mesures commerciales n'ont pas d'origine idéologique et ne ciblent pas spécifiquement les gouver- nements progressistes : Donald Trump les applique sans distinction politique. » De fait, la hausse générale de 10 % a été imposée à toute la région, sauf au Mexique (avec qui Trump est en train de négocier de manière bilatérale), à Cuba (déjà sous embargo), ainsi qu'au Venezuela et au Nicaragua, frappés par des taxes encore plus élevées. Aucune excep- tion n'a été faite pour les alliés, comme l'Argen - tine, en dépit du fait que son président, Javier Milei, adopte une position de « subordination » à Trump, explique Luciana Cadahia.
Outre les expulsions de migrants et la hausse des tarifs, Anna Ayuso anticipe un impact majeur du retrait de USAID, surtout en Amérique centrale et aux Caraïbes. En 2023, l'agence de coopération internationale a distribué plus de 1,7 milliard de dollars dans la région, les princi- paux bénéficiaires étant la Colombie, Haïti et le Venezuela. De son côté, Luciana Cadahia consi- dère que « l'interruption des aides de l'USAID joue paradoxalement en faveur de l'Amérique latine, car l'USAID a créé la logique des ONG, décapitalisant les états et promouvant l'idéolo- gie du libre marché plutôt que des États forts et démocratiques qui bénéficient aux peuples ».
/ Des critiques mais pas de mesures concrètes
« Chacun agit de son côté », résume Anna Ayuso à propos de la réaction des gouvernements pro- gressistes latino-américains face à Trump. « Leur point commun est qu'ils évitent la confronta- tion directe et cherchent à prévenir une guerre commerciale », explique celle qui est aussi doc- teure en droit international. L'exemple le plus frappant est celui de la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. La cheffe d'État a accepté de déployer 10 000 soldats à la frontière pour bloquer les migrants, en échange d'une suspen- sion des menaces de hausse des taxes doua- nières brandies par Trump. « Plus de 70 % du commerce mexicain dépend des États-Unis : ils sont obligés de négocier. » Pour la chercheuse, le fait que Trump ait exclu le Mexique de la nou- velle vague de tarifs prouve que « la stratégie d'apaisement a marché, le lobby des industries états-uniennes étant plus affecté par les droits de douane avec le Mexique et le risque d'une récession aux États-Unis » si un mur d'impôts commerciaux était érigé entre la grande puis- sance et son voisin du Sud.
Le seul à avoir ouvertement, et brièvement, défié le chef d'État états-unien est Gustavo Petro. Le 26 janvier, le président colombien a interdit l'atterrissage d'un avion transpor- tant des migrants expulsés et menottés. « Sa réponse a été forte, mais chaotique », commente Alejandro Mantilla, professeur de sciences poli- tiques à l'Université nationale de Colombie. « À 3 heures du matin, Gustavo Petro a décidé d'in- terdire l'atterrissage. » S'est ensuivi un échange d'attaques verbales entre les deux dirigeants, puis la menace américaine d'imposer un tarif de 25 % sur les produits colombiens. Bogotá a finalement accepté de payer les vols à condi - tion que les expulsés ne soient plus menottés. Une sortie de crise présentée comme une vic- toire par les deux camps. En mars, la secré- taire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a signé avec Gustavo Petro un accord sur l'échange de données biométriques, destiné à renforcer le contrôle migratoire. « Une trêve temporaire », selon Alejandro Mantilla.
Les présidents chilien et brésilien ont aussi critiqué Donald Trump. « Nous devons être pré- parés, mais nous n'allons pas nous prosterner ni supplier les États-Unis pour qu'ils renoncent », a déclaré Gabriel Boric à propos des possibles taxes sur le cuivre, principale exportation du pays andin vers les États-Unis. De son côté, Lula da Silva a dénoncé le « traitement dégradant » des migrants brésiliens expulsés. Dans le même temps, le Congrès brésilien a adopté une loi don- nant au gouvernement des outils pour contrer les barrières commerciales états-uniennes.
Pourtant, ces actions n'ont pas été, pour l'ins- tant, suivies de mesures concrètes. « Les dirigeants évitent l'affrontement direct et jouent la carte multilatérale, notamment le Brésil avec les Brics », explique Anna Ayuso. Le Brésil et le Chili ont annoncé des recours à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les droits douaniers de Trump, à l'instar de la Chine, mais leur efficacité reste limitée : « L'OMC est paralysée, et ces procédures prennent des années. »
/ Une intégration régionale affaiblie
Au début des années 2000, plusieurs pays latino-américains gouvernés par la gauche avaient renforcé leur intégration pour résister aux États-Unis. « L'acte fondateur fut le rejet de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) en 2005, à Mar del Plata, voulue par George W. Bush. Cela a lancé un mouvement souverainiste opposé aux politiques américaines », rappelle la chercheuse argentine Luciana Cadahia. Une unité dans laquelle le président vénézuélien Hugo Chávez a joué un rôle central.
« Le Venezuela a beaucoup œuvré pour l'inté- gration mais, aujourd'hui, il est un frein », estime Anna Ayuso, les progressistes étant divisés sur la situation du pays. « Lula a parié sur des élec- tions pour réintégrer le Venezuela dans la région, mais cela n'a pas marché », tandis que Gabriel Boric s'est toujours frontalement opposé à Nicolás Maduro. Alejandro Mantilla abonde : « En théorie, Trump pourrait provoquer une unifica- tion tactique des progressismes, mais leurs divi- sions internes l'empêchent. »
Après son clash avec Trump, le président colombien et la présidente hondurienne, Xiomara Castro, ont tenté d'organiser une réunion de la Communauté d'États latino- américains et des Caraïbes (Celac) pour préparer une réponse commune. Mais des gou - vernements conservateurs alignés sur la poli- tique de Trump ont bloqué l'initiative. D'autres organisations régionales, comme l'Unasur et le Mercosur, sont aussi affaiblies. « L'Unasur a explosé. Lula a tenté de la relancer, mais le cas vénézuélien bloque tout. Quant au Mercosur, l'Argentine et le Brésil y sont désormais peu compatibles », explique Anna Ayuso.
L'imprévisibilité de la Maison Blanche com - plique encore plus la coordination. « Il fau- dra attendre le Sommet des Amériques en République dominicaine fin 2025 pour voir où va Trump et si des positions communes émergent », estime la docteure en droit public international à l'Université autonome de Barcelone. Pour l'heure, le Républicain fait face à une mosaïque de gouvernements divisés, qui tentent de protéger leurs économies et leurs migrants des effets du virage protectionniste et xénophobe américain.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Paradis - Enfer ou Le trou noir de l’économie souterraine

L'évasion fiscale et l'évitement fiscal des jumeaux non identiques qui ne partagent pas la même couche, mais proviennent de la même souche. Ils occupent des demeures semblables situées dans les mêmes paradis, pensent de la même manière et stockent leur pactole sous les mêmes palmiers.
Ils adorent le silence, ne se pointent pas au guichet automatique et n'ont jamais rien à déclarer lorsqu'ils franchissent les barrières des douanes sociétales. Ils sont sans frontières ni États et sont donc partout et nulle part à la fois … Et leur paradis est notre enfer.
Un désastre annoncé
L'ONG britannique Tax Justice Network (TJN)révélait dans une étude publiée en novembre 2024 que le coût combiné des abus fiscaux transfrontaliers commis par des multinationales et des particuliers possédant des avoirs non déclarés à l'étranger estimés à 492 milliards de dollars américains. Soit 347,6 milliards perdus en raison de l'abus transfrontalier de l'impôt sur les sociétés par les multinationales et 144,8 milliards perdus en raison de l'évasion fiscale des personnes fortunées. On estime que le Canada a jusqu'à 30 milliards par année en impôts perdus ! Le Canada figure au rang du cinquième plus grand contributeur au problème mondial des paradis fiscaux et du secret financier. Eh oui ! Selon une formule née du franglais torturé de Jean Chrétien, ancien Premier ministre : « Le Canada est le plus meilleur pays du monde ».
L'État des lieux : une fourmilière de déliquescents délinquants
Toujours selon la même étude, certains pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui établissent pourtant les règles, sont eux-mêmes responsables de la majorité́ des pertes fiscales mondiales sur les sociétés. On les surnomme « les Huit nuisibles » – L'Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis d'Amérique, l'Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni – car ils tentent d'empêcher le monde entier de convenir, au sein des Nations-Unies, de règles fiscales susceptibles de mettre un terme aux abus fiscaux à l'échelle mondiale. Ce petit groupe qui représente à peine 8 % de la population mondiale est pourtant responsable des pertes fiscales infligées à d'autres pays pour une valeur de 212 milliards de dollars par an … Quelle arnaque et quelle gang d'affreux tricheurs et prédateurs.
Braquage légal ? – Immoral et tragique !
Voici des extraits éloquents et révoltants concernant ces détournements de capitaux planétaires tirés de l'édition Justice fiscale : État des lieux en 2024. « Parmi les pays de l'OCDE, les plus mauvais élèves sont encore une fois le Royaume-Uni et son réseau de territoires d'outre-mer et de dépendances de la Couronne, souvent appelés le deuxième empire du Royaume-Uni (surnommé aussi toile d'araignée britannique), et l'axe plus large de l'évasion fiscale, qui comprend le deuxième empire du Royaume-Uni ainsi que les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. … le deuxième empire du Royaume-Uni est responsable d'environ un tiers des 145 milliards d'impôts que le monde perd chaque année à cause de l'évasion fiscale des fortunes offshores, ce qui coûte au monde plus de 48.3 milliards d'impôts perdus. L'axe de l'évasion fiscale est responsable de plus de 43 % des 145 milliards de dollars américains que le monde perd chaque année à cause de l'évasion fiscale du patrimoine offshore, ce qui coûte au monde 62.7 milliards en impôts perdus ».
Sous l'impulsion de la mondialisation à partir des années 1980, l'ouverture des marchés de capitaux, la déréglementation des échanges et la présence accrue des multinationales dans l'économie ainsi que le développement du numérique ont favorisé le développement des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale.
Ainsi, bon nombre d'entre nous réalisons que ce titanesque et ténébreux piratage de fonds fonctionne, perdure et même se raffine grâce à la cupidité des personnes et des entreprises, le concours d'institutions, de banques et la servilité d'États riches. Comment ? Grâce à l'opacité des structures, l'inventivité des stratagèmes utilisés, le camouflage derrière des organigrammes complexes de sociétés-écrans ainsi qu'à l'aide de réglementations complaisantes mises en place par leurs laquais de dirigeants et cautionné par la soumission, voire l'abdication latente des populations pourtant directement concernées. Évidemment, tout cela est rendu possible avec la complicité de paradis fiscaux et bien aux vues dans de florissants chapelets de cathédrales flottantes mondiales du capitalisme financier et au double standard adopté par des banques dans ces manèges dont, entre autres, Goldman Sachs, UBS et Crédit Suisse. – Précisons que la banque d'investissement Goldman Sachs faisait partie des trois principales banques américaines responsables de la crise des Subprimes en 2007-2008. Cette crise fomentée, appréhendée de longue date et dissimulée par ces mêmes institutions financières, d'ailleurs mal encadrées par les organismes de régulation des marchés, a tragiquement appauvri et scandaleusement endetté et brisé la vie de millions de familles non seulement aux États-Unis, mais également ailleurs dans le monde –. Oui ! Bravissimo à ces troupeaux de salauds coupables de ce gâchis, demeurés en liberté et toujours confortablement juchés dans leur cache d'acier et de verre et s'offrant du bon temps avec le cash du monde « à l'abri » dans leurs portefeuilles à malice.
Splendeur et décadence ou Le triomphe de la provocation
Si tout au moins les indigestes extraterritoriens de l'opulence gaspillaient leur (le nôtre) fric à bouffer frénétiquement leurs milliards de « BigMacaviars » – Ça va prendre combien d'éternités ? – bien fourrés aux volatiles indices boursiers, saupoudrés aux humeurs factices des boursicoteurs et copieusement nappés à la sauce de la croissance sans fin. Et, si cette amoncellement souvent gargantuesque de richesses n'avait aucune incidence, nous contemplerions alors peut-être – Tout en se maintenant à bonne distance. – l'explosion de cette obésité financière morbide et fétide. Hélas, c'est rarement le cas. Au contraire. Au final, l'existence de ces paradis fiscaux fragilise et menace la survie des États démocratiques en portant atteinte directe à leur souveraineté politique, mais dépossède en plus les pays de manière abjecte et calculée. Leurs actions délétères engendrent de faux déficits et créent un abyssal « trou noir » dans l'économie mondiale ainsi que de lourdes pertes en revenus fiscaux dues aux faramineux gains accumulés par ces meutes de chacals dont on dresse tous les ans un palmarès avec une certaine ostentation … Quelle honte ! L'existence et la publication d'un tel palmarès, entre autres celui du magazine Forbes, ne constitue pas uniquement en soi un terrible scandale. En vérité, il illustre davantage une arrogante et altière provocation qui établit en parfaite symbiotique la démonstration d'une distorsion inique du capitalisme financier actuel et du démantèlement des fondements de la société et de l'effritement de ses valeurs universelles.
Évasion fiscale et l'évitement fiscal – Duplicité et pauvreté endémique
Ce psychodrame économico-socialo-mondialisé monté de toutes pièces contraint les États à emprunter leur propre argent à fort taux entraînant des déficits ainsi que d'injustes privations et de dures souffrances pour les populations dont les services publics sont alors morcelés et les mailles des filets sociaux transpercées. En définitive, nous nous retrouvons face à des détournements colossaux de richesses qui briment la destinée de millions de personnes. Selon la Banque mondiale en 2024, près de 700 millions de personnes, soit 8,5% de la population mondiale, vivent aujourd'hui avec moins de 2,15 $ par jour. – Chez nous, une baguette de pain vaut 2,99 $ et un Big Mac 5,64 $ –. Selon le même rapport, 44 % de la population mondiale vit avec moins de 6,85 $ par jour, ce qui est considéré comme le seuil de pauvreté dans les pays émergents. Selon un rapport des Nations-Unies, environ 10 % de la population mondiale vit dans des conditions d'extrême pauvreté et se bat pour satisfaire des besoins élémentaires tels la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à un système sanitaire. Actuellement, le 1 % des personnes les plus riches captent plus de richesse que 95 % de la population. Quant au Québec, soulignons que des milliers de ménages vivent uniquement d'une paie à l'autre. Que les ménages s'appauvrissent de plus en plus, les banques alimentaires ont constamment faim et viennent en aide 872, 000 personnes et sans compter que lors des dix dernières années le prix de l'immobilier résidentiel a augmenté deux fois plus rapidement que le revenu des ménages. Présentement, le salaire des PDG est 226 fois plus grand que celui du travailleur moyen selon une analyse de l'Observatoire québécois des inégalités. – Il y a vraiment de quoi s'indigner. –
Le pouvoir – Nouveau paradis des offshoriens et des oligarques
Face à tant de richesses dormantes qui profitent exclusivement à une coterie d'ultra-riches et qui par surcroit ne viennent en aide à personne avec leur fortune, mais qui au contraire les appauvrissent davantage, il apparaît une autre dramatique et inique réalité que l'on pourrait qualifier selon l'expression de Frantz Fanon de : « Les Damnés de la terre ». Une récente déclaration d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, illustre fort bien cela, à savoir que : « Quelque 3,3 milliards de personnes, soit près de la moitié de l'humanité vivent dans des pays qui dépensent plus « au paiement des intérêts » de leur dette que pour l'éducation et la santé. » Et pour ajouter l'insulte à l'injure et faire plaisir à ces pseudo-élites financières, des décrets sont promulgués, des législations votées, incluant des pénalités et imposant le commun des mortels au détriment des corporations et des multinationales. Et ces dernières n'en continuent pas moins de bénéficier légalement et à profusion d'alléchantes assiettes fiscales garnies de bonbons confits aux contributions du peuple et jouissant d'un lucratif assortiment de subventions et d'avantages financiers, le tout soigneusement enrobés d'allégements fiscaux et s'amusant à surfer sur les humeurs fluctuantes des marchés et profiter de la saveur boursière aseptisée du jour. En vérité, même si ces personnes et ces corporations tentent de se dédouaner en invoquant la « légalité » de l'évitement fiscal – Une légalité souvent contraire à « l'esprit de la loi. » – plutôt que l'évasion fiscale. À l'épreuve de la vérité, il n'en demeure pas moins que les procédés employés permettent à tous d'eux d'éviter le paiement d'impôts et de dissimuler des patrimoines et que pour y parvenir ils utilisent des canaux analogues à ceux de l'évasion fiscale et trouvent refuge dans les mêmes paradis.
En définitive, quel admirable exercice de sémantique et formidable éthique « élastomère » ! Les nantis de ce monde sont résolument parvenus à élaborer des écrans de fumée « blanchie » aux vertus presque analgésiques cuirassant l'acceptabilité sociale et teintés d'une prospérité à peine voilée solidement amalgamée à une irrévocable fatalité. Après la mondialisation et ses avatars polymorphes de surabondance vient de s'installer une administration étatsunienne déjantée et voyou, abonnée à la brutalité et au chantage et grassement commanditée aux sesterces numériques et cautionnée par l'obédience des oligarques des GAFAM. Ces oligarques allergiques aux valeurs universelles telles l'empathie, la compassion et la justice sont brusquement en train d'ouvrir les vannes à un courant protectionniste et isolationniste. Ils se complaisent et s'auto-congratulent en démantelant cavalièrement les socles de l'État de droit et buldozant les relations internationales. Nous replongeant alors bien malgré nous et de manière violente à l'époque des miséreux vassaux à la merci des lubies de leurs opulents et intransigeants Seigneurs. Ces autocrates pour qui la terre entière est redevenu leurs châteauforts protégés par des ponts-levis infranchissables qu'ils défendront avec acrimonie et exploiteront comme bon leur semble, et jusqu'à la fin … S'il le faut ! Cela explique d'ailleurs la raison pour laquelle ils affichent « une tête intelligente artificielle » nourrie aux algorithmes cryptés de la misère et confortablement engoncée dans la crasse doctrinale de certains groupes et l'évanescence mensongère de réseaux sociaux et l'opacité des nuages lucratifs. Car ils demandent à la Lune toujours plus de richesses et qu'ils possèdent depuis le temps des crocs financiers bien affutés. Ainsi, avec leurs yeux de chacals plus gros que la panse, ils pensent et salivent au juteux sol au coulis de minéraux rares de la planète rouge ainsi qu'ils fantasment aux nouveaux habits verts griffés d'Hugo Boss avec lesquels ils se pavaneront fièrement dans leurs gigantesques casemates dorées marquées d'un « X » et solidement implantées et fortifiées dans les Gate City interstellaires de la planète Mars … Un petit pas pour les pauvres, un grand pas pour les riches ! Voilà le New Deal de Citizen Trump alias l'éternel cruel Joker obnubilé par ses tarifs et son claironnant et ostentatoire MASGA : « MAke Stupidity Great Again »
Un modus operandi venu du haut du pavé
À titre d'exemple, l'ancien ministre des Finances et Premier ministre du Canada,Paul Martin, dont l'entreprise Canada Steamship Lines était enregistrée à l'époque à la Barbade, les Paradise Papers nous ont révélé, en 2017, qu'une demi-douzaine de ses filiales enregistrées là-bas avaient été transférées aux Bermudes, en 2012 et 2013, où « le taux d'imposition est nul ».– Dire que ce personnage public aura tout de même siégé, sans difficulté et sans ressentir le moindre embarras, à titre « d'Honorable » au Parlement canadien à la fois comme ministre des Finances et Premier ministre pendant 13 longues années …– Voici un autre exemple éloquent et plus récent celui-là. L'éventuel Premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a voulu s'évader de l'évasion fiscale en sachant pertinemment en tant qu'ancien banquier comment l'éviter, a dans ses fonctions de président du conseil d'administration enregistré deux fonds d'investissement dans un paradis fiscal lorsqu'il officiait chez Brookfield Asset Management (BAM) qui gère un portefeuille global de 510,6 milliards de dollars, l'équivalent du quart du PIB du Canada. Il a tenté de se justifier en affirmant : « … qu'il souhaitait maximiser les rendements des investisseurs en enregistrant les fonds évalués en tout à 25 milliards de dollars US aux Bermudes », à l'évidence un paradis fiscal reconnu. Il également enregistré un fonds d'investissement de 5 milliards aux Îles Caïmans. – Merci de ne pas applaudir. –
Ô surprise ! On retrouve parmi ces investisseurs la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ainsi que le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario. Ô autre surprise ! Tout d'abord, Brookfield n'a payé aucun d'impôt depuis trois ans et pendant cette même période l'entreprise enregistrait des profits nets cumulés de plus d'un milliard de dollars américains et que pas moins 14 de ses entreprises apparaissaient, en 2021, dans les Pandoras Papersdu Consortium international des journalistes d'investigation. En contrepartie, selon une étude de l'Institut Fraser réalisée en 2024, une famille canadienne au revenu moyen accordait une plus grande partie de son revenu aux impôts (taxes de vente, taxes foncières et les impôts payés au fédéral, provincial et municipal), environ 43 %, qu'au logement ainsi qu'à l'achat de nourriture et de vêtements évalués à 36 %. Voilà une illustration manifeste d'une forme d'injustice sociale et fiscale.
Ô, autres surprises pénibles ! Brookfield Asset Management et son associé Ballast Investments sont les plus gros propriétaires de logements de San Francisco et le Comité du droit au logement de San Francisco y recense des pratiques associées à la « rénoviction » telles des hauses de loyer abusives, des pertes de services, du mauvais entretien, des travaux non terminés et l'usage d'intimidation et de harcèlement etc. – Notons au passage que ce type d'alliance de grands propriétaires fonciers et de fonds d'investissement contribue directement au fléau de la « financiarisation » du logement et de la spéculation malheureusement en progression dans les grands centres urbains et aux conséquences désastreuses pour les populations résidentes. – Brookfield est également tenu responsable d'avoir rasé 9000 hectares de savane brésilienne, soit deux fois et demie la superficie de Montréal, pour y planter du soja entre 2012 et 2021. Il faut savoir qu'entre 1968 et 2017, la production mondiale du soja a crû de 751 %. Bravo pour la sauvegarde de la forêt amazonienne … Ce poumon de la planète produit 20 % de l'oxygène que nous respirons. – Les sauvegardes ne se sont plus réalisées à l'aide d'un disque dur, elles sont plutôt évaporées dans les nuages à l'image des actions discutables et condamnables ! – « Est-il normal que je paie moins d'impôts que ma secrétaire ? » Warren Buffet
Les Panama Papers : Le Canada, opiniâtre et talentueux cancre de la classe
Le quotidienLa Presse nous apprenait, dans la foulée des Panama Papers, que près de 2 milliards de dollars avaient été récupérés dans le monde. Il s'agissait en fait de la fuite de 11,5 millions de documents édités entre 1977 et 2015 par la firme panaméenne Mossack Fonseca. Et depuis tout ce temps, l'Agence de revenu du Canada n'a réussi à réclamer qu'un maigre 83 millions de dollars. Quant à Revenu Québec, ses contrôles fiscaux ont permis des réclamations à la hauteur de 41 millions de dollars. Une bien piètre performance que la nôtre comparée à d'autres pays comme le Royaume-Uni avec 360 millions de dollars, la Suède avec 338 millions de dollars. Comme le déclarait si bien Jonathan Farrar, professeur de fiscalité à l'Université de Waterloo : « C'est un peu lamentable ». Cela revient à envoyer le message selon lequel les contribuables fortunés peuvent tricher sans courir de grands risques. « Et même s'ils se font prendre, ils pourront s'en sortir », estime-t-il. Quant aux États-Unis eux, ils n'ont à ce jour jamais fourni de chiffres concernant le résultat de leurs enquêtes fiscales. Et ça, c'est encore plus déplorable, pour ne pas dire inquiétant … À se demander qui protège qui et pourquoi ? Et, avons-nous vraiment l'intention de mettre un terme à cette outrageante coexistence de deux classes citoyennes.
Que la Fête continue ! ou Que l'on mette fin à la mascarade ?
Ainsi, c'est donc avec la raison à off qu'hélas nous contribuons au maintien et à la croissance de ce double standard totalement injustifié, protégée et toléré de cette économie au noir. En définitive, nous nous trouvons à financer à même nos maigres économies et nos lourds impôts et taxes, l'acquisition de ce Colt 45 – Approuvé par la National Rifle Association (NRA). – qu'ils nous braquent au corps et prennent évidemment soin de dissimuler sous le secret bancaire, cet obscur voile corporatif. Ce fameux voile qui constitue dorénavant la nouvelle forme d'hidjab légalement porté par les libertariens ! Et dire que ces pillards s'insurgent contre la libre pensée. Qui elle, se réclame pourtant de la raison et de la science, du bien commun et si nécessaire de la désobéissance civile, contrairement à leur version empoisonnée qui entraîne des perturbations sans précédent, le pillage éhonté du monde et le torpillage à grande échelle des échos-systèmes de la planète.
Toutefois, la bataille n'est pas perdue afin de mettre un terme à ce fléau. Chez-nous, depuis plus de vingt ans, Attac Québec a livré de nombreuses batailles pour la justice fiscale et sociale par ses activités d'éducation et de mobilisation. Attac a toujours porté l'idée de taxer les transactions financières pour contrer la spéculation, aider les citoyennes et les citoyens et financer les biens et les services publics. Car, pour Attac : « Il n'y a pas de justice sociale sans justice fiscale et qu'il faut mettre fin aux paradis fiscaux, … et faire en sorte que les individus comme les entreprises paient leur juste part d'impôt ».
Selon l'organisme Tax Justice Network (TJN), une solution globale pointe enfin à l'horizon et je cite : « Le monde est à l'aube d'une réforme fondamentale de la gouvernance fiscale internationale. Une convention fiscale ambitieuse des Nations Unies, qui sera adoptée d'ici 2027, aura de profondes répercussions sur la capacité des populations du monde entier à profiter des avantages d'États efficaces, en utilisant le superpouvoir social offert par une politique fiscale progressiste pour réaliser des progrès inclusifs en matière de bien-être humain. Dans le même temps, la convention fiscale des Nations Unies pourrait marquer un changement profond dans les inégalités de pouvoir entre les pays, en mettant fin à la capacité de quelques-uns d'empêcher l'imposition effective de leurs acteurs économiques dans d'autres pays ». En espérant que « les huit nuisibles » cessent de bloquer cette réforme sans précédent. Et d'ici-là, il ne tiendra alors plus qu'à nous d'exercer des pressions, tout au moins sur le Canada, afin qu'il adhère entièrement à cette Convention fiscale des Nations-Unies. Puis, qu'il la défende avec force et conviction sur diverses tribunes et la fasse respectée ici afin de mettre fin à cette mascarade planétaire qui sème le chaos dans les esprits et exacerbe les inégalités sociales en creusant un fossé de plus en plus abyssal entre riches et pauvres Car cette économie souterraine avec ses tentaculaires détournements de capitaux, déstabilise l'économie mondiale, fragilise les fondements des États, gangrènent le destin des populations et entravent la marche des Nations.
« Que l'État se contente d'être juste, nous nous chargeons d'être heureux. » Benjamin Constant
Gaétan Roberge
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Rutte : armement contre sécurité sociale

Mark Rutte, le flamboyant secrétaire général de l'OTAN [depuis le 1er octobre 2024, premier ministre des Pays-Bas d'octobre 2010 à juillet 2024], a déclaré lors d'une conférence de presse, dans les derniers jours de l'année dernière, que « lorsque vous regardez ce que les pays dépensent pour les retraites, la sécurité sociale et la santé, nous avons besoin d'une fraction de cela pour garantir que les dépenses de défense atteignent un niveau qui nous permette de maintenir à long terme notre dissuasion ». Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de relire cette phrase pour en reconnaître la clarté. Pour les dirigeants de l'OTAN, ce n'est pas une question de discrétion, c'est une question de franc-parler : ils nous disent qu'il faut vraiment réduire les dépenses de retraite ou de santé pour financer les armements.
7 avril 2025 | tiré du site alencontre.org
https://alencontre.org/europe/rutte-armement-contre-securite-sociale.html
Trois mois plus tard, et réalisant que Trump s'affirme comme le plus grand danger pour l'Europe, ce discours est devenu plus confus, mais aussi plus insistant sur la nécessité de changer la stratégie d'investissement de l'Europe. En un mot, ces dirigeants veulent que ce qui est nécessaire pour l'armement soit prélevé sur la sécurité sociale ou les retraites. Fini le temps où l'Union européenne annonçait des plans verts ou des investissements massifs dans la « transition énergétique », le nouveau vert est devenu marron ou noir.
La Commission est ainsi passée d'un discours environnementaliste à un discours guerrier, et il y a même des dirigeants qui prévoient une guerre dans trois ans. Une fois de plus, le champion de la démesure, Rutte, nous a carrément sommés d'apprendre le russe, la langue des nouveaux maîtres qui nous guettent à nos frontières, si nous n'acceptions pas ce dévoiement de ressources pour financer la guerre.
Le problème, c'est que les données ne collent pas. Les pays de l'Union européenne dépensent chaque année trois fois plus que la Russie en armement. En d'autres termes, chaque année, l'écart entre leur capacité militaire et celle des forces armées russes se creuse ; et elles se sont montrées inopérantes face à un adversaire faible comme l'Ukraine. L'Europe dispose d'une supériorité militaire gigantesque sur la Russie (et, soit dit en passant, dépense plus en dépenses militaires que la Chine). (3 avril 2025, traduction rédaction A l'Encontre)
Francisco Louça est professeur d'économie à l'Université de Lisbonne. Un des animateurs du Bloco de Esquerda. Se présente à Braga à l'occasion des législatives de mai 2025, entre autres pour mener le combat contre l'extrême droite. Cette brève intervention fait partie d'un podcast hebdomadaire sur le site du quotidien Publico, conjointement au journaliste Fernando Alvez et à la poétesse Rita Taborda Duarte.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un nouveau souffle pour le média de l’écologie

Ce lundi 14 avril, Hervé Kempf, fondateur du média Reporterre, passe la main. Amélie Mougey prend sa suite et devient directrice de la rédaction. Ce même jour, Reporterre publie son rapport d'activité et affiche une très bonne santé.
Tiré de Reporterre. Légende de la photo : Hervé Kempf et Amélie Mougey à Paris le 21 mars 2025. Photo Mathieu Génon / Reporterre.
Dans la déjà longue vie de Reporterre, un chapitre s'ouvre, et va faire des étincelles : après douze ans à la tête du média, Hervé Kempf passe la main à Amélie Mougey, qui sera la nouvelle directrice de la rédaction.
Ce passage de relais se fait dans les meilleures conditions. Comme en témoigne notre rapport d'activité publié ce jour, Reporterre se porte bien. Grâce à l'engagement de près de 46 000 donatrices et donateurs — ce média est le leur —, une équipe de 29 personnes salariées, dont 24 journalistes (4 embauches depuis début 2025), assure tous les jours un suivi affûté de l'actualité écologique. Sa mission : porter sans relâche ces sujets dans le débat public.
Notre modèle, basé à 97 % sur le don, est unique en France et il est le garant de notre indépendance : Reporterre est un média sans publicité, sans actionnaire, en accès libre pour que l'information soit à la portée de toutes et tous. Chaque mois, ce sont plus de 2 millions de visiteurs uniques qui viennent lire nos enquêtes, reportages, entretiens, tandis que des centaines de milliers de personnes regardent nos vidéos et reçoivent nos lettres d'info, s'informant ainsi sur la santé de la planète… et de l'humanité.
Après avoir porté haut le média qu'il a fondé, constitué une équipe talentueuse, joyeuse et solidaire, Hervé Kempf va prendre une retraite — sans doute un poil active, mais il avoue volontiers qu'il sera content de dormir le matin —, tandis qu'Amélie Mougey va apporter son énergie, son talent et sa jeunesse pour animer une rédaction en pleine forme. Venue de La Revue dessinée, qu'elle a dirigée pendant huit ans après avoir fait ses armes à Libération, puis dans l'information écologique à Terra Eco, elle a convaincu l'équipe qu'elle était « la bonne personne, à la bonne place ».
Élan nouveau
Les défis qui nous attendent sont majeurs. Alors que la situation écologique mondiale est pire que jamais, que le fascisme s'affirme sans honte, que les ultrariches et le système capitaliste bloquent la société dans une impasse technosolutionniste délétère, enquêter sans relâche, maintenir une information libre défendant les valeurs de l'écologie, de la justice et de la solidarité est une tâche vitale.
Pour faire face aux vents contraires, Reporterre doit même continuer à se développer, à grandir, à diversifier les formats pour toucher le plus grand nombre tout en restant fidèle à sa ligne : porter plus largement les valeurs d'égalité et d'émancipation et se faire l'écho des 1 000 initiatives qui conjurent un avenir désastreux. Car il y a des bonnes nouvelles et un élan nouveau pour inventer et raconter un monde vivable et désirable.
Pour découvrir cette rédaction pas comme les autres, ses valeurs, son fonctionnement, son quotidien, écoutez le podcast Le média du monde d'après de Rémi Dybowski-Douat.
Pour tout savoir du développement et de la situation financière de Reporterre, notre rapport d'activité est en ligne !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Contrer Trump : la gauche se réveille

Après une période de sidération universellement partagée, la gauche recommence à penser et à parler.
10 avril 2025 | regards.fr
https://regards.fr/la-lettre-du-10-avril-2/
Puisque Donald Trump nous en donne l'occasion, prenons le temps de cette pause dans la guerre des droits de douane américains pour regarder comment les gauches – qui ne furent pas laudatrice de la mondialisation libérale – se positionnent. Les réactions face à ce moment de remise en cause, majeur par son ampleur, sa soudaineté et sa violence révèlent les structures de pensées et de projets. Mille nuances se dessinent.
Mélenchon : faire mieux
Logiquement, Jean-Luc Mélenchon écrit dans sa dernière note de blog : « Les crises sont aussi des opportunités politiques pour se redéployer et pour pouvoir appliquer des méthodes jusque-là réputées impossibles à mettre en œuvre. Les dominés doivent en profiter. » Jugeant l'augmentation des droits de douane inadaptée, il développe deux pistes principales pour la France. La première vise les entreprises de la tech : « Il s'agit de taxer l'ensemble du chiffre d'affaires que ces compagnies réalisent sur notre territoire puisqu'aujourd'hui elles ne le sont pas. On en tirera la possibilité d'une relève relocalisée chez nous bien plus rapide que pour des aciéries ou des usines de nickel ». La seconde piste est celle d'une « taxation des droits intellectuels contenus dans les marchandises ». Il précise : « Cela inclut tous les secteurs où les droits (brevets, marques, droits d'auteur, etc.) sont essentiels : pharma, tech, cinéma, musique, logiciels, etc. 30% à 50% de la production mondiale est concernée, directement ou indirectement, par des droits de propriété intellectuelle (paiement de redevances, licences, etc.). Et les États-Unis sont de loin le leader mondial en la matière. »
Tondelier : l'improbable synthèse
Début avril, Marine Tondelier, fidèle à sa volonté de mettre tout le monde d'accord, écrivait un post sur Instagram qui rejoignait les inquiets de la remise en cause du libre-échange, se rangeait du coté de ceux qui veulent une riposte forte au niveau européen et s'affirmait du côté du souverainisme. Joli ! La secrétaire nationale des Écologistes se veut très critique face à l'actuel chambardement : « Par l'annonce d'une hausse massive des droits de douane, les États-Unis souhaitent redéfinir le libre échange international, mettant en péril notre industrie et alourdissant la facture pour les consommateurs ». Elle en appelait à l'Europe : « Face à cette attaque, l'Europe doit réagir avec fermeté. L'annonce d'une riposte sur les services numériques est un premier pas, mais elle doit être suivie d'autres mesures fortes ». Elle s'affirmait dans le camp des souverainistes : « Notre souveraineté énergétique et industrielle est menacée à force de délocalisations ». Et appelait à « reprendre le contrôle et protéger nos travailleuses, travailleurs et nos industries ! »
Ruffin : mobilisation générale
François Ruffin veut lui aussi voir dans ce moment un levier pour promouvoir d'autres logiques. Sur France Inter ce 9 avril, il énonce : « Donald Trump rompt de manière unilatérale, brutale et agressive avec un ordre mondial libéral. Il est stupide d'abord pour son pays. » Mais il enchaîne avec un détonnant « Tant mieux ! C'est une chance pour l'Europe et pour la France. Il y a un enjeu à avoir des protections et des régulations pour une sortie, en partie, de la mondialisation. […] Il faut le plan des 100 produits sur lequel on veut retrouver notre autonomie avec pour cela des barrières et des régulations. » François Ruffin propose un plan qui allie quotas d'importation, barrières douanières, politique de la commande publique. « L'Europe doit penser différemment. Il y a faire changer ce qui se passe au niveau européen et la France doit peser en ce sens. » Il juge « ridicule » la riposte envisagée par la commission européenne. Et, pour celui qui s'avance sur le chemin de 2027, il affirme que la France peut agir : « Il ne faut plus de capitaux américains et il faut mobiliser les capitaux nationaux. […] La commande publique a permis de préserver une industrie de défense en s'exonérant des règles de l'OMC. On peut rassembler le pays sur un tel projet. »
L'Après : l'esprit public face aux empires
Dans son édito sur le site de L'Après – l'association créée par Clémentine Autain, Alexis Corbière, Danielle Simonnet, Raquel Garrido –, le député Hendrik Davi interroge : « De quoi cette guerre commerciale est-elle le nom ? » Il note « l'interruption brutale du fantasme néolibéral d'une concurrence libre et non faussée sur un marché mondiale unifié […] Nous pourrions nous en féliciter. Mais nous ne sommes pas pour opposer les travailleurs des différents pays. » Hendrik Davi propose « de repartir des besoins et de notre nécessaire souveraineté alimentaire, sanitaire, énergétique ou industrielle. Nous avons besoin d'un nouvel ordre économique mondiale basée sur la coopération et non sur la compétition. » Reprenant la proposition portée par Clémentine Autain, le député de Marseille suggère « pour faire face aux enjeux écologiques et sociaux […] nous devons défendre l'esprit public avec une sécurité sociale de l'alimentation ou la refondation de services publics de l'énergie, du transport ou des médicaments ». Il conclut : « Face aux nouveaux empires, il n'a jamais été aussi urgent de défendre un nouvel internationalisme qui défende la justice sociale et écologique. Le NFP doit rapidement mettre cette question à son agenda. »
Roussel : battre le dollar
En meeting à Vénissieux ce 8 avril, Fabien Roussel affirme : « Les peuples d'Europe sont aussi menacés par la guerre économique mondiale lancée par monsieur Trump et sa clique d'ultra-riches. La guerre de Trump est une guerre sérieuse, dangereuse. Trump n'est pas fou. Il compte ses sous, et il en veut beaucoup, beaucoup, et il le dit comme ça ! Mais le capitalisme américain est malade, le dollar est malade et, aujourd'hui, les États-Unis sont en crise, traversés par une crise, dépassés par la Chine. Alors, comme une personne qui se noie, ils s'agitent et ils entraînent avec eux ceux qui veulent leur apporter de l'aide […] Nous ne devons pas accepter ce qui se passe, bien sûr de la part de Trump, mais y compris la mauvaise réponse actuelle de l'Europe à cette politique. Investissons massivement pour relocaliser nos entreprises, l'industrie en France et en Europe ! Investissons dans la production d'énergie décarbonée. Divisons par deux, par trois, par quatre, le prix de l'électricité et nous serons beaucoup plus compétitifs par rapport aux États-Unis ! Il faut que le message soit clair : les traîtres n'auront pas de place ici en France ! S'ils veulent partir, qu'ils partent, mais sans les capitaux et sans l'outil de travail, parce que nous le réquisitionnerons et ça restera chez nous. Enfin, il faut oser remettre en cause l'hégémonie du dollar. Des pays mettent en débat l'idée d'une autre monnaie que le dollar pour faire commerce entre nous. Avançons sur cette idée. Mettons en place une autre monnaie pour une autre mondialisation, respectant les peuples, respectant la planète. »
Catherine « Tricot »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












