Derniers articles

Pourquoi je me dissocie de la position majoritaire du Comité de rédaction de Presse-toi à gauche

La crise se poursuit.
Vers la fin de l'après-midi 26 mars, le président Trump annonçait qu'à partir du 2 avril, il allait imposer des droits de douane de 25% sur tous les véhicules importés aux États-Unis. Après avoir écouté le premier ministre de l'Ontario Doug Ford et le premier ministre du Canada Mark Carney réagir, j'ai passé, une fois couché ce soir-là, de longs moments d'insomnie.
Dans de telles circonstances tout à fait historiques, savoir pour qui voter dans les prochaines élections fédérales importe énormément.
La position majoritaire du Comité de rédaction de Presse-toi à gauche est qu'il faut appuyer le NPD, le seul parti qui reflète réellement les valeurs progressistes. Appuyer stratégiquement le Parti libéral pour empêcher une victoire de Pierre Poilievre, serait, selon ce point de vue, contribuer à la méséducation de la population, aller à l'encontre de nos valeurs et de nos aspirations. Cela reviendrait à voter pour le moindre mal en mettant sous le tapis la défense réelle des intérêts de la majorité populaire. L'urgence, selon cette position, serait de prendre la rue et de militer pour la mise en place d'un réel projet de société en finissant une fois pour toutes avec le capitalisme, le patriarcat, les guerres, les génocides et l'exploitation de la terre.
Il y a quelques mois, le Comité de rédaction m'invitait à me joindre à lui. J'aime y participer et je respecte et admire énormément mes collègues. Les valeurs qu'ils et elles défendent m'inspirent. Leur engagement à produire et maintenir vivant, ce cela de façon tout à fait bénévole, un journalisme de qualité, m'impressionne.
Cependant, je ne partage pas la position majoritaire du comité.
Pour étayer mon opinion dissidente, je traçais, dans un article précédent, le portrait de l'actuel premier ministre du Canada, Mark Carney, en me fondant sur son livre Values : Building a Better World for All (2021), dont je venais tout juste de terminer la lecture. Et je remettais carrément en question ce qu'affirment de nombreux progressistes tels que James Hardwick et David Moscrop et ce que laisse entendre la position majoritaire. À savoir que Carney n'est qu'un néolibéral qui vénère à l'autel du fondamentalisme du marché et qu'il va faire pencher le Parti libéral plus à droite.
Carney, comme je l'ai démontré dans mon article, rejette carrément dans son livre à la fois l'analyse des économistes néoclassiques et celle des économistes néolibéraux. À certains égards, son analyse me rappelle beaucoup celle du psychanalyste américain de tendance marxiste Erich Fromm, qui, dans The Sane Society (1955), rejette le capitalisme parce que celui-ci, dit-il, réduit l'être humain à une simple marchandise. Le capitalisme, allègue Fromm, mène à l'aliénation, et c'est pourquoi il plaide pour un projet de socialisme humaniste et démocratique. Fromm s'inspire partiellement des écrits du jeune Marx et rejette, comme ce dernier, la sacralisation ou le fétichisme des forces du marché.
Cependant, même si je maintiens mordicus que dans la crise historique existentielle que nous vivons présentement au Canada, la grande priorité des progressistes devraient être de tout faire pour empêcher une victoire de Pierre Poilievre, quitte à appuyer stratégiquement le Parti libéral, cela ne veut pas dire que je partage toutes les opinions que Mark Carney exprime dans son livre Values.
Selon Carney, il est tout à fait faux d'alléguer, comme le font la plupart des économistes de la gauche comme de la droite, qu'Adam Smith, que plusieurs perçoivent comme le pionnier de la science économique, était un fondamentaliste du marché. Autrement dit, qu'il croyait que les riches n'ont qu'à chercher à s'enrichir de plus en plus pour que soit automatiquement atteint, comme par magie et grâce à la main invisible présumément de Dieu, le bien commun.
Il est facile de croire cela, affirme Carney, si on ne concentre que sur un ou deux passages de l'œuvre majeure de Smith, Wealth of Nations. Cependant, dès qu'on considère l'ensemble de son œuvre, et surtout son premier livre The Theory of Moral Sentiments, cette thèse – la recherche de la richesse des puissants mène automatiquement au bien commun – ne tient plus du tout la route.
Sur ce point, qui est tout de même fort important, je ne partage pas l'opinion de Mark Carney.
***************
Les crises, cela est bien connu, mènent souvent à la polarisation. Disparaissent rapidement, dans de telles situations, les nuances.
Vous êtes pour nous ou contre nous, affirmait George Bush Jr à la suite de l'attaque des tours jumelles à New York, mardi matin, le 11 septembre 2001.
Si Mark Carney découvrait la sagesse d'Adam Smith alors qu'il vivait les conséquences de la crise financière de 2008, je découvrais Adam Smith, pour la première fois de ma vie, alors que je vivais le coup d'État chilien qui renversait, en 1973, le gouvernement socialiste de Salvador Allende.
Comme l'attaque des tours jumelles à New York, c'était aussi un mardi matin. Et, de plus, c'était aussi un 11 septembre. Même le nombre de morts ici et là était à peu près le même : 3 000.
Les lunettes évènementielles que portait Mark Carney comme gouverneur de la Banque d'Angleterre lorsqu'il lisait The Theory of Moral Sentiments étaient fort différentes des lunettes évènementielles que je portais lorsque je lisais minutieusement ce même livre.
Les lunettes académiques que Carney portait lorsqu'il lisait ce livre étaient aussi fort différentes des lunettes académiques que je portais lorsque je le lisais. Carney détenait une licence en économie de l'Université de Harvard (1988), ainsi qu'une maitrise (1993) et un doctorat (1995) en économie de l'Université d'Oxford. Je détenais un baccalauréat des arts (1961) et une maitrise en philosophie (1966) de l'Université d'Ottawa et un baccalauréat en théologie (1968) de l'Université Saint Thomas d'Aquin à Rome. Je ne terminerais ma scolarité de maitrise en économie à l'Université McGill que plus tard (1978).
Avant d'expliquer davantage, dans un prochain article, pourquoi je me dissocie de la position majoritaire du Comité de rédaction de Presse-toi à gauche, qui qualifie carrément le Canada de pays impérialiste, colonisateur et extractiviste, et ce au moment même où ce dernier se trouve plongé dans une crise historique existentielle, je vais comparer, dans cet article, l'interprétation que j'ai faite d'Adam Smith en 1974 avec celle qu'en a faite Mark Carney dans son livre de 2021.
Une comparaison qui devrait montrer que, bien que je me dissocie de la position majoritaire du Comité de rédaction, je partage plusieurs des valeurs et inquiétudes profondes qui sous-tendent celle-ci.
Deux interprétations fort différentes de la pensée d'Adam Smith
Carney semble avoir découvert la grande sagesse d'Adam Smith alors qu'il tentait, comme gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, de résoudre les problèmes issus de l'énorme crise financière de 2008, des problèmes dont la gravité était telle qu'une partie substantielle de la population remettait en question l'économie de marché comme telle.
Lorsque j'étais à la Banque centrale d'Angleterre, nous nous sommes souvent inspirés de ses idées pour aborder des questions allant de l'avenir de la monnaie à l'ère des cryptoactifs à la manière de reconstruire les fondements sociaux des marchés financiers après la crise financière de 2008, affirme Carney (...). Ce faisant, nous avons été inspirés par Smith, le sage de la politique, de la morale, de l'éthique et de la jurisprudence, et non par Smith, le fondamentaliste du marché de la légende et de l'opportunisme politique de la droite et de la gauche.
Je découvrais Adam Smith, comme mentionné plus haut, dans un tout autre contexte.
J'avais 31 ans, et je me trouvais alors à Santiago, Chili. Quelques mois plus tôt, j'avais vécu le violent coup d'État du 11 septembre 1973 par lequel les militaires, soutenus par les riches hommes d'affaires chiliens et le gouvernement américain, renversaient le gouvernement socialiste démocratiquement élu de Salvador Allende.
Semaine après semaine, j'entendais les militaires proclamer avec fierté que le Chili avait retrouvé la liberté. Vive le retour du marché libre, nous disaient-t-ils ! Vive le retour des investissements !
Cependant, ces proclamations me bouleversaient et me révoltaient profondément, car je voyais ces mêmes militaires exécuter sommairement, s'adonner à la torture la plus barbare imaginable – selon une Commission d'enquête, quelques 27 000 de Chiliens et Chiliennes ont subi de la torture – , faire disparaître des personnes, acheminer comme du bétail de dizaines de milliers d'adeptes de l'Unité populaire dans des camps de concentration, imposer la censure totale des médias et bannir la plus grande centrale ouvrière du Chili.
Si ma mémoire est bonne, c'était le début mars 1974 que je découvrais Adam Smith. Je venais de commencer à suivre un cours d'économie à l'Instituto Latinoamericano de Doctrinas y Estudios Sociales (ILADES). Mon professeur m'avait demandé de faire une dissertation sur Adam Smith, et j'avais sorti de la bibliothèque sa première œuvre, The Theory of Moral Sentiments (1759). Il s'agissait d'un livre de philosophie morale, et bien qu'il soit assez volumineux, sa lecture ne m'était pas du tout rébarbative, puisque que je détenais une maitrise en philosophie.
ILADES n'était pas mon premier choix.
En arrivant au Chili fin juillet 1973, ma conjointe d'alors, Wynanne Watts, et moi nous étions inscrits dans le Centro del estudio de la realidad nacional (CEREN), une institution progressiste qui faisait partie de l'Université catholique du Chili.
Cependant, à peine nos cours commencés fin aout, le coup d'État du 11 septembre y mettait subitement fin, la dictature démantelant immédiatement le CEREN.
Ce geste répressif n'étonnait guère, puisque cette institution était hautement réputée et son influence dans la gauche était remarquable, non seulement au Chili et toute l'Amérique latine, mais aussi au niveau international.
Privés de cours, Wynanne et moi nous tournions alors immédiatement aux tâches qui, dans ces évènements dramatiques que nous vivions, nous paraissaient les plus urgentes : aider les personnes traquées par les militaires à prendre refuge dans une ambassade, faire parvenir des rapports au Comité Québec-Chili à Montréal, rencontrer les nombreux journalistes qui arrivaient à Santiago pour leur raconter ce qui arrivait au Chili.
Ayant passé presque huit ans au séminaire à me préparer à la prêtrise, j'étais abasourdi et profondément révolté de voir la complicité de l'Église catholique dans le coup. J'ai donc commencé à exprimer ma frustration dans mon journal, et, peu à peu, ce dernier s'est transformé en livre.
Début mars 1974, je réussissais, après quelques tentatives manquées, à faire parvenir mon manuscrit Chili : le coup divin à Montréal. Et c'est à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, que Wynanne et moi ont commencé à suivre des cours à ILADES.
Si ILADES n'avait pas connu le même sort que le CEREN, c'est parce que cette institution était dirigée par les Jésuites, lesquels étaient proches du Parti démocrate-chrétien, un parti qui, initialement, avait appuyé le coup d'État.
Mon professeur d'économie à ILADES m'avait demandé de faire une dissertation sur Adam Smith, mais je lui avais expliqué discrètement que je voulais aussi poursuivre, à l'insu de tous, le projet de recherche que j'avais initié au CEREN, soit découvrir la pensée de Karl Marx.
Comme les militaires brûlaient dans la rue tous les livres de tendance socialiste ou même social-démocrate qui leur tombaient sous la main, les Jésuites avaient discrètement accepté que soient entreposés dans l'énorme sous-sol d'ILADES les livres de la bibliothèque du CEREN.
C'est dans ce sous-sol, vers lequel mon professeur a eu la gentillesse de me diriger, que j'ai trouvé quelques livres de Karl Marx. Non sans difficulté énorme, d'ailleurs, car il y avait des montagnes de livres et ils étaient empilés par terre dans un désordre total !
Lire Smith, le grand apôtre du capitalisme, et Marx, le plus grand et illustre critique du capitalisme, dans le contexte du coup d'État brutal qui était en marche, m'ouvrait les yeux.
Si quelqu'un cognait à la porte de notre appartement situé dans un quartier populaire de Santiago, je cachais immédiatement, avant d'ouvrir la porte, le livre de Marx que j'étais en train de lire.
L'interprétation de Mark Carney de l'œuvre d'Adam Smith
Dans son livre Values, Mark Carney affirme, comme noté plus haut, que les économistes se sont trompés en présentant Adam Smith comme le préconiseur d'un laissez-faire où individus et entreprises n'auraient qu'à poursuivre égoïstement le profit afin que soit automatiquement atteint le bien commun. Si on s'en tient, affirme-t-il, au deuxième livre de Smith, Wealth of Nations (1776), le livre de loin le plus acheté et lu, on peut facilement avoir cette impression. Cependant, insiste Carney, pour comprendre Smith, il faut absolument tenir compte de l'ensemble de son œuvre. Et de façon particulière de son premier livre, The Theory of Moral Sentiments (1759), où Smith, dit-il, adhère clairement aux valeurs éthiques classiques, reconnaissant que toute société saine doit se fonder sur les grandes vertus humaines que sont justice, compassion, amour, respect etc.
Une société purement commerciale, dans laquelle les hiérarchies sociales sont basées sur la richesse, amène naturellement les gens, note Carney, à se concentrer sur la recherche systématique de la richesse, cette recherche que Max Weber considère comme principal déterminant sociologique du capitalisme.
Adam Smith craignait, poursuit Carney, qu'une telle recherche systématique n'encourage un comportement amoral. En cela, il était en désaccord total avec la conclusion du théoricien social du XVIIe siècle Bernard Mandeville dans sa parabole des abeilles, selon laquelle la poursuite de vices privés par les abeilles conduit à la prospérité de la ruche, faisant de ces vices des vertus publiques.
Au lieu de reconnaître que Smith rejetait carrément la fameuse parabole des abeilles de Mandeville, poursuit Carney, les économistes ont fait exactement le contraire. Ils ont présenté Adam Smith comme le père et grand défenseur du laissez-faire.
Il est révélateur, écrit Carney dans son livre, que les économistes se soient rangés du côté des abeilles, en les adoptant comme symbole de la Royal Economic Society.
Présenter Smith comme le père du laissez-faire, insiste Carney, n'est qu'une caricature de ce grand économiste, une déformation grossière de sa pensée. C'est passer sous silence, poursuit l'ex-banquier catholique qui pratique la méditation, le fait que Smith était le plus réfléchi et catholique des philosophes du monde entier !
Les écrits de Smith, affirme Carney, mettent en garde contre les erreurs consistant à assimiler l'argent au capital et à dissocier le capital économique de son partenaire social, erreurs que l'on peut commettre en ne lisant que quelques pages, certes brillantes, de Wealth of Nations. Cette caricature de Smith en tant que « père du laissez-faire » dévalorise grossièrement le plus réfléchi et le plus catholique des philosophes du monde entier ; l'expression « main invisible » n'apparaît qu'une seule fois dans ce livre et seulement trois fois dans les œuvres rassemblées de Smith.
Smith, Carney argumente, n'était pas du tout un intellectuel au service du grand capital. Il était tout à fait conscient du danger que le gouvernement soit indument influencé par le capital.
Smith a mis en garde contre le fait qu'un système politique dominé par les entreprises permettrait une conspiration de l'industrie contre les consommateurs, les entreprises cherchant à influencer la politique et la législation.
Mon interprétation de l'œuvre d'Adam Smith
Plongé dans un Chili où riches et puissants avaient orchestré le renversement brutal du gouvernement de l'Unité populaire qu'appuyaient fortement la grande majorité des travailleurs et travailleuses ainsi que les marginalisés des bidonvilles, ma lecture de The Theory of Moral Sentiments – j'avais méticuleusement lu ce livre au complet – fut fort différente de celle de Carney.
Voici un extrait du journal que j'écrivais en avril 1974, alors que j'étais en train de lire ce livre. Un extrait où parfois je paraphrase et souvent je cite longuement et textuellement Smith.
Pour moi, l'exemple qui suit va au cœur de la philosophie du père du capitalisme, Adam Smith.
Smith parle d'un fils de pauvre qui, voyant et enviant le rang et la situation matérielle d'un homme riche, s'efforce d'obtenir pour lui-même ce rang et cette situation. À cette fin, il travaille beaucoup plus fort qu'il ne l'aurait fait autrement, sacrifie beaucoup de choses dont il aurait pu jouir, apprend un métier très difficile, étudie jour et nuit, puis fait tout son possible pour faire connaître publiquement son excellence afin d'obtenir un emploi toujours plus élevé et de meilleure qualité. À cette fin, il va même jusqu'à faire la cour à toute l'humanité, à servir ceux et celles qu'il déteste et à être obséquieux envers ceux et celles qu'il méprise.
Une fois qu'il a atteint la richesse, le pouvoir et la gloire, il est vieux, usé par le travail et le labeur, et il découvre alors que ce monde de rêve qu'il avait toujours imaginé, et qui l'avait toujours poussé à aller de l'avant, est beaucoup plus imaginaire que réel. Il découvre que sa richesse est très précaire et remplie de soucis qui lui font perdre temps et quiétude de l'esprit, et qu'en outre, les vraies valeurs qui réconfortent le cœur de l'homme sont ailleurs, et qu'il aurait pu les atteindre depuis longtemps sans toute cette peine et toute cette ambition.
Cet extrait de mon journal fait apparaître Smith comme un grand sage. Comme, pour reprendre les paroles de Mark Carney, le plus réfléchi et le plus catholique des philosophes du monde entier. Quelqu'un qui nous montre, un peu comme ne le faisaient Platon et Aristote, que les vraies valeurs qui réconfortent le cœur des personnes humaines ne résident aucunement dans la poursuite de richesse, choses matérielles, rang, pouvoir et prestige. Quelqu'un qui nous rappelle l'importance d'enseigner aux jeunes de prioriser amour, solidarité, et relations humaines profondes.
Cependant, le passage qui suit dans mon journal laisse entendre que selon Smith, l'Anglosaxon pragmatique, ce serait une erreur que de tenter d'enseigner une telle morale aux jeunes. Car le bon Dieu, dit Smith, nous a créé avec cette tromperie innée en nous. Un peu comme la loi de la gravité que découvrait Newton, elle est implantée dans notre nature. Et c'est d'ailleurs précisément cette tromperie – la tendance de prioriser richesse, puissance, et prestige au lieu de l'amour et la solidarité – qui représente le grand propulseur des progrès que réalise l'humanité.
Il est bon, poursuit Smith, que la nature nous impose cette façon de faire. Car c'est cette tromperie qui suscite et maintient en mouvement continuel l'industrie de l'humanité. C'est elle qui a incité les humains à cultiver le sol, à construire des maisons, à fonder des villes et des états, et à inventer et améliorer toutes les sciences et tous les arts qui ennoblissent et embellissent la vie humaine.
Ce dernier passage de Smith, que je citais textuellement dans mon journal chilien d'avril 1974, ressemble comme deux gouttes d'eau à un autre passage que je découvrais en 1977 lorsque je me préparais pour une maitrise en économie à l'Université McGill. Celui que l'on trouve dans le livre Capitalisme et liberté (1961) du grand théoricien du néolibéralisme, Milton Friedman, de l'Université de Chicago. Un livre, d'ailleurs, qui représente en quelque sorte la bible de la révolution économique néolibérale qu'a imposée par la force brutale la dictature chilienne pendant 17 ans. Et un livre qui a profondément impressionné Pierre Poilievre dans sa jeunesse.
La seule modification à apporter pour rendre pratiquement identiques ce passage tiré de The Theory of Moral Sentiments et celui tiré de Capitalisme et liberté est de remplacer le mot tromperie par l'expression qu'utilise Friedman entreprise individuelle (individual endeavour).
Revenons à mon journal d'avril 1974.
Immédiatement après cité dans mon journal le passage ci-haut de Smith, je poursuis en me lançant dans une critique percutante de la philosophie morale d'Adam Smith, utilisant pour ce faire le couteau analytique que m'ont permis d'aiguiser mes quatre années d'études en philosophie.
L'amour du système lui-même, affirme Smith en 1759, est le moteur du monde des affaires ! L'amour de l'harmonie, de la régularité, de l'efficacité du système ! L'amour des moyens et non des fins ! L'amour non pas tant de la richesse, du pouvoir et des honneurs extérieurs, mais plutôt des mécanismes qui permettent de les obtenir. En tant que fins, jugées comme telles, la richesse et le pouvoir font en effet de bien piètres concurrents, car "ils apparaissent toujours au plus haut point méprisables et insignifiants", affirme Smith. Ce n'est que lorsque nous considérons ces fins que sont richesse et pouvoir, "non pas dans leur contexte abstrait et philosophique, poursuit-il, mais dans leur contexte concret et complexe", c'est-à-dire "liées à l'ordre, au mouvement régulier et harmonieux du système, de la machine ou de l'économie qui les produit", qu'elles apparaissent vraiment valables et dignes d'efforts.
Avant de reproduire la longe citation textuelle de Smith qui apparaît dans mon journal immédiatement après cette critique mordante, j'aimerais rappeler à lectrices et lecteurs que pour Mark Carney, The Theory of Moral Sentiments représente la preuve par excellence que Smith était bel et bien le plus réfléchi et le plus catholique des philosophes du monde entier. Que pour Carney, c'est surtout dans ce livre que Smith rend clair le fait que toute société saine devrait reposer sur les grandes valeurs éthiques.
Les leaders de ce grand mouvement du système, les riches, affirme Smith, peuvent s'efforcer tant qu'ils veulent de ne poursuivre que leurs propres intérêts. L'estomac du riche n'est pas plus gros que celui du paysan le plus pauvre : le reste, le riche est obligé de le distribuer entre ceux et celles qui préparent, de la plus belle manière, le peu dont il fait usage lui-même, entre ceux et celles qui aménagent le palais où ce peu doit être consommé, entre ceux et celles qui fournissent et maintiennent en ordre toutes les différentes babioles et bibelots qui sont employés dans l'économie de la grandeur ; tous et toutes tirent ainsi du luxe du riche et de son caprice une part des nécessités de la vie et de la justice. (...)
Les riches, poursuit Smith dans The Theory of Moral Sentiments, ne consomment guère plus que les pauvres ; et malgré leur égoïsme et leur rapacité naturels, bien qu'ils ne songent qu'à leur propre intérêt, bien que la seule fin qu'ils se proposent en faisant travailler de milliers d'hommes et de femmes ne soit que la satisfaction de leurs vains et insatiables désirs, ils partagent avec les pauvres le produit de toutes leurs améliorations.
Ils sont conduits par une main invisible à faire à peu près la même distribution des choses nécessaires à la vie que celle qui aurait été faite si la terre avait été divisée en portions égales entre tous ses habitants, poursuit Smith ; et ainsi, sans le vouloir, sans le savoir, les riches favorisent l'intérêt de la société, et fournissent les moyens de multiplier l'espèce. Lorsque la Providence a partagé la terre entre quelques maîtres seigneuriaux, elle n'a ni oublié ni abandonné ceux et celles qui semblaient avoir été écartés du partage. Ces derniers et dernières jouissent aussi de leur part de tout ce que cette terre produit.
Certes, avoue Smith, la Providence, c'est-à-dire le bon Dieu, n'a pas fait un très bon boulot lorsqu'il a partagé la terre entre tous ses habitants. Les riches, quelques maitres seigneuriaux, ont reçu à peu près tout.
On se croirait en 2025 ! C'est comme si Smith, qui écrivait pourtant ces mots il y a quelques siècles, plus précisément en 1759, était en train de décrire notre monde actuel, et non le sien.
Le bon Dieu ne semble pas s'être amélioré au cours des siècles ! Encore à l'heure actuelle, il ne semble pas faire un très bon boulot, puisque qu'il distribue la part de lion des revenus et de la richesse à une petite poignée de riches !
Mais ne vous en faites pas trop, mesdames et messieurs, poursuit Smith. Car, en partageant de façon aussi inégale la terre, le bon Dieu n'a ni oublié ni abandonné ceux et celles qui semblaient avoir été écartés du partage !
Non, nous dit Smith. il ne les a pas oublié et abandonné du tout ! Il a fait en sorte que grâce à cette tromperie innée qu'il a placée dans notre nature, une tromperie qui nous pousse sans cesse à rechercher ces fausses valeurs que sont biens matériels, pouvoir, puissance et prestige, l'humanité progresse à grands pas. Car les riches, nous dit Smith, malgré leur rapacité et leur seule poursuite du profit, sont conduits par une main invisible à faire à peu près la même distribution des choses nécessaires à la vie que celle qui aurait été faite si la terre avait été divisée en portions égales entre tous ses habitants !
Je crois Mark Carney lorsqu'il affirme que lui et ses collègues de la Banque centrale d'Angleterre se sont inspirés des idées brillantes de Smith pour solutionner un tas de problèmes issus de la crise financière de 2008, allant de l'avenir de la monnaie à l'ère des cryptoactifs à la manière de reconstruire les fondements sociaux des marchés financiers. Smith, il est vrai, ne souffrait aucunement de l'étroitesse de perspective qui caractérise la science économique contemporaine, surtout l'école néolibérale qui prédomine.
Cependant, son interprétation de Smith, selon moi, laisse à désirer. Elle manque énormément de rigueur, surtout en ce qui concerne la philosophie morale d'Adam Smith.
Mark Carney a beau insisté sur le fait qu'il importe de considérer l'ensemble de l'œuvre d'Adam Smith, et non pas de se limiter aux seuls trois passages dans celle-ci, dont celui que je viens de reproduire, où il se réfère à la beauté et merveille de la main invisible...
Il a beau nous rappeler, et ce fort justement d'ailleurs, que Smith savait nuancer. Qu'il dénonçait le fait que parfois les entreprises se concertent pour maintenir artificiellement hauts les prix ; le fait que les entrepreneurs, les « masters » comme les appelait Smith, cherchent souvent à maintenir les salaires les plus bas possibles, et qu'ils ont le gros bout du bâton, puisque les travailleurs et les travailleuses, pour résister à de telles manœuvres, ne peuvent faire la grève que quelques jours, faute de moyen financiers...
Il a beau insister sur le fait que selon Smith, le fonctionnement sain du marché suppose confiance, intégrité et équité...
Il a beau nous rappeler tout cela...
Toujours est-il que la vision du monde qui se dégage clairement de la philosophie globale d'Adam Smith n'a rien de très réconfortant pour les Damnés de la terre (1961) dont parle Franz Fanon dans son livre.
En tout cas, elle ne me réconfortait nullement lorsque je me retrouvais à Santiago, Chili, en avril 1974.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Sans virus.www.avast.com

Ensemble, debout face aux élections fédérales 2025 : Pour un avenir féministe, solidaire et inclusif

Alors que le Canada s'apprête à retourner aux urnes le 28 avril 2025, la Fédération des femmes du Québec souhaite s'adresser à toutes ses militantes, allié·es, partenaires, et surtout, à toutes les femmes dans la lutte pour un monde plus juste. Nous sommes à un moment charnière, un moment où nos solidarités doivent être plus fortes que jamais.
2 AVRIL 2025
S'informer et se mobiliser : ressources, campagnes, événements et outils
Depuis plusieurs années, nous assistons à la montée inquiétante des droites et de ses discours visant à s'opposer aux évolutions sociales tout en revenant à des valeurs traditionnelles. Cette vague s'accompagne d'attaques frontales contre les droits des femmes, des personnes trans et non binaires, des personnes migrantes, ainsi que de toutes les communautés historiquement marginalisées. Les droits durement acquis sont remis en question. Nos filets sociaux s'effritent. Les violences queerphobes et transphobes augmentent. Le droit à l'avortement est fragilisé. La crise du logement frappe de plein fouet les femmes en situation de précarité. Les discours démagogiques sur l'immigration attisent la peur plutôt que la solidarité. Les défenseur·es de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de la recherche sont attaqué·es.
Mais nous savons que, face à ces vents contraires, nous avons le pouvoir collectif de riposter et de proposer un autre avenir.
À la FFQ, nous croyons qu'un avenir féministe ne peut se construire qu'en intégrant une perspective intersectionnelle : en reconnaissant que les oppressions se croisent et se renforcent, et que notre lutte pour les droits des femmes est indissociable des luttes contre le racisme, la transphobie, la pauvreté, la crise climatique, et toutes les formes d'injustice.
Les élections fédérales de 2025 sont une occasion cruciale de faire entendre nos voix, de faire valoir nos revendications et de rappeler aux décideur·euses que nous ne resterons pas silencieuses.
Nous appelons toutes les féministes et toutes les personnes engagées pour un avenir plus juste à se mobiliser, à s'informer, à sensibiliser leurs entourages et à poser des gestes concrets pour défendre nos droits. Chaque vote, chaque parole, chaque action compte !
Ensemble, refusons les politiques qui nourrissent les inégalités.
Ensemble, exigeons un accès réel au logement, à l'avortement, à la sécurité économique pour toutes.
Ensemble, défendons les droits des personnes trans, non binaires, migrantes, racisées et précaires.
Ensemble, portons une voix forte pour la justice environnementale et sociale.
Notre espoir ne réside pas dans les promesses électorales, mais dans la force de notre solidarité qui sera pérenne. C'est ensemble, dans nos communautés, dans la rue, que nous ferons reculer la haine et avancer nos droits.
Pour vous outiller et vous informer, nous vous proposons plus bas une série de ressources féministes, médiatiques et citoyennes : guides d'analyse, outils de mobilisation, revues de presse et initiatives de nos allié·es. Que ce soit pour mieux comprendre les enjeux électoraux, planifier des actions militantes ou outiller votre entourage, ces ressources sont là pour nourrir notre riposte et renforcer notre solidarité.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Agir avec détermination contre la pauvreté et les inégalités

Dans le cadre de la présente campagne électorale fédérale, les membres du Mouvement ATD Quart Monde, un mouvement de lutte à la grande pauvreté, appellent le futur gouvernement fédéral à mener une ambitieuse stratégie de lutte à la pauvreté et aux inégalités.
Posté le 31 mars 2025
Cette stratégie doit viser un grand objectif : améliorer, en priorité, le revenu et les conditions de vie du cinquième de la population le plus pauvre. Cette stratégie doit, de plus, se penser et se bâtir avec la pleine participation des personnes concernées, celles-là mêmes qui la vivent au quotidien.
Les membres du Mouvement souhaitent un État fédéral pro-actif, engagé et déterminé à protéger et améliorer les services publics tout en combattant les inégalités sociales et économiques qui se creusent depuis quelques années.
Les membres du Mouvement ont identifié 7 enjeux prioritaires sur lesquels ils interpellent les candidats et candidates.
Mener un grand chantier pour le logement social
Le dossier du logement est la préoccupation première des membres. Se loger adéquatement à un coût raisonnable est devenu un très grand défi budgétaire pour des centaines de milliers de ménages à faibles revenus au pays. Le coût du logement entraîne une aggravation très marquée de la pauvreté et une réelle dégradation du tissu de nos communautés.
Cette crise du logement est connue depuis plusieurs années et pourtant les choses bougent trop lentement. Il est plus que temps que soit mené un vaste et ambitieux chantier de logement social et communautaire. Le gouvernement fédéral doit ainsi accentuer considérablement ses efforts financiers afin de soutenir la construction de nouvelles unités de logement social et la rénovation des logements sociaux insalubres.
Financer plus largement des projets de transport collectif et de transport en commun
Se déplacer est souvent un grand défi pour des personnes plus démunies tant au niveau de la disponibilité des services de transport que de leur coût. Le gouvernement fédéral doit davantage soutenir les projets de transport collectif, régionaux et en commun afin d'assurer des services de qualité et accessibles financièrement qui assurent la mobilité de tous. De plus, de tels projets ont un impact positif sur l'environnement.
Agir plus fortement contre les changements climatiques
Il est largement documenté que ce sont les populations les plus pauvres, ici et ailleurs dans le monde, qui vivent dans les environnements les plus mauvais et qui souffrent le plus des changements climatiques. Cette injustice climatique doit cesser et le gouvernement fédéral doit mener des actions ambitieuses et ciblées afin de contrer ces inquiétants dérèglements. Le gouvernement doit soutenir le verdissement des villes, la lutte aux îlots de chaleur, les technologies vertes, etc. et s'assurer que cela soit équitablement réparti entre les populations du pays.
Augmenter l'aide internationale directe et sans conditions aux pays les plus pauvres
Les Nations Unies ont fixé à 0,7 % du Produit national brut (PNB) le niveau d'aide internationale que les pays doivent viser. Le Canada avec 0,23 % est encore loin de cet objectif et c'est une honte pour un pays aussi riche que le nôtre. Les membres d'ATD Quart Monde, en toute solidarité avec les populations les plus démunies du monde, demandent donc, dans les meilleurs délais, l'augmentation du niveau d'aide internationale du Canada afin d'atteindre la cible de 0,7 %. Ils demandent que cette aide soit directe, sans conditions et au bénéfice des populations les plus marginalisées de ces pays.
Être un pays ouvert pour les réfugiés et les demandeurs d'asile
Le contexte mondial actuel de guerre et de catastrophes et l'extrême pauvreté qui persiste dans plusieurs régions du monde crée des mouvements migratoires importants. Les membres souhaitent largement que notre pays reste ouvert et accueillant et que les services publics nécessaires soient en place pour bien réussir cet accueil. Les membres souhaitent également que soient combattues le racisme et la discrimination y compris celle basée sur le statut social de la personne.
Agir plus durablement pour améliorer les conditions de vie des peuples autochtones
Les membres du Mouvement reconnaissent l'histoire et la situation particulières des personnes issues des Premières Nations et des Inuits, et sont solidaires des nombreuses injustices qu'ils ont connues. Les membres appellent à une réelle réconciliation entre les peuples du pays. De plus, ils demandent que les personnes des Premières Nations et Inuits soient impliquées directement dans les décisions et les investissements requis qui les concernent. Il est inacceptable qu'ils ne puissent avoir accès au même niveau de services publics (eau potable, logement, services sociaux, etc.) que le reste de la population du pays.
Assurer la sécurité du pays sans impacter les mesures sociales
Les membres s'inquiètent de l'augmentation annoncée du budget des dépenses militaires. Quoiqu'ils reconnaissent que l'enjeu de la sécurité du pays doit être pris en considération, ils craignent que cela se fasse au détriment des budgets sociaux. Ils ont la même crainte au regard du retour à l'équilibre budgétaire. Dans les choix budgétaires à faire, il importe impérativement de protéger les budgets sociaux au bénéfice des composantes de la population canadienne les plus défavorisées.
En terminant, les membres du Mouvement ATD Quart Monde rappellent que la pauvreté ne peut se mesurer uniquement à partir du panier de consommation (MPC), mesure privilégiée par le gouvernement fédéral.
En conséquence, ils portent à l'attention des candidats et candidats l'excellent rapport Les Dimensions cachées de la pauvretéauquel le Mouvement a contribué et qui démontre qu'une stratégie efficace de lutte à la pauvreté doit intégrer d'autres dimensions soit :
Dépossession du pouvoir d'agir
Souffrances dans le corps, l'esprit et le cœur
Combat et résistance
Maltraitance sociale
Maltraitance institutionnelle
Contributions non reconnues
Manque de travail décent
Revenu insuffisant et précaire
Privations matérielles et sociales
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Élections fédérales 2025 - Beauport Limoilou : Vers un air plus pur, de meilleurs accès au fleuve et le droit au logement

Québec, 3 avril 2025 - Des membres de la Table citoyenne Littoral Est et d'Accès Saint-Laurent Beauport demandent aux candidates et candidats à la campagne fédérale de la région de Québec de s'engager concrètement en vue de transformer nos quartiers en un territoire plus propre, plus sain et comportant davantage de logements sociaux.
Ceux-ci sont actuellement caractérisés par trop d'activités industrialo-portuaires, de la contamination des sols et beaucoup de pollution de l'air à proximité d'une population vulnérable.
Ainsi, nos organismes leur demandent de reconnaître la zone sacrifiée du Littoral Est et de s'opposer à un éventuel projet de terminal de conteneurs promu par l'entreprise QSL au Port de Québec et à tout autre projet émetteur de pollution atmosphérique. Il est généralement reconnu que ce type de projet détériore davantage la qualité de l'air, ce qui est inacceptable dans un secteur déjà saturé en contaminants atmosphériques comme le secteur Beauport-Limoilou. La réalisation de ce projet exacerberait aussi la congestion routière, alors que le Directeur de la santé publique recommande plutôt de réduire la capacité routière. Il nuirait également à l'aménagement tant attendu de la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain, pour laquelle citoyennes et citoyens se sont battus.
Ce sont des mesures d'assainissement de l'air qui doivent être envisagées prioritairement par nos élu.es. De plus, nous demandons aux candidates et candidats de s'engager à accorder un statut légal de protection aux battures de Beauport afin de les protéger des effets négatifs de tout développement autoroutier et industriel futur. L'intégrité de ce milieu écologique exceptionnel est régulièrement menacée par des projets industriels irresponsables et ces battures doivent être reconnues à leur juste valeur.
Ensuite, afin d'assurer un accès direct, sécuritaire et convivial à la baie de Beauport via l'avenue D'Estimauville, les candidates et candidats devraient s'engager pour que le prochain gouvernement fédéral, de concert avec le Canadien National et l'Office des transports du Canada, contribuent aux
futurs aménagements de la phase 4 de la Promenade Samuel-de-Champlain pour accéder directement à la plage, et ce, sans entrave. Ce joyau qu'est la plage, légué à la Ville de Québec par le gouvernement fédéral en 2008, est peu accessible à la population. En effet, la cour de triage du CN fait obstacle à cet accès naturel.
Enfin, nous demandons aux candidates et candidats et à leurs partis de défendre un accroissement des investissements fédéraux dans le logement social et de se doter d'un objectif chiffré de bonification de l'enveloppe budgétaire destinée au logement social (HLM, coop et OBNL), de manière à réaliser l'objectif de rehausser la part de logements sociaux à hauteur d'un minimum de 20% du parc de logements locatifs des quartiers du Littoral Est.
La crise du logement est criante dans nos quartiers, qui sont également de plus en plus touchés par la gentrification. Plus de 2300 ménages sur notre territoire sont en situation de « besoin impérieux » de logement, c'est-à-dire que leur logement est inadéquat, inabordable ou d'une taille non convenable, et que leur niveau de revenus est insuffisant pour leur permettre de payer les frais d'un logement approprié et adéquat dans leur communauté.
En résumé, nous demandons aux candidates et aux candidats de :
● reconnaître que le Littoral Est est une zone sacrifiée ;
● s'opposer à un éventuel projet de terminal de conteneurs promu par l'entreprise QSL au Port de Québec et à tout autre projet émetteur de pollution atmosphérique ;
● d'accorder un statut légal de protection aux battures de Beauport ;
● d'assurer un accès direct, sécuritaire et convivial à la baie de Beauport via l'avenue D'Estimauville ;
● se doter d'un objectif chiffré de bonification de l'enveloppe budgétaire destinée au logement social dans le secteur afin d'atteindre 20% du marché locatif.
Que proposent nos candidates et candidats à titre d'engagements électoraux pour améliorer la qualité de vie des quartiers littoraux, assainir l'air de la Basse-Ville, aménager de meilleurs accès au fleuve et concrétiser notre droit au logement ? Nous souhaitons vous entendre.
Accès Saint-Laurent Beauport
Table citoyenne Littoral Est
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Quand la menace plane, ça prend une vraie assurance emploi ! » dit le Conseil National des Chômeurs et Chômeuses

Montréal, le 3 avril 2025 – Le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) s'invite dans la campagne électorale, revendiquant un régime d'assurance-emploi plus juste et plus robuste dans le contexte actuel d'incertitude politique et économique provoquée par les menaces et décisions du président des États-Unis.
Le slogan du CNC, « QUAND LA MENACE PLANE, ÇA PREND UNE VRAIE ASSURANCE-EMPLOI » sera destiné aux partis fédéraux, tout en cherchant à sensibiliser la population, afin de faire de l'assurance-emploi un enjeu important de l'élection. Dans cet objectif, le CNC s'est inscrit comme « tiers » auprès d'Élections Canada, et déploiera sur l'ensemble du territoire québécois des milliers de pancartes de type électoral et une large panoplie d'outils de communication en ligne.
En conférence de presse, les co-porte-paroles du CNC, Selma Lavoie et Milan Bernard, ont fait valoir la nécessité d'un filet social réformé, plus juste et mieux adapté aux réalités du monde du travail et aux crises qui s'abattent sur nos sociétés.
« On ne peut pas s'arrêter aux mesures de soutien annoncées juste avant la campagne électorale et on ne peut encore moins se permettre des reculs. Il faut que le régime soit bonifié, qu'il devienne plus simple et plus protecteur. C'est fondamental, particulièrement dans le contexte actuel où les décisions et menaces du président des États-Unis font craindre des pertes d'emplois importantes » - Milan Bernard, co-porte-parole du CNC
« Nous en appelons ainsi aux partis fédéraux : ils doivent s'engager à élargir la couverture et assouplir les trop graves sanctions rattachées aux raisons de fin d'emploi présentement jugées invalides. Ils doivent aussi mettre des mesures qui protègent mieux les travailleurs et travailleuses des industries saisonnières. Les électeurs et électrices vont avoir cela en tête au moment de voter le 28 avril prochain » - Selma Lavoie, co-porte-parole du CNC
« Ceux qui aspirent à nous gouverner ne doivent en aucun cas se laisser influencer par le démantèlement de l'État opéré au sud de notre frontière par Trump et sa bande, cela doit être dit haut et fort », ont conclu les co-porte-paroles.
Nos revendications
En compagnie des grandes centrales syndicales québécoises (FTQ, CSN, CSQ et CSD) et du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) revendique les mesures suivantes pour faire face aux crises d'aujourd'hui et de demain :
• Une norme universelle d'admissibilité de 420 heures ;
• Une augmentation du montant des prestations et l'établissement d'un seuil plancher à 500 $ ;
• L'exclusion pour fin d'emploi invalide circonscrite au dernier emploi occupé (un demandeur sur 4, qui a travaillé et cotisé au régime au cours de la dernière année, est refusé en raison de ces sanctions) ;
• Un prolongement de la mesure actuelle permettant de recevoir des prestations plus tôt en simplifiant les règles qui régissent le traitement des indemnités de départ et autres sommes versées à la suite d'une cessation d'emploi.
Pour en savoir plus : www.lecnc.com/pensezy
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lutte contre les paradis fiscaux : un appel aux candidats fédéraux

Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein, le collectif Échec aux paradis fiscaux met en garde contre l'absence de mesures concrètes pour lutter contre l'évasion fiscale. Dans une lettre ouverte publiée dans Le Devoir le 1er avril 2025, l'organisme propose deux pistes d‘action pour renforcer la justice fiscale et protéger les services publics.
Tiré de Ma CSQ.
Un manque de transparence persistant
Le Canada figure parmi les pays les plus permissifs en matière d'opacité fiscale. Depuis 2016, les multinationales doivent produire une « déclaration pays par pays » détaillant leurs activités à l'étranger, mais ces données restent confidentielles. Échec aux paradis fiscaux revendique un accès public à ces informations afin de permettre aux journalistes et aux organismes de la société civile de jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir.
Une imposition plus juste des multinationales
Malgré l'adoption en 2024 d'un impôt minimum mondial de 15 %, le collectif estime que cette mesure est insuffisante. Elle laisse subsister de nombreuses exemptions et contribue à normaliser un taux d'imposition artificiellement bas. Selon les estimations, les stratégies d'évitement fiscal coûtent à l'État canadien 12,7 milliards $ annuellement, ce qui correspond à plus de 3 % des dépenses de santé du pays. Le groupe plaide pour un taux effectif d'imposition des multinationales porté à 25 % afin d'assurer la pérennité du modèle social canadien.
Face à ces enjeux, Échec aux paradis fiscaux exhorte les partis politiques à intégrer ces revendications à leur programme. Pour l'heure, les principaux candidats demeurent silencieux sur ces questions cruciales pour l'avenir fiscal du Canada.
Paradis fiscaux : deux pistes pour dépasser l'évidence électorale (Élections fédérales 2025)
La dernière page de l'ère Trudeau se tourne à peine que, déjà, les dés électoraux semblent jetés. En dépit des divergences entre les partis, les principaux candidats semblent s'entendre sur une chose : l'heure est aux baisses d'impôt. Les prochaines semaines de campagne électorale annoncent une surenchère de mesures d'« allégement » qui, au nom de la vigueur économique nationale, continueront d'affaiblir un filet social déjà vacillant.
La question de la répartition juste des responsabilités fiscales est bien sûr cruciale, mais elle ne peut se résumer à la réduction des sources de revenu public. Le changement de ton à Washington, où trumpiens et GAFAM parlent d'une même voix, appelle un nouvel élan de solidarité sociale, que le gouvernement fédéral doit soutenir pleinement. Cette solidarité passe avant tout par la défense de nos services publics et la lutte contre le recours aux paradis fiscaux, qui chaque année prive l'État de revenus essentiels à la santé des finances publiques.
Le silence des candidats sur cette question fait douter de leur résolution à prendre le problème de l'évitement fiscal des multinationales et des riches particuliers au sérieux. Dans le cadre de cette campagne électorale, le collectif Échec aux paradis fiscaux propose ici aux aspirants premiers ministres deux pistes concrètes d'action afin de parer notre modèle social à la tempête qui vient.
Combattre l'opacité canadienne
L'opacité considérable du système canadien nous empêche d'avoir une idée claire de la somme d'impôts effectivement payée par les multinationales faisant affaire au pays. Les compagnies opérant sur le sol canadien sont en effet soumises à des exigences de déclaration particulièrement faibles, qui classent le Canada parmi les cinq principaux pays responsables des abus transfrontaliers identifiés par le Tax Justice Network[1] .
Pourtant, depuis 2016, le gouvernement fédéral dispose d'une source d'information importante sur les activités des multinationales connue sous le nom de « déclaration pays par pays ». Dans ces déclarations, les sociétés multinationales répertorient les activités économiques qu'elles mènent dans l'ensemble des pays où elles opèrent. Le problème n'en est donc pas un de disponibilité des données, mais bien d'accès à celles-ci : le gouvernement refuse de les rendre disponibles au grand public, invoquant des questions de protection des données privées.
« Le problème n'en est donc pas un de disponibilité des données, mais bien d'accès à celle-ci […] »
En garantissant un accès public et gratuit aux données des déclarations pays par pays, le Canada permettrait aux journalistes et aux organisations de la société civile de jouer plus efficacement leur rôle de chien de garde de la démocratie. Alors que le pouvoir économique des multinationales confère à celles-ci une influence politique grandissante, la préservation de ces foyers de contre-pouvoir est essentielle. Cette mesure, déjà mise en œuvre depuis l'automne dernier par l'Australie, contribuerait à un assainissement considérable du système fiscal canadien.
Imposer justement les profits des multinationales
En dépit de l'opacité, il y a de bonnes raisons de croire que les sommes d'impôt payées effectivement par les multinationales sont minimes. Les rares estimations, forcément partielles, évoquent des taux moyens d'imposition allant « au mieux » jusqu'à 9,6 %[2], bien en deçà du taux statutaire fédéral-provincial moyen établi à 26,6 %.
Pour lutter contre cette tendance à la moins-disance fiscale, le gouvernement canadien place depuis 2019 ses espoirs dans la loi dite de l'« impôt minimum mondial ». Cette mesure phare de la réforme de la fiscalité internationale de l'OCDE, entrée en vigueur au Canada en juin 2024, promet de mettre fin à la concurrence fiscale entre les États en instaurant un seuil d'imposition minimale de 15 % pour toutes les multinationales réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 750 millions d'euros.
À bien y regarder, cette promesse semble plutôt relever de l'illusion. L'impôt minimum mondial ne dispose pas des armes législatives pour mener son projet à bien. Non seulement prévoit-il des provisions exemptant certains types de revenu de l'assujettissement au taux minimum, mais il contribue également à normaliser la pratique d'un taux d'imposition artificiellement bas. Pourquoi en effet payer le taux prévu par la loi fiscale lorsque le taux minimum est fixé à seulement 15 % ?
Un sérieux coup de barre est nécessaire pour éviter d'accentuer la tendance en vigueur, conséquence de la stratégie actuelle du gouvernement canadien. Depuis des années, le collectif Échec aux paradis fiscaux réclame une cible du taux effectif d'imposition des multinationales fixé à 25 %, ce qui rapprocherait le Canada de la moyenne des États de l'OCDE. L'évitement fiscal des grandes sociétés s'élève annuellement à 12,7 milliards de dollars, soit plus de 3 % des dépenses canadiennes totales en santé.
Un engagement ferme du Canada en faveur d'un taux effectif à 25 % représenterait un premier pas en vue de la pérennisation des assises fiscales de notre modèle social[3]. En ces temps tumultueux, nous appelons les candidats à faire preuve de courage et à exiger que les multinationales paient leur juste part au Trésor public.
Notes
[1] Tax Justice Network, “Justice fiscale : État des lieux 2024”, 2024, p. 34. En ligne : https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2024/11/State-of-Tax-Justice-2024-French-Tax-Justice-Network.pdf ..
[2] Anis Maaloul, “L'adoption de la déclaration pays par pays (DPP) du projet BEPS a-t-elle affecté l'évitement fiscal des multinationales ? Cas des multinationales canadiennes”, 2023, Cahier de recherche 2023-03, Université de Sherbrooke, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, p. 17-19.
[3] Consulter la section “Encaisser” de la campagne “Démasquer, Condamner, Encaisser” du collectif Échec aux paradis fiscaux à l'adresse suivante : https://echecparadisfiscaux.ca/campagne/encaisser/ .

Élections : 4 des 5 partis fédéraux s’engagent à respecter le Consensus québécois en environnement

À l'aube des élections fédérales, quatre des cinq principaux partis politiques – le Bloc Québécois, le Nouveau Parti démocratique (NPD), le Parti libéral (PLC) et le Parti vert – se sont engagés à respecter le Consensus québécois en environnement dans le cadre de l'élaboration de leurs plateformes politiques respectives.
Cette initiative, portée par la coalition Vire au vert – qui regroupe une vingtaine d'organisations de la société civile québécoise – représente le « strict minimum » à respecter pour assurer la crédibilité des propositions environnementales des plateformes électorales aux yeux de l'électorat du Québec.
Quant au Parti conservateur du Canada (PCC), il n'a toujours pas signifié d'appui au Consensus, et ce, malgré de multiples communications initiées par Vire au vert depuis le lancement du Consensus en octobre dernier.
« On a donné beaucoup de temps aux partis pour qu'ils puissent prendre position, même si pour nous, ce consensus représente le strict minimum à respecter en matière d'environnement. Les élections approchent à grands pas et l'électorat du Québec a le droit de savoir où logent leurs potentiels élu(e)s sur ce plan », affirment les groupes membres de la coalition.
« Qui nous sommes »
La coalition Vire au vert rappelle que le Consensus québécois ne constitue en rien une liste de souhaits idéalistes ou radicaux, mais plutôt une série de grands principes à respecter sur le plan climatique et environnemental.
Par exemple, notre eau, nos lacs et nos rivières sont des richesses collectives précieuses que nous voulons protéger contre la pollution, et nos terres agricoles sont cruciales pour notre résilience alimentaire. Voyez l'ensemble des éléments du Consensus.
« Il s'agit d'une série de choix politiques et sociaux qui ont façonné le développement du Québec, qui représente qui nous sommes comme nation, comme peuple », concluent les groupes.
Partenaires de Vire au vert pour les élections fédérales 2025
Accès transports viables, Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME), Centre d'écologie urbaine, Coalition Québec meilleure mine, Eau Secours, ENvironnement JEUnesse, Équiterre, Fondation David Suzuki, Fondation Rivières, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Front étudiant d'action climatique (FÉDAC), Mères au front, Nature Québec, Piétons Québec, Réalité climatique Canada, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, Réseau des femmes en environnement, Trajectoire Québec, Vélo Québec, Vigilance OGM, Vivre en Ville.

Ces universitaires experts du fascisme qui quittent les États-Unis pour le Canada

Trois professeurs de la prestigieuse université Yale ont quitté les États-Unis de Trump pour enseigner à Toronto, au Canada. Il s'agit du couple d'historiens formé par Timothy Snyder et Marci Shore, tous deux spécialisés sur les régimes autocratiques et l'Europe de l'Est, et du professeur de philosophie Jason Stanley, qui a abondamment écrit sur le fascisme et la propagande.
Tiré de Courrier international.
C'est un peu comme si l'université de Toronto était en train de se muer en refuge pour les universitaires américains experts de l'autocratie et du fascisme, souligne le quotidien canadien The Globe and Mail.
Trois professeurs de la prestigieuse université Yale – tous trois virulents critiques du président Donald Trump – occupent en effet désormais des postes d'enseignement à la Munk School of Global Affairs & Public Policy, le département des affaires internationales et des politiques publiques de l'université de Toronto, rapporte le journal.
La semaine dernière, le professeur de philosophie américain Jason Stanley, expert du fascisme et de la propagande, a en effet annoncé qu'il quittait lui aussi les bancs de Yale pour ceux de l'université de Toronto. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués, dont Les Ressorts du fascisme, paru en 2022 en France aux éditions Eliott.
Il vient y rejoindre le couple d'universitaires spécialisés dans l'histoire de l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique, Marci Shore et Timothy Snyder, qui ont déménagé à Toronto l'été dernier dans le cadre d'un congé sabbatique et pour lesquels “la réélection de Donald Trump a lourdement pesé dans leur décision de rester au Canada” et d'enseigner à l'université de Toronto.
“Sonner l'alarme”
Ces universitaires américains ont non seulement choisi de s'exiler, mais ils utilisent leurs nouvelles chaires pour “sonner l'alarme” sur les dérives de l'administration Trump, notamment ses attaques contre l'enseignement supérieur aux États-Unis, ainsi qu'exprimer “leurs craintes face à la montée de l'autoritarisme au sud de la frontière”, souligne le quotidien canadien. Début février, l'historien Timothy Snyder a été l'auteur d'un post très remarqué sur la plateforme Substack, dans lequel il dénonçait le coup d'État numérique en cours de Donald Trump et Elon Musk.
C'est aussi ce que fait le professeur de philosophie Jason Stanley dans une longue interview accordée au magazine américain Vanity Fair et publiée ce 31 mars. Dans cet entretien, il confesse quitter Yale à regret pour rejoindre le Canada, devenu, en quelque sorte, “l'Ukraine de l'Amérique du Nord”.
Il y souligne notamment que l'Amérique de Trump est de plus en plus enferrée dans les griffes du fascisme : “Les choses vont très mal dans ce pays. Nous sommes face à un régime autoritaire. Les gens ne réagissent pas. Les choses vont plus vite qu'en Russie, et les journalistes n'agissent même pas de manière à se faire tirer dessus ou à être défenestrés – ce qui est censé arriver aux journalistes dans ce genre de situation”, déplore-t-il non sans une pointe d'humour noir.
L'élément déclencheur qui l'a poussé à déménager au Canada ? C'est la récente “capitulation de l'université Columbia”. La célèbre université new-yorkaise a en effet très récemment accédé à l'essentiel des demandes du gouvernement Trump pour ne pas perdre ses financements fédéraux.
“La démocratie passe avant le prix des œufs”
Dans cette interview, l'universitaire dénonce un climat étouffant et confesse être en train de vivre, en tant qu'Américain juif, “le moment le plus antisémite de ma vie”. Il évoque les manifestations pro-Gaza de ces derniers mois sur les campus et leur répression, et qualifie la politique du gouvernement Trump d'“attaque antisémite sur l'antisémitisme”.
“J'aimerais vivre aux États-Unis, mais je veux vivre aux États-Unis parce que c'est un pays libre”, conclut-il sur une note aussi alarmiste que caustique. “Un grand nombre d'Américains se moquent de la liberté. Les sondages montrent que les Américains n'ont que faire de la démocratie. Mes valeurs sont différentes. Pour moi, la démocratie passe avant le prix des œufs [une denrée particulièrement touchée par l'inflation outre-Atlantique]. Ce que je trouve particulièrement insensé, naïf et stupide, c'est de renoncer à la démocratie et d'augmenter le prix des œufs.”
Interrogée dans les colonnes du Globe and Mail, la directrice de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'université de Toronto, Janice Stein, souligne de son côté qu'il est essentiel que son département multiplie les travaux de recherche et les enseignements sur l'autoritarisme et la démocratie alors que les États-Unis s'engagent “sur une voie profondément inquiétante”.
“Il est très troublant d'y voir les universités prises pour cible, des étudiants harcelés, arrêtés, expulsés, détenus”, explique-t-elle au quotidien canadien, avant de conclure : “Les universités sont la première cible. Les universités et les tribunaux – c'est toujours ainsi que se déroule le scénario du pire. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux.”
Bérangère Cagnat
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La nostalgie centriste ne viendra pas à bout de la menace trumpiste sur le Canada

Même si les Démocrates sont encore abasourdis.es et dans la peur post-électorale, les libéraux centristes dans d'autres pays occidentaux dont les démocraties les plus importantes, on observe un regain d'énergie et de soutien populaire grâce aux menaces de D. Trump. Une des particularités de sa vision élargie c'est de considérer les alliés traditionnels des États-Unis méritent d'être punis.
Jeet Heer, The Nation, 24 mars 2025
Traduction, Alexandra Cyr
Pour preuve la guerre commerciale lancée contre le Canada, le Mexique et l'Europe. De même de son appel pour que le Canada, le Groenland et le Panama soient intégrés aux États-Unis. Mais ce fut une bénédiction pour les partis de centre gauche qui faisaient face à des insurrections de la part de partis populistes de droite et qui maintenant ont l'opportunité de se présenter comme les défenseurs du patrimoine national.
Le cas du Canada est particulièrement intéressant. Jusqu'à récemment, le Parti libéral, sous la gouverne du Premier ministre Justin Trudeau, s'apprêtait à être battu fermement lors de la prochaine élection (fédérale). Après une décennie de pouvoir, le charme juvénile de J. Trudeau avait pâli, subit le traumatisme de la Covid et une inflation démoralisante pour le Parti. L'électorat indécis, dans ce contexte, était prêt au changement. Le Parti conservateur sous la direction de Pierre Poilievre, un troll habile agitateur « anti woke » à la JD Vance, avait brandit un puissant message anti système : Le Canada est brisé.
Mais, quand D. Trump a commencé à dire qu'il n'y avait aucune raison pour que le Canada existe comme nation et qu'il devrait devenir le 51ième État américain, la dynamique politique canadienne a été transformée. Brisé ou non, li fallait se porter à la défense du Canada. Les Libéraux se sont retrouvés en bien meilleure position pour se présenter comme le Parti de l'unité nationale en temps de crise, plutôt que les Conservateurs, le Parti néodémocrate (NPD) ou les séparatistes du Bloc Québécois. Après avoir dirigé le pays pendant 70 ans au 20ième siècle, les Libéraux sont tenus pour le Parti de gouvernement naturel du pays ; le parfait Parti auquel se rallier en temps de crise.
Le 19 février, après une courte course à la direction du Parti, les Libéraux sont passés de J. Trudeau à l'ancien banquier, Mark Carney qui a endossé le costume du leader de l'unité nationale. Durant cette période échevelée, les Libéraux ont vu leur quote de popularité atteindre un point historique dans les sondages. Au moment de l'assermentation du Président Trump, les Conservateurs était à 44.8% dans les sondages et les Libéraux à 21.9% selon l'agrégateur de la CBC. Depuis ce moment, les scores se sont rapproché à 37.8% pour les Libéraux à 37.2% pour les Conservateurs. Cette amélioration de la position des Libéraux est largement attribuable à l'effondrement des appuis au NPD et au Bloc québécois. Le NPD a été le Parti associé aux Libéraux depuis 2021 qui avait été élu sans majorité et qui avait besoin d'un partenaire parlementaire pour gouverner. Mais la menace de D. Trump a affaibli la prétention du NPD à l'effet qu'il méritait une récompense pour avoir poussé le gouvernement libéral à sa gauche et obtenu l'introduction de politiques comme le financement des soins dentaires.
L'électorat de centre gauche, effrayé par D. Trump et convaincu que les Conservateurs étaient trop proche de lui pour leur faire confiance, ont rallié la bannière libérale. Le rapprochement entre les deux Partis dans les sondages est trompeur ; les Conservateurs bénéficient d'un important appui dans les zones rurales de l'ouest du pays alors que les libéraux ont une position enviable partout dans le pays ce qui leur permet de jouir du vote « utile » pour utiliser le jargon des sciences politiques.
Compte-tenu de cette remontée dans les sondages et de l'actuel courant nationaliste canadien anti Trump, il n'est pas étonnant que dimanche, Mark Carney ait convoqué les électeurs.trices à une élection anticipée le 28 avril prochain. Les libéraux ont de bonnes raisons de penser qu'ils pourront profiter d'une majorité malgré que le dynamisme des élections canadiennes puisse renverser la tendance actuelle.
Mais gagner les élections n'est qu'une partie de la politique ; gouverner est également crucial. Même si je ne doute pas que les Libéraux aient d'excellentes chances de gagner cette élection, je crains que la politique d'unité centriste de M. Carney ne réussisse pas à transformer la passion nationaliste en politiques qui puissent résoudre les profonds problèmes économiques et sociaux (du pays).
Il est fort possible qu'il continue la politique néo libérale d'affaiblissement des capacités de l'État ce qui rendrait le Canada vulnérable devant le populisme de droite interne, devant les visées expansionnistes et les attaques de D. Trump. D'une certaine façon, M. Carney est la version canadienne de Joe Biden en 2020 : le candidat sûr pour tenir la position et qui promet le retour de la normalité en temps perturbés. Mais, comme J. Biden a été incapable de maitriser la situation, on a toutes les raisons de penser que les politiques d'ancien régime de M. Carney n'auront fait que repousser le triomphe de l'extrême droite.
Dans toute sa personnalité, M. Carney est un technocrate néo libéral, même s'il se présente en assurant qu'il a une conscience sociale aiguisée. Il est né en 1965, a étudié à Harvard et Oxford avant de travailler pendant 13 ans comme consultant chez Godman Sachs. En 2003, il entre à la Banque centrale du Canada et occupe aussi divers postes au gouvernement. En 2007, il devient Gouverneur de la Banque centrale du Canada et ensuite, de 2013 à 2020, gouverneur de celle d'Angleterre. Il a plus tard été vice-président de la firme multinationale Brookfield qu'on évalue à la hauteur de trois mille milliard de dollars. (Son portefeuille de New-York comprends Brookfield Place).
Pas étonnant, qu'avec ce passé, les premiers gestes de M. Carney dans le Parti libéral, qui n'était pas vraiment des plus énergiques, soient de le recentrer. À titre de Premier ministre, il a immédiatement aboli la taxe carbone qu'il avait pourtant soutenue pour souligner sa fibre envers la lutte aux changements climatiques. Ensuite il a aussi annulé une proposition d'augmentation de l'échelle des gains en capitaux. Ces deux décisions visent directement l'électorat conservateur entre autre l'annulation de l'augmentation de l'échelle des gains en capitaux va directement bénéficier au plus riches contribuables.
Dans un article dans Canadian Dimensions, James Hardwick souligne que dans son ouvrage de 2021, Value(s) : Building a Better World for All, M. Carney souligne les grands problèmes comme les changements climatiques et les inégalités économiques. Mais il insiste pour dire que leur solution passe par des bricolages techniques et une amélioration de la conscience sociale. Il écrit : « les individus et leurs entreprises doivent redécouvrir leur sens de la solidarité et de responsabilité envers le système. Plus largement, en basant plutôt nos valeurs sur celles de la société nous pourrons créer des plateformes de prospérité ».
Comme le souligne M. Hardwick, ces nobles sentiments sont bien loin de l'ampleur des problèmes du Canada et du monde :
« C'est le fondement de sa vision pour un monde meilleur. Il croit sincèrement qu'il est possible de créer un nouveau véhicule néo libéral éthiquement responsable. Ultimement, il n'est pas intéressé à affronter l'oligarchie corporative et son pouvoir. Il veut plutôt utiliser les incitations financières des marchés pour encourager les oligarques à agir en faveur de l'aspect social. Il pense que les excès du capitalisme peuvent être contenus par la création de mesures justes, des métriques spécifiques et du « benchmarking ». (Limites à ne pas franchir. Nd.t.)
Sur Substack, le journaliste Luke Savage est dans le même ton. Il donne une analyse tout aussi dévastatrice de l'énorme fossé entre la crise mondiale actuelle, que M. Carney comprend autant que n'importe qui et ses propositions de solutions anémiques : « Avec un manque d'analyse sérieuse du pouvoir, tout en opérant dans les limites du système qu'il prétend critiquer, il nous laisse avec des propositions qui sont autant brumeuses qu'insatisfaisantes. Un peu de persuasion morale ici, un peu plus de conscience de classe éthique, quelques ajustements mineurs dans les règles du gouvernement et Miracle : un capitalisme mondial plus gentil, plus tendre nous attend ».
Pour avoir une idée d'à quel point les alternatives avancées par M. Carney sont inadéquates pour répondre au « trumpisme » il vaut la peine de visionner la publicité qu'il a publié samedi où il se met en scène avec le comédien Mike Myers. Tous les deux portent des chandails de hockey, se rencontrent dans une aréna et assistent à une partie. M. Carney questionne M. Myers, qui est né au Canada mais réside aux États-Unis, à propos de divers aspects de la culture populaire canadienne. Ils échangent à propos du programme pour enfants, Mr. Dressup, avec les marionnettes Casey et Finnegan, la bande rock The Tragically Hip et la chanson « Bud the Spud » de Tom Connor.
Pour la génération des Canadiens.nes anglais.ses de 40 ans et plus, c'est une plongée dans les souvenirs. Ce fut un succès relatif sur les médias sociaux. Mes ces références à la culture populaire auront peu de résonnance chez les plus jeunes, l'émission a disparu en 1996, ni chez beaucoup d'immigrants.es et pas non plus chez les Canadiens.nes français.es.
L'étroitesse de cette annonce n'est pas le seul problème. Le nationalisme de M. Carney est nostalgique et lisse. Jusqu'ici, le nationalisme canadien a toujours inclus de grands projets d'État : la construction du chemin de fer au 19ième siècle, la création du système de santé national, un soutien important à la culture canadienne avec le diffuseur national et la promotion du bilinguisme.
Dans la crise actuelle, il se peut que le chamboulement économique exige des réponses fortes de ce type. Un nationalisme plus visionnaire pourrait renforcer notre alliance avec le Mexique et des nations de notre hémisphère autre que les États-Unis. Nous pourrions renforcer notre population avec des programmes pour recruter des Américains.nes découragés.es, en investissant dans un train à haute vitesse (TGV), et en mettant à jour notre système de santé. En bon néo libéral qu'il est, M. Carney refuse d'investir l'imagination nécessaire que la politique du moment exige. D. Trump est un fasciste avéré aux États-Unis qui menace d'annexer le Canada. En semant le doute sur la souveraineté du pays et la sécurité de sa frontière, il parle de son voisin du nord de la même manière que Vladimir Poutine parle de l'Ukraine et que Benjamin Netanyahu parle de Gaza et de la Cisjordanie. Devant une telle menace, il faut un esprit combattif sans nostalgie. On ne peut combattre le fascisme en invoquant des marionnettes de la télévision que vous avez aimées lorsque vous étiez enfant.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Corridor pour fossiles

Les élections du 28 avril se tiennent dans le contexte d'une tourmente trumpienne. Nous devons réagir ! Pour tenter de coordonner une réponse commune face à cette menace économique, le Premier ministre Carney et ses homologues provinciaux ont tenu une conférence au Musée de la guerre le 21 mars dernier.
Ils ont convenu de favoriser le commerce interprovincial sur un axe est-ouest et de faciliter l'exportation de nos ressources vers des marchés autres que les États-Unis. Ils sont « ...tombés d'accord pour créer un corridor national pour faciliter le transport et l'exportation du pétrole et du gaz... » ainsi que d'autres produits.[1]
Un corridor est-ouest pour faciliter les échanges commerciaux entres les provinces et pour diversifier nos marchés d'exportation, je veux bien…, pourvu que ce corridor respecte la priorité des priorités. L'éléphant dans la pièce durant cette élection hors normes, ce sont les changements climatiques. Il ne faudrait pas que notre réponse à l'ouragan de la perruque orange nous fasse oublier l'avenir des jeunes générations vivant sur une planète dont les écosystèmes ont été fragilisés par la combustion de trop d'énergies fossiles ! Dans les faits, est-ce que le CORRIDOR proposé se limitera uniquement à la résurrection de l'oléoduc Énergie Est et du gazoduc GNL Québec et de son port méthanier ? Est-ce que l'électricité et les énergies de l'avenir nécessaires à une véritable transition énergétique seront renvoyées aux calendes grecques ?
Comme des joueurs d'échecs, nous devons réagir à la menace immédiate à notre « roi » tout en planifiant nos actions stratégiques pour le combat à long terme. Même pour un jovialiste, construire un oléoduc de 4 600 Km comme Énergie Est requiert minimalement 5 ans. À ce moment-là, le mandat de Trump sera terminé. Mais nous serons pris avec un éléphant blanc dispendieux. Le coût pharaonique de ce future corridor risque d'être tellement élevé qu'on se rappellera avec nostalgie que TransMountain a coûté seulement 50 milliards de dollars aux contribuables canadiens.[2]
Énergie Est et GNL Québec ont été abandonnés par le gouvernement du Québec ET celui d'Ottawa à cause des problèmes économiques et environnementaux et du manque d'acceptabilité sociale. Aussi bien la société québécoise que les deux paliers de gouvernement ont convenu que le jeu n'en valait pas la chandelle ! Malgré Trump et l'incertitude économique, il faut évaluer sérieusement si les raisons qui ont amené le rejet de ces projets générateurs de destruction climatique sont toujours valides.
En ce qui a trait aux évaluations nécessaires pour ce futur corridor, M. Poilievre déplore que « ...la loi anti-pipeline C-69 est toujours en vigueur…. »[3] Quant à M. Carney, il propose d'éliminer les dédoublements en « ...reconnaissant les évaluations des provinces ... ».[1] Heureusement qu'il reconnaît la qualité des évaluation du BAPE (Bureau d'audiences publiques sur l'environnement). On se souviendra qu'en 2015-2016, Trans-Canada Pipelines et Énergie Est refusaient systématiquement de se soumettre aux audiences du BAPE alléguant qu'ils reconnaissaient seulement l'autorité du NEB/ONE (National Energy Board/Office national de l'énergie). On a compris le pourquoi de cette obstination lorsqu'on a appris que M. Watson, le premier dirigeant du NED, et deux membres de l'office ont eu une rencontre secrète derrière des portes closes avec un lobbyiste d'Énergie Est.[4] Ce manque de transparence par une entité quasi-judiciaire a mis du plomb dans l'aile de la cause d'Énergie Est ! Est-ce que la justification pour construire les pipelines de ce corridor énergétique requiert des évaluations bidons ???
En période électorale, les lobbyistes tordent le bras de tous les politiciens prétextant l'urgence ; ils placent leurs « pions » pour être en position de force pour l'avenir prévisible.[5] Dans la campagne électorale, la taxe fédérale sur le carbone, un outil efficace contre les changements climatiques, est tombée, victime de la petite politicaillerie partisane avec une vue à court terme. Mais, dans cette partie d'échecs, les tarifs et la lubie du « 51e État » de Trump mettent une pression difficilement tolérable sur les « tours » et les « chevaliers » du Canada et du Québec. Mais la partie se gagne en protégeant le « roi », c'est-à-dire le climat. Notre « reine » est placée stratégiquement car le corridor des énergies fossiles doit obligatoirement traverser le Québec. Au nom des jeunes et de toute la biodiversité, utilisons cet atout pleinement pour mettre les projets pétroliers et gaziers « échec et mat » !
Gérard Montpetit
membre du CCCPEM
le 2 avril 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Solidarité avec la Palestine

Rien ne peut pas nous arrêter,
l'injustice ne peut pas nous paralyser,
l'oubli ne peut pas s'installer dans nos esprits.
C'est la mémoire qui doit nous guider,
c'est le sens de l'amour et de la justice qui doit nous faire marcher, parler, pleurer sur le chemin, mais sans rester à la traîne.
« La Palestine, du fleuve à la mer, vaincra » n'est pas seulement une phrase,
c'est une conviction dans la lutte contre les cruautés,
c'est un désir de se souvenir de l'humanité,
c'est comprendre que dans tous les territoires où la persécution, la criminalisation et le meurtre ont lieu, où tout fait mal et fait rage,
c'est là que les racines de nos pieds nous disent que nous ne pouvons pas abandonner, que nous ne pouvons pas nous fatiguer.
Abandonner n'a jamais été une option,
car tout comme en Palestine, en Amérique latine,
nous continuons à rêver d'une vie digne pour tous, pour chacun, pour tous.
Nous continuons parce que nous savons que les vies pour lesquelles nous luttons vont au-delà des vies humaines ;
nous luttons pour des vies qui, à leur tour, donnent la vie,
parce que le complément fait partie de la vie même que nous défendons.
Le poème est écrit par Cony Oviedo, militante féministe du Paraguay, Marche mondiale des femmes et représentante des Amériques au Comité international de la Marche mondiale des femmes.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Marchons pour Du pain et des roses, encore… et plus que jamais !

Il y a 30 ans, à l'initiative de la Fédération des Femmes du Québec, dans un élan sans précédent, plus de 850 femmes parcouraient plus de 200 km, en 10 jours, sur les routes du Québec pour réclamer du pain et des roses — du pain, pour mettre fin à la pauvreté, et des roses, pour vivre dans la dignité.
Aujourd'hui, en 2025, la FFQ vous invite à honorer et poursuivre cette grande mobilisation pour l'égalité des femmes et la justice sociale que demeure la Marche des femmes contre la pauvreté “Du pain et des roses”.
Événement très rassembleur pour la société québécoise, cette marche historique a concentré les énergies et les espoirs d'un nombre incalculable de femmes, d'individus et d'organisations très variées. Son rayonnement a dépassé le Québec et a été la bougie d'allumage de la Marche mondiale des femmes qui en sera à sa 6e édition en 2025 et qui réserve une place de choix au 30e anniversaire de “Du pain et des roses”.
Marchons ensemble pour garder la mémoire collective bien vivante, souligner l'héritage de ce mouvement, se rappeler qu'il reste des kilomètres à parcourir et, surtout, ne jamais baisser la garde.
Des marches locales et régionales auront lieu partout au Québec ce printemps du 26 mai au 4 juin 2025, pour souligner les luttes féministes, faire entendre nos voix et bâtir un avenir plus juste.
Le point culminant de cette mobilisation consistera en une grande marche, le 7 juin prochain, de 13h a 16h, à Québec. Réservez cette date à votre agenda et faisons ensemble vibrer nos pas et notre volonté à l'unisson.
Dans un contexte géopolitique et socioéconomique instable et préoccupant, nous sommes encore en marche et nous ne pouvons pas rester immobiles face aux reculs, aux actualités, à la menace qui gronde.
Il est aussi essentiel de faire l'état des lieux quant au 9 revendications de la marche contre la pauvreté Du pain et des roses de 1995, de protéger nos acquis et de revendiquer à nouveau.
De grandes figures du féminisme d'hier et d'aujourd'hui, les militantes et marcheuses de l'époque et d'autres personnalités inspirantes seront présentes, prendront la parole et surtout, marcheront et chanteront avec nous.
Que vous ayez marché en 1995 ou que vous découvriez ce pan d'histoire féministe québécois marquant, votre présence compte.
Vous voulez marcher avec nous ?
Organisez ou informez-vous sur les marches locales et régionales entre le 26 mai et le 4 juin auprès des groupes de femmes ou organisations de votre région
Notez la date du 7 juin pour la marche nationale à Québec.
Invitez vos ami·es, vos collègues, vos proches.
Suivez les actualités de la page FB dupainetdesroses
Épinglez et consultez régulièrement cette page du site FFQ pour ne rien manquer et accéder à des ressources.
Joignez-vous aux bénévoles et organisatrices : painetdesroses@ffq.qc.ca
Le samedi 7 juin : une marche et un grand rassemblement à Québec
La FFQ vous donne rendez-vous à Québec, le samedi 7 juin à 13h, pour une marche symbolique et un rassemblement festif, aux côtés des féministes de 1995 et de 2025.
Toute la population est conviée.
Départ : Musée national des beaux-arts de Québec — là même où les marcheuses des trois contingents se sont rassemblées le dernier jour de la marche de 1995.
Arrêt : Devant l'Assemblée nationale, en mémoire du rassemblement de 15 000 personnes du 4 juin 1995.
Arrivée : Parc de la Francophonie, pour un moment de célébration, de mémoire et de mobilisation.
Du 26 mai au 4 juin 2025 : Marches dans vos milieux
Partout au Québec, des groupes (mixtes et non mixtes) sont invités à organiser des marches collectives de proximité, dans leur quartier, leur localité ou leur région en commémoration du 30e anniversaire de Du pain et des roses. Une actualisation de la mobilisation sous forme de marches.
Ces marches peuvent prendre la forme qui vous convient :
– Une seule sortie ou plusieurs
– Courtes ou longues distances
– En silence ou en musique
– Symboliques ou revendicatrices
L'objectif : marcher ensemble pour du pain et des roses, dans l'inclusion et la solidarité, avec les personnes en situation de pauvreté, de handicap ou vivant d'autres formes de marginalisation.
En marche vers un meilleur avenir, toujours et encore !
Un rappel : les 9 revendications de 1995
1- Un programme d'infrastructures sociales avec des emplois accessibles dès maintenant aux femmes.
2- Une loi proactive sur l'équité salariale.
3- L'augmentation du salaire minimum au-dessus du seuil de la pauvreté (8.15$ de l'heure).
4- L'application de la loi des normes minimales du travail à toutes les personnes participant à des mesures d'employabilité.
5- Un système de perception automatique des pensions alimentaires avec retenue à la source.
6- La création d'au moins 1 500 nouvelles unités de logement social par année.
7- L'accès aux services et aux programmes existants de formation générale et professionnelle, avec soutien financier adéquat, pour toutes les personnes qui ne sont pas prestataires de l'assurance-chômage ou de la sécurité du revenu, en vue de leur insertion ou de réinsertion au travail.
8- L'application rétroactive de la réduction du parrainage de 10 ans à 3 ans pour les femmes immigrantes parrainées par leur mari ainsi que la mise sur pied d'un mécanisme d'accès aux droits sociaux pour les femmes parrainées victimes de violence conjugale et familiale.
9- Le gel des frais de scolarité et l'augmentation des bourses aux étudiantes/ts.
Les marraines de 1995
Titres qu'elles portaient en 1995 :
Anne-Marie Alonzo, auteure dramatique (décédée en 2005)
Audrey Benoît, comédienne et vice-présidente de la Commission des jeunes sur l'avenir du Québec
Aoura Bizzarri, Collectif des femmes immigrantes du Québec.
France Castel, comédienne et chanteuse.
Ariane Émond, écrivaine et journaliste.
Ranee Lee, chanteuse de jazz.
Chantal Petitclerc, marathonienne.
Michèle Rouleau, animatrice de télévision.
Marie-Claire Séguin, compositrice.
Marie-Josée Turcotte, journaliste sportive.
Marjorie Villefranche, de la Maison d'Haïti.
Pour en savoir plus sur la Marche contre la pauvreté : Du pain et des roses
Vous souhaitez contribuer à l'événement, comme organisme ou en votre nom personnel, ou annoncer votre intérêt à y participer ? https://bit.ly/Du-pain-et-des-roses-1995-2025-interet-organisation-participation
Pour rester informée, nous vous invitons à suivre : https://www.facebook.com/Dupainetdesroses1995
Plongez dans l'univers des archives de Du pain et des roses 1995 : https://bit.ly/duPainDesRoses1995
Communiquez avec le comité organisateur : painetdesroses@ffq.qc.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des changements gouvernementaux en défaveur des femmes et des minorités

Le premier ministre Mark Carney a prêté serment le 14 mars dernier devant un cabinet ministériel réduit. En effet, ce sont 13 ministères qui sont soit disparus ou effacés, dont celui des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et celui de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap. Cette situation inquiète les groupes de femmes à travers le Canada, dont la Fédération des femmes du Québec.
Créé en 1976, le ministère des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, autrefois connu sous le nom de ministère de la Condition féminine, jouait un rôle clé pour faire avancer les droits des femmes et l'égalité des genres. Sa disparition en 2025 n'a rien d'anodin : elle prive les femmes et les minorités de genre d'une voix forte au sein du gouvernement, à un moment où les reculs sont déjà tangibles. Il ne s'agit pas simplement d'un réaménagement administratif : l'effacement d'un ministère dédié envoie un message politique fort, reléguant au second plan les questions cruciales d'égalité des genres, de droits des jeunes et des personnes marginalisées.
Comble de l'ironie, pendant qu'on effaçait ce ministère à Ottawa, la ministre Marci Ien défendait avec conviction son importance devant l'ONU, lors de la 69e session de la Commission de la condition de la femme. Un contraste saisissant.
Pendant ce temps, ailleurs dans le monde…
Le Canada n'est pas le seul pays où les mécanismes institutionnels pour l'égalité sont fragilisés. En Hongrie, Viktor Orbán a dissout le ministère de l'Égalité en 2010. En Pologne, depuis 2015, les politiques d'égalité ont été reléguées à un secrétariat symbolique. Aux États-Unis, Donald Trump a dissout le Council on Women and Girls. Ce démantèlement progressif crée des précédents inquiétants, où l'égalité devient une simple variable d'ajustement idéologique.
Aux États-Unis, les droits des femmes sont sauvagement attaqués – tout comme ceux des personnes LGBTQIA2S+, immigrantes et racisées – par un gouvernement ouvertement misogyne et raciste. Coupures dans les politiques d'équité, diversité et inclusion (EDI), restriction jusqu'à l'absurde de l'accès à l'avortement, affaiblissement des législations contre la violence conjugale, rapatriement de l'influenceur masculiniste accusé de trafic humain Andrew Tate, pas une journée ne se passe sans l'annonce d'un nouvel affront.
Mais qu'on se le dise : bien que le Canada soit souvent cité en exemple en matière d'égalité des genres, nous sommes bien loin d'être à l'abri des idées réactionnaires si populaires chez nos voisins du sud et ailleurs dans le monde. Selon un sondage Léger, 15 % des Canadiens voteraient pour Donald Trump s'ils en avaient la possibilité. Qui plus est, 46% des Canadiens sont en accord avec la mesure de Donald Trump d'interdire l'accès aux sports féminins aux personnes transgenres et 40% approuvent sa décision de légaliser qu'il n'y a que deux sexes [sic]. Ces appuis sont révélateurs des courants conservateurs présents ici aussi.
Une montée inquiétante du masculinisme
Au Québec, la montée du masculinisme et le retour des soi-disant « valeurs traditionnelles » inquiètent, comme l'a démontré le tollé autour du documentaire Alpha de Simon Coutu et de l'invitation – heureusement retirée – de l'influenceur masculiniste Joël McGuirk à l'émission Tout le monde en parle en novembre dernier.
Ce retour en arrière trouve évidemment écho dans l'arène politique. Pierre Poilièvre, le chef conservateur qui mène dans les intentions de vote au fédéral, a souvent critiqué les politiques féministes du gouvernement libéral de Justin Trudeau et ce qu'il appelle les « politiques identitaires ». Sa proximité avec des groupes conservateurs et pro-vie dans le parti inquiète les groupes de femmes, notamment en ce qui a trait à ses positions sur l'avortement.
Gare au retour en arrière
Dans ce contexte délétère, la disparition du ministère des Femmes, de l'Égalité des genres – même dans un gouvernement temporaire – inquiète grandement la Fédération des femmes du Québec. Les droits des femmes, des personnes en situation de handicap, des personnes LGBTQIA2S+ et des jeunes ne peuvent être traités comme des enjeux secondaires. Ils constituent le socle d'une société forte, juste et résiliente et d'une économie solide. Dans ce contexte préoccupant, il est plus crucial que jamais de renforcer nos politiques en faveur de l'égalité des genres et de l'inclusion. Aucun acquis n'est permanent. L'égalité des genres n'est pas un luxe ni un dossier accessoire : c'est un indicateur fondamental de la santé démocratique et économique d'un pays. Nous appelons les décideurs, la société civile et l'ensemble des citoyen·nes à rester vigilants et à refuser tout recul.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Changer la game : le RLQ mobilise le milieu sportif pour plus d’inclusion

À l'approche de l'édition 2025 de la Journée de visibilité lesbienne , le Réseau des lesbiennes du Québec lance aujourd'hui la campagne nationale Changer la game, une initiative visant à transformer le milieu sportif québécois en un espace plus inclusif pour les personnes lesbo-queer. Inspirée par l'univers du sport, cette campagne met en lumière les défis spécifiques rencontrés par ces athlètes tout en proposant des actions concrètes pour favoriser un changement durable. Cette campagne invite à devenir des game changers, une expression utilisée pour décrire des événements et des idées qui entraînent un changement important dans les façons de faire ou de penser dans un domaine.
Un terrain plus inclusif : des actions concrètes
Tout au long du mois d'avril, le RLQ invite plusieurs associations sportives du Québec à adopter des pratiques plus inclusives, dans le but de favoriser des changements durables au sein de leurs organisations. Ces actions visent à contrer la lesbophobie et à promouvoir un environnement où toutes les athlètes peuvent évoluer sans crainte de discrimination. « Dans un contexte où de plus en plus d'associations professionnelles pour les femmes voient le jour, il était important pour nous de nous mobiliser pour changer concrètement la game dans le milieu sportif, que ce soit en invitant les associations sportives à adopter ou renforcer une politique anti-discrimination, à offrir des formations sur l'inclusion et la diversité à l'interne ou en les invitant à créer des espaces sécuritaires pour les personnes LGBTQ+ dans leur milieu », explique Cynthia Eysseric, directrice générale du RLQ.
Des chiffres qui parlent
● 67 % des athlètes LGBTQ+ et 85 % des athlètes trans ont vécu au moins un épisode d'homophobie dans le sport canadien (Guylaine Demers, 2017).
● 42 % des Canadiens gais et des Canadiennes lesbiennes ont été victimes ou témoins de discrimination dans un contexte sportif, soit plus du double des personnes hétérosexuelles (Statistique Canada , 2024).
● Les piscines publiques et les vestiaires sont perçus comme les endroits les moins sécuritaires pour les personnes LGBTQ2+ en raison de l'exposition du corps et des espaces genrés (Mémoire UQTR « À la quête d'un safe space en loisir : l'accès des personnes LGBTQ2+ aux services publics et municipaux de loisir ainsi qu'aux infrastructures municipales récréatives et sportives », 2023).
Un appel à l'action pour toute la communauté sportive
« L'absence de visibilité et de représentations positives des sportives lesbo-queer nourrit un sentiment d'exclusion, créant un environnement où des athlètes peuvent se sentir invisibles ou dévalorisées. Cela décourage de nombreuses jeunes personnes lesbo-queer de s'investir pleinement dans le sport ou de se dévoiler, par peur de discrimination ou de marginalisation », ajoute Cynthia Eysseric.
Pour y remédier, la campagne Changer la game met en lumière des athlètes inspirantes à travers des portraits diffusés sur les réseaux sociaux. En offrant des modèles accessibles, cette initiative vise à sensibiliser le grand public et à encourager les fédérations, clubs et athlètes à adopter des pratiques plus inclusives.
Pour en savoir plus sur la campagne, visitez le siteWeb
À propos du RLQ
Le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) est la référence centrale en ce qui concerne les enjeux touchant les différentes communautés lesbiennes au Québec. Depuis 1996, il défend collectivement les droits des femmes et des personnes des communautés lesbo-queer, afin d'amplifier leurs voix et leur visibilité pour leur permettre d'exister pleinement.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Stablex ou l’art de masquer la vérité !

« Il faut être capable de prendre ces décisions-là pour le bien de l'ensemble des Québécois ! » Voilà en quels termes, d'un air frondeur, notre Premier ministre François Legault, justifie la procédure d'exception qu'est le bâillon, pour accélérer l'adoption du projet de loi 93 qui vise à transférer un terrain de la municipalité de Blainville à la compagnie américaine Stablex, spécialisée dans l'enfouissement des déchets dangereux.
Non seulement M. Legault prétend-il parler en notre nom, mais il s'octroie une supposée dose de détermination ou de courage que n'auraient pas les personnes qui s'opposent à l'adoption du projet de loi 93.
Quelques semaines à peine après le fiasco de NorthVolt, avec la destruction de plusieurs milliers de mètres carrés de terrains humides et la dilapidation de centaines de millions de dollars de fonds publics, nous voilà en train de revivre le même scénario avec le dossier de Stablex à Blainville : même empressement, même manque de transparence, même absence d'écoute de divers représentants de la population !
Il faudrait être bien malvenu et malhonnête de remettre en question la crédibilité et la légitimité des personnes qui, au nom du bien commun, contestent la décision du gouvernement Legault, à commencer par la mairesse de Blainville, Mme Liza Poulin et son conseil, appuyés en cela par la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM), par la Fédération québécoise des municipalités, par l'Union des municipalités du Québec, par des représentants du monde agricole, par des groupes écologistes et par le BAPE (Bureau d'audiences publiques sur l'environnement) qui a exprimé un avis négatif sur ce projet. Cela commence à faire beaucoup de monde !
À qui faut-il faire confiance pour la défense de nos intérêts quand le gouvernement et Stablex refusent de rendre publique l'étude que cette dernière a commandée à Englobe pour connaître la valeur écologique du terrain convoité ? Heureusement, le Devoir a pu mettre la main sur ce document de 430 pages, daté d'octobre 2023, mais qui n'a jamais été rendu public !
À qui faut-il se fier quand la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, affirme qu'on a affaire à un « terrain dénaturé et desséché » et qu'il n'y a plus de tourbières « depuis longtemps », alors que l'étude même d'Englobe, dont elle a sûrement pris connaissance, la contredit et rappelle qu'on retrouve 97 237 mètres carrés de tourbières dont le « rendement des fonctions écologiques … est élevé ».
Mostefa Khallaf, poète et philosophe franco-algérien, disait : « Le mensonge qui était l'art des faussaires, des dupeurs et des flatteurs, est devenu à la portée de tout le monde. Le palmarès revient aux hommes politiques dupant une plèbe anesthésiée et complice du désordre sociétal. »
Nous n'avons pas de pouvoir sur les personnes qui ne se gênent pas pour manipuler et fausser les faits à leur avantage et intérêt. Mais nous avons le pouvoir, individuellement et collectivement, de refuser de nous laisser duper et anesthésier par leurs discours.
Ce terrain compte une superficie de milieux humides deux fois plus importante (278 000 mètres carrés) que celle qui a été détruite par NorthVolt. Selon les experts du GIEC (Groupe international d'experts sur l'évolution du climat), ces milieux naturels jouent un rôle important pour la protection de la biodiversité et pour la lutte contre la crise climatique, dont l'urgence n'est plus à démontrer pour l'avenir de nos enfants, petits-enfants et générations futures.
Dans une autre perspective, au cœur d'un contexte de guerre tarifaire avec le gouvernement américain et des menaces qu'il fait peser sur notre souveraineté, comment se fait-il qu'on n'ait pas trouvé d'entreprises québécoises compétentes pour gérer nos propres déchets, de sorte que nos fonds publics mettent à profit les compétences des gens d'ici en plus de nous enrichir ?
Surtout, face au président Trump qui répète qu'il n'a pas besoin de nous, pourquoi faudrait-il qu'on sacrifie nos milieux naturels de haute qualité pour servir de poubelle pour ses déchets dangereux ?
Devant le refus par le gouvernement Legault d'accepter la proposition de la CMM d'une solution de rechange qui aurait permis à Stablex de s'installer sur un autre terrain appartenant déjà au gouvernement, nous appuyons fortement la ville de Blainville et la CMM dans leur recours en Cour Supérieure pour contester la légalité et la constitutionnalité du projet de loi 93 car, contrairement à M. Legault, nous ne croyons pas que sa décision sert l'intérêt des citoyennes et citoyens actuels et futurs du Québec.
Pierre Prud'homme
30 mars 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des milliers de travailleuses réclament que le gouvernement en fasse plus pour les CPE

La convention collective est échue depuis plus de deux ans et le gouvernement tarde toujours à donner des conditions qui permettraient de s'assurer d'avoir une relève dans le secteur. Alors que les travailleuses sont à bout de souffle, sa préoccupation principale est d'augmenter la force de travail.
3 avril 2025 | tiré du site de la CSN
Des milliers de travailleuses et de travailleurs des CPE de la CSN ont participé à la manifestation nationale pour réclamer que le gouvernement Legault écoute leurs solutions pour freiner la pénurie de personnel et valoriser les emplois en CPE. La CSN annonce de plus que la prochaine séquence de grève sera les 7 et 8 avril prochain.
Les travailleuses et travailleurs des CPE qui participent à la manifestation nationale proviennent de toutes les régions du Québec. Depuis des décennies, les travailleuses des CPE et la CSN luttent sans cesse pour faire des gains pour bonifier les conditions de travail afin de maintenir ce réseau qui est un joyau collectif depuis sa création. Malheureusement, la convention collective est échue depuis plus de deux ans et le gouvernement tarde toujours à donner des conditions qui permettraient de s'assurer d'avoir une relève dans le secteur. Alors que les travailleuses sont à bout de souffle, sa préoccupation principale est d'augmenter la force de travail.
« En prenant la rue aujourd'hui, les travailleuses des CPE veulent que le gouvernement comprenne qu'elles sont déterminées à bonifier leurs conditions de travail. Pendant qu'on lui parle de la pénurie qui frappe notre secteur et des cohortes qui sont vides dans les cégeps, le gouvernement veut nous faire travailler encore plus. Le problème dans les CPE, ce n'est certainement pas qu'on n'en fait pas assez pour les enfants, c'est qu'on ne nous donne pas toutes les conditions pour faire notre travail. Comment expliquer que le gouvernement continue d'accepter une disparité de traitement entre le secteur des CPE et le secteur public ? », demande Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN).
En grève les 7 et 8 avril
Si les pourparlers ne sont pas rompus, la négociation ne progresse pas suffisamment pour espérer arriver à une entente de principe rapidement. Les employeurs et le gouvernement restent campés sur leur position et refusent surtout d'en faire davantage pour aider un réseau qui en a grand besoin. Chaque journée de grève supplémentaire met la pression nécessaire pour que la négociation chemine avant de se rendre à la grève générale illimitée. C'est pourquoi la CSN indique dès maintenant que deux nouvelles journées de grève s'ajoutent, soit les 7 et 8 avril.
« Les CPE sont un réseau créé par et pour les femmes. Ce que les travailleuses et les parents veulent, c'est que les services reprennent dans les CPE avec de meilleures conditions de travail. Le gouvernement aura grand besoin d'être plus attractif s'il veut réussir à créer les milliers de places que les parents attendent tellement. Comme le gouvernement bouge trop peu, les travailleuses accentuent la pression avec deux nouvelles journées de grève », lance Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs privés de la FSSS–CSN.
« La détermination des travailleuses des CPE est remarquable. Depuis toujours elles se battent pour améliorer leurs conditions de travail et les services aux enfants. Les conditions qu'elles ont aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau des gouvernements, c'est le fruit de leurs luttes. Cette bataille des 13 000 travailleuses des CPE de la CSN bénéficie à l'ensemble des enfants qui fréquentent un service de garde. Que ça plaise ou non aux employeurs et aux gouvernements, la grève est l'ultime moyen qui permet à des milliers de travailleuses et de travailleurs d'améliorer leur sort. C'est pourquoi le gouvernement doit retirer le projet de loi 89 », de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.
Une grève partout au Québec
La CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l'ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE. Voici le nombre de centres affiliés à la CSN par région :
7 CPE en Abitibi-Témiscamingue
11 CPE au Bas-Saint-Laurent
10 CPE sur la Côte-Nord
22 CPE dans le Centre-du-Québec et la Mauricie
36 CPE en Estrie
12 CPE en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine
11 CPE dans Lanaudière
25 CPE dans les Laurentides
51 CPE en Montérégie
112 CPE à Montréal et à Laval
23 CPE en Outaouais
64 CPE à Québec et dans Chaudière-Appalaches
31 CPE au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Travailleurs étrangers temporaires – Québec doit permettre à ceux déjà ici d’accéder à l’immigration permanente

Montréal, le 31 mars 2025. – La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et plusieurs de ses syndicats affiliés présents dans le secteur privé demandent au gouvernement de mettre en place une voie de passage exceptionnelle pour accueillir de façon permanente au Québec les travailleurs étrangers temporaires déjà présents sur le territoire et qui ne sont plus en mesure de renouveler leur permis de travail.
321 mars 2025 | tiré du site de la FTQ
https://ftq.qc.ca/travailleurs-etrangers-temporaires-quebec-doit-permettre-a-ceux-deja-ici-dacceder-a-limmigration-permanente/
« Il faut absolument trouver le moyen de leur ouvrir les portes de l'immigration permanente. Ces travailleurs et ces travailleuses vivent dans nos régions, plusieurs avec leurs familles, ils sont souvent essentiels au bon fonctionnement de nos usines. Bon nombre d'entre eux ont appris le français et le Québec a investi dans différents programmes en vue de faciliter leur établissement dans nos communautés. Des liens humains se sont créés. Le gouvernement du Québec doit absolument leur tendre la main pour qu'ils et elles puissent immigrer de façon permanente au Québec », souligne le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.
Alors que le gouvernement fédéral a resserré considérablement l'octroi de permis de travailleurs étrangers temporaires, plusieurs permis arrivent à échéance et des travailleurs et des travailleuses devront quitter le territoire.
Le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, souligne que le Québec aurait avantage à accueillir définitivement ceux et celles déjà sur le territoire. « Il est urgent de donner la possibilité aux travailleurs étrangers temporaires présents sur le territoire actuellement de faire une demande d'immigration auprès du gouvernement du Québec. Le Québec a besoin d'eux. L'avenir de plusieurs entreprises en dépend. Il faut cesser le système à deux vitesses des permis de travail fermé et tendre la main à ceux et celles qui sont déjà sur le territoire pour qu'ils immigrent de façon permanente, et qu'ils deviennent des citoyens à part entière, avec les mêmes droits que tous. »
Plusieurs syndicats affiliés à la FTQ, dont les Métallos, les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) et l'Union des employés et employées de service (UES-800), Unifor constatent le phénomène. Le premier ministre lui-même reconnaît que les besoins des régions doivent être considérés.
Les récentes restrictions dans les renouvellements de permis de travail entraînent des difficultés sur le terrain. « Par exemple, dans certaines usines, entreprises, manufactures, de nombreux travailleurs sont sur des permis temporaires. Avec les restrictions, une bonne partie d'entre eux devraient partir, ce qui met en péril la production. Ce serait important qu'on puisse leur donner l'occasion de rester en immigrant de façon permanente », font valoir les leaders syndicaux Anouk Collet, conseillère principale au président national des TUAC, Marie Deschênes, vice-présidente exécutive de l'UES 800, et Olivier Carrière, directeur exécutif adjoint Unifor, qui comptent parmi leurs rangs de leurs organisations plusieurs centaines de travailleurs étrangers temporaires.
La sélection des immigrantes et des immigrants permanents relève entièrement du gouvernement du Québec. « Québec a toute la marge de manœuvre nécessaire pour accueillir les travailleurs étrangers temporaires présents sur le territoire de façon permanente, en leur délivrant un certificat de sélection du Québec. Ce sont des candidats et des candidates de choix, qui ont des compétences importantes pour le marché du travail et qui sont essentiels à la vitalité économique de nos régions », conclut le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.
La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un pour tous, et tous contre Amazon : la solidarité internationale face à la crise

En réponse à la fermeture des entrepôts d'Amazon au Québec et aux récentes campagnes de boycottage visant l'entreprise, nous souhaitons vous proposer un article d'opinion corédigée par le Centre international de solidarité ouvrière (CISO), la présidente de la CSN, Caroline Senneville, et le président du STT d'Amazon Laval - CSN, Félix Trudeau. Celle-ci vise à dépeindre l'importance de la solidarité internationale dans cette période de crise, ainsi que le pouvoir qu'exercent les grandes firmes comme Amazon sur les droits des travailleurs et travailleuses.
Signataires :
Félix Beauchemin, chargé de l'éducation, Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
Amélie Nguyen, coordonnatrice, CISO
Félix Trudeau, président du STT d'Amazon Laval - CSN
Caroline Senneville, présidente, Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Dans un monde turbulent qui semble révéler de plus en plus le pouvoir sournois des grandes entreprises multinationales, le cas d'Amazon au Québec souligne l'urgence d'une lutte internationale coordonnée et forte.
On s'en rappelle : le 22 janvier 2025, l'entreprise Amazon annonce la fermeture soudaine de ses sept entrepôts au Québec, causant la perte de plus de 4 700 emplois. Selon l'entreprise, le retour à un modèle de livraison par sous-traitance était tout simplement préférable. Cependant, pour tous les acteurs des secteurs économiques et sociaux concernés par cette affaire, la raison sous-jacente est incontestable : la récente syndicalisation de 287 employé·e·s d'un entrepôt de Laval a été la bougie d'allumage de l'entreprise reconnue pour ses pratiques antisyndicales flagrantes.
C'est maintenant une évidence, le plan d'affaires de la multinationale repose sur l'exploitation des travailleur·se·s pour faire un profit considérable. Si ces mêmes travailleur·se·s usent de moyens légaux pour faire valoir leurs droits, l'entreprise usera, elle aussi, de passe-droits pour contrer la menace. Partout dans le monde, les schémas antisyndicaux se répètent : affichage anti-syndicat, rencontres individuelles avec les employé·e·s, renvoi de militant·e·s, pressions, menaces et surveillance. Aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni ou en France, toute tentative est rapidement et fortement réprimée à coups de millions de dollars.
Ces échecs individuels sont lourds de conséquences, comme en témoignent la perte d'emplois et l'affaiblissement du droit au travail dans chaque région touchée. Selon nous, ces défaites doivent cependant agir comme un signal d'alarme sur le pouvoir réel de ces firmes : lorsque les travailleuses et travailleurs se battent isolément dans des juridictions locales, Amazon peut déployer ses ressources et déplacer ses activités là où les syndicats sont plus faibles, les lois plus laxistes, les salaires bas et les conditions de travail encore plus précaires. C'est le principe même de la délocalisation – une escroquerie légalisée, voire encouragée, par les systèmes législatifs et économiques mis en place depuis les années 1980 –, qui a pour effet de placer les travailleur·se·s locaux en compétition avec les travailleur·se·s du monde entier.
Il serait donc valable de baisser les bras, de s'avouer vaincus face au pouvoir incontestable d'une entreprise scélérate. Cependant, l'histoire atteste que les efforts d'ampleur concertés et organisés par une masse de travailleurs et travailleuses ont la capacité de faire flancher les géants. Il y a quelques années, la transmission d'informations entre les syndicats québécois etbelge de l'entreprise Kronos a mis en lumière les mensonges de l'employeur quant aux assurances fournies aux travailleuses et travailleurs de son usine canadienne, ouvrant de nouvelles avenues de négociation. Des actions mondiales concertées ont même permis d'organiser collectivement certaines usines textiles au Bangladesh. En raison de l'impact direct de ces gains sur les conditions des travailleur·se·s d'ici, les syndicats investissent depuis plus de 50 ans dans plusieurs campagnes
de solidarité internationale, notamment par la création d'un réseau intersyndical de solidarité internationale, le Centre international de solidarité ouvrière (CISO).
Dans un contexte où les pressions sur le marché sont de plus en plus fortes, la compétition grandissante et où les actionnaires scrutent chaque dollar investi, il peut devenir financièrement intenable de continuer à gaspiller des dollars dans des entrepôts neufs et vides, comme c'est le cas avec Amazon au Québec. Plus les initiatives de résistance se multiplient, plus les mouvements de contestation gagnent en ampleur, et plus la colère populaire gronde, l'entreprise n'aura d'autre choix que d'ouvrir la porte à la négociation. Et ce sera à ce moment précis que nous pourrons enfin renverser la balance du pouvoir.
Solidarité aux luttes syndicales du monde entier ! Solidarité aux campagnes de boycottage d'Amazon !
Le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) est un réseau intersyndical de solidarité internationale qui réunit près de 80 syndicats à travers le Québec. Il célèbre cette année ses 50 ans.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’austérité du gouvernement Legault ronge nos services publics

Nous voilà toutes et tous plongés dans une époque improbable et inquiétante, faite entre autres de guerre tarifaire avec nos voisins du Sud, de dérives autoritaires, de menaces à nos droits sociaux et syndicaux et de possibles reculs environnementaux malgré l'urgence climatique.
Alors que ce pourrait être l'occasion de se donner les moyens d'un Québec moins dépendant des échanges avec les États-Unis, plus juste et écologiquement exemplaire, le gouvernement Legault nous entraîne dans la voie inverse. Il nous replonge dans le mauvais film de l'austérité et des coupes de services. Avec le nouveau budget qui vient d'être déposé, de nouvelles scènes désolantes de ce navet sont à prévoir.
Avec un minimum de courage politique et sans toucher en général le portefeuille de la population, ce gouvernement pourrait pourtant augmenter de plusieurs milliards les recettes de l'État. Comment ? En s'assurant d'une part d'avoir les moyens suffisants pour mieux lutter contre l'évasion et l'évitement fiscal, d'autre part en mettant en place des mesures comme l'établissement d'un régime fiscal plus progressif, l'instauration de taxes sur le patrimoine, l'imposition des superprofits de grandes entreprises et surtout, sabrer dans le recours à la sous-traitance.
Ce gouvernement a plutôt choisi la facilité avec l'austérité et la mise à mal de nos services publics à la grandeur du Québec. Quand les budgets des ministères et organismes publics ne permettent pas de couvrir la hausse des besoins et donc de soutenir la hausse des coûts de programmes, il s'agit bien d'austérité, car ces ministères et organismes devront couper à quelque part. On fonce droit dans le mur quand il n'y a plus d'embauches externes et que le personnel occasionnel est mis à pied depuis novembre. Ce gouvernement ne veut pas l'admettre et craint le vilain mot, mais c'est bien le cas.
Les répercussions se font déjà sentir aux quatre coins du Québec sur la capacité des ministères et organismes de la fonction publique et parapublique à réaliser leur mission et sur les services à la population.
Des bureaux de Services Québec qui ferment leurs portes plusieurs jours par semaine ; plusieurs mises à pied dans le Centre de communication avec la clientèle du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ; des inventaires fauniques et des analyses écotoxicologiques de l'eau, de l'air et du sol compromises au ministère de l'Environnement ; le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous au Tribunal administratif du logement qui dépasse souvent les 20 jours, si le bureau n'est pas ouvert qu'un jour par mois ; etc.
Est-ce là les services publics auxquels on serait en droit de s'attendre, dans toutes les régions du Québec ? Il a pourtant été démontré que le secteur public contribue fortement à la résilience économique régionale, ce qui est d'autant plus essentiel en période de crise.
De grâce, à l'inverse des dérives cauchemardesques qui se révèlent jour après jour tout près de nous aux États-Unis, ayons la clairvoyance de ne pas saboter nos services publics, garants du vivre-ensemble, et efforçons-nous plutôt de saisir l'occasion pour cheminer vers un meilleur Québec.
Christian Daigle, président général du SFPQ.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Dehors la CAQ, ça presse »

« Dans la vraie vie, quand une ou un employé n'atteint pas ses objectifs et fait plus de tort que de bien, on le remercie. Ça devrait être pareil pour les député-es. Il serait à peu près temps que l'on dise collectivement ‘'dehors'' à la CAQ ». - Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches.
Restés sur leur faim à la suite de sa performance comme député, comme ministre responsable des infrastructures et comme ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, des syndiqué-es ont symboliquement remercié Jonathan Julien cet avant-midi et commencé le déménagement de son bureau de comté.
« On ne peut pas attendre 2026 avant de “remercier'' le gouvernement de la CAQ, il faut les sortir avant qu'ils ne fassent plus de dégâts, ça presse », a déclaré Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches. La syndicaliste souligne qu'il n'y a pas que l'incertitude concernant les nombreux projets d'infrastructure en matière de transport dans la région qui pose problème, mais un ensemble de décisions douteuses qui s'avèrent finalement non seulement coûteuses mais inefficaces.
Barbara Poirier cite pêle-mêle la création de Santé Québec, qui fait exploser la rémunération des cadres sans améliorer en rien la situation sur le terrain (au contraire, on assiste à des suppressions de postes), les dossiers Norvolt et Stablex, l'inaction face à la crise du logement, la désinvolture face à la fermeture sauvage des entrepôts d'Amazon, la valse-hésitation face aux projets de transport en commun, le moratoire sur l'immigration permanente qui ajoute à l'incertitude économique ambiante…
« Comme si ce n'était pas suffisant, le gouvernement en rajoute en s'attaquant au droit de grève des travailleuses et des travailleurs avec le projet de loi 89. N'en jetez plus, la cour est pleine ! » poursuit la présidente du conseil central. « Dans la vraie vie, quand une ou un employé n'atteint pas ses objectifs et fait plus de tort que de bien, on le remercie, ça devrait être pareil pour les député-es, » conclut Barbara Poirier, « il serait à peu près temps que l'on dise collectivement ‘'dehors'' à la CAQ ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Chloé Sainte-Marie chante la vraie nature de Gilles Carle

Chloé Sainte-Marie APLP2009 (i) a inauguré le 3 avril une riche exposition d'œuvres d'art intitulée la vraie nature de Gilles Carle, attirant une foule nombreuse envahissant tout le Centre Culturel Pierre-Gobeil de Rock Forest (Sherbrooke). Même ses escaliers étaient chargés de photos, principalement, celles de Pierre Dury, ami proche du regretté cinéaste.
Par Pierre Jasmin, 6 avril 2025. Tiré du site des Artistes pour la paix. Photo : Portrait de Chloé par Gilles Carle qui orne son CD 2008 du temps où son amour créateur était encore vivant.
Une exposition choyée de la vie culturelle sherbrookoise
« Tantôt caricaturaux, humoristiques ou érotiques, pastichant même des maîtres de l'histoire de l'art, les dessins, les tableaux et les photographies de Gilles Carle sont une incursion dans son univers intime. Grâce à la collaboration de sa muse et compagne Chloé Sainte-Marie, découvrez les multiples facettes d'un homme libre qui a célébré la vie sans retenue », a prononcé en discours de bienvenue le commissaire François Renaud.
Remplacé à Radio-Canada par le membre illustre des APLP Frédéric Back qui quittait l'École des Beaux-Arts où il avait succédé à Borduas, Gilles Carle entre à l'Office national du film du Canada au début des années 60 à titre de scénariste. Il y tourne quelques courts métrages documentaires, mais c'est la fiction qui l'intéressera davantage et le centre montrera plusieurs de ses films, dont, en présence de Micheline Lanctôt, la Vraie nature de Bernadette, l'histoire d'une des premières écolos woke du cinéma québécois. Comme les Artistes pour la Paix, Chloé Sainte-Marie croit que dans le contexte politique actuel, il est vital de s'inspirer de la liberté d'esprit de Gilles Carle. En marge de l'exposition, Chloé donnera son formidable spectacle Maudit Silence le 12 avril à 19 h 30.
Ici et là sur les murs, des textes évocateurs rappelaient mon prédécesseur secrétaire des Artistes pour la Paix, le regretté Bruno Roy (ii). L'ancien ministre de la Santé du gouvernement Marois, Réjean Hébert, président d'honneur de l'expo, est resté muet sur le fiasco du ministre actuel Christian Dubé (iii). On est reconnaissants au Dr Hébert à la forte présence pour ses recherches sur les aînéEs et pour l'appui généreux qu'il a accordé, avec certaines ministres de la CAQ dont trois députées étaient présentes, aux neuf maisons Gilles-Carle miraculeusement fondées : elles peinent actuellement, vu l'état budgétaire lamentable de la Santé, à recruter les infirmières requises à leur fonctionnement optimal. C'est Chloé qui avec Pierre-Karl Péladeau avait réussi à convaincre le gouvernement en remplissant la salle Maisonneuve (où je m'étais pressé avec ma conjointe) que les proches-aidantes méritaient d'être aidées, et une aide leur fut accordée d'abord à titre de soulagement temporaire.
Petit récital de chansons
Nouvellement membre de l'Ordre du Canada, ce qui attira peut-être la curiosité de la ministre Marie-Claude Bibeau en grande forme qui m'avoua son appétit culturel et sa hâte du 28 avril pour se tourner vers sa nouvelle carrière municipale, nous eûmes droit d'abord à trois chansons par Annie Bouchard à la forte présence scénique. C'est au rez-de-chaussée, dans la salle de spectacles bondée d'une centaine de personnes aux applaudissements nourris, que nous avons assisté ensuite à quatre chansons de Chloé, accompagnée à la guitare par le directeur du centre, l'auteur-compositeur-interprète Ian Fournier. À l'origine, trois chansons étaient prévues, dont une magnifique en langue innue inspirée par un poème de sa grande amie Joséphine Bacon, puis celle à laquelle les spectateurs ont communié de toute leur âme en répétant le premier couplet :
Brûle brûle brûle
la chandelle de la vie
brûle brûle brûle
la chandelle de l'amour
passe le temps de vivre
le temps du bonheur
passent les heures exquises
le printemps et les fleurs
déjà la flamme vacille
déjà notre cœur aussi
la noirceur tombe sur la ville
adieu l'ami
adieu la vie
Se tournant alors vers moi, Chloé a tenu à me dédier la chanson « chamaille » pour saluer l'effort surhumain des Artistes pour la Paix à subsister sans sous, avec comme agenda unique la paix et ses exigences de vérité heurtant l'establishment. De l'album "Je marche à toi" (2008), avec 19 chansons sur des vers de Roland Giguère, Gaston Miron, Alexis Lapointe et des musiques de Gilles Bélanger, certaines d'entre elles prophétiques (Patrice Desbiens La haine), elle a interprété, encore sur des paroles de Gilles et la musique de François Guy :
Les plaines brûlent, mon cœur chavire
Qu'il est amer parfois de vivre !
Où est mon ami, mon ami de cœur ?
Pourquoi ce feu, cette rancœur ?
Chamaille, chamaille,
Maudite chamaille !
Chamaille, chamaille,
Maudite chamaille !
Est-il blessé, encore vivant ?
Ou est-il mort dans la bataille,
Les yeux crevés, la jambe perdue ?
Ram'nez-le moi, mort ou crochu !
La ville brûle ; mon cœur chavire
Qu'il est amer parfois de vivre !
Méchante France, mauvaise Angleterre
Maudits vieux pays, toujours en guerre ...
Toute notre reconnaissance à l'incomparable Chloé Sainte-Marie, belle muse vivante de la paix des corps et des âmes dont la générosité (et celle de Pierre D.) permet à cette exposition de durer jusqu'en juillet et d'être gratuite, en attendant le relais du Musée d'Art contemporain de Montréal qui se réveillera peut-être lors du centenaire de Gilles Carle en juillet 2028 ?
PS Voici deux reportages qui ont salué l'exposition :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2153359/exposition-gilles-carle-dessins-sherbrooke-chloe-sainte-marie
https://www.latribune.ca/arts/arts-visuels/expositions/2025/04/04/trois-mois-pour-renouer-avec-gilles-carle-son-art-et-sa-muse-FXPCAAGHBFC55HZNB3VD7YN5ZM/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une entente de principe acceptée à une forte majorité !

Québec, le 5 avril 2025 — Les quelque 6 000 membres de Revenu Québec représentés par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ont approuvé l'entente de principe intervenue avec leur employeur à 88 %. Le taux de participation était de 86 %.
Rappelons que la convention collective était échue depuis le 31 mars 2024. Le nouveau contrat de travail est d'une durée de cinq ans et se terminera donc le 31 mars 2029.
« Nous sommes heureux d'en être arrivés à une entente avec l'employeur qui est satisfaisante pour nos membres dans le contexte actuel d'instabilité économique. Nous avons obtenu des gains importants, notamment une augmentation de la cotisation de l'employeur aux assurances collectives et l'ajout de congés mobiles. Cependant, une négociation est un exercice de compromis alors des enjeux demeurent comme le fait que la politique de télétravail demeure non conventionnée et l'absence de congés destinés aux personnes victimes de violence conjugale. Nous poursuivrons notre travail et nos efforts en vue de la prochaine négociation », indique Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.
Faits saillants
Voici les principaux faits saillants de l'entente de principe :
• Augmentations salariales de 12,4 % sur 5 ans (pour les échelons de 1 à 19), soit 2,8 % en 2024, 2,6 % en 2025, 2,5 % en 2026, 3,5 % en 2027 et 1,0 % en 2028.
• Au 1er avril 2028, majoration salariale de 0,5 % au 19e échelon pour toutes les personnes concernées.
• Clause remorque en 2028-2029 avec le personnel professionnel de la fonction publique (dont 1 % garanti).
• Somme forfaitaire de 1 500 $ à tout le personnel professionnel à l'emploi au 31 mars 2025.
• Prime de criticité rétroactive au 2 décembre 2024 jusqu'au 30 mars 2029 pour les employés qui exercent des fonctions critiques dans le secteur d'activité de la conformité fiscale.
• Ajout de trois congés mobiles pour cinq années consécutives d'ancienneté dans la même catégorie d'emploi professionnelle à Revenu Québec et un jour de congé mobile pour trois années consécutives d'ancienneté.
• Augmentation significative de la contribution de l'employeur aux assurances collectives.
• Attente moins longue pour avoir accès à des jours de vacances supplémentaires.
• L'employeur s'engage à poursuivre ses démarches pour la certification auprès des Milieux de travail alliés contre la violence conjugale.
À propos du SPGQ
Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35 000 spécialistes, dont environ 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
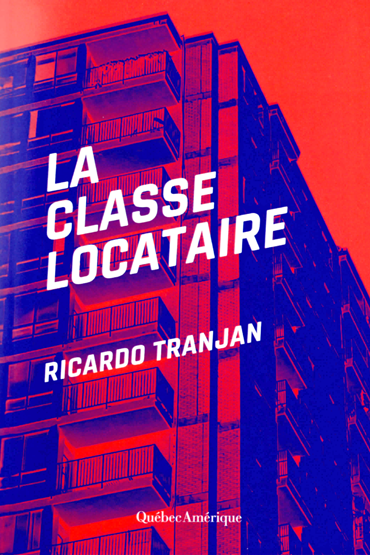
Politiser la question du logement
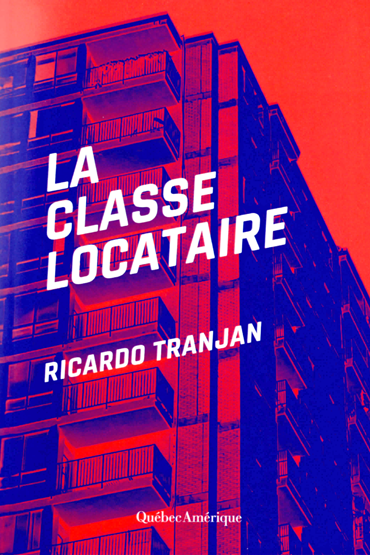
Au Québec, le mouvement de lutte pour le droit au logement a longuement été seul à parler de « crise du logement ». Ce vocable lui permettait de mettre en lumière des urgences vécues par les locataires : difficulté extrême à trouver et louer un logement, aggravation du problème d'incapacité de payer, explosion du nombre d'évictions, montée de l'itinérance, etc. Il pouvait du même coup dénoncer les pratiques du marché privé de l'habitation et avancer ses propres revendications en faveur de la réalisation massive de logements sociaux et du renforcement des mesures de protection légale des locataires, en particulier du contrôle ou du gel des loyers.
Au mieux, comme ce fut le cas au début du millénaire, l'expression réussissait à se frayer un chemin dans les grands médias et auprès des autorités politiques et permettait d'obtenir certains gains, par exemple de l'aide d'urgence pour les ménages sans logis ou à risque immédiat de le devenir.
Au tournant des années 2020, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) a de nouveau sonné l'alarme, cette fois sur les conséquences de la rareté grandissante d'appartements accessibles financièrement. L'appel a, dans un premier temps, été accueilli par un haussement d'épaules de la part des autorités politiques, des grands mélias et de la plupart des autres acteurs. La situation a bien changé au cours des toutes dernières années. Il se passe rarement une semaine sans que la « crise du logement » rebondisse dans l'actualité. Le mot « crise » a quant à lui été récupéré par les gouvernements, les associations de constructeurs ou de propriétaires, le Conseil du patronat, les chambres de commerce, les institutions financières, et tant d'autres.
Le récit et les solutions mises de l'avant ne sont cependant plus les mêmes. Pas question de dénoncer la responsabilité du marché privé dans cette situation, mais d'appeler tous les intervenants à mettre l'épaule à la roue afin d'intensifier et d'accélérer la construction de logements, sans égard au coût des loyers. Le tout est assorti de timides engagements gouvernementaux quant à la réalisation d'une minorité de logements qualifiés d'abordables, mais dont le loyer est trop cher pour les ménages les plus en difficulté.
En présentation de sa Stratégie québécoise en habitation, dévoilée en août 2024, la ministre responsable, France-Élaine Duranceau, offre un concentré de ce discours : « Notre vision est claire : la clé de la sortie de crise, c'est d'augmenter l'offre de logements. Il faut accélérer le rythme. Développer plus. Développer plus vite, tout en préservant les logements existants. Voilà l'imposant chantier auquel la Stratégie nous convie tous. L'action gouvernementale ne pourra suffire à elle seule, compte tenu de l'ampleur des besoins. Tous les acteurs de l'écosystème de l'habitation sont concernés. Et pour que chacun puisse contribuer à sa pleine mesure, l'environnement doit être propice au développement, et la productivité stimulée. » [1]
La parution de la traduction du livre de Ricardo Tranjan, adaptée à la réalité québécoise, arrive à point nommé dans ce contexte. Paru en anglais en mai 2023, il représente un véritable antidote contre le discours dominant. Économiste politique et chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives, l'auteur montre que l'utilisation faite de la formule « crise du logement » vise à dissimuler la vraie nature du marché. Celui-ci n'est pas, comme on tente de nous le faire croire, aux prises avec des difficultés temporaires, de simples accidents de parcours, pouvant se régler par des solutions techniques. Il est plutôt basé « sur une inégalité structurelle et une exploitation économique ». Il s'agit d'un enjeu politique qui appelle une lutte politique.
Pour en finir avec la « dépolitisation du logement », Tranjan propose de le considérer comme le théâtre d'une lutte des classes, opposant celle des locataires à celle des propriétaires. Même si l'auteur admet lui-même que cette division de la société n'est pas « aussi structurelle que le travail salarié », elle lui permet d'en parler en termes d'appropriation, amorcée dès la colonisation et le vol des terres aux peuples autochtones, puis poursuivie par la quête incessante de profits de la part des propriétaires.
L'auteur considère que cette dépolitisation repose sur des perceptions faussées des réalités des locataires comme des propriétaires. Il s'attarde donc à démolir les préjugés permettant de traiter les locataires comme des « citoyens de seconde zone » qui ont échoué à avoir accès à la propriété - et. à réaliser le « rêve canadien ». Il s'en prend du même souffle aux mythes, véhiculés depuis toujours au Québec par les associations de propriétaires, laissant croire que les propriétaires dans leur ensemble vivent dans une constante précarité financière. Il démontre au contraire, estimations chiffrées à l'appui, que la classe des propriétaires est principalement composée de « familles bien nanties, de petites entreprises, des sociétés immobilières et des investisseurs financiers », bien loin de risquer d'y laisser à tout moment leur chemise.
Un autre intérêt de La classe locataire est son récit de résistances passées ou actuelles sur le front du logement. Amateur d'histoire, Ricardo Tranjan raconte des épisodes de lutte qui se sont déroulés dans plusieurs provinces canadiennes depuis les années 1860. Dans le cas de Montréal, l'auteur a fait le choix d'écrire sur une lutte oubliée, celle des locataires des Habitations Jeanne-Mance, premier HLM construit au Québec, qui, dans les années 1960, ont dû affronter l'autoritarisme de ses administrateurs inspirés par l'idéologie de la rénovation urbaine dont l'un des objectifs était de « discipliner les locataires ».
L'essai coup-de-poing de Ricardo Tranjan se termine par un appel à « choisir son camp » dans la lutte des classes entre locataires et propriétaires. Il est à souhaiter que cet appel soit entendu et repris, les forces étant de plus en plus inégales, avec la marchandisation et la fiscalisation du logement, qui continuent sans entraves à étendre leurs tentacules.
François Saillant,
auteur et militant pour le droit au logement
Ricardo Tranjan, La classe locataire, Québec Amérique, 2025
[1] Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Stratégie québécoise en habitation, Bâtir ensemble pour mieux se loger, 2024,p. 4.

Alain Deneault et Claude Vaillancourt lèvent le voile sur le pouvoir incandescent des multinationales

Organisé par Attac Québec et accueilli par la librairie Zone Libre, le lancement de l'ouvrage « Multinationales : Une histoire du monde contemporain » a eu lieu mercredi 26 mars dernier. Claude Vaillancourt, président de l'organisation altermondialiste ATTAC-Québec et Alain Deneault, philosophe québécois, tous deux contributeurs de l'ouvrage, étaient sur place pour présenter la publication.
Tiré d'Alter Qiuébec.
Le livre noir des multinationales
Alain Deneault est notamment connu pour son ouvrage « Noir Canada », paru en 2008, dans lequel il remet en cause le discours discursif d'un Canada internationaliste et pacifiste qui soutient pourtant des entreprises qui exploitent et pillent les ressources du continent africain. Réitérant un projet militant et engagé à travers « Multinationales : Une histoire du monde contemporain », il estime que cet ouvrage aurait pu s'intituler « Le livre noir des multinationales » du fait de son approche critique qui s'attelle à dénoncer le vrai visage de ces entreprises et à mettre en lumière l'ampleur du pouvoir de dépendance qu'elles exercent à tous les niveaux de la société.
Structuré autour d'une ligne du temps débutant en 1850 à l'ère de la révolution industrielle, l'ouvrage rassemble les contributions d'environ quarante autrices et auteurs francophones. Il se lit aisément grâce à une approche historique riche en récits, permettant une lecture par période, qui en fait une véritable encyclopédie.
Cet ouvrage invite à nuancer l'idée célèbre avancée par Max Weber, selon laquelle l'État détient le monopole de la violence physique légitime en mettant en lumière le contre-pouvoir que représentent les multinationales. Il affirme que les États ont tendance de plus en plus à céder leur pouvoir au privé, jusqu'à placer les entreprises au-dessus des lois nationales.
Pour saisir la logique sous-jacente de cette dynamique, Claude Vaillancourt mentionne que tout cela fût rendu possible par l'avènement du néolibéralisme et le climat de libre-échange qui en découle. Cela a permis aux multinationales de se développer à une vitesse fulgurante.
Multinationales et absence d'éthique
L'histoire a montré que la croissance d'une multinationale est souvent impossible sans manquements à l'éthique ou exploitation. Dans un monde où leur pouvoir s'accroît sans cesse, l'ouvrage agit aussi comme un acte d'accusation contre le système lui-même.
On y dénonce l'incompatibilité croissante entre le développement des multinationales et les enjeux sociaux et environnementaux contemporains. Typiquement, les règles environnementales sont bien souvent considérées comme des obstacles par ces entreprises, ce qui témoigne de leur volonté d'adapter les lois, voire de les supprimer, à leurs seuls intérêts.
La relation entre les multinationales et l'extrême droite
Ce contournement et ce refus de politique environnementale illustrent d'ailleurs en partie la relation intime que les multinationales entretiennent avec l'extrême droite : les patrons des entreprises ne montrent en effet aucune réticence à s'associer à de tels partis, recherchant un environnement politique favorable à leurs profits.
Vincent Bolloré, chef d'entreprise à la tête du Groupe Bolloré — qui contrôle notamment Canal+, CNews, C8, Europe 1, ainsi que le groupe Lagardère — incarne parfaitement la dangerosité de ces stratégies d'influence idéologique, par lesquelles les multinationales cessent d'être de simples entreprises pour devenir de véritables acteurs politiques.
Historiquement centrée sur la logistique, la communication et le transport, et très implantée en Afrique, cette multinationale française s'est progressivement tournée vers le secteur des médias, ce qui permet aujourd'hui à Vincent Bolloré de façonner le débat public.
L'ère Trump
La récente réélection de Donald Trump mérite une attention particulière quant à son impact sur les multinationales. Connu pour ses mesures protectionnistes et isolationnistes, portées par un discours populiste et climatosceptique, l'exercice du pouvoir du milliardaire invite à s'interroger sur l'avenir de la mondialisation et des multinationales, qui se sont pourtant construites et renforcées en parallèle grâce à l'essor du libre-échange et à la « course vers le bas ».
Dans la continuité de son ouvrage « La fin du néolibéralisme » paru en 2023, Claude Vaillancourt signale que D.Trump ne fait que perpétuer la mise en œuvre des politiques néolibérales, mais à un niveau national et que son premier mandat a largement bénéficié à certaines multinationales. Ainsi sa réforme fiscale de 2017 a abaissé le taux d'imposition sur les sociétés de 35 à 21 % et ses remises en cause de certains accords de libre-échange ne visaient pas à limiter le pouvoir des multinationales, mais plutôt à tendre vers sa devise « America First », en appelant à un retour à une économie d'après-guerre.
Dans ce contexte, l'approche de D. Trump représente un paradoxe avec d'une part un discours patriotique et antisystème et d'autre part des politiques renforçant les multinationales. Conscient de leur portée stratégique, le président des États-Unis utilise les tarifs douaniers comme un outil de négociation et d'intimidation. Face à cette logique, il faudrait recréer une économie basée sur d'autres principes que ceux utilisés par ces multinationales et le libre-échange.
L'ouvrage démontre que la puissance et le champ d'action acquis par les multinationales sont tels, qu'elles peuvent s'adapter à toute conjoncture économique pour en tirer profit, faisant ainsi fi de principes tels que le pacifisme, l'éthique, les enjeux sociaux, le respect de l'environnement et du droit, la lutte contre les conflits d'intérêts et le capitalisme sauvage…. Claude Vaillancourt et Alain Deneault nous mettent aussi en garde contre l'influence de ce secteur privé qui favorise l'avènement de l'extrême droite dans nos sociétés. Ils critiquent la non-réaction des personnes politiques et, loin d'être défaitistes, les incitent, par leur volonté, à jouer un rôle qui rendrait nos sociétés plus démocratiques et conformes à leur posture morale.
Pour en savoir plus
Sous la direction d'Olivier Petitjean et Ivan du Roy (2025), Multinationales, une histoire du monde contemporain, Éditions La Découverte. Paris, 860 pages,
Site de l'Observatoire des multinationales
Site des Éditions La Découverte
Extrait du livre sur le site des Éditions de La découverte
Vidéo du lancement à Paris
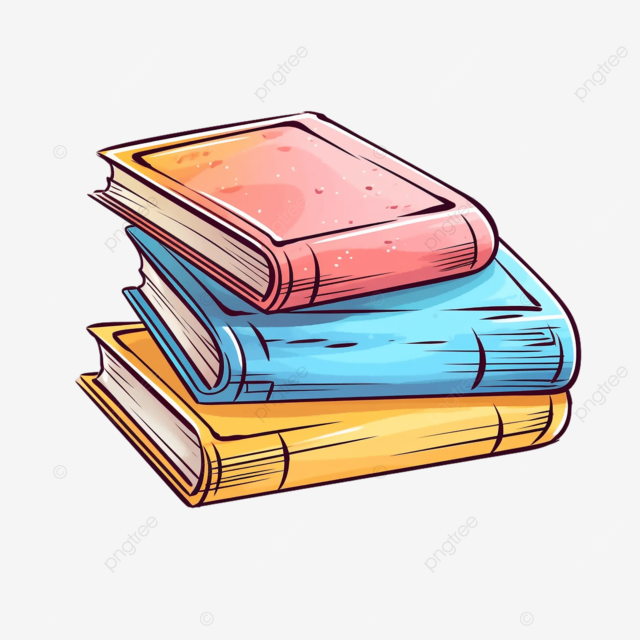
Comptes rendus de lecture du mardi 8 avril 2025
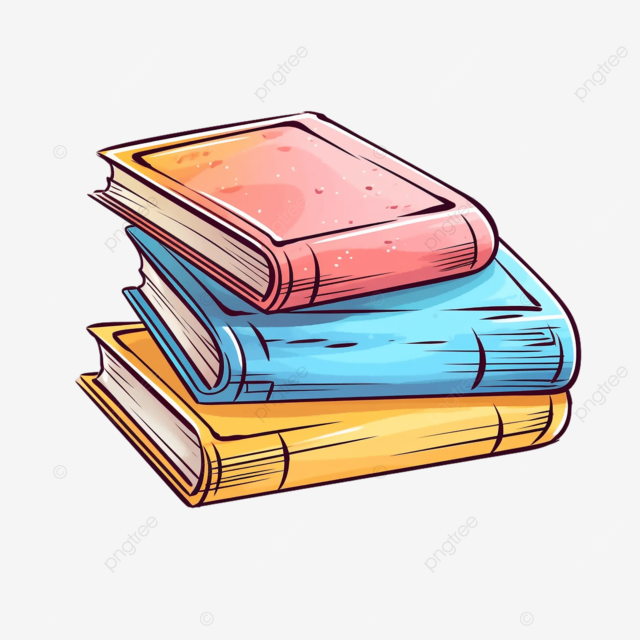
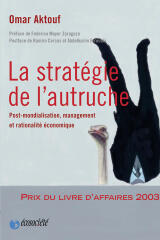
La stratégie de l'autruche
Omar Aktouf
Omar Aktouf nous a quitté mercredi dernier. Professeur en gestion à l'École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal), il était un grand défenseur de la justice sociale et un ardent critique des modèles économiques néolibéraux. Je l'ai découvert à la lecture de son fameux ouvrage « La stratégie de l'autruche », publié en 2002. Il nous y expliquait en somme que « lorsque 3 milliards d'individus — soit la moitié de la planète — vivent avec moins de 3 $ par jour, que 225 milliardaires possèdent l'équivalent de l'avoir de 2 milliards de personnes, que 51 sociétés figurent parmi les 100 premières économies du monde, que l'économie mondiale est à 90% spéculative, que la masse financière (hors actions et obligations) circulant quotidiennement représente 10 fois la valeur des réserves cumulées de toutes les banques centrales du monde… » on était plus loin « du non-sens absolu ». Un bouquin où j'ai beaucoup appris et qui avait à l'époque contribué à nous ouvrir les yeux sur les aspects structurels des iniquités.
Extrait :
Chacun pourrait se demander ce que peut bien apporter un énième livre portant sur la mondialisation, ses conséquences, ses tenants et ses aboutissants lorsque, déjà, le sujet est au bord de la saturation. Ce que, en toute humilité, mais aussi avec une certaine certitude de praticien de première ligne, je prétends apporter avec cet ouvrage, c'est une autre façon d'interroger notre ordre économique dominant : en le mettant en parallèle constant avec son inséparable bras armé, le management. Bras armé devenu tout aussi mondialisé que la cause idéologique et théorique qu'il sert.
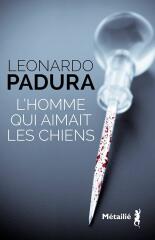
L'homme qui aimait les chiens
Leonardo Padura
Traduit de l'espagnol
Ivan, écrivain cubain en devenir miné par les difficultés et le découragement, rencontre sur la plage un singulier personnage qui prétend avoir bien connu Ramòn Mercader, l'assassin de Trotski. Cet homme lui racontera, au fil des rencontres, ce qui deviendra la trame du roman : la perpétuelle fuite de Trotski, traqué à mort par Staline, et le cheminement de son assassin, depuis la guerre d'Espagne jusqu'au tragique événement, et son emprisonnement et son rejet des siens. Un roman historique admirable, qui nous fait pénétrer au coeur du régime stalinien, avec ses purges, ses assassinats, et la peur diffuse, généralisée, qu'il provoque. Des millions de vies brisées, anéanties... Un vif désir de justice sociale, devenu, surtout sous Staline, une monstrueuse dictature.
Extrait :
Pour la première fois, Ramòn devait entendre parler avec insistance de l'opportunisme de Trotski, à l'époque exilé en Turquie, Trotski le plus sournois des ennemis, et ses partisans espagnols, dangereux infiltrés au sein de la classe ouvrière. Mais la véritable passion d'África ressortait quand elle dissertait sur la pensée et la pratique de Joseph Staline, l'homme qui faisait de la révolution bolchevik une forteresse radieuse. Tout à sa dévotion pour África, Ramòn se laissa gagner par sa haine démesurée pour Trotski et par sa vénération pour Staline, sans imaginer jusqu'où le mènerait ces passions.
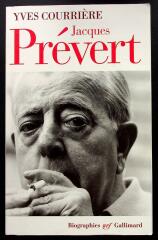
Jacques Prévert
Yves Courrière
J'ai découvert cette biographie de Jacques Prévert en fouinant dans la bibliothèque de ma belle-sœur Sylvie. J'aime depuis longtemps ce grand poète anarchiste de l'après-guerre, connu d'abord pour son recueil « Paroles ». Cette biographie de 688 pages, écrite dans un style dense, nous fait beaucoup mieux connaître cet homme profondément épris de justice et de liberté.
Extrait :
C'est dans ce contexte que parut « Dîner de têtes », à l'instant où la dépression allait frapper vraiment la France. On mesure mieux l'impact subversif de ce texte quand on connaît la situation du pays au moment de sa publication, même si Commerce et les différentes revues littéraires d'avant-garde qui avaient publié Prévert n'étaient guère susceptibles de parvenir dans les mains ouvrières. L'important était de faire quelque chose au moment ou la misère et le mécontentement grandissaient dans la classe la plus défavorisée, mais aussi dans la classe moyenne. De nombreux citoyens y avaient, comme les ouvriers, de plus en plus de mal à joindre les deux bouts mais, contrairement à la classe ouvrière dont les espoirs allaient vers le parti communiste, ils se tournaient ver l'extrême droite où des ligues, ayant pour objectif de renverser la République, étaient en gestation.
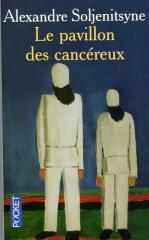
Le pavillon des cancéreux
Alexandre Soljenitsyne
Traduit du russe
C'est l'un des plus connus et des bons romans de ce grand écrivain russe du XXe siècle qu'est Soljenitsyne. Au pavillon des cancéreux, quelques hommes, alités, souffrent d'un mal inexorable que l'on dit incurable. Mais le cancer n'est pas le véritable personnage de ce roman. Il est plutôt l'occasion pour ces hommes en sursis de s'interroger sur le sens de leur vie…
Extrait :
Une rivière qui finit dans les sables ! Une rivière qui ne se jette nulle part, qui distribue généreusement ses meilleures eaux, ses meilleures forces, comme ça, au passage et à l'occasion, à ses amis ! N'est-ce pas l'image de nos vies de bagnards, auxquelles il n'est pas donné de réaliser quoi que ce soit, qui sont vouées à un étouffement sans gloire, et ce que nous avons eu de meilleur, c'est un plan d'eau où nous n'étions pas encore à sec, et tout ce qui reste de nous, c'est ce qu'il tient d'eau dans la paume des deux mains, ce que nous avons mis de nous-mêmes et échangé avec autrui dans une rencontre, une conversation, un secours.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La contre-offensive de la gauche et les écolos face à Marine Le Pen !

Le parti de l'extrême Droite (RN) a fait choux blanc à Paris ! Aussitôt saisies par l'évènement, les forces de la Gauche, des Ecolos, des Syndicats et des Associations, ont (en dépit du retard de coordination) répliqué le jour même par la mobilisation, dimanche 6 avril, Place de la République.
De Paris, Omar HADDADOU
Quand la guerre commerciale ombrage le génocide en continu à Gaza, et ses 50.000 morts !
Entre la politique protectionniste abrupte de Donald Trump (ulcéré par l'excèdent économique chinois), le subside de 4 millions de dollars versés annuellement à son protégé Bibi, sa détermination à éponger le déficit de 350 milliards de dollars par des taxes sur les droits de douane, la bulle inflationniste sur un fond de récession planétaire, de crashs boursiers et d'un écartèlement de l'Union Européenne, il est un lieu qui n'accroche point l'attention des amateurs de la capitalisation, les courtiers et autres charognards de la finance, à savoir la bande de Gaza ! Génocidaires et racistes patentés sanglés de cimeterre néocolonialiste, frappent aujourd'hui d'une manière qui dépasse l'imaginaire.
Impuissantes face au crime, les Institutions internationales inspirent répugnance et infamie. La force de frappe des nantis libéraux dans l'espace public en proie au conflit est telle, qu'ils se paient le luxe de braver la Justice avec désinvolture. Le cas du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et sa campagne d'extermination en est la preuve irréfragable. Idem pour la cheffe de file du Rassemblement National, Marine le Pen.
Le premier, frappé d'un mandat d'arrêt, poursuit dans l'impunité absolue, à défier la Cour Pénale Internationale (CPI) en se déplaçant librement, comme ce fut le cas, hier 7 avril, lors de sa visite à Donald Trump pour le persuader à exempter Israël ou aménager les droits de douanes (s'élevant à 17% ) à compter de mercredi. Un déplacement ayant aussi pour ordre du jour l'obtention de l'approbation de Washington pour éradiquer le Hamas.
Quant à la Députée européenne et fer de lance du RN, Marine le Pen, s'appuyant sur ses relais avec les puissances financière et médiatique en Europe et outre atlantique, elle exclut toute « musique » prémonitoire l'expédiant au cimetière des icônes déboulonnées.
La cheffe de file du Rassemblement national avait, rappelons-le- a écopé d'une peine de 4 ans de prison dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, ainsi que 100. 000 euros d'amende au procès des Assistants Parlementaires du Front National.
La mise en cause déclarait fermement qu'elle fera appel. Une décision lui sera notifiée à l'été 2026. Un procès dont l'ampleur continue à alimenter les plateaux friands d'audimat. Héritière de l'effronterie de son feu père, elle confesse aux médias que « c'est un combat comme d'autres ! ». Au journal « Le Parisien », elle fait preuve du même aplomb : « Je ne me laisserai pas faire. Ça ne m'atteint pas, ça me motive ! »
UN PLAN SERRE DE L'IMAGE POUR GONFLER LA STATISTIQUE AVEC LA CONNIVENCE DES MEDIAS. Comble de l'imposture propre à l'Extrême Droite, fournir aux médias inféodés publics et privés des vidéos taillés sur mesure sur la manif. Le but ? Masquer la déshérence de la manifestation, c'est-à-dire le Flope ! Une enquête menée par une journaliste, relayée, ce lundi, par les matinales radiophoniques, a débusqué le « Grenouillage » de l'extrême Droite, qui aurait eu recours à cette pratique machiavélique.
C'est dans ce climat de racisme effusif et de campagne génocidaire, à l'heure où l'on apprend la mort de 32 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, tués dans des frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza, que les voix de la Gauche et des Ecologiste se sont élevées ce dimanche à Paris, Place de la République pour dire « Stop aux massacres ! ».
Urgence Palestine, LFI-NFP, associations, syndicats, Etudiants (es), corps médicaux, citoyens (es), ont donné de la voix lors de cette marche. Des représentants de collectifs ont pris la parole pour dénoncer la complicité et le silence des Occidentaux. Les slogans scandés par la foule portaient des messages forts, appuyés par des mises en scène macabres, illustrant le massacre des femmes et des bébés, sur une chaussée arrosée de sang.
Une manif qui illustre l'innommable cruauté, clôturée par : « Une seule solution, la décolonisation ! » « Gaza, Gaza, Paris est avec toi ! Nous ne lâcherons rien ! Nous serons là pour empêcher les racistes de conquérir la rue ! » « On est là, on là, même si Macron ne veut pas, mais on là ! » « Pas de Fachos dans nos quartiers, pas de quartiers pour les Fachos ! Gaza vaincra ! ».
O.H




******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un « coup » à l’Université Columbia ?

Princeton est devenue la dernière université à être ciblée par l'administration Trump. Le gouvernement fédéral suspend des dizaines de subventions fédérales à Princeton. La nouvelle est tombée un jour après que l'administration Trump a menacé de couper près de 9 milliards de dollars à Harvard en raison de la réponse de l'école aux manifestations organisées par les étudiants sur le campus en solidarité avec Gaza. Auparavant, l'administration Trump avait suspendu 175 millions de dollars de financement fédéral à l'université de Pennsylvanie et 400 millions de dollars à l'université de Columbia. À Columbia, le conseil d'administration a réagi en acceptant une série de demandes du président Trump dans le but de conserver le financement fédéral.
(This is Democracy Now !, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman, with Juan González).
Tout cela intervient alors que Columbia est en pleine tourmente. Vendredi, la présidente intérimaire de Columbia, Katrina Armstrong, a démissionné. Le conseil d'administration de Columbia a alors nommé sa propre coprésidente, la journaliste Claire Shipman, au poste de présidente par intérim de l'école.
Pendant ce temps, Mahmoud Khalil, un étudiant palestinien leader de la contestation à Columbia, reste enfermé dans une prison pour immigrés en Louisiane plus de trois semaines après avoir été enlevé par des agents de l'ICE dans son logement de l'université de Columbia, après avoir fait appel au président de Columbia pour qu'il l'aide. Mardi, un juge fédéral du New Jersey a décidé que le procès de Khalil devait se poursuivre dans le New Jersey, où Khalil a été emmené avant d'être envoyé en Louisiane.
Nous sommes rejoints par Katherine Franke, ancienne professeure à la faculté de droit de Columbia.
Bienvenue sur Democracy Now ! En quoi est-ce inhabituel ? C'est la troisième femme, les trois premières femmes, à être présidente de l'université de Columbia. D'abord Minouche Shafik, et maintenant Katrina Armstrong, qui a été renvoyée et remplacée par le coprésident du conseil d'administration ?
KATHERINE FRANKE : Ce à quoi nous assistons, c'est à la poursuite et à l'escalade de la dérive du conseil d'administration de l'université de Columbia. Un rapport de près de 400 pages a été publié hier par le Sénat de l'Université de Columbia, documentant la manière dont les administrateurs ont abusé de leur pouvoir au cours des deux dernières années pour mal gérer les événements à Columbia. Ainsi, la nomination de Claire Shipman, en dehors du processus normal, à la présidence de Columbia fait partie de ce modèle de prise de contrôle de l'université par les administrateurs, par ces mandataires sociaux de l'université, qui ont clairement démontré qu'ils ne ressentent aucune fidélité à la protection de notre mission académique, mais qui, d'une certaine manière, travaillent main dans la main avec l'administration Trump pour détruire cette même mission.
JUAN GONZÁLEZ : Et, Katherine, quand vous dites que le conseil d'administration se comporte en voyou, quel serait le processus normal de sélection d'un président à Columbia ?
KATHERINE FRANKE : Eh bien, Juan, je suis heureuse que vous posiez la question. J'ai apporté avec moi la charte et les statuts de Columbia. L'un de leurs articles stipule très clairement que lorsqu'un président ou un président en exercice a quitté ses fonctions, a démissionné ou s'est retiré d'une autre manière, le provost est censé devenir le président en exercice, jusqu'à ce que les administrateurs procèdent à une recherche régulière, qui impliquerait de nombreuses parties prenantes au sein de la communauté universitaire. Mais au lieu de permettre à Angela Olinto, la doyenne de Columbia, qui jouit d'une excellente réputation et qui, je pense, aurait été accueillie comme présidente par intérim par tous les membres de notre communauté, ils ont nommé leur propre coprésident du conseil d'administration, conformément aux règles statutaires.
Et Juan, je dois dire que j'ai l'impression que l'université de Columbia est devenue la Tesla de la communauté universitaire américaine, où des personnes fortunées achètent leur place au conseil d'administration et se nomment ensuite PDG de l'organisation, pour ensuite ruiner l'image de marque de cette institution.
Personne de sensé ne veut d'une Tesla en ce moment, et les gens se dirigent vers les portes de Columbia. Les admissions viennent d'être publiées pour le programme de premier cycle, et les chiffres sont en chute libre.
Les étudiants ne veulent pas venir à Columbia.C'est donc très similaire, cette sorte de prise de contrôle hostile de notre institution, celle avec laquelle vous avez un long héritage, Juan, qui reflète ce qui se passe également dans d'autres parties du pays.
JUAN GONZÁLEZ : Et je voulais vous interroger à ce sujet, la menace de l'administration Trump de couper 400 millions de dollars de financement fédéral à l'université qui l'a forcée à reculer sur certaines questions clés.Columbia dispose, d'après mes dernières lectures, d'une dotation de 14,8 milliards de dollars.
Elle aurait facilement pu remplacer ces 400 millions de dollars pour les quatre mandats de - les quatre années de l'administration Trump - à partir de sa propre dotation, et je suppose que c'est à cela que sert une dotation, pour les situations d'urgence.
Quel est votre sentiment sur la façon dont ces universités, au cours des dernières décennies, en dépendant largement des entreprises donatrices ou des subventions fédérales, se sont mises dans une situation où elles sont essentiellement contrôlées par des forces extérieures ?
KATHERINE FRANKE : Je pense que c'est tout à fait exact, que le modèle d'entreprise d'une université, en particulier des grandes universités de recherche comme Columbia, en est venu, au cours des dernières années, à dépendre très fortement de l'argent fédéral pour son budget.C'est la plus grande partie de notre budget, avec les frais et autres revenus que nous tirons de la gestion de l'école de médecine.Il ne s'agit pas des frais de scolarité. Ce ne sont pas les grands donateurs.Ce sont les deux : l'argent fédéral et les revenus de la faculté de médecine. Il ne s'agit pas des frais de scolarité.
Ce ne sont pas les grands donateurs. Il s'agit de ces deux éléments : l'argent du gouvernement fédéral et les revenus de la faculté de médecine.
Et lorsque nous sommes en phase avec le gouvernement américain, c'est une excellente chose.
Mais lorsque ce n'est pas le cas, nous sommes incroyablement vulnérables. Je pense donc que c'est le moment où toutes les universités - et l'enseignement supérieur en général - doivent réfléchir à un nouveau modèle de gestion d'une université, qui ne soit pas aussi dépendant des vents politiques qui soufflent sur notre pays.
Je ne pense pas que le fonds de dotation va résoudre notre problème. Une grande partie des fonds de la dotation de Columbia, qui est la plus petite de toutes les écoles de l'Ivy League, je le note, sont liés de telle sorte qu'ils doivent être alloués à des flux de financement particuliers. Ils ne peuvent pas être réappropriés pour financer ou remplacer ces subventions fédérales. En tout état de cause, il s'agirait d'une solution de fortune à court terme. Le budget est trop important pour être couvert par les subventions fédérales qui ont été supprimées. Il s'agit de plus de 400 millions de dollars aujourd'hui, mais ce sera beaucoup plus. À Harvard, on parle de milliards de dollars. Le fonds de dotation ne peut pas combler cette lacune.
Il est donc temps pour nous de réfléchir aux raisons pour lesquelles les professeurs ou, plus important encore, les présidents d'université sont si bien payés.
Nous devons nous demander qui est rémunéré et valorisé au sein de l'université. Ce sont ces mêmes chercheurs de l'école de médecine qui gagnent beaucoup plus qu'un professeur de philosophie ou d'anglais à Columbia, en partie pour récompenser le fait qu'ils ont puisé dans les fonds fédéraux pour soutenir le modèle d'entreprise de l'université.
Il est donc temps que nous prenions du recul et que nous ne disions pas « Oh, la tirelire va nous sauver », mais que nous réfléchissions de manière plus critique à la manière dont nous gérons nos universités.
AMY GOODMAN : Je voudrais m'adresser à Jeff Sovern. Il est l'un des quatre enfants du premier président juif de l'université Columbia, Michael Sovern. Mardi, Democracy Now ! a contacté Jeff et lui a demandé de lire à haute voix la lettre ouverte que lui et ses frères et sœurs viennent de publier dans le Washington Post.
JEFF SOVERN : Notre père, Michael I. Sovern, a été le premier président juif de l'université Columbia, qu'il a servie pendant plus de 60 ans.
Nous pensons que s'il était vivant aujourd'hui, il serait dégoûté par la coercition exercée par le gouvernement sur Columbia, prétendument au nom de notre religion. Nous ne croyons pas que le président Donald Trump soit sincère dans sa volonté de protéger les juifs de l'antisémitisme.
Nous trouvons plus probable qu'une administration dont le vice-président a convenu avec Richard M. Nixon que « les professeurs sont l'ennemi » utilise l'antisémitisme comme prétexte pour nuire à Columbia et aux autres universités d'élite américaines. ...
Notre père est l'une des trois seules personnes inhumées sur son campus bien-aimé de Columbia. L'attaque de Trump contre l'université profane un lieu sacré pour notre famille. Il est à la fois plausible et inquiétant que certains à Columbia soient antisémites. Mais nous ne pensons pas que les tentatives visant à forcer l'université à renoncer à son indépendance soient une réponse appropriée. Et nous souhaitons que l'administration Trump cesse de nous éclairer au gaz.
AMY GOODMAN : Il s'agit de Jeff Sovern, l'un des quatre enfants du premier président juif de l'université Columbia, Michael Sovern.
Il lisait une lettre ouverte que lui et ses frères et sœurs avaient publiée dans le Washington Post. Professeur Katherine Franke, vous avez enseigné à Columbia pendant près d'un quart de siècle. Vous avez finalement été contrainte de prendre votre retraite en raison de votre soutien aux étudiants pro-palestiniens, aux étudiants juifs, aux étudiants musulmans, aux étudiants qui se considèrent comme athées, peu importe, mais qui partagent tous leur inquiétude face à l'assaut d'Israël sur Gaza. Pouvez-vous nous parler de ce qu'il dit et de ce marteau d'accusations d'antisémitisme, les assimilant à de l'antisionisme ?
KATHERINE FRANKE : Michael Sovern a été un incroyable président de notre université. Son bureau, après qu'il a quitté ses fonctions de président, se trouvait au bout de mon couloir, et je le voyais donc tous les jours. Il a dirigé l'université dans des moments très difficiles et était en fait président lorsque j'étais étudiante à Columbia - à Barnard. À l'époque où j'étais étudiante, Columbia n'admettait pas de femmes. La déclaration de ses enfants résonne donc très fort pour ceux d'entre nous qui ont très bien connu le président Sovern.
Je sais que Lee Bollinger, notre président le plus récent - enfin, pas le plus récent, car nous en avons eu tellement, mais notre président le plus récent à long terme - exprime lui aussi, enfin, de réelles inquiétudes quant à la direction de l'université.
Et j'ai parlé à un certain nombre d'anciens proviseurs, qui estiment que Columbia a perdu son chemin au nom de la protection des étudiants juifs - de certains étudiants juifs - contre les préjugés.
Et, bien sûr, nous ne devrions avoir aucune forme d'antisémitisme sur notre campus, mais ceci est utilisé comme une feuille de vigne pour un projet politique.
Si Columbia se souciait vraiment d'éradiquer toutes les formes de préjugés de notre université, elle aurait fait quelque chose de sérieux au sujet d'un de mes collègues masculins de la faculté de droit qui utilise régulièrement le mot N en classe, un collègue masculin blanc qui pense que c'est drôle et que cela le rend cool, ou un autre qui raconte des blagues sur l'esclavage à des étudiants noirs en classe et qui pense que c'est une chose très drôle et appropriée à faire dans la classe. Les élèves noirs de ces classes se sont plaints auprès de l'administration, mais rien ne s'est passé.
Je sais que Lee Bollinger, notre président le plus récent - enfin, pas le plus récent, car nous en avons eu tellement, mais notre président le plus récent à long terme - exprime lui aussi, enfin, de réelles inquiétudes quant à la direction de l'université.
Et j'ai parlé à un certain nombre d'anciens proviseurs, qui estiment que Columbia a perdu son chemin au nom de la protection des étudiants juifs - de certains étudiants juifs - contre les préjugés.
Et, bien sûr, nous ne devrions avoir aucune forme d'antisémitisme sur notre campus, mais ceci est utilisé comme une feuille de vigne pour un projet politique.
Si Columbia se souciait vraiment d'éradiquer toutes les formes de préjugés de notre université, elle aurait fait quelque chose de sérieux au sujet d'un de mes collègues masculins de la faculté de droit qui utilise régulièrement le mot N en classe, un collègue masculin blanc qui pense que c'est drôle et que cela le rend cool, ou un autre qui raconte des blagues sur l'esclavage à des étudiants noirs en classe et qui pense que c'est une chose très drôle et appropriée à faire dans la classe. Les élèves noirs de ces classes se sont plaints auprès de l'administration, mais rien ne s'est passé.
Nous avons donc une réaction excessive face à l'antisémitisme – et encore une fois, je ne prétends pas qu'il n'y a pas d'incidents ; il y a toujours des formes d'antisémitisme dans toutes les institutions dont nous faisons partie – mais nous ne réagissons absolument pas aux questions de sexisme, de racisme, d'homophobie, etc. D'ailleurs, tous ces propos ont été retirés du site web de l'université. J'ai des collègues transgenres à Columbia qui craignent pour leur sécurité dans les locaux de la faculté de droit. L'environnement ne nous a donc pas procuré un sentiment de sécurité accru. Notre sécurité a été instrumentalisée au nom de la promotion d'un projet politique plus vaste qui, à mon avis, vise à démanteler l'université elle-même.
JUAN GONZÁLEZ : Et Katherine, je voulais vous interroger sur la campagne de terreur menée par l'administration Trump contre les étudiants internationaux, notamment la révocation de leur statut d'immigration. Le Times of India rapporte que le Département d'État a envoyé des courriels à des centaines d'étudiants internationaux, leur demandant de s'auto-expulser pour leur prétendue participation à des activités militantes sur les campus. Les États-Unis sont depuis longtemps un lieu d'études pour des étudiants du monde entier. Quel est l'impact de cette situation, non seulement sur Columbia, mais aussi sur toutes les universités du pays ?
KATHERINE FRANKE : Eh bien, Juan, je ne saurais trop insister sur le fait que nos étudiants sont terrifiés.
Et il ne s'agit pas seulement des étudiants qui ont des visas ou des cartes vertes. Il s'agit de tous nos étudiants qui viennent d'autres pays, qui peuvent même être citoyens à ce stade, parce qu'il semble qu'il n'y ait pas de limite à la manière dont cette administration va tester et violer la loi en nettoyant - cela ressemble à une sorte de nettoyage racial et ethnique qui se produit sur nos campus.
L'une des raisons pour lesquelles j'aimais être professeur à Columbia était que dans beaucoup de mes cours, la moitié des étudiants venaient d'autres pays. Ils apportaient leurs expériences, leur sagesse, d'autres notions d'autres systèmes juridiques, d'autres cultures dans la salle de classe, ce qui en faisait un environnement d'apprentissage très riche. J'ai beaucoup appris d'eux.
Et quand je parle à mes collègues maintenant - je n'enseigne plus, mais j'entends que ces étudiants ne disent pas un mot. Et certains d'entre eux ne viennent même plus sur le campus, parce qu'ils ont peur de se faire pincer et que l'administration leur remette leur téléphone portable et leur adresse personnelle. Les classes se vident donc de ces voix et de ces corps. C'est une perte pour la communauté de Columbia, mais c'est une forme horrible de terreur pour les étudiants qui sont effrayés.
AMY GOODMAN : Alors que nous parlons de ce qui arrive aux étudiants, je voulais terminer - nous n'avons qu'une minute. Mardi, un juge fédéral du New Jersey a statué que Mahmoud Khalil - il était le négociateur entre les étudiants et l'Université de Columbia ; il était un étudiant diplômé de SIPA, qui avait une carte verte - que son cas - il a été retiré du logement de l'Université de Columbia ; sa carte verte a été révoquée ; il a été éloigné de sa femme, qui était sur le point d'accoucher ; et il a été envoyé dans une prison de l'ICE en Louisiane. Le juge du New Jersey a décidé que son dossier devait être traité dans le New Jersey, où il a été emmené avant d'être envoyé en Louisiane. Que se passe-t-il dans cette affaire ? Vous étiez conseiller de Mahmoud Khalil.
KATHERINE FRANKE : J'ai travaillé en étroite collaboration avec lui pendant un an et demi, tout comme l'université.
Ils l'ont choisi comme étudiant pour s'asseoir au milieu, entre les étudiants qui protestaient et l'administration elle-même, parce qu'ils savaient qu'il était mature, qu'il était raisonnable, que tout le monde lui faisait confiance. Il était exactement la personne qu'il fallait pour être le négociateur entre l'université et les étudiants. Et puis ils lui ont mis une cible dans le dos, essentiellement, en laissant des contre-vérités circuler dans les médias sociaux et ailleurs, sortir de la bouche de la secrétaire d'État et d'autres responsables de l'administration Trump. Vous savez, cela me brise le cœur, Amy, de voir ce qui lui arrive à lui et à sa famille, mais pas seulement à eux.
Il est toujours dans ce centre de détention, cet horrible endroit en Louisiane, même si l'affaire est dans le New Jersey.
Ses avocats se battent avec acharnement - je les connais tous bien - pour qu'il soit transféré. Son dossier a été déplacé, mais il ne l'a pas été. Et ils continuent d'argumenter auprès du juge pour que Mahmoud rentre chez lui, pour qu'il soit - en quelque sorte - chez lui, dans le New Jersey, pour qu'il soit plus proche de sa famille et de ses avocats.
C'est une horrible leçon de choses qui montre comment les institutions dont vous pensez faire partie et auxquelles vous pouvez faire confiance se retournent contre vous, qu'il s'agisse de Columbia ou du gouvernement des États-Unis, et à quel point il est difficile de le ramener dans un lieu de sécurité et de liberté. Et nous espérons tous que les prochaines plaidoiries au tribunal ramèneront Mahmoud au moins dans un centre de détention du New Jersey, ce qui est mieux que l'endroit où il se trouve actuellement.
AMY GOODMAN : Katherine Franke, ancienne professeure à la faculté de droit de Columbia, où elle a passé un quart de siècle, a été contrainte de prendre sa retraite en janvier.
Source : https://www.democracynow.org/2025/4/2/university_trump_gaza_harvard_princeton_columbia
Traduit avec Deepl.com, par Martin Gallié pour PTAG.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Alors que les crises convergent, le défi de savoir comment avancer pour celleux d’en bas

Cette résolution sur la situation mondiale était adoptée par le 18e Congrès mondial par 109 pour, 12 contre, 7 abstentions et 4 NPPV.
Par Quatrième internationale
27 mars 2025
18e Congrès Mondial - 2025
Toastt21 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0
Introduction
Il y a quatre ans, il était impossible de prédire à quelle vitesse la multicrise, ou convergence des crises capitalistes, allait s'accélérer. Donald Trump est revenu renforcé au gouvernement de l'impérialisme hégémonique, cette fois avec un cabinet et un projet ouvertement néofasciste ou “pur” post-fasciste : le Projet 2025 de la Fondation Heritage (l'un des groupes de réflexion les plus anciens et les mieux financés de l'extrême droite américaine), repris par le Parti républicain trumpiste. Il représente les secteurs les plus radicaux du capital étatsunien – en termes de libertarianisme néolibéral et de mépris pour les institutions de la démocratie bourgeoise la plus ancienne : nominalement les Big Tech, la crypto finance, le capital-risque et l'industrie fossile, auxquels s'ajoute l'industrie désormais plus lucrative que jamais de l'armement.
Compte tenu de la profondeur et de la violence des mesures qu'elle applique déjà aux niveaux national et international, l'administration américaine sous Trump-Musk devient une “bombe” intensifiant au maximum toutes les crises de la “multicrise” (ou convergence des crises) que nous soulignons dans ce document. C'est un tournant, qui inaugure un nouveau moment dans la situation mondiale, encore plus turbulent, dangereux et imprévisible. Trump 2.0 cherche à lutter contre le déclin relatif de l'hégémonie américaine au cours des dernières décennies en projetant à l'échelle mondiale une suprématie expansionniste, recolonisatrice, prédatrice et annexionniste – une suprématie qui ramènerait les États-Unis à la situation d'hégémonie sans concurrents de l'immédiat après-guerre. C'est le sens national et international de MAGA.
Le Trump du second mandat est bien plus activement dangereux pour les travailleur·ses et les citoyen·nes américain·es, pour la géopolitique, l'économie mondiale et l'équilibre international des pouvoirs que son premier mandat. Il considère tout le monde comme un ennemi : la Chine en premier lieu, la Russie de son “ami” Poutine, l'ONU et avec elle toutes les institutions de l'ordre mondial des 80 dernières années, ainsi que les BRICS et tout gouvernement souverain se trouvant sur son chemin. Sans parler des institutions démocratiques bourgeoises américaines elles-mêmes, sur lesquelles il entend imposer des changements sans précédent.
Fort d'une victoire électorale convaincante, du contrôle du Congrès et de la Cour suprême, d'un ministère de faucons et de milliardaires non qualifiés mais loyaux, Trump est sérieux lorsqu'il menace de reprendre le canal de Panama, de s'emparer du Groenland et d'annexer le Canada, et lorsqu'il annonce un plan explicite pour « nettoyer » Gaza et déporter ses habitant·es en Égypte et en Jordanie, soutenir la colonisation israélienne de la Cisjordanie, après avoir imposé le récent cessez-le-feu à un Netanyahou réticent mais complètement soumis. Son administration procède déjà à des expulsions humiliantes et médiatiques (des travailleurs immigrés latino-américains et indiens, qualifiés de bandits, arrivent enchaînés dans leur pays).
Le leader mondial des climatosceptiques, Trump 2.0, a annoncé des incitations totales à l'exploration et à l'exploitation des énergies fossiles (drill, baby, drill !), a déjà détruit l'EPA (l'agence américaine de l'environnement) et a ordonné l'annulation du financement de tous les programmes avec lesquels les États-Unis collaboraient à des projets de protection écologique à l'étranger. Le rejet même du “capitalisme vert” par ces nouvelles fractions impérialistes au pouvoir est lié à la concurrence avec la Chine, qui domine les technologies alternatives aux énergies fossiles (éolien, solaire, transport électrique). L'intelligence artificielle, sur laquelle ils parient comme le moyen le plus rapide de dépasser les Chinois, nécessite des ressources énergétiques gigantesques et un contrôle sur les ressources minérales de toute sorte.
Pour mettre en pratique le “America First”, les néofascistes désormais soutenus par des secteurs essentiels du capital étatsunien ont besoin du climato-scepticisme, du mépris absolu pour les terribles menaces que la catastrophe écologique fait peser sur la vie de centaines de millions d'êtres humains innocents, tout comme ils ont besoin de la haine de ceux qui sont différents, de ceux qui résistent, des femmes, des LGBTQIA+. Ils ont besoin de l'exaltation virilo-misogyne de la force comme moyen de s'imposer, de la volonté de soumettre la Chine, la Russie, l'Europe et le monde entier. Mais ils ont avant tout besoin de vaincre les mouvements syndicaux, étudiants, communautaires, féministes, noirs et indigènes, les ONG pro-démocratie, et même la presse bourgeoise américaine critique.
Le projet trumpiste exprime également la nécessité pour ces fractions du capital impérialiste qu'il représente d'empêcher à tout prix – même au prix du démantèlement de l'État américain et de la fin de tout vestige de politique sociale et égalitaire – la transformation démographique des États-Unis en une nation pleinement diverse, majoritairement non blanche, racialement, politiquement, sexuellement et religieusement, et la menace politique qui en découle pour l'élite politique et économique wasp. Comme le soulignent les analyses de Black Lives Matter, il s'agit d'une réaction stratégique face au danger que la population américaine ne soit plus blanche, protestante ou anglo-saxonne, tout comme ne l'est plus la Californie (avec les Latinos, les Afro-Américain·es, les métis, les Asiatiques et les peuples autochtones).
La victoire de Trump a stimulé les mouvements d'extrême droite dans les centres capitalistes et dans les pays périphériques ou semi-périphériques. Les peuples les plus directement menacés par l'impérialisme hégémonique sous Trump sont les peuples du Moyen-Orient, à commencer par les Palestiniens. La nouvelle administration américaine devient maintenant, avec le gouvernement génocidaire de Netanyahou, l'avant-garde de l'extrême droite mondiale, avec un soutien total au projet colonial de l'État sioniste. Israël mène actuellement une campagne de terreur massive et une guerre asymétrique qui constituent un saut qualitatif dans la guerre d'apartheid, de colonisation et de nettoyage ethnique qui dure depuis 75 ans. Le premier objectif est d'éradiquer le peuple palestinien par la déshumanisation des Palestinien·nes et une logique suprémaciste. Mais, un pays après l'autre, les réfugiés et les migrants, les militants écologistes, les militants de la solidarité avec la Palestine et d'autres sont la cible de mesures répressives adoptées par des gouvernements de droite (et autres), officiellement dirigées contre de prétendues menaces « terroristes », « criminelles » et « antisémites ».
L'administration Trump 2.0, ainsi qu'Israël, visent également à isoler davantage l'Iran et à l'attaquer – une des explications des tentatives étatsuniennes de séparer la Chine de la Russie et de passer des accords distincts avec l'Inde de Modi, en un mot de diviser les fragiles BRICS actuels. Au Moyen-Orient, neutraliser Poutine pour qu'il n'interfère pas dans la région en échange d'une paix pro-russe dans la guerre d'Ukraine pourrait signifier un nouveau chapitre plus sanglant de la guerre expansionniste étatsunienne-israélienne contre l'Iran.
En Europe occidentale, l'impact de Trump, ses menaces, ses tarifs douaniers et son chantage avaient déjà fait pression sur Macron pour élever les dépenses militaires françaises aux 5 % exigés par les États-Unis. Les menaces de l'impérialisme américain contre le Groenland sont, avant tout, une menace contre la population du Groenland, qui se retrouve prise dans un réseau de concurrence impérialiste qu'elle n'a pas choisi. Mais c'est aussi une menace pour le monde, mis en danger par l'exploitation avide des richesses du Groenland et la militarisation du fragile Arctique. Un simple accident comme celui du golfe du Mexique en 2010 pourrait signifier des dommages irréversibles pour les océans de la planète. De même, un affrontement militaire dans l'Arctique pourrait s'avérer fatal pour les écosystèmes mondiaux. La perspective à court et moyen terme est un renforcement du réarmement général.
Alors que la concurrence économique et géopolitique entre les États-Unis et la Chine s'intensifie sous Trump, le monde deviendra encore plus militarisé ; la menace nucléaire se renforcera et les conflits et les tensions se multiplieront à la suite des contradictions exacerbées par le nouveau projet impérialiste. Rien ne se fera sans contradictions importantes. Comment parviendront-ils à déconnecter l'économie américaine de la machine manufacturière chinoise ? Si l'ennemi central est la Chine – s'interroge le New York Times – pourquoi alors se battre avec ceux qui pourraient être des alliés contre elle (en référence à l'Inde, à l'Europe, et aux voisins Mexique et Canada) ? Pourquoi la guerre tarifaire généralisée, qui va faire monter les prix intérieurs ? Si l'effondrement climatique a le potentiel d'anéantir une grande partie de l'humanité, pourquoi l'encourager ?
C'est la nature du capital en général et de ces secteurs en particulier : face à une réduction sans précédent de la croissance et de leurs taux de profit et d'accumulation après 2008, ils embrassent la solution ultralibérale, guerrière et fasciste. Devant l'impossibilité de rester les gestionnaires d'un système qui garantit des profits extraordinaires pour le capital de tous bords, ils choisissent de protéger leurs propres intérêts et d'imposer leurs règles au monde. Un projet mondial de changement d'une telle ampleur et d'une telle virulence ne peut s'imposer sans rencontrer une résistance importante.
Même si les exploité·es sont privé·es d'alternatives sociales et politiques de la part de la gauche révolutionnaire, les conflits de tous bords s'intensifieront. Les militant·es et sympathisant·es de la IVe Internationale doivent répondre à ce scénario incertain et difficile par une compréhension et une action révolutionnaires. La crise multidimensionnelle du capitalisme, avec ses monstres – dont l'un se trouve à la Maison Blanche – rapproche la planète de l'effondrement et l'humanité de l'extinction. Notre immense tâche est de contribuer à l'arrêter de toute urgence.
I/ Une crise planétaire multidimensionnelle
Les problèmes importants de l'humanité sont plus internationaux que jamais. La crise capitaliste est devenue multidimensionnelle pour la société humaine et la Terre. Il y a une articulation dialectique des différentes sphères, sans hiérarchie, entre (a) la crise environnementale – qui depuis plusieurs années produit des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes et rapproche le point de non-retour, la limite pour mettre en œuvre des mesures visant à assurer la survie même de l'humanité sur Terre, (b) la phase de stagnation économique de longue durée, et ses conséquences sociales déstructurantes, (c) l'avancée de l'extrême droite sur la voie ouverte par les démocraties et les gouvernements néolibéraux en crise, (d) l'intensification, sur le plan de la bataille entre les États, de la lutte pour l'hégémonie entre les États-Unis et la Chine, (e) la multiplication et l'intensification, toujours plus dangereuses, des guerres.
La crise de la mondialisation néolibérale a ouvert une nouvelle phase dans l'histoire du capitalisme. Il s'agit d'une période qualitativement différente de celle que nous avons vécue depuis l'instauration de la mondialisation néolibérale à la fin des années 1970, et bien plus conflictuelle du point de vue de la lutte des classes et de la lutte entre les États que celle qui s'est ouverte il y a 33 ans avec l'effondrement de l'Union soviétique et des régimes bureaucratiques d'Europe de l'Est.
1.1. Qu'est-ce qui caractérise la polycrise actuelle ?
Il existe deux différences majeures entre la situation actuelle et la convergence des crises au début du 20e siècle, qui ont débouché sur “l'ère des catastrophes” (1914-1946). La facette la plus immédiatement menaçante de cette crise multidimensionnelle qui n'existait pas il y a cent ans est la crise écologique provoquée par deux siècles d'accumulation capitaliste prédatrice.
L'économie capitaliste mondialisée, basée sur la combustion d'énergies fossiles et la consommation croissante de viande et d'aliments ultra-transformés, aggrave rapidement la crise climatique. Un climat qui réduira l'avenir de l'humanité sur la planète. La fonte des pôles et des glaciers accélère la montée des eaux et la crise de l'eau. L'agro-industrie, l'exploitation minière et l'extraction d'hydrocarbures progressent (non sans résistance) sur les forêts tropicales, pourtant essentielles au maintien des systèmes climatiques et de la biodiversité de la planète. Les effets de la crise climatique continueront à se manifester violemment, détruisant les infrastructures, les systèmes agricoles, les moyens de subsistance et provoquant des déplacements massifs de populations.
Rien de tout cela ne se produira sans une exacerbation des conflits sociaux.
Le deuxième élément à souligner (très différent d'il y a cent ans) est l'absence d'alternatives révolutionnaires de masse. En effet, au milieu de ces changements de plus en plus rapides, le problème de l'absence d'une alternative crédible au capitalisme aux yeux des masses, l'absence d'une force anticapitaliste ou d'un ensemble de forces dirigeant des révolutions économiques et sociales devient plus aiguë. Le moment d'extrême instabilité du capitalisme et de son système interétatique est aussi celui d'une grande fragmentation politique et idéologique des mouvements sociaux et de la gauche.
1.2. Les crises se renforcent mutuellement : guerres, reproduction sociale et algorithmes
Une crise multidimensionnelle n'est pas une simple somme de crises, mais une combinaison dialectiquement articulée, dans laquelle chaque sphère a un impact sur l'autre et est impactée par les autres. Le lien entre la guerre en Ukraine (avant l'explosion du conflit en Palestine) et la stagnation économique a aggravé la situation alimentaire critique des plus pauvres dans le monde, avec plus de 250 millions de personnes supplémentaires souffrant de la faim en dix ans (2014-2023). Le flux de personnes déplacées par les guerres, le changement climatique, la crise alimentaire et la propagation des régimes répressifs augmente, en particulier dans les pays les plus pauvres.
On ne peut expliquer la montée des tensions militaires régionales et internationales, ainsi que la militarisation rapide des discours et des budgets gouvernementaux ou la croissance récente de l'industrie d'armement, sans prendre en compte l'exacerbation de la concurrence sur les marchés mondiaux, l'intensification de l'extractivisme néocolonial et la lutte pour les minerais stratégiques (que ce soit pour la production de véhicules électriques ou d'armes de dernière génération, ou encore pour alimenter l'économie numérique et le monstre de l'intelligence artificielle). Aucune région de la planète n'est exempte de zone de haute-tension : le Moyen-Orient, la mer de Chine et l'Afrique en sont de bons exemples. L'enchaînement des écocides sur les cinq continents et dans toutes les mers ne s'explique pas non plus s'il n'est pas lié à cette recrudescence des concurrences intercapitalistes et interimpérialistes, qui montre une fois de plus que l'économie de l'armement – surtout après la Seconde Guerre mondiale – est un élément constitutif et permanent de l'impérialisme sous toutes ses formes, dans toutes les géographies et à toutes les époques.
Le changement climatique, l'appauvrissement des terres, l'accaparement des territoires les plus fertiles par les oligarchies, ainsi que la baisse de la part des salariés dans les revenus nationaux, l'abandon et la détérioration des services de base (santé, éducation, eau, etc.) par les États néolibéraux, ont généré une augmentation des inégalités entre les individus – mais surtout un plus grand éloignement de l'accès aux revenus, aux biens et aux richesses entre les pays, les classes sociales, les communautés et les peuples, et entre les hommes et les femmes, les personnes racisées et les autres.
Les perspectives désastreuses dans les domaines environnemental et économique poussent une partie significative des fractions bourgeoises dans différents pays à abandonner le projet des démocraties formelles comme meilleur moyen d'obtenir des profits croissants. Des secteurs d'activité de plus en plus importants commencent à soutenir des alternatives autoritaires au sein des démocraties libérales, ce qui conduit au renforcement des mouvements fondamentalistes de droite et des gouvernements d'extrême droite sur tous les continents. Il existe une fracture – dont la pérennité reste à démontrer – entre les différentes fractions bourgeoises dans les différents pays, une partie de la classe dominante se tournant vers l'ultra-droite et une autre partie restant attachée au projet démocratique-bourgeois. L'exemple le plus notable de cette division entre fractions capitalistes est la polarisation entre le trumpisme (qui a pris d'assaut le Parti républicain) et le Parti démocrate aux États-Unis.
L'expansion d'une sociabilité néolibérale hyperindividualiste, qui, combinée à l'utilisation par la droite des réseaux sociaux et peut-être maintenant de l'Intelligence Artificielle (AI), favorise encore plus la dépolitisation, la fragmentation des classes et le conservatisme. Les technologies numériques, en plus de l'impact sur l'emploi et l'organisation des salariés, contribuent également à approfondir la subordination-clientélisation, sinon sa réduction pure et simple, de la moyenne et petite paysannerie, considérée comme la principale productrice de l'alimentation mondiale. Le capitalisme néolibéral d'aujourd'hui introduit des dispositifs numériques et des algorithmes en tant que nouvelles forces productives, donnant lieu à l'émergence du travail sur les plateformes numériques – parfois appelé ubérisation, qui occupe déjà plus de 200 millions de travailleur·ses – et à diverses relations sociales médiatisées exclusivement par le marché.
D'autre part, le néolibéralisme, en continuant à attaquer violemment ce qui reste de l'État-providence, en imposant la surexploitation des travailleur·ses de l'industrie et des services et surtout des soignant·es, jette les femmes, en particulier les femmes travailleuses et encore plus violemment, les femmes racisées (Afro-descendantes, Roms, descendantes de peuples autochtones, Africaines et Sud-Asiatiques dans le Nord global) dans le dilemme entre survivre (mal) ou se défendre. Le néolibéralisme maintient les femmes dans la force de travail formelle (largement dans le Nord) ou moins structurée, plus informelle (tout autour du monde mais particulièrement dans le Sud Global), réduisant encore les salaires et les revenus des salariées (qu'elles travaillent dans l'industrie, les services ou le commerce). L'idéologie du retour à la famille traditionnelle, constitutive de la matrice néolibérale et qui est poussée à l'extrême par l'aile droite des fondamentalismes, sert à faire peser sur toutes les femmes des classes populaires les tâches de prendre en charge les enfants, les personnes âgées, les malades et les personnes handicapées. Ce type de travail était autrefois couvert par l'État-providence, en particulier dans les pays capitalistes avancés, mais il fait aujourd'hui l'objet de coupes brutales.
La formation de blocs géopolitiques a également des conséquences sur la politique sexuelle : des alliés des États-Unis, tels que Taïwan et la Thaïlande, introduisent le mariage entre personnes du même sexe, tandis que la Chine revient sur des avancées antérieures en faveur des personnes LGBTQIA+, et qu'un adversaire des États-Unis comme l'Iran soutient un axe hostile à l'émancipation sexuelle (alors que certains membres du bloc dirigé par les États-Unis, du Vatican au royaume saoudien, sont tout aussi réactionnaires dans ce domaine).
Avec des réseaux de reproduction sociale en crise, plus importante dans les pays néocoloniaux que dans les métropoles, la société néolibérale “domestifie” (confie à la famille) et racialise (confie aux non-Blancs, aux Noirs, aux femmes indigènes, aux immigré·es) les tâches de soins, mais n'assume pas la responsabilité de la reproduction sociale dans son ensemble.
1.3. La situation économique et sociale
Nous vivons toujours sous l'impact de la formidable crise économique ouverte par le krach financier de 2008, qui a débuté l'année précédente et a ouvert une récession mondiale. Le mode de fonctionnement capitaliste néolibéral ne peut plus garantir les taux de croissance, de profit et d'accumulation de la fin des années 1980 et des années 1990. Deuxièmement, la polarisation géopolitique, aggravée par les guerres et la montée du nationalisme réactionnaire – grandement renforcé par l'arrivée de Trump 2.0 – ébranle les chaînes de valeur super-internationalisées, la production et le commerce international.
La mondialisation néolibérale est en crise. Cependant, aucune des grandes difficultés du capitalisme néolibéral n'a entraîné de changement dans la nature financiarisée – dirigée par le capital financier – qui concentre la richesse dans les comptes d'un nombre de plus en plus restreint d'entreprises et d'individus, tout en jetant de plus en plus d'êtres humains dans la pauvreté. Bien qu'en crise, le capital et son régime économique néolibéral continuent de produire des inégalités entre les pays, les régions et à l'intérieur des pays. Pour la seule année 2024, le système a créé 204 nouveaux milliardaires, alors que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté, avec moins de 6,85 dollars par jour, est resté inchangé depuis les années 1990. En 2023, les 1 % les plus riches des pays impérialistes ont soutiré 30 millions de dollars par heure aux pays dépendants ou semi-coloniaux – un résultat qui découle fondamentalement du système financier qui impose aux gouvernements du monde des ajustements inacceptables, l'endettement, la réduction des salaires, des droits sociaux et la marchandisation de l'agriculture.
La numérisation des processus de production et de consommation, qui dure depuis 30 à 40 ans et qui était à la base de la restructuration dite néolibérale de la production, s'intensifie aujourd'hui avec l'introduction accélérée de l'IA. L'IA est mise en œuvre pour récupérer les taux de profit et d'accumulation en recherchant un bond dans la productivité du travail et des taux de profit. Une fois de plus, cela réduira l'emploi, rendra les emplois et les travailleur·ses plus précaires et donnera de plus en plus de pouvoir aux entreprises technologiques.
Outre leur caractère récessif, les politiques économiques néolibérales – fondées sur les intérêts prédominants de la finance – ébranlent le niveau de vie des masses laborieuses par le biais de l'endettement des travailleurs et des pays dépendants auprès des grandes banques privées impérialistes ou du FMI et de la Banque mondiale. La hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation accroît les dettes souveraines et privées, créant les conditions de nouvelles crises de défaut de paiement, comme celles qui ont déjà éclaté au Sri Lanka, au Ghana et en Zambie, ou évitées in extremis grâce aux prêts d'urgence accordés par le FMI et la Chine à des dizaines de pays tels que l'Argentine, le Nigeria, le Pakistan, l'Égypte, le Kenya, le Bangladesh et la Tunisie. La recherche effrénée de « protection contre la crise » (c'est-à-dire le maintien des profits) par les entreprises encourage la spéculation financière. Cette spéculation menace en permanence le système avec des vagues de faillites comme en 2008.
II/ L'extrême droite défie les régimes “néolibéraux démocratiques”, les travailleur·ses et les opprimé·es
Depuis la récession post-2008, mais plus clairement depuis 2016 (Brexit et première victoire de Trump), une constellation de nouvelles forces d'extrême droite se développe dans les États et les sociétés. Son avant-garde mondiale est aujourd'hui le génocidaire Benyamin Netanyahou avec son rôle de colon raciste au Moyen-Orient. Outre sa montée en puissance en Europe, en Asie et en Amérique latine, l'extrême droite menace les États-Unis et le monde avec le retour de Trump à la Maison Blanche.
Les forces d'extrême droite du 21e siècle se sont renforcées et multipliées au fil des victoires électorales, puis des mesures anti-immigration et de restriction des libertés et des droits sociaux. Elles se présentent comme ‘‘anti-système” (contre les systèmes politiques qu'elles identifient hypocritement à la dégradation des conditions de vie, à la corruption et à l'insécurité), alors qu'elles ne le sont pas du tout. Elles sont l'expression ultime de la défense du capitalisme dans sa phase actuelle. Pour garantir l'application de leurs politiques ultra-néolibérales ou, dans certains cas, de nationalisme xénophobe, elles ont recours à des discours traditionalistes réactionnaires, et le racisme le plus violent, généralement sous des déguisements religieux fondamentalistes – le christianisme pentecôtiste aux États-Unis et au Brésil, l'hindouisme en Inde, l'islamisme au Pakistan, en Afghanistan et en Iran.
S'appuyant sur leur grande et précoce expertise dans l'utilisation de réseaux sociaux de plus en plus gigantesques et non réglementés (dans lesquels, en général, il est possible de dire des contre-vérités et de porter des accusations infondées en toute impunité), ils déclarent la guerre aux droits des travailleur·ses en général, mais surtout aux droits des femmes, aux LGBTQIA+, aux minorités (ou majorités) ethniques ou religieuses internes, aux immigré·es, aux personnes raciisées en général et aux militant·es de l'environnement. Avec leur négationnisme scientifique en tout genre, ils sont en guerre ouverte contre les mouvements écologistes et tous ceux qui croient au changement climatique.
Comme leurs ancêtres nazis classiques, ils sont essentiellement racistes envers différents groupes ethniques – tels que les migrants de deuxième, troisième et quatrième génération en Europe et les Noirs, les populations asiatiques, arabes et latinos aux États-Unis – et souvent particulièrement violents envers les vagues de migrants les plus récentes, qu'ils accusent d'être responsables des problèmes d'emploi et d'insécurité. En Asie du Sud-Est, “l'ennemi désigné” est constitué par les minorités d'une autre religion que la religion majoritaire, comme Modi avec les deux cents millions de musulmans du pays.
Bien que l'extrême droite au pouvoir aujourd'hui ne tende pas à établir des régimes fascistes classiques basés sur le modèle des années 1930, les gouvernements d'extrême droite de l'Inde, de la Turquie, de la Hongrie et d'autres pays ont réussi pendant des années à combiner les formes apparentes de la démocratie bourgeoise avec une répression efficace des médias indépendants, des partis et des mouvements d'opposition, ainsi que des intellectuels critiques. Cette tendance s'intensifie. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a entraîné une répression féroce des voix anti-guerre et de la dissidence en général. La répression vise également la dissidence sexuelle et de genre, alors que des lois contre la « propagande gay » deviennent plus sévères et sont adoptées dans d'autres pays – tandis que dans des pays comme l'Indonésie et la Turquie, l'espace qui s'était ouvert aux communautés LGBTQIA+ s'est récemment refermé. En Israël, le gouvernement néofasciste dénonce toute opposition à la guerre génocidaire contre Gaza comme « antisémite » et, en conséquence, la réprime. Les gouvernements pro-israéliens d'Amérique du Nord et d'Europe mènent des campagnes similaires
Cette combinaison de néolibéralisme extrême et de traditionalisme fondamentaliste et racisme est extrêmement fonctionnelle pour le système capitaliste : elle est l'expression de la recherche, par de larges secteurs bourgeois du Nord et du Sud, d'une issue économique, politique et idéologique à la crise structurelle du système en faisant avancer l'histoire “à l'envers”. Ces capitalistes continuent de soutenir ceux qui promettent d'instaurer un régime autoritaire, de détruire les droits (et bien sûr tout semblant d'État-providence), de renvoyer les femmes à la sphère domestique (c'est-à-dire à la simple reproduction de la force de travail), de soumettre les personnes racisées et les sexualités alternatives à l'oppression la plus brutale et à l'invisibilité, d'expulser des migrants et leurs descendants, de contrôler les mouvements de masse d'une main de fer, d'imposer des ajustements brutaux et des dépossessions, en particulier de ce qui reste de la paysannerie et des sociétés communales. Tout cela dans le but de parvenir à une société majoritairement surexploitée, délivrée idéalement des conflits, dans laquelle le capital pourra récupérer ses taux de profit et d'accumulation perdus.
L'avancée de cette constellation d'extrême droite est le résultat de décennies de crise des démocraties (néolibérales) et de leurs institutions (y compris tous les partis traditionnels, même ceux de “gauche” , qui ont administré des États sous le régime du néolibéralisme). Ces gouvernements et régimes engagés dans le néolibéralisme ont accru les inégalités, la corruption, l'insécurité, ainsi que la misère, les guerres et les catastrophes climatiques dans les pays du Sud – ce qui encourage les migrations vers le Nord. Ils ont apporté des réponses insatisfaisantes aux aspirations des peuples et des travailleurs. Ils ont ainsi contribué à tourner les classes moyennes possédantes, les secteurs salariés privilégiés (les cols blancs), et même une partie des classes les plus vulnérables, vers des alternatives autoritaires.
La nouvelle extrême droite est le résultat complexe de la désintégration des tissus sociaux imposée par le néolibéralisme, le désespoir des secteurs sociaux appauvris face à l'aggravation de la crise depuis 2008, combinée à (1) l'échec de la droite “néolibérale progressiste” et des “alternatives” représentées par la social-démocratie (social-libéralisme et “progressisme” au Sud et à l'Est) à enrayer la paupérisation, la précarité de l'emploi, l'insécurité face à la criminalité et à l'immigration et (2) l'absence générale d'alternatives populaires révolutionnaires présentant une voie radicalement opposée à la crise.
L'extrême droite peut être particulièrement pernicieuse lorsqu'elle met en avant une politique “modernisée” en matière de genre et de sexualité, revendiquant un engagement nouveau en faveur de l'émancipation des femmes et de la tolérance à l'égard des personnes LGBTQIA+, tout en s'en prenant vicieusement à certains des groupes les plus vulnérables. Les personnes transgenres sont des cibles privilégiées de l'extrême droite, par exemple des Républicains aux États-Unis, de Bolsonaro, de Milei, tandis que les droits parentaux et d'adoption des couples de même sexe font l'objet d'attaques concertées de la part, par exemple, du gouvernement Meloni en Italie. La résistance à ces attaques doit faire partie intégrante de la solidarité contre l'extrême droite.
Ce tableau pose comme tâche fondamentale pour la Quatrième Internationale : la luttes sur tous les fronts contre les forces d'extrême droite, l'autoritarisme et le néofascisme, mais aussi contre les politiques néolibérales et réactionnaires qui les ont fait naître et qui continuent à les façonner.
III. Les exploité·es, les secteurs opprimés et les peuples du monde ont répondu par des mobilisations. Et maintenant ?
Ce siècle a connu au moins trois grandes vagues de luttes démocratiques et anti-néolibérales (début du siècle, celle de 2011 et celle de 2019-2020), un mouvement des femmes renouvelé, le mouvement antiraciste qui a émergé aux États-Unis, et une constellation de luttes pour la justice climatique à travers le monde. Cependant, ces grandes luttes ont été confrontées, d'un point de vue objectif, non seulement au capitalisme néolibéral et à ses gouvernements, mais aussi aux dilemmes de la réorganisation structurelle du monde du travail.
La classe ouvrière au sens large (salarié·es), qui se prépare actuellement aux impacts de l'intelligence artificielle (et résiste, comme le montre la grève des scénaristes et des acteurices d'Hollywood), reste une force vivante et nombreuse, bien que restructurée, réprimée, moins consciente et organisée qu'au siècle dernier. Les grands complexes industriels avec des dizaines, des centaines de milliers de travailleur·ses s'étendent en Chine et dans toute l'Asie du Sud-Est. Néanmoins, dans le contexte où la classe ouvrière industrielle a perdu de son poids social dans une grande partie du monde capitaliste avancé, les secteurs opprimés, les jeunes et les nouvelles franges de travailleur·ses précaires ne sont pas encore organisés de manière permanente et ont en général des difficultés à s'unir avec le mouvement syndical affaibli. Dans le même temps, les méthodes traditionnelles d'organisation des syndicats échouent souvent à répondre adéquatement aux besoins du précariat d'aujourd'hui. Pour leur part, les paysan·es d'Afrique, d'Asie du Sud (Inde et Pakistan) et d'Amérique latine résistent elleux aussi courageusement à l'invasion de l'agro-industrie impérialiste. Les peuples indigènes, qui représentent 10 % de la population mondiale, résistent à l'avancée du capital sur leurs territoires et défendent les biens communs indispensables à l'ensemble de l'humanité. La défaite du Printemps arabe, la tragédie syrienne et maintenant l'avancée expansionniste du sionisme va retarder et retarder encore la capacité de résistance des peuples du Proche et du Moyen-Orient – malgré cela, nous voyons le soulèvement héroïque des femmes et des filles d'Iran.
Après la crise de 2008, on a assisté à une reprise des mobilisations de masse dans le monde entier. Printemps arabe, Occupy Wall Street, Plaza del Sol à Madrid, Taksim à Istanbul, juin 2013 au Brésil, Nuit Debout et Gilets jaunes en France, mobilisations à Buenos Aires, Hong Kong, Santiago, Bangkok. Cette première vague a été suivie d'une deuxième vague de soulèvements et d'explosions entre 2018 et 2019, interrompue par la pandémie : la rébellion antiraciste aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec la mort de George Floyd, les mobilisations de femmes dans de nombreuses régions du monde, les révoltes contre les régimes autocratiques comme en Biélorussie (2020), une mobilisation massive des agriculteurices indien·es a été victorieuse en 2021. En 2019, des manifestations, des grèves ou des tentatives de renversement de gouvernements ont eu lieu dans plus de cent pays : dans six d'entre eux, les gouvernements ont été renversés avec succès, dans deux autres, la composition des gouvernements a été complètement modifiée par des changements ministériels.
Au lendemain de la pandémie, il y a eu trois mois de résistance en France contre la réforme des retraites de Macron et le soulèvement des travailleur·ses, des étudiant·es et du peuple en Chine qui a mis en échec la politique Zéro Covid du PCC. Aux États-Unis, le processus de syndicalisation et de lutte se poursuit dans de nouveaux secteurs (Starbuck's, Amazon, FedEx), avec l'émergence de nouveaux processus anti-bureaucratiques partis de la base, avec des grèves principalement dans l'éducation et la santé. En 2022/2023, la grande grève des scénaristes et des acteurices d'Hollywood, ainsi que la grève historique et jusqu'à présent victorieuse des travailleur·ses des trois grandes entreprises automobiles du pays.
Bien sûr, le rapport de forces actuel n'est pas du tout favorable et le temps n'est pas à l'offensive, tout comme il ne l'était pas pendant la pandémie – qui, cependant, a conduit au mouvement Black Lives Matter, si important pour la défaite de Trump en 2020, et à la grève française contre la réforme des retraites, si fondamentale pour expliquer la remarquable capacité de réaction électorale de la gauche française en 2024. Souligner, à juste titre, que la précédente vague de luttes a reflué, et que l'extrême droite montante est aujourd'hui un ennemi fondamental et dangereux ne peut pas nous conduire à conclure que les exploité·es et les opprimé·es du monde sont défait·es, écrasé·es pour une longue période. Par contre, dire que nous ne sommes pas historiquement vaincu·es ne signifie pas non plus caractériser la situation comme offensive ou révolutionnaire. Au-delà de “l'offensivisme” et de l'impressionnisme défaitiste, il y a la place pour un pari réaliste sur la capacité des exploité·s et des opprimé·es à continuer à résister au capital et à ses conséquences néfastes, à lutter pour leur survie et de meilleures conditions de vie, au milieu des guerres, des bouleversements climatiques et des plans d'ajustement, bien qu'avec des nouvelles formes d'organisation et avec plus de difficultés qu'auparavant.
IV/ Une époque de guerres et de changements géopolitiques rapides. Vers une reconfiguration de l'ordre mondial
La confrontation entre les États-Unis, l'impérialisme dominant, et la Chine, l'impérialisme émergent, domine la situation géopolitique internationale. Une caractéristique particulière de ce conflit est le degré élevé d'interdépendance économique entre les deux, un héritage de la mondialisation néolibérale. La mondialisation comme nous l'avons connue jusqu'en 2008 n'est plus, mais il n'y a pas non plus de démondialisation. Les conflits géopolitiques sont un symptôme de cette crise structurelle et, là aussi, nous entrons dans un territoire inexploré et sans précédent.
Le désordre en construction rend le monde plus conflictuel et plus dangereux. Il y a quelques années, l'instabilité et le chaos géopolitique apparent s'aggravaient avec l'administration Trump 1.0 et sa focalisation sur la guerre économique avec la Chine, mais elle a fait un premier saut qualitatif avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine en février 2022, et un second saut avec la guerre provoquée par l'expansionnisme israélien, soutenu ouvertement par les États-Unis et moins ouvertement par les impérialismes européens. La situation s'est aggravée avec le renforcement de l'OTAN pour répondre à Poutine et le soutien financier et militaire des États-Unis à l'objectif de Netanyahou de redessiner les frontières dans tout le Moyen-Orient. Ainsi, l'industrie de guerre réalise des milliards de dollars de profits, au prix du sang de centaines de milliers de personnes.
Malgré leur rôle dans l'OTAN, leur leadership et leur soutien à la guerre impérialiste d'Israël, il y a, d'un point de vue historique, un affaiblissement relatif de la puissance hégémonique des États-Unis – et il n'y a rien de plus dangereux qu'une hégémonie contestée – parce qu'ils ont déjà des concurrents économiques et géopolitiques. De nouveaux impérialismes s'affirment, comme la Russie, ou émergent d'une façon moins belliqueuse, comme la Chine. Il s'agit d'une reconfiguration en cours dans un contexte mondial d'immense instabilité, sans que rien ne soit consolidé. En tout état de cause, l'unipolarité du bloc sous leadership américain issu de l'effondrement de l'URSS n'existe plus. L'Inde cherche cependant à s'affirmer comme une puissance régionale (ou du moins sous-impérialiste) en jouant un double jeu : elle maintient une alliance politique avec les États-Unis et une rivalité avec la Chine, mais entretient une intense relation de coopération économique (pétrole) et technologique (industrie de guerre) avec la Russie, et participe aux BRICS.
4.1. Les guerres et les tensions géopolitiques se multiplient
Nous assistons à une multiplication des situations de guerre de toute sorte dans le monde : guerres civiles (comme au Soudan et au Myanmar), guerres et tensions inter-impérialistes, guerres impérialistes de colonisation (comme celle d'Israël vers ses environs). Les tambours battent en Europe et dans les parties du Moyen-Orient qui ne sont pas encore atteintes par l'expansionnisme israélien (qu'en sera-t-il de l'Égypte et de la Syrie ?). Les tensions géopolitiques s'accroissent en Asie de l'Est. Les revendications chinoises sur la mer de Chine méridionale bafouent les droits maritimes d'autres nations. Les tensions militaires dans la péninsule coréenne, le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale se poursuivent et s'aggravent. Il semble que la Chine ne souhaite aucunement le déclenchement d'une guerre dans ces trois régions, mais, bien sûr, on ne peut exclure la possibilité que des événements inattendus – y compris un changement radical dans la situation intérieure de la Chine elle-même – conduisent à des tensions militaires devenant si extrêmes qu'elles puissent mener à une guerre régionale.
La Chine accélère son propre renforcement militaire, notamment en développant sa marine et en se déployant dans l'espace, afin de concurrencer les États-Unis et le Japon. Elle a délibérément provoqué, en particulier des navires philippins, dans le cadre d'une politique de défi indirect avec les États-Unis.
Les États-Unis visent à maintenir leur domination militaire sur cette région stratégiquement importante et à contenir la Chine. Dans une légère inversion de la trajectoire du président Duterte, le gouvernement philippin de Marcos Jr. s'est rapproché des États-Unis. Il est urgent de démilitariser la mer de Chine méridionale. Les États-Unis n'étant plus en mesure de renforcer leur présence militaire en Asie de l'Est, le Japon a partiellement repris le rôle militaire que jouaient les États-Unis, en augmentant rapidement ses dépenses militaires, en renforçant ses armements, en militarisant la chaîne des îles Nansei, du sud-ouest de Kyushu au nord de Taïwan, et en promouvant l'intégration des forces armées japonaises et américaines. Cette situation résulte de la pression de l'impérialisme US et de la volonté de l'impérialisme japonais de disposer d'une force militaire plus puissante pour défendre ses intérêts en Asie de l'Est et du Sud-Est.
Depuis le début de l'année 2024, les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont de nouveau intensifiées après une période de dialogue. La Corée du Nord a abrogé l'accord intercoréen de 2018 visant à réduire les tensions et, en octobre 2024, a modifié sa Constitution pour désigner le Sud comme un État hostile. Les gouvernements nord et sud-coréens, soutenus par la Chine et les États-Unis, adoptent une ligne dure de confrontation.
La menace nucléaire devient plus concrète. Il existe déjà quatre points chauds nucléaires localisés. L'un d'entre eux se trouve au Moyen-Orient, il s'agit d'Israël. Trois se trouvent en Eurasie : l'Ukraine et la Russie en Europe, l'Inde et le Pakistan, ainsi que la péninsule coréenne. Cette dernière est la seule à être active. Le régime nord-coréen procède régulièrement à des essais et à des tirs de missiles dans une région où la force aéronavale américaine est stationnée et où se trouve le plus grand complexe de bases américaines à l'étranger (au Japon, en particulier sur l'île d'Okinawa).
4.2. Les États-Unis, une hégémonie en crise qui essaie de se réaffirmer
L'émergence de rivaux n'enlève pas aux États-Unis leur nature de pays le plus riche et le plus puissant militairement, doté d'une puissance de guerre sans précédent et d'une bourgeoisie la plus convaincue de sa “mission historique” de dominer la planète à tout prix, et donc de faire la guerre en faveur de la continuité de son hégémonie. L'Oncle Sam est celui qui a effectivement le dernier mot dans la “collectivité” impérialiste. Le fait est que si les États-Unis sont imbattables en matière de coercition, ils ont un sérieux problème, inédit depuis la guerre du Vietnam : une hégémonie impérialiste (comme toutes les hégémonies) ne peut être maintenue que si elle convainc également ses alliés et son opinion publique intérieure. Les États-Unis ont de très graves problèmes de légitimité extérieure mais aussi, et c'est encore plus grave, de légitimité interne, des éléments qui n'existaient pas dans la période précédente de supposée “unipolarité” et de “guerre contre le terrorisme” dans les années 1990. Son élite économique et politique est divisée comme jamais auparavant sur le projet de domination interne et est obligée de faire face à l'imbroglio de défaire les chaînes de valeur qui ont profondément lié l'économie américaine à l'économie chinoise au cours des 40 dernières années
En plus de leur relatif déclin économique, les États-Unis constituent une société et un régime démocratique bourgeois en crise ouverte depuis que le Tea Party et Trump ont pris le contrôle du Parti républicain de l'intérieur – avec la prétention de changer les règles de la plus ancienne démocratie bourgeoise du monde – et que la polarisation s'est accentuée. La tendance de cette crise est de s'approfondir davantage et, avec Trump à la Maison Blanche, de contribuer à affaiblir “l'Amérique”, autrefois toute puissante – parce qu'elle sera confrontée à des conflits entre l'exécutif, le Congrès et la justice, capables de nuire à ses objectifs globaux.
Les États-Unis ont travaillé à découpler leur économie de celle de la Chine, mais à l'exception du secteur des technologies de pointe, il est impossible de couper les chaînes d'approvisionnement mondiales dans lesquelles la Chine joue un rôle clé. Les États-Unis n'ont donc pas d'autre choix que de continuer l'affrontement (et à imposer des sanctions) dans le secteur des hautes technologies et à s'engager dans une rivalité militaire tout en restant économiquement interdépendants.
4.3. La nature de la Chine actuelle
Le “grand bond” chinois des 30 dernières années est de nature capitaliste. Héritier d'une grande révolution sociale et d'un tournant restaurateur à partir des années 1980, indispensable à la refonte néolibérale du monde (menée en partenariat avec les États-Unis et leurs alliés), l'impérialisme émergent chinois a des caractéristiques particulières, comme tous les impérialismes. Il repose sur un capitalisme étatique centralisé au sein du PCC et de l'armée chinoise, un capitalisme de développement avec des politiques ouvertement développementalistes où la plupart des grandes entreprises sont des joint-ventures entre des entreprises appartenant à l'État ou contrôlées par l'État et des entreprises privées.
Le parti-État ne contrôle pas tout dans l'économie. Il n'y a pas de planification centralisée, comme c'était le cas en Union soviétique. Le modèle économique capitaliste chinois doit également satisfaire les exigences des forces du marché, qui déterminent les actions du gouvernement. En d'autres termes, elles influencent les politiques planifiées et mises en œuvre. La planification a donc lieu dans la convergence des politiques de planification initiées par l'État avec les intérêts et les actions du marché, y compris le marché libre au niveau national et international, y compris ses mouvements en dehors du contrôle de l'État.
L'impérialisme émergent de la Chine est, bien sûr, toujours en cours d'élaboration. Depuis le début du siècle, les exportations de capitaux de la Chine ont augmenté de manière significative avant de se stabiliser en 2016. Les investissements directs dans l'économie chinoise, en revanche, sont en baisse depuis 2020 en raison des incertitudes géopolitiques. Ainsi, depuis 2022, la Chine est un exportateur net de capitaux (elle exporte plus de capitaux qu'elle n'en importe). Les entreprises chinoises ont pris des participations importantes dans les entreprises énergétiques, minières et d'infrastructures des pays néocoloniaux (Asie du Sud-Est et centrale, Afrique et Amérique latine) et le dragon est devenu le plus grand déposant de brevets au monde. Elle investit de plus en plus dans l'armement et met en garde, avec une véhémence croissante, qu'il existe une (ou plusieurs) ligne(s) – Taïwan et la mer de Chine méridionale – que les rivaux et les États plus faibles ne doivent pas franchir.
La Chine n'a pas encore envahi ou colonisé “un autre pays” sur le modèle européen ou américain, bien que sa politique à l'égard du Xinjiang soit colonialiste. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance non occidentale à exploiter les richesses de l'Afrique. Les créanciers chinois détiennent 12 % de la dette extérieure globale de l'Afrique. La Chine est déjà le premier partenaire commercial de la quasi-totalité des pays d'Amérique latine et un investisseur majeur (secteur de l'énergie). Elle utilise son pouvoir économique pour imposer des échanges inégaux par le biais de prêts garantis par les ressources naturelles, d'accords commerciaux ou d'investissements dans les industries extractives et les infrastructures.
4.4. La Russie impérialiste
La Russie d'aujourd'hui est l'État résultant de la destruction massive des fondations de l'ancienne Union soviétique et de la restauration capitaliste chaotique et non centralisée qui y a eu lieu – de la prise de contrôle d'anciennes et de nouvelles entreprises par des bureaucrates transformés en oligarques. Poutine et son groupe, issu des secteurs des anciens services d'espionnage et de répression, ont élaboré au début du siècle le projet de recentralisation du capitalisme russe, en utilisant les relations bonapartistes entre oligarques et une version du 21e siècle de la vieille idéologie nationale-impérialiste de la Grande Russie, transformée en principal instrument pour réaffirmer le capitalisme russe dans la concurrence impérialiste et pour accroître qualitativement la répression des peuples de la Fédération – y compris le peuple russe. La nature ultra-répressive du régime de Poutine pourrait évoluer vers le fascisme.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été préparée pendant des années. Elle faisait partie d'un grand plan visant à restaurer l'Empire russe à l'intérieur des frontières de l'URSS stalinienne, mais avec Catherine II comme point de référence. Pour Poutine, l'existence de l'Ukraine n'est qu'une anomalie dont Lénine est coupable et qu'il faut réintégrer dans le giron russe. L'occupation militaire du Donbass, de Louhansk et de la Crimée en 2014 a constitué la première phase de l'invasion. L'opération dite « spéciale » devait être très rapide et se poursuivre jusqu'à Kiev, où un gouvernement subordonné devait être mis en place. Les forces occidentales, prises au dépourvu, n'ont pu que s'incliner devant le fait accompli. Ce qui a arrêté la machine de guerre de Poutine, c'est l'ampleur de la résistance ukrainienne, imprévue par Poutine, mais aussi par l'Occident.
4.5. L'Europe : le vieux continent en déclin et en conflit
La nouvelle situation mondiale affecte dans une large mesure l'Union européenne et l'Europe dans son ensemble. Le continent se réchauffe deux fois plus que le reste de la planète, avec des précipitations extrêmes, des vagues de chaleur marines, etc. La crise économique frappe durement la région, avec une croissance de la productivité de seulement 10 % depuis 2002, contre 43 % aux États-Unis, et une crise profonde dans l'industrie automobile. Le mouvement ouvrier est en grande difficulté, notamment en Espagne et en Italie, où la gauche a subi un énorme revers après avoir géré un système qui ne prévoit plus rien à redistribuer. La construction d'une force politique ouvrière indépendante est un processus très lent, avec des rythmes différents selon les pays. Cependant, la classe ouvrière a encore une capacité d'intervention considérable, comme on l'a vu en France avec le mouvement des retraites et le Nouveau Front populaire, ou en Grande-Bretagne avec la réaction aux émeutes racistes et le mouvement sur la Palestine. Le déclin économique relatif, l'affaiblissement structurel de la classe, combinés aux mauvaises expériences avec les gouvernements dits de gauche et à la croissance des migrations résultant des guerres, du changement climatique et des interventions impérialistes, expliquent la croissance de l'extrême droite dans la plupart des pays, y compris des pays comme le Portugal, l'Allemagne et les pays scandinaves, qui jusqu'à présent semblaient protégés. Le fascisme est une menace de plus en plus réelle.
4.6. Instabilité généralisée
Des bombes et des drones tuent en Palestine, au Liban, au Soudan, au Yémen et dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En outre, nous assistons à des guerres civiles ouvertes ou secrètes, comme dans le cas du Myanmar, par exemple, et à la lutte constante des États d'Amérique latine contre les organisations criminelles qui, à leur tour, s'en prennent à la population, comme en témoignent le Mexique, le Brésil et l'Équateur.
Dans un Moyen-Orient troublé et menacé, l'effondrement du régime détesté de Bachar el-Assad a été un événement important. Un demi-siècle de dictature sanguinaire a pris fin. La chute du régime n'a pas été obtenue par des mobilisations de masse, mais par une opération militaire menée par une faction islamiste radicale. Cependant, l'aspiration du peuple syrien à la liberté et l'accumulation de la résistance depuis le début du soulèvement syrien ont joué un rôle important. La fin de l'ère Assad a été un soulagement pour des millions de Syriens. Les mouvements sociaux, féministes et démocratiques ont enfin la possibilité de s'organiser par le bas. Mais cet espoir s'accompagne d'une profonde méfiance à l'égard du caractère réactionnaire du groupe dirigeant, Hayat Tahrir al-Sham.
La Turquie, à travers l'Armée nationale syrienne, intervient également par ambition sous-impérialiste pour profiter de la reconstruction du pays mais surtout pour mettre fin à l'administration autonome kurde au nord et à l'est de la Syrie, dans la région du Rojava, à sa frontière. Paradoxalement soutenus par Washington et Tel-Aviv (pour défendre leurs intérêts), les Kurdes syriens s'efforcent de maintenir leur processus d'autodétermination et leurs structures administratives par tous les moyens disponibles, tant par la diplomatie que par les armes.
En Asie du Sud-Est, l'Inde entretient sa rivalité nucléaire avec le Pakistan. La Corée du Nord a renforcé sa dépendance militaire, politique et économique à l'égard de la Russie, en fournissant des armes et des munitions aux forces russes et en envoyant des troupes sur les champs de bataille en Ukraine. En échange, la Russie coopère au transfert de technologies à la Corée du Nord pour le développement d'armes nucléaires.
Au Myanmar, la résistance contre la junte militaire s'intensifie et a enregistré des gains militaires et diplomatiques significatifs. Une défaite militaire de la junte est possible. Bien que la Chine lui ait apporté un soutien décisif après sa défaite de 2021, elle adopte une approche pragmatique. Si la junte ne peut pas garantir la protection des investissements chinois, Pékin serait prêt à s'engager avec une autorité qui le pourrait.
Cette situation conflictuelle progresse dans la géoéconomie et la géopolitique de l'Afrique, où la Russie est en concurrence avec la France et les États-Unis sur le plan économique et militaire, en particulier dans les anciennes colonies francophones d'Afrique de l'Ouest. De son côté, la Chine continue d'essayer d'accroître son influence économique dans toutes les parties du continent africain ainsi qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Après quarante ans de mondialisation néolibérale, les pays semi-coloniaux continuent de concentrer des proportions plus importantes d'inégalités, de faim, d'absence de systèmes de protection sociale, de gouvernements autoritaires, d'expropriation et de conflits sociaux sanglants. Cependant, l'internationalisation financière, productive, commerciale et culturelle a également produit une égalisation perverse avec le Nord en termes de problèmes et de polarisation politique : la montée de l'extrême droite (Duterte, Bolsonaro, Modi, Milei), la croissance du pouvoir des organisations criminelles, les tragédies climatiques (comme en Inde, au Bangladesh, aux Philippines, au Brésil), les crises des systèmes étatiques et politiques, les guerres civiles (comme au Myanmar, au Soudan, en République démocratique du Congo, en Haïti) et les guerres entre pays.
Depuis le début du siècle, l'Amérique du Sud est le théâtre d'une série de luttes, de manifestations massives, d'estallidos (émeutes) populaires, d'élections de gouvernements réformistes nés de ces luttes et de beaucoup de polarisation politique – car le néo-extractivisme, l'exploitation prédatrice de la nature, la casse sociale, les inégalités, la violence quotidienne, la militarisation et les crises politiques se développent, ce qui nourrit aussi les alternatives d'extrême droite. Depuis 2018, un nouveau cycle de mobilisations a balayé, de manière radicale, les pays andins. Résistances, explosions et luttes sociales – qui ont combiné des revendications démocratiques et économiques – d'une part, et permanence de l'extrême droite comme ennemi central d'autre part. Ces luttes sont parfois canalisées par l'élection des gouvernements dits “progressistes” de la deuxième vague.
L'Afrique, cette région de 1,2 milliard d'habitants, et en particulier l'Afrique subsaharienne, est victime de la partie “inégale” d'un développement inégal et combiné. Elle reste le continent le plus pauvre du monde. La Banque mondiale estime que 87 % des personnes extrêmement pauvres dans le monde vivront en Afrique d'ici 2030. L'Afrique n'est responsable que de 4 % des émissions mondiales de carbone, mais 7 des 10 pays les plus vulnérables aux catastrophes climatiques se trouvent en Afrique. Quatre années de sécheresse dans la Corne de l'Afrique ont entraîné le déplacement de 2,5 millions de personnes. Le continent connaît une vague de conflits dont bon nombre sont liés à de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz, et à la course au contrôle et à l'extraction de terres rares et d'autres minéraux critiques (cobalt, cuivre, lithium, platine) pour les technologies à faibles émissions de carbone nécessaires à “l'économie verte” des pays impérialistes.
Aux côtés des anciennes puissances coloniales, les États-Unis, la Chine et la Russie jouent un rôle important dans l'extraction de richesses par des formes de surexploitation et dans l'alimentation des conflits sur le continent. Des guerres régionales, coups d'État et guerres civiles continuent de définir l'économie politique du continent. La Russie est déployée pour saper l'influence occidentale et accéder à de l'influence dans la région. Une série de coups d'État en Afrique de l'Ouest ont miné la puissance du néocolonialisme français et les nouveaux régimes se tournent vers les concurrents de Washington pour obtenir des aides militaires et financières.
Le traité de Pelindaba, entré en vigueur en 2009, fait de la quasi-totalité de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires légale et reconnue. La chaîne des îles Chagos, y compris l'île Diego Garcia (DG), vient d'être acceptée comme faisant partie de l'île Maurice, même si les États-Unis y conservent leur base militaire. L'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) doit donc surveiller DG (qui a signé des accords avec les membres du traité) pour s'assurer de l'absence d'armes nucléaires dans les avions, les entrepôts ou les transits américains. La Commission africaine de l'énergie nucléaire devrait également être chargée de ce contrôle, mais il doit être effectué de toute façon, et le gouvernement mauricien doit l'accepter.
V/ L'émergence du “campisme”
Ces dernières années, nous avons malheureusement assisté à la croissance et à la propagation à de nouvelles couches de l'idéologie du campisme comme expression de la recherche d'alternatives au capitalisme. Expression issue de l'idée de l'existence de “deux camps” s'affrontant sur la scène internationale à l'époque de la guerre froide, l'idéologie campiste se fonde sur l'idée que contre le “camp” de l'impérialisme hégémonique, tout ennemi ou adversaire des États-Unis (l'ennemi de mon ennemi est mon ami) mérite d'être allié. Ainsi, ils défendent les régimes de Bachar el-Assad en Syrie, de Poutine en Russie, d'Ortega au Nicaragua ou de Maduro au Venezuela. Selon certains campistes, la Chine, assurément en grave conflit avec les États-Unis, serait non seulement meilleure que l'adversaire, mais aussi un modèle de socialisme.
Cette dangereuse tendance se fonde sur des préconceptions et des diagnostics erronés du monde, qui n'est plus bipolaire (en tout état de cause, la “multipolarité” ne garantit rien de positif). Elle se renforce parce qu'il est beaucoup plus facile de croire aux alternatives représentées par de vrais États (même s'ils ne sont pas des alternatives) que de relever le défi de les construire à partir d'en bas. En outre, la Chine dispose d'un puissant soft power (capacité financière et de propagande) pour convaincre les militants et intellectuels progressistes du monde entier de son statut de “modèle alternatif”. Diverses organisations dites communistes, héritières des vestiges des anciens partis communistes, apprécient particulièrement cette idéologie campiste délétère. De manière contradictoire, les campistes se développent également dans des secteurs de la jeunesse d'Europe et d'Amérique latine (au moins). Dans certains pays, des organisations de gauche de tradition anti-stalinienne s'en emparent également. La situation nous oblige à faire un effort organisé et permanent de propagande, d'éducation et d'actions concrètes spécifiques pour soutenir les victimes du raisonnement campiste – comme les peuples d'Ukraine, du Venezuela et du Nicaragua.
VI. Des exigences centrales pour une nouvelle ère
Face à l'extrême droite du Nord et du Sud, les politiques unitaires des exploité·es et opprimé·es, dont le front unique, sont un élément important de notre répertoire, sans jamais négocier ou accepter la perte de notre indépendance politique ou celle des mouvements sociaux. Comme par le passé, cette lutte contre l'extrême droite doit prioriser la défense des droits d

De la guerre commerciale à l’unité des peuples contre l’Axe fasciste Trump-Poutine

Mercredi 2 avril, 16h, heure de Washington, Trump pérore devant les caméras et expose un tableau. Sur le tableau, des pourcentages : ce sont les hausses de tarifs douaniers pour le monde entier – sauf la Russie, la Corée du Nord et le Burkina Faso. Pour le reste, ne détaillons pas, c'est une blitzkrieg : 20% contre l'UE, 24% contre le Japon, 26% contre l'Inde, 31% contre la Suisse, 34% contre la Chine, 46% contre le Vietnam …
Sans oublier diverses petites îles comme les îles Heard et Mc-Donald (Australie, sud de l'océan Indien) inhabitées, mais dont les pingouins sont frappés de 10% de taxes imaginaires !
Dans les deux jours qui ont suivi, le fléchissement des bourses du monde entier s'est mis à regarder de plus en plus dans la direction du krach, surtout à partir de l'annonce, ce vendredi, d'une réponse « œil pour œil » de la Chine, plaçant 34% sur les produits étatsuniens.
La dimension ubuesque, délirante et grotesque, de ces mesures, est incontestable. Diverses conjectures circulent sur la manière dont les hausses de tarifs ont été calculées par les zouaves de la Maison blanche (apparemment, ils ont divisé le montant de l'excédent commercial du pays avec les EU par le volume de ses exportations aux EU et divisé le résultat par 2 et appelé ça « pourcentage »). La brutalité est indéniable elle aussi : il s'agit d'une déclaration de guerre commerciale au monde, sauf à la Russie. Et dans guerre commerciale, il y a « guerre ».
Mais on ne peut comprendre ce qui est en train de se passer si on l'explique uniquement à partir de la bêtise de Donald Trump, même associée à ses liens mafieux anciens avec Poutine. La tendance à la fragmentation du marché mondial n'a cessé de poindre et de monter depuis la crise de 2008. Le Brexit, la guerre commerciale avec Beijing, le premier mandat Trump, le Covid, la crise du fret, la guerre russe contre l'Ukraine, en ont ponctué les étapes. Trump opère le basculement total d'un coup, mais toutes les conditions étaient là. La « mondialisation » capitaliste devient la dislocation, tout aussi mondialisée.
La dernière grande dislocation du marché mondiale s'était produite entre le 24 octobre 1929, krach à Wall Street, et le 30 janvier 1933, arrivée de Hitler à la chancellerie allemande. L'intensification et l'extension du commerce mondial, et donc la « mondialisation », avaient été prônés par les plus riches États, à commencer par les États-Unis, comme panacée pour que ceci ne se reproduise plus, après le choc pétrolier de 1973 et encore, de manière poussive, après le krach du 15 septembre 2008. Mais la tendance à la dislocation montait. Trump vient de la faire triompher. Il a, en quelque sorte, parcouru le chemin économique allant du 24/10/1929 au 30/01/1933, d'un seul coup.
C'est là une formidable manifestation de puissance, mais sui generis : c'est la puissance n°1 qui se tire plusieurs balles dans les pieds. Si tant de pays étaient excédentaires dans leur commerce avec les États-Unis, c'est que ceux-ci, depuis longtemps, sont les premiers consommateurs du monde et vivent à crédit. Inflation, licenciements, compression des salaires, vont s'abattre brutalement sur le peuple américain, et les secteurs capitalistes étatsuniens qui vont s'effondrer ne manquent pas.
S'il y a une rationalité dans cette irrationalité du capital devenant fou et oubliant tout sauf qu'il doit s'accumuler, elle est la suivante : faire plonger le monde entier plus que les États-Unis eux-mêmes plongeront afin de restaurer leur puissance relative à l'intérieur de l'effondrement absolu. Envers tout le monde, sauf la Russie, et surtout envers la Chine.
Demain, les manifestations vont déferler dans toutes les villes américaines. La question est de centraliser ce mouvement : grèves de masse et marches sur Washington devraient être la perspective des centrales syndicales, qui en sont loin.
La tentative de l'UAW de trouver la conciliation avec Trump sur le terrain du protectionnisme est un obstacle politique central. A la base, nombreuses sont les sections syndicales qui appellent à manifester demain, ou qui, par exemple, comme le local 160 de l'UAW à General Motors, Michigan, appellent à s'unir avec les ouvriers mexicains et canadiens plutôt que de soutenir ces « tarifs ». C'est une question centrale, car Trump a pour l'instant refusé d'affronter le syndicalisme dans l'industrie, laissant Musk attaquer dans la fonction publique, mais il va devoir le faire s'il respecte le mandat des milliardaires écrit dans Project 2025. Et alors, Shain Fain, dirigeant lutte de classe de l'UAW… jusqu'à la victoire de Trump, va avoir un problème, car les fermetures d'usines et l'attaque antisyndicale arriveront en même temps !
L'affrontement commence maintenant. Dans le monde entier, les exploités et opprimés vont chercher leur voie, non celle de la riposte douanière graduée ou massive des gouvernements empêtrés, mais de la mobilisation indépendante contre l'Axe fasciste Trump-Poutine qui nous mène à la guerre, et pas dans une génération. C'est une question d'années, sinon de mois. Alors, Organise, comrade ! Organisons-nous, camarades ! Et vite.
APLUTSOC
Le 04-04-2025.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Anarchistes ukrainiens luttant contre l’impérialisme et construisant l’entraide en temps de guerre

Robert Francis fait un reportage sur Solidarity Collectives, un réseau d'anarchistes ukrainiens qui s'organisent sur une base anti-autoritaire et luttent en première ligne contre l'invasion russe.
Publié le 4 avril 2025, sur les collectifs de solidarité par Robert Francis
Publié en français sur : https://samizdat2.org/anarchistes-ukrainiens-luttant-contre-limperialisme-et-construisant-lentraide-en-temps-de-guerre/
Il était tôt le matin aux États-Unis lorsque je me suis assis pour une conversation avec Anton, un coordinateur de Solidarity Collectives, qui me parlait depuis l'Ukraine. Malgré la grande distance et le décalage horaire, l'urgence de notre discussion était indéniable. La guerre se poursuivait et des gens continuaient à mourir. Anton et ses camarades continuaient à s'organiser, à se battre, à résister. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'une bataille pour un territoire, mais d'une lutte pour la survie – une lutte à la fois contre l'impérialisme russe et les forces plus larges qui avaient cherché à dominer l'Ukraine bien avant que la guerre ne commence.
Depuis notre conversation enregistrée, beaucoup de choses ont changé. Donald Trump est revenu au pouvoir, et son administration a déjà commencé à faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle entame des négociations qui lieraient les concessions économiques et territoriales aux intérêts américains. Alors que l'Ukraine subit la pression extérieure de la Russie depuis des décennies – bien avant la révolution orange de 2004 – elle est désormais confrontée à une pression supplémentaire de la part de Washington, où Trump se fait l'écho des récits du Kremlin tout en lorgnant sur l'industrie des métaux rares de l'Ukraine.
Aujourd'hui plus que jamais, les militants occidentaux doivent entendre les voix des anarchistes et des anti-autoritaires en Ukraine. Pendant trop longtemps, certaines factions ont rejeté les luttes ukrainiennes comme étant soit une guerre par procuration, soit un simple champ de bataille pour les puissances impérialistes. Ce cadrage efface l'action des Ukrainiens qui résistent au pouvoir de l'État et à l'intervention étrangère depuis des années. Elle ne tient pas compte du fait que beaucoup de ceux qui se battent aujourd'hui étaient les mêmes qui protestaient contre la corruption du gouvernement, s'opposaient au nationalisme et construisaient des mouvements radicaux bien avant le début de cette guerre.
Depuis que l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine a commencé en février 2022, un réseau d'anarchistes et d'anti-autoritaires ukrainiens s'est organisé pour soutenir leurs camarades sur les lignes de front, fournir une aide humanitaire et remettre en question les récits entourant la guerre. Opérant sous le nom de Solidarity Collectives, ce groupe fonctionne comme une initiative indépendante et populaire visant à soutenir les combattants anti-autoritaires tout en s'engageant dans des efforts humanitaires et médiatiques plus larges. Leur travail témoigne de l'idée que l'auto-organisation, l'entraide et l'action directe restent viables même dans les conditions extrêmes de la guerre.
Anton a décrit les origines du mouvement comme une réponse urgente à l'agression russe. « Certains d'entre nous se préparaient déjà à l'éventualité d'une invasion depuis des années, même si ce n'était pas forcément de la manière dont les choses se sont déroulées », a-t-il expliqué. « Il y avait des camarades qui imaginaient une résistance de type partisan, quelque chose de décentralisé et en dehors des structures étatiques. Mais lorsque l'invasion à grande échelle s'est produite, la nature de la guerre était différente. Il ne s'agissait pas d'une résistance souterraine mais d'un conflit militaire direct et à grande échelle, et les gens ont dû s'adapter. »
Solidarity Collectives n'était pas seulement un projet idéologique, mais une nécessité pratique. De nombreux anarchistes et anti-autoritaires ont choisi de se battre dans l'armée ukrainienne, non pas en raison d'une loyauté retrouvée envers l'État, mais parce qu'ils reconnaissaient que la résistance à l'impérialisme russe nécessitait une action directe. « Il n'y a pas d'autre solution que de se battre », a déclaré Anton. « Si l'armée russe se rend, la guerre prend fin. Si les soldats ukrainiens déposent les armes, l'Ukraine sera occupée et des milliers d'autres personnes seront torturées et tuées. Ce sont les deux seules issues possibles. »
De nombreux anarchistes et anti-autoritaires ont choisi de se battre dans l'armée ukrainienne, non pas par loyauté retrouvée envers l'État, mais parce qu'ils ont reconnu que la résistance à l'impérialisme russe passait par l'action directe.
Leur collectif assiste aujourd'hui une centaine de combattants anti-autoritaires dans l'armée ukrainienne, en leur fournissant du matériel, des fournitures médicales et un soutien logistique. En outre, ils s'engagent dans des initiatives humanitaires et dans des actions de sensibilisation des médias pour contrer la désinformation omniprésente qui entoure l'Ukraine, en particulier parmi des segments de la gauche occidentale.
L'un des aspects qui définissent les collectifs de solidarité est la diversité des origines des personnes impliquées. Contrairement aux unités militaires conventionnelles qui s'appuient sur des traditions nationalistes ou militaires professionnelles, ce réseau est composé d'anarchistes, de punks, de féministes, de syndicalistes et de personnalités sous-culturelles qui, avant la guerre, étaient plus susceptibles d'organiser des manifestations, de squatter des bâtiments ou de jouer dans des groupes punks que de s'engager dans la lutte armée.
Anton a souligné que nombre de ceux qui luttent aujourd'hui contre l'impérialisme russe sont issus de communautés clandestines et militantes, plutôt que d'institutions étatiques ou de formations nationalistes. « Beaucoup de personnes que nous soutenons étaient impliquées dans l'organisation anarchiste, les mouvements féministes, les groupes de hooligans antifascistes ou même la scène punk », a-t-il expliqué. « Ce sont des gens qui passaient leur temps à manifester, à aller à des spectacles, à soutenir des projets d'entraide. Beaucoup d'entre eux ne s'étaient jamais imaginés combattre dans une guerre conventionnelle, mais lorsque l'invasion s'est produite, ils ont compris qu'il n'y avait pas d'autre option. »
L'éthique du bricolage et de l'auto-organisation qui définissait leur vie avant la guerre s'est répercutée sur leur façon de fonctionner sur le champ de bataille. « Ce ne sont pas des gens qui se contentent de suivre les ordres aveuglément », explique Anton. « Ils réfléchissent de façon critique à ce qu'ils font. Ils ne se battent pas parce que l'État leur dit de le faire. Ils se battent parce qu'ils savent ce qui est en jeu s'ils ne le font pas. »
Dans les rangs de ceux qui se battent ou apportent leur soutien, on trouve des organisateurs anarchistes qui ont passé des années à résister à la politique du gouvernement ukrainien, des syndicalistes qui se sont heurtés aux oligarques, des féministes qui se sont organisées contre la violence patriarcale et des punks qui ont passé leurs nuits à crier contre l'oppression dans des lieux clandestins. « Il y a ici des gens qui, avant la guerre, squattaient des bâtiments, faisaient du Food Not Bombs, mettaient en place des centres sociaux autonomes », explique Anton. « Beaucoup d'entre eux avaient participé à des actions directes contre la corruption et la violence de l'État en Ukraine. Et pourtant, ils ont tout de suite compris que cette guerre n'a pas pour but de défendre le gouvernement ukrainien – il s'agit d'arrêter une force impérialiste qui veut détruire tout ce que nous représentons. »
Ce mode d'organisation décentralisé et non hiérarchique a rendu les Collectifs de solidarité particulièrement efficaces pour répondre aux besoins urgents. « Nous n'avons pas de chaîne de commandement stricte comme une armée traditionnelle », explique Anton. « Nous fonctionnons sur la base de la confiance, de la communication directe et de principes partagés. Si quelqu'un a besoin d'un équipement de protection, nous trouvons le moyen de le lui faire parvenir. Si une école a besoin d'ordinateurs portables pour les élèves déplacés par la guerre, nous nous organisons pour y parvenir. Si nous devons contrer la désinformation russe, nous utilisons nos réseaux pour diffuser la vérité. »
La présence de bénévoles internationaux, notamment des Biélorusses et des Russes qui luttent contre le régime de Poutine, souligne encore davantage le caractère transnational et anti-autoritaire du mouvement. « Certains de nos camarades sont originaires de Biélorussie et de Russie », explique Anton. « Ils se battent ici parce qu'ils comprennent qu'une victoire russe en Ukraine signifierait davantage d'oppression dans leur propre pays. Ils ont vu ce que le régime de Poutine fait aux dissidents, et ils savent que cela fait partie d'une lutte plus large contre l'autoritarisme. »
Malgré leur engagement, nombre de ces combattants et militants ont payé le prix ultime. « Nous avons déjà perdu de nombreux camarades », dit sombrement Anton. « Certains étaient ukrainiens, d'autres internationaux, mais tous comprenaient pourquoi ce combat était important. L'un des plus connus était Cooper Andrews, un anarchiste américain venu se battre et tué en avril 2023. Ce n'était pas un simple soldat – c'était une personne qui croyait en quelque chose de plus grand, qui a mis sa vie en jeu pour la solidarité internationale. »
Ce sentiment de solidarité s'étend au-delà des personnes directement impliquées dans les combats. « Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont en première ligne », a déclaré Anton. « Il s'agit de tous ceux qui les soutiennent – ceux qui organisent la logistique, ceux qui fournissent l'aide humanitaire, ceux qui diffusent la sensibilisation à l'échelle internationale. Chaque personne qui participe à cette lutte fait partie du même mouvement. »
Le travail de Solidarity Collectives a naturellement évolué vers trois domaines principaux : le soutien militaire, l'aide humanitaire et l'engagement médiatique.
« Au départ, l'accent était presque entièrement mis sur le soutien militaire », se souvient Anton. « Il n'y avait pas le choix. Les combattants avaient besoin d'équipements de protection, de fournitures médicales, de nourriture et même de véhicules. Malgré tout, l'État ukrainien n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de tout le monde, et en tant qu'anarchistes, nous n'allions pas attendre qu'ils s'en rendent compte. »
L'aspect soutien militaire de leur travail consiste à acheter et à distribuer des équipements de protection tels que des gilets balistiques, des casques, des dispositifs de vision nocturne et des trousses de premiers secours. « Nous avons reçu des plaques qui ont été touchées par des tirs mais qui ont sauvé la vie de personnes », explique Anton. « Si nous n'avions pas fourni ces plaques, ils seraient morts ».
Au-delà du champ de bataille, le groupe apporte également une aide humanitaire aux civils touchés par la guerre. « Il ne s'agit pas seulement de soutenir les combattants », a souligné Anton. « Nous aidons aussi les civils, les personnes déplacées, les étudiants – tous ceux qui ont été touchés par la guerre. Nous avons fourni des ordinateurs portables à des étudiants contraints de suivre des cours à distance en raison de conditions dangereuses, nous avons aidé à reconstruire des maisons et nous avons collaboré avec des syndicats dans toute l'Europe pour acheminer de l'aide. »
Un autre élément clé de leur travail est la sensibilisation des médias, qui sert à la fois à lutter contre la désinformation et à faire connaître leurs efforts. « Nous devons contrer la propagande russe », explique Anton. « Il y a un récit omniprésent selon lequel l'Ukraine est envahie par les nazis, qu'il s'agit juste d'une guerre par procuration pour l'OTAN, que quiconque se bat contre la Russie est en quelque sorte un agent de l'impérialisme occidental. C'est un non-sens, et c'est dangereux. »
L'un des débats les plus controversés entourant la participation anarchiste à la guerre est la question de l'antimilitarisme. Certains anarchistes hors d'Ukraine soutiennent que le fait de rejoindre l'armée, même en cas d'autodéfense, contredit les principes anti-autoritaires. Anton, cependant, considère qu'il s'agit d'une mauvaise compréhension à la fois de la nature de la guerre et des principes de l'anarchisme.
« Il y a une différence entre le militarisme et l'autodéfense », dit-il. « Le militarisme consiste à utiliser la force militaire pour affirmer son pouvoir, pour dominer, pour s'étendre. Ce que nous faisons, c'est lutter contre une armée d'invasion qui veut nous effacer. »
Il a reconnu que dans l'abstrait, les anarchistes pourraient préférer organiser la résistance en dehors des structures militaires de l'État, mais il a souligné que les conditions du monde réel dictent des choix différents. « Ce n'est pas un débat théorique pour nous », a-t-il déclaré. « Cela ne se passe pas dans un livre ou sur un forum de discussion en ligne. Cela se passe dans la vraie vie, et la réalité est que des gens sont bombardés, torturés et exécutés par les forces russes. Le pacifisme n'est pas une option lorsque vous êtes confronté à un génocide. »
Anton a évoqué des exemples historiques de résistance armée anarchiste, comme la guerre civile espagnole, où les anarchistes ont lutté contre le fascisme aux côtés de forces militaires plus traditionnelles.
« Les anarchistes espagnols aimaient-ils le gouvernement républicain ? Non. Mais ils se sont battus à leurs côtés parce que l'alternative était la victoire fasciste », a-t-il déclaré. « Notre situation est similaire. Nous ne nous battons pas pour le gouvernement ukrainien. Nous nous battons pour nos communautés, notre peuple et notre droit à l'existence. »
Au-delà de la question du militarisme, Anton et d'autres membres des Collectifs de solidarité ont dû faire face à des idées fausses très répandues sur l'Ukraine – en particulier parmi les segments de la gauche occidentale qui semblent plus désireux de critiquer l'OTAN que de soutenir la résistance réelle contre l'agression russe.
« L'une des choses les plus absurdes que j'ai entendues est l'idée que l'Ukraine est remplie de nazis », a déclaré Anton. « Y a-t-il des éléments d'extrême droite en Ukraine ? Bien sûr. Tout comme il y en a aux États-Unis, en France, en Allemagne et partout ailleurs. Mais l'extrême droite n'est pas au pouvoir ici. Elle n'a jamais obtenu plus de quelques pour cent des voix. L'idée que l'Ukraine est une sorte d'État fasciste n'est que de la propagande russe. »
Il a également exprimé sa frustration face aux appels à une paix négociée, en particulier de la part de personnes qui semblent peu comprendre ce qu'une telle paix impliquerait réellement. « Que signifie « paix » dans ce contexte ? » demande Anton. « Pour certains, cela signifie que l'Ukraine doit se rendre. Cela signifie que les Ukrainiens doivent être occupés, emprisonnés, torturés et exécutés. Ce n'est pas la paix. C'est un meurtre de masse. »
Il a relevé l'ironie particulière des gauchistes occidentaux qui prônent des solutions qui conduiraient à la mort de leurs camarades. « Si la Russie gagne, les gens comme moi seront les premiers à être pris pour cible », a-t-il déclaré. « Les anarchistes, les féministes, les syndicalistes, tous ceux qui ont résisté à l'impérialisme russe – nous serons tous pourchassés ».
Malgré les défis, Anton garde l'espoir que la solidarité internationale peut faire la différence. « Nous avons reçu un soutien incroyable de la part de camarades en Pologne, en Allemagne, en France, aux États-Unis et au-delà », a-t-il déclaré. « Les gens ont organisé des collectes de fonds, envoyé du matériel et fait connaître notre lutte. »
Il a insisté sur le fait que l'une des choses les plus importantes que les gens peuvent faire est de donner. « La réalité, c'est que nous avons besoin d'argent », a-t-il déclaré. « C'est la façon la plus directe d'aider. Nous l'utilisons pour acheter des équipements de protection, des fournitures médicales et d'autres produits essentiels. Chaque dollar fait la différence. »
Pour ceux qui ne peuvent pas contribuer financièrement, Anton a souligné l'importance de diffuser des informations exactes. « Contestez la propagande russe quand vous la voyez », a-t-il déclaré. « Amplifiez les voix ukrainiennes, en particulier celles des organisateurs antiautoritaires et de gauche. Assurez-vous que les gens comprennent que ce n'est pas une guerre de choix pour nous – c'est une guerre de survie. »
La guerre en Ukraine a mis en lumière les échecs d'une grande partie de la gauche occidentale, qui considère trop souvent le conflit à travers une abstraction géopolitique plutôt que la lutte vécue de ceux qui résistent à l'impérialisme. Anton et ses camarades se battent parce que l'alternative est l'occupation, la répression et la mort. « Nous n'avons pas le luxe de débattre de l'autodéfense », a déclaré Anton. « Cette question a trouvé sa réponse lorsque les premières bombes sont tombées ». Rejeter la résistance de l'Ukraine comme une guerre par procuration n'est pas de l'anti-impérialisme, c'est de la complicité avec la violence coloniale de la Russie.
Si l'Ukraine perd, ce ne sont pas les oligarques qui souffriront, mais les travailleurs, les anti-autoritaires, les féministes, les queers, les syndicalistes et les activistes, ceux-là même que la gauche occidentale prétend soutenir. La solidarité ne peut pas être conditionnée par la pureté idéologique ou les débats académiques sur l'impérialisme. Elle doit être pratique, matérielle et immédiate.
Comme l'a dit Anton : « Nous ne demandons pas votre approbation. Nous demandons votre solidarité. »
Alors que la guerre se poursuit, Solidarity Collectives reste engagé à la fois dans la résistance et l'entraide, travaillant non seulement pour la survie de l'Ukraine, mais aussi pour un monde libéré de la domination impérialiste. « Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine », a déclaré Anton. « Il s'agit de montrer que la résistance est possible. Que l'impérialisme peut être combattu. Que les gens peuvent s'organiser, même dans les pires conditions, et rester solidaires. »
Pour plus d'informations ou pour soutenir leur travail, rendez-vous sur https://www.solidaritycollectives.org/en/
Publié par Tempest traduction Deepl revue ML
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












