Derniers articles

29 mars 1987 - 29 mars 2025 : Qu’en est-il du respect de la Constitution haïtienne ?
Chaque 29 mars, Haïti marque l'anniversaire de la Constitution de 1987, adoptée par référendum dans un contexte de renouveau démocratique après la chute de la dictature des Duvalier. Conçue comme un rempart contre l'autoritarisme et une garantie des libertés fondamentales, cette Constitution devait symboliser un nouvel élan vers un État de droit et une gouvernance transparente. Trente-huit ans plus tard, la question se pose : ce texte a-t-il réellement été respecté, ou a-t-il été vidé de sa substance par des pratiques politiques contraires à ses principes fondamentaux ?

La Constitution de 1987 a été perçue comme un espoir de rupture avec les abus du passé. Elle instaurait un système présidentiel limité, des contre-pouvoirs pour éviter la concentration excessive de l'autorité et un ensemble de droits et libertés pour les citoyens. Pourtant, dès les premières années, des tentatives de modification et de contournement ont affaibli l'application de ses principes.
L'instabilité politique chronique a souvent entraîné des dérives, avec des gouvernements utilisant des stratagèmes divers pour contourner les exigences constitutionnelles. Les décrets gouvernementaux en période de vacance parlementaire, les reports électoraux récurrents et les manipulations pour prolonger des mandats en sont des exemples frappants.
Le respect de la Constitution haïtienne est à géométrie variable. Les articles garantissant les droits fondamentaux des citoyens, notamment en matière de justice, d'éducation et de conditions de vie dignes, restent largement inappliqués. Par contre, certains articles sont invoqués avec zèle lorsqu'ils servent les intérêts des gouvernants ou des groupes d'influence.
L'indépendance du pouvoir judiciaire, prévue par la Constitution, est restée une utopie. La nomination de juges et la gestion des institutions judiciaires sont fréquemment soumises à des influences politiques, rendant l'application de la loi partiale et inéquitable.
Face à ces dérives, des voix s'élèvent régulièrement pour une refonte de la Constitution. Certains prétendent qu'elle est inadaptée aux réalités du pays et qu'une nouvelle version plus pragmatique est nécessaire. D'autres, en revanche, soulignent que le véritable problème n'est pas la Constitution elle-même, mais plutôt l'absence de volonté politique pour la respecter et la faire appliquer dans son intégralité.
L'avenir du respect de la Constitution haïtienne repose donc sur la capacité des acteurs politiques et de la société civile à en faire un véritable outil de gouvernance, plutôt qu'un texte manipulable au gré des intérêts personnels. Ce 29 mars 2025 doit être une occasion de réflexion collective sur la place du droit dans la construction d'un État moderne et d'une société juste et équilibrée.
Le respect de la Constitution ne doit pas être une option, mais une obligation pour tous, au service d'un avenir stable et prospère pour Haïti.
Smith PRINVIL
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Celui qui lutte peut perdre mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu »

Dans Étincelles écosocialistes, paru aux éditions Amsterdam en 2024, le sociologue et philosophe marxiste et écosocialiste Michael Löwy rassemble l'essentiel de ses textes récents sur la théorie et la pratique de l'écosocialisme, mouvement et projet politique international à l'émergence duquel il a particulièrement contribué, comme théoricien en co-signant par exemple le Manifeste écosocialiste international de 2001 ou en publiant l'ouvrage de référence Ecosocialisme : l'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste (Mille et Une Nuits, 2014) et comme militant, notamment dans le cadre de la Quatrième Internationale.
Dans cet entretien avec Alexis Cukier, philosophe et membre de la rédaction de Contretemps, Michael Löwy revient sur la signification théorique et la portée politique du projet écosocialiste, en s'appuyant sur une analyse des luttes sociales et écologiques dans le monde, notamment en Amérique latine, qu'il analyse comme des résistances au capitalisme et au néofascisme écocides, comme des jalons vers une société alternative, et comme des raisons d'espérer que soit actionné à temps le frein d'urgence de la révolution écologique et sociale.
19 mars 2025 | tiré de la revue contretemps.
https://www.contretemps.eu/etincelles-ecosocialistes-entretien-michael-lowy/
Alexis Cukier : Etincelles écosocialistes rassemble des textes de nature et d'objets différents, sur divers auteurs de la théorie marxiste et de l'écologie politique (notamment Walter Benjamin, André Gorz, Joel Kovel, John Bellamy Foster), les luttes écologiques et sociales en particulier au Brésil, des phénomènes spécifiques comme la publicité ou le surréalisme, et sur des propositions politiques comme la décroissance…mais il me semble que l'écosocialisme est plus qu'un fil directeur, c'est un vrai point de vue sur la totalité.
Voici donc deux questions pour commencer : quelle est la spécificité de ton approche de l'écosocialisme, est-ce par exemple la démocratie sur laquelle tu insistes particulièrement ? et dans quel contexte de réception et discussion sur l'écosocialisme le livre s'inscrit-il ?
Michael Löwy : J'insiste sur la démocratie, en effet, mais je pense que ce n'est pas un thème qui est polémique chez les écosocialistes. Il y a un certain consensus : si la planification écologique n'est pas démocratique, elle ne peut pas avoir lieu. Je pense qu'il y a une dynamique positive, un intérêt croissant pour l'écosocialisme partout dans le monde, notamment en France mais aussi aux Etats-Unis, en Amérique latine.
Mon livre est un recueil de textes, mais en effet il y a une cohérence : je pense qu'il est important de convaincre la gauche, les marxistes, les communistes, que l'écologie est décisive – que l'on ne peut plus penser le projet socialiste et le projet communiste sans l'écologie d'une façon centrale. Et de convaincre les écologistes qu'on ne peut pas confronter la crise sans les instruments du marxisme et sans une perspective socialiste, une perspective communiste. C'est cela l'objectif. Et c'est pour cela que mon travail cherche à faire connaître ces discussions, expériences de lutte, en rapport au marxisme. Nous sommes plusieurs à essayer de le faire, des camarades de la Quatrième Internationale, mais pas seulement, qui essayons de faire avancer les idées écosocialistes.
AC : Dans le débat académique, le terme d'écomarxisme (ou marxisme écologique) s'est installé, autour d'auteurs comme John Bellamy Foster ou Kohei Saito. Que penses-tu des théories de ces auteurs ? Dans le livre, tu discutes notamment de l'œuvre de Foster, en soulignant ses apports et aspects positifs, et en proposant une critique, assez discrète, du fait qu'il sous-estime le caractère productiviste de certains passages des Grundrisse de Marx. On pourrait être beaucoup plus critique de cette tendance apologétique chez Foster…
D'où ma question : comment estimes-tu le rôle qu'il joue dans les débats autour du marxisme et de l'écologie, et de l'écosocialisme ?
ML : Je trouve que John Bellamy Foster joue un rôle très positif. Le fait d'avoir mis en route l'écomarxisme, d'avoir commencé à développer une réflexion sérieuse sur les aspects écologiques de la pensée de Marx, a été très important pour aider les marxistes d'aujourd'hui à prendre au sérieux l'écologie.
J'ajouterais que ce que Foster et autres écomarxistes écrivent sur le rôle du capitalisme dans la crise écologique, la nécessité d'une révolution écologique et d'une alternative écosocialiste – c'est au moins aussi important que leurs travaux sur Marx. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un avis fondamentalement positif à propos du travail qu'ils font. Mais j'ai aussi quelques critiques.
Concernant Bellamy Foster, effectivement, je pense qu'il a une présentation un peu trop lisse de Marx et d'Engels, comme si il y avait, dès le début, dès la thèse de doctorat de Marx jusqu'à ses derniers écrits, une continuité de préoccupations écologiques. Il a eu le mérite d'avoir mis en relief des aspects de Marx qui étaient sous-estimés ou ignorés, autour de la problématique de la rupture du métabolisme notamment. Il a joué un rôle très positif pour convaincre les marxistes que l'écologie, ce n'est pas quelque chose d'extérieur au marxisme ou d'hostile, mais quelque chose qu'on trouve déjà dans une certaine mesure chez Marx.
Mais je pense qu'il est allé un peu trop loin, parce qu'il y a certains écrits de Marx qui restent encore marqués par le productivisme qui était l'idéologie dominante de son époque. Et surtout la question écologique n'avait pas du tout au XIXᵉ siècle l'importance qu'elle a au XXe siècle – le problème commençait seulement à apparaître. On voyait les premiers signes de destruction de l'environnement par le capitalisme. Mais aujourd'hui, c'est devenu une question de vie ou de mort pour l'humanité. Donc un changement très radical, un changement décisif. Et il est tout à fait normal que pour Marx et Engels, la question écologique n'était pas centrale.
Je rappelle toujours que Marx et Engels n'ont pas écrit un seul livre sur la question écologique, même pas un seul article ou un seul chapitre du Capital. Mais c'est normal parce qu'à leur époque, ce n'était pas encore une question brûlante, au sens propre et au sens figuré. Donc il ne s'agit pas pour moi de critiquer Marx ou de le dénoncer, mais de reconnaître les limites qui sont celles de sa période. Et en même temps, c'est vrai que Marx et Engels ont eu l'intuition de cette contradiction, de cette rupture métabolique. Donc c'est important de sauver ce moment écologique chez Marx. Mais il ne faut pas surestimer l'importance et la cohérence de ce moment au sein de l'œuvre de Marx.
C'est ma principale critique à Bellamy Foster, qui est un ami, et dont je respecte le travail. J'insiste : l'apport de Bellamy Foster n'est pas seulement de relire Marx mais de penser en termes marxistes les problèmes écologiques contemporains. Il a écrit un livre sur la révolution écologique qui est très important.[1] Et il a transformé la Monthly Review qui était une des principales revues de la gauche américaine en une revue éco-marxiste, c'est très important aussi.
AC : Et que penses-tu des derniers ouvrages de Kohei Saito ?
ML : Kohei Saito aussi a joué un rôle très important, très positif. Il a l'avantage sur Bellamy Foster d'avoir analysé la pensée de Marx non comme un système cohérent du début à la fin, mais comme une pensée en mouvement, qui au début reste marquée par une vision productiviste. C'est évident dans le Manifeste communiste qui parle du capitalisme qui a réussi à dompter la nature, etc. Mais aussi de certains passages des Grundrisse qui celèbrent « la mission civilisatrice du capitalisme ».
Saito montre que c'est à partir des années 1860, avec la lecture de Liebig notamment, qu'il y a une prise de conscience chez Marx, de l'épuisement de la fertilité de la terre, de la rupture du métabolisme et aussi, dans une certaine mesure, du problème écologique plus généralement. Cet apport de Saïto, qui consiste à montrer le mouvement de la pensée de Marx, est important. Et je pense que c'est important aussi de montrer que le marxisme, après Marx aussi, est également une pensée en mouvement, qui ne se limite pas à répéter ce que Marx a dit, mais a toujours été obligé à affronter des problèmes nouveaux comme l'impérialisme, le fascisme, le stalinisme et maintenant la crise écologique.
La critique que je fais à Kohei Saito, qui est aussi un ami, quelqu'un que j'aime bien, c'est que, à la fin de son dernier livre, il essaie de démontrer que Marx était déjà pour la décroissance[2]. Helas, ça ne colle pas… Dans un autre livre antérieur, il terminait en disant que pour Marx, le problème écologique était le problème le plus important du capitalisme. Cela n'était pas possible à son époque, de même que Marx ne pouvait pas vraiment penser la décroissance. La question ne se posait pas à son époque. Donc là, je ne suis pas d'accord.
Dans le livre traduit en français, Moins ! La décroissance est une philosophie (2024), la section sur Marx est bonne, sauf cette conclusion qui affirme qu'il était partisan de la décroissance. Je trouve que la proposition de Saïto d'un communisme de la décroissance est une excellente idée. Sauf qu'elle ne se trouve pas chez Marx ! Ce qui n'empêche pas que ce soit une très bonne idée.
AC : En lisant le livre, la présence du concept de réification, et plus largement de la pensée de Georg Lukács, m'a paru remarquable. C'est le cas par exemple des très intéressants articles sur la publicité, ou sur le surréalisme. Je connais tes travaux sur Lukács, sur Max Weber, mais je n'avais pas vu le rapport avec l'écosocialisme. Comment ferais-tu le lien entre la thématique « marxo-wébérienne » de la réification, et l'écologie ?
ML : Le concept de réification, je pense que c'est un des très grands apports de Lukács, et aussi de Lucien Goldmann qui a continué dans cette lignée. Cela permet de comprendre comment tout devient marchandise et la logique marchande domine tout dans la société capitaliste, non seulement l'économie directement, mais aussi la politique, la culture, la religion, l'art…Tout devient marchandise, tout devient une chose qu'on vend, qu'on achète. Les rapports entre les êtres humains deviennent chosifiés, réifiés.
Je pense que c'est un instrument conceptuel fondamental pour comprendre le capitalisme. Et évidemment, cela conduit au rapport à la nature, qui est, elle aussi, complètement chosifiée. La nature est vue uniquement comme un ensemble de choses qui doivent devenir des marchandises. Ce sont des matières premières pour la marchandise. Donc il y a dans le capitalisme une logique de chosification, de marchandisation, de réification de la nature. On pourrait en effet développer une critique Lukácsienne du capitalisme dans son rapport à la nature – ce que je n'ai pas vraiment fait dans le livre, sauf ici ou là, de façon limitée. Mais cela pourrait être une démarche à développer.
Ce n'est pas seulement le concept de réification qu'on peut reprendre de Lukács, mais aussi la méthode, et particulièrement la catégorie de totalité. C'est très important. Lukács a écrit dans Histoire et conscience de classe que ce qui distingue le marxisme de la science bourgeoise, ce n'est pas la prédominance de l'économie, c'est la catégorie dialectique de la totalité. Et c'est très important pour comprendre le problème écologique. On ne peut pas se limiter à l'analyse économique. Il faut voir les choses comme une totalité où il y a l'économie, la politique, la culture, la société, la lutte des classes, c'est une totalité. Et la crise écologique, c'est une totalité, qui concerne toute la vie des humains. Je pense que la catégorie de la totalité est fondamentale. Il y a beaucoup d'apports de Lukács qui sont importants pour la méthode marxiste.
Cela dit, il est vrai que Lukács n'a pas de réflexion sur l'écologie, ou très peu. Il y a un texte de lui où il y a quelques pistes, qui s'appelle Chvostismus und Dialektik (« Dialectique et Spontanéité », on devrait dire plutôt « Dialectique ou Suivisme »). Ce texte de 1925 qu'on a découvert récemment était inédit du vivant de Lukács. C'est une réponse aux critiques d'Histoire et conscience de classe (1923). On y trouve une discussion sur le rapport à la nature, une polémique contre certains marxistes qui ont une vision totalement acritique du rapport de l'industrie et de la technologie à la nature. Donc il y a une piste, mais qui n'est pas vraiment développée par Lukács.
En tout cas, je pense que l'idée de faire une analyse de la crise écologique à la lumière du concept de réification est une bonne idée.
AC : Une des questions qui m'est venue en te lisant concerne la place des expériences de reconversion écologique du travail portée par les travailleurs et travailleuses, ouvrier.e.s, paysan.ne.s et dans d'autres secteurs qui cherchent à rediriger leurs activités pour les décarboner, les dépolluer, répondre à des besoins fondamentaux des êtres humains ou les inscrire dans les cycles de la nature.
Dans le livre, il y a des exemples, notamment l'alliance entre mouvement indigène, paysan et syndical, autour des Seringueiros et de Chico Mendes. Mais il y a une insistance plus grande sur la réduction du temps de travail afin de libérer du temps pour des activités démocratiques et écologiques. Il me semble qu'il faut arriver à tenir les deux, réduction du temps de travail et luttes éco-syndicalistes, pour le dire ainsi. Comment articules-tu ces deux enjeux ?
ML : Il est vrai que dans mon livre, je ne parle pas beaucoup des expériences syndicales de luttes ouvrières écologiques. Mais j'ai publié un recueil de textes avec mon ami Daniel Tanuro sur les luttes socio-écologiques[3] et qui sont effectivement très importantes. Dans le livre on trouve des luttes paysannes, mais aussi des luttes ouvrières, de luttes syndicales. Donc dans cet autre livre, on parle de ces expériences. Mais c'est vrai que dans Étincelles écosocialistes, je n'en parle pas beaucoup.
En même temps, il faut dire que les secteurs en lutte aujourd'hui sur des questions socio-écologiques sont avant tout, par exemple en Amérique latine, les indigènes et les paysans ainsi que, un peu partout dans le monde, les femmes et les jeunes. Ce sont elles et eux qui sont vraiment les premières et les premiers à s'engager massivement dans des luttes, dans les mobilisations. C'est dans le travail du soin (care), effectué par des femmes essentiellement, qu'on trouve le plus de sensibilité aux thèmes écologiques, tandis que le mouvement ouvrier traditionnel, mâle, plus syndicalisé dans l'ensemble, est très en retard, et souvent encore prisonnier du productivisme et surtout du chantage à l'emploi.
On voit cela dramatiquement aujourd'hui, par exemple dans l'industrie automobile, qui est en crise parce que les automobiles se vendent moins bien. Les gens cherchent d'autres moyens de transport et les ouvriers se trouvent au chômage. Que faire ? Ce n'est pas très facile de proposer une reconversion à une usine automobile. Qu'est-ce qu'ils vont faire : produire des trottinettes, des bicyclettes ? Il n'y a rien d'impossible, mais ce n'est pas évident… Donc c'est une vraie difficulté et je n'ai pas de solution simple pour ça.
Mais effectivement, il y a des expériences positives de reconversion écologique au sens large. Notamment des usines en faillite où il y a des expériences intéressantes et il faut en parler, il faut les rendre populaires, il faut les donner comme exemple. Je suis d'accord que c'est très important. Et donc je trouve par exemple que le fait que, en France, un syndicat comme la CGT a fait quelques pas envers l'écologie, même s'il y a eu deux pas en avant et un pas en arrière, c'est quand même très important. Donc c'est une bataille qu'il faut mener.
En même temps, il faut reconnaître qu'aujourd'hui ceux qui sont à l'avant-garde dans les luttes écologiques, ce sont les paysans, les indigènes, les femmes, notamment dans le Tiers-Monde. Et la jeunesse, les mouvements autour de Greta Thunberg. Mais si le mouvement ouvrier ne se rallie pas à un projet écosocialiste, on ne pourra jamais gagner, c'est évident.
AC : Tu viens de mentionner la jeunesse et Greta Thunberg, et je voulais te poser une question sur la nouvelle génération de mouvements écologistes, et notamment les Soulèvements de la Terre.
Je pense que se joue là quelque chose de très important, porteur d'espoir, y compris en termes de renouvellement des pratiques militantes et de la culture politique, plus horizontale et plus dans le faire. On voit là aussi des alliances entre les jeunes et les paysans, notamment la Confédération paysanne, par exemple dans la lutte contre les mégabassines. Et c'était déjà le cas en fait à la ZAD de Notre-Dames-des-Landes, il y avait déjà des rencontres et alliances avec les mondes du travail. On voit aussi qu'émerge à partir de ces expériences une vraie élaboration stratégique.
Comment vois-tu le mouvement de la jeunesse écologiste qui a émergé au niveau international autour de Greta Thunberg, d'une part, et les Soulèvements de la Terre en France, d'autre part ?
ML : Je pense que ce sont deux expériences très importantes. La mobilisation internationale de la jeunesse que Greta Thunberg a réussi à lancer est très radicale, avec le mot d'ordre « changeons le système, pas le climat ». On y trouve une dynamique anticapitaliste. Je pense que c'est vraiment un mouvement formidable, qui connaît des hauts et des bas, évidemment, mais c'est un mouvement formidable.
Et puis effectivement, il y a les Soulèvements de la Terre, que je n'ai pas pris en compte parce qu'à l'époque où j'écrivais les textes du livre, ça n'existait pas encore ou ça a commencé à paraître, mais effectivement aujourd'hui c'est l'expérience socio-écologique la plus importante en France. Il y avait déjà eu Notre-Dame-des-Landes, en effet, où le syndicat CGT local s'était engagé. C'était déjà quelque chose de très important. Mais les Soulèvements de la Terre, c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est formidable la façon dont ils ont réussi à rassembler des gens venus d'horizons très divers. Et, comme tu le dis, de façon massive et très combative.
Evidemment, ils ont été victimes d'une répression inouïe et d'une brutalité criminelle de la part de l'Etat, de Macron. Mais la tentative de dissoudre le mouvement a raté, et il est toujours là, très actif. Je pense que c'est un mouvement qui a beaucoup d'avenir. Et c'est un des grands espoirs aujourd'hui en France et en Europe, les Soulèvements de la terre. C'est très important. S'il y a une réédition élargie de mon livre, il faudra absolument que j'inclue un chapitre sur les Soulèvements de la Terre.
C'est évident qu'il faut aller dans cette direction, construire des mobilisations qui soient capables de travailler à cette convergence entre le social et l'écologique, entre le mouvement écologique et la jeunesse, etc. Avec les ONG, Attac, le mouvement social et syndical, la Confédération paysanne notamment, les jeunes…ces convergences concrètes, c'est la bonne stratégie pour avancer, j'en suis tout à fait convaincu.
C'est le thème du livre sur les luttes socio-écologique qu'on a publié avec Tanuro. C'est le seul espoir qu'on puisse changer le rapport de force qui est pour le moment nous est très défavorable : travailler à cette convergence entre le social et l'écologie qui est plus facile, même en France, autour des questions comme l'eau et la terre, et plus difficile au niveau des usines. Mais il faut y aller aussi. Si on n'arrive pas à débloquer la convergence au niveau du travail et des entreprises, on ne pourra pas avancer.
Je veux donner un exemple d'une convergence qui s'est esquissée mais qui n'a pas vraiment réussi, autour du fret ferroviaire. C'est une question fondamentale pour les cheminots, évidemment, parce que le gouvernement est en train de démanteler le fret. Mais c'est aussi une question écologique fondamentale parce que du point de vue des émissions de CO2, il faut en finir avec le tout-camion. C'est un désastre écologique. Le tout-camion est un désastre social, y compris pour les camionneurs, avec les accidents notamment. Il faut en finir avec ça et le seul espoir, c'est le fret.
Donc c'est une lutte écologique aussi. Or il y a eu une déclaration commune il y a quelques mois, d'Attac et de quelques ONG écologistes avec les cheminots, mais ça n'a pas vraiment embrayé dans une vraie mobilisation comme par exemple Les soulèvements de la Terre. Il faut qu'on puisse mobiliser les syndicats et les mouvements écologistes autour des questions comme le fret ferroviaire.
AC : En ce qui concerne les convergences et alliances, nous avons évoqué tout à l'heure les seringueiros, et je voulais revenir sur le chapitre « Au Brésil : le combat de Chico Mendes », en te posant deux questions. D'abord, comment présenterais-tu l'importance des luttes sociales et écologiques latino-américaines pour l'histoire du développement du mouvement écosocialiste au niveau international ? Et aujourd'hui, après Bolsonaro notamment, comment vois-tu la dynamique au Brésil, les possibilités pour l'avenir ?
ML : D'abord il faut dire qu'en effet, en Amérique latine, il y a des expériences très intéressantes de lutte socio-écologique, notamment indigènes et paysannes. On voit cela un peu partout, au Pérou, au Mexique et au Brésil, où il existe un mouvement social très important, peut-être le mouvement social le plus important en Amérique latine : le mouvement des paysans sans terre, le MST. Et il y a un formidable mouvement féministe, par exemple au Chili, c'est le mouvement des femmes qui est à l'avant-garde
Au Brésil, le MST organise des centaines de milliers de paysans. Il mène un combat depuis des années pour la réforme agraire, mais il ne se limite pas à lutter pour faire pression sur le gouvernement, il commence à mettre sur pied concrètement une réforme agraire sur le terrain. Il le fait en occupant des fermes improductives, en occupant des terres, en établissant des communautés paysannes ou des coopératives un peu partout dans le Brésil. Or ce mouvement a fait, il y a une vingtaine d'années, un tournant écologique.
Au début, ça ne les intéressait pas tellement, mais depuis 20 ans, ils ont fait un vrai tournant écologique, qui s'accentue depuis. Là où se trouvent les occupations, leurs coopératives, leurs fermes, ils ont fait un tournant vers la production bio. Et aujourd'hui, ils sont devenus par exemple le plus grand producteur de riz bio au Brésil. Or le riz, c'est la base de la nourriture des Brésiliens avec les haricots noirs. Donc cette expérience est très importante. C'est vraiment une expérience sociale et écologique de masse, avec un mouvement qui est très politique.
La plupart des militant.e.s, des cadres du MST, sont marxistes. Et ils ont une école de formation formidable, où je suis allé avec ma compagne, plusieurs fois, qui s'appelle l'École Nationale Florestan Fernandes, du nom d'un sociologue marxiste très connu. C'est une école où ils forment leurs cadres, leurs militant.e.s, mais aussi des militant.e.s d'autres mouvements sociaux, de toute l'Amérique latine et même du monde entier. C'est vraiment une école de formation marxiste, locale, nationale, latino-américaine et mondiale. Et là aussi, ils commencent à parler d'écologie et d'écosocialisme. C'est quelque chose de très important.
Plus généralement, en Amérique latine, on a ces mobilisations socio-écologiques des paysan.ne.s, des indigènes, qui sont très combatives. Et puis on voit apparaître aussi, mais à une moindre échelle évidemment, un intérêt pour l'écosocialisme, comme ce fut le cas par exemple d'Hugo Blanco, un des grands dirigeants paysans et indigènes de l'Amérique latine, au Pérou, et au Mexique où il est récemment décédé. Il avait l'habitude de dire « Nous les indigènes, nous pratiquons l'écosocialisme depuis cinq siècles ».
Et il y a quelque chose de vrai. Les indigènes ont un rapport à la nature, à la fois communautaire et collectif, qui se caractérise aussi par le respect pour l'eau, la terre, les arbres, la nature. Cela fait partie de leur culture, de leur spiritualité. Donc il y a vraiment une contradiction de leur culture avec le capitalisme, avec la logique réifiée du capitalisme. Il y a non seulement dans ces luttes indigènes et paysannes une question vitale, par exemple défendre l'eau contre l'empoisonnement, mais il y a aussi, disons, une « affinité négative » entre l'esprit indigène et l'esprit du capitalisme.
La question décisive, dans ce domaine, c'est évidemment l'avenir de l'Amazonie. Elle concerne tout d'abord les populations locales, les indigènes, les paysan.ne.s qui habitent là-bas et qui veulent protéger la forêt contre la logique destructive massive du capitalisme, sous la forme d'entreprises minières, notamment d'extraction d'or, qui sont des gangs criminels qui essaient de trouver l'or mais en empoisonnant les rivières avec du mercure. Et surtout contre l'agrobusiness qui détruit la forêt pour remplacer les arbres par les pâturages ou des champs de soja.
Au Brésil, l'agrobusiness est une puissance énorme, ils contrôlent la moitié du Parlement, et aussi les gouvernements locaux. Donc il y a un combat décisif pour sauver l'Amazonie où sont engagés en première ligne les indigènes, les communautés paysannes locales, avec le soutien d'une partie de la gauche, d'une partie importante de l'Église, et évidemment des écosocialistes et des anticapitalistes.
C'est une bataille fondamentale qui concerne évidemment les populations locales, mais aussi l'ensemble du Brésil, parce que c'est de l'Amazonie que viennent les rivières de pluie sans lesquelles le sud du Brésil serait désertifié. Et il concerne aussi toute la planète, parce que l'Amazonie est un des derniers grands puits de charbon qui absorbe une partie importante du CO2. Si l'Amazonie est détruite ou si elle devient une savane, ce qui est un danger très réel si on continue avec les incendies et les destructions, alors le changement climatique deviendra incontrôlable.
Donc c'est une affaire qui concerne tout le monde, qui nous concerne tous, non seulement les indigènes, les Brésiliens mais aussi toute l'humanité. Dans cette bataille très importante, le gouvernement Lula a apporté certaines améliorations, évidemment, par rapport à Bolsonaro qui avait mis en œuvre une dynamique totalement destructrice. Mais on est encore loin du compte.
Il y a notamment un affrontement maintenant autour du projet d'exploitation de pétrole dans l'embouchure de l'Amazone…car à cet endroit, dans la mer, il y a du pétrole, apparemment de grandes quantités, même si on ne sait pas exactement. Et donc il y a une discussion pour savoir si on va exploiter ce pétrole en haute mer ou pas, avec un danger évident : s'il y a un problème comme c'est arrivé au golfe du Mexique, cela inonderait l'Amazonie de pétrole, avec des conséquences dramatiques pour l'environnement. Sans parler du fait que ce pétrole va être exploité, brûlé et contribuer au changement climatique. Donc il y a un débat, y compris au sein du gouvernement de Lula. Cela va dépendre du rapport de force dans la société. C'est une bataille très importante.
Je reviens pour finir à la partie de ta question sur l'écosocialisme en Amérique latine. Son développement est inégal selon les pays. Au Brésil, il existe un réseau écosocialiste depuis quelques années déjà, avec des militant.e.s venu.e.s de tous les horizons de la gauche, de tous les partis de la gauche radicale. C'est un acquis très important. Ils organisent des activités, ils ont publié un manifeste, certain.e.s de leurs militant.e.s sont dans le gouvernement, au ministère de l'écologie. Donc ils ont une certaine influence, limitée, bien sûr, mais l'existence d'un réseau brésilien écosocialiste est un acquis important. Il y a aussi un réseau en Argentine qui a organisé un colloque écosocialiste international à Buenos Aires, en 2024. Et il y a aussi d'autres initiatives, moins développées, qui existent dans d'autres pays.
AC : Tu as parlé de l'agrobusiness et de Bolsonaro…il faut parler de la question du rapport entre écocide et extrême droite ou néofacisme. Nous sommes quelques jours après l'investiture de Trump, dont la formule « drill baby drill » exprime bien le projet extractiviste débridé. On voit partout l'alliance entre néofascistes et néolibéraux, au service d'un projet extractiviste et productiviste très dur, qui passe aussi par la répression des mouvements écologistes.
Comment vois-tu cette montée du néofascisme d'un point de vue écosocialiste ? Est-ce que tu reprends ce terme, parfois employé récemment pour parler des rapports entre écologie et extrême droite, d'écofascisme ?
ML : Je n'utilise pas le terme écofascisme, dont je pense qu'il introduit de la confusion. Les fascistes ne sont pas écologistes, la plupart sont ouvertement négationnistes en ce qui concerne le climat. Quelques-uns essaient maladroitement de jouer un peu avec l'écologie dans un registre nationaliste, mais c'est vide. Le Rassemblement national est un bon exemple : ils essaient de peindre un tout petit peu en vert leur drapeau brun, mais cela n'a aucune consistance. Donc je pense que l'écofascisme est une fausse piste. Par contre nous sommes vraiment confrontés à un fascisme anti-écologique, à 200 % écocide.
Les exemples que tu as cités sont parlants : chez Trump, il y a un refus total de l'écologie, et le même vaut pour Milei et Bolsonaro. Tous ces gens sont complètement aveugles à la crise écologique. Ils font comme si elle n'existait pas et défendent de manière acharnée le pétrole, le charbon et toutes les offensives destructrices de la nature. C'est bien sûr extrêmement inquiétant. C'est notamment le cas de Trump, parce que les dégâts qu'il peut provoquer aux Etats-Unis sont à une échelle infiniment plus grande que Milei en Argentine ou même Bolsonaro au Brésil.
Mais aux Etats-Unis on peut craindre le pire : quatre années de Trump avec l'exploitation intensive du pétrole partout, cette menace d'invasion du Groenland, etc. C'est extrêmement dangereux, extrêmement inquiétant, et bien sûr un développement très négatif du point de vue du combat contre le changement climatique. C'est vraiment un pas en arrière gigantesque.
Mais ça ne sert à rien de se lamenter, il faut organiser la résistance ! Il faut organiser la résistance partout où ces gouvernements néo-fascistes se sont installés. Je dis néo-fascisme parce que ce n'est plus le fascisme des années 1930, ce ne sont pas des Etats totalitaires avec des bandes en uniformes qui défilent, ou la Gestapo… c'est une autre forme, totalement alignée sur le néolibéralisme extrême. Dans le cas de Milei, c'est une espèce d'anarcho-libéral-fascisme, c'est très différent du corporatisme nationaliste du fascisme classique.
Mais il y a des traits communs qui sont le nationalisme, la haine de la gauche, le racisme, la recherche du bouc émissaire responsable de tous les maux. C'étaient les juifs pour les nazis. Ce sont les mexicains pour Trump, ce sont les musulmans en Europe. Cette logique du bouc émissaire est typique de la logique fasciste. De même que le culte du chef, du sauveur : Trump, Bolsonaro… qu'on a appelé au Brésil le Messie. Et Trump se dit envoyé par Dieu. Donc il y a des éléments en commun avec le fascisme classique, mais c'est quand même une forme nouvelle.
Et une de ces caractéristiques nouvelles, c'est justement cette dynamique antiécologique, de destruction forcenée de la nature, d'exploitation à fond des énergies fossiles avec des conséquences dramatiques. Il faut organiser la résistance partout, en partant de secteurs qui sont mobilisés. Le mouvement des femmes, la jeunesse, des secteurs du mouvement paysan, certains courants syndicaux, les écologistes, la gauche… Il faut lutter. Il n'y a pas d'autres moyens que de résister, de lutter. Et il y des possibilités.
Même aux Etats-Unis, par exemple, il y a des Etats qui sont gouvernés par les démocrates, ce n'est pas formidable pour nous, écologistes, mais c'est quand même un peu mieux. Donc ces Etats comme la Californie vont essayer de résister à la politique de Trump jusqu'à un certain point. Mais bien sûr je compte surtout sur les mouvements sociaux. Ces jours-ci, il se passe des choses intéressantes, en termes d'auto-organisation aux Etats Unis : des écoles, des églises, qui déclarent qu'ils vont empêcher les déportations des migrants. Et il y aura aussi des résistances concernant l'écologie.
N'oublions pas qu'il y a eu le grand mouvement contre le pipeline Keystone aux Etats Unis avec la participation notamment des indigènes, les Sioux, soutenus par certains courants syndicaux, par la gauche, par les écologistes. Ils ont réussi à bloquer le pipeline. Donc il y aura des luttes. C'est le seul espoir.
AC : Venons-en à une dernière question, pour finir par de l'espoir, du positif. Une des forces de l'écosocialisme est d'aborder de front la question du projet de société alternative, écologiste, communiste, égalitaire, féministe, antiraciste, internationaliste…Dans le livre cela apparaît nettement dans les derniers textes, et notamment autour de la question de la décroissance écosocialiste, au sujet de laquelle tu as écrit plusieurs textes récemment.
Tu as aussi participé à la rédaction d'un Manifeste de la Quatrième Internationale proposant un programme de transition écosocialiste[4], écrit par des militant.e.s écosocialistes de plusieurs pays. Il y est question des luttes qui articulent questions sociales et écologiques, mais aussi d'un projet écosocialiste, de planification démocratique et d'autogestion, de nouvelles institutions.
Pourrais-tu nous expliquer ce que tu entends par décroissance écosocialiste, et à partir de là développer tes arguments sur l'écosocialisme comme projet de société désirable ?
ML : Oui nous pensons, je pense et mes camarades aussi, qu'il ne suffit pas d'être anticapitaliste, il faut proposer une alternative, sinon on n'est pas crédible. Et cette alternative, c'est l'écosocialisme, c'est le projet, pas simplement de changer les rapports de propriété, mais d'une nouvelle civilisation fondée sur d'autres valeurs et d'autres formes de production et de consommation, une autre façon de vivre.
C'est un projet très ambitieux, dont certains axes sont ceux classiques du socialisme, comme la propriété collective des moyens de production, l'autogestion et la planification démocratique, mais maintenant avec un contenu écologique qui n'était pas tellement présent dans le passé. Et évidemment, ce projet, cette nouvelle civilisation, ne va pas se faire d'un jour à l'autre. Il y aura un processus de transition, le Manifeste que tu as mentionné pense une transition entre le capitalisme et l'écosocialisme.
Bien sûr, l'écosocialisme n'existera jamais si on ne commence pas la lutte pour l'écosocialisme ici et maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre que les conditions soient mûres pour agir. Parfois on nous critique en nous disant : « votre projet écosocialiste est bien gentil, mais on ne peut pas attendre, il y a une urgence sur la question écologique, il faut agir dès maintenant ».
Mais nous ne proposons pas du tout d'attendre que la conscience soit mûre pour la révolution mondiale, ce n'est pas du tout cela. Il faut agir ici et maintenant, même pour de petites choses, de petites victoires qui ralentissent la vitesse de la course à l'abîme. Pour reprendre cet exemple, si on peut arrive à sauver le fret ferroviaire en France, ce n'est pas l'écosocialisme, mais c'est un pas très important dans ce combat. Donc il faut commencer la lutte ici et maintenant.
En ce qui concerne la question de la décroissance, il faut dire que jusqu'à il y a quelques années, nous étions assez réservés envers la décroissance, pour deux raisons. Premièrement, certains des partisans de la décroissance ne parlaient pas du capitalisme. Leur ennemi, c'était la croissance en général. Comme s'il pouvait y avoir un capitalisme décroissant. Et puis deuxièmement, nous pensons que la décroissance en soi n'est pas une alternative de société, cela ne dit pas quelle société on veut.
Mais en même temps, nous avons été de plus en plus convaincus que les courants de la décroissance avaient raison de dire qu'on ne peut pas affronter la crise écologique sans une décroissance de la production matérielle. D'abord parce qu'il faut réduire la consommation d'énergie de façon très substantielle, parce que les énergies renouvelables ne peuvent pas totalement remplacer les énergies fossiles. Même les énergies renouvelables demandent des matières premières, des minerais, qui n'existent pas à l'infini…Donc il faut réduire la consommation d'énergie, réduire la production matérielle. On ne peut pas continuer avec cette accumulation.
Donc l'idée de décroissance, nous la trouvons légitime. Mais il faut que ce soit une décroissance anticapitaliste, sans aucune illusion sur la possibilité d'un capitalisme décroissant. Et il faut l'associer à un projet de société qui est l'écosocialisme. C'est pour cela que nous parlons de décroissance écosocialiste. Et heureusement, une partie du mouvement décroissant va aussi dans cette direction, anticapitaliste d'abord, et même pour certains écosocialiste. C'est pour cela que nous avons publié l'année dernière une déclaration commune entre quelques écosocialiste, moi compris, et quelques théoriciens de la décroissance. Sur le mot d'ordre : pour une décroissance écosocialiste.
Donc nous avons intégré, moi et mes camarades, la décroissance dans notre conception de ce qu'est l'écosocialisme, parce que nous sommes convaincus qu'il faut réduire la production matérielle. Alors évidemment, les anti-écologistes disent « Ah, vous voulez affamer les gens ? Vous voulez que les gens ne puissent plus manger, qu'ils ne puissent plus habiter, qu'ils ne puissent pas se transporter ? Vous êtes pour l'écologie punitive ! ». C'est le discours de la droite. Mais pour nous, les écosocialistes, qu'est-ce que la décroissance signifie plus précisément ?
Je dirais, tout d'abord, en finir avec l'obsolescence programmée qui est inhérente au capitalisme. Parce que les produits sont faits pour ne pas être durables. Je donne toujours cet exemple : ma grand-mère avait un frigo qui durait 40 années. Mais pour le capitaliste qui produit le frigo, c'est une très mauvaise affaire…s'il vend un frigo tous les 40 ans, c'est un désastre. Donc il faut qu'il puisse vendre un frigo tous les quatre ans, et il produit des frigos qui, après quatre années, ne marchent plus. C'est la logique du capitalisme, et l'obsolescence programmée est inhérente à la logique du capitalisme. C'est rationnel pour le capitaliste : il faut produire des marchandises qui deviennent obsolètes le plus vite possible.
Il faut mentionner aussi l'obsolescence par la mode. C'est un autre truc : le téléphone portable qui a toujours un nouveau gadget, dont il faut acheter le nouveau modèle. C'est inhérent au capitalisme et cela produit un gaspillage monstrueux, aussi parce qu'on ne peut plus réparer les objets : l'ordinateur qui a un problème, on ne peut pas le réparer, on ne peut même pas l'ouvrir, il faut le jeter et en acheter un autre, tout nouveau. C'est la logique du système et c'est un gaspillage énorme. Donc si on en finit avec l'obsolescence programmée, si on ne produit que des produits durables et réparables, on ferait déjà un pas énorme en direction de la décroissance, en réduisant donc la production de biens rien que par la suppression de l'obsolescence programmée.
Ensuite, il y a aussi la suppression des biens et services inutiles. Il y a une quantité astronomique de biens inutiles et/ou nuisibles. Bien entendu, ce n'est pas le bureau politique qui va décider de ce qui est utile et inutile, c'est aux gens de le faire, démocratiquement. Mais il est évident qu'il y a une quantité de biens qui sont inutiles, et aussi de services totalement inutiles. L'exemple le plus évident est la publicité. A quoi sert la publicité ? C'est nécessaire au capitalisme, mais dans une société rationnelle, la publicité serait totalement inutile. Et c'est un gaspillage énorme d'énergie, de matières premières, de papier, de force de travail. Donc il faut supprimer la publicité. On pourrait multiplier les exemples. Il ne s'agit pas d'une « écologie punitive », mais d'éliminer des choses qui sont totalement inutiles.
Ensuite, il y a des questions qui sont plus compliquées, par exemple celle de la voiture. Il ne s'agit pas de supprimer la voiture : elle a une utilité sociale, mais il s'agit de réduire substantiellement sa place dans toute la société, y compris l'idéologie, la culture, le mode de vie construit autour de la voiture. Tu ne peux pas exister sans voiture. Aux Etats-Unis, la carte d'identité, c'est le permis de conduire, qui remplace la carte d'identité. Si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'identité, tu n'existes pas.
Donc il faut en finir évidemment avec cette civilisation de la voiture et organiser les villes autrement pour qu'il y ait de la place pour les piétons, pour les bicyclettes et pour les transports publics gratuits. Tout cela réduira beaucoup la place de la voiture, mais on ne va pas supprimer la voiture, ça serait d'arbitraire. Un autre exemple compliqué, c'est la viande.
La viande est un désastre sanitaire : c'est une source de maladies cardiaques. Et c'est un désastre environnemental, parce que sa production, l'élevage, surtout dans les pays du Sud comme le Brésil, détruit les forêts. Et aussi parce que l'élevage produit du méthane qui est un des gaz à effet de serre les plus dangereux. Donc il faut impérativement, du point de vue écologique et du point de vue de la santé publique, réduire la consommation de viande.
Il faut mentionner aussi la souffrance des animaux, c'est un autre argument. Je ne mettrai pas en première place. Je sais que mes amis véganes mettent en première place la souffrance des animaux, et je le respecte, mais je ne mettrai pas en première place parce qu'il y a d'autres animaux qui mangent des animaux, les tigres et les loups mangent aussi d'autres animaux, on ne va pas criminaliser cela. La souffrance des animaux est un argument respectable, mais je mettrais en première place l'argument écologique et l'argument de santé publique, pour dire qu'il faut réduire la consommation de viande, c'est impératif.
Cela étant dit, on ne va pas le faire par décret, on ne va pas rationner, il faut convaincre les gens qu'il faut réduire la consommation de la viande. Il faut mener un combat politique à l'intérieur de la gauche, et notamment en France où le parti communiste fait l'apologie du bifteck français. Il faut mener un combat, qui est difficile parce qu'il y a des habitudes, une culture de la viande, et tout un secteur économique qui dépend de la viande, depuis les éleveurs jusqu'aux bouchers, etc. Donc il faut leur trouver des alternatives, et ce combat n'est pas facile, mais il faut le mener. Réduire la consommation de viande fait partie de la décroissance.
Donc voilà ce qu'est la décroissance pour nous. Moi et mes camarades, nous assumons la décroissance comme un des vecteurs essentiels du projet écosocialiste.
Alors on pourrait dire : tout cela, c'est très bien, mais quel est le rapport de force ? On a Trump. On a tous les fascistes anti-écologistes au pouvoir. Et l'écosocialisme, est quand même encore un mouvement assez minoritaire. Evidemment, il ne faut pas entretenir un optimisme béat. Et effectivement, le rapport de force n'est pas très favorable. Mais il faut éviter de tomber dans le fatalisme pessimiste – par exemple celui des collapsologues qui disent que la catastrophe écologique est inévitable, qu'il faut se préparer pour survivre, etc.
Je suis totalement opposé à cela pour deux raisons. D'abord, si la catastrophe écologique a vraiment lieu, je ne sais pas si on pourra survivre. Et deuxièmement, la bataille n'est pas perdue. Nous pouvons résister et nous pouvons lutter. Je termine avec une citation attribuée à Brecht, que j'aime beaucoup, et qui dit : « Celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu ».
Notes
[1] John Bellamy Foster, The Ecological Revolution. Making Peace with the Planet, Monthly Review Press, 2009.
[2] Kohei Saito, Moins ! La décroissance est une philosophie, Paris, Seuil, 2024.
[3] Michael Löwy et Daniel Tanuro (dir.), Luttes sociales et écologiques dans le monde. Allier le rouge et le vert, Paris, Textuel, 2021.
[4] Projet de « Manifeste du marxisme révolutionnaire à l'ère de la destruction écologique et sociale du capitalisme », en ligne : https://fourth.international/fr/comite-international/866/604
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Québec appelle à la résistance et à la solidarité face aux menaces de l’administration Trump

Un collectif de citoyennes et de citoyens québécois de toutes allégeances lance aujourd'hui un appel à la résistance et à la solidarité afin de faire front commun contre les récentes menaces économiques, culturelles et politiques provenant de l'administration Trump.
Page facebook de l'événement%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&locale=fr_CA]
Face aux tarifs douaniers injustifiés imposés par les États-Unis et au chantage politique visant à affaiblir la souveraineté économique, numérique, démocratique et culturelle du Québec et du Canada, ce collectif affirme haut et fort qu'il est hors de question de céder aux pressions américaines ou d'envisager toute forme d'annexion aux États-Unis.
Un grand rassemblement aura lieu le 6 avril à 13 h 30 au pied du Mont-Royal, près de la statue de Georges-Étienne Cartier, afin d'exprimer notre solidarité et notre résistance face aux menaces de l'administration Trump.
« Nous sommes profondément attachés aux valeurs démocratiques, culturelles et sociales développées par notre société au fil du temps », souligne le collectif dans une déclaration qui a été signée par plusieurs centaines de personnalités publiques québécoises. « Il est impensable pour nous de reculer sur des enjeux aussi fondamentaux que l'égalité des sexes, les droits des femmes, le droit à l'avortement, l'équité salariale, les droits des personnes LGBTQ+, la lutte contre la discrimination raciale ou encore la préservation de notre système universel de santé et de nos services éducatifs accessibles », rappelle Alain Saulnier, porte-parole du collectif.
Le collectif dénonce vivement l'idée d'importer au Québec et au Canada un modèle américain qui aggrave les inégalités économiques et sociales, compromet les acquis sociaux essentiels, encourage le port d'armes, envisage la réinstauration de la peine de mort ou néglige la lutte contre les changements climatiques.
La protection de la langue française, de la culture québécoise ainsi que des cultures autochtones constitue également une priorité essentielle. Le collectif réaffirme ainsi la nécessité de résister aux géants américains du web et à leur influence croissante.
« Nous lançons un appel à nous unir et à résister face aux pressions exercées par le président Trump et son administration », poursuit Alain Saulnier. « Nous invitons la société civile, les représentants patronaux, syndicaux, communautaires, féministes, environnementaux et culturels à faire front commun pour défendre notre autonomie, notre diversité culturelle et nos acquis sociaux. »
Cette solidarité dépasse les frontières du Québec. Le collectif appelle aussi les Canadiennes et Canadiens des autres provinces à manifester la même détermination. Finalement, nous devrons, au courant des mois et années à venir, approfondir nos liens avec les citoyennes et citoyens américains qui subissent eux aussi les conséquences néfastes des politiques de l'administration Trump et travailler ensemble pour mettre en échec les visées autoritaires de cette administration.
« Face à une menace commune, nous devons nous tenir debout ensemble », conclut le collectif. « Le temps presse, c'est maintenant à nous de jouer. »
Plusieurs centaines de personnes ont déjà signé la déclaration. Notamment : Alain Saulnier, Christine Beaulieu, Christine St-Pierre, Liza Frulla, Louise Beaudoin, Yvon Deschamps, Jacques Godbout, Caroline Senneville (Présidente de la CSN), Éric Gingras (Président de la Centrale des syndicats du Québec / CSQ), Tania Kontoyanni (Présidente de l'Union des Artistes), Alain Saladzius, Alain Vadeboncoeur, Alex Norris, Anaïs Barbeau-Lavalette, Anaïs Larocque, Anne-Marie Cadieux, Ariane Charbonneau, Catherine Durand, Clément Duhaime, Deneault Alain, Destiny Tchehouali, Dominique Legault, Françoise David, Fred Pellerin, Guylaine Tremblay, Jean-Robert Bisaillon, Jean-Robert Choquet, Joanne Liu, Jonathan Durand Folco, Laure Waridel, Lorraine Pintal, Louise Caouette Laberge, Louise Sicuro, Maka Koto, Mariana Gianelli, Michel Lacombe, Michel Rivard, Michelle Chanonat, Monique Simard, Normand Baillargeon, Pierre Trudel, Ségolène Roederer, Simon Brault, Agnès Gruda, André Bélisle, André Noël, Annick Charette, Ariane Roy, Benoit McGinnis, Boucar Diouf, Camil Bouchard, Céline Bonnier, Christian Bégin, Christian Vanasse, Claude Desrosiers, Claude Legault, Claude Meunier, Dominic Champagne, Edith Butler, Édith Cochrane, Emmanuel Bilodeau, Ève Déziel, François Avard, François Delorme, François Girard, Geneviève Rochette, Geoffrey Gaquère (Directeur artistique et codirecteur général du TNM), Isabelle Vincent, Jacqueline Lemay, Janine Krieber, Jean-François Lépine, Jean-François Nadeau, Jean-Sébastien Fournier, Julie Le Breton, Lana Carbonneau, Léa Clermont-Dion, Lise Aubut, Lizann Demers, Lou Vincent Desrosiers, Louise Harel, Louise Richer, Luc Ferrandez, Mani Soleymanlou, Manon Barbeau, Marie Malavoy, Marie-Josée Lacroix, Marie-Pier Boisvert, Marion Dove, Martin Viau, Mélissa Dion, Michel Désautels, Mireille Elchacar (Mères au front), Mona Greenbaum (Fondatrice de la Coalition des familles LGBT+), Monique Savoie, Morgane Gelly, Myriam Perraton Lambert, Pascale Cormier, Patrice Michaud, Paule Baillargeon, Philippe Poullaouec-Gonidec, Pier Paquette, Pierre Curzi, Pierre Martin, Pierre-Michel Tremblay, Rachida Azdouz, Rémi Bourget, René Richard Cyr, Robin Aubert, Salam Yazbeck, Vincent Graton.
Pour apposer sa signature à l'appel à la résistance.
Le collectif pour un appel à la résistance et à solidarité face aux menaces de l'administration Trump rassemble plus de 300 signataires.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Union fait l’avenir : Lancement des États généraux du syndicalisme

C'est avec grande fierté que le coup d'envoi a été donné aux États généraux du syndicalisme. Avec pour thème « L'union fait l'avenir », les neuf principales organisations syndicales québécoises – l'APTS, la CSN, la CSD, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ – se réunissent afin de réfléchir ensemble aux défis qui attendent les travailleuses et les travailleurs pour les prochaines années, avec en trame de fond un climat social, économique et politique en ébullition, notamment des attaques au droit de grève avec le projet de loi n° 89.
Le mouvement syndical québécois est à un tournant décisif. Les neuf principales organisations syndicales québécoises unissent leurs forces pour amorcer une réflexion collective dans le cadre des États généraux du syndicalisme, une démarche sans précédent au Québec.
Au cœur de cette démarche : une conversation profonde et honnête sur notre avenir collectif, des discussions sur la modernisation des approches syndicales pour mieux répondre aux attentes des travailleuses et des travailleurs et pour renforcer leur pouvoir d'action face aux nouvelles réalités du monde du travail.
Le syndicalisme, ce sont des visages, des voix et des réalités qui méritent d'être entendus. Cette démarche proactive cherche à revitaliser le mouvement syndical, assurer une plus grande justice sociale et bâtir un avenir où les travailleuses et les travailleurs pourront collectivement prendre leur place.
Un engagement pour l'avenir du syndicalisme
« Nos organisations veulent moderniser leurs approches pour mieux répondre aux attentes variées des travailleuses et travailleurs. Depuis toujours, le syndicalisme est une force de changement. À travers luttes et revendications, nous avons façonné le Québec et obtenu des acquis précieux pour l'ensemble de la société. Aujourd'hui, les défis s'accumulent, mais nos valeurs demeurent solides. Avec cette démarche inédite, nous voulons renforcer notre action collective et bâtir un avenir plus juste et solidaire », ont déclaré conjointement les présidences des neuf organisations syndicales : Robert Comeau (APTS), Luc Vachon (CSD), Caroline Senneville (CSN), Éric Gingras (CSQ), Mélanie Hubert (FAE), Julie Bouchard (FIQ), Magali Picard (FTQ), Christian Daigle (SFPQ) et Guillaume Bouvrette (SPGQ).
Un dialogue ouvert sur des enjeux majeurs
Les États généraux permettront d'examiner plusieurs questions essentielles liées à l'avenir du syndicalisme québécois. Ils porteront sur la place du syndicalisme dans la société et son rôle dans l'amélioration du bien-être collectif, ainsi que sur la capacité des syndicats à mobiliser leurs membres et à accroître leur rapport de force. L'évolution des relations intersyndicales sera également abordée, de même que le modèle québécois en relations de travail ainsi que la représentativité et le sentiment d'appartenance des membres. Enfin, les discussions porteront sur les façons de lever les obstacles à la participation des groupes historiquement discriminés afin d'assurer une plus grande inclusion au sein du mouvement syndical.
Un processus en trois grandes étapes
Cette initiative intersyndicale s'étendra sur plus d'un an et demi et comprendra :
1- une période de consultation des travailleuses et travailleurs, ainsi que de spécialistes du monde du travail et de la société civile, en 2025 pour recueillir leurs perspectives ;
2- un colloque au printemps 2026 pour discuter des résultats des consultations et identifier des pistes de solution ;
3- un grand événement au début de 2027 pour clore les États généraux et présenter les conclusions de cette démarche collective.
En engageant un dialogue sans précédent, ces neuf organisations syndicales québécoises souhaitent poser les fondations d'un syndicalisme solide, plus inclusif et adapté aux réalités de demain.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Votez Palestine

Pour ces élections, on soutient la Palestine. Nous sommes une campagne non partisane qui défend les droits et la liberté des Palestinien.ne.s pendant les élections fédérales canadiennes.
UNE PLATEFORME POUR LA PALESTINE
La Plateforme pour la Palestine a été développée en consultation avec la communauté palestinienne et ses partenaires solidaires à travers le Canada. Elle est ancrée dans les obligations du Canada sous le droit national et international.
- Imposer à l'Israël un embargo bilatéral sur les armes
- Mettre fin à l'implication du Canada dans les colonies israéliennes illégales
- Dénoncer le racisme anti-palestinien et protéger la liberté d'expression sur la Palestine
- Reconnaître l'État de la Palestine
- Protéger et financier les actions d'aide à Gaza
Pour soutenir cette campagne, visitez le site à l'adresse ci-dessous
https://votepalestine.ca/fr-home
LA PLATEFORME PALESTINE
La Plateforme Palestine présente les demandes unifiées de la communauté palestinienne et des personnes à traves le pays qui considèrent la position du Canada sur la Palestine comme un enjeu électoral majeur. Elle a été élaborée avec la communauté palestinienne et des partenaires solidaires à travers le Canada, et s'appuie sur les obligations du Canada en vertu du droit international, telles qu'elles sont inscrites dans les lois et les politiques nationales.
Les électeurs peuvent utiliser cette plate-forme pour évaluer les candidats dans votre circonscription et vous aider à décider pour qui voter le jour de l'élection. Les candidats peuvent consulter la plateforme pour comprendre les attentes des électeurs canadiens qui soutiennent la justice pour les Palestiniens.
Nous encourageons tous les résidents (électeurs ou non) à parler à leurs candidats locaux et à leur demander leur avis sur ces cinq points du programme. Faites-leur savoir que vous ne soutiendrez qu'un candidat qui défend les droits humains des Palestiniens et le droit international.
Imposer un embargo sur les armes à Israël dans les deux sens
Les marchands d'armes du Canada exportent des armes (y compris des pièces et des composants) ainsi que des technologies militaires et de sécurité vers Israël, à la fois directement et par l'intermédiaire des États-Unis. L'industrie militaire et de défense canadienne achète également des armes et des pièces détachées israéliennes, qui sont testées sur le terrain sur des Palestiniens, finançant ainsi directement les efforts de guerre et l'économie d'Israël. Ces importations et exportations militaires rendent le Canada complice des atrocités commises par Israël dans les territoires palestiniens illégalement occupés. Le gouvernement canadien doit imposer un embargo complet et immédiat sur les armes à destination d'Israël dans les deux sens, ce qui implique de mettre fin au commerce militaire avec Israël par l'intermédiaire des États-Unis ou de tout autre État tiers.
Mettre fin à l'implication du Canada dans les colonies israéliennes illégales
Bien que la politique étrangère canadienne reconnaisse formellement que les colonies israéliennes constituent une violation de la quatrième Convention de Genève, ce qui en fait des crimes de guerre, le Canada n'a pas pris de mesures contre les violations constantes du droit international et le vol des terres palestiniennes par Israël. Le gouvernement canadien peut prendre des mesures immédiates pour mettre fin à sa complicité dans ces crimes, notamment en interdisant tout engagement avec les colonies israéliennes illégales, y compris les investissements financiers, le commerce de biens ou de services et les échanges culturels et universitaires ; en révoquant le statut d'organisme de bienfaisance des organisations caritatives canadiennes qui soutiennent les colonies israéliennes ; et en interdisant la propriété, la vente ou la location de biens immobiliers situés dans les colonies israéliennes illégales à toute personne au Canada.
Lutter contre le racisme anti-palestinien et protéger la liberté d'expression sur la Palestine
La stratégie canadienne de lutte contre le racisme reconnaît que les Palestiniens au Canada sont confrontés à des niveaux de haine sans précédent. Néanmoins, ceux qui s'expriment contre l'occupation illégale et le génocide israéliens sont pris pour cible par la police et font l'objet de poursuites malveillantes ; ils sont dénoncés au Parlement, font l'objet de mesures disciplinaires de la part de leurs employeurs et sont réduits au silence par des institutions publiques telles que les universités. Le gouvernement canadien peut cesser de perpétuer le racisme anti-palestinien et respecter ses engagements en matière de lutte contre le racisme systémique au Canada en reconnaissant pleinement le racisme anti-palestinien dans la Stratégie antiraciste du Canada et en protégeant la liberté d'expression et les droits civils de ceux qui s'engagent dans diverses formes de protestation, y compris les Boycotts, Désinvestissements, et Sanctions (BDS) en faveur des droits des Palestiniens.
Reconnaître l'État de Palestine
L'État de Palestine est actuellement reconnu par plus des trois quarts des États membres des Nations Unies, dont l'Irlande, l'Espagne et la Norvège. Bien que la reconnaissance de l'État palestinien par le Canada soit largement symbolique, elle permettrait d'accroître la pression diplomatique sur Israël pour qu'il mette fin à son occupation illégale du territoire palestinien. Le Canada doit soutenir le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, inscrit dans le droit international.
Financer correctement les efforts de secours à Gaza, y compris l'UNRWA
Depuis octobre 2023, Israël a détruit plus de 85 % des infrastructures de Gaza, y compris les maisons, les hôpitaux et les écoles, laissant la bande de Gaza en ruines. Le Canada doit jouer un rôle substantiel dans les efforts de secours pour aider à reconstruire Gaza, en particulier à la lumière des menaces croissantes de dé-financer les organisations d'aide essentielles. Il s'agit notamment de financer correctement l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), qui a été une bouée de sauvetage pour les réfugiés palestiniens dans le territoire occupé et dans toute la région, mais qui a perdu des millions de dollars de financement en raison du retrait du soutien du gouvernement américain. En assurant un financement adéquat des efforts de secours, y compris de l'UNRWA, le Canada pourrait s'acquitter de sa responsabilité envers la communauté internationale.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Il est temps de boycotter l’Amérique

L'administration Trump s'est opposée si vigoureusement à un récent discours de l'ambassadeur d'Afrique du Sud qu'elle l'a expulsé des États-Unis. Qu'avait dit Ebrahim Rasool de si répréhensible ? Honnêtement, le discours qu'il a prononcé lors d'un séminaire en ligne parrainé par un institut de recherche sud-africain était plutôt ennuyeux.
24 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
Mais il y avait fait cette observation : « Donald Trump lance […] un assaut contre le pouvoir en place, ceux qui sont au pouvoir, en mobilisant le suprémacisme contre le pouvoir en place à l'intérieur du pays. »
Cette phrase demande un peu d'interprétation. Dans ce cas, le « pouvoir en place » est la bureaucratie fédérale, les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion au sein de l'administration et des entreprises, les initiatives antiracistes en général, et même les éléments du Parti républicain qui n'ont pas été trumpifiés. Le « suprémacisme », quant à lui, est la suprématie blanche.
En substance, l'ambassadeur souligne que Trump et le MAGA ont lancé une campagne visant à promouvoir la suprématie blanche dans un pays où le mouvement des droits civiques avait réalisé suffisamment de progrès pour être considéré aujourd'hui comme le courant dominant.
Il ne s'agit pas d'une accusation farfelue. Parmi toutes les actions racistes de l'administration actuelle, la plus scandaleuse est peut-être la promesse de Trump d'accélérer l'obtention de la citoyenneté américaine pour les Afrikaaners blancs d'Afrique du Sud qui, selon Trump, sont victimes de discrimination.
Ainsi, alors que l'administration déporte des milliers de Noirs et de Bruns et tente de retirer la citoyenneté de naissance d'encore plus de personnes de couleur, elle propose d'accélérer l'obtention de la citoyenneté pour un groupe de Blancs originaires d'Afrique. Il ne s'agit pas d'un titre du magazine The Onion. Il s'agit de nationalisme blanc. Même si les Afrikaaners étaient victimes de discrimination en Afrique du Sud – ce qui n'est pas le cas – le fait de privilégier leur entrée aux États-Unis par rapport aux Afghans terrifiés à l'idée de retourner sous le joug des talibans, aux Haïtiens fuyant l'effondrement social ou aux Soudanais fuyant la guerre civile serait toujours considéré comme une mesure raciste.
Les ouvertures de Donald Trump en direction des Afrikaaners constituent également un retour surprenant de la politique américaine aux positions favorables à l'apartheid des années 1980, lorsque l'administration Reagan s'est opposée à l'opinion mondiale en maintenant des relations fortes avec le régime de la minorité blanche en Afrique du Sud. À l'époque, aux États-Unis, le mouvement anti-apartheid appelait le monde à boycotter, sanctionner et se désinvestir de l'Afrique du Sud (BDS).
Alors qu'un nationaliste blanc est (à nouveau) devenu président des États-Unis, il est temps de s'inspirer du mouvement anti-apartheid. Alors que l'administration Trump impose des restrictions sur les voyages de 43 pays vers les États-Unis, qu'elle impose des droits de douane à ses alliés comme à ses adversaires, qu'elle s'acoquine avec des autocrates comme le Russe Vladimir Poutine, qu'elle démantèle des programmes fédéraux conçus pour aider les personnes dans le besoin partout dans le monde, alors qu'elle se retire de l'accord de Paris sur le climat et du Conseil des droits humains des Nations unies, alors qu'elle déporte illégalement des milliers de personnes et envoie certaines d'entre elles dans d'horribles prisons au Salvador, alors qu'elle soutient des partis politiques d'extrême droite et néonazis, alors qu'elle menace de s'emparer du Groenland et d'absorber le Canada, il est temps d'appeler le monde à traiter ce pays comme un paria.
C'est ce que vient de faire András Schiff. Le grand pianiste a annoncé cette semaine qu'il annulait ses prochains engagements et qu'il ne se produirait pas aux États-Unis. Cette décision intervient après qu'il ait refusé de jouer en Russie et dans son pays natal, la Hongrie. « C'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan ; je ne m'attends pas à ce que beaucoup de musiciens suivent, a déclaré András Schiff, mais cela n'a pas d'importance. C'est pour ma propre conscience. Dans l'histoire, il faut réagir ou ne pas réagir. »
Un tel boycott ne devrait pas être une mise à l'écart permanente, mais une réponse spécifique à des politiques qui violent clairement le droit international et les valeurs universelles de la démocratie et des droits humains. Bien sûr, les États-Unis ont violé ces principes par le passé. Mais cette fois, l'administration Trump a franchi tellement de limites qu'elle menace de renverser le système même du droit international.
Une fois que le gouvernement américain aura abandonné ses politiques de nationalisme blanc, entre autres positions inacceptables, il pourra être accueilli à nouveau au sein de la communauté des nations. En attendant : ne venez pas ici, n'investissez pas ici, n'achetez pas chez Tesla ou Amazon ou toute autre entreprise qui a embrassé l'anneau de Trump. Trump boycotte effectivement le monde en se retirant des institutions internationales et en violant les normes internationales. Le monde devrait lui rendre la pareille.
Isoler l'administration Trump
Les tarifs douaniers aveugles de l'administration Trump ont déjà incité un certain nombre de pays à riposter. Le Canada a imposé 32,8 milliards de dollars de droits de douane aux États-Unis, tandis que l'Europe en a imposé 28 milliards. La Chine a annoncé des droits de douane de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié américains, ainsi que des droits de douane de 10% sur d'autres produits, notamment le pétrole brut, les machines et les véhicules agricoles.
Les habitants de ces pays adaptent également leurs plans de voyage en conséquence, une décision que Robert Reich a récemment approuvée. C'est ce que rapporte le Washington Post :
« Les Canadiens font l'impasse sur les voyages à Disney World et les festivals de musique. Les Européens évitent les parcs nationaux américains et les Chinois partent plutôt en vacances en Australie. Selon Tourism Economics, les voyages internationaux à destination des États-Unis devraient diminuer de 5% cette année, contribuant à un manque à gagner de 64 milliards de dollars pour l'industrie du voyage. Cet institut avait initialement prévu une augmentation de 9% des voyages à l'étranger, mais a révisé ses estimations à la fin du mois dernier pour prendre en compte “les politiques et la rhétorique polarisantes de l'administration Trump”. »
La politique de Trump nuit aux États-Unis, qu'il s'agisse de l'industrie du voyage, des instituts de recherche qui perdent des subventions fédérales ou du consommateur moyen qui paie tous les droits de douane par des prix plus élevés.
Certains observateurs recommandent aux autres pays de résister à la tentation de se tirer une balle dans le pied en imposant leurs propres sanctions. L'économiste Dani Rodrik, par exemple, suggère que les tarifs douaniers de rétorsion ne feront que nuire aux pays qui les imposent, de sorte que la meilleure stratégie « consiste à minimiser les dégâts en restant aussi loin que possible de l'intimidateur et en attendant qu'il s'écroule dans un coin ».
L'économiste Gabriel Zucman préconise également d'appliquer des droits de douane aux oligarques américains : « Si Tesla veut vendre des voitures au Canada et au Mexique, Musk lui-même, en tant qu'actionnaire principal de Tesla, devrait payer des impôts au Canada et au Mexique. Imposez-lui un impôt sur la fortune et conditionnez l'accès au marché de Tesla au paiement de cet impôt. »
Modifier les plans de voyage, imposer des droits de douane sur les produits américains, taxer les ploutocrates américains : autant de stratégies potentiellement utiles. Mais elles ne vont pas assez loin.
S'attaquer au nid de frelons
Vous avez déjà entendu ce conseil : ne le contrariez pas, ne l'incitez pas à s'emporter, ne mettez pas davantage en danger les personnes qui l'entourent. Mais les maris violents ne font que poursuivre leur comportement inacceptable face à de telles attentions.
De nombreux dirigeants internationaux espèrent éviter la colère de Trump en le louant, en l'invitant à des défilés militaires ou au moins en faisant profil bas dans l'espoir qu'il ne dirigera pas sa colère dans leur direction.
Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, par exemple, a fait de son mieux pour s'attirer les faveurs de Trump, en particulier après la réunion désastreuse qui s'est tenue à la Maison Blanche le mois dernier. Il a ainsi pu relancer l'aide militaire américaine et le partage de renseignements. Mais il est toujours sur le point d'être vendu à la table des négociations si et quand l'administration Trump accepte les conditions strictes de la Russie pour un cessez-le-feu et un accord de paix.
Pourtant, objecterez-vous, aucun pays n'est assez puissant pour remettre Trump à sa place. Et ceux qui pourraient avoir une chance de le faire – la Chine, la Russie – sont plus intéressés à travailler avec Trump pour diviser le monde en sphères d'influence.
Mais il reste encore beaucoup de pays qui peuvent s'unir, comme une armée de Lilliputiens de petite et moyenne taille pour entraver le Gulliver ivre de pouvoir. Il leur suffit de frapper les États-Unis là où ça fait mal. N'achetez pas les produits des entreprises américaines qui soutiennent Trump. Ne permettez pas à ces entreprises d'investir dans vos pays. Réorientez vos transactions monétaires en vous éloignant du dollar.
Ces mesures ne doivent pas être prises en une seule fois. Elles doivent plutôt être mises en place de manière stratégique afin de forcer Trump à revenir sur ses politiques les plus nocives.
Les tactiques de dénonciation ne fonctionnent pas avec les dirigeants qui n'ont pas honte. Il faut le frapper au portefeuille, c'est le seul langage qu'il comprend.
Ces mesures nuiront-elles aux Américains ordinaires ? Probablement. Mais pas plus que ce que nous fait désormais subir Trump. Les droits de douane que les pays ont imposés en représailles aux actions de Trump auront un impact négatif sur près de 8 millions de travailleurs américains, dont la majorité se trouve dans les comtés qui ont voté pour lui. Mais ces coûts ne sont rien comparés à ce que le monde subira à la suite des réductions de l'aide étrangère imposées par Trump, qui tueront probablement des centaines de milliers de personnes par an.
Une dernière recommandation : ne pas couper toute communication avec les États-Unis.
Dans les années 1980, la campagne anti-apartheid a favorisé des contacts considérables entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Mais il s'agissait d'une relation basée sur la solidarité entre les organisations de la société civile. Mes chers amis du Canada, du Mexique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine : s'il vous plaît, n'assimilez pas Trump aux États-Unis. Oui, beaucoup de gens ici ont voté pour lui. Mais ils commencent à avoir des remords d'acheteur. Joignons nos mains au-delà des frontières et des lignes de parti et disons : « Nous ne tolérerons pas les brutes racistes. »
L'alliance contre le fascisme a fonctionné pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mouvement anti-apartheid a été couronné de succès. Opposons-nous maintenant aux Trump, aux Poutine et aux Netanyahou de ce monde. Ils ne représentent qu'un pour cent et sont largement dépassés en nombre.
John Feffer, 19 mars 2025.
https://fpif.org/its-time-boycott-america/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis. Dans les universités, une campagne maccarthyste pour protéger Israël

Après de fortes mobilisations dans les plus grandes universités américaines contre la guerre que mène Israël à Gaza, vient le temps du retour de bâton, renforcé par l'administration toute puissante de Donald Trump. Sur les campus, pour les soutiens du peuple palestinien, c'est la chasse aux sorcières, qui n'épargne pas les voix juives.
Tiré de orientxxi
24 mars 2025
Par Sylvain Cypel
Traductions : français فارسى
L'image montre un groupe de policiers en uniforme noir entourant une personne arrêtée. Cette personne est de dos, les mains attachées derrière. Les policiers portent des casques et des protections, et il y a une atmosphère tendue, suggérant une manifestation ou une intervention policière.
Extrait du documentaire The Encampments, réalisé par Michael T. Workman et Kei Pritsker (2025)
Watermelon Pictures, Macklemore et BreakThrough Media
En France, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle (Arcom) lance une instruction contre le journaliste Jean-Michel Aphatie pour avoir comparé les crimes de l'armée française dans la colonisation de l'Algérie à Oradour-sur-Glane, un crime nazi commis sur le sol français. L'Observatoire juif de France, lui, saisit la justice contre le réalisateur Jonathan Glazer, qui a déclaré qu'aujourd'hui « la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier des massacres et un nettoyage ethnique à Gaza ». Une campagne visant à bannir l'exposé de vérités dérangeantes est engagée.
Aux États-Unis, ce phénomène focalisé sur ce qui touche à la question palestinienne est apparu il y a plus d'une décennie. Il se poursuit avec une ampleur décuplée depuis l'accession de Donald Trump au pouvoir. Une « novlangue » est imposée pour nier le réel, et plus spécifiquement les crimes commis par des autorités coloniales – hier en Algérie, aujourd'hui en Palestine.
Confusion et manipulation
Sur les campus outre-Atlantique, cette bataille fait désormais rage. Un exemple récent parmi cent : le 25 février 2025, Kathy Hochul, gouverneure démocrate de l'État de New York, ordonne au Hunter College d'annuler deux offres d'emploi à des postes d'enseignants en études palestiniennes. Il s'agit là de l'une des universités qui, ensemble, forment la City University of New York (CUNY), composée de 25 campus, 17 000 professeurs et enseignants, 275 000 étudiants. Le profil des postes, voté préalablement par le directoire, demandait aux candidats
un regard critique sur les questions relatives à la Palestine, y compris, mais sans s'y limiter, au colonialisme de peuplement, au génocide, aux droits humains, à l'apartheid, la migration, les dévastations climatiques et infrastructurelles, la santé, la race, le genre et la sexualité.
La gouverneure de l'État a jugé que l'université Hunter devait « supprimer immédiatement ces offres d'emploi et procéder à un examen approfondi pour garantir que des théories antisémites ne soient pas promues en classe » (1).
Entre temps, Jeffrey Wiesenfeld, un ex-administrateur de CUNY, très vigilant sur tout ce qui touche à Israël, avait prévenu Hochul du scandale que susciteraient ces embauches. Pour situer le personnage, Wiesenfeld avait tenté, en 2011, d'empêcher l'allocation d'un prix au scénariste Tony Kushner, un dramaturge juif américain connu, à cause de ses positions critiques envers Israël. Cette fois, il a intimé à la gouverneure de nettoyer ses écuries. Et elle s'y est plié. « La rhétorique haineuse sous toutes ses formes n'a pas de place à l'Université CUNY », a-t-elle tranché. Des études palestiniennes équivaudrait à laisser place à la haine. Professeur à CUNY, Corey Robin s'en est ému. Si les termes « colonisation », « génocide » ou « apartheid », sont jugés « haineux » et interdits sur le campus, autant dire qu'aucune voix pro-palestinienne n'y a plus sa place, a-t-il jugé (2).
Indubitablement, l'antisémitisme progresse sur les campus aux États-Unis. Et bien entendu, on peut constater dans la mouvance défendant les droits des Palestiniens, par ignorance ou en toute connaissance de cause, des expressions d'antisémitisme avérées. Tout comme on peut constater ou pressentir des expressions avérées d'islamophobie ou d'arabophobie parmi les soutiens d'Israël. Le racisme reste, malheureusement, chose courante et au plus haut niveau. Mais ce qui monte beaucoup plus encore, et avec l'aval des autorités publiques, c'est la confusion des termes, la manipulation de l'accusation d'antisémitisme afin de délégitimer toute critique des actes commis par un État, Israël, et de transformer la défense des droits des Palestiniens en manifestation de « haine ».
Toute critique du sionisme est discriminatoire
Cette bataille des mots est menée à partir d'une idée simple et d'une stratégie. L'idée consiste à éluder toute référence à ce qui advient à Gaza et en Cisjordanie, pour faire de l'antisémitisme le seul sujet du débat. La stratégie, elle, se développe sur deux axes. D'abord, les soutiens d'Israël entendent imposer une « nouvelle définition » du mot antisémitisme, celle proposée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA). Pour résumer, depuis la fin du XIXe siècle, l'acception admise du terme l'équivalait à la judéophobie, le racisme anti-juif. Désormais, la « nouvelle définition » l'élargit à la critique de l'État d'Israël. Elle ne le stipule pas explicitement, mais c'est bien à cela qu'elle sert de facto. Dès lors, dire qu'Israël commet des crimes devient antisémite.
Après de longs débats internes, la célèbre université Harvard s'est résolue, en janvier 2025, à adopter ladite « nouvelle définition » de l'antisémitisme. Le résultat est que, par exemple, définir l'État d'Israël comme une « entreprise raciste » sort du champ du débat légitime pour devenir ipso facto susceptible de poursuites. Suite à des plaintes du groupe local Students Against Antisemitism (Étudiants contre l'antisémitisme), qui lui reprochait d'avoir insuffisamment agi pour museler « l'antisémitisme grave et omniprésent sur le campus » – comprendre : les manifestations de soutien aux Palestiniens –, Harvard a trouvé un accord avec les plaignants. L'université devait publier sur son site internet la déclaration suivante :
Pour de nombreux juifs, le sionisme fait partie de leur identité juive. Tout comportement qui contreviendrait à la politique de non-discrimination s'il visait des juifs ou des Israéliens peut également contrevenir à cette politique s'il vise des sionistes (3).
En clair : toute critique du sionisme est discriminatoire.
Instrumentaliser une loi sur les droits civiques
À partir de là, se développe le deuxième axe de la stratégie : les mesures judiciaires pour lutter contre ce « nouvel antisémitisme ». L'affaire montre la dimension de la manipulation. En 1964, le Congrès américain adoptait une loi sur les droits civiques qui mettait fin à la discrimination raciale. Elle visait en priorité à protéger les Noirs, historiquement premiers visés par les agressions racistes, et élargissait son application à toute minorité « ethnoraciale », selon le terme anglo-saxon usuel. Son titre VI portait spécifiquement sur la protection des minorités dans la sphère éducative. Les juifs n'y figuraient pas. Le judaïsme étant perçu comme une religion, la rejet de l'antisémitisme ressortait d'autres espaces juridiques. Cependant, en 2004, le bureau des droits civiques du ministère américain de l'éducation accepta la requête de divers organismes pour que « des groupes présentant des caractéristiques à la fois ethniques et religieuses, comme les Arabes musulmans, les Juifs américains et les Sikhs » soient pris en compte par le titre VI de la loi anti-discrimination (4).
À l'époque, personne n'y vit à redire. Qui pouvait récuser l'inscription de l'antisémitisme dans une catégorie légale commune avec les autres formes de racisme ? Mais à partir des années 2010, constatant une montée d'hostilité au sionisme sur les campus américains, des organismes pro-israéliens commencèrent à voir combien l'insertion des juifs dans ledit titre VI ouvrait de perspectives pour délégitimer toute parole hostile au sionisme et aux actes criminels d'Israël. Si l'antisionisme est « la forme moderne de l'antisémitisme », alors toute critique de l'État sioniste devient une attaque contre tous les juifs. Dès lors, le Parti républicain et une majorité des dirigeants démocrates ont transformé le fameux titre en instrument juridique pour faire taire toute défense de la cause palestinienne, et menacer les universités de plaintes si elles ne prenaient pas des mesures draconiennes pour interdire les « propos antisémites » sur les campus. Motif très prisé des plaignants : la dénonciation des crimes de guerre d'Israël à Gaza, en Cisjordanie ou au Liban, contribue à « créer un environnement hostile » envers les juifs en général – donc passible de poursuites sous le fameux titre VI. Celui-ci est donc désormais utilisé pour interdire tout débat sur des crimes.
« Du fleuve à la mer »
Les défenseurs des droits civiques et de la liberté d'expression, en particulier l'Union américaine des libertés civiles (American Civil Liberties Unions, ACLU), qui joua un rôle majeur dans l'adoption des lois antiségrégationnistes de 1964, s'étranglent d'indignation. Cela n'empêche pas les poursuites sous le chapeau de ce texte de se multiplier. D'octobre 2023 à octobre 2024, 153 enquêtes ont visé à réprimer les manifestations pro-palestiniennes sur les campus, et 70 affaires ont été déposées devant le Bureau des droits civiques du département de l'éducation, alléguant des « violations du titre VI ». Comme dit Radikha Sainath, juriste de l'association Palestine Legal, ce motif est devenu « un marteau pilon pour réprimer la parole des étudiants soutenants les droits des Palestiniens » (5).
Un des exemples les plus absurdes de cette situation est la caractérisation d'« antisémite » de tout partisan de la cause palestinienne qui utilise l'expression « from the River to the sea » (« du fleuve à la mer », c'est-à-dire, du Jourdain à la Méditerranée, en référence au territoire de la Palestine historique). Les pourfendeurs du « nouvel antisémitisme » y voient un refus caractérisé de « reconnaitre l'existence de l'État d'Israël », passible de poursuites. Or, l'expression « du Jourdain à la mer » est quotidiennement exprimée par d'innombrables dirigeants israéliens et leurs soutiens aux États-Unis pour manifester leur désir de s'emparer en totalité de ce même territoire, souvent accompagné explicitement du désir d'expulser la totalité des Palestiniens qui y résident – et ce, sans être jamais menacés de la moindre sanction.
Le monde universitaire sous pression
Ces attaques atteignent rarement les portes des tribunaux, car elles suffisent généralement pour amener les autorités académiques à se soumettre aux exigences des plaignants. Ceux-ci font alors interdire ici la projection d'un film, là une manifestation, ailleurs un débat, au motif qu'ils constituent un « environnement hostile » à une minorité sur le campus. Peu importe que de nombreux étudiants juifs dénoncent ces méthodes. À Harvard, une pétition a fait interdire la diffusion d'un documentaire intitulé Israelism, portant sur la désaffection des jeunes juifs américains envers le sionisme, au motif qu'elle créerait « un environnement hostile » aux étudiants juifs. En novembre 2024, une quarantaine d'élus de l'État de New York, républicains et démocrates, ont appelé le gouverneur à mettre hors la loi l'association Students for Justice in Palestine, arguant, toujours, que le titre VI l'y oblige.
Les dirigeants et enseignants des universités sont sous pression. On exige leur départ s'ils refusent de prendre les mesures qu'on attend d'eux. Un étudiant alléguant, par exemple, qu'un enseignant a prononcé en cours les termes « État colonial » au sujet d'Israël peut exiger qu'une enquête soit illico diligentée au motif que l'emploi de cette définition constitue un « harcèlement » à son égard. Dès lors, note Geneviève Lakier, professeure de droit à l'université de Chicago, « les administrateurs des universités ont peur du risque. Ils ne veulent pas avoir d'ennuis, perdre le financement de donateurs ou faire l'objet d'une mauvaise publicité. Le plus simple pour eux est de réprimer les discours supposés violer le titre VI » (6).
Quand l'administration Trump s'en mêle
Depuis son entrée à la Maison blanche, Donald Trump multiplie les appels à renforcer la punition des universités rétives. L'Anti Defamation League (ADL), la principale association américaine de lutte contre l'antisémitisme, ou Stand With Us, une association de soutien inconditionnel à Israël, militent pour que la totalité des universités américaines adoptent la définition de l'IHRA et soumettent toute contestation à des poursuites légales sous le titre VI, afin d'« éradiquer définitivement » l'antisionisme aux États-Unis. La grande majorité du Congrès leur est acquise. Le débat pour légiférer sur les sanctions à prendre est désormais sur la table.
Le 3 mars, Trump a annoncé sur son réseau Truth Social que bientôt « tout financement fédéral CESSERA pour les écoles ou les universités qui autorisent des manifestations de protestations illégales », comprendre, critiques d'Israël. « Les agitateurs, a-t-il ajouté, seront emprisonnés ou renvoyés définitivement dans leur pays, les étudiants américains expulsés définitivement ou, selon les délits, incarcérés. BAS LES MASQUES ! ». Son administration a immédiatement annulé 400 millions de dollars (367,74 millions d'euros) de contrats publics et de subventions à l'université de Columbia pour avoir insuffisamment réprimé les manifestations pro-palestiniennes du printemps 2024. Juste après, le leader de ces manifestations, Mahmoud Khalil, un Palestinien détenteur d'un master en relations internationales, était interpellé par l'agence de surveillance de l'immigration et des douanes (ICE) et privé de sa « carte verte » (green card, autorisation décennale de résidence aux États-Unis). Son incarcération a soulevé un tollé dans les cercles académiques, auxquels se sont joint des universitaires et des associations juives – y compris des organismes sionistes tels que J-Street, Zioness ou le Jewish Council for Public Affairs, la plus grande association juive démocrate.
Mais ces réactions restent faibles. Le sentiment d'une administration Trump toute puissante et bénéficiant du soutien des corps constitués — sénat, chambre et Cour suprême — tétanise les autorités universitaires. Avant même que Trump ne dégaine, Columbia avait constitué en secret un comité spécial de discipline, intitulé Bureau de l'équité institutionnelle, destiné à traquer et sanctionner les leaders estudiantins de la mouvance critique d'Israël, au nom de la « protection des étudiants juifs ». Convoqués devant ce bureau, des étudiants ont constaté avec stupeur que leur correspondance avait été espionnée pour y traquer, en particulier, les mots interdits comme « colonial » ou « génocidaire », susceptibles de leur valoir des sanctions allant jusqu'à l'exclusion de l'université. Certains d'entre eux ont indiqué qu'il leur a été demandé de livrer les noms d'autres condisciples « impliqués dans des groupes pro-palestiniens et des manifestations sur le campus ». Et, après avoir vu sa subvention suspendue, l'université de Columbia a accepté le diktat du président.
Le 3 mars, la chercheuse irano-américaine Helyeh Doutaghi, directrice-adjointe d'un laboratoire en économie à l'université de Yale, a été convoquée par sa direction. Celle-ci a reçu un rapport d'une association nommée Jewish Onliner présentant Doutaghi comme une « terroriste » (7). Elle est instantanément mise en congé, son accès informatique à l'université est fermé. Sans enquête préalable, elle passe immédiatement devant une commission de discipline. La chercheuse dénonce un rapport truffé de fausses informations réalisé par une intelligence artificielle. La commission n'en disconvient pas. Mais Doutaghi reconnait volontiers être une militante pro-palestinienne et plus généralement décoloniale. Elle est licenciée en 24 heures.
Une odeur de mccarthysme flotte sur l'université américaine. Elle se répand même au-delà. À Miami, le 13 mars, le maire a licencié le directeur d'un cinéma municipal pour avoir diffusé le documentaire No Other Land, au motif que ce film, réalisé ensemble par le Palestinien Basel Adra et l'Israélien Yuval Abraham, et récipiendaire de l'oscar pour le meilleur documentaire, est « une attaque de propagande unilatérale contre le peuple
juif » (8).
Notes
1. Arno Rosenfeld, « Hochul orders Hunter College to remove Palestinian studies job listings », The Forward, 26 février 2025.
2. Corey Robin, « Kafka comes to CUNY, coreyrobin.com, 28 février 2025.
3. Vimal Patel : « Harvard adopts a definition of Antisemitism for discipline cases », New York Times, 21 janvier 2025.
4. Alex Kane, « The Civil Rights Law shutting down pro-Palestine speech », Jewish Currents, 15 novembre 2014.
5. ibid.
6. Ibid.
7. elyeh Doughati, « Suspended for pro-Palestine speech : My speech on Yale Law School's embrace of AI-generated smears », MondoWeiss, 13 mars 2023.
8. « Miami Beach mayor moves to evict theater operator for showing Oscar winner “No Other Land” », Jewish Telegraphic Agency, 16 mars 2025.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Condamnation de Marine Le Pen : une décision logique qui met fin à des années d’impunité

La décision de justice concernant Marine Le Pen, d'autres élus et dirigeants du RN est logique d'un point de vue judiciaire et de la gravité des faits reprochés : détournement de fonds publics à hauteur de 4 millions d'euros dans le cadre d'un système de financement de son parti politique ayant duré plusieurs années.
Publié par L'APRÈS le 31 mars 2025
D'après le tribunal, ce détournement a permis indirectement aux dirigeants du RN d'assurer leur train de vie personnel, et constitue un contournement des règles de financement des partis politiques et donc un détournement démocratique.
La décision de justice n'exprime aucun acharnement. C'est l'application de la loi.
Elle n'empêche en rien le RN de défendre ses propositions et de se présenter aux prochaines élections.
En République, la justice doit être la même pour toutes et tous. Elle ne peut être rendue différemment selon le statut politique des citoyens, le mandat qu'on occupe ou celui pour lequel on postule.
Il ne peut exister d'immunité politique. La participation à l'élection présidentielle ne confère aucun privilège.
La 6e République que nous appelons de nos vœux devra être celle de l'honnêteté et du respect de l'éthique.
Publié par L'APRÈS le 31 mars 2025
***
Première réaction à la condamnation de Marine Le Pen
31 mars 2025 | par aplutsoc | https://aplutsoc.org/2025/03/31/avant-la-prise-de-parole-de-marine-le-pen-sur-le-plateau-de-tf1-a-20h/
Nota : cette se place avant les propos et arguments que Marine Le Pen tiendra à l'occasion de la séquence avec tapis rouge que lui offre TF1 à partir de 20H.
La décision de justice prise aujourd'hui à l'encontre de Mme Le Pen et d'une bande de dignitaires du RN, parmi lesquels M. Alliot, maire de Perpignan, est, comme le déclare le communiqué de l'APRÈS, une décision logique, et qui n'a en fait que trop attendu : les faits accablants, combinant détournement de fonds publics, enrichissements privés, dans le cadre d'un système organisé initialement par Jean-Marie Le Pen, sont connus depuis treize ans !
C'est une non-condamnation ou une mesure de « clémence » qui aurait été un coup porté à la démocratie. La lettre du droit interdisait au juge de ne pas condamner dans cette affaire. Mais en ne cédant pas aux pressions initialement exercées, au moins implicitement, lors de la mise en place du gouvernement Bayrou, puis lors de la nomination de M. Ferrand par Macron à la tête du Conseil constitutionnel, le tribunal a bel et bien, qu'elle qu'ait été son intention, porté un coup au véritable système anti-démocratique : celui de la V° République, dont le RN est un pilier fondamental. Ce coup rejoint celui porté par les sept ans de prison requis contre le grand délinquant qu'est l'ancien président de la V° République Nicolas Sarkozy.
Fait de la plus haute importance : la toute première réaction au verdict est venue de Moscou, en à peine quelques minutes, rapidement suivi par Victor Orban. L'axe néofasciste fait savoir son mécontentement. S'ils en avaient les moyens, ils programmeraient une « intervention militaire spéciale » contre les « juges fascistes ». A l'heure où sont écrites ces lignes, l'on n'a pas encore connaissance d'éventuelles réactions de l'autre branche de l'Axe, celle du triumvirat Trump/Musk/Vance.
Leur ligne est claire : dénoncer le « gouvernement des juges ». La défense des affairistes et corrompus du RN rejoint le combat de Trump contre tous les tribunaux encore indépendants des États-Unis, comme celui d'Orban, comme celui de Netanyahou contre les normes constitutionnelles israéliennes en relation avec ses projets de déportation et de massacre des Palestiniens. L'existence de normes de droit fondées sur la loi égale pour toutes et tous, et d'une jurisprudence publique et transparente, fait partie, pour les révolutionnaires sérieux, des acquis à défendre et à approfondir. Ce que nous pouvons reprocher au système judiciaire, ce n'est pas de condamner des puissants comme Mme Le Pen, mais de le faire trop rarement en étant trop souvent implacable avec les pauvres.
La ligne générale des pseudo-défenseurs de la démocratie que sont les amis de Mme Le Pen, à savoir les Poutine, les Trump, les Orban et les Netanyahou, ose se réclamer de la démocratie contre le « gouvernement des juges » alors qu'ils ne défendent rien d'autre que la dictature exercée frauduleusement au nom d'un peuple clientélisé et manipulé qui ne peut s'exprimer que dans les conditions de plébiscites contraints.
Dans ces conditions, il faut noter l'équivoque du communiqué de LFI, qui dit « prendre acte » de la décision de justice envers des élus RN corrompus, mais dit aussi s'opposer à l'impossibilité d'un recours, ce qui est faux – le recours est possible, c'est la peine d'inéligibilité qui s'applique sans attendre, de même qu'une suspension de permis de conduire peut s'appliquer avant tout appel ! – puis explique dédaigneusement que LFI n'utilise pas « un tribunal » contre le RN et le battra (toute seule ?!) « dans les urnes et dans la rue ». Toute équivoque est levée par l'explication de texte twittée par J.M. Mélenchon : « … la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. C'est à cela que devrait servir le référendum révocatoire dans une 6° République démocratique. »
Il se confirme ici que la 6° République de J.L. Mélenchon n'est pas démocratique, mais bonapartiste et présidentielle, et qu'elle aurait recours à des « référendums » n'ayant par ailleurs aucune chance d'aboutir contre le Chef en place, tout en déniant l'exercice de la justice et en préconisant ouvertement ici le fait que les élus, surtout, sans doute, le « président », soient au-dessus des lois. Le terrain de la critique mélenchonienne de la décision de justice contre Mme Le Pen est celui-là même du RN, de M. Retailleau, et derrière eux de l'axe poutinien : contre la démocratie reposant sur la garantie des droits fondamentaux et de l'état de droit, l'ordre plébiscitaire des Chefs « populaires » à poigne.
C'est là cela même avec quoi il faut en finir, et en vue de quoi le jugement d'aujourd'hui est fondamentalement une bonne nouvelle. La VI° République que nous voulons ne sera pas la V° bis, elle n'aura pas de président mais une assemblée constituante et des assemblées à différents niveaux, combinées à la garantie des droits assurée par le judiciaire et la fonction publique.
Les forces démocratiques, la gauche et le mouvement ouvrier sauront-ils exploiter cette bonne nouvelle comme il convient ?
Il faut pour cela qu'elles s'unissent contre la V° République et le déni de démocratie qu'est l'existence même de l'exécutif Macron/Bayrou/Retailleau, en exigeant un gouvernement démocratique qui hausse les salaires, abroge la loi retraites, sauve les services publics, aide l'Ukraine et prenne à bras le corps la question climatique, étape vers une assemblée constituante et un changement de régime.
C'était possible voici quelques mois. Cela ne le serait plus dans le monde de Trump et Poutine ? Alors que le gouvernement Bayrou semble plus fragilisé que jamais ? Alors que le RN va partir en campagne pour sa prétendue « démocratie » contre « les juges » et « le système » ? Inacceptable !
Il va falloir l'imposer, par les luttes sociales, par la démocratie, par l'unité d'action, et par l'indispensable bataille politique de clarification, notamment contre le bonapartisme autoritaire lui-même dans l'union populaire qui doit, pour gagner, s'en débarrasser !
31/03/2025 à 18H45.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ni Poilievre, ni Carney, Mères au Front au pouvoir !

Voilà comment j'envisage la prochaine élection fédérale et le nouveau cycle politique qui s'ouvre sous nos yeux. Face au fascisme qui vient et à l'oligarchie libérale qui prétend nous protéger : Résistons !
Texte trop long, en trois actes.
Acte I : Le courage retrouvé
Hier, j'ai eu eu la chance de participer au rassemblement montréalais des Mères au Front qui a réuni des milliers de personnes sur Ste-Catherine pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Parallèlement, des rassemblements et chaînes humaines avaient lieu dans des dizaines de municipalités au Québec et au Canada, avec un enthousiasme inattendu. Il y a avait de l'énergie, de la joie, de la colère, de la beauté, une atmosphère de résistance.
Maudit que ça fait du bien de vivre ce moment de "bonheur public", comme le souligne Hannah Arendt qui fait de cet affect le cœur de l'action politique.
Cette année, le 8 mars revêtit une signification historique particulière, car ce fut la première et plus importante mobilisation collective au Québec depuis l'élection de Trump.
Les discours étaient hautement politiques, tissant des liens entre les luttes historiques pour les droits des femmes, les menaces du fascisme et de la broligarchie qui prétendent vouloir refaçonner l'ordre du monde, mais aussi un appui aux peuples écrasés par les guerres et les puissances impérialistes (Ukraine, Gaza), des articulations avec la nécessaire transition écologique, le besoin de construire un monde viable pour nos enfants, l'humanité et le vivant.
Face à la léthargie, le sentiment d'impuissance et d'isolement qui nous amène à "doomscroller" la fin du monde sur nos ordis et nos téléphones, on se sort enfin du fatalisme et on retrouve une puissance d'agir. Voilà un ingrédient clé de la résistance.
Bien sûr, cette mobilisation du 8 mars ne changera pas le monde en soi ; mais c'est le début de quelque chose. La Multitude sort dans la rue, non pas sous la bannière d'une seule cause ou d'une revendication centrale, mais de plusieurs causes convergentes, dans un front large et uni.
C'est cet esprit du 8 mars que j'ai retrouvé sous une forme différente et percutante en après-midi à l'Usine C, en allant voir l'étrange pièce "Use et Abuse" des artistes Christian Lapointe et Alix Dufresne qui renouent avec le caractère brut, subversif et radical de la performance, sur fond d'une conférence d'Alain Deneault sur le capitalisme, la gouvernance et les industries culturelles.
C'était beau, brutal, drôle et violent, exprimant de façon crue et cathartique cet aspect "rage" qui nous habite à différents degrés ces temps-ci. Un moment clé fut Alix qui brandit une pancarte qu'elle venait d'écrire au marqueur noir sous le coup de l'improvisation : "8 mars tous les jours tabarnak !". Le public a applaudi.
Une discussion portant sur la soumission du secteur culturel aux impératifs budgétaires et du managérialisme s'en est suivie, exprimant de fortes résonances avec le Front commun pour les arts qui se met en place ces temps-ci. La lutte contre l'austérité en culture, en éducation, en santé, contre les cours de francisation et les initiatives de transition socio-écologique, tout cela converge en ce moment ; ça bouillonne.
L'argent ne manque pas ; ce sont les oligarques, des entreprises comme Northvolt, IBM et SAP (qui ont empoché des millions dans le scandale SAAQclic), Amazon, Tesla et d'autres compagnies contrôlées par des milliardaires qui s'enrichissent actuellement alors que les gens se serrent la ceinture pour l'épicerie, leur logement ou hypothèque. Plusieurs craignent actuellement pour la perte de leur emploi ou leur sécurité à cause d'une guerre tarifaire déclenchée par un tyran qui rêve de faire de nous une succursale des États-Unis.
***
Acte II : Le marasme des élections fédérales
Dans cette conjoncture unique et extrême, Justin Trudeau a démissionné et la course à la chefferie du Parti libéral du Canada vient de couronner son nouveau leader, Mark Carney.
Il devient ainsi le premier ministre du Canada, sans même avoir été élu dans une élection générale. C'est assez hallucinant : le chef d'un État, non-élu par la population, devient maintenant l'homme qui devra tenir tête à Trump... d'ici la prochaine élection qui sera déclenchée sous peu.
Les conservateurs le dépeignent déjà comme un technocrate et un membre de l'élite mondialiste, ce qui est vrai en bonne partie : Carney a été gouverneur de la Banque du Canada (suite à la crise financière de 2008), gouverneur de la banque d'Angleterre (durant la période du Brexit), et un grand partisan du capitalisme vert. Tout l'establishment médiatique le positionne déjà comme le digne successeur de Trudeau, et un "homme fort" capable de répondre aux grandes crises économiques en raison de ses compétences d'économiste.
Il est plus à droite que Trudeau, il fait la promotion de la rigueur budgétaire, plaide pour l'usage de l'IA dans la fonction publique, et commence déjà à concéder une série de choses à l'administration Trump au niveau économique et environnemental. Je ne doute pas de son expérience et de son "expertise", mais face à l'administration Trump, il incarne une sorte de "rempart néolibéral" qui apparaîtra comme un "moindre mal" face au techno-fascisme décomplexé du duo Trump-Musk.
Autrement dit, Carney est un membre de l'oligarchie libérale qui défendra les intérêts de cette oligarchie locale dans le contexte d'une guerre commerciale inédite avec les États-Unis.
Par ailleurs, celles et ceux qui seraient tentés de voter Poilievre pour se débarrasser de l'héritage Trudeau ou du "capitalisme woke" risquent d'être déçus. Le Parti conservateur dirigé par Poilievre est largement aligné sur le plan idéologique et politique avec le trumpisme au Sud de la frontière, avec quelques différences près (Canada Strong, version soft du Make Canada Great Again).
Le triomphe de Poilievre a heureusement été refroidi par l'arrivée de Trump et le carnage qu'il a instauré au niveau domestique et international depuis le 20 janvier 2025. Toute la complexité de la droite radicale canadienne consiste maintenant à se positionner à la fois "contre" Trump et "pour" ses politiques, dans un contexte de tension croissante avec les États-Unis.
Mais dans les deux cas, que ce soit le Parti conservateur de Poilievre qui incarne une broligarchie fascisante semi-décomplexée, puis le Parti libéral sauvé par Carney qui incarne l'oligarchie néolibérale mesurée, avec un chef parlant vaguement français et qui est en bonne partie déconnecté des préoccupations de la population, nous sommes face à un choix déchirant et stratégique.
Certains iront voter pour le moindre mal (Carney), d'autres auront ce ressentiment anti-Trudeau tellement enraciné qu'ils voteront pour Poilievre (malgré les risques), d'autres s'abstiendront, d'autres iront voter NPD, Verts ou pour le Bloc québécois en guise de protestation.
Une partie de moi dit "tout sauf Poilievre", admettant ainsi la légitimité du vote utile et stratégique afin de faire barrage contre l'extrême droite. Personnellement, je comprends les gens qui voteront ainsi, d'autant plus qu'il est faux et dangereux de faire une pure équivalence entre néolibéralisme et fascisme.
Cela dit, je ne peux m'empêcher de penser en même temps aux gens qui ne pourront voter pour le Parti libéral de Trudeau/Carney suite au génocide à Gaza, au projet du pipeline Trans Mountain, et à certaines mesures liberticides que ce gouvernement a mis en place pendant la pandémie.
Le problème principal est que les anti-Trudeau iront se jeter dans les bras de Poilievre (ou encore Maxime Bernier), croyant se battre contre l'autoritarisme et l'oligarchie, sans réaliser qu'ils voteront du même coup pour une version encore pire et autoritaire de cette oligarchie, convergeant avec le délire trumpiste.
Et les gens qui ne veulent ni Trudeau ni Poilievre, espérant un Canada plus progressiste (NPD, Verts) et/ou un Québec indépendant (Bloc), chercheront à obtenir vos votes dans les prochaines semaines, sans avoir une chance réelle de prendre le pouvoir. En termes plus simples, le système politique canadien me semble complètement bloqué.
***
Acte III : Résistons encore
Je ne souhaite pas ici convaincre qui que ce soit pour qui voter, ni même de voter. Mais l'important reste à mes yeux cette donnée fondamentale : ni sous Poilievre, ni sous Carney, nos communautés et nos territoires seront en sécurité. L'un accélère l'annexion du Canada aux États-Unis, l'autre propose d'y mettre un frein par une vassalisation économique du Canada au service de l'oligarchie américaine, canadienne et mondiale.
Dans les deux cas, on aura besoin d'une vigilance extrême, de mouvements sociaux combatifs, d'autonomie collective, de résilience, de réseaux d'entraide locaux, de groupes de résistances clandestins, de luttes territoriales contre l'extractivisme, d'une démocratie forte et vivante à l'échelon municipal et régional. On aura aussi besoin de rebâtir un internationalisme radical, et s'inspirer de luttes de libération nationale qui se sont effectuées dans un cadre plus large contre l'impérialisme et le colonialisme.
Une pseudo-indépendance à la Trump ne fonctionnera pas, ni au Canada ni au Québec. À l'inverse, une belle gouvernance néolibérale du statu quo version Mark Carney ne fera que nous enfoncer dans une impasse, par une prolongation du Canada tel qu'il a existé mais qui ne peut plus durer.
Il faut raviver la gauche et le mouvement écologiste certes, cela ne sera pas d'abord par les urnes. Il faudra dynamiser les mobilisations citoyennes et les solidarités partout, au-delà des cadres établis des partis politiques, trop souvent englués dans leur calendrier électoral et restreint.
Voilà l'esprit des Mères au Front, qui s'incarne aussi dans d'autres mouvements qui prennent forment au Québec comme ailleurs : les Soulèvements du Fleuve, Multitudes, Stand Up For Science, les actions directes contre les concessionnaires Tesla, le mouvement 50501 (50 protests, 50 states, 1 movement), les luttes pour la libération palestinienne, la solidarité avec l'Ukraine, Black Lives Mater, le mouvement féministe, LGBTQ+, et d'autres expressions du mouvement pour la justice climatique.
La transformation sociale passe avant tout par ce changement clair de nos consciences et de cet appel décomplexé à l'action directe, à l'amour, à la rage et à l'espoir qui se ne contente plus d'un sauveur de gauche, du centre ou de droite : résistons ensemble pour la suite du monde.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Autonomie politique

En complément pour la campagne fédérale actuelle, j'aimerais amené tout d'abord quelques éléments concrets sur l'articulation et l'alliance politique existant entre les branches provinciales du NPD hors-Québec et le NPD fédéral.
Par Guillaume Manningham, proléterre de la ruracité
1) Sur la Palestine, je salue le courage politique de l'ex-députée ontarienne d'Hamilton-Centre au provincial, Sarah Jama. Le NPD fédéral a pris du temps à prendre position clairement contre l'armement et le soutien politique à la machine coloniale israélienne. Il n'a pas fait de l'enjeu du soutien historique canadien à la colonisation et l'occupation des terres du peuple palestinien de la part du gouvernement fédéral libéral un enjeu qui aurait au minimum mérité un vote de confiance. Et donc de « risquer » d'aller en élections dû à l'arrêt du support néodémocrate au gouvernement libéral depuis 2021. Encore une fois, les gains sociaux partiels comme l'assurance-dentaire ont pesé plus que la place de l'anticolonialisme, de l'anti-impérialisme et de l'antimilitarisme au NPD comme chez une grande majorité de partis sociaux-démocrates du Nord global. Et ce, depuis trop longtemps.
Sarah Jama a pris position le 10 octobre en déclarant son appui à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'à la fin de toute occupation des terres palestiniennes. Elle affirme alors avec justesse que la violence et les représailles enracinées dans le colonialisme de peuplement ont coûté la vie à beaucoup trop d'innocents. Elle a qualifié la situation dans les territoires palestiniens occupés comme un apartheid, soit un régime politique qui donne délibérément et clairement la priorité aux droits politiques, juridiques et sociaux fondamentaux d'un groupe plutôt qu'à un autre au sein de la même unité géographique sur la base de l'identité raciale, nationale et ethnique de chacun. Elle citait ainsi les travaux du rapporteur spécial de l'ONU Michael Lynk en 2022.
Face à sa prise de parole rapide, courageuse et juste, qui allait à contre-courant du vent médiatique et politique, elle a dû faire face le 23 octobre à une motion de censure du gouvernement « progressiste »-conservateur de Doug Ford. La motion demandait au président de l'Assemblée législative de ne pas reconnaître la présence de la députée en Chambre tant qu'elle n'aura pas retiré officiellement ses propos et qu'elle ne se sera pas excusée à nouveau. Doug Ford a soutenu qu'elle était antisémite depuis longtemps et qu'elle appuyait le viol et le meurtre de juifs innocents.
Surtout, au même moment et s'écrasant sous la pression dans un moment historique critique pour la Palestine, la cheffe du NPD en Ontario, Marit Stiles, a annoncé l'expulsion de Sarah Jama du caucus néo-démocrate ! Elle sera à partir de là députée indépendante et elle se présentera indépendante lors des dernières élections ontariennes recevant 14,9% des votes exprimés, soit près de 5000 votes. Face à l'expulsion du caucus de Marit Stiles, Anthony Marco, président du Conseil du travail de Hamilton et du district, a déclaré que le NPD pouvait considérer sa carte de membre comme révoquée. Fred Hahn, président du Syndicat canadien de la fonction publique, a décrit une journée très triste. Pour lui, l'élue est une voix nécessaire et fortement soutenue. Il s'agissait d'une décision profondément troublante et extrêmement dangereuse, a-t-il déclaré. À ma connaissance, tout le caucus du NPD fédéral n'a pas supporté Sarah Jama à ce moment critique et son silence était complice de branche ontarienne. Pourtant, c'est de plusieurs Sara Jama qu'on aurait besoin comme voix des luttes de libération. Et non des Marit Stiles prête à gouverner le système capitaliste et ses horreurs avec de légères mesures de redistribution du butin impérialiste et colonial à l'interne.
2) Le NPD est au pouvoir depuis 2017 en Colombie-Britannique. D'abord minoritaire et soutenu par le Parti Vert jusqu'aux élections anticipées de 2020 où il est devenu majoritaire avec le premier ministre John Horgan. Est-ce qu'on se souvient de la lutte de défense du territoire Wet'suwet'en contre le gazoduc de CGL traversant leur territoire ancestral de 22 000km2 ? Cela a aboutit à 75 personnes arrêtées à GRC en 2019, 2020 et 2021 en plus d'un harcèlement et des menaces constantes. Le NPD a toujours soutenu ce gazoduc colonial et destructeur et a été complice de la répression et du colonialisme qui se poursuit. Malgré que c'est la première province canadienne a avoir signé en 2019 la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le consentement préalable, libre et éclairé des communautés et de leur gouvernance sur les terres ancestrales non-cédées a été bafoué malgré la Convention 169 sur les peuples autochtones et tribaux de l'Organisation internationale du travail, Convention que le Canada en 2025 n'a toujours pas adopté...et encore moins respecté !
En 2021, John Horgan souffre d'un cancer sévère et doit se retirer avant la fin de son second séjour au pouvoir et une course à la chefferie néodémocrate est déclenchée. Course qui mènera la personne qui gagne au poste ultime de PM. À ce moment, des groupes écologistes de base opposés aux projets capitalistes, patriarcaux, coloniaux extractivistes comme le gazoduc de CGL décident de présenter Anjali Appadurai, une candidate extra-parlementaire qui s'était présentée aux élections pour le NPD en 2020 et avait été défaite. La campagne revigore le membership de base du NPD. Mais cet esprit politique grassroots c'est une menace au train-train quotidien de l'appareil au pouvoir. Un rapport d'Elizabeth Cull, la directrice générale des élections à la direction du NPD, soutient que « Mme Appadurai s'est livrée à une conduite inappropriée grave en travaillant avec des organismes tiers du milieu environnemental pour mener des campagnes d'adhésion en son nom ». Et le NPD de la Colombie-Britannique décide de disqualifier Anjali Appadurai et l'ancien procureur général et ministre David Eby devient l'unique candidat à la direction du parti au pouvoir. Il aura une majorité renouvelée de justesse aux élections de 2024.
C'est un jour triste pour la démocratie, a déclaré Sonia Furstenau, chef du Parti vert lors du couronnement de David Eby. « La campagne de Mme Appadurai a parlé franchement des recoupements entre les soins de santé, le climat et la crise du coût de la vie [...] et de l'échec du gouvernement en place pour faire avancer ces dossiers. Il n'est pas surprenant qu'autant de gens aient été inspirés par son message. »
Le président du Parti vert, Adam Olsen a déclaré : « Le parti au pouvoir en Colombie-Britannique a ouvert la voie pour que le candidat qu'il a choisi puisse s'installer sans obstacle au plus haut poste de la province. David Eby mènera un gouvernement qui a étouffé les critiques et l'obligation de rendre des comptes en limitant et, même parfois, en empêchant l'accès à l'information. »
J'ai cherché du soutien de la part de député.es du NPD au fédéral ou une déclaration de Jagmeet Singh sur ce coup aux militan.tes de base et je n'ai rien trouvé. J'ai seulement trouvé un appui enthousiasme de M. Singh à David Eby et au NPD provincial dans la campagne de 2024. Comme si ce gouvernement n'était pas concrètement un acteur de la dépossession des communautés autochtones, de la destruction environnemental et de la répression face aux protections des forêts, des lacs, de l'océan et de freiner les changements climatiques. Pourquoi valider le NPD fédéral et espérer qu'il forme un gouvernement au fédéral un jour serait différent ?
En Colombie-Britannique, il existe des portes tournantes entre les compagnies privées et le NPD y compris au niveau des compagnies d'énergie fossile et des minières. Le lobbying au bureau d'Eby et ses ministres est payant pour ces compagnies. Actuellement, Énergie Est et GNL Québec sont très loin d'être de retour avec des compagnies privées prêtent à investir des dizaines de milliards. Tandis que le gouvernement du NPD facilite actuellement l'examen environnemental et le processus décisionnel de dizaines de projets extractivistes dont une mine d'or dans le lot parmi d'autres minéraux critiques (intouchables ?) prétendus nécessaire à la transition énergétique, au développement durable et à la réconciliation avec les Premières Nations...
De nouveaux gazoducs pour exporter du gaz liquéfié comme celui de Prince Rupert (PRGT) sont en chantier ou le seront très bientôt. Et ce, après les canicules, sécheresses, inondations et feux de forêt catastrophiques des dernières années dans les communautés de Colombie-Britannique et qui ont tué beaucoup de monde. Quand il a fait 45 degrés à Vancouver en 2021, j'ai mesuré l'ampleur du désastre mortel actuel qui devrait faire en sorte de freiner d'urgence et transformer rapidement notre système de production, distribution et consommation. En plus, dans le contexte du néofascisme US, ce sont des milliardaires états-uniens qui ont acheté le projet de PRGT. Le milliardaire de Wall Street et principal donateur de Donald Trump, Steve Schwarzman, veut accélérer le projet de transport du gaz de Prince Rupert. Pourquoi ? Parce que sa société financière, Blackstone, est maintenant un investisseur majeur dans le projet et peut faire encore plus d'argent.
L'expansion des activités de fracturation hydraulique en Colombie-Britannique, appuyées par les États-Unis aura pour conséquences :
– Augmenter les factures de services publics pour les familles en C.-B.
– Donner plus de contrôle sur nos ressources énergétiques aux États-Unis
– Défier les collectivités le long du tracé du pipeline qui s'opposent au projet
– Détruire l'eau douce, le saumon et les habitats fauniques
– Rendre le changement climatique PIRE (le méthane libéré dans l'atmosphère est pire que la combustion du charbon)
– Retarder la création de bons emplois dans le secteur des énergies renouvelables
Source et infolettre hebdomadaire super pertinente pour les luttes anticoloniales au soi-disant Canada : https://www.dogwoodbc.ca/
******
Je soumet à la réflexion collective le texte plus bas « Pour l'autonomie politique » paru durant la campagne électorale québécoise de 2022 et dont les propositions sont toujours pertinentes pour cette campagne-ci.
Pour l'autonomie politique
Le concours de popularité et de propositions politiques en rafale pour aspirer à gérer le système est sur le point de se terminer. Officiellement nommé élections, ce processus en amène plusieurs à affirmer que c'est LE moment démocratique et même que ce serait notre DEVOIR d'aller voter, peu importe pour qui (!). Souvent cela va jusqu'à dire que si une personne ne vote pas, elle serait privée de la légitimité de s'exprimer et serait politiquement inactive et ignorante. Ça fait pas mal de monde ça. Le taux de participation en 2018 a été le 2e plus bas depuis 1927, soit 66.45%. Et n'oublions pas que le vote est par comté dans un système parlementaire représentatif dont on promet depuis longtemps une réforme du mode de scrutin proportionnel. Comme par hasard, depuis René Lévesque jusqu'à Justin Trudeau et François Legault, toutes ses promesses dans l'opposition se sont évaporées une fois rendues au pouvoir. La CAQ vient de régner sur nous de façon majoritaire, même par décrets, durant 4 ans et ce avec un peu moins de 25% d'appui des personnes inscrites en 2018 !
Ces institutions d'en haut, Parlements et États canadiens et québécois, sont issues du génocide envers les Premiers Peuples qui est toujours en cours faut-il le rappeler. Et « nos » institutions et « nos » États se sont bâties sur la destruction des systèmes de gouvernance qui sont bien plus anciens et légitimes que les conseils de bande. La juridiction et la légitimité de « nos » appareils étatiques au service du monde marchandisé n'ont jamais été décidé démocratiquement. Et par démocratie, j'entends non seulement la majorité populaire, mais peut-être surtout l'auto-détermination et le consentement de tous les peuples qui y vivent depuis des siècles, non pas depuis 1867 ou 1608. Je vous invite à lire Ellen Gabriel, activiste pour les droits humains et environnementaux de la nation Kanien'kehá:ka habitant Kanehsatà:ke près d'Oka dans le territoire qu'on nomme Québec. Son texte écrit l'an dernier avant les élections fédérales est un appel au respect de son droit à ne pas voter dans des institutions coloniales.1 Observons également les Six Nations de la Confédération Haudenosaunee, qui veut dire « peuple des maisons longues ». On y découvrira premièrement un riche système de gouvernance de démocratie participative en lien avec le vivant qui est toujours en cours tandis que moins de 10% des personnes inscrites votent aux élections fédérales canadiennes.
Je crois important de poser le politique en dehors des élections parlementaires et de se rassembler sur nos propres bases politiques autonomes. Que les gens votent ou pas, cela n'est pas central et ne devrait pas nous diviser à coups d'impératif (Allez voter ! Ne votez pas !). La fameuse classe politique protège et défend l'État en affirmant que c'est la seule voie possible de changement et de légitimité démocratique. Cette politique d'en haut c'est celle qui vise à commander le pouvoir d'État, mais peut-être surtout, c'est celle qui considère que les solutions n'ont d'autres chemins et doivent se construire à partir de ou en lien avec les institutions étatiques. Au contraire, la politique d'en bas n'attend rien de ce chemin et des creuses promesses de la classe politique, ni rien à rechercher dans les bureaux du pouvoir. Depuis trop longtemps, l'en bas social se rallie à la politique d'en haut et conçoit l'action politique de façon subordonnée au calendrier électoral et aux partis en présence, à l'opinion publique, aux médias dominants rétrécissant le champ des possibles. Peut-être que la tribune électorale peut servir à des moments choisis, au niveau tactique, pour diffuser un discours et appeler à une pratique autonome d'en bas. Toutefois, cela est assumer clairement dès le départ que ce n'est pas une priorité stratégique et que jamais un.e porte-parole n'aspire à gouverner et être président.e ou PM en chef.fe, ni individuellement ni en tant qu'organisation. Ce serait au contraire un appel à dire que le changement se fera par nous-mêmes, que l'émancipation et la libération seront l'oeuvre des opprimé.es, des exploité.es et de personne d'autre. Dans tous les cas, peu importe le parti élu le 3 octobre, ne comptons que sur nos propres moyens et nos propres luttes pour ouvrir le champ des possibles.
« Pratiquer une démocratie radicale d'autogouvernement et concevoir un mode de construction du commun libéré de la forme État ; démanteler la logique destructrice de l'expansion de la valeur et soumettre les activités productives à des choix de vie qualitatifs et collectivement assumés ; laisser libre cours au temps disponible, à la dé-spécialisation des activités et au foisonnement créatif des subjectivités ; admettre une pluralité des chemins de l'émancipation et créer les conditions d'un véritable échange interculturel : telles sont quelques-unes des pistes qui dessinent les contours d'un anticapitalisme non étatique, non productiviste et non eurocentrique. »
2
Notes
1.Katsi'tsakwas Ellen Gabriel , Respect my right to not vote, Ricochet Media, 14 septembre 2021, https://ricochet.media/en/3776/respect-my-right-to-not-vote
2.Jérôme Baschet, Adieux au capitalisme, Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, 2017.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ressusciter les projets morts

Depuis le 20 janvier, la pléthore d'annonces lancées depuis le bureau ovale a causé tout un émoi. Parmi cette inondation de nouvelles parfois loufoques, souvent menaçantes, la politique du « drill, baby drill » nous démontrait que le lobby des énergies fossiles venait de prendre le pouvoir alors que le rejet de l'Accord de Paris se voulait la négation complète de l'existence des changements climatiques.
De plus, les mauvaises blagues au sujet du « gouverneur du 51e état » ainsi que la proposition d'annexer le canal de Panama et le Groenland laissent présager un Anschluss (annexion de l'Autriche par les nazis en 1938 ) du 21e siècle.
Certes, ces dizaines d'annonces quotidiennes provenant de la Maison-Blanche peuvent donner le vertige. Et il faut réagir ! La « donne politique » a changé du tout au tout depuis janvier. Mais notre réaction doit être logique et rationnelle. Oui, il faut diversifier nos marchés pour ne pas dépendre presqu‘exclusivement de nos exportations aux États-Unis. Malgré l'actuelle tornade trumpienne, notre boussole interne doit toujours maintenir le cap sur la lutte contre les dérèglements climatiques.
Pour diversifier nos exportations, les leaders de 14 compagnies de gaz et de pétrole en profitent pour faire la promotion de nos ressources énergétiques et des pipelines comme la réponse miracle à tous nos problèmes économiques. Dans une lettre adressée à Messieurs Carney, Poilievre, Singh et Blanchet, ces promoteurs des énergies fossiles[1] demandent que l'on déclare une crise canadienne de l'énergie où des projets-clés seraient déclarés être dans « l'intérêt national ». Cette « urgence » permettrait de réduire la réglementation, d'augmenter la production de pétrole et de permettre le début des travaux de projets majeurs en moins de six mois après qu'une demande ait été déposée.[2] Allo, les études d'impacts environnementales !
Plusieurs politiciens s'interrogent ouvertement sur la pertinence de ressusciter l'oléoduc Énergie Est et le gazoduc GNL Québec.[3] Quant à M. Poilievre, qui aspire à devenir Premier ministre lors des prochaines élections, il se lamente du fait que « ...la loi anti-pipeline C-69 est toujours en vigueur… »[4] Depuis deux ans, abolir la taxe carbone a été son mantra. Mais si l'objectif politique du chef conservateur est d'aider le Canada à devenir plus compétitif dans des marchés diversifiés, abolir la taxe carbone pourrait être contreproductif. En effet, l'Union Européenne se prépare à implanter un « mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) », c'est-à-dire un tarif sur les biens qui ont une grosse empreinte carbone.[5]
Dans un communiqué de presse, Équiterre et une centaine d'organisations font remarquer que la résurrection de ces vieux projets n'est qu'un « mirage ». Avec justesse, ils soulignent que « ...la transition socioécologique est la voie à suivre, tant pour assurer la prospérité économique du Québec que pour lutter contre les changements climatiques... »[6] Oui, il faut répondre à une situation politique inusitée, mais temporaire. Bâtir un pipeline géant de 4 600 km, ça prend au moins cinq ans même en coupant les coins ronds. Dans 5 ans, Trump ne sera plus au pouvoir ; mais nous, nous serons pris avec cette patate chaude dispendieuse.
Les promoteurs des énergies fossiles gagnent sur tous les fronts. Aux États-Unis, Trump veut s'enrichir avec le pétrole. Il sort son pays de l'Accord de Paris et éviscère les politiques environnementales. Lee Zeldin, le nouvel administrateur de l'EPA (l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis), explique ainsi cette nouvelle politique sur le site web de l'agence : « ...Nous enfonçons un poignard directement dans le coeur de la religion des changements climatiques pour abaisser les coûts de la vie des Américains, permettre l'épanouissement des énergies américaines… »[7] Tandis qu'au Canada, la réponse des pétrolières, ce serait de construire des infrastructures qui permettront de produire plus de pétrole pendant des décennies.
Pourtant, les scientifiques et le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont unanimes. Il faut réduire nos émissions planétaires de carbone. Le Dr James Hansen nous dit que si nous voulons préserver une planète similaire à ce qui a permis à notre civilisation de s'épanouir, il faudrait réduire la concentration de carbone dans l'atmosphère à 350 ppm. Selon lui, si l'humanité continue à brûler des énergies fossiles au même rythme, « ...la jeune génération sera condamnée à un nettoyage gargantuesque et douteux, ou à un accroissement d'impacts climatiques délétères, ou aux deux…. »[8]
M. Trump et les adorateurs du dieu pétrole ressemblent à une horde de lemmings qui s'élancent, tête baissée, vers le précipice d'une mer appelée changements climatiques. S'ils veulent se noyer, c'est leur choix. Mais ont-ils le droit d'imposer ce suicide collectif à la jeune génération ? Les jeunes, nés après l'an 2000, doivent-ils se contenter de vivre avec la possibilité cauchemardesque de faire face à l'apocalypse de la 6e grande extinction des espèces ? Comme le déplorait la jeune Greta Thunberg au siège de l'ONU en septembre 2019 : « ...Vous avez volé nos rêves avec vos paroles creuses….Les gens souffrent, ils meurent. Des écosystèmes entiers s'effondrent et tout ce dont vous parlez c'est de l'argent et de contes de fées de croissance économique éternelle ! How dare You ?... » (Comment osez-vous ?)[9]
Gérard Montpetit
Membre du CCCPEM
le 24 mars 2025
1] https://www.tcenergy.com/open-letter-to-party-leaders
9] Greta Thunberg par Maëlla Brun édition l'Archipel, 2020, 237 pages. citation à la page 122
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En réponse à Trump, le Canada doit se dissocier de l’armée américaine

Face à la belligérance de Donald Trump, le Canada continue d'aider l'armée et l'industrie de l'armement américaines. En réponse à l'hostilité du président, le Canada devrait annuler le contrat Lockheed Martin F-35, mettre fin aux échanges d'officiers et annuler notre participation au programme de défense antimissile du NORAD.
Tiré de Canadian dimension
21 mars 2025
Récemment, le Premier ministre sortant Justin Trudeau a déclaré que Trump voulait saboter l'économie canadienne dans le but d'annexer ce pays. « Ce qu'il veut, c'est un effondrement total de l'économie canadienne », a déclaré M. Trudeau, “parce que cela facilitera notre annexion”. Par la suite, le New York Times a rapporté que M. Trump avait dit à M. Trudeau qu'il souhaitait redessiner la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.
De nombreuses personnalités des médias canadiens ont réagi aux menaces de Donald Trump en appelant à une forte augmentation des dépenses militaires. Le chroniqueur principal du National Observer, Max Fawcett, a récemment déclaré qu'« il est probablement temps pour le Canada de porter ses dépenses militaires à 5 % du PIB », tandis que le commentateur Dean Blundell a noté que « le Canada doit se réarmer, recruter et signer des accords stratégiques de sécurité dans le monde entier tout en cherchant comment se procurer la bombe [atomique] ». Lors du récent débat sur le leadership libéral, Chrystia Freeland et Karina Gould ont toutes deux critiqué Mark Carney, le vainqueur final, pour ne pas s'être engagé sur leur plan visant à porter les dépenses militaires à 2 % du PIB en deux ans (M. Carney s'était engagé sur cinq ans).
Bien que chacun ait des arguments légèrement différents pour augmenter les dépenses de la défense, il n'y a pas d'argument anti-Trump crédible, nationaliste (canadien), pour stimuler l'armée qui n'inclut pas le découplage de la machine de guerre américaine. Comme je le détaille dans Stand on Guard for Whom : A People's History of the Canadian Military, les forces armées canadiennes agissent comme une extension virtuelle de l'empire américain. Le mois dernier, Justin Massie, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, a déclaré au Devoir : « Nos forces sont conçues comme des blocs Lego qui s'emboîtent les uns dans les autres ». Un bataillon canadien, a-t-il fait remarquer, est conçu pour être inséré dans une brigade américaine ou internationale. Nous disposons d'un échantillon d'armée pour « colmater » les brèches », a ajouté M. Massie.
L'homme qui cherche à annexer le Canada semble être d'accord. Trump a exigé à plusieurs reprises qu'Ottawa augmente ses dépenses militaires et a critiqué le Canada pour sa trop grande dépendance à l'égard des États-Unis en matière de sécurité.
Au lieu de faire écho à l'appel de Trump en augmentant les dépenses militaires d'une force structurée pour aider le Pentagone, les nationalistes canadiens devraient s'opposer au paiement de 19 milliards de dollars au géant américain de l'armement Lockheed Martin pour des avions de chasse afin que l'armée de l'air canadienne puisse être « interopérable » avec son homologue américaine. Les États-Unis contrôlent les mises à jour logicielles et matérielles des F-35 nécessaires à la poursuite de l'exploitation des avions. Par conséquent, certains ont suggéré que les États-Unis auront effectivement un « interrupteur d'arrêt » sur l'achat du Canada, dont le coût est estimé à 70 milliards de dollars sur la durée de vie des avions.
Lors d'une conférence de presse, la semaine dernière, le chef du Bloc Québécois, Yves François-Blanchet, m'a dit qu'il était ouvert à l'annulation de l'accord sur les avions de combat en réponse à la belligérance de Trump. Pour sa part, l'ancien ministre libéral des affaires étrangères, Lloyd Axworthy, a ajouté sa voix à celle d'un nombre croissant de Canadien-nes qui s'expriment sur l'accord relatif aux avions de chasse. Depuis le 11 mars, plus de 4 000 personnes ont envoyé un courriel au nouveau Premier ministre Mark Carney pour lui demander de mettre fin au contrat portant sur les avions offensifs capables de fabriquer des armes nucléaires.
Jusqu'à présent, cependant, le NPD n'est même pas disposé à envisager l'annulation du contrat. Le 25 février, j'ai demandé à Jagmeet Singh s'il était favorable à l'annulation de ce contrat dans le cadre de son plan visant à adopter une ligne dure face à Trump. Le chef du NPD a refusé de répondre directement.
Il ne devrait pas être controversé de reconsidérer une dépense de 19 milliards de dollars en faveur d'un géant militaire américain comme mesure de rétorsion contre le siège économique d'un président annexionniste. L'arrêt du paiement enverrait un message à la plus puissante entreprise d'armement des États-Unis. Elle communiquerait également une position ferme au Pentagone, puisque le Canada a choisi le F-35 principalement pour être plus « interopérable » avec l'armée de l'air américaine.
Selon le ministère de la défense nationale, il existe « 80 accords au niveau du traité, plus de 250 protocoles d'accord et 145 forums bilatéraux sur la défense » entre les armées canadienne et américaine. Ottawa devrait suspendre ou annuler certains de ces accords pour exprimer sa désapprobation face aux menaces commerciales et d'annexion des États-Unis. Dans le cadre de NORAD, le commandant américain de l'accord, basé au Colorado, pourrait déployer des avions de combat canadiens basés dans ce pays sans l'aval exprès du Canada. Au lieu de poursuivre le plan des libéraux visant à dépenser des dizaines de milliards de dollars pour renforcer NORAD, ne devrions-nous pas remettre en question la participation du Canada à l'accord ?
Si se retirer de NORAD est peut-être un pas de trop pour la plupart des politiciens canadiens, il existe une foule de mesures moins controversées et sans coût qu'Ottawa peut adopter pour signifier son mécontentement au Pentagone. Pourquoi ne pas interrompre les échanges d'officiers jusqu'à ce que Trump cesse de menacer le pays d'annexion ? Ou pourquoi ne pas interrompre les essais d'armes américaines au Canada jusqu'à ce que le président mette fin à sa guerre commerciale et à ses menaces de droits de douane ? Ou pourquoi ne pas interrompre les patrouilles navales conjointes dans les océans lointains jusqu'à ce que Trump cesse de qualifier le premier ministre canadien de gouverneur de son 51e État fantaisiste ?
Il n'est pas très logique de rester intégré à l'armée d'un pays hostile dont le président veut annexer le Canada.
Prenez une minute pour demander au nouveau Premier ministre libéral Mark Carney de mettre fin à ses projets d'achat de F-35.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Élections fédérales 2025 Campagne « Je vote PRO-CHOIX »

Le 23 mars 2025, le gouvernement a déclenché la prochaine campagne électorale fédérale. La population canadienne votera le 28 avril 2025, et la FQPN souhaite mobiliser ses membres et partenaires pour le droit à l'avortement.
Tiré du site web et du guide Je vote pro choix
Dans le climat politique actuel, il est primordial que le droit de choisir l'avortement soit une priorité électorale pour toustes.
Depuis la décriminalisation de l'avortement en 1988, il y a eu 50 projets de loi ou motions pour restreindre le droit à l'avortement au gouvernement fédéral. Le plus récent projet de loi, C-311, remonte à seulement 2023, et 100% des élus conservateurs ont voté en faveur de cette loi.
Nous avons le pouvoir de choisir un gouvernement qui s'engage à défendre le droit fondamental de chacun.e de disposer de son corps.
Dans la semaine précédant le jour de scrutin, la FQPN publiera une liste des candidat.es qui s'engagent à voter contre tout projet de loi anti-choix. Si vous souhaitez participer à la mobilisation dans votre région, contactez info@fqpn.qc.ca.
***
La Fédération du Québec pour le planning des naissances adopte des positions pro-choix dans une perspective de justice reproductive. Cela signifie que notre organisation prend une posture politique féministe de transformation sociale et de lutte aux oppressions. Nous nous opposons
ouvertement à toute politique, projet de loi ou programme qui ne garantissent pas la liberté des femmes, des hommes trans, des personnes non-binaires, bispirituelles ou intersexes de disposer de leur corps. Toutefois, nous ne favorisons aucun parti politique en particulier. À vous de
faire la part des choses. Nous invitons toutes les personnes à aller rencontrer leur candidat·es, à les questionner et à vérifier leurs plateformes politiques pour s'assurer que celles-ci sont en accord avec leurs valeurs pro-choix. Ce document peut être reproduit de façon partielle ou complète à la condition de mentionner la source.
C'est quoi être pro-choix ?
Les groupes pro-choix sont des organisations qui militent pour la défense du droit des femmes, des hommes trans, des personnes non-binaires, bispirituelles et intersexes de disposer de leur corps. Les groupes pro-choix font la promotion du libre choix lorsqu'une personne vit une grossesse. Ces groupes présentent toutes les options sur un pied d'égalité, soit la poursuite de la grossesse en vue de devenir parent, la poursuite de la grossesse en vue d'avoir
recours à l'adoption ou l'interruption de la grossesse.
Concrètement, être pro-choix c'est :
· faire confiance aux femmes et aux personnes enceintes qu'elles sont capables et autonomes de prendre la meilleure décision pour elles-mêmes à ce moment de leur vie ;
· une décision prise par soi-même en cohérence avec ses valeurs, ses croyances et son vécu ;
· un pouvoir d'agir sur sa propre vie ;
· un choix fait de façon libre et éclairée. Pour ce faire, il faut disposer des bonnes informations et ne subir aucune pression ;
· être pour la vie ! Pour une vie de qualité dans des conditions décentes et privilégier la vie des femmes, des hommes trans, des personnes non-binaires, bispirituelles et intersexes ;
· être contre le contrôle du corps des femmes ;
· s'opposer au système patriarcal.
On ne peut pas dissocier le libre choix et la justice reproductive des luttes sociales qui entourent les services en santé sexuelle et reproductive gratuits et accessibles, les programmes sociaux inclusifs et un filet social fort qui réduit les inégalités et permet de jouir pleinement de
notre citoyenneté !
De tout temps, des femmes, des hommes trans, des personnes non binaires, bispirituelles et intersexes ont décidé d'interrompre leur grossesse, souvent au péril de leur vie. Et cela pour plusieurs raisons, principalement :
· ne veulent pas d'enfant
· n'en veulent pas à ce moment de leur vie
· n'en veulent pas un autre
· n'en veulent pas avec ce partenaire
· n'en veulent pas dans la pauvreté
· n'en veulent pas à la suite d'une agression sexuelle
· ne veulent pas élever un enfant dans le monde actuel
· n'importe quelle autre raison qui lui est propre.
Le contrôle du corps des femmes
Dans les sociétés patriarcales, le pouvoir des hommes sur les femmes, les hommes trans, les personnes non-binaires, bispirituelles et intersexes s'exerce principalement en contrôlant leurs corps. Ce contrôle peut prendre plusieurs formes, par exemple :
· violence conjugale, harcèlement, viol, inceste, agression
sexuelle, traffic sexuel, féminicide ;
· mutilation génitale, crime d'honneur, mariage forcé ;
· contrôle médical de la vie reproductive : contraception, grossesse, accouchement, ménopause, stérilisation forcée ;
· la mode, les standards de beauté, la chirurgie esthétique.
L'interdiction et la criminalisation de l'avortement est un des moyens de contrôler le corps et la vie d'une autre personne. Ses impacts sur la santé physique et mentale sont considérables et ont des conséquences sur l'ensemble de la société. L'avortement est encore une fois utlilisé
comme outil politique d'oppression.
La glorification de la maternité
Aujourd'hui encore, l'identité associée au genre féminin repose en grande partie sur la glorification de la maternité. La maternité est associée à la « nature biologique » de la féminité. Le fameux « instinct maternel ». Les femmes sans enfants devraient se sentir incomplètes.
Il est tout à fait normal de ne pas avoir le désir d'avoir des enfants, de porter des enfants ou de devenir parent. Avorter, c'est refuser la maternité obligatoire, c'est prendre la décision de désobéir à une pression sociale. Le silence et la honte entourant le choix de la non- maternité doivent cesser.
D'un côté le mouvement anti-choix associe souvent, à tort, l'avortement à un acte dangereux ou égoïste. Alors que de l'autre côté, il n'est aucunement fait mention des conséquences physiques et psychologiques d'une grossesse menée à terme. D'ailleurs, l'annonce d'une grossesse
est parfois un élément déclencheur à l'apparition ou l'aggravation de violences conjugales ou de contrôle coercitif.
Chaque personne a son histoire, son vécu, ses raisons.
Cette décision lui appartient et est valable !
Gouvernement minoritaire
La politique canadienne en bref
Citoyen·nes → Député·es → Lois
Notre démocratie
Le Canada utilise une manière de fonctionner qui se nomme la démocratie représentative. Ce type de démocratie demande aux citoyen·nes d'élire des personnes représentantes (député·es) qui seront appelées à défendre leurs intérêts à la Chambre des communes. Le pays est divisé en 343 circonscriptions. Votre député·e est donc choisi·e en fonction du lieu où vous résidez. Le parti qui fait élire le plus de député·es se retrouve donc avec le pouvoir. Le deuxième parti qui a le
plus de député·es formera l'opposition officielle.
La Chambre des communes
L'ensemble des député·es élu·es siège à la Chambre des communes. C'est là que tous les projets de loi sont proposés, discutés et votés. Tous les député·es peuvent déposer des projets de loi, ou des motions indépendamment de leur allégeance politique.
Gouvernement majoritaire
Un gouvernement est considéré majoritaire lorsque son nombre de député·es représente plus de 50% des 343 circonscriptions (172 députés et plus). Si tous les député·es de son parti s'entendent pour voter une loi, un gouvernement majoritaire n'a pas besoin de négocier avec les partis d'opposition pour faire adopter des lois.
Un gouvernement est considéré minoritaire si le parti avec le plus grand nombre de député·es fait élire moins de 50% des député·es à la Chambre des communes (moins de 172 député·es). Pour être capable de faire voter des lois, un gouvernement minoritaire doit négocier avec
les partis d'opposition afin d'obtenir plus de 50% des voix à la Chambre des communes.
La question de l'avortement aux élections
Pourquoi on parle d'avortement en contexte de campagne électorale fédérale ?
Il est important de noter que l'avortement était considéré comme un acte criminel jusqu'en 1988. Il a été décriminalisé dans un jugement de la Cour suprême du Canada. Les personnes qui avaient recours à l'avortement et les personnes qui les pratiquaient étaient passibles
d'une peine d'emprisonnement.
Le mouvement anti-choix1 s'est mobilisé dans les 35 dernières années afin de faire reculer le droit à l'avortement durement gagné par le mouvement féministe. Que ce soit en diffusant de l'information mensongère, par l'ouverture de centres « d'aide à la grossesse » qui orientent systématiquement les femmes vers la poursuite de la grossesse ou en s'assurant de présenter des candidat·es anti-choix dans le plus de circonscriptions possibles. Le mouvement anti-choix
est encore bien présent au Canada.
Depuis 1988, de nombreux·ses élu·es ont déposé des projets de loi visant à recriminaliser ou restreindre le droit des femmes de choisir. À ce jour, 50 projets de loi ou motion ont été déposés, heureusement, aucun n'a été adopté.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La signification du départ de Gabriel Nadeau-Dubois

Huit ans après avoir pris les rênes du parti, GND laisse derrière lui une formation moribonde, presque impossible à distinguer du PQ, et qui traîne en cinquième place des sondages. C'est l'expression de la faillite du réformisme de gauche en général.
Tiré de : https://www.marxiste.qc.ca/article/la-signification-du-depart-de-gabriel-nadeau-dubois
ven. 21 mars 2025
photo Crédit : André Querry / Flickr
Une époque prend fin : Gabriel Nadeau-Dubois a annoncé sa démission comme porte-parole de Québec solidaire, « usé » par les critiques au sein du parti à son endroit depuis deux ans.
Huit ans après avoir pris les rênes du parti, GND laisse derrière lui une formation moribonde, presque impossible à distinguer du PQ, et qui traîne en cinquième place des sondages. C'est l'expression de la faillite du réformisme de gauche en général.
La contradiction chez QS
Bien des gens seront tentés de blâmer GND en tant qu'individu pour les déboires de QS. Il a certes joué un rôle central dans la stagnation du parti et l'effritement de sa base de membres. Mais le problème est beaucoup plus profond qu'un seul individu.
QS a toujours été une formation contradictoire. L'impulsion ayant donné naissance à QS en 2006 était le rejet du tournant austéritaire du PQ dans les années 90 et 2000, une humeur anticapitaliste grandissante dans un contexte de mobilisations de masse (mouvement anti-mondialisation, grève étudiante de 2005).
Les partis sociaux-démocrates au Canada et ailleurs tournaient à droite, et QS s'inscrivait à contre-courant de cette tendance. En 2009, le parti adoptait même un manifeste qui parlait ouvertement de dépasser le capitalisme.
Mais en même temps, la direction du parti tend à plier sous la pression de l'establishment capitaliste, qui pousse toute formation de gauche à abandonner ses prétentions « radicales ».
C'est cette contradiction qui explique les conflits des dernières années.
Déjà à l'époque de Françoise David et Amir Khadir, la tendance à la modération était bien présente. En 2014, David disait que « l'idéalisme c'est bien, mais à un moment donné il faut entrer dans le réel. […] Nous sommes des idéalistes pratiques. »
Plus clairement encore, en 2016, Khadir affirmait : « Nous réalisons qu'il y a des obstacles importants devant nous, il y avait la perception (au début) que nous étions radicaux. En fait, nous sommes réformistes. Nous sommes à l'Assemblée nationale car nous acceptons le principe de réforme. »
L'arrivée de GND à la tête de QS était la continuation et l'approfondissement du tournant ouvertement réformiste. Mais contrairement à Françoise et Amir, la clique autour de GND a mené une lutte tant ouverte que larvée contre tout ce qui représentait les racines anticapitalistes de QS.
Contre-révolution tranquille
Depuis ses tout débuts, GND a mené une lutte contre la base du parti. Sur toutes les questions fondamentales, il était à la droite du membership, visant à modérer le programme et le discours du parti.
En 2017, GND et sa clique soutenaient l'idée des « alliances stratégiques » avec le PQ pour supposément lutter contre les libéraux et la CAQ. Cela avait été rejeté par le congrès de mai de cette année-là.
En 2019, un conflit avait lieu à propos du « débat » sur les signes religieux. La direction avait imposé depuis des années le « compromis » d'interdire les signes religieux « seulement » pour les policiers, juges et gardiens de prison. Contre l'avis de GND, le membership a voté pour renverser cette position et s'opposer à toute interdiction de signes religieux pour les emplois publics.
Le congrès de novembre 2021 a marqué un autre tournant. Le parti a alors rejeté son engagement envers la gratuité scolaire dans un premier mandat. Les députés s'étaient également mobilisés contre toute une série de propositions anticapitalistes.
Renaud Poirier-St-Pierre, employé pour le cabinet de GND, avait bien résumé le congrès sur X : « Beaucoup de changements au congrès de @QuebecSolidaire. Les propositions moins terre à terre sont rejetées, dont plusieurs nationalisations. On ne voyait pas ça avant. »
À cela s'ajoute le fait que la direction a tassé Catherine Dorion, la seule députée qui se moquait de l'establishment, malgré sa grande popularité. Le départ de la co-porte-parole Émilise Lessard-Therrien, partie en mai dernier en dénonçant « les habituels compromis, les calculs d'image et les indicateurs de votes » et un parti « à la remorque de ce qui est “gagnable” à court terme », a simplement confirmé le conflit au sein du parti.
GND représente la quintessence du réformisme parlementaire allergique à tout ce qui le fait paraître « radical », pas assez « terre à terre ». Il a représenté depuis huit ans, plus clairement que quiconque, l'aile de QS qui souhaite modérer le parti et le rendre acceptable aux yeux de l'establishment.
Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, l'a peut-être exprimé mieux que quiconque : « Un célèbre proverbe attribué à Churchill dit que si tu n'es pas socialiste à 20 ans, t'as pas de cœur, mais si t'es pas rendu capitaliste à 40 ans, t'as pas de tête. Son récent virage “pragmatique” à ses 34 ans et sa démission d'aujourd'hui me donnent confiance en l'avenir… » Si Duhaime se réjouit, c'est qu'il y a un problème.
L'impression est que QS regarde toujours au-dessus de son épaule, cherchant à s'assurer que son « image » sera bonne auprès de l'establishment politique et médiatique. On croirait que les responsables des communications et les dirigeants ont une peur bleue d'une chronique négative dans le Journal de Montréal.
L'épisode du serment au roi en 2022 est un exemple parfait de leur peur viscérale de l'opinion publique bourgeoise. Alors que le PQ prenait la seule position de principe, soit de refuser de prêter serment, les députés de QS prêtaient serment et retournaient à l'Assemblée nationale, laissant ainsi au PQ l'honneur d'avoir tenu son bout.
Les résultats sont clairs. Alors que la CAQ est de plus en plus discréditée, c'est le PQ qui en profite. QS est perçu comme un parti qui n'a pas de colonne, ne propose rien de différent du PQ et même des autres partis. Dans ce processus, GND a réussi à démoraliser la base militante, sans rien obtenir en retour.
Et le tout a été fait de manière totalement malhonnête. C'est seulement en 2024 que GND a parlé ouvertement d'une différence politique au sein du parti, après le départ d'Émilise Lessard-Therrien.
Il l'a exprimé à nouveau hier en entrevue, affirmant que le débat n'était pas fini : « Un parti de contestation ou un parti qui, à court terme, se donne un plan de marche pour former un gouvernement et améliorer la vie du monde ordinaire. Mais cette question-là n'est pas résolue encore. » Nous reviendrons plus loin sur cette fausse dichotomie.
Il convient de mentionner que face à cette véritable contre-révolution tranquille dans QS, la gauche du parti n'a pas mené la bataille. Tandis que les membres organisés autour de La Riposte socialiste (devenu le PCR) dénonçaient la direction prise par GND et ses amis, nous nous faisions dire par ces gens de cesser de brasser la cage. La direction de QS a ainsi pu mener ses attaques contre les racines radicales du parti presque sans opposition.
Résultat, QS a effectivement été complètement transformé par GND. Bien des militants ont ensuite simplement quitté le navire en silence.
Un processus mondial
L'échec de GND n'est pas une question de faillite personnelle, et ce n'est pas un phénomène propre à QS seulement. Il s'agit en fait d'un reflet de la crise du réformisme partout dans le monde.
Au fédéral, le NPD a depuis longtemps abandonné tout langage socialiste, a perdu toute pertinence, et est pratiquement impossible à distinguer des libéraux.
Aux États-Unis, le « socialiste » Bernie Sanders – rendu énormément populaire en 2016 par son appel à une « révolution contre les milliardaires » – s'est accroché de toutes ses forces à Joe Biden et Kamala Harris, laissant à Trump l'espace pour gagner une portion importante de la classe ouvrière à sa démagogie anti-establishment.
En pleine crise du capitalisme, alors qu'une colère sourde gronde et que les institutions du statu quo capitaliste (parlement, tribunaux, médias, universités, etc.) sont discréditées et rejetées par un nombre grandissant de gens, les partis « de gauche » s'y accrochent de plus belle. Ils pensent ainsi être raisonnables, « pragmatiques », modérés.
Et donc partout, ils stagnent, et laissent le champ libre à la droite populiste qui peut ainsi canaliser la colère des travailleurs et se présenter comme une force anti-establishment.
Alors que la « gauche » a peur de son ombre et se plie à toutes les conventions, la droite populiste à-la-Trump n'a que mépris pour les médias, les institutions, le décorum – et c'est ce qui la rend populaire auprès d'une couche des travailleurs écoeurés du statu quo.
GND se présente comme le défenseur du pragmatisme qui permettra à QS de former le gouvernement, au lieu d'être un « parti de contestation ». L'ironie est que jamais QS n'a été aussi loin de former un gouvernement. GND invoque la nécessité « d'écouter les gens », quand en réalité, c'est de l'opinion publique véhiculée par les médias et les politiciens dont il se soucie. En réalité, GND et sa bande sont incapables de voir que d'adopter un clair discours anti-establishment, de s'adresser à la classe ouvrière et dénoncer le capitalisme – en d'autres mots, adopter une approche de classe – est précisément ce qui amènerait QS à gagner en popularité auprès des travailleurs.
La faillite de GND est l'expression de la lâcheté du réformisme de gauche en général, incapable d'envisager sérieusement de rompre avec le capitalisme et ses institutions.
Sortir du cul-de-sac
L'avenir de QS est incertain. Le départ de GND ne fait qu'exposer davantage au grand jour le cul-de-sac dans lequel se trouve le parti. Mais cet état lamentable n'est pas le fait d'une seule personnalité.
C'est l'ensemble du leadership de QS qui évite comme la peste de dénoncer le capitalisme et a accepté et aidé le tournant vers la modération. Rien ne changera avec Ruba Ghazal comme principale tête d'affiche du parti.
Il faut changer de cap. La classe ouvrière et la jeunesse du Québec ont besoin d'un parti qui prend une approche de classe sans compromis. Il faut un parti qui n'ait aucune peur de mépriser l'establishment et d'attaquer le capitalisme. Il faut un parti qui défend un véritable programme socialiste.
GND s'est dit « usé ». Nous, communistes, débordons d'énergie et d'optimisme. La crise du système capitaliste pousse des millions de gens partout dans le monde à chercher une issue. C'est la gauche réformiste qui est incapable de fournir une solution de rechange.
C'est pourquoi nous disons à tous les solidaires déçus, aux jeunes et aux travailleurs qui n'en peuvent plus de vivre dans une société capitaliste qui n'apporte que crise du logement, inflation, instabilité, chômage : travaillons à renverser le système capitaliste.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Message à Ruba

Suite à l'annonce de la démission de Gabriel Nadeau-Dubois (GND) comme Co-porte-parole masculin de Québec Solidaire (QS), qui elle-même s'inscrit dans la tourmente vécue par le parti depuis le printemps 2024, il serait important de connaître la position et les intentions de Ruba Gazal concernant cette polémique soulevée par les propos de GND sur le « pragmatisme », le « parti de gouvernement », la « modernisation » et autres déclarations intempestives qui furent vécues comme une douche froide, pour ne pas dire un « détournement de programme », par une bonne partie des militants de QS.
Pour ma part (je l'ai déjà précisé dans des messages précédents destinés aux instances du Parti et publiés dans le site de Presse-toi à gauche !), ces sorties médiatiques donnaient tous les signes de la précipitation, de l'improvisation, d'une impulsivité mal contrôlée de la part d'un leader qui ne sait plus où donner de la tête, à cours de solutions ou de stratégies devant l'indifférence généralisée à l'Assemblée Nationale sur les enjeux de l'heure, urgents et cruciaux, comme la crise climatique, la crise du logement, la xénophobie grimpante (même dans les institutions « libérales »), le pouvoir hégémonique de l'argent sur la démocratie, la montée de l'extrême-droite, etc. D'ailleurs, dans sa lettre envoyée aux membres via le site de QS (relayée par les médias), GND se dit « fatigué » et avoue être dépassé par la situation, à la fois à l'interne (divergences entre l'aile parlementaire et la base militante) et à l'externe (Parlement, société civile, etc.)
Dans un court article publié dans Le Devoir dernièrement (21 mars), Amir Kadir a eu des mots très justes pour décrire l'événement et sa portée à moyen ou long terme pour QS : d'abord, il a félicité GND pour son geste « courageux » ; plutôt que de s'accrocher au pouvoir de façon orgueilleuse (comme on le voit souvent un peu partout dans les partis politiques traditionnels), il s'est montré sage et consciencieux en remettant sa démission, à la fois pour le bien du parti et pour l'intéressé lui-même (il est tout d'abord un « homme » ― conjoint, père de famille ― avant que d'être un député au service du « Peuple »).
Ensuite, Amir a remis les pendules à l'heure : dans le contexte actuel d'hyper-capitalisme où la voracité des géants de la finance, des multinationales, des propriétaires des moyens de production et des détenteurs de capitaux ne semble plus avoir aucune limite (les velléités décomplexées d'appropriation tous azimuts de Donald Trump en est la preuve la plus évidente), il serait illusoire de croire que seul un changement d'administration publique (la voie parlementaire qu'a choisie, entre autre, QS) pourrait freiner cette tendance autodestructrice du néolibéralisme. Comme l'Histoire l'a démontré à plusieurs occasions, les changements (politiques, sociaux, culturels, économiques) importants ont été rendus possibles par une mobilisation citoyenne d'envergure, relayée par les Institutions (même les plus « bourgeoises » d'entre elles) qui, en retour, peuvent également contribuer à accélérer le processus de « réforme », voire (n'ayons pas peur des mots) le processus « révolutionnaire ».
Ceci dit, cette remarque de l'ancien porte-parole solidaire concerne aussi, et en premier lieu, QS qui s'est définie depuis le début comme étant un parti « des urnes et de la rue ». Pour rester fidèle à ce leitmotiv fondateur, il faut s'assurer que cette dialectique, ce va-et-vient permanent entre les deux aspects d'une politique de nature « progressiste » (l'aspect « officiel » ― les urnes ― et l'aspect « informel » ― la rue), puisse s'opérer de façon efficace et en toute liberté. Or, il faut reconnaître que depuis les résultats « mitigés » qu'a connus le parti aux dernières élections (2022), ce qui explique aussi, du moins en partie, ces derniers, le pendule a eu tendance à s'accrocher du côté de l'aspect « officiel » du processus, délaissant l'autre aspect, « informel », qui pourtant est à la base et la raison d'être même de QS, d'où la polémique à laquelle je faisais référence plus haut.
Il ne s'agit pas de jeter l'anathème et de s'enfermer, réciproquement, dans des positions irréconciliables, chacune des parties reprochant à l'autre, soit son manque d'ancrage dans les mouvements sociaux, soit son idéalisme et son manque de réalisme eu égard à la réalité « vécue » par l'aile parlementaire, toujours coincée, pour ainsi dire, entre le marteau et l'enclume. D'une part, on peut comprendre la difficulté de résister aux sirènes du parlementarisme et des stratégies politico-médiatiques qui se concentrent sur l'atteinte de résultats à court terme, les yeux fixés sur l'échéance électorale, forçant la députation à mettre constamment en sourdine des pans entiers du programme sous le prétexte, fallacieux s'il en est un, déjà maintes fois ressassé dans notre passé récent, que les Québécois(es) ne sont pas « prêts » (pas « prêts » pour l'Indépendance, pas « prêts » pour élire un parti de gauche, pas « prêts » pour affronter la crise climatique, pas « prêts » pour remettre en question leur mode de vie, pas « prêts » pour adopter d'autres modes de consommation, etc.) D'autre part, la base militante, au plus près des effets dévastateurs des politiques anti-sociales préconisées et appliquées par les différents partis « de gouvernement » (au service d'une bourgeoisie toujours plus « déconnectée » des besoins « réels » de la population), s'inquiète du recentrage opéré par le caucus parlementaire qui ne représente, somme toute, qu'une minorité à l'intérieur de QS, même si elle fut « élue » (donc représentante légitime du « Peuple »), leur donnant ainsi les outils nécessaires pour œuvrer en toute « légalité » à l'intérieur des Institutions démocratiques.
Les récentes démissions (GND, Émilise Lessard-Therrien), les témoignages (Catherine Dorion), la stagnation des intentions de vote pour QS sont l'occasion de revenir aux fondamentaux, de faire un bilan des dernières stratégies électorales, des désaccords qui ont émergé au printemps dernier, bref de faire le point sur la situation (idéologique, politique, électorale, stratégique) « réelle » du parti, afin de mieux s'orienter pour la suite, c'est-à-dire pour le reste du mandat de Legault qui va vraisemblablement être remercié par l'électorat pour ses « précieux » services rendus à la population : par exemple, quelle position adoptée face à un possible gouvernement péquiste et encore plus si le PQ entre minoritaire au Parlement, donnant à QS une possible balance du pouvoir ? Faut-il persévérer dans cette tendance au recentrage qu'on a pu observer il y a presqu'un an de cela ou faut-il, au plus vite, faire la clarté sur cette stratégie une fois pour toutes et assumer pleinement le fait que nous soyons un parti de « gauche » dans un univers de droitisation extrême, donc un parti « souffre-douleur » pour les médias, les autres formations politiques (droite nationaliste, centre, extrême-centre), les institutions « bourgeoises » et les chantres du Capital pour qui nous sommes le Mal incarné. Dans quel état se trouvent les relations entre la permanence de QS et les divers mouvements sociaux qui ont appuyé l'aile parlementaire jusqu'à maintenant ?
C'est à ces questions qu'il faut répondre et de ces variantes socio-politiques dont il faut prendre acte afin de continuer à offrir aux Québécois(es) une véritable alternative démocratique et non pas un faux-semblant (un « duplicata ») de la gauche comme on en a vu et qu'on voit encore partout en Occident. Il faut se le redire, la route risque d'être encore longue. Qu'à cela ne tienne : « Patience dans l'azur ! » disait Charles Baudelaire.
Mario Charland
Shawinigan
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
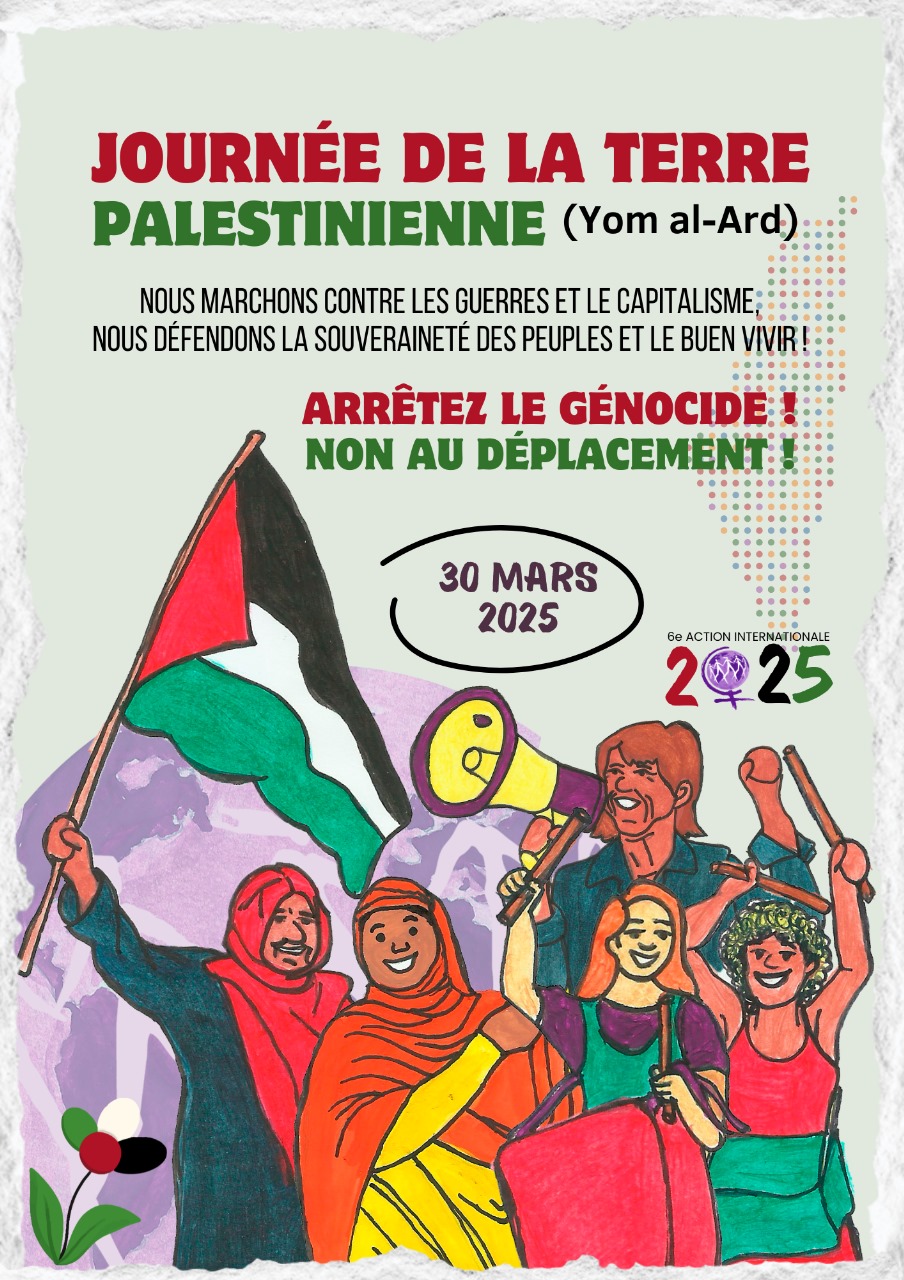
Déclaration de la Marche mondiale des femmes pour le 30 mars, Journée de la Terre Palestinienne : Stop au génocide !
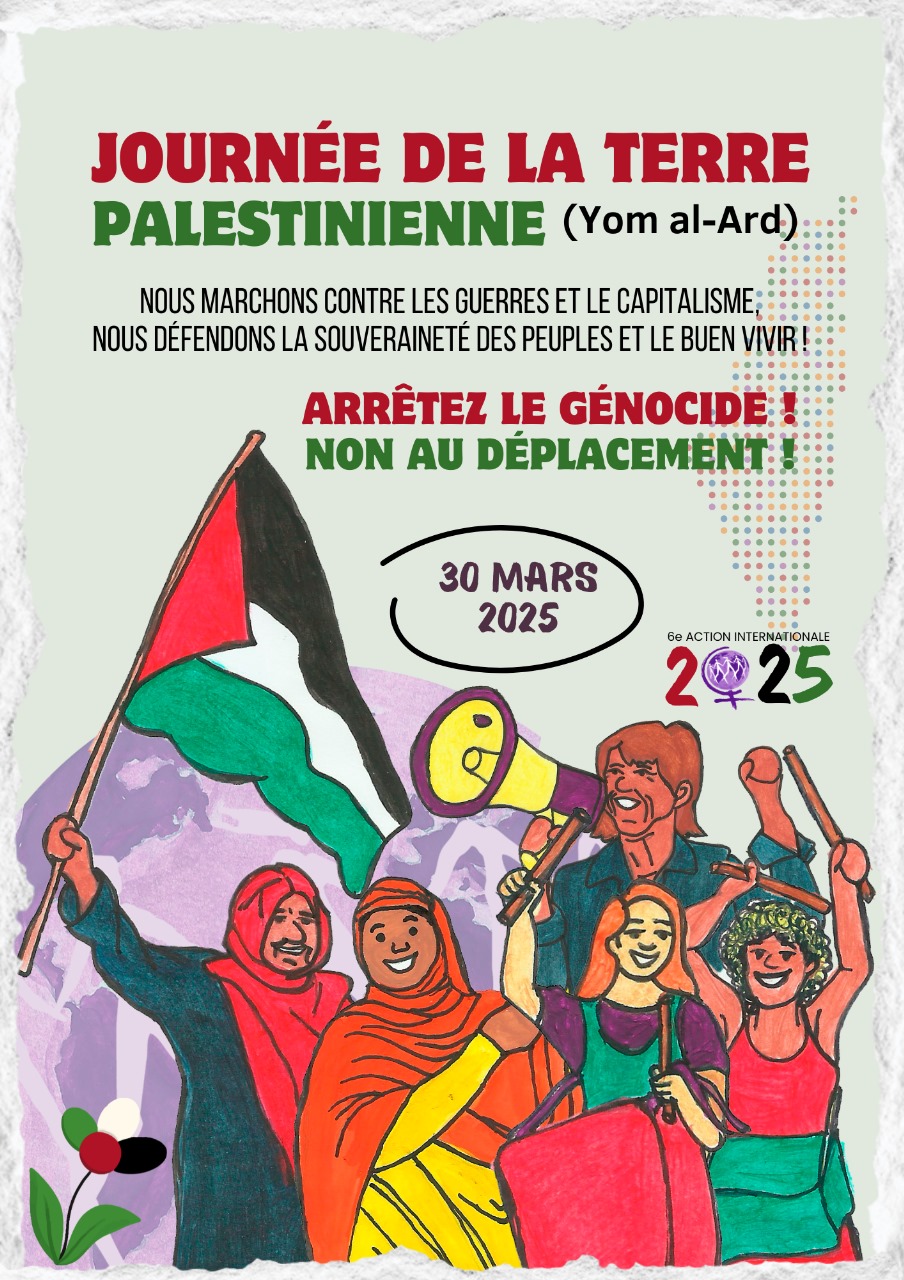
À l'occasion du 30 mars, Journée de la Terre de Palestine, nous réaffirmons notre solidarité inébranlable avec le peuple palestinien contre le colonialisme sioniste, le génocide et les déplacements forcés de population. Cette journée marque la résistance palestinienne et son combat permanent pour son droit légitime à sa terre et à son autodétermination. Cette cause est au cœur de la 6ème Action Internationale de la Marche Mondiale des Femmes.
Tiré de l'infolettre de la CQMMF
https://marchemondiale.org/2025/03/declaration-de-la-marche-mondiale-des-femmes-pour-le-30-mars-journee-de-la-terre-palestinienne-stop-au-genocide-non-au-deplacement-en-palestine/?lang=fr&utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-large-3e-mars-2025
En cette journée de lutte et de résistance du peuple palestinien, la Marche Mondiale des Femmes, dénonce une fois de plus le lien entre la militarisation et la violence contre les femmes et les communautés. Les forces militaires impérialistes criminalisent la résistance, déplacent les populations, imposent des frontières et détruisent les modes de vie traditionnels. Ce système sert les entreprises transnationales et l'ordre capitaliste patriarcal, ciblant les femmes tout en alimentant la violence coloniale, la militarisation et l'oppression, de la Palestine au Sahara occidental, de la Syrie à la Colombie, du Yémen au Kurdistan, et bien d'autres encore.
Depuis 75 ans, les Palestiniens et les Palestiniennes résistent aux déplacements forcés, à la confiscation de ses terres et à l'expansion des colonies. En dépit de la guerre, de la faim et de la destruction, ils refusent de quitter leur terre. Les tentatives de nettoyage ethnique du peuple palestinien ont échoué, comme en témoigne leur retour dans le nord de Gaza malgré la destruction de leurs maisons et de leurs infrastructures.
La MMF condamne toutes les politiques qui minent le droit des Palestiniens.nes à leur terre et à leur autodétermination. L'occupation est un projet d'expansion au-delà de la Palestine, comme le montrent les actions sionistes au Liban et en Syrie. Si le monde se soumet à ces plans, d'autres pays seront menacés. Nous soulignons également que le projet d'occupation est, par essence, un projet idéologique expansionniste représenté par la Terre Promise, et l'occupation ne se contentera pas de la Palestine, pour eux la Terre Promise s'étend du Nil à l'Euphrate, et si la communauté internationale et les pays arabes acceptent ces plans, ils devront penser au prochain pays dont ce sera le tour – il suffit de voir ce que l'occupation sioniste fait actuellement dans le sud du Liban et en Syrie.
La communauté internationale doit aller au-delà de la solidarité pour exiger la fin de l'occupation et défendre l'autodétermination du peuple palestinien, comme l'ont reconnu la Cour internationale de justice et l'Assemblée générale des Nations Unies. Le déplacement de la population palestinienne menace d'étendre le conflit à tous les pays de la région, ce qui compromet les possibilités de paix et de coexistence entre les peuples.
Notre vision féministe lie la guerre au patriarcat et au capitalisme, appelle à la démilitarisation et promeut une culture de la paix qui va au-delà de la simple absence de guerre. Nous luttons pour les droits des femmes dans les zones de conflit. Nos actions contre la guerre et la militarisation demandent que les femmes soient incluses dans les négociations de paix, prônent la désobéissance civile en réponse aux agressions, cherchent à construire des réseaux transnationaux et rejettent l'impérialisme.
Á l'occasion de la Journée de la Terre, la MMF appelle toutes les forces progressistes à :
– Exiger un cessez-le-feu global et le retrait d'Israël.
– Soutenir la fermeté du peuple palestinien et son retour en toute sécurité sur sa terre.
– Fournir une aide d'urgence et une reconstruction à Gaza.
– Veiller à ce que les responsables des crimes de guerre israéliens répondent de leurs actes.
– Cesser le génocide, non au déplacement !
Nous marchons contre les guerres et le capitalisme,
Nous défendons la souveraineté des peuples face au sionisme et à l'impérialisme !
Marche mondiale des femmes
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Regroupement vigilance énergie Québec s’oppose à STABLEX et le Projet de loi 93

L'Assomption le 25 mars 2025 - Le gouvernement de la CAQ veut forcer la municipalité de Blainville à vendre un terrain dans une grande tourbière, pour permettre à une compagnie américaine d'agrandir son site d'enfouissement et de recevoir des déchets toxiques en provenance des États-Unis, de l'Ontario et du Québec.
Des prélèvements d'eau autour du dépotoir existant ont déjà révéléla présence de plusieurs contaminants. Les sols et l'eau souterraine sont menacés par les fuites toxiques du dépotoir. C'est l'une des raisons pourquoi le BAPE s'est opposé au projet de Stablex. Mais le gouvernement du Québec s'entête à vouloir permettre l'expansion du site d'enfouissement.
De plus, le terrain en question fait partie d'un plan de protection des milieux humides dont le règlement a été adoptépar la Communauté Métropolitaine de Montréal en avril 2022, et approuvé par le gouvernement du Québec. Malgré l'opposition des élus et de la population de Blainville, et face à une opposition grandissante, la CAQ a proposé une loi spéciale, le projet de loi 93, pour forcer la ville à lui vendre le terrain convoité par Stablex. Selon des sources bien informées, le gouvernement devrait contourner le débat démocratique et forcer l'adoption du projet de loi avec la procédure du bâillon, dès jeudi 26 mars 2025. Il y a de quoi s'indigner.
Le Regroupement Vigilance Énergie Québec joint sa voix à celle des citoyens et élus de Blainville, à celle de la Communauté Métropolitaine de Montréal et de l'Union des municipalités du Québec et à celle de nombreux organismes de la société civile. Nous nous opposons à la vente forcée de ce terrain pour qu'une compagnie américaine privée vienne y déverser les déchets toxiques en provenance de l'extérieur du Québec. Nous invitons plutôt le gouvernement de François Legault à renoncer à son projet de loi 93 et à suivre la recommandation de la CMM faite en décembre 2024, pour un examen approfondi de la politique de gestion des matières dangereuses résiduelles du Québec.
Si le gouvernement du Québec essaie de forcer les citoyens de Blainville et de la CMM à accepter ce projet, le RVÉQ encourage les citoyens à organiser une résistance de désobéissance civile non violente de masse, afin de bloquer les travaux d'agrandissement. Le RVÉQ offre une formation pour cette action, telle que celle offerte aux citoyens de Kanesatake en 2024.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte : États généraux du syndicalisme : l’union fait l’avenir !

Moteur de progrès social, le mouvement syndical québécois a largement contribué à l'amélioration des conditions de travail, à la reconnaissance des droits des travailleuses et travailleurs ainsi qu'au renforcement du filet social de l'ensemble de la population québécoise. Les victoires obtenues ont façonné le Québec moderne et montré la force de la solidarité syndicale et sociale.
Le monde du travail change à une vitesse fulgurante et les défis qui se dressent devant nous sont plus grands que jamais. Dans plusieurs secteurs, la précarisation s'accentue, le taux de syndicalisation stagne ou diminue. La judiciarisation croissante des relations de travail, les attaques politiques face aux lois encadrant le droit d'association — dont le projet de loi 89 est un exemple probant — et la polarisation des discours fragilisent notre capacité à défendre efficacement les intérêts des travailleuses et travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou non. Le mouvement syndical québécois est à un tournant important.
Devant ces défis, les neuf principales organisations syndicales québécoises, — l'APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ — unissent leurs forces pour amorcer une réflexion commune dans le cadre des États généraux du syndicalisme, une démarche sans précédent au Québec.
Sur une période de deux ans, à travers différentes étapes de consultation, nos organisations iront à la rencontre des militantes et des militants, des travailleuses et des travailleurs, des spécialistes du monde du travail et de la société civile pour dresser un portrait juste et lucide de l'état du syndicalisme québécois et identifier les pistes de solutions pour le renforcer.
Au cœur de cette démarche : une conversation profonde et honnête sur notre avenir collectif, des discussions sur la modernisation des approches syndicales pour mieux répondre aux attentes des travailleuses et des travailleurs et pour renforcer leur pouvoir d'action face aux nouvelles réalités du monde du travail.
Le syndicalisme, ce sont des visages, des voix et des réalités qui méritent d'être entendus. Cette démarche proactive cherche à revitaliser le mouvement syndical, assurer une plus grande justice sociale et bâtir un avenir où les travailleuses et les travailleurs pourront collectivement prendre leur place.
Le 31 mars, nous marquerons le coup d'envoi de cette grande démarche collective qui met en lumière nos forces, notre solidarité et notre engagement. Une démarche que nous portons avec fierté et qui se déploie bien au-delà des différentes bannières syndicales.
C'est un projet ambitieux, à la hauteur des aspirations que nous portons pour le Québec de demain. Nous appelons les travailleuses et travailleurs ainsi que les actrices et acteurs du monde du travail à se mobiliser et à participer activement aux travaux des États généraux du syndicalisme.
Notre mouvement est toujours porté par une volonté commune de regarder vers l'avant. Aujourd'hui, nous prenons les choses en mains pour réfléchir à l'avenir du syndicalisme et renforcer les liens de solidarité entre nos organisations syndicales, pour faire plus et mieux ensemble. Il s'agit des intérêts des travailleuses et des travailleurs et de la société québécoise. Nous leur devons l'audace de cette démarche et nous y croyons.
Ensemble, nous nous donnerons les moyens d'être plus fortes et forts, plus efficaces, plus solidaires ! Parce qu'une chose est certaine : l'union fait l'avenir !
Cosignataires de la lettre
Robert Comeau, président de l'APTS - Luc Vachon, président de la CSD - Caroline Senneville, présidente de la CSN - Éric Gingras, président de la CSQ - Mélanie Hubert, présidente de la FAE - Julie Bouchard, présidente de la FIQ - Magali Picard, présidente de la FTQ - Christian Daigle, président du SFPQ - Guillaume Bouvrette, président du SPGQ
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Inhalothérapeutes Le gouvernement doit avoir le courage d’agir pour cette profession en péril

L'histoire d'une jeune inhalothérapeute de 27 ans, en arrêt de travail après seulement six ans de carrière, épuisée par un horaire intenable qui l'a poussée à négliger ses besoins fondamentaux, a pu choquer plusieurs personnes. Alors que l'épuisement et la surcharge frappent cette profession, des chiffres révèlent qu'à l'hôpital où elle travaille, 43 % des postes sont vacants. À la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ, nous ne sommes pas surprises, car ce phénomène est loin d'être isolé.
La pénurie d'inhalothérapeutes touche plusieurs établissements du RSSS, notamment dans Charlevoix, l'Outaouais et Montréal, où les bris de service sont fréquents. Des plans de contingence, impliquant des équipes en sous-effectif, sont souvent mis en place, fragilisant les équipes et compromettant la qualité des soins. Cette pénurie entraîne parfois l'annulation d'interventions chirurgicales, ce qui déjoue le plan gouvernemental pour réduire les listes d'attente en chirurgie.
La situation est d'autant plus préoccupante qu'environ 3 439 inhalothérapeutes sont actuellement membres de la FIQ, alors que plusieurs ne le sont pas, ce qui laisse croire qu'une partie de la profession travaille dans le secteur privé, notamment en clinique pour le traitement de l'apnée du sommeil.
Depuis plusieurs années, la FIQ dénonce l'aggravation des conditions de travail des inhalothérapeutes, liée à plusieurs facteurs : surcharge constante, épuisement, manque d'avancement, non-reconnaissance du champ de pratique et stress dû aux responsabilités élevées.
Le manque de soutien en début de carrière et un programme collégial d'inhalothérapie dépassé aggravent la situation. La formation collégiale en inhalothérapie reçoit de nombreuses candidatures chaque année, mais le taux d'abandon est élevé en raison de la difficulté du programme et de son inadéquation avec les réalités de la profession.
Les inhalothérapeutes jouent un rôle essentiel, mais méconnu dans les soins critiques, notamment en soins intensifs, aux urgences et dans la prise en charge des maladies respiratoires, accentuées par les changements climatiques. La COVID-19 a mis en lumière leur expertise auprès des patient-e-s sous ventilation mécanique. Au sein des équipes de réanimation, leur travail consiste à évaluer, traiter et surveiller les troubles respiratoires, administrer les traitements, opérer diverses technologies et équipements, réaliser des tests diagnostiques et assister en anesthésie. Leur rôle est vital pour les personnes atteintes de problèmes cardiorespiratoires.
En septembre 2024, la FIQ a déposé un mémoire<https://www.fiqsante.qc.ca/wp-conte...> dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi 67, qui visait la modernisation du système professionnel et l'élargissement de certaines pratiques en santé. Ce projet avait suscité des préoccupations, notamment concernant la réduction des exigences professionnelles, ce qui aurait pu compromettre la qualité des soins.
Dans son mémoire, la FIQ insistait sur la nécessité de maintenir des standards élevés. Pourquoi ? Parce que ce projet de loi, en cas de pandémie liée à un virus cardiorespiratoire, permettrait à une personne sans obligations professionnelles d'accomplir des actes réservés aux inhalothérapeutes. Elle pourrait ainsi évaluer un-e patient-e et ajuster la médication sans la formation ni le cadre requis pour protéger le public. Un non-sens.
Il est grand temps d'investir dans l'inhalothérapie. Une formation adaptée aux défis actuels et des conditions de travail dignes de l'expertise de ces professionnelles sont essentielles pour garantir des soins sécuritaires. Il faut rendre cette profession plus attractive, notamment en reconnaissant pleinement leur champ de pratique. L'équité salariale doit aussi être une priorité. Revoir le programme, revaloriser l'expertise et renforcer le soutien clinique : des gestes concrets pour attirer et retenir ces professionnelles indispensables. Il est temps d'agir avec courage pour préserver et valoriser cette profession essentielle.
Julie Bouchard
Présidente
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
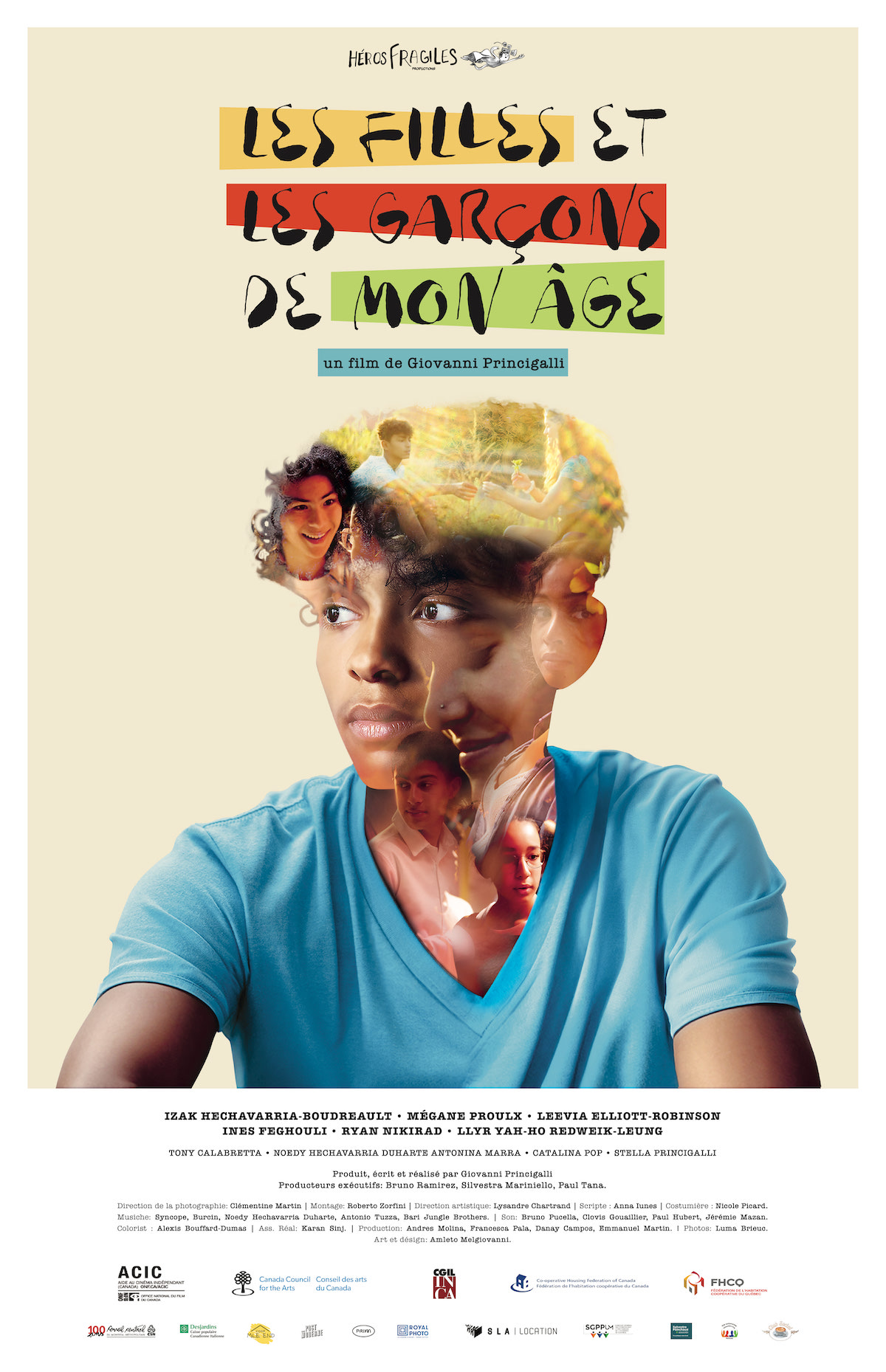
Les filles et les garçons de mon âge
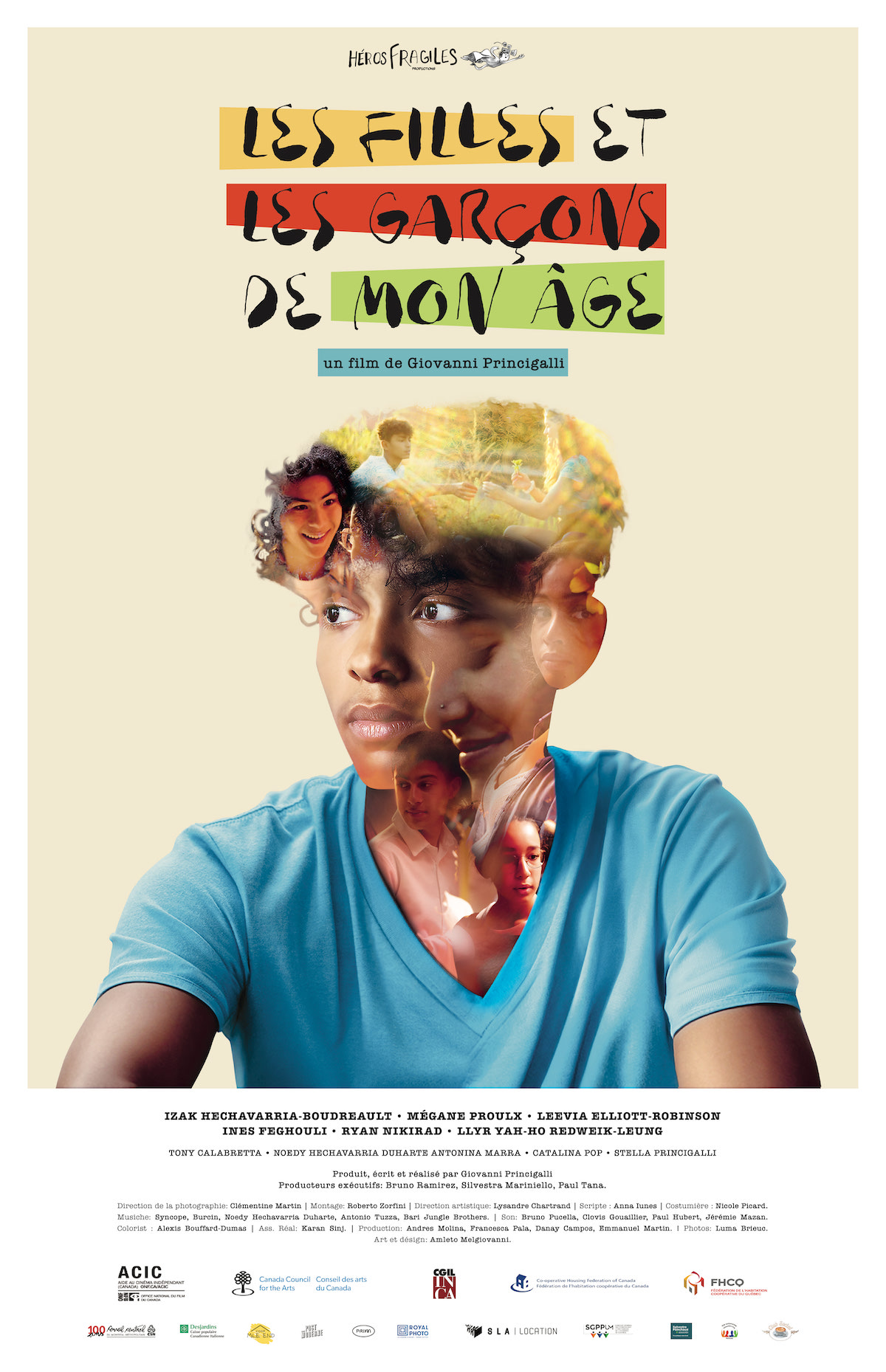
Le court-métrage *Les filles et les garçons de mon âge* (19 min) sera présenté à Vues d'Afrique le 4 avril 2025 à 17 h au cinéma du Parc à Montréal.
« Une œuvre au rendu visuel et au contenu brillant qui met en scène avec sensibilité et délicatesse une histoire de passage à l'âge adulte à la consistance onirique. Un court métrage intense et touchant » *(Antonio Falcone dans Lumière et ses frères)
« Un aperçu rêveur comme seul l'amour à douze ans peut l'être » (Emanuela Mocci, Taxi driver)
FESTIVALS
Black film festival Montreal
RIFF Festival del film indipendente di Roma
2 nominations au Youth Oscar Accademy
Vues d'Afrique film festival
BUFF Malmö Film Festival
Festival internacional del cinema de Gibara
*SYNOPSIS*
Le film raconte la dernière fin de semaine que Hector, un Cubain-Canadien de 14 ans, passe à Montréal, dans la coopérative d'habitation où il est né et a grandi. En effet, sa mère, Iulia, âgée d'environ 38-40 ans a épousé en secondes noces Bruno, un Italo-Canadien âgé d'environ 57-60 ans, qui vit lui aussi dans la coopérative. Iulia est veuve depuis longtemps. Bruno et Iulia pensent qu'ils veulent changer leur vie, c'est maintenant. Ils veulent ouvrir une crémerie glacée sur une plage en Californie. Mais Hector a peur de l'inconnu et de quitter son micro-monde. Il a grandi avec les autres enfants de la coopérative. Ils ont fréquenté la même garderie, puis l'école primaire et enfin l'école secondaire. Hector est secrètement amoureux de Noa, une fille québécoise de son âge qui habite elle aussi dans la coop. Avant de partir, il devra trouver le courage d'avouer son amour.
Mais à porter un certain intérêt à Hector il y a Sophia d'origine Jamaïcaine et Samira d'origine algérienne. Le grand voyage coïncide avec un premier baiser et le passage de l'enfance à l'adolescence. Le film est dédié à la mémoire de Pierre Jutras (1945-2023), réalisateur et scénariste, ainsi que directeur historique de la Cinémathèque québécoise.
*NOTES de PRODUCTION et de RÉALISATION*
Le titre est un clin d'œil à la célèbre chanson de Françoise Hardy et à la série de films produits dans les années 1990 par Tv Arte sur le thème de l'adolescence. D'ailleurs, le titre semble suggérer que c'est le protagoniste du film lui-même qui nous racontera un jour ces derniers jours d'été avec ses amis et ses amours (sa génération), avant de leur dire au revoir.
Le film est largement inspiré de mon adolescence.
Le film a été tourné dans la coopérative d'habitation où j'habite à Montréal. Le jeune homme qui joue le rôle d'Hector n'avait aucune formation ni expérience en tant qu'acteur. Tout comme le personnage qu'il incarne n'avait jamais embrassé une fille auparavant, c'est dans le film qu'il aura son premier baiser. C'est lui que j'ai choisi, et non un acteur professionnel, parce que je trouvais que sa timidité, sa réserve, sa voix fluette, son visage même, correspondaient parfaitement à l'état d'esprit et au caractère de son personnage. Les autres jeunes acteurs, en particulier les trois jeunes filles, ont joué dans des films présentés dans des festivals tels que le TIFF et Berlin, ainsi que dans de nombreux feuilletons télévisés.
Outre les subventions et le soutien public des organismes suivants, Conseil des arts du Canada et ONF aide au cinéma indépendant, le film a été soutenu par le mouvement coopératif, syndical, social et italo-canadien canadien, les députées provinciales Ruba Ghazal et Elisabeth Prass, ainsi que par des professeurs universitaires d'histoire du cinéma d'origine italienne, et par des commerçants de quartier ou la communauté italienne de Montréal.
—
Giovanni Princigalli
www.herosfragiles.com
http://storytelling.concordia.ca/fr/content/princigalli-giovanni
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump et le fascisme historique. Nous devons affronter la réalité !

La nature du trumpisme – et le type de régime que Donald Trump pourrait installer – sont l'objet de nombreux débats. Entre apparence d'une nouveauté radicale et recyclage de théories et principes de l'extrême droite historique, comment peut-on envisager le rapport de Trump au fascisme historique ? Dans cette contribution, John Ganz, journaliste politique états-unien et auteur notamment de When the Clock Broke, développe une critique des contributions qui réfutent l'idée d'héritage fasciste du trumpisme.
Tiré de la revue Contretemps
24 mars 2025
Par John Ganz
***
Peu après les élections, j'ai écrit un billet intitulé « Tester la thèse du fascisme », dans lequel je disais que je reviendrais périodiquement sur cette idéeet que je verrais où nous en étions sur cette question. Le terme employé peut sembler anodin. De nombreux critiques ont affirmé que le fait d'appeler ce qui est « fascisme » a échoué politiquement et que nous devrions donc l'abandonner, mais j'ai toujours soutenu que la théorie était utile et même prédictive à certains moments.
L'évolution des mouvements et des régimes fascistes historiques est très instructive pour comprendre la dynamique politique de l'époque. Mais, bien sûr, elle n'épuise pas non plus les possibilités du présent : nous vivons à une époque différente, avec des conditions technologiques, sociales et institutionnelles différentes. Aujourd'hui, je vais aborder quelques contre-arguments et interprétations et tenter d'expliquer pourquoi le cadre du fascisme a un meilleur sens pour le présent que tout ce que ses opposants ont à offrir.
« Trump est faible »
Il s'agit d'une insistance commune des critiques de la thèse du fascisme, comme Corey Robin. Elle repose sur la notion erronée selon laquelle le fascisme représente le pouvoir lui-même, une idée paradoxalement tirée de la propagande fasciste elle-même. On raconte que Trump a très peu de pouvoir sur le Congrès, qu'il n'est pas encore très populaire et que, par conséquent, son bilan sera davantage marqué par des échecs que par des réussites. Ils soulignent la difficulté qu'il a eue à faire passer ses choix ministériels.
En termes de système constitutionnel, oui, Trump est faible et devrait être contrôlé en tant que tel, mais c'est précisément la raison pour laquelle il essaie de plier et de briser le système constitutionnel et de le remplacer par la règle du décret. Il doit s'appuyer fortement sur le pouvoir exécutif. Cela s'inscrit dans la lignée des mouvements fascistes historiques, dont aucun n'a jamais approché le vote populaire que Trump a obtenu, soit dit en passant. Ils ont dû recourir à la force pour compenser l'absence de consentement politique. Leur justification pour prendre des mesures extraordinaires était le processus sclérosé et corrompu de la législation parlementaire, d'où la nécessité d'une « main forte ».
Corey Robin qualifie aujourd'hui Trump 2.0 de présidence « hostile », mais les commentateurs l'ont observé depuis un certain temps et l'ont utilisé pour décrire le succès initial de Trump 1.0 dans l'élaboration d'un programme par le seul biais d'actions exécutives. Dans leur livre de 2020, Trump, the Administrative Presidency, and Federalism, Frank J. Thompson, Kenneth K. Wong et Barry G. Rabe utilisent le terme même de « prise de contrôle hostile » pour décrire la manière dont la première présidence Trump « a poussé l'enveloppe de l'action exécutive à des niveaux sans précédent dans les annales de la présidence administrative ». Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est que l'intensification de cette utilisation de l'exécutif. Le fait que Trump doive s'appuyer sur l'idée d'un exécutif tout-puissant rend son régime plus dictatorial par nature, et non moins.
Une autre partie de la thèse de la faiblesse est que la coalition de Trump a des divisions et des contradictions significatives. Là encore, les détracteurs de la thèse du fascisme se laissent abuser par la propagande fasciste qui dépeint le parti comme évoluant dans l'unité avec la volonté du leader. Les mouvements fascistes historiques étaient très fracturés, voire incohérents. Le fascisme italien et le nazisme contenaient tous deux une « gauche » populiste qui a été mise sur la touche, voire détruite, dans le but de prendre le pouvoir et de calmer les nerfs d'une bourgeoisie anxieuse.
Dylan Riley, l'un des principaux critiques de la thèse du fascisme, fait lui-même cette analogie dans la préface révisée de The Civic Foundations of Fascism in Europe : « Comme Mussolini et Hitler, Trump est confronté à une fronde sous la direction de Steve Bannon, qui rappelle Farinacci “(1) (Roberto Farinacci était le chef de l'aile ”syndicaliste nationale » pro-ouvrière du parti, dont le pouvoir a décliné à mesure que Mussolini s'est rapproché des intérêts industriels). Ce glissement du « populisme » vers une alliance totale avec les intérêts capitalistes s'inscrit dans la dynamique historique des mouvements fascistes.
« Trump s'appuie toujours sur l'ordre constitutionnel »
Je me demande dans quelle mesure c'est encore le cas. En 2020, Corey Robin a dit cela dans une interview avec Jewish Currents :
« Je trouve ironique que les gens choisissent ce moment, et la présidence de Trump, pour attribuer l'étiquette « fasciste » à la droite, car le fascisme, c'est avant tout une politique de la force et de la volonté. C'est pourquoi les fascistes détestent traditionnellement l'ordre constitutionnel : parce qu'ils pensent qu'il limite l'affirmation de la volonté politique. L'ironie de la politique Trumpiste/GOP est qu'elle est complètement dépendante de l'ordre constitutionnel. À cet égard, c'est presque le contraire du fascisme. »
Le fait est que, tout comme Trump, les fascistes historiques sont arrivés au pouvoir grâce aux institutions existantes d'un système constitutionnel, à la fois au sens juridique et formel – ils ont été invités à former le gouvernement par le chef de l'État – et au sens politique – ils ont gouverné – initialement – en coalition avec d'autres partis. Il est vrai que les fascismes historiques se sont opposés à ce cadre et ont cherché à l'ébranler et à le détruire, mais ils ont également dû coopérer avec des éléments de l'ancien régime, conformément aux limites de leur pouvoir politique.
Les critiques de la thèse du fascisme disent souvent qu'il est absurde de comparer le trumpisme au fascisme puisque nous ne vivions manifestement pas sous un régime fasciste répressif dans Trump 1.0. Très peu de gens ont dit que nous vivions sous un régime fasciste ; ils ont dit que Trump était, dans son essence, un fasciste, ce qui est une distinction conceptuelle différente.
Les critiques cherchent à éluder la différence entre un mouvement fasciste et un régime fasciste afin de tourner en dérision leurs opposants, mais ils ignorent également à quoi ressemblait le fascisme réellement existant. En Italie, Mussolini a gouverné en tandem avec l'ancien système politique de 1922 à 1925, jusqu'à ce que la véritable phase dictatoriale commence à la suite de la crise Matteotti, une débâcle qui menaçait sérieusement son règne. Dans un premier temps, il a tenté d'éviter une confrontation directe entre la dictature et le régime parlementaire, même si les éléments les plus radicaux de son mouvement exigeaient un tournant révolutionnaire. Il doutait alors de disposer d'une force politique suffisante pour imposer un tel changement.
Mussolini a d'abord cherché à consolider son pouvoir tandis que les conservateurs tentaient de normaliser son mouvement et de canaliser ses énergies vers des cadres politiques conventionnels. Ainsi, durant les premières années du fascisme, une répression croissante a cohabité avec des élections compétitives, une presse libre et une sphère publique pluraliste. Les premières années du fascisme ont vu coexister le pouvoir fasciste et l'accélération de la répression avec des élections compétitives, une presse libre et une sphère publique plurielle (Giacomo Matteotti, 1885-1924) a été assassiné pour avoir publié un livre et prononcé des discours au parlement, où il était député socialiste). Et jusqu'à ce qu'une crise force la main de Mussolini, il semblait que la situation s'était stabilisée dans une sorte de régime hybride.
« Trump est un régime hypercapitaliste, pas un régime fasciste »
Certains disent maintenant que ce à quoi nous assistons est une version de l'effondrement de l'Union soviétique, où l'État a été dépouillé de ses ressources par des oligarques. Une variante positive de cet « argument » est présentée dans un tweet par le sénateur républicain Mike Lee de l'Utah : « Nommez un dictateur fasciste dont le programme consistait à limiter la taille, le coût et le pouvoir du gouvernement. »
Dans l'esprit du public, le fascisme est souvent associé à une forte intervention de l'État, à la nationalisation, à l'industrialisation de guerre et à une certaine mimétique du socialisme. Pourtant, le régime de Mussolini a adopté un programme économique « libéral », placé sous la supervision d'Alberto de' Stefani (1879-1969). De Stefani était favorable aux réductions d'impôts, aux réductions et réformes bureaucratiques et aux privatisations à grande échelle. Comme l'écrit l'historien Germà Bel :
« Le gouvernement a privatisé le monopole d'État sur la vente d'allumettes, supprimé le monopole public de l'assurance-vie, vendu la plupart des réseaux et services téléphoniques étatiques à des entreprises privées, reprivatisé le plus grand producteur de machines métalliques et accordé des concessions à des entreprises privées pour la construction et l'exploitation d'autoroutes. Ces interventions constituent l'un des premiers et des plus décisifs épisodes de privatisation du monde occidental. » (2)
De' Stefani a également poursuivi une politique de rigueur et atteint l'équilibre budgétaire. À contre-courant de la tendance à la nationalisation des années 1930, les nazis ont aussi mené, dans un premier temps, une politique de privatisation motivée par des considérations politiques. (3)
Mussolini n'a pas laissé transparaître ses racines socialistes lorsqu'il s'est adressé pour la première fois au parlement en juin 1921 :
« D'autre part, pour sauver l'État, il faudra procéder à une opération chirurgicale. Hier, l'honorable Paolo Orano(1875-1945) a dit que l'État est semblable au géant Briarée, qui possède cent bras. Je pense qu'il faut en amputer quatre-vingt-quinze. Je pense qu'il faut réduire l'État à son expression purement juridique et politique. […] L'État nous fournira une police, protégera le gentilhomme des criminels, assurera une justice bien organisée, une armée prête à toute éventualité et une politique étrangère alignée sur les intérêts nationaux. Pour le reste, et je n'exclus pas même les écoles secondaires, il faut s'en remettre aux initiatives individuelles. Si l'on veut sauver l'État, il faut abolir l'État collectiviste, qui n'a été qu'un produit de la guerre, et revenir à l'État manchesterien. »
Puis, en janvier 1921, il écrivait encore :
« En résumé, la position du fascisme en ce qui concerne l'État est la suivante : la lutte contre l'État économique monopolistique est indispensable au développement des forces de la nation. Il faut revenir à l'État politico-judiciaire, car ce sont là ses véritables fonctions. En d'autres termes, il faut renforcer l'État politique et démanteler progressivement l'État économique ». (4)
Ce n'est qu'avec la Grande Dépression que le régime fasciste commence à expérimenter le corporatisme, qui finit par favoriser l'industrie plutôt que le travail.
Comme l'a écrit Adam Tooze, les économistes libéraux ont observé le gouvernement fasciste avec beaucoup de sympathie et d'intérêt, voyant en lui un rempart potentiel contre un ordre capitaliste mondial en déclin. En 1927 encore, l'économiste autrichien Ludwig von Mises (1881-1973) pouvait écrire :
« On ne peut nier que le fascisme et les mouvements similaires visant à établir des dictatures sont animés des meilleures intentions et que leur intervention a, pour l'instant, sauvé la civilisation européenne. Le mérite que le fascisme s'est ainsi attribué restera éternellement dans l'histoire ».
A l'heure où j'écris ces lignes, les disciples du disciple de Von Mises, via son héritier intellectuel Murray Rothbard (1926-1995) se déchaînent au sein du gouvernement fédéral.
Techniquement, un coup d'État
Le trumpisme, après une tentative putschiste avortée, a évolué vers une stratégie d'accaparement légal du pouvoir, une dynamique qui, une fois encore, échappe aux critiques refusant d'admettre toute analogie avec le fascisme.
L'actuelle mainmise sur le système de paiement du Département du Trésor rappelle les observations du journaliste fasciste, Curzio Malaparte (1898-1957), dans son ouvrage, Technique du coup d'État(1931). Il y analyse comment les coups d'État modernes les plus efficaces ne reposent pas sur des assauts frontaux contre les institutions de l'État, ni sur de spectaculaires soulèvements militaires, mais plutôt sur la prise de contrôle des “centres nerveux” techniques du pouvoir :
« … le problème du coup d'État moderne est un problème technique…Ce ne sont pas les masses qui font la révolution, mais une simple poignée d'hommes, préparés à toute éventualité, bien entraînés aux tactiques de l'insurrection, formés pour frapper durement et rapidement les organes vitaux des services techniques de l'État. Ces troupes de choc devraient être recrutées parmi les ouvriers spécialisés : mécaniciens, électriciens, opérateurs télégraphiques et radio agissant sous les ordres d'ingénieurs techniques qui comprennent le fonctionnement technique de l'État. »
Je doute que la petite escouade de Musk puisse réellement être assimilée à une force de choc de ce type. Toutefois, elle cherche indéniablement à s'emparer des centres névralgiques du pouvoir. C'est comme si le mouvement trumpiste avait tiré des leçons de ses échecs passés et choisi d'adopter une stratégie différente.
La question de l'idéologie
Les critiques de la thèse du fascisme insistent sur la continuité totale du Parti républicain (GOP) avec son histoire et ignorent un fait pourtant bien documenté : la propagation croissante d'une pensée autoritaire et illibérale à tous les niveaux de la droite contemporaine. Les penseurs de cette nouvelle droite n'hésitent plus à citer ouvertement Carl Schmitt (1888-1985) ou à évoquer la nécessité d'un « césarisme », mais ces évolutions sont soit passées sous silence, soit minimisées par les détracteurs de la thèse fasciste. Certains critiques ont même reconnu que l'idéologie de Trump présentait des accents fascistes, avant de rejeter cette idée comme une simple exagération ou du sensationnalisme.
Ainsi, en 2017, Corey Robin écrivait :
« Le cri de douleur prolongé de Trump semble contenir au moins certains des éléments du « nationalisme passionné » que l'historien Robert Paxton (1932) décrit comme l'essence du fascisme : un sentiment de déshonneur et de honte profonds, qui se manifeste à travers les océans et les continents ; le coup de poignard dans le dos des élites cosmopolites (Obama est « l'économiste du monde » qui commet une « trahison économique ») ; un désir ardent de réenchantement de l'État ; une aspiration à la restauration nationale et à la domination mondiale. »
D'accord, donc.
La question de la violence
Dans un article publié sur son blog , le 09 mars 2025, Corey Robin affirme que la question de la violence politique est aujourd'hui mal posée, car d'autres formes de coercition et d'intimidation ont pris le relais :
« Quelle a été la source la plus persistante et la plus répandue de cette peur et de cette intimidation, non pas pour des groupes politiques isolés, mais pour la grande majorité de la société ? Le pouvoir sur l'emploi. « Dans le cours général de la nature humaine, » écrivait Alexander Hamilton (1757-1804), “le pouvoir sur la subsistance d'un homme équivaut à un pouvoir sur sa volonté”. »
Ce schéma est déjà à l'œuvre : des menaces de licenciements massifs brandies par Trump, le retrait de fonds fédéraux en guise de représailles politiques, ou encore la soumission d'institutions du secteur non lucratif qui coopèrent avec ses exigences de peur de devoir licencier des personnes si elles ne le font pas. Sur la base de mon propre travail, je n'aurais jamais dû être surpris, bien que je l'admette, que ce ne soient pas les Proud Boys sillonnant les rues ni Trump jetant des gens en prison qui aient généré une vague de peur et d'intimidation, semblable à un tsunami, dans ce pays politiquement apaisé.
C'est pourtant ce modèle – la violence exercée d'en bas et d'en haut – que nous avons débattu en vain pendant huit ans. Finalement, la fin s'est avérée être ce qu'elle était au début : une société dominée par la peur, à l'américaine, où des millions de personnes craignent d'être punies par la perte de leur emploi si elles osent s'exprimer. Telle est aujourd'hui la règle du jeu. »
Ce n'était pas l'essence même de l'argument, mais sa version telle que formulée par Robin. L'apparition des Proud Boys et d'autres groupes paramilitaires, ainsi que leur participation à l'attaque du 6 janvier 2021, étaient symptomatiques de la nature autoritaire, voire fasciste du mouvement. Un symptôme que les critiques ont une fois encore choisi de minimiser ou d'ignorer.
En Allemagne comme en Italie, le squadrisme n'a constitué l'unique ou même le principal mode de coercition et de gouvernance des régimes fascistes. Encore une fois, l'idée que les chemises brunes ou les chemises noires se soient frayé un chemin jusqu'au pouvoir par la seule violence de rue relève davantage de la propagande fasciste que d'un fait historique. En réalité, l'élite conservatrice a coopéré avec les fascistes.
Le niveau de violence politique aux États-Unis n'atteint pas celui de l'Italie de l'entre-deux-guerres ou de l'Allemagne de Weimar, mais c'est parce que nous ne vivons ni dans ce contexte historique, ni sous ces conditions sociales. À leur époque, internet n'existait pas.
Robin ne reconnaît-il pas que Benito Mussolini lui-même a rendu l'emploi de ses opposants quasi impossible ? Il est évident que l'on n'a pas besoin de milices dans la rue lorsque l'appareil d'État lui-même devient l'outil de répression. La menace sur l'emploi est une technique éprouvée des dictatures à travers l'histoire. L'attaque contre la société civile orchestrée par des oligarques alliés au régime, via des pressions économiques et juridiques, est une caractéristique centrale des régimes autoritaires modernes. C'est le cas, par exemple, de la Hongrie de Viktor Orbán, qui constitue un modèle explicite pour les partisans intellectuels de Trump. Pourtant, ce parallèle n'a jamais été sérieusement pris en compte par les critiques de la “tyrannophobie”.
« L'absence d'expansionnisme à l'étranger »
Les détracteurs de la thèse du fascisme ont longtemps soutenu que Trump ne pouvait pas être fasciste car il n'était pas expansionniste et non interventionniste.
Regardons où nous en sommes aujourd'hui.
« L'absence de menace révolutionnaire »
Autre argument : le fascisme ne peut exister sans une menace révolutionnaire forte, qui pousse les élites conservatrices à embrasser des mouvements d'extrême droite par peur d'un soulèvement de gauche. Mais cet argument fait abstraction de la façon dont la droite perçoit les États-Unis contemporains.
Dans l'imaginaire de la droite américaine, le pays est déjà sous l'emprise d'une menace totalitaire d'extrême gauche. Selon cette vision, l'ennemi est représenté par les “marxistes culturels”, le wokisme, ou encore la “tyrannie progressiste” des élites universitaires et des médias.
Les manifestations au moment du meurtre de George Floyd, qui ont pris une ampleur nationale, ont été perçues comme un soulèvement révolutionnaire. De la même manière, les restrictions sanitaires liées à la Covid ont radicalisé une partie de la droite en lui donnant une vision paranoïaque d'un contrôle bureaucratique et sanitaire autoritaire.
Enfin, la campagne actuelle visant à démanteler la “DEI” (Diversity, Equity, and Inclusion) ne doit pas être vue uniquement comme un simple débat sur les politiques d'inclusion : elle s'inscrit dans une dynamique réactionnaire beaucoup plus large.
Si l'on s'en tient aux critères stricts de la gauche, il n'y a pas eu de situation révolutionnaire en 2020. Mais selon les critères et les peurs de la droite, il y a eu une crise majeure, avec un mouvement social inédit et une pression idéologique perçue comme étouffante. Cela peut sembler être une réaction excessive. Mais toutes les vagues réactionnaires le sont.
Et maintenant ?
Reconnaître ces faits ne signifie ni que Trump est invincible, ni que toute contestation politique est terminée. Bien au contraire. L'idée que « fascisme = force » n'est qu'un élément de propagande, involontairement relayé par les détracteurs de la thèse du fascisme.
Rien de tout cela ne signifie que Trump réussira nécessairement dans sa quête de pouvoir. Beaucoup soulignent à juste titre l'existence de sérieux obstacles structurels à la consolidation du pouvoir aux États-Unis. De plus, la politique, comme la vie, est souvent marquée par une part de contingence.
Je ne pense pas non plus que Trump soit une copie conforme de Mussolini ou d'Hitler, ni que son régime leur ressemblera en tous points. Il ne s'agit pas d'une instanciation aussi virulente. Pourtant, la comparaison mérite bien plus d'attention que ne veulent l'admettre certains intellectuels, aussi brillants et cultivés soient-ils, qui la rejettent d'un revers de main. Aux détracteurs de la thèse du fascisme, je citerai Oliver Cromwell : “Je vous en conjure… pensez qu'il est possible que vous vous trompiez.”
Notes
1. Dylan Riley, The Civic Foundations of Fascism in Europe, p. 35.
2. Bel, Germà. “The First Privatisation : Selling SOEs and Privatising Public Monopolies in Fascist Italy (1922–1925)” Cambridge Journal of Economics, vol. 35, no. 5, 2011, pp. 937–56.
3. Bel, Germà. “Against the Mainstream : Nazi Privatization in 1930s Germany” The Economic History Review, vol. 63, no. 1, 2010, pp. 34–55.
4. Zeev Sternhell, Naissance de l'idéologie fasciste, p. 228.
*
Publié initialement sur le site Unpopularfront. Traduit de l'anglais par Christian Dubucq pour Contretemps.
*
John Ganz est un écrivain et journaliste politique basé à Brooklyn. Il est l'auteur de la newsletter Unpopular Front surSubstack. Ses articles ont été publiés dans des médias tels que The Washington Post, The Guardian, The New Statesman et Artforum. En 2024, il a publié When the Clock Broke : Con Men, Conspiracists, and How America Cracked Up in the Early 1990s, un livre qui explore les turbulences politiques et sociales des années 1990 aux États-Unis. Il a également occupé le poste de rédacteur en chef exécutif chez Genius.com.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La lutte internationale contre l’extrême droite

La caractéristique déterminante de la politique de masse dans la période actuelle est la croissance stupéfiante et terrifiante de l'extrême droite internationale. Puisque la stratégie socialiste doit s'adapter au caractère de la politique de masse dans la période où elle opère, il s'ensuit que pendant cette période, les socialistes doivent se construire internationalement autour d'une lutte contre la montée de ce monstre.
https://vientosur.info/la-tarea-del-periodo/
22 mars 2025
Dans cet article, j'étayerai l'affirmation selon laquelle la montée de l'extrême droite est la caractéristique déterminante de la période actuelle. Je tenterai ensuite d'articuler une stratégie internationale de lutte contre cette montée et de souligner son rôle stratégiquement indispensable pour les socialistes dans la période actuelle.
Le nouvel autoritarisme et la polycrise
La seconde élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a marqué un moment de transition, où le nouvel autoritarisme en pleine ascension a pris une forme plus claire. Cependant, cette tempête prenait lentement forme depuis près de trois décennies, semblant à certains égards un reflet grotesque du rajeunissement que la gauche anticapitaliste a connu au cours de cette même période, depuis que le cycle actuel de la politique post-soviétique a commencé à prendre forme autour du mouvement antimondialisation de la fin des années 1990. En effet, comme l'a illustré Miguel Urbán, l'affirmation de la souveraineté culturelle nationale face à la mondialisation américanisante était au cœur de l'idéologie et des activités de l'extrême droite à cette époque. La nouvelle gauche de cette période et l'extrême droite insurrectionnelle émergent toutes deux de la même source : la crise du système capitaliste qui progresse lentement.
Le nouvel autoritarisme est une tendance inégale qui va dans le sens d'un divorce entre le capitalisme et la démocratie libérale. Il évolue dans cette direction sous la pression de ce qu'Adam Tooze a appelé la « polycrise », la coexistence de crises multiples et superposées (environnementales, économiques ou biologiques) qui convergent pour créer une crise totale du système. Le nouvel autoritarisme n'est pas une idéologie cohérente et uniforme dans tous les pays, mais une tendance générale qui évolue de manière inégale dans le sens du divorce susmentionné, avec quelques caractéristiques vaguement partagées.
Ce nouvel autoritarisme englobe l'aile Trumpiste du parti républicain, aujourd'hui dominante, Fratelli d'Italia en Italie, VOX en Espagne, le Rassemblement national en France, le Fidesz en Hongrie, Alternative pour l'Allemagne (AfD) et Reform en Grande-Bretagne. Elle comprendrait également des mouvements de combat de rue tels que les Proud Boys, le mouvement international Active Clubs, et même la violence spontanée d'extrême droite à laquelle nous avons assisté au cours de l'été 2024 au Royaume-Uni.
Il est utile d'esquisser quelques-unes des principales caractéristiques du nouvel autoritarisme en utilisant une comparaison avec le fascisme traditionnel comme caisse de résonance pour faire ressortir son caractère distinctif :
1. Le nouvel autoritarisme et le fascisme traditionnel ont tous deux leurs racines dans les classes moyennes, la petite bourgeoisie (petits commerçants, propriétaires, professions libérales, cadres), qui éprouvent des souffrances très réelles en raison de la crise du système, mais qui n'ont pas l'intérêt matériel de développer les outils analytiques nécessaires pour la problématiser de manière adéquate. Le capitalisme leur a procuré certains avantages que la crise a mis en péril. En même temps, ils veulent défendre le capitalisme et trouver une solution à la crise, une contradiction qui les pousse vers la pensée conspirationniste pour expliquer pourquoi le capitalisme ne fonctionne pas pour eux comme il le devrait. Le résultat est qu'ils se méfient à la fois de ceux qui sont au sommet et de ceux qui sont à la base : les grands capitalistes qui les écrasent dans la crise, et les immigré-es et les peuples opprimés qui sont facilement désignés comme boucs émissaires. Incapable de concevoir une crise interne au système, cette classe cherche des causes qui se situent essentiellement en dehors de son fonctionnement normal.
2. Ces deux mouvements sont des tentatives du système de réorienter le mécontentement qu'il génère au sein de cette classe comme moyen de se défendre ou de se sauver. Dans le fascisme traditionnel, la douleur de la Première Guerre mondiale et de la crise économique qui s'en est suivie a été canalisée dans la recherche de boucs émissaires juifs et socialistes qui avaient « poignardé la nation dans le dos » lorsque le front intérieur s'est effondré et que les gains de la classe ouvrière ont menacé le bon fonctionnement du capitalisme. Le fascisme est l'outil qui permet de faire reculer la menace que la classe ouvrière fait peser sur le capitalisme. Dans le contexte du nouvel autoritarisme, la douleur ressentie à la suite de l'effondrement de 2008, de ses conséquences et de la faible reprise a été redirigée contre les personnes migrantes, les minorités raciales, sexuelles et de genre et la gauche, et transformée en une histoire de faibles volontés et d'intentions néfastes d'une cabale démoniaque d'élites pédophiles, le tout aboutissant à un déclin national. Dans les deux cas, la classe moyenne est utilisée pour préserver le système en canalisant le mécontentement qu'il a généré.
3. Alors que le fascisme traditionnel prônait ouvertement l'abolition totale de la démocratie, le nouvel autoritarisme respecte au moins ses formes. À tout le moins, il n'a pas d'autre choix que d'opérer au sein de ses structures pour le moment, même s'il fait de son mieux pour les miner de l'intérieur. Pourtant, la tendance générale, comme le montre clairement le contraste entre le premier et le deuxième mandat de Trump, est d'ouvrir de plus en plus d'espace pour le démantèlement des institutions démocratiques.
4. Le manque d'uniformité idéologique au sein du nouvel autoritarisme met en lumière une autre de ses caractéristiques clés : alors que le mouvement dans son ensemble ne peut pas être qualifié de fasciste avoué, les fascistes auto-identifiés jouent un rôle central parmi ses cadres, dont beaucoup ont des racines dans les organisations fascistes plus traditionnelles du passé. Cela signifie que dans de nombreux partis et organisations des nouveaux autoritaires, il existe des forces engagées dans l'approfondissement de la politique de l'organisation dans une direction plus radicale et plus violente. L'étrangeté de la période actuelle se traduit par des circonstances apparemment contradictoires, où quelqu'un qui a presque certainement encore des sympathies ouvertement fascistes, comme Giorgia Meloni en Italie, siège à la tête d'un État bourgeois au nom de la nouvelle idéologie autoritaire.
5. L'inhomogénéité idéologique du nouvel autoritarisme met en évidence une autre caractéristique essentielle : son caractère historique ouvert. Ce serait une erreur de considérer l'extrême droite contemporaine comme statique, avec un caractère défini et évoluant vers une fin définie. Le processus de développement du nouvel autoritarisme dépendra d'un certain nombre de facteurs, tels que le rythme de l'aggravation des crises économiques et environnementales, l'acuité de la lutte des classes et la capacité de la gauche révolutionnaire à proposer une alternative.
6. Le nouvel autoritarisme se distingue également du fascisme classique par la scission institutionnelle entre les mouvements parlementaires et les mouvements de lutte dans la rue. L'exception notable est le BJP du Premier ministre indien Narenda Modi, qui possède une aile explicite de lutte dans la rue, le Rashtriya Swayamsevak Sangh. Cependant, ce fascisme de rue interagit avec l'hétérogénéité et le caractère ouvert du nouvel autoritarisme, car il n'y a pas d'étanchéité entre les activités des organisations parlementaires et les combats de rue, ni entre les groupes parlementaires et la violence de rue « spontanée » de la droite. Les activités des uns ont des répercussions sur les activités des autres.
Le pogrom raciste qui s'est déroulé au Royaume-Uni au cours de l'été 2024, où des années de rhétorique anti-immigration de la part de l'extrême droite et des partis traditionnels ont soudainement débouché sur des violences de rue massives, est un exemple qui a bien mis le phénomène en évidence. Aux États-Unis, si le trumpisme n'a pas de liens formels explicites avec un mouvement de combat de rue, il peut s'appuyer sur une histoire de violence d'autodéfense d'extrême droite extra-étatique qui va du KKK au mouvement des milices en passant par des groupes comme les Proud Boys et les Oathkeepers. La façon dont ces forces peuvent être utilisées à des fins anti-démocratiques violentes a été mise en évidence par le « coup d'État du 6 janvier 2021 » et le pardon massif accordé à ceux qui ont participé à cette tentative de coup d'État peu convaincante. Alors que Trump s'appuie actuellement principalement sur le pouvoir de l'exécutif pour démanteler autant d'aspects démocratiques de l'État bourgeois qu'il le peut, il est probable que cela crée une résistance à un moment donné, et il garde ces forces en réserve pour entrer en action si la violence extra-étatique devient nécessaire. L'expansion internationale des clubs actifs d'extrême droite, qui associent l'exercice physique à la suprématie de la race blanche, est une preuve supplémentaire de la tendance croissante à la violence de rue. L'avenir de la relation entre la violence de rue de l'extrême droite et les institutions parlementaires reste incertain, mais ce qui est clair, c'est que nous assistons à une recrudescence de cette violence dans le monde entier et qu'il existe un lien évident entre cette violence et la rhétorique et les activités de l'aile électorale du mouvement. Étant donné le caractère ouvert de l'extrême droite contemporaine, elle pourrait bien évoluer vers l'unification formelle de ces deux camps. Nous voyons des preuves de ce potentiel dans Fratelli d'Italia et Alternative pour l'Allemagne (AfD) en Allemagne, qui encouragent discrètement les forces de combat de rue par le biais de leurs organisations de jeunesse.
L'extrême droite définit la période
La politique mondiale continue d'exister dans l'ombre de la crise de 2008. Cette crise a été le tournant qui a définitivement brisé l'hégémonie que la classe capitaliste avait construite autour du néolibéralisme, créant un vide dans lequel de nouvelles voix, de gauche comme de droite, ont pu se faire entendre.
Comme presque toujours, ce mécontentement s'est d'abord exprimé spontanément dans des mouvements tels que le Printemps arabe, Occupy aux États-Unis et le 15M en Espagne. Ces mouvements ont exigé des changements fondamentaux dans le fonctionnement du système, exprimant un anticapitalisme spontané. Ces mouvements étaient également les héritiers des philosophies d'organisation inspirées par les anarchistes de l'après-guerre froide. Ils privilégiaient l'horizontalité sur l'efficacité, et leur rejet de la politique créait un vide qui demandait à être comblé.
Ce vide a été comblé par une nouvelle social-démocratie radicale résurgente sous la forme de groupes tels que Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, Die Linke en Allemagne, Momentum au Royaume-Uni et, aux États-Unis, l'insurrection social-démocrate au sein du Parti démocrate incarnée par la figure de Bernie Sanders. Alors que les socialistes étaient obligés de travailler aux côtés et même au sein de ces organisations pour s'engager dans la radicalisation, tout révolutionnaire lucide pouvait prédire la trajectoire de ces organisations à l'avance. En poursuivant une stratégie de socialisme par le haut, elles se sont isolées de la seule source capable de défier matériellement le système, la classe ouvrière consciente d'elle-même, et ont été disciplinées par le capital dans une lente et pathétique marche à reculons vers la rupture de leurs engagements libératoires et l'intégration au statu quo bourgeois.
Cela ne veut pas dire que l'extrême droite a stagné pendant cette période, mais elle n'a pas joué un rôle central dans la détermination du caractère de la période, dans la mesure où elle a décidé de la stratégie des révolutionnaires. En 2010, les Démocrates de Suède ont remporté 20 sièges au parlement et en Hongrie, Viktor Orbán est devenu chef du gouvernement. L'Aube dorée est entrée au parlement grec en 2012, et l'UKIP a remporté 27,5 % des voix lors des élections européennes de 2014, tandis que le Front national est devenu la plus grande section française de ce même organe. Le parti polonais Droit et Justice a remporté à la fois la présidence et le parlement en 2015, et l'English Defence League est descendue dans les rues du Royaume-Uni. Malgré ces gains de l'extrême droite, la période a été définie par une social-démocratie rajeunie et jeune qui a fait quelques progrès face à un courant bourgeois dominant qui tente de maintenir son hégémonie de plus en plus instable.
L'élection d'Orbán en 2010 a été un moment important dans la montée du nouvel autoritarisme. Avant son élection, M. Orbán avait engagé des avocats privés pour élaborer un plan visant à détruire rapidement la démocratie hongroise en démantelant le système d'équilibre des pouvoirs qui empêchait le pouvoir de rester en permanence entre les mains d'une seule faction. En fait, Orbán écrivait le manuel de ce que les nouveaux autoritaires devraient faire lorsqu'ils prennent les rênes d'un État bourgeois. En effet, il existe un lien direct entre Orbán et le Projet 2025, le document de 900 pages de la Fondation Heritage d'extrême droite qui informe les politiques de guerre éclair de l'actuelle Maison Blanche de Trump. Ce document décrit un plan pour une présidence étatsunienne d'extrême droite visant à attaquer l'« État profond », à démanteler l'appareil d'État et à le remplacer, le cas échéant, par des loyalistes d'extrême droite. Simultanément, le plan appelait à renforcer l'intervention de l'État sur des questions sociales telles que l'avortement et les droits des personnes transgenres, à démanteler la démocratie et à évoluer vers quelque chose que l'on pourrait plus ou moins qualifier d'État national-chrétien. Ce document a été rédigé sur les conseils de l'Institut du Danube, le groupe de réflexion anglophone d'Orbán, qui a établi une collaboration formelle avec la Heritage Foundation pour sa production.
La seconde moitié de la dernière décennie a été marquée par l'auto-immolation des nouveaux mouvements sociaux-démocrates, soit en prenant le pouvoir à l'État bourgeois et en revenant sur leur parole (comme Syriza), soit en entrant dans des coalitions gouvernementales bourgeoises (comme Podemos) et en trahissant leurs principes, soit en s'appuyant sur une conception tellement appauvrie de l'électoralisme qu'ils ont inévitablement vidé leur base de sa substance (comme le DSA). L'extrême droite a commencé à revendiquer plus d'importance au cours de cette période, avec le passage du Brexit, la première élection de Trump en 2016 et l'entrée de l'AfD au parlement fédéral allemand pour la première fois en 2017, obtenant 94 sièges et devenant le troisième plus grand parti du pays. Au centre de cette croissance, la guerre civile syrienne et la légère augmentation de la migration qui en a résulté, dont la droite s'est emparée pour créer un bouc émissaire utile. Cette période a également vu la croissance des mouvements d'extrême droite dans les rues, des 3 Percenters, Oath Keepers et Proud Boys aux États-Unis, à Generation Identity, Reichsbürger et Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West en Europe.
La fin de la décennie a été témoin d'énormes explosions sociales dans le monde entier. L'année 2019 a été marquée par des révoltes en Algérie, en Bolivie, au Chili, au Liban, au Soudan, en France, en Équateur, en Égypte, à Hong Kong, etc. Sans perspective socialiste révolutionnaire ni organisation lui permettant de devenir une arme sociale puissante, ces mouvements se sont arrêtés avant la révolution politique ou , le plus souvent, se sont effondrés sur eux-mêmes. Cependant, ces mouvements témoignent de l'énergie que de larges pans des classes populaires touchées par la crise ont encore en réserve.
La pandémie a tout changé. L'hégémonie de la classe dirigeante, déjà vacillante, a subi de plein fouet la pandémie et les conséquences économiques qui en ont découlé. La gauche a été la première à occuper le devant de la scène, avec un mouvement mondial pour la vie des Noir-es déclenché par le meurtre brutal de George Floyd par la police de Minneapolis, à la fin du mois de mai 2020. Des dizaines de millions de personnes de toutes origines sont descendues dans la rue aux États-Unis, d'abord en se livrant à des émeutes, en brûlant des postes de police et des voitures en signe de colère, puis en se transformant en un mouvement de protestation soutenu qui a duré des mois. Mais en l'absence d'organisation pour canaliser cette énergie et en raison de la réticence de la plus grande organisation de gauche de l'époque, la DSA, qui préférait se concentrer sur les élections de 2020 plutôt que de s'engager de manière significative dans la lutte populaire, ces mouvements ont peu à peu perdu de leur importance, cédant la place au centre. En s'attaquant au mouvement, le centre a tenté de retrouver sa stabilité en utilisant des arguments qui donnaient raison à la droite, en disant que le mouvement entraînait le chaos et la criminalité dans son sillage. La loi et l'ordre contre le crime et l'immigration sont devenus le cri de ralliement du centre et de l'extrême droite, et la gauche n'avait pas les moyens organisationnels de lancer une contre-attaque. Les mouvements qui ont suivi le soulèvement du Hamas à Gaza le 7 octobre 2023 n'ont fait que renforcer cette tendance, les centristes et l'extrême droite s'unissant pour défendre l'État sioniste contre les mouvements pour la justice en Palestine.
Au lendemain de la pandémie, et après plus d'une décennie de crise économique, la pensée conspirationniste a explosé, des théories QAnon pleines de tropes antisémites sur les « mondialistes » qui complotent pour détruire la civilisation occidentale de l'intérieur, au scepticisme anti-vaccin et à la théorie du « Grand Remplacement », selon laquelle les élites (souvent à dominante juive) ont conspiré pour détruire les populations blanches autochtones de l'Occident par l'immigration de masse. Avec une gauche radicale trop faible pour intervenir et un centre qui ne propose rien en dehors de la norme néolibérale qui a échoué, l'extrême droite a pu s'insérer dans la structure fissurée de l'hégémonie bourgeoise et se tailler une place en apparaissant comme une alternative au système en crise.
Nous nous trouvons donc dans une situation où l'hégémonie bourgeoise échoue et où la droite propose une vision alternative de l'ordre mondial. En 2022, le Rassemblement national de Le Pen, rebaptisé, a remporté 41,5 % des voix au second tour, et les Démocrates de Suède sont devenus le deuxième parti au Riksdag, tandis que les Fratelli d'Italia, aux racines fascistes, ont mené une coalition de droite à la victoire en octobre. En 2024, le Parti de la liberté autrichien a remporté les élections générales et les partis d'extrême droite ont fait d'énormes progrès aux élections du Parlement européen, sept États de l'UE, la Croatie, la République tchèque, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas et la Slovaquie, ayant tous des partis d'extrême droite au sein de leur gouvernement. Le succès du Rassemblement national aux élections européennes a incité le président français Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale et à convoquer des élections anticipées, au cours desquelles le Nouveau Front populaire de gauche a remporté 142 sièges face au Rassemblement national. Ces élections anticipées ont conduit à une situation de profonde incertitude en France, sans point d'atterrissage évident. Au Royaume-Uni, des pogroms anti-immigrés d'extrême droite ont balayé le pays à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août. Aujourd'hui, en 2025, les élections fédérales allemandes du 23 février ont placé l'AfD en deuxième position avec 20 % des voix, et Reform in Britain a augmenté le nombre de ses membres cotisants à 170 000, avec des chiffres en hausse dans les sondages, dépassant même la popularité des travaillistes.
La nouvelle gauche qui a émergé après 2008 a connu un déclin significatif dans la période post-pandémique. Podemos est devenu une coquille vide, et Die Linke a vu sa représentation se réduire à seulement quatre sièges après les élections européennes de 2024. Le NPA (Nouveau parti anticapitaliste) s'est scindé en 2021, soulignant l'erreur historique de la dissolution de la LCR (Ligue communiste révolutionnaire). Après avoir tourné autour de la vieille politique de Michael Harrington de « l'aile gauche du possible », l'ASD est entrée dans un effondrement des effectifs dont elle ne se remettra probablement jamais.
Bien que Die Linke, s'appuyant sur sa position de principe en faveur des immigré-es, ait augmenté sa marge à près de 9 % lors des récentes élections, il n'est pas certain que ce succès et l'afflux de jeunes membres puissent ébranler les structures réformistes qui s'étaient ossifiées. Bien qu'il puisse s'agir d'un endroit stratégiquement important pour les socialistes, si les membres ne sont pas capables de rompre avec les tendances réformistes et institutionnelles qui ont guidé l'organisation, ce succès pourrait bien s'avérer éphémère.
Il convient de préciser ici que les dynamiques de la période n'excluent nullement des restaurations temporaires de l'hégémonie bourgeoise, ni de brefs moments où le vent soufflerait à nouveau dans les voiles des mouvements réformistes. Il est tout à fait possible d'imaginer que les excès de Trump aboutissent à la restauration du Parti démocrate en 2028, par exemple. Cependant, comme il n'y a pas de solution à la polycrise dans le cadre du capitalisme, la dynamique générale sera à la montée en puissance de l'extrême droite. Les restaurations temporaires et les renouveaux réformistes ne modifieront pas le caractère fondamental et la trajectoire de la période.
En 2024, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis pour la deuxième fois a été la plus importante, car elle a représenté une sorte de tournant dans la montée de la nouvelle extrême droite. M. Trump est arrivé au pouvoir avec un programme anti-establishment, promettant de donner la priorité aux États-Unis afin de ressusciter le rêve américain moribond. Les actions qu'il a menées depuis son entrée en fonction confirment que son second mandat est véritablement motivé par le projet 2025, avec un assaut rapide contre les institutions démocratiques et les membres les plus marginalisés de la société étatsunienne.
Trump et son équipe poursuivent l'élaboration du manuel de jeu sur la manière dont les nouveaux autoritaires doivent opérer lorsqu'ils arrivent au pouvoir à la tête d'un État démocratique bourgeois. Ils ouvrent une nouvelle période dans laquelle le caractère du nouvel autoritarisme est devenu plus clair et dans laquelle l'extrême droite jouera un rôle central, tandis que la gauche n'est pas seulement à l'arrière-garde, mais se retrouve souvent sans tête ni pieds.
La lutte internationale contre l'extrême droite doit définir l'actuelle période de la gauche
Si l'engagement avec les nouvelles forces de gauche a défini le cycle politique précédent pour les socialistes révolutionnaires, la lutte contre les nouveaux autoritaires doit définir celui d'aujourd'hui.
Les socialistes révolutionnaires doivent contempler sobrement la réalité : la période de travail au sein des organisations sociales-démocrates de masse est révolue. Nous sommes dans une période où la conscience de classe a augmenté de manière significative par rapport à l'ère pré-2008, mais où l'effondrement de la foi dans les institutions démocratiques a largement dépassé cette croissance. Dans cette période, l'extrême droite profite de cet effondrement de la foi pour promouvoir une vision alternative du monde, et l'activité de la gauche s'est déplacée de l'arène électorale vers des mouvements sociaux de base disparates.
Que doivent faire les révolutionnaires dans cette situation ? Bien que ni l'analyse du nouvel autoritarisme ni la stratégie que nous développons pour le combattre ne soient identiques à celles de la période du fascisme classique, l'analyse et les stratégies que les révolutionnaires ont développées dans le passé pour lutter contre l'extrême droite peuvent également nous aider à déterminer comment nous pouvons nous organiser aujourd'hui pour repousser ce nouveau monstre.
Bien que sa forme exacte doive sans aucun doute être modifiée pour la période actuelle, la stratégie du front unique reste l'outil clé dont disposent les révolutionnaires aujourd'hui pour lutter contre la montée de l'extrême droite.
La stratégie du front unique a été initialement développée lorsque la vague révolutionnaire qui a secoué le monde après la Première Guerre mondiale a commencé à reculer dans une restauration capitaliste instable vers 1921. Lors de ses troisième et quatrième congrès, en 1921 et 1922, l'Internationale communiste, alors façonnée par la pensée de Lénine et de Trotsky, a présenté cette stratégie comme un moyen de faire face à la réaffirmation de l'hégémonie bourgeoise, dans laquelle les révolutionnaires opéraient, par définition, à partir d'une position de faiblesse relative.
La stratégie visait à sortir les partis communistes de cette situation en tendant la main et en formant des alliances avec la classe ouvrière organisée à la droite des communistes afin de gagner de l'influence parmi ces couches, en obtenant ensemble des réformes concrètes tout en restant critique à l'égard de leur direction. Cela a également permis à la classe de se familiariser avec l'expérience du travail à l'unisson de manière organisée et coordonnée, ce qui serait une caractéristique absolument essentielle de toute tentative révolutionnaire réussie. Cette stratégie était résumée dans le slogan « marcher séparément, frapper ensemble ».
Cette stratégie a pris un nouveau sens lorsque la restauration bourgeoise chancelante a commencé à succomber à la montée du fascisme. Dès 1923, Clara Zetkin préconise l'application de la tactique du front unique contre le fascisme. Malheureusement, la santé de Lénine l'éloignant peu à peu de la direction du mouvement ouvrier, le Comintern dirigé par Zinoviev adopte une ligne d'ultra-gauche, refusant de s'unir dans l'action avec les sociaux-démocrates, ce qui a permis la montée du fascisme en Italie en 1924, et en Allemagne neuf ans plus tard, en 1933.
Réalisant son erreur, mais tirant les mauvaises leçons, le Comintern stalinien s'est alors tourné vers la stratégie du Front populaire, qui cherchait à unir, non pas la classe ouvrière, mais tous les partis, y compris les partis bourgeois, qui s'opposaient à la montée du fascisme. Dans la pratique, cela signifiait que les révolutionnaires devaient sacrifier leur indépendance, et le programme du Front populaire devenir le programme d'une réforme bourgeoise modérée. N'offrant rien aux ouvriers et aux paysans, le Front populaire construit dans l'État espagnol s'est effondré sous le fascisme. Cet échec doit nous rappeler les limites d'une telle approche dans une période où un Nouveau Front Populaire a émergé comme bloc électoral en France qui tente d'endiguer la montée du nouvel autoritarisme du Rassemblement National.
Le front uni aujourd'hui
Une grande partie de ce qui a défini la stratégie du front uni contre le fascisme est applicable aujourd'hui dans la lutte contre les nouveaux autoritaires. Si la faiblesse de la gauche et la montée de l'extrême droite sont bien les caractéristiques de la période actuelle, alors le travail du front uni est redevenu essentiel.
Nous avons vu un excellent exemple de ce à quoi cela pouvait ressembler avec l'expérience d'Aube dorée en Grèce, où une organisation antifasciste, KEERFA (Mouvement uni contre le racisme et la menace fasciste), opérant sur les principes du travail de front uni, a complètement écrasé le parti fasciste ascendant. La KEERFA a mis en place une large coalition d'organisations de la classe ouvrière, des syndicats aux groupes révolutionnaires, qui partageaient un intérêt commun fondamental : empêcher l'Aube dorée de se développer.
Il doit s'agir d'organisations de masse qui opèrent ouvertement et qui, tout en prenant la sécurité au sérieux, ne privilégient pas une culture sécuritaire paranoïaque au détriment de l'ouverture et de l'efficacité.
Une nouvelle stratégie de front uni répond aux questions sur le rôle spécifique de l'organisation révolutionnaire aujourd'hui. Si nous acceptons, comme l'affirme Tempest, que la reconstruction de l'avant-garde de la classe ouvrière par le biais du travail de mouvement est un élément essentiel d'une stratégie de gauche significative aujourd'hui, alors la question se pose souvent de savoir quel rôle reste à jouer pour l'organisation révolutionnaire. Dans cette période de réaction croissante, il est clair qu'au-delà du rôle propagandiste de l'organisation révolutionnaire, son rôle militant doit être de tirer parti de son enracinement dans des luttes spécifiques pour construire des fronts anti-autoritaires qui unissent ces luttes, les rapprochent dans l'action de la politique révolutionnaire et s'efforcent d'écraser la menace de l'extrême-droite.
La question est de savoir comment sortir des enclaves fracturées de la gauche et faire de la politique de masse à une époque où la nouvelle social-démocratie est en recul et où l'extrême droite est en pleine ascension. Le processus de construction du front uni consiste également à trouver un moyen de continuer à s'engager avec les couches radicalisées plus larges de la société et d'accroître la position et l'influence de la politique révolutionnaire au sein de la classe. Si certains éléments de la classe s'éloignent de la nouvelle social-démocratie de la dernière décennie, il est essentiel de trouver un moyen d'entrer en relation avec ces éléments et de les attirer dans notre politique. Le front uni est le type d'outil qui permet d'atteindre cet objectif.
Les révolutionnaires doivent essayer de construire de larges coalitions d'organisations de la classe ouvrière, des mouvements sociaux de base aux syndicats et autres organisations socialistes. Il doit organiser des contre-manifestations contre les manifestations d'extrême droite et tenter de saper l'activité de l'extrême droite partout où il le peut, en rendant très peu attrayant le fait d'apparaître en public comme un partisan de l'extrême droite. La stratégie doit consister à créer des fissures au sein du mouvement d'extrême droite afin d'isoler ses éléments les plus radicaux. En attaquant et en exposant les réalités de l'aile la plus extrême du nouvel autoritarisme, nous pouvons essayer de forcer l'aile plus modérée à garder ses distances sous la menace de la réaction sociale.
Ce mouvement doit être international, car ce qui se passe dans une ville, ou dans un pays, n'a pas seulement des répercussions sur la politique de cet endroit. Aussi ironique que cela puisse paraître de s'organiser au niveau international pour une désintégration générale du monde, c'est exactement ce que fait l'extrême droite internationale. En témoigne un récent rassemblement d'extrême droite à Madrid, où des dirigeants d'extrême droite se sont réunis sous le slogan « Make Europe Great Again » (Rendre à l'Europe sa grandeur). Santiago Abascal de VOX, Marine le Pen, Viktor Orban et Matteo Salvini ont assisté à la réunion, où ils ont salué la victoire de Trump et parlé avec enthousiasme des chances de l'AfD aux prochaines élections allemandes.
Grâce à l'application internationale de la stratégie du front uni, la classe ouvrière peut remporter des victoires concrètes contre l'extrême droite internationale, tout en facilitant le processus par lequel de larges sections de la classe apprennent à travailler les unes avec les autres dans l'unité. À partir de là, la gauche peut commencer à jouer un rôle plus important dans l'élaboration de la forme et du contenu de la politique internationale. Mais pour la période à venir, le front uni doit être au centre de tout ce que nous faisons.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
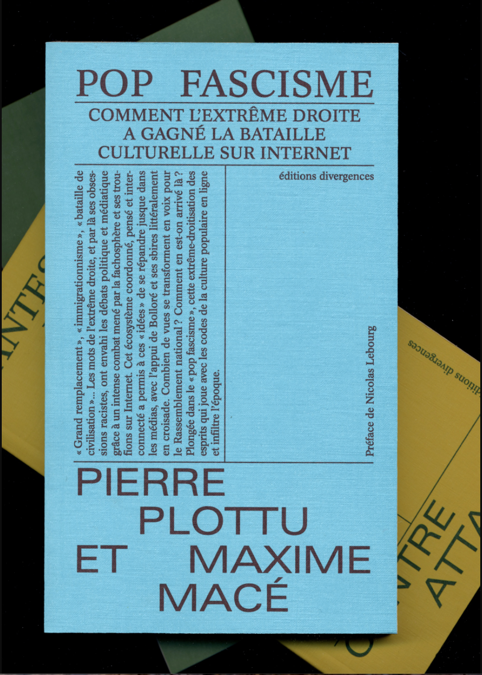
Pop fascisme de Pierre Plottu et Maxime Macé
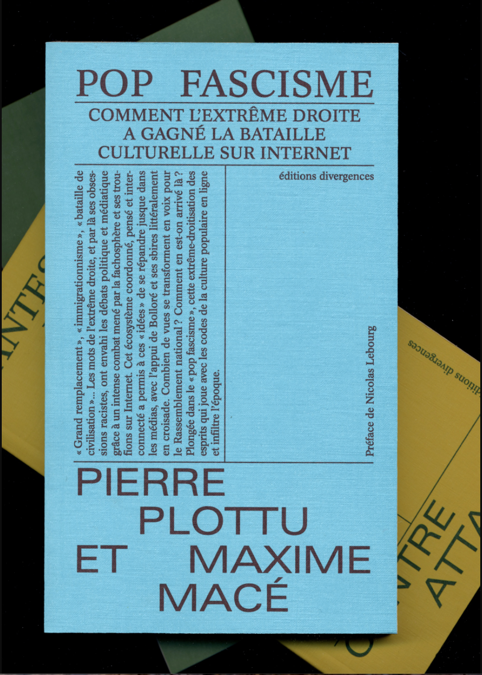
« Grand remplacement », « immigrationnisme », « bataille de civilisation »... Les mots de l'extrême droite, et par là ses obsessions racistes, ont envahi les débats politique et médiatique grâce à un intense combat mené par la fachosphère et ses troufions sur Internet.
Cet écosystème coordonné, pensé et interconnecté a permis à ces « idées » de se répandre jusque dans les médias, avec l'appui de Bolloré et de ses sbires littéralement en croisade. Combien de vues se transforment en voix pour le Rassemblement national ? Comment en est-on arrivé là ? Plongée dans le « pop fascisme », cette extrême-droitisation des esprits qui joue avec les codes de la culture populaire en ligne et infiltre l'époque.
Maxime Macé et Pierre Plottu sont journalistes spécialisés dans la couverture de l'extrême droite et de sa marge radicale. Après plusieurs années en tant qu'indépendants, ils œuvrent désormais à Libération où ils animent notamment la newsletter hebdomadaire dédiée Frontal. Ce livre est leur premier ouvrage.
Éditions Divergences
Paru le 27.9.24
180 pages
ISBN : 9791097088743

Extrême droite : La résistible ascension

Les progrès électoraux de l'extrême droite ces trente dernières années ont installé l'idée de son arrivée inéluctable et imminente au pouvoir. Cette idée a trop souvent permis au personnel politique et médiatique de s'exonérer de l'analyse des causes profondes et de l'alternative à y opposer.
Cet ouvrage, coordonné par le sociologue Ugo Palheta, propose au contraire de comprendre, à l'aide des travaux les plus récents en sciences sociales, la façon dont la route a été pavée à l'extrême droite. Quelles dynamiques sociales ont poussé une partie croissante des élites et certaines fractions des classes populaires à se ranger derrière elle ? Par quels médias et sous quelles formes ont été imposés les discours racistes, sexistes et LGBTI-phobes qui portent l'extrême-droitisation ? Quels réseaux ont appuyé et conforté ce glissement ?
De la préface de l'historien Johann Chapoutot à la postface de Clémence Guetté, co-présidente de l'Institut La Boétie, il s'agit ici d'opposer à la fatalité une analyse précise des forces, mais aussi des failles, de l'extrême droite. Donc de montrer que cette ascension est plus résistible qu'il n'y paraît.
Pour prendre connaissance du sommaire, consultez le fichier « extrait ».
Ugo Palheta
Ugo Palheta est maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille, rattaché au Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (Cresspa) et associé à l'Institut national d'études démographiques (Ined). Il est codirecteur de la publication de la revue Contretemps et animateur du podcast « Minuit dans le siècle ». Il a notamment publié La Possibilité du fascisme. France : trajectoire du désastre (La Découverte, 2018).
Couverture © Sylvain Lamy

De l’État pour le bien-être à l’État pour la guerre : le keynésianisme militaire

Le bellicisme a atteint son paroxysme en Europe. Tout a commencé lorsque les États-Unis de Trump ont considéré qu'il ne valait plus la peine de payer pour la « protection » militaire des capitales européennes contre des ennemis potentiels. Trump veut arrêter de financer l'essentiel de l'OTAN et de lui fournir sa puissance militaire, et il veut mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie afin de pouvoir concentrer la stratégie impérialiste américaine sur l'« hémisphère occidental » et le Pacifique, dans le but de « contenir » et d'affaiblir l'essor économique de la Chine.
24 mars 2025 | tiré du site du CADTM
De l'État pour le bien-être à l'État pour la guerre : le keynésianisme militaire
La stratégie de Trump a fait paniquer les élites dirigeantes européennes. Elles s'inquiètent soudain de la défaite de l'Ukraine face aux forces russes et, avant longtemps, de la présence de Poutine aux frontières de l'Allemagne ou, comme l'affirment le premier ministre travailliste britannique Keir Starmer et un ancien chef du MI5, « dans les rues britanniques ».
Quelle que soit la validité de ce danger supposé, l'occasion a été créée pour les militaires et les services secrets européens de « faire monter les enchères » et d'appeler à la fin des soi-disant « dividendes de la paix » qui ont commencé après la chute de la « redoutable » Union soviétique et d'entamer maintenant le processus de réarmement. La responsable de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, a présenté la politique étrangère de l'UE telle qu'elle la conçoit : « Si, ensemble, nous ne sommes pas en mesure d'exercer une pression suffisante sur Moscou, comment pouvons-nous prétendre vaincre la Chine ?
Plusieurs arguments sont avancés pour réarmer le capitalisme européen. Bronwen Maddox, directrice de Chatham House, le groupe de réflexion sur les relations internationales, qui présente principalement les points de vue de l'État militaire britannique, a donné le coup d'envoi en affirmant que « les dépenses de “défense” “sont le plus grand bien public de tous” car elles sont nécessaires à la survie de la “démocratie” face aux forces autoritaires. Mais la défense de la démocratie a un prix :
« le Royaume-Uni pourrait devoir emprunter davantage pour financer les dépenses de défense dont il a si urgemment besoin. Au cours de l'année prochaine et au-delà, les hommes politiques devront se préparer à récupérer de l'argent en réduisant les allocations de maladie, les pensions et les soins de santé ».
Elle poursuit :
« S'il a fallu des décennies pour accumuler ces dépenses, il faudra peut-être des décennies pour les inverser ». « M. Starmer devra bientôt fixer une date à laquelle le Royaume-Uni atteindra les 2,5 % du PIB consacrés aux dépenses militaires - et un chœur de voix s'élève déjà pour dire que ce chiffre devrait être plus élevé. En fin de compte, les hommes politiques devront persuader les électeurs de renoncer à certains de leurs avantages pour financer la défense. »
Martin Wolf, le gourou de l'économie libérale keynésienne du Financial Times, s'est lancé dans l'aventure :
« les dépenses de défense devront augmenter de manière substantielle. Rappelons qu'elles représentaient 5 % du PIB britannique, voire plus, dans les années 1970 et 1980. Il ne sera peut-être pas nécessaire de maintenir ces niveaux à long terme : la Russie moderne n'est pas l'Union soviétique. Toutefois, il pourrait être nécessaire d'atteindre ce niveau pendant la phase de préparation, en particulier si les États-Unis se retirent. »
Comment financer cela ?
« Si les dépenses de défense doivent être augmentées en permanence, les impôts doivent augmenter, à moins que le gouvernement ne parvienne à réduire suffisamment les dépenses, ce qui est peu probable. »
Mais ne vous inquiétez pas, les dépenses en chars, en troupes et en missiles sont en fait bénéfiques pour l'économie, affirme M. Wolf.
« Le Royaume-Uni peut aussi raisonnablement s'attendre à des retours économiques sur ses investissements en matière de défense. Historiquement, les guerres ont été la mère de l'innovation ».
Il cite ensuite les merveilleux exemples des gains qu'Israël et l'Ukraine ont tirés de leurs guerres :
« La “start up economy” d'Israël a commencé dans son armée. Les Ukrainiens ont révolutionné la guerre des drones ».
Il ne mentionne pas le coût humain de l'innovation par la guerre. Wolf poursuit :
« Le point crucial, cependant, est que la nécessité de dépenser beaucoup plus pour la défense devrait être considérée comme plus qu'une simple nécessité et aussi plus qu'un simple coût, bien que les deux soient vrais. Si l'on s'y prend bien, il s'agit également d'une opportunité économique ».
La guerre est donc le moyen de sortir de la stagnation économique.
Wolf s'écrie que la Grande-Bretagne doit s'y mettre :
« Si les États-Unis ne sont plus les promoteurs et les défenseurs de la démocratie libérale, la seule force potentiellement assez puissante pour combler le vide est l'Europe. Si les Européens veulent réussir cette lourde tâche, ils doivent commencer par sécuriser leur territoire. Leur capacité à le faire dépendra à son tour des ressources, du temps, de la volonté et de la cohésion ..... Il ne fait aucun doute que l'Europe peut augmenter considérablement ses dépenses en matière de défense ».
M. Wolf a affirmé que nous devions défendre les « valeurs européennes » vantées que sont la liberté individuelle et la démocratie libérale.
« Ce sera économiquement coûteux et même dangereux, mais nécessaire, car l'Europe a des « cinquièmes colonnes » presque partout. Il conclut : « Si l'Europe ne se mobilise pas rapidement pour sa propre défense, la démocratie libérale risque de disparaître complètement. Aujourd'hui, on se croirait un peu dans les années 1930. Cette fois, hélas, les Etats-Unis semblent être du mauvais côté ».
Considéré comme « conservateur progressiste », l'éditorialiste du Financial Times Janan Ganesh l'a exprimé sans ambages :
« L'Europe doit réduire son État-providence pour construire un État de guerre. Il n'y a aucun moyen de défendre le continent sans réduire les dépenses sociales ».
Il a clairement indiqué que les gains obtenus par les travailleurs après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui ont été progressivement réduits au cours des 40 dernières années, doivent maintenant être totalement supprimés.
"Selon Janan Ganesh du Financial Times les gains obtenus par les travailleurs après la fin de la Seconde Guerre mondiale doivent être totalement supprimés"
« La mission consiste désormais à défendre la vie de l'Europe. Comment financer
un continent mieux armé, si ce n'est en réduisant l'État-providence ? »
L'âge d'or de l'État-providence de l'après-guerre n'est plus possible.
« Toute personne de moins de 80 ans ayant passé sa vie en Europe peut être excusée de considérer un État-providence géant (sic - MR) comme la voie naturelle des choses. En réalité, c'était le produit de circonstances historiques étranges, qui ont prévalu dans la seconde moitié du 20e siècle et qui ne prévalent plus. »
"Ganesh du Financial Times écrit : « L'Europe doit réduire son État-providence pour construire un État de guerre. Il n'y a aucun moyen de défendre le continent sans réduire les dépenses sociales »"
Oui, c'est exact, les gains obtenus par les travailleurs à l'âge d'or étaient l'exception par rapport à la norme du capitalisme (« circonstances historiques étranges »).
Mais maintenant,
« les engagements en matière de pensions et de soins de santé allaient être suffisamment difficiles à assumer pour la population active, même avant le choc actuel en matière de défense...
Les gouvernements vont devoir se montrer plus pingres avec les personnes âgées. Dans tous les cas, l'État-providence tel que nous l'avons connu doit reculer quelque peu : pas suffisamment pour que nous ne l'appelions plus par ce nom, mais suffisamment pour que cela fasse mal ».
Ganesh, le vrai conservateur, voit dans le réarmement l'occasion pour le capital de procéder aux réductions nécessaires de la protection sociale et des services publics.
« Il est plus facile de faire accepter des réductions de dépenses au nom de la défense qu'au nom d'une notion généralisée d'efficacité. .... Pourtant, ce n'est pas l'objectif de la défense, et les hommes politiques doivent insister sur ce point. L'objectif est la survie ».
Le soi-disant « capitalisme libéral » doit donc survivre, ce qui signifie réduire le niveau de vie des plus pauvres et dépenser de l'argent pour faire la guerre. De l'État providence à l'État de guerre.
Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a fait monter d'un cran le bellicisme. Il a déclaré que la Pologne
« doit se tourner vers les possibilités les plus modernes, y compris les armes nucléaires et les armes modernes non conventionnelles ».
Nous pouvons supposer que le terme « non conventionnel » désigne les armes chimiques ?
Tusk :
« Je le dis en toute responsabilité, il ne suffit pas d'acheter des armes conventionnelles, les plus traditionnelles ».
Ainsi, presque partout en Europe, l'appel est lancé en faveur d'une augmentation des dépenses de « défense » et d'un réarmement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé un plan Rearm Europe qui vise à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour financer une augmentation massive des dépenses de défense.
« Nous sommes à l'ère du réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense, à la fois pour répondre à l'urgence à court terme d'agir et de soutenir l'Ukraine, mais aussi pour répondre à la nécessité à long terme d'assumer davantage de responsabilités pour notre propre sécurité européenne », a-t-elle déclaré.
"L'objectif des dépenses de défense éclipsera les dépenses de déficit disponibles pour la lutte contre le changement climatique et pour les infrastructures qui font cruellement défaut"
En vertu d'une « clause de sauvegarde », la Commission européenne demandera une augmentation des dépenses d'armement même si elle enfreint les règles budgétaires en vigueur. Les fonds COVID non utilisés (90 milliards d'euros) et davantage d'emprunts par le biais d'un « nouvel instrument » suivront, afin de fournir 150 milliards d'euros de prêts aux États membres pour financer des investissements de défense conjoints dans des capacités paneuropéennes, y compris la défense aérienne et antimissile, les systèmes d'artillerie, les missiles et les munitions, les drones et les systèmes anti-drones. Mme Von der Leyen a affirmé que si les pays de l'UE augmentaient leurs dépenses de défense de 1,5 % du PIB en moyenne, 650 milliards d'euros pourraient être libérés au cours des quatre prochaines années. Mais il n'y aurait pas de financement supplémentaire pour les investissements, les projets d'infrastructure ou les services publics, car l'Europe doit consacrer ses ressources à la préparation à la guerre.
Dans le même temps, comme le souligne le FT, le gouvernement britannique
« effectue une transition rapide du vert au gris cuirassé en plaçant désormais la défense au cœur de son approche de la technologie et de la fabrication ».
M. Starmer a annoncé une augmentation des dépenses de défense à 2,5 % du PIB d'ici 2027 et l'ambition d'atteindre 3 % dans les années 2030. La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, qui n'a cessé de réduire les dépenses consacrées aux allocations familiales, aux allocations d'hiver pour les personnes âgées et aux prestations d'invalidité, a annoncé que les attributions du nouveau Fonds national de richesse du gouvernement travailliste seraient modifiées afin de lui permettre d'investir dans la défense. Les fabricants d'armes britanniques sont dans l'embarras. « Si l'on fait abstraction de l'éthique de la production d'armes, qui décourage certains investisseurs, la défense en tant que stratégie industrielle a beaucoup à offrir », a déclaré un PDG.
Il existe un groupe clair de bénéficiaires du programme de dépenses massives : l'industrie de la défense de l'UE
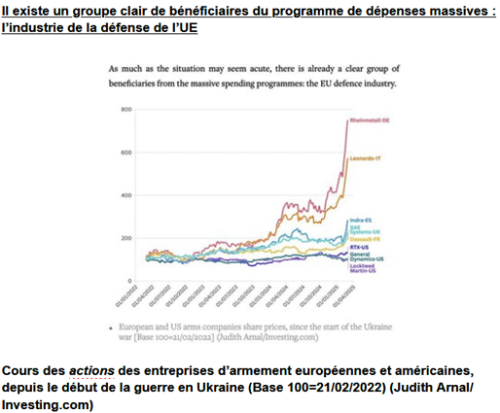
Cours des actions des entreprises d'armement européennes et américaines, depuis le début de la guerre en Ukraine (Base 100=21/02/2022) (Judith Arnal/Investing.com)
En Allemagne, le chancelier élu du nouveau gouvernement de coalition, le Chrétien démocrate Friedrich Merz, a fait adopter par le parlement allemand une loi mettant fin au « frein fiscal », qui interdisait aux gouvernements allemands d'emprunter au-delà d'une limite stricte ou d'augmenter la dette pour financer les dépenses publiques. Mais aujourd'hui, les dépenses militaires déficitaires ont la priorité sur tout le reste, c'est le seul budget qui n'est pas limité. L'objectif des dépenses de défense éclipsera les dépenses de déficit disponibles pour la lutte contre le changement climatique et pour les infrastructures qui font cruellement défaut.
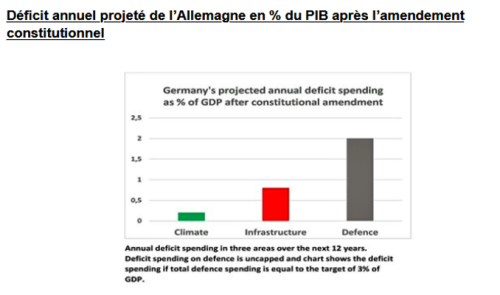
Dépenses annuelles déficitaires dans trois domaines au cours des 12 prochaines années. Le déficit des dépenses de défense n'est pas plafonné et le graphique montre que le déficit des dépenses totales de défense est égal à l'objectif de 3 % du PIB
Les dépenses publiques annuelles dues au nouveau paquet fiscal allemand seront plus importantes que le boom des dépenses qui a suivi le plan Marshall d'après-guerre et la réunification de l'Allemagne au début des années 1990.
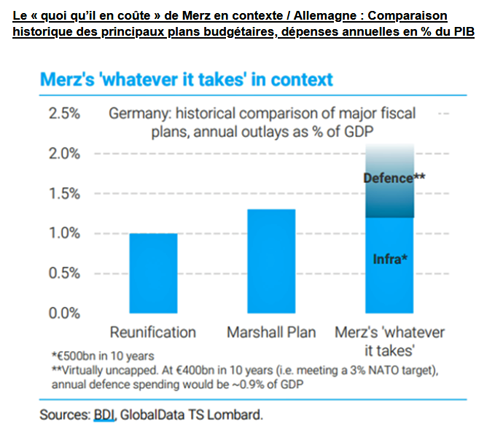
Traduction du graphique :
Reunification : Réunification
Marshall Plan : Plan Marshall
Merz's 'whatever it takes : Le « quoi qu'il en coûte » de Merz
€500bn in 10 years : 500 milliards de dollars en 10 ans
Virtually uncapped. At €400bn in 10 years (i.e. meetinf a 3% NATO target), annual defense spending would be around 0,9% of GDP : Pratiquement sans plafond. À 400 milliards d'euros en 10 ans (c'est-à-dire pour atteindre l'objectif de 3 % fixé par l'OTAN), les dépenses de défense annuelles représenteraient environ 0,9 % du PIB.
Cela m'amène à parler des arguments économiques en faveur des dépenses militaires. Les dépenses militaires peuvent-elles relancer une économie en proie à la dépression, comme c'est le cas dans une grande partie de l'Europe depuis la fin de la grande récession en 2009 ? Certains keynésiens le pensent. Le fabricant d'armes allemand Rheinmetall affirme que l'usine d'Osnabrück de Volkswagen, laissée à l'abandon, pourrait être un candidat de choix pour une reconversion dans la production militaire. L'économiste keynésien Matthew Klein, coauteur avec Michael Pettis de Trade Wars are Class Wars, a salué cette nouvelle :
« L'Allemagne construit déjà des chars d'assaut. Je l'encourage à en construire beaucoup plus ».
La théorie du « keynésianisme militaire » a une histoire. Une de ses variantes était le concept d'« économie d'armement permanente », adopté par certains marxistes pour expliquer pourquoi les principales économies ne sont pas entrées en dépression après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ont au contraire connu une longue période d'expansion, avec seulement de légères récessions, qui a duré jusqu'à l'effondrement international de 1974-1955. Cet « âge d'or » ne pouvait s'expliquer, selon eux, que par des dépenses militaires permanentes destinées à maintenir la demande globale et le plein emploi.
Mais cette théorie du boom de l'après-guerre n'est pas étayée. Les dépenses militaires du gouvernement britannique sont passées de plus de 12 % du PIB en 1952 à environ 7 % en 1960 et ont diminué tout au long des années 1960 pour atteindre environ 5 % à la fin de la décennie. Pourtant, l'économie britannique n'a jamais été aussi florissante depuis lors. Dans tous les pays capitalistes avancés, les dépenses de défense représentaient à la fin des années 1960 une fraction nettement plus faible de la production totale qu'au début des années 1950 : de 10,2 % du PIB en 1952-1953, au plus fort de la guerre de Corée, elles n'atteignaient plus que 6,5 % en 1967. Pourtant, la croissance économique s'est maintenue pratiquement tout au long des années 1960 et au début des années 1970.
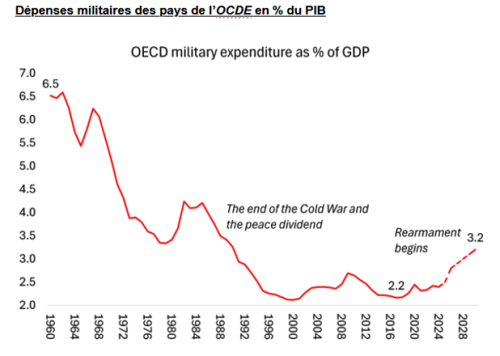
Traduction du graphique :
The end of the cold war and the peace dividend : La fin de la Guerre froide et le dividende de la paix
Rearmament begins : Début du réarmement
Le boom de l'après-guerre n'a pas été le résultat de dépenses publiques d'armement de type keynésien, mais s'explique par le taux élevé de rentabilité du capital investi par les grandes économies après la guerre. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Parce que les grandes économies connaissaient une croissance relativement rapide et que la rentabilité était élevée, les gouvernements pouvaient se permettre de maintenir les dépenses militaires dans le cadre de leur objectif géopolitique de « guerre froide » visant à affaiblir et à écraser l'Union soviétique - le principal ennemi de l'impérialisme à l'époque.
Par-dessus tout, le keynésianisme militaire est contraire aux intérêts des travailleurs et de l'humanité. Sommes-nous favorables à la fabrication d'armes pour tuer des gens afin de créer des emplois ? Cet argument, souvent défendu par certains dirigeants syndicaux, fait passer l'argent avant la vie.
Keynes a dit un jour :
« Le gouvernement devrait payer les gens pour qu'ils creusent des trous dans le sol et les remplissent ensuite. »
Les gens répondaient :
« C'est stupide, pourquoi ne pas payer les gens pour construire des routes et des écoles ».
Keynes répondrait :
« Très bien, payez-les pour construire des écoles. Le fait est que ce qu'ils font n'a pas d'importance tant que le gouvernement crée des emplois ».
Keynes avait tort. C'est important. Le keynésianisme préconise de creuser des trous et de les remplir pour créer des emplois. Le keynésianisme militaire préconise de creuser des tombes et de les remplir de cadavres pour créer des emplois. Si la manière dont les emplois sont créés n'a pas d'importance, pourquoi ne pas augmenter considérablement la production de tabac et promouvoir la dépendance pour créer des emplois ? À l'heure actuelle, la plupart des gens s'opposeraient à une telle mesure, qu'ils considèrent comme directement nuisible à la santé. La fabrication d'armes (conventionnelles et non conventionnelles) est également directement nuisible. Et il existe de nombreux autres produits et services socialement utiles qui pourraient créer des emplois et des salaires pour les travailleurs (comme les écoles et les logements).
Le ministre de la défense du gouvernement britannique, John Healey, a récemment insisté sur le fait que l'augmentation du budget de l'armement
« ferait de notre industrie de la défense le moteur de la croissance économique dans ce pays »
.
C'est une excellente nouvelle. Malheureusement pour M. Healey, l'association commerciale de l'industrie de l'armement britannique (ADS) estime que le Royaume-Uni compte environ 55 000 emplois dans le secteur de l'exportation d'armes et 115 000 autres au sein du ministère de la défense. Même si l'on inclut ce dernier, cela ne représente que 0,5 % de la main-d'œuvre britannique (pour plus de détails, voir le document Arms to Renewables de CAAT). Même aux États-Unis, le ratio est à peu près le même.
Une question théorique est souvent débattue dans l'économie politique marxiste. Il s'agit de savoir si la production d'armes est productive de valeur dans une économie capitaliste. La réponse est oui, pour les producteurs d'armes. Les fournisseurs d'armes livrent des marchandises (armes) qui sont payées par le gouvernement. Le travail qui les produit est donc productif de valeur et de plus-value. Mais au niveau de l'ensemble de l'économie, la production d'armes est improductive de valeur future, de la même manière que le sont les « produits de luxe » destinés à la seule consommation capitaliste. La production d'armes et les produits de luxe ne réintègrent pas le processus de production suivant, que ce soit en tant que moyens de production ou en tant que moyens de subsistance pour la classe ouvrière. Tout en étant productive de plus-value pour les capitalistes de l'armement, la production d'armes n'est pas reproductive et menace donc la reproduction du capital. Par conséquent, si l'augmentation de la production globale de plus-value dans une économie ralentit et que la rentabilité du capital productif commence à chuter, la réduction de la plus-value disponible pour l'investissement productif en vue d'investir dans les dépenses militaires peut nuire à la « santé » du processus d'accumulation capitaliste.
Le résultat dépend de l'effet sur la rentabilité du capital. Le secteur militaire a généralement une composition organique du capital plus élevée que la moyenne de l'économie, car il incorpore des technologies de pointe. Le secteur de l'armement aurait donc tendance à faire baisser le taux de profit moyen. D'un autre côté, si les impôts perçus par l'État (ou les réductions des dépenses civiles) pour financer la fabrication d'armes sont élevés, la richesse qui irait autrement au travail peut être distribuée au capital et peut donc augmenter la plus-value disponible. Les dépenses militaires peuvent avoir un effet légèrement positif sur les taux de profit dans les pays exportateurs d'armes, mais pas dans les pays importateurs d'armes. Dans ces derniers, les dépenses militaires sont une déduction des profits disponibles pour l'investissement productif.
Dans l'ensemble, les dépenses d'armement ne peuvent pas être décisives pour la santé de l'économie capitaliste. En revanche, une guerre totale peut aider le capitalisme à sortir de la dépression et du marasme. L'un des principaux arguments de l'économie marxiste (du moins dans ma version) est que les économies capitalistes ne peuvent se redresser durablement que si la rentabilité moyenne des secteurs productifs de l'économie augmente de manière significative. Et cela nécessite une destruction suffisante de la valeur du « capital mort » (accumulation passée) qu'il n'est plus rentable d'employer.
La Grande Dépression des années 1930 dans l'économie américaine a duré si longtemps parce que la rentabilité ne s'est pas redressée tout au long de la décennie. En 1938, le taux de profit des entreprises américaines était encore inférieur à la moitié du taux de 1929. La rentabilité ne s'est redressée qu'une fois l'économie de guerre en marche, à partir de 1940.

Ce n'est donc pas le « keynésianisme militaire » qui a sorti l'économie américaine de la Grande Dépression, comme certains keynésiens aiment à le penser. La reprise de l'économie américaine après la Grande Dépression n'a pas commencé avant le début de la guerre mondiale. L'investissement n'a décollé qu'à partir de 1941 (Pearl Harbor) pour atteindre, en pourcentage du PIB, plus du double du niveau atteint en 1940. Comment cela se fait-il ? Ce n'est pas le résultat d'une reprise des investissements du secteur privé. Ce qui s'est produit, c'est une augmentation massive des investissements et des dépenses publiques. En 1940, les investissements du secteur privé étaient encore inférieurs au niveau de 1929 et ont même continué à baisser pendant la guerre. Le secteur public a pris en charge la quasi-totalité des investissements, les ressources (valeur) étant détournées vers la production d'armes et d'autres mesures de sécurité dans une économie de guerre totale.
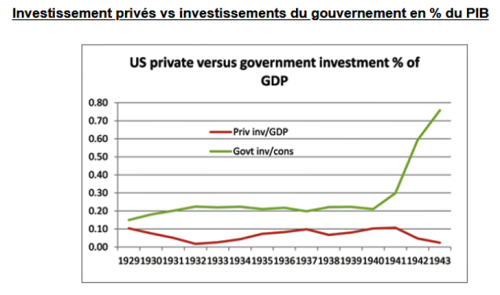
Priv inv/GDP : Investissements privés / PIB
Govt inv / GDP : Investissements du gouvernement / PIB
Mais l'augmentation de l'investissement et de la consommation publics n'est-elle pas une forme de relance keynésienne, mais à un niveau plus élevé ? Eh bien, non. La différence se révèle dans l'effondrement continu de la consommation. L'économie de guerre a été financée en limitant les possibilités pour les travailleurs de dépenser les revenus qu'ils tiraient de leur emploi en temps de guerre. L'épargne a été forcée par l'achat d'obligations de guerre, le rationnement et l'augmentation des impôts pour financer la guerre. L'investissement public signifiait la direction et la planification de la production par décret gouvernemental. L'économie de guerre n'a pas stimulé le secteur privé, elle a remplacé le « marché libre » et l'investissement capitaliste à des fins de profit. La consommation n'a pas rétabli la croissance économique comme l'auraient espéré les keynésiens (et ceux qui voient la cause de la crise dans la sous-consommation) ; au lieu de cela, elle a été investie principalement dans des armes de destruction massive.
La guerre a mis fin de manière décisive à la dépression. L'industrie américaine a été revitalisée par la guerre et de nombreux secteurs ont été orientés vers la production de défense (par exemple, l'aérospatiale et l'électronique) ou en ont été complètement dépendants (énergie atomique). Les changements scientifiques et technologiques rapides de la guerre ont poursuivi et intensifié les tendances amorcées pendant la Grande Dépression. La guerre ayant gravement endommagé toutes les grandes économies du monde, à l'exception des États-Unis, le capitalisme américain a acquis une hégémonie économique et politique après 1945.
Guiglelmo Carchedi explique : « Pourquoi la guerre a-t-elle entraîné un tel bond de la rentabilité au cours de la période 1940-1945 ? Non seulement le dénominateur du taux n'a pas augmenté, mais il a baissé parce que la dépréciation physique des moyens de production a été supérieure aux nouveaux investissements. Dans le même temps, le chômage a pratiquement disparu. La baisse du chômage a permis d'augmenter les salaires. Mais l'augmentation des salaires n'a pas entamé la rentabilité. En fait, la conversion des industries civiles en industries militaires a réduit l'offre de biens civils. L'augmentation des salaires et la production limitée de biens de consommation signifient que le pouvoir d'achat des travailleurs doit être fortement comprimé afin d'éviter l'inflation. Pour ce faire, on institue le premier impôt général sur le revenu, on décourage les dépenses de consommation (le crédit à la consommation est interdit) et on stimule l'épargne des consommateurs, principalement par le biais d'investissements dans des obligations de guerre. En conséquence, les travailleurs ont été contraints de reporter la dépense d'une partie importante de leurs salaires. Dans le même temps, le taux d'exploitation des travailleurs a augmenté. En substance, l'effort de guerre était une production massive de moyens de destruction financée par le travail ».
Laissons Keynes résumer la situation : « Il est, semble-t-il, politiquement impossible pour une démocratie capitaliste d'organiser les dépenses à l'échelle nécessaire pour faire les grandes expériences qui prouveraient mon point de vue - sauf dans des conditions de guerre », extrait de The New Republic (cité par P. Renshaw, Journal of Contemporary History 1999 vol. 34 (3) p. 377 -364).
Traduction : Éric Toussaint avec l'aide de Deepl
Source : Michael Roberts Blog
Auteur.e
Michael Roberts a travaillé à la City de Londres en tant qu'économiste pendant plus de 40 ans. Il a observé de près les machinations du capitalisme mondial depuis l'antre du dragon. Parallèlement, il a été un militant politique du mouvement syndical pendant des décennies. Depuis qu'il a pris sa retraite, il a écrit plusieurs livres. The Great Recession - a Marxist view (2009) ; The Long Depression (2016) ; Marx 200 : a review of Marx's economics (2018), et conjointement avec Guglielmo Carchedi ils ont édité World in Crisis (2018). Il a publié de nombreux articles dans diverses revues économiques universitaires et des articles dans des publications de gauche.
Il tient également un blog : thenextrecession.wordpress.com
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Enlèvements, dissolution : la répression s’abat sur les journalistes au Burkina Faso

Après l'organisation d'un congrès sur l'état de la presse dans le pays, l'Association des journalistes du Burkina a été dissoute, et deux de ses dirigeants enlevés. Reporters sans frontières dénonce une pratique “extrême” et “répressive” pour museler les journalistes.
Tiré de Courrier international.
Cinq cent mille francs CFA d'amende (762 euros), une suspension pour deux semaines… Telles sont les sanctions prises par le Conseil supérieur de la communication (CSC) contre le journaliste Luc Pagbelguem, relate Le Faso. Son tort ? Avoir filmé pour la chaîne privée BF1 le congrès extraordinaire de l'Association des journalistes du Burkina (AJB).
Le 21 mars, ce congrès avait dressé un état des lieux du secteur de la presse dans ce pays sahélien dirigé, depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, par le capitaine Ibrahim Traoré. Les membres du bureau de l'AJB avaient dénoncé la répression contre la presse et la propagande des médias d'État.
Ce 26 mars, BF1 a également publié un communiqué expliquant que la chaîne a envoyé “des lettres d'excuses officielles à la RTB et l'AIB [radiotélédiffusion du Burkina et agence d'information du Burkina, les médias qualifiés de relais de la propagande officielle], et supprimé le reportage sur ce congrès. Le communiqué indique aussi que le CSC souhaite que les excuses de BF1 soient “[étendues] aux autorités nationales”, selon le communiqué relayé par le site d'information Wakat Séra.
L'AJB en ligne de mire
Le messager se retrouve condamné, et contraint à la contrition publique, tandis que l'AJB a été dissoute par les autorités le 25 mars, au lendemain de l'enlèvement de deux de ses principaux responsables.
“Guezouma Sanogo, président de l'AJB, et Boukari Ouoba, vice-président de l'AJB, viennent d'être amenés par des individus se présentant comme des policiers du service des renseignements au CNP-NZ [Centre national de presse Norbert-Zongo] vers une destination inconnue. Le président était en entretien avec Gildas Ouédraogo [à] qui il avait donné rendez-vous à 10 heures”, indique le communiqué de l'association, publié sur sa page Facebook.
Guezouma Sanogo était journaliste à la radio publique. Boukari Ouoba a produit de nombreuses enquêtes et reportages pour le bimensuel d'investigation Le Reporter.
Le 21 mars, “les congressistes [avaient] vivement dénoncé les enlèvements et disparitions de journalistes, ainsi que les atteintes répétées à la liberté d'expression et de presse dans un contexte sécuritaire préoccupant”, souligne L'Observateur Paalga.
Série d'enlèvements
Tout en dénonçant la “mainmise de l'État” sur les médias, le président de l'association, Guezouma Sanogo, avait appelé la corporation à la solidarité afin que le métier “survive à toutes les répressions”. L'AJB avait également réclamé la libération des sept journalistes et chroniqueurs enlevés par des agents de l'État.
Le plus récemment enlevé, Idrissa Barry, a été kidnappé à la mairie de Saaba, en périphérie de Ouagadougou, le 19 mars.
Ces nouveaux enlèvements ont “suscité une vive réaction de Reporters sans frontières (RSF), qui a dénoncé une pratique ‘extrême' et ‘répressive' visant à faire taire les journalistes critiques du pouvoir”, indique Ouestaf, dans un article consacré au durcissement de la répression contre la presse.
Ce 26 mars, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, a déploré que “certains Burkinabè n'[aient] pas encore pris le train de la révolution en marche, préférant se soustraire à l'ordre et à la discipline”, cite Le Faso.
Courrier international
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’isolationnisme de gauche : un chemin vers l’insignifiance politique dans le débat sur la défense européenne

Le Parlement européen a voté une résolution qui définit la ligne en matière de défense et de réarmement. Les critiques les plus sévères à l'égard de la résolution de la Commission européenne sur la défense et le réarmement proviennent du groupe politique de gauche. Parmi eux, Manon Aubry (France Insoumise), qui dénonce : « Vous trouvez de l'argent pour les chars mais pas pour les hôpitaux. » Elle a remarqué avec sarcasme : « C'est comme si, tout d'un coup, il n'y avait plus de réchauffement climatique ni de pauvreté, et que la seule priorité était les véhicules blindés. » De même, Benedetta Scuderi des Verts soutient que « cette course aux armements » mine la croissance et les finances publiques. D'autres voix se sont jointes au chœur, notamment le coprésident de la Gauche Martin Schirdewan et Danilo Della Valle du Mouvement Cinq Étoiles. Pendant le discours de Della Valle, un groupe de représentants du Mouvement Cinq Étoiles a manifesté en agitant des pancartes telles que « Plus d'armes » ou « Plus d'emplois, moins d'armes ».
24 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/24/justice-sociale-defense-europeenne-securite-nationale-quatre-textes/
Au fond, la position de ces politiciens se résume à ceci : laissons le monde qui nous entoure s'effondrer, laissons les pays être envahis – ce n'est pas notre affaire. Ils déclarent vouloir préserver leur modèle social en augmentant le budget du bien-être tout en limitant les dépenses de sécurité – un idéal que partagerait tout politique de gauche. Ce qu'ils ignorent commodément, c'est que le modèle social qu'ils cherchent à protéger a été rendu possible précisément parce que la sécurité a été externalisée à d'autres acteurs – notamment aux États-Unis. Mais que se passe-t-il lorsque la sécurité n'est plus garantie par ces derniers ? C'est une question qu'ils n'abordent jamais, avançant des slogans simples à la place. Les réalités de la compétition internationale pour le pouvoir – désormais à l'un de ses moments les plus intenses depuis des décennies – sont simplement écartées.
Si la France, l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne ne font pas face à une menace militaire immédiate, pour la Pologne, les États baltes et les pays nordiques, le danger est direct. Lorsque votre voisin est l'une des plus grandes puissances militaires du monde, un pays qui a violé tous les principaux accords internationaux au cours de la dernière décennie, bombarde quotidiennement les villes ukrainiennes et dépasse tous les pays européens en dépenses militaires, la capacité à se défendre n'est pas une « course aux armements » – c'est une condition préalable à la survie.
Au cœur de cette question se trouve un refus de voir l'Europe comme un projet commun. Ironiquement, cette forme d'opposition de gauche à la défense européenne est une forme de nationalisme déguisé. Mais le nationalisme, dans sa forme historique, est précisément ce qui a alimenté des siècles de guerre, de destruction et de division sur le continent européen. L'Union européenne n'a jamais été simplement un projet économique – c'était un projet politique et de sécurité conçu pour prévenir la guerre, une leçon tirée des catastrophes répétées du passé.
Ce qui rend cette position particulièrement contre-productive pour la gauche, c'est qu'elle reflète l'isolationnisme des partis souverainistes de droite. Cela est clairement illustré par la façon dont l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a voté aux côtés de la Gauche. Cependant, contrairement à la gauche, la droite est constamment isolationniste. Leur position est simple : ils rejettent les engagements militaires externes et s'opposent aux migrants, renforçant une vision du monde dans laquelle seuls les intérêts de leur nation comptent, et rien au-delà de leurs frontières ne mérite d'attention. Cette position a au moins l'avantage de la cohérence, ce qui la rend plus attrayante pour les électeurs qui croient à l'intérêt personnel absolu.
En revanche, l'isolationnisme sélectif de la gauche – où les menaces de sécurité sont ignorées, mais où les appels à la solidarité internationale sur les questions sociales et environnementales persistent – manque de cohérence et ne trouve pas d'écho auprès du grand public. En attisant des sentiments isolationnistes et égoïstes, la gauche populiste cultive un terrain émotionnel qui, en fin de compte, profite à la droite. Après tout, si l'humeur politique dominante est celle de l'égocentrisme national, c'est la droite – et non la gauche – qui offre une vision plus claire.
Cependant, il faut reconnaître que les critiques de gauche et écologiques des plans de réarmement de l'Europe ont raison de souligner que ni la crise écologique ni l'inégalité systémique n'ont disparu. Ce sont en effet des menaces existentielles pour l'humanité. Mais sont-ils justifiés de présenter la préparation militaire et le soutien à l'Ukraine comme étant en opposition avec la lutte contre ces défis mondiaux ?
En réalité, la lutte pour la sécurité et la lutte contre le changement climatique sont profondément interconnectées.
Prenez la consommation de combustibles fossiles comme exemple. La dépendance de l'Europe – et particulièrement de l'Allemagne – aux combustibles fossiles russes bon marché n'a pas seulement été une catastrophe environnementale, mais aussi une grave responsabilité géopolitique. La dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie a donné au Kremlin l'un de ses outils les plus efficaces de levier politique sur l'Europe. Elle a financé la machine de guerre russe tout en rendant simultanément les nations européennes vulnérables au chantage énergétique. Ainsi, le développement rapide de sources d'énergie alternatives n'est pas seulement un impératif environnemental – c'est une nécessité géopolitique. C'est précisément ce que les Ukrainiens et d'autres États menacés par l'expansionnisme russe demandent. Les démocraties qui se rendent dépendantes des régimes autoritaires pour quelque chose d'aussi critique que l'énergie sabotent leur souveraineté et leur sécurité. Comme l'a justement dit Li Andersson, également membre du groupe de la Gauche, l'UE devrait se fixer un objectif stratégique de réduction de nos dépendances vis-à-vis d'acteurs externes, y compris dans les domaines de l'énergie et du numérique. Cependant, à ce moment précis, selon iStories, les autorités allemandes, russes et américaines discutent de la reprise des livraisons de pétrole et de gaz russes à l'Allemagne – une décision qui contredit directement la sécurité à long terme de l'Europe et son indépendance énergétique.
Résoudre des défis mondiaux tels que le changement climatique et les inégalités est sans aucun doute une priorité, mais le faire dans un cadre isolationniste et souverainiste est une contradiction. Dans un monde où le concept de bien commun disparaît et où la politique est dictée uniquement par la maximisation des intérêts nationaux, les forces qui en bénéficient ne sont pas celles qui défendent la justice climatique ou l'équité sociale. Au contraire, un tel monde est précisément ce que Trump et Poutine promeuvent ouvertement – un monde dans lequel la nature et la vie humaine sont des ressources dispensables dans la poursuite du pouvoir d'État, au service des autocrates au pouvoir. Cela ne signifie pas que les démocraties libérales privilégient automatiquement la nature et la vie humaine. La différence, cependant, est que dans les systèmes démocratiques, il y a de l'espace pour l'opposition et la possibilité d'imposer des visions alternatives. Il suffit de demander aux éco-activistes et aux syndicalistes russes et chinois leur capacité à lutter pour la justice sociale et climatique. Et aux États-Unis, la présidence Trump a démontré avec quelle rapidité les projets environnementaux et sociaux pouvaient être démantelés et leurs valeurs réduites au silence et criminalisées.
Ni la vie humaine ni l'environnement ne peuvent être protégés dans un État qui tombe dans la « zone d'intérêt » des puissances impériales autocratiques. L'ironie de la gauche isolationniste est qu'en rejetant la coopération en matière de sécurité, elle accélère sa propre insignifiance politique. Dans un monde dominé par une politique de grandes puissances sans contrôle, eux et leurs valeurs seront poussés à la marge – d'abord politiquement, puis physiquement.
Le contrat social dans nos sociétés est construit sur l'idée que l'État existe pour protéger les droits et les libertés de ses citoyens, et non pour les sacrifier à des ambitions expansionnistes. Les régimes autoritaires considèrent la vie humaine comme une ressource dispensable à utiliser dans la poursuite d'objectifs géopolitiques. Les démocraties sont contraintes par des considérations éthiques et politiques. Les États autoritaires possèdent un contrôle centralisé sur les médias et une répression efficace, ce qui leur permet de mener des guerres sans tenir compte de l'opinion publique. Les politiciens des démocraties, concentrés sur les cycles électoraux, privilégient les résultats à court terme par rapport aux stratégies à long terme.
Ainsi, les sociétés démocratiques font face à une vulnérabilité stratégique inhérente lorsqu'elles sont confrontées à des États autoritaires agressifs. Pourtant, de nombreuses personnes préfèrent s'accrocher à la croyance que la diplomatie, l'interdépendance économique ou la supériorité morale seule nous préserveront d'une éventuelle agression militaire. Cette pensée naïve conduit à l'inaction et à une vulnérabilité encore plus grande que les régimes autoritaires exploitent efficacement, en présentant une résistance aux puissances autocratiques comme impossible à gagner et inutile.
Les slogans abstraits sur « l'abolition de la guerre » révèlent non seulement un manque de solutions pratiques, mais aussi une réticence à prendre des responsabilités. Au lieu de cela, ils permettent de se sentir juste sans s'engager dans le travail difficile de gouvernance et de stratégie. En refusant de confronter les réalités militaires, ces mouvements deviennent des spectateurs plutôt que des acteurs, commentant les événements plutôt que de les façonner. Ce faisant, ils abandonnent finalement les tâches critiques de sécurité et de défense à ceux auxquels ils s'opposent idéologiquement.
Au lieu de se réfugier dans une rhétorique vide, la gauche doit façonner de manière proactive les solutions. La gauche doit s'unir pour promouvoir une stratégie de défense où la sécurité n'est pas financée par la réduction des programmes sociaux mais par l'augmentation des impôts sur les ultra-riches. Comme Li Andersson le soutient à juste titre, « Ce serait une erreur historique de financer cela en réduisant le bien-être social », car une telle démarche ne ferait qu'alimenter la montée de l'extrême droite. La mesure la plus immédiate et la plus efficace serait la confiscation des actifs russes gelés et leur réinvestissement rapide dans l'aide militaire à l'Ukraine. Pourtant, La France Insoumise, le parti que Manon Aubry représente au Parlement européen, a voté contre la confiscation des actifs russes dans son parlement national. De plus, le Mouvement 5 Étoiles a un historique de positions pro-Kremlin, qui comprennent l'opposition aux sanctions avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine.
Si la gauche ne prend pas de mesures concrètes face à l'agression, elle ne perdra pas seulement sa crédibilité mais renoncera également à son rôle dans la formation de l'avenir de l'Europe.
Hanna Perekhoda, 18 mars 2025
https://www.valigiablu.it/left-wing-rearm-europe/
Traduit pour ESSF par Adam Novak
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74145
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La gauche doit rejeter le faux dilemme entre justice sociale et sécurité nationale

L'armement militaire et l'armement social ne doivent pas être opposés, mais il faut que la gauche présente des revendications offensives pour la production d'armes à la demande, l'abolition des paradis fiscaux et l'obligation pour les milliardaires de payer.
24 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
Suite à la décision américaine d'abandonner l'Ukraine un pays qui constitue désormais la dernière ligne de défense pour la sécurité de l'Europe – l'UE n'a pas d'autre choix que d'agir de manière décisive. Assurer notre propre protection n'est plus un sujet de débat, mais une nécessité indéniable.
Pour la gauche, la question est de savoir si elle dispose d'un programme concret pour faire face à cette crise. Si elle continue à se plaindre de la militarisation – sans même proposer de solutions aux véritables menaces sécuritaires auxquelles nous sommes tous et toutes confrontées – la gauche sera complètement mise à l'écart, laissant le monde à lui-même tout en cultivant avec suffisance sa propre pureté idéologique.
Trois solutions différentes
Réduire les dépenses sociales pour augmenter le budget militaire est à la fois dangereux et réactionnaire. C'est exactement ce que les néolibéraux font déjà aujourd'hui : réduire les fonds alloués à la santé, à l'éducation, aux pensions et à la protection sociale – pour ensuite donner plus de ressources à la défense.
Il est clair que l'affaiblissement de la sécurité sociale exacerbera les inégalités, créera des troubles sociaux et finira par déstabiliser les démocraties. À l'heure où le populisme de droite se développe, les politiques d'austérité ne feront que renforcer les forces antidémocratiques. Étant donné le soutien évident que la Russie et les États-Unis apportent à ces forces, c'est exactement ce que Trump et Poutine espèrent.
Une autre solution consiste à augmenter les impôts des ultra-riches et des multinationales. Celles et ceux qui ont le plus bénéficié de la démocratie devraient contribuer le plus à sa défense. L'introduction d'impôts progressifs sur la fortune, de taxes sur l'énergie et de règles fiscales plus strictes pour les entreprises peut générer des revenus sans frapper l'ensemble de la population.
Toutefois, une telle stratégie nécessite une coordination internationale pour empêcher la fuite des capitaux, car les milliardaires et les entreprises chercheront sans aucun doute à transférer leurs actifs dans des paradis fiscaux. L'annonce récente par Trump de visas dorés pour les ultra-riches montre qu'il se prépare déjà à un tel scénario en renforçant les États-Unis en tant que havre de paix pour les fraudeurs fiscaux. La Suisse se trouve dans une position similaire puisqu'elle ne fait pas partie de l'UE… précisément pour conserver son statut de paradis fiscal.
Ce n'est pas nouveau. Au siècle dernier, alors que d'autres pays augmentaient les impôts pour financer leurs efforts de guerre, la Suisse a accueilli des milliardaires et s'est enrichie de manière éhontée. Elle pourrait très bien répéter la même stratégie opportuniste.
Une troisième option consiste à confisquer les 300 milliards d'euros de fonds russes gelés et à les utiliser pour financer la défense de l'Ukraine et renforcer la sécurité de l'Europe. De cette manière, la Russie serait tenue financièrement responsable de ses crimes de guerre tout en évitant de faire peser des charges supplémentaires sur les citoyens européens.
Toutefois, les autorités de l'UE craignent qu'une telle décision ne crée un précédent susceptible de saper la confiance dans leurs systèmes financiers, ne serait-ce que pour ceux qui envahissent des États souverains et commettent des crimes de guerre. Toutefois, la justice peut constituer un précédent dangereux dans un système fondé sur la protection des intérêts des riches et des puissants.
La reconnaissance de normes morales dans les décisions économiques et politiques risque d'ébranler les fondements du capitalisme. Une idée impensable pour celles et ceux qui profitent de ses injustices.
Les Verts et les Rouges doivent présenter leurs propres propositions
Si la gauche veut rester pertinente, elle doit développer une stratégie claire en matière de politique de défense. Ignorer la sécurité militaire ne fera que permettre à la droite de monopoliser le débat et de dépeindre la gauche comme naïve ou faible – et si c'était le cas, ce ne serait pas une accusation injuste.
La gauche doit rejeter le faux dilemme entre justice sociale et sécurité nationale. La sécurité ne doit pas être financée en réduisant les pensions ou les soins de santé, mais en veillant à ce que les milliardaires et les multinationales contribuent à leur juste part.
La gauche doit lutter pour une fiscalité équitable, supprimer les niches fiscales qui permettent aux entreprises d'échapper à l'impôt et sévir contre les paradis fiscaux, y compris la Suisse.
Aucun pays européen ne peut se défendre seul. Au lieu d'augmenter massivement les budgets militaires nationaux, l'UE devrait renforcer les mécanismes de sécurité collective. La sécurité énergétique doit également être considérée comme une partie intégrante de la stratégie militaire : en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes, nous pouvons empêcher un futur chantage économique.
Surtout, la gauche doit agir rapidement pour obtenir la confiscation des biens de l'État russe. Retarder cette décision pour protéger les intérêts de l'élite financière ne fait qu'enhardir les attaquants.
Hanna Perekhoda
Hanna Perekhoda est historienne et chercheuse à l'Université de Lausanne et activiste au sein de l'ONG ukrainienne « Sotsialnyi Rukh ».
https://solidaritet.dk/venstrefloejen-maa-afvise-det-falske-dilemma-mellem-social-retfaerdighed-og-national-sikkerhed/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment gérer les dilemmes de défense de l’Europe ?

Le partage imminent de l'Ukraine entre Trump et Poutine a divisé l'opinion publique européenne, y compris parmi les amis de l'Ukraine. Ici, Chris Zeller conteste l'analyse récente de Hanna Perekhoda sur la défense et la solidarité européennes..
Chère Hanna,
Je comprends tes arguments. Je partage ta position selon laquelle nous avons besoin d'une perspective de solidarité pour l'ensemble du continent européen. Cette perspective inclut un soutien massif à la résistance ukrainienne. Cependant, le fait que les pays d'Europe et les États-Unis aient jusqu'à présent accordé trop peu de soutien à l'Ukraine n'est pas dû à une infériorité militaire vis-à-vis de la Russie, mais à des raisons politiques et économiques. Au moins certains secteurs importants du capital ont toujours visé à reprendre des « relations économiques raisonnables » avec la Russie.
Il est juste d'exiger que les États européens garantissent que l'Ukraine puisse se défendre. Je suppose que les stocks d'armes de défense aérienne de tous les États européens suffiraient à eux seuls à protéger la population des grandes villes ukrainiennes.
Néanmoins, l'appel à un armement général est erroné. Nous devons considérer le contexte global et planétaire. Et à cet égard, nous sommes confrontés à d'énormes dilemmes qui semblent presque insolubles.
L'attaque de la Russie contre l'Ukraine a contribué à ce que le réchauffement climatique soit largement écarté du débat public. Le réchauffement climatique s'accélère et dans environ cinq à sept décennies, cela signifiera que de grandes parties des zones peuplées ne seront plus habitables de façon permanente. 3 milliards de personnes ne vivront plus dans la niche de température qui a prévalu ces 6 000 dernières années. La rivalité impérialiste et la consommation matérielle des armements feront augmenter massivement les émissions de gaz à effet de serre. La vague d'armement qui s'annonce rendra improbable une réduction substantielle du réchauffement climatique et mettra ainsi directement en péril la reproduction physique non pas de millions, mais de milliards de personnes en quelques décennies.
Le système terrestre change brusquement et marquera tous les conflits sociaux.
Nous ne pouvons pas approuver un réarmement général des puissances impérialistes européennes. Elles utiliseront leur force militaire pour faire valoir leurs revendications par la force dans le contexte d'une rivalité accrue pour les minerais rares et coûteux, les terres rares, les terres agricoles et même l'eau, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou ailleurs. Leur méthode d'adaptation au réchauffement climatique est la militarisation de la société et des frontières et l'exclusion du nombre toujours croissant de personnes superflues. Cela signifie que les puissances européennes voudront également utiliser leur force militaire pour affirmer leurs ambitions coloniales. Après tout, ce n'est rien de nouveau.
Le réarmement conduira à une distribution encore plus inégale des ressources sociales et à l'enrichissement des secteurs les plus pervers du capital.
Comment pouvons-nous faire face à ces dilemmes ?
1.) Les États européens doivent être contraints de livrer un maximum de leurs stocks d'armes (notamment de défense aérienne), y compris des informations de renseignement, à l'Ukraine.
2.) Nous devons exiger la socialisation de l'industrie de l'armement. Cette industrie doit orienter sa production vers les besoins actuels de l'Ukraine. Les livraisons d'armes à d'autres pays, notamment Israël, l'Arabie saoudite et l'Égypte, doivent être arrêtées. Le réarmement au service d'intérêts néo-coloniaux et impérialistes doit être rejeté. Mais nous devons admettre que cette différenciation est difficile à faire dans la réalité.
3.) Nous devons immédiatement entamer une discussion continentale approfondie sur un système de sécurité paneuropéen. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des États baltes potentiellement menacés et de la Moldavie. Nous devons empêcher que la sécurité sociale et écologique ne soit compromise. Une compréhension continentale globale de la sécurité combine la sécurité sociale, écologique et physique. Cela n'est possible qu'au niveau continental.
4.) Nous devons également développer une politique qui aide à convaincre la population générale et particulièrement la classe ouvrière en Russie (et ailleurs) de rompre avec leurs dirigeants. Si les gens perçoivent le réarmement européen comme étant dirigé contre eux, cette préoccupation deviendra impossible.
5.) Nous devons maintenir la perspective d'une rupture mondiale avec le pouvoir capitaliste, une restructuration mondiale et le démantèlement de l'industrie de l'armement, et enfin un bouleversement éco-socialiste, et la remplir d'autant de vie concrète que possible dans les luttes quotidiennes.
Christian Zeller ,20 mars 2025
Christian Zeller est un militant du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (RESU-ENSU).
https://ukraine-solidarity.eu/
Il est professeur de géographie économique et membre du comité de rédaction de la revue germanophone « emancipation – Journal for Ecosocialist Strategy ».
La note de Chris Zeller, publiée sur Facebook, est adressée à Hanna Perekhoda : Comment financer la défense européenne (et comment ne pas le faire)
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article73898
Traduit pour ESSF par Adam Novak
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74144
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’escalade de la violence à l’égard des femmes en Iran : Augmentation du nombre de cas et absence de protection juridique

Plus de 28 000 femmes victimes de violences demandent des rapports médicaux légaux à Téhéran
L'escalade de la violence à l'égard des femmes en Iran : Au cours des 8 premiers mois de 2024, plus de 28 000 femmes à Téhéran ont demandé des rapports médicaux dans des centres médico-légaux en raison de blessures subies lors d'altercations physiques, dont une part importante est attribuée par les experts à la violence domestique.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/26/la-mission-denquete-sur-liran-met-en-evidence-la-persecution-systematique-des-femmes-et-des-filles-autres-textes/?jetpack_skip_subscription_popup
Selon Omidreza Kargar-Bideh, directeur de l'organisation de médecine légale de Téhéran, 74 845 personnes se sont rendues dans ces centres à la suite d'incidents violents, ce qui représente une augmentation de 2,5% par rapport à la même période de l'année précédente.
Parmi les personnes ayant demandé une évaluation médico-légale, 46 528 étaient des hommes et 28 317 des femmes. L'augmentation du nombre de cas impliquant des femmes met en évidence le problème persistant de la violence sexiste en Iran. Bien qu'elles puissent obtenir des rapports médicaux médico-légaux à titre de preuve, les victimes de violences domestiques se heurtent à d'importants obstacles juridiques, car les tribunaux iraniens ne criminalisent pas les violences domestiques à l'encontre des femmes en raison de lacunes juridiques dans le système judiciaire du pays.
Cette situation survient alors que la commission des affaires sociales du parlement iranien examine un projet de loi intitulé « Protection de la dignité et soutien aux femmes contre la violence », qui est dans les limbes de la législation depuis des années. Introduit à l'origine sous la présidence de Hassan Rouhani dans les années 2010, le projet de loi visait à lutter contre la violence à l'égard des femmes, mais il a depuis fait l'objet de révisions approfondies favorisant l'interprétation de la loi islamique par le régime. Les défenseurs des droits des femmes ont critiqué la version modifiée, arguant qu'elle ne fournissait pas de protections significatives aux victimes de violences basées sur le genre.
Absence de refuges sûrs pour les victimes d'abus domestiques
Outre les obstacles juridiques, les femmes victimes de violences domestiques en Iran sont confrontées à une grave insuffisance de refuges sûrs. Selon Fatemeh Babakhani, directrice du refuge Mehr Shams-Afarid, il n'y a actuellement que 17 refuges opérationnels pour les femmes dans tout le pays, ce qui signifie que la moitié des provinces iraniennes ne disposent d'aucun refuge pour les victimes de violences domestiques.
Mme Babakhani a souligné le rôle essentiel que jouent ces refuges en fournissant un hébergement temporaire et des services de soutien, notamment des conseils psychologiques, une assistance juridique et une formation professionnelle. L'âge moyen des femmes qui cherchent un refuge se situe entre 18 et 34 ans, mais il y a aussi des mineurs parmi les victimes. Elle a raconté le cas d'une jeune fille de 13 ans qui avait été forcée à se marier, était tombée enceinte et avait accouché pendant son séjour au refuge.
Les causes profondes de la violence domestique et l'inaction du régime iranien
Hassan Ahmadi, expert juridique au sein du système judiciaire iranien, a identifié les principaux facteurs contribuant à la violence domestique, notamment les attitudes culturelles qui traitent les femmes comme des biens, les difficultés économiques, les troubles psychologiques et le manque d'éducation juridique. Il a souligné que la pauvreté, le chômage et le stress financier exacerbent les tensions familiales, tandis que les troubles mentaux non traités, tels que la dépression et la mauvaise gestion de la colère, alimentent la violence domestique.
M. Ahmadi a également mis en évidence le rôle des normes culturelles qui tolèrent la violence comme méthode de contrôle, en particulier en l'absence de répercussions juridiques. Il a exhorté le régime iranien à mettre en œuvre des lois plus strictes contre la violence domestique et à faciliter l'accès des victimes aux services judiciaires et de soutien.
Conclusion
Le nombre croissant de femmes cherchant à obtenir un rapport médico-légal à Téhéran souligne le besoin urgent de protections juridiques et de systèmes de soutien pour les victimes de violences domestiques. Cependant, la réticence du régime iranien à criminaliser la violence domestique et le manque de refuges sûrs laissent d'innombrables femmes vulnérables à la violence continue. Bien que les organisations locales et les refuges apportent une aide essentielle, un changement systémique reste impossible tant que les réformes juridiques sont entravées par le programme misogyne du régime. Sans changement de régime, le cycle de la violence à l'égard des femmes en Iran persistera, laissant de nombreuses femmes sans recours ni refuge.
https://wncri.org/fr/2025/03/25/violence-a-legard-des-femmes-en-iran/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











