Derniers articles

Perspectives d’une Syrie renaissante

La Syrie connaît un regain d'espoir depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier. La reconstruction du pays ne sera toutefois pas sans difficulté. Le pays est en guerre civile et la population subit une répression gouvernementale violente de plus de dix ans. C'est ce qu'ont affirmé les panélistes du webinaire du 13 mars dernier, intitulé SYRIE : Quel avenir ? Quels défis ? Quelle solidarité ?
Tiré d'Alter Québec.
Le politologue Ziad Majed a d'abord rappelé les circonstances de la chute du régime assadien. À la veille de sa chute, la Syrie de Bachar al-Assad était fragmentée par de nombreuses occupations du territoire de la part d'Israël, de la Turquie, de l'Iran, de la Russie et des États-Unis. Il explique qu'en 2024, le régime s'effondrait déjà et qu'il n'aurait pu résister à quelconque pression surprenante telle que celle du renversement mené par le groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTC) en décembre. Le nouveau président, Ahmed al-Charaa, était à la tête de ce groupe rebelle islamiste né de la guerre civile syrienne.
Se dissocier de l'ancien régime
Le nouveau dirigeant devra « faire avec une Syrie qui a énormément de crises et énormément de défis et de difficultés », explique Majed. La fracture politique et territoriale du pays, le déplacement de la population et la crise économique ne sont qu'une poignée des embûches de la reconstruction avec lesquelles l'administration actuelle devra composer.
Ahmed al-Charaa devra livrer un combat de légitimation à la fois interne et externe. Il doit non seulement réconcilier la relation du gouvernement avec les Kurdes et les Druzes, mais également rétablir les relations du pays avec la communauté internationale. Al-Charaa souhaite se dissocier de Bachar al-Assad en adoptant une posture d'ouverture et d'inclusion envers les groupes minoritaires du pays : les Druzes, les Kurdes et le peuple alaouite, dont Al-Assad est issu.
Cependant, les tensions confessionnelles à l'intérieur du pays restent une réalité, comme l'ont démontré les évènements du 6 mars dernier. Le déchaînement de l'armée du nouveau régime en réponse aux attaques de milices fidèles à l'ancien régime aurait fait plus de 1300 morts. La majorité de ces victimes étaient des civiles alaouites qui ont été ciblé.es et exécuté.es sommairement. Certains désignent les coupables comme étant des « factions indisciplinées » du nouveau régime ayant abusé de leur pouvoir.
De nombreuses fractures sociales
Pour l'historien Farouk Mardam-bey, les deux questions sociales les plus préoccupantes sont d'ordre d'intégration nationale : la question kurde et la tension entre les communautés socioconfessionnelles.
L'administration autonome kurde au nord du pays, le Rojava, était dirigée par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition militaire. Cette dernière avait des relations ambigües avec l'ancien régime, notamment en raison de son lien fort avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe rebelle kurde de Turquie.
Toutefois, la région contient près de 90 % des ressources pétrolières du pays, ajoutant à l'urgence ressentie par le nouveau régime de parvenir à une solution équitable avec les FDS. Le président al-Charaa et les FDS ont ainsi conclu en mars une entente visant à intégrer la coalition et toutes leurs activités à l'institution centrale syrienne.
Selon Mardam-Bey, l'importance territoriale et démographique du Rojava a également influencé cet accord, qui promet de garantir la satisfaction des revendications politiques et culturelles kurdes.
Mardam-Bey considère que cette décision a été accueillie avec enthousiasme autant par la population arabe de Syrie que par les Kurdes. Toutefois, la confession sunnite du nouveau chef inquiète certains membres de groupes minoritaires. Le groupe sunnite, largement majoritaire au pays, peut être perçu comme étant le « nouveau maître du pays » par les alaouites, les ismaélien.nes, les Kurdes ou les Druzes.
« Le plus préoccupant dans ce contexte […] est l'absence de toute force politique libérale ou de gauche qui soit capable de jouer le rôle d'une opposition structurée et responsable ou de prendre la relève si, par malheur, la Syrie sombrait dans l'anarchie », prévient-il.
Une économie à refaire
L'économiste Jihad Yazigi, en direct de Damas, a expliqué que l'économie syrienne souffre principalement de la destruction physique massive causée par la guerre et les coûts de reconstruction. Les dépenses de guerre, l'exode de la main d'œuvre, la fracture du territoire et, surtout, les sanctions occidentales placées sur la Syrie ont contribué à la précarité de la situation économique.
Les sanctions américaines sur le secteur bancaire syrien sont celles qui le pèsent le plus lourd dans la balance. Elles devront être levées pour faire une réelle différence sur l'économie du pays, alors qu'on observe la levée des sanctions européennes sans impact positif marqué. La faillite du secteur bancaire libanais en 2019 a également eu un rôle important à jouer, bloquant l'accès de la population syrienne à des sommes importantes en dépôt au Liban.
Malgré les évènements du 6 mars et les difficultés liées à la reconstruction, il y a « beaucoup de chances que la situation économique du pays, dans les années qui viennent, s'améliore », selon Yazigi.
Pour le moment, la priorité est le redémarrage de la production et de l'activité économique dans tous les secteurs. Les services essentiels à la population, comme l'électricité, le blé et le pétrole doivent augmenter leur production pour permettre à l'économie de se relever tranquillement.
En quête de justice après la chute de l'ancien régime
Selon le juriste Abdulhay Sayed, la justice transitionnelle est essentielle afin de se défaire des vestiges du régime de Bachar al-Assad. « Trop longtemps, la Syrie a été une terre d'impunité », souligne-t-il.
Selon le juriste, la justice transitionnelle sert à faire émerger la vérité à travers le dialogue ainsi qu'à favoriser l'art de la réconciliation. Ce processus de justice doit évaluer les crimes commis par l'institution étatique elle-même. Abdulhay Sayed soutient que « l'appareil d'État a été transformé en un instrument de répression et de violence » par le régime assadien.
Ce dernier rappelle toutefois que le crime d'institution contient une autre dimension, celle-ci concernant sa façon de bâtir du ressentiment qui mène justifier les crimes de masse. Le processus de justice servirait alors aussi à identifier et à analyser les discours qui ont permis cette socialisation de la haine.
Sayed soutient que la condition politique d'une telle justice repose sur un système constitutionnel fondé sur une légitimité électorale. Elle ne peut pas être fondée sur une rhétorique dite révolutionnaire ou sur la construction d'un pouvoir centré autour d'un chef charismatique, comme cela semble être le cas actuellement avec la nouvelle déclaration constitutionnelle.
« C'est uniquement, à mon sens, dans ce cadre qu'une justice véritablement équitable pourra émerger pour tous les Syriens et pas une justice à sens unique », a-t-il conclu.
Malgré les défis que présente la reconstruction au terme de la guerre et de décennies de règne autoritaire, les panélistes se sont montrés assez optimistes quant au futur du pays. Pour les Syrien.nes, dont les réfugiés ont déjà recommencé à regagner leur terre natale, « c'est un acquis considérable qu'il n'y aura plus de président éternel », affirme Ziad Majed. « Leur esprit de révolte et leur esprit de contestation, qu'on voit chaque jour dans les moyens actuels d'information, est plus vivant que jamais ; ils sont prêts à recommencer », maintient-il.
Pour revoir la discussion et le webinaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Sri Lanka à la croisée des chemins : Résister à la domination géopolitique et protéger la souveraineté

Le Sri Lanka se trouve à un carrefour critique dans l'évolution de la lutte géopolitique entre les puissances mondiales et régionales. Les récents accords avec la Chine et l'Inde soulignent l'influence externe croissante sur l'économie du pays, le secteur de l'énergie et la sécurité nationale. Le Front Line Socialist Party (FLSP) avertit que le Sri Lanka risque de perdre à la fois sa souveraineté économique et son autonomie politique en s'emmêlant dans la dynamique de pouvoir indo-pacifique entre la Chine, l'Inde et les États-Unis. Le parti appelle à la sensibilisation du public et à une intervention organisée, arguant que ni le gouvernement ni l'opposition parlementaire ne peuvent sauvegarder les intérêts du Sri Lanka. Cet article examine les implications des récents accords et exhorte le peuple sri-lankais à résister à la domination externe et à œuvrer pour un avenir souverain et indépendant. [AN]
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Le président Anura Kumara Dissanayake a effectué une visite d'État en République populaire de Chine du 14 au 17 janvier 2025 et une déclaration conjointe a été publiée le 16 janvier. Cette déclaration conjointe indique que « les deux parties ont convenu de suivre les huit grandes étapes annoncées par le président Xi Jinping pour soutenir la coopération Une Ceinture Une Route », et « les deux parties ont signé le plan de stratégie d'entreprise Une Ceinture Une Route ». Elle indique en outre que le gouvernement sri-lankais a accepté « d'avancer avec tous les grands projets, y compris la Port City de Colombo et le port de Hambantota, d'utiliser pleinement les programmes tels que l'atelier de la Route de la Soie, et de mettre en œuvre davantage de programmes de subsistance au Sri Lanka conformément aux principes de planification, de construction et de récolte des bénéfices ensemble. La coopération Une Ceinture - Une Route n'est pas seulement un programme de développement économique, mais aussi la stratégie géopolitique de la Chine dans la mer de Chine méridionale et l'océan Indien. Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis sont engagés dans un programme appelé »Stratégie Indo-Pacifique" contre la Chine et cette lutte de pouvoir a créé une forte tension dans la région asiatique, y compris la région de l'océan Indien. La possibilité que cela évolue d'une guerre économique et commerciale, d'une contradiction politique et diplomatique vers un état de conflit militaire ouvert ne peut être exclue. Dans ce cas, l'Inde soutient les États-Unis, en tant que partenaire de la coopération militaire QUAD ainsi que de nombreux autres accords de coopération militaire. Le programme est asservi aux propres ambitions de l'Inde en tant que puissance régionale. La déclaration conjointe publiée avec l'Inde le 16 décembre 2024 est une démonstration de la loyauté du gouvernement actuel envers la stratégie de l'Inde dans l'océan Indien et envers le programme américain qui obtient son soutien. Ces deux déclarations montrent que le Sri Lanka est inclus dans la principale lutte géopolitique de la région de l'océan Indien.
D'autres accords importants qui ne figurent pas dans la déclaration conjointe publiée avec la Chine ont été conclus lors de la visite. La signature d'un accord approuvant la société chinoise SINOPEC pour construire une raffinerie de pétrole dans la région de Hambantota en est le principal. C'était un projet proposé par le régime de Mahinda Rajapaksa et l'administration successive de Ranil Wickramasinghe l'a également approuvé. Jusqu'à présent, le programme n'a pas pu être lancé en raison de l'opposition du peuple, et le JVP, principal parti du gouvernement actuel, était également un critique important du projet à cette époque. L'opposition à ce projet était fondée, d'une part, sur le fait que le Sri Lanka était pris dans un projet géopolitique basé sur le port de Hambantota. D'autre part, le problème causé à la souveraineté énergétique du Sri Lanka par des entreprises étrangères possédant l'importation, le raffinage et la distribution de pétrole qui est devenu un monopole complet du gouvernement du Sri Lanka selon la loi existante sur le pétrole. De plus, le manque de clarté sur la façon dont l'argent sera reçu par le Sri Lanka, même si l'on parle d'un investissement, était une autre raison. Aucune de ces raisons n'a changé cette fois-ci non plus.
Puisque le port de Hambantota est déjà propriété de la Chine depuis environ un siècle, le Sri Lanka perdra les revenus pétroliers du port de Hambantota en raison de l'ouverture d'une raffinerie de pétrole à proximité. Dans les conditions où le gouvernement actuel a accepté avec l'Inde de poursuivre les négociations relatives au projet de construction d'un oléoduc indien vers le Sri Lanka, il y a un risque que le Sri Lanka perde les revenus de l'approvisionnement en pétrole brut non seulement au port de Trincomalee mais aussi au port de Colombo. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de perte de revenus, mais aussi d'un risque de perte de la souveraineté énergétique du Sri Lanka, et la fourniture d'installations militaires en lien avec ces ports crée un risque pour la sécurité nationale. Tous ces accords montrent que le Nord et l'Est sont sous domination indienne, tandis que la province du Sud, y compris Hambantota, est sous autorité chinoise. Le fait que ces deux puissances régionales se préparent à une forte intervention à Colombo rend le danger encore plus grave.
Nous attendons l'attention et la participation active de tout le peuple, y compris la classe ouvrière du Sri Lanka, concernant ces dynamiques politiques qui se développent de telle manière que non seulement la souveraineté économique du Sri Lanka mais aussi l'autonomie politique et la sécurité du peuple sont en danger. Nous croyons que les positions prises par le gouvernement sont extrêmement graves dans les contradictions géopolitiques qui ont été annoncées en lien avec les visites du président en Inde et en Chine. Il est clair qu'une solution à ce problème ne peut être attendue de l'opposition parlementaire, qui a maintenu les mêmes positions pendant longtemps. Par conséquent, nous appelons à une intervention organisée du peuple sri-lankais, y compris les travailleurs, qui ont le potentiel de créer des alternatives aux défis économiques, politiques, géopolitiques et militaires auxquels le Sri Lanka est confronté et de les concrétiser.
Comité central
Front Line Socialist Party
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Depuis l’élection de Trump : Augmentation sans précédent du nombre d’approbations de plans de colonies

Dans un revers remarquable, le Conseil supérieur de planification a approuvé plus de plans de construction au cours des trois derniers mois que pendant toute l'année 2024. Entre le 1er janvier et le 19 mars 2025, un total de 10 503 unités de logement ont été approuvées, dépassant les 9 971 unités approuvées pendant toute l'année 2024. Ce mercredi, 1 344 unités supplémentaires devraient être approuvées.
Tiré de Association France Palestine Solidarité
25 mars 2025, Traduction AFPS
Cette accélération spectaculaire fait suite à un changement important de politique. En juin 2023, le gouvernement Netanyahu-Smotrich a supprimé le contrôle direct de l'échelon politique sur la planification des colonies. Auparavant, chaque étape du processus d'approbation nécessitait l'accord du ministre de la défense. En novembre 2024, après l'élection du président Trump, le taux d'approbation des plans a nettement augmenté : le Conseil de planification est passé de réunions trimestrielles à des sessions hebdomadaires, approuvant des centaines d'unités de logement à la fois. Ce changement semble faire partie de la stratégie du gouvernement visant à normaliser la planification de la colonisation, à réduire la surveillance nationale et internationale et à tirer parti de l'attention mondiale portée à Gaza pour faire progresser rapidement l'expansion de la colonisation. Il semble que le gouvernement cherche à « remplir les réserves de planification » avec autant de plans approuvés que possible, garantissant ainsi le potentiel d'un développement futur important.
Peace Now : « Au lieu de s'occuper des otages et d'assurer la sécurité d'Israël, le gouvernement Netanyahu-Smotrich aggrave le conflit et sabote toute chance de résolution pacifique. Le gouvernement fait avancer des projets d'une ampleur sans précédent en Cisjordanie, qui finiront par coûter cher à tous les Israéliens sous la forme d'une violence prolongée et d'un fardeau financier énorme. »
Changements au sein du Conseil supérieur de planification et de l'administration civile
Le processus de planification a connu un développement important en octobre 2024, lorsque Yehuda Alkalai, l'ancien ingénieur du conseil régional de la colonie de Shomron, a été nommé à la tête du bureau de planification de l'administration civile. Des rapports indiquent que le ministre Bezalel Smotrich a plaidé pour la nomination d'Alkalai afin d'accélérer le processus d'expansion des colonies. La nomination d'Alkalai a été suivie d'un rythme extraordinaire d'approbation des plans, parfois quelques jours après leur présentation au Conseil de planification. Cette accélération est en partie attribuée à une approche plus souple en ce qui concerne le respect des conditions préalables avant qu'un plan ne soit soumis à discussion.
Le processus d'approbation rapide d'Alkalai s'aligne sur la stratégie plus large d'annexion poursuivie par le gouvernement actuel. Smotrich a mis en place l'Administration de la colonisation et l'a renforcée avec des conseillers juridiques qui remplacent le personnel juridique de l'Administration civile - qui, selon Smotrich, a « un ADN complètement différent » - une mesure qui semble faciliter des actions qui n'étaient pas réalisables auparavant. En outre, l'inclusion d'un représentant du ministère de la colonisation au sein du Conseil supérieur de planification politise davantage le processus de planification, permettant des décisions plus rapides en faveur de l'expansion des colonies.
Un exemple notable de ces changements est le plan n° 512/2, qui vise à légaliser des dizaines de maisons construites illégalement il y a plusieurs décennies dans la colonie d'Otniel, située au sud d'Hébron. Ce plan, qui ajouterait 156 unités d'habitation à la colonie, a été bloqué pendant des années parce que les routes qui y mènent passent sur des terres palestiniennes privées. En janvier 2025, cependant, le plan a été présenté au Conseil supérieur de planification et l'architecte qui l'a présenté a déclaré : « le plan n'a pas été avancé jusqu'à présent en raison de problèmes fonciers. Maintenant que les problèmes ont été résolus, il est avancé ».
La « solution » approuvée par le conseil juridique est que le plan stipule que des ponts seront construits sur les terrains privés, permettant ainsi de relier le quartier à la colonie. Il convient de noter que, outre le fait que la construction d'un pont viole également la propriété des propriétaires fonciers, les colons qui vivent dans des maisons déjà construites illégalement dans le quartier circulent quotidiennement depuis des années sur des routes qui ont été pavées sur des terres privées, sans aucune interférence. Il est difficile de croire que quelqu'un investirait des efforts et de l'argent dans la construction de ponts alors qu'il pourrait simplement continuer à s'emparer des terres.
Les plans approuvés - approfondir l'occupation jusqu'à l'annexion
La grande majorité des plans approuvés ces derniers mois prévoit l'implantation de colonies à l'intérieur de la Cisjordanie, ce qui a des conséquences considérables pour la continuité territoriale palestinienne et la viabilité d'un futur État palestinien. La construction de 10 000 nouveaux logements devrait permettre d'accueillir 40 000 à 50 000 colons supplémentaires.
Les principales approbations concernent de nouveaux quartiers dans des colonies telles que Itamar (284 unités), Yakir (464 unités), Kochav Yaakov (1 016 unités), Asfar (509 unités) et Ma'ale Amos (561 unités).
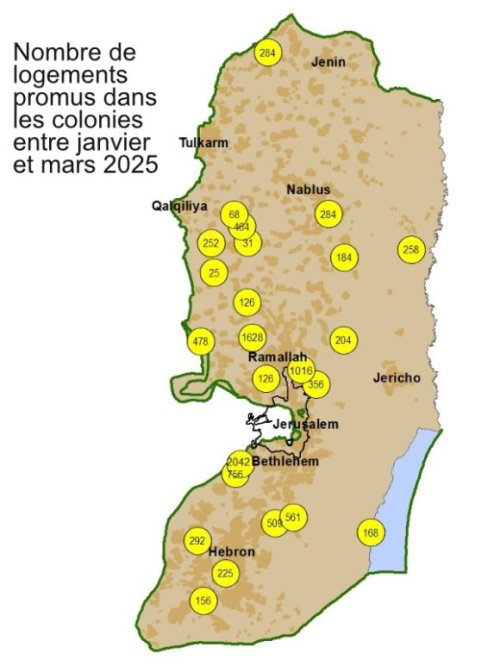
Le plan 516/3/1, dont le dépôt a été approuvé, prévoit la création d'un nouveau et grand quartier de 292 logements à l'est de la colonie d'Adora, ce qui doublera effectivement la taille de la colonie isolée située au nord-ouest d'Hébron. Dans la zone du plan, les colons ont récemment établi un nouvel avant-poste (Adora East Outpost), et le plan cherche à le légaliser rétrospectivement. L'avant-poste a été construit sur les ruines de la communauté palestinienne de Khirbet a-Taybah, qui a été violemment expulsée par des soldats et des colons en octobre 2023, comme le décrit le témoignage des habitants à B'Tselem :
Khirbet a-Taybah, Tarqumya : « La communauté abritait 10 familles, soit 47 personnes au total, dont six mineurs. Quatre autres familles, composées de huit adultes au total, y vivaient en fonction de la saison. Le 7 octobre 2023, des colons et des soldats sont arrivés et ont informé les habitants qu'ils devaient partir parce que le site avait été déclaré zone de tir. Les dix familles qui vivaient dans la communauté de façon permanente sont parties ce jour-là, mais les familles qui y vivaient de façon saisonnière ont continué à venir pendant la journée pour faire paître leurs troupeaux et passer la nuit à Tarqumya. Le 11 octobre 2023, plusieurs résidents ont tenté de rentrer chez eux pour vérifier leurs biens, mais les colons leur ont barré la route. Le matin du 17 octobre, les habitants ont réussi à atteindre leurs terres et ont trouvé 11 cabanes résidentielles et agricoles démolies et du matériel agricole volé. Les soldats qui les ont remarqués les ont chassés. Le 12 novembre 2023, à 12 heures, des soldats sont arrivés dans la communauté et ont informé les familles présentes sur une base saisonnière qu'elles devaient elles aussi partir, faute de quoi leurs maisons seraient démolies et elles seraient expulsées par la force, mais les familles ne sont pas parties. Le 21 novembre, des soldats sont de nouveau venus dans la communauté et ont menacé les membres de ces familles sous la menace d'une arme. En conséquence, les quatre familles sont également parties. Le 4 janvier 2024, à 16 heures, des habitants de la ville de Tarqumya ont vu de la fumée s'élever de leur communauté. Ils sont montés sur une colline surplombant la zone et ont vu que les colons avaient détruit et brûlé quatre structures agricoles et les meubles qu'ils avaient laissés derrière eux, et ont repéré un véhicule de sécurité de la colonie sur les lieux. »
L'exemple le plus frappant est peut-être celui de la colonie de Talmon, à l'ouest de Ramallah, où des plans pour 1 628 unités de logement ont été approuvés au cours des trois derniers mois, ce qui a permis d'étendre considérablement la zone et la population de colons. Avec d'autres projets récemment approuvés, Talmon pourrait bientôt devenir une colonie de dizaines de milliers d'habitants.
Traduction : AFPS
Photo : Peace Now
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Point sur la situation à Gaza le 28 mars 2025

Nos sources : ces informations sont collectées et compilées par une militante anticolonialiste israélienne, et reprises en Israël par des sites contre l'occupation et par des médias palestiniens. En raison des circonstances actuelles, les sources pour ce rapport sont un petit peu plus limitées qu'auparavant, mais les voici : l'Autorité palestinienne de la santé pour la Cisjordanie ; le Croissant Rouge ; l'Office des Nations Unies pour les affaires humanitaires (OCHA) ; WAFA.
Tiré de Agence médias Palestine.
Toujours en raison des circonstances actuelles, nous peinons à recevoir en temps réel les actualités à Gaza, nous actualiserons donc cet article au fil des informations que nous recevrons de nos correspondant-e-s sur place.
Général
– Au cours des dernières 24 heures, 43 personnes ont été tuées et 115 blessées ;
– Depuis le 18 mars 2025 – 896 personnes tuées et 1 984 blessées ;
– Depuis le 7 octobre 2023 – 50 251 personnes tuées et 114 025 blessées.
‣ Cela fait 6 jours et le sort des ambulanciers et des pompiers qui sont allés dans le camp de réfugiés assiégé de https://maps.app.goo.gl/vsD5xjtiv8hvdVsx7
est toujours inconnu. Le corps du commandant de la délégation a été retrouvé la nuit dernière, ainsi que 5 ambulances détruites et enfouies dans le sable. L'armée ne permet pas la poursuite des recherches et empêche les informations de ses chercheurs.
‣ 16 800 camions d'aide humanitaire et 1 400 camions-citernes de carburant n'ont pas pu entrer dans la bande de Gaza depuis le début du mois de mars.
Bande nord
1. Beit Lahia :
‣ Bombardements nocturnes ;
‣ Destruction de maisons dans la zone d'Al Nassar, au nord ;
‣ Bombardements aériens depuis l'est ;
‣ Bombardements aériens, une personne tuée.
2. Camp de réfugiés de Jabalia – Bombardement d'une tente de personnes déplacées dans le camp, 3 personnes tuées, dont un enfant.
Ville de Gaza
1. Al Zeitoun – Bombardement nocturne d'une maison familiale. 14 personnes tuées, 10 blessées, dont de nombreux enfants.
Bande centrale
1. Camp de réfugiés de Nuseirat – Tirs d'artillerie dans la partie nord-est du camp.
2. Camp de réfugiés d'Al Bureij : tirs de mitrailleuses dans la partie nord-est du camp.
District de Khan Yunis
1. Bani Suheila : bombardement aérien nocturne, 2 personnes blessées dont un enfant.
2. Abasan Al Kabira : tirs d'artillerie de nuit et de jour.
3. Al Mawasi : bombardement aérien, personnes blessées.
4. Centre-ville : un véhicule est touché par des bombes larguées par un drone, 2 personnes tuées.
Quartier de Rafah
1. Al Janina :
– Bombardement aérien de nuit, 2 personnes tuées ;
– Tirs de mitrailleuses.
2. Camp de réfugiés de Tel Al-Sultan – maisons démolies.
3. Al Mawasi :
– Tirs d'artillerie et de mitrailleuses ;
– Bombardement aérien.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Point sur la situation en Cisjordanie occupée le 28 mars 2025

Nos sources : ces informations sont collectées et compilées par une militante anticolonialiste israélienne, et reprises en Israël par des sites contre l'occupation et par des médias palestiniens. En raison des circonstances actuelles, les sources pour ce rapport sont un petit peu plus limitées qu'auparavant, mais les voici : l'Autorité palestinienne de la santé pour la Cisjordanie ; le Croissant Rouge ; l'Office des Nations Unies pour les affaires humanitaires (OCHA) ; WAFA.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Toujours en raison des circonstances actuelles, nous peinons à recevoir en temps réel les actualités village par village en Cisjordanie, nous actualiserons donc cet article au fil des informations que nous recevrons de nos correspondant-e-s sur place.
Raids et arrestations
Au cours de la nuit, les forces israéliennes ont effectué des raids dans le camp de réfugiés et la ville de Jénine (67e jour consécutif), le camp de réfugiés et la ville de Tulkarem (61e jour consécutif), lle camp de réfugiés de Nur Shams (48e jour consécutif), Hébron, Ni'lin, Al-Mughayyir, Anza, Meithalun, Zawiya, Naplouse, Yatta, Qalqilya, Beit Ula, Al-Yamun, Deir Sammit. Au cours de la journée, ils ont attaqué Beita, Jinba, Aqabah, Rummanah, Rujeib, Beit Ummar, le camp de réfugiés d'Al-Arroub, le camp de réfugiés d'al-Am'ari, le camp de réfugiés d'Al Fawwar, Salem. Au moins 12 Palestiniens ont été arrêtés, dont 3 mineurs.
– 22 personnes ont été arrêtées à Jinba, dont 17 ont été relâchées par la suite.
Attaques de l'armée contre les Palestiniens
1. Meithalun, au sud-est de Jénine – une force spéciale a fait une descente dans une maison pendant la nuit. Ils ont tiré et blessé l'un de ses habitants. L'accès à l'ambulance a été refusé et la personne blessée a été arrêtée.
2. Beita, au sud de Naplouse – des gaz lacrymogènes sont tirés pendant la manifestation hebdomadaire. Des affrontements ont lieu par la suite. Une personne est blessée par balle.
3. Rummanah, au sud de Jénine – raid et affrontements.
4. Beit Ummar, au nord de Hébron – affrontements. Deux personnes sont blessées par balle.
5. Camp de réfugiés d'Al-Arroub, au nord de Hébron – raid et affrontements.
Démolitions
1. Tulkarem – destruction de serres dans la partie ouest de la ville, près du mur de séparation.
Attaques de colons contre des Palestiniens
1. Qusra, au sud-est de Naplouse – des colons soutenus par l'armée attaquent la région de la source.
2. Jinba, Masafer Yatta – un événement en cours s'est poursuivi le 29 mars, mais tous les événements sont rapportés ici :
Des colons attaquent un berger et son fils et les blessent, et tentent également de voler des moutons.
L'un des colons affirme avoir été attaqué, puis 13 colons attaquent 6 villageois à coups de gourdin. Ils blessent 5 des villageois, dont un mineur grièvement blessé.
À midi, des soldats arrivent, font sortir tous les hommes de la communauté et en arrêtent 22 sur la base de la plainte du colon. 17 sont libérés plus tard. Le 29 mars à l'aube, plus de 100 soldats et colons armés de marteaux font une descente dans le village et vandalisent les biens, y compris la nourriture. Après 5 heures de dévastation et de destruction, les forces et les colons battent en retraite.
3. Farsiyeh, vallée du Jourdain, nord de la Palestine – des colons attaquent des moutons et en tuent plusieurs ainsi qu'un chien de berger.
4. Khirbet Tana, à l'est de Naplouse – des colons attaquent des personnes en train de prier dans une salle de prière, l'armée tire des gaz lacrymogènes.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nétanyahou bénit le soutien à Israël des fascistes européens

Stade ultime de l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, la conférence de Jérusalem, réunie le 27 mars 2025, a scellé le pacte entre Israël et l'extrême droite européenne et américaine. Elle a également offert au président du Rassemblement national, Jordan Bardella, l'occasion de s'affirmer sur la scène internationale. Reportage.
Tiré d'Orient XXI.
Une angoisse particulière, une boule au ventre qui ne vous quitte pas d'être présente à Jérusalem, dans la gueule du loup, pour cette conférence de « lutte contre l'antisémitisme », en compagnie de l'extrême droite occidentale. Tout autour, des hommes et des femmes se revendiquant de la « civilisation judéo-chrétienne », bien propres sur eux avec leurs costumes griffés, leurs tailleurs de marque et leurs talons aiguilles, venu·e·s boire du petit lait en écoutant quatre heures de discours racistes. Ils et elles applaudissent à tout rompre des suprémacistes qui vous désignent comme leur ennemi juré. Que le regard de l'un·e d'eux s'attarde sur vous et des scénarios peu joyeux ne manquent pas de vous traverser l'esprit. Le tout dans une ville où la présence d'Israéliens armés, civils comme militaires, est permanente.
Bouquet final : le discours de clôture de Benyamin Nétanyahou. Impossible de se trouver à quelques dizaines de mètres de cet homme, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la CPI, sans penser aux milliers d'enfants tués à Gaza, aux morts qui sont encore sous les décombres, sans sépulture, à la destruction quotidienne que l'homme fort de Tel-Aviv continue à opérer en toute impunité, en se réjouissant de « changer la face du Proche-Orient ».

Le silence de la presse
Mais pour un déplacement que Jordan Bardella qualifie d'« historique », l'événement organisé sous l'égide du ministère de la diaspora les 26 et 27 mars 2025 à Jérusalem n'émeut pas grand monde en Israël. Il passe même presque inaperçu, si l'on excepte les articles publiés depuis quelques semaines par Haaretz, comme des cris poussés en plein désert. Le quotidien de gauche a d'ailleurs été qualifié durant la conférence de « journal antisémite », sous les applaudissements de la salle.
Les Israéliens ont fort à faire déjà, inquiets de la reprise de la guerre à Gaza — exclusivement à cause du risque qu'elle fait peser sur le retour des prisonniers israéliens vivants. Ils se préoccupent des dérives de leur système politique — démocratique exclusivement pour les Juifs — qui risque de se transformer en une autocratie, entre le limogeage par Benyamin Nétanyahou de Ronen Bar, le chef du Shin Bet, contre l'avis de la Cour suprême, ou le bras de fer avec la procureure générale Gali Baharav-Miara. Quant au sort subi par les Palestiniens, qu'il s'agisse de la poursuite du génocide à Gaza ou du nettoyage ethnique en Cisjordanie, il n'intéresse pas les braves manifestants de Jérusalem ou de Tel-Aviv, qui continuent à hurler en rentrant de leurs rassemblements : « De-mo-kra-tia ! »
Après une première journée consacrée pour les hôtes d'honneur à la visite de « l'enveloppe de Gaza » (les kibboutz autour de l'enclave qui ont été attaqués le 7 octobre 2023) et à celle de Yad Vashem, le mémorial pour les victimes de la Shoah, la partie publique de l'événement se tient durant l'après-midi du jeudi 27 mars. Elle est modestement sous-titrée « Ambassadors of Truth » (Ambassadeurs de la Vérité). Sans doute au sens orwellien du terme.
Sur les hauteurs de Jérusalem-Ouest, au Centre des conventions internationales, la bonne humeur qu'affiche une majeure partie de l'assistance jure avec le dispositif sécuritaire suspicieux. On demande aux étrangers comment ils ont entendu parler de la conférence, on vérifie si les journalistes ne sont pas des militants sous couverture. Un certain nombre de confrères français sont présents, envoyés par leurs rédactions… sauf CNews, qui aurait eu le privilège d'être « invitée » par les organisateurs. Le soir même, Jordan Bardella y intervient en direct depuis Jérusalem. Le journal L'Humanité a, lui, vu son journaliste se faire retirer son accréditation. La liberté de la presse est une valeur sûre dans la « seule démocratie du Proche-Orient ».
Parmi les quelques centaines de personnes présentes, l'on note également la présence en force de représentants de DiploAct, une ONG israélienne présente en France depuis 2022 et composée d'étudiants israéliens francophones réservistes de l'armée. Ses membres sont déjà intervenus sur Radio J et I24 news. Du côté de l'Amérique du Nord, deux poids lourds : la Conservative Political Action Conference (CPAC), dont la réunion annuelle accueille régulièrement des représentants de l'extrême droite européenne, et l'homme d'affaires israélo-canadien Sylvan Adams, qui vient de faire un don de 100 millions de dollars (92,4 millions d'euros) à l'Université David Ben Gourion du Néguev, à Beersheba. L'éloge de la répression des voix critiques d'Israël sur les campus étatsuniens est d'ailleurs un leitmotiv de la soirée, repris par tous les intervenants nord-américains. Mais avant d'en arriver là, des discussions surréalistes nous plongent dans l'ambiance. Par exemple, cet Israélien qui demande à une Étatsunienne : « Vous êtes juive ? » Et elle de répondre : « Oui, ça ne se voit pas ? »
La consécration d'une stratégie
Cet événement ne marque pas tant un tournant dans la politique israélienne que la consécration d'une tendance à l'œuvre depuis quelques années. S'il est vrai que c'est la première fois que les mouvements d'extrême droite sont officiellement invités par Tel-Aviv, les liens entre le gouvernement de Nétanyahou et ces partis se sont renforcés au cours des dernières années. Le soutien à Israël fait partie du cahier des charges de la nouvelle internationale fasciste, ceux que l'on appelle « les antisémites sionistes ». L'occasion de consacrer une normalisation déjà à l'œuvre pour ces partis dans le paysage politique local. Tel-Aviv se montre prévoyant en renforçant les liens avec la classe politique montante, qu'il s'agisse du Rassemblement national qui atteint un score historique en France avec les législatives de 2024, ou des Démocrates de Suède, deuxième parti du pays depuis 2022. L'organisation de cette conférence par Israël est un coup de pouce certain pour ces formations politiques dans leur conquête du pouvoir, alors que la question de leur antisémitisme pouvait rebuter un électorat « modéré ».
Rien que sur l'année écoulée, le leader du parti d'extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal, a rencontré Benyamin Nétanyahou à Jérusalem en mai 2024. Le Premier ministre hongrois Victor Orbán, soutien notoire de Tel-Aviv, a invité son homologue israélien en novembre 2024 à Budapest — il s'y rendra ce mercredi 2 avril, en réaction au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI). Une « clarté morale » saluée par ce dernier. Amichai Chikli, le ministre de la diaspora aux commandes de l'événement de Jérusalem, s'était déjà affiché aux côtés de Jordan Bardella en février 2025, lors de la CPAC. Dès sa nomination en janvier 2023, Chikli avait d'ailleurs ajouté « la lutte contre l'antisémitisme » à l'intitulé de son ministère. Le député européen du Rassemblement national (RN) animé par la foi des convertis, ne croyait pas encore, il y a quelques mois, à l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen (1). De manière plus générale, la European Coalition for Israel, un groupe de lobbying pro-israélien fondé en 2004, rappelle que pour la précédente législature du Parlement européen (2019 – 2024), les 20 partis dont les votes ont été les plus favorables à Israël appartiennent tous à l'extrême droite et aux eurosceptiques (2).
Les voici donc, ces leaders de l'extrême droite, se précipitant à Jérusalem pour faire mentir ce qui historiquement n'a pas toujours relevé de l'oxymore. Des antisémites ont soutenu la création du foyer national juif en Palestine, y voyant l'occasion de se débarrasser des juifs européens. Theodor Herzl lui-même, théoricien de l'idée d'un État national pour les juifs, voyait en eux des alliés objectifs du sionisme.
Bardella en guest star
Côté français, les premiers contacts connus de l'extrême droite institutionnelle avec Israël remontent à 2011, lorsque l'actuel maire de Perpignan, Louis Alliot, avait visité deux colonies en Cisjordanie. À l'époque, les autorités israéliennes avaient refusé de le recevoir. L'ex-compagnon de Marine Le Pen sera ensuite l'artisan du rapprochement entre le RN et Serge Klarsfeld, dont le fils, Arno Klarsfeld, intervient également dans cette conférence, aux côtés du « député du Likoud » — comme on le surnommait à l'Assemblée nationale — Meyer Habib. D'autres figures du RN sont présentes dans le public, à l'instar de Victor Chabert, conseiller presse de Bardella et de Marine Le Pen, ainsi que Thibaut François, secrétaire général de la délégation du parti au Parlement européen. Quant à Marion Maréchal, elle a été reléguée dans une salle annexe, intervenant devant une trentaine de personnes sur les Frères musulmans. Serait-ce parce que, contrairement au président du RN, elle n'a jamais désavoué — même timidement — son grand-père ?

Pour cette demi-journée d'interventions, Jordan Bardella fait clairement figure d'invité d'honneur, ayant le privilège de prononcer un discours — en français, traduit en anglais —, là où Klarsfeld et Habib participent à des tables rondes. Arno Klarsfeld ouvre le bal des hommages, consacrant une grande partie de son temps de parole à l'éloge du RN, dont il qualifie l'invitation à cette conférence d'« initiative très sage ». « Aujourd'hui, le Rassemblement national, qui n'est plus l'extrême droite, est un parti qui favorise les juifs ». De là à parler d'un lobby juif, il n'y a qu'un pas à franchir. Il poursuit : « Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui est devenue l'extrême droite. » La guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force (3).
Klarsfeld mobilise son histoire familiale — ses parents chasseurs de nazis, son cousin enrôlé dans l'armée israélienne et tué le 9 octobre 2023 dans le kibboutz de Kfar Aza, lors de combats avec le Hamas — pour donner un vernis de légitimité à sa rengaine : le danger de l'extrême gauche et de l'islam radical. Même son de cloche chez Meyer Habib qui, tout en soulignant ne pas être du même bord politique que Bardella, déclare depuis la tribune : « Ce qu'il a dit était très fort. Merci. » L'ancien député apparenté Les Républicains exprime également son effarement d'entendre des manifestants en France répéter le slogan « From the River to the Sea » (« De la mer au Jourdain »), appelant à la décolonisation de toute la Palestine historique, toujours interprété par les soutiens d'Israël comme un appel à « jeter les Juifs à la mer », et qui est par contre inscrit dans la charte du Likoud. Enfin, Sylvan Adams interpelle directement le leader du RN en français dans le texte : « M. Jordan Bardella, bienvenue et merci d'être venu à Jérusalem. » Le milliardaire assume un raisonnement simpliste : « Si, avec Marine Le Pen, vous défendez nos droits et notre liberté, alors je suis avec vous. »

Le principal intéressé a, pour sa part, repris les éléments de langage répétés à l'envi en France, sur « l'antisémitisme d'atmosphère » (4), « l'islamisme qui est le totalitarisme du XXIe siècle », ou encore l'enseignement impossible de l'histoire de la Shoah dans « certains territoires » de France. Il a rappelé son attachement à la définition que donne l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA) de l'antisémitisme — c'est-à-dire, celle consistant à faire l'amalgame avec l'antisionisme, et n'a pas manqué de marquer ses distances avec « les groupuscules d'extrême droite » antisémites, élément clé de l'opération dite de « dédiabolisation » du RN ces dernières années. À la fin de son discours, une partie de la salle, séduite, se lève pour applaudir.
Car le public de la conférence est attentif et enthousiaste, généreux en standing ovation. Il est également un réservoir de groupies pour le gouvernement israélien, comme celles qui hurlent « We love you Bibi ! » à l'adresse de Benyamin Nétanyaou, venu spécialement pour cet événement inauguré par deux de ses ministres : celui de la diaspora et celui des affaires étrangères, Gideon Sa'ar.
Un « certificat casher »
Si l'extrême droite mondiale vient montrer patte blanche sur l'antisémitisme, c'est parce que sa haine — officielle — se porte aujourd'hui sur trois nouvelles cibles : les critiques d'Israël — dont la gauche radicale —, les musulman·e·s — et il n'est pas rare d'entendre parmi l'assistance des voix assumer l'équivalence entre islam et islamisme — et les immigré·e·s, y compris ceux « de deuxième et troisième génération en Europe », qui seraient « encore plus radicaux » que les primo-arrivants. Autant d'ennemis partagés avec Tel-Aviv. La seule question qui se pose pour ces autoproclamés ennemis de l'antisémitisme est le positionnement par rapport à Israël et à son gouvernement. Pour le reste, un « certificat casher » (5) sera toujours émis pour absoudre les errements réellement antisémites et autres racines nazies des nouveaux alliés face au « nouvel antisémitisme ». Preuve en est que la présence d'antisémites avérés sur les listes du RN aux législatives de 2024 ne disqualifie pas pour autant Jordan Bardella.
Si des Israéliens ont été choqués par l'organisation de cet événement, ils représentent une infime minorité. L'écrasante majorité de la population est déjà favorable à l'interdiction de l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza — à l'image de la Cour suprême qui vient de rejeter à l'unanimité la requête d'un renouvellement de cette aide —, ou approuve le plan de nettoyage ethnique proposé par le président étatsunien Donald Trump. Cette majorité s'accommode également très bien de vivre au quotidien dans un territoire de plus en plus militarisé. Gageons qu'elle souscrit volontiers, sinon à l'identité des acteurs invités à cette conférence, du moins à celle des ennemis communs que ces derniers partagent avec Israël : les antisionistes, les musulman·e·s et les immigré·e·s. À Jérusalem, comme dans une partie du monde occidental, la haine est officiellement devenue un programme politique.
Notes
1- « Pour Bardella, Jean-Marie Le Pen “n'était pas antisémite” », Le Figaro, 5 novembre 2023.
2- Gilles Paris, « Les nouveaux habits pro-israéliens de l'extrême droite européenne », Le Monde, 31 mai 2024.
3- George Orwell, 1984.
4- Le nom de Florence Bergeaud-Blackler, à qui l'on doit l'expression « frérisme d'atmosphère », a été mentionné comme référence scientifique durant cette conférence.
5- L'expression revient souvent dans la bouche d'Ariel Muzicant, président du Congrès juif européen, ou du député des Démocrates Gilad Kariv, tous deux opposés à l'invitation de l'extrême droite en Israël.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis : Quelle est la distance qui nous sépare du fascisme ?

La question largement débattue aujourd'hui en Amérique parmi la moitié du pays qui a voté pour les démocrates ou qui se considère comme progressiste, et parmi celles et ceux qui se situent à l'extrême gauche, est la suivante : « Donald Trump a-t-il créé un régime autoritaire en l'espace de quelques mois ? Et à quel point sommes-nous proches du fascisme ? »
Hebdo L'Anticapitaliste - 747 (27/03/2025)
Par Dan La Botz
Tous les journaux télévisés et radiophoniques, toute la presse écrite traditionnelle et les médias sociaux débattent de cette question. Les preuves s'accumulent pour répondre à la question : Trump a instauré un régime autoritaire et nous nous dirigeons vers le fascisme. Qu'est-ce qui vient étayer l'idée que la démocratie traditionnelle et la séparation des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) sont en péril grave ?
Vers une dictature techno-politique ?
Trump et les Républicains contrôlent la présidence et les deux chambres du Congrès et le président a nommé une grande partie de la Cour suprême de droite qui a donné au président l'immunité contre les poursuites pour les actes officiels commis pendant qu'il était en fonction. Le Congrès a de fait cédé son pouvoir. Aucun des Républicains du Congrès susceptibles d'être en désaccord avec Trump n'a voulu lui tenir tête, de peur qu'il ne détruise leur carrière politique. Le Parti démocrate national, dont la direction est divisée, n'a élaboré aucun plan de résistance au Congrès ou devant les tribunaux.
Trump a créé le Department of Government Efficiency (DOGE), qui n'est pas un véritable service gouvernemental, et a nommé le milliardaire Elon Musk à sa tête. Musk a fermé des agences créées par le Congrès, mis fin à des programmes gouvernementaux de protection sociale et licencié des dizaines de milliers d'employéEs fédéraux. Trump et Musk affirment qu'ils éliminent la fraude, le gaspillage et les abus, bien qu'ils n'aient jusqu'à présent présenté aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Certes, le peuple américain a élu Trump et donné aux Républicains une majorité au Congrès, mais le travail de Musk est clairement un coup d'État, une prise de contrôle inconstitutionnelle et illégale du gouvernement.
Trump s'arroge également le droit d'annuler des dépenses votées par le Congrès, ce qui constitue une violation de la Constitution, qui stipule qu'il doit exécuter fidèlement la loi.
Trump défie la justice
À ce jour, 132 actions en justice ont été intentées contre l'administration Trump pour ses actions illégales, et dans plusieurs d'entre elles, les tribunaux ont émis des injonctions arrêtant temporairement Trump et Musk et les obligeant même à rouvrir des agences ou à réembaucher des travailleurs licenciés. Trump a demandé — et c'est inédit — la destitution de ceux qu'il appelle les « juges fédéraux voyous », c'est-à-dire les juges qui prennent des mesures qui le bloquent. Le président de la Cour suprême, John Roberts, a réprimandé Trump en déclarant que la destitution n'était pas une réponse appropriée à un différend concernant une décision judiciaire. Dans certains de ces cas, Trump et son équipe semblent être sur le point de résister aux ordres des tribunaux, ce qui engendrerait une crise constitutionnelle et marquerait clairement la fin des normes gouvernementales démocratiques.
Il musèle les libertés
Dans le même temps, Trump, Musk et les législateurs républicains, ainsi que les influenceurs des médias de droite, appellent à la destitution des juges fédéraux et publient en ligne des informations personnelles les concernant, telles que leur adresse personnelle. Des juges et leurs familles ont reçu des menaces de mort et beaucoup vivent désormais dans la peur.
Trump s'en prend également aux universités, menaçant d'expulsion les étudiantEs activistEs néEs à l'étranger, comme Mahmoud Khalil, étudiant à Columbia, supprimant ainsi la liberté académique et la liberté d'expression.
Il veut aussi faire taire les médias. Dans un discours prononcé au ministère de la Justice, il a déclaré : « Je pense que CNN et MSNBC, qui écrivent littéralement 97,6 % de mauvaises choses à mon sujet, sont des bras politiques du parti démocrate et, à mon avis, ils sont vraiment corrompus et illégaux. Ce qu'ils font est illégal ». Trump a fermé le média international du gouvernement, Voice of America, et a également interdit à l'Associated Press (AP) d'assister aux conférences de presse, parce qu'elle a refusé de changer le nom du Golfe du Mexique en Golfe de l'Amérique. Nous vivons désormais dans un régime autoritaire, et le fascisme semble se profiler à l'horizon.
Dan La Botz, traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les investissements de l’université de Yale dans des entreprises vendant des armes à Israël violent la loi de l’État du Connecticut (É.-U), selon une plainte officielle.

Une plainte déposée auprès du procureur général du Connecticut indique que la fondation de Yale viole également ses propres politiques d'éthique en matière d'investissement.
Par Akela Lacy, The Intercept, New York, 26 mars 2025, 10h38
https://theintercept.com/2025/03/26/yale-endowment-israel-weapons-divest/
➜ ➜ Traduction partielle avec Google+a.c.
Photo : Joe Buglewicz/Bloomberg via Getty Images
Une affiche appelant au désinvestissement sur un panneau près de l'Université Yale de New Haven, dans le Connecticut, le 23 avril 2024.
Les investissements de l'université Yale dans des fabricants d'armes weapons manufacturers violent la loi de l'État du Connecticut, affirment les organisateurs de l'université dans une plainte déposée mercredi auprès du procureur général du Connecticut, William Tong.
La plainte demande au procureur général d'enquêter sur le refus refusal de Yale de répondre aux appels des manifestants du campus campus protesters' calls à se désinvestir des fabricants et fournisseurs d'armes militaires, dans le contexte de la guerre israélienne contre Gaza.
« Des investissements financièrement prudents peuvent être inéligibles s'ils sont profondément incompatibles avec la mission et les objectifs de l'université », indique la plainte, citant la loi de l'État et les politiques d'investissement de l'université.
Des universités à travers le pays font l'objet de poursuites judiciaires lawsuits et de plaintes fédérales concernant leur gestion des manifestations contre la guerre. Il s'agit de la première plainte demandant une enquête d'État sur une université pour son refus de se désinvestir de l'industrie militaire liée à la guerre, selon les organisateurs.
Les organisateurs allèguent que les administrateurs de Yale ont manqué à leurs obligations fiduciaires en maintenant des investissements qui exposent le fonds de dotation de l'université à des profits provenant de fabricants et fournisseurs d'armes militaires contribuant aux crimes de guerre commis par Israël.
Bien que Yale Corporation, qui gère le fonds de dotation de l'université, ne divulgue pas la grande majorité de son fonds de dotation de 40,7 milliards de dollars, les organisateurs affirment qu'au moins 4 milliards de dollars sont liés à des fabricants et fournisseurs d'armes militaires. Les rares documents publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) – 99,7 % du fonds de dotation de Yale n'étant pas rendus publics – montrent que l'université a investi plus de 110 000 dollars $110,000 dans des fabricants et fournisseurs d'armes militaires de l'armée israélienne, a rapporté le Yale Daily News l'année dernière. (...)
Les investissements comprennent de l'argent dans des fonds qui détiennent des actions de sociétés d'armement comme Raytheon,Boeing et Lockheed Martin.
La plainte allègue que ces investissements violent à la fois les obligations fiduciaires des investisseurs institutionnels décrites dans la loi de l'État et les propres politiques d'investissement de l'université, qui appellent au désinvestissement des entreprises qui « violent ou entravent l'application » du droit national et international. (Yale n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.)
Presque tous les États ont une loiexigeant que les institutions qui gèrent de l'argent pour des organisations à but non lucratif exonérées d'impôt doivent tenir compte de l'objectif de ces organisations caritatives dans leur décision d'investissement, ce qui signifie que l'esprit de ces choix doit être conforme à la compréhension générale de l'Internal Revenue Service selon laquelle la charitéfournit une aide aux personnes dans le besoin ou soutient le public. travail éducatif ou religieux.
La loi n'interdit pas explicitement les investissements dans une industrie spécifique comme la défense ou la fabrication d'armes, a déclaré l'avocat Ellis Carter.
« Les seules exceptions seraient si une restriction imposée par le donateur limite expressément certains investissements à l'égard d'un don particulier ou si l'université a adopté une politique interne intégrant des considérations éthiques, environnementales ou sociales dans sa stratégie d'investissement », a déclaré Carter.
Les directives d'investissement de Yale sont décrites dans « The Ethical Investor », un livre de 1972 écrit par un ancien professeur de la faculté de droit de Yale que le comité consultatif de dotation de l'université utilise pour guider son travail. L'Université de Yale a déjà interprété ses propres directivesd'investissement comme exigeant le désinvestissement des entreprises aidant au génocide ; violation du droit national, international et humanitaire ; ou de priver les élèves et les enseignants d'un environnement éducatif sûr, ont fait valoir les organisateurs. En 2021, Yale Corporation s'est désinvestie de deux grandes sociétés carcérales privées, CoreCivic et GEO Group.
« Les entreprises d'armement militaire développent, fabriquent et vendent des produits utilisés pour commettre des crimes de guerre et des violations du droit international, y compris la destruction d'écoles, d'universités, de professeurs, d'étudiants, de sites de préservation culturelle et de communautés entières palestiniennes », indique la plainte adressée au procureur général. « Étant donné que ces entreprises sont diamétralement opposées à la mission de l'Université, la prise en compte des objectifs caritatifs de Yale par un fiduciaire prudent et raisonnable interdirait à ces entreprises d'investir. »
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Nous vivons dans une dictature fasciste »

"Ma réponse aux violations des multiples jugements par D. Trump, c'est que le peuple doit prendre les devants parce que les tribunaux ne le feront pas. Ils ne le peuvent pas. Vous voulez que M. Khalil soit libéré ? Il faut aller à Jena et le libérer. C'est en quelque sorte ce qu'il faut (faire)."
Democracy Now, 19 mars 2025
Traduction et organisation du texte, Alexandra Cyr
Amy Goodman : (…) Le juge en chef de la Cour suprême a publié une rare déclaration qui critique le Président Trump et ses alliés.es pour leurs appels à la procédure de destitution contre des juges fédéraux qui ont émis des jugements contre le Président. Le juge en chef Roberts écrit : « Depuis plus de deux siècles il a été établi que la destitution n'est pas la réponse appropriée quand on est pas satisfait d'une réponse judiciaire. La procédure d'appel existe dans ces cas ».
La déclaration du juge en chef Robert est émise après que le Président Trump ait attaqué à plusieurs reprises un juge de district fédéral, le juge James Boasberg qui a ordonné à l'administration de cesser d'employer la loi sur les ennemis étrangers de 1798 pour expulser des immigrants.es. Cette loi n'a été employée que deux fois de toute l'histoire américaine et c'était en temps de guerre. Samedi, l'administration a ignoré le jugement du juge Boasberg de faire revenir aux États-Unis trois vols emportant des immigrants.es expulsés.es vers une prison à sécurité maximale du secteur privé au Salvador.
Dans une publication sur un réseau social, le Président Trump en a appelé de la destitution du juge Boasberg en le décrivant comme « un juge lunatique de la gauche radicale, un fauteur de troubles et un agitateur ». Mais pour vous donner une idée de ce juge, c'est lui qui avait ordonné la publication des courriels de Mme Hilary Clinton (durant la campagne présidentielle de 2016. N.d.t.).
Plusieurs des membres de l'administration Trump ont publiquement menacé de défier les jugements des tribunaux. Voici la déclaration de celui qu'on nomme le tsar des frontières, M. Tom Homan sur Fox News :
Tom Homan : Je suis fier de faire partie de cette administration. Nous n'arrêtons pas. Je n'ai rien à faire de ce que pensent les juges. Je me fiche de ce que pense la gauche. Nous sommes en route.
A.G. : Lundi sur les ondes de CNN, le conseiller à la Maison blanche, M. Stephen Miller, a déclaré que le juge Boasberg n'avait pas l'autorité de juger de (l'application) de la loi sur les ennemis étrangers de 1798. (…) Lundi au cours d'une audience le juge Boasberg a accusé l'administration d'adopter une approche telle que : « Nous n'en avons rien à faire, nous faisons ce que nous voulons ».
Tout cela survient alors que l'administration est face à de plus en plus de poursuites devant les tribunaux. Lundi, un autre juge a bloqué le bannissement des personnes transgenres dans les armées, décrété par le Président Trump. Un autre juge fédéral a statué que le démantèlement de l'USAID exécuté par Elon Musk violait la Constitution de plusieurs façons. Le Président a répondu sur les ondes de Fox News :
Président D. Trump : Nous allons faire appel. Nous sommes face à des juges voyous qui détruisent notre pays.
A.G : Comme les craintes d'une crise constitutionnelle augmentent, nous discuterons de la situation avec Elie Mystal correspondant du secteur justice sur The Nation. Son dernier article est intitulé : Trump is Trying to Create His Own Personal Legal Strike Force ». Il est aussi l'auteur d'un ouvrage qui sera publiédans quelque temps : Bad Law : Ten Popular Laws That Are Ruining America ».
Elie merci d'être de nouveau sur les ondes de Democracy Now ! Que se passe-t-il en ce moment avec ces attaques présidentielles contre les juges ?
Elie Mystal : Nous vivons dans une dictature fasciste. En ce moment c'est notre réalité. C'est ce que nous ressentons. Nous en sommes là. Ce n'est pas une crise constitutionnelle à venir, nous sommes en pleine crise constitutionnelle. (…) Comment pouvons-nous penser que nous sommes en démocratie, comment pouvons-nous nous dire dans une nation de droit si un seul homme, Donald Trump, peut défier les deux autres branches du gouvernement ? C'est ce dans quoi nous sommes. Et c'est ce que le Président a promis de faire et de fait, c'est ce qu'il fait.
Amy, vous avez diffusé le clip où le Président s'exprime, vous avez mentionné la déclaration du juge John Roberts et vous avez correctement pointé du doigt qu'il s'exprime rarement. Arrêtons-nous sur ce qu'il dit. C'est la déclaration la plus faible qu'il pouvait faire. Il tourne autour du pot en laçant ses jolis mots comme : « n'entreprenez pas de procédure de destitution contre les juges fédéraux. C'est mal » Il ne dit rien à propos des violations flagrantes des jugements des tribunaux par le Président Trump. Il ne dit absolument rien à ce sujet.
Encore une fois, (le juge) Roberts n'est pas votre ami. Il ne vient pas nous aider. Je pense qu'il est aussi effrayé par D. Trump que le reste du gouvernement. (…) Je ne connais pas de définition de la dictature fasciste que celle dans laquelle nous nous retrouvons en ce moment.
Juan Gonzalez (D.N.) : Elie, il y a une différence qualitative entre la situation actuelle et les confrontations antérieures entre l'exécutif et les tribunaux. Il faut remonter à 1800, quand il y a eu une fameuse bataille entre le Président Andrew Jackson et la Cour suprême à propos de la relative souveraineté des peuples amérindiens. Et F.D. Roosevelt a aussi eu ses conflits avec la Cour. Mais, comme vous le dites se sont une multitude de juges partout dans le pays qui émettent des jugements contre l'administration Trump. Qu'elle est, selon vous, la différence entre ce qui se passe maintenant et ces batailles historiques ?
E.M. : Donc, en ce moment, l'administration Trump s'exprime directement ; vous venez tout juste de diffuser (la déclaration) de ce dépravé de Stephen Miller qui déclare directement que les juges fédéraux n'ont pas autorité sur cette administration. C'était premièrement. C'est la coupure la plus profonde avec le passé. Ils ne prétendent même pas reconnaitre le pouvoir du système judiciaire fédéral à restreindre ou contrôler cette administration. (…)
Deuxièmement, si vous étudiez ces exemples historiques, pour la plupart il est question de financement militaire. (…) Andrew Jackson dit que les juges ont ainsi jugé pour l'empêcher d'aller de l'avant avec sa politique contre les amérindiens. C'était un génocide. Et Teddy Roosevelt avait expédié la Marine à mi-chemin dans le Pacifique. Il déclare quelque chose qui ressemble à : « Congrès, je suis sûr que vous allez les financer pour qu'ils reviennent n'est-ce pas » ? Il est question d'une branche exécutive exerçant sont large contrôle. Le commandant en chef exerce un large contrôle sur les militaires américains.nes. (…) Ici, il ne s'agit pas d'une situation militaire.
Les fonds de USAID lui ont été attribués par le Congrès. (On lui coupe son financement pour que les fonds reviennent au gouvernement et le juge ordonne que cela cesse). Que dit D. Trump ? « Non je ne le ferai pas, absolument pas ».
Un autre juge ordonne : « Ramenez ces avions et leurs passagers ». Trump déclare : « Non je ne ferai pas ça non plus ». C'est clairement de l'autoritarisme. Clairement, un homme, les caprices d'un seul homme contrôlent le pays. Et comme vous l'avez diffusé, sont tsar des frontières déclare littéralement qu'il ne respectera pas les jugements de cours. Stephen Miller dit cela aussi. D. Trump le dit. C'est ce qui diffère du passé.
Si qui que ce soit pense que c'est équivalent, je veux rappeler que je suis assez vieux pour me souvenir quand la Cour suprême a, inconstitutionnellement à mon avis, rendu l'avortement illégal. Je suis assez vieux pour me rappeler que le Président Biden n'est pas allé au Texas et dire quelque chose comme : « L'avortement pour toutes » ! D'accord ? Non il a respecté le jugement ridicule de la Cour suprême quant au droit des femmes de choisir. Alors, je voudrais seulement faire la comparaison entre la retenue de J. Biden quant aux jugements et ce que nous voyons de la part de l'administration Trump.
J.G. : Je voulais aussi vous demander (votre opinion) à propos de du détournement du Département de la justice en armement même s'il (D. TRump) prétend que c'est ce qu'on a fait antérieurement contre lui. Lors de son discours dans le Great Hall de ce département, il a déclaré : « À titre de chef de l'application de la loi dans notre pays, je vais insister et exiger complète et totale responsabilité pour tout ce qui s'est passé de mal et d'abusif antérieurement ». Il était avec le directeur du FBI, Kash Patel et la ministre de la justice, Mme Pam Bondi, tous deux en service.
E.M. : Oui et encore une fois, c'est D. Trump faisant ce qu'il avait promis de faire. C'est un dictateur agissant comme un dictateur n'est-ce pas ? C'est un homme qui prend personnellement le contrôle de l'appareil d'application de la loi aux États-Unis pour que ses membres attaquent ses ennemis.es politiques. C'est ce qu'il a promis de faire. Je suis surpris que les gens en soient surpris. Que pensiez-vous que cet homme allait faire ? Suivre la loi ? Il a même promis de faire cela. Alors, pourquoi les gens sont-ils surpris qu'il ne le fasse pas maintenant ?
Il est allé au Département de la justice (…), historiquement il est censé y avoir un mur de séparation entre ce Département et le Président des États-Unis. Revenons encore à J. Biden, il n'aurait pas contacté Merrick Garland (ministre de la justice d'alors n.d.t.) pour lui demander s'il faisait quelque chose à propos des personnes qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier.
Mais, mettons cela de côté. Le Président Trump est allé au Département de la justice pour déclarer, annoncer, confirmer qu'il a l'intention d'utiliser ce Département pour attaquer ses ennemis.es politiques, spécialement les avocats.es. Il a énuméré plusieurs d'entre eux et elles durant son discours, Jack Smith, Andrew Weissmannn, Norm Eisen spécifiant que cette tâche reviendrait aux avocats.es du Département (…). Ils et elles travaillent pour lui, pas pour le peuple américain. Il a rendu cela très clair. Les avocats.es de ce département vont, à sa demande, poursuivre les avocats.es qu'il croit s'opposer à lui. C'était le clou de son discours au Département de la justice.
Et qu'à fait Mme Bondi ? Qu'à fait M. Patel ? Ils se sont assis là et ont applaudi. Ils ont applaudi comme le flagorneur et la flagorneuse qu'ils sont. Et nous pouvons prendre pour acquis que les demandes illégales faites par le Président de poursuivre des avocats.es qu'il croit s'opposer à lui, seront exécutées.
Durant ce discours, à un moment donné il dit : « Sur CNN et MSDNC, on dit 97,6% de mauvaises choses contre moi ». C'est de l'exact D. Trump normal. Mais politiquement et légalement, il dit que vous pourriez poursuivre le média parce qu'il écrit de mauvaises choses contre vous. Encore une fois, si ça n'est pas de l'autoritarisme, de la dictature, du fascisme je ne comprends pas ce que ces mots veulent dire.
A.G. : Elie, je voulais connaitre votre opinion à propos des jugements de cours que l'administration défie clairement. Il y a le cas des prisonniers transférés dans une prison super maximum au Salvador alors que le juge a directement interdit cette opération en ordonnant : « Ramenez ces avions ». Il y en avait encore un sur le tarmac. Aussi le cas de la docteure Rasha Alawieh, professeure à Brown University spécialiste du rein. Un juge a statué qu'elle ne devait pas être expulsée, elle l'a été quand même. Pouvez-vous nous faire part de votre opinion à propos de ces cas et celui de Mahmoud Khalil qui se qualifie de prisonnier politique comme vous le savez. Il est détenu dans une prison de la police des frontières (ICE), à Jena en Louisiane. Il a protesté contre le soutien américain à Israël dans sa guerre à Gaza. Pouvez-vous nous parler de tout cela ?
E.M. : Amy, après son élection (D.Trump), le 5 novembre dernier, on m'a dit que les tribunaux allaient nous sauver, allaient le modérer, qu'ils seraient notre dernier gardien qui préviendrait une dictature militaire. Et j'ai répondu que ce ne serait pas le cas, parce que les tribunaux ne peuvent (concrètement) faire respecter leurs décisions. C'est l'exécutif qui voit à le faire. Et quand vous avez un exécutif comme celui de D. Trump, prêt à ignorer ces jugements il n'y a rien que les tribunaux puissent faire.
Donc, une partie de ma réponse sera de me retourner vers mes interlocuteurs qui m'ont répété pendant des mois que les tribunaux allaient nous sauver. Qu'est-il advenu jusqu'à maintenant ? Quel est votre plan maintenant ? Quand les tribunaux ont émis des jugements que D. Trump ignore, quel est le plan B ? Parce que le plan A qui disait que les tribunaux allaient nous sauver ne fonctionnera jamais.
Ma réponse aux violations des multiples jugements par D. Trump, c'est que le peuple doit prendre les devants parce que les tribunaux ne le feront pas. Ils ne le peuvent pas. Vous voulez que M. Khalil soit libéré ? Il faut aller à Jena et le libérer. C'est en quelque sorte ce qu'il faut (faire). Ce n'est pas parce qu'un.e juge va l'écrire sur une feuille de papier que ça va arriver. D. Trump va tout simplement l'ignorer. Nous l'avons vu quand ces Vénézuliens ont été expulsés illégalement après qu'un juge eut ordonné que les avions devaient revenir (aux États-Unis). Et aussi avec la docteure, qu'il a aussi expulsée en disant que ça c'était « fait trop vite » pour que les tribunaux aient eu le temps de juger.
Et encore une fois, je vais revenir au juge en chef Roberts, qui n'a rien dit à ce sujet. D'accord ? Et tout cet écran de fumée que représente « Oh ! Je ne destitue pas mes juges » ! Il n'a rien dit à propos du Président Trump qui refuse de faire revenir les avions tel qu'ordonné par un jugement de cour. C'est le genre de fascisme sous lequel nous vivons. C'est comme ça que je me sens mes amis.es.
A.G. : Merci beaucoup E. Mystal d'avoir été avec nous.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis – Effondrement constitutionnel

Pour les constitutionnalistes, le retour au pouvoir de Trump a créé un véritable vertige. La violation systématique des procédures légales et des normes constitutionnelles établies s'est déroulée à un rythme effréné, donnant lieu à plus d'une centaine de procédures judiciaires, un chiffre qui ne cesse d'augmenter.
25 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/25/etats-unis-effondrement-constitutionnel/#more-92147
Trump a émis une avalanche de décrets qui violent explicitement les lois du Congrès ainsi que le contenu de la Constitution, sur tous les sujets, du refus de la citoyenneté par le droit du sol à la lutte contre les mesures d'inclusion fondées sur la race, le sexe et l'orientation sexuelle, en passant par la dissolution d'agences gouvernementales établies par la loi. Parallèlement, Elon Musk s'est vanté de vouloir prendre le contrôle du gouvernement fédéral, dans le but de privatiser « tout ce qui peut raisonnablement l'être » en procédant à des licenciements massifs, à la vente d'actifs publics (dont « 443 propriétés fédérales », auxquelles pourraient s'ajouter d'innombrables œuvres d'art appartenant au domaine public) et au démantèlement de services essentiels : le tout en violation des dispositions du Congrès et de la Constitution interdisant aux citoyens non confirmés par le Sénat d'effectuer des tâches dévolues aux hauts fonctionnaires.
Ces éléments ont conduit certains commentateurs à établir des analogies entre ce qui se passe aux États-Unis et la situation de la Russie post-soviétique dans les années 1990. Cette période a connu la privatisation quasi complète de l'État russe et une redistribution massive des richesses entre les mains d'un petit nombre de kleptocrates, à l'abri de toute sanction, à l'exception de celles que leurs rivalités pouvaient les amener à s'imposer mutuellement. Mais il existe peut-être un lien plus profond avec l'histoire de la Russie : le système constitutionnel américain du XXe siècle s'est forgé et a trouvé son sens dans son antagonisme avec l'Union soviétique. Les principes fondamentaux américains, qui allient le concept de l'égalité raciale à un État-providence limité, se sont consolidés au cours de trois décennies décisives, du New Deal des années 1930 à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre froide et la révolution des droits civiques des années 1960.
De nos jours, l'Union soviétique a disparu depuis longtemps. Et maintenant, Trump (un milliardaire élu), Musk (un milliardaire non élu et bien plus riche) et une petite coterie de fidèles cherchent à provoquer l'effondrement de ce modèle constitutionnel américain en concurrence avec le leur. Leur action ne permet pas de savoir ce qui est à venir. Mais elle modifie fondamentalement le terrain sur lequel la gauche américaine intervient et nécessitera un mode d'opposition politique que le pays n'a pas connu depuis les années qui ont porté Roosevelt au pouvoir.
*
Pour comprendre ce qui se passe, il est nécessaire de saisir le fondement de l'ordre constitutionnelaméricain. Celui-ci comprend une série de composantes idéologiques et institutionnelles qui correspondent à ce que le sociologue suédois Gunnar Myrdal a qualifié en 1944 de « credo américain », à savoir l'idée que les États-Unis incarnaient la promesse d'une liberté égale pour toutes et tous. À une époque de rivalité planétaire avec l'Union soviétique dans un monde en voie de décolonisation, les élites nationales se sont explicitement ralliées à ce credo constitutionnel. Ses éléments constitutifs consistaient notamment en une compréhension de la Constitution comme étant fondée sur l'élimination progressive des inégalités raciales, sur la base des principes de la lutte contre la discrimination ; une conception antitotalitaire des libertés civiles et des droits à la liberté d'expression ; une défense du capitalisme de marché, partiellement contrebalancée par un État de droit et de protection sociale constitutionnellement établi ; l'acceptation de contrôles et de contrepoids institutionnels, avec les tribunaux fédéraux, en particulier la Cour suprême, en tant qu'arbitre ultime de la loi ; et un attachement à la suprématie mondiale des États-Unis organisée par un pouvoir présidentiel fort.
Tout cela montre clairement que ce n'est pas seulement le progressisme racial qui est attaqué. Les collaborateurs de Trump déchaînent le pouvoir présidentiel de manière à exploiter les tensions internes du système pour faire s'effondrer les dispositions constitutionnelles qui en constituent le fondement. Nous pouvons le constater avec les décisions de Trump de suspendre l'octroi de fonds, de retirer les habilitations de sécurité, d'interdire les discours « pro-diversité » ou d'expulser et peut-être même de traduire en justice des individus pour cause de participation à des manifestations. Bien sûr, l'ordre établi du milieu du XXe siècle a toujours connu des pratiques maccarthystes et n'a pas tenu ses promesses d'intégration, que ce soit par l'internement des Japonais ou les violations des droits pendant la « guerre contre le terrorisme ». Pourtant, après le déclin de la « peur du rouge » des années 1950, le maccarthysme, en tant que projet visant à attiser la peur généralisée, a été considéré par les élites politiques comme fondamentalement « anti-américain » et inconstitutionnel.
Ces pratiques répressives n'ont jamais disparu, mais elles étaient généralement réservées à des groupes défavorisés relativement circonscrits, tels que les radicaux noirs ou les critiques arabes et musulmans de la politique étrangère américaine (en particulier d'origine palestinienne). Ainsi, le soutien de Biden à la répression des manifestations contre la guerre à Gaza s'inscrit dans cette histoire houleuse de la période qui a suivi les années de la « peur du rouge ». En revanche, l'administration Trump, s'appuyant sur les dispositions sécuritaires de l'ère McCarthy et même des années 1790, a commencé à instrumentaliser l'action militante en faveur de la Palestine pour réprimer de manière radicale la liberté d'expression des citoyens non américains. Elle utilise également cette action militante, ainsi que les programmes universitaires et les mesures mises en place par les institutions autour de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI), comme prétextes pour porter un coup sans précédent à l'autonomie interne et à la liberté académique des universités. Cette attaque s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large contre la liberté d'organisation du centre et de la gauche américains, qui vise actuellement les cabinets d'avocats proches du Parti démocrate et pourrait bientôt s'étendre aux groupes de la société civile et aux plateformes de collecte de fonds.
Le détournement du pouvoir présidentiel effectué par les représentant.e.s de Trump en vue de démanteler l'appareil administratif de l'État, et peut-être aussi les grandes avancées sociales du milieu du XXe siècle, s'opère de manière similaire. Il pousse à l'instabilité l'équilibre constitutionnel établi entre capitalisme et régulation, pouvoir présidentiel et pouvoir judiciaire, de telle sorte que l'ordre ancien est de plus en plus difficile à maintenir. La pratique constitutionnelle américaine a toujours fait preuve d'un dualisme classique. Le pacte du milieu du siècle était régi à la fois par une Cour suprême à l'autorité impériale et par une présidence à l'autorité tout aussi impériale. Concrètement, l'attachement commun de l'élite à la domination mondiale des États-Unis signifiait que les tribunaux s'en remettaient au président pour les questions de sécurité nationale, ce qui permettait aux présidents de jouir d'un pouvoir de coercition extraordinaire à l'étranger ou aux frontières et d'agir dans le domaine des affaires étrangères comme un législateur quasiment incontrôlé.
Cette forme de déférence était le résultat d'une série de décisions de justice datant de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, dans lesquelles les juges s'abstenaient largement d'exiger des comptes sur les pratiques sécuritaires, telles que les extraditions de communistes ou le déclenchement de la guerre du Vietnam. Cela ne signifiait pas que les tribunaux ne contrôlaient jamais l'action de l'exécutif en matière d'affaires étrangères, mais que ces rares moments de contrôle s'inscrivaient dans un contexte de permissivité générale. Cette attitude de déférence « là-bas » s'est combinée à l'exercice par les tribunaux de contrôles étendus sur des questions considérées comme nationales, au point que le pouvoir judiciaire fédéral a effectivement fait office d'organe décisionnel dont les décisions finales vis-à-vis des autres instances du pouvoir étaient acceptées sans discussion. Cet équilibre a persisté parce que tant les tribunaux que les présidents ont largement accepté cette répartition des compétences entre affaires étrangères et affaires intérieures.
Mais à mesure que le pouvoir judiciaire fédéral américain devenait de plus en plus conservateur, la relation entre la présidence et le pouvoir judiciaire a pris une nouvelle dimension. Dans le domaine domestique, les tribunaux ont commencé à utiliser ce vaste pouvoir décisionnel pour s'attaquer à la réglementation économique, et ce, en élargissant le pouvoir présidentiel à l'intérieur même du pays. Pendant des décennies, des avocats conservateurs ont élaboré des arguments juridiques pour expliquer pourquoi les agences créées par voie législative constituaient une menace pour un « exécutif unitaire », c'est-à-dire le pouvoir intérieur du président de déterminer du fonctionnement de l'exécutif, indépendamment des directives législatives. Les décisions récentes des tribunaux n'ont peut-être pas démantelé les agences existantes. Mais elles ont eu deux effets : elles ont donné aux juges plus de pouvoir sur les procédures et les décisions des agences, sapant ainsi des acquis réglementaires établis de longue date. Et elles ont remis en question la possibilité qu'une législation inspirée du New Deal puisse limiter le pouvoir présidentiel de décision unilatérale en matière de fonction publique. En effet, la jurisprudence conservatrice sapait silencieusement les fondements de l'État administratif du milieu du siècle, donnant aux juges de droite un plus grand pouvoir pour affaiblir les agences et aux futurs présidents de droite un plus grand pouvoir pour faire de même.
Et donc, tout comme dans d'autres domaines, les décrets de Trump – démantelant unilatéralement les institutions fédérales au mépris des lois du Congrès ou des injonctions des tribunaux – exploitent les faiblesses du système constitutionnel. Comme ceux qui entourent Trump ne le savent que trop bien, une fois les agences fermées, le personnel licencié et les bâtiments vendus, il sera extrêmement difficile de reconstituer le cadre administratif antérieur. Ces dernières années avaient peut-être été ponctuées par des agressions judiciaires conservatrices de faible envergure contre les agences fédérales, soutenues par l'application au coup par coup de certaines théories en matière de pouvoir exécutif. Aujourd'hui, Trump et son équipe s'emparent de ces théories et appliquent la force brute d'un président impérial sans limites – que l'on a déjà pu voir à l'œuvre lors d'interventions à l'étranger – au fonctionnement quotidien de la gestion des affaires publiques nationales. C'est l'autoritarisme planétaire qui s'installe chez nous.
*
Comment les États-Unis en sont-ils arrivés là ? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les institutions juridiques et politiques américaines sont notoirement antidémocratiques. Elles sont organisées autour d'un système étatique qui accorde la représentation sur une base géographique plutôt qu'à des individus, et qui comprend de nombreux mécanismes de veto qui réduisent le caractère décisif du vote. Cette fragmentation est obtenue par le biais du Collège électoral, du Sénat, de la structure et du processus de nomination de la magistrature fédérale, ainsi que de la marge de manœuvre des États pour redécouper les circonscriptions, limiter le droit de vote ou faire obstacle aux programmes nationaux d'intérêt général. Comme nous l'avons vu, ce n'est que dans les circonstances extraordinaires du milieu du XXe siècle que l'État-providence limité et le « libéralisme racial » issus du New Deal ont été intégrés à la Constitution. Cela a nécessité un degré remarquablement élevé d'organisation et de mobilisation des travailleurs dans le contexte de la Grande Dépression. Et plus tard, cela s'est nourri du spectre de l'Union soviétique, de sorte que les élites politiques étaient prêtes à rechercher un compromis entre les partis afin de mettre en œuvre des réformes dans le domaine de la discrimination raciale, considérées par le centre-gauche comme par le centre-droit comme un impératif de sécurité nationale.
Mais à mesure que la guerre froide s'est atténuée et, surtout après l'effondrement de l'Union soviétique, la droite, de plus en plus enhardie, a été moins contrainte de respecter le pacte constitutionnel du milieu du siècle. Celui-ci a toujours suscité l'opposition virulente de l'ethno-nationalisme américain, une force puissante et persistante dans la vie collective, qui n'a pas disparu après les avancées des droits civiques des années 1960. Alors que nous avons tendance à nous concentrer sur la manière dont la guerre froide a entraîné aux États-Unis la répression violente des socialistes et autres militants de gauche, la perception du besoin de faire front commun contre l'Union soviétique a également incité les responsables politiques de droite à endiguer l'extrême droite, notamment en se livrant à une subtile chorégraphie avec le nationalisme blanc américain, à l'aide de « signaux codés » pour signifier leur sympathie tout en s'abstenant de cautionner explicitement certaines prises de position idéologiques.
Cependant, une fois l'URSS disparue, nous avons assisté à l'émergence progressive d'une droite réactionnaire prête à rompre tous les accords économiques et raciaux existants. Stratégiquement, la droite s'est concentrée sur le recours aux outils qui permettent d'exercer un pouvoir minoritaire dans l'ordre constitutionnel existant, avec ou sans majorité électorale. Au fil du temps, les avantages institutionnels de la représentation étatique lui ont permis de s'emparer de la Cour suprême, du Sénat et même de la présidence à deux reprises, malgré la perte de la majorité électorale. Plus fondamentalement, elle a instauré au sein de l'appareil du Parti républicain et de sa base électorale une culture qui considérait la démocratie multiraciale comme une menace quasi existentielle.
Dans le même temps, l'ordre constitutionnel souffrait du poids de ses propres limites idéologiques et institutionnelles. Les deux dernières décennies ont été marquées par une série de crises sociales – dont la plus importante a été l'effondrement financier et ses répercussions en cascade – qui ont mis en évidence la nécessité d'un renouvellement constitutionnel. Pourtant, les politiciens des années 2000 et 2010, qu'il s'agisse de Bush et McCain ou d'Obama, des Clinton et de Biden, étaient tributaires de l'ancien pacte, axé sur le caractère exemplaire des institutions américaines, la foi dans le libéralisme de marché, la valeur morale de l'interventionnisme mondial et la nécessité de réformes raciales mineures. Le problème, bien sûr, était que ces engagements avaient contribué à générer nombre des problèmes endémiques du pays et qu'ils ne pouvaient certainement pas les résoudre maintenant.
Pendant ce temps, la nature sclérosée du système constitutionnel impliquait que même lorsque les Démocrates contrôlaient les leviers du gouvernement, il devenait presque impossible de s'attaquer à ces questions. Sans le soutien populaire de l'époque du New Deal ou l'engagement bipartite en faveur du progressisme racial, pratiquement toute initiative démocratique significative était vouée à l'échec. Même si elle était adoptée par la Chambre des représentants, il fallait, avec le recours à l'obstruction systématique, obtenir soixante voix sur cent au Sénat. Mais le Sénat, en raison de la surreprésentation des zones rurales et des petites agglomérations, penchait déjà massivement en faveur de la minorité républicaine. Pour les démocrates, obtenir soixante voix signifiait donc remporter une supermajorité par-dessus une supermajorité. Les outils qui avaient forgé le pacte constitutionnel de la Déclaration d'indépendance n'étaient plus opérationnels, et l'impasse qui en résultait intensifiait la désaffection politique généralisée.
Il en a résulté un ensemble de circonstances presque idéales pour l'ascension et maintenant le retour de Trump. La préservation d'un ordre constitutionnel rigide issu du XXe siècle, bien après le moment historique qui l'a engendré, a non seulement empêché les réformes nécessaires et attisé la frustration à l'égard des présidents en exercice, mais elle a également permis à Trump d'accéder à la présidence en 2016 sans l'emporter au suffrage universel, puis de restructurer la Cour suprême selon des orientations complètement en décalage avec l'opinion publique. Lorsque Trump a tenté de contester le résultat des élections de 2020, les institutions en place ont rendu extrêmement difficile l'imposition de sanctions à son encontre, que ce soit par une procédure de destitution, des poursuites judiciaires ou son exclusion des futurs scrutins. En réalité, les institutions elles-mêmes n'avaient jamais effectué le travail essentiel de facilitation des réformes ou de prévention des crises de succession ; elles avaient toujours reposé sur un degré élevé de cohésion culturelle de l'élite, que ce soit au début de la République ou à l'époque des droits civiques pendant la guerre froide. Et maintenant, cette cohésion n'existait plus du tout.
Les défaillances de la Cour suprême, que les élites du milieu du siècle avaient conçue pour inculquer des valeurs communes et contenir les conflits, l'illustrent parfaitement. La Cour, presque ouvertement partisane, a joué un rôle crucial dans cette crise, depuis les mesures visant à supprimer la voix des électeurs de droite jusqu'à l'immunité quasi totale accordée à Trump après ses tentatives de faire annuler les élections de 2020. Et avant cela, ce sont ses décisions qui ont ouvert les vannes de l'argent des grands groupes pour le financement des campagnes électorales. Résultat : aujourd'hui, quelqu'un comme Musk peut utiliser sa fortune illimitée pour à lui seul bouleverser les motivations électorales des responsables politiques, en particulier au sein du Parti républicain, puisque les dépenses engagées lors de sa campagne pour les primaires lui permettent de neutraliser à volonté les ennemis qu'il a ciblés.
*
Trump est donc bien placé pour tenter de démanteler l'ordre constitutionnel des États-Unis. Contrairement à peut-être toute autre personnalité politique de l'histoire américaine moderne, y compris Roosevelt dans les années 1930, il jouit d'une capacité remarquable à imposer la discipline de parti aux responsables républicains, un pouvoir que le compte en banque de Musk ne fait qu'amplifier. Trump n'est peut-être pas en mesure de garantir l'élection d'un candidat qu'il soutient, mais ses liens avec sa base électorale signifient que les candidats qui n'ont pas sa faveur seront presque certainement écartés. En outre, il semble motivé par des griefs mesquins et un désir personnel de vengeance ; d'où l'importance qu'il accorde à l'amnistie de ses partisans et à la chasse à quiconque aurait précédemment tenté de s'n prendre à lui. Ce faisant, il a fait de la loyauté personnelle une valeur sacrée et a permis à ses partisans les plus zélés d'exercer une influence politique significative. Il en résulte un second mandat dominé par des idéologues d'extrême droite comme Russell Vought du Project 2025, ou Ed Martin, aujourd'hui au ministère de la Justice, qui sont bien moins motivés par des calculs électoraux que le responsable républicain typique.
De même, Musk semble avoir pour priorité l'accroissement de son pouvoir et son enrichissement personnel, et sa démarche est motivée par l'objectif connexe d'éliminer les contraintes que l'État fédéral impose aux entreprises privées. Ses initiatives visant à licencier en masse les fonctionnaires fédéraux sont révélatrices à cet égard. Bien que le New Deal n'ait jamais systématiquement cherché à limiter l'arbitraire de l'employeur dans le secteur privé, il a instauré des protections au niveau fédéral qui ont restreint le pouvoir des employeurs par rapport à ce qui se faisait ailleurs. L'objectif de Musk est de mettre fin à cette contrainte et de subordonner tous les emplois, publics ou privés, aux diktats des employeurs. Bien qu'il s'agisse clairement d'objectifs anciens de la droite, Musk agit également de manière indirectement motivée par des calculs électoraux. Pour Musk, le parti semble surtout être un outil utile pour libérer les entreprises du contrôle démocratique.
Cette conjonction de facteurs a suscité une volonté d'aller bien au-delà des limites qui ont traditionnellement freiné les républicains par le passé. Pourtant, l'administration est confrontée à des vents contraires non négligeables. Pour commencer, malgré l'idée d'un mandat évoquée par Trump, il reste historiquement impopulaire, n'ayant pas réussi à obtenir 50% des voix lors des élections de novembre. Sa victoire a été fondamentalement obtenue par défaut, en raison du rejet du président sortant lors d'un scrutin où la participation a été plus faible qu'en 2020. Et malgré les discours des Républicains selon lesquels Trump tient ses promesses électorales, la vérité est qu'il a nié vouloir mettre en œuvre des éléments clés de cette rupture constitutionnelle lors de sa campagne électorale, déclarant lors du premier débat : « Je n'ai rien à voir avec le Projet 2025 ». Pour de nombreux électeurs, Trump était considéré en 2024 comme un « modéré » et peu attaché à une idéologie particulière, une perception qui a favorisé sa campagne.
S'il dispose sans doute d'une base de soutien puissante, celle-ci reste minoritaire. Ce projet d'extrême droite ne bénéficie d'aucun soutien majoritaire, même de loin. En effet, la vision dérégulatrice de l'ère néolibérale a perdu de plus en plus de terrain au cours de la dernière décennie. Sa mise en œuvre dans une version extrême n'est viable qu'à court terme en raison de la discipline que Trump et Musk peuvent imposer au parti.
Mais l'horloge tourne, à la fois en raison de l'âge de Trump et de la limite de deux mandats (le narcissisme du président fait qu'il ne semble pas s'intéresser à la question de sa succession). De fait, l'une des conséquences probables à moyen terme de l'offensive trumpiste pourrait être le succès des Démocrates aux élections de mi-mandat de 2026 et un retour des Démocrates à la Maison Blanche en 2028, compte tenu de la prédominance du sentiment d'opposition au président sortant. Tant que les élections aux États-Unis restent plus ou moins équitables, il n'y a pas de chemin clairement tracé pour permettre à Trump, Vought, Musk, Martin et d'autres de consolider un nouvel ordre constitutionnel qui remplacerait l'ancien. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les trumpistes s'efforcent de mobiliser la machinerie étatique pour attaquer l'infrastructure institutionnelle du Parti démocrate : ses avocats, sa capacité à mobiliser les électeurs et ses réseaux d'ONG. Outre la punition des opposants à Trump, l'un des objectifs pourrait être de restreindre la force électorale démocrate sur le modèle des mesures de suppression des électeurs prises dans les années 2010 mais dont l'efficacité a finalement été limitée. S'il est trop tôt pour prédire l'issue de cette opération, il est clair que la base trumpiste n'est de loin pas assez importante pour rendre possible la répétition de telles opérations lors d'élections libres.
Cela ne veut toutefois pas dire que les effets potentiels de l'offensive en cours contre l'ordre constitutionnel existant sont à négliger. Si Vought et Musk parviennent à démanteler une grande partie de l'appareil étatique de réglementation et de protection sociale, il sera probablement impossible de le reconstituer sous sa forme antérieure. Compte tenu du contrôle de la Cour suprême par les trumpistes, on peut donc imaginer un résultat contrasté où certaines des mesures de l'administration seront finalement jugées inconstitutionnelles tandis que d'autres seront maintenues. Bien que ce résultat puisse suffire à satisfaire les centristes qui estimeraient alors que l'ordre ancien reste en place, la situation réelle sera néanmoins celle d'une compétence réglementaire considérablement réduite ainsi que d'un démantèlement plus poussé des réformes raciales et des droits fondamentaux des ressortissants étrangers. Élément crucial, alors que les principes fondamentaux de l'égalité raciale et des libertés civiles étaient autrefois inscrits dans un pacte partagé par les plus hautes sphères dirigeantes, ils pourraient désormais bien être remis en question à chaque échéance électorale.
Un tel résultat montre à quel point l'offensive constitutionnelle de Trump est fondamentalement une offensive culturelle dirigée contre les convictions fondamentales forgées au cours du XXe siècle. La politique d'extrême droite aux États-Unis épouse une conception ethnonationaliste ouverte d'essence chrétienne, doublée d'un individualisme forcené et cupide. Faire passer de telles idées pour normales s'inscrit dans une stratégie politique d'ensemble. Ceci est visible dans les vidéos réalisées ou promues par la Maison Blanche, qui se délectent de cruauté envers les immigrants ou transforment le nettoyage ethnique des Palestiniens en une plaisanterie sur les tours Trump à Gaza.
Effectivement, les coups portés à l'État administratif et aux universités s'inscrivent dans cette volonté de refonder la vie en société selon les valeurs de l'extrême droite. Même après une privatisation à grande échelle, l'État trumpiste aurait encore un rôle à jouer, mais en tant que lieu de pouvoir coercitif contre ceux qui sont perçus comme des ennemis et les éléments extérieurs, et en tant que source de subventions frauduleuses pour les kleptocrates de l'intérieur. L'université trumpiste aurait également sa fonction, mais en tant que moteur néolibéral encore plus extrême pour le retour sur investissement, en relation avec la promotion d'une culture de la « civilisation occidentale ».
*
Quelles implications pour la gauche ? Une réponse courante aux agissements de Trump a été de se rassembler autour de la Constitution et même de croire que les tribunaux sauveront le pays. On le voit dans l'idée que, en refusant de se conformer aux décisions de justice, Trump a déclenché une « crise constitutionnelle » ou une « mise à l'épreuve de sa résistance » – ce qui implique que tout pourrait encore revenir à la normale tant que les responsables écoutent les juges. Contre ce raisonnement, nous devons rappeler que c'est le système constitutionnel qui a ouvert la voie à l'ascension, au retour et à l'offensive actuelle de Trump. Compte tenu de la mainmise de la droite sur la magistrature fédérale, tout regain de confiance dans les juges n'est que le reflet du désir des Démocrates de convaincre suffisamment de bons Républicains de revenir à la raison et de désavouer Trump : un plan qui a échoué à plusieurs reprises.
Ce n'est pas en raison d'une confiance de principe dans les juges ou les normes constitutionnelles qu'il faut s'opposer à la violation des décisions de justice par Trump. La paralysie du système constitutionnel, aggravée par un mécanisme d'amendement impossible à mettre en œuvre, a fait que nombre des acquis démocratiques du pays, de la Reconstruction au New Deal, ont eux-mêmes nécessité un certain degré de transgression des règles. Les grands mouvements sociaux du passé, de l'abolition des esclavages aux droits civiques, en passant par le droit du travail et le droit de vote des femmes, ont appelé à défier les décisions de justice injustes qui ont maintenu l'esclavage, la ségrégation et la privation des droits civiques, ou criminalisé la syndicalisation. Compte tenu du contrôle actuel de la droite sur les tribunaux, la gauche pourrait se retrouver dans une situation similaire dans les années à venir, et appeler à la désobéissance civile à l'autorité judiciaire.
La gauche devrait néanmoins soutenir fermement les actions en justice et dénoncer le mépris de Trump pour les tribunaux, mais pour des raisons différentes. Ces actions sont un moyen, bien que limité, de protéger les plus déshérités contre une violence débridée. Et plus généralement, le mépris de Trump témoigne de l'acceptation générale de l'impunité par l'administration, qu'il s'agisse de tentatives de remise en cause du résultat des élections, de corruption massive, de licenciements arbitraires ou de représailles contre des opposant.e.s politiques. Aucun système démocratique, libéral ou socialiste, ne peut fonctionner si une clique puissante peut systématiquement s'exonérer de la loi tout en utilisant les rouages de l'État pour répandre la peur et l'intimidation.
L'exemple du New Deal rappelle également à la gauche américaine la nécessité de construire une base populaire capable d'imposer des changements significatifs dans l'ordre constitutionnel. Même avant l'agression actuelle de Trump, cet ordre avait échoué en tant que mécanisme permettant de résoudre les crises interconnectées de notre époque : économique, écologique, raciale. Toute perspective réelle de changement positif exigera une majorité solide, même si elle est inférieure aux très fortes majorités que nous avons connues dans la première moitié du XXe siècle. C'est une condition préalable essentielle pour que la gauche puisse rompre avec les règles, mais au nom de la démocratie.
*
Il est certainement envisageable que la faiblesse des Démocrates conduise à une nouvelle victoire républicaine lors des prochaines élections. Cependant, si les Démocrates se retrouvent au pouvoir, leur victoire pourrait s'avérer aussi creuse que celle de Trump : une victoire par défaut, remportée par un.e candidat.e parce que non sortant.e. S'ils parviendront peut-être à stopper les pires éléments de l'extrême droite américaine à court terme, en l'absence de véritables transformations au sein du parti lui-même, ils ne feront que reproduire le cycle de la désaffection à l'égard des sortant.e.s.
Malheureusement, rien dans le Parti démocrate actuel ne suggère qu'il comprenne la tâche que cela implique, ou qu'il soit capable de se comporter comme une opposition organisée et coordonnée. La récente défection de Chuck Schumer, le chef de la minorité au Sénat, qui n'a pas soutenu la direction élue du parti dans ses démarches visant à empêcher Trump d'obtenir l'adoption d'un budget, témoigne d'un manque de cohérence et de courage internes. L'appareil et les dirigeant.e s démocrates semblent prendre des décisions en fonction de leurs objectifs électoraux immédiats, sans tenir compte du contexte politique plus large. Alors que Trump et ses partisans agissent comme une avant-garde, la hiérarchie démocrate a été tellement façonnée par les règles de l'ancien pacte constitutionnel qu'elle semble manifestement incapable de s'en écarter.
Il en résulte une possible ouverture pour la gauche américaine. Alors que les démocrates centristes tentent en vain de maintenir l'ancien ordre constitutionnel et que l'extrême droite ne parvient pas à le remplacer par autre chose que la prédation et la xénophobie, le rôle des forces socialistes démocratiques pourrait être de proposer un autre choix crédible. Un telle initiative devra prendre de multiples formes. Elle nécessitera de défendre les personnes particulièrement vulnérables aux attaques de Trump, parmi lesquelles les non-citoyens, les personnes transgenres et les militants des droits des Palestiniens. Les politiciens et les commentateurs centristes ont fait preuve d'une volonté manifeste de mettre de côté tous ces groupes, en partie par pure suspicion idéologique, en partie par pur opportunisme électoral. Mais il est une leçon qu'a apprise depuis longtemps l'opposition politique confrontée à des régimes autoritaires, que ce soit dans le Sud des États-Unis à l'époque de la ségrégation ou ailleurs, et c'est que la volonté de défendre ses principes est un moyen essentiel d'instaurer la confiance et la solidarité entre les mouvements, y compris en période électorale. Cela implique de prendre des risques, même lorsque cela n'est pas dans l'intérêt immédiat du parti. Et l'incapacité de nombreux Démocrates à agir ainsi, c'est ce qui ouvre la voie aux formations de gauche.
Deuxièmement, la gauche doit mettre en place des structures qui puissent jeter les bases de changements transformateurs, tant au niveau de la Constitution que de la société dans son ensemble. Cela implique de protéger et de développer les institutions porteuses de sens – syndicats de travailleurs et de locataires, formations politiques de toutes sortes, lieux de liberté académique et d'autonomisation des travailleurs dans les universités, pour n'en citer que quelques-unes – qui intègrent les valeurs de démocratie et de solidarité dans la vie quotidienne. Prenons l'exemple des partis politiques. Aux États-Unis comme dans d'autres régions du monde, les partis ont longtemps joué le rôle de communautés sociales, proposant toute une gamme de services et de dispositifs et intégrant les individus dans leur environnement social au sens large. Mais aux États-Unis, le parti n'est pas une véritable organisation qui repose sur l'adhésion de ses membres, et encore moins une communauté sociale. Il s'agit exclusivement d'un moyen pour les élites liées à l'appareil officiel de se présenter aux élections et d'exercer des fonctions officielles. Les Américain.e.s interagissent rarement avec le parti, sauf pendant la période électorale, lorsque des sommes considérables sont dépensées au profit des futur.e.s élu.e.s.
Kamala Harris a réussi à récolter plus d'un milliard de dollars malgré sa défaite. Imaginez qu'un parti ait plutôt utilisé ses vastes ressources pour créer des structures au niveau local. Bien sûr, il existe des règles électorales fédérales aux États-Unis visant à limiter l'achat direct de votes, même si ces règles ont grandement facilité la tâche des entreprises et des milliardaires qui ont pu faire exactement la même chose. Mais cela n'empêche pas de réfléchir de manière créative à l'infrastructure communautaire plus large dans laquelle un parti s'inscrit. Les Black Panthers ont sans aucun doute commis de nombreuses erreurs stratégiques, voire éthiques, mais ils se considéraient comme une formation d'opposition ancrée dans la société civile. Parmi leurs réalisations concrètes les plus durables, on peut citer la fourniture de services à certaines des personnes les plus marginalisées du pays (petits-déjeuners pour les enfants, dispensaires, ambulances, vêtements, services de bus, soutien aux prisonniers et centres éducatifs). Il s'agissait de réponses à un besoin social réel, qui s'inscrivait dans une démarche d'intégration des populations locales au cadre organisationnel du parti. Ils cherchaient à créer, selon les termes de l'historien du populisme Lawrence Goodwyn, une « culture du mouvement » en opposition à celle qui prévalait.
C'est une leçon que la gauche pourrait retenir, compte tenu des initiatives parallèles de l'extrême droite en vue d'établir l'hégémonie de sa propre culture d'opposition. Si le succès électoral de Trump est dû en partie à la capacité de l'extrême droite à créer un univers façonné autour de sa personnalité, la gauche doit élaborer un projet qui fasse contrepoids. Son objectif devrait être de transformer le monde tel que les gens le vivent au quotidien à travers la médiation assurée par ses propres institutions : au travail, à l'école, dans leurs quartiers. Elle devrait contester la réalité à ce niveau élémentaire.
Le problème, bien évidemment, est que le terrain politique actuel – façonné par le long processus d'étouffement du travail et par la richesse et le pouvoir de la classe milliardaire – est très hostile. Les militants de gauche, à l'intérieur comme à l'extérieur du Parti démocrate, sont aussi constamment attaqués par leurs adversaires centristes, plus puissants et mieux coordonnés, qu'il s'agisse des manœuvres visant à faire échouer les campagnes présidentielles de Sanders ou de la répression des manifestations sur les campus en faveur de Gaza. La bataille se mène sur un terrain difficile. Mais le fait est que ni le centre ni l'extrême droite ne peuvent offrir une issue à la décadence institutionnelle de l'Amérique. Il fut une époque où, aux États-Unis et ailleurs, un univers culturel de gauche existait, et il n'y a pas d'autre solution que de le reconstruire.
Aziz Rana
Source – Sidecar. NLR. 21 mars 2025 :
https://newleftreview.org/sidecar/posts/constitutional-collapse
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro.
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74155
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump, la science et la création d’ignorance

Trump donne du fil à retordre aux scientifiques. C'est dans l'ordre des choses d'un fanatique, dont les alliés, les évangélistes et les propriétaires du numérique, se frottent les mains. Leur but : éradiquer tout ce qui leur nuit, consolider une base disciplinée, et pour se faire créer de l'ignorance. La science est bousculée mais ses disciples empruntent-iels les bonnes stratégies ?
26 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/26/trump-la-science-et-la-creation-dignorance/
Le nouveau gouvernement Trump s'en prend aux scientifiques. À peine deux mois après son investiture, le président états-unien a licencié des dizaines de milliers de chercheureuses, réduit les subventions allouées à la recherche, arrêté la collecte de données scientifiques et plus précisément celles portant sur l'environnement ou le climat mais aussi sur les discriminations sociales (race, classe, sexe), limité le droit à manifester sur les campus. Robert Proctor évoque une « guerre contre la science » [1]. Cette offensive ultraconservatrice participe, selon le professeur d'histoire des sciences, à « un âge d'or de l'ignorance ». Elle est facilitée par les soutiens les plus actifs du président, le très important mouvement chrétien évangélique qui essaime un imaginaire pauvre, complotiste, climato-septique, antiféministe, masculiniste, raciste. Se rallient sans sourciller à cette mouvance, les propriétaires du numérique, dont Bezos (Amazon), Zuckerberg (Meta), Musk (X, Tesla, Space X), toujours animés par la course aux technologies, la conquête de l'espace et la quête de profit financier rapide.
Asseoir un pouvoir souverain
La guerre contre les sciences et les scientifiques n'est pas nouvelle. Celle-ci connaît deux piliers concomitants et imbriqués. La première raison pour créer de l'ignorance est idéologique. Trump et ses alliés du capitalisme entendent éliminer tout ce qui leur nuit. Ce parti pris rappelle des périodes et des choix politiques délétères qui ont fini par échouer. Proctor mentionne le nazisme et sa « peur de moindre influence extérieure sur son monde ». On peut aussi mobiliser une brochette de dictateurs, Pinochet et Franco en tête, qui ont, dès leur coup d'État, mené une chasse aux intellectuel·les. Trump fait penser à d'autres homologues élus, et en particulier à Mahmoud Ahmadinejad, président de la République islamique d'Iran de 2005 à 2013, qui s'est fait élire en promettant de mettre l'argent du pétrole sur la table des démunis. Il a en fait suivi l'exemple de ses aînés pour mieux asseoir ses populisme et clientélisme religieux, dans son cas l'islam. Cela est passé par le nettoyage des universités des intellectuel·les dit « libéraux », la fermeture de journaux prisés par les étudiant·es et les milieux intellectuels et l'amplification de la censure (interdiction de publication de livres et de production de films) [2]. Dans tous les cas, l'objectif finalement banal de ces dirigeants est de barrer la route aux opposant·es en lutte contre le capitalisme, les discriminations et les violences, et de consolider un pouvoir souverain sur une population passive, voulu suiviste et docile. Assise sur un masculinisme politique et sur un alignement plus ou moins affirmé aux thèses de l'extrême-droite, la virtuosité de leurs agressions verbales et réelles se mesure à la production de violences épistémiques (expressions, imaginaires, représentations et descriptions de savoirs et connaissances) et par ricochet à la production d'ignorance.
Accélérer la société de l'ignorance
La deuxième raison pour créer de l'ignorance est techno-politique. Trump suit sans sourciller son club de milliardaires issus du numérique, des hommes blancs hétérosexuels riches diplômés, aux ambitions financières et technologiques internationales. Tous sont issus de la contre-culture nord-américaine, dont ils ont adopté la branche antipolitique : se méfier à tout crin de l'État et rejeter le politique. Pourtant tous ont convolé en noces avec les États qui depuis la naissance du secteur sous-traitent les politiques d'éducation, de santé, de transports, etc. Cette collaboration permanente s'illustre aux États-Unis mais aussi en dehors [3]. Pour seul exemple, Macron rencontrait Musk le 3 décembre 2022 à la Nouvelle-Orléans qui un mois plus tard apportait son soutien à la très contestée réforme des retraites [4]. Par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, des plateformes de diffusion audiovisuelles ou de communication en ligne, des applications de suivi d'activités sportives ou culturelles, de l'intelligence artificielle, etc. de nouvelles épistémès s'insinuent dans les esprits des utilisateurices que nous sommes au point de nous abêtir. Par exemple, dans notre très grande majorité, nous nous adaptons sans mot dire et continuellement aux changements que le propriétaire du numérique impose comme une mise à jour de sécurité ou logicielle. Nous nous soumettons à ces incises permanentes par souci de confort tandis que lui augmente sa capacité de concurrence commerciale [5]. Nous adoptons son langage, le like, le tweet, les story, les trolls, les threads. Nous modifions nos comportements. Parfois de mauvaise grâce, nous nous plions aux normes imposées par les logiciels que nous utilisons, alors que nous n'avons absolument pas été consulté·es dans leur création. En fait, tous les jours, nous empruntons un sens unique à très grande vitesse, celui mis en place par une poignée d'hommes qui nous interdisent d'aller dans un autre sens. Nous en arrivons à ne plus nous croiser ni à faire demi-tour tant rester entre nous nous rassure. Nous nous suivons, nous engouffrons dans un tunnel, cet entre soi qui nous conforte dans nos idées ou alimente nos seuls points de vue. Notre esprit critique se développe moins car nos pensées s'échangent de plus en plus sans contradiction avec d'autres. Petit à petit, nos pensées sont bouleversées : elles s'occidentalisent, se libéralisent, se sexualisent, se racisent.
Dirigeants politiques et propriétaires du numérique construisent ainsi depuis les années 1990 une société de l'ignorance dont nous acceptons les règles. Michel Foucault avait évoqué la société disciplinaire [6], organisée autour d'institutions d'enfermement (usines, hôpitaux, écoles, prisons). Gilles Deleuze avait parlé des autoroutes de la société de contrôle [7] : celleux qui les empruntent sont confronté·es à des normalisations qu'ielles acceptent volontiers pour avancer plus vite alors qu'elles sont des formes de pouvoir. Désormais, les « autoroutes de l'information » [8] nous contraignent à une constante surveillance, susceptible d'être suspendue par décision discrétionnaire, sans que nous ayons aucune prise sur les raisons qui la motivent. Finalement, sur ces autoroutes, où les relations de pouvoir sont invisibilisées [9] et où les réalités complexes et les connaissances associées sont dépréciées [10], nous diminuons nos connaissances.
Rompre avec l'agnotologie des sciences
Proctor a bien raison de souligner cet « âge d'or de l'ignorance ». Malheureusement, nous vivons un paradoxe car une grande partie de la science dite dure, celle, en plus des sciences humaines, qui est fortement attaquée par Trump, produit de la connaissance tout en créant de l'ignorance délibérée, ce que le professeur d'histoire des sciences appelle l'agnotologie. Cette situation rend le développement d'une nouvelle épistémologie du soin, de l'éducation, de la recherche, du climat… très difficile. Prenons un exemple. La médecine produit de l'agnotologie de genre et de race [11], notamment parce que le système de santé français est fortement empreint de paternalisme, d'essentialisme mais aussi d'histoire de l'esclavage, de la colonisation et de l'après-colonisation.
Commençons par l'agnotologie de genre. En pratiquant majoritairement ses essais cliniques sur les hommes, en sous-orientant les diagnostics des pathologies chez les femmes [12], et plus globalement en n'intégrant pas le genre dans la santé, la médecine maltraite les femmes. La recherche médicale continue de se concentrer sur le contrôle de leurs corps en tant que personnes dédiées à la reproduction sexuelle [13] et à la gestion de la vie quotidienne (éducation, santé, alimentation des ménages) si bien qu'elle continue à les réduire à leur essence féminine, qui connaîtrait des troubles liés à leurs chromosomes, leurs hormones, leur cycle, leurs humeurs.
De fait, les médecin·es expérimentent des traitements sur des personnes qu'ils considèrent d'emblée soumises, en adoptant une posture de père (de mineur·es civiques) ou de maître (d'esclaves) [14]. Rappelons que pendant la colonisation, les médecins, très majoritairement des hommes, ont par leurs rapports médicaux, leurs essais sur les situations sanitaires des colonies ou encore dans leurs mémoires, dépassé le cadre de la pratique médicale pour jouer un rôle majeur dans l'entreprise coloniale de création de dépendance [15]. Aujourd'hui, Ils perpétuent en particulier l'idée que le corps noir est plus immunisé, plus fort, plus endurant que celui des Blanc·hes [16] tout en renvoyant « le nègre » à l'état d'animal dont le corps doit être bridé et l'esprit domestiqué [17]. De la même façon, avec le syndrome méditerranéen, un stéréotype bien ancré dans la profession, des médecin·es considèrent que les personnes, et plus particulièrement les femmes, nord-africaines ou noires vivant autour de la Méditerranée, exagèrent leurs symptômes et leurs douleurs [18]. De nombreux faits d'actualité en témoignent. L'ensemble construit une agnotologie de race.
La médecine peut alors représenter l'exégèse de cette science qui met volontairement ses piliers – patriarcat, esclavage, colonisation – sous le tapis. Alors, comment soutenir les scientifiques et les espaces de transmission des savoirs dominants ? Comment les aider à transformer la pédagogie à mettre en place dans les enseignements scientifiques ? Comment les soutenir efficacement dans la lutte contre les assauts religieux, technicistes, idéologiques ultraréactionnaires ? En les incitant à balayer devant leur porte.
Joelle Palmieri, 23 mars 2025
Notes
[1] Hervé Morin et Nathaniel Herzberg, « Robert Proctor, historien des sciences : « Nous vivons un âge d'or de l'ignorance », Le Monde, 9 mars 2025,
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2025/03/09/robert-proctor-historien-des-sciences-nous-vivons-un-age-d-or-de-l-ignorance_6577603_1650684.html
[2] Mohammad-Reza Djalili, « L'Iran d'Ahmadinejad : évolutions internes et politique étrangère », Politique étrangère, Printemps (1), 2007, 27-38.
[3] Alexandra Saemmer et Sophie Jehel (dir.), Éducation critique aux médias et à l'information en contexte numérique, Presses de l'ENSSIB, 2020.
[4] Sophie Cazaux, « Elon Musk apporte un soutien inattendu a la réforme des retraites du gouvernement », BFM patrimoine, 21 janvier 2023,
https://www.bfmtv.com/economie/patrimoine/retraite/elon-musk-apporte-un-soutien-inattendu-a-la-reforme-des-retraites-du-gouvernement_AN-202301210053.html.
[5] Jules Naudet, « Le numérique restructure le social – Entretien avec Roberta R. Katz », La vie des idées, Dossier : Faut-il avoir peur de la révolution numérique ?, 8 juin 2022,
https://laviedesidees.fr/Le-numerique-restructure-le-social.html.
[6] Michel Foucault, Construction politiques : savoirs, pouvoirs et biopolitique, Liège, Centre Franco Basaglia, 2012.
[7] Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », L ‘autre journal, n°1, mai 1990.
[8] Cette terminologie, utilisée pour la première fois en 1993 par le sénateur Al Gore, alors vice-président des États-Unis, va entrer dans les discours et rapports pour qualifier les réseaux de communication et leur importance pour la croissance économique de tous les pays.
[9] Fred Turner, L'usage de l'art – de Burning Man à Facebook, art, technologie et management dans la Silicon Valley, Paris, C&F Éditions, 2020.
[10] Edgar Morin, La méthode 4. Les idées, Paris, Le Seuil, coll. Essais, 1991.
[11] Joelle Palmieri, « Agnotologie de genre de la médecine : l'exemple de la douleur », in « La santé : un immense enjeu », Paris : Éditions du Croquant, collection Les débats de l'ITS, n° 15, mai 2024.
[12] Danielle Bousquet, Geneviève Couraud, Gilles Lazimi et Margaux Collet, « La santé et l'accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité », Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Rapport n° 2017-05-29-SAN-O27 publié le 29 mai 2017.
[13] Paola Tabet, La Construction sociale de l'inégalité des sexes. Des outils et des corps, Paris-Montréal : L'Harmattan (« Bibliothèque du féminisme »), 1998, 206 p.
[14] Grégoire Chamayou, « L'expérimentation coloniale », Les corps vils, sous la direction de Grégoire Chamayou, Paris, La Découverte, 2014, p. 341-384.
[15] Malek Bouyahia, « Genre, sexualité et médecine coloniale. Impensés de l'identité ‘indigène' », Cahiers du Genre, vol. 50, no. 1, 2011, p. 91-110.
[16] Delphine Peiretti-Courtis, Corps noirs et médecins blancs : La fabrique du préjugé racial, XIXe-XXe siècles, Paris, La Découverte, La Découverte, 2021.
[17] Achille Mbembé, Critique de la raison nègre, Paris, La Découverte, 2013.
[18] Isabelle Lévy, « La douleur : signification, expression, syndrome méditerranéen », Revue internationale de soins palliatifs, vol. 28, n° 4, 2013, p. 215-219.
https://joellepalmieri.org/2025/03/23/trump-la-science-et-la-creation-dignorance/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Budget 2025 du Québec—Aides pour les patrons, coupes pour les autres
Crise ou transformation ? Revisiter l’exceptionnalisme migratoire québécois
La question migratoire occupe une place de plus en plus centrale dans le débat public québécois. Le Québec se distingue par son autonomie dans la sélection et l’installation des personnes immigrantes, l’importance accordée à la langue française et sa propre approche de l’accueil. Pourtant, les profondes transformations récentes des politiques et des discours sur la migration interrogent cette singularité. Cette introduction situe le Québec dans son rapport à l’immigration permanente et à la migration temporaire sous deux angles : d’abord dans le contexte de l’exceptionnalisme migratoire canadien; ensuite, dans un contexte propre à la province en mettant en lumière ses particularités tout en les confrontant à d’autres sociétés. Nous soutenons que ce qui distingue le Québec du reste du Canada ne réside pas tant dans ses dynamiques migratoires que dans les cadres d’interprétation qui les accompagnent. Plus largement, nous mettons en avant l’importance de renforcer le lien entre recherche et débat public informé en proposant, au sein de ce numéro, des contributions qui analysent les transformations en cours, les rapports de force qui les façonnent et la redéfinition du modèle québécois d’(im)migration.
Le Québec face au dilemme de l’immigration
Cet article explore le dilemme de l’immigration au Québec, en mettant en lumière son évolution historique et son impact sur la politique contemporaine. Je retrace d’abord la manière dont le Québec a acquis ses pouvoirs en immigration, les circonstances et parties prenantes qui ont permis cette transformation, ainsi que les effets de ces avancées sur son rapport à la migration. J’explore ensuite comment la reconfiguration du système partisan québécois a redéfini ce dilemme. L’arrivée de la CAQ au pouvoir en 2018 a marqué une rupture avec le consensus sur l’immigration des élites québécoises. Plus généralement, je mets en avant un tournant identitaire dans le discours des élites où la protection de la langue, de l’identité et des valeurs québécoises prend une place centrale. Cette transformation soulève une question plus large : le contrôle accru de l’immigration constitue-t-il un rempart pour un nationalisme progressif et inclusif ou marque-t-il désormais un glissement vers une conception plus restrictive de l’identité québécoise?
La nouvelle politique de l’immigration au Québec
Les questions migratoires occupent désormais une place centrale dans les débats politiques au Québec, marquant une rupture avec leur statut historiquement marginal. Cette politisation s’inscrit dans une tendance globale et se manifeste par une saillance accrue des thèmes liés à l’immigration ainsi qu’une polarisation idéologique marquée. Depuis l’érosion du consensus interpartisan établi en 1991 avec l’Accord Canada-Québec, les partis politiques québécois adoptent des positions divergentes sur l’immigration, rompant avec le consensus pro-immigration des décennies précédentes. Cette nouvelle ère se caractérise par des seuils d’immigration réduits, un recours croissant à l’immigration temporaire et des réformes restrictives dans plusieurs domaines. En parallèle, les discours simplifiés et souvent polémiques amplifient les stéréotypes et creusent le fossé entre les politiques, les réalités de terrain, et les expériences des citoyen·nes. Cette politisation met en péril le sentiment d’appartenance des personnes immigrantes et menace la capacité du Québec à se projeter comme une terre d’accueil durable et inclusive, pouvant renforcer des divisions à long terme dans la société québécoise.
Long, complexe et précarisant : obtenir la résidence permanente à partir du Québec
Les récents changements en matière d’immigration permanente et temporaire, au Québec et au fédéral, sont susceptibles d’avoir des effets amplifiés sur les parcours des personnes déjà sur place et qui souhaitent obtenir la résidence permanente. Même si le premier ministre Justin Trudeau expliquait récemment que l’immigration permanente (qui vise l’installation) et l'immigration temporaire (qui répond à des demandes à court terme) sont deux catégories distinctes, celles-ci ne sont pas étanches et de plus en plus de personnes obtenant la résidence permanente ont une expérience temporaire préalable. Dans cet article, je propose de déplier les différentes couches de complexité des régimes migratoires canadien et québécois que doivent naviguer les résident·es temporaires espérant obtenir la résidence permanente au Québec. Je montre comment ce processus long et complexe de transition vers un statut de résidence octroyant les pleins droits – la résidence permanente – affecte leur parcours de manière souvent précarisante.
Stéréotypes et représentations des communautés italiennes et haïtiennes au Québec : une analyse historique croisée (1900-2024)
Cet article analyse l’évolution des stéréotypes associés aux communautés italiennes et haïtiennes au Québec depuis 1900, en mettant en lumière comment ces représentations ont évolué en fonction des transformations des lois canadiennes et québécoises sur l’immigration, ainsi que des changements sociaux, économiques et politiques dans la province. En examinant les processus historiques et les contextes spécifiques, il démontre que ces stéréotypes ne sont pas seulement des reflets des dynamiques migratoires, mais aussi des constructions sociales qui ont été façonnées par les rapports de pouvoir et les luttes d’intégration. À travers l’étude de ces deux groupes, l’article explore comment les défis d’intégration se répercutent sur la perception de ces communautés dans la société québécoise, soulignant les enjeux de racisme, de classe et de culture. L’argument central repose sur l’idée que les stéréotypes, tout en évoluant, persistent sous différentes formes, et que leur déconstruction nécessite une compréhension historique des processus migratoires et des politiques d’accueil.
La régionalisation de l’immigration au Québec. Au-delà des « postes vacants »
Depuis quelques années, la régionalisation de l’immigration connaît un nouvel élan au Québec. Il suffit de se promener aujourd’hui dans nombreuse villes du Québec pour s’apercevoir que la présence immigrante fait maintenant partie de la réalité quotidienne. Dans cet article, je propose de dépasser la logique économique du phénomène migratoire, celle des « postes vacants », pour s’intéresser à une dimension plus sociologique de la régionalisation de l’immigration, celle qui s’inscrit dans une lecture du territoire québécois. Je mets en avant une réflexion autour de l’importance qu’une nouvelle géographie de l’immigration peut signifier pour le développement et l’épanouissement de villes et régions situées en dehors des grands centres.
L’immigration, un enjeu municipal au Québec ?
Les municipalités québécoises jouent un rôle crucial, mais souvent sous-estimé, dans l’accueil, l’insertion et l’inclusion des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. Ce texte examine l’intervention croissante des municipalités dans ces domaines en répondant à quatre questions clés: pourquoi leur rôle mérite-t-il une attention particulière, quelles sont leurs responsabilités, quelles actions concrètes mènent-elles et quels défis rencontrent-elles? Face au transfert de responsabilités du gouvernement provincial et à l’urgence de répondre aux besoins locaux, plusieurs villes ont adopté des approches structurées pour bâtir des collectivités ouvertes et inclusives. Dans ce contexte, elles doivent concilier leur autonomie limitée avec les contraintes institutionnelles pour surmonter les défis liés à l’immigration. Loin d’être de simples exécutantes ou des relais du provincial, les municipalités doivent être reconnues de facto comme de véritables gouvernements de proximité, avec un potentiel encore à exploiter.
Le Programme des travailleurs étrangers temporaires au Québec. Les leçons du secteur agricole pour l’industrie de la construction
Au cours des dernières années, le Québec a connu une augmentation significative du recours au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTÉT), accompagnée d’une diversification accrue des secteurs d’emploi qui en bénéficient. Dans cet article, j’examine l’intégration récente du PTÉT dans l’industrie de la construction et la compare à son utilisation plus ancienne et bien établie dans le secteur agricole. Cette analyse vise à comprendre comment l’expérience accumulée dans le domaine agricole depuis les années 1990 peut éclairer les enjeux liés à la mise en œuvre du programme dans le secteur de la construction. Je m’intéresse particulièrement aux facteurs ayant favorisé l’embauche de la main-d’œuvre migrante temporaire, au-delà du discours dominant sur la « pénurie de main-d’œuvre ». Je mets en évidence le fait que le PTÉT a permis de fournir une main-d’œuvre vulnérable, davantage exposée à des formes d’abus qui ne sont pas toujours sanctionnées de façon adéquate, en recréant des conditions de travail similaires à celles recherchées dans le cadre des délocalisations à l’étranger. Enfin, j’explore la question de la défense des droits de la main-d’œuvre migrante temporaire dans ces deux industries, en examinant les défis auxquels sont confrontées les associations syndicales.
Migration inc. : les intermédiaires privés qui font tourner les rouages de la migration de travail temporaire au Québec
Au cours des dernières années, la croissance du nombre de travailleur·euses migrant·es temporaires au Québec a favorisé le développement d’une infrastructure migratoire commerciale facilitant l’organisation de la migration de travail temporaire. Cette infrastructure se compose de divers intermédiaires privés, tels que les agences de recrutement et les consultants en immigration. Dans cet article, je propose une réflexion sur les rôles et pratiques de ces intermédiaires dans les processus migratoires contemporains. Je décortique leurs multiples fonctions et lieux d’opération et explique comment leurs pratiques contribuent à façonner les précarités et opportunités dans les expériences des personnes migrantes. En insistant sur les champs d’action et les effets des pratiques d’intermédiation, je souhaite mettre en évidence le pouvoir qu’exercent les intermédiaires dans la gouvernance et la gestion de la migration de travail temporaire.
L’accueil des personnes déplacées ukrainiennes au Québec
Cet article aborde l’accueil des personnes déplacées ukrainiennes au Québec ayant fui l’invasion et agression russe de 2022. Alors que le Canada accueille la deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde, un statut migratoire temporaire novateur a été créé par le gouvernement fédéral pour admettre les déplacé·es ukrainien·nes et leur donner accès aux services d’établissement – ce qui n’est pas le cas pour les autres migrant·es temporaires. Le Québec s’est rapidement mobilisé pour soutenir les Ukrainien·nes. Dans la province, qui gère ses services d’établissement de manière autonome, les migrant·es temporaires étaient déjà éligibles aux services d’établissement depuis 2020. Les déplacé·es ukrainien·nes du Québec ont un profil démographique et socioéconomique similaire à ceux du reste du Canada. Au niveau local, ils font face aux mêmes défis qu’ailleurs au pays, par exemple l’inégale densité de la diaspora ukrainienne et des services de première ligne, mais aussi à des défis spécifiques tels que le rôle de la maîtrise du français dans l’admissibilité à la résidence permanente.
La « nouvelle vague » d’immigration française à Montréal vue à travers quelques commerces
Depuis le début des années 2000, l’immigration française vers le Québec, surtout à Montréal, connaît une forte augmentation. Dans cet article, nous présentons une facette de la « nouvelle vague » d’immigration française à Montréal, soit l’ouverture de nouveaux commerces à destination des ressortissant·es français·es. À travers des entreprises comme Snatch (restaurant de tacos français), Top Discount (épicerie spécialisée en produits français), Double Menton et Saucisson (bistro français), nous explorons leurs répercussions économiques et socioculturelles sur la vie montréalaise. Cette facette de l’immigration française au Québec illustre comment ces mobilités transforment les paysages urbains et culturels tout en reflétant des aspirations à une qualité de vie différente. En parallèle, cette dynamique pose également des questions sur l’évolution de Montréal comme foyer de l’immigration française, particulièrement le Plateau Mont-Royal.
Germaine Beaulieu : Murmure à l’inconnu : Poésie : Les Éditions Mains libres : 2024 : 114 pages (recension)
Mireille Cliche : Le règne des incendiaires : Poésie : Écrits des Forges : 2024 : 76 pages (recension)
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











