Derniers articles

Haïti : terreur et stratégie de l’impuissance

La suspension des activités de Médecins sans frontières (MSF) dans deux centres de santé et l'assassinat, le 31 mars 2025, de deux sœurs religieuses sont autant de marqueurs de la descente aux enfers d'Haïti. L'Église a réagi en dénonçant l'inaction du pouvoir, dont l'impuissance renvoie à l'histoire du pays et à l'ingérence internationale.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/21/la-double-dette-dhaiti-1825-2025-une-question-actuelle-autres-textes/
Le 31 mars dernier, un nouveau massacre a eu lieu en Haïti. Parmi les victimes figurent Evanette Onezaire et Jeanne Voltaire, deux sœurs catholiques. Une semaine plus tard, à la suite d'une attaque ciblée survenue le 15 mars contre un convoi de MSF, l'organisation a annoncé suspendre ses activités dans deux structures. Ce double événement consacre à la fois l'extension territoriale des gangs au sein et en-dehors de la capitale Port-au-Prince, contrôlée à 85% par les bandes armées, et l'étendue de leur emprise, à laquelle plus aucun espace ni symbole – social, culturel ou religieux – n'échappe.
Ces quatre dernières années, MSF a dû, à plusieurs reprises, suspendre ses activités et déplacer ses centres en fonction des attaques et de l'avancée des gangs. En avril 2021, des hommes lourdement armés étaient entrés, en plein office, dans une église adventiste pour kidnapper quatre personnes. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. Une dizaine de jours plus tard, c'est un groupe de sept religieux catholiques, dont deux Français, qui étaient enlevés. Dénonçant la « dictature du kidnapping » par laquelle les gangs s'enrichissent, l'Église catholique avait appelé alors, phénomène inédit, à la grève des écoles, universités et hôpitaux dans son giron afin de protester contre l'insécurité.
Depuis lors, les religieux n'échappent pas à la violence. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'église Sacré-Cœur de Turgeau, dans le cœur de la capitale (et où se situait l'un des centres de MSF qui a suspendu ses activités), a été attaquée. À l'instar des autres institutions – publiques, médiatiques (les locaux de trois médias ont été saccagés le mois dernier), culturelles (c'est aujourd'hui la fondation emblématique FOKAL qui risque à tout moment de tomber entre les mains des gangs) –, les églises sont devenues des cibles. Elles n'offrent plus aucun refuge à une population cernée de toutes parts et abandonnée par l'État, qui ne cesse de résister.
Descente aux enfers
De 2021 à aujourd'hui, la même image revient – celle d'une « descente aux enfers » –, la même prière et la même dénonciation de l'inaction des autorités. Ainsi, dans son dernier communiqué, la Conférence haïtienne des religieux a exprimé « sa profonde douleur, mais aussi sa colère devant la situation infrahumaine », critiquant les « soi-disant leaders de ce pays, [qui] tout en s'accrochant au pouvoir, sont de plus en plus impuissants ».
De 2021 à 2025, de l'assassinat du président Jovenel Moïse au Conseil présidentiel de transition actuel, en passant par les deux ans et demi du gouvernement catastrophique d'Ariel Henry, soutenu à bout de bras par la communauté internationale, l'effondrement du pays s'est aggravé et accéléré. Plus d'un million de personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, sont déplacés par la violence et la moitié de la population a besoin d'une aide humanitaire.
Les autorités haïtiennes se succèdent, la violence s'accroit, l'impunité se renforce. L'embargo sur les armes – dont la quasi-totalité provient des Etats-Unis – et le régime de sanctions décidés par l'ONU sont peu ou pas appliqués, tandis que les quelques mille policiers de la mission multinationale armée, sur place depuis des mois, paraissent peu actifs et, de toute façon, inefficaces. L'échéance électorale de cet automne est un mirage auquel, par lâcheté ou intérêt, seules la classe politique haïtienne et la communauté internationale s'accrochent, pour ne pas reconnaître la faillite de la stratégie poursuivie jusqu'à présent. La transition est bloquée et il n'y aura pas d'élections.
À la merci des forces destructrices
À juste titre, l'église dénonce tout à la fois les exactions des gangs armés et l'inaction, sinon la complicité du pouvoir. Mais la passivité et l'indifférence de la classe politique en Haïti sont le pendant de l'interventionnisme de Washington et d'une oligarchie tournant le dos à la population pour mieux répondre aux injonctions internationales. Quelle puissance publique, quelle volonté politique peuvent en effet se déployer dans un pays piégé dans une équation internationale saturée par la dépendance et l'ingérence ?
La matrice néocoloniale s'est cristallisée en 1825 avec l'imposition par la France à son ancienne colonie d'une indemnité de 150 millions de francs pour dédommager les planteurs qui avaient perdus, avec leurs terres et leurs esclaves, toutes leurs richesses. À défaut de pouvoir recoloniser Haïti, on s'assurait de son contrôle. En échange, l'État français « concédait » une indépendance acquise vingt-et-un ans plus tôt, en 1804, à la suite du soulèvement des esclaves et d'une révolution qui avait chassé les troupes napoléoniennes.
Cette rançon contribua à enfermer le pays dans une spirale d'endettement, de crises et d'interventions étrangères. Elle consolida dans le même temps l'élite haïtienne et la logique impériale. Au fil du temps, Washington se substitua à Paris et la dépendance changea de direction. Demeure l'exigence des Haïtiens et Haïtiennes d'obtenir réparation de la France et de se dégager de l'emprise états-unienne.
« L'absence de réaction efficace face à l'insécurité persistante est un échec grave qui met en péril la nation abandonnée à la merci des forces destructrices » affirme la Conférence haïtienne des religieux. Les manifestations contre l'insécurité et la passivité des autorités en place se multiplient ; manifestations lourdement réprimées par la police. Le Réseau national de défense des droits humains (Rnddh) dénonce un « terrorisme d'État, qui, depuis 2018, est établi comme mode de gouvernance » et l'absence de plan des autorités, qui « cantonne l'institution policière dans un rôle de sapeurs-pompiers ». L'impuissance du gouvernement, la terreur des gangs, l'ingérence internationale ne sont pas des fatalités, mais des manières de gouverner dont les Haïtiens et Haïtiennes veulent se libérer.
Frédéric Thomas
https://www.cetri.be/Haiti-terreur-et-strategie-de-l
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Afghanistan : plus de 10% de la population pourrait être privée de soins fin 2025 faute d’aide américaine

Plus de 10 % des habitants d'Afghanistan risquent de ne plus avoir accès aux soins d'ici la fin de l'année 2025 à la suite de l'arrêt de l'aide américaine, a alerté l'Organisation mondiale de la Santé. Le système de santé, déjà affaibli, se retrouve dans une situation critique depuis que les États-Unis ont suspendu leur soutien en janvier. Il y a un mois, l'OMS signalait déjà que 1,6 million de personnes n'avaient plus accès à des soins vitaux en l'absence de financements alternatifs.
Tiré d'El Watan.
Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à trois millions de personnes, selon Edwin Ceniza Salvador, représentant de l'organisation en Afghanistan, qui estime que deux à trois millions d'Afghans supplémentaires pourraient bientôt être dans la même situation. Le pays, qui compte environ 45 millions d'habitants, est l'un des plus pauvres du monde. Depuis la fin du financement américain, 364 centres de santé ont déjà fermé et 220 autres sont menacés. L'OMS s'inquiète du risque croissant de décès liés à cette crise sanitaire. Malgré les efforts d'autres donateurs pour compenser l'arrêt du soutien américain, l'écart à combler reste considérable. Les États-Unis, qui étaient jusque-là les premiers contributeurs humanitaires dans le pays, ont supprimé 83 % des programmes de leur agence de développement USAID, représentant 42 % de l'aide humanitaire mondiale consacrée à l'Afghanistan.
En parallèle, la situation migratoire s'aggrave. Près de 60 000 Afghans ont été contraints de retourner dans leur pays entre le 1er et le 13 avril après l'annonce par le Pakistan d'une campagne d'expulsion massive visant des centaines de milliers de migrants. L'Organisation internationale pour les migrations a précisé que ces retours se sont effectués principalement via les postes-frontières de Torkham et de Spin Boldak. Avec ces retours massifs, les besoins humanitaires explosent, notamment dans les régions frontalières et les zones d'accueil déjà sous pression, selon Mihyung Park, responsable de l'OIM en Afghanistan.
Actuellement, trois millions d'Afghans vivent au Pakistan. Parmi eux, 800 000 ont perdu leur carte de résident en avril, tandis que 1,3 million bénéficient encore d'un permis de séjour temporaire valide jusqu'au 30 juin grâce à leur enregistrement auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Les autres vivent sans papiers officiels, dans une grande précarité.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sri Lanka : Fabriqué au Sri Lanka, taxé en Amérique et abandonné par le FMI

Le 2 avril 2025, le président américain Donald Trump a annoncé les tarifs douaniers du « Jour de la Libération », imposant des mesures commerciales aux partenaires du monde entier. Cette politique comprenait un tarif de base de 10% sur toutes les importations, ainsi que des « tarifs réciproques » stricts et spécifiques à chaque pays, visant à reproduire les tarifs que ces pays ont imposés sur les exportations américaines. Le Sri Lanka, un pays fortement dépendant des exportations de vêtements vers les États-Unis, a été frappé par un tarif stupéfiant de 44%.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière. Publié en anglais dans Polity. Source de l'image.
Cette décision a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie des vêtements prêts-à-porter (RMG) de cette nation insulaire, un secteur qui emploie 15% de la main-d'œuvre industrielle totale du pays, dont beaucoup de femmes, et contribue significativement aux recettes d'exportation et au PIB (Sri Lanka Export Development Board 2025). Au-delà du secteur de l'habillement, les répercussions économiques pourraient être vastes et profondes. Une baisse des exportations de vêtements mettrait à rude épreuve les revenus en devises étrangères du Sri Lanka, élargirait son déficit commercial et exercerait une pression à la baisse sur la roupie. Une monnaie plus faible, à son tour, augmente le coût des importations, entraînant une inflation plus élevée et faisant monter le coût de la vie. L'effet combiné des pertes d'emplois, de la baisse des recettes d'exportation et de l'augmentation des coûts pourrait faire passer le Sri Lanka d'une position déjà fragile à une crise économique et financière encore plus profonde.
« L'Amérique d'abord » ou effondrement économique ? Analyse de la guerre tarifaire de Trump
La décision de Trump d'imposer des tarifs douaniers étendus, même sur des « pays amis » comme le Sri Lanka, est mieux comprise à travers le prisme du populisme de droite et de la crise structurelle du capitalisme américain. Sa stratégie politique s'est constamment appuyée sur le populisme de droite, qui se nourrit de rhétorique nationaliste, de protectionnisme économique et de la représentation des nations étrangères, qu'elles soient alliées ou rivales, comme des menaces économiques pour les travailleurs américains. En imposant des tarifs sans discrimination, Trump renforce son image de défenseur de l'industrie manufacturière américaine et des emplois face à la mondialisation. Il a capitalisé sur la colère populaire, particulièrement parmi sa base électorale de la classe ouvrière, tout en ignorant commodément le rôle joué par les puissantes entreprises américaines dans l'exploitation des règles du libre-échange pour délocaliser leurs opérations à la recherche de profits plus élevés, une pratique qui est le résultat direct des incitations capitalistes et des politiques économiques néolibérales qui ont encouragé de tels comportements (O'Connor 2020). De plus, Trump a déformé la compréhension publique de la question en la présentant comme si d'autres pays « profitaient » et « escroquaient » les États-Unis (Dillon 2018). Cette guerre tarifaire permet à Trump de maintenir sa légitimité politique en démontrant son engagement envers les politiques « L'Amérique d'abord », même si elles perturbent des relations économiques de longue date (The White House 2025).
D'un point de vue systémique, la guerre tarifaire peut également être comprise dans la logique du capital, particulièrement la tendance à la baisse du taux de profit, une contradiction clé du capitalisme identifiée par les économistes marxistes (Harvey 2010). Au cours des dernières décennies, le capitalisme américain a fait face à des crises de rentabilité résultant de la délocalisation de la production vers des marchés du travail moins chers, des avancées technologiques, etc., et le pays a continué à s'appuyer de plus en plus sur la spéculation financière, la croissance tirée par la dette et des stratégies géopolitiques pour maintenir les profits (Foster et McChesney 2012). Dans ce contexte, les tarifs protectionnistes fonctionnent comme une tentative de reconfigurer le commerce mondial en faveur du capital américain en extrayant de meilleures conditions commerciales par la coercition économique. Même les tarifs sur les nations amies servent cette stratégie plus large : ils font pression sur les exportateurs étrangers pour qu'ils absorbent les coûts ou négocient des concessions qui, en fin de compte, profitent au capital américain.
Quand les rêves néolibéraux rencontrent le cauchemar tarifaire de Trump
La guerre tarifaire de Trump, en particulier le sévère tarif de 44% sur les exportations du Sri Lanka, justifie les critiques de gauche concernant la dépendance du gouvernement du Pouvoir Populaire National (NPP) aux prescriptions néolibérales soutenues par le FMI et à un modèle de croissance tiré par les exportations. Les prévisions budgétaires 2025 du gouvernement NPP dépendent fortement d'une reprise des recettes d'exportation, notamment du secteur de l'habillement, pour soutenir la consolidation budgétaire et financer les services publics essentiels. Selon la dernière politique commerciale et d'exportation du Sri Lanka, le gouvernement vise à atteindre un revenu annuel d'exportation de 18,2 milliards USD d'ici 2025, le secteur de l'habillement devant être le principal moteur, ciblant 5,2 milliards USD de revenus (Rizkiya 2025). Cependant, avec le plus grand marché d'habillement du Sri Lanka désormais effectivement fermé par un tarif de 44%, ces projections d'exportation deviennent rapidement irréalistes. Cela confirme ce que la gauche a longtemps soutenu : qu'une économie liée à la demande externe et aux flux de capitaux mondiaux est intrinsèquement instable, particulièrement lorsqu'elle est soumise à des politiques commerciales impérialistes et aux caprices de pays puissants comme les États-Unis (Chang 2002 ; Rodrik 2007). Au lieu d'isoler le pays des chocs externes, le cadre néolibéral axé sur les exportations du FMI a rendu le Sri Lanka plus dépendant et vulnérable.
De plus, le programme du FMI est fondé sur la restructuration de la dette souveraine du Sri Lanka, largement détenue par des créanciers étrangers. Pour gagner leur confiance, le gouvernement a été contraint de s'engager à des objectifs fiscaux ambitieux grâce à l'augmentation des revenus provenant des exportations (Fitch Wire 2025). Cependant, avec ces revenus maintenant menacés, le Sri Lanka risque de ne pas atteindre ses objectifs budgétaires et de service de la dette, mettant en péril le processus de restructuration et risquant plus d'instabilité, voire un défaut de paiement. Cela met en évidence une autre critique fondamentale de la gauche : la perte de souveraineté dans le cadre de la restructuration dirigée par le FMI, où les priorités nationales sont subordonnées aux exigences des créanciers et des marchés mondiaux (Stiglitz 2002).
Conclusion
La guerre tarifaire de Trump fait plus que causer des dommages à l'économie d'exportation du Sri Lanka. Elle expose les failles profondes et structurelles du néolibéralisme dirigé par le FMI. Comme l'affirme Ha-Joon Chang (2002), des pays riches comme la Grande-Bretagne et les États-Unis se sont industrialisés grâce à une utilisation intensive de politiques protectionnistes et d'intervention étatique, pour ensuite « retirer l'échelle » et faire pression sur les pays en développement pour qu'ils adoptent le libre-échange. Chang rejette l'affirmation néolibérale selon laquelle « Il n'y a pas d'alternative », soulignant plutôt que la mondialisation et le développement économique sont façonnés davantage par des décisions politiques que par une inévitabilité technologique (Chang 2007).
La gauche s'appuie sur cette critique en soutenant que les réussites en matière de développement ne sont pas issues de l'orthodoxie du marché libre, mais d'un mélange pragmatique de protectionnisme, d'entreprises publiques et de flexibilité stratégique. Par exemple, le développement rapide de la Corée du Sud a impliqué une forte direction gouvernementale, une politique industrielle et une approche sélective de la mondialisation (Chang 2002). Ils rejettent également l'économie du ruissellement, dont Thomas Piketty (2014) a montré qu'elle approfondit les inégalités plutôt que de promouvoir une prospérité partagée. De même, Dani Rodrik (2007) démontre que les pays qui ont ouvert leurs économies progressivement et selon leurs propres termes ont connu un développement plus stable et équitable que ceux qui ont suivi une libéralisation complète sous la pression du FMI ou de la Banque mondiale.
Des critiques comme Stiglitz (2002) et Chang (2007) avertissent que le libre-échange, dans sa forme actuelle, tend à privilégier les gains à court terme en matière de consommation tout en sapant les fondements structurels du développement à long terme. Il exacerbe souvent les inégalités et érode les industries nationales. En même temps, les institutions financières internationales comme le FMI appliquent un double standard : alors que les économies avancées déploient des stimuli fiscaux et une expansion monétaire pendant les ralentissements économiques, les pays en développement sont poussés vers l'austérité. Ces mesures, telles que l'augmentation des taux d'intérêt et la réduction des dépenses publiques, suppriment directement l'investissement, la croissance et l'emploi (Stiglitz 2002 ; Weisbrot et al. 2009).
Dans cette optique, les tarifs du « Jour de la Libération » sur le Sri Lanka ne sont pas seulement un événement économique, mais un tournant politique. Ils mettent à nu à quel point le modèle néolibéral actuel est dicté de l'extérieur et vulnérable. C'est un signal d'alarme pour le gouvernement du Pouvoir Populaire National. L'argument de longue date de la gauche résonne maintenant plus que jamais : la véritable reprise ne peut pas venir de la poursuite de marchés d'exportation volatils ou de la dépendance aux prêts étrangers. Au contraire, elle nécessite de reconstruire la souveraineté économique par la production nationale, la sécurité alimentaire et énergétique, et le contrôle démocratique sur la politique fiscale.
Dans un monde de plus en plus façonné par le protectionnisme et le nationalisme économique, le Sri Lanka doit repenser sa voie. La poursuite d'une croissance tirée par les exportations au détriment de la résilience nationale n'est plus défendable. Un modèle de développement enraciné dans l'équité, la durabilité et l'autonomie n'est pas seulement possible, il est crucial.
Taniya Silvapulle est chercheur à l'Association des Scientifiques Sociaux.
Références
Chang, Ha-Joon. (2002). Kicking Away the Ladder : Development Strategy in Historical Perspective. Londres : Anthem Press.
Chang, Ha-Joon. (2007). Bad Samaritans : The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. New York : Bloomsbury Press.
Dillon, Sara A. (2018). « Getting the 'message' on free trade : Globalization, jobs and the world according to Trump. » Santa Clara Journal of International Law 16 (2) : 1-44. Disponible sur https://digitalcommons.law.scu.edu/scujil/vol16/iss2/1/
Fitch Wire. (2025). « Sri Lanka's revenue raising drive key to credit profile. » Fitch Ratings (19 février). Consulté le 04/04/2025. Disponible sur https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/sri-lankas-revenue-raising-drive-key-to-credit-profile-19-02-2025
Foster, John Bellamy, et McChesney, Robert W. (2012). The Endless Crisis : How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China. New York : Monthly Review Press.
Harvey, D. (2010). The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. New York : Oxford University Press.
O'Connor, Brendon. (2020). « Who exactly is Trump's 'base' ? Why white, working-class voters could be key to the US election. » The Conversation (28 octobre) : https://theconversation.com/who-exactly-is-trumps-base-why-white-working-class-voters-could-be-key-to-the-us-election-147267
Piketty, T. (2014). Le Capital au XXIe siècle. Traduit par Arthur Goldhammer. Londres : Harvard University Press.
Rizkiya, Nuzla. (2025). « Sri Lanka aims US$ 18.2bn in export revenue for 2025. » Daily Mirror (17 janvier) : https://www.dailymirror.lk/business-news/Sri-Lanka-aims-US-18-2bn-in-export-revenue-for-2025/273-300272
Rodrik, Dani. (2007). One Economics, Many Recipes : Globalization, Institutions, and Economic Growth. New Jersey : Princeton University Press.
Sri Lanka Export Development Board. (2025). « Sri Lankan apparel industry capability. » Consulté le 05/04/2025. Disponible sur https://www.srilankabusiness.com/apparel/about/industry-capability.html?utm
Stiglitz, Joseph E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York : W.W. Norton & Company.
Weisbrot, Mark, Rebecca Ray, Jake Johnston, Jose Antonio Cordero, et Juan Antonio Montecino. (2009). IMF-Supported Macroeconomic Policies and the World Recession : A Look at Forty-One Borrowing Countries. Washington, D.C. : Center for Economic and Policy Research (CEPR). Disponible sur https://cepr.net/publications/imf-supported-macroeconomic-policies-and-the-world-recession-a-look-at-forty-one-borrowing-countries/
The White House. (2025). « America First Investment Policy. » (21 février). Consulté le 04/04/2025. Disponible sur https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/america-first-investment-policy/
Taniya Silvapulle
Traduit pour l'ESSF par Adam Novak
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Syrie : le fragile redémarrage post-Assad

Après plus de dix ans de guerre civile, la population est confrontée à un processus de relance et de reconstruction extrêmement complexe. Les premières mesures prises par le gouvernement en témoignent.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière. Source - Istituto per gli studi di politica internazionale, 18 avril 2025.
La chute du régime d'Assad en décembre 2024 avait rallumé l'espoir d'un avenir meilleur pour la Syrie. Cependant, après seulement quelques mois, de nombreuses difficultés sont apparues ou se sont aggravées : fragmentation territoriale et politique, ingérence et occupation par des forces étrangères, tensions sectaires, en particulier après le massacre des Alaouites dans la région côtière, et absence d'une transition politique inclusive et démocratique. Ces dynamiques constituent autant d'obstacles à une reprise économique et à un processus de reconstruction, tous deux urgents et nécessaires.
Les difficultés actuelles
Plus de la moitié des Syriens sont toujours des personnes déplacées, à l'intérieur du pays ou à l'étranger. 90 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et, selon les Nations unies, 16,7 millions de personnes – soit trois sur quatre – se sont trouvées dans le besoin d'une aide humanitaire.
L'amélioration des conditions socio-économiques est donc déterminante tant pour l'avenir de la Syrie que pour que la population syrienne s'implique davantage dans la transition politique actuelle. De plus, la reprise et la reconstruction nécessiteront l'aide financière internationale.
On estime que le coût de la reconstruction de la Syrie se situera entre 250 et 400 milliards de dollars. L'aide financière internationale, associée à l'implication de l'État, devrait être utilisée pour reconstruire les logements des populations déplacées et relancer les secteurs productifs de l'économie, en évitant d'alimenter les dynamiques spéculatives et commerciales.
Les investissements étrangers restent toutefois entravés par les sanctions imposées à la Syrie et à Hayat Tahrir Cham (HTC). Fin février 2025, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont suspendu les sanctions visant certains secteurs et certaines institutions syriennes. Les sanctions américaines de grande ampleur restent le principal obstacle. En janvier, l'administration Biden a assoupli celles qui frappaient le secteur énergétique et les transferts de fonds personnels. La nouvelle administration Trump, en revanche, n'a pas encore défini de politique claire à l'égard de la Syrie ni de position sur les sanctions.
Cela dit, même abstraction faite de ces mesures restrictives, la Syrie est confrontée à de profonds problèmes économiques structurels qui ralentissent la reprise économique et compromettent les perspectives d'avenir du processus de reconstruction.
L'instabilité de la livre syrienne (SYP) pose un autre problème important. Au lendemain de la chute du régime d'Assad, sa valeur sur le marché noir a grimpé en flèche en raison de l'afflux de devises étrangères, des anticipations d'un soutien de la part d'acteurs régionaux et occidentaux, des politiques monétaires visant à réduire l'offre de SYP sur le marché et de la dollarisation informelle. Mais le chemin vers la stabilisation de la SYP est encore long, ce qui décourage les investisseurs à la recherche de rendements rapides ou à moyen terme.
En outre, certaines régions du nord-ouest utilisent depuis plusieurs années la livre turque pour stabiliser les marchés affectés par la forte dépréciation de la SYP. Le dollar américain est également largement utilisé dans le pays. La réintroduction de la SYP comme monnaie principale pourrait donc s'avérer problématique dans un contexte d'instabilité.
Les infrastructures et les réseaux de transport syriens sont encore sévèrement endommagés. Les coûts de production sont élevés et de graves pénuries de biens essentiels et de ressources énergétiques persistent. La Syrie souffre également d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et la question de savoir si et quand ces travailleurs spécialisés reviendront reste ouverte.
Le secteur privé, composé principalement de petites et moyennes entreprises aux capacités limitées, doit encore faire l'objet d'une modernisation et d'une restructuration importantes après plus de treize ans de guerre et de destruction. Les ressources publiques sont également très réduites, ce qui limite encore davantage les possibilités d'investissement dans l'économie.
Les principales ressources pétrolières syriennes sont concentrées dans le nord-est du pays, actuellement sous le contrôle de l'Administration autonome du nord-est de la Syrie (AANES) à direction kurde. Un accord récent entre la présidence syrienne et l'AANES devrait faciliter l'accès de Damas à ces ressources. Cependant, la production syrienne de pétrole et de gaz naturel a continué de baisser considérablement depuis 2011. La production de pétrole est passée de 385 000 barils par jour en 2010 à 110 000 au début de 2025, une quantité largement insuffisante pour répondre aux besoins locaux. Avant la chute d'Assad, la Syrie était en grande partie approvisionnée en pétrole par l'Iran, mais ce soutien a depuis cessé.
Avec l'augmentation continue du coût de la vie et la dévaluation de la SYP, les Syriens sont devenus de plus en plus dépendants des envois de fonds. Le volume de ces derniers est supérieur à la fois aux investissements directs étrangers en Syrie, qui ont été minimes depuis 2011, et à l'aide humanitaire, qui a dépassé en moyenne 2 milliards de dollars par an ces dernières années.
Les premières décisions
Dans le même temps, l'orientation et les décisions économiques du gouvernement, qui outrepassent son mandat temporaire et imposent ou promeuvent sa vision économique comme modèle d'avenir pour la Syrie, consolident et accélèrent la mise en place d'un modèle néolibéral, accompagné de mesures d'austérité. Cette politique favorise principalement les intérêts des classes entrepreneuriales. Le chef du HTC, Ahmad al-Charaa, et ses ministres ont en effet organisé de nombreuses rencontres avec des hommes d'affaires syriens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, afin de leur exposer leurs visions économiques et d'écouter leurs demandes, dans le but de satisfaire leurs intérêts.
En outre, des signes concordants indiquent que le HTS accélère le processus de privatisation et met en œuvre des mesures d'austérité dans le pays. Avant sa participation au Forum économique mondial de Davos, le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Chaibani, a déclaré au Financial Times que les nouveaux dirigeants avaient l'intention de privatiser les ports et les entreprises publiques, d'attirer les investissements étrangers et d'accroître le commerce international. Il a également ajouté que le gouvernement « étudiera les partenariats public-privé afin d'encourager les investissements dans les aéroports, les chemins de fer et les routes ».
En ce qui concerne les mesures d'austérité, de nombreuses décisions ont déjà été prises. Le prix du pain subventionné a été augmenté de 400 SYP (pour 1100 grammes) à 4 000 SYP (initialement pour 1500g, ensuite ramené à 1200g). Au cours des mois suivants, la fin des subventions pour le pain a été annoncée, dans le cadre de la libéralisation du marché. Quelques semaines plus tard, le ministre de l'Électricité, Omar Shaqrouq, a déclaré dans une interview accordée en janvier 2025 au site The Syria Report que le gouvernement prévoyait une réduction progressive, voire même la suppression, des subventions sur l'électricité, car « les prix actuels sont très bas, inférieurs à leur coût, mais seulement de manière progressive et à condition que les revenus moyens augmentent ». Actuellement, l'approvisionnement en électricité du réseau public dans les principales villes du pays ne dépasse pas deux heures par jour. Dans le même temps, le prix de la bouteille de gaz domestique subventionnée a été augmenté de 25 000 SYP (2,1 dollars) à 150 000 SYP (12,5 dollars), ce qui a de graves répercussions pour les familles.
En outre, le ministre de l'Économie et du Commerce extérieur a annoncé le licenciement d'un quart ou d'un tiers du personnel de l'État, ce qui correspond aux employé.e.s qui, selon les nouvelles autorités, percevaient un salaire sans travailler. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'estimation du nombre total de travailleurs licenciés, alors que certain.e.s employé.e.s sont en congé payé pendant trois mois dans l'attente d'éclaircissements sur leur situation professionnelle réelle. À la suite de cette mesure, des protestations de travailleurs licenciés ou suspendus ont éclaté dans tout le pays.
Bien qu'une augmentation de 400 % des salaires des travailleurs ait été annoncée pour février 2025, portant le salaire minimum à 1 123 560 SYP (environ 93,6 dollars), cette mesure, qui n'a pas encore été mise en œuvre, reste insuffisante pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. Selon les estimations du quotidien Kassioun à la fin du mois de mars 2025, le coût minimum de la vie pour une famille syrienne de cinq personnes résidant à Damas s'élève à 8 millions de livres syriennes par mois (soit l'équivalent de 666 dollars). [1]
Fin janvier 2025, Damas a réduit les droits de douane sur plus de 260 produits turcs. Les exportations turques vers la Syrie au premier trimestre de cette année se sont élevées à environ 508 millions de dollars, soit une augmentation de 31,2 % par rapport à la même période en 2024 (près de 387 millions), selon le ministère turc du commerce. Les responsables syriens et turcs ont également exprimé leur volonté de rouvrir les négociations sur l'accord de libre-échange entre la Syrie et la Turquie de 2005, suspendu depuis 2011, dans le but d'élargir la coopération économique. Toutefois, cela pourrait avoir un impact négatif sur la production nationale syrienne, en particulier dans les secteurs manufacturier et agricole, qui pourrait avoir du mal à soutenir la concurrence des importations turques. L'accord précédent, conclu en 2005, avait eu des effets dévastateurs sur l'industrie locale, entraînant la fermeture de nombreuses usines, notamment dans les banlieues des grandes villes.
En conclusion, la Syrie est confrontée à des défis socio-économiques pressants. Dans un tel contexte, les problèmes sociaux et économiques doivent être traités rapidement afin d'améliorer les conditions de vie et la faculté de la population à participer à la vie politique pendant la période de transition. Cependant, l'orientation économique et politique du nouveau gouvernement, caractérisée par une volonté de libéralisation accrue, de privatisation, d'austérité et de réduction des subventions, ne fera qu'accroître les inégalités sociales, l'appauvrissement, la concentration des richesses entre les mains d'une minorité et l'absence de développement productif, autant d'éléments qui ont été à l'origine du soulèvement populaire de 2011.
Joseph Daher
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde.
Notes
[1] À la veille du ramadan, le Conseil norvégien pour les réfugiés a interrogé diverses personnes avec des revenus différents, qui ont estimé que le coût mensuel de la nourriture, du loyer et des services publics s'élevait à 3 millions de livres syriennes, soit 300 dollars américains, par famille, principalement en raison de la fluctuation constante du taux de change et de la volatilité du marché.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’armée israélienne transforme 30 % de la bande de Gaza en zone tampon, un demi-million de personnes sont déplacées et des dizaines d’autres sont tuées

L'armée israélienne affirme avoir transformé 30 % de la bande de Gaza en « zone tampon », tandis que l'ONU déclare qu'un demi-million de Gazaouis ont été déplacés depuis mars.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : A Deir al-Balah, les gens se réfugient dans un espace extrêmement surpeuplé, 3 juin 2024 © UNRWA
L'armée israélienne a annoncé que ses forces avaient pris le contrôle d'environ 30 % de la bande de Gaza, la transformant en un « périmètre de sécurité opérationnel », alors que l'agence de défense civile de Gaza a déclaré qu'au moins 37 personnes, dont la plupart se trouvaient dans des campements de civils déplacés, avaient été tuées lors d'attaques israéliennes jeudi.
L'armée a également affirmé dans un communiqué avoir attaqué environ 1 200 « cibles terroristes » depuis les airs et mené plus de 100 autres opérations ciblées depuis qu'elle a violé l'accord de cessez-le-feu et repris la guerre contre la bande de Gaza le 18 mars.
Elle a ajouté que la zone tampon élargie a permis à Israël de « parvenir à un contrôle opérationnel total sur plusieurs zones et itinéraires clés de la bande de Gaza ».
Parallèlement, les Nations unies ont indiqué qu'environ 500 000 Palestiniens ont été déplacés depuis la fin du cessez-le-feu à Gaza, lorsqu'Israël a repris ses attaques militaires sur le territoire palestinien dévasté.
« Nos partenaires humanitaires estiment que depuis le 18 mars, environ un demi-million de personnes ont été nouvellement déplacées ou déracinées une fois de plus », a déclaré mercredi Stéphanie Tremblay, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Plus petit et plus isolé
Israël a également déclaré qu'il continuerait à empêcher l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave, malgré les avertissements de plus en plus nombreux des groupes de défense des droits humains concernant des conditions proches de la famine, les produits de première nécessité venant rapidement à manquer.
« La politique d'Israël est claire : aucune aide humanitaire n'entrera à Gaza », a réaffirmé le ministre israélien de la défense, Israël Katz, ajoutant que le blocage de l'aide était « l'un des principaux outils de pression » utilisés contre le Hamas.
L'armée laisse également la bande de Gaza « plus petite et plus isolée », a-t-il poursuivi.
Un groupe d'activistes israéliens, Breaking the Silence, a condamné ces commentaires dans un message sur X, déclarant que la soi-disant « zone tampon » était un « nettoyage ethnique à grande échelle ».
La diminution des ressources à Gaza, associée au blocus de l'aide, a entraîné une augmentation de la malnutrition aiguë chez les enfants, a déclaré l'OCHA, l'agence des Nations unies pour les affaires humanitaires.
L'organisation a déclaré le mois dernier qu'au moins 3 696 enfants palestiniens avaient été diagnostiqués comme souffrant de malnutrition aiguë.
Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également publié une déclaration mercredi soir, indiquant qu'il avait demandé à son équipe de négociation de poursuivre ses efforts pour obtenir la libération des prisonniers détenus à Gaza.
Il a ajouté que M. Netanyahu avait procédé à une « évaluation de la situation » par téléphone avec l'équipe de négociation et les responsables des services de sécurité, et qu'il leur avait demandé de poursuivre « les démarches visant à faire avancer la libération des captifs ».
Des dizaines d'habitants de Gaza tués dans des frappes
L'agence de défense civile de Gaza a déclaré jeudi que 37 personnes avaient été tuées dans les frappes israéliennes, la plupart d'entre elles étant des personnes déplacées qui s'abritaient dans des tentes dans le territoire dévasté.
Les survivants ont décrit une forte explosion dans le campement densément peuplé qui a mis le feu à plusieurs tentes.
« Nous étions assis paisiblement dans la tente, sous la protection de Dieu, quand nous avons soudain vu quelque chose de rouge qui brillait, puis la tente a explosé et les tentes environnantes ont pris feu », a déclaré à l'AFP Israa Abu al-Rus.
« C'était censé être une zone sûre à Al-Mawasi, et l'endroit a explosé. Nous avons fui la tente en direction de la mer et nous avons vu les tentes brûler ».
Après qu'Israël a déclaré Al-Mawasi zone sûre en décembre 2023, des dizaines de milliers de Palestiniens ont afflué vers ses dunes de sable le long de la côte méditerranéenne pour se réfugier des bombardements israéliens.
Mais depuis, la zone a été touchée par des frappes israéliennes répétées.
Des sources médicales à Gaza ont également déclaré qu'Israël avait tué au moins 35 personnes tôt ce mercredi.
Israël a intensifié ses attaques sur la bande de Gaza jeudi matin, une canonnière israélienne stationnée au large de la côte du territoire tirant sur l'ouest de la ville de Gaza, avant que d'autres attaques ne frappent d'autres zones, notamment Rafah et Khan Younis.
Les hommages ont également afflué pour une journaliste palestinienne nommée Fatima Hassouneh et 10 autres membres de sa famille qui ont été tués par une frappe aérienne israélienne visant leur maison dans la ville de Gaza mercredi.
Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a déclaré que plus de 50 000 Palestiniens ont été tués par Israël dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, sans compter les milliers de personnes piégées sous les décombres qui sont présumées mortes.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’internationalisme de combat antidote au poison nationaliste du fascisme renaissant !

« La seconde histoire est liée au ghetto de Wilna. Jusqu'à son extermination, une partie des hommes étaient conduits hors du ghetto pour travailler dans une usine d'armement. Le directeur de l'usine était un jeune officier SS (on peut trouver son nom dans le livre de Kovner) qui chaque matin regardait attentivement les hommes qui venaient travailler. Ayant compris que Kovner était leur dirigeant, il s'arrange pour le voir tète à tête et lui demande de but en blanc : « Les gars, vous avez besoin d'armes ? » Kovner est sidéré.
Par Yorgos Mitralias
Il craint une provocation mais l'autre lui tend un revolver et depuis ce jour-là, chaque jour. Au moment du départ du convoi, il répète cette opération fort dangereuse pour tous les deux. Bien des années plus tard, lors du procès de Eichmann à Jérusalem, Kovner qui était un témoin de l'accusation, évoqua devant le tribunal l'histoire de cet officier. Eichmann, dans sa cage de verre, qui écoutait d'un air tendu, a brusquement éclaté : « Je connais ce traitre, nous n'avons pas pu l'anéantir ». C'est possible. Mais malheureusement il n'y a personne a qui demander s'il est encore en vie ». (1)
Cette incroyable histoire de l'officier SS qui pourvoie en armes ses détenus juifs destinés à la mort, afin qu'ils se libèrent de leurs bourreaux nazis, est tirée du passionnant livre autobiographique « Les sentiers du passé » (Ed. Syllepse) du grand historien de l'URSS Moshe Lewin. Et elle nous est venue en tête en lisant les dernières nouvelles concernant le -toujours plus grand- mouvement des réservistes Israéliens qui refusent de servir à Gaza, et qui ont comme mot d'ordre le très éloquent « Œil pour œil et nous devenons tous aveugles »…
Évidemment, ce n'est pas un hasard que tant Eichmann que Netanyahou utilisent le même mot, le mot « traitre » pour qualifier leurs compatriotes qui désobéissent à leurs ordres et refusent de participer à leurs guerres. D'ailleurs, tant Eichmann que Netanyahou emploient aussi le même mot, le mot « terroristes » pour rendre imprésentables leurs « ennemis » Juifs d'alors pour l'un, palestiniens d'aujourd'hui pour l'autre !
Cependant, au-delà de leurs analogies, sinon de leurs similitudes, force est de constater qu'il y a au moins une différence de taille qui sépare ces deux cas de refus d'obéir aux ordres des supérieurs. Dans l'actuel cas israélien, comme le constate le média israélien +972 « qui s'est entretenu avec plusieurs associations de défense des "refuzniks", la plupart des réservistes ayant défié ces derniers mois les ordres d'enrôlement n'ont aucune "objection idéologique réelle à la guerre". Ils sont plutôt "démoralisés, lassés ou excédés par sa durée interminable".*
Tout autre a été la motivation de l'officier SS qui armait les jeunes détenus -et partisans- Juifs de Vilnius. Lui, il a fait quelque chose qualitativement très différent : il ne s'est pas contenté ni de refuser la guerre par pure pacifisme, ni de montrer de la compassion pour les travailleurs « esclaves » juifs de son usine d'armement, ni même de les cacher et les aider à survivre, comme l'a fait l'officier de la Wehrmacht Wilhelm Hosenfeld pour le pianiste juif du ghetto de Varsovie Władysław Szpilman (2), ce qui serait déjà énorme. Lui est allé beaucoup plus loin en se joignant, tout a fait consciemment , à ces juifs, en leur offrant, jour après jour, des armes, sans qu'eux les lui demandent (!), pour qu'ils se battent contre son Allemagne nazie et son armée dont lui-même était un officier ! En somme, cet officier SS est le parfait « traitre » car il a changé de camp, passant du camp des bourreaux à celui de leurs victimes, afin de se battre avec eux -les armes à la main- contre la barbarie génocidaire !
Ceci étant dit, le grand problème actuel de la population juive d'Israël, et par conséquent de tout le Moyen Orient, est que, à quelques exceptions (héroïques) près, il manque cruellement de tels « traitres. Des admirables « traitres » de leur État raciste et génocidaire, qui sauveraient l'honneur non seulement de leur nation juive mais aussi de l'humanité entière en décidant de changer de camp pour se battre avec les victimes de leur propre pays, expropriés, humiliés, opprimés, massacrés, déportés, ethniquement nettoyés et exterminés dans ce qui est la definition du genocide !
Toutefois, ce qui devient de plus en plus évident c'est que le besoin urgent de ces « traitres » se fait sentir maintenant bien au-delà d'Israël et du Moyen Orient, pratiquement partout sur notre terre. Et cela parce qu'au moment où la peste brune refait surface, on a un besoin plus que vital de ces « traitres » et de leur exemplaire internationalisme pratique en tant qu'antidote aux démons nationalistes de l'entre-deux-guerres qui semblent plus menaçants que jamais. On a besoin des gens qui poussent jusqu'au bout leur logique antifasciste ou anticolonialiste comme par exemple l'a fait le Français Georges Boudarel quand il a décidé de se joindre aux maquisards Viet Minh qui combattaient l'impérialisme français au début des années '50. Ou comme l'ont fait ces jeunes trotskistes Français qui ont osé l'impensable, en éditant et en diffusant parmi les soldats Allemands de la base de sous-marins de Brest, le journal ronéotypé « Arbeiter und Soldat » (Travailleur et Soldat). Inutile de dire que tous ont payé très cher leur initiative internationaliste : Boudarel s'est trouvé jusqu'à la fin de sa vie dans le viseur des colonialistes impenitents Français qui voulaient se venger, tandis que la trentaine des militants français et de soldats allemands du groupe de Brest, ont été soit exécutes soit envoyés au Front de l'Est ou dans des camps de concentration. Quant au dirigeant de ce groupe, le jeune revolutionnaire Juif Berlinois Martin Monath alias Widelin, après qu'il a survécu miraculeusement à une première exécution par la Gestapo (deux balles à la tête et à côté du cœur), il a été repris et pendu.
A quelques jours du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Boucherie Mondiale, et au moment où le spectre de Hitler et de sq peste brune planent de nouveau sur notre vieux continent, il est plus qu'utile de se rappeler de ces héroïques internationalistes et de constater que leurs combats exemplaires sont d'une actualité brulante…
Notes
1. Abba Kovner : Juif, combattant, poète, sioniste de gauche. Après avoir tenté d'organiser l'insurrection du ghetto de Wilna (Vilnius), il s'enfuit par les égouts avec ses camarades pour gagner les forêts, où il devient une légende par ses exploits au combat à la tête d'un millier de garçons et filles juives, en lien avec des partisans soviétiques. Après la guerre, voulant se venger, il tente, heureusement sans succès, d'empoisonner l'eau des grandes villes allemandes. Une fois en Israël, il est actif dans la gauche sioniste et justifie les massacres des Palestiniens.
2. Voir le très beau film « Le pianiste » que Roman Polanski a consacré à la destruction du ghetto de Varsovie et à l'histoire du Juif Szpilman et de son sauveur officier de la Wehrmacht.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bande de Gaza : ce que la guerre fait aux femmes

Dans la guerre israélienne contre le territoire palestinien, les femmes sont encore plus victimes que les hommes. À la mort et aux blessures s'ajoutent des souffrances sociales et intimes, aujourd'hui mises en lumière par un rapport qui décrit tous les aspects de ces vies brisées.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
16 avril 2025
Par Gwenaëlle Lenoir
Dans la bande de Gaza, environ 12 000 femmes sont mortes dans les bombardements ou sous les tirs israéliens depuis octobre 2023, victimes des avions, des navires, des drones, des chars et des soldats de l'infanterie. Avec pour conséquence la « destruction complète du tissu social de Gaza », affirme le rapport « Violations israéliennes et inaction internationale, les femmes de Gaza brisées par une violence multiple » du Centre palestinien pour les droits humains (PCHR), publié au mois de février.
« Des femmes qui travaillent, des journalistes, des médecins, des soutiens de famille et des épouses ont été prises pour cibles, laissant des milliers d'enfants sans leur mère. Plus de 6 000 familles ont perdu leur mère, laissant un vide irréparable dans leur vie », écrit l'organisation en préambule.
Parmi ces victimes, deux avocates de cette ONG, Nour Abou al-Nour et Dana Yaghi, chargées justement de recueillir la parole des femmes et de leur apporter une assistance légale. Elles ont été tuées, avec plusieurs de leurs proches, dans les bombardements de leurs maisons familiales, où elles avaient trouvé refuge après leur déplacement forcé. La première le 20 février 2024 ; la deuxième quatre jours plus tard. Leur sort est emblématique de celui des femmes de Gaza.
En huit chapitres, le rapport du PCHR décrit tous les aspects de ces vies brisées. Chacun de ces chapitres est accompagné de témoignages collectés sur le terrain par les employé·es de l'organisation, qui risquent aussi leur vie. Ce sont pas moins de huit cents femmes de tous âges et toutes conditions sociales qui ont été longuement interrogées pour cette étude, à travers l'ensemble du territoire. Elles ont été choisies dans un échantillon plus large de 2 602 femmes. Célibataires, veuves, divorcées, mères de famille... tous les statuts maritaux sont représentés.
Blessures physiques, mort ou disparition de proches, perte des sources de revenus, politique de la faim menée par Israël, déplacements forcés, épidémies, séparations familiales, arrestations arbitraires : tous les aspects de la destruction de la vie des femmes sont abordés. Et ce, avec des détails et des précisions qui dessinent un paysage glaçant et rendent palpables les souffrances physiques et mentales de ces victimes et leur désarroi.
Des vies amputées
Les blessures physiques des femmes de Gaza conduisent souvent, dans la grande misère médicale du territoire palestinien, à l'amputation d'un membre inférieur ou supérieur. Ce qui induit une perte d'autonomie, des difficultés à accomplir leurs tâches habituelles, prendre soin des enfants par exemple. En l'absence de chirurgie réparatrice, les corps blessés ne sont que « rafistolés », et le sentiment de perte de leur féminité affecte la plupart des témoins. Cette souffrance-là est habituellement peu abordée, et c'est une des qualités du rapport d'en rendre compte.
« Les blessures et les défigurations ont non seulement marqué mon corps, mais ont également laissé une profonde cicatrice dans mon âme qui restera avec moi longtemps. Je vis maintenant avec une douleur constante, non seulement à cause de la santé que j'ai perdue, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance et de faiblesse qui me hante chaque jour, comme si je m'étais perdue », témoigne Ferial Ibrahim Souleiman al-Jamal, une veuve de 33 ans, grièvement blessée sur tout le corps par des éclats lors d'un bombardement aérien.
Même avec un corps intègre, les Gazaouies sont blessées économiquement, socialement, mentalement. La société de la bande de Gaza est conservatrice, et les rôles y sont fortement genrés. Dans une famille, le rôle du gagne-pain et du protecteur est généralement dévolu aux hommes. Perdre ce soutien – mort, disparu ou arrêté – produit de l'anxiété et de la dépression. Les femmes sombrent ainsi dans un sentiment d'isolement, renforcé par les déplacements forcés multiples qui séparent les familles et par la situation économique désastreuse.
La guerre n'a pas seulement détruit ma maison et mon projet ; elle m'a volé ma stabilité.
Wafa Abdullah Hassan al-Majdalawi, habitante de Gaza
Celles qui travaillaient ont perdu leur activité, que ce soit dans un bureau, une administration, une boutique, sur un marché, aux champs, et ne peuvent plus faire face aux besoins de leur famille et de leurs enfants quand elles en ont. Elles se retrouvent entièrement dépendantes de l'aide humanitaire et vivent dans l'angoisse.
Israa Atef Khamis Abou al-Ata, 27 ans, est mère de deux fillettes. Son mari, pêcheur, a été tué par des missiles israéliens avec un de ses compagnons le 25 octobre 2024 alors qu'il rangeait sa petite embarcation sur la plage. Elle s'est confiée à propos de ses deux enfants : « Aujourd'hui, je suis à la fois leur mère et leur père, assumant toutes les responsabilités que mon mari avait l'habitude de porter seul. Nous n'avons plus aucune source de revenus et je ne peux pas subvenir à nos besoins essentiels. »
Elle poursuit : « Je ramasse du bois de chauffage et je fais la queue pendant des heures pour obtenir de l'eau potable. La nourriture est rare et limitée, principalement des conserves. Je compte sur l'aide et la nourriture fournies par les cuisines caritatives, qui se composent principalement de pâtes et de lentilles. Cela ne suffit pas à répondre à mes besoins ni à ceux de mes enfants. Ma santé mentale s'est considérablement détériorée depuis la perte de mon mari. »
Des dignités brisées
Les femmes qui travaillaient se sentent tout aussi démunies. Ainsi Wafa Abdullah Hassan al-Majdalawi, 46 ans, habitante du camp de réfugié·es de Chati et déplacée dans une école de l'Unrwa servant d'abri, explique qu'elle a perdu la pâtisserie qu'elle avait montée à force de travail et de volonté : « Au plus fort de mon activité, je faisais travailler treize femmes, dit-elle. Malheureusement, la guerre a complètement détruit mon projet et j'ai perdu la source de revenus que j'avais construite pendant plus de onze ans. Ce projet était la sécurité économique de ma famille, et maintenant il ne reste plus rien. »
« J'ai essayé de lancer un petit projet avec des ressources modestes dans le refuge, mais les conditions difficiles l'ont rendu presque impossible, ajoute Wafa Abdullah Hassan al-Majdalawi. Le manque de matières premières dû au blocus sévère et aux déplacements répétés causés par les ordres d'évacuation israéliens empêchent toute forme de stabilité. Rien ne peut compenser ce que j'ai perdu. La guerre n'a pas seulement détruit ma maison et mon projet ; elle m'a volé ma stabilité et m'a arrachée à une vie que je croyais autrefois sûre, me laissant des blessures profondes et un fardeau insupportable. »
Les déplacements forcés et multiples obligent beaucoup de femmes à vivre dans des abris précaires ou des lieux surpeuplés où toute intimité est impossible. Leur dignité est brisée par les longues heures de queue devant les rares sanitaires, durant lesquelles elles sont exposées au regard de tous – une humiliation dans cette société. Elle l'est aussi par les files d'attente interminables pour obtenir l'aide alimentaire, l'eau potable.
Le cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier, accompagné d'une reprise conséquente de l'aide humanitaire, avait laissé espérer un mieux pour la population, en particulier pour les femmes. Mais la rupture de la trêve, dans la nuit du 17 au 18 mars, par l'armée israélienne, la reprise des tueries et des ordres de déplacement, permettent d'assurer que le prochain rapport sur le situation des femmes à Gaza sera encore plus alarmant.
Gwenaelle Lenoir
P.-S.
• Mediapart. 416 avril 2025 à 12h23 :
https://www.mediapart.fr/journal/international/160425/bande-de-gaza-ce-que-la-guerre-fait-aux-femmes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le génocide perpétré par Israël a repris, tout comme l’incapacité des médias à le couvrir

Israël a repris ses massacres à grande échelle à Gaza. Les médias occidentaux ont repris la même couverture désastreuse des 18 derniers mois.
Tiré de agence médias Palestine
15 avril 2025
Par Assal Rad
Le 18 mars, Israël a rompu le prétendu “cessez-le-feu” en vigueur depuis deux mois à Gaza en lançant l'attaque la plus meurtrière depuis novembre 2023 et en tuant plus de 400 Palestiniens, dont près de la moitié étaient des enfants. Depuis, la violence s'abat sans répit. L'Organisation des Nations unies estime qu'au moins 100 enfants sont tués ou blessés à Gaza chaque jour.
La décision d'Israël de reprendre le massacre à grande échelle n'a pas seulement replongé Gaza dans les profondeurs du carnage. Elle a également constitué un nouveau test pour les médias occidentaux. Après tant de mois de mort, et alors qu'Israël a clairement rejeté la paix, allaient-ils enfin accorder au génocide des Palestiniens le traitement médiatique qu'il mérite ?
Personne ne devrait être surpris de constater que la réponse à cette question a été un non retentissant. Alors que le génocide entre dans son 19e mois et que les atrocités se poursuivent, la faillite des médias continue.
Si des groupes de défense des droits de l'homme comme Amnesty International ont rapidement condamné les attaques du 18 mars et dénoncé « le génocide israélien et ses frappes aériennes illégales », les médias occidentaux se sont empressés de rationaliser les crimes d'Israël et de présenter les attaques comme étant « contre le Hamas ».
En focalisant leurs titres sur le Hamas plutôt que sur les nombreuses victimes civiles, les médias se font le relais des arguments israéliens sans tenir compte des vidéos rendues publiques qui montrent clairement qu'Israël bombarde à nouveau Gaza de manière indiscriminée.
Ce qui rend cette pratique des médias occidentaux d'autant plus indigne, c'est qu'ils traitent la plupart du temps les affirmations d'Israël – un État qui commet un génocide – comme des faits, tout en laissant planer le doute sur les autorités palestiniennes avec le préambule désormais couramment utilisé de « dirigé par le Hamas ». Pire encore, en privilégiant le langage de l' « accusation » plutôt que celui des faits, les médias minimisent les recherches et les rapports fondés sur des preuves d'institutions éminentes telles que les Nations unies, Amnesty International et Human Rights Watch.
Le 18 mars, à mesure que nos écrans affichaient le carnage causé par les frappes aériennes israéliennes et les images horribles des corps d'enfants palestiniens qui s'empilaient, les médias traditionnels ont bien été obligés de couvrir l'événement, mais sans le caractère d'urgence ou l'indignation que justifiait un tel moment. Les médias ont continué à parler d'un « cessez-le-feu fragile » ou à affirmer que la décision d'Israël de rompre unilatéralement son accord avec le Hamas avait mis le cessez-le-feu « en doute » – et non complètement détruit.
Cette affirmation absurde et le refus de qualifier les actions d'Israël de violation du cessez-le-feu – en particulier au lendemain d'un massacre israélien – illustrent la façon dont les médias occidentaux ont défini la notion de « cessez-le-feu » pour les Palestiniens depuis le début de la trêve censée avoir commencé le 19 janvier.
Dans les faits, Israël a tué en moyenne trois Palestiniens par jour au cours de cette période. Pourtant, les grands titres occidentaux ont continué à faire référence à un cessez-le-feu.
Les médias utiliseraient-ils le même langage si trois Israéliens en moyenne étaient tués chaque jour ? On peut gager qu'une telle situation ferait plutôt l'objet d'une couverture approfondie, avec des unes sur les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu.
Seulement quelques jours avant le massacre du 18 mars, une seule attaque israélienne a tué neuf Palestiniens, un incident que les médias n'ont toujours pas caractérisé comme une violation de l'accord.
Cela illustre également le caractère trompeur et mensonger du discours israélien selon lequel « il y a eu un cessez-le-feu le 6 octobre ». Pour les Palestiniens qui vivent sous l'occupation militaire, le blocus et l'apartheid, et qui sont constamment menacés de perdre leur maison, leur terre et leur vie, il n'y avait pas de paix avant le 7 octobre. Le récit occidental diffusé par les médias renforce donc l'idée qu'il s'agit d'un cessez-le-feu tant que les Israéliens sont en sécurité, alors que les vies palestiniennes sont sacrifiables.
Quand l'effusion de sang par Israël a repris, la déformation la plus flagrante de la part des médias a sans doute été de la présenter comme un retour à la « guerre » ou aux « combats ».
En dépit des rapports des Nations unies, d'Amnesty International, de Human Rights Watch et d'autres experts qui concluent qu'Israël commet un génocide à Gaza, les médias occidentaux persistent à refuser ce terme. À ce titre, les médias commettent effectivement un déni de génocide.
Confrontés aux conclusions d'un autre rapport récent des Nations unies, selon laquelle Israël a « commis des actes génocidaires en détruisant systématiquement des installations de soins de santé sexuelle et reproductive », les médias occidentaux ont recouru au registre familier de la mise en « accusation ».
https://x.com/AssalRad/status/1844601069831324053
Plutôt que de présenter ces conclusions comme une preuve supplémentaire du consensus mondial croissant selon lequel Israël commet un génocide, les médias occidentaux ont remis en question ces conclusions en les plaçant entre guillemets évasifs.
Même lorsqu'Israël ne laisse aucune place à l'ambiguïté, les médias s'empressent de la créer.
Le 2 mars, Israël a ouvertement déclaré qu'il cesserait toute aide à Gaza, ce qui constitue une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu et du droit international. Une semaine plus tard, les autorités israéliennes ont ajouté qu'elles couperaient l'électricité en plus de la nourriture et du carburant, une décision qu'Amnesty International a qualifiée de « nouvelle preuve du génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens de la bande de Gaza occupée ».
Comment les médias ont-ils couvert ces transgressions évidentes ? Les médias occidentaux ont présenté la décision d'Israël de bloquer délibérément l'aide à la population civile – un acte de punition collective – comme une tactique de guerre légitime pour « faire pression sur le Hamas » et obtenir des concessions, puis ont répété le même schéma une semaine plus tard lorsqu'Israël a annoncé qu'il couperait l'électricité à Gaza.
Quelques jours seulement après qu'Israël a officiellement mis fin au « cessez-le-feu », une vidéo a été diffusée le 21 mars montrant les forces israéliennes en train de démolir sciemment le seul hôpital de Gaza spécialisé dans le traitement du cancer. Cette vidéo d'une explosion délibérée, un crime de guerre éhonté à la vue et au su de tous, n'a suscité pratiquement aucune réaction de la part des grands médias. Lorsque, quelques jours plus tard, Israël a attaqué un autre hôpital, tuant cinq personnes, dont un garçon de 16 ans, ces derniers ont tenté de justifier les frappes contre les hôpitaux avec le prétexte de « cibler le Hamas ».
Dans les semaines qui ont suivi le 18 mars, le génocide ininterrompu s'est poursuivi sans relâche. Qu'il s'agisse de prendre pour cible des hôpitaux et des bâtiments des Nations unies, d'attaquer le siège de la Croix-Rouge ou d'assassiner des journalistes comme Hossam Shabat, les forces israéliennes semblent n'avoir aucune retenue dans la violence impitoyable qu'elles continuent d'exercer contre les civils palestiniens, les travailleurs humanitaires et toutes les personnes jouissant d'une protection.
Chacune de ces histoires d'horreur aurait dû faire l'objet d'une couverture médiatique et d'une indignation unanime. La plupart n'ont pas fait l'objet d'une couverture médiatique suffisante et n'ont ni permis à Israël de répondre de ses crimes, ni même de qualifier ses actes de criminels.
Le cas récent d'Israël tuant 15 médecins et secouristes palestiniens, puis les enterrant dans une fosse commune avec leurs véhicules d'urgence écrasés, fournit un exemple flagrant de la manière dont les grands médias évitent de rapporter chacune de ses atrocités.
Les Palestiniens ont rapporté qu'Israël avait pris pour cible les secouristes pendant plus d'une semaine avant que les médias occidentaux ne publient l'histoire. Israël a même admis avoir tiré sur leurs véhicules quelques jours auparavant, sans que cela ne suscite d'intérêt. Ce n'est que lorsque le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies et des fonctionnaires tels que Jonathan Whittall ont mis en ligne des vidéos confirmant les rapports que les médias grand public ont finalement été contraints de couvrir ce crime odieux commis par Israël.
Cependant, comme pour leurs autres reportages, de nombreux articles ont préféré titrer “Les Nations unies accusent” – en dépit des preuves vidéo – et ont relayé les justifications des massacres par Israël. C'est cette tendance à minimiser et à blanchir les crimes de guerre d'Israël qui pose la question de la complicité des médias. Après tout, qu'y a-t-il de plus digne d'intérêt pour les médias qu'Israël reprenant son génocide en force ?
Traduction : JC pour l'Agence Média Palestine
Source : The Nation
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le grossier chantage à l’antisémitisme

Comme il fallait s'y attendre, Donald Trump reprend à son compte une idée reçue dans la plupart des cercles politiques américains : pour justifier leur tentative de réduire l'indépendance des universités et leur liberté intellectuelle, lui et son entourage ont recours à l'argument aussi faux qu'éculé de "l'antisémitisme" qu'auraient démontré des militants et militantes lors de manifestations propalestiniennes.
Photo Serge d'Ignazio
Les classes politiques occidentales et surtout l'américaine ont souvent utilisé cet argument pour discréditer l'activisme en faveur de la cause palestinienne. Quelques manifestants ont pu utiliser des mots malheureux dans leurs discours et slogans vis-à-vis d'Israël et porter à son égard des accusations injustes, mais cela n'en fait pas pour autant des racistes, les mots dépassant parfois la pensée. Il faut surtout éviter de généraliser. Une mise au point s'impose donc une fois de plus sur ce sujet délicat. Nous allons procéder par ordre.
1- Tout d'abord, les Juifs et Juives ne sont pas des Sémites. Ils ne forment pas une ethnie. Il n'existe pas d'hérédité juive. Il s'agit d'adhérents à une religion, d'une culture, d'une mystique, au même titre que le christianisme et l'islam. Il existe des nations à majorité catholique, mais aucune hérédité catholique. Les gens de confession juive peuvent abandonner leur foi quand ils veulent, tout comme d'autres personnes ont la liberté de s'y convertir. Mais pendant des siècles, la cohérence religieuse était si intense un peu partout qu'on a fini par confondre les adhérents à telle ou telle religion avec une "race". Cela explique (sans les justifier, bien entendu) les multiples persécutions dont les Juifs ont souffert dans l'Europe chrétienne au Moyen-Âge. Il vaudrait donc mieux parler d'antijudaïsme, tout comme il y eu de l'anticatholicisme de la part des gouvernements protestants (par exemple, celui des Anglais contre les Irlandais) et de l'antiprotestantisme en France à l'époque des guerres de religion au seizième siècle. Les Irlandais ne sont pas pas davantage génétiquement catholiques qu'une majorité de Britanniques ne sont congénitalement protestants.
2- On doit ensuite distinguer judaïsme et sionisme. Ce dernier représente un courant idéologique qui prône le retour des gens de religion juive sur la terre supposée de leurs ancêtres, au Proche-Orient. Cet aspect politique du judaïsme ne fait d'ailleurs pas l'unanimité chez les Juifs eux-mêmes. Pour des considérations spirituelles, mystiques, humanistes et religieuses, un certain nombre d'entre eux s'opposent en effet aux sionistes. Les manifestations universitaires propalestiniennes récentes aux États-Unis comptaient parmi leurs rangs un certain nombre de ces personnes qui estiment que le sionisme trahit l'idéal judaïque. Ils prennent fait et cause pour le peuple dépossédé, les Palestiniens. Il faut savoir que si dans l'Antiquité, les Romains ont déporté un certain nombre de révoltés de confession judaïque, une majorité de la population est demeurée sur place. Certains déportés ont fait des convertis en Europe, mais ceux-ci et leurs descendants n'ont jamais vécu en Palestine. La population demeurée sur place a continué à pratiquer sa religion, jusqu'à la conquête arabe du septième siècle qui a entraîné sa conversion à l'islam. Ce sont les ancêtres des Palestiniens d'aujourd'hui. Une minorité d'entre eux a cependant continué à adhérer au judaïsme. Elle a vécu en bonne entente avec ses compatriotes convertis à l'islam. Mais tout a changé, pour le pire, lorsque des Juifs européens, inspirés par le sionisme ont commencé à affluer en Palestine (alors sous mandat britannique) au début du vingtième siècle. On connaît la suite.
3- Il existe bel et bien une composante de racisme dans toute cette histoire, mais elle ne se niche pas où on la situe habituellement. Plusieurs sionistes (des Européens pour la plupart) partageaient les préjugés occidentaux contre les "Arabes" . À cette époque impérialiste (à l'orée du vingtième siècle) où les puissances colonialistes (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Pays-Bas) s'enorgueillissaient de leurs possessions outre-mer et parlaient de la "mission civilisatrice de l'homme blanc", bien des Juifs européens étaient imprégnés à divers degrés de cette mentalité. De leur point de vue, la population locale palestinienne était inférieure et elle occupait des terres que leurs aïeux avaient supposément possédées. C'est donc sans état d'âme que les militants et dirigeants sionistes ont commencé à envahir la Palestine, d'autant que plusieurs de leurs compatriotes fuyaient les persécutions antijudaïques en Europe, particulièrement en Allemagne. Mais ce faisant, ils créaient un autre problème grave, celui-là au Proche-Orient.
Les dirigeants occidentaux et israéliens invoquent toujours le supposé "droit à l'existence" de l'État hébreu (même s'il s'est établi sur les ruines de l'ancienne Palestine arabe) et s'appuient pour ce faire, sur la mémoire des multiples victimes de l'Holocauste. N'est-ce pas au contraire lui faire injure, la trahir en quelque sorte que de légitimer l'injustifiable à l'endroit d'un autre peuple qui n'a jamais rien fait à personne et qu'on martyrise parce qu'il ose se défendre ?
Jean-François Delisle
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis : Enseignements des enlèvements et de la terreur

L'ENLÈVEMENT de Mahmoud Khalil, l'étudiant palestinien titulaire d'un diplôme universitaire et d'une carte verte, enlevé le 8 mars à son domicile de l'université de Columbia, est désormais associé à d'autres détentions très médiatisées et à des menaces d'expulsion, sans compter des dizaines, voire des centaines de cas méconnus. Le secrétaire d'État Marco Rubio s'en vante ouvertement.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
12 avril 2025
Par Against the Current
La résistance s'organise ! Photo : Dan La Botz
Ces arrestations et disparitions mettent en évidence le règne de la terreur auquel sont confrontés les titulaires de visas étudiants et même de cartes vertes. Elles combinent plusieurs aspects étroitement liés des cinq grandes situations d'urgence en matière de droits civils et humains aux États-Unis et au sein de l'empire américain dans le monde :
• Le génocide israélo-américain en Palestine, qui se traduit désormais par la menace ouverte de l'exode forcé de Gaza, le nettoyage ethnique de masse et l'annexion imminente de la Cisjordanie par Israël.
La criminalisation des actions de protestation contre le génocide, en particulier sur les campus universitaires.
La collusion entre l'extrême droite sioniste pro-israélienne et chrétienne-nationaliste, avec notamment Campus Watch, Betar USA et Canary Mission, qui recensent les étudiants et les professeurs militants pour les cibler, les expulser et/ou les déporter.
• L'intention de l'administration Trump de détruire les universités américaines en tant qu'institutions vouées à la pensée scientifique, culturelle et critique, et la lâcheté spectaculaire des administrations des universités de Columbia, du Michigan et d'autres encore qui ont capitulé face à ces attaques.
• Le comportement illégal du gang Trump, y compris sa violation flagrante des ordonnances des tribunaux qui ont fermé les portes aux déportations.
• Les liens entre les campagnes d'extrême droite menées aux États-Unis et en Israël, visant à consolider un régime autoritaire dans les deux pays.
Nous aborderons certains cas en particulier. Mais tout d'abord, il s'agit de bien prendre conscience que les groupes ciblés aux États-Unis, sans parler de la Palestine, vivent un épisode terrifiant, tout comme les dizaines de millions de personnes dans le monde confrontées à des épidémies à grande échelle ou à la famine en raison de la suppression par les États-Unis du financement de programmes qui sont essentiels à leur survie.
Dans le même temps, les services vitaux fournis par les agences gouvernementales fédérales et leurs effectifs sont systématiquement démantelés, avec des conséquences désastreuses pour la santé publique, les soins aux anciens combattants, les écoles publiques, le service postal et bientôt la sécurité sociale et l'assurance maladie.
Comment résister à une attaque sur plusieurs fronts clairement conçue pour avoir un effet paralysant ? Tout d'abord, il est nécessaire de reconnaître le caractère systématique et coordonné des attaques, afin que les cibles ne se retrouvent pas cloisonnées et que les actions de défense ne restent pas isolées et divisées.
Les cibles
Mahmoud Khalil, le Dr Rasha Alawieh et le professeur Badar Khan Suri ne sont pas des cas indépendants de, par exemple, la menace de couper 175 millions de dollars de subventions fédérales à l'Université de Pennsylvanie pour le crime consistant à autoriser un athlète transgenre à participer à une compétition sportive féminine, ou d'un décret présidentiel annulant les conventions collectives et le droit de négociation du syndicat des employés fédéraux.
Ces interactions sont en partie à l'origine de la mobilisation de plusieurs millions de personnes le 5 avril dans les rues de centaines de villes américaines, grandes et petites, bleues, rouges ou violettes, qui ont scandé « Hands Off » (Ne touchez pas à nos droits), exaspérées par les crimes du gang Trump-Musk et sidérées par la chute libre stupéfiante des marchés provoquée par le déchaînement tarifaire de Trump contre l'économie mondiale.
La détermination de cette résistance populaire n'a pas encore été mise à l'épreuve, mais le 5 avril a été un sacré début.
Pour rappeler quelques faits essentiels : Mahmoud Khalil, diplômé de Columbia, détenteur d'une carte verte et dont la femme, Noor Abdalla, était enceinte de huit mois, a été appréhendé par des agents en civil du ministère de la Sécurité intérieure alors que le couple regagnait son logement en résidence universitaire.
Columbia avait ignoré les demandes de protection de Khalil, qui s'était senti suivi. Figure de proue du mouvement de protestation de l'année dernière et négociateur d'un règlement pacifique de l'occupation, Khalil n'a jamais été accusé d'aucun crime ni sanctionné de quelque manière que ce soit par l'université.
Après s'être vu signifier la « révocation » de son « visa étudiant » (inexistant) puis de sa carte verte, Mahmoud a été emmené dans le New Jersey et expédié dans un centre de détention isolé de Louisiane avant que les tribunaux n'aient pu intervenir. Un juge fédéral a ordonné le renvoi de l'affaire dans le New Jersey. À l'heure actuelle, il reste à voir si le régime Trump se conformera à cette décision judiciaire comme à d'autres.
Yunseo Chung, une étudiante de Columbia âgée de 21 ans, est une résidente permanente qui vit aux États-Unis depuis l'âge de 7 ans. Actuellement dans un lieu tenu secret, elle a intenté une action en justice pour empêcher son expulsion après que des agents de l'immigration ont perquisitionné et fouillé des résidences universitaires de Columbia sous prétexte que l'établissement ou ses résidences « hébergent et cachent des étrangers en situation irrégulière sur son campus ».
Ni « illégale » ni accusée de quoi que ce soit, en vertu de quelle hypothétique thèse juridique Mme Chung est-elle passible d'expulsion ? Supposément, sa participation à des manifestations pro-palestiniennes fait d'elle « un obstacle aux objectifs de la politique étrangère américaine » en vertu d'une loi de 1952 datant de l'ère McCarthy autorisant l'expulsion pour ces motifs.
Le Dr Rasha Alawieh, néphrologue, chirurgienne et professeure adjointe à la faculté de médecine de l'université Brown, de retour d'un voyage au Liban, a été détenue pendant trente-six heures puis placée sur un vol de retour, en violation d'une ordonnance d'urgence du tribunal interdisant son expulsion.
Les prétendus « motifs d'expulsion » : La présence du Dr Alawieh aux funérailles de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah assassiné par Israël, en présence de dizaines de milliers de Libanais.e..
Ces cas sont loin d'être les seuls où les agents de Trump ont contourné une décision de justice, comme l'illustre l'expulsion collective de présumé.e.s « membres de gangs » vénézuéliens ou salvadoriens — sans preuve ni la moindre procédure légale — vers la prison mortelle « super-max » au Salvador.
Bien qu'il ait admis une « erreur administrative », le gouvernement affirme que les tribunaux n'ont « aucune compétence » pour ordonner le retour de Kilmar Armando Abrego Garcia, un père de famille bénéficiant d'un statut protégé aux États-Unis, qui a été arrêté le 12 mars à Baltimore après avoir terminé sa journée de travail en équipe à l'usine.
Ranjani Srinivasan, une étudiante indienne dont le doctorat en urbanisme est presque terminé, a été « désinscrite » de l'université Columbia après que des agents de l'immigration sont venus à son appartement et, n'ayant pas réussi à entrer pour procéder à son arrestation, ont déclaré que son visa était annulé et lui ont dit qu'elle avait 15 jours pour quitter le pays.
Elle demande maintenant l'asile au Canada, mais ne révèle pas où elle se trouve pour des raisons de sécurité. Elle a déclaré à CBC News qu'elle n'avait en fait pas participé aux manifestations sur le campus (elle aurait été aperçue dans la foule au printemps dernier, alors que l'accès à sa résidence universitaire avait été fermé).
Grant Miner, président du syndicat des étudiants de troisième cycle de Columbia et doctorant de cinquième année, a été licencié la veille du début des négociations sur le renouvellement de la convention collective et expulsé pour ses activités pro-palestiniennes.
Le comportement méprisable de Columbia, qui a réprimé et expulsé des étudiants l'année dernière, est désormais aggravé par sa lâche servilité face à une série de demandes draconiennes de la Maison Blanche et de Trump. Ces mesures comprennent le renforcement des pouvoirs de la police du campus, l'interdiction des masques et la mise sous tutelle externe de son très réputé centre d'études sur le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie.
De forts soupçons pèsent sur les membres du conseil d'administration de l'université qui auraient balancé Khalil au gouvernement. Comme l'a écrit le professeur émérite et historien de renom Rashid Khalidi dans The Guardian (25 mars 2025) :
« Après la capitulation de vendredi, Columbia mérite à peine le nom d'université, puisque son enseignement et ses recherches sur le Moyen-Orient, et bientôt bien d'autres encore, seront bientôt contrôlés par un « vice-recteur principal pour la pédagogie inclusive », en réalité un vice-recteur principal pour la propagande israélienne.
« Les partisans d'Israël, furieux que les études sur la Palestine ait trouvé leur place à Columbia, l'ont surnommée « Bir Zeit sur l'Hudson ». Mais à supposer qu'elle mérite encore le nom d'université, elle devrait s'appeler Vichy sur l'Hudson. » [Bir Zeit est la principale université palestinienne de Cisjordanie. « Vichy » fait référence au régime fantoche français de la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation nazie — ndlr.]
Badar Khan Suri est professeur à Georgetown et chercheur postdoctorant sur la religion et les processus de paix au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Il se trouve légalement aux États-Unis grâce à une bourse de recherche et à un visa universitaire. De nationalité indienne, il vit avec sa femme, citoyenne américaine, et leurs trois enfants à Rosslyn, en Virginie. Lorsqu'il est rentré chez lui le 17 mars après un repas de rupture du jeûne du ramadan, des agents fédéraux masqués l'ont placé en détention sans qu'il ne soit accusé d'aucun acte criminel.
En un peu plus de 72 heures, il a été transféré dans plusieurs centres de détention pour immigrants, puis dans un centre de transit de l'ICE à Alexandria, en Louisiane. Les collègues du professeur Suri soupçonnent l'administration de viser en réalité son épouse palestinienne Mapheze Saleh, qui est citoyenne américaine et ne peut donc pas être arrêtée pour être expulsée.
Le 25 mars, des agents masqués du département de la Sécurité intérieure ont également appréhendé sur le trottoir Rumeysa Ozturk, une étudiante activiste de l'université Tufts, et l'ont fait monter de force dans une voiture banalisée. Comme Mahmoud Khalil, Rumeysa a été emmenée dans un centre de détention de l'ICE en Louisiane à l'insu de ses avocats et de sa famille.
L'invocation de la « sécurité des Juifs » et la nécessité de lutter contre un antisémitisme prétendument répandu et persistant (une exagération insensée, s'il en est) à Harvard, Columbia, etc., devraient également être considérées comme une version d'un stratagème classique de la droite.
Ce stratagème pervers vise à amener les cibles de ces attaques illégales et antidémocratiques à « en rendre les Juifs responsables ». Cela est fait pour détourner l'attention des objectifs de la droite (MAGA, sionistes chrétiens, etc.) qui cherchent à saper l'autorité des institutions universitaires libérales ; à détourner l'attention de l'antisémitisme qui existe réellement à droite et au sein même de l'administration Trump ; à empêcher que la vérité soit dite sur ce qui se passe à Gaza ; à mener une campagne visant à renforcer l'idéologie suprémaciste blanche dans l'éducation et ailleurs ; et bien plus encore.
Nous devons nous opposer aux esprits capitulateurs dans le monde universitaire et ailleurs qui accordent du crédit à ces mensonges, et ne pas permettre cette exploitation grossière de l'identité juive, et ce, tant dans l'intérêt des Palestiniens que pour l'avenir de tout le monde. Un exemple éloquent en a été donné le 2 avril par des étudiant·e·s juifs et juives de Columbia qui se sont enchaîné·e·s aux grilles du campus pour réclamer la libération de leur ami Mahmoud Khalil.
Contre-attaque face à la crise et à l'urgence
Ce qui se passe actuellement - du passage en force par décret à la terreur exercée sur les communautés d'immigré·e·s et les militant·e·s de la cause palestinienne, en passant par l'abolition du droit du sol - conduit à la destruction substantielle du gouvernement constitutionnel aux États-Unis, ne laissant qu'un papier peint décoratif pour dissimuler la pourriture.
À la lâcheté de nombreuses administrations universitaires s'ajoute celle de certains grands cabinets d'avocats qui capitulent devant Trump. À l'opposé, les organisations de défense des libertés civiles et les avocat·e·s des personnes menacées d'expulsion s'impliquent énergiquement dans les procédures judiciaires et tirent la sonnette d'alarme dans les médias. Mais les hauts dirigeants du Parti démocrate gardent un silence assourdissant sur la destruction de la Palestine.
Le discours-marathon du sénateur Cory Booker, du 31 mars au 1er avril, a mis en évidence de multiples exactions commises par Trump et Musk, mais n'a pas trouvé le temps de faire référence au massacre en Palestine. Ce nouveau héros des démocrates ne s'est pas non plus joint aux quinze sénateurs qui ont voté en faveur de la résolution de Bernie Sanders rejetant la nouvelle livraison massive d'armes américaines à Israël. Et si des dizaines de membres démocrates du Congrès ont signé une lettre contestant la détention de Mahmoud Khalil, le nom du dirigeant de la minorité Hakeem Jeffries brille par son absence.
Il est certain que la répression à laquelle nous assistons s'inscrit dans une crise beaucoup plus large. Elle englobe les attaques ouvertes des suprémacistes blancs contre les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion ; l'effacement de l'histoire et de la lutte des Noirs dans les musées du Smithsonian, au Kennedy Center à Washington DC, sur le site web du ministère de la Défense et ailleurs.
Il est également possible que la frénésie tarifaire de Trump engendre un marasme économique aux États-Unis, en Amérique du Nord et dans le monde. Certains de ces problèmes sont abordés dans ce numéro d'Against the Current, notamment l'article de Kim Moody sur l'économie et l'incapacité des démocrates à réagir efficacement.
La riposte dépend de la base et commence par la défense de toutes les personnes prises pour cible par la frénésie répressive de Trump. Bien entendu, tout partisan des droits fondamentaux du Premier Amendement devrait exiger la libération immédiate de Mahmoud Khalil, quelle que soit leur opinion sur ce que doit être l'activité militante en faveur de la Palestine.
En même temps, l'agitation et l'engagement pour la liberté des Palestiniens et contre le génocide doivent se poursuivre, inspirés par l'exemple et le courage de Khalil.
Nous devons insister sur le fait que le sort du peuple palestinien, sacrifié en masse sur l'autel du cynisme politique, de l'impérialisme et du régime de peuplement colonial, n'est pas un cas isolé. Il est inextricablement lié aux luttes dans notre propre société et à notre avenir à tous.
Les éditeurs, Against the Current
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre vandevoorde avec l'aide de DeepLpro.
Source - Against the Current. À paraître dans le numéro de mai-juin 2025 d'ATC, ATC 236 :
https://againstthecurrent.org/lessons-of-abductions-
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis : Harvard tient bon – 2 200 M$ pour défendre son autonomie

Dans un affrontement sans précédent, l'Université Harvard est devenue le théâtre d'une bataille politique qui menace de redéfinir les rapports entre le gouvernement fédéral et l'enseignement supérieur aux États-Unis.
16 avril 2025 | tiré du Joural des alternatives | Photo : Camp pro-palestine à l'Université d'Harvard en avril-mai 2024 @ crédit photo Dariusz Jemielniak (Pundit) CC BY 4.0 via wikicommons
https://alter.quebec/etats-unis-harvard-tient-bon-2-200-m-pour-defendre-son-autonomie/
Le 14 avril 2025, l'administration du président Donald Trump a annoncé le gel de plus de 2 200 millions de dollars en fonds fédéraux destinés à Harvard, ainsi que de 60 millions de dollars en contrats, après que l'université eut refusé de se plier à une série d'exigences gouvernementales. Ce conflit, qui s'est intensifié avec des menaces de révoquer l'exemption fiscale de Harvard, marque un tournant dans la lutte pour l'autonomie académique.
L'origine du conflit : les exigences de la Maison-Blanche
Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Trump a redoublé d'efforts pour réformer les universités d'élite, soutenant que plusieurs d'entre elles promeuvent des idéologies contraires aux « valeurs américaines ». Dans le cas de Harvard, la Maison-Blanche a exigé des changements radicaux dans les politiques d'admission, d'embauche et d'enseignement, avec l'objectif affiché de lutter contre l'antisémitisme sur le campus.
Parmi les exigences précises figurent l'élimination des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), l'interdiction des masques lors des manifestations étudiantes et la révision des programmes d'études sur le Moyen-Orient pour garantir leur « neutralité ». L'administration a également requis la collaboration de Harvard avec des agences fédérales pour traquer la population étudiante étrangère participant à des activités jugées « anti-américaines », une demande critiquée pour son ambiguïté et son potentiel à restreindre la liberté d'expression. On peut consulter ici la lettre du gouvernement de Donald Trump avec « des exigences sans précédent du gouvernement fédéral pour contrôler la communauté de Harvard ».
La réponse de Harvard : un défi à l'autorité
Le président de Harvard, Alan M. Garber, a publié le 14 avril un communiqué percutant, qualifiant les exigences de la Maison-Blanche de tentative « inconstitutionnelle » de contrôler l'institution. « Nous ne renoncerons ni à notre indépendance ni à nos droits constitutionnels », a déclaré Garber, marquant la première résistance publique d'une université face aux politiques de Trump. L'université a également engagé deux avocats de renom pour défendre ce qu'elle considère comme une attaque contre son autonomie. On peut prendre connaissance ici de la réponse du président d'Harvard.
La décision de Harvard a reçu le soutien de figures comme l'ancien président Barack Obama, qui a qualifié le gel des fonds d'« illégal » et de tentative d'étouffer la liberté académique, ainsi que de la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, qui a salué la position de l'université.
Impact sur le financement et la recherche
Le gel de 2 200 millions de dollars en fonds fédéraux représente une menace majeure pour Harvard, dont les recherches en médecine, en technologie et en sciences sociales dépendent largement de ces subventions.
Selon le Washington Post, l'université a déjà pris des mesures préventives en empruntant 750 millions de dollars à Wall Street pour consolider ses finances. Cependant, des spécialistes comme Donald E. Ingber, directeur de l'Institut Wyss de Harvard, préviennent que cette mesure risque de « paralyser la poule aux œufs d'or de la science et de l'éducation américaines ».
Réactions dans d'autres universités
Le défi lancé par Harvard n'est pas un cas isolé. D'autres universités d'élite subissent des pressions similaires. Par exemple, l'Université Columbia a perdu 400 millions de dollars en fonds fédéraux en mars 2025 à la suite de manifestations sur le campus liées à la guerre entre Israël et Hamas. Bien que Columbia ait choisi de négocier avec l'administration, sa présidente intérimaire, Claire Shipman, a précisé qu'elle ne céderait pas sur des questions compromettant son autonomie.
De son côté, Princeton a perdu 210 millions de dollars en subventions de recherche, tandis que Cornell et Northwestern font face à des gels de 1 000 millions et 790 millions de dollars, respectivement. Ces institutions ont exprimé leur inquiétude face au manque de clarté des accusations de la Maison-Blanche et à l'impact sur des recherches cruciales, comme le développement de technologies médicales.
L'avenir de l'enseignement supérieur
L'escalade des tensions entre l'administration Trump et les universités soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre la supervision gouvernementale et la liberté académique. La menace de Trump d'imposer des taxes à Harvard comme à une « entité politique » si elle continue de « promouvoir des maladies idéologiques » a ravivé le débat, quelques critiques comparant ces tactiques au maccarthysme des années 1950.
Alors que Harvard prépare sa défense juridique, l'issue de cet affrontement pourrait établir un précédent pour d'autres institutions. Les universités pourront-elles préserver leur indépendance face à la pression financière ? Ou devront-elles plier devant les exigences d'un gouvernement qui contrôle les ressources fédérales ? Pour l'instant, la résistance de Harvard a inspiré d'autres établissements à réévaluer leur position, marquant le début d'une lutte qui dépasse les murs des campus universitaires.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Contre Amazon et la CAQ, une semaine pour raviver la combativité et brasser le système
Poilievre, ton chien est mort

Vers une renaissance syndicale
L'année 2024 a vu se conclure les négociations avec le Front commun du secteur public, tandis que les nouvelles réformes néolibérales de la CAQ continuent à mettre à mal les services publics. En réponse, une contre-attaque syndicale non négligeable s'organise.
Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle porte le potentiel d'un renouveau du mouvement syndical chez les travailleur·euses de l'État. Depuis l'adoption, il y a 40 ans, de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, les rondes de négociation ont donné lieu à peu de confrontations directes entre l'État patronal et les centrales syndicales. En effet, ces dernières, par peur de mesures répressives (comme des lois forçant le retour au travail) ou de l'imposition par décret de conventions collectives, ont eu très peu recours à la grève [1]. Les dispositions concernant les services essentiels prévues dans la Loi, l'encadrement de l'exercice du droit de grève, et la création d'ententes nationales et locales sont autant de facteurs qui ont mené à créer des négociations factices entre l'État et ses travailleur·euses. Les négociations d'ententes locales avec les centres de services scolaires, produit de la loi susmentionnée, en sont un bon exemple. Lors de celles-ci, le syndicat n'a pas le droit d'exercer légalement son droit de grève. Toutefois, ces négociations ont un impact considérable sur le travail des enseignant·es [2].
L'État, dans son rôle de législateur, règle le cadre juridique des négociations de façon à lier les mains des travailleur·euses et à limiter le rapport de force qu'ils et elles peuvent exercer sans transgresser ses lois patronales. Ainsi, en toute impunité, et parfois même avec l'aval des directions syndicales [3], les gouvernements ont adopté des mesures d'austérité et une série de lois visant à dégrader les conditions de travail dans le secteur public, par l'introduction de principes inspirés de la nouvelle gestion publique. On parle ici de mesures visant à centraliser davantage les institutions publiques sous la coupe des gouvernements, et au recours à la sous-traitance par le privé. La fin des élections dans les commissions scolaires et l'augmentation du recours aux cliniques privées en santé en sont deux exemples. On connaît l'incidence que ces mesures ont eue sur une brève période : les problèmes massifs de désertion des milieux de l'enseignement et de la santé par le personnel qualifié, la dégradation des services aux patient·es et la création du système d'éducation le plus inégalitaire au pays.

Le Front commun de 2023
Quelques circonstances ont toutefois permis au dernier Front commun de changer un peu le ton imposé par la Loi sur le régime de négociation. En 2020, la pandémie de COVID-19 a mis en lumière l'importance du rôle des travailleur·euses de première ligne dans le secteur public. Dans les années suivantes, l'inflation grimpante a poussé plusieurs travailleur·euses du secteur privé, alors en négociation, à demander de meilleures conditions de travail. Cela a donné lieu à une augmentation considérable des jours de grève au Québec [4]. Le contexte était donc favorable à un Front commun de grande ampleur. Dans presque tous les syndicats, l'envergure de l'appui aux votes de grève a été historique, à la surprise du gouvernement et peut-être même de certains syndicats [5]. Très peu de préparation a été faite en amont des négociations pour mobiliser les membres et les mener vers la grève en comparaison aux Fronts communs de 1972 ou de 1976 par exemple [6].
Le débrayage des travailleur·euses du Front commun, de la FAE et de la FIQ en 2023 se démarque par sa longueur (22 jours de grève pour la FAE) et la créativité des moyens de pression employés. Les enseignant·es ont occupé les bureaux du Conseil du trésor à Montréal, bloqué un terminal du port de Montréal et organisé de grandes manifestations rassemblant différents acteurs de la société civile. Sur les lignes de piquetage, on entendait des travailleur·euses prendre des positions inédites, notamment le désir d'en finir avec l'école à trois vitesses [7]. Toutefois, force est de constater que le Front commun, faute de préparation et de coordination, n'a pas réussi à canaliser cette énergie et à la faire aboutir sur une vraie transformation du régime d'austérité.
Il est important de souligner tout de même les gains historiques obtenus dans les ententes. Au niveau économique, les augmentations salariales et la mesure de protection contre l'inflation brisent des dizaines d'années d'augmentations rachitiques de 0 à 1 % par année. Au niveau politique, le mouvement syndical a réémergé comme une force sérieuse dans l'espace public. Même si le potentiel incarné par le Front commun n'a pas été réalisé en entièreté, cette mobilisation nous permet de tirer plusieurs leçons pour la suite des choses.

La mobilisation continue !
En effet, ce dernier Front commun a créé un momentum dans la mobilisation contre les réformes néolibérales de la CAQ en galvanisant les syndiqué·es et en confirmant l'appui de la population à leurs revendications. En effet, bien qu'un an se soit écoulé depuis la signature des ententes de principe, les centrales syndicales continuent d'accumuler des moyens de pression et des mobilisations contre le bulldozer de la CAQ. La taille de ces mobilisations est importante à souligner : la campagne « Pas de profit sur la maladie » de la CSN a ainsi rassemblé des milliers de personnes au Colisée de Trois-Rivières. De plus, elles peuvent se targuer d'atteindre parfois leur cible ! La mobilisation d'enseignant·es dans la région de Montréal a forcé la CAQ à revoir ses coupures et à réinvestir dans les programmes de francisation. Ces campagnes témoignent d'un mouvement syndical qui arrive à se relever tranquillement des revers subis depuis les années 1980, et d'une base qui commence à se mobiliser et à participer à la vie syndicale. Maintenant, pour passer à l'offensive, il faudra se doter d'un projet de société pour le mouvement des travailleur·euses de l'État. Comme Jean-Marc Piotte le soulignait en 1973, notre victoire en dépend :
« Dans le secteur public, la grève entraine des économies pour l'État et des pertes de salaire pour les travailleurs. Ceci ne signifie pas que la grève est un instrument inefficace dans le secteur public : cela indique seulement que la grève, comme les autres moyens de lutte, ne peut y avoir un sens et une efficacité que si elle est pensée politiquement [8]. »
Cette politisation de la vie syndicale, la base ne doit pas attendre de la recevoir des conseils exécutifs. Des initiatives inspirantes dans cette direction ont vu le jour l'année dernière à l'Alliance des professeures et des professeurs de Montréal. Le caucus uni de la base enseignante a mené une campagne contre la fermeture des classes d'adaptation scolaire, et la création du caucus du secteur public d'Alliance ouvrière a rassemblé des travailleur·euses de différentes accréditations syndicales.
[1] Cela fait partie d'une tendance nationale à la baisse des heures grevées depuis 1981, voir Gouvernement du Canada, « Jours non travaillés en raison de grèves et de lock-out, 1976 à 2021 », 30 mai 2022. En ligne : www150.statcan.gc.ca/n1/pub/14-28-0001/2020001/article/00017-fra.htm.
[2] On y négocie par exemple le dépassement du nombre d'élèves, la répartition des heures de travail dans le calendrier scolaire et le cadre des affectations de contrats.
[3] On pense notamment à la participation des centrales syndicales au « nouveau pacte social » pour le déficit zéro de Lucien Bouchard, qui a servi de prétexte pour d'importantes coupes budgétaires.
[4] Caillou, A. (2024, novembre 15). « Pourquoi les grèves sont-elles en hausse au Québec ? » Le Devoir. En ligne : www.ledevoir.com/economie/823786/pourquoi-greves-sont-hausse-quebec
[5] Le plan d'action mobilisation adopté par le conseil fédératif de la FAE en février 2023 ne comprenait pas l'organisation d'assemblées pour tenir des votes de grève.
[6] Le Front commun de 1972 est précédé par la publication de trois manifestes des grandes centrales syndicales (CSN, FTQ, CEQ) exposant leur projet politique. En 1976, les grandes centrales constituent un conseil d'orientation qui sera la structure décisionnelle du Front commun. Celle-ci est composée de 750 travailleur·euses.
[7] Pour d'autres exemples, lire le texte de Marion Miller, « 22 jours de grève », dans le numéro 100 d'À bâbord !.
[8] Piotte, J-M. La lutte syndicale (chez les enseignants). Les éditions Parti Pris, Montréal, 1973, p. 157. Texte intégralement disponible dans les Classiques des sciences sociales
Émile Lacombe est enseignant en arts plastiques au Centre de services scolaires de Montréal.
Photos : Manifestation du Front commun 2023 - 23 septembre 2023 (André Querry).
Un candidat expulsé par la police pour avoir dénoncé la censure des petits partis
No hay causas comunes – El marxismo-leninismo y la revolución social libertaria | F.C. (Canada, 2024)
Anarco sin capitalismo | Erick Benítez Martínez (Mexico, 2024)
The Commons of Labor | Jeff Shantz (Canada, 2025)

Printemps 2015 : retour sur une grève étudiante et sociale
À l’hiver 2014-2015, un mouvement se met en place avec l’objectif de lancer une grève étudiante et sociale au Québec. Il est porté par les Comités Printemps 2015 avec un ancrage principalement dans les cégeps et les universités. Ainsi, de mars à mai 2015, plus de 100 000 étudiant·es débrayent pour contester les mesures d’austérité portées par le gouvernement libéral de Philippe Couillard (2014-2018) et dénoncer les projets industriels en lien avec les hydrocarbures. Malgré ses ambitions, la grève rencontre plusieurs obstacles : répression institutionnelle et policière, désaveu de certains leaders étudiants et incapacité à étendre la grève auprès des grands syndicats. Le Printemps 2015 n’en demeure pas moins riche de plusieurs succès, dont la relance des grèves politiques dans les universités et l’imposition du thème écologique comme incontournable. Cette expérience permet aussi de réfléchir à la nécessité de développer nos propres forces, à l’intérêt d’un discours clair et à l’importance de prendre au sérieux l’organisation afin de mener des luttes victorieuses. Dix ans plus tard, retour sur une grève dure et explosive, qui peut encore informer nos combats.
Entrevue réalisée par Anarchive.
Entretien avec J.L. et R.D.
J.L. et R.D. : Avant de commencer, on pense important de dire que nous ne sommes qu’une voix parmi les nombreuses qui ont vécu les événements du Printemps 2015. On va parler, ici, à partir de nos positions dans le mouvement et nous assumons que d’autres interprétations et récits du mouvement existent. Toutefois, avec l’oubli qui caractérise le Printemps 2015, il nous semblait important de participer à l’échafaudage d’une mémoire critique et nécessairement polyphonique de celui-ci.
Pouvez-vous me parler du contexte d’émergence de la grève étudiante de 2015 ? Que vouliez-vous faire de différent par rapport aux grèves précédentes, dont celles de 2005 et de 2012 ? Comment le projet a été élaboré et avec quel objectif ?
J.L. : Je pense qu’un élément central de la grève de 2015, c’est le rendez-vous manqué de 2012 avec la grève sociale, avec quelque chose qui voulait déborder du milieu étudiant. Ça débordait un peu en 2012 avec les casseroles, et il y avait un appel continuel à la grève sociale, mais jamais les travailleurs et les travailleuses n’ont réellement embarqué dans le mouvement. Cette question a continué à tarauder beaucoup de militants et de militantes dans le milieu, sur comment réussir l’élargissement. Et là, c’est le contexte de l’austérité. Un nouveau gouvernement s’est fait élire en avril 2014. Dès le mois de mai, ils annoncent des coupures. Là, on sait qu’il y a quelque chose qui s’en vient avec un gros mouvement d’austérité qui va toucher tout le monde. Le premier groupe qui va proposer de faire quelque chose au printemps, c’est le IWW (Industrial Workers of the World). C’est eux qui, dès le mois de mai, me parlent d’un projet pour faire une grève sociale contre l’austérité le 1er Mai 2015.
Ç’a été quand même important dans la réflexion qu’il y a eu à ce moment-là, sur comment le mouvement étudiant pourrait participer dans un contexte d’appel à une grève générale. C’est pour ça qu’il y a eu une volonté d’aller vers une grève étudiante. Cette volonté s’est constituée au cours de l’été 2014 où il y a eu des discussions. À l’automne, dès la première assemblée de l’AFESH, il y a une proposition pour créer des Comités Printemps 2015. La première rencontre des Comités va se tenir le 25 septembre 2014. Tout ça se fait aussi dans un moment où il y a une augmentation des mobilisations syndicales, tout au long de l’automne 2014. Il y a eu des manifestations au niveau municipal. À l’UQAM, il y a eu deux journées de grève des employés de soutien où on a fait des grèves sauvages dans les cours de gestion. Il y a eu des mobilisations dans les CPE, des mobilisations de travailleurs et de travailleuses à grande échelle un peu partout. En même temps, la grève sociale commençait à percoler dans certains syndicats pour le 1er Mai, principalement en éducation. Puis, il y a la question écologiste, mais R.D. pourrait peut-être plus en parler.
R.D. : En 2015, l’austérité était à l’ordre du jour et on a voulu réfléchir : « Comment on lance un mouvement vers la grève sociale ? » Je me souviens qu’en 2012, le SÉTUE avait porté l’idée de la grève sociale, mais c’était quelque chose de très flou, qui n’était pas dans l’imaginaire politique, ni du mouvement étudiant, ni des syndicats. On s’est dit qu’on allait reprendre cette idée parce que c’était un truc qui était resté, notamment avec les Wobs (IWW). Il y avait aussi eu différentes mobilisations écolos et anticoloniales, notamment contre la ligne d’oléoduc Énergie Est. Il y avait eu la Marche des peuples pour la Terre-Mère et le mouvement Idle No More en 2012. Donc, il y avait déjà une communauté écolo et anti-coloniale, qui n’était pas étudiante, mais jamais on n’entendait parler de ces campagnes dans le milieu étudiant. Puis là, on s’est dit que l’extractivisme était un enjeu dont il fallait se saisir dans un rapport anticapitaliste. On est arrivé avec la proposition contre les hydrocarbures. Et les gens demandent toujours : « Ah, pourquoi c’est là, la revendication contre les hydrocarbures ? » C’est toujours la revendication qu’on met de côté, qu’on oublie. Pour moi, c’était vraiment important d’avoir cette revendication-là, de faire la jonction entre l’écologisme et l’anticapitalisme, et d’en faire un enjeu social qui n’appartient pas juste aux hippies écolos.

Durant le printemps 2015, les médias et certains acteurs politiques contestent la légitimité des grèves étudiantes. On doute notamment du lien entre les luttes étudiantes et les enjeux sociaux plus généraux. Que représentait la grève étudiante pour vous cette année-là ?
J.L. : Ce qu’elle avait de spécifique la grève de 2015, c’est que c’était la première grève générale illimitée sur des enjeux politiques dans le milieu étudiant depuis 1968. C’est-à-dire, un appel à une grève générale illimitée qui ne soit ni sur les frais de scolarité, ni sur les prêts et bourses. À l’exception de 1968, ç’a toujours été pour une réforme dans les régimes des prêts et bourses ou contre les hausses de frais de scolarité. Donc, il y avait quelque chose de nouveau à ramener la grève étudiante comme un pouvoir politique pour adresser les enjeux de l’heure qui étaient à l’époque : l’austérité, les hydrocarbures, la destruction des écosystèmes et celle de l’État social. Concernant la délégitimation de la grève, c’était un enjeu politique. Je pense que ce qui s’est passé en 2015, pour les médias, au-delà de dire que ce n’était pas correct ou légitime de faire grève sur des enjeux qui n’étaient pas directement étudiants, c’est une attaque contre la légitimité de la grève elle-même, notre droit était remis en question ! Et ça, c’est ce qu’on va voir à l’UQAM avec la répression. Ce qui est réprimé, c’est le « faire-grève ». C’est le fait d’aller dans des classes pour lever des cours. Dans le discours médiatique aussi, c’était présent. Ce qu’ils voulaient, l’État, les médias, les administrations scolaires, c’était briser le « faire-grève » qui avait été développé, notamment en 2012, et qu’on voulait faire déborder de son cadre établi à ce moment-là. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là, sur la légitimité de faire une grève qui ne touche pas juste les enjeux étudiants, mais aussi la légitimité de la grève elle-même comme pratique de perturbation. Si on décide collectivement d’arrêter la machine de l’école, c’est normal d’aller lever des cours. C’est cette guerre qui s’est déroulée pendant tout le Printemps 2015 avec les administrations, les étudiants de droite, les médias et le gouvernement.
R. D. : La légitimité de la grève, elle va être contestée par les médias, dans tous les cas. Même les luttes pour les frais de scolarité, en 2012, étaient contestées dans les médias. En 2015, ils l’ont fait aussi parce que c’étaient des revendications qui allaient au-delà de l’intérêt matériel des étudiants. Ces remises en question, ces attaques ne venaient pas uniquement de l’État et des médias, elles venaient aussi de l’interne, notamment à l’ASSÉ (Association pour une solidarité syndicale étudiante). C’est une grève dont les revendications contre l’austérité et contre les hydrocarbures sont demeurées larges. On ne chiffrait rien. Il n’y avait pas de revendications claires ou de volonté de négociation avec l’État. Et donc, la légitimité de la grève a été remise en question sur ces bases-là, dans la mesure où on n’avait pas de mode de représentation. On ne cherchait pas à avoir un comité de négociation avec l’État. Je me souviens que les réformistes et les personnes dans les syndicats disaient : « C’est quoi votre cible ? Un réinvestissement de 2 % dans les services publics ? » Ils voulaient chiffrer des trucs. Pour nous autres, c’était une grève de rupture. C’est ça qui s’est exprimé avec le slogan « Fuck toute » devant la répression.
J.L. : Je me rappelle, il y avait une grosse influence au niveau politique, qui venait des mouvements autonomes qui ont suivi le moment 1968, notamment des discours qui soulignent la relation entre le mouvement ouvrier et le mouvement étudiant, à l’extérieur du cadre syndical. Un des éléments qui répond à ça, c’est le « Fuck toute ». Il y avait quelque chose de très conjoncturel à l’époque, contrairement au mouvement des années 1960, où le discours c’était « Nous voulons tout », le discours de l’autonomie, un discours maximaliste. En 2015, ce qui a émergé, c’est « Fuck toute » et ce n’est pas nous qui avons imposé ça. C’est le mouvement qui l’a créé. Je trouve qu’il y a quelque chose d’emblématique quant à notre rapport au monde, dans le jeune XXIe siècle. Contrairement aux années 1960, où tout était à conquérir, nous étions, nous sommes, dans un monde, une civilisation, qui est en autodestruction, autant au niveau économique avec la crise de l’austérité, qu’au niveau écologique. Nous avions un rapport de destruction du monde existant, davantage que d’appropriation comme dans les années 1960. On se situait en continuité avec l’autonomie des années 1960, mais dans un rapport davantage négatif, qui était le propre de notre époque, où on n’était pas capable de dessiner d’avenir ou d’horizon aussi clair que ce qui pouvait être fait dans les années 1960.
R.D. : Il n’y avait pas de solution satisfaisante. Alors on a essayé d’imaginer quelque chose d’autre. Le Printemps 2015 a aussi pu être imaginé parce qu’on a cru qu’il y avait une possibilité que, dans la période de négociation des conventions collectives, les syndicats partent également en grève sociale. Finalement, le calcul était mauvais, puis ce n’est pas arrivé. Ç’a été une erreur qui nous a beaucoup nui, et c’est aussi ce que les réformistes et les syndicalistes nous ont beaucoup reproché. Ils disaient que le printemps c’était trop tôt, qu’il fallait attendre l’automne. Il fallait que les syndicats, pour qu’ils partent en grève sociale, le fassent de façon légale. On s’attendait à ce qu’ils puissent voter des grèves sociales, mais ce n’est pas arrivé.
J.L. : Ça, on l’a compris à un moment donné, je pense, mais on ne cherchait pas à soutenir le Front commun et ses grèves légales, mais plutôt les grèves politiques qui s’annonçaient pour le 1er Mai. On ne pouvait plus reculer à ce moment-là, on ne mettait plus l’accent là-dessus dans les assemblées générales. Malgré tout ça, il y avait des syndicats qui allaient de l’avant avec des grèves illégales, notamment dans le milieu de l’enseignement collégial. Il y a eu une vraie campagne de grève sociale le 1er Mai, des grèves étaient prévues par les profs de l’UQAM, il y avait des appels à la perturbation économique par certains syndicats, des groupes communautaires qui parlaient de grève sociale. Nous, on s’est dit qu’on allait continuer à aller de l’avant. Je reviendrai là-dessus plus tard, sur notre erreur dans le rapport au syndicalisme.


Le 20 mars 2015, juste avant le déclenchement de la grève, 9 étudiants sont convoqués par la direction de l’UQAM et accusés d’avoir participé à des actions de perturbation depuis 2013. Le comité exécutif de l’UQAM veut les expulser, parce qu’ils militent dans le mouvement étudiant et qu’ils sont perçus comme des leaders. Quels effets a eu la répression institutionnelle et judiciaire sur la manière de mener la grève ? Quelle a été votre perception de l’état de la surveillance et des représailles sur les campus ?[1]
J.L. : Je commencerais en 2012, qui a été pour moi le moment de changement dans les modalités des levées de cours à l’UQAM. Je vais moins parler pour les autres universités que je connais moins. À la fin de la grève de 2012, il commence à y avoir des injonctions, notamment contre l’AFESPED. C’est le moment où on commence à faire des levées de cours avec la peur de la répression. C’est le moment où les gens commencent à se masquer dans les levées de cours. C’est la première fois que je vois ce changement. D’habitude, on arrivait dans les cours pas masqués, on faisait des messages. Si ça allait mal, on faisait un peu de bruit, mais on n’était pas en mode « Black Bloc » en entrant dans les classes. Puis, à l’automne 2014, il va y avoir une répression contre plusieurs militants pendant les levées de cours. Des personnes sont identifiées et on les accuse de faire de l’intimidation sur les autres étudiants.
C’est pour ça que je disais tantôt que l’enjeu dans la grève de 2015 c’est devenu le « faire-grève », le fait de pouvoir faire des levées de cours. Il y a des gens qui n’étaient pas masqués et qui commençaient à se faire menacer de renvoi. En se faisant menacer de renvoi, les gens commencent à se masquer pour se protéger de la répression. En se masquant plus, ça augmente la tension avec les autres étudiants. En parallèle, surtout au printemps 2015, ça escalade encore plus. Il y a des gardiens de sécurité qui arrivent. Au début, c’étaient des gardiens de sécurité normaux. Mais après, l’UQAM engage des firmes de sécurité spécialisées pour protéger les salles de classe. Ça se bat à coups de poing dans l’université entre gardiens de sécurité et étudiants pour pouvoir faire la grève. Jusqu’à ce que la police rentre dans une occupation qui va avoir lieu au pavillon J-A DeSève. Le niveau de répression de la fin de 2012 est revenu dès le début de la grève du Printemps 2015, puis ç’a augmenté. Au niveau de l’administration de l’UQAM, je me rappelle, la présidente du Conseil d’administration, Lise Bissonnette, nous comparait à l’État islamique.
R.D. : Elle a écrit une lettre qu’elle a envoyée à tout le monde de l’UQAM, qui avait aussi été reprise dans à peu près tous les médias. « Pour l’UQAM, lettre à tous »[2] qui remettait en question le concept d’université sanctuaire et qualifiait les mesures disciplinaires et légales de « courageuses ». Avant le déclenchement de la grève, c’était déjà dans tous les médias qu’on allait avoir une GGI (grève générale illimitée), puis là, il y avait déjà des communications publiques pour remettre en question la légitimité de la grève. La position de l’État, c’était de dire aux administrations universitaires : « Appliquez vos règlements et punissez les étudiants qui font la grève. » C’était très clair que la stratégie de l’État, plutôt que de remettre en question la légitimité de la grève pour les associations étudiantes, était de punir les personnes qui font concrètement les grèves, en appliquant toutes sortes de règlements, s’ils bloquent des cours, etc. Le 20 mars, à la veille du déclenchement de la grève, j’ai reçu un appel : il y a un huissier qui est passé chez ma collègue du CA. Je reçois plein de messages et d’autres appels, comme quoi il y a des gens qui ont reçu la visite des huissiers chez eux pour être convoqués à un comité de discipline pour une expulsion de l’UQAM, pour des activités politiques qu’ils avaient faites dans les années précédentes.
La direction de l’UQAM avait essayé d’identifier les organisateurs et les organisatrices de la grève. Il y avait une compréhension assez moyenne de c’était qui. Moi, je n’ai pas été convoqué, mais la première journée où je suis retourné à l’université, on m’a appris que je n’étais plus étudiant. En même temps que les gens recevaient la convocation, ils ont décidé de refuser ma demande de prolongation d’inscription à la maîtrise. Donc j’ai été renvoyé de facto, et je ne pouvais plus être sur le CA de l’université comme représentant des étudiants. Ma collègue était suspendue du CA parce qu’elle était devant le comité de discipline. Donc, il n’y avait plus d’étudiants au CA ! Cette stratégie de répression des militants et l’intervention de l’État dans la façon dont les universités ont géré la grève est devenue évidente peu après le 1er avril 2015 quand le ministre de l’Éducation de l’époque, François Blais, est sorti direct dans les médias pour justifier qu’il recommandait aux recteurs des universités d’expulser jusqu’à 2 ou 3 étudiants par jour pour mater la mobilisation étudiante sur les campus[3].
Je ne sais pas s’ils pensaient qu’ils avaient le bon monde ou s’ils voulaient juste nous faire peur, mais ç’a changé tout le cours de la grève, avant même son commencement. À partir de ce moment-là, plus personne ne pouvait faire des choses à visage découvert. La capacité de faire une grève à l’UQAM, qui était au cœur du Printemps 2015, était remise en question. Ç’a conduit à des rencontres pour faire des levées de cours en black bloc, alors qu’on n’avait pas le droit. Les gens avaient des parapluies. On se rencontrait dans un local d’association, tout le monde se « black bloquait ». Moi et d’autres, étant donné que nous étions ciblés et connus de l’administration, nous avons tout de même suivi à visage découvert. J’avais un Garda qui m’était assigné qui me suivait partout. Quand j’allais aux toilettes, il me suivait ! À un moment donné, je me souviens, j’étais passé à côté du local de Repro-UQAM, la porte était ouverte. Il y avait un tableau avec des photos énormes, en 11×17, de plein de militantes et de militants. C’était le local des Gardas à ce moment-là pendant la grève. La situation empirait, ils étaient rendus à imposer par la force que les cours ne soient pas bloqués. Il y avait des undercovers, des armoires à glace habillés en civil qui se mettaient devant la porte des cours et qui nous empêchaient d’aller lever les cours. Il fallait les tasser et se battre, mais ça ne fonctionnait pas parce qu’il y avait plein de Gardas en plus. Jusqu’au moment où il y a eu des batailles. Ils ont fini par faire rentrer les flics après les levées de cours le 8 avril.
J.L. : Il y a aussi un autre élément concernant la répression institutionnelle au niveau de l’UQAM. Il va y avoir des référendums pour dissoudre les associations étudiantes, un plan coordonné par des étudiants de droite à la veille du déclenchement de la grève pour affaiblir encore plus le mouvement. Le vendredi où les militantes et les militants étudiants ont été expulsés, les résultats du référendum étaient dévoilés. Les étudiants de droite ont réussi : l’AFESPED a été dissoute. L’AFESH a réussi à gagner son référendum et à rester reconnue. Il y avait de la répression individuelle, mais il y avait aussi des attaques contre les organes syndicaux des étudiants à la veille du déclenchement de la grève.

La grève de 2015 se veut à la fois étudiante et sociale. En conséquence, elle est construite autour de comités locaux (ou comités « Printemps 2015 »). Le but est de consolider un réseau large et horizontal, avec l’espoir de sortir des structures étudiantes traditionnelles et de mener une grève sociale. Qu’elle était la composition de ces comités, comment se sont-ils formés ? Quelle était la relation entre le réseau des comités et les structures syndicales étudiantes, notamment l’ASSÉ ?
J.L. : La proposition pour créer les Comités Printemps 2015, ça vient du mouvement étudiant. Il y a quelque chose de drôle, parce que le but c’est de sortir des associations étudiantes, mais ce qui a fondamentalement créé le mouvement, c’est une proposition à l’AFESH. La raison pour laquelle on voulait faire des comités autonomes, c’est qu’on voulait pouvoir intégrer des travailleurs et des non-étudiants là-dedans, et ne pas s’arrêter au statut étudiant comme modalité d’organisation dans la lutte. On voulait sortir du corporatisme étudiant, et ça marchait un peu. Mais le mouvement restait très étudiant. Dans les assemblées larges, il y avait quand même différents groupes. Il y avait toujours une présence de quelques syndiqués et non-étudiants, mais disons que le cœur était resté pas mal étudiant. Il y avait le comité large de Printemps 2015, mais il y avait aussi différents comités de travail. Il y a eu un genre de décentralisation à un moment, avec des comités locaux dans différentes institutions et régions. Il y en avait à Concordia, à l’UQAM, à l’Université de Montréal, en Estrie, en Montérégie, à Québec, mais aussi des groupes spécifiques à des enjeux particuliers. Par exemple, il y avait un groupe Printemps 2015 CPE, animé par des militantes dans les Centres de la petite enfance, qui avaient rajouté plein de membres qui travaillaient dans les CPE pour initier une grosse discussion large. Il y avait Féministes unies contre l’austérité (FUCA), Printemps 2015 Santé, Printemps 2015 Éducation populaire et plein de petits groupes comme ça, un peu éclatés, qui ont participé à construire leur propre mouvement.
Après ça, il y a la relation entre les Comités Printemps 2015 et l’ASSÉ. La première fois qu’on est allé au Congrès, c’est à l’automne 2014. On a fait adopter un mandat pour que l’ASSÉ appuie les Comités Printemps 2015, mais on n’a pas réussi à faire adopter un mandat pour qu’ils appuient la grève générale illimitée. On était pris dans un double truc où il n’y avait pas de mandat pour appuyer une GGI au début, mais où ils devaient soutenir le mouvement… Il y avait une relation d’amour-haine avec l’ASSÉ. En janvier 2015, on va faire une tournée en collaboration avec l’ASSÉ, avec des conférences qui étaient données dans plusieurs cégeps et universités. Toutefois, il y a du travail de sape qui est fait par l’ASSÉ, qui va dire aux associations membres de ne pas faire la grève. On nous l’a dit dans certains cégeps de région, après que l’ASSÉ soit passée, on arrivait et ils nous disaient : « Ah oui, mais l’ASSÉ vient de nous dire qu’il ne faut pas voter la grève. » C’est la première fois que l’ASSÉ a travaillé contre une grève dans son histoire, depuis sa fondation en 2001. Et je crois que ça a joué beaucoup sur son affaiblissement politique, son incapacité à être à l’avant-garde des mouvements pour la première fois dans l’histoire de l’organisation. Peut-être qu’on pourrait revenir sur la stratégie politique qu’on avait proposée pour faire la grève. Ce qu’on proposait, c’était de déclencher la grève le 21 mars, qui était un samedi, et ça c’était plus une blague pour le début du printemps. Donc, ç’a commencé pour vrai le lundi 23 mars. On avait fait adopter largement deux semaines de grève pour commencer, jusqu’à la grande manifestation du 2 avril qui était organisée par l’ASSÉ. Ce qu’on proposait dans le document de grève, c’était « que l’on tienne une assemblée générale reconductible la semaine du 7 avril » et « que l’on appelle à un congrès extraordinaire de l’ASSÉ les 4 et 5 avril ».

L’idée, c’était qu’on déclenche la grève pour deux semaines, après il y avait un congrès, dans ce congrès-là, on voit ce qu’on fait. Est-ce qu’on continue ou non ? Est-ce qu’on a de la force ou non ? Ce n’était pas un truc « jusqu’au-boutiste » qu’on proposait au départ, ce n’était pas « on fait la grève quoi qu’il arrive ». Toutefois, ce qui s’est passé, c’est que, deux jours avant la manifestation du 2 avril, il y a un document de l’exécutif de l’ASSÉ qui a coulé dans les médias. Le matin on s’est réveillé, il y avait dans les médias : « L’ASSÉ appelle à arrêter la grève et à faire un repli stratégique ». Donc, avant la manifestation, qui devait être pour nous le thermomètre, il y a déjà un appel à rentrer en classe. Le monde était vraiment en tabarnak en disant, pour de vrai, vous n’avez même pas attendu le 2 avril après votre grosse manif pour appeler au repli stratégique, vous l’avez fait avant et ç’a affaibli le mouvement en sortant dans les médias. Et là, il y a eu le congrès qui a été n’importe quoi. Nous, ce qu’on voulait et ce qu’on espérait, depuis le début, c’était d’être récupéré par l’ASSÉ. Et on n’a pas compris, comment, pourquoi, l’exécutif de l’ASSÉ a choisi de faire ça, de jouer ce rôle-là. Mais ç’a été vraiment une tension politique majeure, qui va, pour moi, être un enjeu vital pour le mouvement étudiant, c’est-à-dire qui va faire en sorte que l’ASSÉ, comme pôle combatif, ne va jamais se relever.

Le 5 avril 2015, lors d’un congrès de l’ASSÉ, les associations membres décident de destituer le personnel de l’exécutif, parce que celui-ci a publié un texte appelant à suspendre la grève jusqu’à l’automne 2015. Pouvez-vous me parler du conflit ouvert entre la direction et les réseaux locaux de l’ASSÉ ? Est-ce qu’on peut affirmer que l’ASSÉ tentait de reprendre le contrôle sur un mouvement de grève qui la dépassait ?
J.L. : Je ne dirais pas qu’ils ont essayé de reprendre le contrôle. Comme j’ai dit, il y a eu le document qui a coulé dans les médias, où ils ont appelé à arrêter la grève à la veille de la manif du 2 avril 2015. Après, il y a eu le congrès. Durant le congrès, une des premières choses qu’ils font, c’est démissionner. Ils savaient que les gens étaient en tabarnak et qu’ils voulaient les destituer. Ils ont préféré partir au milieu de la grève. Et donc, ne pas avoir à faire un mandat qu’ils ne voulaient pas faire, parce qu’ils ne voulaient pas faire la grève. Ce que le congrès a fait, c’est dire : « Non, vous n’allez pas démissionner, c’est nous qui allons vous destituer. » Il fallait montrer que la raison pour laquelle ils partaient, ce n’est pas parce qu’ils voulaient, mais c’est parce qu’il y avait un désaccord avec les associations étudiantes de base. Qu’ils aient été destitués ou non, ils seraient partis. Je pense que c’est important à dire. Nous n’étions pas les méchants qui avons voulu les destituer, c’est eux-mêmes qui ont voulu partir parce qu’ils ont fait des Papineau d’eux-mêmes. C’est-à-dire qu’au moment où la lutte était au plus haut et que c’était dangereux, ils ont préféré aller aux États-Unis et quitter leur camp plutôt que de rester dans la lutte.
R.D. : C’était aussi ce que Gabriel Nadeau-Dubois avait fait en 2012.
J.L. : Exactement, c’était un peu ça. Il y a eu un exécutif temporaire qui a été élu à ce moment-là, qui regroupait différents membres un peu dans l’entre-deux du conflit. Ces gens-là n’étaient pas dans les Comités Printemps 2015 ni membres de l’ancien exécutif de l’ASSÉ. Ils ont essayé de gérer le poste, mais la situation était devenue ingérable, explosive, il n’y avait pas de possibilité de remise en commun…
Le 8 avril 2015, des manifestants occupent le pavillon J-A DeSève de l’UQAM à la suite de l’arrestation d’une vingtaine de personnes dans le sous-sol du même bâtiment[4]. Que représente l’occupation de ce pavillon pour les manifestants ? Quel est votre souvenir de l’événement ?
J.L. : C’était impressionnant. C’était le moment, un des plus fous que j’ai vécu en 2015 et au-delà en termes de mobilisation dans le milieu étudiant, parce que ç’a été spontané. Dans le fond, quand ça s’est passé, il y avait des tournées de classe qui se tenaient le matin, justement, qui étaient dans le sous-sol du pavillon DeSève, et là, on passait entre le pavillon de gestion et le pavillon DeSève. En passant, il y a des flics qui sont sortis et qui ont essayé d’arrêter du monde. Il y a des profs qui ont fait une ligne pour essayer de protéger les étudiants contre l’intervention des policiers. En même temps, il y a des gardiens de sécurité qui pognent du monde et il y a une vingtaine d’arrestations. C’est un choc pour tout le monde, la police est rentrée et ils nous arrêtent parce qu’on fait grève dans l’université. Ils arrêtent des gens qui font des levées de cours. C’est là que ça pète. Après ça, rapidement, il y du monde qui commencent à s’asseoir en haut du pavillon, il y a une assemblée style un peu « Occupy » qui se fait. Quand je dis « Occupy », tu as du monde assis et il n’y a pas de micro, et on entend « Maintenant ! » et tout le monde répète. « Maintenant ! Nous allons occuper le pavillon ! » Les gens commencent à se passer le mot. Il y a du monde qui ramène un système de son pour de la musique. Il y a une table qui se remplit de bouffe et il y a aussi des profs qui nous payent plein de bouffe. Et là, il y a du monde qui arrive.
Au début, on est 50 ou 100 personnes, mais ça augmente rapidement à 200, 300, 400, 500 personnes qui sont dans l’université et ça se transforme en fête. T’as des lumières, t’as un gros système de son et tout le monde qui danse. En même temps, il y a des dizaines de personnes qui courent partout dans les corridors de l’UQAM et qui pètent tout. Tu te promènes dans les corridors, tu vois des gens en train de jouer au soccer avec une caméra de sécurité. Dans un autre coin, les gens réussissent à défoncer l’Aide financière aux études et ils détruisent tout. T’as des bureaux administratifs avec des dossiers vidés au sol. C’était, je pense, plus d’un million de dollars de dommages qui ont été faits, mais en mode festif, complètement. Ça danse, les gens boivent. En même temps, il y a tout ça qui se passe en réponse à l’administration, et puis il y a une négociation qui se fait avec le syndicat des chargés de cours, des profs et des gens des associations étudiantes pour demander le retrait des accusations, sinon, on continue l’occupation. Finalement, à un moment donné, ça brise. Le syndicat des profs est venu nous parler pour dire : « L’administration ne veut pas reculer. » L’occupation continue, imagine 500 ou 600 personnes dans la bâtisse ! Il devait y avoir une manifestation ce soir-là et cette manif de soir, finalement, elle se ramène dans l’UQAM pour participer à l’occupation. Ça dure jusqu’à minuit environ et l’anti-émeute commence à débarquer. On était au rez-de-chaussée et il y avait des gardiens de sécurité au début qui ont essayé d’atteindre le rez-de-chaussée. Les gens leur lançaient des chaises et il y a eu une méga-barricade qui a été faite.
R.D. : Toutes les chaises du pavillon ont été empilées dans les escaliers roulants du DS.
J.L. : Finalement, une bannière est mise par-dessus les escaliers roulants. C’était vraiment intense. Quand la police arrive, les gens décident de crisser leur camp. Tout le monde. Il y a eu zéro arrestation !
R.D. : Pour rentrer, les flics ont brisé les murs de vitre qui séparent différentes sections dans l’université.
J.L. : À coup de bélier ! Mais tout le monde était sorti par la porte d’en arrière. 500 personnes, des millions de dommages, zéro arrestation ! Et le plus beau party qu’on a vécu à l’UQAM. Ç’a joué un rôle vraiment cathartique. C’était la répression qu’on vivait depuis deux semaines, ils venaient de faire entrer la police, ils venaient d’arrêter 22 personnes. Le pavillon a été fermé pendant plusieurs jours à cause des dégâts.
R.D. : Il y a eu des choses comiques après, comme le « Je suis la machine distributrice ». Les gens en gestion avaient fait une vigile aux chandelles pour les machines distributrices défoncées, non ironiquement ! Il faut aussi dire que la grève continuait, entre autres, à cause de la répression à l’UQAM, dans le sens où ça poussait les grévistes à résister. Mais bon, c’était quand même difficile de légitimer une grève nationale à cause de la répression à l’UQAM, ça rentrait dans l’équation de conflit avec les autres acteurs. Dans le sens où la grève en générale a fini par s’épuiser, puis finalement c’était l’UQAM qui était en grève contre son administration d’une certaine manière. Mais c’était assez incroyable, parce que le seul moyen de faire des levées de cours, c’était d’être vraiment très, très, très nombreux. Je pense qu’on était au moins une centaine à faire des levées de cours. On arrivait à un moment où ça devenait de plus en plus difficile. D’habitude, on se serait dit qu’il y aurait moins de monde parce qu’il y avait de la répression. Mais en fait, il y avait de plus en plus de monde, il y avait des foules de gens qui faisaient les levées de cours. C’est dans ce contexte-là qu’ils ont appelé les flics. Ça s’était organisé avec la sécurité de l’UQAM, parce que la sécurité pointait les gens à arrêter.
J.L. : Quand ils ont arrêté les personnes qui faisaient des levées de cours, ils ont viré une salle de classe pour la transformer en prison. Ils ont même levé le cours qui se donnait. Ils disaient : « Là, on a besoin de construire un lieu d’incarcération. »
R.D. : On dit toujours qu’il faut que les conditions d’enseignement soient réunies pour avoir des cours. À cette époque-là, il n’y avait aucune condition qui était réunie. C’était comme de la magie d’avoir une manifestation avec 10 000 personnes pour nous soutenir, et que des centaines d’entre eux nous rejoignent dans l’occupation. C’était de dire : « Vous nous réprimez à cette hauteur-là, on réagit à cette hauteur-là. » Et ç’a fonctionné. Je pense qu’il y a un trauma réel du coût politique de la répression. Le fait qu’on soit capable de s’organiser pour les levées de cours et qu’on soit capable de répliquer avec ce niveau-là, ç’a été gagnant pour nous sur le long terme. C’est pour ça qu’aujourd’hui, les levées de cours ont diminué en intensité. Bon, aussi, il y a moins de grèves ces dernières années. Pour dire comment l’administration et les flics réagissaient, je reviens à quand les flics ont défoncé les baies vitrées. L’occupation était finie, on était dehors, puis là, on les voyait défoncer les fenêtres. Ils se sont tous mis en rang, même les Gardas. Il y en avait une qui avait son casque d’anti-émeute, puis elle marchait devant le bataillon d’antiémeutes et elle les guidait.

Le 1er Mai, la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses, converge avec le mouvement de grève de 2015, notamment avec l’appel pour une journée nationale de grève et de perturbation. Pouvez-vous décrire ce qui s’est passé à l’occasion de cette journée en 2015 ?
J.L. : Comme je l’ai dit, l’idée de Printemps 2015 vient de l’appel à la grève sociale pour le 1er Mai, qui était notamment portée par le IWW. Ils vont mettre en place une coalition vers la grève avec différents groupes communautaires et des syndicats. Il y avait ça qui se passait et il y a vraiment eu une mobilisation qui a été historique à ce niveau-là, notamment avec la grève des enseignants et des enseignantes dans les cégeps, en fait. C’était une grève politique illégale, la première grève politique illégale depuis 1976, dans le sens que c’est une grève qui n’est pas sur les conventions collectives. Je pense que c’est un des gains de 2015 qu’on a eus, la capacité à dire que les syndicats pouvaient faire des grèves politiques. C’est Sherbrooke, qui avait lancé le mouvement de grève sociale au niveau des profs de cégeps. Eux, ils ont réussi à faire une grève sociale le 1er Mai. En parallèle, certaines fédérations de centrales syndicales appelaient à une journée de perturbation économique. Donc, dans la journée du 1er Mai, ç’a commencé le matin, avec les Wobs, qui ont bloqué un truc de la STM, après ça, il y a eu un blocage du chantier du CHUM. Les gens des centrales syndicales ont occupé le Centre du commerce mondial et ils ont aussi occupé des banques. Il y avait plus d’une centaine de groupes communautaires en grève sociale, qui referont, dans les années suivantes, d’autres grèves sociales pour défendre le communautaire.

Il y avait aussi la manif du 1er Mai qui s’est tenue et le Conseil central du Montréal métropolitain, le conseil régional de la CSN, a décidé cette année-là de participer à la manif de la Convergence des luttes anticapitalistes, la CLAC[5]. C’est la seule fois que les syndicats ont participé à la manif de la CLAC, ce qui veut dire que même les centrales syndicales, ou plutôt les conseils régionaux qui sont souvent plus « gauchistes », avaient assumé d’aller dans la manif anticapitaliste. Cette année-là, la manif anticapitaliste, c’était 10 000 personnes environ, qui venaient de différents secteurs de la ville. Il y avait les profs de cégeps en grève qui partaient du Cégep Ahuntsic qui sont descendus, il y avait un rassemblement des maoïstes du PCR, il y avait un rassemblement de la CLAC et un autre, enfin, qui venait de l’Est aussi. Tout le monde a convergé vers le centre-ville et c’était le chaos toute la soirée. La police n’a pas pu prendre le contrôle parce qu’il y avait trop de monde. C’était vraiment intense[6].
Moi j’étais en région donc je peux parler aussi de ce 1er Mai à Sherbrooke. J’étais allé soutenir les syndicats des professeurs qui étaient en grève sociale cette journée-là. J’ai participé à cette manif à Sherbrooke, où il y avait quelques milliers de personnes. À Sherbrooke seulement, et c’était ça partout ! Il y a eu des manifs à Saint-Jérôme, à Valleyfield, au Saguenay. C’était une des journées les plus importantes et les plus fortes du mouvement, les syndicats appelaient à des perturbations économiques, ils bloquaient des trucs. Ç’a été, pour moi, un des grands succès de Printemps 2015, et ça va marquer, en montrant qu’on peut refaire des grèves politiques. C’est ce qu’on a réussi à gagner. À mon sens, les grèves pour le climat en 2019 n’auraient jamais pu se tenir sans cette expérience. C’était les mêmes profs qui avaient fait la grève du 1er Mai 2015 qui ont lancé la campagne pour faire une grève climatique en 2019. La capacité et même l’imagination de pouvoir faire des grèves illégales pour des raisons politiques, c’est le gain qu’on a eu. C’est dire : « Eille les syndicats, vous pouvez aussi lutter pour l’écologie, contre l’austérité et pas juste pour vos intérêts corporatistes. »
R.D. : Il faut quand même le spécifier, ce n’étaient pas les directions syndicales qui ont appelé à cette mobilisation. C’était ça qui était inédit, que les syndiqués à la base s’organisent malgré les réticences de leurs centrales, comme nous on s’est organisé malgré les réticences de l’ASSÉ. On a parlé des Wobs qui avaient évoqué cette idée de faire une grève sociale le 1er Mai, et qui ont beaucoup travaillé pour intégrer des acteurs du communautaire et des travailleurs. Cette initiative-là a pu profiter de la mobilisation de Printemps 2015 dans les mois précédents. Il y a eu tellement de choses cette journée-là, il y avait du monde partout. Il y avait plusieurs actions, par exemple l’action des banques, où il y avait des centaines de personnes. On ent
The Salish Sea Anarcha Network | Jeff Shantz (Canada, 2024)
L’histoire n’est jamais un long fleuve tranquille
Vidéo | Un phare anarchiste à Montréal : 40 ans de luttes sur le boulevard Saint-Laurent (English captions)
États-Unis : Harvard tient bon – 2 200 M$ pour défendre son autonomie
Les travailleurs de LifeLabs entament leur huitième semaine de grève
Colombie : les généraux de l’horreur et les « faux positifs »
Victoire de la droite à l’élection présidentielle en Équateur
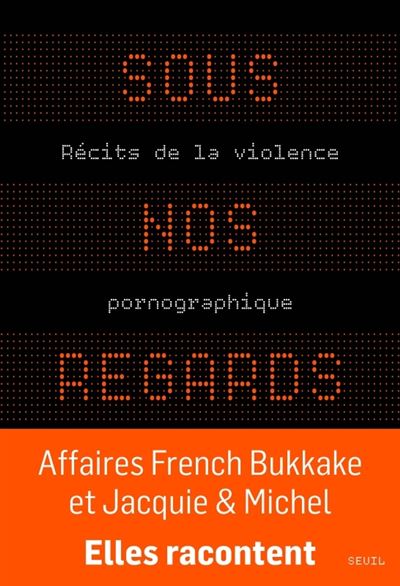
Sous nos regards, récits de la violence pornographique
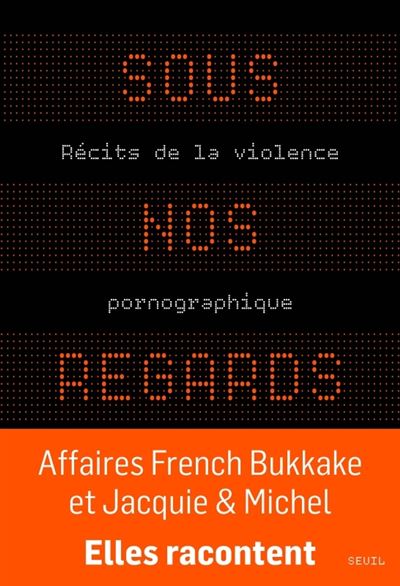
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/12/sous-nos-regards-recits-de-la-violence-pornographique/?jetpack_skip_subscription_popup
Seize femmes, victimes des réseaux de pornographie French Bukkake et Jacquie et Michel témoignent dans cet ouvrage collectif puissant. Elles avaient en moyenne vingt-trois ans quand les viols ont eu lieu. pornographie sous nos regards
Pascal OP, le producteur de French Bukkake, tourne des vidéos où des hommes éjaculent en cercle sur le visage d'une femme à genoux, puis lui imposent de nombreuses pénétrations. Les femmes sont recrutées par Julien Dhaussy, sous le faux profil Facebook d'Axelle Vercoutre, qui se lie d'amitié avec des jeunes femmes fragiles, devient l'oreille de leurs souffrances, les convainc de faire de l'escorting.
Elles subissent alors un viol d'abattage par Dhaussy, qui les pousse ensuite sur les tournages de Pascal OP, dont les vidéos sont présentées comme raffinées, avec une diffusion privée au Canada. Dans des lieux inconnus, où rien ne leur est expliqué et où aucune de leur demande de limite n'est respectée, elles sont violées par des bandes d'hommes. Beaucoup d'entre elles n'osent pas porter plainte et quand elles le font, les policiers répondent : « on ne viole pas une actrice porno ».
L'affaire Jacquie et Michel, en cours d'instruction, est sensiblement proche. Michel Piron est producteur (Jacquie n'existe pas). Sous couvert de « porno-amateur », des rabatteurs manipulent pour lui des jeunes femmes en détresse économique et sociale pour les contraindre à des tournages où elles sont victimes de viols collectifs.
Chaque récit est co-écrit par une plaignante de ces deux affaires, et une autrice, chercheuse ou journaliste. L'ouvrage est introduit par l'historienne Christelle Taraud, qui dépeint l'aggravation des violences dans l'industrie pornographique depuis les années 990, un porno « d'abatage » représentant les femmes comme des « territoires à ravager ».
Sous nos regards : des descriptions insoutenables
Seize voix distinctes, et pourtant toutes fondues dans la même horreur. La majorité a été victime de violences depuis l'enfance, frappées, violées, incestées. Des violences qu'elles n'ont pas toujours pu nommer. Et il y a celles qui s'estiment « trop gentilles », naïves, qui ont voulu aider, obéir, et qui ont été prostituées. Alice dit que c'est le point de ressemblance entre toutes les filles du procès : « Ils sentent ces choses-là, ils repèrent quand on est fragiles. »
La description des scènes de viols est insoutenable. Les corps des filles sont suppliciés, ravagés, humiliés. Elles hurlent, elles saignent, on leur demande de sourire. Ce sont souvent des jours de tournage d'affilée, des pénétrations à la chaîne, des orifices qui se déchirent. Mélanie raconte : « l'un d'eux m'a étranglée si fort que j'ai perdu connaissance. La caméra ne s'est pas arrêtée. »
A la première « mort », celle des viols, succède la diffusion des vidéos, une mort sociale. Certaines sont abandonnées par leurs amis et familles. Elles sont reconnues dans la rue, au travail, harcelées, insultées, agressées, considérées comme responsables des violences subies. En douze ans Amélie a déménagé dix-huit fois et changé vingt fois d'emploi. À chaque fois, tout recommence : « où que j'aille, quoi que je fasse, on finit par me reconnaître. À croire que la France entière regarde du porno. » Beaucoup d'entre elles ne sortent plus de chez elles, vivent la nuit.
Les vidéos se retrouvent sur de multiples plateformes de porno, visibles dans le monde entier. Si elles veulent les faire retirer, les producteurs demandent de l'argent. D'autres chantages viennent d'anonymes qui menacent d'envoyer les vidéos à leurs proches, à leurs cercles professionnels. Même quand des sites sont condamnées par la justice, les vidéos finissent toujours par réapparaitre sur d'autres sites. Ces femmes n'ont pas le droit à l'oubli. Loubna parle d'une « emprise infinie. »
Leurs récits manifestent les violences de genre, de race et de classe de cette industrie pornographique. Dans les sous-titres des vidéos et sur les tournages, elles sont traitées de salopes, de « fuck-meat » (viande-à-baiser), de « sac-à-foutre ». Elles sont appelées « beurette » ou « chinetoque ». Pascal OP reconnaît s'en prendre sciemment à des femmes de classes populaires, les désignant comme des « cassos » : « Ces filles-là sont des grosses cassos, elles n'ont pas de thune, elles sont à la rue. Mais nous on est contents, ça fait de bons vides-couilles. »
Les mots justement, ces femmes veulent les remettre à l'endroit, comme Noëlie et Pauline : « Nous n'avons jamais été actrices. Et le porno, ça n'est pas du cinéma. Ce qu'on voit sur les images est réel. Nous, on ne faisait pas semblant. Ce qu'on nous a fait, nous l'avons réellement vécu. »
Elles interpellent aussi les hommes qui regardent les vidéos, se masturbent sur leurs viols. Mélanie égrène la longue litanie des hommes qui l'ont violée et utilisée, y inclut les consommateurs de porno : « chaque jour des centaines de types me violent par procuration, jouissent dans leurs paumes moites et passent à autre chose. » Elle lance un dernier cri, en attendant le procès : « Ils m'ont bimboïfiée, pornifiée, putifiée, ils m'ont déshumanisée. Je ne suis pas une poupée. Je suis un être humain, je suis mon corps, sexué, fécond, mortel. Je suis vivante. Je demande justice. »
Anne Waeles
Sous nos regards, Ouvrage collectif, éditions du Seuil, 2025.
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/culture/sous-nos-regards-recits-de-la-violence-pornographique/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

1er mai 202 : Plate-forme contre l’austérité

Les mesures d'austérité fragilisent notre société, affectant en premier lieu les populations les plus vulnérables. Sous prétexte de rationalisation budgétaire, nos gouvernements procèdent à des coupes systématiques dans les services publics essentiels, affaiblissant ainsi le filet social et accentuant les inégalités.
10 avril 2025 - tiré du site de la FTQ
https://ftq.qc.ca/1er-mai-2025/#1744301470112-4a1cb758-0c8d
Depuis plusieurs mois, le gouvernement du Québec a fait le choix politique de l'austérité. La mise à jour économique de novembre dernier a confirmé que la province allait bel et bien être plongée dans un cycle de compressions budgétaires affectant ainsi directement la grande majorité de la population.
Pourtant, il n'y a pas si longtemps, ce même gouvernement caquiste avait préféré appliquer des baisses d'impôts et distribuer des chèques de centaines de dollars plutôt qu'investir dans les services publics et des programmes sociaux qui profitent à toutes et à tous.
Si le gouvernement a fait le choix de l'austérité, ce n'est certainement pas celui des travailleur-se-s. C'est un film dans lequel le Québec a déjà joué et dont les grands gagnants sont les mêmes qui votent ces mêmes mesures d'austérité : les riches.
À ce contexte provincial s'ajoute évidemment l'élection fédérale qui pointe à l'horizon. Quel sera le parti qui prendra le pouvoir et quelles seront ses grandes orientations ? Impossible également de passer sous silence la grande incertitude dans laquelle Donald Trump plonge le monde entier, y compris nous.
Pour cette édition de la Journée internationale des travailleuses et travailleurs, le message est sans équivoque : Toujours debout contre l'austérité.
L'austérité et l'atteinte aux droits
Le respect des droits de tout le monde ne devrait jamais être négociable au gré des humeurs d'un gouvernement. Les droits au travail, à l'éducation, à la santé, au logement, à l'alimentation ou au transport devraient être inaliénables. Pourtant, les mesures d'austérité fragilisent au plus haut point ces droits.
La place accordée à l'école à trois vitesses, l'ouverture de plus en plus grande au privé en santé, le sous-financement dans les transports en commun, l'accès à des logements abordables impossible ou l'augmentation du panier d'épicerie pèsent de plus en plus lourd sur les épaules d'une grande partie de la population qui n'arrive même plus à combler leurs besoins de base.
L'austérité met donc en péril le droit fondamental d'accès à la santé, à l'éducation et à des services publics de qualité. Celles et ceux qui dispensent ces services voient également leurs conditions de travail se dégrader, ce qui nuit tant aux travailleur-se-s qu'aux bénéficiaires et aux patient-e-s. Et quand on ajoute à cela le droit de grève qui est actuellement grandement menacé, c'est une attaque frontale de plus que les travailleur-se-s ne peuvent laisser passer.
L'austérité et la fragilité des travailleur-se-s à statut précaire
Les travailleur-se-s à statut précaire, notamment les travailleur-se-s étranger-ère-s temporaires et les demandeur-se-s d'asile, font face depuis beaucoup trop longtemps à des conditions de travail épouvantables telles que de faibles salaires, des heures travaillées excessives, des abus de pouvoir et un manque de protection sociale.
Personne ne devrait être laissé pour contre ou exploité en raison du type d'emploi occupé ou de son origine. Il est grand temps que les gouvernements adoptent de meilleures politiques et lois qui protègent leurs droits notamment en matière de salaire minimum, d'heures de travail et de conditions de travail sécuritaires.
Ces travailleur-se-s ont besoin de solidarité et non d'austérité. La réduction de l'offre de services de francisation dans les centres de services scolaires au détriment des populations immigrantes est un exemple éloquent des effets dévastateurs des mesures d'austérité sur cette population.
Ils-elles sont donc confronté-e-s à des conditions de travail indignes et à une exploitation croissante, souvent sans protection sociale. Les emplois précaires se multiplient, et l'accès à des conditions de travail justes et équitables se restreint.
En l'absence de protections adéquates, leur accès à la résidence permanente demeure un véritable parcours du combattant. Cette situation engendre un déni de leurs droits fondamentaux et leur impose un silence forcé, les empêchant de revendiquer de meilleures conditions de travail.
Pendant ce temps, la redistribution de la richesse continue de bénéficier à une minorité, laissant la majorité des travailleuses et travailleurs dans une situation d'insécurité croissante.
L'austérité et l'effritement des filets de protection sociale
Les filets de protection sociale sont essentiels pour protéger les plus vulnérables et garantir une égalité des chances pour tous et toutes. Dans un contexte d'austérité, on assiste à l'effritement de ces filets venant ainsi augmenter les inégalités sociales.
Les attaques à l'endroit des femmes, des personnes marginalisées et des moins nanties sont plus importantes que pour le reste de la population. Les mesures d'austérité favorisent largement les emplois occupés par des hommes alors que ceux où les femmes sont d'ailleurs surreprésentées, comme dans les services publics, sont victimes de coupes importantes.
Parallèlement, plusieurs réformes sont mises en œuvre frappant de plein fouet des franges complètes de la population déjà fragiles. Les personnes en situation de handicap, celles bénéficiant de l'aide sociale, les victimes d'actes criminels ou les victimes de lésions professionnelles par exemple.
Collectivement, les filets de protection sociale sont ardemment souhaités et défendus. Il est grand temps que les gouvernements prennent en compte la vision et les attentes de la population.
L'austérité et la dégradation des services publics
La seule façon de garantir des services publics et l'accès à des programmes sociaux auxquels la population a droit c'est en y investissant les sommes nécessaires et en garantissant de bonnes conditions de travail à ceux et celles qui les dispensent.
Les coupures importantes imposées au réseau de l'éducation et à celui de la santé et des services sociaux sont catastrophiques. Le béton tombe en ruine et les services fondent comme neige au soleil. Devant l'état lamentable dans lequel se trouvent les établissements scolaires, de santé et de services sociaux, c'est le secteur privé qui en profite.
Les mesures d'austérité se manifestent de multiples façons. On supprime des postes, coupe des services, augmente le fardeau des organismes communautaires ou privatise tout simplement. Dans un tel contexte, la lutte pour des services publics et des programmes sociaux gratuits, accessibles et universels est fondamentale pour alléger le fardeau financier de la population et améliorer leurs conditions de vie. Même les personnes retraitées, qui ont contribué toute leur vie à ce modèle québécois, n'ont pas ou peu accès à ces services.
L'austérité n'est pas une nécessité – c'est une idéologie politique. Ce n'est pas un choix inéluctable, mais bien une volonté de démanteler nos acquis sociaux au profit d'une élite économique. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous tenir debout contre l'austérité et exiger un modèle de société plus juste et solidaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Grande manifestation pour le Jour de la Terre à Québec (22 avril 2025)

Le 22 avril 2025, une grande manifestation et une chaîne humaine symbolique entoureront l'Assemblée nationale à Québec dans le cadre du Jour de la Terre. Ce rassemblement, initié par la Coalition régionale justice climatique et sociale, vise à attirer l'attention sur les défis environnementaux et sociaux qui définissent l'urgence de notre époque.
4 avril 2025 | par Juliet Nicolas | tiré du journal Le Carrefour de Québec | « Photo » : Coalition régionale justice climatique et sociale
L'année 2024 a marqué un tournant inquiétant pour le climat : des records de chaleur ont été atteints. Dépassant le seuil critique de +1.5 degré de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle. Ce réchauffement accéléré entraîne des conséquences dramatiques, comme la multiplication d'événements climatiques extrêmes. Notamment la fonte du pergélisol, ce sol gelé en permanence depuis des milliers d'années et qui libère des gaz à effet de serre lorsqu'il se dégrade. Ainsi que l'érosion des écosystèmes.
Les transformations exercent une pression majeure sur la sécurité alimentaire, la santé publique, les revenus et la qualité de vie à l'échelle mondiale. Préserver les milieux naturels et réduire la dépendance aux énergies fossiles s'impose désormais comme une nécessité.
Une justice sociale bafouée
Alors que beaucoup voient leurs conditions de vie se dégrader, certains conservent un train de vie élevé, souvent lié à des activités polluantes. Selon Oxfam, les 1 % les plus riches épuisent leur budget carbone annuel en seulement dix jours, tandis que les 50 % les plus pauvres en consomment une fraction sur trois ans.
Ce déséquilibre exige des mesures audacieuses pour forcer les plus pollueurs à contribuer à la transition énergétique et pour renforcer le filet social qui protège les plus vulnérables.
Les revendications au cœur de la mobilisation
Face à l'absence d'actions concrètes, la mobilisation citoyenne joue un rôle clé pour impulser des transformations nécessaires. La grande manifestation s'articulera autour de trois revendications fondamentales :
- Il est crucial d'intensifier la lutte contre les crises climatique et de biodiversité en abandonnant progressivement les énergies fossiles, pour réduire les émissions et protéger les écosystèmes.
- Un réinvestissement important dans les services publics et les programmes sociaux est crucial pour renforcer les infrastructures et soutenir la population face aux défis actuels. Notamment grâce à une taxation accrue des grandes fortunes pour un financement équitable et durable.
- Enfin, pour être pleinement efficace, la transition écologique doit être équitable et inclusive. Elle doit s'appuyer sur des politiques qui accompagnent les travailleurs et les communautés dans leur adaptation aux changements, tout en garantissant des solutions accessibles et durables pour les plus vulnérables.
- Ces mesures concertées, axées sur la justice climatique et sociale, représentent une voie pragmatique pour répondre aux défis environnementaux et assurer une meilleure qualité de vie pour tous.
Une responsabilité collective
La manifestation du 22 avril se présente comme une occasion majeure de démontrer la force de l'engagement citoyen. En se rassemblant autour de l'Assemblée nationale, les participants souhaitent inciter les décideurs à agir de manière responsable et concrète. Répondre aux crises environnementales tout en instaurant une justice sociale durable n'est plus une option, mais une nécessité pour assurer un avenir viable.
Le 26 avril, à l'occasion du jour de la Terre, nous descendons dans la rue pour nos transports !
Nous sommes des usagers et usagères du transport, des syndiqué(e)s du milieu, des habitant(e)s préocupé(e)s, des automobilistes forcés d'en être, des cyclistes en quête de sécurité, des étudiant-es qui veulent se rendre à leurs cours facilement et bien plus encore. Nous vous donnons rendez-vous le 26 pour notre santé, pour notre capacité à se déplacer, pour une économie au service de la majorité, pour nos droits collectifs, pour des milieux de vie plus résilients, pour l'avenir !
Parce que notre résistance doit passer par la construction d'alternatives, nous vous invitons à prendre la rue aux côtés des syndiqué(e)s du transport collectif. Ensemble, désarmons les pétrolières et les politiciens qui sont à leur solde en nous libérant collectivement de la dépendance aux hydrocarbures. Exigeons un financement du transport collectif qui permette l'amélioration du service et de la qualité des emplois. Faisons en sorte, que partout au Québec, des alternatives à l'auto solo puissent se mettre en place. Investissons dans un avenir viable, à l'image du monde que nous souhaitons !
Joignez-vous à nous pour exiger :
- Un financement public pérenne pour maintenir et développer le réseau
– Des emplois de qualité dans le secteur du transport collectif
– Des transports accessibles à toutes et tous – physiquement, géographiquement et financièrement
Rendez-vous le 26 avril 2025 à 13 h sur la Place des Festivals (métro Place-des-Arts).
Venez colorés, avec des pancartes, votre énergie et de quoi faire du bruit ! Plus d'informations sur le trajet et les surprises de cette manif à venir.
Organisateurs : Front commun pour la transition énergétique, FTQ, La Planète s'invite au Parlement, Mouvement pour un transport public abordable, TNCDC - Table nationale des Corporations de développement communautaire, Conseil central du Montréal métropolitain - CSN et Écologie populaire.
Pour plus d'informations : https://www.facebook.com/events/place-des-festivals/jour-de-la-terre-finan%C3%A7ons-nos-transports-collectifs-publics-/559774849745542
Source : https://scfp.qc.ca/appel-a-tous/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Négociation nationale des CPE : Les 13 000 travailleuses en grève alors que la négociation s’intensifie

La négociation s'est poursuivie toute la fin de semaine et les échanges continuent de façon intensive. L'objectif est de parvenir à une entente bonifiant les conditions de travail des travailleuses en CPE dans les meilleurs délais.
Les 13 000 travailleuses et travailleurs en CPE syndiqués à la CSN sont en grève du 14 au 16 avril, alors que la négociation s'intensifie avec le gouvernement. La grève est maintenue afin de parvenir à une entente le plus rapidement possible.
La négociation s'est poursuivie toute la fin de semaine et les échanges continuent de façon intensive. L'objectif est de parvenir à une entente bonifiant les conditions de travail des travailleuses en CPE dans les meilleurs délais. Pour la CSN, qui représente 80 % des travailleuses syndiquées en CPE, il est important que le gouvernement accepte de bonifier ses offres pour répondre aux préoccupations des travailleuses quant à l'avenir des CPE.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












