Derniers articles
Changement de culture : Combien d’animaux sont morts pour notre assiette ?
Du Canada à Gaza : « une histoire de génocide »

Réflexions et propositions sur le Cahier de propositions de Québec solidaire

Le 8 septembre, les membres de Québec solidaire recevaient une version actualisée du Programme de Québec solidaire et un Cahier propositions. Ce dernier doit faire l'objet de discussions dans les associations du parti. Les propositions pourront être amendées et la date limite de ces amendements est le 8 octobre prochain. Le 23 octobre, le cahier de synthèse des propositions et des amendements sera à son tour disponible. C'est ce dernier qui sera soumis au congrès du parti qui doit se tenir les 7, 8 et 9 novembre prochain. Dans le cadre de la discussion sur l'actualisation du programme de Québec solidaire, ce texte présente des remarques tant sur l'analyse de la situation et des propositions qui visent à répondre à cette situation dans une option d'émancipation politique et sociale. Nous abordons ici proposition par proposition les Blocs 1 et 2 du Cahier de propositions qui correspondent au premier chapitre du programme intitulé Créer une économie verte et solidaire.
L'ébauche du programme actualisé se limite à une « vision politique » et une « philosophie gouvernementale générale » au détriment d'analyses concrètes de la situation actuelle, de revendications précises et d'une stratégie de lutte permettant d'amorcer un processus de transformation sociale. Cette posture a) évite d'évaluer les rapports de forces sociaux et le rôle des mouvements sociaux comme acteurs des transformations sociales ; b) neutralise le programme en le réduisant à des politiques gouvernementales d'un éventuel gouvernement solidaire, empêchant ce programme d'outiller le parti pour les luttes concrètes extra-parlementaires ; c) déconnecte le projet de société de ses conditions de possibilité en négligeant d'élaborer des stratégies précises.
Le programme doit redevenir un outil stratégique complet, intégrant analyse, propositions et stratégies concrètes de transformation sociale, articulées aux luttes présentes. Il s'agit de proposer un programme qui dépasse l'approche centrée uniquement sur l'éventuelle gestion d'un gouvernement de Québec solidaire, et d'esquisser un programme d'action articulé aux luttes sociales et au processus constituant produit par ces luttes. L'exercice proposé ne vise qu'à identifier les amendements et ajouts au programme en partant du Cahier de propositions.
Bloc 1 : Économie et transition socioécologique – Éclairer le rôle de l'économie dans la transition
Résumé des propositions soumises à la discussion
1.1 Les objectifs de l'économie solidaire.
Québec solidaire vise une économie décarbonée en 2050. Un gouvernement de Québec solidaire appliquera dans un premier temps un plan de transition énergétique visant l'élimination des hydrocarbures dans la production et la consommation d'énergie. Un gouvernement de Québec solidaire se dotera de nouveaux outils de planification et d'orientation économique pour améliorer le bien-être collectif et assurer le respect des droits de toutes et tous.
Critiques
Si on peut se questionner sur ce que signifie l'expression du dépassement à terme du capitalisme. Parler d'un système plus juste, inclusif et viable, c'est flou à souhait. On a ici une bonne illustration de ce que l'on entend par la réduction du programme à une vision politique. En fait, dans cette approche, l'analyse de la situation économique et politique est escamotée, les classes sociales, leurs intérêts divergents et les rapports de force entre ces dernières sont invisibilisés. On verra que cela demeure une constante dans l'ensemble du texte de l'ébauche.
Le mode de production capitaliste conduit à une prédation qui détruit systématiquement des forêts et des espèces animales, terrestres et marines.
Cette seule priorité d'une économie décarbonée pour 2050 ne se distingue en aucune façon de celle avancée par les autres partis politiques au Canada et au Québec. Aucune cible pour 2030 ; aucune reprise des propositions du GIEC et des groupes écologistes en termes de cible. On se contente de généralités sur l'accélération de la transition socioécologique sans en définir le contenu.
Amendements et ajouts
Il faut définir des objectifs intermédiaires pour l'atteinte des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et reprendre les objectifs avancés par les groupes écologistes.
Mais un frein significatif à la catastrophe climatique et la perte de la biodiversité ne peut être construit que par l'élimination de la poursuite d'une croissance sans entrave favorisant l'accumulation capitaliste. Il faut défendre une décroissance véritable en donnant la priorité à l'économie d'énergie, l'économie des ressources naturelles et la protection de la biodiversité. Cela passe par :
• la production de biens répondants aux besoins sociaux et non à une consommation débridée stimulée par la publicité ;
• la priorité donnée aux travaux qui vise l'économie d'énergie, comme la construction et la réparation de logements et d'édifices sobres en consommation d'énergie ;
• l'arrêt de l'obsolescence planifiée des produits et la facilitation des réparations ;
• la relocalisation au plus près des usagers et usagère des productions pour éviter les transports aériens et maritimes sur de grandes distances de marchandises coûteuses en énergie ;
• une planification démocratique et citoyenne de ce qui doit être produit rompant avec la seule poursuite de profits.
Défendre la biodiversité exigera :
• le passage d'une agriculture industrielle à une agriculture biologique qui évite la surfertilisation, l'usage de pesticides, et sa réorientation vers la production de protéines végétales au lieu de protéines animales ;
• la sortie d'une agriculture centrée sur la production carnée en mettant fin aux élevages industriels ;
• la fin de la déforestation par l'exploitation privée des forêts et une gestion qui tend à diminuer la variabilité des espèces d'arbres sur un territoire ;
• L'arrêt d'une pêche industrielle qui détruit les ressources halieutiques.
Arguments pour l'ajout
Pour ce qui est de l'objectif de la décarbonation pour 2050, un horizon aussi éloigné ne permet pas de fixer des objectifs de lutte immédiats pour les mouvements sociaux et de soutenir les objectifs des groupes et mouvements écologistes.
Pour ce qui est de la décroissance et de la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, cela ne peut être le seul résultat d'une action gouvernementale à venir. Il faut mettre de l'avant des revendications qui peuvent être reprises par les mouvements sociaux. La lutte contre la production des biens sociaux et des dépenses ostentatoires sont des combats qui doivent être livrés maintenant. Cela est aussi vrai de la lutte contre l'obsolescence planifiée et pour la réparabilité des produits menée par des mouvements de consommateur-ices, les syndicats, les groupes écologistes.
Pour ce qui est de la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, on ne peut se contenter de parler d'aires protégées, c'est tout le rapport à la nature qui doit être transformé et cela implique une rupture avec la logique de croissance infinie pour la recherche de profits.
Résumé des propositions soumises à la discussion
1.2 (1.2.1) Diversifier les modèles économiques
Il faut que la logique de l'accumulation des profits cesse pour laisser plus d'espace à l'économie sociale. L'économie doit revenir entre les mains des communautés québécoises.
Critiques
Ces propositions sont des abstractions. La propriété privée des moyens de production et d'échange par les monopoles qui sont souvent des multinationales étrangères et les grandes banques doit être remise en question, car ce sont les acteurs majeurs du système économique qui déterminent la logique d'évolution qui conduit à la prédation et à la destruction de la nature.
Amendements et ajout
L'économie ne peut revenir entre les mains de la majorité populaire sans la socialisation des grandes entreprises des secteurs stratégiques de l'économie. Cette socialisation passe par la nationalisation, puis la démocratisation de ces entreprises pour donner le contrôle aux travailleurs, aux travailleuses, et aux citoyen-nes.
Arguments en faveur des amendements et ajouts
On ne peut en reste à des formulations qui ne permettent pas à la majorité populaire et aux mouvements sociaux d'agir concrètement dans le sens des objectifs visés.
Résumé des propositions soumises à la discussion
1.3 (1.2.1) Diversifier les modèles économiques
On propose trois critères pour une nationalisation : 1. son caractère stratégique ; 2. la grande quantité de capital nécessaire ; 3. la démonstration de l'échec du secteur privé.
Critiques
Si on peut nationaliser sans démocratiser (soit étatiser), on ne peut socialiser les secteurs économiques appartenant au grand capital sans nationaliser (les banques, les grandes entreprises d'exploitations minières, forestières ou les grandes industries de transformation et de transport). Elles doivent devenir du domaine public si on veut pouvoir opérer dans ces dernières une démocratisation véritable donnant le pouvoir aux travailleuses, aux travailleurs et aux citoyen-nes.
Si le critère 1 pour la nationalisation peut être à considérer, le critère 2 montre que la proposition ne considère pas la nationalisation sans compensation et la démocratisation qui devrait s'ensuivre ; le critère 3 de l'échec du secteur privé équivaut ni plus ni moins à faire prévaloir la recherche du profit sur les besoins sociaux.
Amendements et ajouts
La socialisation des grandes entreprises et des banques passe par leur nationalisation et la démocratisation de leur fonctionnement.
Les critères 2 et 3 sur la nationalisation doivent être biffés.
Arguments en faveur des amendements et ajouts
La démocratie économique ne peut être réalisée si une minorité possédante continue d'avoir le contrôle des choix d'investissement et de mobilisation de l'argent, alors que cette minorité se constitue en force à de blocage de la transition écologique et sociale, comme la conclusion de ce chapitre du programme révisé le reconnaît.
Résumé des propositions soumises à la discussion
Participation des travailleuses et travailleurs à la transition socioécologique
1.4 (1.2.3) Protection et participation des travailleuses et des travailleurs dans la transition socioécologique
Un gouvernement de Québec solidaire applique le principe de Zéro perte d'emploi net à l'intérieur de chaque région. Il assurera la diversification des économies locales. Il favorisera des investissements dans les secteurs peu polluants et la requalification de la main-d'œuvre. Un gouvernement de Québec solidaire encouragera la participation des travailleuses et des travailleurs dans la gestion des impacts de la transition écologique.
Critiques
Quelle sera la politique d'investissement d'un gouvernement solidaire pour diversifier l'économie d'une région ? Comment et avec quels moyens un gouvernement solidaire investira-t-il dans les secteurs peu polluants ? Comment les travailleuses et les travailleurs seront-ils impliqués dans les choix gouvernementaux ?
Encourager la participation dans la gestion des impacts est pour le moins timide ; la question est celle d'assurer non seulement la participation, mais aussi la prépondérance des travailleurs et travailleuses.
Amendements et ajouts
Pour Québec solidaire, cela passera par la proposition de créer des conseils régionaux de planification démocratique, où siégeront côte à côte des élu-es, des syndicats, des collectifs écologistes et des associations citoyennes et communautaires. Ces conseils doivent être ouverts, transparents et redevables devant la population. Les grandes orientations économiques, énergétiques et sociales doivent être débattues publiquement et tranchées collectivement. Les assemblées citoyennes locales, les budgets participatifs et le droit de référendum sur les projets destructeurs sont des outils indispensables pour briser l'opacité du pouvoir et donner une voix directe au peuple.
Québec solidaire soutiendra que les travailleuses et travailleurs doivent occuper une place centrale dans ce processus. Eux seuls connaissent la réalité des emplois, les conditions de travail et les besoins de reconversion. Ils doivent avoir un droit de regard sur chaque projet régional, notamment dans les secteurs stratégiques, comme l'énergie, le transport, la forêt, l'agriculture ou l'industrie.
Enfin, pour éviter que ce processus ne soit confisqué par les institutions, il faut mettre en place des observatoires citoyens et syndicaux chargés de surveiller la mise en œuvre des décisions et de forcer les autorités à rendre des comptes régulièrement. Les bilans doivent être publics, débattus et rectifiés collectivement.
Arguments en faveur des amendements et ajouts
La protection des travailleuses et des travailleurs ne peut se contenter d'un encouragement à la participation. Cette protection ne peut être assurée que par un processus de démocratisation économique qui ne doit pas s'arrêter à la porte des entreprises ou des institutions publiques.
Résumé des propositions soumises à la discussion
Soutien aux municipalités dans la transition écologique
1.5 (1.2.4) Soutenir les municipalités dans la transition écologique
Un gouvernement solidaire soutiendra adéquatement les municipalités dans la mise en œuvre de la transition socioécologique. Il donnera aux régions les moyens d'organiser leur développement économique et la socialisation. Un gouvernement solidaire confiera à de nouveaux conseils régionaux la planification de la transition socioécologique.
Critiques
Le soutien adéquat, cela ne signifie rien de précis. Le moyen d'organiser la mise en œuvre de la transition n'est pas non plus définie. Il s'ensuit que l'on en reste à un discours sans ancrage dans le réel.
Amendements et ajouts
Il faudra assurer le transfert du budget de l'État vers les municipalités, instaurer la mise en place de budgets participatifs et instaurer un fond de solidarité inter municipalités.
Arguments en faveur de l'Amendement
Les propositions avancées ne sont pas uniquement conditionnées à une éventuelle prise du pouvoir par Québec solidaire. Elles peuvent favoriser les mobilisations citoyennes pour remettre en cause le contrôle bureaucratique et étatique de l'état sur les municipalités tel que le prévoit la loi actuelle.
Résumé des propositions soumises à la discussion
Encadrer le commerce le libre échange et le financement
1.6 (1.2.5) Encadrer le commerce, le libre-échange et le financement
Un gouvernement de Québec solidaire imposera des obligations environnementales, sociales et de gouvernance renforcée pour les entreprises québécoises à l'étranger. Les organismes publics devront respecter les mêmes normes.
Critiques
La question du commerce et du libre-échange ne saurait concerner que les seuls investissements étrangers des entreprises québécoises. Ce qui est en jeu avec la finance, c'est la capacité de financer les investissements publics permettant une véritable transition socioécologique.
Amendements et ajouts
Il est nécessaire de dénoncer les traités qui portent atteinte à la souveraineté démocratique et aux droits sociaux et environnementaux, notamment l' Accord Canada–États-Unis–Mexique, l'Accord économique et commercial global, et le Partenariat transpacifique global. Il faut exclure explicitement les services publics et la culture des clauses de libéralisation et d'investissement, et abolir les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, qui favorisent injustement les multinationales au détriment des intérêts collectifs.
Pour encadrer les entreprises québécoises à l'étranger, une loi sur la responsabilité extraterritoriale doit être adoptée, obligeant les entreprises et investisseurs publics québécois à respecter des normes rigoureuses en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
Pour refonder nos rapports à la finance mondiale, il convient d'instaurer une taxe sur les transactions financières (TTF) ainsi que sur les profits bancaires, d'interdire toute relation avec des paradis fiscaux officiellement reconnus et d'imposer la transparence bancaire, notamment par la levée du secret bancaire. Par ailleurs, les produits financiers spéculatifs nuisibles doivent être interdits afin de réduire les risques systémiques et la financiarisation de l'économie.
Québec solidaire doit appeler à la socialisation des banques et des assurances.
Bloc 2 : Habitation, énergie, ressources naturelles et travail
Habitation
Résumé des propositions soumises à la discussion
2.1 (1.3.1.2) Réguler et bâtir habitations et logements (2,3,4,5) Un gouvernement de Québec solidaire s'attaquera frontalement aux spéculateurs, élargira et durcira l'éventail des sanctions. Les projets publics et privés de construction et de rénovation devront obéir à des normes écologiques. Les projets immobiliers devront répondre aux besoins de proximité des services publics afin de résoudre les problèmes liés à l'étalement urbain. Le secteur privé devra consacrer un pourcentage minimal des nouvelles habitations aux logements sociaux. Les Cégeps et universités devront offrir des lieux de résidences à prix modiques. Un gouvernement solidaire renforcera de manière drastique le rôle de l'État dans la construction et la gestion du parc public de logements. Il protégera le parc locatif et l'accès à la propriété individuelle et collective. Il prendra des mesures pour éviter que des personnes consacrent plus que 30% de leur revenu à leur loyer.
Critiques
Les propositions concernant l'habitation sont précises et répondent aux problématiques en matière d'habitation. Il reste qu'elles s'inscrivent essentiellement dans la conception du programme où tout n'est que le résultat de l'action d'un éventuel gouvernement de Québec solidaire.
Amendements et ajouts
Les actions citoyennes sont essentielles pour renforcer les droits et remettre les décisions entre les mains des collectivités. Québec solidaire soutiendra les initiatives visant la mise en place d'assemblées citoyennes régionales qui pourront encadrer les grands projets et permettre une véritable planification citoyenne de la gestion des milieux de vie. Les communautés devront bénéficier d'un droit d'achat préférentiel lors des ventes de terrains ou d'immeubles stratégiques. Les actions citoyennes et de différents mouvements sociaux aideront à garantir l'inclusion systématique des Premiers Peuples dans tous les processus décisionnels liés au territoire. Des Conseils d'aménagement territoriaux régionaux seront mis en place, composés d'élu-es, de citoyen-nes, d'organismes locaux, d'organisations syndicales et communautaires ainsi que de représentant-es autochtones pour élaborer démocratiquement des plans d'aménagement régionaux.
Énergie :
2.2.(1.3.2) Pour la conservation de notre eau et de notre énergie
Résumé des propositions soumises à la discussion
Québec solidaire s'oppose à la construction de tout nouveau pipeline. La collectivité, ce qui inclus les salarié-es et citoyen-nes et les Premières nations, doivent établir démocratiquement la stratégie de l'État Québécois. Il est urgent de lancer un vaste chantier pour accroître la production d'énergies renouvelables et non polluantes – solaire, géothermique et éolienne. Un gouvernement de Québec solidaire donnera les pleins pouvoirs d'étude et de recommandations au BAPE avant tout nouveau projet de développement hydroélectrique. Il stoppera les projets de développement énergétique qui ne sont pas responsables et durables sur le plan écologique. Il instaurera un programme d'efficacité énergétique comprenant la réduction d'énergie dans les milieux domestiques, du secteur public et des transports, la rénovation écologique des bâtiments et le resserrement des normes…
Critiques
Ici encore, les revendications et actions proposées par le projet de programme se limitent à décrire l'intervention gouvernementale. Les acteurs et actrices et les mobilisations qu'ils ou elles pourraient entreprendre pour transformer maintenant la situation ne sont pas envisagés… Il faut ajouter cette dimension.
Amendements et ajouts
Québec solidaire soutiendra la mise en place d'une planification écologique et démocratique qui réponde de manière résiliente aux besoins énergétiques de la population aux échelles locales, régionales et nationales, et qui donne un rôle primordial et décisionnel aux travailleuses et travailleurs concerné-es dans la gestion des ressources énergétiques. Il soutiendra les municipalités dans le développement et la gestion des microréseaux intelligents énergétiques adaptés à leurs besoins et se mobilisera avec les militant-es écologises pour refuser la relance de la filière nucléaire, y compris l'exploitation de l'uranium.
Arguments en faveur des ajouts
Ces ajouts visent à enrichir le programme au niveau de la démocratisation et la socialisation de ces propositions dans une démarche basée sur les mobilisations citoyennes et de différents acteurs sociaux.
Ressources naturelles
2.3 (1.3.5.2) Pour des pêcheries à l'échelle humaine.
Résumé des propositions soumises à la discussion
Un gouvernement de Québec solidaire inclura le milieu des pêcheries dans sa stratégie agroalimentaire afin de diminuer notre dépendance aux marchés internationaux, garantira la traçabilité, créera des chaînes d'approvisionnement locales, commercialisera les produits locaux partout au Québec et développera une aquaculture durable. Un gouvernement de Québec solidaire soutiendra la concertation élargie des actrices et acteurs de l'industrie des pêches en incluant les peuples autochtones et en respectant les droits ancestraux. Il repensera aussi le modèle actuel d'attribution des permis et quotas pour favoriser les pêcheurs et pêcheuses ancrées dans nos communautés.
Critiques
Les revendications et actions proposées par le projet de programme se limitent à décrire l'intervention gouvernementale. Les acteurs et actrices et les mobilisations qu'ils pourraient entreprendre pour transformer maintenant la situation ne sont pas envisagés… Il faudrait ajouter cette dimension.
Amendements et ajouts
Québec solidaire soutiendra les revendications et les moyens d'action des pêcheurs et pêcheuses du Québec qui visent à assurer la viabilité économique de leur métier et la protection durable des ressources halieutiques. Cela passe par des luttes (manifestations, grève de pêches, pressions politiques sur les autorités) pour un accès équitable aux quotas de pêche, en s'opposant à leur concentration entre les mains de grandes compagnies ou d'investisseurs financiers.
Québec solidaire contribue à favoriser des alliances avec ces travailleurs et travailleuses pour améliorer leur rapport de force.
Québec solidaire appuiera la collaboration des artisan-es avec les communautés autochtones et les chercheur-euses, ainsi que les expérimentations locales de quotas collectifs autogérés, afin de mieux équilibrer exploitation et préservation. et soutiendra les initiatives des pêcheur-euses pour la protection des stocks halieutiques et leur implication dans des partenariats scientifiques pour assurer un suivi régulier des stocks.
Québec solidaire joindra sa voix à leurs revendications et à leurs actions en alliances avec les organisations environnementales pour la protection des habitats marins menacés par la pollution, le chalutage de fond et la destruction des écosystèmes.
Arguments en faveur des ajouts
On ne peut concevoir le passage à des pêcheries à l'échelle humaine en excluant les acteurs et les actrices de cette industrie, en ne disant rien sur leurs revendications actuelles et sur leurs actions et sur la nécessité pour Québec solidaire de s'impliquer en soutien avec les luttes pour leur reprise de contrôle sur les pêcheries, la protection des ressources halieutiques et la protection des milieux marins.
2.4 (1.3.5.3) Pour des mines et des forets gérées responsablement (3)
2.5 (1.3.5.3) Pour des mines et des forêts gérées responsablement(4)
2.5 (1.3.5.3) Pour des mines et des forêts gérées responsablement (6)
Résumé des propositions soumises à la discussion
Un gouvernement de Québec solidaire placera l'industrie minière sous une étroite surveillance, en nationalisant au besoin certains minéraux stratégiques. Il élaborera une nouvelle loi sur les mines suivant une consultation populaire. Il mettra en place un système de redevance pour les entreprises exploitant les ressources naturelles afin d'encourager l'utilisation de ressources renouvelables en s'assurant que les ressources soient équitablement réparties – entre les régions, les Premières Nations et l'État québécois. Il garantira que la restauration complète des sites miniers soit assumée par les entreprises minières..
Un gouvernement de Québec solidaire adoptera une stratégie de gestion durable et d'adaptation de la foresterie aux changements climatiques, en collaboration avec les communautés touchées, particulièrement les Premières Nations et les Inuit, l'industrie et les travailleurs et travailleuses.
Un gouvernement de Québec solidaire en coopération avec les Premières Nations et les Inuit renouvellera le secteur forestier en surveillant et évaluant en continu les entreprises publiques et privées ou coopératives à partir de critères socio-économiques. Il élaborera des politiques publiques favorisant une plus grande utilisation de produits du bois provenant d'une exploitation durable.
Critiques
Il faut préciser ce que fera Québec solidaire comme parti, d'ici à ce qu'il soit au pouvoir.
Amendements et ajouts
Québec solidaire soutiendra les actions citoyennes pour la démocratisation de la gestion des ressources naturelles et leur appropriation collective.
Québec solidaire encouragera la création et l'animation d'assemblées citoyennes dans les régions ressources afin de débattre de la gestion locale des mines et des forêts. Il favorisera des initiatives de consultation populaires, comme des référendums citoyens sur des projets contestés. Il défendra non seulement la nationalisation des ressources stratégiques, mais plaidera en faveur de leur socialisation ou la coopérativisation et soutiendra des campagnes publiques en faveur de la socialisation des entreprises exploitant des minéraux stratégiques et des grandes entreprises forestières.
Il soutiendra les luttes autochtones pour la protection du territoire par sa présence sur le terrain, ainsi qu'un appui juridique et médiatique.
Québec solidaire appuiera la mise en place d'institutions du pouvoir populaire, comme la création de comités de veille citoyenne sur les processus de consultation et d'évaluation environnementale. Il appuiera la mise en place de commissions de vigilance citoyenne semblables à des « sentinelles écologiques » qui pourraient documenter les atteintes au territoire. Québec solidaire favorisera enfin la création de tables de solidarité autochtone-allochtones locales pour favoriser le dialogue et la mise en œuvre concrète d'une cogestion territoriale démocratique.
Arguments en faveur des ajouts
Cet ajout, vise à enrichir le programme afin qu'il ne les limite pas à une description d'une éventuelle politique gouvernementale. Il s'agit ici encore d'ancrer le programme, et par le fait même Québec solidaire, comme acteur des luttes qui se mènent actuellement et qui visent à renforcer le pouvoir populaire.
Droit des travailleuses et des travailleurs
2.7 (1.4.2) Pour la syndicalisation des milieux de travail sains (1)
Résumé des propositions soumises à la discussion
Un gouvernement de Québec solidaire reverra le rapport de force entre employeurs et salarié-es et améliorera leurs conditions de vie. Il prendra les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les travailleuses puissent se syndiquer et exercer leurs droits syndicaux. Il inscrira le droit de grève dans la Charte des droits et libertés de la personne et interdira les lockout. Il révisera en profondeur la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il veillera à leur respect pour protéger l'ensemble des travailleuses et travailleurs, incluant les temporaires.
Critiques
Ce sont là des revendications justes pour améliorer les conditions de travail, de vie et d'organisations des travailleuses et des travailleurs, mais ces transformations sont reportées à une éventuelle prise de pouvoir par Québec solidaire. Pourtant, face à l'offensive néolibérale et la montée de l'extrême droite et le tournant autoritaire et antisyndical des gouvernements, il y a des tâches pour un parti politique qui ne peut être remis à plus tard. Le programme de Québec solidaire ne peut passer sous silence les tâches qui découlent de cette situation. Le programme du parti doit donc préciser le travail qui doit être fait maintenant pour contribuer à renforcer le rapport de force en sa faveur et pour contrer l'offensive du patronat et des gouvernements à son service.
Amendements et ajouts
Le mouvement syndical québécois est confronté à une offensive patronale et gouvernementale sans précédent, il doit répondre à des défis majeurs : restriction des droits syndicaux, précarisation du travail, privatisation des services publics, explosion des inégalités et crise écologique. La fragmentation du salariat – marquée par la multiplication des emplois temporaires, de l'économie de plateforme et du travail ubérisé – rend l'organisation collective plus difficile, tandis que l'austérité et les PPP grugent nos services essentiels.
Face à ces défis, le mouvement syndical québécois revendique des hausses salariales substantielles, indexées au coût de la vie et la pleine reconnaissance des droits syndicaux dans tous les secteurs. Il exige un réinvestissement massif dans la santé, l'éducation et les services sociaux, ainsi que la construction de logements sociaux accessibles. Dans le contexte de la crise climatique, il met de l'avant la nécessité d'une transition juste : reconvertir les emplois polluants en emplois verts et socialement utiles, développer massivement le transport collectif et reprendre démocratiquement le contrôle des secteurs stratégiques, comme l'énergie, les mines ou le numérique.
Québec solidaire doit soutenir activement les luttes du mouvement syndical pour ces revendications et les défendre sur toutes les tribunes. Cela implique de renforcer la mobilisation de son secteur de travailleurs et travailleuses syndiqués afin de favoriser la mobilisation de l'ensemble de ses membres et de son soutien populaire dans ces combats.
Québec solidaire doit contribuer à construire des alliances solides entre le mouvement syndical et différents secteurs de la société (mouvement étudiant, mouvement féministe, mouvement écologique, mouvement communautaire, mouvement anti-raciste et autochtone), afin de créer un véritable front populaire dans lequel le mouvement syndical est appelé à jouer un rôle essentiel.
Arguments en faveur des ajouts
Si une gestion gouvernementale de gauche apporterait un renforcement essentiel à la défense des droits des travailleuses et des travailleurs, le soutien à la défense de ces droits ne sauraient être reporté à l'éventuelle prise du pouvoir par Québec solidaire. C'est pourquoi il faut que le programme décrive les buts et les formes de l'implication de Québec solidaire dans ce combat.
Intelligence artificielle
2.8 Pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies
Résumé des propositions soumises à la discussion
Un gouvernement de Québec solidaire instaurera un cadre réglementaire concernant les technologies basées sur les principes de transparence, de transition socioécologique, de respect de l'identité et de la culture québécoise et de respect de la propriété intellectuelle et des droits d'auteurs. Il créera un filet de sécurité pour les travailleurs et travailleuses touchées par l'automatisation. Il exigera une étude d'impact éthique et sociale pour tout déploiement de l'intelligence artificielle dans les services publics. Il s'assurera que la mise en place d'infrastructures numériques se fasse de façon écoresponsable.
Critiques
Ici comme ailleurs, ce sont des propositions importantes, mais elles remettent l'initiative à un éventuel gouvernement de Québec solidaire et à son pouvoir de gestion. Pourtant des acteurs et actrices (syndicats, écologistes, pacifistes, scientifiques) agissent déjà sur le terrain pour contrer les effets négatifs que provoquent déjà la généralisation de l'IA sous l'initiative des grands patrons de la Silicon Valley. Il est donc important que QS se mobilise en alliance avec ces acteurs et actrices pour participer aux combats en cours. Le programme du parti doit refléter cette volonté.
Amendements et ajouts
Face à la généralisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les milieux de travail, d'étude et de vie quotidienne, différents acteurs sociaux formulent actuellement des revendications et mettent en œuvre des moyens d'action pour en encadrer l'usage et en réduire les effets négatifs. Québec solidaire doivent soutenir les actions des syndicats qui exigent que l'automatisation ne soit pas synonyme de licenciements massifs et qui demandent que l'introduction de l'IA permette la réduction collective du temps de travail sans perte de salaire.
Québec solidaire soutiendra les revendications des salarié-es qui dénoncent l'utilisation de l'IA visant à renforcer leur surveillance ou à dégrader leur dignité au travail. Québec solidaire se joindra aux campagnes publiques des syndicats visant à dénoncer la surveillance algorithmique ou les suppressions de postes. Québec soutiendra les luttes pour l'imposition de normes communes pour protéger les salarié-es.
Québec solidaire sera partie prenante des actions des militant-es écologistes, qui soulignent l'empreinte écologique et matérielle de l'IA et dénoncent la consommation colossale d'énergie des centres de données et l'extraction de métaux rares nécessaires à son déploiement. QS défendra avec les organisations environnementales les choix technologiques des citoyens-nes et les communautés. QS participera aux campagnes de sensibilisation et aux actions militantes des écologistes pour bloquer l'arbitraire des dirigeants de la tech.
Québec solidaire reprendra à son compte les critiques des scientifiques qui revendiquent un accès public aux codes et aux bases de données, ainsi qu'une évaluation indépendante des impacts sociaux et environnementaux de l'IA. Ils exigent que certaines applications soient interdites, notamment les armes autonomes, les systèmes de notation sociale ou les dispositifs de manipulation politique de masse.
Québec solidaire s'impliquera dans les combats pour refuser que l'IA soit abandonnée au seul pouvoir des grandes entreprises et des gouvernements et pour la soumettre à un contrôle démocratique, transparent et citoyen.
Arguments en faveur des ajouts
En amont d'une éventuelle gestion gouvernementale par Québec solidaire de l'intelligence artificielle, le programme de Québec solidaire, comme parti des urnes et de la rue, doit baliser l'intervention du parti autour de ces enjeux.
Conclusion : les réels enjeux du débat programmatique à Québec solidaire
Le débat sur le programme à Québec solidaire a pour une grande part été présenté comme ayant pour objectif de le rendre plus pédagogique et accessible pour la majorité de la population. En fait, l'ébauche du programme met de côté les engagements politiques liés aux mouvements sociaux et présente essentiellement les politiques d'un éventuel gouvernement de Québec solidaire.
L'enjeu de ce débat est donc, essentiellement, soit de définir le programme comme un plan de gestion d'un gouvernement en attente (ce qui nous est proposé dans le Cahier de propositions), soit comme celui d'un parti des urnes et de la rue qui avance, bien sûr, les orientations d'un gouvernement solidaire, mais qui propose surtout des mesures articulées aux luttes en cours afin d'enraciner le parti dans les mouvements sociaux et de faire du programme un outil de lutte s'adressant à la majorité populaire et à ses organisations : syndicats, groupes féministes, écologistes, étudiants, communautaires et autochtones.
Le programme devient alors une boussole pour la mobilisation et la construction du pouvoir populaire. Les amendements et ajouts proposés ne sont que des pistes pour réinscrire dans le programme une véritable démarche d'un parti des urnes et de la rue.
Je suis « pauvre conne »
Des groupes dénoncent un projet de loi 33 « carcéral » de Doug Ford
Un balado de ¾ d’heure sur l’emprise au Québec-Canada de la plus grande papetière mondiale et championne du pillage écologique en Indonésie
Frédérik Grégoire, sur la base de recherches exhaustives et documentées, a élaboré un balado de trois quarts d'heure sur l'entreprise Asia Paper and Paper (APP) – Paper Excellence – Domtar – Resolu, propriété privée d'une seule personne et plus grande papetière mondiale. On y apprend qu'après avoir qu'après pillé la forêt indonésienne pour ses plantations, drainé des tourbières et, last but not least, anéantit des villages par la violence, le meurtre et le feu, cet oligopole, depuis le début des années 2000, a mis la main sur les deux plus grandes papetières du Canada, Domtar, puis du Québec, Resolu, en 2023. Après avoir contribué à l'épuisement des forêts de la Colombie britannique, dont le nombre de scieries a diminué de 40% en 20 ans, Domtar alias Paper Excellence alias APP s'attaque aux forêts du Québec. Après avoir refusé de comparaître devant un comité parlementaire fédéral, le propriétaire a sollicité une rencontre avec le Premier ministre Legault. Le lien avec le projet de loi 97 crève l'écran. Cette loi, entre autres, supprime les tables locales, où l'industrie forestière est un acteur, pesant faut-il le dire, parmi d'autres pour remettre la gestion des forêts à l'industrie forestière.
Envoi par Marc Bonhomme, 9 septembre 2025
Qui est Jackson Wijaya ? Quels sont ses antécédents de violation de droits humains et de destruction environnementale en Indonésie ? Avec le projet de loi 97, la CAQ aide-t-elle cet homme à vider les forêts du Québec sous le prétexte de protéger des emplois ?
1 : Pétition à l'endroit de François Legault et Terry Duguid : https://chng.it/NB8JCxNv9h
2 : Lettre de Nature Québec à l'endroit de Maïté Blanchette-Vézina : https://naturequebec.org/campagnes/de...
3 : Document sources : https://docs.google.com/document/d/1Z...
4 : Consultation particulière avec l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (1 :10 à 28 :40) : • Les Premières Nations face au PL 97 : Une ...
5 : Consultation particulière avec Nature Québec (4 :27 :55 à 4 :53 :00) : • Les Premières Nations face au PL 97 : Une ...
6 : Entrevue de QUB avec Maïté Blanchette-Vézina : • Échange CORSÉ : la ministre Maïté Blanchett...
7 : Consultation particulière avec le Conseil de l'Industrie Forestière du Québec (1 :57 :55 à 2 :41 :40) : • PL 97 : L'avenir de la foresterie québécoi...
8 : Mon Patreon, si tu as envie de me verser 5$ : https://www.patreon.com/posts/grace-t...
QUESTIONS OU COMMENTAIRES – Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions et les commentaires m'aident à m'améliorer !
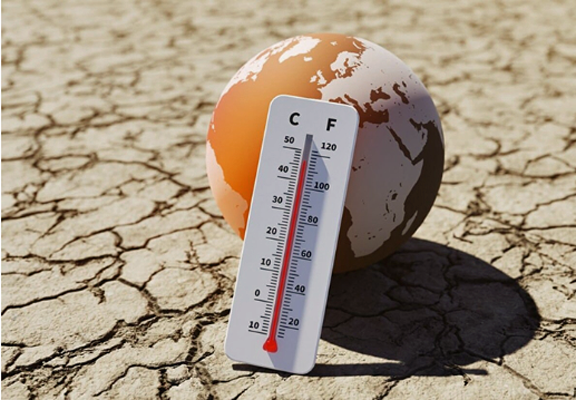
L’écosocialisme est incontournable, bon marché, solidaire, emballant
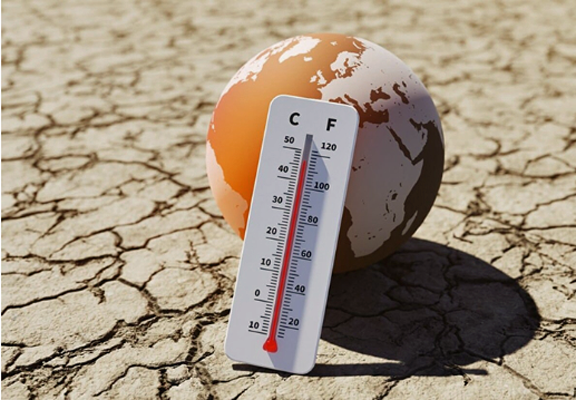
En quelques lignes, dans sa série de deux articles publiés par le site À l'Encontre et repris par ESSF et Presse-toi-à-gauche, Robert Lochhead brosse un tableau percutant de l'état du monde tout en soulignant pourquoi l'essentiel, la crise climatique, est perdue de vue :
Depuis 1990, toute la politique du réchauffement climatique n'a-t-elle donc été qu'un théâtre hypocrite ?
L'objectif de Paris en 2015, c'était de ne pas dépasser en 2100, 1,5ºC-2ºC de plus qu'en 1850. Or aujourd'hui, nous avons déjà atteint 1,5ºC de plus et le monde continue à brûler toujours plus de combustibles fossiles. À ce rythme, nous allons vers 3ºC voire 4ºC de plus en 2100. Soit un monde invivable pour les milliards d'êtres humains les plus vulnérables.
L'ambiance est plombée par l'extermination des Palestiniens à Gaza, la récente guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, et la poursuite de l'offensive russe contre l'Ukraine, et les progrès partout de l'extrême-droite, qui est négationniste du réchauffement climatique.
La faim, la misère, les guerres, l'oppression, l'exploitation avec ses bas salaires et la précarité, ainsi que les distractions des médias, masquent le problème aux yeux des larges masses que les gouvernements ne se préoccupent d'ailleurs pas d'éclairer et alerter.
Tout le bla-bla-bla des COP, de dire Greta Thunberg, depuis plus de trente ans, soit depuis la conférence internationale sur le climat à Rio de Janeiro en 1992, a abouti à ce que « [d]e 1990 à 2021, la part à la production mondiale primaire d'énergie des combustibles fossiles a, certes, baissé de 81,36% à 80,34% grâce au développement des énergies renouvelables. Mais leur quantité absolue a presque doublé… » Côté génération d'électricité, « le solaire et l'éolien [en] représentent aujourd'hui 10%. » Pourquoi ce quasi-boycott de la prise en main climatique ? D'expliquer Robert Lochhead :
Globalement, le coût de remplacement de l'infrastructure fossile et nucléaire existante est d'au moins 15 à 20 trillions [mille milliards] de dollars. […] Les capitalistes des fossiles ne défendent pas seulement leurs profits mais surtout la rentabilité de leurs gigantesques capitaux fixes pas encore amortis et résultant d'investissements réalisés relativement récemment partout dans le monde. Probablement que beaucoup de décideurs du monde se rassurent en pensant que le progrès scientifique va apporter dans dix ou vingt ans des solutions insoupçonnées aujourd'hui qui ne perturberont pas la marche du business et permettront même de faire des bonnes affaires. Et, si possible, faire payer la facture aux salariés-consommateurs, par le jeu des prix protégeant les profits, ce qui ne cesse de discréditer la lutte contre le changement climatique aux yeux des couches les plus pauvres de la population, ce que l'extrême-droite exploite malicieusement.
Le mythe de la gratuité des énergies dites renouvelables ignorant les coûts fixes
À cette explication lapidaire mais en plein dans le mil, l'auteur en ajoute cependant une autre : « …la baisse des prix des énergies renouvelables diminue la rentabilité des capitaux qui s'y placent pour les vendre. Une fois que les panneaux solaires sont vendus et installés, le soleil est gratuit alors que les combustibles fossiles doivent être achetés tous les jours. Seuls les combustibles fossiles offrent des bénéfices à deux chiffres. » Ce point apparaît exact mais il est finalement incorrect. Les énergies solaire et éolienne sont certes plus qu'abondantes, partout et apparemment gratuites mais elles sont aussi diffuses (non concentrées comme celles fossiles) et intermittentes. En découle que par kWh elles requièrent beaucoup plus de matériaux et d'espace que les hydrocarbures y compris pour les fermes de batteries ou autres technologies d'entreposage.
On objectera fort à propos que les énergies solaire et éolienne étant partout, elles n'ont pas besoin de coûteux systèmes de transport (pipelines, chemins de fer, bateaux, ports) en autant que leur production soit décentralisée. Sauf pour le solaire auto-produit, il faut quand même un réseau électrique adaptée au grand nombre de sources de captation et au caractère variable de celle-ci, ce qui n'est pas bon marché. Somme toute, si les énergies solaire et éolienne ont un coût variable nul, leur coût fixe dû aux équipements gargantuesques pour les capter et les stocker est loin de l'être. À bien y penser, les hydrocarbures sont eux aussi gratuits sous forme brute. Ils sont aussi un cadeau de la nature. Leurs coûts résident dans leur extraction, leur raffinage pour le pétrole, et surtout leur transport tandis que les coûts des énergies solaire et éolien résident dans leur captationtransformation, une forme d'extraction, et leur transport.
La rente des fossiles soutenue par les ÉU les avantage malgré un coût supérieur
Dans les deux cas, le prix rentabilise les coûts fixes non seulement en fonction du profit moyen de l'économie globale mais aussi de la rente propre à l'extraction des ressources naturelles. La rente des hydrocarbures est surtout fonction de la difficulté de l'extraction mais aussi de la distance du transport. La rente des productions éolienne et solaire est fonction du degré d'ensoleillement ou de l'intensité-régularité du vent de la localisation des équipements de captation et aussi du transport. La différence entre les deux systèmes est que celui des hydrocarbures est mature. En termes de la loi du développement capitaliste menant à la centralisation-concentration il est sous l'emprise d'oligopoles géants, privés et étatiques, opérant mondialement. Le système des énergies renouvelables est en développement, quoique certaines entreprises émergent. Donc ce dernier reste fortement concurrentiel comme en témoignent les difficultés de l'industrie des panneaux solaires en Chine et même celle éolienne sous attaque trumpienne.
Il en découle que le secteur des hydrocarbures paraît plus rentable que celui solaire-éolien bien que le coût moyen par kWh de l'énergie solaire-éolienne est depuis peu moins élevé en général que celui des hydrocarbures. Ce facteur économique se combine à un facteur politique. Dans l'affrontement des deux superpuissances pour l'hégémonie mondiale, la plus puissante a opté toutes voiles déployées pour les hydrocarbures au point de menacer la rentabilité du secteur éolien par ses annulations de projet. La Chine, quant à elle, a opté pour le solaireéolien au point de mettre en cause la rentabilité du solaire par son généreux soutien à ce secteur.
Attention ici au terme chargé idéologiquement de « renouvelable ». Les réserves de charbon peuvent encore durer plus d'un siècle, et la technologie du fracking a repoussé les réserves pétrolières et gazières prouvées à un demi-siècle dans chaque cas. Cependant, les sites les moins chers pour l'extraction des hydrocarbures ont été épuisés depuis longtemps quoique les dictatures du MoyenOrient, en connivence avec les grandes pétrolières, les égrainent à petit feu pour maximiser leurs rentes. Quant au solaire-éolien, les meilleurs sites abondent encore non seulement ceux les plus ensoleillés ou venteux mais ceux à proximité des réseaux de transport et des importantes clientèles. Ce facteur rentier y est pour beaucoup afin d'expliquer le récent coût inférieur des énergies dites renouvelables.
Les énergies solaire-éolienne amplifient et se superposent aux énergies fossiles
Les énergies renouvelables charrient leur lot de pollution et d'épuisement des ressources y compris pour les émanations de GES et la destruction des habitats. Comme les énergies fossiles, elles ne remettent pas en question la domination du système de transport par le véhicule solo, celui électrique se substituant celui à essence, et de ce fait la domination de l'habitat humain par la « villa unifamiliale » pour employer la juste expression de Robert Lochhead. En résulte dans les deux cas un étalement urbain à la circulation congestionnée dévoreur énergivore de ciment, d'acier et d'asphalte sans compter les espaces naturels et agricoles et emprisonnant le peuple-travailleur dans le piège de la dette hypothécaire et automobile.
La fabrication des véhicules individuels électriques, en particulier des batteries, est aussi très polluante et énergivore et par là émettrice de GES puisque 80% de l'énergie mondiale est encore fossile comme le rappelle fort à propos Robert Lochhead. Même l'exception hydroélectrique québécoise n'y échappe pas totalement puisque les mines nordiques loin du réseau électrique doivent recourir à l'énergie fossile. Non seulement le tout-électrique dit renouvelable ne se détache pas des énergies fossiles mais tant leur recours à davantage de matériaux par kWh produit, l'onéreux objectif de la substitution des fossiles par les dite renouvelables et la complexité technologique des panneaux, éoliennes et batteries exigent une expansion géométrique des mines à ciel ouvert, nécessitées par la très basse densité dans la croûte terrestre de ces minéraux et terres rares, avec leurs ravages connus environnementaux et sociaux. Finalement les énergies dites renouvelables loin de se substituer aux énergies fossiles s'y superposent comme au XXe siècle le pétrole et le gaz n'ont pas remplacé le charbon mais s'y sont ajoutés tout en le laissant croître et de beaucoup.
L'auteur oublie la croissance inhérente au capitalisme vert à soutenir par la gauche !
On touche ici à la croissance inhérente au capitalisme du simple fait de l'accumulation du capital cherchant à se valoriser pour ne pas périr. Mais l'auteur n'aborde pas le débat sur la décroissance car « [i]l n'existe aujourd'hui aucun rapport de forces social pour un écosocialisme même si c'est la solution véritable. Cela n'imposerait rien de moins qu'abolir le capitalisme. » D'office Robert Lochhead accepte donc par défaut l'inévitable paradigme de la croissance. Plutôt « il faut proposer à un mouvement social des objectifs prioritaires, à court et moyen terme, qui soient le ferment d'une lutte à long terme plus globale. Des objectifs qui soient repris par un mouvement social comme un pont entre la situation actuelle et la nécessaire transition ces prochaines années vers des objectifs de transformation à grande échelle plus vastes si le mouvement social se renforce. » Concrètement, il s'agit de « l'idée d'un plan Marshall » soit un capitalisme vert passant de petits projets, qui en ce moment pullulent, à de grands projets qui font une différence.
De dire l'auteur, « [j]e paraphrase le Programme de Transition de Léon Trotsky de 1938 » du moins il s'en inspire. Est-ce que l'actuel capitalisme vert des petits projets peut mener à celui des grands projets comme antichambre de la rupture écosocialiste ? That is the question. L'auteur prend la peine de chiffrer ce saut vers les grands projets :
[Selon Cédric Durand] Dans son dernier rapport sur l'énergie, Bloomberg (New Energy Outlook 2021) estime qu'une économie mondiale en croissance nécessitera un niveau d'investissement dans l'approvisionnement et les infrastructures énergétiques compris entre 92 000 et 173 000 milliards de dollars au cours des trente prochaines années. L'investissement annuel devra plus que doubler, passant d'environ 1700 milliards de dollars par an aujourd'hui à une moyenne comprise entre 3100 et 5800 milliards de dollars par année. »
L'auteur montre que de telles sommes sont déjà disponibles chaque année mais que le grand capital les oriente essentiellement vers le statu quo des hydrocarbures :
De COP en COP, ce sont 1300 milliards $ qui ont été promis aux pays dits en développement pour chaque année dès 2035. Une grande partie seront des prêts, qui vont augmenter leur dette, et le reste devrait être des investissements privés. Cela reste vague. [16] Ce sont des promesses. Pour le moment, même les 100 milliards par année promis pour le Fonds vert pour le Climat, destiné à être géré par la Banque mondiale, n'ont pas été versés par les pays riches. Entretemps, durant l'année 2021-2022, les compagnies pétrolières et gazières ont fait 4000 milliards $ de bénéfices.
Comment y arriver ?
Il faudrait exiger des conférences internationales des pays disposés à agir efficacement et qui constituent une masse suffisante pour avoir un effet notable sur la planète, ce qui est appelé diplomatiquement « union of the willing. » Par exemple, l'Union européenne plus le Canada, l'Australie et la Nouvelle Zélande, soit des pays où une pression populaire, une force démocratique, peut s'exercer sur les gouvernements. Plus la Chine, si elle réalise ses promesses de mesures efficaces contre le réchauffement climatique.
Robert Lochhead propose une poussée mobilisatrice au sein des pays du vieil impérialisme qui jusqu'ici reste fidèle à l'application des normes de la démocratie parlementaire, même virant à droite toute, sur fond d'une économie néolibérale se durcissant. Faute, selon ces critères, de pouvoir inclure les ÉU trumpiens et ainsi pouvoir prétendre à une masse critique, il inclut la Chine, à la fois championne des énergies fossiles et renouvelables, se situant cependant aux antipodes de toute démocratie quelle qu'elle soit. Probablement que l'auteur s'en remet à la logique de la compétition entre les deux superpuissances eu égard aux formes d'énergie.
Une transition à la Trotski consolidant le capitalisme vert contre l'écosocialisme !
Est-ce là une logique de transition à la Trotski créant les « conditions gagnantes » d'une rupture écosocialiste ? Qui dit rupture écosocialiste dit décroissance matérielle et croissance des services aux personnes, à commencer par ceux publics tendant à la gratuité parce que financés par la socialisation de la Finance et par la fiscalité progressive. Il y a les services publics existants à approfondir pour annuler les coupes qui les ont charcutés au point de leur faire mauvaise réputation, et ceux à élargir pour répondre à des besoins essentiels tels les transports, le logement social, l'énergie et l'alimentation de base, l'accès aux lacs et rivières… Il s'agit aussi d'un enjeu qualitatif et non seulement quantitatif. Le principe de décroissance matérielle commande de substituer le transport actif et en commun au véhicule privé, le logement collectif entouré de services de proximité, de jardins communautaires et parcs accessibles à pied à la place de la villa unifamiliale dans des banlieues motorisées, des aliments végétariens et frais remplaçant viandes et aliments ultratransformés, des vêtements originaux qui durent remplaçant ceux prêts-à-porter-prêts-à-jeter, des produit électroménagers et électroniques durables et réparables.
Rien à voir donc avec la société de consommation de masse qui répond de travers
ou pas du tout aux besoins essentiels parce qu'elle est le corollaire de l'accumulation capitaliste. L'écosocialisme, au contraire, récuse la logique capitaliste de la compétition de toustes contre toustes visant l'accumulation matérielle illimitée et aboutissant au militarisme pour lui substituer une société du soin et du lien axé sur le développement des personnes et sur leur solidarité pour ne laisser personne derrière. Une société écosocialiste ne vise donc pas à produire pour produire mais à produire pour reproduire une société de plus en plus riche socialement que ce soit dans le domaine des sciences, des arts, de l'organisation solidaire. Il n'est pas étonnant que l'écosocialisme converge avec l'écoféminisme axé aussi sur le soin et le lien pour la reproduction sociale et sur le buen vivir autochtone axé sur la reproduction de la terre-mère étant entendu que l'un est nécessaire à l'autre et vice-versa.
Le passage des « petits projets » aux « grands projets » prépare-t-il la rupture écosocialiste ? Ce passage s'accomplissant dans le cadre du capitalisme, il déboucherait sur de grandes réformes propres au croissanciste capitalisme vert. L'image qui vient en tête est l'actuel modèle chinois étendu au moins aux grands pays riches sauf aux ÉU nous dit l'auteur. On peut imaginer au mieux une course entre énergies dites renouvelables et celles fossiles que gagneraient à terme, mais quand, les premières. Mais comme les lourds investissements massifs dans les équipements pour les énergies renouvelables, en croissance continuelle, nécessitent le recours aux énergies fossiles pour un bon bout de temps, les énergies fossiles continueront de croître même si elles deviendront relativement moins importantes que celles renouvelables.
« Grands projets » vers le « basculement catastrophique de la civilisation humaine »
La vitesse de croisière de ce réformisme vert n'est pas suffisante pour respecter les plafonds prudents de hausse de la température fixés par le GIEC avant que se déclenchent les rétroactions dues aux points de bascule (fonte des glaciers, permafrost…) qui provoqueront « un basculement catastrophique de la civilisation humaine » comme l'auteur le dit et le montre. Il faudra donc, en parallèle, pour reprendre des parties de sous-titres de l'auteur, « [c]apturer le CO2… », utiliser des « technologies à émissions négatives » comme « la BECCS, bioénergie avec capture et séquestration du carbone » et « [r]efroidir l'atmosphère… » c'est-à-dire des technologies d'apprentis-sorciers extrêmement coûteuses et non technologiquement abouties. Toutefois, l'auteur pense que ces « grands projets » pourront s'en dispenser car il oublie l'impératif de la croissance. Les conséquences en seront autant de lucratives occasions d'investissement par le grand capital. Mais comme ces gargantuesques projets ne participent pas à la reproduction de la société, en particulier à celle de la force de travail, sauf en creux, ils exigeront un soutien étatique massif lequel imposera, impose déjà, une austérité permanente.
On peut gager que s'enfoncer dans cette voie provoquera d'immenses clash de luttes sociales ce qui contraindra le capitalisme néolibéral à se muer en régime néofasciste… lequel pourrait se muer en écofascisme par nécessité de survie de l'humanité pour que le capitalisme survive.
On constate que l'on se situe aux antipodes de l'antichambre de l'écosocialisme. Le passage des « petits projets » aux « grands projets » n'a rien à voir avec un programme de transition trotskyste mais tout à voir avec un cul-de-sac réformiste. Cyniquement, on pourrait invoquer la politique du pire en se disant que le cul-desac du capitalisme vert poussé à bout pourrait tout autant provoquer une révolution écosocialiste que l'écofascisme. C'est oublier que la politique du pire mène au pire car elle repose sur une fausse solution, le capitalisme vert, trompeuse, démoralisante et démobilisante. Est-ce à dire qu'étant donné le rapport de forces, l'écosocialisme est inatteignable comme le dit l'auteur ? D'autant plus que l'alliance avec le capitalisme « progressiste » afin de faire débloquer la lutte pour le capitalisme vert contre les tenants du capitalisme fossile est une illusion étant donné que le croissancisme capitaliste ne mène pas au remplacement de celui des hydrocarbures mais à leur imbrication l'un dans l'autre ce qui mène aux gargantuesques et ubuesques « technologies à émissions négatives ». L'erreur de fond de Robert Lochhead est, en ignorant le croissancisme inhérent au capitalisme, d'avoir pensé que les « grands projets » permettraient de substituer les énergies dites renouvelables à celles fossiles.
L'écosocialisme s'impose de soi et s'éclaircira par la lutte pour les réformes
N'en reste pas moins, objecterait l'auteur, que se pose le réalisme de la lutte écosocialiste. Le premier atout de l'écosocialisme c'est sa nécessité une fois levé l'obstacle de la pseudo-solution du capitalisme vert. Comme le synthétise l'auteur, cité au début de ce texte, le monde capitaliste est en train de sombrer dans l'enfer de la terre-étuve. Aveuglé par le soutien du génocide du peuple palestinien, ce monde renie l'abc des droits humains au prix de sa militarisation. Obnubilé par l'attraction des milliardaires se détachant de la réalité quotidienne, ce monde abandonne à sa misère et à ses inégalités le peuple-travailleur dont il stimule la haine de soi en le divisant contre lui-même par l'instrumentalisation de ses superficielles différences de sexe, de genre, de race et d'ethnies. Le deuxième atout en est la faisabilité technologique et financière par rapport au capitalisme vert. L'écosocialisme est technologiquement mature même s'il pourrait bénéficier d'inventivité technologique à sa mesure — science et technologie ne sont pas neutres — par exemple pour la bio-agriculture. Il est relativement bon marché : par exemple du logement social écoénergétique pour tout le monde dans un habitat débarrassé de l'auto solo par rapport à des banlieues tentaculaires de villas unifamiliales. Si l'expropriation du capital financier, la tête pensante du capitalisme, est indispensable, c'est davantage pour parer aux folies des grands projets inutiles à la rentabilité forcée que pour financer les projets écosocialistes.
Last but not least, l'écosocialisme est une société de bonheur maximisant temps libre et solidarité : le travail socialement nécessaire est avant tout axé sur le soin et le lien écoféministe pendant que l'effondrement de la production matérielle de masse dégage pour soi et pour les autres ce précieux temps hors travail obligatoire. C'est à se demander pourquoi la lutte pour l'écosocialisme ne soulève pas l'enthousiasme. Cette faille montre à quel point l'échec du socialisme du XXe siècle, en fait sa terrible déformation, a troublé les esprits au point de rendre la fin du monde plus plausible que la fin du capitalisme. Pour s'encourager, la lutte pour des réformes spécifiques retrouve toute sa place, par exemple « [r]emplacer tout le chauffage des bâtiments au mazout et au gaz naturel par du chauffage électrique [tout en les éco-énergisant], par une campagne volontariste sur 10 ans […] électrifier rapidement camions et bus qui sont relativement moins nombreux et appartiennent pour la plupart à des entreprises importantes qui en ont les moyens [et non subventionner l'achat de véhicules électriques perpétuant le capitalisme vert], annuler la dette des pays sub-sahariens.
C'est dans la lutte pour ce genre de réformes, même si elles sont loin de s'attaquer aux contradictions du capitalisme vert, que le peuple-travailleur pourra reconstruire son unité combative et retrouver son élan révolutionnaire d'il y a un siècle tout en approfondissant chemin faisant sa compréhension des tromperies du capitalisme vert. Et cette lutte est une authentique lutte de classe comme le montre le tableau d'Oxfam reproduit par l'auteur : la consommation des 10% les plus riches est responsable 50% de l'effet de serre contre 10% pour le 50% le plus pauvre. Reste ce milieu ambivalent (40% responsable de 40%), majoritaire dans les pays du vieil impérialisme, qui doive se brancher. Secouons nos puces, camardes.
Marc Bonhomme, 7 septembre 2025
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca

La lutte du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, un enjeu pour tout le mouvement ouvrier

Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes fait face à un vent contraire venant de deux sources qui se combinent. Le refus de négocier de Poste Canada qui s'en tient qu'aux reculs et l'offensive antisyndicale du gouvernement Carney et ses comparses du monde patronal.
Les employéEs du Port de Montréal et de Colombie Britannique avaient été obligés de retourner au travail en novembre 2024 ainsi que les employéEs ferroviaires en août en envoyant les parties en arbitrage exécutoire forçant les employés à retourner au travail.
La même situation s'était reproduite avec les employéEs de Postes Canada en décembre mais cette-vois-ci le ministre n'a pas imposé l'arbitrage, mais a créé une commission d'enquête sur les relations de travail, qui devait remettre son rapport le 22 mai 2025. Dirigée par William Kaplan, médiateur et arbitre ce dernier a émis ses recommandations le 15 mai.
Selon le syndicat, ce rapport penche fortement en faveur des positions et des recommandations de Postes Canada. "Nous sommes fondamentalement en désaccord avec la majeure partie de ses recommandations et contestons certains des renseignements sur lesquels elles sont fondées. Nous nous sommes également opposés au processus de la Commission dans son ensemble, mais nous étions d'avis que nous nous devions d'y participer afin de donner une voix aux travailleurs et travailleuses des postes". Le rapport présente également trois situations possibles après le 22 mai. Il est important de noter que les recommandations du commissaire Kaplan ne seront pas nécessairement mises en œuvre ; il revient à la ministre Patty Hadju de décider si elle donnera suite au rapport ou non.
À la fin mai, le STTP avait demandé un arbitrage exécutoire afin de mettre fin au refus de négocier de Poste Canada. Ce dernier avait rejeté cavalièrement cette proposition, affirmant vouloir rétablir la stabilité du système postal et soutenait que l'arbitrage serait long. [1]
Le 30 mai, Postes Canada demandait à la nouvelle ministre de l'Emploi et de la Famille, Patty Hajdu, d'obliger les membres STTP à voter directement sur l'offre "finale" de la société d'État. En vertu de l'article 108.1 du Code canadien du travail (CCT), le ministre a le pouvoir de court-circuiter les représentants syndicaux et d'obliger les membres à voter directement sur l'offre de l'employeur. Si une majorité simple des travailleurs et travailleuses votaient en faveur de l'offre de Postes Canada, une nouvelle convention collective aurait été imposée, mettant fin à la capacité du syndicat de négocier. [2]. C'est une première en termes d'offensive antisyndicale.
Postes Canada a mis toutes les énergies pour mettre le syndicat de côté
Selon les dirigeants syndicaux Renaud Viel et Yanick Scott respectivement président de la section locale de Montréal et directeur national, la direction de Postes Canada a mis toutes les énergies possibles afin de convaincre les membres de voter en faveur. Ils ont multiplié les courriels et les contacts directs aux employéEs utilisant même les modules téléphoniques internes des facteurs et factrices pour leur texter des messages les incitant à voter en faveur. Le syndicat a fait campagne contre et a rencontré le plus de membres possible, mais n'avait certainement pas les mêmes ressources que la direction de Postes Canada.
De tout temps c'est le syndicat qui réunit les membres dans des assemblées où il explique les enjeux avant de procéder à un vote pour l'acceptation ou non de la convention collective négociée.
Malgré ce vote imposé, 70% des membres ont refusé la proposition patronale. Au total 80% des membres ont voté, soit environ 40 000 membres. Cela a confirmé la détermination des membres du syndicat à poursuivre la lutte.
Le STTP a remis des offres le 20 août, les rencontres ont été reportées par la direction de Poste Canada et aucune rencontre n'est prévue à ce jour. Pendant ce temps, Postes Canada coupe les postes vacants, ce qui correspond à environ 10% des effectifs. Cela provoque des réaffectations et des mouvements de personnel.
Les conditions de travail découragent beaucoup d'employéEs qui quittent, il y a donc un gros taux de roulement et plus de nouveaux et nouvelles employéEs, qui se retrouvent toujours à l'échelon de salaire le plus bas. Le syndicat revendique donc une réduction des 7 échelons de salaire qui existent depuis la convention collective de 2013.
Les perspectives de la direction de Poste Canada demeurent en majorité dans ce qui est en baisse et dans certains cas disparaitre, il n'y a pas d'emphase sur les colis. Elle veut plus de Temps Partiel, flexibles, de fin de semaine. En fait Poste Canada veut des TP partout et considère ces items non négociables. Pour ces raisons, le STTP a demandé l'arbitrage.
La mauvaise gestion de Postes Canada explique ses difficultés financières
Postes Canada impute ses difficultés financières principalement à la grève du STTP en 2024, la baisse des volumes de la poste-lettres et augmentation de remise et la baisse des volumes de colis, et des recettes qui en découlent, en raison de la concurrence.
Selon la présidente nationale du STTP Jan Simpson, la situation financière de Postes Canada découle des décisions de sa haute direction. La société d'État dépense sans compter, ses dépenses autres qu'en main-d'œuvre grimpent en flèche. Ses états financiers indiquent que, de 2017 à 2023, ses dépenses non salariales ont augmenté de plus d'un milliard $ par année, soit une hausse de 56,5 %. Au cours de la même période, les salaires n'ont augmenté que de 14,1 %. Par ailleurs, de mai 2023 jusqu'à au moins mai 2025, Postes Canada est exemptée de cotisations au régime de retraite. Ce ne sont pas les salaires et les avantages sociaux qui sont en cause, mais bien la mauvaise gestion et les dépenses excessives de Postes Canada. La véritable question à se poser est la suivante : où va tout l'argent que dépense Postes Canada ?
À l'origine, le plan quinquennal de Postes Canada allouait quatre milliards $ pour la mise à niveau des infrastructures afin de répondre à l'explosion du nombre de colis durant la pandémie. Or, lorsque la croissance du nombre de colis a fléchi, Postes Canada a continué de dépenser.
En somme, quatre milliards $ dépensés en cinq ans équivaut à 800 millions $ par année, d'où la perte financière de 748 millions $ pour l'exercice 2023. [3]
Contrer l'offensive anti ouvrière
Poste Canada manipule l'opinion publique et prend prétexte de la pression à la baisse qu'impose le secteur privé sur les conditions de travail des travailleurs et travailleuses du secteur public. La majorité des compagnies privées de livraison de colis donnent la livraison en sous-traitance, soustrayant ainsi les travailleurs et travailleuses aux règles du code du travail et à des conditions de travail décentes. Ce qui donne prétexte à Poste Canada de faire pression sur ses employéEs pour abaisser les salaires et les conditions de travail.
La législation concernant la livraison de colis doit être modifiée pour devenir similaire à celle de la Poste-lettre, afin d'offrir un service universel. Cela ouvrirait la porte à l'obtention de conditions de travail équitables pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Les compagnies privées y trouveraient ainsi moins d'intérêt, ce qui permettrait au service postal public de reprendre ce marché.
Cette situation renforcerait le mouvement syndical et permettrait d'élargir la portée de conditions de travail décentes et mieux rémunérées à une plus grande partie de la population. On comprend que le gouvernement canadien a un tout autre agenda, Carney nous l'a bien démontré.
Le PDG du Business Council, Goldy Hyder, a obtenu une rencontre en face à face avec le premier ministre Mark Carney quelques jours à peine après son élection. Par l'intermédiaire du Business Council, le Canada des grandes entreprises a formulé son cahier de doléances sans détour : accélérer l'extraction des ressources, réduire les impôts pour les géants du numérique et les riches, démanteler les services publics et injecter des fonds massifs dans l'industrie de l'armement. [4]
Le STTP est à l'avant-garde de la lutte ouvrière dans l'état canadien, Carney et les grandes entreprises l'ont bien compris. À nous maintenant de construire la solidarité, la lutte du STTP c'est la lutte de tout le mouvement ouvrier !
André Frappier
[1] Postes Canada rejette la demande d'arbitrage exécutoire du syndicat Radio-Canada.https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2169117/postes-canada-rejet-proposition-syndicat-arbitrage-executoire#:~:text=Postes%20Canada%20affirme%20que%20ses,les%20n%C3%A9gociations%20avec%20le%20syndicat.&text=Postes%20Canada%20a%20rejet%C3%A9%20la,travail%20%C3%A0%20un%20arbitrage%20ex%C3%A9cutoire.
[2] The Maple https://canadiandimension.com/articles/view/under-mark-carney-capitals-leading-lobby-group-is-back-in-the-drivers-seat
[3] Communiqué STTP 16 Août 2024 2023-2027/123 No. 23
[4] Sous Mark Carney, le principal groupe de pression du capital reprend le volant DE : Nicolas Barry-Shaw. https://canadiandimension.com/articles/view/under-mark-carney-capitals-leading-lobby-group-is-back-in-the-drivers-seat
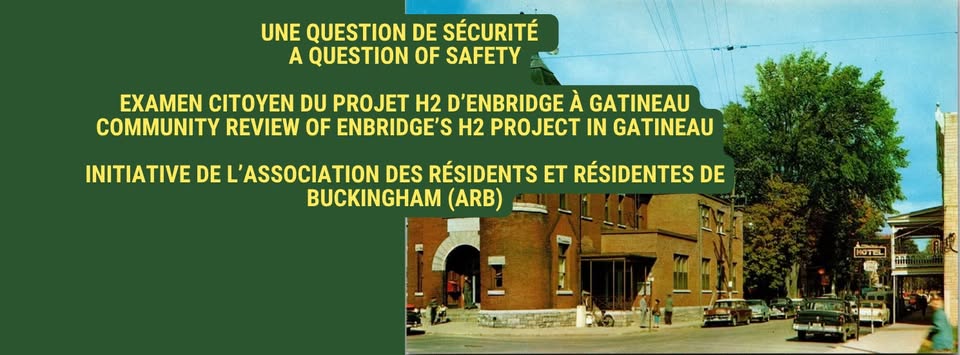
L’Association des résidents et résidentes de Buckingham rencontre les représentants d’Enbridge et dénonce les incohérences du tracé retenu pour le projet de conduite d’hydrogène
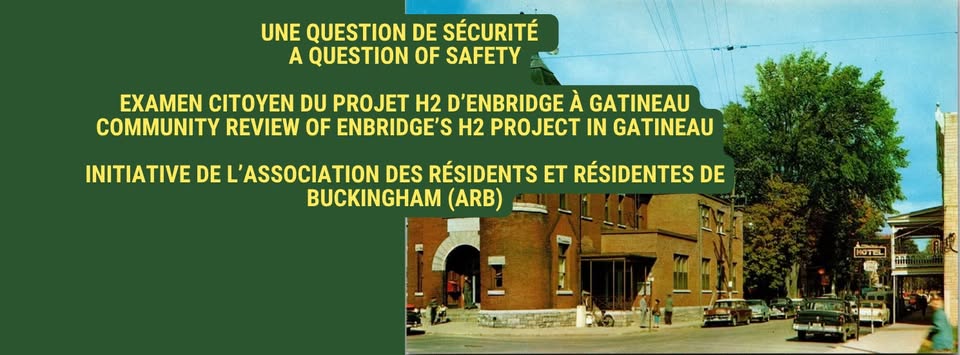
Gatineau, le 8 septembre 2025 – L'Association des résidents et résidentes de Buckingham (ARB) a rencontré, vendredi le 5 septembre, les représentants d'Enbridge afin de discuter du projet de conduite à 100 % d'hydrogène dont le tracé retenu traverse les secteurs résidentiels de Buckingham et Masson-Angers. Edmond Leclerc, conseiller municipal du secteur Buckingham était présent à la rencontre à titre d'observateur. Malgré l'invitation envoyée au Service de la
sécurité publique de Gatineau, aucun représentant ne s'est présenté.
La conduite à haute pression serait enfouie dans les rues résidentielles, longeant notamment une école, des services de garde, des résidences pour aînés ainsi que trois zones à risque de glissements de terrain. Malgré les assurances de l'entreprise, l'ARB a mis en lumière plusieurs incohérences dans la façon dont Enbridge présente son projet :
• Sécurité mise au second plan : Enbridge a reconnu que la zone d'impact d'un incident pourrait s'étendre sur « quelques dizaines de mètres », ce qui comprend des maisons et bâtiments publics longeant le tracé. Malgré cela, l'entreprise semble avoir retenu la solution la plus opportune pour l'entreprise : utiliser les emprises municipales existantes le long de la rue Georges et de la 148, sans étude transparente des corridors alternatifs plus sûrs comme les lignes d'Hydro-Québec ou l'autoroute 50. Il nous semble que ce choix s'explique par la pression d'avancer rapidement ce projet stratégique pour l'industrie face à l'utilisation prometteuse de l'hydrogène. Mais derrière cette justification, un fait demeure : la sécurité des citoyens n'a pas été le premier critère.
• Normes minimales seulement : Enbridge promet de respecter les normes en vigueur, dont la CSA Z662, qui renvoie à la sécurité des réseaux de canalisations de pétrole et de gaz. Ces normes servent d'exigences minimales, et non de meilleures pratiques. Pour un premier projet de ce type au monde, se limiter au strict minimum n'est pas acceptable.
• Tracés alternatifs peu ou pas étudiés : Les corridors d'Hydro-Québec et l'autoroute 50 n'ont jamais été sérieusement étudiés par Enbridge suite aux demandes d'accès à l'information effectuées par l'ARB auprès d'Hydro-Québec.
• Enbridge affirme que son projet n'est pas assujetti à l'article 31.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement. En effet, le tracé a été calibré à 3 999 kPa, soit juste en dessous du seuil de 4 000 kPa qui déclenche automatiquement un examen du BAPE. Toutefois, l'article 31.1.1 de la même loi accorde au ministre de l'Environnement un pouvoir
discrétionnaire par lequel le projet peut être soumis à une évaluation complète si le ministre juge qu'il présente des risques majeurs ou soulève une forte inquiétude citoyenne.
L'ARB demande :
• Qu'un examen complet par le BAPE soit effectué sans délai ;
• Que le projet soit reconnu et traité comme une conduite de transmission, avec toutes les normes de sécurités qui s'y appliquent ;
• Qu'Enbridge étudie et privilégie un tracé plus sécuritaire, éloigné des secteurs résidentiels.
Le 16 septembre prochain, la séance du conseil de ville se tiendra à Buckingham, à laquelle le conseil municipal se prononcera sur l'avis de proposition d'une résolution pour que la Ville de Gatineau demande officiellement au gouvernement du Québec d'assujettir le projet d'hydrogénoduc d'Enbridge à une évaluation environnementale complète incluant la tenue d'audiences publiques par le BAPE.
« Nous sommes pour une transition énergétique acceptable et sécuritaire. Si Enbridge veut faire du Québec un pionnier en transport d'hydrogène, cela doit se faire avec transparence et selon des normes dignes d'un premier projet de ce type, et non en banalisant les risques et les particularités de l'hydrogène. Le vrai choix sécuritaire, c'est d'éviter d'enfouir la conduite dans les rues au cœur de nos quartiers » - Nicole Robitaille-Carrière, présidente de l'ARB
À propos de l'ARB
L'Association des résidents et résidentes de Buckingham est un organisme à but non lucratif et un regroupement citoyen indépendant voué à informer les résidents face aux projets et enjeux locaux. Elle agit pour protéger la santé, la sécurité et la qualité de vie de la communauté.
Suivez-nous sur Facebook :
ARB - Association des résidents et résidentes de Buckingham
Une question de sécurité / A Safety Review - Projet H2 à Gatineau.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La libération de la Palestine : un combat anticolonial et antifasciste

Dans ce nouvel épisode de son podcast « Minuit dans le siècle » (produit pour Spectre et disponible sur toutes les plateformes d'écoute), Ugo Palheta reçoit Omar Alsoumi, militant franco-palestinien et l'un des principaux animateurs de l'organisation Urgence Palestine. Centrale dans l'organisation des mobilisations en solidarité avec Gaza et la Palestine au cours des deux dernières années, Urgence Palestine est menacée de dissolution par le gouvernement actuel.
6 septembre 2025 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/liberation-palestine-combat-anticolonial-antifasciste-alsoumi-podcast/
Omar Alsoumi évoque son parcours et revient sur la trajectoire des mouvements de solidarité avec la Palestine au cours des vingt-cinq dernières années en France, revenant sur l'importance de faire place aux récits palestiniens, de Palestiniens qui résistent et combattent, loin de l'image paternaliste de « victimes parfaites » (Mohammed El-Kurd).
Il souligne ce que représente le combat pour la libération de la Palestine pour des millions de personnes à l'échelle globale, en particulier dans un pays comme la France marquée à la fois par la vigueur du racisme colonial (islamophobie) et par une forte immigration postcoloniale, la portée à la fois singulière et universelle de ce combat, sa dimension matérielle, géostratégique, mais aussi spirituelle. Nous discutons enfin du lien indissociable entre fascisme et colonialisme, mais aussi des menaces auxquelles fait face Urgence Palestine dans un contexte de fascisation de l'ordre capitaliste-néolibéral, particulièrement marqué en France.
Enregistrement le 17 juin 2025. Mixage : Aurélien Thome.
Crédit photo : Photothèque Rouge /Martin Noda / Hans Lucas

Uni.es contre le projet de loi C2 (Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière)

Le 3 juin dernier, le gouvernement déposait le projet de loi C-2, le « Stronger Border Act ». Une loi omnibus qui s'attaque de front aux droits fondamentaux : restriction de l'asile, extension de la surveillance et du partage de données, modification d'une dizaine de lois (immigration, sécurité publique, criminalité, douanes, renseignement, communications, finances, surveillance côtière).
En collaboration avec le Front "Uni.es contre le projet de loi C2", nous avons produit cette capsule qui explique concrètement ce que contiennent ces mesures, leurs impacts sur les personnes migrantes et demandeuses d'asile, et pourquoi il est urgent de se mobiliser pour exiger le retrait de C-2.
Avec la participation de Laurence Guénette (Ligue des Droits et Libertés), Sylvie St-Amand (Fédération des femmes du Québec), Amel Zaazaa (L'Observatoire pour la justice migrante), Harrold Babon (Clinique pour la justice migrante), Marisa Berry Mendes (Amnistie internationale Canada Francophone), Melissa Claisse (Collectif Bienvenue - Welcome Collective) et François Loza Rodriguez (TCRI).
À voir et à partager largement.
Cette vidéo a été produite par l'Observatoire pour la justice migrante.
Le 3 juin dernier, le gouvernement déposait le projet de loi C-2, le « Stronger Border Act ». Une loi omnibus qui s'attaque de fronts aux droits …
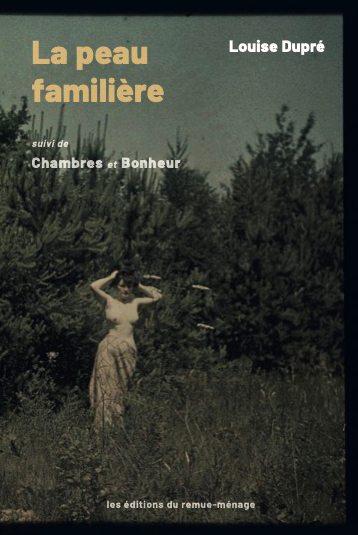
La peau familière
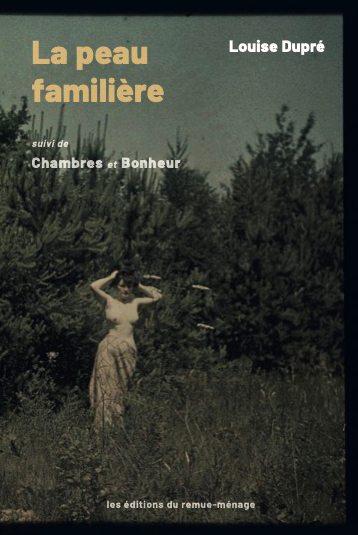
Parution le 5 août 2025 au Québec
Parution le 5 septembre 2025 en Europe
Louise Dupré est une grande poète, romancière et dramaturge québécoise, une voix incontournable de la littérature féministe. Ses premiers recueils de poésie en prose, publiés au Remue-ménage dans les années 1980 et pour la plupart épuisés, sont ici réunis en un seul volume.
« une rumeur de fin, prématurée, violente, comme dans un mauvais film, et les yeux de ma fille collés à la télévision, une rumeur de mort, je la vois, réellement, et les yeux de ma mère qui s'achèvent sur le drame. je griffonne malgré tout ma passion, cela fait sens, cette douloureuse évidence, cela tient d'une éthique peut-être, quelque chose comme
NE PAS ACCEPTER D'ALLER À SA PERTE. »
Si La peau familière aborde la vie de tous les jours – et souvent ses horreurs –, de la guerre au quotidien de la ménagère, Chambres se consacre à ce lieu du féminin par excellence, non sans rappeler la « chambre à soi », qui est aussi un lieu d'enfermement. Dans Bonheur, plus rien n'échappe au souvenir.
Ces trois premiers recueils de Louise Dupré sont constitués de suites poétiques en prose, composés d'une trame narrative, de fragments de mêmes scènes, telle une série de photographies. Les mots s'y font dialogue intime, flux de conscience. La poésie sensorielle trace le parcours de voix, de bruits, de lieux, de vies.
En ressortent les thématiques de l'ensemble de l'œuvre de Dupré : le corps, les injustices, l'absence, la mort. Et, bien sûr, les femmes.
Poète, romancière, dramaturge et essayiste, LOUISE DUPRÉ a publié une trentaine de titres, qui lui ont valu de nombreux prix et distinctions. Elle collabore régulièrement avec des artistes de différentes disciplines. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec, de l'Ordre du Canada et du Parlement des écrivaines francophones.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Devenir Lean - Quand la gestion transforme la santé | Livre à paraître le 20 août | Société de performance, système de santé, bilan

Soigner des patients comme on fabrique des voitures ? Il y a 14 ans, on nous disait que la méthode de gestion Lean (ou Toyota) allait résoudre les problèmes du système de santé. Quel bilan tirer de cette expérience ? Alors que le ministre Dubé vante sa réforme (qui emprunte au Lean sans le revendiquer) et demande aux médecins d'être plus « performants », allons-nous rejouer dans le même film ? Bienvenue dans la société de performance !
L'essai Devenir Lean - Quand la gestion transforme la santé, de l'anthropologue Dani Tardif, paraîtra en librairie le 20 août prochain.
À propos du livre
En 2011, le système de santé du Québec a été chamboulé par l'instauration d'un plan national visant à le réorganiser selon la philosophie du Lean Management, une méthode de gestion inspirée par Toyota. « Le Lean est la solution aux problèmes de performance dans le réseau de la santé », affirmait l'ex-ministre de la Santé du Québec, Yves Bolduc. Selon lui, ce changement allait permettre de gagner 30 % de productivité et d'efficience en diminuant la bureaucratie et en éliminant les tâches et délais inutiles. Quatorze ans plus tard, où en sommes-nous ?
À l'heure où le ministre Dubé vante sa nouvelle réforme (qui emprunte au Lean sans le revendiquer officiellement) et demande aux médecins d'être plus performants, Dani Tardif nous propose un tout autre récit de la transformation culturelle ayant eu lieu dans certains établissements du réseau de la santé. Se butant aux limites de la condition humaine, le Lean Management, cet ethos de l'amélioration continue, a entraîné des conséquences individuelles et collectives tragiques, sans atteindre ses objectifs.
Au-delà de l'étude de cas, l'anthropologue démontre également que cette méthode de gestion a participé à créer une nouvelle culture dont l'intention n'est plus seulement d'appliquer le Lean dans la sphère du travail, mais de devenir Lean au quotidien. En effet, si le modèle capitaliste nous demande de toujours faire plus en réinvestissant le capital dans une quête perpétuelle de plus-value, le Lean nous demande de toujours faire mieux : « Je m'inquiète lorsque le Kaizen et l'amélioration continue se transforment en philosophie de vie. Quelle détresse infinie lorsqu'on se rend compte qu'il est impossible que notre "moi" devienne toujours de plus en plus performant ! » Elle révèle ainsi un des rouages de la proverbiale société de performance.
Disséminée par ses disciples depuis des années, l'utopie managériale du Lean est dorénavant invisible parce qu'implantée un peu partout dans les secteurs public et privé. Produisant une transformation culturelle qui déborde du monde du travail, elle participe à la managérialisation de la société. Et vous, êtes-vous devenus Lean ?
À propos de l'auteurice
Détentrice d'une maîtrise en anthropologie sociale et culturelle de l'Université Concordia et d'un certificat en création littéraire de l'Université du Québec à Montréal, Dani Tardif est un·e artiste multidisciplinaire queer et non binaire.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Quand ton corps devient le seul moyen de protestation
Kaveh Boveiri
La personne dans la photo s'appelle Stéphane Chalmeau.
Il était candidat au doctorat et chargé de cours.
« J'ai arrêté mon doctorat, parce que je voulais quitter l'académie ». Il quitte ainsi une vie financièrement prometteuse et choisit une autre piste.
Depuis le 8 août, il met sa possession la plus précieuse comme le seul moyen efficace de la protestation contre le génocide actuel à Gaza. « Deux premiers jours, j'ai été en grève de la faim et de la soif. Dès aujourd'hui, je suis en grève de la faim ». Il reste pendant cette période en face de La Place des Fleurs-de-Macadam sur la rue Mont-Royal.
Je lui demande sa permission pour que nous prenions une photo. « Avec plaisir ! », il nous dit modestement. « Tu viens me joindre dans la photo ? » il me demande amicalement. « Non ! Cette détermination unique, c'est tout le tien », je lui réponds.
En faisant du vélo quelques minutes plus tard, je m'entends dire à mon amie photographe : « Si je n'avais pas de reflux… ». Je me trouve hyper-égoïste, en essayant de trouver une justification pour être inactif.
Pour certains camarades d'entre nous qui cherchent un cas exemplaire de la solidarité absolue, le cas de Stéphane est une illustration impeccable. Sa décision est d'arrêter sa grève après 4 jours. Le moment où tu lis ce texte, il a fort probablement arrêté sa grève — pas son message.
P.S. Stéphane arrête sa grève de la faim le lundi 11 août à 21 h 10. Il y a sur une petite boite renversée, qui joue le rôle de sa table, deux boites de bluets et une boite de pêches. Dans sa main, il a un melon d'eau. Il le regarde comme s'il est une nourriture céleste, le coupe soigneusement et invite sept personnes autour de lui à manger avec lui.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le sanglot de l’homme blanc
C'est la formule qui me vient à l'esprit lorsque je réfléchis sur le refus de la Ville de Québec de permettre l'étude d'ossements découverts sur la rue Saint-Anselme dans le quartier Saint-Roch et qui remonteraient à la bataille des Hauteurs d'Abraham. Ces ossements contiendraient des restes de guerriers hurons, alliés des Franco-Canadiens contre les Britanniques. Cette expression vient de Pascal Bruckner dont l'essai portant ce titre a été publié en 1983. Pour résumer sommairement le contenu du livre, l'auteur y pointe la culpabilité et la haine de soi qui inhiberaient depuis un bon bout de temps beaucoup d'Occidentaux par rapport aux sociétés de ce qu'on appelle le Tiers-Monde. Je ne l'ai pas lu, mais des résumés. Il me semble s'appliquer fort bien au cas du veto opposé par l'administration municipale de la Vieille Capitale à l'étude scientifique de ces ossements dont la provenance est assez incertaine. Il fait suite à l'opposition du chef des Hurons de la réserve de Wendake Pierre Picard, située dans la banlieue nord de Québec à tout examen scientifique de ces restes au nom du respect des croyances indiennes, perçu comme une intrusion susceptible de troubler l'esprit des ancêtres.
Depuis déjà plusieurs années, une tendance se confirme en archéologie, préhistoire et paléontologie : dans les cas de découverte d'ossements anciens, qu'ils soient trouvés sur le territoire d'une collectivité autochtone ou même loin de celui-ci, devant les réticences « d'intégristes » appartenant à cette collectivité qui tiennent à éviter toute étude scientifique de ces restes au nom du respect de leurs croyances, les autorités « blanches » ont tendance à céder, donc à renoncer à une approche rationnelle et historique en matière de recherche archéologique.
Pourtant, l'identité des restes de la rue Saint-Anselme est incertaine. On présume qu'ils proviennent de participants autochtones et « blancs » à la bataille de 1759. Si la Ville ne revient pas sur sa décision (sans doute adoptée pour éviter l'accusation de racisme à l'endroit des Hurons), elle demeurera mystérieuse. La science y perdra beaucoup. Les croyances traditionnelles huronnes sont tout à fait légitimes et respectables, mais doit-on pour autant renoncer à l'étude des squelettes afin de ne pas heurter les convictions religieuses d'un groupe de citoyens et de citoyennes, ou du moins d'une partie d'entre eux ?
On doit rappeler que les Hurons de Wendake ne peuvent prétendre au droit de premiers occupants de l'endroit où ils vivent. En effet, leurs ancêtres y sont arrivés en provenance de la baie Georgienne (le long du lac Huron en Ontario) en 1648-1649, fuyant les Iroquois avec lesquels ils étaient en guerre, vu qu'ils avaient forgé une alliance avec les Français. On dispose d'archives le prouvant. Il faut souligner aussi que les guerriers hurons n'étaient pas les seuls auxiliaires autochtones présents à Québec durant le siège de 1759. Le réseau des alliances indiennes mis sur pied par les Franco-Canadiens s'étendait loin sur le continent. Des guerriers de nations habitant ce qui est aujourd'hui le Midwest américain épaulaient l'armée française, pas seulement des Hurons. J'ignore s'il existe des réserves dans cette région et si oui, ce que penseraient les descendants des auxiliaires présents à Québec en 1759 de la démarche de monsieur Picard de refuser l'examen des ossements de la rue Saint-Anselme. La question se pose. Et les compatriotes de monsieur Picard sont-ils tous d'accord avec lui ? Il y a beaucoup d'incertitudes dans cette histoire.
Une mauvaise conscience taraude de nos jours plusieurs Blancs quant au traitement qu'ont subi les Amérindiens en Amérique du Nord. Ils ont été, comme on sait, les grandes victimes de la colonisation britannique, puis américaine et dans une moindre mesure. française. Les Premières Nations sont aujourd'hui enclavées dans des réserves où elles bénéficient quand même d'une certaine autonomie. C'est facile de laisser éclater le sanglot de l'homme blanc lorsque l'autre est vaincu et dépouillé de son territoire...
On peut penser par exemple, à un exemple représentatif qui illustre ce sentiment de culpabilité : le film (très émouvant au demeurant) « Danse avec les loups » » de Kevin Costner sorti en 1990. Le contraste est frappant avec le passé, où on présentait dans les livres d'histoire, les romans, à la télévision et au cinéma les Amérindiens comme des barbares sanguinaires et primitifs. Les mouvements indianistes ont profité de ce sentiment de honte pour réhabiliter leurs ancêtres, à juste titre. Certains militants ont même rejeté le christianisme enseigné autrefois par les missionnaires pour renouer avec la religion ancestrale, du moins ce qui en subsiste. Tout ce processus intellectuel et politique s'est édifié pour l'essentiel sur la notion de respect des croyances traditionnelles propres aux peuples amérindiens.
On comprend ce mouvement de « retour aux sources » religieuses dont la légitimité ne peut être remise en cause. Mais il est permis de se demander s'il ne va pas trop loin dans certains cas en bloquant toute étude scientifique de squelettes et d'objets anciens. Dans le cas de la rue Saint-Anselme, celle-ci se trouve loin du territoire de la réserve de Wendake et on ignore la « nationalité » des gens dont on a retrouvé les restes. Seule une étude détaillée et rigoureuse permettrait d'y voir clair. L'opposition de Pierre Picard et de ses adjoints, de même que la reculade de la Ville privent l'ensemble des Québécois et des Québécoises d'informations importantes sur le déroulement d'un épisode capital de leur histoire. En étudiant minutieusement les ossements mis au jour, on récolterait ainsi de précieux renseignements sur le mode de vie de ces gens, leur régime alimentaire, leur état de santé, les circonstances précises de leur mort, etc.
Si une telle reculade s'est produite à Québec, elle peut aussi bien avoir lieu ailleurs. Par exemple, en cas de découverte de squelettes amérindiens à Saint-Constant ou à Longueuil, céderait-on à l'opposition prévisible des Mohawks de Kahnawake afin de ne pas blesser leur « sensibilité culturelle » ?
Devrait-on en définitive renoncer à l'étude des traces matérielles de l'histoire amérindienne du Québec (et d'ailleurs au Canada) au nom du respect de convictions religieuses autochtones dont on n'est même pas certains qu'elles font encore l'unanimité chez ces gens ? Après tout, on n'est plus dans la période coloniale et leurs sociétés ont évolué, tout comme la nôtre. Cette capitulation entraînerait alors un sérieux recul des connaissances scientifiques sur le passé.
Ces dernières et le respect des cultures autochtones ne se contredisent pas, mais se complètent plutôt. Bien connaître son histoire constitue l'occasion pour une collectivité de mieux se comprendre elle-même et aussi, surtout peut-être, de mieux s'entendre avec ses voisines.
Si certaines croyances autochtones et autres peuvent sembler loufoques à des esprits critiques, il faut aussi admettre que la science n'a pas réponse à tout, et surtout pas au destin ultime de l'homme. À mesure qu'elle progresse, on s'aperçoit (en fait, les scientifiques le savent depuis longtemps) que toujours plus de choses demeurent à découvrir et que des connaissances qu'on tenait pour acquises doivent être modifiées, ou même parfois abandonnées. La science n'est pas un absolu, les scientifiques en ont conscience depuis longtemps (du moins les plus lucides d'entre eux), mais un phénomène culturel ; tout comme la religion mais avec le souci de comprendre rationnellement l'homme et l'Univers aussi objectivement que possible.
Jean-François Delisle
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture du mardi 9 septembre 2025


Pour une gauche à gauche
Pierre Dubuc
Pierre Dubuc est directeur et rédacteur en chef de l'aut'journal, un mensuel progressiste et indépendantiste que j'apprécie beaucoup. Sa pensée politique et sociale vaut d'être connue. Dans « Pour une gauche à gauche », publié en 2011, mais qui se révèle toujours éclairant à la lumière des événement en cours, Pierre Dubuc y critique les propositions sociales et linguistiques de Jean-François Lisée comme conseiller des chefs du Parti Québécois, essayiste, analyste et blogueur. L'auteur nous y explique qu'au cours des dernières années, Lisée a popularisé le concept de « gauche efficace », inventé par son mentor François Legault. Au programme de cette « gauche efficace » explique-t-il, on trouve la privatisation partielle d'Hydro-Québec, le remplacement des taxes progressives, la paie au mérite pour les enseignants, la transformation d'organisations syndicales du secteur public en coopératives de production et une réécriture majeure de notre politique linguistique au détriment du français comme langue officielle et commune.
Extrait :
Quand Mme Marois a pris la direction du Parti Québécois, elle a déclaré qu'elle voulait « renouveler la social-démocratie » et, pour bien signaler à quelle enseigne elle logeait, elle a déclaré qu' « il fallait créer la richesse, avant de la partager ». L'expression est en effet connue. Elle a été la bannière du « New Labour » de Tony Blair. Puis, plus tard, pour être sûre d'être bien comprise sur le sens de la démarche, la chef du Parti Québécois a précisé qu,elle faisait référence à « l'enrichissement individuel » des Québécois. En réplique À cette dernière déclaration, le SPQ Libre a fait paraître dans Le Devoir un texte intitulé « S'enrichir durablement, c'est s'enrichir collectivement ». La publication de ce texte a valu au SPQ Libre d'être expulsé du Parti Québécois.

Le monde qui pourrait être
Bertrand Russell
Traduit de l'anglais
Bertrand Russell est l'un des grands intellectuels du siècle dernier. Ce livre au titre plein de regrets et d'espoir m'a vraiment beaucoup plu. Russell y dresse l'historique des premières doctrines socialistes et anarchistes. Il nous y livre aussi sa pensée sur les grandes questions de société que sont le travail, les salaires, le syndicalisme, la liberté et ses limites inévitables, les relations internationales, les sciences et les arts. Un livre éclairant qui nous permet encore aujourd'hui de garder l'espoir d'un avenir meilleur.
Extrait :
L'anarchiste, aux yeux de l'homme de la rue, est un personnage qui jette des bombes et commet toutes sortes de crimes, soit parce qu'il est plus ou moins fou, soit parce qu'il dissimule sous le couvert d'opinions politiques extrêmes ses tendances criminelles. Il est évident que cette image est à tout point de vue insuffisante. Il y a des anarchistes qui croient à la vertu des bombes, mais nombreux sont ceux qui n'y croient point. On peut trouver des hommes de toutes nuances d'opinion qui sont pour la projection de bombes si l'occasion est appropriée : par exemple, les hommes qui lancèrent la bombe à Sarajevo, origine de la guerre actuelle, n'étaient pas des anarchistes mais des nationalistes. Ces anarchistes, partisans des machines infernales, ne sont pas différents en ce domaine du reste de leurs concitoyens, exception faite de cette infime minorité qui adopte l'attitude tolstoïenne de la non-violence. Les anarchistes, tout comme les socialistes, admettent en général la théorie de la lutte des classes, et s'ils se servent de bombes, c'est dans le même esprit que le gouvernement qui utilise les siennes à des fins guerrières : mais pour chaque bombe fabriquée par un anarchiste les gouvernements en fabriquent des millions, et pour chaque homme tué par la violence anarchiste, des millions sont tués par la violence des États. Nous pouvons donc écarter de notre réflexion cette question de la violence, qui prend une si grande importance dans l'imagination populaire, puisqu'elle n'est ni essentielle ni particulière à ceux qui font profession d'anarchisme.

Déraison
Horacio Castellanos Moya
Traduit de l'espagnol
Un journaliste plutôt paranoïaque se retrouve au Guatemala après avoir insulté le président de son pays. Il s'y voit charger de réviser les mille cent feuillets d'un rapport sur le génocide perpétré par l'armée contre les Indiens. C'est un travail accablant, qui va tranquillement beaucoup l'affecter psychologiquement. Le roman est écrit dans un style vivant, souvent drôle, mais toujours très réaliste, qui nous ramène historiquement en arrière, depuis le renversement du gouvernement progressiste de Jacobo Árbenz Guzmán par le gouvernement américain et la mise en place et le maintien par ce dernier des dures et cruelles dictatures qui procéderont pendant plusieurs décennies à des tueries de masse et au génocide des Indiens. Une belle découverte !
Extrait :
En effet, dans mon courrier se trouvait un message du compadre Toto, que j'ai tout de suite ouvert avec mon plus bel enthousiasme, et qui n'était pas une lettre mais plutôt une sorte de télégramme qui disait : « Hier à midi monseigneur a présenté le rapport dans la cathédrale avec tambours et trompettes ; on l'a assassiné pendant la nuit dans la maison paroissiale, on lui a bousillé la tête avec une brique. Tout le monde se chie dessus. Dis merci d'être parti ».

Le coup de lune
Georges Simenon
Un autre très bon roman de Georges Simenon. Il se déroule avec réalisme à Libreville, au Gabon, dans l'entre-deux-guerres. Il constitue de ce fait, sans que ce soit le sujet du livre, un témoignage et une remarquable critique du colonialisme. Un jeune homme, Joseph Timar, poussé par son puissant oncle, est nommé dans une concession de bois dans la grande forêt du Gabon, alors colonie française. Il s'installe à l'Hôtel Central dans la ville encore peu peuplée. Rien n'est comme il l'avait prévu. Puis survient le drame…
Extrait :
L'entretien dura un quart d'heure. On ne dit pas un mot du nègre tué, ni de l'enquête. Une fois de plus, avant le déjeuner, Timar avait la tête alourdie par l'alcool et il trouva cet état agréable, car ses pensées avaient un flottement qui rendait insensibles les angles désagréables.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

APPEL : L’Ukraine doit recevoir tout ce dont elle a besoin pour obtenir une paix juste !

Adressé à la Commission européenne et aux gouvernements des États membres de l'Union européenne, de Norvège et du Royaume-Uni
Le problème
Après les « sommets » du président américain Trump avec Poutine (15 août) et les dirigeants européens (18 août), l'Ukraine est confrontée à la perspective effrayante d'un accord de « paix » injuste qui récompense l'agresseur russe.
S'il est imposé à l'Ukraine, cet accord légitimera :
- L'occupation violente par la Russie d'un cinquième du territoire ukrainien et le transfert à la Russie de territoires et de populations actuellement sous administration ukrainienne
- La destruction des villes, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, de l'environnement et du patrimoine de l'Ukraine
- Le meurtre de dizaines de milliers de citoyens ukrainiens et l'enlèvement de milliers d'enfants ukrainiens, et
- La russification génocidaire des territoires occupés, ainsi qu'une multitude d'autres crimes de guerre.
Cela fera également peser la responsabilité de mettre fin à la guerre non pas sur l'agresseur, la Russie, mais sur l'Ukraine, sa victime, alors même que le régime de Poutine intensifie ses bombardements sur les villes et les infrastructures ukrainiennes.
Nous, soussignés, appelons donc l'Union européenne, les gouvernements de ses États membres et du Royaume-Uni à apporter un soutien total et inconditionnel à l'Ukraine en prenant immédiatement les mesures suivantes :
- Armement complet et rapide de l'Ukraine, en partie grâce à l'interdiction d'armer les États agresseurs tels qu'Israël et l'Arabie saoudite.
- Aide à l'Ukraine pour développer sa propre industrie de défense et trouver des fournisseurs fiables, autres que les États-Unis, pour les équipements qu'elle ne peut toujours pas fabriquer.
- Annuler (et pas seulement suspendre) le remboursement de la dette extérieure de l'État ukrainien.
- Transférer les avoirs russes gelés à l'Ukraine.
- Renforcer les sanctions contre le régime de Poutine et les oligarques qui le soutiennent, en particulier dans les secteurs bancaire et immobilier.
- Raccourcir le calendrier de l'Union européenne pour éliminer sa dépendance à l'égard des exportations de combustibles fossiles russes et imposer des sanctions sévères aux entreprises qui participent à ce commerce.
- Renforcer les efforts européens et mondiaux pour le retour en toute sécurité de tous les enfants ukrainiens kidnappés, pour la libération et le retour en toute sécurité de tous les prisonniers civils ukrainiens et pour l'échange des prisonniers de guerre.
- Poursuivre rigoureusement les crimes de guerre russes.
- Soutenir les mouvements anti-guerre russes et les militants anti-guerre emprisonnés en Fédération de Russie et dans les territoires occupés.
PRINCIPAUX SIGNATAIRES
Tanya Vyhovsky, sénatrice du Parti progressiste du Vermont, Sénat de l'État du Vermont (États-Unis)
Christopher Ford, secrétaire, Campagne de solidarité avec l'Ukraine (Angleterre et Pays de Galles)
Peter Cooper, secrétaire, Campagne de solidarité avec l'Ukraine Écosse
Julie Ward, ancienne députée européenne, Parti travailliste (Royaume-Uni)
Graham Campbell, conseiller municipal de Glasgow pour le Parti national écossais (Écosse)
Simon Pirani, professeur honoraire, Université de Durham (Royaume-Uni)
Bernard Dreano, président du Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale (France)
Carmen Claudin, chercheuse senior, Institut des affaires internationales de Barcelone (Espagne)
Szymon Martys, coordinateur par intérim, Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (Pologne)
Alfons Bech, coordinateur syndical, Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (Espagne)
Howie Hawkins, Réseau de solidarité avec l'Ukraine (États-Unis)
Sacha Ismail, responsable des relations syndicales, Campagne de solidarité avec l'Ukraine (Angleterre et Pays de Galles)
Maryann Abbs, militante pour la solidarité avec l'Ukraine et la justice climatique (Canada)
Serhiy Kasianov, membre du conseil d'administration, Organisation des anciens élèves de Harvard Aerospace and Defense, Association professionnelle du gouvernement ukrainien
Dr James Doughney, professeur émérite, Université Victoria, Melbourne (Australie)
Thomas Weyts, coordinateur, Comité belge du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine
David Acosta Guillerm, conseiller municipal, Gràcia, Barcelone, pour Barcelona en Comú (Espagne)
Oksana Kozlova, maître de conférences, École de traduction et d'interprétation, Université libre de Bruxelles, Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (Belgique)
John Andersson, coordinateur, Ukraine-Solidarity (Suède)
John Meehan, coordinateur, Gauche irlandais avec l'Ukraine
Serhiy Onyshchenko, père, Ukrainien, ingénieur chez Exalate (Belgique)
Carme Sansa Albert, acteur catalan (Espagne)
Frank Fourneau, Fonds de soutien à l'Ukraine et Heart4Ukraine (Belgique)
Daniel Tanuro, écrivain écosocialiste et membre de la Quatrième Internationale (Belgique)
Christian Zeller, professeur de géographie économique, rédacteur en chef, emanzipation - Zeitschrift für ökosozialistische Strategie (Autriche).
Gauche anticapitaliste / SAP-Antikapitalisten (Belgique)
Nouveau Parti Anticapitaliste (France)
Voir cette déclaration du RESU sur les négociations de « paix ».
PETITION lancée par le Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (ENSU).
Signaler une violation des politiques
avatar of the starter
European Network for Solidarity with Ukraine Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine
Lanceur de pétition
Network of national groups building solidarity with the Ukrainian people in their struggle against invasion by the Putin regime of the Russian Federation

Faut-il vraiment mourir pour exister ?

Voici un texte que je vous propose pour publication. Il a été écrit par Marie-Claude Tadros-Giguère, juste avant sa mort, le 23 août dernier, à l'âge de 89 ans. Cette femme a grandi à Jaffa et a dû fuir lors de la création de l'État d'Israël en 1948. Elle a été au cœur du mouvement de solidarité entre le Québec et la Palestine depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui.
Le texte de Marie-Claude Tadros Giguère nous a été envoyé par Sébastien Bouchard.
Je n'aurais jamais cru quitter ce monde au moment où mon pays d'adoption allait enfin reconnaître mon foyer d'origine. Mais voilà qu'une violente tumeur met fin à mes jours. Je termine ma vie alitée, amaigrie et sans force, sordide coïncidence avec l'agonie de mon peuple.
Je ne serai plus des vôtres quand la prochaine Assemblée générale des Nations Unies s'ouvrira. Tout l'Occident, à part les États-Unis, se joindra alors aux 148 pays qui ont déjà reconnu la justesse de notre projet national. Avant que le premier ministre Carney ne fasse sa déclaration à l'ONU, je tenais à partager avec vous l'étonnante saga qui m'a menée jusqu'ici, chez vous, et qui reflète bien les soubresauts perpétuels qui secouent le Proche-Orient depuis le début du siècle dernier. Car c'est ici que j'ai entrepris mon combat en 1969, peu après mon arrivée, pour faire reconnaître le droit des Palestiniens à leur foyer. À l'heure de l'effroyable carnage de Gaza déjà décimé par la famine et du spectaculaire projet de colonisation « E1 » que vient d'approuver la Knesset, le rêve de deux États, palestinien et israélien, s'est envolé en fumée. Alors dites-moi : de simples proclamations sur la Palestine suffisent-elles pour changer le cours de l'histoire et dicter la paix ? Ou servent-elles plutôt d'exutoire pour se dédouaner de 77 années d'indifférence ?
Voici ce qu'aurait pu devenir la Palestine au sortir de la Première Guerre mondiale, sur les promesses de Lawrence d'Arabie : un peuple libéré des empires ottoman et britannique, où Juifs et Arabes auraient pu créer un pays cosmopolite, où coulent le lait et le miel qui caractérisaient toute la côte levantine.
Je suis née en 1936 dans le quartier d'Al-Ajami, à Jaffa, à dix minutes au sud de Tel- Aviv. C'est là que mon grand-père maternel, Alfred Roch, un Palestinien diplômé en génie agricole en France, avait aménagé une orangeraie. Du port de Jaffa, il exportait ses savoureuses oranges vers l'Europe à bord des navires danois de la Maersk. Ce furent d'ailleurs les émissaires de cette entreprise qui m'accueillirent plus tard à Montréal.
Alfred avait épousé Olinda Baldensperger, ma précieuse grand-mère, à qui j'aimais me confier durant mon adolescence. Née elle aussi à Jaffa, elle descendait d'une famille alsacienne installée en Palestine dès 1848. C'est de cette lignée que me vient mon prénom francophone, qui suscite souvent l'étonnement. Rien de très arabe, direz-vous, pourtant, je parlais et lisais couramment le mashriqi ammiya, ce dialecte arabe qui rrrroule les ‘r' typiques de toute la région.
Il y a près d'un siècle, mon grand-père Alfred participa aux premières négociations palestiniennes avec les Britanniques. Après avoir été conseiller municipal à Jaffa, il rejoignit la Révolte arabe contre l'Empire ottoman en 1916. Mal lui en prit : il fut exilé en Anatolie avant de pouvoir revenir à son orangeraie, puis se faire élire au premier Congrès national palestinien de Jérusalem en 1928. Mais rien n'y fit. Les dés étaient pipés : les Britanniques avaient pris parti pour un foyer national juif avant même de prendre le relais colonial ottoman, sans considération pour le peuple qui y vivait.
Mon autre grand-mère, Sofia Feinberg, était née la même année qu'Alfred Roch, en 1882. Elle venait d'une famille juive d'Odessa qui avait fui les persécutions en Russie. Elle fit ainsi partie de la première grande vague d'immigration juive, ou aliyah, en Palestine. Avant la Première Guerre mondiale, Sofia fit la rencontre de mon grand-père, Théodore Tadros, un Grec orthodoxe de Jérusalem. Et comme leurs deux familles renièrent la mixité de leur mariage, Théodore et Sofia durent s'exiler en Égypte, où Sofia se convertit au christianisme.
J'étais une drôle de Sémite, un reflet du méli-mélo culturel et religieux du Levant d'alors. Car on oublie souvent que les Palestiniens sont autant sémites que les Juifs sépharades d'Israël, davantage même que les Ashkénazes venus d'Europe, qui sont devenus l'élite dirigeante du jeune État juif. D'où l'ironie de nous faire accuser d'être antisémites lorsqu'on critique Israël.
Mon père Michel, qui avait grandi en Égypte, est revenu en Palestine où il devint dentiste. C'est là qu'il a rencontré ma mère, Paulette Roch. J'achevais une enfance paisible, entourée de trois de mes jeunes frères (un quatrième naîtra à Amman), dans les odeurs de l'orangeraie, lorsque tout chavira en 1948. J'avais douze ans. Sept cent mille d'entre nous durent fuir le pays sous les tirs israéliens. Ce jour funeste devint Al- Nakba, « la catastrophe », un exode sans retour possible.
Mon père nous a alors conduits en urgence à Amman, en Transjordanie, tandis que mon grand-père Tadros organisait notre établissement à Alexandrie. C'est là que j'ai poursuivi mes études, avant de prendre la route vers Montréal en 1965.
J'y ai rencontré mon mari, Luc Giguère, un économiste au siège du Mouvement Desjardins à Lévis. Avec lui, je découvre le Québec, son histoire et sa culture. Je connaissais déjà Félix Leclerc, que j'écoutais en boucle sur notre gramophone familial en Égypte. Entrainée par mon mari, j'ai également plongé dans la politique québécoise.
Et c'est lors d'une assemblée du Mouvement Souveraineté-Association en 1968 que j'ai tendu la main à René Lévesque et me suis présentée comme Palestinienne. Le dialogue s'est ouvert. Plus tard, avec Michel Chartrand, il témoignera de son appui à la création d'un État palestinien au congrès de la Fédération canado-arabe à Montréal. Tous deux prendront aussi part, avec moi, à une table ronde à l'Université Laval.
En 1969, j'ai participé avec un groupe d'universitaires de Montréal à la première grande semaine d'information sur la Palestine, qui en dura deux finalement. Des conférences furent présentées dans les cégeps naissants, les universités et les assemblées syndicales ici et là au Québec. Ce fut l'éclosion d'un mouvement d'information durable qui distingua le Québec du reste du pays. Quand le Parti québécois devint membre observateur de l'Internationale socialiste après son élection en 1976, l'Organisation de libération de la Palestine fit de même et délégua un représentant à son congrès.
Au même moment, j'aidais nombre de journalistes, dont Pierre Nadeau et Clément Trudel, à se familiariser avec la cause palestinienne. J'accompagnais en Cisjordanie des délégations comme celle dont faisait partie, en 1986, le président de la CSN Gérald Larose, accompagné du comédien Daniel Gadoua, de Michel Duchesne du cégep Montmorency et de la grande Monique Fitz-Bach, alors membre du Bureau national de la Centrale de l'enseignement du Québec.
En 1972, nous avons créé le Comité Québec-Palestine. Mais ce n'était pas sans risques, ni aberration. Les locaux de la Fédération canado-arabe furent truffés de micros de la GRC, tandis que la police fédérale dépêchait un agent pour me mettre en garde contre tout « acte délictueux » lors de la visite de Jean-Paul II à Québec, en 1984.
À Ottawa, j'ai rencontré plusieurs députés et ministres, y compris Mitchell Sharp, qui dirigea plusieurs ministères. Peine perdue. Malgré toutes ses opérations de paix et l'envoi de casques bleus à travers le monde, le Canada s'est contenté de contribuer à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), un organisme que les Israéliens viennent de bannir tant à Gaza qu'en Cisjordanie.
Avant de fermer les yeux, je ne demande qu'une faveur aux Québécois, mes alliés, mes amis : celle de poursuivre leurs revendications pour une justice pleine et entière au Proche-Orient, et pour la reconnaissance d'un foyer pour le peuple palestinien. Reste à savoir si pareil projet paraît plus réalisable aujourd'hui que celui d'un État laïc, binational, regroupant Juifs et Palestiniens, qui marquerait enfin l'histoire de l'humanité.
Marie-Claude Tadros Giguère, Québec 2025

Guy Rocher (1924-2025) : Un phare s’éteint

Guy Rocher est incontestablement un grand sociologue qui mérite d'être qualifié de monument de la pensée sociologique. Tout au long de sa vie adulte, il a mis son expertise scientifique et ses qualités professionnelles au profit de la société québécoise.

Il a incontestablement été un chef de file de sa génération et un intellectuel influent durant la période allant de la Révolution tranquille jusqu'à tout récemment. Dans ses nombreuses prises de position, Guy Rocher prônait l'égalité des chances, la justice sociale et l'égalité entre les sexes ou les genres. Il a adhéré à un certain nombre de grandes causes comme la laïcité, la défense et la promotion de la langue française, l'accès à l'éducation pour le plus grand nombre par le biais de la gratuité scolaire et du salaire étudiant et, last but not least, l'indépendance du Québec. Nul doute que l'implication de cet homme dans nos grands débats de société, de la fin des années cinquante jusqu'à aujourd'hui, a été profitable à une frange importante de la population d'ici. Dans les prochaines lignes, je veux vous parler du sociologue que j'ai lu et de l'acteur social qui m'a interpellé. On me permettra d'esquisser, à grands traits, des éléments de sa vie et de m'étendre un peu plus longuement sur d'autres aspects étroitement associés au changement social de la province. De plus, je présenterai quelques points forts de sa démarche théorique en sociologie.
De 1924 jsqu'au début des années cinquante
Guy Rocher a vu le jour le 20 avril 1924. Après de brillantes études classiques, il s'engage à temps plein au sein de la Jeunesse étudiante catholique (JEC). Il effectue, quelques années plus tard, un retour aux études qui le mènera de l'Université Laval à la prestigieuse Université Harvard où il obtiendra un philosophiæ doctor (Ph. D.) en sociologie. C'est grâce à une bourse d'études du Père Lévesque - qui a d'abord sollicité un prêt auprès de Jean Marchand, Secrétaire général de la Confédération des travailleurs catholiques canadiens (l'ancêtre de la CSN) - que Guy Rocher a été en mesure d'acquitter ses frais de scolarité américains qui étaient, même à cette époque, exorbitants.
Guy Rocher a grandi et évolué dans un Québec tantôt frappé d'immobilisme - « L'ancienne société traditionnelle, cléricale, repliée sur elle-même » - et tantôt pleinement engagé sur la voie de la mutation et de la modernisation de certaines de ses institutions politiques, sociales et culturelles - « une société postindustrielle, laïque, appartenant de plus en plus à la civilisation nord-américaine ».
Authentique « sociologue citoyen », il n'a jamais craint, dans ses analyses, de porter un regard critique sur la réalité sociale. Sa pratique sociologique a été marquée par un va-et-vient presque incessant entre, d'une part, la pratique de l'action et, d'autre part, la pratique de l'interprétation. Cette dynamique, entre ces deux pratiques, a débouché sur une soif de comprendre et d'expliquer l'énigme du changement social tout en participant à la transformation de la réalité sociale. La célèbre triade du chanoine Cardijn - fondateur des mouvements d'Action catholique -, c'est-à-dire « voir, juger, agir », aura eu l'heureux effet d'inspirer le jeune Rocher sur le plan de la méthode à appliquer dans l'observation et la nécessaire intervention transformatrice du social. Mais, les quatre années passées - de 1943 à 1947 - en tant que dirigeant permanent de la JEC, si riches soient-elles, lui font réaliser « la pauvreté » de son « appareil intellectuel » pour interpréter « le milieu social et l'énigme de ses transformations ». La découverte de la sociologie sera alors déterminante dans la suite de sa carrière.
Guy Rocher connaît certes un parcours scolaire atypique. Après des études classiques ininterrompues qui le mènent à l'obtention d'une licence en droit, son association à la JEC l'amène à militer bénévolement sur diverses questions qui touchent la société québécoise, alors que deux hommes auront une influence majeure dans sa destinée : le père Georges-Henri Lévesque et bien entendu Paul Gérin-Lajoie. Pourquoi ces deux personnes ? D'une part, comme mentionnée plus haut, c'est le père Lévesque qui a parrainé Guy Rocher dans ses démarches d'inscription à l‘Université Harvard et, d'autre part, Paul Gérin-Lajoie en fera un commissaire chargé de formuler des recommandations porteuses d'avenir en matière d'éducation pour la province de Québec - et j'ai nommé la célèbre Commission Parent, nous y reviendrons.
De retour à l'université, vers la fin des années quarante, Guy Rocher se familiarise avec les grandes théories interprétatives sociologiques qui ont pour auteurs : Comte, Marx, Weber, Durkheim et Parsons. Il prend connaissance également des résultats des recherches empiriques des sociologues rattachés à l'École de Chicago. Une « muraille » se dresse toutefois entre ces deux approches qui lui semblent aux antipodes l'une par rapport à l'autre. Aucun accord « entre la théorie » et « les recherches empiriques » ne lui apparaît envisageable. C'est la lecture de l'ouvrage d'Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique (1835), qui donne l'occasion à Guy Rocher de faire le lien entre les grandes théories sociologiques et la réalité empirique, ce qui sous-entend le passage de la pratique sociale à l'interprétation du changement.
Pour l'essentiel, la nature des propos de Tocqueville, lui permet ce « premier regard sur une société en mutation ». Autrement dit, ce livre l'amène à saisir comment un processus de mutation sociale peut se trouver orienté dans la voie de « l'implantation d'une démocratie ». C'est d'ailleurs le même livre d'A. de Tocqueville qui rend possible à Guy Rocher « (d')entrer dans les arcanes de la sociologie théorique de Talcott Parsons ». Une lecture plus « attentive » de ce dernier lui fait découvrir qu'il y a là « une théorie sociologique de la société démocratique face aux sociétés totalitaires fascistes et communistes ». Mais, cette approche théorique parsonnienne ne lui apporte pas l'essentiel de la méthode qu'il réclame pour mieux comprendre la dynamique du changement social.
Les années cinquante
Au début des années cinquante, son expulsion de l'Université Laval, d'abord à cause de son implication dans la campagne d'appui aux grévistes d'Asbestos ; ensuite sa pratique de la sociologie, alors qu'il observe durant cette décennie les membres des groupes dominants - le clergé et le pouvoir politique - réfractaires au changement ; puis enfin, son implication dans les années soixante qui lui procurent « l'intense sentiment d'assister et de participer à une mutation sociale, politique et culturelle », tout ceci amène Guy Rocher à réaliser qu'il porte en lui les marques indélébiles de son « temps historique ». Il réalise donc qu'il est complètement imperméable à toute forme de déterminisme et constate aussi, qu'il n'y a « pas d'évolution nécessaire ni irréversible. ». Refusant les dogmes « qu'ils soient religieux, politiques ou autres », sa perception du changement lui sera suggérée par le mot suivant : « contingent ». Est contingent « ce qui peut se produire ou non ». Rocher nous confie que ses pratiques théorique et orientée vers la réforme sociale découlent d'une approche qui nous ramène toujours à sa lecture d'Alexis de Tocqueville, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir dans les sociétés démocratiques que des « changement(s) raisonné(s) ». Il devient donc clair pour Guy Rocher que la dynamique du changement social ne réside pas dans de supposées « lois de l'histoire », bien plutôt dans cette force mobilisatrice qui accompagne des acteurs sociaux suffisamment motivés pour s'engager dans la voie du changement social désiré. Pour le théoricien qu'est Guy Rocher, il ne peut y avoir qu'une sociologie : celle qui crée des outils pour comprendre le changement social. Il en est ainsi, parce que « (l)e changement social, inhérent à la société, à la vie sociale, à tout ce qui est vivant, sera une source indéfinie de nouveaux défis ». La tâche du sociologue consiste justement à « comprendre ce qui change, comment les sociétés se transforment et d'expliquer pourquoi le changement, dans sa « contingence », est allé, va ou peut-être ira dans telle direction plutôt que telle autre.
Des années cinquante jusqu'aux années 2010
Une fois son doctorat en poche, il est embauché comme professeur de sociologie, d'abord à l'Université Laval et ensuite à l'Université de Montréal. Le professeur Guy Rocher est aussi connu pour sa contribution au sein de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, mieux connue sous le nom de Commission Parent. C'est cette commission qui allait proposer la démocratisation du système d'éducation au Québec et la création des centres d'éducation générale et professionnelle – les fameux cégeps, nous y reviendrons. Lors de la crise d'Octobre 1970, il décide de rompre certaines amitiés avec des libéraux fédéraux. Il passe alors du nationalisme canadien à celui québécois. Rappelons qu'il a été sous-ministre au développement culturel de 1977 à 1979 et sous-ministre au développement social de 1981 à 1983 au sein de gouvernements péquistes. Il a joué un rôle très important dans la rédaction de la Charte de la langue française au Québec (la loi 101). Des années quatre-vingt jusqu'à tout récemment, il exerce le rôle de professeur-chercheur au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit. Il prend sa retraite en 2010, à l'âge de 86 ans, et quelques mois plus tard, on lui décerne le titre de professeur émérite.
La sociologie du changement social
Le moins que l'on puisse dire, au sujet de Guy Rocher, c'est qu'il correspond à un sociologue au parcours long et également exceptionnel par la multitude de ses points d'intérêts. Nommons ici les objets de recherche suivants : les rapports entre l'Église et l'État ; l'évolution des théories sociologiques de l'action sociale ; les aspirations scolaires des jeunes Québécois ; la question linguistique ; la sociologie du droit ; l'éthique dans le domaine de la pratique médicale ; la sociologie des réformes, etc. Certains de ses ouvrages ont été traduits dans de nombreuses langues. La grande qualité de ses travaux scientifiques en sociologie en fait incontestablement un modèle pour plusieurs. Attardons-nous un peu sur sa vision du changement social, de la sociologie du droit et de la sociologie des forces hostiles au social-réformisme.
Le changement social occupe une place de choix dans la démarche analytique de Guy Rocher. De manière plus précise, ce sont les processus qui rendent possible le changement qui l'ont grandement intéressé. Dans ses Entretiens avec François Rocher, il explique pour quelles raisons il opte pour une sociologie des réformes - et non des révolutions - pour comprendre l'évolution et les transformations des sociétés occidentales au XXe siècle en général : « [N]ous vivons dans une période historique, en Occident, où il n'y a pas eu d'importantes révolutions. La dernière, bien sûr, c'est la révolution bolchevique de 1917. […] Cela veut dire que les changements planifiés se sont faits davantage par des réformes que par des révolutions, depuis un siècle environ. Pourquoi ? […] En général, les révolutions ont pu se produire parce que l'État faiblissait, n'était plus en mesure de résoudre les problèmes ni d'assurer le contrôle. Dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui, nous vivons avec des États qui sont relativement forts, qui sont établis et dont la légitimité n'est généralement pas contestée. Et cela, parce que ce sont des États de droit, basés sur la rationalité juridique […]. Ce genre d'État de droit se prête à des réformes plutôt qu'à des révolutions. »
Guy Rocher déplore que les sociologues actifs durant les années mille neuf cent soixante et soixante-dix ne se soient pas intéressés davantage à la sociologie des réformes. Ces derniers semblaient préférer les luttes révolutionnaires comme authentique vecteur du changement social ou de la transformation sociale. N'allons pas croire cependant que Guy Rocher mésestime l'apport de Marx en regard du développement de la pensée en Occident. À Georges Khal, il dira : « Le marxisme a certainement contribué […] à la pensée du XIXe et du XXe siècles. Avec le freudisme ou la psychanalyse, le marxisme fut une des grandes révolutions intellectuelles, sociales et culturelles de la pensée occidentale moderne. Il a donné à la philosophie et à la pensée politique des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus ancrées dans la réalité. Le grand mérite de la pensée de Marx, […] c'est d'avoir jeté un éclairage nouveau sur les relations entre la pensée, la culture et la vie matérielle, d'avoir renversé les perspectives du vieil idéalisme et mis en valeur le rôle des conditions matérielles de vie, des rapports de travail et de la technologie dans l'histoire humaine. » Rocher indiquera aussi : « Je suis ouvert à la pensée de Marx et d'Engels, mais pas à celle de Lénine ». Il reprochera à ce dernier, avec raison d'ailleurs, d'avoir instauré « un État et une société totalitaires ».
La sociologie du droit
Constatant que le pouvoir politique s'exprime, pour l'essentiel, à travers des lois, des règlements et des normes écrites qui concourent, à l'occasion, à réformer la société, Guy Rocher y va de sa contribution au développement d'une théorie sociologique du droit. C'est à l'aide des concepts de pluralisme juridique, d'ordres juridiques, d'internormativité, d'efficacité et surtout d'effectivité qu'il théorise le droit. Au sujet de ces deux derniers concepts, il énonce ce qui suit : « L'efficacité, c'est la façon dont le droit a des effets qui correspondent à l'intention de celui qui le fait, qu'il s'agisse du législateur, d'un tribunal ou de contractants. Par ailleurs, il y a ce que j'appelle l'effectivité : ce sont les effets qui n'étaient pas prévus, ou des effets à très long terme. » Il y a pour lui deux moments dans le droit : d'abord, celui où « l'on crée le droit » et ensuite, celui « où on l'applique ». Le concept d'effectivité est nécessaire pour comprendre comment le droit évolue. Il porte à notre attention la position que « [l]es juristes ont beaucoup d'imagination, soit pour inventer du nouveau droit, soit pour faire dire à des lois ou des règlements ce qu'on n'avait pas pensé qu'ils allaient vouloir dire ». Le droit est « le bras de l'État » qui se prête à des « dérives ». Guy Rocher nous incite donc à rester vigilants face au droit. Celui-ci peut être sans effets réels ou se transformer en son contraire.
La sociologie des forces hostiles au social-réformisme
La vie sociale ne nous confronte pas à un changement linéaire. À l'heure où l'idéologie néolibérale triomphe et où les acquis sociaux issus de la période keynésienne sont frontalement remis en question par les gouvernements de droite qui dirigent les pays avancés, il importe de créer une nouvelle branche de la sociologie. La preuve est faite, les partis politiques qui un jour ont prôné le changement progressiste se sont permutés en forces d'inertie. L'esprit réformiste qui habitait jadis le Parti libéral s'est volatilisé. Idem pour le Parti québécois. Dans la foulée des travaux de Guy Rocher, il faut penser maintenant à une sociologie de ces forces d'inertie – des forces de résistance, comme les a appelées le sociologue – hostiles au social-réformisme. Nous devons aussi travailler à l'expansion d'une « grille d'analyse à la fois systématique et critique du droit », ainsi qu'à mettre au point une sociologie… des sociétés animales. Invité par la prestigieuse revue Commentaire à indiquer des avenues futures de recherche pour la sociologie, Guy Rocher y est allé en effet d'une étonnante réponse qui illustre à merveille que même nonagénaire il était capable d'adopter un point de vue original. Il se disait d'avis que « la sociologie ne s'est pas encore souciée de l'immense champ de recherche des sociétés animales, des plus petites aux plus grandes, des terrestres et des maritimes. La collaboration entre la sociologie et les savants de la faune est encore à venir ». C'est peut-être là, au sein de certaines sociétés animales, qu'il est possible de trouver la clef des rapports de coopération au lieu des rapports de combat et de compétition qui caractérisent les sociétés humaines.
Une écriture accessible
Guy Rocher est un brillant scientifique. Il est un des rares à pouvoir communiquer avec clarté dans une langue accessible au plus grand nombre. Son style d'écriture s'oppose au langage hermétique de trop nombreux sociologues nébuleux. L'étude portant sur les aspirations scolaires - l'étude du groupe ASOPE dont il était un membre important - nous en a appris beaucoup sur les raisons expliquant pourquoi certains jeunes abandonnaient l'école. Dans certains cas, la raison principale résidait dans le fait que le personnel de l'école et certains parents demandaient à leurs enfants : « Que vas-tu faire à la fin de tes études ? ». La fin des études correspondait ici au secondaire 5. Les résultats de cette recherche nous ont permis de comprendre que la réponse à certains faits sociaux ne résidait pas uniquement dans un cadre théorique élaboré au XIXe siècle ou dans les écrits d'universitaires localisés dans la tour d'ivoire des institutions prestigieuses. Guy Rocher n'adhère pas au déterminisme à la manière d'Émile Durkheim. Il est d'avis que la découverte sociologique est à la fois le résultat d'une intervention de la société sur elle-même et implique également de reconstruire le tout dans les gestes et les paroles des individus concernés par le phénomène à l'étude. Inspiré en cela par Max Weber, Guy Rocher a pratiqué le constructivisme sociologique bien avant que celui-ci soit de mise dans la recherche actuelle.
En écoutant ou en lisant Guy Rocher, nous nous retrouvons avec un scientifique qui tient des discours ou qui rédige des textes invitant à douter des théories doctrinales. Sa démarche nous incite fortement à analyser et à nuancer ce qui mérite de l'être. La pensée de Guy Rocher s'éloigne d'un manichéisme simpliste ou des oppositions élémentaires et souvent binaires.
L'acteur social
Comme mentionné plus tôt, Guy Rocher a été un membre très actif de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec. C'est elle qui a osé proposer rien de moins que la démocratisation de l'éducation - à travers la création d'un ministère portant le même nom -, la laïcisation des institutions d'enseignement, l'égalité des chances entre les sexes et les groupes linguistiques, l'accessibilité du plus grand nombre, l'élargissement de la gratuité à tous les niveaux, la régionalisation de certains services, la création d'une université d'État, etc.. Les travaux de cette commission ont obligé les membres de la classe dirigeante à effectuer une panoplie de réformes qui ont été porteuses de mutations sociales profitables aux femmes et aux personnes issues de familles modestes. Ce sont maintenant plus de 2 millions de personnes qui ont fréquenté un établissement scolaire postsecondaire au Québec, soit autour d'une personne adulte sur quatre ; ce qui s'avère considérable pour une société qui affichait le taux de scolarisation le moins élevé en Amérique du Nord en 1961.
C'est grâce aux travaux des membres de la Commission Parent et aux audacieuses propositions de réformes contenues dans leur rapport qu'il y a eu, durant les années soixante, la création d'une kyrielle de nouvelles institutions scolaires au Québec – telles que les polyvalentes, les cégeps et aussi le réseau de l'Université du Québec. En bref, la création de plusieurs dizaines d'établissements d'enseignement susceptibles de permettre au plus grand nombre de développer leurs aspirations scolaires et de pouvoir poursuivre leurs études en s'endettant le moins possible.
Guy Rocher a donc osé rêver l'amélioration de la population du Québec grâce à l'instruction, ce qui supposait un système d'éducation public, accessible et gratuit de la prématernelle jusqu'à l'université. Mais Guy Rocher c'est plus qu'un ex-membre de la Commission Parent, c'est aussi un grand intellectuel inspirant et, comme il le confiait à sa fille Anne-Marie, « un battant ».
Durant certaines grèves de ses collègues universitaires, il n'a d'ailleurs pas hésité à prendre parti en leur faveur. Tout en étant attaché à l'Université de Montréal, il a demandé en 2009 à la ministre de l'Éducation de l'époque, madame Michelle Courchesne, de financer adéquatement l'UQAM. Que dire de ses interventions lors des grèves des professeurEs de l'Université Laval et de l'Université du Québec à Montréal en 1976-1977 ? À cette époque, il a été un sous-ministre du développement culturel qui n'a pas eu peur d'ouvrir la porte de son bureau aux présidents de syndicats, alors que le ministre de l'Éducation préférait de son côté entendre le seul point de vue des recteurs de ces universités désertées pendant plus de 15 semaines.
Guy Rocher et la curiosité
Lors d'une intervention au Collège Montmorency, Guy Rocher a déclaré qu'il existait deux sources d'accès au bonheur : la curiosité et l'adhésion à une cause susceptible de modifier l'organisation de la vie dans la Cité. C'est en effet l'étonnement ou la curiosité, si vous préférez, qui le conduit depuis fort longtemps dans la voie de la résolution de l'énigme du changement social. Sans la curiosité, il n'y a pas, selon lui, de connaissances susceptibles de nous permettre de comprendre le monde ou ses phénomènes concrets et de trouver des voies qui mènent à la résolution du changement raisonné. Pourquoi les filles et les garçons n'ont-ils pas accès aux mêmes programmes de formation scolaire et universitaire ? Pourquoi les francophones, les autochtones, les allophones subissent-elles et subissent-ils des discriminations face aux anglophones ? La quête du savoir ou de la connaissance chez Guy Rocher puise incontestablement dans une forme de stupeur devant le monde tel qu'il se présentait ou se dresse devant lui. C'est la persistance de son étonnement, tout au long de sa longue vie d'adulte, qui lui a permis de continuer à interroger d'une manière franche et authentique le monde dans lequel nous sommes et retrouvons à la fois des personnes voulant le garder intact et d'autres contribuant à le refaçonner.
Devant la vie de Guy Rocher, Sénèque aurait probablement modifié certains passages de son livre intitulé Sur la brièveté de la vie.
Un homme actif au sein de sa société jusqu'à quasiment son dernier souffle
Guy Rocher a été sollicité jusqu'à ses toutes dernières années de sa vie pour donner son avis sur certains enjeux majeurs de notre avenir collectif. Jusqu'à tout récemment, il a rédigé des mémoires et fait des présentations à l'Assemblée nationale. Il nous a montré qu'il était possible d'intervenir, même en tant que nonagénaire et jeune centenaire, dans les débats avec intelligence et passion. Il nous a démontré en plus que la vie peut être heureuse pour celles et ceux qui savent jouir pleinement de leurs ressources personnelles. Pour lui, il importait de toujours rester curieuses et curieux devant la réalité, et d'adhérer à un certain nombre de causes à défendre.
Homme du XXe et du premier quart du XXIe siècle, Guy Rocher fait partie des personnages d'envergure qui ont façonné notre existence collective lui qui en a été un acteur majeur durant au moins 75 années de sa longue vie.
Une vie qui a contribué à changer – en partie - le monde
Personnellement, quand je regarde la vie de Guy Rocher, je retiens la perspective d'analyser, dans le cadre d'une démarche rigoureuse et originale, notre monde en vue de le changer en fonction des intérêts du plus grand nombre. Guy Rocher est pour moi un sociologue et un citoyen qui s'est mis au service des membres de la société en nous suggérant fortement d'envisager la nécessité de s'enrôler socialement et politiquement, d'abord en observant notre monde, ensuite en identifiant les injustices et finalement en s'engageant dans la voie du changement afin de combattre les discriminations intolérables entre les sexes, les oppressions inqualifiables entre les groupes ethniques et culturels ainsi que les exclusions inacceptables des groupes minoritaires ou exploités.
Pour conclure
De tout ce qui précède, deux mots minimalement me viennent en tête : générosité et inspiration. Le professeur Guy Rocher a été un être profondément généreux. Il a beaucoup donné aux autres et a longtemps été disponible pour continuer à donner. Il a démontré qu'une personne, même centenaire, pouvait entreprendre avec passion ce qu'elle avait le goût de faire. Contrairement à ce que suggère Sénèque, Guy Rocher a été la preuve que même à un âge avancé il n'est pas nécessaire de se retirer de la scène publique. Incontestablement, il y a beaucoup de lui dans ce que nous sommes. Son enseignement et ses travaux ont été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui ont décidé d'inscrire leurs recherches dans le sillage de sa démarche originale.
Guy Rocher n'est plus. Sa voix s'est éteinte et ses yeux sont maintenant fermés à tout jamais. Il nous reste par contre ses voies analytiques et son regard sociologique pour continuer à observer et à analyser le monde dans lequel nous sommes en vue de le transformer au bénéfice du plus grand nombre. Nous pouvons certes poursuivre son œuvre dans ce que j'appelle : « La voie de ses regards… »
Yvan Perrier
Professeur de science politique
Cégep du Vieux Montréal
3 septembre 2025
16h30
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Sources :
Duchesne, Pierre. 2019. Guy Rocher : Voir – Juger – Agir. Tome I (1924-1963) ; Montréal : Québec / Amérique, 458 p..
Duchesne, Pierre. 2021. Guy Rocher : Le sociologue du Québec. Tome II (1963-2021). Montréal : Québec / Amérique, 618 p..
Kahl, Georges. 1989. Guy Rocher : Entre les rêves et l'histoire. Entretiens avec Georges Khal. Montréal : VLB éditeur, 232 p..
Lemay, Violaine et Karim Benyekhleh. 2014. Guy Rocher : Le savant et le politique. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 243 p..
Rocher, Anne-Marie. 2002. Guy Rocher : Un sociologue militant. VHS. Productions Testa et le Centre de Banff.
Rocher, François. 2010. Guy Rocher : Entretiens. Montréal : Boréal, 243 p..
Saint-Pierre, Céline et Jean-Philippe Warren (dir.). 2006. Sociologie et société québécoise : Présences de Guy Rocher. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 319 p. ;

Le potentiel radical inexploré du NPD

L'historien Ian McKay discute du défi du NPD face au libéralisme canadien et à sa propre dérive centriste, et de ce qu'il pourrait faire pour saisir son potentiel transformateur
5 septembre 2025 | tiré du site The Breach media
La course à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) a officiellement été lancée cette semaine. Après avoir subi une défaite écrasante aux élections d'avril, le NPD a perdu son statut de parti et a été réduit à seulement sept député·e·s, son chef Jagmeet Singh démissionnant immédiatement.
Quelle est la prochaine étape pour le parti ? Quelles leçons son histoire offre-t-elle ? Sa dérive centriste des dernières décennies est-elle irréversible ? Ou bien possède-t-il, comme l'avance l'historien Ian McKay, une « possibilité radicale » encore non réalisée ?
D'ici la fin mars 2026, lorsque la course à la direction se conclura, nous aurons peut-être quelques réponses.
McKay, professeur émérite à l'Université McMaster, est l'un des historiens de gauche les plus incisifs du Canada. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Rebels, Reds, Radicals : Rethinking Canada's Left History, Radical Ambition : The New Left in Toronto, et Warrior Nation : Rebranding Canada in an Age of Anxiety.
Martin Lukacs s'est entretenu avec McKay pour The Breach Show, et l'entrevue a été complétée par une correspondance par courriel.
The Breach (Martin Lukacs) : Donnez-nous un aperçu général du terrain politique canadien auquel un parti comme le NPD est confronté, que vous analysez depuis longtemps comme « l'ordre libéral » résilient du pays.
Ian McKay : Ma position est que le Canada est un ordre libéral. Par là, je ne veux pas seulement dire que les partis libéraux sont, depuis les années 1840, nos seuls partis fédéraux au pouvoir (même si cela en dit déjà long). Je veux dire que l'idéologie libérale, pénétrée par les valeurs capitalistes, façonne de nombreux détails de nos vies.
Le mot « libéral » est bien sûr contesté. Aux États-Unis, depuis les années 1930, il a été confusément appliqué à toute personne cherchant une version plus humaine du capitalisme. En Europe, il conserve davantage son sens originel de philosophie politique où l'individu est la fin ultime. Historiquement, le Canada s'est rapproché de ce second sens. Dans les deux versions, toutefois, les liens entre capitalisme et libéralisme sont évidents.
Nous, Canadiens, grandissons généralement avec un idéal « d'individualisme possessif », terme forgé par l'économiste politique C.B. Macpherson. Notre estime de nous-mêmes est liée à la quantité de biens que nous accumulons et au prestige social qui l'accompagne. Cet imaginaire idéologique façonne autant les petits détails de nos vies que le cadre global de notre politique. Nous sommes très matérialistes, dans un sens grossier d'accumulation toujours croissante. Nous considérons la propriété—surtout la nôtre—comme sacrée. Nous nous disons que c'est la juste récompense de notre dur labeur. Et nous faisons généralement abstraction de toutes les façons dont l'État et l'ordre social ont rendu possible pour certains d'entre nous de devenir de tels « individus autonomes », ainsi que de toutes les raisons structurelles (comme le colonialisme) qui empêchent d'autres de le faire.
Ainsi, toute suggestion d'interférer avec les « droits de propriété »—et ici les guillemets sont essentiels—suscite une résistance farouche, même si, au fond, nous réalisons que, à l'ère du capitalisme d'entreprise, l'idée que le travail acharné mène à la sécurité et à la prospérité est dépassée. Aujourd'hui, on peut travailler dur toute sa vie et ne jamais gagner autant qu'un ploutocrate en un après-midi. Et ce ploutocrate a souvent bénéficié d'un avantage initial grâce à l'héritage, aux bonnes écoles et aux bonnes connexions.
Ou, comme dirait Antonio Gramsci, l'individualisme possessif est hégémonique. Nos relations entre nous et avec la nature en viennent à paraître immuables. Même si, à un certain niveau, vous désapprouvez cet individualisme acquisitif—pour des raisons religieuses ou philosophiques—vous n'avez pratiquement pas d'autre choix que de vous y conformer dans votre vie quotidienne.
Mais voici le problème. Ce système d'hypothèses sociales, ce culte de l'accumulation de biens, ce régime de prestige et de pouvoir, et les rapports sociaux capitalistes qu'il incarne, mènent l'humanité à un effondrement civilisationnel. Ainsi, comme l'a dit prudemment Macpherson et comme l'a affirmé Gramsci, nos notions de propriété, de liberté et d'individualisme doivent être repensées, jusque dans nos présupposés les plus fondamentaux sur le monde social. La tâche de toute gauche sérieuse, et de tout parti véritablement de gauche, n'est pas d'accepter le statu quo, le capitalisme et l'ordre libéral, mais de les critiquer, les contester et les remplacer.
The Breach : Dans l'introduction d'une excellente anthologie sur le CCF-NPD intitulée Party of Conscience, vous décrivez le NPD comme représentant, au mieux, « une possibilité radicale partiellement réalisée » qui a atténué cet individualisme débridé dont vous parlez. Mais il a aussi souvent succombé à une révolution passive libérale où toutes les tendances véritablement démocratiques et radicales sont réduites au plus petit dénominateur électoral commun et absorbées par un Parti libéral toujours adaptable. Pouvez-vous expliquer les façons dont il a atténué cet individualisme débridé et celles dont il y a succombé ?
Ian McKay : Les grandes réalisations du mouvement de gauche au XX ? siècle—j'entends par là les sociaux-démocrates, les communistes et les mouvements sociaux égalitaires en général, unis par leur volonté de dépasser les rapports sociaux capitalistes—sont : les syndicats industriels, la santé publique, l'éducation publique, l'assurance-maladie, certaines mesures de sécurité sociale, la reconnaissance et la défense des droits des nations opprimées, l'écosocialisme, et l'égalité des genres et des sexualités. Toutes ces avancées ne devraient ni être dénigrées ni minimisées.
Mais à cause de la puissance durable de l'individualisme possessif et du capitalisme, chacune de ces avancées a été, avec le temps, intégrée et rendue relativement inoffensive par l'ordre libéral dominant. Prenons le cas du mouvement ouvrier. Des gens—y compris une légion de communistes de base et de socialistes radicaux—se sont battus, et certains sont morts, pour les syndicats au Canada. Comme historien du travail, je pense ici aux mineurs de charbon, mais il y en a bien d'autres. Ces luttes ont changé les choses. Les enfants de huit ans ne descendent plus dans les mines, des mesures de sécurité industrielle existent, et les travailleurs harcelés par leur patron peuvent faire appel à un représentant syndical. Avec le temps, les libéraux—farouchement et logiquement anti-syndicaux au départ, car les syndicats portaient directement atteinte aux « droits de propriété »—ont fini par accepter le syndicalisme, sous peine de voir l'ordre capitaliste sombrer dans le chaos. Les syndicats sont ainsi devenus de plus en plus respectables légalement. Nous n'attendons plus que des mitrailleuses soient pointées sur les grévistes—du moins pas au Canada, et pas en 2025.
Mais l'ordre libéral a exigé un prix pour ces avancées. Les syndicats sont devenus intensément légalistes. Aujourd'hui, il faut un avocat pour naviguer à travers les subtilités d'une convention collective moyenne. Les grèves existent toujours, mais contrairement aux grands moments de lutte systémique du passé ouvrier—les grandes grèves en Nouvelle-Écosse de 1909-1911 et 1921-25, la grève générale de Winnipeg en 1919, les luttes du CIO de 1937 à 1946, les luttes du Front commun au Québec dans les années 1970—elles tendent à être plus localisées et limitées. Elles portent rarement des revendications remettant en cause le système. Les syndicats défendent de plus en plus leurs intérêts corporatifs étroits sous un régime de « légalité industrielle ».
Un autre exemple de révolution passive est le système de santé public canadien, fruit en grande partie du CCF en Saskatchewan, qui a jeté les bases du régime pancanadien que nous connaissons aujourd'hui. Ce fut un défi énorme à l'individualisme possessif. Il signifiait que des individus « autonomes » ne pouvaient plus s'enrichir sur le dos des malades, des personnes fragiles et âgées. Il avait une portée universelle. Aujourd'hui, comparé aux États-Unis, un infarctus ou un diagnostic de cancer ne vous mènera (généralement) pas à la faillite au Canada. Si les socialistes n'avaient pas lutté âprement pour cette conquête de 1944 à 1962, traités de fanatiques délirants avides de priver les individus de leurs droits et libertés, les libéraux étant à la pointe de l'attaque, aucun de ces acquis ne ferait partie de la vie canadienne.
Mais regardez comment la santé publique universelle a été minée de l'intérieur par les intérêts corporatifs et l'individualisme. Les compagnies pharmaceutiques, les médecins et administrateurs grassement rémunérés, les hôpitaux fonctionnant comme des entreprises—ce qui semblait à beaucoup de socialistes être la conquête d'un droit humain fondamental a été progressivement affaibli par des libéraux prêchant la concurrence et pratiquant l'austérité. La pandémie récente a révélé, par exemple, à quel point les conservateurs acquisitifs et affairistes, dont une belle brochette de ténors conservateurs ontariens, ont remodelé les conditions de vie des personnes âgées, qui ont souffert et sont mortes en masse au Canada parce que les concepts égalitaires de soins universels de santé et aux aînés n'ont jamais vraiment été concrétisés.
De cette manière, et bien d'autres encore, l'ordre libéral absorbe, à petites doses homéopathiques, des éléments de l'égalitarisme socialiste. Mais une fois digérés, on ne reconnaît plus vraiment ce qui, à l'origine, constituait un défi radical à l'individualisme possessif. Ces acquis sont, pour ainsi dire, modifiés au point de devenir méconnaissables. Voilà, selon moi, la logique d'une révolution passive libérale. Et c'est la logique des deux grands partis libéraux du Canada—les Conservateurs (qui étaient il y a un siècle les Libéraux-Conservateurs) et les Libéraux (anciens Réformistes)—les seuls partis qui ont gouverné au niveau fédéral.
Regardez notre récente élection fédérale de 2025. Le NPD a subi une défaite historique—6,3 % du vote populaire, perdant son statut de parti officiel, son pire résultat de mémoire d'homme. Pourquoi ? Essentiellement parce que les partisans du NPD ont déserté en masse pour rejoindre le Parti libéral, vu comme un rempart contre Poilievre et l'extrême droite. Résultat : un Parti libéral pro-entreprises dirigé par un banquier central élu grâce aux votes de millions d'électeurs de gauche. C'est comme si l'ancienne boutade du premier ministre Mackenzie King (ce maître libéral des arts de la révolution passive), selon laquelle les CCF-NPDistes n'étaient que des « libéraux pressés » et non engagés dans la construction d'un nouvel ordre social, se voyait confirmée. Difficile de déceler, dans la dernière campagne électorale du NPD, la moindre remise en cause de l'ordre dominant. J'y vois la démonstration que les élites du NPD sont devenues elles-mêmes des partisanes de l'ordre libéral établi—et les socialistes démocratiques restés au sein du parti en ont payé le prix fort.
Le libéralisme, au sens large, érige l'individualisme possessif en religion séculière. Nous vivons dans une société où, à grande comme à petite échelle, l'individualisme possessif est omniprésent. C'est l'un des schémas les plus persistants de l'histoire politique canadienne. Le prix à payer pour ignorer cette réalité, ou y souscrire implicitement, c'est de perdre la raison d'être fondamentale du NPD. Voilà la leçon de 2025.
Il me semble que cette question de savoir comment l'ordre libéral, au sens large, doit être contesté remonte à la fondation même de la CCF. On considère généralement, dans l'histoire dominante, que la CCF a toujours été composée de sociaux-démocrates guidés principalement par des intellectuels de la classe moyenne, de tempérament modéré, qui fuyaient le radicalisme. Mais des travaux historiques récents ont révisé cette histoire des origines pour inclure des militants socialistes issus de la classe ouvrière et d'inspiration marxiste, qui ont tenté de créer un mouvement ancré dans des principes socialistes, tout en cherchant à obtenir un large soutien. Pouvez-vous en parler ?
Ian McKay : James Naylor, dans son livre The Fate of Labour Socialism, a vraiment, à mon sens, fait un travail brillant en montrant à quel point cette vision dominante de la CCF est limitée. Bien sûr, cette vision rend compte d'une partie de l'histoire du parti — les professeurs d'université issus de la classe moyenne, certains partisans modérés de l'Évangile social chrétien, tout un éventail de réformateurs sérieux de la classe moyenne. Mais ce qu'elle omet, comme le montre Naylor, c'est la force persistante d'un socialisme ouvrier défendant une alternative post-capitaliste. Comme le souligne Naylor, le Regina Manifesto, déclaration fondatrice de la CCF en 1933, reflète en grande partie l'influence des réformateurs de la classe moyenne sur le parti.
J'ai personnellement un faible pour ce Manifeste — il n'existe pas beaucoup d'autres manifestes socialistes dans le monde qui insistent sur la nécessité de passages à niveau ferroviaires, et son côté terre-à-terre et pragmatique reflète la volonté de répondre à des problèmes immédiats. Nous voulons acheminer nos récoltes vers le marché, bon sang ! Mais regardez la conclusion du Manifeste, qui déclare que nous ne nous reposerons pas tant que le capitalisme n'aura pas été éradiqué. Cela semble en décalage avec le reste du texte. Comme Naylor l'explique très bien, cela révèle en réalité la tension qui traversait le parti. Les socialistes ouvriers étaient trop faibles à Regina — voyager jusque-là leur coûtait cher, entre autres — pour imposer l'orientation de l'ensemble du Manifeste. Mais ils étaient assez forts pour exiger cette phrase finale percutante. Elle reflétait leur conviction (et la mienne) que le capitalisme, en tant que système, est cruel, irrationnel et qu'il appelle à être dépassé. Il existait — et il continua d'exister — un noyau de radicalisme au sein de la CCF que les récits dominants ont tendance à balayer sous le tapis ou à présenter comme l'œuvre d'excentriques inadaptés.
Comment analyseriez-vous l'évolution du parti dans les années 1940 et 1950 ?
Ian McKay : Les années 1940 furent une décennie charnière. Les communistes, qui constituaient une force puissante dans les années 1920 et 1930 — bien plus démocratique et enracinée à la base qu'on ne s'en souvient généralement — perdirent la lutte pour l'hégémonie à gauche, en partie, ironiquement, parce que la CCF avait appris d'eux de nombreuses techniques d'organisation et les avait dépassés sur leur gauche. Globalement, je pense que la CCF fut prise en main par une direction très issue de la classe moyenne dans les années 1940. Grâce à un excellent livre de J.F. Conway, The Prairie Populist : George Hara Williams and the Untold Story of the CCF, nous comprenons beaucoup mieux comment une partie des militants de la CCF, qui imaginaient un parti contestant les rapports de propriété capitalistes dans les campagnes, furent écartés par une direction plus centriste. Sous M.J. Coldwell, puis Tommy Douglas, le parti se rapprocha de plus en plus de positions libérales de gauche et recruta surtout dans les classes moyennes. Il s'engagea fortement dans la Guerre froide, y compris en soutenant la guerre de Corée, en partie pour affaiblir les communistes.
Mais même en dehors de ces lignées socialistes ouvrières marginalisées, il subsistait encore des éclats de socialisme affirmé. Make This Your Canada, publié en 1943 par Frank Scott et David Lewis — ce dernier étant une figure partagée entre le socialisme ouvrier et la Ligue pour la reconstruction sociale, plus bourgeoise, et qui fournit une direction intellectuelle à cette prise en main par la classe moyenne — imaginait un Canada gouverné par une planification socialiste. Incroyablement, ce n'est pas Occupy Wall Street qui inventa l'expression « les 99 % contre le 1 % », mais bien Scott et Lewis. Le livre se vendit à des dizaines de milliers d'exemplaires et fut un best-seller de son époque, étudié par les militants de la CCF à travers tout le pays.
Ian McKay : Oui, Make This Your Canada est un livre vraiment surprenant pour ceux qui adhèrent à l'idée que la CCF n'aurait été qu'un mouvement modéré, désintéressé de toute remise en cause du capitalisme, car l'hypothèse de base qui traverse le livre est que l'État doit gérer l'industrie.
On peut imaginer des exceptions où l'État ne s'en chargerait pas, mais l'essentiel de Make This Your Canada repose sur un État parlementaire socialiste efficace. Les auteurs rendaient hommage aux « labeurs titanesques » de Marx, et on les voit encore plaider pour un Canada socialiste dans lequel la propriété publique serait la norme. C'est sur la base de cette déclaration programmatique que la CCF obtint de bons résultats au milieu des années 1940. Le message résonnait bien, en particulier auprès des soldats — un sondage montra que la CCF devançait à la fois les libéraux et les conservateurs. C'est un livre frappant pour qui croit au récit dominant sur la CCF.
Dix ans plus tard, ce message socialiste avait été largement étouffé dans le parti.
Pourquoi ? D'abord, à cause d'une vaste campagne de peur après la Seconde Guerre mondiale, menée par les partis libéraux, soutenus par un bataillon de capitalistes influents, qui convainquirent de nombreux électeurs qu'un vote socialiste équivalait à un « suicide social » (pour reprendre le titre d'un de leurs pamphlets les plus célèbres et diffusés). Selon eux, si vous votiez pour la CCF, tout allait changer : vous ne pourriez plus prier dans vos églises, les familles seraient détruites, les femmes maltraitées par les praticiens de santé publique, l'Armée rouge occuperait Ottawa — et ainsi de suite. Cette propagande porta ses fruits, et on en retrouve encore aujourd'hui des échos dans les discours de la droite. La Guerre froide réduisit un mouvement communiste autrefois influent à un noyau pro-soviétique résiduel. De plus, le niveau de vie s'éleva pour beaucoup dans les années 1950 et début 1960.
À bien des égards, la CCF et son successeur, le NPD, sont devenus, dans les années 1950 et jusque dans les années 1960, une sorte de parti keynésien de gauche libérale. Le sens commun de l'époque était que la gestion keynésienne de la demande avait résolu les contradictions de l'économie capitaliste. Tous les discours sur le socialisme, la classe ouvrière et la propriété publique — toutes les notions de remplacement systémique du capitalisme — en vinrent à être considérés comme des antiquités du passé.
Dans ce contexte, le succès du gouvernement de la CCF de la Saskatchewan à mettre en place l'assurance-maladie, malgré les nombreux défauts de ce régime — surtout sur les questions autochtones et environnementales — fut exceptionnel, le produit de certains dirigeants qui firent de l'accès égal aux soins de santé une question de principe. Un Parti libéral fédéral en difficulté emprunta cette idée socialiste, l'édulcora et la revendiqua comme sienne. Avec le temps, bien sûr, les libéraux la trahirent à maintes reprises, le Parti libéral contemporain menant même la plus brutale attaque contre elle au milieu des années 1990.
Dans l'ensemble, il y eut un glissement marqué du parti vers la gestion du capitalisme, et non son renversement. La Déclaration de principes de Winnipeg ne dit presque rien sur la classe ou le conflit de classes. Les premiers pas vers le Nouveau Parti démocratique déroulèrent le tapis de bienvenue à tous les « Canadiens d'esprit libéral ».
Je pense donc qu'à la fin des années 1960, le NPD était un parti plutôt modéré. Ed Schreyer arriva au pouvoir au Manitoba comme premier ministre élu sous la bannière du NPD. Son gouvernement mit en place l'assurance automobile publique, qui resta une revendication constante du NPD des années 1960 aux années 1990 (symptôme du profond libéralisme du NPD de Bob Rae qui, après avoir fait campagne élection après élection sur cette base, abandonna même ce principe central). Dans l'ensemble, toutefois, le gouvernement Schreyer fut très modéré, et Schreyer lui-même reçut sa grande récompense des libéraux — la fonction de gouverneur général.
Nous voilà donc dans les années 1960, période de turbulences et de guerres impériales brutales, de nouvelles mouvances de gauche en effervescence, et de la contestation la plus connue de l'orientation du NPD : le Waffle. Parlez-moi de la façon dont vous percevez cela, avec plusieurs décennies de recul.
Ian McKay : Par souci de transparence, je devrais dire qu'au lycée, j'étais un membre mineur du Waffle, j'ai assisté au congrès de 1971 et milité pour Jim Laxer, le candidat du Waffle à la direction, qui força David Lewis jusqu'au quatrième tour de scrutin. Je garde encore de la sympathie pour ce mouvement. J'admirais Mel Watkins, l'autre dirigeant en vue du Waffle, et je suis devenu ami avec John Smart, figure clé en Ontario et (assez ironiquement) mon étudiant diplômé. Je ne suis pas un commentateur neutre. Un « Canada socialiste indépendant », slogan central du Waffle, est une idée que je défendrais encore aujourd'hui. Je n'ai joué aucun rôle important dans le mouvement, mais je l'ai vu — et je le vois toujours — positivement.
Comme historien de la gauche, cependant, je pense aussi qu'il est important d'évaluer les mouvements de gauche, y compris — peut-être surtout — ceux que nous favorisons, à la fois avec sympathie et avec réalisme. Dans ce cas, j'ai de la sympathie pour la façon dont le Waffle a capté une part de l'élan radical de la Nouvelle Gauche, que Peter Graham et moi, dans notre livre Radical Ambition : The New Left in Toronto, décrivons comme centré sur des principes tels que l'autogestion, la libération nationale et la communauté — et comment, un temps, il a réussi à faire percer l'idée d'un Canada socialiste indépendant à travers le blocus imposé par les médias libéraux canadiens contre les idées radicales.
Mais je suis aussi critique. Prenons le Manifeste du Waffle, débattu à Winnipeg à la fin des années 1960. Consultez-le en ligne, et vous verrez qu'il est rédigé de manière rigide, rempli de slogans, avec un anti-américanisme superficiel se substituant à une analyse du capitalisme mondial. Quand je l'ai relu récemment, je me suis dit : Vraiment ? C'est le mieux que nous pouvions faire ? Il n'y a rien sur les peuples autochtones, l'antiracisme, les femmes, les luttes LGBTQ+. Même sur le Québec, où le Waffle allait plus tard faire un travail important, le Manifeste semble prisonnier d'un modèle de « deux nations » hérité des libéraux et des conservateurs.
Ce qu'on oublie facilement, c'est que le Manifeste faisait partie d'un processus — et pas la partie la plus importante, à mon avis. La CBC a réalisé un documentaire fascinant sur la réunion fondatrice du Waffle, qui nous présente certaines de ses figures les plus importantes. Cela m'a révélé à quel point le document fut un travail bâclé, conçu pour frapper les esprits lors d'un congrès du NPD. Mais cela a aussi biaisé notre perception globale du mouvement, en donnant l'impression d'un cercle d'universitaires masculins complotant dans le salon torontois de Gerald Caplan. En réalité, le Waffle s'avéra bien plus ambitieux, inclusif et impressionnant que ne le laissent croire le Manifeste et ce documentaire. Il y eut de nombreux « mouvements Waffle » à travers le pays.
Par exemple, on pourrait croire — en voyant le documentaire et en lisant certains écrits — que le Waffle fut une affaire exclusivement masculine. Mais les femmes du Waffle furent une force avec laquelle il fallait compter. Elles menèrent de nombreuses campagnes, autour du droit à l'avortement et de l'égalité salariale. Elles défièrent les mouvements syndicaux rétrogrades et les NPD provinciaux sur la question des droits des femmes. Elles imposèrent l'idéal de la parité des sexes dans les principaux comités du parti, une proposition extrêmement contestée en 1971 et qui devint une pratique acceptée par le parti dès la décennie suivante. Le féminisme socialiste acquit au Canada une force supérieure à celle de bien d'autres régions du monde, avec des résultats durables.
De même, le silence du Manifeste du Waffle sur les enjeux autochtones ne doit pas être vu comme représentatif du mouvement. En Saskatchewan, les militants du Waffle mirent l'accent sur les droits autochtones, et Mel Watkins joua un rôle clé pour faire connaître la résistance autochtone au pipeline de la vallée du Mackenzie.
L'impression donnée par certains écrits est que le Waffle fut un phénomène éphémère centré en Ontario, sans réelle portée. La nouvelle historiographie suggère le contraire (et j'aimerais ici saluer une thèse de David Blocker à l'Université Western et les travaux de Roberta Lexier à l'Université Mount Royal, deux grandes contributions à la recherche). Elle montre que les expériences du Waffle variaient selon les régions. En Ontario, les militants du Waffle furent expulsés en 1972 à la demande de la direction du parti, inquiète des menaces venant des syndicats « internationaux » (c'est-à-dire basés aux États-Unis) dont le parti dépendait financièrement. Le Waffle avait commencé à s'implanter dans les mouvements ouvriers de certains endroits — Hamilton, Toronto, Sudbury, et même ma ville natale, Sarnia — ce qui agaça visiblement plusieurs figures syndicales puissantes.
Mais Blocker montre surtout qu'à travers le pays, les expériences furent diverses. Si, en Ontario, les militants du Waffle voulaient rester dans le parti et résistèrent à leur expulsion, au Manitoba et en Saskatchewan, ils s'éloignèrent du NPD dominant et ne se considéraient pas comme liés organiquement à lui. En Colombie-Britannique, selon Blocker, les militants du Waffle entrèrent tout simplement dans le parti et ne furent pas expulsés. Au Nouveau-Brunswick, le parti provincial passa sous le contrôle d'une direction liée au Waffle, ce qui alarma tellement le NPD fédéral qu'il reconstitua inconstitutionnellement le parti provincial d'en haut. Au Québec, l'insistance des militants du Waffle sur l'autodétermination créa des liens avec l'aile gauche du Parti québécois, et il n'est pas exagéré de dire que la position actuelle du parti sur le droit du Québec à tracer sa propre voie dans (ou hors de) la Confédération s'appuie sur des positions du Waffle des années 1970.
En somme, le récit établi — selon lequel l'expulsion du Waffle en Ontario en 1972 marqua la fin de son histoire — paraît de moins en moins convaincant. Le mouvement fut plus complexe et plus significatif à long terme qu'on ne l'avait d'abord imaginé.
Et certains enjeux de l'époque, comme la montée d'un nationalisme de gauche en réaction à l'impérialisme américain, semblent aujourd'hui revenir sur le devant de la scène.
Oui, et je pense que cela nous dit deux choses : d'abord, à quel point il est important de saisir cette histoire de façon précise et détaillée. Ensuite, à quel point le NPD a changé à partir des années 1990. Avant cela, le NPD mettait beaucoup l'accent sur l'indépendance canadienne, notamment en luttant pour un nouveau type de politique énergétique. Une chose que Blocker souligne, et que j'ai été stupéfait de découvrir, est que le NPD de l'Ontario avait officiellement approuvé lors d'un congrès la nationalisation d'Imperial Oil, une revendication du Waffle.
Je ne savais pas cela !
Ian McKay : Moi non plus, je ne le savais pas, avant de le découvrir dans son travail. L'évaporation de ce principe fondamental de la gauche — à savoir que nous contestons la propriété des grandes entreprises et la politique qui l'accompagne — aide à expliquer la parodie actuelle d'un premier ministre conservateur en Ontario et de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre à Ottawa se faisant passer pour le « Capitaine Canada ». Leurs partis respectifs ont défendu depuis des décennies l'intégration économique continentale capitaliste. Nous récoltons maintenant les fruits de leurs politiques. Le NPD devrait élaborer un mouvement de résistance populaire contre la prise de contrôle du Canada et dénoncer l'hypocrisie flagrante des partis libéraux dont les politiques nous ont conduits à notre situation actuelle de dépendance abjecte vis-à-vis de l'Empire américain.
Tu as déjà évoqué l'un des gouvernements provinciaux néo-démocrates des années 1970. Mais il semble vraiment que dans les années 1990, le NPD ait été confronté à un déclin de la capacité fiscale de l'État, à une rupture de ses liens avec la classe ouvrière, amorçant ainsi ce qui allait s'accélérer en une capitulation plus complète au néolibéralisme. Les conséquences furent nombreuses, mais au cours des années 2000, Brad Lavigne, l'un des principaux conseillers de Jack Layton puis brièvement de Mulcair, décrivait le parti comme ayant abandonné « les grands projets pour de petites choses faisables ».
Ian McKay : L'exemple classique ici est le gouvernement Bob Rae. Il est arrivé au pouvoir avec une majorité en 1990 (avec seulement environ 37 % des voix). Ils ont remporté le pouvoir sur un programme traditionnel du NPD — assurance automobile publique, etc. Ils ont instauré certaines bonnes mesures, comme une loi anti-briseurs de grève. Mais dès le tout début, ils ont été confrontés à une catastrophe économique : un Ontarien sur dix sans emploi, l'effondrement des grandes industries, et une dette provinciale qui inquiétait Wall Street. Après avoir expérimenté des approches keynésiennes de gauche, que les grands médias torontois ont fustigées, le gouvernement s'est tourné vers l'austérité. Il n'a pas réussi à maintenir son alliance avec le mouvement syndical et a même piétiné les droits de négociation collective.
En essence, il est passé de la social-démocratie au néolibéralisme. The Left in Power de Steven High, qui vient de paraître chez Between the Lines, offre une interprétation subtile et puissante de ce moment. Il va bien au-delà du Rae-bashing pour explorer les dilemmes structurels de son gouvernement, qui comptait à la fois quelques socialistes honnêtes et la cohorte habituelle d'opportunistes et de renégats.
Ce débâcle était un signe des temps. Partout au Canada, les néo-démocrates, même ceux officiellement opposés aux nouvelles orthodoxies néolibérales, en sont venus à les adopter eux-mêmes. En Saskatchewan, le régime a même supprimé de nombreux hôpitaux ruraux, ce qui a grandement contribué à miner son soutien dans les campagnes. En Alberta, le gouvernement néo-démocrate s'est adapté plutôt que de remettre en cause radicalement une économie fondée sur les combustibles fossiles, complice du changement climatique mondial. Les gouvernements néo-démocrates du Manitoba et de la Saskatchewan ont mis en place des programmes d'austérité néolibérale semblables à ceux imposés par les régimes conservateurs et libéraux ailleurs. Le gouvernement néo-démocrate de Darryl Dexter en Nouvelle-Écosse, obsédé par le déficit et limité à un seul mandat, s'est conformé essentiellement à ce modèle.
Pour un partisan constant d'un Canada socialiste indépendant, ces compromis étaient décourageants. Ils révélaient les limites d'un socialisme parlementaire dépendant du capitalisme. Dans tant de cas, les gouvernements néo-démocrates se débattaient d'urgence en urgence — et il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas, d'analyse globale sur la manière de répondre aux crises récurrentes du capitalisme d'une façon qui aille au-delà de l'atténuation de leurs conséquences. Steven High a une belle formule à propos de la « brume du pragmatisme ». Et une fois la brume dissipée, ce sont toujours les mêmes classes possédantes qui dirigent, comme elles l'ont toujours fait. Pas étonnant que tant de jeunes, condamnés à des vies de précarité permanente, aient si peu de foi dans le parti. Ils sentent bien que toutes les belles paroles ne changeront pas vraiment les réalités de leur existence.
Je soulignerais aussi le début de l'émergence d'un nouveau type d'opérateur néo-démocrate dans cette même décennie. Un professionnel hautement spécialisé de la politique qui, parfois en travaillant dans des firmes privées à but lucratif comme celles qui se sont formées au Manitoba au milieu des années 1990, est devenu membre d'une plus large coterie de consultants, spécialistes en communication et agences de publicité servant de tapis roulant à la politique néolibérale blairiste de la troisième voie. Leur paradigme est recyclé encore et encore dans toutes les campagnes provinciales et fédérales subséquentes du NPD.
Ian McKay : C'est un très bon point. On pourrait dire : « de Tommy Douglas au télémarketing ». Je pense qu'une fois que le NPD commence à se voir comme un parti qui joue simplement le même jeu que les autres, il veut naturellement gagner ce jeu. Comment y parvenir ? Eh bien, on engage des experts qui organisent des groupes de discussion, adaptent les publicités et élaborent des stratégies persuasives sur les réseaux sociaux — et ainsi de suite. Au bout du compte, le parti ne se distingue plus vraiment des autres partis.
Rae et Mulcair sont tous deux des symptômes de ce tournant loin d'une véritable alternative de gauche. J'ai presque apprécié Mulcair dans son rôle d'imitation de Perry Mason à la Chambre des communes, mais quelqu'un se souvient-il maintenant des scandales qu'il dénonçait si obsessionnellement ? Peut-on citer un discours de Jagmeet Singh qui remet en cause le système ? Ces figures ont été absorbées sans douleur par le système — un reflet du schéma persistant de la révolution passive libérale. L'histoire du CCF-NPD compte une longue liste de telles figures, exemples individuels de la révolution passive en action.
J'ajouterais que ceux qui se trouvent à la gauche de ce consensus néolibéral portent une certaine responsabilité dans cette situation désastreuse. Les intellectuels de gauche depuis les années 1980 — en économie politique, histoire, sociologie, études culturelles, théorie féministe — ont produit un travail important (puisque j'en fais partie, je suppose que je suis bien placé pour le penser). Mais, en partie à cause de la disparition du Waffle, en partie à cause de leurs façons de parler souvent obscures, ils ne parviennent généralement pas à atteindre les masses de travailleurs.
L'attaque actuelle contre le « marxisme culturel » est menée par des gens qui ont inventé un croquemitaine sur la base d'une absence totale de compréhension de la tradition qu'ils diffament. Mais leur message toxique trouve un écho parce que, dans une large mesure, les marxistes ont passé les quarante dernières années à se parler entre eux. Ils s'expriment souvent dans un langage qui dit en gros : « Nous ne sommes pas comme vous. »
La gauche a perdu sa capacité à parler aux gens ordinaires. Elle doit la retrouver. Et je ne parle pas de cette façon simplifiée de propagande néo-démocrate — « les gens comptent davantage, nous nous battons pour vous », etc. J'appellerais tout cela des formulations sans cerveau. Je parle de réellement comprendre où en sont les travailleurs aujourd'hui, de vraiment le saisir et de ne pas leur parler de haut.
Le résultat d'un NPD accommodant envers le néolibéralisme et d'une gauche inefficace est un sentiment généralisé que personne dans la politique fédérale n'est vraiment capable de faire une quelconque différence. Ayant abandonné les principes fondamentaux qui sous-tendaient le CCF et que le Waffle avait ravivés, les néo-démocrates traditionnels peinent à expliquer pourquoi les gens devraient voter pour eux et non pour les libéraux. Pourquoi s'attarder auprès de personnes qui ne savent pas qui elles sont et qui, au bout du compte, semblent tout à fait disposées à passer chez les libéraux chaque fois que cela leur convient ? La tragédie est qu'un tel conformisme ne nous aide pas à changer les dynamiques d'un système qui nous pousse tous vers une catastrophe multidimensionnelle — une « crise organique » de l'ordre établi, pour citer Gramsci. Cela nous détourne du travail de compréhension et de maîtrise de cette crise.
Parlez un peu de ce qu'est l'héritage, même dans l'histoire de la CCF et du NPD, en ce qui concerne ce travail intellectuel et culturel. Parce que je pense que vous avez vous-même souligné qu'à différentes époques — avec le socialisme ouvrier des années 1930, avec la pensée oppositionnelle des années 1960 qui a mené au Waffle, avec les féministes socialistes des années 1980 — il y a eu des moments d'effervescence intellectuelle. Qu'est-il advenu de tout cela ?
Ian McKay : L'un des grands mérites d'une lecture sérieuse, non polémique et réaliste de l'histoire de la gauche est qu'elle montre que, confrontés à leurs propres crises déchirantes du capitalisme, les militants de gauche au Canada ont souvent créé de puissants mouvements anticapitalistes. Au plus fort de la Grande Dépression et de la guerre froide, ils ont persévéré. Ils méritent d'être respectés comme nos ancêtres collectifs.
énération après génération, les militants de gauche au Canada nous ont légué de précieuses ressources de pensée et de lutte. Il est facile de sous-estimer la première génération des années 1890-1920, dont beaucoup concevaient le socialisme comme une science évolutive de la transformation et se considéraient comme des révolutionnaires. Ils ont fondé des revues, produit des livres et aidé à organiser des grèves massives. La deuxième vague de socialistes a été fortement influencée par la Révolution russe — et tous n'étaient pas membres du Parti communiste, loin de là. La troisième, incarnée par la CCF, s'est attachée à transformer les États canadiens existants et à les développer comme instruments de réorganisation de la société. La quatrième et la cinquième — la Nouvelle Gauche et les nouveaux mouvements sociaux — ont travaillé à partir des idées de libération sociale et personnelle face aux contraintes de la société capitaliste.
Puis est arrivé le néolibéralisme. Et le néolibéralisme n'est pas seulement une technique d'économie politique : c'est en réalité une philosophie totalisante et envahissante de la vie — un individualisme possessif dopé aux stéroïdes. Lorsqu'il a commencé à s'imposer au Canada, en grande partie à l'instigation des partis libéral et conservateur, mais ironiquement aussi avec l'aide de gouvernements provinciaux néo-démocrates, il est devenu difficile d'imaginer une gauche cohérente et théoriquement ambitieuse. Nous ne repartons pas de zéro — toutes ces générations passées de militants ont beaucoup à nous enseigner — mais nous devons imaginer une nouvelle formation de gauche au Canada, capable de défier le néolibéralisme tant sur le plan national que mondial.
C'est difficile, étant donné la puissance du néolibéralisme — qui est en essence un programme cohérent et systématique de démobilisation puis de destruction du mouvement ouvrier et de la gauche. Le système a cette capacité de normaliser ce qui ne l'est pas : une planète à l'agonie, une ploutocratie gavée face à des travailleurs réduits à des vies de misère, et même un génocide en cours défendu au nom de « l'Occident ». Pas besoin d'être marxiste — même si ça aide — pour voir que ces phénomènes étroitement liés constituent tous une menace directe, non seulement pour les travailleurs du monde entier, mais pour la civilisation humaine dans son ensemble. La prochaine formation de gauche devra placer cette menace au cœur de sa politique.
D'un autre côté, on a l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais dans ma propre vie, il existe une tendance culturelle contre-hégémonique et un appétit pour une pensée audacieuse et radicale, anti-corporatiste et anti-néolibérale. Mais il semble que le parti, le NPD, dans son état actuel, n'ait absolument aucune volonté de s'y engager, de l'alimenter, de l'éduquer.
Ian McKay : En effet. Dans son état actuel, le NPD ne fait presque aucun travail sérieux pour analyser le système social ou pour transformer la vision du monde de ses membres. Contrairement à l'époque où la CCF organisait des groupes d'étude consacrés à l'analyse socio-économique, où l'on s'attendait des communistes à étudier sans cesse, ou encore à l'époque où Make This Your Canada exposait avec finesse une politique très différente, le NPD actuel réagit passivement aux crises de l'ordre néolibéral.
Bien sûr, la rhétorique est encore parfois là — les gens avant les profits, mettre la communauté en premier, défendre les familles de travailleurs, etc. Mais si la rhétorique n'est pas suivie d'un travail acharné d'analyse et d'action, elle ne résonne pas. Le parti fait très peu d'éducation. Je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai eu l'impression qu'on me présentait un message cohérent du NPD allant au-delà d'une propagande simpliste.
Le parti ne mène pas non plus beaucoup de travail éducatif entre les élections (il y a certaines exceptions notables, comme les campagnes provinciales inspirées du NPD en Nouvelle-Écosse sur la crise du logement). Il n'a aucune présence intellectuelle dans la société civile — pas un seul quotidien reflétant une perspective contre-hégémonique. Ainsi, non seulement il lui manque une vision socialiste cohérente, mais il lui manque aussi le sens qu'il faut transformer la société civile pour obtenir un changement politique durable.
Rien de tout cela ne relève du pessimisme ou du fatalisme. Toutes ces tendances peuvent être combattues. Les formations de gauche passées l'ont fait. C'est un élément encourageant que l'on retrouve dans l'histoire de la gauche.
Au plus fort de la Dépression, alors que des gens étaient abattus pour avoir été au chômage, on a en réalité créé une opposition socialiste efficace et militante. Même chose dans les années 1960 : face au Vietnam, face à toutes les énormités de l'ordre capitaliste libéral, les gens ont massivement répondu et fait une différence significative. Il n'y a aucune raison que cela ne puisse pas se reproduire. Nous devons simplement réapprendre à le faire, encore une fois, en prêtant attention de manière réaliste à notre contexte spécifique et à la manière dont il peut être transformé, dans un exercice que Gramsci appelait la « reconnaissance ».
Quelque chose que vous avez dit avant l'enregistrement m'a frappé : il y avait en réalité beaucoup plus de place pour le débat et la dissidence, même, par exemple, à l'époque où le Waffle était actif, puis en voie d'être purgé, dans les années 1970.
Ian McKay : C'est exact. Il se passait beaucoup de choses dans ce moment du Waffle qui laissent penser que les dirigeants du parti étaient disposés à écouter et à prendre au sérieux sa critique. Par exemple, Stephen Lewis lisait avec une certaine sympathie le Waffle Manifesto avant de devenir le principal adversaire du mouvement. Ed Broadbent était proche du mouvement avant de s'en distancer (et comme je le lui ai rappelé dans une entrevue peu de temps avant sa mort, son professeur Macpherson, à l'Université de Toronto, lui avait sévèrement enjoint de retrouver son anticapitalisme). On avait le sentiment qu'un débat honnête sur les fondamentaux au sein du parti pouvait être une bonne chose.
Je ne retrouve plus cette impression aujourd'hui. Ce que je ressens du parti, c'est une tendance assez autoritaire à faire taire les dissidents potentiels. On pense à Sarah Jama, à Hamilton, expulsée parce qu'elle a été, sur la question de Gaza, une antifasciste prématurée. Ou aux divers candidats du NPD choisis par leurs associations de circonscription et ensuite rejetés par la direction. Il y a dans le parti un autoritarisme inquiétant qui permet aux dirigeants de réprimer les dissidents au lieu de les écouter. Dans un parti véritablement démocratique, on permet aux gens d'être en désaccord avec la ligne du parti et on en débat. On a des discussions franches et claires. Homogénéiser le parti, lui imposer une règle verticale et descendante, c'est le contraire de la démocratie.
À quoi attribuez-vous cela ? Car j'ai souvent souligné que des partis de droite, comme le Parti conservateur, entretiennent souvent une relation plus saine avec leur propre aile droite, en les utilisant comme chevaux de Troie pour déplacer les limites du débat acceptable. Alors que, du côté de la gauche, on trouve une orientation très différente. Est-ce une sorte de résidu du complexe de guerre froide du NPD ?
Ian McKay : Oui, en partie. Et un autre facteur de l'anti-intellectualisme de gauche a été le désintérêt de nombreux théoriciens de gauche pour s'engager avec les gens sur des questions qui comptent directement pour eux, dans un langage qu'ils peuvent comprendre. La montée du néolibéralisme a eu un effet extrêmement fragmentant sur une gauche déjà hétérogène.
Je pense que c'est aussi, et là je suis un peu autocritique, un aspect durable de la culture de gauche, depuis le XIXe siècle en réalité, où si je discute avec vous et que nous ne sommes pas d'accord, je vous déclare essentiellement ennemi, persona non grata, vous devez être expulsé du mouvement, votre nom traîné dans la boue. On voit cela tout au long des polémiques de Marx contre ses adversaires : Anti-Dühring. Mais qui se souvient de Dühring, franchement ? Personne ne s'en rappelle, alors que tout le monde se rappelle du Manifeste… qui fait 400 pages. La gauche a hérité de cette tendance, accentuée par beaucoup des nouveaux mouvements sociaux dans les années 1970. Je pense que c'est très contre-productif.
Les militants de gauche, souvent, à mon expérience, pensent que les gens devraient penser exactement comme eux. Ou ils imaginent que, s'ils accrochent une affiche avec la faucille et le marteau dans la cafétéria universitaire ou qu'ils utilisent certaines déclarations comme « nous, le peuple », ils parlent réellement au nom du peuple. Or, c'était le dilemme tragique classique des partis d'avant-garde dans les années 1970.
Ils se déclaraient « partis révolutionnaires ouvriers », ou quelque variante de ce nom, mais en réalité, il y avait très peu d'ouvriers dans ces partis. Et les gens de la classe ouvrière les ignoraient simplement. Ils ne comprenaient pas leur langage. Ils ne saisissaient pas leurs références historiques. Tout cela leur paraissait étrange et étranger.
Donc oui, la guerre froide est pour beaucoup là-dedans. Mais il y a aussi un certain élément d'autoritarisme de gauche, cette culture de l'anathème. Et dans les deux cas, il faut aller au-delà. Il faut développer de nouvelles façons de se parler qui ne soient pas de cet ordre. Pas seulement parce que c'est discourtois, mais aussi parce que cela rebute les gens.
Il me semble qu'aux meilleurs moments du parti, peut-être pas organisationnellement, mais dans certaines campagnes, les formations CCF/NPD ont su élaborer des critiques très efficaces du système économique et mener des campagnes percutantes. Je pense à la campagne de David Lewis en 1972, où il a ciblé de façon célèbre les « corporate welfare bums » (les parasites de l'aide corporative).
Ian McKay : Bon point. David Lewis, nourri dans les traditions marxistes juives, n'a jamais perdu le sens qu'un message central de la gauche devait être de dévoiler et de résister aux irrationalités du capitalisme. Bien qu'ardent combattant dans les campagnes de la guerre froide contre les communistes, je pense qu'il n'a jamais perdu ce sentiment sous-jacent que le capitalisme devait être combattu et dépassé. Sa campagne de 1972 s'est attachée à éduquer les gens sur la corruption du système, avec des entreprises se gavent à la mangeoire publique. Chaque jour, il y avait une nouvelle révélation sur le festin corporatif de l'État. Les médias ont largement relayé son message radical. La campagne n'était pas parfaite. Même le slogan central reprenait l'idée de « welfare bums », un reste du libéralisme traditionnel. Mais elle était encore bien meilleure que beaucoup des campagnes qui ont suivi, avec leurs mots creux et sucrés sur la justice et l'égalité.
Alors, avec votre « chapeau d'historien », quel conseil donneriez-vous à une formation émergente qui imagine que le NPD pourrait réaliser une partie de ce potentiel radical jamais concrétisé ?
Ian McKay : D'abord, je recommanderais de développer une conscience solide de ce que, depuis plus d'un siècle, la gauche canadienne a accompli contre des obstacles énormes. Il est facile de se laisser submerger par la crise organique actuelle de l'ordre capitaliste et d'oublier qu'elle se poursuit depuis longtemps. Les militants de gauche de l'époque de la Dépression, qu'ils soient communistes ou socialistes, confrontés à des droitiers prompts à tirer et à des conditions plus sombres que celles que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais, ont réalisé des prouesses étonnantes de résistance et de renouveau culturel, allant de la Marche sur Ottawa au théâtre d'agit-prop jusqu'aux premiers balbutiements du féminisme socialiste. Les militants de la Nouvelle Gauche, face à l'obscénité de la guerre du Vietnam et aux autorités complices, furent tout aussi impressionnants à leur manière. Le féminisme socialiste et la libération homosexuelle qui se sont développés au sein de la Nouvelle Gauche ont transformé les rapports de genre au Canada. Ces formations successives de la gauche ont fait une grande différence. La prochaine gauche peut en faire autant.
Ensuite, j'examinerais de près comment les expériences dans des contextes similaires à celui du Canada se sont déroulées. Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, La France Insoumise, l'ascension et la chute de Jeremy Corbyn, le phénomène Bernie Sanders aux États-Unis, les expériences socialistes en Colombie, au Brésil et au Chili : toutes méritent une étude attentive. On ne peut pas simplement importer des modèles d'ailleurs dans le contexte canadien, mais on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Elles peuvent servir à la fois d'avertissements et d'exemples inspirants.
Troisièmement, je travaillerais à développer des mouvements sociaux et culturels qui « entourent » le parti avec des militants véritablement engagés dans l'analyse et le dépassement du capitalisme. C'est une leçon que je tirerais du féminisme socialiste et de l'écologisme radical — deux courants qui ont acquis une influence significative en dehors du parti et auxquels celui-ci a dû répondre. Les féministes socialistes nous offrent un exemple de la manière de combiner l'activisme extra-parlementaire avec le travail à l'intérieur du parti — un thème favori, d'ailleurs, du Waffle, qui n'a jamais été seulement un mouvement centré sur le NPD et qui a souvent poussé pour un parti capable de mener des luttes au niveau communautaire.
Quatrièmement, je développerais et affinerais la critique de la propriété et du complexe culturel de « l'individualisme possessif ». Cela impliquerait de montrer, dans un langage terre-à-terre à la manière du CCF, à quel point il a été désastreux de traiter les droits de propriété comme des absolus. Bien sûr, les libéraux, comme ils l'ont fait dans leurs croisades passées contre les droits syndicaux, l'assurance-maladie, une politique étrangère indépendante, etc., lanceront le cri que les socialistes veulent dépouiller les gens ordinaires de leur logement et de leur voiture. En tant que croyants fidèles à l'ordre établi, c'est leur rôle idéologique. Mais le nôtre est de souligner à quel point la société qu'ils défendent si ardemment est autodestructrice, irrationnelle et cruelle. L'enjeu est l'éradication de la propriété capitaliste et des rapports sociaux qui l'accompagnent, et non la confiscation des petites possessions qui protègent les gens ordinaires des ravages du marché. Entre libéraux et socialistes, il existe une rivière de feu. Il n'existe pas de « bloc progressiste » qui unirait les deux.
Et cinquièmement, pour revenir au point de départ de notre conversation, il s'agit d'avoir une analyse du libéralisme et une alternative à celui-ci. Depuis au moins les années 1920, les processus de révolution passive libérale ont aspiré de nombreux militants de gauche à imaginer que les libéraux (et, dans bien des cas, le Parti libéral) sont nos amis. Depuis un siècle, cette confusion a été désastreuse pour la gauche — comme l'a montré de manière si douloureuse la récente élection. Nos deux partis dominants, ainsi que leurs homologues pseudo-populistes, doivent être contestés radicalement — tant sur leurs principes sous-jacents que sur leurs pratiques. Se rapprocher des libéraux, c'est la mort pour la gauche. Ils ne sont pas nos amis.
Beaucoup des nouveaux mouvements sociaux apparus depuis les années 1970 ont été des exemples admirables de telles critiques efficaces. Ils se sont appuyés sur les idées de la nouvelle gauche des années 1960 et 1970 en matière d'autonomisation des communautés, de soulèvement des groupes opprimés et de revendication d'un avenir meilleur. Mais je pense que ce qui manquait à beaucoup de militants de la nouvelle gauche des années 1960, et qui manque aussi à beaucoup de militants actuels, c'est la nécessité d'un mécanisme de coordination, d'un organe général permettant de mettre en dialogue ces divers mouvements sociaux afin qu'ils créent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Seul un tel corps cohérent peut tirer des leçons des expériences passées et chercher à les transmettre à une population plus large. On a encore besoin d'un parti, malgré tous les problèmes inévitables qu'il comporte. Un parti dans lequel les gens peuvent véritablement confronter leurs divergences et élaborer un programme. Peut-être que ce parti pourrait même être un NPD fondamentalement transformé.
Merci d'avoir trouvé une lueur d'espoir pratique et de possibilité dans une histoire qui n'a pas toujours été porteuse d'espoir. Merci pour votre temps, Ian.
Ian McKay : Avec plaisir.

Sur le génocide de Gaza et sa négation

Ce n'est pas qualifier la guerre d'Israël de génocide qui est tendancieux. C'est le rejet de cette qualification qui relève de la négation de génocide (une catégorie qui inclut la négation de la Shoah).
Tiré du blogue de l'auteur.
4 septembre 2025
Dès le début de la riposte israélienne à l'opération Déluge d'al-Aqsa du 7 octobre 2023, il était clair que l'État sioniste avait lancé une guerre plus meurtrière et plus destructrice que toutes ses guerres précédentes. C'était là le résultat de l'interaction entre le gouvernement le plus extrémiste de l'histoire de cet État et l'attaque la plus grave lancée par une organisation palestinienne armée dans l'histoire de la résistance palestinienne. Ce que j'avais prédit dans mon premier commentaire sur les événements, trois jours seulement après l'opération menée par le Hamas, s'est malheureusement réalisé à la lettre :
L'opération Déluge d'al-Aqsa a permis de réunifier une société israélienne qui souffrait d'un profond schisme et d'une grave crise politique. Elle a permis à Benyamin Netanyahou et à ses collègues de l'extrême droite du mouvement sioniste d'entraîner avec eux les sionistes du camp politique opposé en préparation d'une guerre qui prend de plus en plus et de manière alarmante les caractéristiques d'une guerre génocidaire. Cela commence par l'imposition d'un blocus total, y compris électricité, eau et nourriture, à toute la bande de Gaza et sa population de près de deux millions et demi d'habitants. Il s'agit d'une violation flagrante et extrêmement grave du droit de la guerre, qui confirme que les sionistes se préparent à commettre un crime contre l'humanité du plus haut calibre.
Depuis la création de l'État d'Israël, la droite sioniste rêve d'achever ce qui a commencé avec la Nakba de 1948 par une nouvelle expulsion massive des Palestiniens de l'ensemble des territoires de la Palestine entre le fleuve et la mer, bande de Gaza comprise. Il ne fait aucun doute qu'ils voient maintenant ce qui s'est passé samedi dernier comme un choc qui leur permettra d'entraîner le reste de la société sioniste derrière eux dans la réalisation de leur rêve à Gaza d'abord, en attendant l'occasion de le mettre en œuvre en Cisjordanie. La gravité de ce qui s'est passé en Israël samedi dernier est susceptible d'atténuer l'effet dissuasif de la prise d'otages par le Hamas, contrairement à ce qui s'est passé lors des précédentes séries de confrontations entre le mouvement et l'État sioniste. Il est très probable que cette fois-ci, ce dernier ne se contentera de rien de moins que de la destruction de la bande de Gaza dans une mesure dépassant tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, afin de la réoccuper au moindre coût humain possible pour Israël et de provoquer le déplacement de la majeure partie de sa population vers le territoire égyptien, le tout sous prétexte d'en éradiquer complètement le Hamas. (« Le Déluge d'al-Aqsa risque d'emporter Gaza », Al-Quds al-Arabi, 10 octobre 2023, en arabe).
Pour s'en apercevoir, il n'était nul besoin d'être doté d'un pouvoir de prédiction singulier ; cela était plutôt clairement visible pour quiconque voulait voir et n'était pas aveuglé par l'idéologie, les émotions ou les illusions. Trois jours plus tard, le 13 octobre 2023, moins d'une semaine après le début de la tragédie, Raz Segal, professeur d'études de l'Holocauste et du génocide à l'Université de Stockton aux États-Unis (et citoyen israélien), publiait un article retentissant sur le site web du magazine progressiste américain Jewish Currents, commentant ce qui avait commencé à se dérouler à Gaza sous le titre « Un cas d'école de génocide ». Segal mettait en exergue la dure réalité de la prolifération des déclarations de responsables israéliens indiquant une intention génocidaire explicite, associée au meurtre indiscriminé de civils à Gaza et aux incitations et mesures visant à leur déplacement.
Depuis les premiers jours de la guerre d'Israël contre Gaza, la « guerre des récits » fait intensément rage, parallèlement à l'horrible assaut militaire. Il a fallu des semaines, voire des mois, avant que le débat ne se déplace de la pertinence de comparer l'opération Déluge d'al-Aqsa aux pogroms des Juifs dans l'histoire européenne, jusques et y compris le génocide nazi, à la pertinence d'appliquer le concept de « génocide » à ce que l'État d'Israël fait dans la bande de Gaza.
Un an après le début de l'invasion, les condamnations de ce qui se déroulait à Gaza en tant que génocide ont commencé à se multiplier, qu'elles soient émises par des organisations juridiques, des organisations de défense des droits humains ou des groupes universitaires. Il s'agit, entre autres, des accusations portées par la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, et des rapports publiés par Amnesty International, Human Rights Watch, la Rapportrice spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, ainsi que, plus récemment, par deux organisations israéliennes : le Centre israélien d'information sur les droits humains dans les territoires occupés (connu sous le nom de B'Tselem) et Médecins pour les droits humains (Physicians for Human Rights).
La position retentissante la plus récente à cet égard est la résolution adoptée par l'Association internationale des universitaires spécialistes du génocide (IGSA) le 31 août, qui a été soutenue par 86 % des votants parmi les 500 membres de l'association. La reconnaissance que ce qui se passe à Gaza est un génocide est devenue si largement partagée que le débat est maintenant passé de l'accusation selon laquelle qualifier la guerre d'Israël de génocide serait tendancieux à l'accusation selon laquelle le rejet de cette qualification relève de la négation de génocide (qui inclut la négation de la Shoah). Cette accusation a été lancée avec force par Daniel Blatman, un historien israélien spécialisé dans l'histoire de la Shoah et professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, dans un article publié le 31 juillet dans Haaretz sous le titre « L'identité de victime qu'Israël s'est forgée au fil des générations alimente aujourd'hui sa négation du génocide à Gaza ».
L'un des exemples les plus déplorables de négationnisme est un article publié dans le Jerusalem Post par l'avocate israélienne Nitsana Darshan-Leitner, présidente de l'Israel Law Center (Shurat HaDin), qui défend l'État sioniste devant la Cour pénale internationale. L'article, publié le 28 juillet, a peut-être contribué à inciter Blatman à écrire le sien. Dans cet article, l'avocate répond avec véhémence à Omer Bartov, également professeur d'études de l'Holocauste et du génocide, enseignant à l'Université Brown aux États-Unis, qui a publié un article dans le New York Times le 15 juillet intitulé « Je suis spécialiste du génocide. Je sais reconnaître un génocide quand j'en vois un ».
Le déplorable dans l'article de Darshan-Leitner atteint son apogée lorsqu'elle critique la description par Bartov des actions d'Israël comme constituant un génocide, en affirmant que cela « déprécie » le terme et « efface l'horreur unique » des génocides internationalement reconnus, parmi lesquels l'autrice mentionne ce qui s'est passé en Bosnie. Le fait est que le génocide bosniaque, qui a eu lieu pendant la guerre de Bosnie dans la première moitié des années 1990, a entraîné la mort d'environ 30 000 personnes et le déplacement d'environ un million de non-Serbes sur un total de 2,7 millions (soit 37 %). Qu'en est-il alors de ce qui se passe à Gaza, où le nombre de morts directes a jusqu'à présent atteint environ 64 000 (sans compter les morts inconnus sous les décombres et les morts indirectes, qui dépassent de loin le nombre de morts directes) et le déplacement d'environ deux millions sur un total de 2,2 millions (c'est-à-dire plus de 90 %) ? Comment cet horrible résultat peut-il « déprécier » le concept de génocide et « effacer son horreur unique » en comparaison de ce qui s'est passé en Bosnie ?
La vérité, qui devient de plus en plus difficile à nier, est que le génocide en cours à Gaza, tant en termes de proportion de la population totale qu'en termes de degré de brutalité de ses auteurs, est déjà entré dans l'histoire comme l'un des cas les plus horribles de génocide que le monde ait connus depuis la Seconde Guerre mondiale, surtout de la part d'un État industrialisé dont la distinction technologique même, adossée à l'État le plus puissant de la planète, lui a permis de se distinguer dans la barbarie.
* Dernier ouvrage paru : Gaza, génocide annoncé. Un tournant dans l'histoire mondiale.
Traduit de ma chronique hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 2 septembre. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les Etats-Unis dans la zone crépusculaire

Dans cette zone crépusculaire des Etats-Unis post-constitutionnel, où la Constitution est remise en question par le deuxième mandat de Trump, des conflits imbriqués sont en train de converger. Ni l'ordre national ni l'ordre mondial ne sont plus « fondés sur des règles » de la manière dont on le pensait auparavant. Les conséquences sont imprévisibles, mais risquent d'être explosives.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
30 août 2025
Par Against the Current
Chicago : défense des droits des immigrés lors du 1er mai. (Sarah Jane Rhee)
Bien évidemment, les socialistes sont les critiques les plus virulents de l'ordre constitutionnel tant vanté des États-Unis, avec toutes ses barrières antidémocratiques solidement ancrées. Et « l'ordre international fondé sur des règles » a toujours signifié pour les pays du Sud une domination et une exploitation impérialistes, un endettement écrasant et des massacres.
Nous reconnaissons toutefois que les offensives actuelles menées par la droite et les forces ultra-racistes et suprémacistes chrétiennes, facilitées par le cloaque sans fond dans lequel se vautrent Trump et ses acolytes corrompus, visent clairement à paralyser les droits et libertés démocratiques fondamentaux, et non à les étendre. Cela doit être le point de départ de toute discussion sérieuse sur la situation actuelle. Les crises qui requièrent une attention particulière à l'heure actuelle sont les suivantes :
1) La destruction génocidaire de Gaza et la menace imminente qui pèse sur la survie du peuple palestinien sur sa terre. L'impérialisme américain est indifférent au sort de la Palestine : n'importe quelle issue lui convient, tant qu'il y a « stabilité » et suprématie américaine au Moyen-Orient.
Mais le gouvernement israélien actuel, et le mouvement néonazi des colons qui dicte son programme, envisagent un avenir dans lequel aucune population palestinienne substantielle ne viendrait entraver l'expansion du « Grand Israël ». Ce projet exige le déplacement massif de la population de Gaza (et de Cisjordanie), mais il n'y a bien sûr nulle part où les envoyer.
La réalité de la privation généralisée de nourriture à Gaza, telle qu'elle avait été prédite avec précision il y a plusieurs mois, ne peut plus être cachée à la communauté internationale ni à l'opinion publique américaine, d'où l'effondrement du soutien à Israël et à la politique américaine, en particulier parmi les jeunes et les électeurs du Parti démocrate. À l'échelle mondiale, le spectacle de cette catastrophe est en train de détruire le prestige et l'image de « pays pilote » des États-Unis, même si cette dynamique n'est pas encore assez rapide.
En attendant, ce « crime impérialiste du siècle » alimente directement la politique américaine. Le gouvernement Trump exerce une dictature et fait chanter les universités américaines en utilisant comme arme la diffamation pour dénoncer « l'antisémitisme rampant sur les campus » (voir l'analyse détaillée de Purnima Bose sur l'université de l'Indiana dans ce numéro).
Règne de la terreur dans les communautés immigrées
2) La majeure partie de la population américaine ne vit pas dans les conditions d'un État policier. Mais une partie importante de la population est confrontée précisément à cette réalité : les familles et les communautés immigrées — et pas seulement les sans-papiers, qui peuvent à tout moment être arrêtés par des agents masqués de l'ICE dans des fourgons banalisés, pour être incarcérés dans des camps de détention de masse, puis expulsés sans ménagement. La majorité d'extrême droite de la Cour suprême (il est tout à fait trompeur de la qualifier de « conservatrice ») a encouragé ces pratiques dans une série de décisions qui sont dénoncées avec vigueur dans les mises en garde éloquentes des juges Jackson et Sotomayor en particulier.
Outre le caractère proprement cruel de ce sadisme gratuit, les vagues de raids anti-immigrés, les mises en détention et les expulsions — sans possibilité de recours — vers des pays tiers (El Salvador, Guatemala, Soudan du Sud !) constituent la principale méthode utilisée par le régime Trump pour expérimenter l'exercice d'un pouvoir exécutif illimité, passant outre les procédures légales établies et les protections constitutionnelles en vigueur depuis longtemps.
Ces méthodes peuvent être étendues à tout le monde, citoyen.ne.s, résident.e.s ou autres. Le recours à des rafles massives, la proclamation de « situations d'urgence nationale » manifestement fondées sur des prétextes frauduleux pour déployer la Garde nationale et l'armée dans les rues, la démonisation de communautés de personnes bénéficiant d'un statut protégé par la loi (« ils mangent les chiens ! »), la révocation définitive de leur statut... Tout cela peut être le signe avant-coureur de mesures qui seront prises à l'encontre de populations plus larges.
Les administrations précédentes préféraient maintenir les expulsions et les déportations pour l'essentiel sous le radar, tandis que pour Trump et ses conseillers clairement fascistes comme Stephen Miller, il s'agit d'être aussi transparent et brutal que possible. Cela satisfait la base du MAGA et terrorise les communautés avec le spectre des disparitions, de « Alligator Alcatraz », de Guantanamo et de la prison-centre de torture salvadorienne CECOT.
Cette campagne pourrait entraîner une vague d'auto-expulsions de personnes pour qui il est tout simplement insupportable de vivre et de travailler dans le climat de terreur d'un État policier. D'un autre côté, les initiatives communautaires et les actions juridiques en défense des immigrant.e.s se multiplient, tandis que grossit le sentiment général de dégoût suscité par les arrestations lors des audiences judiciaires, les expulsions expéditives de jeunes et d'immigrant.e.s qui travaillent et vivent aux États-Unis depuis des décennies, voire depuis leur enfance.
Les expulsions et les rumeurs d'expulsion peuvent également avoir des effets dévastateurs dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, de l'hôtellerie et de la restauration. Le fait est que le système d'immigration américain, défaillant et restrictif, est incompatible avec la dépendance réelle d'une grande partie de l'économie à l'égard du travail effectué par les immigré.e.s.
Le test du droit du sol
3) La tentative flagrante de Trump d'abolir le droit du sol constitue le premier défi posé à toute limitation du pouvoir exécutif arbitraire. Cette initiative a été bloquée par des décisions de justice et sera finalement examinée par la Cour suprême, à majorité d'extrême droite, dont la légitimité est également mise en cause.
Rien dans la Constitution américaine, et même peu de choses dans la langue anglaise, ne peut être plus clair que le libellé simple du quatorzième amendement adopté après la guerre civile, selon lequel toutes les personnes nées aux États-Unis « et soumises à leur juridiction » (c'est-à-dire autres que les familles de diplomates non soumises à la loi américaine) sont « citoyennes des États-Unis et des États où elles résident ».
Outre l'importance évidente que cela revêt en soi pour les personnes et les familles concernées, la suppression du droit à la citoyenneté par naissance rendrait effectivement toutes les protections constitutionnelles en vigueur, du premier amendement au droit de vote, tributaires des caprices du pouvoir exécutif.
Il en résulterait un vide béant quant à ce qui définit les conditions ouvrant droit à la citoyenneté, ou le pouvoir de l'accorder ou de la retirer, et créerait toute une classe de personnes apatrides de naissance, dépourvues du « droit d'avoir des droits » (comme l'a si bien formulé Hannah Arendt). Plus encore, la machine Trump est prête à tenter de retirer leur citoyenneté à un grand nombre de ressortissant.e.s américain.e.s naturalisé.e.s.
Si la Cour suprême – qui a déjà interdit aux tribunaux de district de prendre des arrêtés à portée nationale contre le pouvoir exécutif arbitraire – autorisait finalement le gang Trump à supprimer la citoyenneté par droit de naissance, toutes les protections constitutionnelles seraient réduites à un simple décor (y compris l'autorité de la Cour elle-même), ce qui ouvrirait la perspective d'un véritable cirque où chaque État définirait sa propre conception de la citoyenneté.
Comme dans ce scénario presque inimaginable, il n'est pas tout à fait garanti que le pays en sorte indemne, il semble logique de supposer que la tentative de Trump de s'attaquer au droit du sol sera stoppée.
Mais il y a déjà deux juges d'extrême droite (Thomas et Alito) pour lesquels aucune mesure de protection ni aucun acquis, pas même (par exemple) le droit à la contraception, n'est à l'abri d'une remise en question. Comme dans d'autres circonstances, le degré d'intérêt et d'attention du public influera sur l'issue juridique de cette véritable crise constitutionnelle.
Des contradictions explosives
4) La cupidité et l'indolence extrêmes de la classe dirigeante américaine, ainsi que le racisme à peine dissimulé d'une grande partie de celle-ci, rendent une grande partie du programme économique de Trump très attrayant pour le capital.
Mais en imposant des droits de douane de manière débridée (et souvent illégale), Trump menace la stabilité de l'économie américaine et mondiale, notamment en risquant de provoquer une récession de type « stagflation » et une hémorragie potentielle du marché obligataire, qui, via la vente de bons du Trésor, est absolument essentiel au financement de la dette américaine. Une catastrophe de l'ampleur de l'effondrement du marché immobilier de 2008-2009 ou de l'impact de la pandémie de Covid se profile à l'horizon.
Certains éléments du programme de tarification douanière ont un sens d'un point de vue impérialiste. Si les États-Unis veulent dominer le monde (ce qui n'est pas notre objectif, mais certainement celui du capital américain), ils ont besoin d'industries nationales de l'acier, de l'aluminium et des semi-conducteurs.
Mais en imposant des droits de douane généralisés, y compris à des alliés amis qui sont essentiels dans la confrontation entre les États-Unis et la Chine, ils ne font que mettre en place une taxation régressive qui pénalise les consommateurs américains les moins aisés et frappe le plus durement les plus pauvres, tout en obligeant le Canada, le Mexique et les pays européens à se démener pour trouver des partenaires commerciaux plus diversifiés.
Même cela n'est rien comparé au démantèlement du gouvernement fédéral par Trump et DOGE. Il ne s'agit pas vraiment de réduire les coûts, mais plutôt de détruire les éléments du gouvernement qui fonctionnent bien et fournissent des services essentiels, allant de la surveillance des phénomènes météorologiques dangereux à la fourniture de données économiques précises, sans oublier les menaces terrifiantes pour la santé publique que représentent les annulations de programmes de développement de vaccins et le démantèlement du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Les observateurs sont stupéfaits de voir les « conservateurs traditionnels » républicains se soumettre au culte de Trump, approuvant les nominations au Cabinet, les coupes dans Medicaid et d'autres mesures budgétaires dont ils savent pertinemment qu'elles sont désastreuses.
Le grand « magnifique » projet de loi met le pays sur la voie de la faillite (3 400 milliards de dollars ajoutés à la dette sur 10 ans), expose les hôpitaux ruraux et certains hôpitaux urbains à un risque extrême en raison des coupes dans Medicaid, élimine des travaux de recherche scientifique essentiels et les capacités d'alertes météorologiques pour les événements extrêmes, et provoque toute une série d'autres catastrophes.
Ce qui pourrait sauver les Républicains d'une violente réaction politique, c'est le fait que le Parti démocrate est, à bon droit, encore plus impopulaire et dépourvu de toute stratégie identifiable au niveau national.
Quel est l'objectif ?
L'administration Trump n'a pas hérité d'une crise profonde et immédiate. Il existe des problèmes à long terme liés à l'appareil fédéral, et certainement un impératif impérialiste face à la rivalité croissante et à la confrontation potentielle avec la Chine. Certaines choses, comme l'enseignement supérieur, sont de moins en moins accessibles financièrement (un problème que la volonté de transformer nos universités en succursales de la Trump University aggrave au lieu de le régler).
Rien de tout cela ne justifiait la destruction totale des services publics ou les violentes attaques policières contre les communautés d'immigrants vulnérables.
Si l'on réfléchit à des exemples de régimes réactionnaires ou autoritaires, leurs politiques servent en général un objectif identifiable. La présidence Reagan des années 1980 a commencé par une forte récession provoquée par les hausses des taux d'intérêt décidées par Paul Volcker pour juguler l'inflation, puis a donné naissance à l'« économie de l'offre » néolibérale, avec des conséquences désastreuses pour la classe ouvrière, mais des avantages très tangibles pour les profits et la « stabilité » du capital.
Le coup d'État de Pinochet au Chili en 1973 a permis de contrer une potentielle révolte révolutionnaire de la classe ouvrière et a donné lieu à des « réformes » sauvages en faveur du libre marché qui, au moins au début, ont satisfait le capital et certains secteurs de la classe moyenne.
Même si l'on considère des régimes totalitaires extrêmes, les premières années du régime hitlérien ont relancé l'économie allemande, renforçant ainsi sa base politique. Et la période initiale du régime stalinien (au milieu des années 1920) en Union soviétique a été marquée par une reprise économique et quelques années relativement favorables pour la paysannerie, avant le virage violent vers la collectivisation forcée, qui a entraîné une famine génocidaire en Ukraine et d'autres horreurs.
Sans vouloir en aucun cas mettre ces exemples disparates sur un pied d'égalité, chacun d'entre eux représentait un projet de classe et/ou une réponse à des crises. Le programme de Trump, mis à part quelques points stratégiques identifiables de nationalisme économique (par exemple, les droits de douane sur l'acier) et de capacité militaire (l'expansion effrayante des capacités de guerre à l'intelligence artificielle et à la technologie spatiale, catastrophiques en elles-mêmes), produit plus de problèmes qu'il n'en « résout ».
Des spéculations circulent quant à la possibilité que les élections de mi-mandat de 2026 soient annulées sous un prétexte « d'urgence ». Cela ne semble guère nécessaire. Le découpage électoral partisan extrême déjà en cours, à nouveau rendu possible par la Cour suprême, pourrait faire l'affaire dans un pays où l'électorat national est divisé de manière très serrée. Nous assistons également aux tentatives de Trump de restreindre fortement les nouvelles inscriptions sur les listes électorales, aux menaces juridiques et au harcèlement dans les bureaux de vote, ainsi qu'à la tentative de modification du recensement.
Nous comprenons comment les racines profondes de l'ascension de Trump sont alimentées par la croissance effroyable des inégalités, les craintes justifiées d'une grande partie de la population qu'elle et ses enfants n'aient pas d'avenir abordable, et les contradictions d'un colosse impérial qui cherche à dominer le monde alors que sa société intérieure est confrontée à la stagnation, voire pire.
La zone crépusculaire institutionnelle créée par Trump et sa secte présente de nombreuses caractéristiques effrayantes et des résultats potentiels encore plus désagréables, y compris ce qui pourrait devenir une « crise post-constitutionnelle » à part entière. Nous n'avons fait qu'effleurer quelques-unes des menaces centrales de la nouvelle présidence Trump - la première fois sous forme de farce, la seconde sous forme de tragédie.
Ce qui en résultera dépendra fortement de la manière dont la population, les mouvements sociaux et surtout les travailleurs et les syndicats réagiront. L'initiative « May Day Strong » des secteurs activistes du mouvement ouvrier n'est qu'un début. La classe ouvrière ne doit pas être spectatrice de sa propre destruction, ni de la famine génocidaire de Gaza.
La rédaction, Against the Current
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro.
Source - Against the Current No. 238, September-October 2025, Samedi 30 août 2025 :
https://againstthecurrent.org/atc238/letter-from-the-editors-in-twilight-zone-usa
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

France - Le 10 septembre on bloque tout, le 18 on continue !

La crise politique s'accélère à l'approche du vote de confiance du 8 septembre, qui pourrait faire tomber le gouvernement Bayrou. Deux dates de mobilisation émergent : le 10 septembre pour « tout bloquer » et le 18 septembre à l'appel de l'intersyndicale. L'enjeu : construire un mouvement durable et offensif.
Hebdo L'Anticapitaliste - 765 (04/09/2025)
Par Le Comité exécutif du NPA
Depuis l'annonce du vote de confiance pour le 8 septembre, et la probable chute consécutive du gouvernement, la crise politique ne cesse de s'approfondir en France. Il faut d'abord en prendre la mesure : si Bayrou tombe, quatre Premiers ministres se seront succédé depuis 2022, un record sous la 5e République. Bayrou s'est ainsi vu obligé de rassurer un patronat très inquiet à l'université d'été du Medef. Dans les rangs de la majorité, certains appellent déjà à reculer sur la suppression des deux jours fériés, comme Bruno Retailleau ou Yaël Braun-Pivet.
Le bal des prétendants au fauteuil de Premier ministre a déjà commencé, depuis Darmanin jusqu'au Parti socialiste qui se déclare, seul et en dehors de l'alliance moribonde du NFP, prêt à gouverner. La possible dissolution de l'Assemblée nationale pourrait de reconduire une assemblée tripartite sans majorité claire ou d'ouvrir davantage la voie à l'extrême droite.
L'heure n'est pas à chercher des réponses institutionnelles ou électorales à la crise, elle est à l'organisation et au développement de la mobilisation. Les réunions et assemblées qui se tiennent dans de nombreuses villes connaissent une dynamique ascendante et témoignent de la colère et de la détermination des participantEs.
En somme, la crise politique continue et s'aggrave. Tout repose sur notre capacité à la faire exister et à l'approfondir dans la rue.
L'appel à « tout bloquer » le 10 septembre
L'appel à « tout bloquer » le 10 septembre est bien sûr un point d'appui pour cela. La composition sociale et politique du mouvement a été analysée par le politologue Antoine Bristielle, à partir des réseaux sociaux de la mobilisation, sur les réponses d'un millier de personnes1. Il en ressort que même si 27 % d'entre elles étaient Gilets jaunes en 2019, leur composition sociologique est différente. Il s'agit de personnes clairement politisées à gauche : aux dernières présidentielles, 70 % ont voté LFI, 10 % NPA. Elles ont ensuite un profil plus jeune, mieux intégré et plus diplômé que la moyenne. Néanmoins, certains liens peuvent être faits avec les Gilets jaunes — ainsi, les personnes mobilisées proviendraient plus des petites et des moyennes communes que des métropoles, exprimeraient une grande défiance vis-à-vis de la politique traditionnelle, en particulier des partis, et hésiteraient sur leurs buts et leurs moyens d'action (lire page 10).
LFI s'est tout de suite insérée dans cette mobilisation en appelant à la grève générale pour le 10 septembre. Plus récemment, Solidaires, la CGT et la FSU s'y sont jointes. L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU, Solidaires) a réussi quant à elle à se reconstituer de manière unitaire et à sortir un communiqué et un appel commun à la mobilisation pour le 18 septembre. Bien que l'intersyndicale ne soutienne pas explicitement la date du 10, ce qui est regrettable, il faut se saisir de la date du 18 car le projet de loi de finances ne tombera pas le 10 au soir. Les deux dates ne doivent pas être construites en opposition, mais ensemble, ce qui implique aussi que l'intersyndicale, de même que l'ensemble de la gauche sociale et politique, s'empare de la date du 10.
Tout l'enjeu est donc de construire dans la durée, au plus près des collectifs de travail et à travers l'auto-organisation un mouvement puissant qui puisse gagner sur nos revendications. En un mot : le 10 on bloque tout, et le 18 on continue !
Le 10 septembre, une étape clé dans un mouvement encore à construire
Face à une telle crise politique, à une telle accélération de la situation, le signal doit être donné que c'est le moment d'y aller, toutes et tous ensemble ! Le mouvement va s'inscrire dans la durée. Nous devons donc construire les cadres d'auto-organisation : sur nos facs, sur nos lieux de travail, dans nos quartiers, nous constituons les AG de celles et ceux qui luttent et se mettent en grève. Sans tomber dans la substitution : c'est bien sûr aux grévistes de décider des suites de leur grève. Enfin, nous devons donner un horizon politique à la mobilisation. Après Bayrou, Macron doit tomber. Mais au-delà, le NPA portera la nécessité d'en finir avec la 5e République et d'en appeler à une Constituante. La base pour cela, ce sera bien sûr les organes d'auto-organisation qui auront émergé de la mobilisation.
C'est pourquoi le NPA sera de toutes les luttes de ce mois de septembre. Le 10 n'est qu'un début, construisons la suite !
Comité exécutif du NPA-l'Anticapitaliste
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Juifs et Palestiniens unis envoient une lettre à la Ville de Montréal

Une lettre exigeant que l'équipe cycliste Israel Premier Tech ne soit pas autorisée à participer au Grand Prix Cyclistes de Montréal, qui aura lieu le 14 septembre 2025, a été remise par huissier au bureau de la mairesse Valérie Plante le vendredi 5 septembre.
Montréal le 7 septembre 2025 - Sylvan Adams – (ami proche du criminel Benjamin Netanyahou) – propriétaire de l'équipe cycliste Israel Premier Tech, (anciennement connu sous le nom d‘Israel Start-Up Nation)s'est présenté comme un « ambassadeur autoproclamé de l'État d'Israël » et a indiqué que les cyclistes d'Israel-Premier Tech sont également considérés comme des ambassadeurs du pays.
Faut-il rappeler que de multiples organisations israéliennes de défense des droits humains, dont B'Tselem et Physicians for Human Rights Israel, et la plus grande association mondiale de spécialistes du génocide, soit International Association of Genocide Scholars, ont publiquement qualifié les actions d'Israël à Gaza de génocide, de crime contre l'humanité, et de crime de guerre.
En permettant à une équipe agissant comme agent de promotion d'un État accusé de violations des droits humains à un évènement qu'elle parraine, la Ville de Montréal s'expose à un risque réel de complicité et de blanchiment de ces crimes par le sport, communément appelé le « sportswashing. »
Il faut noter que le directeur technique du Tour d'Espagne, qui est présentement en train d'avoir lieu, a tout récemment suggéré que l'équipe Israël-Premier Tech se retire de la compétition.
PAJU estime que cela constitue un motif supplémentaire pour procéder à l'exclusion de l'équipe Israël-Premier Tech du Grand Prix Cycliste de Montréal.
Par conséquent, PAJU demande formellement à la Ville de Montréal, et particulièrement à la Mairesse Valérie Plante, d'utiliser leur autorité pour exiger l'exclusion immédiate de l'équipe Israël-Premier Tech de la liste des participants au Grand Prix Cycliste de Montréal 2025.
info@paju.org
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À la rescousse de François Legault

Avec la saga SAAQclic, le premier ministre Legault en a plein les bras et, « comprenant la colère des Québécois », il souhaite se relancer « humblement » avec de nouvelles idées, de nouveaux ministres.
Jacques Benoit
GMob (GroupMobilisation)
J'ai pensé apporter mon humble contribution à la réflexion de notre PM, et j'ai utilisé Chatgpt. Comme Yoshua Bengio l'a dit, l'IA peut servir au bien comme au mal.
Alors puisque la question de la richesse au Québec obsède notre PM, je me permets ici de partager avec lui la réponse obtenue à ma question : « Quelles solutions pour lutter contre les inégalités et la pauvreté au Québec ? »
RÉPONSE : « Très bonne question !
Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales au Québec nécessite des solutions à la fois économiques, sociales et politiques. Voici les principaux leviers d'action :
1. Agir sur les revenus et l'emploi
• Hausser le salaire minimum pour qu'il corresponde au revenu viable dans chaque région.
• Favoriser les emplois de qualité (stabilité, avantages sociaux, progression salariale).
• Réduire l'écart salarial entre hommes et femmes, et entre groupes majoritaires et minorités.
• Encourager la formation continue afin que les travailleurs puissent s'adapter aux nouvelles réalités économiques (numérique, transition écologique).
2. Améliorer l'accès au logement
• Développer davantage de logements sociaux et abordables, surtout dans les grands centres.
• Encadrer plus fortement les loyers pour limiter la spéculation immobilière.
• Soutenir la rénovation et l'entretien des logements existants dans les quartiers défavorisés.
3. Renforcer l'éducation et la formation
• Accès équitable à l'éducation préscolaire (CPE et services de garde subventionnés) pour briser le cycle de la pauvreté dès l'enfance.
• Soutien accru aux élèves en difficulté (tutorat, aide financière, accompagnement psychosocial).
• Réduire les obstacles financiers aux études supérieures (bourses plus accessibles, logement étudiant abordable).
4. Soutenir la santé et le bien-être
• Accès élargi aux soins non couverts (santé mentale, soins dentaires, lunettes).
• Développer des services de proximité dans les régions éloignées et les quartiers défavorisés.
• Programmes de prévention en alimentation, activité physique et santé mentale.
5. Lutter contre les discriminations systémiques
• Reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers pour les immigrants.
• Programmes ciblés pour les communautés autochtones : logement, santé, éducation, autonomie économique.
• Mesures contre le racisme et la discrimination à l'embauche et dans l'accès au logement.
6. Renforcer le filet social
• Augmenter l'aide sociale et les prestations pour qu'elles couvrent réellement les besoins de base.
• Bonifier les allocations familiales pour soutenir les familles monoparentales.
• Développer l'économie sociale et solidaire, qui combine emploi et impact social.
7. Agir sur la redistribution de la richesse
• Réformer la fiscalité pour qu'elle soit plus progressive (les plus riches contribuent davantage).
• Limiter l'évasion fiscale des grandes entreprises et des particuliers fortunés.
• Investir davantage dans les services publics (santé, éducation, transport, culture), qui bénéficient surtout aux ménages à revenu faible et moyen.
En résumé, il n'y a pas de solution unique : il faut agir en parallèle sur le revenu, le logement, l'éducation, la santé, la lutte contre les discriminations et la redistribution de la richesse.
C'est ce qui permet non seulement de réduire la pauvreté, mais aussi de créer une société plus égalitaire et inclusive.
Veux-tu que je te propose un plan structuré de lutte contre les inégalités ? »
J'ai pensé que le PM pouvait continuer tout seul à interroger Chatgpt.
Lui, ou tous les partis en lice aux élections de 2026.
Et avant le remaniement ministériel, le ministre Charrette, qui est encore responsable de la lutte aux changements climatiques, pourrait aussi poser à Chatgpt la question : « Quelles solutions pour lutter contre les changements climatiques au Québec ? »
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Être collectif dans un monde qui divise

Saint-Jérôme, 2 septembre 2025 – Dans un contexte marqué par les inégalités sociales grandissantes, les crises multiples et le désengagement de l'État, le Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) lance un appel vibrant d'humanité pour réaffirmer la force du collectif dans un monde qui divise. L'histoire nous l'a prouvé maintes fois : c'est dans la solidarité que réside notre véritable force.
Réunis lors d'un lac-à-l'épaule en juin dernier, l'équipe du ROCL et son nouveau conseil d'administration ont élaboré un plan d'action porteur de cette vision collective. Le cœur de ce plan ? Un congrès d'orientation qui se tiendra les 21 et 22 octobre 2025, un rendez-vous solidaire qui marquera un tournant stratégique pour le mouvement communautaire laurentien.
« L'année 2025 marque un tournant crucial pour le milieu communautaire. L'effritement des services publics, la montée des inégalités, la polarisation sociale : ce sont nos communautés et les organismes communautaires qui y sont ancrés qui en subissent les contrecoups directs », témoigne Benoit Larocque, coordonnateur du ROCL. Crise du logement, crise écologique, insécurité alimentaire, violence, pauvreté, santé mentale : les enjeux sont multiples, et ce sont les populations les plus vulnérables qui en paient le prix.
Devant cette urgence d'agir, les groupes communautaires se retrouvent aux premières loges de cette détresse humaine et bien malgré eux, finissent par pallier les absences de l'État, au détriment de leur mission première, celle de transformer la société et défendre les droits des personnes les plus marginalisées.
« Le milieu communautaire n'est pas un pansement. Il est une force de résistance, de transformation et de solidarité. C'est là que se déploie ce qu'il y a de plus humain en nous : la capacité de rêver, de se rassembler, d'espérer, d'agir », rappelle Christine Richard, présidente du ROCL.
Toutefois, dans un contexte où les inégalités s'accentuent, où le financement demeure instable, où les exigences administratives s'alourdissent et où la précarité des conditions de travail fragilise les équipes, comment les organismes communautaires peuvent-ils rester pleinement ancrés dans leur mission de transformation sociale et de militance ?
C'est précisément pour réfléchir à ces questions de fond que se tiendra le congrès d'orientation en octobre prochain. Un moment pour entendre la voix des 164 organismes que le ROCL représente, afin de dégager une posture et des stratégies pour mieux les soutenir dans les années à venir, des années qui seront marquantes pour l'identité du mouvement communautaire, qui se façonne en même temps que l'histoire dans laquelle il s'inscrit.
Et c'est dans le « Nous » que réside la réponse. Cette force collective qui, tout au long de l'histoire et à travers de nombreuses luttes, a permis de faire émerger davantage de justice, d'égalité et de liberté. Comme le disait Desmond Tutu : « Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes ; car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. »
Face à un monde qui fragmente, les organismes communautaires du Québec affirment, jour après jour, qu'il est possible d'humaniser davantage notre société. À travers son congrès, le ROCL lance un appel à l'unité malgré les différences, à la cohésion, à la réflexion et à la connexion. Un appel à co-créer ensemble un avenir qui nous rassemble et qui nous ressemble à travers nos luttes sociales, nos solidarités, nos coeurs ouverts et nos voix qui refusent de se taire.
Dans un monde en crise, choisir l'humanité est un acte radical. Et ensemble, nous continuerons de choisir ce qui unit plutôt que ce qui divise.
Le ROCL est un regroupement existant depuis près de 30 ans constitué de plus de 160 organismes communautaires autonomes qui œuvrent dans les Laurentides. Lieu de rassemblement pour les organismes de la région, il offre de la formation, de l'accompagnement et du soutien aux organismes du territoire afin de leur permettre de s'épanouir pleinement dans leurs racines communautaires. Il vise par son action, son approche et son rôle de représentation à faire rayonner l'identité des organismes communautaires autonomes et à opérer de profonds changements pour plus de démocratie, de solidarité et de justice sociale et écologique.
P.J. Sur la photo, sept des neuf membres du C. A. et l'équipe de travail du ROCL
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Journée internationale de l’alphabétisation :La stratégie nationale de lutte à l’analphabétisme ne peut plus attendre !

Montréal, le 8 septembre 2025 — En cette Journée internationale de l'alphabétisation, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) presse le gouvernement du Québec d'inscrire au rang de ses priorités la lutte à l'analphabétisme et le développement des compétences en littératie, numératie et littératie numérique de la population. Pour y arriver, l'adoption d'une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme doit impérativement faire partie des orientations phares de sa Politique d'éducation des adultes et de formation continue en cours d'élaboration.
En une décennie, la proportion de personnes peu alphabétisées a augmenté au Québec. En 2012, 19 % de la population québécoise âgée de 16 à 65 ans, soit plus d'un million d'adultes, avaient de grandes difficultés avec l'écrit. En 2022, cette proportion a grimpé à 22 %. Ces plus récents résultats issus du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA 2022) commandent à la fois une action gouvernementale d'envergure et structurante et l'allocation de ressources suffisantes.
Selon Caroline Meunier, coordonnatrice du RGPAQ, « le fait qu'une partie importante de la société québécoise se situe aux plus faibles niveaux de littératie engendre des coûts sociaux et économiques majeurs, en plus d'avoir des effets délétères sur la trajectoire de vie des personnes directement concernées et celle de leurs enfants. Cela compromet la capacité de ces personnes à exercer pleinement leurs rôles sociaux et est source d'inégalités sociales et économiques. Tout cela justifie une intervention vigoureuse de l'État, ainsi que de l'ensemble de la société. »
En juin dernier, le gouvernement du Québec conviait des représentants de la société civile à un rendez-vous visant à actualiser la Politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue datant de 2002. Le RGPAQ espère fortement que cet exercice de mise à jour sera l'occasion pour l'État québécois d'enfin prendre acte de la nécessité d'agir en matière d'alphabétisation et de lutte à l'analphabétisme. Le RGPAQ l'exhorte, par le fait même, à lancer un grand chantier de travail pour doter le Québec d'une réelle stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme.
« Le Québec doit impérativement se doter d'une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme et renforcer ses mesures de lutte à la pauvreté et l'exclusion, soutient Caroline Meunier. Une telle stratégie, élaborée et mise en œuvre avec le concours d'acteurs clés de la société civile, devra s'attaquer aux causes et aux conséquences de l'analphabétisme. Surtout, davantage de ressources devront être investies pour soutenir à la fois les adultes, désirant améliorer leur niveau de littératie, et les lieux d'apprentissage leur offrant cette occasion. Notre réseau se tient prêt à collaborer à cet important chantier de travail. »
Le RGPAQ<https://rgpaq.qc.ca/> représente 78 organismes d'alphabétisation populaire à travers le Québec. Il est voué à la promotion et au développement de l'alphabétisation populaire et des groupes populaires d'alphabétisation ainsi qu'à la défense collective des droits des adultes peu alphabétisés. Il partage avec l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome la vision d'une société juste, égalitaire et démocratique.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Fin du mauvais théâtre à Longueuil ?

« Catherine Fournier a mis fin au « mauvais théâtre » qui divisait Longueuil », pouvait-on lire samedi dans le Devoir.
Curieusement, l'espace « commentaires », habituellement à la fin des articles, était inexistant. Condition de son équipe de communications ? Le Devoir qui prend parti discrètement dans l'élection ?
Je me permets donc d'intervenir ici pour rappeler quelques hauts faits de notre grande « metteuse en scène ».
1. Le dossier de l'aéroport 1 : dans son programme électoral de 2021, elle avait écrit « Nous exercerons un leadership solide afin que le développement de l'aéroport soit soumis à des conditions strictes d'acceptabilité sociale ». Deux consultations publiques en 2022, l'une pilotée par le député fédéral Denis Trudel, l'autre résultant de l'Office de participation publique de Longueuil issu de l'administration Fournier, sont arrivées à la même conclusion : aucun développement/expansion sans dépôt pour discussion publique d'études pertinentes (économique, sanitaire, environnementale, climatique). Or, quatre mois après le dépôt des deux rapports de consultation, l'expansion de l'aéroport était annoncée, sans dépôt des études demandées, dans une conférence de presse où les journalistes recevaient l'information sans droit de poser des questions, et où la porte-parole médiatique était la mairesse qui répétait partout qu'il y avait acceptabilité sociale, puisque 58 % de la population sondée s'était dite favorable à une augmentation du nombre de vols à l'aéroport (sans définition de l'augmentation : nombre et types d'avions). Voici ce qu'étaient les « conditions strictes d'acceptabilité sociale » de Catherine Fournier.
2. Le plan climat : en chantier dès 2022, promis pour 2024, mais pourtant retardé d'un an, sans doute, pour obtenir la plus grosse subvention du programme québécois Accélérer la transition climatique locale. Or, la lecture du plan nous apprend que ses données datent de 2019 : conséquemment, l'expansion de l'aéroport, qui fait partie de la Ville de Longueuil, n'est pas incluse dans le portrait des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire. C'est pas rien puisque cette expansion ajoutera aux appareils des écoles de pilotage, surnommés « tondeuses à gazon volantes » par la population importunée, plus d'une centaine d'avions de ligne chaque jour, sans compter les vols privés et les vols nolisés. Plusieurs centaines de milliers de tonnes de GES seront émises annuellement, en plus des particules fines cancérigènes découlant de la combustion du carburant dans les moteurs. Cette pollution ne s'arrêtera pas les jours d'été où la fumée des incendies de forêt rend l'air dangereusement irrespirable pour la population, entre autres pour la santé des enfants. Quant aux promesses de réductions du plan, elles seront vite effacées par les GES du nouvel aéroport.
3. La chaise des générations : fascinée par ce symbole lancé par le maire de Québec, soit placer dans la salle du conseil municipal une chaise des générations pour rappeler aux élu.e.s que leurs décisions ont des impacts sur les générations futures, la mairesse commanda à Mères au Front - Rive-Sud une telle chaise qu'elle s'empressa de recevoir avec tout son conseil un soir de séance. Du bien beau théâtre ! Ensuite ? Ensuite, rien. On a placé la chaise dans un coin, et on a continué d'agir comme avant : « business as usual » !
4. Temps des questions publiques réduit de 5 à 2 minutes, interventions coupées au nom du “décorum”, réponses éludées. Une vraie farce de démocratie !
Imitant son conseiller Sylvain Larocque, la mairesse peut maintenant crier : fin du mauvais théâtre, place au stand-up !
Jacques Benoit
Citoyen de Longueuil
Membre de GMob (GroupMobilisation)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Entre Battle River-Crowfoot, Londres et Victoria, des chemins différents vers un même objectif : se débarrasser du système électoral actuel

À dessein, les 214 candidatures indépendantes sur les bulletins de Battle River-Crowfoot font réagir. Par cette action, le Longest Ballot Committee (LBC) revendique de remplacer le système électoral fédéral en mettant en place une assemblée citoyenne. Je peux concevoir qu'une telle assemblée soit appropriée à ce niveau, puisqu'aucun modèle de remplacement n'a encore été déposé. Qu'une assemblée citoyenne ne soit pas mon choix pour le Québec ne m'empêche cependant pas d'être solidaire des mouvements qui la choisissent, et j'éprouve la même solidarité envers des opérations comme celles du LBC.
Leur action a fait ressortir la pire démagogie dont Pierre Poilievre est capable, hiérarchisant les candidatures valables à ses yeux versus les autres. Quant à la réaction d'Élections Canada,elle prouve qu'il est facile d'afficher la liste des candidatures pour simplifier le vote, procédure tout à fait normale sous divers modèles proportionnels, annulant ainsi un vieil argument du camp du statu quo.
Les médias d'ici n'en parlent pas, mais ce statu quo est actuellement contesté au Royaume-Uni et en Colombie-Britannique. Les parlementaires y ont entamé des travaux qui pourraient bien mener à la fin du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour… celui que nous devrions aussi mettre au rebut.
Pour la première fois, la Chambre des Communes britannique fait un premier pas vers le remplacement du mode de scrutin portant son nom, et c'est un événement. Qualifiées comme étant les pires de l'histoire du Royaume-Uni, les élections de 2024 ont permis au parti Labour de former un gouvernement majoritaire avec seulement 34% des voix, produisant un indice de distorsion de 24, ce qui est très élevé.
Ce réveil brutal a contribué à ce que des organisations comme Electoral Reform Society. Fair Vote UK et Make Votes Mattermettent le sujet dans l'actualité. Et il y est.
Audébut décembre 2024, un projet de loi proposant d'établir un système proportionnel pour les élections nationales et locales a été déposé (Bill 138). Le 30 janvier, les parlementaires britanniques ont débattu durant 2,5 heures sur le sujet, mais il faut maintenant que le principe du projet de loi soit adopté afin qu'une Commission parlementaire en fasse l'examen, ce qui est actuellement prévu pour le printemps. L'opinion publique étant maintenant au rendez-vous, le calendrier pourrait s'accélérer, le plus récent sondage du National Centre for Social Research rapportant que 60% de la population britannique appuie le changement du mode de scrutin, confirmant la tendance observée depuis 2021.
Du côté de la Colombie-Britannique, depuis octobre 2024, un gouvernement tout juste majoritaire a été formé par le Nouveau Parti démocratique, avec 47 des 93 sièges, versus 44 pour le Parti conservateur et 2 pour le Parti vert.
À peine 2 mois plus tard, le NPD et le Parti vert signaient une entente de collaboration, renouvelée en mars, créant notamment un comité multipartisan pour consulter et recommander un nouveau mode de scrutin. À la différence de bien d'autres gouvernements, cette promesse n'a pas servi à repousser le sujet ; le 18 juillet le Special Committee on Democratic and Electoral Reform concluait 11 journées d'auditions et son rapport sera déposé fin novembre. Malgré la saison estivale, 136 personnes et 46 organisations y ont été entendues, dont le tiers par des femmes. Les mémoires déposés ne sont pas encore disponibles, mais mon analyse du verbatim des 182 présentations démontre un très grand intérêt envers le remplacement du système électoral.
Outre les personnes et organisations s'étant exprimées uniquement sur le 2e volet de la consultation, pour un vote à 16 ans et l'éducation à la démocratie, le remplacement du système électoral a été abordé dans 140 auditions, mais surtout, 134 fois en faveur de l'implantation d'un système de la famille proportionnelle. Un appui à 96%, dont le Comité ne pourra faire abstraction !
Ce message impressionnant démontre aussi que les écueils des 20 dernières années n'ont pas eu raison du mouvement dans cette province. La plupart des présentations se sont concentrées sur les objectifs démocratiques à atteindre, mais plusieurs ont spécifié vouloir une proportionnelle mixte compensatoire, suivie du vote unique transférable (STV), confirmant le choix exprimé au référendum de 2018.
Les probabilités sont grandes pour que les travaux de ces deux parlements mènent, au début de 2026, au rejet du « modèle britannique », ce qui serait assez cocasse considérant leurs noms respectifs. Leurs processus sont très différents, mais dans les deux cas, ils devront se conclure par la modification de leur loi électorale.
Les événements du Royaume-Uni et de la Colombie-Britannique ont plus de chances d'influencer Mark Carney, François Legault ou Paul St-Pierre-Plamondon que l'allongement du bulletin de vote, mais tout doit être tenté.
Mercédez Roberge, autrice de Élections québécoises de 2022 et précédentes : s'indigner et remplacer le système électoral(2024) et de Des élections à réinventer, un pouvoir à partager (2019 - Éditions Somme toute). Présidente du Mouvement démocratie nouvelle de 2003 à 2010.
11 août 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Caisse et la Palestine : tenter de rassurer tout en évitant de répondre

Le 15 juillet, La Presse publiait une lettre ouverte du PDG de la Caisse, Charles Émond, intitulée “Nous nous préoccupons de la crise humanitaire en Palestine”. Dès le lendemain, nous avons contacté La Presse pour sonder leur intérêt à publier une réaction de la Coalition. Après quelques échanges, nous avons reçu la réponse suivante le 21 juillet : “La Presse a publié plusieurs textes sur cette question récemment, qui présentaient des points de vue différents, c'est pourquoi nous n'avons pas retenu le vôtre pour publication.” Il s'agit d'une réponse standard qu'on aurait pu nous faire dès le départ... Mais, en nous répondant ainsi après quelques jours de réflexion, La Presse prend surtout la décision de laisser le dernier mot à La Caisse, car elle n'a publié aucun texte de réponse à la lettre ouverte de Charles Émond.
Pour mieux comprendre cette décision, il faut savoir que c'est La Presse qui avait elle-même sollicité cette lettre ouverte de La Caisse dans des circonstances, disons, un peu troubles, autour de la publication d'un autre article intitulé “Sortez nos caisses de retraite de « l'économie du génocide »”, initialement soumis le 7 juillet et paru le 15 juillet, sous la signature de Rafaëlle Sinave et 124 autres personnes. Cette lettre avait fait l'objet de longues discussions et de nombreux ajustements de contenu entre son autrice principale et la section “Dialogue” de La Presse, qui avait indiqué, tour à tour, que la lettre pourrait être publiée le 9, puis le 10, puis le 11 juillet. Puis, coup de théâtre, l'autrice apprend le 10 juillet que La Presse décide de ne pas publier ! Et enfin, dernier revirement, face aux protestations plus que légitimes de Rafaëlle Sinave, La Presse offre une nouvelle date de publication, le 15 juillet, à condition que La Caisse – qu'ils avaient eux-mêmes pris l'initiative de solliciter entretemps – accepte de publier une lettre ouverte en même temps. Que la publication d'une lettre de citoyen.nes dépende de la publication d'une lettre d'une institution publique qui jouit de multiples forums pour faire connaître sa position est plutôt renversant !
Notons finalement que Le Devoir a décidé de ne pas publier le texte de la Coalition, en invoquant qu'une “réplique” devait être faite dans le même média que le texte critiqué. Et que Le Soleil n'a pas répondu à notre demande.
La Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse) est nommément pointée du doigt dans le rapport du 30 juin de la Rapporteuse spéciale de l'ONU, Me Francesca Albanese, intitulé « De l'économie d'occupation à l'économie de génocide ». En réponse à la couverture médiatique significative de ce rapport, le PDG de La Caisse, Charles Émond, a adressé une lettre ouverte à tous les Québécois.es, parue dans La Presse le 15 juillet. Sa lecture révèle une simple opération de sauvetage de l'image de La Caisse, évitant systématiquement d'aborder les enjeux véritables tout en appelant à « continuer d'avoir un dialogue constructif ».
Quel est le fond de la question ?
Le droit international interdit de fournir des armes, de la machinerie, de l'équipement, des matériaux, des produits et des services de quelque nature que ce soit qui contribuent au génocide à Gaza, à l'établissement, au maintien ou à l'expansion des colonies israéliennes, au régime d'apartheid israélien et à l'occupation militaire en Palestine.
Ce que le rapport de Me Albanese démontre, c'est que les grandes entreprises et institutions financières de partout dans le monde ont systématiquement ignoré leurs obligations à cet égard, y compris jusqu'au génocide actuel. Le rapport de Me Albanese indique que la CDPQ investit 9,6 milliards $ dans la quarantaine de compagnies qui y sont nommées. Me Albanese indique qu'il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg. Uneanalyse plus détaillée de la Coalition du Québec URGENCE Palestine et du Mouvement pour une paix juste, en avril 2025, montre en effet qu'il s'agit plutôt de 27,4 milliards $ dans 76 entreprises. C'est sur cette base que se mène la campagne panquébécoise « Sortons la Caisse des crimes en Palestine ».
La Caisse déforme ou minimise ce qui lui est reproché
D'entrée de jeu, la Caisse se disculpe et se veut rassurante. Elle ramène les critiques qui lui sont adressées à des « allégations ». Elle se défend par la simple réaffirmation de sa bienveillance. Et elle prétend qu'elle a déjà agi, en bloquant tout nouvel investissement en Israël et dans le Territoire palestinien occupé (TPO).
Or, comme nous l'avons fait savoir plusieurs fois à la Caisse, ce qui nous préoccupe ce ne sont pas principalement ses investissements en Israël, mais bien ses investissements dans des compagnies de partout dans le monde, dont certaines activités s'inscrivent dans l'économie d'occupation et l'économie de génocide, dénoncées par Me Albanese. M. Charles Émond nomme bien quelques-unes de ces compagnies, mais il prend soin de ne jamais mentionner ce qui leur est reproché.
Concernant Lockheed Martin, qui fournit à Israël la majorité des avions servant à bombarder Gaza, largement responsables pour les 62 000 morts et 112 000 blessés depuis le début du génocide, M. Émond ramène le problème à « une exposition de 0,025 % » dans « des actions déjà en circulation sur les marchés, qui font partie de paniers de titres standards ». En quoi ce jargon financier exonère-t-il La Caisse ?
Concernant Caterpillar, M. Émond affirme qu'il « est extrêmement difficile de tracer une ligne entre les entreprises qui ont des politiques pourtant claires et l'utilisation finale de leurs produits par leurs clients ». Or l'utilisation des bulldozers D9 de Caterpillar par l'armée israélienne pour démolir des dizaines de milliers de maisons palestiniennes est documentée depuis des décennies et a fait l'objet de nombreuses campagnes de dénonciation, notamment par Human Rights Watch(2004) et Amnesty International (2010). Dans le génocide en cours à Gaza, les bulldozers D9 de Caterpillar ont joué et continuent de jouer un rôle central dans la destruction impitoyable de toutes les infrastructures civiles de Gaza. M. Émond mentionne aussi que Caterpillar « fabrique des machines pour usage dans la construction, dont de grands projets d'infrastructure ». Nous lui rappelons qu'en plus des démolitions, cette entreprise a notamment participé aux « grands projets d'infrastructure » des colonies où plus de 700 000 Israélien.nes vivent illégalement dans le TPO, et du mur de séparation de plus de 700 kilomètres qui a servi à annexer près de 10% de la Cisjordanie.
Pour qu'un dialogue soit possible, il faut un réel attachement aux droits
Les activités des compagnies mentionnées ci-haut et de dizaines d'autres dans lesquelles la Caisse investit participent à des crimes commis par Israël. De répéter qu'il ne s'agit que d'une petite partie de leurs activités dans le monde démontre le peu d'importance qu'accorde la Caisse au droit international et, particulièrement, aux violations des droits du peuple palestinien.
La Caisse décrit la situation en Palestine avec des termes vagues comme « conflit » et « crise humanitaire », alors que c'est d'occupation militaire, de colonisation, d'apartheid et de génocide qu'il s'agit, comme le démontre bien le rapport de Me Albanese. Il documente abondamment la participation de nombreuses entreprises à travers le monde, dont la CDPQ, à la commission de ces crimes.
C'est notre argent que gère la Caisse et elle doit le faire de manière responsable, éthique et transparente. S'assurer qu'aucun de ses investissements ne contribue, de manière directe ou indirecte aux crimes commis contre le peuple palestinien fait partie de ses obligations. À mesure que la population québécoise est mise au courant, son indignation croît. Le déni total de la Caisse ne passera pas !
Bruce Katz (Palestiniens et Juifs Unis – PAJU)
Martine Eloy (Collectif Échec à la guerre)
Raymond Legault (porte-parole de la Coalition du Québec URGENCE Palestine)
Amélie Nguyen (Centre international de solidarité ouvrière – CISO)
Catherine Pappas (Alternatives)
Glenn Rubenstein (Voix juives indépendantes – Montréal)
membres du Comité de coordination de la Coalition du Québec URGENCE Palestine
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











