Revue À bâbord !
Publication indépendante paraissant quatre fois par année, la revue À bâbord ! est éditée au Québec par des militant·e·s, des journalistes indépendant·e·s, des professeur·e·s, des étudiant·e·s, des travailleurs et des travailleuses, des rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l’organisation de notre société, dans les rapports entre les hommes et les femmes et dans nos liens avec la nature.
À bâbord ! a pour mandat d’informer, de formuler des analyses et des critiques sociales et d’offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire. À bâbord ! veut appuyer les efforts de ceux et celles qui traquent la bêtise, dénoncent les injustices et organisent la rébellion.

Le travail est-il mortel ?

Si, dans le quotidien des personnes travailleuses, la routine métro-boulot-dodo se veut souvent monotone et répétitive, elle apparaît, au moins, sans risque. Malheureusement, plus de 200 personnes par année succombent à cette routine à cause d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
La violence du travail est largement sous-estimée. On pourrait croire que les accidents de la route sont plus dangereux que le travail : leur couverture médiatique est supérieure, leur nombre plus largement diffusé et la dangerosité de la cohabitation des véhicules motorisés et des autres usagers de la route fait couler de plus en plus d'encre. Sans diminuer les importants enjeux de la sécurité routière, illustrons qu'en 2021, il y a eu 27 541 accidents de la route au Québec [1] comparativement à 105 692 lésions professionnelles reconnues [2], 3,83 fois plus. Ce chiffre n'est que la pointe de l'iceberg, car il ne prend pas en compte les lésions non reconnues, celles qui ne sont pas déclarées et les problèmes qui ne causent pas d'absences au travail.
On accepte que le travail soit dangereux. Les accidents sont banalisés et cela augmente la probabilité de mort au travail. Cette banalisation des accidents et l'acceptation sociale du danger du travail permettent au patronat d'investir très peu dans la prévention, et ce, même si la santé et la sécurité au Québec sont basées sur le principe de l'élimination du danger à la source. Il est même possible de constater que le laisser-aller face aux accidents et lésions au travail fait partie de nombreux modèles d'affaires et que la santé et la sécurité sont fréquemment vues comme une responsabilité individuelle reposant sur les personnes salariées plutôt qu'une responsabilité collective initiée par l'intervention à la source.
Le patronat n'en paie pas assez le prix
En 2021, Bernard Huot, le propriétaire de la Boucherie Huot, a été reconnu coupable de négligence criminelle. L'accusé faisait aussi face à des accusations d'homicide involontaire et de négligence causant la mort, et a reçu une peine de 18 mois de prison. [3] La défense de Huot a consisté à rejeter le blâme sur l'employé plutôt que d'en prendre la responsabilité.
« Bernard Huot était plus préoccupé par le rendement et la production que par la sécurité de ses employés », écrit Annie Trudel, juge à la Cour du Québec.
Ce constat de la juge Trudel ne devrait pas s'arrêter à Huot. Le cas Huot est l'un des dix seuls cas de criminalisation d'un accident de travail dans la jurisprudence canadienne. Pourtant, au cours de l'année 2021, 207 décès ont été reconnus comme ayant été causés par des maladies professionnelles ou des accidents de travail. À titre de comparaison, le Québec a connu 88 homicides. Si l'on considère que Bernard Huot est le seul patron ayant été jugé criminellement responsable d'un décès au travail cette année-là, on peut déduire que 206 employeurs n'ont eu pour conséquence qu'une hausse de leur cotisation à la CNESST.
Il n'est pas ici question d'insinuer que tout accident de travail est causé par une intention criminelle, mais plutôt de démontrer que les accidents et les décès sont banalisés comme étant inévitables et inhérents au travail, un sacrifice en partie accepté afin d'assurer la cadence, la productivité et la profitabilité.
On tue au nom de la productivité
Or, pour augmenter la productivité, la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses devraient être une priorité. En 2021, le Québec a perdu 22,5 fois plus de jours travaillés par personnes en raison d'accidents du travail et de maladies professionnelles (17 931 079) [4] qu'en raison d'arrêts de travail dus à une grève ou un lock-out (795 447 jours travaillés par personnes perdus) [5]. En partie au nom de la perte dommageable de jours travaillés, il arrive que l'État intervienne en cas de conflits de travail. Où en est cette volonté d'agir, lorsqu'il s'agit de santé et de sécurité ?
À cet égard, la dernière réforme de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) fut une occasion ratée (voir encadré). Depuis l'adoption de la réforme, le nombre de lésions professionnelles a augmenté de façon vertigineuse, passant de 105 692 en 2021 à 149 812 accidents du travail reconnus en 2022. [6]
Observation macabre : le décès d'une personne au travail n'entraîne pas de perte de jours travaillés par personne dans les statistiques. Contrairement à une personne blessée, puisque la personne décédée doit immédiatement être remplacée et n'a pas de période de réadaptation nécessaire, sa disparition n'est pas considérée comme une absence. En ce sens, elle est aussi considérée comme coûtant moins cher à l'État en raison de l'absence de coûts médicaux de rétablissement.
Même si le nombre d'accidents et de décès liés au travail ne sont plus ceux de la révolution industrielle, le travail reste dangereux. Les conséquences des accidents sont toujours importantes et bouleversent de nombreuses vies. Comment alors expliquer cette banalisation des accidents, lésions et décès au travail, notamment par rapport à d'autres types de morts violentes ? Est-ce en raison de leur nombre important ou de leur incapacité à surprendre ou à scandaliser ? N'en reste pas moins que nul·le ne devrait craindre pour sa vie à essayer de la gagner [7]. Les campagnes de sensibilisation n'arrivent absolument pas à faire percoler l'ampleur du problème auprès du public et des acteurs les plus concernés par la prévention du danger à la source : les employeurs.
[1] SAAQ, Bilan Routier 2021, Québec, 2022, 16pp.
[2] CNESST, Statistiques annuelles 2021, Québec, 2022, 180p.
[3] Yannick Bergeron, « Accident de travail dans une boucherie : le propriétaire reconnu coupable », Radio-Canada, 11 janvier 2021. En ligne : ici.radio-canada.ca/nouvelle/1762414/accident-travail-boucherie-huot-proprietaires-reconnus-coupables
[4] CNESST, op. cit. p. 39.
[5] Ministère du Travail, Liste des arrêts de travail 2021. En ligne : www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/liste-des-arrets-de-travail-au-quebec/resource/7577f86f-cb82-4469-ab5b-eeaa8444a96c
[6] CNESST, « Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail », Communiqué de presse, 27 avril 2018. En ligne : www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/salle-presse/communiques/jour-deuil-2023# : :text=Bilan%20statistique%202022&text=Toujours%20en%202022%2C%20161%20962,149%20812%20accidents%20du%20travail.
[7] Merci à Geneviève Baril-Gingras, professeure en Relations industrielles à l'Université Laval, pour l'idée des comparaisons.
Philippe Lapointe est conseiller à la FTQ-Construction.
Illustration : Marcel Saint-Pierre, Bande verticale, série Alliage. Pellicule d'acrylique sur toile, 305 x 90 cm.Collection Corporation Financière Power

« Ceux que la mort fait travailler »

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal est géré par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame. Il compte 17 employé·es de bureau et 90 responsables de l'entretien. Des personnalités comme Thérèse Casgrain, Lhasa de Sela et Émile Nelligan y ont trouvé le repos éternel. Le défi de tenir une grève dans un lieu aussi chargé symboliquement n'est pas banal. Histoire d'un conflit de travail avec Patrick Chartrand. Propos recueillis par Isabelle Larrivée.
À bâbord ! : Aux yeux du public, avant 2018, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges semblait un milieu de travail sans histoire. Qu'est-ce qui a déclenché ce conflit ?
Patrick Chartrand : Nous avons malheureusement un historique de conflit avec notre employeur, le dernier remontant à 2007, un lockout de 17 semaines. Cette fois-ci, notre contrat était échu depuis le 31 décembre 2018 et nous avons connu des négociations laborieuses, en plus de la pandémie. De plus, il y a eu des changements dans l'administration en 2019, et nous avons senti très rapidement que nous serions en confrontation avec le nouveau directeur général.
ÀB ! : Qui était en grève et quelles étaient les principales revendications ?
P. C. : Les employé·es de bureau ont déclenché la grève le 20 septembre 2022 et les employé·es d'entretien ont fait de même le 12 janvier 2023. Dans les deux cas, on discutait de la sécurité d'emploi. L'employeur voulait notamment réduire le plancher d'emploi pour les employé·es à temps plein. Il voulait aussi nous faire accepter des gels salariaux pour les années passées, soit de 2019 à aujourd'hui, et n'offrir aucune rétroactivité. Nos demandes étaient plutôt centrées sur la préservation de nos acquis et une augmentation de salaire basée sur l'importante hausse du coût de la vie.
ÀB ! : Qu'est-ce qui explique la mise à pied de 26 employé·es en mai 2021 et quel rôle joue ce licenciement dans la déclaration des hostilités ?
P. C. : Ces suppressions de postes ont effectivement augmenté la tension d'un cran. Nous étions en pleine pandémie. Malgré le fait que le gouvernement nous avait placé·es sur une liste d'emploi prioritaire et que nous avions travaillé chaque jour, notre employeur a décidé de ne permettre qu'un accès limité aux familles. Nous étions au minimum des effectifs depuis plus d'un an, ce qui a aussi contribué à affecter le moral des travailleur·euses et renforcé notre décision de faire la grève.
ÀB ! : Quels sont les résistances, les arguments de la Fabrique ?
P. C. : La Fabrique parlait de problèmes financiers, mais elle refusait d'ouvrir les livres. Il fallait la croire sur parole. Elle est aussi propriétaire et gestionnaire de la Basilique Notre-Dame. Celle-ci a dû fermer ses portes lors de la pandémie, ce qui a certainement créé un vide financier. Mais le cimetière, lui, n'avait pas été affecté par la pandémie, bien au contraire.
ÀB ! : Quelles étaient les propositions à l'étude ?
P. C. : Grâce à un conciliateur et probablement aussi à l'immense pression médiatique des familles, la négociation a débloqué en juin. Le conciliateur a travaillé avec les deux parties pour construire une proposition de règlements. Nous avons accepté de faire une concession pour le plancher d'emploi et en retour, l'employeur a dû accepter de mettre de l'argent sur la table, particulièrement pour la rétroactivité.
ÀB ! : Pourquoi le protocole de retour au travail proposé par la partie patronale, début juin, a-t-il semblé aussi décevant ?
P. C. : Au moment où les parties en sont venues à une entente, et vu, surtout, la longueur du conflit, il fallait mettre en place un protocole de retour au travail. Il fut ardu de convenir d'un protocole adéquat pour les deux parties. Les enjeux de reconnaissance furent les plus difficiles à régler, particulièrement en ce qui concerne le fonds de pension et les vacances.
ÀB ! : Comment anticipez-vous la fin de ce conflit ? Quelles sont les attentes pour l'avenir des employé·es ?
P. C. : Au moment d'écrire ces lignes, nous en sommes venu·es à une entente qui vaut jusqu'au 31 décembre 2027, et nous sommes de retour au travail depuis le 17 juillet. Malheureusement, les employé·es de bureau ne sont pas parvenu·es à une entente. Nous restons solidaires de nos collègues et souhaitons de tout cœur un dénouement rapide et à la hauteur de leurs attentes.
Patrick Chartrand est président du syndicat des employé·es de l'entretien du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, CSN.
La phrase « Ceux que la mort fait travailler » est reprise d'un slogan du syndicat des employé·es du cimetière de Notre-Dames-des-Neiges.
Illustration : Marcel Saint-Pierre, Vert signal, 1998, détail, série Zones grises. Pellicule d'acrylique sur toile, 210 x 130 cm. Collection Denis Gascon

Une lecture féministe de l’histoire médicale. Hommage à Barbara Ehrenreich

Décédée le 1er septembre 2022, Barbara Ehrenreich n'avait cessé, à travers son œuvre, d'interroger le primat de la science médicale et de désacraliser les rituels qui maintiennent son autorité. Cette critique se décline aussi bien dans ses écrits qu'à partir de son expérience de la maladie.
Depuis Sorcières, sages-femmes et infirmières, écrit avec Deirdre English, suivi du pamphlet Fragiles ou contagieuses, la militante féministe et socialiste Barbara Ehrenreich a soutenu le projet d'une histoire féministe de la professionnalisation de la médecine. Titulaire d'un doctorat en immunologie cellulaire, ses plus récents livres ont complété sa critique du fétichisme scientifique, qu'elle nomme le « vernis de la science », conférant à la médecine des pouvoirs justifiant des pratiques sexistes, classistes et racistes. En effet, selon Ehrenreich, les discours médicaux, sous l'égide bienveillante de la santé, imposent leurs fictions dominantes telles que le cancer comme combat individuel ou la maladie comme récit patriarcal. En monopolisant la pratique du soin, l'institution médicale s'est attribué la compétence ultime en matière de contrôle de la population. Son histoire et ses intérêts économiques actuels révèlent les liens ténus entre la science et la pratique médicale effective.
Guerre aux travailleuses de la santé
L'histoire de la professionnalisation de la médecine pourrait être résumée à une lutte acharnée contre les femmes en tant que travailleuses de la santé. Cette lutte pour le monopole de la médecine, corrélée à la lutte des classes, s'opère en deux phases historiques : la chasse aux sorcières dans l'Europe médiévale et la montée de la profession médicale en Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle.Ehrenreich démontre que la première phase fut supportée par l'Église pour qui les guérisseuses représentaient une menace à la fois politique, religieuse et sexuelle. Ces empiristes hérétiques, qui avaient un pouvoir positif sur la reproduction et un rôle important dans les économies locales, étaient souvent soutenus par des mouvements anticléricaux ou des organisations paysannes. Dès le XIVe siècle, cette guerre aux guérisseuses engendre l'axe Église-État-corps médical et inaugure un marché où la médecine est basée sur l'éminence plutôt que sur l'évidence (la preuve scientifique).
À la fin du XIXe siècle aux États-Unis, la concurrence entre médecins et soignantes, puis entre médecins et praticiens de médecines alternatives, culmine par le monopole que l'on connait grâce au soutien direct des entreprises capitalistes (Rockefeller et Carnegie). L'organisation du travail dans l'institution médicale occidentale est à l'avenant : les femmes sont les ouvrières d'une industrie où médecins et directeurs d'hôpitaux sont les patrons. Ehrenreich souligne qu'en toute logique patriarcale, les femmes deviennent l'objet d'étude privilégié de la médecine et font les frais de théories paradoxales : maladies et dangerosités leur sont imputées suivant des intérêts de classe et des impératifs de clientélisation. La fin du XIXe siècle voit la justification du sexisme passer d'un discours religieux aux arguments biomédicaux. Avec l'apparition des catégories infirmière/médecin, l'acte du soin et celui de la guérison achèvent leur divorce : « Tout le crédit de la guérison va naturellement au médecin, car lui seul “ participe à la mystique de la Science.” » Une autorité qui ritualise dangereusement la pratique médicale et antagonise le patient, selon elle.
Santé publique, induction de comportements
La médecine comme technologie de pouvoir afférente au patriarcat capitaliste s'incarne aussi dans les formes et fonctions de la santé publique. Depuis les campagnes de mouvement de tempérance (antialcoolisme) ou de pureté sociale (antiprostitution) jusqu'à la guerre au tabagisme, véritable guerre aux pauvres, la santé publique brandit des discours moralistes pour étouffer le plus souvent ses intentions de contrôle de la population [1]. Sa fonction régulatrice est facilitée par les liens bureaucratiques et historiques étroits qu'elle entretient avec la police.
On retrouve un même écart entre discours et raisons scientifiques dans l'impératif à la prise en charge individuelle de notre santé, qui, rappelle Ehrenreich, ont suivi aux États-Unis le développement des assurances maladie, ces régimes qui ont aussi mis la table à la lucrative industrie du fitness. Être en santé semble signifier être apte à la dépense. Selon elle, il est impératif que la culture occidentale cesse de percevoir la mort comme un échec. À l'intérieur d'un système de santé inique, le cumul d'actions à mener pour s'harnacher à la vie — sans égard à sa qualité — ne peut qu'épuiser, appauvrir et humilier certaines populations. Ehrenreich compare le cabinet du médecin à un lieu de confession des transgressions où sera rendu un verdict d'innocence ou de culpabilité, procès qui s'étend jusqu'au décès sur lequel sera opérée une autopsie biomorale : quelles négligences individuelles sont en cause ? « Chaque mort peut désormais être comprise comme un suicide », déplore-t-elle.
Dans l'expérience de la grande maladie, l'injonction à la Santé s'accompagne d'une sommation au triomphalisme. C'est l'expérience que Barbara Ehrenreich en fait quand elle reçoit à 56 ans un diagnostic de cancer du sein. Dans l'article Welcome to Cancerland, elle s'insurge contre la culture du cancer du sein qui valorise la positivité et la guérison miraculeuse. Ce culte du cancer célèbre la lutte individuelle comme un chant épique contre la maladie plutôt qu'une reconnaissance des facteurs sociaux et environnementaux qui peuvent contribuer à sa prévalence. Les entreprises et laboratoires ayant fait leur miel de la cause du cancer du sein, courtisant un marché de femmes d'âge moyen ou offrant des traitements pharmaceutiques couteux et semi-toxiques sont ceux-là même, grands pollueurs, qui émettent des cancérigènes. Ce faisant, ils placent les femmes en position d'alliées involontaires des entreprises qui les rendent malades. Ehrenreich regrette que la colère soit évacuée de ces mouvements sans mobilisation politique contre le « complexe industriel du cancer ». Dans le cas précis du cancer du sein, la thématique sexiste et infantilisante incarnée par les ours en peluche et les crayons roses reconduit une logique d'obéissance aveugle à des protocoles médicaux connus pour leur efficacité limitée.
Mouvement pour la santé du peuple
Il faut souffrir pour ne pas mourir : telle est la maxime sociale qui justifie l'acharnement thérapeutique. Mais pourquoi s'échiner à prévenir la fin d'une vie déjà confisquée par la médecine, déterminée par notre statut socio-économique et des facteurs environnementaux et dont la prise en charge sera assujettie à notre valeur sur le marché du travail ? Dans une institution où l'on répertorie décervelage (gaslighting) médical, violences gynécologiques et obstétricales et biais racistes, classistes et sexistes dans la reconnaissance de la douleur, qui peut prétendre avoir les clés de sa santé ? À l'instar du mouvement pour la santé du peuple [2], le féminisme informe la lutte contre l'élitisme médical. Pour Barbara Ehrenreich, les ultra-riches s'illusionnent aussi. Elle se rit de la complaisance particulière des transhumanistes de la Silicon Valley qui voient leur corps comme un programme perfectible et pour qui chaque heure est un pas de plus vers la science de l'immortalité. Si le peu d'argent vous éloigne de l'accès à la santé, beaucoup de pouvoir semble vous éloigner de la science.
Heureusement, le projet critique d'Ehrenreich offre une éducation militante et propose des formes de résistance contre les pratiques abusives et des moyens de s'affranchir de la dépendance aux techniques médicales. Elle prône d'abord une prise de conscience par l'éducation pour les femmes axée autour d'une justice épistémique, référant à la production du savoir scientifique à partir d'une diversité d'expériences et de perspectives, suivi d'une juste distribution de ce savoir. Ensuite, elle valorise une organisation collective par le biais de groupes de femmes/féministes dont il existe plusieurs exemples passés et actuels : les groupes féministes comme Action cancer du sein qui politise la lutte, ou le mouvement self help qui encourage l'autoéducation et l'autoexamen du corps afin de prendre des décisions éclairées en matière de soin. Enfin, elle milite pour le développement d'une expertise médicale désintéressée et alternative qui dépasserait toute logique de marché. Ceci commande un appel politique à la transparence des laboratoires de recherche et une critique des normes de genre et de race qui sous-tendent les pratiques médicales.
Les recherches de Barbara Ehrenreich démontrent que le discours médical n'a pas suivi le progrès technologique, mais a plutôt axé ses efforts sur un marché à conquérir et une idéologie à véhiculer pour sécuriser ce marché. Elle n'a pas oublié en contrepartie d'offrir à toutes une harmonie de colère et d'indignation : « Ce qui m'a soutenu tout au long des “ traitements ” est une rage purificatrice, une résolution — encadrée par les nuits blanches de la chimiothérapie — de voir le dernier pollueur, avec, disons, le dernier agent de l'assurance maladie, étranglé avec le dernier ruban rose. »
[1] Le mouvement pour le contrôle des naissances, en dépit d'une initiative féministe, a répondu à un terrible agenda raciste et classiste.
[2] Le mouvement pour la Santé du Peuple (1830-1840) attaque l'élitisme médical et est corrélé aux États-Unis aux mouvements féministes autant qu'auront pu l'être les luttes pour le droit de vote.
Stéphanie Barahona est éditrice chez Remue-Ménage.
OEUVRES CITÉES
Barbara Ehrenreich et Deirdre English, Sorcières, sages-femmes, infirmières. Une histoire des femmes et de la médecine, Montréal, les éditions remue-ménage, 2016 [1976], 108 pages.
Barbara Ehrenreich, Natural Causes. Life, Death and the Illusion of Control. Londres, Granta, 2018, 256 pages.
Barbara Ehrenreich, Deirdre English, Fragiles ou contagieuses. Le pouvoir médical et le corps des femmes, Paris, Cambourakis, 2016, 160 pages.
Illustration : Marcel Saint-Pierre, Vert signal, 1998, détail, série Zones grises. Pellicule d'acrylique sur toile, 210 x 130 cm. Collection Denis Gascon

Quand la mort est affaire de classe

« N'oublions pas mes bien chers frères que nous sommes tous égaux devant la mort ». Il m'énerve.
Ce sont ses dernières volontés, alors, il faut endurer. Elle voulait un prêtre. Avec ses économies, elle s'est payé un prêtre. Elle voulait être embaumée et exposée, mais comme c'est dispendieux, elle s'est payé une petite boite pour monter aux cieux. Il faut ménager ses transports. Elle était contente d'avoir fait ses arrangements funéraires. J'ai souvent trouvé les joies de ma mère incompréhensibles.
Je jette un coup d'œil à la parenté rassemblée. C'était la dernière des grands-tantes. Même ceux qui ne la voyaient plus sont venus. J'ai ma face de carême. Pour ne pas leur parler trop longuement, je me cache dans ma douleur. Personne ne comprend, je suis un incompris, tant mieux.
J'imagine qu'elle voulait un prêtre pour les prières. Lui, il s'est imaginé qu'il lui fallait parler. Nous sermonner un peu. Être prêtre est un métier en voie de disparition, il veut nous montrer son utilité, peut-être même nous rallumer la flamme avant que ma mère soit incinérée.
Ce prêtre n'est pas méchant. Juste un peu trop curé. Il parle de « l'égalité devant la mort ». La belle idée ! C'est aussi vrai que l'égalité des chances ou l'égalité homme-femme. L'égalité devant la mort et « poussière tu redeviendras poussière ». La mort comme un grand sac d'aspirateur. Tout le monde a l'air d'y croire.
Je ne connais pas la majorité de mes cousins et cousines, et encore moins leur progéniture. Cela doit être la douleur. Je les regarde avec des préjugés. Je suis certain qu'au moins la moitié aurait signé la pétition pour empêcher l'arrivée d'un cimetière musulman à Saint-Apollinaire égaux devant la mort, mais pas dans ma cour. Je suis en colère, contre la vie, contre la mort. Cela doit être la peine.
« Tous égaux devant la mort ». Il le répète, il le répète à l'infini et cela me donne une idée de l'éternité.
J'ai envie de l'interrompre. De lui parler d'un humain mort de froid sur le chemin Roxham, d'une trans battue à mort, d'un ado qui a reçu une balle dans le dos, des femmes autochtones abandonnées au bord des routes, j'ai des tas d'exemples qui me défilent dans la tête.
« Égaux devant la mort ». Il y a une circonscription fédérale qui a uni Saint-Henri avec Westmount. L'écart de l'espérance de vie est de 10 ans. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour rétrécir cet écart a été de « gentrifier » Saint-Henri.
Il a fini. La cérémonie est finie. Je dis merci.
Une cousine qui survit en faisant des ménages me tend sa main calleuse et me dit combien elle aimait ma mère. Elle me touche. Un cousin qui a « trop » réussi dans la vie m'offre ses sympathies. Je souris.
Je regarde ma mère, je l'imagine à l'étroit dans sa petite urne, elle qui ne sortait jamais, qui vivait recluse, la voici qui sort en boite… enfin, je me calme. Un jour, nous serons égaux « dans » la mort.
Jean-Yves Joannette est ex-coordonnateur de la Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal.
Illustration : Marcel Saint-Pierre, Racines au carré, 2002, Œuvres parisiennes.Pellicule d'acrylique sur toile, 110 x 120 cm

Les désillusions d’une thanatologue

J'ai rencontré Maude Jarry, une brillante écrivaine, alors qu'elle était étudiante en recherche-création littéraire de l'Université de Montréal. Je me rappelle qu'un jour dans mon bureau, Maude m'a dit être diplômée en thanatologie, mais elle avait quitté la profession.
Je connaissais aussi une autre Maude, jeune femme remarquable qui, elle aussi, a travaillé dans le domaine des soins aux défunt·es en région et qui, quand je l'ai croisée, il y a quelques mois, avait abandonné rapidement ce métier, selon elle, décevant. J'ai décidé de parler à Maude Jarry, de penser avec elle ses années en thanatopraxie pour comprendre un peu pourquoi ces deux femmes ont senti la nécessité de changer de profession.
L'itinéraire d'une croque-mort
Si Maude est entrée au cégep Rosemont, dans cette technique singulière pour certain·es, c'est qu'elle avait le désir d'apprendre dans un domaine où les cours de microbiologie, de science côtoyaient ceux de cosmétique. Elle avait aussi envie de s'engager dans ce qu'elle voyait comme un travail où la relation d'aide, le care étaient centraux. Maude a vite créé un blogue à l'époque « Mademoiselle Croque-mort » où elle dévoilait les secrets et les dessous de sa pratique et où elle tenait à faire connaitre ses apprentissages et sa profession, ce qui n'a pas toujours été apprécié par certain·es de ses professeur·es et par les futurs employeurs qui la lisaient.
Elle a pourtant trouvé un premier job dans une petite entreprise familiale où elle travaillait en laboratoire pour s'occuper des soins aux corps, où elle lavait les toilettes ou les voitures et multipliait les tâches les plus diverses. Puis elle est partie travailler durant plus de trois ans dans une grande entreprise. À travers ces années, Maude a ressenti un malaise grandissant envers la philosophie à la base même de ce processus invasif de conservation du corps que l'on trouve dans les salons funéraires. Les produits utilisés hautement toxiques pour les êtres vivants qui travaillent sur les corps et l'environnement, les déchets en grandes quantités qui sont générés par l'embaumement, la désillusion ressentie dans un travail que Maude voyait axé sur le care et qui parfois se réduisait à de la vente, les lois très rigides de protection de la santé publique ont fait en sorte que Maude a préféré quitter la profession, non pas fâchée, mais plutôt sceptique sur sa capacité à y être bien, en accord avec ses principes éthiques et politiques.
Les limites du métier
Maude me dit par ailleurs trouver ridicule qu'on ne puisse pas enterrer les corps dans un linceul, sans cercueil, directement dans la terre. Elle questionne ce « rite » qui veut que les corps subissent un traitement qui contrevient à une pensée et une nécessité écologique. Elle me parle d'une ancienne collègue dont elle vient d'apprendre le suicide. Elle me mentionne des cas difficiles d'embaumement, des traumatismes lors de traitements de corps violentés dont il ne faut pas trop parler. Elle me dit : « Nous étions des cordonniers mal chaussés, vus comme capables d'accueillir des sujets difficiles, de suivre des gens à travers des périodes douloureuses, mais en fait incapables de dire leur propre détresse. L'épuisement professionnel, la fatigue de compassion ne sont pas rares dans le métier. » Maude est joyeuse malgré ce qu'elle me raconte. Elle ne déteste pas son ancien travail. Elle y est même retournée pour donner un coup de main pendant la pandémie. Mais si elle pense retourner dans un salon funéraire, ce ne serait ni à la vente ni au laboratoire, mais auprès des gens endeuillés pour lesquels il y a tant à faire.
Illustration : Marcel Saint-Pierre, Racines au carré, 2002, Œuvres parisiennes.Pellicule d'acrylique sur toile, 110 x 120 cm
Maude Jarry est écrivaine et diplômée en thanatologie. Propos recueillis par Catherine Mavrikakis.

La sépulture, impensé de la situation d’immigration

Ébranlée par la tragédie de la mosquée de Québec, la communauté musulmane s'est mobilisée dans la recherche d'un terrain visant à fonder un cimetière. Sur sa route, elle a dû affronter l'hydre d'un intégrisme inédit.
Laisser son corps en terre d'immigration revêt une signification profonde, non seulement pour ce qui concerne sa propre mort, mais aussi au regard de ceux qui nous survivent [1]. Respectant les rites ancestraux, la sépulture devient un point de repère pour les proches, la communauté, la société où l'on a passé parfois plus d'années que dans son pays d'origine, mais aussi parce que l'incorporation à la terre du pays d'immigration prend le sens de l'enracinement et de l'intégration des futures générations. C'est pourquoi, du point de vue symbolique, devoir faire face au déni de sépulture, comme le dit Lilyane Rachédi, c'est mourir deux fois : d'abord par la mort physique réelle, puis par la non-reconnaissance du lien d'appartenance au pays choisi : « Ces gens-là veulent mourir ici et demandent à avoir leur place. Cela devrait plutôt être vu comme l'intégration ultime » [2]. Le poids symbolique de l'inhumation en pays d'immigration souligne que l'immigrant·e n'est pas qu'un·e passant·e provisoire destiné·e à repartir.
Projet de cimetière
En janvier 2017 a lieu, dans la grande mosquée de Québec, un attentat armé où six hommes sont tués et plusieurs blessés, certains gravement. Trois des six familles endeuillées choisissent de rapatrier les dépouilles de leurs proches dans les pays d'origine des défunts. Les trois autres, désirant enterrer leurs morts au Québec, se retrouvent face à l'obligation de les inhumer dans le seul cimetière musulman du Québec, qui se trouve à Laval, à 300 kilomètres de leur résidence. Cette situation rend difficiles l'accomplissement des rituels de deuil et la possibilité de se recueillir sur la tombe de l'être aimé. L'aménagement d'un cimetière musulman à Québec, réclamé depuis des décennies, devient donc crucial.
Une entreprise funéraire du village de St-Apollinaire offre de vendre un terrain à la communauté musulmane pour aménager ce cimetière, à la condition d'obtenir une autorisation de dézonage. Rapidement, dans cette petite démocratie municipale de 6 000 habitant·es, des voix insatisfaites s'élèvent et la tenue d'un référendum devient incontournable.
Un groupe de citoyen·es, le clan du Non, mené par Sunny Létourneau, s'oppose vivement à ce dézonage. Or, Sunny Létourneau est membre en règle de la Meute, groupe de pression à l'époque très présent sur les réseaux sociaux et aussi dans des manifestations. Pour ce groupe défendant des valeurs identitaires, nationalistes et ouvertement islamophobes, il n'y a d'Islam que politique.
Pendant la campagne référendaire, les tensions s'accroissent. Selon le maire du village, Bernard Ouellet, qui soutient l'acquisition du terrain, les personnes qui sont favorables au projet n'osent pas s'exprimer. Le clan du Non brandit des préjugés de toutes sortes et fait circuler de fausses informations quant aux pratiques funéraires musulmanes. Résultat : la demande de dézonage du terrain convoité est rejetée par une courte majorité de trois voix.
L'affaire du projet de cimetière musulman de St-Apollinaire offre la possibilité d'analyser plusieurs enjeux liés aux aspects religieux, mais aussi sociaux et politiques, de l'immigration. Comment la volonté d'une communauté de jouir d'un lieu de sépulture est-elle devenue un sujet de controverse ? Et d'abord, en quoi la notion de « frontière » s'immisce-t-elle dans ce débat ?
Affaire de frontières
Les frontières dont il est question ici circonscrivent un territoire symbolique que l'on refuse de concéder parce qu'il est investi d'enjeux identitaires.
Plusieurs auteur·es s'intéressent à l'idée de frontière en contexte d'immigration. Sirma Bilge [3] met en évidence les transformations que l'idée de frontière connait au Québec. Si elle l'applique surtout à la question de l'égalité de genre, elle souligne qu'au sein même des discours s'érige une frontière qui instituera la rupture entre ce qui est « nous » et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire le « non-nous ».
Danielle Juteau [4] questionne l'inclusivité du nationalisme. Elle suggère qu'il comporte une face externe construisant un rapport de domination entre le « nous » et le « eux », mais aussi une face interne recouvrant un ensemble intériorisé d'éléments appartenant à l'histoire.
J'emprunterai ici la distinction « nous/non-nous » de Bilge et celle de Juteau entre « nous/eux ». Ces emprunts ne rendent pas totalement justice aux contextes théoriques dans lesquels ils sont déployés chez les auteures citées. Cependant, ils contribuent à faire comprendre que la frontière n'est pas qu'une ligne de démarcation entre deux territoires. Dans le cas présent, elle spatialise une violence ségrégative et s'exprime jusque dans le contexte sépulcral.
Variations sur des pronoms
Le rejet référendaire de St-Apollinaire, et surtout la campagne de désinformation qui l'a précédé, contraint la communauté musulmane à un rapport de force qui l'oppose aux Québécois·es « de souche » et à une amère réalité voulant que sa volonté, ses aspirations soient négligeables ou tout simplement ignorées. « Québécois·e de souche » est l'expression même du maintien des frontières entre des groupes inégaux de Québécois·es chez Juteau ou de l'« ethnicité fondationnelle » présidant à la distinction entre ce qui appartient au vrai « nous » et ce qui constitue les autres chez Bilge. Ce qui se joue entre le projet de cimetière réel et le fantasme colonial de la Meute creuse la démarcation frontalière.
La Meute pourrait représenter ce que Bilge appelle une « patrouille des frontières », sorte de vigie d'État de la communauté majoritaire qui agit en deux temps. D'abord, la mission qu'elle s'est attribuée prend la forme d'une croisade dont les enjeux sous-jacents reposent, en plus du conflit territorial, sur une guerre aux musulman·es. Ce faisant, la Meute, tacitement approuvée par une frange de la population, cherche à se légitimer en se drapant des signes de la communauté majoritaire et en se réclamant d'une universalité qui la rend intouchable.
Ensuite, nous nous trouvons devant une double opposition dans laquelle apparaissent des modes d'exclusion différents. L'opposition entre la notion de « nous » et de « non-nous », d'abord, a comme effet d'occulter l'autre, de ne lui accorder aucune réelle existence. Mais l'opposition qui se cristallise ensuite entre le « nous » et le « eux » a plutôt comme conséquence de mettre l'autre en évidence pour mieux le stigmatiser. La communauté musulmane se heurte subitement, dans cette expérience cuisante, à un double standard : elle est à la fois invisibilisée dans ses aspirations et mise brutalement en évidence par l'attention soudaine dont elle fait l'objet. La construction de la double opposition approfondit le sillon frontalier au moyen d'une représentation déformée de la culture musulmane et de ses rites.
On évoque d'abord des intentions malveillantes, un désir d'envahir le village et de s'imposer à la vie paisible des résident·es : « Nous, la Meute, ne voulons pas que notre société se voit [sic] imposer une idéologie totalitaire qui fait de la discrimination sexiste, vestimentaire, alimentaire, matrimoniale et sépulcrale » [5].
On insinue aussi — les clichés sont persistants — le danger terroriste que les Québécois·es musulman·es peuvent représenter : « Un cimetière, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de préjugés, mais je ne voudrais pas qu'il y ait des actes terroristes dans cinq ou dix ans et regretter tout ça » [6].
On attribue à la communauté des pratiques étonnantes concernant les rites funéraires : « Une dame a même affirmé que ce cimetière allait attirer les loups parce que les musulmans enterrent les corps sans cercueil. »
On souligne enfin le manque de flexibilité de cette communauté puisqu'elle refuse la contre-proposition d'un cimetière multiconfessionnel : « Pourquoi c'est toujours les musulmans, la religion islamique pis le Coran ? Les autres, ils ne font pas ça ? » [7]
L'opposition « nous/eux » désigne donc la minorité en fonction des peurs et de la méfiance issues de l'incompréhension et de l'ignorance : ainsi, l'« ordre national » se pense, selon Abdelmalek Sayad [8], comme étant naturel, comme allant de soi. On perçoit cette minorité en fonction de représentations intériorisées et imaginaires qui se confondent avec l'observation objective, comme l'a bien montré Edward Saïd, au service d'un discours construisant une justification nationale par la minorisation de l'une de ses composantes. Cette construction provoque le renvoi constant d'un groupe à l'extérieur des frontières symboliques, même si ses membres vivent sur le territoire et qu'ils et elles contribuent, de toute évidence, à la société. Cette double opposition imposée à la communauté des Québécois·es musulman·es, et avivée dans l'histoire du cimetière, peut les placer dans une situation sans issue.
Affleurement d'intégrisme national
La conception de la frontière que propose Abdelmalek Sayad, pour sa part, se fonde davantage sur une stratégie politique de contrôle du flux migratoire. Elle délimite ce qui relève ou non du national. Dans ce régime oppositionnel et exclusif se construit ce qu'il appelle l'« intégrisme national » au moyen duquel on considère que les immigrant·es qui sont là ne devraient pas y être et s'ils y sont, c'est qu'il y a une faille au sein de l'ordre national.
En d'autres termes, le projet de cimetière semble porter atteinte à l'intégrité d'un ordre homogène et inentamé. L'ordre national, dit encore Sayad, ne peut en effet tolérer une frontière qui créerait une séparation entre ce qui est « nous » et ce qui ne l'est pas. Le cimetière est dès lors perçu à la fois comme une incursion dans le territoire national et une erreur que l'on peut encore éviter ou, à tout le moins, tenter de contrôler. Cette méfiance sera exacerbée et instrumentalisée par la Meute et rend intolérable l'éventuelle présence d'un cimetière musulman.
Force est de constater que, sous cette guerre menée contre l'aménagement d'un cimetière, au cœur de l'intégrisme national, se dissimule l'idée d'une laïcité étroite en vertu de laquelle il serait notamment possible d'occulter, de diluer ou de stigmatiser les pratiques musulmanes. Cette laïcité exigerait d'elle, en somme, le sacrifice d'une part de soi pour mieux passer inaperçu·e dans la majorité et se fondre en elle.
Les catégories qui règlent la perception de l'autre sont, selon cette perspective, « des catégories nationales, voire nationalistes » [9], déterminantes et structurantes. Le discours de la Meute se construit à partir d'une rhétorique ultranationaliste, réfractaire à l'immigration et à la présence de l'Islam. Le droit de fixer des frontières, considéré comme le privilège des Québécois·es « de souche », serait soudainement revendiqué par une communauté minorisée, immigrante et musulmane, ce qui semble, à leurs yeux, injustifiable.
Inhumation en terre d'accueil
Le refus manifesté par les citoyen·nes de St-Apollinaire soutenu·es par la Meute fut une piètre victoire. La question nationale qui taraude des franges de la société québécoise alimente un ressentiment antireligieux indiquant que nous n'avons pas fini d'en découdre avec les traumatismes du passé. Entretenue par des années de politiques douteuses, l'exaltation nationaliste de la Meute est venue galvaniser les efforts visant à mettre à mal une communauté éprouvée. À la suite de l'assassinat de six de ses membres à Québec, on aurait pu néanmoins espérer qu'elle fasse l'objet de plus de compassion.
L'expérience vécue par la communauté québécoise musulmane tout au long de cet épisode fut certainement une épreuve pour sa dignité, mais elle a aussi suscité un grand élan de solidarité.
Après 20 ans de recherche, le Centre culturel islamique de Québec et la Ville de Québec ont signé en décembre 2019 l'acte de vente d'un terrain situé près de la Ville de Sainte-Foy, protégeant pour les 50 prochaines années la volonté des membres de la communauté d'enterrer leurs morts auprès d'eux.
[1] Chaïb, Y. (2000). L'émigré et la mort : la mort musulmane en France. Edisud.
[2] citée sans Lisa-Marie Gervais, « Le double deuil des immigrants », Le Devoir, 14 mars 2017. www.ledevoir.com/societe/493919/le-double-deuil-des-immigrants.
[3] Sirma Bilge. « La patrouille des frontières au nom de l'égalité de genre dans une nation en quête de souveraineté.pdf », Sociologie et sociétés, 42, no 1 (2010) : 197-226.
[4] Danielle Juteau, L'ethnicité et ses frontières, 2e éd. (Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 2015). Chapitre 4, « La communalisation ethnique dans le système-monde ».
[5] Déclaration de la Meute citée par X. Camus, « L'implication de La Meute dans le camp du Non à Saint-Apollinaire ». Ricochet. 15 juillet 2017. ricochet.media/fr/1899.
[6] « Le cimetière musulman divise Saint-Apollinaire », Le Soleil, 18 mai 2017.
[7] Cité par Xavier Camus, op.cit.
[8] Sayad, A. (1999). Immigration et « pensée d'État ». Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 129(1), 5 14.
[9] A. Sayad, idem.
Illustration : Marcel Saint-Pierre, Infrarouge, 2007, série Tondi. Pellicule d'acrylique sur bois, 120 cm de diamètre. Collection Jean-Royer.

Apartheid israélien et nécropolitique. Jusqu’où compter les morts ?

Avec le nouveau gouvernement israélien, l'hypothèse de l'annexion totale de la Cisjordanie devient de plus en plus plausible. Parallèlement, les opérations meurtrières de l'armée israélienne se poursuivent, et le blocus contre Gaza perdure depuis 2007. Israël s'empare d'un droit de vie ou de mort sur la population palestinienne. Si la « nécropolitique » fait référence à une politique de la mort, comment l'État d'Israël la met-il en œuvre et jusqu'où ira-t-il ?
Dans ce texte, nous allons nous pencher sur un cadre d'analyse élaboré par Achille Mbembé, historien et politicologue camerounais, qui, s'appuyant sur les notions de souveraineté et de biopouvoir développées par Foucault, explique que « l'expression ultime de la souveraineté réside largement dans le pouvoir et la capacité de dire qui pourra vivre et qui doit mourir. Faire mourir ou laisser vivre constituent donc les limites de la souveraineté, ses principaux attributs. » (Mbembé, 2006 : 29)
Je définis d'abord la souveraineté comme le droit de tuer. Aux fins de ma démonstration, je lie la notion foucaldienne de biopouvoir à deux autres concepts : l'état d'exception et l'état de siège. J'examine les trajectoires par lesquelles l'état d'exception et la relation d'inimitié sont devenus la base normative du droit de tuer. Dans ces situations, le pouvoir (qui n'est pas nécessairement pouvoir d'État) fait continuellement référence, et a toujours recours, à l'exception, à l'urgence et à une notion « fictionnalisée » de l'ennemi. (Mbembé, 2006 : 30).
La souveraineté à laquelle se réfère Mbembé renvoie au pouvoir, notamment celui qui permet de décider qui fait partie du « Nous » et qui en est exclu. En d'autres mots, la souveraineté dont il est question ici permet de désigner l'Ennemi, celui ou celle sur qui l'État, mais pas seulement, a le droit de vie ou de mort. De là, Mbembé établit un lien avec le racisme. De son avis, l'établissement de la division des espèces humaines en différents groupes et la subdivision en sous-groupes distribués à partir de critères reposant sur une césure biologique aboutit au racisme. Il précise : « Dans l'économie du biopouvoir, la fonction du racisme est de réguler la distribution de la mort et de rendre possibles les fonctions meurtrières de l'État. » C'est, dit-il, « la condition d'acceptabilité de la mise à mort ». Il rappelle que pour Foucault, « l'État nazi est l'exemple le plus achevé d'un État exerçant le droit de tuer ». Il ajoute : « l'État nazi est perçu comme ayant ouvert la voie à une formidable consolidation du droit de tuer, qui a culminé dans le projet de la solution finale. Ce faisant, il est devenu l'archétype d'une formation de pouvoir qui a combiné les caractéristiques de l'État raciste, l'État meurtrier et l'État suicidaire » (ibidem, 32).
Fractionnements territoriaux
Cette approche théorique proposée par Mbembé et ici synthétisée nous permet d'extrapoler et d'avancer l'hypothèse voulant qu'Israël constitue un régime d'apartheid menant une nécropolitique, ou politique de la mort. À l'instar de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, le régime d'apartheid israélien constitue une entrave majeure au développement individuel et collectif de la population palestinienne vivant à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, et empêche le regroupement du peuple palestinien désormais dispersé sur plusieurs territoires et États. En dissociant le territoire conquis par les sionistes en 1948 (qu'on appelle aujourd'hui Israël) de la Cisjordanie et de Gaza par une ligne d'armistice, en séparant Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie en 1967, puis en séparant la Cisjordanie de la bande de Gaza pour les traiter comme deux territoires distincts, et enfin en fragmentant la Cisjordanie en zones A, B, et C à l'issue des Accords d'Oslo [1], Israël a, de facto, divisé la population palestinienne qui ne faisait qu'une avant la création d'Israël en 1948. À chaque zone territoriale correspond un statut spécifique pour les habitant·es, et une règlementation distincte qui exercent des contraintes sur les conditions de vie des Palestinien·nes, et les séparent les un·es des autres.
En outre, ces divisions et subdivisions territoriales et la multiplication de statuts distincts ont pour effet d'affaiblir, voire d'effriter le sentiment d'appartenance à une identité commune, le peuple palestinien, à une histoire et un territoire commun. Les contraintes imposées par l'État d'Israël font en sorte qu'un·e jeune Palestinien·ne d'une vingtaine d'années vivant en Cisjordanie n'a jamais mis les pieds à Jérusalem parce qu'Israël le lui interdit. Il ou elle ne connaît pas cette ville pourtant au cœur de son histoire, et au centre du territoire revendiqué pour en faire la capitale d'un futur État palestinien. Les nombreux barrages routiers sont des entraves de plus à la mobilité des Palestinien·nes à l'intérieur des mêmes secteurs géographiques, ce qui contraint grandement la poursuite des études, le travail et la plupart des activités commerciales et économiques. De plus, ce découpage sociospatial accroît le pessimisme de celles et ceux qui estiment que de facto, il est devenu impossible de démanteler les colonies de peuplement en vue de créer un État palestinien sur un territoire contigu. La matérialité de cette fragmentation territoriale empêche même la représentation visuelle d'un éventuel État palestinien qui permettrait à la société palestinienne de s'émanciper politiquement.
Même si Mbembé n'aborde pas directement la question du territoire, la notion de souveraineté y est intimement liée. Ainsi il est permis d'avancer que le biopouvoir est celui qui permet de déterminer qui a le droit de vivre sur un territoire délimité, et qui n'y a pas droit. Pensons ici aux villes blanches sud-africaines durant la période de l'apartheid qui étaient interdites aux Noir·es d'Afrique du Sud. Ces dernier·ères pouvaient certes y travailler, mais ils et elles étaient obligé·es de rentrer dormir dans leurs townships (villes habitées exclusivement par les Noir·es), à moins d'avoir un permis. Autrement, ils et elles risquaient de fortes pénalités qui pouvaient aller jusqu'à leur couter la vie.
Apartheid et appropriation spatiale
Le biopouvoir, la souveraineté, le territoire et le racisme sont donc liés et justifieraient l'accaparement du droit de vie ou de mort ou la nécropolitique au sens de Mbembé. Un peu à l'image de l'Afrique du Sud, l'État d'Israël a découpé et aménagé le territoire sur lequel il a établi et consolidé sa « souveraineté » depuis 1948, à la faveur des intérêts juifs. En 1967, à la suite de l'occupation militaire de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est [2] (occupation illégale à l'égard du droit international), le gouvernement israélien adoptait un schéma d'aménagement prévoyant les futurs sites pour la construction des colonies de peuplement à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza. Au fil du temps, environ 280 colonies ont été érigées pour l'usage exclusif de 710 000 colons juifs [3]. Là-dessus, 138 sont reconnues officiellement par le gouvernement israélien, les autres sont des « avant-postes », c'est-à-dire des noyaux d'habitation créés par des militant·es juif·ves plus radicaux qui prennent l'initiative de créer des sites appelés à être reconnus officiellement par le gouvernement israélien. Ces colonies pourtant établies à l'extérieur de la Ligne verte, soit la ligne d'armistice imposée en 1949 qui sépare l'État d'Israël à la Cisjordanie, ont été construites pour la très grande majorité sur des terres confisquées par Israël, qui appartenaient à des familles palestiniennes. Très souvent, elles sont construites par des ouvriers palestiniens qui pour vivre ou survivre n'ont d'autres choix que d'accepter ce travail. À titre de rappel, à Gaza, il y avait 21 colonies de peuplement où 9 000 colons jusqu'en 2005, date d'un retrait unilatéral israélien.
À Jérusalem-Est, la situation diffère quelque peu de celle qui prévaut en Cisjordanie et à Gaza, car le gouvernement israélien a officiellement annexé cette partie de la ville, ce qui signifie qu'aux yeux des Israélien·nes, la ville est entièrement sous souveraineté israélienne. Cela vaut pour les quartiers de la vieille ville comme pour les quartiers palestiniens qui sont à l'extérieur. La région métropolitaine de Jérusalem a, elle aussi, été découpée selon un schéma d'aménagement ségrégationnel. On y retrouve des quartiers palestiniens et des colonies de peuplement érigées à Jérusalem-Est. Et depuis les années 2000, des familles de colons s'établissent, sous protection policière, au sein même de quartiers palestiniens, ce qui accroît grandement le climat d'insécurité [4].
Par ailleurs, même si Israël n'a pas étendu sa souveraineté aux territoires de la Cisjordanie et de Gaza, il demeure qu'il les judaïse en y établissant des colons juifs et juives. De plus, à partir de la première Intifada [5], les dirigeants israéliens ordonnaient la construction de routes de contournement afin que les véhicules immatriculés de plaques israéliennes ne passent pas trop près des villes et villages palestiniens. Par la suite, des infrastructures routières séparées seront construites. Bref, la planification et l'aménagement territorial ont permis à Israël de matérialiser un régime d'apartheid sur l'ensemble du territoire de la Cisjordanie et de Gaza, aujourd'hui reconnu comme tel par Amnistie internationale, Human Rights Watch et l'organisation israélienne B'tselem.
En outre, il importe de saisir que la stratégie israélienne d'appropriation spatiale des territoires palestiniens s'accompagne de l'accaparement de l'eau, une ressource essentielle à la vie. Selon B'Tselem, 80 % de l'eau de la Cisjordanie serait consacrée au service des activités agricoles israéliennes.
Par ailleurs, ce régime d'apartheid s'accompagne d'un récit qui entretient la peur et la haine de l'Autre, encourage différentes formes de violence et banalise la mort, tant celle des hommes, des femmes que des enfants. C'est ici que la pensée de Mbembé apparaît encore plus pertinente, car elle permet d'avancer que la souveraineté et le biopouvoir ont conduit Israël et des groupes de colons à pratiquer une nécropolitique, soit une politique de la mort pour l'ennemi d'Israël.
Fabrique de l'ennemi palestinien
À la fin du 19e siècle, les Palestinien·nes habitant le territoire de Palestine ont d'abord été considéré·es comme un « peuple absent » comme le rappelle d'ailleurs le fameux slogan des premiers colons sionistes : « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. » Progressivement, ils et elles sont devenu·es indésirables, aux yeux des Israélien·nes, parce qu'ils s'opposaient à la puissance occupante, et résistaient aux confiscations des terres. Plus encore, ils n'ont jamais collaboré avec Israël et se sont rangés derrière l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) de façon quasi unanime. Ajoutons enfin qu'ils et elles ont été associé·es au terrorisme, à la volonté de jeter les Juif·ves à la mer, et au projet de destruction de l'État d'Israël. Ces images de l'Autre qui imprègnent encore aujourd'hui les discours gouvernementaux, les manuels scolaires, la muséologie et la culture contribuent au sentiment d'insécurité des Israélien·nes, laissant croire de façon récurrente à des attaques palestiniennes imminentes, à des enlèvements ou à des attentats à la bombe. Ce discours permet ainsi à l'État d'Israël d'agir en toute impunité sous prétexte qu'il y a état d'urgence ou état d'exception. Les gouvernements israéliens au pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, autorisent ainsi des opérations militaires de grande envergure comme celles qui ont été menées contre la bande de Gaza depuis 2006 (date de la victoire électorale du Hamas à la tête du gouvernement de Gaza), ou appellent à briser les os de la jeunesse palestinienne comme cela avait été le cas lors de la première Intifada. Dès lors qu'on évoque la menace palestinienne, les dirigeant·es israélien·nes autorisent le recours à des mesures illégales à l'égard du droit international. On parle ici de détentions administratives ou d'emprisonnements sans procès, d'emprisonnement de mineur·es, ou de mesures dites de représailles comme la destruction de maisons où un membre de la famille est soupçonné d'avoir participé à une action contre Israël. De leur côté, des colons israéliens vont déraciner des arbres sur les terres palestiniennes ou entraveront le travail des paysan·nes palestinien·nes, qui demeurent pour un bon nombre de familles palestiniennes le principal moyen de subsistance.
Cette lecture très synthétisée de la souveraineté et de la nécropolitique permet de mettre à nu la véritable nature colonialiste, raciste et meurtrière de l'État d'Israël, un État qui se dit encore un État d'exception [6] alors qu'il a l'une des plus puissantes armées de la région du Machrek et qu'il bénéficie de l'aide militaire et financière des États-Unis.
[1] À l'issue des Accords d'Oslo, la Cisjordanie a été divisée en trois zones géographiques distinctes, soit la zone A constituée des grandes villes palestiniennes et placée sous l'Autorité palestinienne, la zone B qui recouvre les zones en périphérie de ces grandes villes, et enfin, la zone C.
[2] Le Golan syrien et une partie du Sinaï égyptien ont également été occupés à l'issue de la Guerre des Six jours, mais nous n'en traitons pas dans cet article.
[3] Ces données proviennent de l'organisme israélien des droits humains et concernent l'année 2022.
[4] Les colons israéliens qui sont réservistes portent leurs armes sur eux jour et nuit.
[5] « Intifada » signifie en arabe « soulèvement ». La première Intifada a eu lieu de décembre 1987 à 2001.
[6] Selon Universalis : « On désigne par “ état d'exception ” la situation dans laquelle se trouve un État qui, en présence d'un péril grave, ne peut assurer sa sauvegarde qu'en méconnaissant les règles légales qui régissent normalement son activité. L'organisation de l'État, en période normale, est conçue de manière à réaliser un équilibre entre les exigences du pouvoir et celles de la liberté ; elle ne convient plus lorsqu'il s'agit de faire face à un danger exceptionnel et que le besoin d'efficacité et de rapidité passe au premier plan. »
Anne Latendresse est militante internationaliste.
Illustration : Marcel Saint-Pierre, Méli-mélo, 1978. Huile sur toile libre, 213 x 619 cm

Antigone et la fondation nationale par le deuil

Comment appréhender la succession morbide de tueries de masse aux États-Unis ? Si elles sont le fruit de la folie du siècle, elles s'ancrent aussi dans l'histoire américaine et contribuent à refonder la nation.
Sur certains sites de prévention de la violence, une carte des États-Unis marque d'un point rouge les villes ayant servi de scène à des fusillades de masse durant les dernières années. Le territoire américain se trouve ainsi reconfiguré à partir des massacres qui l'habitent. En menant une recherche sur le mot mass shooting (fusillade de masse), on tombe sur une longue liste de lieux associés à cette pratique. Aucun pays n'est à l'abri de tels massacres et les exemples récents nous montrent leur mondialisation. Certes, les États-Unis ont développé une pratique routinière des fusillades de masse s'inscrivant dans une expérience de la violence par armes à feu. En 2013, on dénombrait aux États-Unis 21 175 suicides et 11 313 homicides involontaires et volontaires par armes à feu, alors qu'au Japon, durant la même année, 13 mort·es de la même manière étaient recensé·es. Un·e Américain·e a 300 fois plus de chances de mourir d'un homicide par arme à feu qu'un·e Japonais·e. [1]
Si le massacre établit un temps de la répétition (« encore un ») développé à partir d'un récit comptable, voire maniaque (20 200 morts causées par des armes et travers 647 fusillades de masse en 2022), il dialogue aussi avec la géographie des États-Unis (Uvalde, Aurore, Bernardino, Half Moon Bay et tant d'autres lieux). Les fusillades de masse (en très grande majorité perpétrées par des hommes ou des personnes qui s'identifient au genre masculin) [2] perpétuent des récits de territoires et de conquêtes possibles et impossibles. La part de la construction nostalgique du genre à travers le port d'armes n'est pas à négliger, comme le montrent de nombreuses études [3].
À chaque instant, tout·e citoyen·ne américain·e sait qu'il ou elle peut être la cible d'un tireur fou dans une salle de concert, une école, une université, un centre d'achats, un bar, un restaurant, une salle de cinéma et même sur l'autoroute. Des criminologues affirment qu'éliminer le risque de meurtre de masse aux États-Unis impliquerait des mesures « extrêmes » : abolir le second amendement, faire advenir le plein emploi, réinstaurer le sens de la communauté et introduire la possibilité d'arrêter toute personne qui a l'air suspecte ou qui agit de façon considérée étrange (ce qui est tout de même le cas dans le profilage racial, mais passons…). « Les fusillades sont peut-être le prix que nous devons payer pour vivre dans une société où la liberté personnelle est si estimée » [4].
Les fusillades ont une histoire
Or, ces fusillades de masse ne sont pas nouvelles dans l'histoire américaine, malgré le sentiment général. Il est habituel de faire remonter la première fusillade de masse en août 1966, à l'Université du Texas à Austin. 15 personnes moururent et 31 furent blessées lors de cet événement. Le Smithsonian Institute, lui, voit la première fusillade de masse en 1949 quand un vétéran de guerre mit à mort 13 personnes en 12 minutes dans la ville de Camden (New Jersey). S'il n'y a pas de bataille ici pour la première place dans cette série de l'horreur, force est de constater qu'il est difficile, après une brève recherche sur internet, d'avoir accès aux données relatives aux fusillades de masse avant le XXe siècle. Pourtant, on découvre des récits montrant l'existence de tels événements : en 1891, un homme armé blesse, dans une salle de concert d'une école au Mississippi, 14 personnes [5]. En 1893, quatre étudiants furent tués par balle et moururent durant une danse festive au Plain Dealing High School en Louisiane. Ces meurtres de masse souvent haineux, racistes, sont peu pris en compte par la mémoire historique américaine, relevant simplement dans les esprits des dommages collatéraux de l'esclavage ou encore de querelles intimes et privées.
En effaçant ainsi le passé américain et en faisant de la fusillade de masse le produit d'une modernité, d'un éventuel relâchement des mœurs, on évite de faire remonter à la surface de l'histoire le fait que les États-Unis d'Amérique se sont construits sur des génocides (peuples autochtones) et des violences terribles (ségrégations de toutes sortes, guerres civiles) qui leur ont permis de se constituer en nation. Le second amendement, sur lequel on s'appuie pour défendre l'accès aux armes, va en ce sens. La folie meurtrière, souvent aveugle et banalisée, est peut-être un des gestes problématiques, mais fondateurs, de la nation américaine et de beaucoup de nations occidentales qui ont longtemps été fières de leur capacité à dominer d'autres peuples, à effacer des altérités et à nier leur violence fondatrice, dont l'archaïsme pulsionnel ne colle pas avec les progrès dont se targuent ces pays.
Cette idée d'un trauma à répétition est avancée par des psychologues aux États-Unis [6]. Rossolatos par exemple va dans le sens d'un traumatisme culturel où les membres d'une collectivité, ici les États-Unis, sont l'objet (ou le sujet) d'événements horribles qui laissent des marques indélébiles sur la conscience d'un groupe, marques que les fusillades de masse à répétition mettent en scène et réactivent. Rossolatos suggère que les fusillades de masse servent de glu sociale. L'Amérique sans cesse rejoue sa violence fondatrice et crée du bouc émissaire, du sacrifice qui vient refonder, à travers le deuil des communautés et des groupes politiques. Il est commun d'entendre les discours politiques présidentiels commencer ainsi : « J'aimerais que tout le monde à travers le pays garde dans ses pensées et prières les familles et la communauté de… ».
Un trauma national
Les fusillades de masse constituent des traumas collectifs sur des territoires d'abord limités. Mais elles deviennent vite des traumas nationaux par l'intermédiaire des médias qui configurent souvent les événements dans la hâte demandée par le sensationnalisme. Ce deuil collectif, en série et demeurant toujours à refaire, concerne l'ensemble du territoire américain qui se voit atteint. Pourtant, ce n'est pas seulement un discours de deuil qui se fait jour à l'occasion de ces fusillades, mais un plaidoyer pour la résilience du peuple américain qui, comme le phénix renaît plus fort de ses cendres et ses blessures, garantissant sa liberté. Peu de textes ont réfléchi sur ces traumatismes à répétition comme récits refondateurs et donc nécessaires à la « grandeur » d'une nation. Les fusillades de masse n'occuperaient-elles pas dans la nation une place semblable aux récits de guerre ?
Ces meurtres de masse visant un groupe déterminé ou non doivent être pensés dans un rapport au territoire national, sans cesse conquis. En effet, si le meurtrier, par son geste, n'a pris possession d'un lieu que momentanément, il est impossible de négliger la place imaginaire et symbolique créée par un espace que la fusillade a propulsé dans un ensemble de lieux de terreur et de résilience politique et religieuse. Après l'événement, cet espace est le terrain d'une occupation identitaire, communautaire et politique, puisque la mort et le deuil, comme nous l'a si bien montré la grande Antigone, créent des territoires réels et symboliques pour lesquels des partis se battent et s'arrogent des droits sur les morts.
S'il semble loin le temps pour la pensée occidentale où les suicidé·es des chrétiens n'avaient pas droit au cimetière, il faut néanmoins se pencher sur les modalités actuelles des lieux de commémoration des fusillades de masse pour comprendre que la question de l'hommage aux mort·es est encore très importante dans les sociétés occidentales.
L'appropriation du deuil
On ne peut pas négliger de penser les discours conflictuels et belliqueux qui ont lieu dans l'après-coup des fusillades. La reconstruction de la mémoire et le culte des morts après un tel événement viennent conforter des récits stratégiques. La mort et les mort·es servent les fins de l'État ou encore de groupes religieux ou/et politiques. C'est du moins ce que montre dans une étude importante Crystal Lacount [7] qui analyse la construction de la mémoire après le massacre de Columbine perpétré en 1999 dans un collège du Colorado, par deux étudiants.
Comme lors de beaucoup de fusillades, tout juste après le massacre, un désir spontané de témoigner aux mort·es une dernière pensée s'est exprimé aux alentours du collège devenu scène de crime. Des chapelles spontanées furent érigées par des citoyen·nes dévasté·es qui apportaient des objets personnels symboliques. Ces gestes, qui pouvaient redonner aux gens une capacité d'agir, se voulaient une offrande faite aux jeunes mort·es. Ces lieux spontanés de commémoration se présentent comme neutres politiquement. D'un commun accord tacite, on peut même parfois pleurer sur ces sites les meurtriers, tant ces espaces se veulent accueillants envers une douleur vive. Notons cependant que ces gestes ne sont pas le privilège des fusillades de masse, mais de morts qui viennent toucher viscéralement le public (mort de Lady Diana, de la reine Élisabeth, etc.). Il s'agit de laisser la trace d'une émotion, d'une douleur sur le site de la mort ou dans ses alentours qui restent dans la pensée populaire porteurs de quelque chose. Personne n'est en effet immédiatement inclus·e dans ces rituels de mémoire ou n'en est exclu·e. Ce mélange d'artefacts, de pensées, ce bric-à-brac d'offrandes, montre un tissu social qui se fait à travers le deuil et étonnamment parfois dans une diversité.
Or, dans l'après-coup des fusillades, la mort devient un territoire politique où est demandé un contrôle des armes, mais où sont instrumentalisées de prétendues persécutions contre les communautés religieuses ou encore contre la NRA (National Rifle Association) qui voit une appropriation par la gauche anti-armes des mortes et des morts. Certaines de ces organisations de droite tentent donc de s'immiscer dans la construction des lieux officiels de commémoration du massacre pour mieux leur donner un ancrage idéologique.
Une semaine après le massacre de Columbine, une bataille eut lieu sur la question de croix commémoratives. Fallait-il ériger des croix pour les meurtriers ? Greg Zanis, charpentier (comme le Joseph du Nouveau Testament) de son état, vint tout droit de Chicago pour édifier 15 croix de six pieds. Ces « Crosses for losses » ont créé des dissensions dans la communauté de Littleton au Colorado. Le père d'une victime de Columbine détruisit les croix dédiées aux meurtriers. Entre un geste spontané de deuil et une érection de croix par un charpentier de Chicago atteint de prosélytisme national et religieux, il y a un monde que seule la prise de possession du territoire de la mort semble justifier. Mais très mal…
Devant cette violence chrétienne, on préféra reconstruire le collège qui avait été très abimé par la fusillade. Les parents de victimes et les blessé·es joignirent leurs efforts et créèrent un groupe nommé Healing of People Everywhere (H.O.P.E.) qui érigea un mur de la guérison. Le Wall of Healing, fait des pierres rouges du Colorado, crée de nos jours un ovale englobant, qui se veut inclusif et hospitalier. Dans ce mémorial, chaque famille des victimes put fournir un texte personnel dont les mots furent gravés dans la pierre. Après ces massacres par fusillade et après de longues et intéressantes consultations publiques, il est possible dans certaines communautés de créer un mieux-être collectif en rendant hommage aux mort·es et à la douleur à travers une diversité et un mélange des voix.
Est-ce que les États-Unis pourront refonder de vraies collectivités dans un deuil respectueux et diversifié ? C'est ce que souhaitent beaucoup de gens qui sentent que c'est malheureusement à travers le deuil que le politique peut se renouveler. Comme quoi, même en Amérique, les Antigone se rebellent encore et toujours contre des deuils politiques qui font dans la parole toute faite et dans l'appropriation des morts.
[1] Fisher, Max, and Keller , J. (2017) « What explains US Mass Ahootings ? International Comparisons Suggest an Answer. » The New York Times.
[2] Bridges, Tristan, and Tober, Tara Leigh (2022) « Mass shootings and masculinity ».
[3] Morgan, S., Allison, K., & Klein, B. R. (2022) “Strained Masculinity and Mass Shootings : Toward A Theoretically Integrated Approach to Assessing the Gender Gap in Mass Violence, Homicide Studies, 2022, p. 10887679221124848.
[4] Fox, J. A., & DeLateur, M. J. (2014) « Mass Shootings in America : Moving Beyond Newtown », Homicide Studies, 18 (1), 125–145. Ma traduction de la dernière phrase de l'article.
[5] behindthetower.org/a-brief-history-of-mass-shootings
[6] Rossolatos, G. (2020) « Consuming the Scapegoat : Massshootings as Systemically Necessary Cultural Trauma », International Journal of Marketing Semiotics & Discourse Studies, Vol. VIII, pp.1-16.
[7] LaCount, Crystal (2020) Commemoration, Memorialization and Mass School Shootings : an Analysis of Collective Memory and Power Structures. A thesis submitted to the Graduate Council of Texas State.
Catherine Mavrikakis est écrivaine et professeure de création littéraire à l'Université de Montréal
Illustration : Marcel St-Pierre, Sous le chapiteau, 1999, détail. Pellicule d'acrylique sur toile, 120 x 150 cm. Collection particulière

Colombie. Entre la violence et l’espoir
Plusieurs analystes ont expliqué la persistance de la violence en Colombie par des manifestations de criminalité individuelle. Il faut toutefois, même si cela est complexe, tenter de comprendre la violence autrement pour rendre compte de sa persistance dans le temps et l'espace.
De nombreuses générations ont vécu dans ces circonstances, depuis le moment de notre naissance en tant que république en 1810 par la main du libérateur Simon Bolivar et son rêve d'une Amérique unie. À cette époque, il est évident que les guerres menées par les Espagnols ont été guidées par des intérêts individuels qui s'opposaient à ce rêve.
Une clarification nécessaire
Il est important de garder à l'esprit que les différents actes de violence en Colombie ont été si nombreux et d'une telle ampleur qu'il n'est pas possible de les traiter dans leur ensemble. Les facteurs qui ont déclenché ces conflits sont multiples. Les victimes ne peuvent pas être entièrement comptabilisées.
Le sociologue colombien Orlando Fals Borda a avancé plusieurs hypothèses sur les raisons de cette violence. Certaines d'entre elles sont liées à une série de luttes régionales, d'autres à des causes structurelles telles que la pauvreté et les inégalités sociales. Une troisième hypothèse concerne les idéologies politiques en jeu. Une autre analyse s'intéresse au manque de légitimité de l'État et à l'exercice du monopole de la force [1].

Par ailleurs, de l'État colombien et son appareil militaire et paramilitaire aux groupes de paysans armés en passant par les diverses guérillas insurgées ou les groupes criminels en général, de nombreux acteurs violents ont été impliqués. Chacun d'entre eux a contribué à ces conflits.
Les origines de la violence
Le contexte actuel trouve ses racines dans les évènements connus sous le nom de « La Violencia » qui se sont produits entre 1946 et 1963. Un cap est franchi le 9 avril 1948, avec l'assassinat du dirigeant du Parti libéral Jorge Eliécer Gaitan. Cet épisode décisif pour l'histoire de la Colombie marque la naissance des groupes d'autodéfense paysans. Ces derniers vont engendrer des guérillas proches du Parti libéral qui constituaient alors la réponse armée aux groupes paramilitaires liés au Parti conservateur.
La période de violence s'est approfondie avec la barbarie vécue dans les campagnes, où la mise à mort par empalement des hommes, des femmes et des enfants est devenue chose courante. Cela a entraîné de grands déplacements des communautés paysannes qui ont été contraintes d'occuper de nouvelles terres pour leurs cultures, ce qui a déclenché diverses confrontations avec les propriétaires terriens.
Il convient de mentionner que les oligarques ont accepté de mettre fin à la guerre entre les conservateurs et les libéraux par la construction du Front national, qui était un pacte entre les deux partis pour écarter le général dictateur Gustavo Rojas Pinilla du pouvoir et « arrêter l'effusion de sang ». Cependant, le Front national a fermé les portes du pouvoir politique à certains groupes sociaux, dont les groupes paysans, les communautés autochtones et la population à gauche politiquement, en assurant l'alternance du pouvoir entre libéraux et conservateurs tous les quatre ans. Les problèmes dans les campagnes se sont poursuivis, les paysans n'ayant pas de terres à cultiver et la misère dans les villes continuant de croître. En conséquence, certaines guérillas libérales ont refusé la paix proposée par le gouvernement et ont continué d'affronter l'État.
Parallèlement à l'augmentation du déséquilibre dans la distribution des terres, la répression exercée par l'État s'est accrue. Plusieurs groupes émergent face à cette situation. En 1967, les guérillas révolutionnaires des FARC-EP [2], de l'EPL [3], et de l'ELN [4], tous d'orientation marxiste-léniniste, apparaissent. En 1970, le M-19 nait en réponse à la fraude électorale qui a profité au conservateur Misael Pastrana. D'une autre perspective, le mouvement indigène Quintín Lame nait à son tour en 1981.
De difficiles accords de paix
Bien que l'histoire de la Colombie ait été marquée par la violence, il est important de mentionner que la société civile – les communautés paysannes, les syndicats, les peuples autochtones, les femmes, les afrodescendant·es, les étudiant·es et les communautés locales – a toujours recherché la paix.
Les années 1980 ont été caractérisées par le travail de diverses communautés pour cesser les hostilités entre les différents groupes armés, y compris l'armée nationale. C'est pourquoi, en 1984, une table de négociation a été ouverte entre le gouvernement de Belisario Betancur et la guérilla des FARC-EP à Uribe-Meta. Elle avait pour but d'obtenir un cessez-le-feu bilatéral et de négocier une solution politique au conflit social et armé.
L'un des éléments les plus importants qui ont été discutés concernait la nécessité d'élargir la démocratie et de faire participer les secteurs de la société qui avaient été historiquement marginalisés par les politiques du Front national. Ainsi est né le parti La Unión Patriótica-UP. Son objectif était de consolider un accord de paix qui permettrait la participation politique de la guérilla et d'autres secteurs populaires et alternatifs.

L'UP était composée d'un grand nombre de personnes avec et sans affiliation politique. Elle comprenait des membres des FARC et du Parti communiste colombien, des syndicalistes, des organisations paysannes, communautaires et étudiantes, et même des libéraux et conservateurs ayant des positions démocratiques.
Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la violence contre l'UP commence. Dès le premier instant de sa consolidation, des milliers de militant·es ont été assassiné·es, torturé·es et contraint·es de fuir le pays. Le nombre de victimes de ce génocide a été estimé à 6000 personnes. Il convient de mentionner l'assassinat de deux candidats à la présidence : Jaime Pardo Leal et Bernardo Jaramillo. L'extermination de l'Unión Patriótica signifiait la perte de son statut juridique et donc la perte de son action politique. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'UP qui a été victime de la répression de l'État et de son appareil paramilitaire, mais aussi d'autres coalitions comme le mouvement syndical et populaire A Luchar.
Ces massacres faisaient partie d'un plan d'extermination systématique contre le parti politique. Ils et elles ont été exécuté·es avec la participation d'agents de l'État et du secteur paramilitaire, et avec la complaisance des autorités. Dans ce contexte, les FARC-EP ont considéré qu'il n'y avait pas de conditions politiques favorables pour continuer le processus de paix et ont repris les armes.
Malgré la répression et la persécution politique, le peuple colombien n'a pas renoncé à son rêve de vivre en paix, et, en 1990, la paix a été signée avec le M-19, une partie de l'EPL, le Mouvement Quintín Lame et une faction de l'ELN. Cependant, la violence s'est fait à nouveau sentir le 8 mars de la même année lorsque le candidat présidentiel du M-19, Carlos Pizarro, a été assassiné. En 1991, la nouvelle constitution néolibérale est promulguée, laissant derrière elle de nombreux éléments démocratiques qui avaient été acquis.
Les années 1990 ont été caractérisées par une violence intense dans le pays où les oligarques ont travaillé avec les trafiquants de drogues et les paramilitaires, faisant des milliers de mort·es, de disparu·es, de torturé·es et de déplacé·es.
Malgré ce climat politique, de nombreuses organisations, partis de gauche et secteurs démocratiques ont continué à travailler pour la paix. À la fin de la décennie, une table de négociation a été créée entre le gouvernement d'Andrés Pastrana et la guérilla des FARC-EP à El Caguán. Malheureusement, elle a échoué en raison de l'aggravation du conflit et du renforcement du paramilitarisme.
Après la rupture de la table des négociations, le conflit s'est aggravé avec l'arrivée d'Álvaro Uribe et sa politique de « sécurité démocratique ». Celle-ci se concentrait prétendument sur l'élimination militaire de l'insurrection, tout en renforçant la répression contre les organisations sociales, les défenseur·euses des droits humains et les militant·es de gauche. Durant cette période sombre, 6 402 exécutions extrajudiciaires ont été dénombrées à ce jour. Le plus souvent, il s'agissait de civil·es déguisé·es en guérillero·as et tué·es par l'armée pour obtenir des prix et des promotions.
Des années plus tard, en 2012, l'UP a de nouveau été légalement autorisée à fonctionner. La même année, l'État colombien a accepté une certaine responsabilité dans le génocide. Et en novembre 2016, la guérilla des FARC et le gouvernement de Juan Manuel Santos ont signé l'Accord final pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable.
Le dénouement de ce long conflit rend manifeste la nécessité de mettre fin aux violences, de distribuer plus équitablement les terres, de mettre en place un système de justice, de vérité, de réparation et de non-répétition des erreurs passées.
Un moment historique
La Colombie a une longue histoire de violence qui a laissé des blessures profondes, dont la plupart ne sont toujours pas cicatrisées. Mais en même temps, elle a une histoire de résistance et de résilience. Ses principaux acteurs et actrices ont contribué à une politique démocratique, à la mémoire historique, à l'art et à la transformation sociale. La lutte pour la paix à partir du principe moral de justice sociale a été un but décisif pour la construction de la démocratie dans le pays.
À chaque épisode de violence, les communautés ont appris à affronter les scénarios les plus douloureux. Il n'est pas possible de parler de la violence en Colombie sans parler des actions collectives qui visent toujours à construire et transmettre la mémoire collective. Les luttes historiques pour la terre, les revendications des communautés historiquement marginalisées comme les communautés autochtones, afrodescendantes, paysannes et ouvrières, la signature de l'accord de paix et le soulèvement de millions de jeunes en 2021 ont créé les conditions sociopolitiques nécessaires pour qu'une coalition des forces alternatives et de gauche arrive au pouvoir en juin 2022. C'est une première dans l'histoire de la Colombie.
Cette coalition s'est engagée à vérifier certains des besoins des populations vulnérables. Six mois après l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Gustavo Petro, ancien guérillero du M-19, une série de réformes ont été mises en place, comme la protection de l'Amazonie, la réforme agraire, la loi de paix totale, le rétablissement des relations avec le Venezuela et la reprise des négociations avec l'ELN [5].
Mais ni la paix ni la justice sociale ne viendront du gouvernement seul. Les mouvements sociaux et les partis de gauche en sont conscients et travaillent chaque jour pour éviter d'être victimes d'un nouveau conflit ou d'être instrumentalisés par les institutions.
Tant les mouvements que les partis travaillent à mettre un terme définitif à un système oppressif, extractiviste, raciste, criminel et patriarcal qui a fait de la Colombie sa véritable forteresse économique. C'est pourquoi notre slogan restera le suivant : « Ils peuvent couper une fleur, mais ils ne mettront pas fin au printemps. »
[1] Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta Ya ! Colombia : memorias de guerra y dignidad. Resumen, Bogotá, CNMH, 2013, page 13. German Guzman Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umana Luna, La violencia en Colombia Tomo 1, Bogotá, Taurus, 2005, page 15.
[2] Forces armées révolutionnaires de la Colombie-Armée populaire.
[3] Armée populaire de libération.
[4] Armée populaire de libération nationale.
[5] INFOBAE, Colombia/ Estos son los 50 logros que destacó Gustavo Petro en sus primeros 100 días de gobierno, www.infobae.com/america/colombia/2022/11/15/estos-son-los-50-logros-que-destaco-gustavo-petro-en-sus-primeros-100-dias-de-gobierno/
Jessica Ramos et Ronald Arias, militant·es de l'Unión Patriótica (parti politique colombien)
Photos : Unión Patriótica
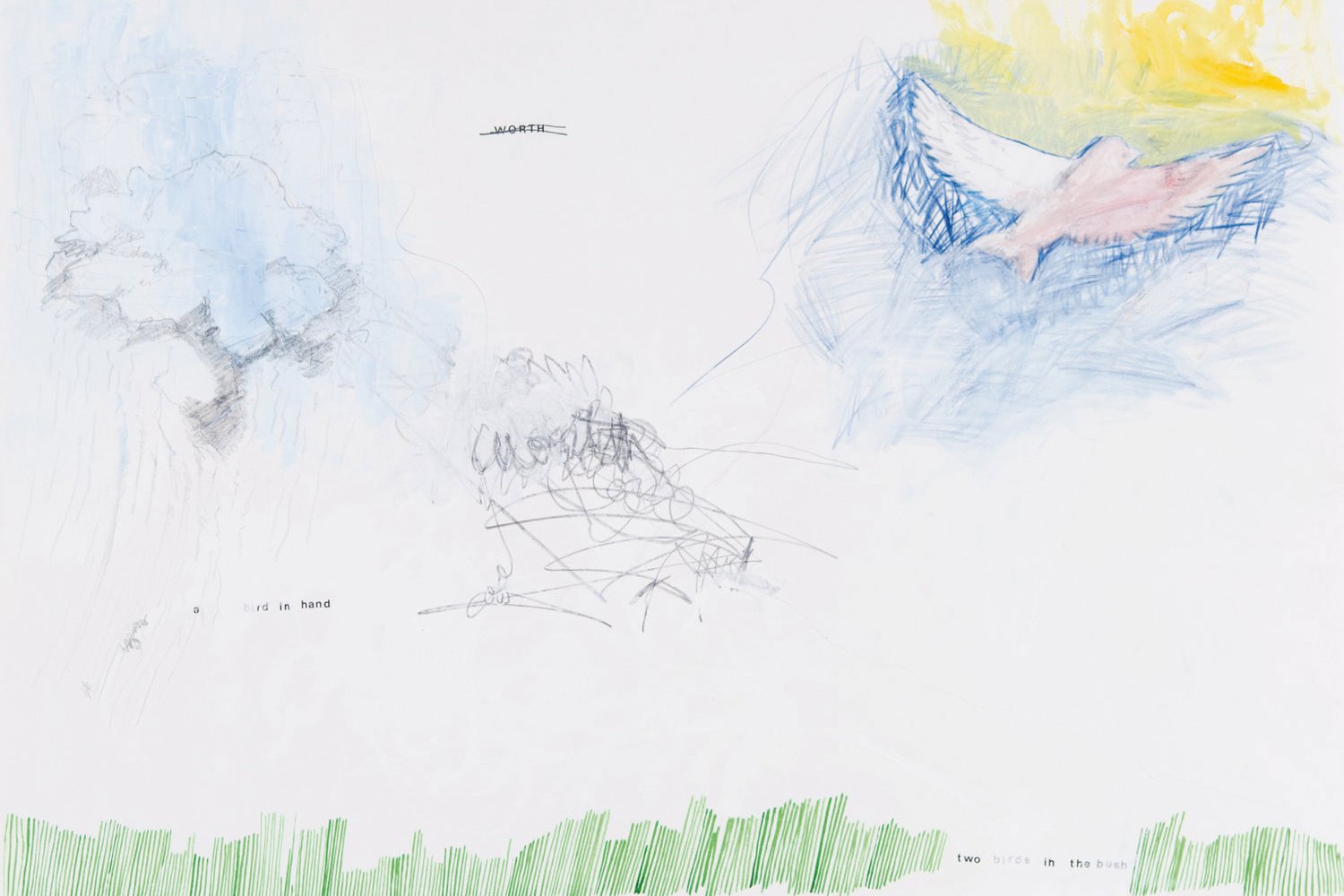
Acadie : Un accent sur notre monde

L'Acadie : une communauté, un peuple, une nation ? Le besoin de se nommer, de se placer et de se (re)définir conduit à une multitude de réponses qui convergent toutes vers une volonté d'expression d'un groupe distinct, ancré au sein d'un territoire atlantique sans frontières claires. L'identité acadienne est à la fois forte et fragmentée, autant dans les espaces variés qui la composent que dans la façon de la vivre au quotidien.
Ce questionnement sans cesse renouvelé mène pourtant vers une expansion de l'identité et devient une force qui cherche constamment les meilleurs agencements pour construire le vivre-ensemble sur le territoire. Autrement dit, l'exercice de se réinventer pousse vers la résilience et l'agir. L'Acadie est à même de se bâtir au quotidien, de se reformuler à travers des discours identitaires fondamentalement hétérogènes et multiples.
Toute lutte, toute prise de conscience, tout projet de société qui figure dans ce dossier peut servir de réponse à la question qu'on se pose (trop) souvent : « c'est quoi, l'Acadie ? ». À dire vrai, si cette grande question reste sans réponse fixe, c'est parce que l'Acadie est tournée vers l'avenir.
Le dossier brosse un portrait de l'Acadie d'aujourd'hui, qui se définit par sa multiplicité et sa contemporanéité au-delà des marqueurs identitaires classiques (la Déportation, la généalogie, la langue française, la pêche, etc.). On y interroge le rapport au territoire et à la langue, en plus d'y explorer le rapport que les Acadien·nes entretiennent avec le pouvoir politique. Le dossier présente aussi des réflexions sur les enjeux queer en contexte minoritaire francophone et rural, ainsi que sur l'accueil que réserve l'Acadie du Nouveau-Brunswick aux immigrant·es racisé·es. Les enjeux féministes sont quant à eux abordés dans un texte sur l'accessibilité des services publics d'avortement et de santé reproductive au Nouveau-Brunswick. Le dossier se termine par une réflexion sur l'impact de la crise climatique sur le littoral acadien et les activités économiques et culturelles reliées à l'océan, car, bien que l'Acadie soit en redéfinition constante, la mer demeure centrale dans son rapport au territoire.
En réponse à la fameuse phrase d'Irène Doiron (dans le documentaire L'Acadie, l'Acadie !!? de Michel Brault et Pierre Perreault) comme quoi « l'Acadie, c'est un détail », le présent dossier suggère plutôt que l'Acadie est la somme, vaste et remarquable, de tous ses détails, hétérogènes, mouvants, imaginatifs.
Nous remercions chaudement l'artiste Angèle Cormier pour les illustrations de la couverture et de la page d'ouverture du dossier.
Dossier coordonné par Valérie Beauchamp, Arianne Des Rochers, Isabelle LeBlanc et Charles MacDougal
Avec des contributions de Alex Arseneau, Kevin Arseneau, Rébeka Frazer-Chiasson, Mélodie Jacquot-Paratte, Michelle Landry, Geneviève L. Latour, Philippe LeVoguer, Charles MacDougall, Leyla Sall, Isabelle Violette et Mathieu Wade
Isabelle LeBlanc est professeure agrégée en sociolinguistique. Charles MacDougall est citoyen engagé.
Illustration : Angèle Cormier œuvre dans le domaine des arts visuels depuis plus
de 20 ans. Après avoir obtenu son baccalauréat en arts visuels à l'Université de Moncton, elle a travaillé sur des plateaux de tournage, dans un centre d'artiste autogéré, auprès d'un festival de cinéma et un festival de littérature. Elle est présentement technicienne à la Galerie d'art Louise-et-Reuben-Cohen et au Musée acadien de l'Université de Moncton. Elle travaille principalement en sérigraphie à l'atelier d'estampe Imago, situé au Centre culturel Aberdeen.













