Revue À bâbord !
Publication indépendante paraissant quatre fois par année, la revue À bâbord ! est éditée au Québec par des militant·e·s, des journalistes indépendant·e·s, des professeur·e·s, des étudiant·e·s, des travailleurs et des travailleuses, des rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l’organisation de notre société, dans les rapports entre les hommes et les femmes et dans nos liens avec la nature.
À bâbord ! a pour mandat d’informer, de formuler des analyses et des critiques sociales et d’offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire. À bâbord ! veut appuyer les efforts de ceux et celles qui traquent la bêtise, dénoncent les injustices et organisent la rébellion.

Le capitalisme coupable

Nous avons posé à différents groupes les deux mêmes questions : pourquoi y a-t-il de la pauvreté dans notre société et comment l'éradiquer définitivement ? Voici leurs réponses.
Mouvement Action-Chômage (Mac)
Le MAC est un groupe de défense des droits des sans-emploi. Il informe et défend les gens tout en visant la sauvegarde et l'amélioration du régime d'assurance-chômage.
Au Mouvement Action-Chômage de Montréal, on a un très gros parti pris pour les classes populaires. Depuis plus de 50 ans, on est de toutes les luttes contre la pauvreté, une pauvreté révoltante compte tenu de l'abondance et de la richesse produite à Montréal, au Québec et au Canada. Cette indigence est aussi absurde quand on sait qu'elle est le fruit d'une transgression crasse des droits humains, constamment bafoués. Rappelons qu'encore en 2024, des personnes ne peuvent pas manger à leur faim, se loger convenablement ou se déplacer.
Dans les bureaux du MAC de Montréal, on côtoie quotidiennement la cause profonde de cette pauvreté : le capitalisme. La pauvreté existe dans notre société parce que le système en a besoin pour se maintenir. Sans la pauvreté, il ne pourrait y avoir de riches qui s'approprient le fruit du travail collectif. En attendant que la main invisible du marché se manifeste enfin, les inégalités nourrissent la pauvreté qui le lui rend bien. Mais pourquoi se plaindre ? On nous assure que le travail c'est la santé, que ce sont les patrons qui prennent les risques pour faire fructifier le bien commun et que la richesse finira bien un jour par ruisseler vers le bas, à condition que tout le monde y mette du sien ? Ces idées ont largement infiltré la façon dont on gère les services publics comme la santé, l'éducation et les programmes sociaux tels que l'aide sociale et l'assurance-emploi.
Au MAC de Montréal, on voit aussi comment l'État peut être au service des patrons en gérant la caisse d'assurance-emploi – sans y mettre un sou – de manière que seule la moitié des travailleuses et travailleurs aient accès à leurs prestations quand ils ou elles en ont besoin. C'est évident pour nous que le patronat a besoin de la menace du chômage pour garder les travailleuses et travailleurs à leur poste. La justification pour un piètre programme social de remplacement de revenu est toute trouvée. Il ne faudrait pas être trop confortable… L'armée de réserve est essentielle au renouvellement constant du bassin de cheap labour sur lequel reposent des pans entiers de notre économie. Le régime actuel d'assurance-emploi est donc un outil de régulation de la main-d'œuvre pour s'assurer que les travailleur·euses prennent le premier emploi venu et restent bien ancré·es dans la pauvreté.
Endiguer la pauvreté est impossible dans notre organisation économique actuelle. La seule façon d'y arriver serait d'atteindre le plein emploi, une impossibilité structurelle à l'intérieur du capitalisme. En attendant le grand soir et un changement de paradigme profond, il nous reste à lutter pour un régime d'assurance-chômage décent qui donne un vrai revenu de remplacement en cas de perte d'emploi – pas seulement 55 % – qui s'assure que les personnes puissent faire une bonne recherche d'emploi pour trouver un emploi qui corresponde à leurs besoins, à leurs compétences et à leurs obligations. Un régime qui soit idéalement géré par et pour les travailleuses et travailleurs, pas par un État constamment au service du patronat.
Comité intersyndical Montréal métropolitain (CIMM)
Le CIMM est une table de concertation intersyndicale représentant plus de 400 000 travailleuses et travailleurs à travers les syndicats et les structures régionales de la plupart des organisations syndicales montréalaises.
Le Québec est traditionnellement présenté comme une société égalitaire, juste, dotée d'un filet social robuste et attentive aux besoins des plus précaires. Pourtant, force est de constater que les inégalités sociales et la pauvreté y font des ravages depuis longtemps, et plus particulièrement ces dernières années. Après des décennies de néolibéralisme, nous sommes moins bien outillé·es que nous le croyions pour répondre à la crise du logement et à la montée galopante de l'inflation. Celles-ci touchent une proportion significative de la population ; nous en sommes même rendu·es au point où des travailleuses et travailleurs, parfois à temps plein et syndiqué·es, doivent avoir recours aux banques alimentaires. La situation actuelle est inacceptable et nous avons la responsabilité collective d'y faire face.
Contrairement à ce dont on voudrait nous convaincre, la pauvreté n'est ni inévitable ni naturelle. Elle est une conséquence du système socioéconomique au sein duquel nous évoluons et de l'inégale répartition du pouvoir politique au sein de la société. Il est donc possible d'y mettre fin : il s'agit d'avoir la volonté, le courage et la créativité politiques, ainsi que la mobilisation sociale pour y parvenir. Évidemment, une telle chose est plus facilement dite que faite. On peut imaginer que les bénéficiaires des injustices actuelles résisteront à des changements qui mettraient en péril leurs privilèges. Ceci complique l'affaire, mais ne la rend pas irréalisable.
Dans les faits, il serait possible de pourvoir aux besoins de toutes et de tous. Pour y parvenir, il faudrait répartir la richesse d'une manière égalitaire. Or, cet objectif est profondément opposé à celui du système capitaliste, qui carbure aux inégalités et à la concentration de la richesse aux mains d'une minorité, d'ailleurs de plus en plus infime.
S'ajoute à cela que la répartition du pouvoir au sein de la société reflète de manière assez rigoureuse celle de la richesse : autrement dit, que les personnes qui disposent du pouvoir sont celles qui bénéficient des inégalités socioéconomiques. La surreprésentation des riches à l'Assemblée nationale et au gouvernement l'illustre très bien, de même que l'influence démesurée des corporations sur notre vie politique et sociale.
Il serait naïf d'espérer que des gens qui profitent du statu quo fassent quoi que ce soit pour le changer. S'ils peuvent admettre quelques mesures cosmétiques qui apaisent leur conscience et flattent leur image, jamais ils ne mettront réellement en péril leurs privilèges et les inégalités sur lesquelles ceux-ci sont fondés. Pensons par exemple au projet de loi 31 sur le logement, qui favorise outrancièrement les propriétaires ; au refus du ministre de l'Éducation de reconnaître l'école à trois vitesses ; aux baisses d'impôts successives décrétées par la CAQ ; aux subventions gigantesques octroyées à des multinationales pour les inciter à s'établir ici : chacune de ces décisions récentes de la CAQ manifeste son biais en faveur des riches ou son refus de mettre en place des mesures systémiques et structurantes pour lutter contre les inégalités sociales.
Face à ces constats, nous sommes d'avis qu'il ne faut pas baisser les bras. Mais il ne faut pas non plus sombrer dans l'angélisme : jamais nous ne convaincrons les profiteurs de mettre fin à une situation dont ils bénéficient. La société est traversée de rapports de force qui jouent actuellement et depuis longtemps à l'avantage des riches et des puissants : c'est sur ce plan que nous devons mener la lutte contre la pauvreté, l'injustice et l'exclusion sociale. Comme syndicalistes, nous avons la conviction que c'est par la constitution d'un rapport de force puissant, unitaire, démocratique et inclusif que nous y parviendrons. C'est donc en ce sens qu'il faut travailler : travailler à l'éveil de la conscience populaire et rallier les forces vives de la société civile et tenir tête aux riches et aux puissants afin que la population se gouverne par elle-même, libérée de l'oppression et de l'injustice. C'est là notre seul espoir de vaincre durablement les fléaux de la pauvreté et des inégalités sociales.
Collectif Emma Goldmann
Le Collectif Emma Goldmann est une organisation anarchiste/autonome active à Saguenay, sur le Nitassinan
Pourquoi, sur Terre, des personnes meurent-elles de faim alors qu'il y a une surproduction de nourriture ? Elles meurent simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter de quoi se nourrir.
Pour les capitalistes, tout est marchandisable – des aliments à l'habitation – et ce, indépendamment des droits de la personne. Pire, l'humain ne représente qu'une ressource parmi tant d'autres. Une ressource dont on peut disposer à volonté (compression, fermeture, délocalisation) et ce, indépendamment des conséquences sur les individus et les communautés. Après tout, le but est de maximiser le profit et non de travailler pour le bien commun.
Une infime minorité d'individus possèdent les moyens de production, tandis que l'immense majorité des gens ne possèdent que leur force de travail à offrir en échange d'un salaire. Dans les mots du Collectif Mur par Mur :
« Le travail tel qu'il s'instaure et se généralise avec le capitalisme est fondé sur l'organisation de la dépendance matérielle à travers la privation des moyens de production et le commerce de la subsistance […] Il faut d'abord avoir été dépossédé de tout moyen d'existence pour être obligé de vendre sa force de travail à un patron en vue de recevoir un salaire pour ensuite acheter des marchandises afin de survivre. [1] »
Comment en finir avec la pauvreté ? Le plein travail ne règle pas à lui seul la question de la pauvreté ; loin de là.
Le capitalisme est un système violent et mortifère. Au-delà des limites inhérentes à une planète aux ressources limitées, l'économie capitaliste, même lorsqu'elle roule à plein régime, laisse une part significative d'individus jugés non productifs, non compétitifs ou excédentaires sur les lignes de côté.
Aujourd'hui, nous subissons les contrecoups de l'inflation. Demain, ce sera la récession ou la stagnation économique qui entraîneront leurs lots de misères, d'endettement et de pauvreté. Ces crises sont inhérentes à l'économie capitaliste.
Nous croyons, à l'instar du philosophe et écrivain John Holloway, que « L'impératif n'est […] pas de construire le parti en vue de la prise du pouvoir, mais recréer de l'autonomie là où celle-ci a été détruite par l'intermédiaire mortifère engendré par le marché mondialisé. [2] »
C'est donc ici et maintenant qu'il faut créer des fissures dans le système, par nos résistances, nos rébellions. En réhabilitant le commun, en créant comme l'appelle Holloway, des brèches. Que ce soit une occupation, un piquet de grève, derrière une barricade dans un chemin forestier, etc. Ces moments sont des brèches portant un nouveau rapport au temps où les rapports de domination sont brisés pour en créer d'autres.
[1] Collectif Mur par Mur, Pour un anarchisme révolutionnaire, Les éditions L'échappée, 2021.
[2] Holloway, Crack capitalism : 33 thèses contre le capital, Libertalia, 2016.
Illustration : Anne Archet

Le Sahel face au péril militariste

Au Sahel, le coup d'État militaire survenu au Niger le 26 juillet 2023 est le sixième du genre depuis 2020 dans cet espace en proie à une crise sécuritaire inédite, après ceux enregistrés au Mali, au Burkina Faso et au Tchad.
Il se singularise d'autres événements tant par son mode opératoire, à savoir la séquestration du président par sa propre garde, que par les circonstances de sa venue, marquée par l'absence de tensions sociales ou politiques visibles. Ce coup d'État militaire a surpris toutes les personnes qui, à l'intérieur comme à l'extérieur, se sont refusées à considérer sérieusement le risque de voir la crise politico-sécuritaire ouvrir la voie à un retour au pouvoir des militaires un peu partout au Sahel, y compris au Niger, pays considéré comme le plus résilient de l'espace sahélien.
Au cours des dix dernières années, il faut dire que la plupart des acteur·trices internationaux sont resté·es fortement attaché·es à l'idée, vendue par certain·es expert·es, que le Niger représente une certaine exception au Sahel : d'abord, du fait de sa stabilité politique, puisqu'il n'a pas connu une rupture violente de l'ordre constitutionnel depuis 2010, et ensuite du fait de sa relative résilience face aux attaques des groupes armés, qui opèrent sur plusieurs fronts, notamment à l'est et à l'ouest. Ces deux éléments de contexte, associés au fait que le pays a connu récemment la première transition du pouvoir pacifique entre deux présidents, ont contribué à forger ce qu'il convient de considérer à présent comme le mythe de l'exception nigérienne, et c'est ce mythe qui s'est effondré le 26 juillet dernier de façon plutôt brutale, au grand bonheur de ceux et celles qui rêvent de voir le pays renouer avec l'autoritarisme d'antan.
Un procès en règle
À la faveur de ce coup d'État, il est apparu qu'un nombre significatif de citoyen·nes de ce pays ne sont pas loin de croire qu'un régime militaire est mieux placé qu'un régime civil pour relever les grands défis du moment, comme essaient de le faire admettre certains soutiens intellectuels de la junte militaire à travers des analyses soutenant que l'avènement de la démocratie a été un facteur sérieux de déstabilisation des États au Sahel. Les événements de ces derniers mois ont montré que le soutien au coup d'État militaire ne se nourrit pas seulement des rancœurs accumulées au cours des douze années de gestion du pays par le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarrayya), ou de la colère suscitée par les sanctions et menaces de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; il se nourrit également d'un procès en règle du modèle même de la démocratie représentative, présentée comme un produit importé, sinon comme un véritable cheval de Troie des Occidentaux, qui ne servirait qu'à diviser pour mieux régner au Sahel.
Après le Mali et le Burkina Faso, on peut donc affirmer que le Niger semble bien parti pour refaire durablement l'amère expérience d'un pouvoir militaire qui pourrait s'avérer bien plus redoutable que ceux qu'il a connus dans le passé. Et cela même malgré l'espoir de voir les acteurs nationaux et régionaux se mobiliser pour transformer la crise ouverte par le coup d'État du 26 juillet en une opportunité de remettre la démocratie sur les rails. Cette crise, faut-il le rappeler, a été un révélateur des divisions et clivages qui traversent la société nigérienne, et a permis à beaucoup de Nigérien·nes de prendre conscience de l'intérêt que portent les grandes puissances internationales à leur pays. Les diverses réactions au coup d'État militaire ont été très riches en enseignements. Elles ont mis en lumière le jeu des grandes puissances et la capacité de certains acteurs nationaux à le faire correspondre à leurs propres agendas.
Politique d'un putsch
Ainsi, dès les premiers jours du coup d'État militaire, il est clairement apparu que les militaires putschistes et leurs soutiens civils sont bien conscient·es des enjeux de la crise en cours pour les puissances extérieures. Le contexte international actuel, marqué par de fortes rivalités entre ces dernières, ne leur a pas échappé et leur offre quelques marges de manœuvre pour se maintenir au pouvoir. Ainsi, les faits montrent que les militaires nigériens n'ont pas perdu de vue deux facteurs dont ils pourraient tirer profit : d'abord, la difficulté pour les puissances extérieures, bien qu'unanimes à condamner la prise du pouvoir par la force, à s'entendre sur la marche à suivre pour les obliger à retourner dans leurs casernes ; ensuite, l'existence d'un potentiel réel de soutien à des projets de restauration autoritaire de la part de certaines puissances comme la Russie et la Chine qui ne les appréhendent pas comme une menace à leurs intérêts stratégiques.
Outre ces deux facteurs importants, il convient de noter que les militaires putschistes et leurs soutiens civils n'ont pas perdu de vue l'existence, au sein de l'opinion sahélienne, d'un ressentiment profond à l'égard des puissances occidentales présentes sur le terrain. Comme leurs homologues du Mali et du Burkina Faso, ils ont bien compris que ce ressentiment, qui se double d'une forte demande de souveraineté, peut servir de levier à la fois pour légitimer localement leur irruption sur la scène politique et pour mettre sur la défensive toute puissance qui s'y opposerait. C'est en tenant compte de tout cela ainsi que des craintes légitimes que suscite la menace d'intervention militaire de la CEDEAO (à présent abandonnée) qu'ils se sont empressés à placer la question de la présence des forces extérieures, en particulier françaises, au cœur des enjeux de la crise ouverte par leur prise du pouvoir. Cette stratégie a été payante : elle a permis de rallier à la junte de larges pans de la population.
Aujourd'hui, après avoir obtenu le départ des forces françaises présentes dans le pays depuis bientôt une décennie, la junte espère encore tirer profit des sanctions et des menaces de la CEDEAO pour continuer à souder derrière elle les forces armées et la population, mais elle semble bien consciente que nombre de ses propres soutiens, civils comme militaires, attendent aussi des signaux clairs indiquant qu'elle n'est pas le bras armé de l'ancien président Issoufou Mahamadou qui cristallise toutes les rancœurs nées des douze années de gestion du pays par son parti, le PNDS-Tarrayya.
Échec démocratique et militaire
Les manifestations des mois précédents, dont le thème principal était le départ immédiat des forces françaises du Niger, ont été l'occasion pour certains de rappeler à la junte que leur soutien ne lui sera définitivement acquis que si elle prend ses distances d'avec l'ancien président, accusé d'être l'instigateur même du putsch du 26 juillet.
Quoi qu'il en soit, il est important de garder à l'esprit que le retour au pouvoir des militaires au Niger, comme au Mali et au Burkina Faso d'ailleurs, n'est pas seulement le symptôme d'une crise de la démocratie. Il est aussi la sanction de l'échec de tout ce qui a été entrepris jusqu'ici pour vaincre les groupes armés, à commencer par le déploiement sur le terrain des forces extérieures, qui n'a pas permis de faire reculer l'insécurité dans les pays. La rhétorique des militaires putschistes, au Niger comme au Mali et au Burkina Faso, est claire sur ce sujet : elle impute cet échec aux dirigeant·es civils, accusé·es d'avoir fait de mauvais choix, et aux forces extérieures, présentées comme des complices des groupes armés. L'enjeu pour les militaires putschistes n'est pas seulement d'éluder la part de cet échec qui incombe aux forces de défense et de sécurité nationales, mais il s'agit surtout de se poser en libérateurs providentiels des peuples dont les dirigeants civils et leurs alliés extérieurs n'ont pas pu assurer la sécurité qu'ils étaient en droit d'attendre. Le pari est encore loin d'être gagné.
A. T. Moussa Tchangari est journaliste et militant altermondialiste.
Photo : Soldats nigériens à Diffa, Département de la défense des États-Unis (CC0 License)

Guatemala. Victoire pour la démocratie

L'entrée en poste du nouveau président élu Bernardo Arévalo le 15 janvier 2024 marque un tournant pour le Guatemala. Si elle représente une victoire pour la démocratie et l'État de droit, les obstacles demeurent nombreux et l'avenir, incertain…
Le Guatemala s'inscrit parmi les pays les plus corrompus au monde selon l'organisation Transparency International. Cette corruption se matérialise à travers ce que plusieurs nomment communément le « pacte des corrompus » : un réseau d'élites politiques, militaires et économiques qui a réussi, au fil des ans, à modeler à son avantage la scène politique et économique du pays, notamment par la manipulation des institutions publiques, électorales et juridiques. Cette corruption s'est accentuée depuis la dissolution de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala en 2019 par le président Jimmy Morales et l'inéligibilité de plusieurs candidats progressistes ou anti-establishment. Dans ce contexte particulier, la création du parti Movimiento Semilla suite aux protestations anticorruptions de 2015 représente possiblement l'étincelle ayant permis le changement de paradigme observé aux dernières élections.
La surprenante arrivée d'Arévalo
L'élection présidentielle de 2023 marque ainsi un tournant avec l'élection à la présidence du candidat progressiste Bernardo Arévalo. Arévalo se dresse comme un défenseur de l'État de droit et une figure forte du mouvement anticorruption au Guatemala. De plus, la candidature d'Arévalo présente également une distinction importante du fait de son absence de lien avec le monde politique et les autres instances corrompues. Le dénouement étonnant du premier tour, positionnant Arévalo favorablement pour le deuxième tour, fut en effet une réelle surprise pour la sphère politique conservatrice qui ne tarda pas à mettre en œuvre certaines actions pour empêcher son élection. En effet, l'élite politique et économique du pays tenta de bloquer la participation de son parti au deuxième tour et de bannir Arévalo de l'élection en entamant des poursuites judiciaires contre le candidat et son parti.
Une procédure légale auprès de la Cour constitutionnelle pour dénoncer de soi-disant irrégularités lors du premier tour des élections et pour révoquer l'immunité politique d'Arévalo fut lancée par les différents partis conservateurs. Cette attaque envers la démocratie fut secondée d'une tentative par le Ministère Public de révoquer le statut du parti. Ces actions furent entre autres portées par la procureure générale du Guatemala, María Consuelo Porras, et le chef du Bureau du procureur spécial contre l'impunité du Ministère Public, Rafael Curruchiche. Dans la même lignée, en décembre dernier, Curruchiche tenta – en vain – d'inciter le tribunal suprême électoral d'annuler le résultat de l'élection lors d'une conférence de presse. Ces actions sont d'ailleurs qualifiées de « tentative de coup d'État » par l'Organisation des États d'Amérique.
Un changement de paradigme
La mobilisation du peuple guatémaltèque face aux diverses tentatives de la droite de saboter l'élection a eu un impact majeur sur la préservation de l'État de droit et de la démocratie du pays. Cette mobilisation étonnante du peuple guatémaltèque représente un changement de paradigme important pour le pays, caractérisé par le retour dans la rue d'une population qui avait délaissé cette forme de manifestation dans les dernières années, par peur de représailles. Plusieurs nomment ainsi cette révolution sociale le deuxième printemps guatémaltèque. Les manifestations publiques en faveur du respect de la démocratie et en soutien au président élu ont représenté une pression constante sur le « pacte des corrompus » afin de respecter le résultat de l'élection.
Cette mobilisation a particulièrement été portée par des leader·euses autochtones et par la jeunesse guatémaltèque qui ont joué un rôle majeur, autant dans la campagne électorale d'Arévalo que dans son entrée en poste. Cette jeunesse s'est fortement mobilisée en faveur du nouveau président, dans la rue et sur différents médias sociaux. De même, plusieurs regroupements autochtones ont lutté pour le respect du processus démocratique en manifestant devant le bureau de la procureure générale pendant plusieurs mois. Après une longue période d'incertitude et de lutte acharnée, Arévalo réussit enfin à atteindre sa cérémonie d'assermentation dans la nuit du 14 au 15 janvier, malgré les tentatives de la droite de l'en empêcher.
Un avenir semé d'embûches
Bien qu'elle représente sans aucun doute une victoire pour l'État de droit, la démocratie et la lutte anticorruption au Guatemala, l'élection de Bernardo Arévalo ne marque pas la fin de ces combats. Les nombreuses tentatives visant à empêcher son entrée en poste montrent la persévérance du pacte des corrompus ainsi que son emprise sur les instances du pays. Par ailleurs, la transition politique ne se déroule pas sans heurts. Le refus de la procureure générale Porras de rencontrer Arévalo illustre la dure conciliation entre le nouveau chef de l'exécutif et l'establishment politique. Le froid entre Arévalo et la procureure générale représente une difficulté bien particulière pour le nouveau président qui ne peut pas entamer de poursuite pénale contre l'élite corrompue sans son appui. Cette paralysie du système judiciaire – retardant les objectifs anticorruptions d'Arévalo – pourrait bien lui coûter certains de ces soutiens. Dans la même lignée, l'absence de majorité du Movimiento Semilla au Congrès présage de nombreuses difficultés à venir.
Ainsi, malgré la forte mobilisation de la population et bien que la jeunesse et certains mouvements autochtones se soient montrés en faveur de l'entrée en poste d'Arévalo, cette mobilisation n'est pas garante d'un appui pérenne de ces groupes et de la population en général, dont les attentes sont élevées. Le président devra faire ses preuves et présenter des résultats tangibles afin de préserver cet engagement.
Photo : Président Bernardo Arévalo, Gouvernement du Guatemala (Crédit : PDM 1.0 DEED)

Israël - Palestine : la fabrique du consentement occidental

Depuis le 7 octobre, Israël poursuit de façon incessante ses bombardements, ses frappes de missiles et ses attaques ciblées contre des hôpitaux, des écoles, des universités et des résidences au vu et au su du monde entier. Ces crimes de guerre sont accompagnés d'une rhétorique où Israël se présente comme la victime des Palestinien·nes, ce qui justifie, croit-il, son « droit de se défendre ».
Cette guerre contre Gaza est accompagnée d'un récit repris par les principaux médias occidentaux qui répètent allègrement la version israélienne voulant que tout ait commencé le 7 octobre, lors de l'attentat du Hamas qui a fait un peu plus de 1 200 victimes, essentiellement des civil·es israélien·nes. Notre propos ici n'est pas de nier l'ignoble tuerie commise par le Hamas, mais de questionner l'absence de mise en contexte dans laquelle s'est produit cet événement. Aucun média (ou si peu) n'a rappelé au monde que cet événement s'inscrit dans le cadre d'une occupation militaire et d'un blocus isolant complètement Gaza, et empêchant les Gazaoui·es de circuler, que ce soit pour aller en Cisjordanie, en Égypte ou ailleurs.
Aucun journaliste (ou si peu) n'a eu le réflexe ou le courage de rappeler ce que signifie concrètement ce blocus pour près de deux millions de personnes qui sont en confinement total sur un petit territoire depuis 16 ans maintenant, confinement collectif qui les prive de soins de santé plus performants, qui leur interdit de retrouver les membres de leurs familles vivant en Cisjordanie ou en Israël, qui les prive également d'opportunités d'emploi ou encore de visites à la Mosquée al-Aqsa, le troisième lieu de pèlerinage pour les musulman·es. Qui a entendu parler de l'intervention de l'armée israélienne à Jénine l'été dernier, l'une des plus importantes opérations militaires depuis le début de l'occupation israélienne de la Cisjordanie en 1967 ? L'armée est intervenue dans le camp de réfugié·es et dans la ville même de Jénine, tirant notamment sur la mosquée. Selon le ministère palestinien de la Santé, douze Palestinien·nes ont été tué·es et on compte quelque 100 blessé·es, dont 20 sont dans un état grave. Ce type d'intervention de l'armée israélienne, qui viole les droits des habitant·es des territoires palestiniens, fait désormais partie des faits divers. Cette banalisation de la violence du colonialisme israélien a contribué à ce que désormais, la « question palestinienne » disparaisse du radar médiatique occidental.
L'affaire de l'hôpital de al-Shifa
Ainsi, les médias occidentaux reprennent sans scrupules la trame narrative israélienne et la reconstitution de « preuves », à partir de données et de photos satellitaires fournies par l'armée israélienne. L'affaire de l'hôpital de al-Shifa à Gaza en est un bon exemple. Les dirigeants de l'armée ont déclaré que cet hôpital cachait des infrastructures stratégiques et militaires du Hamas. Pour soutenir cette affirmation, l'armée israélienne a présenté des photos de caches d'armes dans un endroit qui aurait pu être n'importe où, de même que des vidéos de soldats israéliens marchant dans un tunnel, lampes frontales au front et armes droites devant. Où ont été tournées ces scènes, nul ne le saura. Mais il demeure que des médecins européens présents sur place pour aider la population palestinienne ont démenti la version israélienne. Malgré cela, les journalistes non palestiniens, qui opèrent de l'extérieur de la bande de Gaza, ont repris ce récit presque mot pour mot, ce qui a servi à justifier l'explosion et la destruction totale de cet hôpital à l'heure où les intervenant·es des Nations Unies, et en premier lieu son secrétaire général Antonio Guterres, évoquent une crise humanitaire d'une ampleur sans précédent…
Le contrôle des médias
Pour ajouter, est-il nécessaire de rappeler que la couverture journalistique occidentale se fait de l'extérieur de Gaza ? Il est interdit pour les journalistes d'entrer dans cette zone de guerre. Celles et ceux qui, comme Céline Galipeau, vont dans la région se voient contraint·es d'aller rendre visite à des résident·es israélien·nes des colonies de peuplement environnantes. Les reportages qui donnent la parole à des personnes qui ont été enlevées par le Hamas ou aux membres de leur famille participent à renforcer le récit israélien, diffusé largement à la télévision. Il semble qu'aucun·e journaliste de Radio-Canada ou d'une autre télévision d'ici n'ait pris la peine d'aller rencontrer des opposant·es ou militant·es israélien·nes qui interviennent en solidarité avec le peuple palestinien, ou à tout le moins qui travaillent en matière de défense des droits humains. Pourtant, de telles organisations existent, et elles sont connues.
En effet, d'autres voix que celles de l'État ou de l'armée existent en Israël et dénoncent le génocide en cours, même s'il leur est plus difficile de se faire entendre en temps de guerre. À titre d'exemple, le journal israélien Haaretz a fait connaître l'une des conclusions d'une enquête policière israélienne révélant qu'un hélicoptère de l'armée israélienne a tiré sur des personnes qui couraient dans tous les sens lors des attentats de militants palestiniens du Hamas, le 7 octobre dernier. Selon le rapport révélé par Haaretz, l'hélicoptère israélien aurait vraisemblablement tué un·e ou des Israélien·nes. Peu de médias occidentaux ont relayé cette information pourtant crédible, et provenant d'un média israélien. Même si l'armée israélienne a nié ces accusations, ces éléments d'information illustrent à quel point cette guerre est aussi une guerre médiatique. Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux jouent également un rôle important. S'il n'y avait pas eu d'individus utilisant leur cellulaire pour filmer les Palestinien·nes marchant nu·es dans le désert, aurions-nous cru aux atrocités et aux humiliations commises par l'armée israélienne ?
Enfin, notons que les journalistes qui travaillent à Gaza sont les cibles privilégiées de l'armée israélienne. Ce ciblage fait partie intégrante de la fabrique du consentement. Au début de l'année 2024, selon le Syndicat des journalistes palestiniens, 102 journalistes ont été tué·es à la suite de bombardements israéliens de leurs maisons ou de leurs bureaux, ainsi que lors de leur pratique journalistique, soit « 8,5 % des journalistes de Gaza » [1].
Fabriquer le consentement
Tous ces éléments nous amènent à évoquer la célèbre thèse de Noam Chomsky et Edward Hemann : la fabrique du consentement. On renvoie ici à la création d'un récit constitué de faits choisis (ou omis), et d'informations répétées ad nauseam par les médias, qui contribue à imposer une « vérité ». Un processus qui permet aujourd'hui à Israël de justifier le processus d'annihilation de la population palestinienne de Gaza.
Notons que cette volonté israélienne d'empêcher que les faits soient dévoilés est appuyée par un bon nombre de dirigeants de pays occidentaux comme le président français Emmanuel Macron, qui a tenté d'interdire les manifestations propalestiniennes (le premier ministre François Legault avait évoqué cette idée pour finalement y renoncer) et a fait expulser la représentante de l'Autorité palestinienne qui avait été invitée par des organisations de la société civile à prendre la parole lors de certains événements. Aux États-Unis, les rectrices de grandes universités comme Harvard ou le MIT ont été forcées de démissionner, du fait des pressions des philanthropes pro-israéliens qui financent ces vénérables institutions. Le principe même de manifester son appui au peuple palestinien est menacé, et c'est pourquoi plus que jamais nous devons leur témoigner concrètement notre appui et participer au boycott, aux sanctions et au désinvestissement à l'égard d'Israël.
[1] Cela comprend 78 praticien·nes du journalisme et 24 professionnel·les des médias selon le Syndicat des journalistes palestiniens. Selon le Committee to Protect Journalists, en date du 23 janvier 2024, il s'agirait plutôt de 83 journalistes et travailleur·euses des médias tué·es (donnée confirmée) ; 76 journalistes palestinien·nes ; quatre journalistes israélien·nes, et trois Libanais·es ; 16 journalistes ont été blessé·es et trois journalistes sont portés disparu·es. Enfin, 25 journalistes auraient été arrêtés.
Anne Latendresse est militante internationaliste.
Illustration : Ramon Vitesse

Conteurs à gages : Des récits pour se réconcilier avec la/notre nature

Étienne Laforge et Félix Morissette, surnommés les « Conteurs à gages », créent pour, par et avec des groupes citoyens, des contes écologiques au cœur du quartier Rosemont—La-Petite-Patrie à Montréal. Nous nous sommes entretenus avec eux pour en apprendre sur leurs ambitions, et plus particulièrement sur le rôle de l'art du conte pour réfléchir notre rapport à la nature, nourrir l'imaginaire, et construire des récits ancrés dans les quartiers. Propos recueillis par Samuel Raymond.
À bâbord ! :Une part de votre mission est de « susciter la curiosité et inspirer la transition écologique ». Pourquoi avoir choisi l'art du conte ?
Étienne Laforge : En fait, il s'est imposé. En pandémie, Félix et moi marchions dans les ruelles de notre enfance et nous trouvions qu'il y avait là une mythologie existante issue de communautés, de parents, et d'enfants qui se voisinaient. Le conte, c'est l'art de se raconter. On voulait rassembler le monde.
Félix Morissette : On l'a aussi choisi pour deux de ses forces. Premièrement, on a un grand besoin de tirer nos imaginaires par les. Un·e conteur·euse est toujours en train de modeler son histoire en fonction de qui il ou elle s'adresse, et selon le contexte. C'est ancré dans une réalité. On avait envie d'infinies variations pouvant être portées par plein de voies différentes. Deuxièmement, le conte permet de grandes libertés. Par exemple, il permet de réfléchir à des êtres non humains très facilement. La forme est simple, a peu de règles et favorise l'improvisation. Tout ça facilite la création de situations ou de personnages éclatés. On peut évoquer les grands peupliers du parc Lafontaine et automatiquement, on est en présence d'eux.
ÀB ! : Dans votre processus, pourquoi mettre autant l'accent sur la question de la relation des humains avec la nature ?
F. M. : La pandémie nous a permis de ralentir et, comme plusieurs artistes, de prendre contact avec notre quartier. Et puis, on voyait la nature reprendre ses droits. Ça donnait envie de se renseigner, de sortir un livre, de commencer à identifier les plantes, de faire un jardin de balcon. On a fait beaucoup de recherches pour mieux comprendre ce qui nous entoure, nos différences d'avec les autres êtres. Par exemple, le Merle d'Amérique. Comment fonctionne-t-il ? Qu'est-ce qu'il fait pendant l'hiver ? Tout ça donnait des filons narratifs aux histoires qui venaient s'ajouter à une série de réflexions à propos de situations personnelles et collectives.
É. L. : La pandémie a été un moment de reconnexion avec la nature. Dans leurs derniers retranchements, c'est souvent là où les gens vont. Toutefois, le discours écologiste me mine parfois. La lutte écologiste vient des fois avec des impératifs qui sont trop portés par les individus. Et dans la fiction, c'est soit postapocalyptique et l'humanité a échoué, soit on cherche une échappatoire. On veut refaçonner positivement la façon dont on parle de notre relation à la nature. C'est par ce lien qu'on va trouver une façon de calmer notre anxiété. C'est une urgence de créer de nouveaux récits.
ÀB ! : Quelles est votre intention avec vos créations ?
F. M. : Qu'à la fin de l'un de nos contes, une personne reparte, prenne une respiration, observe les feuilles rougir, le petit temps frette. Notre désir est d'amener une reconnaissance, une appréciation de ce qui nous entoure. Puis, on veut mettre l'accent sur la valeur, l'impact et l'apport de différents êtres de la nature d'une manière poétique plutôt qu'avec un point de vue utilitaire à partir duquel, par exemple, on dirait que les arbres peuvent nous permettre d'économiser de l'argent en réduisant l'écoulement de l'eau. On veut que les gens sortent de nos heures de conte avec un sentiment de connexion. Nourrir l'imaginaire avec ces histoires optimistes nous rend plus à même de reconnaître les initiatives positives. On comprend l'urgence actuelle, mais ça prend un ballant.
É. L. : On se représente souvent la nature comme si on en était extérieur, mais le conte peut faire en sorte que les gens s'identifient à elle. Que ce soit à propos de l'histoire de la job d'un cloporte dans une craque de ruelle ou la job d'une saison qu'on a imaginé. Si on peut se reconnaître dans ces éléments-là, je pense qu'il y a un côté amoureux de la nature qui va émerger. C'est ces petites poésies qui m'accrochent et me font embrasser les éléments autour. Un jour, on a fait un lancement lors d'une grosse tempête de neige. Le monde est arrivé en retard. C'était la folie. À la fin du spectacle, j'ai reçu des messages de gens enthousiastes de vivre la tempête. Il y a comme eu une adéquation avec les éléments qui est née des histoires racontées. C'est le résultat qui se révèle à nous après avoir raconté une histoire.
F. M. : C'est un processus par lequel on arrête d'être toujours en lutte avec la nature. Dans l'histoire de notre relation à l'environnement au Québec, la religion catholique nous a amené·es dans un rapport sacré à la nature. Une œuvre de Dieu parfaite et belle. L'humain est séparé de la nature tout en étant au-dessus d'elle. Puis, on a évolué pour être davantage dans une relation de contrôle et de lutte. Ces deux visions du monde sont en nous. On essaie de trouver d'autres façons de s'engager, de dévoiler notre interdépendance, de jouer avec la nature. On explore comment on peut établir une relation avec elle sans être dans un romantisme fini ni dans une relation de domination.
ÀB ! : Quelles sont vos inspirations ?
F. M. : Je m'inspire de notre héritage canadien-français, mais aussi des cultures grecque et romaine. Dans ces cultures, on peut fouiller et trouver des éléments féconds pour la création de contes en jouant avec leurs codes. Ensuite, la culture canadienne-française agricole a développé des rites et des relations à l'environnement qui sont fortes et riches. Je pense à ma grand-mère et sa ferme comme une influence importante.
Sinon, des éléments qu'on prend rarement le temps d'analyser sont tout aussi inspirants. Je pense par exemple aux quatre saisons pour lesquelles nous avons créé une série de contes. Les gens sont souvent en lutte contre elles. Ainsi, l'automne est souvent dur pour le moral. On a donc écrit un conte sur le mois de novembre en retournant notre apriori négatif pour voir comment, en se nourrissant de la mort, novembre crée la première neige qui est l'un des plus beaux moments de l'année.
É. L. : Mon arrière-grand-père a été mineur et bûcheron en Abitibi. Mon grand-père a été mineur et étudiant. Dans leur mode de vie, il y a quelque chose de très proche de la nature, un travail de la terre, et à la fois, une exploitation des ressources. Ce n'est pas très loin de notre génération. De cet héritage, un de nos thèmes importants est celui de la nature qui nous donne, mais qui est aussi indomptable.

ÀB ! : En ce qui concerne les contes créés par votre duo, comment les testez-vous ?
F. M. : On présente généralement un premier jet devant les groupes citoyens. Ça nous aide à placer beaucoup de choses. Quand tu te retrouves devant quelqu'un·e et que tu racontes une histoire pour la première fois, c'est là que tu réalises que, maudit que c'était pas clair ton affaire ! Le conte permet de travailler une relation, tu t'adresses à quelqu'un·e. Tant que tu n'as pas cette relation, ce n'est pas clair ton ancrage est où.
É. L. : C'est agréable de présenter ces premières versions dans un contexte de communauté qui te connaît. Il y a plus de chance qu'elle te dise ce qui ne marche pas. On se sent aussi plus à l'aise. Il y a un lien de confiance qui s'est créé.
ÀB ! : Comment se déroule votre processus de création avec les groupes citoyens ?
É. L. : Durant la dernière année, on s'est intégré dans des groupes citoyens de Rosemont—La-Petite-Patrie à travers deux projets de recherche-création et d'accompagnement de projet participatif. Le but est que ces groupes puissent définir leurs propres récits. La première année servait davantage à la création d'une programmation culturelle. On a offert des contes et il y a eu des prestations de plusieurs artistes de différentes disciplines pour mobiliser et faire connaître le projet. Pour la deuxième année, on veut permettre à ces communautés d'écrire leurs propres récits, qui s'inspireront de la forme de ceux de Conteurs à gages en s'intéressant notamment aux enjeux socioécologiques de leur quartier. Ce qui est plaisant avec les communautés avec lesquelles on tisse des liens, c'est qu'on sent qu'elles ont le goût de jouer. Notre rôle est donc de partager nos outils pour qu'elles puissent s'épanouir dans des récits qui sont bien édifiés et inspirants.
F. M. : Le processus de création dépend de ce sur quoi on écrit. Quand tu écris des contes sur un territoire, des milieux de vie ou un parc, il faut qu'il y ait un ancrage personnel ou collectif. L'objectif est de développer des outils pour créer de nouveaux récits et que les gens puissent se les approprier. Par exemple, on a vécu plusieurs expériences au parc de Gaspé avec un groupe. Il y a un moment où t'as un déclic. Tu te rends compte que tu appartiens au parc. Il vit un peu en toi et fait partie de ton imaginaire. Quand tu ressens ça, tu peux commencer à travailler parce que tu es arrivé à une véritable relation au lieu. Ensuite, les filons émergent. Dans notre cas, les personnes qui vivent près de l'endroit sont celles qui le connaissent le mieux. C'est eux et elles qui portent l'histoire. Le groupe n'a pas nécessairement tous les outils pour structurer un conte, élaborer des personnages, créer un événement déclencheur et confectionner des retournements créatifs. On est là pour explorer ça avec lui, l'accompagner en utilisant nos outils. Par exemple, le concept de « héros doux », celui de filon, celui d'ancrage. On veut aussi travailler sur les forces de chaque personne. Ensuite, ces histoires pourront être écrites, structurées, imprimées et finalement, transmises. Une ruelle verte pourra avoir son recueil de contes qui explique, par exemple, l'origine de la ruelle ou qui raconte des histoires de voisinage.
ÀB ! : Vous incorporez parfois de courts commentaires éditoriaux dans vos contes. Comment composez-vous avec cet aspect ?
É. L. : Les éléments plus éditoriaux et politiques nous aident à démarrer une idée, mais vont rapidement se décliner en des enjeux plus grands et plus profonds. Après ça, dans la relation avec le public, ces éléments peuvent revenir. Je pense à un de nos contes qui s'appelle Le printemps silencieux. Il a tout le potentiel d'aborder la crise du logement actuelle, mais il traite aussi de tensions dans la société, de fiertés, de pouvoirs et de désir d'avoir plus.
ÀB ! : Que se passe-t-il pour Conteurs à gages dans les prochains mois ?
F. M. et É. L. : À la fin de l'hiver et au début du printemps, Conteurs à gage sera en écriture. L'univers des contes de saison continue de fleurir. Notre premier conte, Automne est paru en format audio le 17 octobre. On souhaite d'ailleurs remercier les artistes audios et visuels qui travaillent avec nous. Sinon, les groupes de citoyens qu'on accompagne seront en processus d'écriture de leurs contes. Puis, un troisième univers s'ouvre l'été prochain. Ce sont les contes et légendes des boisés de Laval en association avec l'organisme Canopée. Il rassemble des habitantes de Laval qui entretiennent des relations avec les boisés. Elles nous serviront de guide pour rédiger de nouvelles histoires…
Illustration : Laurie-Anne Deschênes. Photo : Conteurs à gages du 13 octobre 2023 (Masson Village).

Auprès de la mort

Le présent article rassemble les témoignages de trois femmes âgées offrant une fenêtre sur leur expérience de vie et leurs réflexions quant aux thèmes du deuil et de la mort. Il s'agit d'une invitation à l'écoute de personnes ayant leur propre vécu, sensibilités et visions du monde. Une brève tribune pour une parole humaine intime remettant ainsi à jour l'éternelle question : « Mort, où est ta victoire ? »
Face au suicide, créer des garde-fous
Rita, gestionnaire d'un programme d'aide aux résident·es d'un complexe immobilier
Sarah [1] était une résidente à laquelle je me suis tout de suite attachée. Bipolaire, après des moments de grande euphorie, elle sombrait dans des états dépressifs qui l'ont conduite à mon bureau. Je suis alors entrée dans ses confidences sur une vie très solitaire, marquée par le décès d'une maman adorée et des relations qui n'en étaient pas avec un fils impossible à convaincre de lui laisser voir sa petite-fille, dont la mère s'opposait à toute visite d'une femme aussi « dérangeante » qu'elle.
Quant à moi, je trouvais plaisant de l'entendre parler de ses joies d'enfant apprentie-peintre parce que j'admirais ses œuvres d'adulte. Je comprenais avoir affaire à une véritable artiste, douée non seulement pour la peinture, mais aussi pour la sculpture. Elle avait une façon de se raconter là-dessus qui pouvait être très drôle. Mais tout le monde n'était pas comme moi en position d'apprécier son goût de la facétie. Avec les autres résident·es, par exemple, quand elle commençait à se confier sur ses déboires, elle n'en finissait plus. Aussi évitaient-elles-ils de la croiser dans les corridors.
L'étonnant là-dedans, c'est qu'elle avait, parallèlement, un côté misanthrope qui l'amenait à aller faire ses courses en soirée de façon à ne rencontrer personne de connaissance. De peur qu'on ne la remarque, elle m'avait bien fait comprendre qu'elle ne viendrait me voir qu'après les heures de bureau. Cette après-midi-là, quand elle est arrivée vers 16h15, j'étais très fatiguée de ma journée de travail, je ne souhaitais qu'une chose : rentrer chez moi. Mais elle insistait. Je lui ai alors répondu que, non, pas cette fois-ci, elle n'avait qu'à venir plus tôt.
Les jours suivants, alarmée de ne plus la voir passer comme d'habitude, je me fis accompagner d'un gardien de sécurité pour ouvrir sa porte. Mon inquiétude était fondée, elle gisait morte, une bouteille vide d'eau de Javel à ses côtés.
Vous décrire mon sentiment de culpabilité après cette effroyable découverte, je n'y parviendrais pas. Et puis, j'ai réfléchi et compris que je n'étais pas responsable de son choix. Alors, j'ai réagi en me lançant dans une période d'activité intense où j'allais créer deux programmes, les Appels d'amitié et la Tournée des appartements avec un·e représentant·e du SPVM, afin de détecter les besoins d'aide de personnes vulnérables ou fragilisées.
Ces programmes ont prouvé depuis qu'ils peuvent faire la différence. Là réside ma consolation.
À l'approche d'une fin de vie, se tourner vers le concret
Diane, militante, traductrice et entrepreneure
Il refuse de m'entendre parler de mort prochaine, mais ne répugne pas à aborder le sujet lui-même, et je comprends tout à fait son attitude. Peut-être parce que, depuis que je le connais, je le vois vivre dans la douleur – avec une faiblesse pulmonaire doublée d'arthrose et des hanches artificielles. Fils d'un père tuberculeux, il a vécu son enfance entouré de constantes précautions. Il en a gardé la phobie d'être touché, ce qui aurait pu me poser problème. Mais non, le lien entre nous s'est avéré sentimental d'abord et avant tout.
Il faut dire que, jeune femme, j'ai connu pendant cinq ans l'enfer d'un premier ménage violent et ce, à l'étranger puisque mon mari de l'époque et moi avons commencé notre vie commune à Paris où nous étions étudiants tous les deux. Mon désarroi d'alors m'a conduite à me tourner vers le féminisme, lequel m'a permis de comprendre l'étendue de la maltraitance envers les femmes et de militer contre.
De retour au pays, douze ans ont passé pendant lesquels j'ai vécu seule. Échaudée, je ne cherchais pas à me remarier ni ne voulais d'enfant. Mon travail de traductrice et d'enseignante à l'Université me prenait tout mon temps, au point qu'à un moment donné, j'ai eu peine à honorer tous mes contrats. Ma rencontre avec Jean-Jacques, qui œuvrait aussi en traduction, m'a tirée d'affaire. Je l'ai mis à l'essai. Avec succès : il avait un style apte à bonifier le texte le plus médiocre ! Si bien qu'ensemble, nous avons fondé une entreprise.
Et les choses se sont enchaînées. Dans la maison que j'avais achetée sur les entrefaites, bien que chacun de nous y faisait appartement à part, notre relation nous est vite devenue indispensable, car, avons-nous découvert, nous pouvions y exprimer notre colère respective contre nos enfances muselées.
Sans doute faut-il voir dans notre histoire si atypique l'explication de notre rapprochement, encore plus grand depuis l'annonce faite par une pneumologue en janvier 2023 qu'il serait dorénavant forcé de recourir à une bonbonne d'oxygène en permanence. Et me voilà devenue assistante à la prise de pilules, aux déplacements, au réglage du CO2, au tri de papiers. Maintenant, chaque jour compte, nous le passons à discuter des aménagements concrets à faire dans notre mode de vie pour améliorer cette nouvelle phase de notre histoire commune. Le meilleur et le pire se sont confondus. J'espère qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin.
En exil, s'ouvrir aux autres
Micheline, épouse aimante
Le mari avec qui vous me voyez aujourd'hui, ce n'est plus le même homme. Atteint d'Alzheimer, il redevient un enfant, et c'est en acceptant cette nouvelle forme de relation, que je continue de lui démontrer mon amour.
Au moment de notre mariage, début des années '70, il venait de sortir de l'Université avec un Bac en électrotechnique et une mineure en enseignement. Premier dans toutes les matières, il a reçu une invitation de la Québec Cartier Mining à venir visiter Gagnon, où on lui offrait un poste bien rémunéré et une maison sur place. Nous étions jeunes, ouverts à l'aventure ; de plus, cette invitation arrivait juste à point, car je venais d'être mise à pied par mon employeur. Notre réponse fut un « oui » enthousiaste.
Cette première expérience d'exil eut ses bons et mauvais côtés, mais elle ne nous découragea pas d'aller vivre ailleurs. C'est ainsi qu'au début de la décennie '80, cinq ans après notre expérience nordique, mon mari fut approché, cette fois, par la section internationale d'Hydro-Québec pour aller enseigner sa spécialité en Afrique. Là encore, nous fûmes partants, même si, nous avertit l'Ambassade, nous aurions, une fois sur le terrain, à censurer nos lettres et à éviter de prendre des photos. C'est seulement là-bas, que, face au spectacle déstabilisant de la misère de nos voisins autochtones, nous avons réalisé qu'en ce pays, le destin était le maître.
Parce que nous nous démarquions des colons sur place par notre simplicité de manières et notre absence de préjugés, on nous a adoptés, ce qui nous a protégés. Partant en voyage, par exemple, nous fûmes avertis de ne pas passer par un certain endroit. Mais la présence d'un danger toujours à redouter, me faisait peur. Par moments, il m'arrivait même de paniquer à la pensée de rester sans possibilité de retour.
Cette période reste pourtant dans mon souvenir comme la plus vivante de mon existence. Nous étions loin de chez nous dans un pays où la mort guette, c'est vrai, mais jamais nous n'avons oublié l'accueil des Africain·es quand ils ont compris que nous n'étions pas venus pour les humilier. Avec eux-elles, qui prenaient le temps de me saluer lors de mes promenades quotidiennes, je me sentais exister comme humaine. Cette sensation, impossible de l'avoir en restant dans son cocon, alors que, sur le qui-vive, la vie apparaît toujours belle et précieuse.
[1] Prénom fictif
Geneviève Manceaux est psychopédagogue et écrivain.
Le texte fait écho à notre dossier « La mort. Territoire politique et enjeu de pouvoir » paru dans notre numéro 98 et qui abordait le sujet selon ses dimensions politiques. Dans la même veine, nous vous invitons aussi à redécouvrir le dossier « Vieillir » de notre numéro 84.
Visuel : Rrawpixel

Il n’y a pas de mémoire révolutionnaire sans illustrations

Remi, alias Rémo, est illustrateur et bédéiste engagé. Depuis 2017, il réalise du dessin militant sur différentes causes et mobilisations, comme la grève de l'UQAM de 2019 ou les luttes décoloniales. Il s'est aussi investi auprès de la revue Fêlure. À l'occasion de la sortie de sa bande dessinée autobiographique L'Enfant-Homme, publiée par le collectif d'impression et d'édition féministe indépendant La Guillotine, À bâbord ! a souhaité s'entretenir avec lui.
À bâbord ! : Peux-tu nous parler un peu de ta BD ?
Rémo : Je l'ai rédigée et dessinée en 2020, en plein dans la pandémie. C'est ma première bande dessinée complète, c'est la première fois pour moi. Le thème central, c'est les abus, les abus sexuels, les abus de pouvoir. C'est un récit qui est tiré de ma réalité. Plus jeune, j'ai vécu une situation d'abus grave avec un ami de mon père qui est devenu mon employeur. Je travaillais de manière informelle chez lui : faire du jardinage, du ménage, des petits travaux… J'y ai vécu toutes sortes de violences : psychologiques, verbales et sexuelles. Bien sûr, j'étais très peu payé, bien en dessous du salaire minimum de l'époque. Cet homme compensait mon petit salaire en me donnant de l'alcool à volonté. Très jeune, je me suis donc mis à boire beaucoup, sur mon milieu de travail, c'était en quelque sorte ma paye. Ce contexte, le fait de lier ça au travail, ça a ouvert la porte aux abus. Je le pense maintenant : il n'y a pas une grande distance à parcourir entre être le maître des actions de quelqu'un et être le maître du corps de quelqu'un.
ÀB ! : Comment as-tu représenté ce contexte difficile ?
R. : D'abord il y a la présence continue de l'alcool, mais aussi une dimension cognitive, la mémoire, l'oubli. Subir la violence c'est trop douloureux, trop traumatisant. Ta mémoire l'élimine. Tu l'oublies, même si c'est arrivé la même journée. L'alcool augmentait cet effet. On veut oublier les abus et la violence sexuelle parce que ça fait trop mal. L'alcool endommageait ma mémoire et moi, je voulais qu'elle soit endommagée.
ÀB ! : À qui s'adressent ta BD et ton récit ?
R. : Premièrement, je l'ai fait pour moi. Je suis le premier lecteur, je l'ai fait parce que j'avais besoin de la faire. C'est un moyen de ne pas oublier. Il ne me restait que des flashs. En créant le récit et en le mettant sur papier, il ne peut plus s'envoler. Après, ça s'adresse à beaucoup de gens ! C'est sûr qu'il y a une expérience difficile et il faut une certaine maturité. Ça peut s'adresser autant à des adolescent·es qu'à des adultes. Mon but avec cette publication c'est de montrer une preuve des agressions, une version du moins. Ça se peut. Moi, je l'ai vécu. Si d'autres ont le même vécu, la BD est là pour leur dire : « moi aussi j'en ai vécu, de la violence sexuelle, ça existe ». Aussi, mon vécu est celui d'une agression au masculin, d'un homme et d'un adolescent. On en parle de plus en plus des agressions sexuelles et c'est une très bonne chose. Cette œuvre peut participer à la conversation d'un point de vue masculin, mais aussi le contexte d'abus liés au travail qui est très peu discuté.

ÀB ! : Quelle est la place de la BD pour aborder des sujets aussi difficiles ?
R. : La BD a sa place parmi les arts visuels dans l'ensemble, mais je pense que BD est en expansion au Québec. Il y a de plus en plus de gens qui en lisent, adolescent·es comme adultes. Il y a beaucoup de personnes au Québec qui sont intimidées par l'écrit, pour elles, la BD est un média plus accessible, moins intimidant qu'un roman ou des essais. La BD est un moyen artistique de plus. Aussi, il y a le récit comme tel. Pour moi, c'était très sensoriel : des ambiances, des sensations, des postures corporelles. Je me voyais mal passer ça par l'écrit. Il me fallait des illustrations. Par exemple, dans ma BD, il n'y a pas de décor, c'est des fonds noirs. Ça représente le souvenir, un morceau de mémoire qui flotte dans le vide, comme un cauchemar. Je me voyais mal faire flotter l'écriture pour transmettre ce message. Aussi, le personnage de l'agresseur, il avait plusieurs formes – c'était un ami de mon père, je l'aimais aussi, donc son visage se transforme. Avec la BD, ça passe mieux, on est habitué de voir les personnages changer selon la situation : la malléabilité des formes aidait mon propos avec la force de l'illustration.
Une amie m'a déjà dit : « il n'y a pas de mémoire révolutionnaire possible sans illustration ». Ça m'a marqué, je suis d'accord. Les causes et les difficultés décrites par les gens ont besoin de symboles. L'illustration est un marqueur facile : elle pose des bornes dans la mémoire.


Sans voix : carnets de recherche sur la radicalisation et l’islamophobie

Bochra Manaï, Sans voix : carnets de recherche sur la radicalisation et l'islamophobie, Éditions du Remue-Ménage, 2022, 144 pages.
Dans le cadre de la lutte à la radicalisation, Bochra Manaï souhaite « faire émerger les récits marginalisés et amplifier les paroles absentes ». C'est donc dans un souci de « jeter les bases d'une réelle conversation transformatrice » qu'elle partage la voix des personnes principalement concernées et affectées par le phénomène de radicalisation, mais aussi celle de diverses personnes musulmanes, dont elle-même, dans un contexte national et international d'islamophobie. À travers le partage de son expérience personnelle, des entrevues et rencontres tenues au cours de son projet de doctorat, des interpellations publiques et politiques, de la triste actualité qui opère en parallèle et de la couverture médiatique qui en découle, nous sommes amené·es à découvrir toute la toile d'influences de cette problématique sociale.
En situant ce contexte social et son impact sur les communautés ou les individus, l'autrice réoriente la réflexion autour des sources de la colère ou de la rupture pouvant mener à la radicalisation plutôt que d'associer cette source à la religion, qui ne devient qu'un instrument pour la canaliser. Elle déconstruit l'idée de la radicalisation comme état et met plutôt en lumière le processus d'exclusion qui mène à cette violence. Cette exclusion découle de la création d'un Autre, généralement défini par les systèmes d'oppressions comme le patriarcat, le racisme et l'âgisme. Bochra Manaï nous invite alors à réfléchir à « ce qui se trame derrière nos dénis dès qu'il s'agit d'islamité ou de jeunesse ». Le refus de reconnaître l'islamophobie ou le racisme systémique mène à l'incapacité de saisir l'exclusion sociale, notamment sur la question de légitimité de la parole, de la reconnaissance de l'expérience ou de l'opinion, d'une réelle écoute et donc, d'une rencontre. Cet argument est étayé d'exemples concrets de tensions sociales ayant émergées des événements autour de la présence musulmane : les débats polarisants sur les accommodements raisonnables, la création de la Charte des valeurs ou l'instauration de la loi 21, par exemple.
Pour briser ce cycle, les paroles rapportées et la proximité avec les réflexions et les émotions de l'autrice permettent la rencontre avec l'humain. Manaï nous invite à porter un regard honnête, empathique et sensible sur les vies qui sont impliquées dans ces enjeux souvent réduits à l'actualité polémique et à une action politique déconnectée. L'exemple du plan d'action gouvernemental créé afin d'agir sur la radicalisation démontre l'incompréhension, sinon le refus, de reconnaître et d'agir sur les fondements de cet enjeu et ce, malgré les demandes effectuées par les communautés musulmanes lors des consultations préalables. En effet, dans ce plan, la radicalisation semble déjà uniquement tournée vers les musulman·nes, mais de plus, l'enjeu de l'islamophobie n'y est simplement pas abordé. On en vient rapidement à voir comment une supposée mobilisation politique et citoyenne contre la radicalisation a, en fait, instrumentalisé, omis ou occulté les principaux concerné·es et les racines du problème en accroissant plutôt la sécurité et la vigilance au nom du vivre-ensemble. Sans surprise, un raté.
Au fur et à mesure, on prend aussi conscience de notre propre rôle comme lecteur·rice. Dans un contexte politique et médiatique où toutes les énergies du gouvernement caquiste servent à nier le racisme systémique et l'islamophobie plutôt qu'à essayer de les comprendre, et alors que le sensationnalisme l'emporte, personne n'est à l'abri de la polarisation. Et puisque la radicalisation découle, selon Bochra Manaï, d'une rupture sociale créée par une incompréhension mutuelle, ces carnets permettent la rencontre et favorisent le regard critique et la compréhension.

Fake news - Tout sur la désinformation

Nereida Carrillo et Aberto Montt, Fake news - Tout sur la désinformation, Les 400 coups, 2023, 120 pages.
Le tandem à la source de ce livre sur les nouvelles frelatées s'avère des plus pertinents à l'heure où, tellement souvent, nous sommes englué·es dans la toile et ses méandres. L'ouvrage, tant sur le front documentaire que sur celui d'une proposition graphique percutante, vient stimuler notre curiosité naturelle en prenant soin de nous épauler à devenir plus alertes et critiques face à l'information pléthorique se trouvant sur les internets. Par exemple, le principe de vérification a quelque chose d'incontournable afin de contre-valider l'actualité. On nous y présente ainsi des méthodes de vérification utiles comme PANTERA (provenance, auteur, nouveauté, ton, éléments de preuve, réplique, agrandir). Le grand mérite de ce livre n'est pas de fournir des vérités mais de laisser des questions ouvertes ; notamment au niveau de l'élargissement des perspectives quant à l'information ou encore, pourquoi tel sujet et pas tels autres ? Journaliste, chercheuse, enseignante – et aussi animatrice du projet d'éducation aux médias Learn to Check – Nereida est acrobate sur tous ces sujets. Il en va de même pour le dessinateur Alberto Montt, dont les personnages hyperréalistes et un peu fous (son trait a des parentés avec Gary Larson et Farside Gallery) ajoutent une valeur certaine au contenu. Le Pinocchio en couverture l'illustre à merveille…
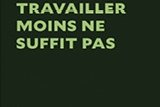
Travailler moins ne suffit pas

Julia Posca, Travailler moins ne suffit pas, Écosociété, 2023, 144 pages.
Nous rêvons tous de moins travailler. Mais étant donné la place incontournable qu'occupe le travail dans nos vies, nous nous rendons rapidement compte qu'il y a un fossé à franchir entre cette pensée et sa réalisation. On se pose les questions suivantes : est-ce possible ? Est-ce souhaitable ? Quelles en seront les conséquences ? C'est à ces questions que répond adroitement la sociologue Julia Posca dans Travailler moins ne suffit pas.
La réduction du temps de travail a été une des grandes victoires du mouvement social depuis le XIXe siècle, alors qu'un ouvrier pouvait travailler de 10 à 16 heures par jour, pour un nombre estimé à 3000 heures par année. Les progrès sont tels que la prochaine étape consisterait à passer à la semaine de quatre jours, un choix parfaitement envisageable, d'après la démonstration de Posca. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre, sera-t-il encore possible de poursuivre dans cette direction ? L'autrice montre que cette pénurie affecte surtout les secteurs où le travail est le plus difficile et les salaires les plus bas, là où les femmes sont majoritaires : le travail du soin et les services. Dans ces cas, il faut bien plus que la semaine de quatre jours pour empêcher ces personnes d'être traitées « comme de simples ressources susceptibles d'être reléguées à tout moment au rang de vulgaire déchet. »
Moins travailler a des conséquences sur la consommation, et incidemment, sur l'environnement. Il s'agit là d'un des aspects les plus intéressants de cet essai. Le développement du capitalisme, surtout dans sa période fordiste, a associé la diminution des heures de travail à une plus grande consommation qui fait rouler l'économie. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et la crise environnementale, ce modèle ne peut plus tenir. Pour résoudre ce problème, il faut changer la forme des entreprises. La surproduction, les emplois inutiles, mais valorisés, les performances boursières des grandes entreprises sont autant d'obstacles qui font que même si on arrive à une réduction des heures de travail, le monde dans lequel nous vivons sera de plus en plus fragilisé. Julia Posca propose donc de mettre fin à la course au profit, par l'économie sociale, les services publics et les organismes sans but lucratif, davantage préoccupés par la qualité de vie et la justice sociale.
L'essai de Julia Posca, concis et très pédagogique, développe une réflexion globale sur le travail. Les sujets dont on parle beaucoup, comme la pénurie de main-d'œuvre, le rêve de prendre sa retraite à quarante ans, ou les liens entre travail et consommation, sont abordés dans une large perspective qui ramène les débats à leur racine : tout, dans le fond, demeure une question d'organisation sociale, et celle qui est la nôtre n'est pas une fatalité.












