Revue À bâbord !
Publication indépendante paraissant quatre fois par année, la revue À bâbord ! est éditée au Québec par des militant·e·s, des journalistes indépendant·e·s, des professeur·e·s, des étudiant·e·s, des travailleurs et des travailleuses, des rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l’organisation de notre société, dans les rapports entre les hommes et les femmes et dans nos liens avec la nature.
À bâbord ! a pour mandat d’informer, de formuler des analyses et des critiques sociales et d’offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire. À bâbord ! veut appuyer les efforts de ceux et celles qui traquent la bêtise, dénoncent les injustices et organisent la rébellion.

« Entreprise libérée » : Expérimentations et apprentissages

Fondée en 2004 en Beauce, l'entreprise RG dessin est une entreprise privée de dessin industriel de 12 employé·es qui s'inspire du concept d'entreprise libérée. Une gouvernance qui emprunte des éléments d'autogestion tout en conservant certains traits propres aux entreprises privées. Comment se déploie cette philosophie dans l'entreprise ?
Entrevue avec Vincent Roy, président co-fondateur de l'entreprise privée RG dessin. Propos recueillis par Isabelle Bouchard et Samuel Raymond.
À bâbord ! : En quoi consiste le concept « d'entreprise libérée » ?
Vincent Roy : La première caractéristique d'une entreprise libérée est celle de la transparence généralisée de la gouvernance. Cela veut dire que nous rendons disponibles le plus d'informations et de données possible. Que ce soient ce que l'on facture aux clients, le coût des opérations, les salaires des salarié·es, les impacts des décisions, tout cela est connu.
Chaque trois mois, nous rendons disponibles nos dépenses et nos revenus. Les employé·es peuvent consulter ces données sur notre logiciel de gestion en tout temps. Nous refusons que le pouvoir des chiffres soit concentré dans les mains d'un petit groupe. Certain·es employé·es développent ainsi une connaissance intime de l'entreprise en ce qui concerne les chiffres.
Au-delà de ça, nous pratiquons « la délégation radicale des décisions » dans la mesure où nous avons une confiance absolue que nos salarié·es sont en mesure de prendre des décisions pour le bien commun. Par exemple, les employé·es gèrent mon salaire et les leurs. Nous ajustons les salaires une fois par année en tâchant de les maintenir concurrentiels. Ils et elles sont invité·es à prendre des décisions pour l'entreprise, mais aussi pour le bien de notre communauté : on a donné un montant x pour une salle de spectacle, on a rendu notre terrain plus vert, etc.
La perte la plus importante pour moi, ce n'est pas qu'un·e employé·e vole du temps ou du matériel à l'entreprise, mais plutôt qu'un·e employé·e ait uniquement travaillé sans avoir mis à contribution sa propre créativité. Laisser de l'espace à la créativité, c'est de l'engagement !
Cela va de pair avec l'acceptation de la prise de risque. J'accepte que certaines initiatives ne fonctionnent pas. Sans cela, les gens ne prendront pas de décisions, ne développeront pas leur autonomie et l'entreprise ne se libérera pas. Cela n'est pas simple, car les employé·es ont le réflexe de me demander la permission ou sont dans l'attente de mes conseils. À force de leur répondre : « Toi, qu'en penses-tu ? Que ferais-tu ? », alors ils et elles finissent par s'habituer et par prendre les décisions. Il va de soi que si j'étais informé d'une prise de décision qui pourrait mettre en péril la viabilité à court terme de l'entreprise, j'utiliserais mon droit de veto, mais cela n'est jamais arrivé en vingt ans.
ÀB ! : Comment se prennent les décisions du quotidien chez RG dessin ?
V. R. : Dès que j'ai vendu un projet, il devient la responsabilité d'une personne ou d'une équipe qui décide de la suite, sauf, pour le moment, ce qui concerne la facturation. C'est l'équipe qui détermine si un crédit est donné au ou à la client·e si le rendu n'est pas parfait. Une fois par semaine, nous tenons une rencontre pour faire le point sur les projets en cours.
Pour les projets d'amélioration intra et extra entreprise, nous procédions auparavant par comité. Cela avait ses limites, notamment à cause de la routine qui s'installait. Maintenant, nous procédons par porteur·euses de projets. Dans ce cas, on s'en remet à l'initiative individuelle. Si une personne veut faire quelque chose, elle le fait. Sinon, il faut accepter qu'il n'y ait pas nécessairement quelqu'un·e d'autre pour le faire. Dans cet esprit, nous avons un employé qui est devenu le maître en informatique même si ce n'est pas pour cela que nous l'avions initialement engagé. Les personnes se découvrent des talents cachés ou bien ont l'opportunité de mettre de l'avant des compétences personnelles. Cela améliore l'écosystème de notre milieu de travail.
Une fois par année, nous recevons une personne-ressource externe qui vient animer notre groupe pour que l'on se dote de projets d'amélioration. L'an passé, nous en comptions 57 et nous sommes sur le point de tous les réaliser. Par exemple, nous avons aménagé un patio extérieur et développé notre clientèle en faisant du démarchage aux États-Unis.
ÀB ! : Comment les conflits sont-ils gérés ?
V. R. : Déjà, l'enjeu des horaires est important dans notre milieu. Nous avons choisi de ne pas en avoir. Cela amenuise la possibilité de conflits et les gens s'ajustent en fonction des heures d'arrivée de chacun. Il faut aussi savoir que nous avons beaucoup investi en formation, en communication non violente par exemple, pour faciliter les bonnes relations. En ce sens, nous avons aménagé la cafétéria pour créer une ambiance qui favorise les échanges. Cela dit, il y a parfois des conflits, mais nous ne vivons pas dans un climat conflictuel, bien au contraire.
ÀB ! : Pour terminer, comment vous formez-vous ?
V. R. : Depuis quelques années, je suis encadré par une spécialiste en culture d'entreprise libérée que je consulte régulièrement. À la blague, je dis qu'elle m'a appris à devenir un dictateur. En effet, je dois obliger les gens à décider pour et par eux-mêmes !
En ce sens, il faut se tenir loin de la microgestion et il faut faire confiance à notre monde ! Ce qui est génial, c'est que cette philosophie de gestion se répand en Beauce.

Changer de cadre pour détruire la grande pauvreté

Restreindre notre compréhension de la pauvreté au seul manque de ressources limite notre capacité à y répondre durablement. C'est seulement en rendant visibles les dimensions cachées de la pauvreté avec les personnes qui la vivent et à partir de leur expérience que l'on peut espérer y mettre fin.
« Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde », tel est le premier des Objectifs de développement durable (ODD) que l'Organisation des Nations Unies s'est donnés d'ici 2030. Malgré des développements technologiques et économiques sans précédent, une grande partie de l'humanité souffre encore des violences de la pauvreté. Malgré l'action d'une multitude d'organisations, la multiplication de programmes locaux, nationaux, internationaux, la pauvreté continue d'être l'un des principaux problèmes sociaux persistants et non résolus de notre espèce.
Des actions limitées par une compréhension limitée
Notre échec collectif à mettre fin à la pauvreté est sans doute lié aux définitions incomplètes ou erronées de la pauvreté et à leurs effets sur les actions mises en œuvre pour y répondre.
Ainsi, la définir comme l'incapacité à obtenir le minimum nécessaire à l'existence physique de base, la pauvreté dite absolue, a mené à l'établissement de seuils, indicateurs ou mesures de pauvreté en dessous desquels une personne est considérée en situation de pauvreté. En fonction de ces indicateurs, différents programmes caritatifs ou mesures d'urgence gouvernementales ont été mis en place pour répondre ici à l'insécurité alimentaire, là au démantèlement de camps de misère, ailleurs à la protection des enfants en les retirant de leurs familles pour les protéger de la pauvreté.
Sous l'impulsion des luttes des mouvements populaires, la limitation aux seules conditions physiques d'existence de cette conception de la pauvreté a été complétée par les dimensions sociales, économiques et juridiques de pauvreté relative à une société. Des formes de pauvreté qui ne seraient pas le fruit d'une punition divine, du hasard ou de la fatalité, mais bien d'une organisation sociale et économique accordant en excès aux un·es ce qu'elle refuse en nécessaire aux autres. Ainsi, la pauvreté devient une situation multidimensionnelle et le résultat direct de violations de droits humains. C'est ainsi que différentes institutions nationales [1] ou internationales [2] ont adopté des cadres de définition de la pauvreté inspirés de ceux du prêtre et activiste Joseph Wresinski, où elle est décrite comme étant :
« l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins grave et définitive. Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. »
Cette approche par les droits humains et la reconnaissance de la nature multidimensionnelle de la pauvreté permet de mettre en garde contre des « solutions » magiques qui peuvent se retourner contre les personnes concernées. En effet, de nombreux projets continuent d'être pensés sans les personnes en situation de pauvreté, comme des programmes contre l'insécurité alimentaire, des plans d'aménagement urbain, de santé mentale, d'alphabétisation. En les excluant des discussions et en ignorant leur expertise, les décisions sont prises sans intégrer plusieurs dimensions de la pauvreté, notamment émotionnelles, symboliques ou relationnelles. Des dimensions pourtant essentielles dans le succès ou l'échec de ces initiatives et que seules des personnes qui vivent la pauvreté peuvent identifier.Penser la pauvreté avec les personnes qui la viventLe Mouvement international ATD Quart Monde mène avec d'autres acteurs ce combat pour que la manière d'interroger, de comprendre, de décider et d'agir sur la pauvreté soit pensée avec les personnes qui la vivent. Au début des années 2000, des militant·es d'ATD Quart Monde ayant une expérience de pauvreté, des éducateurs et éducatrices populaires ainsi que des chercheur·es et universitaires ont mis en place une démarche de « Croisement des savoirs » ayant pour objectif d'identifier les connaissances dont nos sociétés ont besoin pour mettre un terme définitif à la misère. Cette première expérience a entraîné la multiplication de démarches similaires pour mieux comprendre la pauvreté, la définir et agir pour l'endiguer.
Entre 2017 et 2019, ATD Quart Monde, en partenariat avec une équipe de recherche de l'Université d'Oxford et soutenue par la Banque Mondiale, a lancé une démarche au niveau international qui visait à identifier les dimensions cachées de la pauvreté [3]. Des personnes vivant la pauvreté ont été impliquées à chaque étape de la recherche, depuis la conception du projet, la collecte et l'analyse des données jusqu'à la rédaction du rapport final.
Rendre visibles les dimensions cachées de la pauvreté
Ce travail de recherche a ajouté aux éléments traditionnellement associés à la pauvreté – manque de travail décent, revenu insuffisant et précaire, privations matérielles et sociales – les dimensions sociales et institutionnelles souvent invisibilisées, mais constantes dans l'expérience de la pauvreté. Cette recherche a par exemple révélé les dimensions liées à l'incapacité des institutions, par leurs actions ou leur inaction, à répondre de manière appropriée et respectueuse aux besoins et à la situation des personnes concernées, ce qui les conduit à les ignorer, à les humilier et à leur nuire. Elle a aussi identifié la dimension des contributions non reconnues : les connaissances et les compétences des personnes vivant dans la pauvreté sont rarement vues, reconnues ou valorisées et même ces personnes sont souvent présumées, à tort, incompétentes.
Les co-chercheur·es ayant un vécu de pauvreté ont joué un rôle essentiel dans l'identification de trois dimensions centrales dans l'expérience de la pauvreté : la dépossession du pouvoir d'agir, soit le manque de contrôle sur sa vie et la dépendance vis-à-vis des autres, la souffrance dans le corps, l'esprit et le cœur, le sentiment d'impuissance à y faire quoi que ce soit, et finalement le combat continu pour survivre aux nombreuses formes de souffrances causées par la pauvreté.
Ce travail a aussi permis de contribuer à l'identification d'éléments qui amplifient la violence de la pauvreté vécue par les personnes, comme ceux liés aux croyances culturelles, aux identités et oppressions multiples, ou encore aux éléments liés à la durée de la pauvreté et aux inégalités régionales.
Tenir compte de tous les aspects
C'est en prenant en compte l'ensemble de ces dimensions de la pauvreté qu'il est possible d'expliquer l'échec de programmes visant à y mettre fin. Ainsi, on peut comprendre comment les programmes d'employabilité contribuent, sans le savoir, à des effets de maltraitance institutionnelle ou encore comment ceux d'aide alimentaire participent, sans le vouloir, à la dépossession du pouvoir d'agir des personnes.
Ce travail nous permet de comprendre que c'est par la prise en compte de toutes les dimensions de la pauvreté que l'on pourra dépasser les mesures d'urgence ou les solutions temporaires et espérer définitivement y mettre fin. Surtout, ce travail nous rappelle la nécessité de construire des cadres avec les personnes qui la combattent au quotidien pour se libérer, libérer leurs familles et, finalement, libérer définitivement nos sociétés des violences de la pauvreté.
[1] Rapport Grande pauvreté et précarité économique et sociale adopté par le Conseil économique et social français en 1987.
[2] Par exemple dans les travaux de la Commission et du Conseil des Droits de l'Homme sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté de l'ONU.
[3] ATD Quart Monde, « Les dimensions cachées de la pauvreté ». En ligne : www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2019/05/DimensionsCacheesDeLaPauvrete_fr.pdf
Léo Berenger Benteux est allié et Daniel Marineau est volontaire du Mouvement international ATD Quart Monde.
Illustration : Anne Archet

Petite chronologie de l’autogestion au Québec

1945
L'imprimerie coopérative Harpell – Sainte-Anne-de-Bellevue
Considérée par plusieurs comme l'ancêtre du mouvement autogestionnaire au Québec, c'est en 1945 que l'imprimerie devient une coopérative de travail pendant près de 50 ans. À son plus fort, elle réunit près de 300 membres travailleurs·euses.
1947
Le village de Guyenne ou « la petite Russie » – Abitibi
En 1946 est mis en place une formule de colonisation du territoire qui mènera à la création d'un village où les décisions se prennent collectivement par les hommes, « les Pionniers de Guyenne ». En 1969, les femmes, après plusieurs années de luttes, sont admises aux assemblées politiques.
1968
La Clinique communautaire Pointe-Saint-Charles – Montréal
Des étudiant·es en médecine et en sociologie du quartier se mobilisent pour créer une clinique médicale populaire avec une approche basée sur les déterminants sociaux de la
1975
Le Centre de santé des femmes de Montréal – Montréal
Le CSF vise une prise en charge par les femmes de leur santé physique et mentale. Un organisme central dans les luttes pour la légalisation de l'avortement et un des premiers lieux au Québec où il est pratiqué.
1970 à 1980
Le projet du JAL – Témiscouata
Le projet du JAL nait au cours du mouvement des Opérations Dignité et réunit quatre villages : St-Juste-du-Lac, Auclair, Lejeune et Lots-Renversés. Portés par les principes d'action « animation-formation-développement », ces villages inventeront un modèle original de développement territorial, communautaire et autogéré.
1974 à 1982
L'usine Tricofil – Saint-Jérôme
Dans les années qui précèdent l'ouverture de Tricofil, l'usine Regent Mills Knitting (1916-1974) était déjà animée par l'un des syndicats les plus combatifs de l'époque. En 1972, l'occupation de l'usine par des centaines de travailleur·euses marque un point tournant dans ce qui deviendra Tricofil. Cette expérience autogestionnaire est considérée par certains comme la plus grande expérience autogestionnaire au Québec.
1975 à 2006
Éditions coopératives Albert Saint-Martin – Montréal
Maison d'édition autogérée offrant des ouvrages critiques sur la société québécoise. Elles portent le nom de l'un des pionniers du socialisme au Québec.
1985
L'usine de pneu Uniroyal/Servaas - ville d'Anjou
De 1972 à 1985, les luttes des travailleurs de l'usines ont graduellement pavé la voie vers l'autogestion. Suite à la fermeture de l'usine en 1985, les travailleurs ont formé une coopérative de travail (Société coopérative ouvrière de production de caoutchouc, SCOPCAT).
2018
Le Bâtiment 7 – Montréal
De 2003 à 2016, des groupes citoyens se mobilisent pour s'approprier un bâtiment appartenant anciennement au CN. Ce projet se concrétise en 2018 et se veut un espace communautaire autogéré par les différentes organisations qui l'occupent. La structure est ouverte à la communauté à travers plusieurs instances démocratiques.
2003 à 2020
Le café Coop Touski – Montréal
Cette institution phare du quartier Centre-Sud de Montréal a tissé les jalons d'une grande histoire de bouffe, de micro-culture, de grands rêves, mais surtout d'autogestion. On comptera plus d'une centaine de personnes salariées.
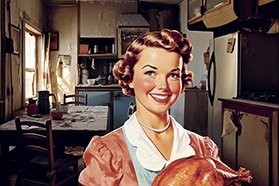
L’aide alimentaire, un garrot pour les plus vulnérables

Les organismes d'aide alimentaire du Québec n'ont jamais été sous une telle pression. On peut s'étonner qu'autant de gens ne puissent pas se nourrir par leurs propres moyens dans une société supposément riche comme la nôtre. Pourtant, le coût élevé des aliments, d'une part, et la crise du logement, d'autre part, laissent peu de choix aux plus vulnérables de notre société. Et ces derniers ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
Dans l'édition 2023 de notre étude annuelle Bilan-Faim, parue en octobre dernier, le réseau des Banques alimentaires du Québec annonçait répondre à 2,6 millions de demandes. Chaque mois. Une demande d'aide alimentaire répondue, ça peut être un panier de provisions ramené à la maison par une famille, un repas préparé et livré par une popote roulante au domicile d'une personne âgée, une collation remise à un enfant, etc. Depuis 2019, le nombre de demandes a augmenté de 33 %. À elle seule, la quantité de paniers de provisions remis a doublé sur la même période. À travers tous ces services, notre réseau estime aider mensuellement 872 000 personnes aux quatre coins de la province.
Avant la pandémie, nous aidions mensuellement 500 000 personnes. Comment une aussi grande augmentation en si peu de temps s'explique-t-elle ? Bien sûr, la crise sanitaire a fragilisé de nombreuses personnes déjà précaires, que ce soit physiquement, mentalement ou financièrement. Mais c'est l'inflation galopante qui sévit depuis qui nous amène la plus grande vague de demandes de notre histoire. La hausse du prix du panier d'épicerie frappe durement, on ne vous apprendra rien. La population doit faire des choix devant les rayons en ce qui a trait à la quantité ou à la qualité des aliments achetés. L'insécurité alimentaire guette tranquillement celles et ceux qui réduisent leurs portions, puis sautent carrément des repas…
Il y a 42 % des ménages bénéficiant des paniers de provisions qui déclarent l'aide sociale comme principale source de revenus. Cette proportion est en baisse graduelle depuis 2019, alors que la part des ménages bénéficiaires qui déclarent un emploi comme source principale de revenus atteint maintenant 18 % ! Nous constatons donc que plusieurs travailleurs et travailleuses à petit salaire du Québec n'arrivent plus à se nourrir convenablement. En ce qui a trait à la composition des ménages, là encore c'est varié, mais notons que 45 % des ménages aidés par les paniers de provisions sont des familles avec enfant(s).
Malheureusement, l'alimentation est une dépense compressible, c'est-à-dire qu'elle paraît négociable par rapport à d'autres dépenses obligatoires, comme payer son loyer. Les organismes communautaires de notre réseau évoquent majoritairement la crise du logement et le coût élevé des loyers comme explication de la hausse des demandes d'aide alimentaire, car 62 % des ménages aidés sont locataires d'un logement privé. De plus, les usager·ères sont des adultes vivant seul·es (37 %) et des familles monoparentales (19 %).
L'aide alimentaire, une mesure de lutte contre la pauvreté
Les organismes d'aide alimentaire sont aux premières loges devant les effets de la pauvreté, dont l'insécurité alimentaire est un symptôme. Être forcé·e de réduire la quantité et la qualité de son alimentation est le signe d'une détresse financière à laquelle nous devons mieux répondre en tant que société.
Surtout, il ne faut pas négliger l'impact psychologique et physique de l'insécurité alimentaire. Il est difficile d'envisager de nouvelles solutions de sortie de la pauvreté (par exemple, la recherche d'un emploi) quand la faim nous tenaille. La réduction de la pauvreté diminuerait certainement l'insécurité alimentaire parmi la population, et inversement, l'élimination de la faim serait un frein de moins dans le parcours des personnes pour sortir de la pauvreté.
La réduction durable de l'insécurité alimentaire et sa prévention doivent passer par une amélioration du filet social québécois. Nous appuyons donc des solutions qui augmenteraient pour de bon le pouvoir d'achat des personnes moins nanties grâce à des mesures de redressement de leurs revenus et d'allègement du coût de la vie.
La résolution de la crise du logement devrait ainsi être une priorité du gouvernement afin de soulager la pression sur notre réseau. Le salaire minimum devrait également permettre d'atteindre un revenu viable. La majoration des prestations de l'aide sociale et leur indexation trimestrielle à l'inflation nous semblent également nécessaires. À travers ces mesures, il faudrait réfléchir, dans une perspective intersectionnelle, à la manière de soutenir les femmes, les minorités sexuelles, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap ainsi que les membres des Premières Nations, qui sont plus susceptibles de vivre de l'insécurité alimentaire.
« Les banques alimentaires, ça ne règle rien. » Faux !
Certaines personnes sont parfois tièdes devant le fabuleux travail accompli par les banques alimentaires. Quel est l'adage qui dit qu'il est préférable d'apprendre à pêcher que de donner du poisson ? Nous reconnaissons que l'aide alimentaire est une mesure palliative. Dans la situation actuelle, il est cependant difficile d'imaginer un avenir proche où les Québécois·es seront à l'abri des difficultés systémiques et bénéficieront d'un filet social assez solide pour être à l'abri de situations nécessitant le recours à un organisme d'aide alimentaire.
Entretemps, les banques alimentaires demeurent nécessaires, voire vitales. Alors que plusieurs considèrent l'aide alimentaire comme un simple pansement, nous osons dire que nous sommes un garrot. La faim n'est pas une petite blessure ! L'objectif premier de l'aide alimentaire est de procurer un soulagement immédiat à la faim. L'aide alimentaire est exceptionnellement bien organisée au Québec. Notre association provinciale regroupe 19 moissons, qui sont de grandes banques alimentaires régionales responsables d'approvisionner en denrées les organismes communautaires locaux de leur territoire, afin que ces derniers puissent se concentrer sur leur mission essentielle d'aide à la personne. Grâce à un système de partage provincial équitable et à des opérations bien rodées, de très grandes quantités de nourriture peuvent être distribuées rapidement et efficacement jusqu'aux personnes dans le besoin. Mais les organismes dont c'est la mission font aussi beaucoup plus.
L'étude « Parcours » de la Chaire de recherche du Canada sur les approches communautaires et inégalités de santé indique que le recours aux banques alimentaires est l'une des dernières stratégies utilisées par les personnes en insécurité alimentaire pour s'approvisionner : 46 % des nouveaux demandeurs d'aide alimentaire sont en insécurité alimentaire grave à ce moment. Les banques alimentaires sont la porte d'entrée dans les organismes communautaires pour 86 % des nouveaux demandeurs de cette étude. Parmi les organismes de notre réseau, 46 % offrent aux usager·ères un service de référencement vers des organismes spécialisés qui pourront répondre à d'autres problématiques de vie. Au sein même d'un organisme d'aide alimentaire, plusieurs services complémentaires sont souvent offerts : éducation, prévention, préparation de la déclaration de revenus, hébergement, aide au logement, aide à la recherche d'un emploi, etc.
Que nous réserve l'avenir ?
Nous sommes inquiet·ètes, alors que les incertitudes économiques, les craintes d'une récession et les impacts à long terme de la pandémie et de l'inflation nous laissent croire que les personnes fragilisées auront besoin de soutien encore longtemps. Après la crise économique de 2008, soit la dernière fois que notre réseau a connu une hausse aiguë de la demande, les besoins pour les services d'aide alimentaire ne sont jamais redescendus.
Le financement des organismes communautaires est cependant insuffisant depuis des décennies. Leur précarité est accentuée aujourd'hui par la hausse des besoins auxquels ils doivent répondre et par l'inflation qui augmente leurs coûts de fonctionnement. Nous sommes en démarche auprès du gouvernement pour obtenir le soutien nécessaire à notre réseau.
Pour donner un ordre de grandeur du défi auquel nous devons faire face, nos membres, les 19 moissons régionales, ont redistribué ensemble plus de 84 millions de kilos de nourriture, pour une valeur marchande de 512 M$, à leurs organismes accrédités en 2023-2024. Et souvent, cela n'a pas été suffisant pour apaiser tous les ventres…
POUR ALLER PLUS LOIN
Pour avoir un meilleur portrait de la faim au Québec, consultez le rapport complet Bilan-Faim Québec 2023, disponible sur le site des Banques alimentaires du Québec : https://banquesalimentaires.org
Camille Dupuis travaille aux Banques alimentaires du Québec.
Le réseau des Banques alimentaires du Québec assure l'approvisionnement en denrées et sa logistique à près de 1300 organismes communautaires de proximité à travers le territoire québécois, offrant divers services à la population : comptoirs alimentaires, popotes roulantes, services de collations pour les enfants, cuisines collectives, maisons d'hébergement pour femmes, ressources pour les immigrant·es, services aux personnes en situation d'itinérance, etc.

Individualisation de l’itinérance : « Si tu veux, tu peux ! »

La pauvreté est l'une des causes de l'itinérance, et elle se ressent dans le quotidien des personnes en situation d'itinérance. Les organismes communautaires membres du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) en sont témoins chaque jour : la pauvreté a des effets ravageurs sur nos concitoyen·nes, et les ressources manquent pour les soutenir adéquatement.
La pauvreté, c'est l'affaire de tout le monde – ce sont nos voisin·es qui doivent aller à la banque alimentaire pour réussir à finir leur mois, c'est l'étudiant·e qui doit cumuler plusieurs emplois pour arriver à payer son loyer, c'est la personne qui quête parce que son chèque d'aide sociale n'est pas suffisant pour couvrir ses besoins de base. Dans le milieu de l'itinérance, nous sommes confronté·es à la pauvreté chaque jour, mais surtout, nous sommes confrontés à sa complexité. Parce que l'itinérance et la pauvreté sont loin d'être des enjeux faciles.
Michel a une famille, un bon emploi, un entourage qui le soutient. Du jour au lendemain, il perd tout et se retrouve à la rue, à dormir sur un banc de parc. Bien que cette histoire soit fictive, dans l'imaginaire collectif, c'est souvent de cette manière qu'est comprise l'itinérance – un coup de malchance, un événement bouleversant, une irrégularité dans une vie « normale ». On s'imagine que de sortir d'une situation d'itinérance, c'est aussi simple que de se trouver un logement – si on réussit à « placer » Michel en appartement, il pourra reprendre le cours de sa vie et mettre derrière lui ce malheureux incident de parcours. Sans surprise, la réalité est beaucoup plus complexe.
L'exemple de Michel est le reflet d'une perspective individualisante de l'itinérance qui conceptualise ce phénomène comme un échec personnel, qui aurait donc comme solution un effort personnel. Selon cette perspective, la trajectoire d'une sortie d'itinérance commencerait par la reprise en main, puis par un retour en logement pour pouvoir finalement redevenir un membre productif de la société. Si Michel est capable, rien n'empêche les autres de le faire !
Cette façon de concevoir l'itinérance passe totalement à côté des causes structurelles du passage à la rue et omet de considérer les barrières systémiques auxquelles les personnes en situation d'itinérance font face tout au long de leur parcours. Loin d'être une ligne droite, l'itinérance se dessine plutôt comme un gribouillis, un processus de désaffiliation sociale, de va-et-vient parsemé d'embûches entre la rue et le logement. L'itinérance, ce n'est pas aussi simple que de tomber dans la rue, d'être dans la rue et d'en sortir. Par-dessus tout, c'est un phénomène social et non individuel.
La pauvreté est un choix de société
La société capitaliste chapeautée par l'État construit et maintient les conditions qui mènent à la pauvreté et à l'exclusion sociale. La pauvreté est un choix politique : prenons par exemple les montants d'aide sociale qui sont volontairement calculés pour combler 50 % seulement des besoins de base afin de pousser les prestataires à « se trouver une job ». Dans une société où l'employabilité est valorisée par-dessus tout, les personnes qui ne peuvent pas travailler sont ainsi condamnées à la pauvreté par l'État, et celles qui travaillent au salaire minimum ne sont pas loin devant. Avec un chèque d'aide sociale de moins de 800 $ par mois, essayer de payer au minimum un loyer, une épicerie et ses déplacements relève du miracle… et ce n'est pas le gouvernement qui se surmène pour aider, lui qui envoie les Québécois·es vers les banques alimentaires déjà surchargées, lui qui s'attaque aux droits des locataires et qui investit peu dans les ressources communautaires ou de manière à transformer leur mission de transformation sociale en rapiéçage de misère. Ce n'est donc pas l'État qui facilite la sortie de pauvreté, et c'est sans compter le manque d'accès aux soins de santé, l'éducation, la judiciarisation des personnes dans l'espace public, la discrimination et le racisme systémique… les personnes en situation de précarité doivent faire des efforts surhumains pour se battre contre un ensemble de systèmes dans lesquels les dés sont pipés.
Comment donc parler de solution simple à l'itinérance alors même que l'on constate qu'elle est la résultante d'une accumulation de manquements collectifs et de trous dans notre filet social ? Alors que l'idée de mettre fin à l'itinérance en fournissant un logement à chacun est attrayante, force est de constater qu'un toit ne fait pas disparaître la précarité et l'exclusion sociale. Évidemment que le logement est un droit et que chacun·e devrait avoir accès à un chez-soi sécuritaire. Supposons toutefois que chaque personne soit placée en logement aujourd'hui : il y aurait quand même des personnes en instabilité résidentielle, des femmes qui subissent des violences, des personnes judiciarisées par la police, d'autres qui subissent de la discrimination parce qu'elles consomment, des jeunes LGBTQ2S+ qui se font mettre à la porte, des personnes qui sortent de prison sans aide à la réinsertion, des personnes qui n'arriveraient pas à se trouver un emploi ou à le maintenir et qui auraient de la difficulté à payer leur loyer à la fin du mois – la pauvreté ne disparaît pas avec un logement.
Plus qu'une question de logement ou de « motivation »
Personne n'est contre l'idée d'un monde sans itinérance. Toutefois, la croyance que mettre fin à l'itinérance est réalisable sans changements sociaux profonds – sans programmes de lutte à la pauvreté, sans réel accès à l'éducation, sans accès à des soins de santé adaptés et exempts de stigmatisation, sans revenu permettant de sortir de la pauvreté – est dangereuse. Si le poids de la sortie de l'itinérance repose sur les épaules des plus vulnérables et non sur celles de l'État qui les écrase, nous condamnons à la pauvreté et à l'exclusion sociale une grande partie de nos concitoyen·nes. Nous reproduirons malgré nous les schèmes d'une société de méritocratie, risquant de diviser les personnes entre celles qui « méritent » de l'aide puisqu'elles font des efforts pour s'en sortir versus celles qui ne se « forcent pas » et qui ne « méritent » donc pas d'aide de la société.
Puisque ce sont l'État et la société capitaliste qui produisent les situations de pauvreté, c'est à l'État que revient la responsabilité de remédier à la situation et de construire un filet social assez solide pour empêcher les personnes de tomber entre ses mailles. L'itinérance est un enjeu de société dont les causes sont complexes et différentes pour chaque personne – il y a autant de façons de basculer et de vivre en situation d'itinérance que de personnes. Pour l'instant, alors que ce sont des choix politiques qui engendrent et maintiennent des situations de pauvreté et d'exclusion sociale, ce sont les organismes communautaires qui se mobilisent pour venir en aide aux personnes et qui font les frais du sous-financement des services publics. En attendant que les instances publiques prennent leurs responsabilités et financent adéquatement les services sociaux, ce sont les organismes communautaires qui travaillent à colmater les brèches d'un système conçu pour que certain·es s'y noient.
Lorsqu'une personne passe à travers toutes les mailles du filet social, elle se retrouve dans les organismes en itinérance qui, eux-mêmes en situation précaire, se démènent pour offrir des ressources dignes avec les minces moyens à leur disposition. Face à l'inertie de l'État, comment pouvons-nous collectivement soutenir nos voisin·es qui subissent les contrecoups des désinvestissements sociaux, comment lutter contre l'individualisation de problèmes sociaux ? Bientôt confronté·es à des années qui, nous dit-on, seront fastes, nous nous devons de bâtir des solidarités intersectorielles et interclasses pour revendiquer le respect de nos droits et refuser leur effritement par une succession de gouvernements apathiques. Personnes domiciliées ou non, organismes et citoyen·nes – soyons furieux·euses, indigné·es, soyons solidaires et reprisons ce filet social ensemble.
Catherine Marcoux est organisatrice communautaire au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).
Illustration : Anne Archet

La pauvreté, cause et conséquence de violations de droits humains

La précarité économique dans laquelle un nombre de plus en plus important d'entre nous se trouve compromet le droit à la sécurité sociale et nuit à l'exercice de l'ensemble des droits humains.
Visant à faire connaître, à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits humains, la Ligue des droits et libertés (LDL) s'appuie de façon constante sur la Charte internationale des droits de l'Homme (aussi appelée Charte internationale), composée de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).
Ces instruments abordent la pauvreté sous l'angle du droit, bien que le terme « pauvreté » lui-même n'y soit pas utilisé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'Organisation des Nations Unies (CDESC) définit la pauvreté comme le fait de « ne pas avoir les moyens de base pour vivre dans la dignité ». Ainsi, les États qui ont adhéré à la Charte internationale, dont le Canada et le Québec, reconnaissent que l'être humain doit être libéré de la misère.
Pour atteindre cet objectif, les trois instruments qui constituent la Charte internationale des droits de l'Homme interdisent la discrimination fondée sur la fortune dans l'exercice des droits et libertés. En outre, la DUDH et le PIDESC ainsi que certains traités thématiques prévoient le droit à la sécurité sociale.
Droit à la sécurité sociale
Pour le CDESC, le droit à la sécurité sociale, qui implique l'accès à des prestations en espèce ou en nature, garantit entre autres une protection contre la perte de revenu, le coût démesuré de l'accès aux soins de santé ou l'insuffisance des prestations familiales. « [P]ar sa fonction redistributrice, le droit à la sécurité sociale joue un rôle important dans la réduction et l'atténuation de la pauvreté en évitant l'exclusion sociale et en favorisation l'insertion sociale. » En vertu du PIDESC, les États doivent en garantir la réalisation progressive, impliquant l'obligation d'agir au maximum des ressources disponibles afin de mettre en œuvre des politiques publiques prévenant et redressant les inégalités sociales et économiques. Les États ont par ailleurs l'obligation immédiate de s'assurer que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination.
Cela étant, la sécurité sociale n'est pas le seul droit que la pauvreté compromet : au contraire.
Tous les droits humains
De fait, la précarité économique dans laquelle un nombre de plus en plus important d'entre nous se retrouve affecte la capacité à réaliser l'ensemble des droits humains. Le CDESC se dit convaincu que « la pauvreté constitue un déni des droits de l'Homme ». Il indique :
« Dans la perspective de la Charte internationale des droits de l'homme, la pauvreté peut être définie comme étant la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé de manière durable ou chronique des ressources, des moyens, des choix, de la sécurité et du pouvoir nécessaire pour jouir d'un niveau de vie suffisant et d'autres droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. Tout en reconnaissant qu'il n'existe pas de définition universellement acceptée, le [CDESC] fait sienne cette conception multidimensionnelle de la pauvreté, qui reflète l'indivisibilité de tous les droits de l'homme. »
D'une part, la pauvreté entretient un lien étroit avec la discrimination : elle peut en être aussi bien la source que la conséquence. D'autre part, le rapport entre la pauvreté et les obstacles à l'exercice d'autres droits, comme les droits à l'alimentation saine, au logement décent, à l'éducation et à la santé, par exemple, est manifeste. La pauvreté peut ainsi être conçue à la fois comme une cause et une conséquence de la violation de multiples droits, par ailleurs interdépendants. Ainsi, la lutte à la pauvreté exigera la mise en œuvre de différentes mesures ayant une portée sur un ensemble de droits.
La Charte des droits et libertés de la personne
Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, largement inspirée du droit international, interdit la discrimination sur la base de la condition sociale dans l'exercice d'autres droits et libertés. Elle garantit également certains droits économiques et sociaux, comme le droit à l'instruction publique gratuite, le droit à des mesures financières et à des mesures sociales ainsi que le droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent la santé, la sécurité et l'intégrité physique. Ces droits ne bénéficient cependant pas de la préséance sur les autres dispositions législatives qui est accordée à certains droits et libertés garantis par la CDLP. Ceci a pour effet d'en limiter la portée juridique et, par conséquent, les recours judiciaires visant l'examen de législations ou de diverses mesures qui seraient porteuses de violations de ces droits. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui a notamment comme mandat d'assurer la promotion et le respect des principes contenus dans la CDLP, recommandait pourtant, dans son bilan des 25 ans de la Charte, que la préséance soit étendue à ces droits, ce qui offrirait une voie de lutte contre la pauvreté.
Fiscalité au potentiel discriminatoire
Par ailleurs, la LDL a récemment examiné la portée de diverses mesures fiscales visant à suppléer à l'insuffisance du revenu par des crédits d'impôt plutôt que par une bonification des prestations sociales ou des salaires. Examinées sous l'angle du droit à la protection sociale tel que reconnu dans le PIDESC, cette fiscalisation du social présente un lourd potentiel de discrimination et soulève notamment des enjeux de protection de la vie privée et d'accès à la justice.
Ainsi, le fait d'aborder la pauvreté en tenant compte du cadre normatif relatif aux droits humains contribuerait à garantir que des éléments essentiels de lutte à la pauvreté, comme le principe de non-discrimination, la participation de la population aux prises de décision ainsi que l'interdépendance et l'indivisibilité avec les autres droits, reçoivent toute l'attention qu'ils méritent. La lutte s'en trouverait renforcée et potentiellement plus efficace.
Marie Carpentier est avocate et membre de la Ligue des droits et libertés.
Illustration : Anne Archet

Le droit comme outil de contrôle des corps

L'égalité formelle est garantie par la loi à travers la protection des droits des personnes par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Toutefois, les recours juridiques au sujet des droits économiques et sociaux basés sur ces chartes ont été peu concluants au Canada.
On peut ainsi se questionner sur le manque d'égalité réelle au sein de notre système de justice. Ajoutons à cela que la Constitution canadienne, comparativement à celles de plusieurs autres États, ne garantit pas les droits économiques et sociaux. Ces constats soulèvent la nécessité de réfléchir à la réelle protection des droits fondamentaux que procure le système juridique aux groupes marginalisés, plus particulièrement aux citoyen·nes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Comment le droit contribue-t-il à créer des inégalités économiques et sociales, et quelles sont les pistes de solution qui se dressent devant nous en vue d'un avenir plus juste ?
Néolibéralisme et pauvreté
La néolibéralisation du système public de notre État de droit a affecté de manière démesurée les services juridiques, et ce, en se déresponsabilisant de l'un de ses principes fondamentaux : promouvoir les droits de toutes et tous. Force est de constater un appauvrissement important des institutions sociales par les gouvernements dans une logique d'assimilation de l'État au marché boursier, entraînant ainsi une privatisation majeure des services publics. Ce phénomène politique a eu pour conséquence immédiate d'exacerber les inégalités, ciblant majoritairement les individus vivant différents obstacles systémiques et économiques, ainsi que leur capacité à faire protéger leurs droits. Au sein du système de justice, le mouvement néolibéral a également eu comme conséquence « […] un recours accru aux processus juridiques associés au droit social pour sanctionner ou contrôler les personnes vivant en situation de pauvreté », notamment dans le contexte de la protection de la jeunesse, en matière de droit psychiatrique et en droit du logement [1]. Cette conjoncture entre judiciarisation et manque d'accès au système de justice est analysée par la professeure Emmanuelle Bernheim dans « Judiciarisation de la pauvreté et non-accès aux services juridiques : quand Kafka rencontre Goliath ». Effectivement, l'État néolibéral adopte des stratégies autoritaires menant ainsi à davantage de contrôle sur les corps.
L'une de ces stratégies autoritaires est l'hypersurveillance dont les communautés sous le seuil de la pauvreté sont victimes et qui contribue conjointement à leur surreprésentation sur les bancs des tribunaux. Cette optique punitive de l'État sur sa population n'apporte pas une meilleure protection aux personnes ni à leurs droits fondamentaux. Michel Foucault pose les bases de ce constat, résumé dans le livre Foucault à Montréal dirigé par Sylvain Lafleur. Il est possible de lier, entre autres, cette surveillance à l'augmentation du nombre de règlements municipaux portant sur les « incivilités » visant les populations en situation de précarité, dont les personnes en situation d'itinérance et les travailleuses du sexe. Le but de ces règlements n'est pas de prévenir le crime, mais plutôt de protéger le capital de certains membres de la population. Le phénomène de l'hypersurveillance est également amplement documenté en ce qui a trait aux droits criminel et pénal. La littérature montre que l'hypersurveillance mène à la persécution disproportionnée des femmes, des personnes noires, racisées et autochtones, des personnes en situation de pauvreté et de la communauté LGBTQIA2S+. Ainsi, nous pouvons conclure que le droit se présente comme un outil de contrôle des corps.
L'invisibilité législative
L'invisibilité des personnes pauvres dans la production du savoir juridique civiliste, un droit au service des propriétaires et du capital, est documenté dans une étude par les chercheur·euses Alexandra Bahary-Dionne et Marc-Antoine Picotte, publiée en 2023 [2]. Les auteur·es y réitèrent le caractère situé du droit, une notion juridique proposée par la chercheuse Sandra Harding qui refuse la prétention d'une quelconque neutralité dans la création du savoir juridique [3]. Dans l'article « Les pauvres et le droit civil : essai sur la production du savoir juridique », le constat des auteur·es par l'étude du vocabulaire utilisé dans le Code civil québécois est que malgré une surreprésentation des personnes en situation de précarité dans les différents domaines de droit social, les personnes en situation de pauvreté sont invisibles au niveau législatif civiliste. Les auteur·es arrivent au même constat au niveau doctrinal et jurisprudentiel civiliste.
L'aide juridique
En réaction au contrôle de l'État sur les corps des personnes issues de milieux défavorisés ainsi que leur invisibilité dans la législation, certaines pistes de solution s'offrent à nous : miser, notamment, sur l'aide juridique et sur le milieu communautaire. En suivant la logique néolibérale, l'aide juridique est l'un des services publics qui devait être réduit dès les années 90. Pourtant, selon la Coalition pour l'accès à l'aide juridique fondée en 2007 par plusieurs organismes communautaires, l'aide juridique est un droit fondamental, « une pierre d'assise de l'accès à la justice ». [4] Selon un mémoire déposé à la Commission des institutions par la Coalition en 2018, le financement adéquat du réseau est l'un des changements substantiels devant être apportés à la Loi sur l'aide juridique. La stagnation des seuils d'admissibilité est également dénoncée dès 2007. Comme le mentionne le mémoire déposé dans le cadre du projet de loi 168, bien que la situation se soit améliorée en 2016 par l'arrimage du seuil d'admissibilité au salaire minimum, la situation n'est pas sans faille : les dossiers à l'aide juridique n'augmentent pas malgré cette réforme. La Coalition exige également de revoir le bassin de services. Effectivement, plusieurs services juridiques ne sont plus couverts ou sont soumis à des critères discrétionnaires, notamment en ce qui concerne le non-consentement aux soins, de demande en garde en établissement et de droit du logement. Finalement, la Coalition demande que les procédures d'accès à l'aide juridique soient grandement simplifiées, puisque les documents requis et leur nature entraînent actuellement des délais trop importants menant à une privation de l'accès à la justice. Du point de vue des membres de la Coalition, tous les services publics comme les services de santé, les services de garde en centres de la petite enfance (CPE) et l'enseignement scolaire devraient être adéquatement financés par l'État. La privatisation devrait être au cœur de l'actualité, afin de démontrer ses nombreux effets néfastes pour le droit à l'égalité.
La reconnaissance du milieu communautaire
L'accessibilité au droit pour l'ensemble de la population est un élément central de l'accès à la justice. Cela prend forme à travers l'éducation juridique et la garantie d'un accès à une information juridique claire et vulgarisée, mais la complexification des notions juridiques compromet ces objectifs. Le milieu communautaire, un service juridique non traditionnel, participe activement à cette mission sociale, notamment par le biais de cliniques juridiques et par la création d'organismes d'accompagnement au sein des tribunaux. Il est du devoir du ministère de la Justice de financer ces organismes à la hauteur de leurs implications afin de répondre à son rôle : la promotion de la justice. De surcroît, au-delà du financement, il devrait être primordial pour le législateur de consulter davantage les organismes concernés et de prendre en considération leurs demandes lors de l'écriture de nouveaux projets de loi sur les enjeux liés à la précarité et à l'accès à la justice, afin de représenter de façon véritable les besoins de la population en la matière. Cela participerait également à lutter contre l'invisibilité des personnes en situation de pauvreté dans la loi, comme l'ont démontré les auteur·es Alexandra Bahary-Dionne et Marc-Antoine Picotte. Par exemple, dans le cadre du projet de loi 31 en matière de droit au logement, nous avons pu constater le manque de prise en considération flagrant de notre gouvernement à l'égard des organismes communautaires comme le RCLALQ, portant ainsi atteinte aux droits des locataires en matière de cession de bail.
Dans les deux mesures énumérées plus haut, il est question de la responsabilité de nos gouvernements. Toutefois, ceux-ci font preuve, historiquement, de peu d'intérêt pour un système de justice qui travaille pour tous et toutes. Si les droits fondamentaux des personnes en situation de vulnérabilité économique ne sont pas garantis par les chartes, que les comportements étatiques sont autoritaires à leur égard et qu'ils sont invisibles dans notre législation, sommes-nous devant un mouvement « punitif de la pauvreté ? » [5]
[1] Emmanuelle Bernheim, « Judiciarisation de la pauvreté et non-accès aux services juridiques : quand Kafka rencontre Goliath », Reflets : revue d'intervention sociale et communautaire, 25(1), 2029, p. 71.
[2] Alexandra Bahary-Dionne et Marc-Antoine Picotte, « Les pauvres et le droit civil : essai sur la production du savoir juridique », Communitas, vol 4, no 1, 2023. https://www.erudit.org/fr/revues/communitas/2023-v4-n1-communitas08993/1108313ar/
[3] Sandra HARDING, « Rethinking Standpoint Epistemology : What is “Strong Objectivity” ? », (1992) 36:3 The Centennial Review 437.
[4] Coalition pour l'accès à l'aide juridique, Mémoire de la Coalition pour l'accès à l'aide juridique présenté à la Commission des institutions, 2018, p. 3
[5] Loïc Wacquant, Punishing the Poor : The Neoliberal Government of Social Insecurity, Duke University Press, A John Hope Franklin Center Book, 2009, p. 408.
Clara Landry est membre de l'Association des juristes progressistes.
Illustration : Anne Archet

Travailler au rabais

Si l'on admet que nos sociétés se structurent fondamentalement autour de l'idée que le travail contribue à la dignité et à l'intégration sociale des personnes, ne faudrait-il pas que cette participation les prémunisse aussi de la pauvreté ?
Ce n'est pourtant pas le cas, en dépit d'un consensus social en vertu duquel travailler à temps plein devrait protéger de la pauvreté, comme le soulignait Barbara Ehrenreich en 2001 dans l'ouvrage phare L'Amérique pauvre [1]. Vingt ans plus tard, notre premier ministre a beau marteler « qu'il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un au Québec qui n'ait pas à manger », on « découvre » encore, année après année, l'ampleur du recours aux banques alimentaires. On se désole que celui-ci progresse régulièrement de manière fulgurante, et, qui plus est, on s'étonne à chaque fois qu'une proportion non négligeable de ces personnes travaillent, dont plusieurs à temps plein !
Si, dans nos pays du capitalisme avancé, on peut être pauvre en raison des aléas de la vie, de la vie chère, de la spéculation immobilière ou de l'endettement, c'est aussi parce que l'emploi ne paye pas assez et qu'il ne comporte aucune garantie d'heures ou de protections sociales. L'emploi faiblement rémunéré constitue une réalité non anecdotique des marchés du travail nord-américains. Par-delà les débats autour des différents « indicateurs de pauvreté » permettant de faire valoir une « diminution du taux de pauvreté au cours des dernières années [2] », force est de constater que la pauvreté reste saillante et que le fait que certain·es se hissent légèrement au-delà des seuils peut non seulement dissimuler l'emploi faiblement rémunéré, peu protégé, voire dangereux, mais aussi contribuer à le légitimer. De surcroît, et il est important de le souligner, la pauvreté en emploi touche surtout les personnes se situant aux croisements de multiples axes d'oppression comme le racisme systémique, les politiques migratoires, la persistance des divisions de genre, l'âgisme, la condition sociale et le capacitisme.
Dévalorisation et non-reconnaissance du travail du care
Il nous faut d'abord insister sur la dévalorisation et la non-reconnaissance historique du travail de « care ». Du fait de leur inscription dans la filiation du travail domestique, ces emplois « de femmes » – préposées aux bénéficiaires, éducatrices en services de garde, préposées à l'entretien ménager – persistent à être peu reconnus et sous rémunérés, en dépit de leur rôle essentiel. À la faible rémunération associée à ces emplois, ajoutons que ces milieux sont propices au travail gratuit, alors que le don de soi et la vocation viennent justifier d'en faire toujours plus avec moins. Le sous-financement du secteur communautaire et ses effets sur les travailleuses du milieu en constituent une illustration patente, alors que la tâche paraît sans fin.
Une femme migrante dont les diplômes acquis à l'étranger ne sont pas reconnus a de fortes chances de se voir refoulée vers ces emplois en raison de la discrimination et du racisme systémique. Bien que les femmes blanches et natives du Québec restent elles aussi cantonnées dans les secteurs d'emploi dits féminins, il faut donc reconnaître que celles qui sont issues de l'immigration ou qui sont racisées sont les premières à se voir relayées vers les segments les moins avantageux sur le plan de la rémunération et de la reconnaissance sociale.
Le « sale boulot » aux gens en marge
Dans l'univers des « sales boulots », nous ne pouvons pas non plus faire l'impasse sur tous ces postes que les « Québécois·es de souche » ne voudraient pas : ouvrier·ères d'entrepôt, attrapeur·euses de volaille, livreur·euses à la demande, cueilleur·euses de tomates ou de petits fruits, pour ne nommer que ceux-là. L'assignation des populations im/migrantes à ces emplois, plus qu'une coïncidence, trouve ses assises dans le racisme systémique et la reconfiguration des systèmes migratoires canadien et québécois. Les travailleur·euses du Sud global sont ainsi les bienvenu·es, dans la mesure où leur séjour est temporaire et qu'ielles occupent des emplois de faible qualité et pauvrement rémunérés.
Malgré la multiplication des abus et des dénonciations féroces et récurrentes concernant les « permis fermés », ces personnes sont généralement tenues dans des zones à l'écart de la citoyenneté – pensons aussi aux étudiant·es internationaux, aux réfugié·es, aux personnes sans statut –, avec pour effet de miner directement leur accès aux différents régimes de protection sociale et leur capacité à activer les droits du travail qui sont pourtant censés les protéger.
Constituant prétendument une opportunité financière, voire de survie pour ces travailleur·euses dont les conditions de vie dans leur pays d'origine ont été minées par les politiques d'ajustement structurel, les conflits armés, les accords de libre-échange et la crise climatique, ces emplois demeurent pourtant ce qu'ils sont : de sales boulots dont la population installée ne veut pas, qui impliquent bien souvent une protection aléatoire, des risques liés à la santé et à la sécurité, de longs déplacements non rémunérés, un salaire horaire extrêmement faible, des tâches et des horaires exténuants, etc. Et c'est ainsi que la délocalisation interne peut permettre aux populations locales de continuer à jouir de leur confort, mais surtout aux entreprises d'empocher leurs profits.
Banalisation des mauvaises conditions des emplois transitoires
Quant aux postes de commis en magasin, de préposé·es à la clientèle ou de services tous azimuts qui ne sont pas occupés par ces travailleur·euses migrant·es, d'aucuns banalisent l'exploitation et la précarité dans ces emplois faiblement rémunérés sous le prétexte qu'il s'agit de « jobs d'entrée » ou de sortie. L'idée selon laquelle ces emplois sont transitoires – pour les « jeunes » et les immigrant·es nouvellement arrivé·es, ou encore qu'ils sont accessoires pour les personnes retraitées qui y trouveraient un moyen de se maintenir actives – est en partie vraie.
Elle masque plus largement une tendance forte de l'emploi au cours des quarante dernières années : la banalisation de la précarité, la privatisation des protections sociales, la dégradation des services publics, le contournement des droits du travail par le recours aux agences de placement ou au faux statut d'indépendant·es, les allers-retours entre l'emploi faiblement rémunéré, le chômage et l'assistance, etc. Si la mobilité ascendante bénéficiant à certain·es d'entre elleux peut masquer ces dynamiques, elle ne devrait pas faire oublier que d'autres – nombreux et nombreuses – stagnent dans des positions et des conditions d'emploi précaires qui ne mènent nulle part. En omettant de se demander s'il est légitime que des emplois soient de si piètre qualité, on en vient en quelque sorte à avaliser ce qui semble être devenu un droit : celui des employeurs de disposer constamment d'un bassin suffisant de travailleurs et travailleuses pouvant être rémunéré·es au minimum.
Personne ne dira que la plupart de ces emplois ne sont pas essentiels. Mais alors, pourquoi la valeur sociale des tâches réalisées ne se reflète pas dans la qualité des conditions d'emploi ? À cet égard, rappelons que jusqu'à tout récemment, le taux de chômage de nos économies avancées se maintenait à un creux historiquement bas. Or, il nous paraît évident que ce succès repose sur une configuration du marché du travail marquée par une forte tolérance aux inégalités et au travail de faible qualité, dont l'État est en partie responsable. Il apparaît clair que celui-ci laisse faire, tout en contribuant activement à l'accroissement des vulnérabilités qui favorisent l'acceptation de conditions de travail et d'emploi dégradées. À l'encontre de l'illusion que chacun·e est « à sa place » en raison de son « mérite », il nous apparaît donc urgent de rappeler que les assignations actuelles à l'emploi, selon des rapports sociaux de genre, de race et de classe, sont plutôt le produit de mécanismes historiques et systémiques qui doivent impérativement être contestés, mais aussi, plus largement, qu'elles témoignent de l'abandon d'une des valeurs aussi rattachées au travail, à savoir qu'il devrait procurer à tous et à toutes les moyens d'une vie digne.
[1] L'autrice évoque notamment le fait que 94 % des Américain·e·s, républicains et démocrates confondu·e·s, estiment que « les personnes qui travaillent à temps plein devraient être en mesure de “ faire sortir ” leur famille de la pauvreté » (p. 119).
[2] Desrosiers, Éric « Le taux de pauvreté a fortement baissé au Québec au début de la pandémie », 7 mai 2022, Le Devoir.
Marie-Pierre Boucher, Laurence Hamel Roy et Yanick Noiseux sont membres du Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS).
Illustration : Anne Archet

Repères de pauvreté, repères de société

En 2002, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette loi nous engageait à « tendre vers un Québec sans pauvreté ». Où en sommes-nous ?
Depuis cette date, bon an, mal an, les moyens ont été là pour y arriver. Le revenu total après impôt dont ont disposé les ménages québécois pour vivre a été suffisant pour assurer en moyenne à chaque ménage environ deux fois le seuil de couverture des besoins de base qui lui était attribuable selon sa taille et sa localité d'après la mesure du panier de consommation (MPC) qui sert au suivi de la loi. Pour le dire autrement, si la capacité de couvrir ses besoins de base équivaut à un indice panier de 1, soit la possibilité d'acquérir un panier de consommation selon la MPC, notre capacité collective d'aisance a tourné autour de deux paniers, soit un indice panier de 2.
Est-ce à dire qu'il n'y avait pas de pauvreté au Québec ? Certainement pas. Pour donner un ordre de grandeur, pendant cette période, le dixième le plus pauvre des ménages, surtout composé de personnes seules, a disposé en moyenne de l'équivalent de plus ou moins un demi-panier (un peu plus en 2020 en raison de la Prestation canadienne d'urgence, qui a augmenté temporairement les ressources d'une partie de ce décile).
Autrement dit, ce dixième le plus pauvre des ménages n'a eu chroniquement accès qu'à la moitié du nécessaire pour couvrir ses besoins de base, avec les impacts connus sur la santé et l'espérance de vie de la partie qui manquait. Pendant la même période, le dixième le plus riche des ménages a vu sa part augmenter d'environ quatre paniers à près de quatre paniers et demi en moyenne. De fait, les données montrent par l'absurde que si la volonté politique avait été là, avec des politiques sociales et fiscales à l'avenant, il aurait été constamment possible dans les deux dernières décennies de résoudre durablement le déficit de couverture des besoins de base au Québec sans perte de niveau de vie pour le reste de la population.
Il aurait suffi d'appliquer un principe d'amélioration prioritaire des revenus du cinquième le plus pauvre de la population sur ceux du cinquième le plus riche, comme le préconisait la proposition de loi citoyenne pour un Québec sans pauvreté qui avait précédé l'adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. À défaut d'un tel principe dans la loi adoptée, et de règles pour l'appliquer, la croissance du niveau de vie est allée en haut de l'échelle des revenus plutôt qu'en bas.
Voilà pourquoi il importe de considérer l'ensemble de l'échelle des revenus quand on se préoccupe de mesurer la pauvreté, plutôt que de se limiter à ceux et celles qui se trouvent sous les seuils – à tout le moins, si on veut avancer en direction d'une société sans pauvreté comme le veut la loi, dans une perspective de bien-vivre mieux partagé.
Si la pauvreté n'est pas qu'économique, elle est nécessairement économique et tributaire des règles du jeu économique et de la vie qu'on veut vivre ensemble, ne serait-ce que parce que le revenu dont on dispose détermine le niveau de vie qu'on peut avoir dans la société telle qu'elle est.
La MPC, qui est compilée et révisée périodiquement par Statistique Canada depuis 2002, sert au Québec depuis 2009 au suivi des situations de pauvreté sous l'angle de la couverture des besoins de base. Pourtant, comme l'a expliqué alors le Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion (CÉPE) en référant à la définition de la pauvreté donnée dans la loi et à une définition fondée sur la capacité d'exercer l'ensemble de ses droits reconnus, le panier de biens et services (qui prend en compte l'alimentation, les vêtements, le logement, le transport et d'autres besoins) qui en détermine les seuils ne remplit pas pour autant l'ensemble des conditions nécessaires à une vie exempte de pauvreté.
Si on utilise la MPC comme repère et qu'on situe l'ensemble de la population par rapport à ce repère, on aperçoit alors tout le continuum de niveaux de vie qui constitue notre réalité comme société. Où situer la démarcation entre la pauvreté et son absence dans ce continuum ? La question reste ouverte.
Dans ses comparaisons internationales, le Québec utilise comme mesure de faible revenu (MFR) deux pourcentages du revenu médian, soit 50 % (MFR-50) et 60 % (MFR-60). Utilisée dans plusieurs pays européens, la MFR-60 sert de critère pour la cible donnée dans la loi, soit de rejoindre les rangs des nations industrialisées où il y a le moins de personnes pauvres.
De son côté, l'IRIS publie depuis 2015 un indicateur de revenu viable fondé sur un panier de biens et services offrant plus de latitude que celui de la MPC tout en lui restant comparable. Jusqu'à maintenant, il s'avère situé à environ 1,3 fois le seuil de la MPC, du moins pour une personne seule à Montréal. Si la MPC suppose généralement un revenu après impôt un peu en dessous de la MFR-50 au Québec, le revenu viable avoisine le seuil de la MFR-60 selon les localités étudiées.
Comme le montre le tableau 1, ces quatre mesures se complètent pour donner une assez bonne idée d'un revenu après impôt nécessaire à la transition entre la pauvreté et son absence pour une personne seule à Montréal en 2020.
Utilisées conjointement avec l'indice panier, ces données évitent de se limiter aux seules populations sous les seuils et de les y cantonner par le fait même dans les décisions publiques les concernant. Leur croisement dans un tableau de bord dont on peut suivre l'évolution au fil des ans impose un regard et une action sur l'ensemble du pacte social et fiscal.
On voit qu'en 2020, 55,1 % de la population pouvait être située dans la classe moyenne selon un critère courant (un revenu entre 75 % et 150 % du revenu disponible médian, alors de 48 200 $ pour une personne seule et de deux fois plus pour une famille de quatre). Sous le seuil d'entrée à 75 % du revenu médian (autour de 1,5 panier), 26,2 % de la population était à plus faible revenu, avec des degrés de gravité différents :
Les ménages disposant de l'équivalent de 2 ou 3 paniers étaient en plein dans la classe moyenne ainsi définie. Environ 18,7 % de la population se trouvait au-delà de ce critère, même si plusieurs pouvaient se croire en deçà. À 4 paniers, on se trouvait même dans le décile le plus riche des ménages.
- Faible revenu autour ou au-delà du revenu viable et de la MFR-60 comme critères de sortie de la pauvreté (60 % – 75 % du revenu médian) (12 %) ;
- Entre la couverture des besoins de base et la sortie de la pauvreté (50 % – 60 % du revenu médian) (6,5 %) ;
- Autour ou en deçà de la couverture des besoins de base (moins de 50 % du revenu médian) (7,7 %, dont 4,8 % [1] sous le seuil de la MPC avec moins d'un panier pour vivre).
Les ménages disposant de l'équivalent de 2 ou 3 paniers étaient en plein dans la classe moyenne ainsi définie. Environ 18,7 % de la population se trouvait au-delà de ce critère, même si plusieurs pouvaient se croire en deçà. À 4 paniers, on se trouvait même dans le décile le plus riche des ménages.
Le suivi sur plusieurs années de ce tableau de bord s'avère également instructif. Il montre par exemple l'impact positif, quoique temporaire, de la PCU et des autres mesures d'aide à l'emploi en temps de COVID sur les revenus disponibles en 2020. Comparativement à 2019 et contrairement à la tendance des années précédentes, l'amélioration du revenu disponible est allée cette fois dans le bas et le milieu de la courbe (tassement vers la droite, donc vers de meilleurs revenus en dollars constants) sans perte de niveau de vie en haut de celle-ci en dollars constants.
Des questions à se poser
En disposant de l'ensemble de cette distribution et de son évolution dans le temps, il devient plus facile de poser certaines questions de société et de pacte social et fiscal.
Il y a par exemple cette question incontournable : comment justifier, devant un tel schéma, la règle qui plafonne à un demi-panier (en fait 55,1 % du seuil de la MPC, lequel devrait servir de plancher) la garantie de revenu d'une personne sans emploi à l'aide sociale de base ?
Et cette question existentielle : quel écart en plus ou en moins de deux paniers (la moyenne pour l'ensemble de la population) est-il acceptable de viser vers une société sans pauvreté où le bien-vivre est mieux partagé ?
Vient alors une autre question : devrait-il y avoir un plafond ? La question se pose d'autant plus que plus l'indice panier est élevé, plus le revenu en cause hypothèque fortement le budget carbone collectif.
Arrive finalement cette inévitable question socio-environnementale : vers quel indice panier écologiquement soutenable devrions-nous tendre en tenant compte de nos formes de production et de consommation, actuelles et à faire évoluer ?
Aborder l'ensemble des ménages à partir des seuils qui servent de repères au suivi de la pauvreté pour pouvoir ensuite se situer collectivement dans l'échelle des revenus est un équipement à se donner pour en venir, et ça presse, à répondre à ces questions et à reconsidérer notre rapport au revenu et à la richesse en conséquence.
[1] Comparativement à 8,9 % en 2019 sans les mesures de soutien liées à la COVID.
Vivian Labrie est chercheure associée à l'IRIS.
Illustration : Anne Archet
POUR ALLER PLUS LOIN
En continuité avec cette conclusion, et pour des références vers les concepts et les données présentés à grands traits dans cet article, voir le mémoire présenté par l'IRIS au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre des consultations pour la quatrième mouture du plan d'action requis par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale : IRIS, Trois ingrédients pour un Québec sans pauvreté et résilient face à l'urgence climatique, 2023.
https://iris-recherche.qc.ca/publications/memoire_lutte_pauvrete/

Une personne sur dix

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe 36 organisations nationales québécoises, populaires, communautaires, syndicales, religieuses, féministes, étudiantes, coopératives ainsi que des collectifs régionaux dans la plupart des régions du Québec. Depuis ses débuts, le Collectif travaille en étroite association avec les personnes en situation de pauvreté. Propos recueillis par Yannick Delbecque.
À bâbord ! : Pourquoi le Collectif a-t-il été formé ?
Virginie Larivière : Le Collectif s'appelait à son origine le Collectif pour une loi visant l'élimination de la pauvreté. Il a été créé à la fin des années 1990 par des groupes de Québec réunis autour d'une proposition de réforme de l'assistance sociale par le gouvernement de l'époque. Ces groupes ont su aussi mobiliser plusieurs personnes en situation de pauvreté concernées par cette réforme, notamment des personnes âgées ou assistées sociales. Ce mouvement a vraiment pris beaucoup d'ampleur et l'idée de revendiquer une loi visant l'élimination de la pauvreté est apparue comme étant mobilisatrice. Les groupes ont rédigé une proposition citoyenne de loi visant l'élimination de la pauvreté, laquelle a été présentée à l'Assemblée nationale, puis largement amendée par les parlementaires pour finalement être adoptée à l'unanimité en 2002.
Après l'adoption de la loi, le collectif a été renommé Collectif pour Québec sans pauvreté. Nous agissons depuis comme chien de garde au sujet des enjeux liés à la pauvreté, des mesures proposées, des budgets. Le Collectif a maintenant trois grands champs d'action. Premièrement, nous faisons de la représentation politique. On utilise notre influence pour faire adopter de meilleures politiques publiques en matière de lutte contre la pauvreté. On interpelle aussi le gouvernement et les partis d'opposition pour mettre de la pression. Le deuxième volet de notre action est ce que nous appelons « les pratiques avec ». Il s'agit du principe selon lequel on doit mener cette lutte avec les personnes en situation de pauvreté concernées par l'objet de ces luttes. Enfin, le troisième volet de notre action est celui de la recherche. Nous avons développé des projets de recherche-action participative et nous participons à des projets de recherche universitaire.
ÀB ! : Qu'est-ce qui explique qu'il y a de la pauvreté dans notre société ?
V. L. : Parce qu'on tolère le fait que des gens ne couvrent pas leurs besoins de base. Parce que nous sommes dans un système capitaliste qui crée de la pauvreté en générant des gagnant·es et des perdant·es. Les perdant·es, ce sont les personnes en situation de pauvreté. Historiquement, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui sont exploité·es pour alimenter le jeu du capitalisme. Le capitalisme fait en sorte que les possédants, ceux qui réussissent à se hisser au sommet, puissent s'approprier les profits. Les possédants peuvent maintenant gagner cent fois le salaire de leurs ouvrières et ouvriers les moins payé·es. C'est ce qui fait apparaître les inégalités de toute nature, qu'elles soient économiques, sociales, de santé et culturelles.
Dans les dernières décennies, ces écarts se sont agrandis de façon absolument indécente sans qu'on arrive à y trouver de réponse politique. Nous sommes paralysé·es devant le grand jeu du capital et du mythe du capitaliste qui réussit grâce à son seul travail et à son génie. Il y a encore des gens qui saluent ces « réussites » de personnes qui seraient sorties de nulle part et qui réussiraient seules à monter au sommet. On ne calcule cependant jamais le coût collectif de ces succès individuels. On sait que personne n'arriverait seul·e à monter si haut dans notre monde compétitif mondialisé. Il y a nécessairement eu tout un échafaudage d'appuis, de relations, de connaissances, de moyens financiers, moyens auxquels la grande majorité du monde n'a pas accès.
On accepte l'existence de la pauvreté comme une fatalité. Il y aurait toujours eu des pauvres et des gagnants et la seule chose à faire serait de tirer son épingle du jeu : faire les bons choix, réussir à l'école, rester en santé. Comme si le fait de se retrouver en situation de pauvreté ou de devenir riche était la conséquence de choix individuels.
ÀB ! : Comment éradiquer la pauvreté ?
V. L. : Il faut beaucoup de volonté politique ! Évidemment, éliminer la pauvreté, c'est une question de revenus. Les gens sont pauvres parce qu'ils manquent de revenus. Ils n'ont pas assez d'argent pour s'offrir la couverture des besoins de base pour sortir de la pauvreté. L'augmentation des revenus figure bien sûr dans nos revendications.
Je pense cependant que la clé de la lutte à la pauvreté est de défaire les importants préjugés à l'égard des personnes en situation de pauvreté et à l'égard du système générant de la pauvreté. On a tellement de préjugés que ça nous empêche de rehausser le revenu des plus pauvres, de nous attaquer véritablement aux inégalités socioéconomiques. S'il y avait moins de préjugés, si le portrait global était mieux compris, il serait beaucoup plus facile d'éliminer la pauvreté. Par exemple, il y a encore beaucoup de préjugés à l'égard des personnes assistées sociales. Pour comprendre comment cela est nuisible aux luttes que nous menons, on peut se rappeler comment en 2012 les préjugés envers le mouvement étudiant ont pu lui nuire. Iels seraient des « enfants gâté·es pourris » qui buvaient de la sangria sur des terrasses avec des cellulaires. On dépeint beaucoup les personnes en situation de pauvreté comme étant profiteuses, paresseuses et en manque de volonté. Beaucoup au Québec ont un avis assez campé au sujet de l'assistance sociale, mais très peu connaissent véritablement ce système et son fonctionnement. Ses conditions d'accès extrêmement contraignantes sont méconnues : qui en est exclu·e, quelles sont les conditions pour y avoir accès, quelles sont les conditions pour le conserver, etc. Il est urgent de défaire ces préjugés et la méconnaissance qu'on peut avoir envers les personnes en situation de pauvreté.
Ensuite, il faut la volonté politique. Depuis 20 ans, les gouvernements de tout ordre clientélisent la population. On peut mettre de l'avant des mesures de lutte contre la pauvreté, de rehaussement du revenu, mais visant certaines catégories de personnes, ce qui clientélise ces mesures. Par exemple, des mesures pour les personnes aînées, pour les femmes seules de 60 ans et plus, etc. Depuis quelques années, les deux paliers de gouvernements ont mis en place des mesures pour les personnes aînées, mais de 70 ans et plus, alors que depuis longtemps, on considère comme aînées les personnes à partir de 65 ans, dès leur retraite. Cela coûte moins cher, mais cela clientélise. Ce ne sont plus des mesures universelles. Il arrive la même chose au système d'assistance sociale. On catégorise les gens en fonction de leur capacité à rejoindre le marché du travail avec toutes sortes de biais dans la manière de déterminer ces catégories. Dans les dernières années, on a aussi beaucoup mis de l'avant des mesures pour les familles. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est encore une approche clientéliste qui, cette fois-ci, a comme effet d'exclure les personnes seules et les couples sans enfants. Ces personnes sont les plus oubliées en matière de lutte contre la pauvreté et ne sont l'objet d'aucune mesure particulière.
Quand on n'a pas la volonté de lutter contre la pauvreté de manière large, on tombe dans ces petites catégories. C'est ce qui fait que malgré l'adoption de la loi visant l'élimination de la pauvreté il y a 20 ans, malgré le fait que le préambule de cette loi donnait 10 ans au Québec pour devenir une des nations qui compte le moins de personnes pauvres, nous en sommes à peu près au même point. Aujourd'hui, une personne sur dix au Québec ne couvre pas ses besoins de base.
Virginie Larivière est porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté.
Illustration : Anne Archet














