Revue À bâbord !
Publication indépendante paraissant quatre fois par année, la revue À bâbord ! est éditée au Québec par des militant·e·s, des journalistes indépendant·e·s, des professeur·e·s, des étudiant·e·s, des travailleurs et des travailleuses, des rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l’organisation de notre société, dans les rapports entre les hommes et les femmes et dans nos liens avec la nature.
À bâbord ! a pour mandat d’informer, de formuler des analyses et des critiques sociales et d’offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire. À bâbord ! veut appuyer les efforts de ceux et celles qui traquent la bêtise, dénoncent les injustices et organisent la rébellion.

Forums citoyens sur l’éducation : il faut travailler à changer le rapport de force

En 2023, l'initiative Parlons éducation réunissait près de 1 700 personnes dans 20 forums et plus de 50 ateliers jeunesse à travers tout le Québec pour discuter des défis du système scolaire québécois. Bilan et perspectives avec Suzanne-G. Chartrand, porte-parole du collectif Debout pour l'école. Propos recueillis par Wilfried Cordeau.
À bâbord ! : Les forums Parlons éducation ont permis une vaste mobilisation citoyenne. Pourquoi cet exercice était-il nécessaire ?
Suzanne-G. Chartrand : Depuis la première phase des États généraux sur l'éducation en 1995, jamais la population n'a été invitée à discuter et à se prononcer sur la vision qui doit guider le développement de l'école, sur ce qui fonctionne ou non, sur le type d'institution qu'elle souhaite pour l'avenir. Pour les organismes citoyens à l'origine des forums [1], c'était extrêmement important de faire ce travail démocratique. Et ça a fonctionné. S'il pouvait s'exprimer des sensibilités différentes au cours des débats, il n'y avait pas vraiment de grandes divergences sur le plan des orientations politiques. Beaucoup de consensus ont émergé, et le diagnostic est vraiment inquiétant et sévère. Il révèle à quel point notre société est à côté de la plaque sur à peu près toute la ligne. Partout, les gens ont exprimé l'urgence d'agir. Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ces constats, les participant·es sortaient des forums avec le sourire, avec un espoir et une volonté de faire bouger les choses.
ÀB ! : En décembre dernier, une synthèse de ces échanges a été rendue publique. Quels grands défis s'en dégagent pour l'école québécoise ?
S.-G. C. : La synthèse résume en 40 pages plus de 1 000 pages de notes prises dans des dizaines d'ateliers : un travail colossal ! Sur les cinq grands thèmes [2] abordés, beaucoup de pistes de réflexion se dégagent. D'abord, il est clair que la mission de l'école est complètement dévoyée. Après les États généraux, ledit « renouveau pédagogique » mandate l'école d'instruire, de socialiser et de qualifier. Cette trilogie-là est encore discutable, mais très rapidement elle s'efface au profit d'un nouveau mantra : la réussite éducative, voire la réussite pour elle-même. On ne vise plus la culture, le développement ou l'émancipation des êtres humains, mais leur performance, dans une compétition effrénée. La raison d'être de l'apprentissage finit par se réduire à ce qui est utile pour la diplomation. Cette vision-là, conforme à la nouvelle gestion publique et à sa gestion axée sur les résultats a complètement perverti la mission de l'école dans les 30 dernières années. Or, dans les forums, les gens ont plutôt affirmé que l'école, en misant sur des connaissances et des compétences, doit développer chez les jeunes une capacité d'émancipation d'agir comme citoyens et citoyennes averti·es et critiques, dans la perspective d'une société qui soit la plus égalitaire et juste possible. Et cela passe par un meilleur développement des compétences langagières, par un renforcement culturel des programmes, par un décloisonnement des matières, mais aussi par l'ouverture de l'école à son village, à son quartier, aux artistes, aux communautés avoisinantes, aux gens de métier, aux membres des communautés ethnoculturelles différentes, nouveaux arrivants ou pas, etc.
Ensuite, la question de ce qu'on appelle « l'école à trois vitesses » a été largement discutée. Unanimement, on a déploré que notre modèle éducatif soit en train de se fracturer. L'école privée, subventionnée à hauteur de 70 %, et les programmes sélectifs au public (souvent très onéreux) fonctionnent grâce à la capacité de payer des parents et aux notes des élèves : ils sont à la même vitesse. Il y a aussi au public des programmes moins sélectifs. Puis, il y a les classes dites régulières composées d'élèves moins performant·es, moins fortuné·es, nouvellement arrivé·es au Québec sans connaître le français ou qui font face à toutes sortes de difficultés. Cette ségrégation est un problème qu'on ne peut plus ignorer et auquel il faut absolument mettre un terme.
ÀB ! : Soixante ans après le rapport Parent, la question de l'égalité des chances demeure donc entière.
S.-G. C. : Absolument. Les gens ont aussi déploré qu'il y ait, encore en 2024, des populations totalement exclues du projet d'égalité des chances. Des jeunes et des adultes qui sont dans les écoles et les centres, mais qu'on ne reconnaît pas, et dont les besoins sont complètement invisibilisés. Par exemple, 50 % des enfants inuit·es et issu·es des Premières Nations sont scolarisé·es dans le système scolaire québécois et la majorité d'entre elleux dans de grandes villes comme Montréal. Est-ce qu'on leur donne une place ? Est-ce qu'on tient compte de leurs besoins culturels ? Les élèves issu·es de l'immigration, on les francise certes, mais quel accueil culturel ou social leur offre-t-on ? Quel soutien offre-t-on également aux jeunes qui ont eu des difficultés durant leur parcours du secondaire et qui peinent à décrocher leur diplôme ? Quelle valeur sociale accorde-t-on à la formation professionnelle pour des jeunes qui souhaitent apprendre un métier ? Donc, cela fait pas mal de laissé·es-pour-compte au sein d'un système qui se dit démocratique et qui peine à offrir à ces jeunes des perspectives épanouissantes.
ÀB ! : Les personnels scolaires disposent-ils de tous les outils nécessaires pour relever ces défis ?
S.-G. C. : Tout le monde convient qu'il est temps de reconnaître et de revaloriser le travail fondamental de l'ensemble des personnels scolaires : du personnel enseignant, des gens des services de garde, du personnel de soutien, des technicien·nes, des professionnel·les, des membres de direction d'établissements. Tout ce monde est à la course et beaucoup sentent qu'ils et elles n'arrivent pas à faire leur travail aussi bien qu'ils et elles le voudraient. Plusieurs finissent par se sentir submergé·es, par tomber malades ou abandonnent le navire. Il y a encore énormément de gens très investis dans ces métiers-là, mais c'est aussi devenu une source de frustrations, de fatigue et de souffrance importantes. On ne peut plus se permettre de démobiliser celles et ceux qui font l'école. Et il faut cesser de prétexter de la pénurie de main-d'œuvre pour ne rien faire.
Ensuite, les forums ont souligné l'absence de démocratie dans notre système scolaire. L'abolition des commissions scolaires et des élections scolaires, la création de centres de services scolaires (CSS), dirigés par des conseils d'administration opaques, le pouvoir du gouvernement de nommer les directions de CSS et d'infirmer leurs décisions ont été largement décriés. Nombre de personnes engagées dans les nouvelles instances des CSS ont dénoncé l'absence de temps pour débattre et ont exprimé le sentiment que tout est décidé d'avance et qu'elles sont bâillonnées. Quant aux jeunes, leur place est très limitée dans ces instances et dans les décisions qui touchent leurs apprentissages. Donc, on a affaire à une institution déconnectée de son personnel, de ses élèves, de sa communauté, et tout entière au service d'une machine bureaucratique et d'une vision instrumentale et productiviste.
ÀB ! : C'est un portrait plutôt riche et percutant des défis qu'il nous reste à relever comme société. Quelle doit être la suite ?
S.-G. C. : Une chose est claire, ce gouvernement se montre même hostile à discuter avec les principaux intéressés, à proposer une réflexion collective, à consulter la population sur quoi que ce soit. Sa vision est profondément opposée à celle exprimée dans les forums. Pour que les choses changent, il faut travailler à changer le rapport de force entre la population, la société civile et le gouvernement. C'est pourquoi Debout pour l'école lance une nouvelle consultation partout au Québec, pour que les gens identifient quels seraient les chantiers prioritaires à mettre à l'agenda public pour les prochaines années. À partir de là, nous souhaitons inviter la société civile à se regrouper autour de ce qui émergerait comme un Livre blanc citoyen, voire un rendez-vous national. L'heure est venue de créer un levier de mobilisation collective qui montrerait qu'une partie importante de la population réclame des changements structurels et durables pour le système d'éducation au Québec.
[1] L'initiative Parlons éducation découle des efforts concertés des organismes citoyens Debout pour l'école, École ensemble, Je protège mon école publique et le Mouvement pour une école moderne et ouverte.
[2] Soit : la mission de l'école ; l'école à trois vitesses ; l'inclusion de toutes les populations scolaires ; la valorisation des personnels scolaires ; la démocratie scolaire.
Suzanne-G. Chartrand est du collectif Debout pour l'école.
Photo : Forums Citoyens Parlons Éducation de 2023 (Debout pour l'école).

L’innovation au service des locaux communautaires

Alors qu'on salue l'importance des organismes communautaires pour le maintien du filet social, la crise d'accès à des locaux ajoute un fardeau difficile à porter pour un réseau déjà précaire. Les intervenant·es et des directions d'organismes se demandent comment poursuivre leur mission auprès de la population quand leur propre avenir est incertain. Pour mieux surmonter cet obstacle, plusieurs regroupements communautaires et acteurs de l'économie sociale se retroussent les manches et tentent d'explorer le champ des possibles.
La pérennité des groupes communautaires est fragilisée par la difficulté de trouver des espaces convenant à leur cadre financier ou qui sont accessibles à la population desservie. Les programmes pour financer l'hébergement des organismes restent insuffisants. Ces derniers doivent donc emprunter des sentiers non balisés pour trouver des solutions à leurs besoins. Dans le sillon de l'article « Le tissu social des quartiers menacés : Protéger les locaux communautaires montréalais » paru dans le numéro 96 d'À Bâbord !, nous souhaitons ici souligner quelques initiatives intéressantes et encore peu explorées.
Une fiducie foncière en émergence dans Ahuntsic
L'aménagement de tout un secteur du quartier Ahuntsic à Montréal vise le développement de 800 à 1000 unités d'habitation, un pôle alimentaire, des commerces, des équipements publics et un centre communautaire. Il s'agit du lecteur Louvain Est, une ancienne cour de voirie qui appartient à la Ville. Le projet est porté par l'arrondissement et la Table de quartier Solidarité Ahuntsic. En plus d'être un exemple de planification qui associe municipalité et concertation locale, c'est un modèle de fiducie d'utilité sociale qui a été choisi pour servir l'intérêt social et collectif souhaité.
La fiducie d'utilité sociale (FUS) est une structure juridique de propriété et de gestion du patrimoine. Ici, c'est la Société de développement de l'Écoquartier Louvain qui est désormais le développeur du site et le gestionnaire de la fiducie. Cet OBNL collabore avec des comités de travail animés par la Table de quartier afin de déterminer les usages et les aménagements qui permettent de soutenir les orientations principales du projet, soit l'accès à l'alimentation, la transition socioécologique, l'habitation et la mobilité durable. Parmi les stratégies pour accomplir cette mission, la FUS favorise le développement de biens immobiliers hors marché grâce à la création d'un fonds local de développement. Tout promoteur communautaire ou privé qui acquiert un lot devra verser une rente annuelle à la fiducie et devra se conformer aux énoncés de la mission. Le modèle d'affaires est ainsi alimenté par les revenus dégagés grâce aux développements immobiliers. Cependant, certains freins ralentissent le projet. Par exemple, le développement des usages mixtes demeure compliqué à réaliser au sein d'une même entité. Le contexte financier et la réglementation contraignante ralentissent aussi la mise en œuvre du chantier de centre communautaire. C'est donc un dossier à suivre.
Une entente d'usufruit pour des taxes foncières allégées
Le modèle d'usufruit s'est d'abord fait connaître dans l'arrondissement montréalais du Plateau-Mont-Royal quand la machine municipale s'est mise au service de la protection et du développement d'espaces pour les artistes. En effet, en plein boom résidentiel des années 2010, les anciens lofts industriels du Mile-End furent un à un rénovés puis convertis en espaces commerciaux. Les conditions locatives n'étaient plus accueillantes pour de nombreux artistes, alors évincé·es. Les citoyen·nes, appuyé·es par l'arrondissement, se sont mobilisé·es pour freiner l'exode de ces artistes à la recherche d'ateliers, protéger leurs pôles d'emplois et préserver cette vitalité culturelle. C'est par l'entente d'usufruit que cela a été possible. Comme la plupart des autres bâtiments compris dans ce secteur, les anciens bâtiments industriels auraient probablement accueilli des entreprises du numérique bien plus en moyens de payer les nouveaux loyers. Mais dans le cas où une communauté souhaite maintenir ou développer des activités à but non lucratif dans certains bâtiments privés et ralentir la surenchère des loyers non résidentiels locatifs, l'entente d'usufruit se révèle être un outil juridique efficace.
L'ouverture d'un centre communautaire dans le quartier Centre-Sud, au 2240 rue Fullum à Montréal, en est un autre exemple. Cet immeuble de 25 000 pieds carrés qui appartenait à la communauté des frères du Sacré-Cœur et hébergeait quelques organismes communautaires avait été racheté par des intérêts privés. Grâce à l'intervention des élu·es municipaux qui en ont protégé la vocation et avec l'appui du milieu, les organismes du quartier ont négocié une convention d'usufruit avec les nouveaux propriétaires. Depuis septembre 2023, après un an de pourparlers, la totalité de l'immeuble est désormais à la disposition d'organismes.
Les avantages de la convention d'usufruit sont doubles. Contrairement aux baux commerciaux dont les termes sont généralement de 5 ans, avec des variations de prix impossibles à prévoir d'un terme à un autre, les usufruits sont habituellement de plus longue durée. Dans le cas du centre communautaire de la rue Fullum, il s'agit d'un terme de 15 ans renouvelable. En plus de permettre une stabilité matérielle aux équipes de travail et à la population desservie, la plus longue durée du terme permet d'anticiper et de contrôler l'augmentation des coûts du projet sur le temps long. L'usufruit permet aussi aux organismes hébergés d'être admissibles à des exemptions de taxes foncières. Sans ce contrat qui reconnaît certains droits de propriété à l'usufruitier, les organismes situés dans tout projet immobilier dont le propriétaire est privé ne sont pas admissibles à cet allègement fiscal. L'exemption représente un rabais d'environ 80 % de la facture initiale pour les organismes montréalais admissibles.
La négociation pour s'entendre sur les termes de l'usufruit et la démarche d'exemption comprennent des particularités juridiques pour lesquelles l'accompagnement d'avocat·es en droit immobilier est indispensable. La facture salée qui en découle reste un obstacle important. En plus d'être onéreuse, la phase de préparation du projet demande un engagement intense de la part des organismes. Par chance, les organismes occupants, la Table de quartier et des ressources humaines du CIUSSS ont appuyé la démarche. Cela a permis de réunir les bras et les têtes nécessaires pour animer les étapes de développement. La pérennité de ce projet va dépendre de l'implication des membres qui seront appelé·es à être vigilant·es pour s'assurer que les décisions restent cohérentes avec la mission d'offrir des loyers abordables tout en effectuant les réparations et l'entretien requis sur ce bâtiment centenaire. Les réflexes de gestion collective demandent encore à être aiguisés.
Tout comme les ateliers d'artistes du Mile-End, les activités communautaires sont largement menacées quand l'offre de locaux non résidentiels devient rare. L'usufruit est un outil juridique intéressant qui permet aux organismes de réduire certaines charges fiscales et apporte une stabilité que les baux commerciaux privés ne procurent pas. Le maintien des activités à but non lucratif doit également être porté par les arrondissements, ces derniers pouvant modifier ou protéger le zonage, c'est-à-dire les fonctions attribuées à tout bâtiment sur son territoire. Leur rôle a été déterminant pour le maintien des activités communautaires pour le bâtiment du Centre-Sud ainsi que les deux pôles artistiques du Mile-End.
La pierre angulaire
Les modèles de la fiducie d'utilité sociale ou de l'entente d'usufruit sont intéressants et méritent d'être davantage déployés. Toutefois, les mécanismes de mise en œuvre que sont les programmes de financement et l'accompagnement technique et stratégique doivent être au rendez-vous. Les investissements en temps et en argent de la part d'organismes communautaires engagés dans ce genre de projet sont exponentiels. Les risques inhérents à tout projet immobilier sont également difficiles à évaluer pour des organismes qui tentent simplement de veiller à une certaine stabilité à leur mission. Par ailleurs, ces situations génèrent une pression sur des équipes déjà fragiles en raison de l'appauvrissement de la population et des difficultés de rétention du personnel. Les organismes communautaires peuvent bien innover, créer, sortir des sentiers battus ou mutualiser, mais sans les ressources adéquates, leurs efforts sont vains.
Gessica Gropp est chargée de projet pour les locaux communautaires à la Coalition montréalaise des Tables de quartier.
Photo :Centre communautaire de la rue Fullum à Montréal (Audrée T. Lafontaine).
Note. Le terme usufruit réfère au droit de jouissance d'un bien dont une personne détient la propriété par une autre personne (morale ou physique). L'usufruitier s'engage à conserver l'intégrité du bien tout en l'utilisant (usus) et en profitant des fruits (fructus). Une entente d'usufruit désigne un arrangement juridique notarié qui peut concerner un bien immobilier, une entreprise ou un portefeuille d'investissements.

Pour l’autogestion au travail !

La hiérarchie et les relations autoritaires sont trop souvent considérées comme l'ADN de l'univers du marché du travail et, à notre avis, elles sont trop peu questionnées. Elles apparaissent comme l'ordre naturel des choses.
Or, les nombreuses expériences d'organisations horizontales qui ont émergé à travers notre histoire démontrent que la suppression des rapports hiérarchiques au travail permet de favoriser le bien-être et la dignité par l'engagement et la participation collective. Dès lors, rester enfermé·e dans ce cadre d'organisation hiérarchique du travail conduit à la négation de toute la créativité dont sont capables les travailleur·euses pour instaurer de nouvelles formes de relations sociales. Puisque le travail occupe une grande partie de notre vie, remettre en question les rapports hiérarchiques et de pouvoir qui sont au cœur du système de production de la valeur nous apparaît comme un angle radical pour un changement social structurel et culturel.
L'autogestion en milieu de travail sera définie ici comme une structure dans laquelle tous·tes les membres impliqué·es participent directement à la prise de décision pour l'ensemble des sphères d'une organisation, sans intermédiaire. Quels rapports cette forme d'organisation entretient-elle avec le concept de démocratie ? Quels sont les défis concrets de l'autogestion au quotidien ? Les expériences présentées ici pourront, nous l'espérons, alimenter ces réflexions. À travers ce mini-dossier, une ligne du temps, conçue avec la participation d'Archives révolutionnaires, met aussi en lumière quelques expériences québécoises d'autogestion en milieu de travail.
Mini-dossier coordonné par Valérie Beauchamp, Isabelle Bouchard et Samuel Raymond
Avec des contributions de Valérie Beauchamp, Paolo Miriello, Vincent Roy, Carole Yerochewski

Autogestion démocratique pour tous... et toutes

Depuis le 19e siècle en Europe, la coopérative et l'autogestion sont devenues le support d'une réflexion utopique de transformation démocratique du travail et de la société.
Ce mouvement a fait naître et renaître des projets et des pratiques, car, sous la poussée de différents mouvements sociaux, ce que peut être une société démocratique évolue : l'autogestion et le concept de société autogérée doivent désormais prendre en compte des enjeux politiques comme la redéfinition des rapports humains avec l'environnement et l'émancipation des rapports sociaux de sexe et race. En fait, ces enjeux sont profondément interdépendants, ce qui exclut d'emblée de n'avoir qu'une réflexion macroéconomique ou sociale, portant sur des systèmes de planification autogérés, sans l'articuler à sa mise en œuvre micro et mezzo. Partir de pratiques transformatrices concrètes menées par des communautés locales ou des villes peut être plus fructueux que de commencer par élaborer une vision globale en apparence séduisante, car visant explicitement les institutions et le pouvoir capitaliste, mais laissant dans un angle mort la façon dont se reproduisent les rapports sociaux de domination et d'exploitation [1].
Rapports de production capitalistes
Il est possible de tirer des enseignements des expériences récentes d'économie solidaire ou populaire, en particulier de celles qui se déroulent dans les pays du Sud, notamment au Brésil dans les années 1990 et 2000 et début 2010, où ce sont des populations pauvres et des communautés traditionnelles ou autochtones qui sont aussi impliquées. Leur participation directe fait tout d'abord ressortir que l'autogestion à l'échelle d'une coopérative ne règle pas l'enjeu de l'hétéronomie du travail.
Croire qu'un projet militant d'autogestion suffit à transformer le rapport au travail quand la coopérative continue d'être prise dans des logiques productivistes qui conduisent à, ou reproduisent la hiérarchisation des tâches, c'est faire l'impasse sur la reproduction des rapports sociaux de domination et d'exploitation. La tenue régulière d'assemblées générales, accompagnées de techniques participatives en petits groupes, préparatoires ou parallèles, ne peut favoriser la démocratie directe indépendamment de la possibilité donnée à chacun et chacune de se projeter individuellement et collectivement, et donc de participer à la définition de l'objectif. À l'échelle d'une entreprise, la gouvernance autogestionnaire est prise en tenaille entre la volonté de démocratiser et la nécessité de s'adapter aux contraintes de la productivité capitaliste. L'autogestion réduite à l'idée d'une propriété collective – ou d'une socialisation des moyens de production – ne suffit pas à produire un lieu où chacun et chacune se reconnaît dans l'objectif poursuivi et ose prendre la parole.
S'autogérer pour produire quoi ?
Dans son ouvrage sur le travail démocratique, Alexis Cukier souligne à escient l'importance de relier la démocratisation du travail à une réflexion sur la finalité du travail et une démocratisation des choix de production. La dissociation traditionnelle entre travail et citoyenneté, que ne comble pas la citoyenneté industrielle, qui laisse les choix économiques aux mains des capitalistes, est l'une des principales sources d'un rapport hétéronome au travail.
S'il suffisait pour démocratiser le travail de réduire le temps qui lui est consacré ou d'améliorer les revenus, ce que sont parvenues à faire des coopératives brésiliennes, le livre de Julia Posca au titre explicite (Travailler moins ne suffit pas) n'aurait pas connu cet engouement. Le contrôle démocratique, autogéré, de l'activité de travail, ne peut se développer qu'en interdépendance avec le contrôle des choix de production, c'est-à-dire de l'économie, par le moyen d'institutions dont il faut débattre parallèlement.
On ne peut oublier que nous vivons dans un monde qui tient quasiment pour acquise la séparation entre la sphère dite de production de celle dite de reproduction sociale. Or, cette séparation est totalement arbitraire, comme on le sait, puisqu'il suffit que des activités de la sphère de reproduction sociale soient vendues et comptabilisées dans le PIB, comme la confection de vêtements, pour basculer dans celle de la production [2].
En outre, cette séparation entre des activités qui seraient du travail et d'autres qui n'en seraient pas, qui se classeraient dans des occupations militantes, citoyennes, bénévoles, comme si l'on n'utilisait pas la même « force de travail » pour débattre, faire des affiches, etc., est en elle-même discutable : elle induit une hiérarchisation entre les différents travaux, selon qu'ils contribuent ou pas, dans une logique capitaliste, à augmenter la valeur d'échange. C'est ainsi que l'on voit depuis une quarantaine d'années se multiplier les fonctions de marketing, d'analyste financier, de contrôle de gestion. Or, leur valeur d'usage, si elle n'est pas nulle dans une logique d'accumulation, a du mal à rivaliser avec celle accordée à un logement salubre ou à une nourriture biologique. Mais les activités qui ont une valeur d'usage irremplaçable, ou « essentielle », comme celles de prendre soin, d'un·e enfant, d'un·e aîné·e, de sa communauté de proximité (géographique, éthique, etc.) sont dévalorisées, atténuant ainsi et même masquant le processus d'appropriation du travail au fondement des divisions sociales ainsi que sexuées et racisées du travail.
Travail et citoyenneté
En adoptant ainsi une perspective féministe matérialiste, on fait ressortir la centralité du travail – de tous les types d'activités et pas seulement du travail marchand – comme activité humaine de production du monde. Comme le souligne Alexis Cukier, le travail n'a pas qu'une fonction économique, mais aussi une fonction politique, celle de produire et reproduire les rapports sociaux de domination et d'exploitation, mais aussi potentiellement de les transformer. L'autogestion participe d'une démarche politique qui doit donc se préoccuper non seulement de produire, mais aussi de « savoir quoi produire, pour qui et comment » c'est-à-dire selon quelles divisions du travail, comme le résumait un syndicaliste brésilien de la CUT [3], frappé par la radicalité d'expériences emmenées par des femmes et des communautés autochtones.
La remise en cause des divisions hiérarchisées, sexuées et racisées du travail conduit à redonner de la valeur à des activités essentielles pour le « vivre ensemble ». C'est aussi à cette condition que l'autogestion du travail et des choix de production peut réconcilier travail et citoyenneté : en donnant une voix collective, en représentant celles et ceux, femmes, personnes pauvres, immigrantes et migrantes, racisées, qui sont susceptibles, en raison de leur position dans les rapports sociaux, de faire émerger de nouvelles cosmogonies où le « prendre soin », de soi, des autres, du vivant, de la planète, sera au fondement du « vivre ensemble ».
[1] Pour un aperçu de ces débats et enjeux, voir Audrey Laurin-Lamothe, Frédéric Legault, Simon Tremblay-Pepin, Construire l'économie postcapitaliste, Lux, 2023.
[2] Voir notamment sur ce sujet Christine Delphy, L'ennemi principal : 1. Économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 2013 [1998].
[3] Central Única dos Trabalhadores (Centrale unique des travailleurs), principale confédération syndicale au Brésil, dont vient l'actuel président Lula.
Carole Yerochewski est sociologue.

Milieu communautaire : pas besoin de patron !

Nous avons interrogé sept personnes travaillant dans des milieux autogérés pour documenter leurs expériences dans ce mode de fonctionnement. Tous et toutes sont issu·es du communautaire, l'un des milieux de travail comptant le plus d'expériences en autogestion au Québec. Pendant les entrevues, il a été marquant de réaliser la similitude des discours que les personnes portent sur leurs expériences d'autogestion en milieu de travail. Il se dégage de ce processus que malgré les différences dans les façons d'appliquer les principes autogestionnaires, les constats qui en ressortent pour les travailleurs et travailleuses sont en tous points semblables.
Pour l'ensemble des personnes interrogées, le principal avantage de l'autogestion est le plus grand contrôle sur ses conditions de travail comparativement aux structures hiérarchiques. Puisque tous et toutes sont amené·es à se prononcer sur l'ensemble des facettes du milieu, chaque élément qui compose le fonctionnement de l'organisme est compris et intégré. « Même si c'est “quelqu'un” qui me donne des tâches dans le sens que c'est le collectif qui me donne des tâches, quand c'est mon équipe qui me donne des tâches, ben je les comprends et je comprends pourquoi il faut les faire et pourquoi c'est moi qui dois les faire. Les tâches, elles ont du sens parce que je les ai analysées et je les ai acceptées. » Ainsi, l'autogestion permet de produire un sens collectif puisque chaque personne participe à l'ensemble des processus décisionnels. Un travailleur nous donnait l'exemple d'une discussion en équipe pour se doter de balises claires encadrant le travail à distance. Dans ce cas, que l'ensemble des personnes participent à la discussion « […] est un avantage parce que même la personne qui fait du télétravail décide aussi des paramètres à mettre en place. » Cela revient donc à avoir un pouvoir réel et concret sur la réalisation des tâches et sur la structuration des services dans l'organisme. De plus, c'est à l'équipe que revient la responsabilité de produire un contrat de travail qui respecte les limites financières de l'organisme. Lorsque les salaires ne sont pas imposés par un·e supérieur·e, mais discutés collectivement, les choix à faire pour la santé financière de l'organisme apparaissent légitimes.
Pour les travailleurs et les travailleuses, le fonctionnement en autogestion entraîne aussi un fort sentiment de liberté, une plus grande ouverture à leurs idées ainsi qu'une reconnaissance concrète de leur apport à l'organisme. De plus, la prise en charge collective du bien-être des travailleurs et travailleuses crée des relations différentes dans l'équipe de travail où l'entraide prend une place centrale. Tous et toutes dans l'équipe de travail sont responsables de l'équilibre entre ses besoins individuels et ceux des autres. De plus, le fait que tous et toutes participent aux mêmes tâches et ont exactement les mêmes conditions de travail entraîne une présomption d'égalité qui renforce ce sentiment de camaraderie.
« RH » : le défi de l'autogestion
Cette égalité entre toutes les personnes composant l'équipe de travail représente toutefois un idéal plutôt qu'une réalité concrète, puisque l'émergence de relations de pouvoir informelles ne peut être complètement évitée, malgré des mécanismes propres à en limiter les effets négatifs. Ce pouvoir a été défini en entrevue comme la différence entre les individus dans leur capacité à influencer les directions prises par l'organisme. Pour dépasser cela, il est primordial que les mécanismes de prises de décisions soient clairs et appliqués rigoureusement pour assurer cette présomption d'égalité. Pour qu'un organisme fonctionne de façon efficiente en autogestion, l'ensemble des membres de l'équipe de travail doivent partager la même compréhension de quelle instance a la responsabilité de quelle décision. Par ailleurs, avoir des structures décisionnelles claires n'est pas garant d'une atténuation des relations de pouvoir lorsqu'il faut les vivre au quotidien. Bien souvent, les mécanismes ont été réfléchis et explicités par écrit dans des documents, mais les équipes de travail doivent constamment rester alertes pour faire vivre ces façons de prendre des décisions collectives : « L'application dans le quotidien de ce que ça veut dire vraiment, ça peut être plus complexe. On peut théoriquement transmettre les structures, les valeurs, les fonctionnements, mais après ça, devant une situation, concrètement, à qui je demande, à quelle instance j'adresse la situation ou la difficulté ? Ce n'est pas juste théorique, des structures, elles se vivent. » Le défi de signaler les difficultés à l'instance appropriée peut causer des tensions dans les équipes de travail.
La façon de composer avec ces tensions dépend des structures mises en place, mais demeure un des principaux défis de l'autogestion, particulièrement en ce qui concerne la capacité à porter un regard critique sur le travail effectué par ses pair·es et à en discuter ouvertement en équipe. Dans les structures autogérées, il n'existe pas de poste dont c'est la responsabilité officielle de surveiller la façon dont est réalisé le travail. Cette responsabilité est partagée par chacune des personnes qui composent l'équipe de travail et doit être appliquée avec rigueur pour le bon fonctionnement de l'organisme. Cela est vu comme une difficulté particulière à l'autogestion, principalement à cause de la présomption d'égalité entre les membres de l'équipe. Les personnes interrogées nomment ne pas vouloir endosser ce rôle de discipline associé à une coordination générale, bien que tous et toutes s'entendent pour reconnaître que la surveillance de l'exécution des tâches est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Le défi est donc de savoir quand, où et comment adresser les tensions qui résultent de l'exécution des tâches. Quand ces mécanismes existent et qu'ils sont opérationnels, il est de la responsabilité des individus de nommer explicitement ce qui pose problème. Cela demande donc aux travailleurs et travailleuses de grandes compétences en communication, particulièrement la capacité à émettre des critiques constructives et à en recevoir. Par contre, si ces mécanismes sont absents du milieu de travail ou s'ils ne sont pas utilisés correctement, il est de la responsabilité de l'organisme de trouver des façons d'intégrer la gestion de l'exécution des tâches dans son fonctionnement.
Mise en commun des expériences
Il nous apparaît que peu d'outils concrets sont partagés par les milieux pour pallier les difficultés qu'entraîne l'autogestion en milieu de travail. Il n'existe pas de lieu pour comparer les expériences d'autogestion avec d'autres qui fonctionnent de la même façon, en ce qui a trait au milieu communautaire à tout le moins. Dès lors, les défis vécus apparaissent comme propres au milieu et non comme des défis communs partagés par l'ensemble des personnes. Il y a donc un besoin au Québec de se regrouper entre organismes qui fonctionnent en autogestion pour réfléchir collectivement aux défis posés par ce type de gestion.

Propositions pour une autogestion viable

Il n'y a pas de recette unique pour l'autogestion, mais il y a certaines réalités qui reviennent souvent d'une entreprise à l'autre. À mes yeux, il importe de s'inspirer des « bonnes pratiques » et des échecs des autres, sans faire l'économie des débats à leur sujet. Voici donc quelques propositions qui, j'espère, aideront à situer quelques-unes des pratiques concrètes pour alimenter des débats constructifs.
Prendre la mesure du sale boulot
De façon presque intuitive, lorsqu'on imagine une entreprise sans patron·nes, notre premier réflexe est de poser la question suivante : qui fera le sale boulot ? En l'absence d'une structure hiérarchique traditionnelle, il est tout à fait légitime de craindre que personne ne veuille assumer les tâches les plus désagréables en entreprise. La question du sale boulot n'est pas une mince affaire ; c'est pratiquement une question civilisationnelle ! Le management contemporain y répond en établissant des relations de pouvoir fondées entre autres sur le salariat, mais comme l'autogestion refuse ce fonctionnement, cela peut longtemps nous tracasser.
Reconnaître cet enjeu et son ampleur est primordial. Il faut aussi savoir reconnaître les dynamiques qui l'aggravent : par exemple, on se retrouve parfois avec une minorité de collègues qui compensent les manquements d'une autre minorité. La minorité responsable met les bouchées doubles, et éventuellement, la minorité irresponsable s'y habitue : elle n'aura alors aucun incitatif à se discipliner, car le travail est accompli par les autres. On aura alors l'impression que tout fonctionne comme prévu, mais en réalité, l'inévitable sentiment d'iniquité risque de dégénérer en conflits interpersonnels. S'il n'est pas toujours réaliste de s'assurer que chaque personne contribue de façon égale à toutes les tâches, il faut toutefois reconnaître ce travail et les personnes qui l'accomplissent. Il faut également s'assurer de leur accorder l'opportunité d'être entendues et d'avoir le contrôle sur leur travail.
Privilégier la confrontation préventive
En contexte autogéré, les gens ne veulent généralement pas jouer aux patron·nes, et ce, pour deux raisons : d'abord parce que les patron·nes ne sont pas apprécié·es, mais aussi parce que les patron·nes sont responsables du travail des autres. On aimerait que chaque personne soit autonome vis-à-vis de ses tâches et que l'on puisse ainsi se concentrer sur les nôtres. Malheureusement, il y a toujours des écarts entre les attentes et le travail accompli. L'entreprise autogérée n'a pas de patron·nes désigné·es pour régler ces écarts, mais ceux-ci doivent être adressés. L'autogestion doit donc favoriser la confrontation préventive : il faut savoir confronter les individus qui ne répondent pas aux attentes. J'insiste sur l'idée de confronter les individus parce qu'il est souvent tentant de lancer des appels vagues à la discipline sans nommer de noms : on peut alors s'exprimer pour le bien de l'entreprise sans avoir le sentiment « d'attaquer » qui que ce soit. Cette pratique se veut préventive, car il est mieux d'ébranler légèrement des collègues que de laisser les manquements générer du ressentiment qui finira tôt ou tard par exploser. Évidemment, cette confrontation se doit d'être bienveillante et de ne pas prendre la forme d'une punition.
Une approche préventive de confrontation établit des procédures pour recevoir et traiter les plaintes. Les réunions ne sont pas toujours le meilleur espace pour ce faire, car certaines personnes auront plus de difficulté à émettre ou à entendre des plaintes dans un contexte de groupe : il pourrait s'avérer plus propice de nommer des personnes responsables pour recevoir les plaintes et confronter les individus concernés en privé. Cela dit, cette responsabilité peut devenir une source de pouvoir indue, donc il faut être prudent·e lorsqu'on choisit de « privatiser » ces démarches. Les procédures peuvent également prévoir une « escalade » des mesures dans le cas de fautes récurrentes, mais il faut aussi être patient·e.
Affirmer les formes d'autorité légitimes
Le choix de l'autogestion est historiquement inspiré d'un rejet de l'autorité des patron·nes, jugée illégitime. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucune forme d'autorité légitime en entreprise, ou que l'avis de chaque personne soit valable en toute circonstance. Il y a des moments où chaque voix doit être traitée de façon égale, et d'autres où il faut reconnaître l'autorité de nos collègues. Ici, j'entends l'autorité comme une capacité de s'imposer, de se faire respecter et écouter au-delà des autres par rapport à un sujet précis, et non comme un pouvoir total et incontestable.
Mary Parker Follett, théoricienne du management participatif, revendiquait une autorité fondée sur la base des compétences. Souvent, cette forme d'autorité est reconnue naturellement : pensons à une réunion sur les états financiers où ce sont les comptables qui ont le dernier mot sur la manière de comptabiliser les revenus et les dépenses. Il y a certaines choses, comme les normes comptables, que l'on ne soumet pas à un vote. L'autorité peut également découler du travail accompli. La notion d'autorité peut protéger les personnes qui connaissent mieux la réalité de leur travail contre l'ingérence individuelle ou contre l'influence excessive de collègues habiles pour mobiliser la majorité. Cela dit, ces personnes n'ont pas toujours raison, et ne devraient pas agir de façon totalement indépendante. Les responsabilités sont accordées collectivement, mais elles sont assumées individuellement : il faut tenter de trouver un équilibre entre ces deux positions légitimes, quoique possiblement antagonistes.
Rendre l'organisation viable
Il est crucial de s'entendre sur une vision de l'autogestion qui prévoit non seulement un fonctionnement idéal, mais aussi des mécanismes pour prévenir et traiter les situations conflictuelles qui peuvent surgir. Si le management traditionnel concentre le pouvoir entre les mains des managers, il leur confie aussi l'ultime responsabilité de ces conflits. C'est justement parce que l'on croit pouvoir faire mieux que l'autorité managériale que l'on choisit l'autogestion : encore faut-il apprendre à faire mieux. Cela est d'autant plus difficile sachant que plusieurs arrivent dans un contexte d'autogestion sans aucune expérience dans cette forme d'organisation : il faut se former collectivement à la responsabilité et la capacité de se dire les « vraies affaires » de manière à résoudre les problèmes de façon respectueuse, mais ferme.
Je dirais que l'autogestion nécessite une certaine rigidité face aux dysfonctionnements : asseoir l'autorité légitime, pratiquer la confrontation préventive et reconnaître les dynamiques malsaines autour du sale boulot n'a rien d'agréable, mais il est préférable de risquer quelques désagréments au quotidien plutôt que de fomenter des catastrophes. Ces pratiques font partie du « sale boulot » organisationnel : il faut éviter qu'une minorité de collègues en soient responsables et en faire un enjeu collectif.
Paolo Miriello est étudiant au doctorat en administration des affaires.

Trop politiques, les syndicats ?

Dans le contexte des attaques antisyndicales de la CAQ et des mobilisations en riposte à celles-ci, nous rendons disponible la chronique Travail de Thomas Collombat, issue de notre prochain numéro. La revue sera disponible en librairie le 8 décembre !
La CAQ ne sait plus où donner de la tête pour essayer de rebondir dans les sondages prévoyant sa disparition et faire oublier les échecs de sa gouvernance, depuis les fiascos de la « filière batterie » jusqu'aux révélations de la Commission d'enquête sur SAAQclic. Quelques mois seulement après avoir fait adopter sa loi draconienne contre le droit de grève, elle utilise à nouveau les syndicats comme boucs émissaires en annonçant un projet de loi permettant à leurs membres de rendre facultative une partie de leur cotisation, destinée aux « activités politiques ». Décryptons ensemble cette tentative de détournement de l'attention collective, qui repose toutefois sur une des marottes historiques de la droite.
À la base de cette énième attaque contre le mouvement syndical se trouve l'idée suivant laquelle les syndicats utiliseraient les cotisations de leurs membres à d'autres fins que celles auxquelles elles sont normalement destinées. Le « carré de sable » syndical se résumerait ainsi aux relations du travail « pures », c'est-à-dire à la négociation et à l'application de conventions collectives. Si les syndicats souhaitent déborder de ce cadre, que ce soit pour faire des représentations politiques auprès du Parlement, contester une loi devant les tribunaux, ou encore appuyer d'autres organisations de la société civile (groupes féministes, travailleur·euses migrant·es…) alors, les membres devraient avoir la possibilité de retirer la partie de leur appui financier correspondant à ces activités.
Dans le débat public, les groupes proches des milieux des affaires brandissent régulièrement « l'exemple européen », soit celui de pays (en fait assez souvent la France) où l'affiliation et la cotisation syndicale sont des décisions individuelles plutôt que collectives, permettant à chaque travailleur·euse de décider s'il ou elle soutient tel ou tel syndicat et ses actions. Cet argument ne tient toutefois absolument pas la route. Dans des systèmes de relations du travail tel que celui de la France, la syndicalisation individuelle va de pair avec le fait que les syndicats négocient pour l'ensemble des salarié·es, affilié·es ou pas, par le biais de conventions collectives de branches ou d'accords interprofessionnels. Ils représentent également l'ensemble de la population dans de grands débats sociaux, tel celui sur les retraites, et jouent d'ailleurs à cet égard un rôle hautement politique, remplaçant même parfois les partis politiques défaillants dans leur capacité de représentation des citoyen·nes [1]. Ne s'attarder qu'à la question du caractère volontaire des cotisations syndicales sans prendre en compte le contexte plus large relève donc soit d'une ignorance des systèmes de relations industrielles, soit de la mauvaise foi.
Une volonté d'affaiblir
Revenons donc en Amérique du Nord, où des dispositions similaires à celles prônées par la CAQ existent bien, mais… aux États-Unis. Et ici, la comparaison est valide dans la mesure où notre système et celui de nos voisins du Sud ont des racines et des logiques communes. Or, si les taux de syndicalisation aux États-Unis et au Canada (et en particulier au Québec) ont commencé à s'écarter considérablement à partir des années 1950, c'est en grande partie en raison de législations limitant, voire interdisant totalement, le prélèvement automatique des cotisations syndicales dans plusieurs États américains. Dans les États dits Right-to-Work, la disposition que nous connaissons au Canada, comme la « formule Rand » (le prélèvement des cotisations par l'employeur sur le salaire qui doit ensuite les reverser au syndicat) est tout simplement interdite [2]. Même dans les États non Right-to-Work, il existe des cas où les syndiqué·es peuvent décider de ne payer qu'une partie de leur cotisation, excluant ce qui est soi-disant destiné aux « activités politiques ». Le résultat est clair : c'est dans ces États que le syndicalisme est le plus faible, y compris et surtout dans les entreprises, là où il est pourtant censé faire son travail « légitime ». L'objectif n'est donc jamais la transparence ou la démocratie, mais bien l'affaiblissement de la capacité collective des travailleur·euses à faire valoir leurs intérêts tant dans les milieux de travail qu'à l'extérieur.
Changements sociaux et syndicalisme
Venons-en donc à la question fondamentale posée par cette annonce de projet de loi : peut-on séparer, au sein des activités syndicales, ce qui relève des relations du travail et ce qui relève du politique ? La réponse est sans équivoque : non. D'une part, l'interactivité entre ces deux sphères est évidente. Les relations du travail n'existent pas dans un vide politique. Elles sont étroitement encadrées par des législations et des réglementations qui reflètent le rapport de force entre travail et capital existant dans la société. Empêcher ou même limiter la capacité d'action des syndicats dans l'arène politique, c'est mettre le doigt sur la balance en faveur des employeurs. Et ceci ne vaut pas uniquement pour les « règles du jeu » des relations industrielles (comme le Code du travail), mais aussi pour toutes les politiques d'ordre social et économique. Si une loi crée, par exemple, un régime universel de retraite ou d'assurance-maladie, ce sont autant d'éléments qu'un syndicat n'aura plus à négocier dans une convention collective, libérant ainsi sa possibilité d'aller chercher d'autres avancées pour ses membres. De la même manière, les conventions collectives servent souvent « d'incubateurs » à des politiques publiques. Ainsi, les congés de maternité ou encore la reconnaissance des conjoints de même sexe ont d'abord été acquis dans des conventions collectives avant de faire l'objet de législations à portée universelle.
D'autre part, les relations du travail sont, en elles-mêmes, politiques. Elles touchent aux rapports de pouvoir dans les milieux de travail, à la répartition de la richesse, à la lutte contre l'arbitraire patronal… Elles sont donc fondamentalement de même nature que les débats pouvant avoir lieu à l'Assemblée nationale et portant sur la fiscalité, la justice sociale ou encore le fonctionnement démocratique de la société. Chercher à limiter la capacité d'action du syndicalisme vise donc bien plus à altérer ce rapport de force qu'à « réformer le régime syndical ». Paradoxalement, une telle réforme encouragerait même le syndicalisme à se replier sur lui-même et à pratiquer une certaine forme de corporatisme, alors que c'est ce qui lui est régulièrement reproché, y compris par la droite ! Pire, les premières victimes d'une telle mesure ne seront sans doute pas tant les syndicats que la myriade d'organismes communautaires et de la société civile qu'ils soutiennent par leurs appuis récurrents ou ponctuels. En affaiblissant les syndicats, on affaiblit l'ensemble des mouvements sociaux et des acteurs de changement, puisque l'appui public dont ils bénéficient ne fait que fondre depuis de nombreuses années.
De la poudre aux yeux
Si le projet caquiste s'inscrit dans un contexte politique immédiat et bien spécifique, il n'est aussi que le dernier avatar d'une tendance à long terme du capitalisme : séparer artificiellement le politique et l'économique. Cette caractéristique, identifiée notamment par l'historienne et intellectuelle marxiste Ellen Meiksins Wood [3], cherche non seulement à créer l'illusion que l'économie n'est pas le fruit de choix humains et de rapports de force sociaux, mais aussi à délégitimer les acteurs cherchant à agir sur les deux fronts, et ainsi à révéler la nature profondément politique des dynamiques économiques. Le syndicalisme, dont l'action se situe à cheval entre ces deux sphères, est naturellement la première cible de ceux cherchant à les séparer de façon hermétique.
Terminons en rappelant que, si la démocratie syndicale est imparfaite et comporte son lot de défis, elle reste l'un des derniers lieux de délibération collective présents dans nos sociétés. Face à la marchandisation croissante de tous les éléments de nos vies quotidiennes, mais aussi aux réformes centralisatrices du gouvernement du Québec mettant fin aux espaces de co-détermination des politiques publiques créées par la Révolution tranquille, il reste bien peu d'endroits où les travailleur·euses peuvent se sentir en contrôle de leur destin collectif et débattre ensemble des directions qu'elles et ils souhaitent prendre. Le projet caquiste, sous couvert de transparence et de démocratie, conduirait au contraire à étouffer ce qu'il reste de cette dernière dans les milieux de travail et plus largement dans la société québécoise.
[1] Voir Thomas Collombat, « Syndicalisme en France : Bataille des retraites », À bâbord !, no 96, p. 10-11. Disponible en ligne.
[2] 26 États américains sur 50 ont adopté des lois Right-to-Work. On y retrouve la plupart des États conservateurs du Sud (le Texas, la Floride, l'Arkansas…) mais aussi certains États du Midwest plus industriels, comme le Wisconsin ou l'Indiana. Le Michigan, bastion important du syndicalisme états-unien, avait adopté une telle législation en 2012, mais celle-ci fut révoquée en 2024.
[3] Ellen Meiksins Wood, « The Separation of the Economic and the Political in Capitalism », New Left Review, vol. 1, no 127, 1981, p. 66-95.
Manifestation du Front commun 2023, le 23 septembre 2023 (Crédit : André Querry).

Épiceries. Faim de justice

Comme bien des besoins de base, l'alimentation a été appropriée par de grandes corporations où l'acte de se nourrir devient pour ces entreprises une façon de s'enrichir. Les profits engrangés par les grandes épiceries se font au prix d'une augmentation des inégalités sociales, alors que de plus en plus d'individus font face à l'insécurité alimentaire et rencontrent des obstacles grandissants à bien s'alimenter.
Pendant la pandémie, le prix des aliments a bondi, hausse justifiée par l'inflation générale. Or, le travail de plusieurs journalistes a permis de mettre en lumière les profits faramineux que ces grandes entreprises ont réalisés pendant cette période ; l'inflation générale avait finalement peu à voir avec cette hausse, mais plutôt l'avarice des actionnaires qui s'enrichissent sur la faim. Comment arrivons-nous à cette hausse du prix des produits d'alimentation, si celle-ci ne s'explique pas par des facteurs extérieurs ? Comment les épiceries contribuent-elles aux inégalités sociales ? C'est à ces questions que cherche à répondre ce dossier en explorant le fonctionnement des grandes épiceries bannières et le système de distribution qui les approvisionne.
Les deux premiers articles du dossier s'attardent spécifiquement à cet angle afin de dresser un portrait global de ce qui se cache derrière les étalages. À la suite du scandale des profits réalisés par les grandes épiceries pendant la pandémie, le Canada a tenté de mettre en place une législation qui a finalement abouti à un code de conduite volontaire et non contraignant. L'un des articles du dossier interroge d'ailleurs le manque de lois encadrant le secteur agroalimentaire, soulignant qu'une telle législation permettrait d'envisager l'alimentation non pas comme une marchandise, mais comme un droit fondamental pour toustes. Sur le plan environnemental, les épiceries participent grandement au gaspillage des denrées alimentaires, une problématique approfondie dans un des articles. Les épiceries reproduisent également les grandes dynamiques d'exclusion et de discrimination qui privent plusieurs franges de la population d'un accès équitable à des aliments de base. Le système de distribution actuel est basé sur des inégalités raciales qui s'exercent autant à l'échelle mondiale que locale – un article expose l'héritage colonial et capitaliste qui se poursuit aujourd'hui dans le système agroalimentaire. Un autre article révèle comment les travailleur·euses dans les épiceries doivent se contenter de conditions de travail précaires qui participent aux profits astronomiques générés par leur travail. De plus, un article se penche sur les obstacles dans les épiceries pour les personnes en situation de handicap. Or, des alternatives existent où des épiceries solidaires et sans but lucratif cherchent à offrir à la population des aliments abordables. Ce dossier met en lumière les multiples facettes – économiques, sociales et environnementales – du système alimentaire actuel, tout en ouvrant la voie à des pistes pour repenser nos épiceries comme des espaces de justice et de solidarité.
Un dossier coordonné par Valérie Beauchamp et Mélanie Ederer. Photos : Rachel Cheng (鄭凱瑤).
Avec des contributions de Amélie Côté, Dimitri Espérance, Jessica Dufresne, Vanessa Girard-Tremblay, Selma Kouidri, Simon Laplante, Ali Romdhani, Elena Solovyova et Leslie Touré Kapo.
Numéro en librairie le 8 décembre.
Photographe et consultante, Rachel Cheng (鄭凱瑤) travaille à l'intersection de la nourriture, de la race et de la durabilité. Elle a collaboré avec diverses organisations à but non lucratif dans les domaines de défense des droits et de l'intégration de l'antiracisme dans leur démarche. La nourriture est la perspective par laquelle elle interprète le monde et cherche à provoquer un changement.
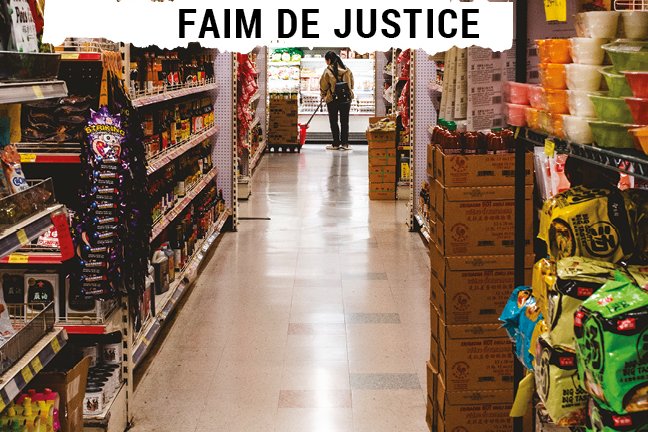
Sommaire du numéro 106

Travail
Trop politiques, les syndicats ? / Thomas Collombat
Société
Face à l'extrême droite, se retrouver / Victor Beaudet-Latendresse et Simon Tremblay-Pepin
L'importance de se projeter / Sophie Elias-Pinsonnault
Sortie des cales
Clap de fin / Jade Almeida
Mémoire des luttes
Le combat de Claudia Jones / Alexis Lafleur-Paiement, membre du collectif Archives Révolutionnaires
L'héritage de Mobilisation : S'enraciner pour mieux lutter / Entretien avec Guillaume Tremblay-Boily. Propos recueillis par Louise Nachet
Coup de poing
Si ça c'est la gauche radicale, qu'est-ce que je suis, moi ? / Anne Archet
Médias
Raconte-moi un commun : Un nouveau balado sur les communs au Québec / Avec Stella Warnier(CRITIC). Propos recueillis par Maël Foucault
Culture numérique
Koumbit : La technologie autrement / Entretien avec le collectif Koumbit. Propos recueillis par Yannick Delbecque
Société
Panique autour de la transidentité / Michel Dorais
Sortir du contrôle, reprendre le pouvoir / Entretien avec Judith Lefebvre. Propos recueillis par Louise Nachet
Mini-dossier : L'austérité, encore et toujours
Coordonné par Caroline Brodeur et Nicolas Lacroix. Illustrations par Élisabeth Doyon
Un mode de gestion des finances publiques catastrophique / Guillaume Tremblay-Boily
Compressions en éducation : le diagnostic et le remède / Chloé Domingue-Bouchard
Secteur de santé : L'austérité en continu / Jean-Philippe Chauny
Pour que cesse la précarité des artistes / Entretien avec Nicolas Rochette. Propos recueillis par Nicolas Lacroix
L'incompétence organisée / Simon-Pierre Beaudet
Dossier : Épiceries. Faim de justice
Coordonné par Valérie Beauchamp et Mélanie Ederer. Photos par Rachel Cheng (鄭凱瑤)
Sous les néons des épiceries bannières : Le choix des présidents / Dimitri Espérance et Vanessa Girard‑Tremblay
Le vrai coût du système mondial de distribution des aliments : Ce que cachent nos épiceries / Ali Romdhani
Droit à l'alimentation : Réparer un système fragmenté / Jessica Dufresne
Démocratiser le zéro déchet / Amélie Côté
Initiatives antiracistes et décoloniales contre l'insécurité alimentaire : Semer la résistance ! / Simon Laplante et Leslie Touré Kapo
Main-d'œuvre en épicerie : Conditions de travail et précarité / Elena Solovyova
Personnes en situation de handicap : Un parcours parsemé d'obstacles / Entretien avec Selma Kouidri. Propos recueillis par Mélanie Ederer
Alternatives aux supermarchés : David contre Goliath / Valérie Beauchamp et Mélanie Ederer
International
Cisjordanie : L'autre visage de la répression brutale en Palestine / Entretien avec Alexandre Smith. Propos recueillis par Claude Vaillancourt
Heritage Foundation : L'éminence grise du gouvernement Trump / Claude Vaillancourt
Culture
À tout prendre ! / Ramon Vitesse
Recensions
Numéro en kiosque le 8 décembre.
Couverture : Rachel Cheng (鄭凱瑤)
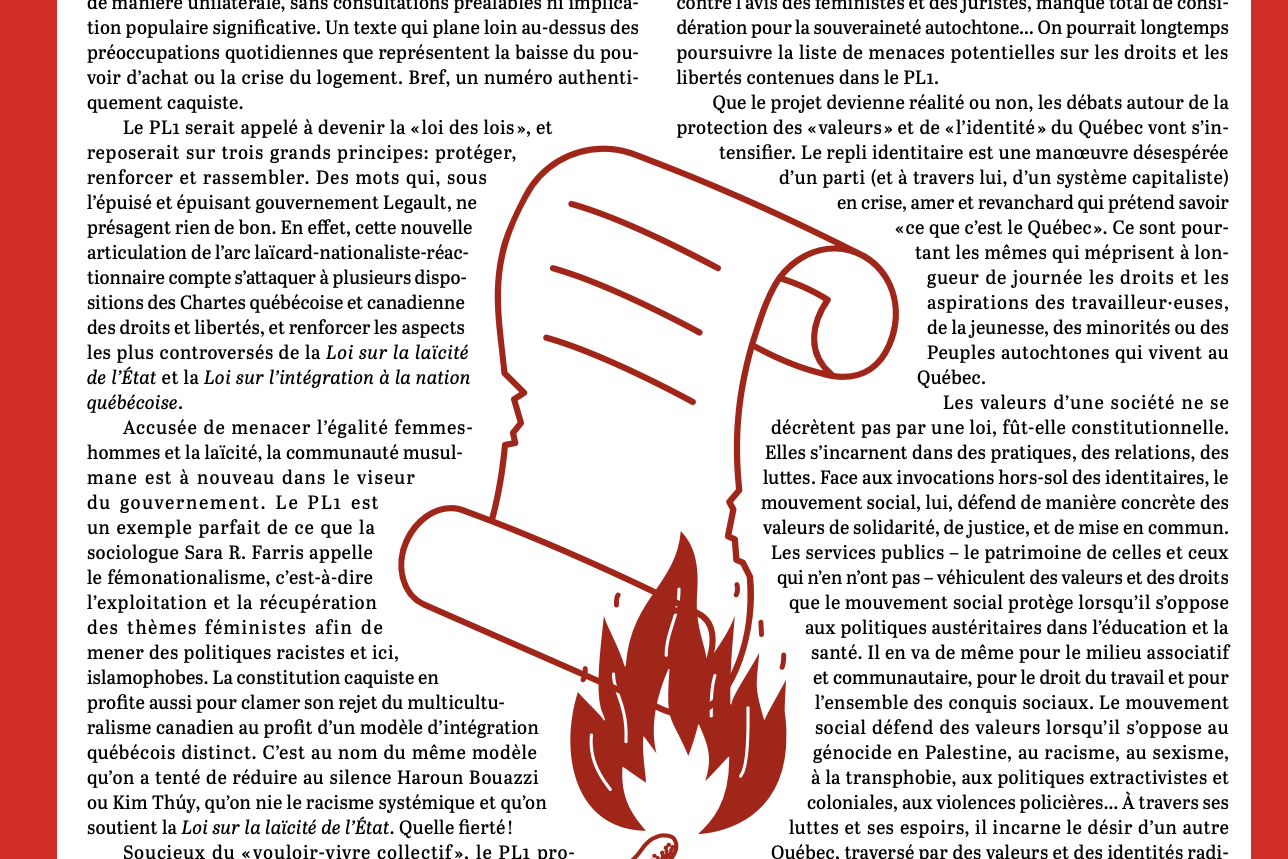
La constitution du repli

Le 9 octobre 2025, le gouvernement de la CAQ présentait à l'Assemblée nationale un projet de loi omnibus : la « Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec ». Un texte que personne n'attendait, déposé de manière unilatérale, sans consultations préalables ni implication populaire significative. Un texte qui plane loin au-dessus des préoccupations quotidiennes que représentent la baisse du pouvoir d'achat ou la crise du logement. Bref, un numéro authentiquement caquiste.
Le PL1 serait appelé à devenir la « loi des lois », et reposerait sur trois grands principes : protéger, renforcer et rassembler. Des mots qui, sous l'épuisé et épuisant gouvernement Legault, ne présagent rien de bon. En effet, cette nouvelle articulation de l'arc laïcard-nationaliste-réactionnaire compte s'attaquer à plusieurs dispositions des Chartes québécoise et canadienne des droits et libertés, et renforcer les aspects les plus controversés de la Loi sur la laïcité de l'État et la Loi sur l'intégration à la nation québécoise.
Accusée de menacer l'égalité femmes-hommes et la laïcité, la communauté musulmane est à nouveau dans le viseur du gouvernement. Le PL1 est un exemple parfait de ce que la sociologue Sara R. Farris appelle le fémonationalisme, c'est-à-dire l'exploitation et la récupération des thèmes féministes afin de mener des politiques racistes et ici, islamophobes. La constitution caquiste en profite aussi pour clamer son rejet du multiculturalisme canadien au profit d'un modèle d'intégration québécois distinct. C'est au nom du même modèle qu'on a tenté de réduire au silence Haroun Bouazzi ou Kim Thúy, qu'on nie le racisme systémique et qu'on soutient la Loi sur la laïcité de l'État. Quelle fierté !
Soucieux du « vouloir-vivre collectif », le PL1 propose de restreindre la capacité des organisations qui reçoivent des fonds publics à contester les lois du Québec devant les tribunaux. Tout aussi réjouissant pour la démocratie : le PL1 entend trouver un « juste équilibre » entre les droits individuels et les « droits collectifs de la nation ». Au risque de gâcher le suspense, il ne s'agira probablement pas de remettre en cause le sacro-saint droit de propriété privée mais plutôt de justifier certaines atteintes à l'encontre des groupes minorisés. Enchâssement du droit à l'avortement dans la Constitution contre l'avis des féministes et des juristes, manque total de considération pour la souveraineté autochtone… On pourrait longtemps poursuivre la liste de menaces potentielles sur les droits et les libertés contenues dans le PL1.
Que le projet devienne réalité ou non, les débats autour de la protection des « valeurs » et de « l'identité » du Québec vont s'intensifier. Le repli identitaire est une manœuvre désespérée d'un parti (et à travers lui, d'un système capitaliste) en crise, amer et revanchard qui prétend savoir « ce que c'est le Québec ». Ce sont pourtant les mêmes qui méprisent à longueur de journée les droits et les aspirations des travailleur·euses, de la jeunesse, des minorités ou des Peuples autochtones qui vivent au Québec.
Les valeurs d'une société ne se décrètent pas par une loi, fût-elle constitutionnelle. Elles s'incarnent dans des pratiques, des relations, des luttes. Face aux invocations hors-sol des identitaires, le mouvement social, lui, défend de manière concrète des valeurs de solidarité, de justice, et de mise en commun. Les services publics – le patrimoine de celles et ceux qui n'en n'ont pas – véhiculent des valeurs et des droits que le mouvement social protège lorsqu'il s'oppose aux politiques austéritaires dans l'éducation et la santé. Il en va de même pour le milieu associatif et communautaire, pour le droit du travail et pour l'ensemble des conquis sociaux. Le mouvement social défend des valeurs lorsqu'il s'oppose au génocide en Palestine, au racisme, au sexisme, à la transphobie, aux politiques extractivistes et coloniales, aux violences policières… À travers ses luttes et ses espoirs, il incarne le désir d'un autre Québec, traversé par des valeurs et des identités radicalement différentes à celles de Legault, St-Pierre Plamondon ou Bock-Côté. Face à nos adversaires réactionnaires, les positions timorées, les capitulations ou la politique de respectabilité sont autant de renoncements envers ces valeurs, qui sont pourtant les piliers de la société que nous souhaitons bâtir.
Le numéro sera disponible en librairie le 8 décembre.












