Revue À bâbord !
Publication indépendante paraissant quatre fois par année, la revue À bâbord ! est éditée au Québec par des militant·e·s, des journalistes indépendant·e·s, des professeur·e·s, des étudiant·e·s, des travailleurs et des travailleuses, des rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l’organisation de notre société, dans les rapports entre les hommes et les femmes et dans nos liens avec la nature.
À bâbord ! a pour mandat d’informer, de formuler des analyses et des critiques sociales et d’offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire. À bâbord ! veut appuyer les efforts de ceux et celles qui traquent la bêtise, dénoncent les injustices et organisent la rébellion.
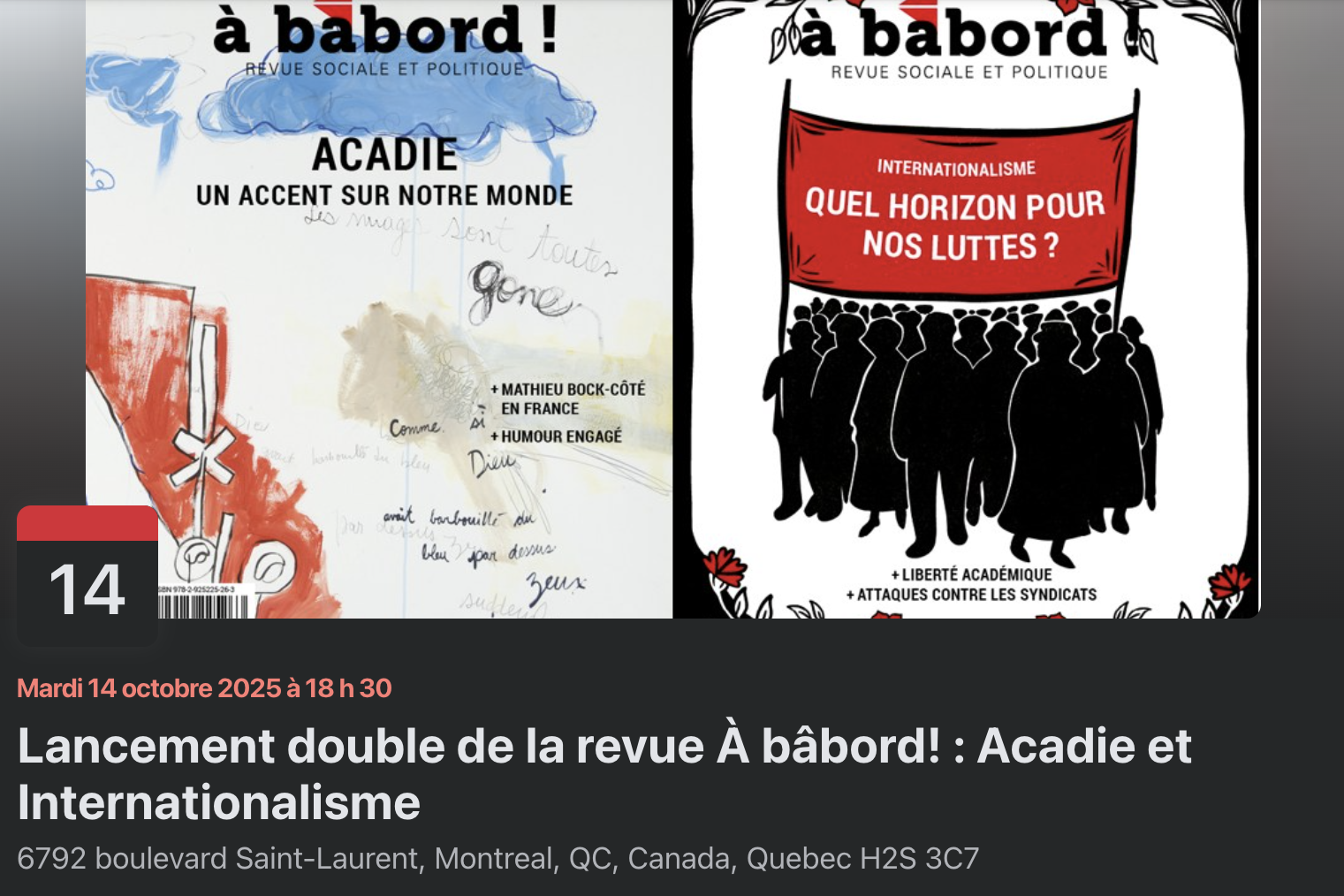
Lancement double le 14 octobre !

La parution du numéro 104 (et son dossier sur l'Acadie) et du numéro 105 (et son dossier sur l'internationalisme) seront soulignés à la librairie N'était-ce pas l'été (6702 St-Laurent, Montréal).
Mardi 14 octobre à 18h30. Entrée libre, bienvenue à toutes et à tous !

Syndiquer Amazon : la nouvelle frontière ?

Le 1er avril 2022, la terre a tremblé chez Amazon. Pour la première fois de son histoire, le géant de la vente en ligne voyait un groupe de ses travailleureuses opter pour la syndicalisation à son entrepôt new-yorkais JFK8. Loin d'être un cas isolé, d'autres initiatives d'organisation collective ont émergé à travers le monde, notamment au Québec. Comment se passe cette campagne et à quelles difficultés fait-elle face ?
En mars 2022, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), contactée par un groupe de travailleureuses de l'entrepôt YUL2, à Lachine, décide de partir à l'assaut de la forteresse Amazon. Au sommet de la liste de récriminations : les salaires, bien trop bas par rapport au reste de l'industrie, mais aussi trop, beaucoup trop d'accidents de travail. « Chez Amazon, tu ne te demandes pas si, mais quand tu vas te blesser », confie un conseiller CSN impliqué dans la campagne de syndicalisation.
En cause, tout d'abord, le rythme et les conditions de travail imposés par Amazon à ses salarié·es. « Les entrepôts, on connaît ça à la CSN », indique David Bergeron-Cyr, vice-président de la centrale et lui-même issu de ce secteur, « mais chez Amazon, c'est complètement différent des entrepôts alimentaires ou pharmaceutiques, par exemple ». La diversité des produits manipulés entraîne des difficultés particulières, mais c'est surtout la cadence imposée, souvent intenable, qui conduit à des accidents. Les quotas de paquets à traiter par jour sont extrêmement élevés et surveillés par des systèmes informatiques. À Amazon, on n'automatise pas nécessairement le travail comme tel, mais on automatise le contrôle.
Et quand les accidents arrivent, ils sont trop rarement déclarés à la Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST). Face à un employeur clairement négligeant et souhaitant camoufler la réalité des conditions de travail qu'il impose, on trouve de nombreux travailleureuses fragilisé·es et souvent démuni·es. C'est ici qu'entre en jeu une autre caractéristique essentielle de la main-d'œuvre d'Amazon : dans leur vaste majorité, les salarié·es de la multinationale sont des personnes migrantes. Immigrant·es reçu·es, temporaires, réfugié·es ou même en attente d'une décision sur leur statut, elles forment le bassin de prédilection au sein duquel Amazon puise ses « ressources humaines ». Avec peu ou pas de connaissances du système légal québécois, elles hésitent à déclarer les accidents de travail ou à exprimer des plaintes, de peur que cela ait une incidence sur leur statut migratoire.
Obstacles à la syndicalisation
Le syndicalisme lui-même est une autre réalité avec laquelle elles doivent se familiariser. Un lien de confiance doit être bâti avec des personnes issues de pays où les pratiques syndicales divergent considérablement de celles du Québec. En effet, les corruptions et les connivences avec l'État et les employeurs sont monnaie courante dans plusieurs pays d'origine des travailleureuses d'Amazon. Même quand elles sont partantes pour participer à une initiative de syndicalisation, certaines personnes salariées composent avec une culture syndicale qui diverge parfois des pratiques nord-américaines, par exemple lorsqu'il s'agit de faire preuve de discrétion ou de garder la campagne confidentielle afin d'éviter les pressions indues de l'employeur. Et des pressions, on soupçonne fortement Amazon d'en faire, notamment par le biais d'affichages décourageant la syndicalisation dans ses milieux de travail.
Mais l'un des principaux obstacles à la syndicalisation, ce sont, à nouveau, les accidents de travail. Comme ils sont rarement déclarés à la CNESST, ils conduisent bien souvent les travailleureuses blessé·es à démissionner ou à se faire congédier, faute d'avoir atteint les quotas de production exigés. Alors que la CSN est bien consciente qu'il s'agit d'une campagne de longue haleine, qui nécessitera un investissement sur le long terme, le fort roulement de personnel rend les efforts de syndicalisation particulièrement ardus.
La centrale n'est toutefois pas seule dans cette bataille et elle peut compter sur un allié de longue date : le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI). Actif depuis le début des années 2000, le CTI est devenu un acteur majeur des luttes pour l'amélioration des conditions des travailleureuses migrant·es. Il connait particulièrement bien le milieu des entrepôts puisqu'Amazon n'est pas le seul joueur de ce secteur s'appuyant massivement sur une main-d'œuvre migrante. Si l'objectif du CTI n'est pas directement de conduire à la syndicalisation, il cherche à la fois à aider les salarié·es à faire valoir leurs droits (par exemple en les aidant à déclarer d'éventuels accidents du travail), mais aussi à leur redonner du pouvoir en leur faisant réaliser leur force collective. Les échanges sont nombreux avec la CSN, et les deux organisations communiquent souvent de façon conjointe afin de dénoncer les pratiques d'Amazon.
Travail essentiel, travailleureuses jetables
S'il est une personne dont le nom est attaché au CTI, c'est bien Mostafa Henaway. Québécois d'origine égyptienne, il est un militant de longue date de la cause des travailleureuses migrant·es. Et le terrain, il le connait : il a œuvré dans de nombreux entrepôts, dont ceux d'Amazon. En plus d'essayer d'y améliorer les conditions de travail, il documente soigneusement ses expériences et ses analyses. Une partie d'entre elles ont été récemment consignées dans l'ouvrage Essential Work, Disposable Workers (« Travail essentiel, travailleureuses jetables ») [1]. Ce livre est riche de nombreux témoignages de travailleureuses migrant·es en première ligne des luttes pour la justice sociale, et propose également une fine contextualisation de ces industries et de leurs logiques d'accumulation.
Mostafa Henaway ne qualifie pas Amazon de géant du commerce électronique, mais plutôt de géant de la logistique. Ce n'est pas tant sa plateforme de vente en ligne qui distingue cette entreprise que sa capacité de livrer une quantité toujours croissante de produits, à une vitesse toujours plus élevée. Et les salarié·es, migrant·es surexploité·es et sacrifiables à merci, occupent un rôle central dans ce modèle d'affaires lucratif grâce auquel Jeff Bezos et ses acolytes dégagent leurs vastes marges de profits. Pour Mostafa Henaway, ce n'est donc pas tant la technologie qui a permis l'émergence d'entreprises comme Amazon, mais plutôt le travail migrant. Sans le travail migrant et son lot d'insécurités, de peurs et d'obstacles à l'organisation collective, impossible de voir naitre ces géants de la logistique que nous connaissons aujourd'hui.
En effet, cette réalité est loin d'être l'apanage d'Amazon. Mostafa Henaway documente notamment ses expériences dans les entrepôts de Dollarama, entreprise québécoise devenue elle aussi en quelques années un acteur incontournable du secteur de la logistique, alimentant ses nombreux magasins par le biais d'entrepôts centralisés aux conditions de travail tout aussi déplorables. À l'instar d'autres entreprises du même type, Dollarama utilise aussi un autre outil afin de fragiliser ses travailleureuses : le recours aux agences de travail temporaire. Réalité relativement nouvelle au Québec, ces agences visent particulièrement les travailleureuses migrant·es et sont régulièrement accusées de les tenir dans l'ignorance de leurs droits tout en déresponsabilisant les entreprises au sein desquelles ils et elles travaillent. Si Amazon ne les utilise pas au Québec (ses structures internes lui permettant déjà de flexibiliser considérablement le travail), elle est connue pour y avoir recours dans d'autres pays. On voit ainsi émerger une nouvelle figure, celle du « temporaire permanent » (« perma-temp »), qui voit se succéder les contrats à durée déterminée, tout en restant parfois dans la même entreprise, mais sans aucun horizon de sécurisation professionnelle ou d'avancement, restant constamment à la merci des agences et de leurs clients. Un·e travailleureuse « jetable », en somme.
Au-delà de ces constats assez sombres, Mostafa Henaway voit toutefois des raisons d'espérer. Et elles viennent justement du caractère essentiel de ces travailleureuses dans le modèle d'affaire d'Amazon et de ses semblables. C'est en prenant conscience de leur position centrale dans cette machine à profits que les travailleureuses peuvent saisir le potentiel de leur action collective. Et c'est donc par un patient travail d'éducation et d'organisation que des pistes de solution peuvent émerger. Une réflexion qui n'est pas sans rappeler celle du regretté Aziz Choudry, professeur à l'université McGill et allié de longue date du CTI, ou encore les travaux de la chercheuse Katy Fox-Hodess sur les débardeurs, qui montrent comment les travailleureuses ont su exploiter le plein potentiel de leur « pouvoir structurel » dû à la position centrale de leur travail dans le capitalisme globalisé [2].
Amazon est là pour rester, mais la lutte pour la reconnaissance et la dignité des travailleureuses du secteur grandissant de la logistique ne fait que commencer.
[1] Mostafa Henaway, Essential Work, Disposable Workers. Migration, Capitalism, Class, Halifax et Winnipeg, Fernwood, 2023.
[2] Voir notamment Katy Fox-Hodess et Camilo Santibáñez Rebolledo, « The Social Foundations of Structural Power : Strategic Position, Worker Unity and External Alliances in the Making of the Chilean Dockworker Movement », Global Labour Journal, vol. 11, no 3, 2020, pp. 222-238.
Photo : Joe Piette (CC BY-NC 2.0)

Pour des « négociations permanentes »

Les négociations dans le secteur public suscitent chez moi à la fois cynisme désabusé et enthousiasme militant. Bref billet d'humeur.
Cynisme désabusé, d'une part, parce que les négociations du secteur public sont strictement encadrées, largement au profit du gouvernement. Nous parlons ainsi du droit de grève et du calendrier des discussions pour désigner cette curieuse chorégraphie. Succession des rondes, répétition des mêmes étapes : les uns et les autres entrent en scène et jouent leur rôle. Les échanges stagnent. On s'en indigne. On invoque d'un côté la capacité de payer du contribuable et de l'autre, on dénonce les nombreux et réels problèmes des réseaux. Les syndicats fourbissent leurs armes, obtiennent des mandats de grève, pendant que le gouvernement adopte la posture paternaliste de celui qui prétend défendre la population contre ses propres travailleuses et travailleurs. Puis, soudainement, obéissant à des règles obscures, le rythme s'emballe avant que des ententes de principe ne soient annoncées, lesquelles reçoivent ensuite un assentiment variable, selon les humeurs des membres des syndicats et le contexte politique. Dans tous les cas, les victoires spectaculaires ne sont pas légion.
Enthousiasme militant, d'autre part, parce que l'échéance des conventions collectives entraîne une mobilisation d'une ampleur inhabituelle. La préparation des dépôts syndicaux, prélude à l'élaboration des revendications, s'accompagne d'un exercice exhaustif de recension des problèmes vécus dans les différents réseaux. Le contexte se prête aussi au renforcement ou à la création d'alliances plus ou moins vastes. Tout cela est propice, en théorie, à la formation d'une conscience politique plus aiguë. Les travailleuses et les travailleurs sont ainsi amené·es à réaliser l'ampleur des problèmes auxquels ils et elles sont confronté·es, ce qu'iels partagent et, inversement, ce qui les oppose au gouvernement et à divers autres acteurs sociaux. Cela contribue à créer un sentiment de pouvoir collectif considérable.
Cynisme ou enthousiasme, on reste avec l'impression que le caractère périodique des négociations nous condamne à une certaine insatisfaction. Or, il y a un élément de discours particulièrement inspirant qui revient à chaque ronde. C'est celui qui consiste à mettre de l'avant, non pas uniquement les préoccupations directes des travailleuses et des travailleurs – le salaire, les conditions de travail –, mais la défense et la valorisation des services publics. Cela permet d'ancrer les revendications syndicales dans un discours fondé sur des valeurs fortes – justice sociale, solidarité, intérêt public –, tout en faisant valoir que la satisfaction individuelle des travailleuses et des travailleurs entraîne des bénéfices pour l'ensemble de la population.
Cependant, marteler ce discours pendant quelques mois, à des intervalles de trois à cinq ans, est clairement insuffisant. Il y a une profonde asymétrie entre les parties en présence. Le gouvernement dispose de moyens sans commune mesure avec ceux des organisations syndicales et des groupes de la société civile. Pendant plusieurs années, dans un système politique favorisant malheureusement les comportements autoritaires d'un gouvernement majoritaire, il impose ses choix et son discours. De surcroît, l'alternance politique n'est garante de rien, dans la mesure où la plupart des partis peinent à se distinguer sur le plan idéologique.
On le sait, une négociation qui se conclut n'est pas la fin de l'histoire. Elle pose plutôt les assises de la suivante. Le cynisme de ce texte ne doit pas faire perdre de vue que c'est dans la durée que progresse le sort des travailleuses et des travailleurs. Mais j'en conclus surtout qu'il ne faut pas rendre les armes à la signature des conventions collectives. Le travail le plus important se déroule entre chaque ronde. Il exige de former des alliances avec toutes les personnes et tous les groupes qui partagent les valeurs évoquées dans ce texte, de résister aux tentatives du gouvernement de nous diviser, de repolitiser la vie quotidienne, de militer sans relâche. Je reconnais moi-même l'ampleur de la tâche. Ces exigences, nous devons nous imposer le défi d'y répondre.
Sébastien Adam est professeur de psychologie et vice-président à la négociation du syndicat des professeures et professeurs du Collège de Rosemont.
Illustration : William Murphy CC BY-SA 2.0
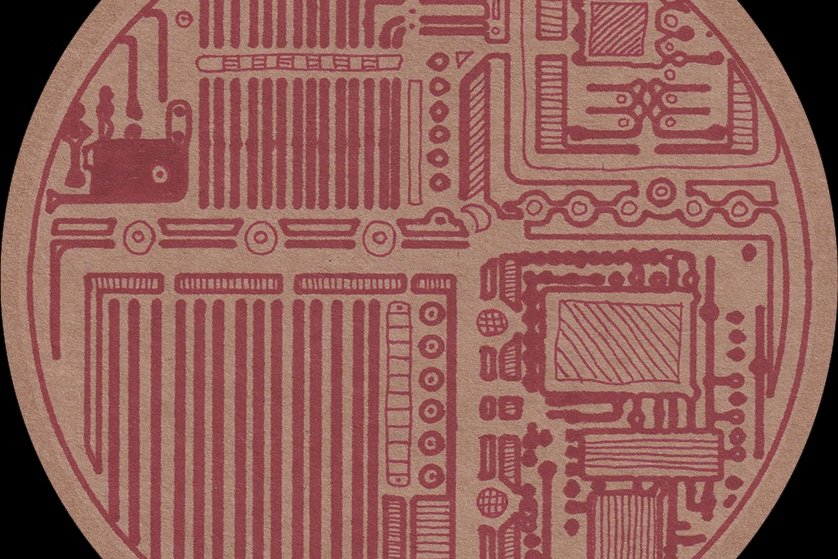
Internet et la raison d’État

Longtemps loué pour son potentiel émancipateur, l'Internet semble être devenu un inquiétant instrument de contrôle aux mains des pouvoirs étatiques et économiques. À l'occasion de la sortie de l'édition québécoise de son livre, intitulé Contre-histoire d'Internet. Du XVe siècle à nos jours (Éditions de la rue Dorion), le sociologue Félix Tréguer revient sur les raisons de cet échec et sur les perspectives actuelles de luttes et de subversions. Propos recueillis par Philippe de Grosbois.
À bâbord ! : Pourquoi parler de « contre-histoire d'Internet » ?
Félix Tréguer : Le choix du terme de contre-histoire est repris de Michel Foucault, qui l'emploie pour désigner une démarche historique à rebours de l'histoire dominante. L'histoire d'Internet – en tout cas, telle que je l'ai d'abord reçue –, c'était cette histoire d'un moyen de communication révolutionnaire, favorisant la démocratie, etc. Une analyse plus critique et plus lucide de l'informatique a pourtant existé, mais tout ça a été quelque peu enterré derrière les utopies numériques des années 1990, nourries à la fois au sein de milieux libertariens de droite et libertaires de gauche, mais aussi par la pensée politique dominante.
ÀB ! : Et pourquoi faire remonter les origines d'Internet au 15e siècle ?
F.T. : C'est une manière de justifier dès le titre l'intérêt d'une histoire de longue durée pour penser la situation historique dans laquelle nous sommes. D'abord, parce que ces utopies communicationnelles ne sont pas propres à Internet. Les stratégies de contrôle et les résistances qui se sont affrontées dans le passé autour de la régulation des moyens de communication passés font également écho à ce qu'on observe s'agissant d'Internet.
Mon livre est une manière de prendre le contre-pied de certaines de ces analyses à partir du travail de Foucault sur le pouvoir, pour montrer en quoi l'espace médiatique est aujourd'hui en train d'entrer dans la logique des sociétés « sécuritaires » ou « de contrôle » (comme les appelait Gilles Deleuze). Cette régulation sociale d'inspiration cybernétique est en rupture avec les principes hérités du libéralisme politique que sont les droits humains, l'un des legs des luttes démocratiques passées intégrés aux régimes bourgeois libéraux. Internet a marqué l'entrée dans ce régime de contrôle basé sur l'informatique, un régime qui aboutit au court-circuitage de dispositifs de l'État de droit dans sa tentative de rétablir des moyens efficaces de surveillance et de contrôle de la liberté d'expression dans l'espace public médiatique.
ÀB ! : Dans votre livre, on n'est pas seulement dans une histoire des communications politiques, mais dans l'histoire d'une certaine raison d'État. Pouvez-vous présenter cette notion et son lien avec les communications ?
F.T. : La raison d'État, c'est cette rationalité froide au fondement du pouvoir moderne, une raison par laquelle on conduit des sociétés de masse, on les rend productives et dociles. Réinterpréter la sphère étatique à travers ce prisme-là, en ce qui concerne les médias, nous permet d'aller à rebours d'une histoire des médias comme un progrès presque continu des libertés et la construction d'une démocratie délibérative chère à Habermas.
Elle permet d'analyser les conquêtes démocratiques dans le domaine des médias comme des concessions de l'État, une manière de lâcher du lest face aux revendications issues notamment des milieux socialistes. À ce stade, à la fin du 19e siècle en France, l'économie des médias s'est de nouveau largement centralisée (en raison des innovations techniques, de la structuration de grands groupes capitalistes adossés aux puissances de la finance, de l'arrivée de la publicité). On peut d'autant plus facilement accorder des libertés en droit qu'en pratique, celles-ci ne renverseront pas l'équilibre politique.
ÀB ! : Qu'y a-t-il dans Internet qui conduit à cette « déstabilisation historique » des mécanismes de contrôle des médias par l'État ?
F.T. : Cela résulte à la fois du projet subversif d'une avant-garde hacker et de ses héritier·ères, de la quantité d'usager·ères qui ne sont pas formé·es au journalisme, ou encore du caractère massif et transfrontière des flux de communication. Cela dit, le livre cherche à relativiser cette déstabilisation. Il y en a eu dans le passé, au moment de la naissance de l'imprimerie, avec la radio et les « sans-filistes » des années 1920 et 1930, etc.
S'agissant de l'histoire de l'informatique, il y a des contradictions aux fondements de cette technologie. Elle est d'abord ancrée dans une rationalité et une histoire qui est celle des grandes bureaucraties, et donc elle est infusée par une rationalité gouvernementale et gestionnaire. Mais elle fait aussi l'objet d'appropriations subversives.
Je pense notamment aux cypherpunks des années 1980 qui ont fait naître la cryptographie citoyenne. Parmi ces innovations, il y a le chiffrement des courriels avec PGP, les serveurs anonymisant qui donneront plus tard le réseau Tor et le projet de WikiLeaks, qui utilise la cryptographie pour faire fuiter des documents en protégeant les lanceurs d'alerte de la répression [1]. Ce petit groupe de cyberactivistes, plutôt anglophone, réunit des cyberlibertariens de droite, voire carrément réactionnaires, mais aussi des libertaires plus à gauche comme Phil Zimmerman qui était aussi engagé dans des luttes antinucléaires.
Tout ça donne lieu à une généalogie ambivalente. Le livre cherche à faire cohabiter ces lignes historiographiques souvent traitées de manière disjointe.
Une autre branche de l'histoire du militantisme numérique est celle de la gauche des mouvements sociaux, plus libertaire et altermondialiste notamment. Dans la deuxième moitié des années 1990 et jusqu'au début des années 2000, l'altermondialisme innove énormément dans les usages militants d'Internet, en transposant certains modes d'action médiatique traditionnels à ces nouvelles technologies.
ÀB ! : Vous commencez le livre d'emblée en disant que « nous avons collectivement échoué ». Quelle est la nature de cet échec et qui sont les responsables ?
F. T. : Je suis engagé depuis plus de dix ans dans La Quadrature du Net, une association française de défense des libertés sur Internet. On travaille à des plaidoyers législatifs, des analyses politiques pour influencer les lois et décrypter certains des enjeux politiques de l'informatique. On essaie – ou plutôt on essayait – de défendre Internet comme un outil d'émancipation et d'accès à la connaissance, on défendait cette utopie héritée des expérimentations militantes que j'ai mentionnées.
Quand je parle d'échec, clairement, la période qu'on traverse est pour le moins adverse. Mais certaines fautes nous sont imputables : une foi parfois aveugle en la technologie, un manque de connaissances historiques qui nourrit des impensés politiques, une certaine naïveté aussi sans doute, et cela en dépit de la créativité et de toutes les choses positives que j'aurais à dire sur ce mouvement de l'activisme numérique.
Nous voyons aujourd'hui se nouer de puissantes alliances entre l'État et les Big Tech pour armer les politiques de surveillance et de censure, à travers des dispositifs automatisés et privatisés, et ce, en lieu et place du tribunal et du juge qui est normalement compétent pour déterminer les limites de la liberté d'expression. On est à l'aube d'un changement de paradigme. La défense des droits humains reste utile et nécessaire pour contester ces nouveaux modes de régulation, mais on est globalement dans un contexte historique où la portée symbolique et l'effectivité pratique de l'imaginaire des droits humains sont passablement reniées. Il s'agit d'en prendre acte pour renouveler nos discours et nos pratiques militantes.
ÀB ! : Dans les médias, on présente plutôt les Big Tech comme les grands gagnants du tout numérique, pendant que l'État essaie tant bien que mal de mettre de l'ordre…
F.T. : Il faut battre en brèche ce récit dominant d'un affrontement entre les grandes plateformes d'un côté, et des États qui vont réguler une économie d'Internet qui leur aurait échappé. Ce à quoi le travail de régulation en Europe aboutit, c'est plutôt l'institutionnalisation des formes d'alliances et d'incorporation de ces grands acteurs du numérique dans les politiques des États, et notamment en matière de censure. On l'a vu en France à l'occasion des révoltes des quartiers populaires qui ont suivi la mort de Nahel Merzouk, un jeune de 17 ans abattu par la police en juin dernier. Dans une initiative extrêmement forte et assumée, le gouvernement a demandé aux réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, Twitter et compagnie de supprimer les vidéos – sans passer par un juge, sans aucune considération pour la liberté d'expression. Les plateformes se sont prêtées de bon gré au jeu.
Ici encore, la notion de raison d'État permet de mettre à distance cette division un peu facile entre public et privé, entre État et entreprises. On voit plutôt la circulation de ces élites, avec certains responsables des affaires publiques de ces grands groupes qui ont été hauts fonctionnaires ou membres de cabinets ministériels. Cela renforce la thèse avancée dans l'ouvrage d'une fusion en cours entre l'État et Big Tech.
ÀB ! : Le livre se termine en affirmant qu'il faut « arrêter la machine ». Qu'est-ce que ça signifie ?
F. T. : Arrêter la machine, c'est d'abord se défaire de deux utopies : une première voulant que nous soyons dans des régimes libéraux et démocratiques, où l'État est une entité qui veille à notre bonheur, et une deuxième qui est cette fascination vis-à-vis de la technologie. Ces impensés dont était en partie héritière une organisation comme La Quadrature du Net, il faut s'en défaire.
Dans le monde d'aujourd'hui, il n'est pas raisonnable de continuer à faire proliférer des machines informatiques (parmi d'autres types de machines), ne serait-ce que pour des raisons écologiques. Ce qui a stimulé ces utopies fondatrices et ce qui a fait que des mouvements politiques dont on se sent proches se sont approprié ces technologies, c'est que celles-ci ont permis de contourner les médias dominants dans l'espace public médiatique, à travers la prolifération d'alternatives. Et pour faire cela, on n'a pas besoin des puces de nouvelle génération, ou des derniers terminaux branchés à notre oreille. L'informatique qu'on avait dans les années 1990 faisait grosso modo le travail. Mettre un ordinateur derrière chaque frigo, derrière chaque objet, dans toutes les voitures, bref cette prolifération de l'informatique est en soi un problème.
Arrêter la machine, c'est aussi se réapproprier la question des techniques médiatiques et de leurs usages. L'histoire peut être une source d'inspiration, car dans les inventions tactiques issues de l'altermondialisme, dans les idées fondatrices de l'époque du premier Web, il y avait plein de belles idées. Il y a eu l'expérience d'Indymedia, adossée à des stratégies médiatiques qui produisaient des choses intéressantes. L'histoire des médias antérieurs à Internet nous rappelle aussi qu'on n'a pas fondamentalement besoin d'ordinateurs pour faire des médias décentralisés, alternatifs et militants. On arrivait à construire une vraie efficacité politique sans ces technologies hypersophistiquées.
Arrêter la machine, c'est enfin assumer une posture de refus face à l'informatisation du monde. Du côté de La Quadrature, on est passé d'un travail autour de la régulation politique d'Internet à un intérêt pour les technologies numériques et à leurs impacts politiques en général. Nos évolutions stratégiques nous ont par exemple conduits à faire campagne en 2019 contre les nouvelles technologies policières. Ici, on n'est plus sur la régulation du Web, mais sur la prolifération de l'informatique et ce qu'elle génère en matière de contrôle social. Lorsqu'on parle de police prédictive ou de vidéosurveillance automatisée à l'aide de l'IA, La Quadrature est dans une posture de refus, une posture qu'on pourrait qualifier d'abolitionniste vis-à-vis ces technologies. Après, au sein du collectif, on peut avoir des avis différents sur à quel point il faut renoncer à la technologie et à ses dangers. Mais je crois qu'on est toutes et tous d'accord pour dire qu'il faut se défaire de ce discours obsédé par l'innovation technologique, très bien résumé par Emmanuel Macron lorsqu'il parlait de la France comme une start-up nation en devenir. Dans notre monde, les technologies numériques sont l'une des principales bouées du capitalisme industriel et elles participent directement d'un modèle de développement écocide, patriarcal et néocolonial. Il nous faut dézinguer cet imaginaire chaque fois que la possibilité nous en est donnée.
[1] Voir aussi Anne-Sophie Letellier, « Les Crypto Wars », À bâbord !, no 85, automne 2020. Disponible en ligne.
Félix Tréguer, Contre-histoire d'Internet. Du XVe siècle jusqu'à nos jours, Montréal, Éditions de la rue Dorion, 2023, 504 p.
Suivez le travail de La Quadrature du Net à https://www.laquadrature.net/
Illustration : Elisabeth Doyon

Couverture médiatique à l’international au Québec : le parent pauvre de l’information

Année après année, sauf exception, les palmarès de l'actualité placent rarement plus d'un événement international parmi les dix ou quinze plus marquants, ce qui pose d'emblée la question de savoir si les médias et le public s'intéressent à ce qui se passe au-delà de nos frontières.
Outre les quelques correspondant·es de Radio-Canada dans quelques grandes capitales, le Québec compte à peine une poignée de correspondant·es ou collaborateur·rices à l'étranger. Cette situation gêne lorsqu'on se compare à la France, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, dont les réseaux d'information ratissent le monde. De Jérusalem à Dakar, de Delhi à Bangkok, de Johannesburg à Rio, les médias des grandes puissances occidentales balisent le monde de correspondant·es, de pigistes, d'envoyé·es spéciaux·ales qui font remonter chaque jour des informations, des reportages, des entrevues, des analyses dans leurs pays respectifs. Hors de l'Occident, la Chine a développé son agence étatique Xinhua et son réseau radio et télé CGTN, tous déclinés en dizaines de langues. Le Japon entretient un réseau de correspondant·es par l'entremise de ses agences de presse et de sa chaîne NHK, tandis qu'Al Jazeera n'a cessé d'ouvrir des bureaux à l'étranger, sa couverture dépassant désormais largement les frontières initiales du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Même les médias de pays de taille comparable à celle du Québec, comme la Suisse ou les pays scandinaves, ont une empreinte internationale notoire. Plusieurs déploient un réseau de correspondant·es et d'envoyé·es spéciaux·ales qu'on ne manque pas de remarquer sur le terrain partout dans le monde. Tout ça au point où un lecteur d'ici passionné par l'international aura tendance à s'abreuver à ces différentes sources d'information étrangères plutôt que d'attendre qu'un média d'ici l'alimente.
Une concurrence déloyale
À ce titre, il existe une sorte de concurrence déloyale, ou plus exactement des fondamentaux démographiques, historiques et géographiques qui peuvent expliquer les raisons d'une faible empreinte internationale dans nos médias. D'abord, le Québec a une faible population – 8,6 millions d'habitant·es – et donc un marché médiatique plus restreint, ce qui rend plus difficile pour les médias d'ici de rentabiliser ou d'amortir les coûts d'un reporter à l'étranger. Malgré tout, les médias d'ici dépêchent des envoyé·es spéciaux·ales à l'occasion. Ensuite, le Québec n'est ni une grande puissance ni un ancien empire ayant eu des colonies en dehors de son territoire national, ce qui induit forcément un autre rapport au monde. Ce rapport peut être très positif pour les reporters d'ici, dégagé·es d'un certain poids ou malaise historique, mais il fait aussi en sorte que l'on s'intéresse moins à certaines régions du monde. Enfin, le Québec ressemble parfois à une grande île postée en première couronne d'un empire américain qui la protège. Nous sommes loin du reste du monde, mais au pas de la première puissance mondiale qui est aussi notre premier partenaire économique et militaire. Cette situation géographique, ou plus exactement géostratégique n'est pas sans conséquence pour le monde de l'information : les États-Unis prennent une très grande place dans notre consommation de l'information internationale. Certain·es diraient même trop grande lorsque le récit américain vient à monopoliser notre intérêt sur le monde hors de nos frontières.
L'ailleurs pour notre propre épanouissement
Si le Québec n'est pas une grande puissance, il demeure traversé de part en part par la mondialisation. Par ses échanges économiques, ses touristes à l'étranger, ses travailleur·euses humanitaires, ses diplomates, mais surtout par sa politique migratoire, le Québec s'inscrit de plain-pied dans la mondialisation. Et cela comporte au moins deux conséquences : ce n'est pas de moins d'information internationale dont nous avons besoin, mais de plus, et nous avons besoin d'une information internationale assumant nos regards sur le monde. Plus d'information internationale et plus d'information racontée par nous et pour nous, en s'inscrivant dans nos débats de société.
Cela ne veut pas dire de chercher coûte que coûte les Québécois·es à l'étranger qui nous raconteront leur monde, mais plutôt d'assumer que se posent chez nous des questions qui méritent un éclairage extérieur. Et cet éclairage permettra peut-être de faciliter le vivre ensemble, de prendre de meilleures décisions politiques, de mieux gérer nos ressources. Par exemple, des milliers de travailleurs saisonniers moissonnent les champs du Québec. Mais quelle est la vie de ces travailleurs et travailleuses essentiel·les une fois rentré·es dans leurs pays ? Quelle situation fuient les Nigérian·es qui traversent le chemin Roxham ? Alors que le gouvernement réenvisage un troisième lien entre Québec et Lévis, il faut voir comment d'autres villes du monde de taille similaire ont géré les questions de mobilité. Les pêcheurs de crabe de Gaspésie craignent une migration des crustacés en raison du réchauffement des eaux, mais qu'en est-il pour les pêcheurs de l'Alaska ? Y a-t-il des leçons à tirer, des façons d'anticiper ce qui s'en vient ? Les exemples de la sorte sont légion et témoignent de l'importance du reportage international pour notre épanouissement collectif.
Quelles solutions ?
Les solutions sont nombreuses pour revaloriser le reportage international québécois. Fondé il y a cinq ans, le FQJI bénéficie du soutien des entreprises, des organismes publics et des syndicats qui, par leurs dons, financent ensemble les dépenses de reportage à l'étranger de journalistes œuvrant pour des médias d'ici. En cinq ans, le Fonds a octroyé plus de 300 000 $ en bourses diverses ayant permis à plus de 60 journalistes de se rendre dans une cinquantaine de pays pour livrer au public québécois au moins 150 reportages originaux. Ces articles et ces reportages radio, télé ou Web ont été diffusés dans près d'une vingtaine de médias, ce qui permet de toucher un vaste public malgré la fragmentation des auditoires.
Le FQJI est une structure unique au monde. À notre connaissance, aucune autre organisation n'a réussi à rallier les secteurs privé et public ainsi que des syndicats pour le front commun et concret de l'information internationale. Cinq ans après sa naissance, ce fonds aussi unique qu'utile doit être consolidé, renforcé, étendu, et ce, pour notre bien collectif.
Hélas, chaque année, des dizaines de projets de reportage pertinents, bien ficelés, ne peuvent être financés, faute de fonds. Les médias d'ici ne peuvent assumer à eux seuls la facture qui vient avec la couverture de l'actualité internationale. Au cours des dernières années, les médias ont vu les géants du Web, les GAFAMs, s'emparer d'une part majeure de leurs revenus publicitaires, au point de menacer leur survie et celle de tout l'écosystème médiatique. Lorsque les médias peinent à payer le salaire de leurs journalistes, comment leur demander d'assumer le coût de reportages à l'étranger ?
Photo : Mike Mertz (CC BY-NC 2.0)

La grève des fros, Abitibi 1934

En 1993, le musicien engagé Richard Desjardins rappelle à notre mémoire collective la grève des fros qui s'est déroulée en juin 1934 à la mine Noranda en Abitibi. Depuis, les militant·es connaissent sa chanson emblématique, mais beaucoup moins l'histoire derrière. Un retour sur cette grève pionnière, courageuse et radicale s'impose afin de comprendre son importance pour le mouvement ouvrier. Par-delà sa féroce répression, l'action des fros demeure exemplaire.
À partir de la fin du 19e siècle, les régions du Témiscamingue puis de l'Abitibi sont progressivement développées. On tente d'y instaurer des communautés agricoles tout en exploitant les ressources naturelles, dont le bois et le minerai. En raison de la difficulté à cultiver des terres à cette latitude, de nombreux colons [1] finissent par travailler dans les chantiers forestiers et dans les mines. Les compagnies profitent de la complaisance des gouvernements et de la disponibilité de cette main-d'œuvre pour exploiter les ressources et la population, engrangeant d'énormes profits au passage. Malgré tout, le développement des mines d'or et de cuivre le long de la faille de Cadillac nécessite toujours plus de bras et les compagnies font venir des mineurs d'Europe de l'Est par milliers au tournant des années 1930.
Dans ce contexte, la Noranda Mines Limited, une société appartenant à des investisseurs new-yorkais, fonde en 1926 la ville éponyme dédiée à l'extraction et à la transformation du cuivre. La ville est sous le contrôle total de l'entreprise grâce à un statut dérogatoire octroyé par le gouvernement. La mine et la fonderie Horne entrent en activité l'année suivante, entraînant une arrivée massive de travailleurs canadiens, finlandais, yougoslaves, polonais, russes et ukrainiens. Au début des années 1930, les villes de Noranda et de Rouyn comptent plus de 5 500 habitant·es, dont 1 300 sont employé·es dans la mine. L'existence y est difficile, mais avec la Grande Dépression et le chômage qui perdurent, la compagnie se permet d'imposer ses conditions… du moins, jusqu'à l'arrivée du syndicat au début de l'année 1933.
La Mine Workers' Union et la grève de 1934
À l'époque, les conditions sont particulièrement éprouvantes pour les mineurs qui travaillent six ou sept jours par semaine, 10 à 12 heures par jour, pour un salaire de 60 cents de l'heure. Les mineurs de fond sont exposés à la poussière de silice et au bruit, sans ventilation adéquate ni équipement de protection. Ils sortent détrempés du trou, « et rentrer en habits mouillés, ce n'était pas drôle, surtout l'hiver quand il fallait traverser à pied le lac gelé, balayé par le vent, parce qu'il n'y avait pas de service d'autobus dans ce temps-là » [2]. Quant aux travailleurs immigrants, d'Europe du Nord et de l'Est – les fros, une contraction du mot « foreigners » (« étrangers ») – ils sont à risque de se faire expulser du pays s'ils ne respectent pas les consignes de leurs patrons. C'est pourtant au sein de ces communautés migrantes, dont sont issus 50 % des mineurs de Noranda, que se développent une conscience politique et une première activité syndicale. Plusieurs de ces travailleurs possèdent une expérience militante et savent que, malgré les menaces, c'est par l'action collective qu'ils ont une chance d'améliorer leur sort.
Un certain nombre de mineurs adhèrent à la Mine Workers' Union of Canada (MWUC) à partir de 1933. Ce syndicat, principalement implanté en Ontario, est affilié à la Workers' Unity League, une organisation communiste connue pour sa combativité. Le syndicat recrute principalement auprès des travailleurs étrangers, qui soit connaissent déjà l'organisation pour l'avoir côtoyée dans d'autres villes minières, soit y sont favorables en raison de leurs conditions exécrables. De plus, une partie des fros sont liés au Parti communiste du Canada, bien implanté dans la région de Noranda et qui encourage les initiatives du MWUC. Le syndicat organise les travailleurs en cellules, permettant d'éviter un démantèlement de tout le réseau en cas d'infiltration policière. Le 11 juin 1934, les mineurs présentent leurs demandes au patron de la mine, Harry Roscoe : ils veulent la reconnaissance de leur syndicat, la journée de huit heures de travail, une ventilation adéquate dans les tunnels et une augmentation de 6 cents de l'heure. Face à l'intransigeance de Roscoe, la grève est déclenchée le lendemain.
Plus de 300 mineurs de fond participent au débrayage, très majoritairement des Européens de l'Est, et bloquent l'entrée du puits avec l'aide de centaines de sympatisant·es. La compagnie, qui contrôle les autorités locales, maltraite les grévistes et fait emprisonner ceux qu'elle considère comme les meneurs. Roscoe refuse toute négociation par crainte de créer un précédent et fait appel à des briseurs de grève, en majorité canadiens-français. Les grévistes répondent par le « cloutage » des routes afin de crever les pneus des camions qui acheminent les scabs vers la mine. La stratégie patronale se fonde à la fois sur la répression et la division des travailleurs, avec un usage retors des fractures raciales et de la peur du communisme chez les Canadiens. Enfin, on mise sur la pauvreté généralisée pour monter les ouvriers dans le besoin les uns contre les autres. Ces stratagèmes portent fruit et la grève prend fin le 22 juin 1934. Plusieurs dizaines de mineurs sont condamnés à des peines de prison, d'autres sont expulsés du Canada dans les semaines qui suivent. À la fin de l'été 1934, la moitié des travailleurs étrangers de la mine ont été licenciés en raison de leur activité syndicale, soit plus de 350 personnes.
« Reprendre notre place dans la lutte des classes »
[3]
La répression brutale de la grève des fros a porté un dur coup au mouvement syndical et socialiste des années 1930 et 1940, d'autant qu'elle était couplée à une diabolisation patronale et ecclésiale des idées progressistes. Pourtant, cette grève a permis au moins deux avancées notables. D'abord, les conditions des mineurs ont été peu à peu améliorées durant les années suivantes, sous la menace persistante d'un nouveau débrayage. Ensuite, cette expérience de lutte a fourni un modèle pour l'organisation politique dans les milieux de travail, repris par les communistes et d'autres lors de différents conflits, dont les grèves du textile en 1937 et en 1946, ou lors des grèves de l'amiante en 1949, de Louiseville en 1952 et de Murdochville en 1957. Sans prétendre à un rôle constitutif de la grève des fros, on ne peut nier son importance dans l'élaboration d'une stratégie syndicale offensive, et ce, malgré la « grande noirceur » québécoise.
Plus qu'une mise en garde contre la division qu'entraîne le racisme ou qu'un simple épisode de notre histoire, la grève des fros nous rappelle l'importance du rapport de force lorsque vient le temps de lutter pour nos droits et le rôle que doit jouer la politique dans les conflits de travail. L'amélioration de nos conditions et, à terme, l'instauration d'une société égalitaire dépendent de notre capacité collective à nous imposer face aux capitalistes. La grève de 1934 n'a pas été immédiatement victorieuse. « Ç'a été joliment dur pour ces gens-là parce que c'était une grève illégale et inorganisée, on va dire. Et puis ces gens-là n'ont certainement pas eu le mérite, le crédit qu'ils auraient dû avoir de cette grève-là. » [4] Mais les fros ont laissé en héritage de meilleures conditions pour tous les mineurs, ainsi qu'une ambition et une détermination à changer radicalement le monde. À nous de prendre le relais contre la fonderie Horne [5] et toutes les grandes industries capitalistes qui détruisent nos vies.
[1] Le masculin est employé pour référer à certains corps de métier réservés aux hommes à l'époque, dont les bûcherons et les mineurs.
[2] L., mineur à Noranda, cité par DUMAS, Evelyn. Dans le sommeil de nos os, Montréal, Leméac, 1971, page 27.
[3] Message collectif de 15 grévistes, adressé à leurs camarades, lors de leur libération de la prison de Bordeaux après deux années d'enfermement, en juin 1936.
[4] Entrevue réalisée en 1976 avec Rémi Jodouin, mineur et syndicaliste abitibien.
[5] Pour connaître les malversations de la Noranda Mines Limited (achetée en 2006 par Xstrata, puis en 2013 par Glencore) et de la fonderie Horne, on consultera le récent ouvrage de CÉRÉ, Pierre. Voyage au bout de la mine. Le scandale de la fonderie Horne, Montréal, Écosociété, 2023.
Alexis Lafleur-Paiement est membre du collectif Archives Révolutionnaires (archivesrevolutionnaires.com).
Photo : Grévistes devant la Fonderie Horne, 1934 (Bibliothèque et Archives Nationales du Québec).

Convergence technologique anarchiste de Montréal

Plusieurs personnes militantes ont cru dans le passé que le développement de l'informatique, en particulier celui de l'Internet, permettrait de nouvelles formes de communication, de luttes et même la création d'espaces autonomes en accord avec leurs valeurs. Cependant, il est maintenant clair que les capitalistes se sont approprié plusieurs de ces idées pour influencer et imposer leur vision sociale, tout en devenant les monstres géants qui dominent désormais le développement technologique.
En septembre 2024, la Convergence technologique anarchiste de Montréal a réuni en congrès les anarchistes souhaitant examiner les rôles potentiels de la technologie dans nos vies et nos luttes.
À bâbord ! : Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à organiser cette rencontre ?
Convergence technologique anarchiste de Montréal (CTAM) : Deux membres du comité organisateur se sont initialement rencontré·es lors de la première édition de Splintercon, à Montréal, à la fin de 2023. Cet événement était organisé par eQualitie, un OBNL montréalais dédié à la création de services Internet décentralisés dans un but d'équité et d'égalité sur le réseau. Même si l'événement était intéressant et qu'on y traitait de certaines dynamiques liées à l'impérialisme occidental, plusieurs des solutions semblaient portées par des entreprises privées et non des communautés. De plus, il n'y avait pas vraiment d'espace pour discuter d'options en dehors du capitalisme : les personnes participant à l'événement étaient en majorité des chercheuses et chercheurs que l'on peut diviser en deux groupes selon leurs moyens : les personnes associées à des universités ou des OBNL, et celles liées à des entreprises de communication. Dans le premier cas, les projets ne disposent pas des moyens ou de l'infrastructure technique nécessaires pour concrétiser leurs idées autrement qu'à petite échelle. Dans le second cas, les entreprises de télécommunication ont les moyens et l'infrastructure, mais consacrent ces ressources à garder l'Internet libre tant que c'est possible d'en tirer des profits. Il y a donc peu de place pour les projets communautaires et à but non lucratif.
Ces constats ont mené à l'idée de mettre en place un événement similaire, mais organisé par et pour les anarchistes afin de discuter des enjeux que nous trouvons importants et des solutions que nous avons à proposer dans une perspective qui est la nôtre. La Convergence est ouverte à tout le monde qui s'intéresse aux technologies dans une perspective émancipatrice.
ÀB ! : Est-ce que la rencontre a permis d'entrevoir une nouvelle place pour l'informatique comme outil de résistance ? Quels moyens pour éviter l'appropriation capitaliste ?
CTAM : Dans les dernières décennies, le Web et la culture des hackers ont grandement été récupérés par le capitalisme.
Par le passé, il y avait une culture beaucoup plus forte du Web ouvert et décentralisé, ainsi que du développement de logiciels libres pour répondre aux besoins de la communauté sans nécessairement attendre une compensation financière. Il y a des critiques à faire à cette culture du logiciel libre, particulièrement quand on regarde qui a le temps et les ressources pour accorder un grand nombre d'heures à du travail non rémunéré. Cependant, il y a probablement des façons de rémunérer les gens en dehors de startups financées par du capital risque et qui, après quelques années à développer un logiciel libre, le transforme en logiciel propriétaire pour faire plus d'argent et répondre aux attentes des investisseurs.
Beaucoup d'hacktivistes d'autrefois sont aujourd'hui des employé·es d'entreprises militaires ou de sécurité, et ne sont plus impliqué·es dans des activités subversives. De la même manière, un grand pan du mouvement des hackers était constitué de gens qui démontaient des logiciels ou qui les pirataient pour mieux comprendre le fonctionnement d'une technologie ou libérer le savoir. Il reste encore quelques communautés de ce genre, mais elles sont beaucoup moins nombreuses qu'avant.
Nous n'avons pas de plan quinquennal ou de programme, mais nous croyons que des événements comme la Convergence peuvent permettre la rencontre des gens, la tenue de discussions et l'émergence de projets afin que cette culture des hackers reprenne de la vigueur, qu'elle puisse à nouveau être subversive et intervenir sur les différentes tensions qui traversent la société.
ÀB ! : Quelle lecture l'anarchisme permet-il de faire de l'évolution de l'informatique ? Pourquoi est-il important d'avoir un événement où échanger au sujet de l'informatique avec une perspective spécifiquement anarchiste ?
CTAM : Beaucoup d'anarchistes, dans leur volonté de combattre les systèmes d'oppressions et de construire des alternatives au capitalisme, en sont venu·es à développer une réflexion critique face aux technologies. Avec la montée du capitalisme algorithmique et de surveillance ainsi que l'exploitation des données personnelles qui est de plus en plus omniprésente, nous croyons qu'une telle critique est importante à développer.
Beaucoup d'idées que les anarchistes mettent en pratique dans leurs communautés (prise de décision collective, gestion de conflits, respect des réalités de chacun·es, etc.) peuvent être utiles pour réfléchir les développements technologiques ou l'hébergement de services dans une perspective émancipatrice et communautaire. Le développement logiciel n'est pas qu'un problème technique, c'est aussi un problème humain. Bien souvent, particulièrement quand on développe un produit afin de faire du profit, on peut remarquer une tendance à évacuer les impacts sociaux et politiques afin de valoriser uniquement la prouesse technologique.
Si nous développions des logiciels dans l'objectif de répondre aux besoins de nos communautés, il serait possible de discuter du « coût social » d'une nouvelle fonctionnalité. Par exemple, si, pour développer une nouvelle fonctionnalité en apparence « cool », il est nécessaire de récolter certaines données sur les personnes utilisant le logiciel, il faut aussi penser que cela pourrait permettre certaines formes de discriminations.
De plus, nous ne vivons pas en dehors de la société et nous utilisons l'Internet et les technologies dans nos vies personnelles ainsi que dans nos luttes ; il est donc important d'avoir des moments pour discuter des façons d'utiliser les technologies sécuritairement et de se protéger des technologies utilisées par l'État pour réprimer les mouvements sociaux.
ÀB ! : Est-ce que vous considérez que les mouvements de gauche dans un sens large, comme les mouvements syndicalistes et communautaires, s'intéressent assez aux questions technologiques ? Est-ce qu'on devrait imiter l'idée de la CTAM dans d'autres milieux ?
CTAM : Les technologies sont souvent des outils du quotidien et moins au cœur du travail d'un organisme ou d'un syndicat. Même si cela peut expliquer le manque d'intérêt pour les technologies, nous croyons que maintenir des infrastructures indépendantes est primordial, particulièrement dans le contexte de la montée de l'autoritarisme.
Il serait probablement intéressant que des acteurs et actrices du milieu de l'informatique libre organisent un événement comme la Convergence afin de discuter des alternatives aux grandes multinationales, mais aussi de voir s'il n'y aurait pas moyen de mutualiser des ressources afin de rendre les technologies libres plus accessibles aux organismes communautaires et aux syndicats.
ÀB ! : Quel est l'avenir de la Convergence technologique anarchiste de Montréal ? Est-ce que cet événement sera récurent ?
CTAM : Il y aura une édition 2025 de la Convergence, dont les dates seront bientôt annoncées. Toutes les informations seront disponibles sur notre site Web. Nous avons aussi organisé un événement sur les réseaux maillés en mai dernier au hackerspace foulab, dans le cadre du festival anarchiste Constellation. Par contre, étant donné le contexte sociopolitique incertain et le fait que nous sommes toutes et tous déjà impliqué·es dans d'autres projets, nous ne nous avancerons pas sur la récurrence de l'événement à long terme.
Illustration : Ramon Vitesse

Constater le temps qu’il fait. Réplique à François Cardinal

On dit parfois que lorsqu'une personne affirme qu'il fait soleil et qu'une autre soutient qu'il pleut, le travail d'un·e journaliste n'est pas de dire qu'il y a controverse, mais plutôt d'aller dehors pour constater le temps qu'il fait. De même, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle était « la plus ouverte au débat public » et que d'autres rétorquent qu'elle était son « fossoyeur », le travail du journaliste est de mener des recherches et d'exercer son jugement critique.
Dans son plus récent Carnet de l'éditeur adjoint, François Cardinal reproche un manque d'équilibre aux personnes qui critiquent une certaine complaisance dans la couverture médiatique québécoise de la vie et de la mort de Charlie Kirk. À ses yeux, ces critiques refusent de « reconnaître chez Kirk une part de charisme » ou « une aptitude à rallier des jeunes marginalisés dans le débat politique ».
Or, ce portrait m'apparaît caricatural. Il ne s'agit pas de nier le charisme de Kirk ou ses habiletés d'organisateur. Seulement, si on ne fait pas mention d'autres versants de sa personne et de son travail, on passe à côté de faits essentiels pour saisir la nature de l'événement et ce faisant, on ne rend pas service au public.
Par exemple, si on attribue uniquement le succès de Turning Point USA (l'organisation fondée par Kirk) au talent ou au style argumentatif de l'activiste, on néglige le fait que ce groupe a reçu près de 400 millions de dollars américains en financement de la part de milliardaires, entre 2012 et 2023.
Parions qu'avec autant d'argent, des étudiant·es voulant débattre du définancement des forces policières ou du génocide à Gaza susciteraient aussi des débats d'envergure sur les campus états-uniens ! En omettant de mentionner cette information, on présente un portrait tronqué, voire trompeur, du phénomène Kirk, en l'attribuant seulement aux qualités d'une personne plutôt qu'à de puissantes forces économiques et politiques.
Le problème est encore plus criant lorsqu'on prête à Kirk, comme François Cardinal le fait, « une volonté de défendre la liberté d'expression ». On a ici aussi un portrait insatisfaisant (et très fréquent dans les médias québécois) des positions politiques de l'activiste. En effet, il serait plus juste de dire que celui-ci défendait la liberté d'expression de points de vue avec lesquels il était en accord. Ces six mots font toute la différence. Dans le cas de points de vue opposés au sien, Kirk avait un tout autre avis.
Selon Kirk, les personnes qui portent des vêtements autres que ceux convenant au sexe assigné à leur naissance sont « une abomination à Dieu ». Il a aussi suggéré que Joe Biden devrait recevoir la peine de mort. Kirk a également initié une « Professor Watchlist », regroupant des centaines de noms de professeurs, avec des étiquettes telles que « Supporteur du terrorisme », « LGBTQ », « Antifa » et « Socialisme ». Ce type de liste, typique des régimes autoritaires ou fascistes, est une porte ouverte aux fans de Kirk pour qu'ils intimident et menacent ces enseignants et donc limitent leur liberté académique et d'expression.
Voilà pourquoi associer Kirk à une simple défense de la liberté d'expression est non seulement incomplet mais fallacieux. Ce qui est dénoncé par plusieurs, ce n'est pas qu'on ait relevé le talent de Kirk, mais plutôt l'euphémisation et l'omission de ses propos à l'endroit de ses opposants politiques ou de personnes marginalisées. À ma connaissance, la première journaliste de La Presse à traiter de la substance du propos de Kirk en ayant recours à des exemples concrets est Rima Elkouri, après 5 jours d'intense couverture médiatique.
Pourtant, ces faits (j'insiste : ce sont des faits objectifs) sont essentiels à la compréhension du personnage. Les adeptes de régimes autoritaires sont toujours ravis de défendre la liberté d'expression de points de vue qu'ils approuvent. Trump lui-même s'est insurgé contre la « censure woke » à plusieurs reprises ces dernières années, y a-t-il encore des gens qui en déduisent qu'il est un adepte de la liberté d'expression ?
Au-delà de cet épisode lui-même, il m'apparaît essentiel de réfléchir à la manière dont l'appel au « dialogue » a été récupéré et dévoyé par des factions politiques qui souhaitent d'abord et avant tout libérer la parole intolérante de l'opprobre et réprimer par la violence les discours de leurs opposants.
Ce texte a d'abord été envoyé à La Presse, mais l'invitation au dialogue public a été refusée par la rédaction.
Image : Pixabay
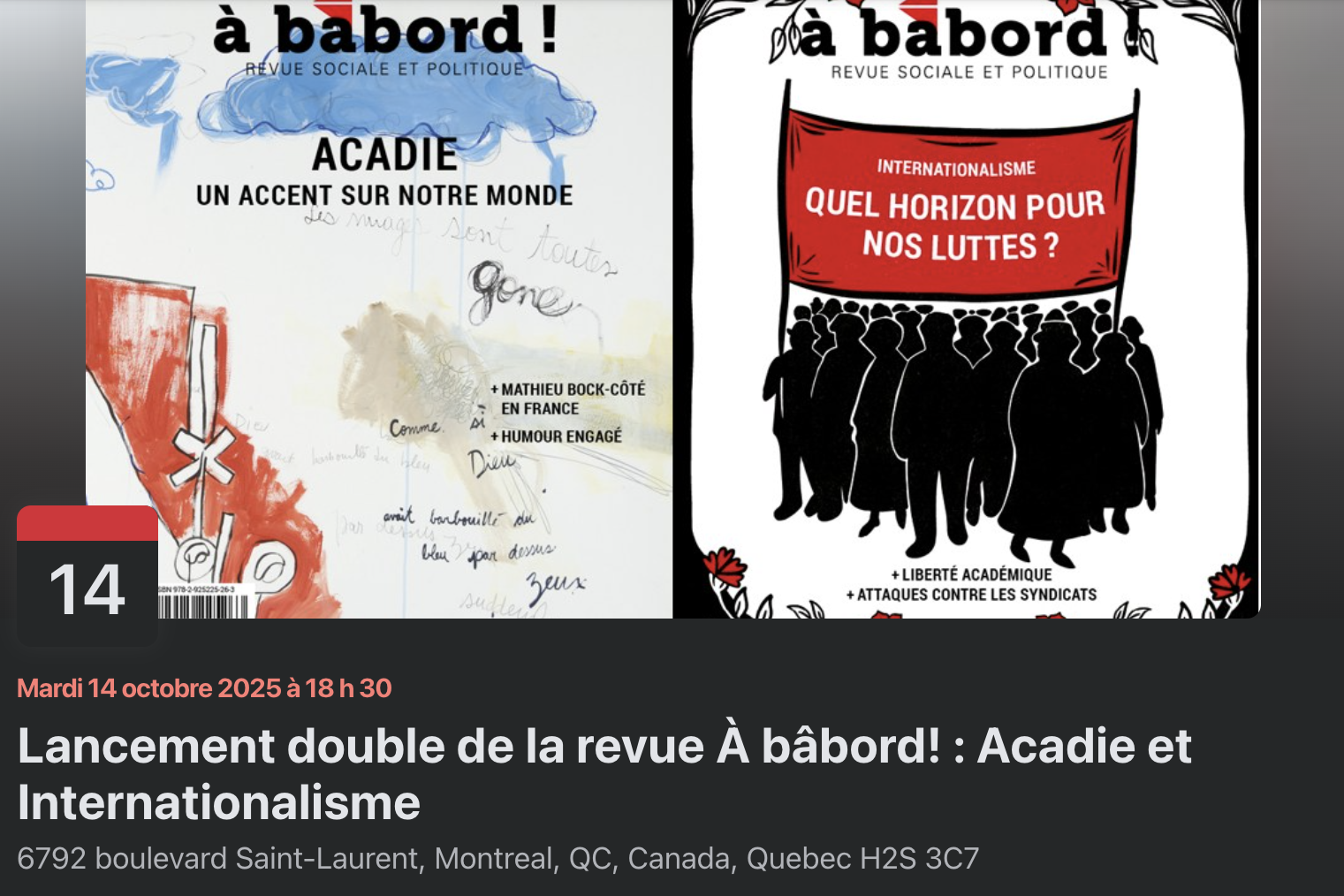
Lancement double le 14 octobre !

La parution du numéro 104 (et son dossier sur l'Acadie) et du numéro 105 (et son dossier sur l'internationalisme) seront soulignés à la librairie N'était-ce pas l'été (6702 St-Laurent, Montréal).
Mardi 14 octobre à 18h30. Entrée libre, bienvenue à toutes et à tous !

Rouyn-Noranda vs. Glencore : « Ça concerne tout le monde »

Le 26 août 2023, 900 personnes se mettent en marche au centre-ville de Rouyn-Noranda. Il fait plein soleil, l'ambiance est à la fête, mais l'indignation demeure au rendez-vous, comme en témoignent les slogans repris en chœur par la foule. Dans le dernier droit, avançant de pied ferme vers l'imposante silhouette de la Fonderie Horne, on scande sans relâche : « Nos vies, nos vies, valent plus que leurs profits ! »
Pour Jennifer Ricard-Turcotte, l'une des organisatrices de l'événement, c'est mission accomplie. La coalition de groupes militants à l'origine de la mobilisation a réussi à faire crier haut et fort par la population la rumeur qui circulait entre les branches et les microparticules d'arsenic depuis le printemps : « Y'en a pas, d'acceptabilité sociale. »
« C'est pas vrai qu'on va se taire »
Retour à l'automne 2022. En pleine campagne électorale, François Legault se présente à Rouyn-Noranda. Le climat social est tendu. Les mois précédents ont été fastes en révélations scandaleuses concernant les impacts des activités de la Fonderie Horne sur la santé des citoyennes et des citoyens. La population est inquiète et réclame des changements. En point de presse concernant les cibles de l'usine pour la réduction de ses émissions d'arsenic et de métaux lourds, le premier ministre déclare : « C'est pas à moi de prendre la décision, c'est à la population de Rouyn-Noranda ». Lesdites cibles prévoient une diminution des émissions d'arsenic de la Fonderie Horne pour atteindre une concentration maximale de 15 nanogrammes par mètre cube d'air d'ici 2028, soit cinq fois plus que la norme québécoise de 3 ng/m3, sans délai imposé pour atteindre cette norme, et avec des dépassements allant jusqu'à 22 fois la quantité permise dans les premières années. Ce plan, qui fait l'objet d'une consultation publique, est majoritairement rejeté par les personnes répondantes. Le message paraît clair : les objectifs sont insuffisants.
Pourtant, le 16 mars 2023, la nouvelle entente ministérielle annoncée entre le gouvernement du Québec et la Fonderie Horne reprend très exactement ces cibles, assorties de la création d'une zone tampon nécessitant la relocalisation d'environ 200 ménages et la mise à terre de 80 bâtiments dans le rayon le plus rapproché de la fonderie. Sur ce projet, la population n'a jamais eu son mot à dire. À ce jour, le processus de relocalisation et d'indemnisation demeure flou pour les personnes concernées, à qui on refuse une place à la table de négociations. Pourtant, les conséquences potentielles sur le tissu social et sur la précarité des citoyen·nes sont nombreuses. En pleine crise du logement, on s'apprête à relocaliser les gens d'un quartier riche d'histoire, de culture et d'entraide, mais aussi marqué par de nombreux problèmes sociaux. Au vu du prix des loyers actuels, ces derniers ne peuvent que se retrouver en HLM.
Johanne Alarie, une organisatrice locale, résume le contexte de mobilisation du 26 août : « La marche, c'était vraiment pour dire qu'on n'accepte pas l'autorisation ministérielle. C'est pas vrai qu'on va se taire pendant cinq ans, qu'on va arrêter de bouger. Y'a des choses qu'on veut qui restent, mais c'est insuffisant, ça va pas assez vite. Quinze nanogrammes, on a dit que c'était ok pour la première année, that's it, pas dans cinq ans. »
Une mobilisation pas comme les autres
Dès le mois de juillet, les organisateurices de la marche commencent à se rencontrer chaque semaine. Cinq comités et des dizaines de citoyen·nes prennent part aux préparatifs de la marche du 26 août et des activités qui l'entourent. S'ajoutent à cela des membres de collectifs citoyens engagés pour la justice environnementale venant de partout au Québec. Pour les personnes organisatrices interrogées, la présence de ces nouvelles voix a eu des effets très bénéfiques. Elle a permis de donner à la lutte une ampleur nationale, de revalider l'indignation des groupes locaux, de tisser des liens humains et de partager des expertises nouvelles : « Le non-respect des normes, ça concerne tout le Québec. Les gens sont venus en support à Rouyn-Noranda, mais aussi parce qu'ils se sentent concernés. On a pu sensibiliser de nouveaux porteurs de dossier ailleurs au Québec qui comprennent notre situation », exprime Johanne Alarie.
Cette mise en relation a été grandement facilitée par le Campement d'autodéfense populaire, qui a organisé une série d'activités dans les jours entourant la marche. Le comité a invité les gens à camper sur les lieux de la future zone tampon grâce à la complicité de propriétaires et de locataires qui ont prêté leur terrain. Visites guidées du quartier Notre-Dame, quiz post-ironique sur Glencore, repas communautaires et assemblées démocratiques ont donné l'occasion aux personnes réunies d'échanger sur de nouveaux moyens de résistance et d'action directe, qui se sont concrétisés de plusieurs façons pendant la fin de semaine. Si l'ambiance est demeurée plutôt bon enfant malgré le sérieux des discussions, Glencore n'entendait pas à rire. La multinationale avait engagé une agence de sécurité dont la présence s'est fait sentir toute la fin de semaine : « Tous nos mouvements étaient documentés », témoigne Samuel Touchette, membre du comité. Plusieurs personnes campeuses ont également témoigné d'actes d'intimidation de la part de personnes dont l'identité demeure inconnue, et qui leur ont fait subir les sons de klaxon et d'insultes tard dans la nuit. Comme le dit Johanne Alarie : « On s'attaque à un monstre ». Face à ce constat, le comité n'entend pas lâcher prise : « À un moment donné, ça suffit les actions qui sont symboliques qui en appellent à la bonne foi, on les a toutes faites. Maintenant, il faut avoir un effet concret sur la compagnie, se mettre devant la machine pour l'arrêter », déclare Frédérique Godefroid.
Et la suite ?
Le 27 août, le député caquiste Daniel Bernard publiait sur sa page Facebook une vidéo affirmant sa grande satisfaction par rapport à la gestion du dossier de la Fonderie Horne. Au conseil municipal suivant, la mairesse Diane Dallaire se montrait à son tour aveugle au mouvement social ayant pris forme dans les rues de sa ville et réitérait son accord avec l'autorisation ministérielle en ajoutant : « aucun nouvel élément ne justifie de changer notre position ». Venu·es dénoncer cette inaction décomplexée dans une séance du conseil qui s'est soldée par le retrait de la mairesse, au bord des larmes, le lundi 25 septembre, les citoyennes et les citoyens présent·es ont été dépeint·es dans les médias comme des « adversaires » et des « opposant·es ». Pour les militant·es interrogé·es, cette victimisation des élu·es doublée d'un confinement des groupes militants au rôle de bourreaux s'avère problématique. « C'est ça le défi, c'est de pas se faire camper dans le rôle des madames fâchées, qui sont jamais contentes, mais continuer d'escalader, d'augmenter les moyens de pression », dit Isabelle Fortin-Rondeau. « Ça m'a profondément heurtée de nous faire dire qu'on faisait une campagne de salissage envers la ville, je trouve que c'est d'un affront. On sait que le conseil municipal travaille super fort, mais ils travaillent fort à mettre en place toutes sortes de comités, de mécanismes pour qu'on s'adapte à quelque chose qu'on a refusé », ajoute Jennifer Ricard-Turcotte. Pourtant, c'est précisément l'attachement à leur communauté, la conviction de vivre dans un lieu de beauté et la volonté de le préserver qui motivent ces femmes à prendre la parole.
Le traitement médiatique de la dernière année a laissé croire à un clivage profond au sein de la population de Rouyn-Noranda. Pourtant, sur le terrain, même au-delà des cercles militants, même chez celles et ceux qui le disent à voix basse pour protéger leurs salaires, un consensus semble se répandre : la Fonderie doit prendre ses responsabilités. À mon sens, le véritable clivage s'opère plutôt entre la population générale et les institutions politiques prônant le statu quo et la tradition mercantile à laquelle la ville est soumise depuis sa naissance. Dans ce contexte d'apparence stagnante, la mobilisation du 26 août a tout de même insufflé de l'espoir. La lutte pour la qualité de l'air gagne en visibilité, entre autres grâce au mouvement national de Mères au front, qui en a fait son principal cheval de bataille. Pour les personnes organisatrices, les mois à venir devront être consacrés au maintien des liens et à un soutien mutuel des luttes à travers la province. « On a collectivement refusé cette autorisation-là, on n'y consent pas. Il en va de notre dignité collective de résister », dit Jennifer Ricard-Turcotte. Qu'il en soit ainsi.
Gabrielle I. Falardeau est citoyenne de Rouyn-Noranda et militante pour la justice climatique et sociale.
Photo : Williams Noury












