Derniers articles

Les femmes du coin de la rue. Corps à corps avec la précarité

Préface de Coline Cardi : « Jusqu'à l'os »
au livre de Patricia Bouhnik : Les femmes du coin de la rue. Corps à corps avec la précarité
Tiré de Entre les ligne s et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/29/preface-de-coline-cardi-jusqua-los/
Avec l'aimable autorisation des Editions Syllepse
« Depuis toujours, sortir de sa cage a été accompagné de sanctions brutales […] C'est l'idée que notre indépendance est néfaste qui est incrustée en nous jusqu'à l'os1. »
Ce livre est une invitation au voyage dans les territoires obscurs de Paris, dans les plis et replis de la ville, dans les marges, les franges, les « angles morts » de l'espace public. Il est une invitation à regarder et à entendre celles qu'on ne veut pas voir : les femmes pauvres, jeunes ou vieilles, désaffiliées, qui vivent avec ou dans la rue. Trop souvent rendues muettes, réduites à des ombres, à des figures sombres et déviantes du féminin. Femmes « infâmes », a priori peu respectables, il s'agit de leur redonner forme et voix. Au-delà de la diversité de leurs trajectoires et de leur quotidien, « leur point commun, écrit Patricia Bouhnik, c'est l'absence de place, de qualités reconnues, de droits et de ressources ». Il s'agit alors de restituer une part à ces sans-part2, de rendre compte de la capacité de celles qu'on juge incapables, de compter les incomptées, rejetées aux bords de la ville comme du politique.
Les « vies périphériques, infimes et méprisées3 », quand elles se déclinent au féminin, continuent d'être « reléguées aux oubliettes ». Chercher à en rendre compte suppose alors d'explorer les « silences de l'histoire4 », de documenter les processus historiques et contemporains d'invisibilisation, voire de disparition – ces processus qui conduisent à ne plus voir ces femmes, à ne plus vouloir les voir.
Il faut remonter au 19e siècle, ce moment où les frontières de genre et les frontières de l'espace urbain sont politiquement redessinées et progressiment incorporées. La ville du 18e siècle, rappelle Arlette Farge, est bruyante, bouillonnante et marquée par la forte présence des femmes issues des milieux populaires5. Le 19e siècle opère un « grand nettoyage ». Les politiques hygiénistes contribuent à vider les rues des « indésirables », les plus pauvres, relégué.es aux marges, associé.es au risque. Dans cette ville moderne décrite par Georg Simmel ou Walter Benjamin, seuls sont autorisés les modèles du flâneur et de la flâneuse : ils « incarnent et portent ostensiblement un modèle de comportement auquel les membres des classes bourgeoises vont adhérer et dans lequel ils vont se reconnaître ». Cette nouvelle police de l'espace public et de la précarité est aussi une police du genre : les femmes qui occupaient les rues et les centres sont désormais assignées à la sphère « privée », à des fonctions de mères et d'épouses. « Ce siècle d'effacement d'une partie des femmes s'est accompagnée de la catégorisation et de la disqualification des contrevenantes : mendiantes, prostituées, vagabondes », rappelle Patricia Bouhnik.
Les pandémies, et celle, plus récente, de la Covid-19, n'ont fait qu'accélérer encore le processus. Les mesures de confinements ont crûment mis en lumière les inégalités sociales et les vulnérabilités. Elles ont aussi conduit celles et ceux qui vivent avec, de, ou dans la rue, à se cacher encore davantage. Et les femmes, là encore, ont payé le plus lourd tribut : dans les logements, elles ont assuré l'ensemble des tâches éducatives et domestiques. La coexistence des sphères d'activité pour les deux sexes aurait pourtant pu donner lieu à des configurations inédites et plus égalitaires. Au-dehors, les « femmes contraintes de vivre à la rue, d'y traîner, d'y stationner, faute d'espace et de ressources, sont toujours là, avec la nécessité de se faire plus discrètes que jamais ». Les glaneuses ne peuvent plus glaner, celles qui vivent de la prostitution ou de la mendicité sont obligées de se cacher davantage. Les modifications architecturales récentes liées à l'organisation des Jeux olympiques, couplées aux lois répressives sur l'immigration et les usages de drogues, repoussent les précaires, exilées, racisées, encore plus loin dans les coulisses de l'espace public urbain. Dans ce contexte, rester invisibles est un principe de survie : il ne faut pas donner prise. S'abriter du stigmate pour ne pas « faire tache dans le paysage ». Éviter les contrôles policiers. Se protéger des violences masculines, omniprésentes.
On compte trop peu les mortes à la rue et les sciences sociales ont joué un rôle dans ce processus de disparition. Ce livre oblige à en prendre la mesure. En dehors de la question prostitutionnelle, les recherches sur la dimension genrée des formes contemporaines de la désaffiliation et des modes de présence et d'existence dans les marges de l'espace public et urbain, sont récentes. Dans les travaux de sociologie urbaine ou de sociologie de la déviance, « le coin de la rue » a, pour l'essentiel, jusque-là désigné, un lieu de sociabilité masculine et de construction de masculinités populaires. On pense, bien sûr, à l'ouvrage de William Foote Whyte, Street Corner Society (1 943), auquel le titre de ce livre fait explicitement référence6. On n'y croise que des hommes, « des femmes ont pourtant toujours été là, au coin de la rue, à la fois diverses, cachées et proches ». Il s'agit dès lors de rompre avec cette forme d'aveuglement pour repenser ces espaces, en s'attardant sur les trajets, les trajectoires et le quotidien de femmes qui, elles aussi, les traversent, les habitent parfois. Cet ouvrage propose une cartographie nouvelle de la ville et de ses marges. « Je suis partie de ces disparitions-là pour tisser le fil des histoires, recouper les contextes et déterminants et tenter de restituer la force des expériences et capabilités engagées », écrit Patricia Bouhnik.
Rendre compte de ces « composantes silencieuses et masquée de la vie sociale », demande du temps : dix années de rencontres et d'échanges, d'« équipées ethnographiques » avec une trentaine de femmes qui vivent dans la rue, dans les quartiers du nord-est de Paris et de l'autre côté du périphérique. Prendre le temps, c'est aussi accepter d'être mise à distance, c'est attendre d'être autorisée, de respecter les distances imposées, c'est parler de soi, de ses trois enfants notamment, de sentir et de ressentir, les odeurs, le froid, de se retrouver parfois dans des formes d'incertitude morale. C'est les suivre dans les kilomètres parcourus au quotidien sans jamais s'imposer. Ou encore rester assise avec elles, sur un banc, à même le sol, dans une tente ou dans une ancienne boutique de vêtements où se retrouvent des femmes vieilles et pauvres – mosaïque de petits mondes.
Rendre compte de ces existences fragiles c'est aussi nommer ces femmes. Les catégories de l'action publique ou de l'analyse sociologique n'y suffisent pas. Les nommer, c'est les reconnaître, les identifier, leur redonner un prénom propre : Josiane, Monique, Solange, Cathy, Brigitte, Riyina, Awa, Farhia, Houda, Anita, Marie, Louise, Violette, Jenny, Coralie, Corinne, Océane, Pauline, Anita, Halima, Yuan, Iny. Leur redonner corps aussi. « Vous avez un mètre dans la tête », dit Solange à Patricia. En leur donnant forme et figure, l'écriture nous oblige à voir les corps et les manières d'occuper l'espace, au-delà des « marques d'infamies à même la peau ». Elles sont blondes, brunes, les cheveux déjà gris, noires, blanches, ridées, décharnées, rondes, en pantalon le plus souvent, les yeux rendus hagards par la prise de crack, ou au contraire toujours à l'affût. Certaines s'efforcent de prendre soin de ce corps, d'autres, au contraire, s'attachent à gommer tout signe de féminité, préfèrent ne pas se laver : l'odeur permet de tenir les autres à distance. Lutter s'apprend par corps.
En traçant ces portraits, ces « vies précaires au bord du monde commun », Patricia Bouhnik repense les processus de désaffiliation et de discrimination en articulant rapports de genre, de classe, de race, d'âge et de sexualité. Ces trajectoires de précarisation sont marquées par des mises à l'écart successives : ruptures familiales ou conjugales, perte d'emploi, placement des enfants, exil, expulsions. Les violences de genre y jouent un rôle central, dans les espaces domestiques comme à la rue. Elles n'ont pas osé porter plainte ou la police n'a pas voulu les entendre. Certaines ont frôlé la mort, elles ont réussi à partir, s'appauvrissant encore. D'autres vivent ces violences au quotidien, taillent une pipe contre une dose de crack. Le déclassement se mesure aussi à des formes successives de dépouillement. Partie avec trois valises dans lesquelles Cathy a rangé son passé, il ne lui en reste plus qu'une aujourd'hui. La vie entière de Coralie tient quant à elle dans un sac à dos. Awa et Fahria n'ont plus de sac du tout.
Leur rapport aux institutions est marqué d'ambivalences. Certaines, migrantes, réfugiées et sans papiers, sans droits et sans ressources, fuient les contrôles policiers. Pour les autres, c'est la crainte des services sociaux qui domine : éviter à tout prix le stigmate de « mauvaise mère » quand elles ont encore leur enfant à charge. Accepter de l'aide, c'est aussi prendre encore le risque d'être violentée, cette fois dans les centres d'hébergement mixtes, tant les structures liées au sans-abrisme n'ont pas été pensées pour les femmes. Aller à la rencontre des « filles du coin de la rue » suppose alors de donner des gages : Patricia Bouhnik leur rappelle régulièrement n'être ni travailleuse sociale, ni policière, ni bénévole dans une association.
Au sens strict du terme, ces femmes ne constituent pas une « population » ni un tout homogène. Toutes ne sont pas logées à la même enseigne, « leurs histoires et leurs modes d'inscription dans la ville sont disparates ». Là est une des grandes forces de cet ouvrage : il souligne les différences pour montrer comment le quotidien de la précarité est lui-même traversé par des inégalités, les rejoue même. Pour négocier leur place, pour ne pas perdre complètement la face, les femmes rencontrées tâchent sans cesse de se distinguer, de mettre à distance les stigmates. Elles mobilisent des figures féminines repoussoirs auxquelles il ne faudrait surtout pas être assimilées. Monique évite celles qu'elle considère comme « sans dignité ». Louise ne veut pas « passer pour une marginale ». Entretenir ces distinctions est vital. Cela fait partie des « microstratégies » qui « misent sur une habile utilisation du temps, des occasions qu'il présente et aussi des jeux qu'il introduit dans les fondations d'un pouvoir7 ». Pour les saisir, le regard sociologique se concentre sur l'infiniment petit, le difficilement dicible – condition nécessaire pour comprendre les capacités des « incapables ».
Patricia Bouhnik met ainsi en évidence l'important travail déployé par ces femmes pour survivre. Non marchand, non reconnu, invisible, il s'agit bien d'un travail. Que Ryana nomme d'ailleurs comme tel. Il concerne le corps au premier chef. Corps-ressource, il est aussi toujours menacé. Pour ne pas subir de violences supplémentaires, il s'agit de déployer des techniques, d'intérioriser de nouveaux codes corporels, d'être au monde. On les perçoit dans les manières de se vêtir, de parler, de se mouvoir, d'affirmer un possible usage de la violence pour se défendre. Le corps peut aussi constituer une monnaie d'échange. Il faut alors payer de sa personne, « la norme de domination et de servitude volontaire est pratiquée ici à l'amiable ». Pour d'autres, en prendre soin est un moyen de se maintenir dans un état de « femmes respectables8 ». Dans ce contexte, les atteintes corporelles et la maladie sont lourdes de conséquences : elles constituent un risque supplémentaire de déclassement pour ces femmes qui, par ailleurs, ont très peu accès aux soins.
Ce travail désigne aussi les systèmes de débrouille et de survie mis en place pour trouver des ressources mentales et matérielles pour soi et pour les autres. Travail au noir, services sexuels, ramassage d'objets dans les rues pour les revendre ensuite, vols, constituent le travail d'« interstices » . Il désigne également les manières d'habiter : les places choisies sur le trottoir, les tentes ou les caravanes sont savamment aménagées. Ces intérieurs parfaitement rangés permettent, malgré tout, de construire une forme de « chez-soi ». Comme ailleurs, le travail est aussi domestique et de care : « Les mères et les sœurs, dans ces configurations de précarité et de malheur quotidiennes, se trouvent en première ligne pour supporter les charges et se sacrifier pour la famille. » Même placés, les enfants restent omniprésents dans l'esprit de leur mère.
Les capacités des « incapables » se logent, enfin, au cœur des solidarités et des jeux d'interdépendance mis en place – formes fragiles et nécessaires de sororité quand il s'agit, ensemble, de « faire corps ». Au final, ce livre est politique : il rappelle avec force que les « filles du coin de la rue » font partie du monde commun.
Coline Cardi9
Patricia Bouhnik : Les femmes du coin de la rue. Corps à corps avec la précarité
https://www.syllepse.net/les-femmes-du-coin-de-la-rue-_r_22_i_1067.html
1. Virginie Despentes, King Kong Théorie, Paris, Grasset, 2006.
2. Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, Le Seuil, 1990.
3. Michel Foucault, « La vie des hommes infâmes », dans Dits et écrits III, Paris, Gallimard, 1994.
4. Michelle Perrot, Les femmes ou les silences de l'histoire, Paris, Flammarion, 1998.
5. Arlette Farge, Vivre dans la rue à Paris au 18e siècle, Paris, Gallimard/Julliard, 1979.
6. William Foote Whyte, Street Corner Society : The Social Structure of an Italian Slum, Chicago, University of Chicago Press, 1943 (traduction française : Street Corner Society, Paris, La Découverte, 1995).
7. Michel de Certeau, L'invention du quotidien, t. 1 : Arts de faire, Paris, Gallimard, [1980] 1990, p. 63.
8. Beverley Skeggs, Des femmes respectables : classe et genre en milieu populaire, Marseille, Agone, 2015.
9. Sociologue, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 et chercheuse au Cresppa/CSU. Ses travaux portent sur la dimension genrée du contrôle social et de la régulation, notamment au travers des figures de la « délinquante » et de la « mauvaise mère ». Elle a codirigé, avec Geneviève Pruvost, l'ouvrage Penser la violence des femmes (Paris, La Découverte, 2012).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le « wokisme » n’existe pas

Le « wokisme » ne désigne pas un mouvement car nul ne s'en revendique ; à défaut d'être un phénomène identifiable, il est le mot par lequel on cherche à éloigner le débat sur le caractère systémique des injustices. Le procès du « wokisme » permet en réalité de disqualifier les minorités dans leurs revendications et participe à une offensive réactionnaire contre l'éveil (wokeness) de la société.
25 mars 2024 | texte tiré d'AOC.info
https://aoc.media/analyse/2024/03/24/le-wokisme-nexiste-pas/
L'idée de l'inexistence du « wokisme » paraîtra sans doute surprenante à nombre de lecteurs. On le comprend : livre après livre, tribune après tribune, des auteurs de toutes disciplines, des journalistes aussi, décrivent une nouvelle configuration idéologique dont il conviendrait d'examiner, toutes affaires cessantes, les redoutables effets. Le doute, ici exprimé, quant à sa réalité ne relève pourtant ni de la provocation, ni de la cécité. Je n'ignore évidemment pas l'existence de cas qui donnent crédit à l'hypothèse d'atteintes systématiques aux libertés d'expression et de création. Quel que soit leur véritable nombre, il est parfaitement légitime de s'en préoccuper : ces libertés sont au fondement de la démocratie et doivent être soigneusement préservées.
Le point de vue que je défends se construit, pour l'essentiel, autour de trois propositions.
La première est d'établir que l'hétéro-désignation manque sa cible, le « wokisme » supposé étant introuvable non seulement parce que nul ne se revendique d'un mouvement qui porterait ce nom, mais surtout parce que les traits supposés le définir sont tellement généraux qu'ils permettent de ranger sous la même dénomination des théories parfaitement distinctes. Je chercherai à établir la valeur de cette proposition en procédant à l'analyse critique de l'idéaltype du « wokisme », tel qu'il est décrit par l'un de ses adversaires les plus déterminés.
La deuxième proposition consiste à montrer que le champ indéfini d'extension de l'accusation tient à sa nature : elle ne vaut que par la fonction qu'elle remplit et n'a nullement pour objectif de décrire le réel. Il s'agit d'euphémiser, voire de nier, la réalité des discriminations ou, au moins, de ne pas reconnaître leur nature et leurs causes.
Enfin, face au caractère systémique des injustices, que celles-ci se situent dans le champ social, dans celui des rapports de sexe ou dans celui des identités raciales, il s'agira d'énoncer ce qu'exige l'éveil par rapport à celles-ci (la wokeness, celle-ci étant considérée comme l'indice d'un bon fonctionnement de la démocratie), tout en se montrant attentif aux ornières dans lesquelles elle pourrait se perdre.
Introuvable « wokisme »
Le terme de « wokisme » suggère l'existence d'un mouvement politique homogène chargé de propager l'idéologie woke. Celle-ci se déclinerait en de multiples sens, mais on choisira, afin d'essayer de la circonscrire, la caractérisation qu'en fait Pierre-Henri Tavoillot (l'un des organisateurs du fameux colloque sur la « déconstruction » qui s'est tenu à la Sorbonne en janvier 2022).
Le philosophe définit le « wokisme » par quatre éléments qui font système : « D'abord, l'idée que la réalité se définit essentiellement comme domination. […] Deuxièmement, le grand dominateur dans cette affaire, c'est l'Occident. C'est en lui que se condensent toutes les oppressions : celle de l'Europe sur le reste du monde (impérialisme), celle de l'homme blanc sur toutes les femmes (patriarcat), celle de l'industrie sur la nature (productivisme), celle des riches sur les pauvres (capitalisme). Troisième point : face à cette grande domination, on a l'impression d'une amélioration des choses : la décolonisation, l'émancipation féminine, l'antiracisme et autres types d'émancipation semblent acquis ; or, pas du tout, ce n'est qu'illusion. […] Et quatrième élément : il faut agir, il faut annuler, changer la langue, déboulonner les statues, modifier les livres… ».
L'intérêt de cette définition est qu'elle synthétise très correctement les principaux griefs, tout en évitant les caractérisations fragiles par des termes caricaturaux à volonté polémique. Il en est ainsi de celles qui voient dans le « wokisme » une nouvelle Inquisition, un totalitarisme en marche, un héritier du trotskisme ou encore une religion sans avenir (la synthèse étant une religion totalitaire dont les fidèles sont disposés à envoyer au goulag celles et ceux qui luttent pour les libertés d'expression et de création).
Pierre-Henri Tavoillot insiste préalablement sur la domination, afin de suggérer qu'il serait inexact de privilégier ce prisme pour comprendre la réalité sociale. C'est le premier moment du déni : l'idée que les rapports sociaux ne puissent être, dans leur totalité, appréhendés par la domination ne devrait pas conduire à nier son importance, ni même à la relativiser.
La conception de la liberté comme absence de domination, que privilégie le républicain critique, est en effet plus convaincante que celle qui la définit par l'absence d'interférence. L'exemple classique pour illustrer ce point de vue est celui de l'esclave qui a la chance d'avoir un maître bienveillant : restant soumis au pouvoir du maître, il n'est pas libre. L'illusion du libéral-conservatisme, acharné à relativiser la dimension de la domination, est de croire qu'il l'est.
Le deuxième trait définitionnel emprunte à la rhétorique bien connue du « fardeau de l'homme blanc » : non, l'Occident n'est pas réellement coupable de ce dont on l'accuse (impérialisme, patriarcat, capitalisme productiviste). L'accusation serait injustifiée car l'Occident, lieu où sont nées les Lumières, ne pourrait être tenu pour responsable des dévoiements de ses principes. Deuxième moment du déni : comme le souligne Suzanne Citron, la France n'a pas dérogé à ses principes, bien qu'elle fût la patrie des droits de l'homme mais parce qu'elle l'était.
Troisième trait : les choses s'améliorent et les « wokistes » sont indifférents à ces évolutions favorables. Indifférents ? Certainement pas, mais celles et ceux qui luttent pour l'émancipation considèrent en effet, à l'instar des révolutionnaires de 1789, qu'il reste beaucoup à faire : il suffit de penser à la persistance des inégalités salariales entre les sexes, la difficulté à voir aboutir judiciairement les plaintes pour viol, le niveau invraisemblablement élevé des féminicides, la non-reconnaissance des mérites des femmes dans la recherche, notamment en science (le cas de Rosalind Franklin est loin d'être une anomalie).
Enfin, quatrième trait, la volonté destructrice du « wokisme », qu'il s'agisse des œuvres d'art, de notre passé ou de notre langue. On reconnaît là l'une des accusations les plus communes, laquelle relève de la cancel culture. Mais, comme l'a souligné Laure Murat, « qui annule quoi ? »[1]. Si les mouvements #MeToo et Black Lives Matter ont souvent recours à la culture de l'annulation, c'est pour dénoncer des situations iniques et exiger des institutions qu'elles prennent leurs responsabilités en cessant d'honorer les personnes accusées d'actes racistes ou d'agressions sexuelles.
Plutôt que sur la dénonciation, il conviendrait d'insister sur la responsabilité, puisqu'il s'agit d'inviter ceux qui sont incriminés à assumer leurs propos, à se justifier, ce qui relève en définitive de la prise de conscience éthique. La cancel culture n'est donc souvent que le seul moyen, pour ceux et celles qui n'ont aucun pouvoir, d'exprimer leur indignation en attirant l'attention sur certains dysfonctionnements dont la société s'accommode si volontiers.
N'oublions pas que cancel culture est une « expression de la droite américaine adoptée par les néoconservateurs français pour mieux disqualifier les interpellations progressistes »[2]. Aux États-Unis, les déboulonnements de statues visent en priorité ce qui symbolise le pouvoir colonial, les suprématistes blancs, les confédérés et le racisme institutionnalisé.
Dans le contexte européen, l'interpellation faite aux musées sur l'origine de leurs collections, en majorité issues des conquêtes impérialistes, montre que la cancel culture, loin de nier l'histoire ou de faire preuve d'une « inculture » systématique, attire souvent notre attention sur les contradictions d'une société qui prône officiellement l'antiracisme et célèbre partout la violence des colons dans l'espace public. Laure Murat, citant Guerre aux démolisseurs de Victor Hugo, rappelle que c'est « l'État qui, le premier, “annule” ou détruit … car il détient seul le pouvoir de censure et de contrôle ». L'histoire se fait en érigeant des monuments tout autant qu'en les faisant tomber.
Dans le même sens, Philippe Forest, pourtant fort peu bienveillant à l'égard du « wokisme », ne voit pas à l'université ce que craignent les anti-« wokistes » : il dit n'avoir jamais assisté, au sein de son établissement, « à ces cas dont on fait grand bruit dans la presse ». Et il ajoute, « je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais aussi scandaleux qu'ils soient, je pense qu'on a tendance à en exagérer l'importance. C'est toujours les mêmes anecdotes qui tournent en boucle : la conférence de Sylviane Agacinski annulée, le collège Evergreen aux États-Unis, la tragédie grecque empêchée pour cause de “blackface”, le professeur congédié pour avoir montré à ses étudiants un extrait du Mépris de Godard… Quelle est l'ampleur véritable du phénomène ? À titre personnel, je n'ai jamais été confronté à ce wokisme radical ».
On constate que la thèse du système « wokiste » a bien du mal à trouver de solides fondements. D'autant que nombreux sont ceux qui, comme moi, sont considérés comme « wokistes » alors que les indices d'appartenance sont évanescents. Que l'on en juge par l'exposé rapide de mes convictions. Mon engagement anticolonialiste vaut, pour mes adversaires, adhésion à la mouvance décoloniale. Ma critique de la « laïcité de combat » est l'indice de mon choix en faveur du multiculturalisme, voire du communautarisme (la distinction étant sans importance pour la plupart des anti-« wokistes »). Mon adhésion au républicanisme critique est comprise comme anti-républicaine (comme si, seule, l'occurrence française était légitime). Mon souci de concilier laïcité et tolérance est perçu comme une concession à un régime de coopération (et non de séparation) entre l'État et les églises. Ma défense de l'universalisme, constante depuis les débuts de ma vie intellectuelle, ne vaut rien pour ceux qui, de l'instruction de son procès, déduisent sa définitive condamnation. Enfin, mon souci de tenir compte des processus de subalternisation des savoirs périphériques, c'est-à-dire l'intérêt accordé à la notion d'injustice épistémique, indiquerait mon mépris pour l'objectivité et, plus globalement, la volonté de relativiser la science, de contester son privilège dans l'accès public au savoir, autrement dit l'absolu contraire de ce que je pense.
Bref, l'universaliste, le rationaliste, le républicain disparaissent sous les amalgames qu'une paresse de la pensée présente comme des articles de foi, sans accorder la moindre attention à la complexité des choix.
À quoi sert l'anti-« wokisme » ?
La promotion académique et sociétale du « wokisme » entretient bien des similitudes avec les querelles qui l'ont précédée (sans pour autant avoir disparu), celles du politiquement correct et de l'islamo-gauchisme. Elles obéissent à une même logique de désignation d'un ennemi supposé, ennemi de l'intérieur mais complice de ceux qui, en dehors de la « civilisation occidentale », chercheraient à en saper les fondements. « Wokisme » permet donc de disqualifier l'ensemble des forces contestataires issues des populations minorisées, accusées, entre autres griefs, d'hypersensibilité. Le refus de rester indifférent devant l'oubli de nos principes suscite une vive réaction venue de milieux politiques et intellectuels divers, mais ayant en commun une conception exclusive de l'appartenance citoyenne.
Au sein d'une nation fortement sécularisée, et ayant fait de la laïcité sa religion civile, l'une des modalités principales de disqualification est de constituer, au sein de nos sociétés démocratiques, une religion nouvelle, généralement décrite comme sectaire. Et si l'opprobre ne suffit pas, on dira que cette religion est à visée totalitaire, voire que ses fidèles sont les agents du totalitarisme. Le caractère outrancier de ce diagnostic ne semble pas un obstacle à sa crédibilité, si l'on juge cette dernière au nombre de passages médiatiques des anti-« wokistes » les plus ardents.
Aussi, alors que les « wokistes » sont suspectés de croire en des choses qui défient le bon sens (non malgré l'absurdité de leurs croyances mais en raison même de cette absurdité, comme le souligne Jean-François Braunstein), est-il permis de se demander si la qualification du « wokisme » comme totalitarisme ne relève pas du même mécanisme, tant, pour ceux qui savent à quoi renvoie le concept, le jugement est en effet absurde. Absurde, mais aussi indécent : faudrait-il comprendre que les « wokistes » font régner la terreur sur les campus et participent au lynchage de ceux qui résistent à la religion « wokiste » ? On mesure l'indécence lorsque l'on sait ce que furent réellement les lynchages aux États-Unis.
Mais, revenons un instant à l'absurdité : elle est au fondement de la constitution de la catégorie « wokisme ». Le procédé est parfaitement décrit par Jean-Yves Pranchère : « Les Lumières ont existé, mais celui qui, en choisissant tel texte de Mercier sur les bibliothèques, tel texte de Diderot sur les rois qu'il faudrait étrangler avec les tripes des prêtres, expliquerait que les Lumières ont été un cas de « lumiérisme », et que le « lumiérisme » qui rassemble Voltaire et Rousseau, Montesquieu et Adam Smith, Kant et d'Holbach, Helvetius et Lessing, etc., est un totalitarisme qui veut expurger les bibliothèques, assassiner les savants, faire régner la terreur, promouvoir le cannibalisme (on imagine au passage une lecture de Montaigne qui dirait que Montaigne voulait nous apprendre à manger les petits enfants), celui-là devrait être tenu pour un histrion »[3]. C'est ainsi que procèdent les anti- « wokistes » lorsqu'ils se veulent constructeurs de concepts.
De cette offensive, qui déborde largement le terrain académique, il n'est pas interdit de penser que son objectif principal, conjointement poursuivi par le pouvoir politique et la droite universitaire, est de combattre l'influence des courants critiques au sein de la recherche en sciences sociales. Cette hypothèse est étayée par le fait que le procès en « wokisme » est instruit contre tous ceux qui remettent en question l'ordre établi, qui sont attentifs à la justice sociale, à la condition féminine et à celle des minorités racisées. Dans ce procès, les procureurs s'approprient parfois les thématiques (notamment en revendiquant leur attention aux injustices, aux inégalités ou aux discriminations) et le vocabulaire des accusés pour les vider de leurs sens.
Quelles sont les craintes des anti-« wokistes » ? Les plus courantes concernent la fragmentation de la nation (ou son émiettement), une nation au sein de laquelle règne « une atmosphère toujours plus servilement diversitaire et victimaire »[4]. La « tribalisation » de la République serait déjà une réalité, les élites se soumettant à la « tyrannie des minorités » et célébrant la « religion diversitaire » au sein de laquelle l'individu, réduit à son assignation identitaire, ne s'appartient plus et substitue l'émotion à la rationalité. On mobilise volontiers les invariants de l'universalisme incantatoire, celui qui confond le « même » et le « commun », qui proteste contre la prétendue sacralisation de l'altérité et s'indigne de la disparition de l'esprit critique au profit du « masochisme moralisateur ».
On alerte aussi sur les dangers de l'islamo-gauchisme, comme figure de l'ennemi intérieur. Cette accusation, généreusement utilisée, popularisée par les pouvoirs publics et relayée par quelques figures médiatiques notoires, laisse entendre que le rôle de l'État est de dire quels courants de pensée seraient acceptables. Procédé dont l'efficacité est douteuse car, comme le remarque François Dubet, « selon la vieille loi de la prédiction créatrice, ce procès fait advenir l'adversaire qu'il combat ». Pourtant, la suspicion d'islamo-gauchisme reste disponible, essentiellement en raison de la fonction qu'elle remplit.
Depuis l'invention du terme, son champ d'application semble ne plus connaître de limites. Sont en effet désignés les courants théoriques perçus comme anti-occidentaux ou encore anti-blancs, c'est-à-dire étrangers à la culture nationale : intersectionnalisme, postcolonialisme, décolonialisme, culture de l'annulation, féminisme « misandriste » et, bien évidemment, « wokisme ».
Gilles Bastin fournit la croustillante recette de ce qu'il nomme justement « boniment néo-républicain » : « Prenez un mot (si possible anglo-saxon, comme “woke”, mais un mot composé “islamo-gauchisme”, par exemple, fera l'affaire), agitez-le fortement dans les médias en le mélangeant à d'autres types de mots (“postcolonial” est idéal mais, si vous n'y pensez pas, “repentance” ou “cancel culture” iront très bien). Au bout d'un moment, vous le verrez enfler, se transformer, devenir un symptôme, puis une menace que vous pourrez finalement brandir pour effrayer l'opinion ». On ne saurait mieux décrire le phénomène de construction du soupçon.
À cet égard, l'instrumentalisation de la laïcité constitue une excellente illustration. Le maintien affiché d'une norme, le modèle français de laïcité, vise en réalité à en imposer une nouvelle, comme le souligne le titre même du rapport Baroin de décembre 2002, « Pour une nouvelle laïcité ». On y lit que la laïcité est contestée « par certaines populations immigrées, qui, issues d'une culture non laïque et non démocratique, ne perçoivent pas le sens de ce principe ». Traduction, on ne peut plus claire, de ce que Géraldine Bozec appelle un « nationalisme cognitif » de la part de ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques[5]. La crise de la laïcité est imputée à la gauche parce qu'elle a « défendu les différences culturelles » et le « communautarisme ». Ce rapport, qui revendique un ethnocentrisme décomplexé, exprime, hélas, ce que, probablement, pensent une majorité de Français.
Une autre fâcheuse conséquence de cette manipulation de l'opinion publique doit être mentionnée : le recul du débat démocratique. La démocratie ne peut, sans risque pour sa survie, laisser prospérer le dégoût du vrai, et, plus généralement, l'indifférence quant à la science, méprisée pour sa vocation à l'universalisation de ses propositions. La démocratie étant, par nature, l'espace où s'échangent les raisons, la promotion du règne généralisé de la doxa, soit la sacralisation du relativisme cognitif au nom d'un pseudo-idéal démocratique selon lequel tout se vaudrait est, à coup sûr, un péril mortel.
De fait, la remise en cause de la valeur de l'objectivité et de la possibilité de la vérité prépare les esprits à accepter le procès en « wokisme », procès instruit dans un nombre de plus en plus grand d'ouvrages et d'articles qui cherchent à donner une consistance à une mouvance, dont, redisons-le, nul ne se revendique. Il n'est pas interdit de penser que les procureurs qui instruisent à charge ce procès représentent une authentique menace pour la démocratie. La wokeness, c'est précisément l'attention inquiète pour la défense des principes démocratiques.
Wokeness versus « wokisme »
Loin de la vision anti-« wokiste » du monde, je souhaite désormais examiner les exigences de la wokeness, autrement dit les conditions de l'émancipation.
L'émancipation peut être définie comme la volonté politique de se défaire de la situation de minorité à laquelle on est soumis. La tentation est grande de hiérarchiser les luttes et, par conséquent, de négliger celles fondées sur la reconnaissance au nom d'un primat sur celles ayant la redistribution pour horizon ou, bien sûr, de choisir la priorité inverse. Je pense, au contraire, que nous devons articuler les unes et les autres. Rechercher les conditions de cette articulation, c'est faire l'éloge de la complication, là où un universalisme incantatoire, lui-même actif dans la chasse aux « wokistes » (ceux-ci étant toujours accusés d'être anti-universalistes), continue de la tenir à distance.
Cet effort doit s'accompagner d'un autre, tout aussi important : être lucide sur les risques que l'exaltation identitaire fait courir à la cause défendue[6]. On ne peut sans péril emprunter les mêmes chemins que ceux de l'oppresseur. Si l'on souhaite que le « wokisme » reste un mythe, qu'il demeure introuvable, l'universalisme, en tant que tel, ne peut être relativisé.
Il peut en effet arriver que les dominés empruntent le vocabulaire, voire l'idéologie des dominants et revendiquent une essence, celle-là même à laquelle ils sont assignés. L'oubli de l'appartenance à une commune humanité se manifeste mécaniquement par le rejet de toute possibilité d'universalisation et, notamment, celle des propositions générales de la science. L'objectivité, la réalité, la vérité deviennent des catégories particulières liées à une histoire et/ou à une communauté. La wokeness, dans la perspective que nous défendons, doit se tenir à l'écart de ces ornières.
La victime a le droit d'être écoutée, et de l'être avant quiconque. Il est, de surcroît, inacceptable de ne pas la considérer comme fondée à décrire l'oppression de son propre point de vue. L'antiracisme ne peut ignorer les revendications fondées sur les situations particulières de racisation. Pour justifier cette position, il est fréquent de citer, à bon escient, Hannah Arendt : « Lorsqu'on est attaqué en tant que Juif, c'est en tant que Juif que l'on doit se défendre ; non en tant qu'Allemand, citoyen du monde, ou même au nom des droits de l'homme[7]. » Ne pas comprendre cette primauté d'un moment, c'est rester enfermé dans une conception décharnée de l'égalité, pour utiliser le vocabulaire de Césaire.
Faut-il pour autant emprunter au raciste les raisonnements servant à légitimer ses privilèges ?
La tentation de l'« essentialisme inversé », c'est-à-dire celle de la reproduction du processus raciste d'essentialisation, mais en inversant la hiérarchie qu'il instaure, doit être écartée. Elle avait d'ailleurs été fermement condamnée par Frantz Fanon dans les Damnés de la terre (chapitre sur « Les mésaventures de la conscience nationale »)[8].
Dans la perspective que nous défendons, elle contrevient à l'exigence centrale de ne pas privilégier une appartenance au détriment de toutes les autres. L'« essentialisme inversé », en n'accordant de l'importance qu'à la race, emprunte au racisme ses schémas de pensée. Cette essentialisation identitaire implique le refus de l'alliance, autrement dit elle prive l'autre de toute expression de solidarité (ou de critique). L'humanisme réel pourrait-il s'en accommoder ? La réponse est bien entendu dans la question.
Une pensée de l'éveil qui négligerait le ressort universaliste des luttes pour l'émancipation donnerait crédit à l'accusation de manichéisme, puisque la division dominants/dominés, au lieu d'être un moteur du changement, deviendrait l'essence du réel, autrement dit tiendrait l'histoire à distance. Elle serait alors conforme à la description de l'anti-« wokisme » : dès lors, elle deviendrait wokisme.
Mais, malgré les tentatives de nous persuader du contraire, la wokeness reste, pour l'essentiel, éloignée de cette dérive. On interprétera, par conséquent, l'anti-« wokisme » comme l'expression d'un désir d'oubli : celui d'un passé dont on s'emploie à réécrire l'histoire, de façon à ce qu'il apparaisse comme une sorte d'accident ou d'anomalie au regard de l'universalité de nos principes. L'expression aussi d'une forme d'aveuglement : on refuse d'admettre la persistance d'un racisme quotidien, lequel explique les profondes inégalités qui ont accompagné l'intégration des populations immigrées.
Les revendications identitaires, pour être combattues, doivent être comprises comme la conséquence d'un déficit, voire d'un déni, de reconnaissance, au lieu d'être stigmatisées comme l'indice d'une volonté de séparation. Ce déficit est sans doute la marque d'une insuffisante intégration de nos passés dans une histoire commune. Réjane Sénac souligne, à juste titre, « la persistance du déni des inégalités et des injustices comme structurant l'histoire et le présent de la société française ». Un véritable engagement républicain implique de « réarticuler les mémoires des souffrances humaines afin qu'elles deviennent toutes des éléments fondamentaux pour rebâtir le monde en commun »[9].
À l'opposé, ceux qui ont recours au mythe du « wokisme » fabriquent un épouvantail sur lequel concentrer la colère, et détournent de ce qui devrait réellement faire peur : la catastrophe écologique, le recul de la démocratie, la banalisation de l'extrême droite et la perspective, corrélative, qu'elle parvienne au pouvoir. Le « wokisme », à défaut d'être un phénomène identifiable, est le mot par lequel on cherche à éloigner le débat sur les questions liées aux discriminations et, peut-être surtout, comme Bourdieu l'avait pressenti, à l'immigration. Il serait heureux que l'on puisse, le plus tôt possible, voir en lui une invention lexicale sans postérité.
NDLR : Alain Policar publiera le 5 avril 2024 Le « wokisme » n'existe pas. La fabrication d'un mythe, aux éditions Le Bord de l'eau.
Alain Policar
POLITISTE, CHERCHEUR ASSOCIÉ AU CEVIPOF
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
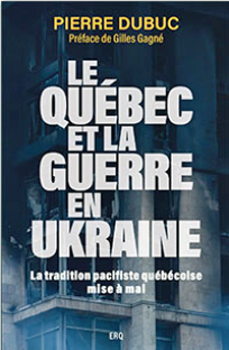
Le Québec et la guerre en Ukraine
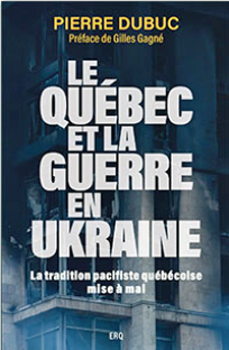
Les guerres mondiales ont marqué profondément l'histoire du Québec. La Nouvelle-France est passée sous contrôle britannique lors de la guerre de Sept Ans. La crise de la Conscription de 1918 a remis la question de l'indépendance à l'ordre du jour, pour la première fois depuis la rébellion des Patriotes de 1837-1838.
Éditions du Renouveau québécois ; Nombre de pages : 222 ; Année de publication : 2023
https://lautjournal.info/publications/le-quebec-et-la-guerre-en-ukraine
Aujourd'hui, la guerre en Ukraine provoque un chamboulement complet de la géopolitique internationale et menace de dégénérer en conflit mondial. Les alliances militaires se recomposent et se raffermissent. Les budgets militaires explosent. Les États-Unis opèrent un découplage économique avec la Chine – particulièrement dans le domaine des matériaux stratégiques – et enrôlent les pays amis dans une économie de guerre camouflée sous la dénomination de « transition énergétique ».
Les ressources minières et énergétiques canadiennes et québécoises sont dans le collimateur de l'Oncle Sam. Le Canada et le Québec répondent présents en subventionnant à coups de dizaines de milliards les usines de la filière batteries. Une politique qui n'est pas sans lien avec la décision du gouvernement Legault d'augmenter de 50% le potentiel hydroélectrique du Québec.
Dès le déclenchement de la guerre, le Québec s'est rallié spontanément à l'Ukraine, sans examen approfondi des politiques qui ont mené à cette guerre. Ce recueil d'articles publiés dans L'aut'journal a pour objectif de combler cette lacune. Il propose une analyse de la guerre en Ukraine d'un point de vue québécois, en rupture avec l'alignement du Canada sur les politiques de l'Empire américain, et renoue avec la tradition pacifiste du peuple québécois

L’intelligence artificielle – Mythes, dangers, désappropriation et résistances

INTRODUCTION AU DOSSIER – Ce n'est pas d'hier que le capitalisme mondialisé développe et s'approprie les techniques et les technologies les plus avancées et productives pour générer plus de capital privé par l'exploitation du travail et par la consommation étendue à l'échelle de l'humanité. Le capitalisme a aussi mis en place des mécanismes de discrimination qui surexploitent les plus dominé·e·s afin de maximiser les profits.
22 mars 2024 | tiré du site des NCS
L'intelligence artificielle (IA) fait partie de ce monde capitaliste. Elle est présente dans nos vies depuis quelques décennies sous différentes formes, on n'a ici qu'à penser à la reconnaissance vocale en téléphonie déployée en 1995 par Bell Canada, pionnier mondial dans ce domaine, en éliminant au passage quelques milliers d'emplois occupés principalement par des femmes. Dans cette joyeuse marre aux algorithmes, les enjeux sont de l'ordre de centaines de milliards de dollars.
Jusqu'ici le développement et le déploiement de l'IA se faisaient plutôt discrets dans des centres de recherche enfouis dans les universités, en « partenariat » avec quelques géants de l'univers numérique. On nous en laissait parfois entrevoir quelques applications « innovantes », dans le domaine de la médecine, de l'automobile autonome, de la reconnaissance faciale, etc. Mais cela restait sous la bonne garde des géants de ce monde.
Mais voilà qu'à la fin de 2023 retentit un coup de tonnerre médiatique dans ce merveilleux univers numérique. L'IA générative, qui depuis une bonne décennie était réservée aux entreprises qui pouvaient se la payer, devient accessible à monsieur et madame Tout-le-Monde sous la forme du robot conversationnel ChatGPT.
La nouvelle a fait fureur et elle n'a pas tardé à déclencher de par le monde un déluge de commentaires et de jugements à l'emporte-pièce. Voilà que l'on pouvait, par le biais d'une simple application, disposer des services d'un robot conversationnel apparemment prodigieux capable de générer instantanément une dissertation de qualité sur n'importe quel sujet de son choix dans la langue de sa convenance.
Bien que l'IA générative sous forme de robot conversationnel ne soit qu'une sous-branche des applications de l'IA basée sur l'apprentissage profond – l'IA couvre beaucoup plus large – il n'en fallut pas plus cependant pour que sur les médias sociaux et dans les grands médias institutionnels finisse par s'imposer un nouveau discours hégémonique en la matière, un discours passe-partout et tout puissant, globalement favorable à l'intelligence artificielle de dernière génération ainsi qu'à ses multiples déclinaisons possibles. Cela est présenté comme quelque chose d'inéluctable et d'indispensable à notre vie future, mettant en sourdine ou à la marge, ou encore passant sous silence bien des dimensions problématiques de l'intelligence artificielle[1].
En guise d'introduction à ce dossier sur l'IA, nous voulons déchiffrer cet emballement pour l'IA et montrer ce qu'il y a derrière ce discours devenu si prégnant, en mettant en évidence comment il reste difficile dans nos sociétés contemporaines de faire la part des choses en matière de découvertes ou de progrès scientifiques et techniques, au point de jouer à l'autruche devant une multitude de dangers pourtant des plus inquiétants.
Sur l'idée de progrès
Il faut dire que pendant longtemps, modernité oblige, nous avons été portés – y compris à gauche – à doter le progrès économique et technique d'un indice hautement positif.
Après l'imprimerie en 1450, la machine à vapeur en 1770, le moteur à explosion en 1854, l'électricité en 1870, les technologies de l'information et de la communication dans les années 1970 et aujourd'hui l'intelligence artificielle, nous pourrions facilement imaginer être partie prenante d'une vaste trajectoire historique pleine de promesses, nous délivrant pas à pas de lourdes tutelles pesant sur notre humanité. Comme si, en nous laissant emporter par l'inéluctable passage du temps, le futur allait nécessairement nous offrir un avenir meilleur que le présent ou le passé.
On a tous en tête des images fortes – par exemple dans le dernier film de Sébastien Pilote, Maria Chapdelaine – de l'existence que menaient nos ancêtres à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe dans ce pays de froid et de neige qu'était le Québec. Ils n'avaient ni eau courante ni électricité ni médecin assuré. Pour survivre et pour faire face aux défis d'une nature hostile, il ne leur restait qu'une vie faite de bûchage acharné et de durs travaux agricoles, d'économies et de privations. Au regard de notre vie d'aujourd'hui, qui souhaiterait revenir à de tels temps ?
Bien sûr, il y avait dans ces images trop simplistes quelques signaux contraires, mais nous avons mis longtemps à en tirer les véritables conséquences. Le progrès, en même temps qu'il délivrait l'être humain de bien des fardeaux, apportait son lot d'inquiétudes et de destruction. À preuve cette ombre de la menace nucléaire qui, à partir de 1945, s'est mise à grignoter, comme un sombre présage, les lumières philosophiques de toutes nos humaines interrogations.
Il y avait aussi ceux et celles qui, à gauche, avaient compris que ce progrès était porté par un mode de production particulier – le mode de production et d'échange capitaliste – qui en sapait une grande partie des potentialités positives. Ils voyaient donc dans un système socialiste, où les richesses privées seraient socialisées, le moyen de redonner au progrès humain ses vertus émancipatrices et libératrices.
Pourtant la plupart d'entre eux, en installant cette socialisation dans un futur indéterminé ou en fermant les yeux sur les difficultés de son actualisation, passée comme présente, et en se croyant portés par le vent de l'histoire, tendaient malgré eux à reprendre à leur compte le mythe d'un progrès inéluctable. D'ailleurs, ils étaient devenus si nombreux, si influents, si assurés de l'avenir – quelle que soit la manière dont ils le pensaient – qu'on avait même fini par tous les regrouper sous un même chapeau : le progressisme. Ils étaient, disait-on, des « progressistes » pariant, plein d'optimisme, sur les valeurs de la modernité, sur les avancées assurées et positives de l'histoire[2].
Le « progressisme », que nous le voulions ou non, nous en sommes, à gauche, les héritiers, et l'idée d'un progrès inéluctable se déployant positivement au fil du temps, continue de nous habiter. Et cela, même si l'histoire parait avoir depuis des décennies infirmé une bonne partie de ces prophéties.
En ne débouchant jusqu'à présent sur aucun changement sociétal de fond, sur aucun saut qualitatif, sur aucun « bond de tigre » comme disait Walter Benjamin, les indéniables avancées scientifiques et techniques qui continuent de fleurir à notre époque s'accompagnent de désordres économiques criants, de guerres nouvelles, de malaises sociaux grandissants, de blocages politiques et de contradictions culturelles. D'autant plus qu'aux maux traditionnels de l'exploitation ou de l'inégalité, fruits connus du capitalisme, sont venus se rajouter ceux, passablement inquiétants et longtemps ignorés, d'un productivisme échevelé : des prédations environnementales généralisées et de brutaux changements climatiques posant cette fois-ci, dans un proche avenir, la question même de notre survie comme humanité.
Voir les choses depuis la perspective de l'histoire
En fait, tout – en particulier ce qui touche aux effets des récentes découvertes scientifiques et techniques sur les sociétés humaines – devrait pouvoir être discuté aujourd'hui, se retrouver sur la grande table des débats collectifs, sans peur et en toute liberté.
Les crises multiples et combinées (crises économiques, sociales, politiques, sanitaires, écologiques, géopolitiques) que collectivement nous affrontons aujourd'hui nous le montrent comme jamais : cette trajectoire ascendante du progrès est en train de se déliter, voire de se transformer peu à peu en son contraire. Elle nous oblige brutalement à nous questionner sur le type de vie auquel nous aspirons comme humains, et sur le devenir de l'humanité. S'épanouira-t-elle sous le signe de la liberté ou de l'émancipation, ou au contraire se distordra-t-elle au gré des impasses d'un « désordre établi » maintenu d'une main de fer par les puissants d'aujourd'hui ? Tout des drames grandissants d'aujourd'hui ne nous oblige-t-il pas à voir les choses de loin, à les scruter depuis la perspective de l'histoire ? Il y a plus de 150 ans de cela, un certain Karl Marx rappelait que :
la seule liberté possible est que l'homme social, les producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges avec la nature […] et qu'ils accomplissent ces échanges en dépensant un minimum de force et dans les conditions les plus dignes et les plus conformes à la nature humaine. Mais, rappelait-il […] cette activité constituera toujours le royaume de la nécessité. C'est au-delà que commence le développement des forces humaines comme fin en soi, le véritable royaume de la liberté[3].
Cette vision large et prospective de la liberté, envisagée pour l'humanité universelle comme une libération vis-à-vis du temps de travail obligé, c'est là tout un programme dont on est loin de voir l'aboutissement aujourd'hui. Elle reste néanmoins d'une brûlante actualité quand on songe au surgissement dans nos sociétés de l'intelligence artificielle de dernière génération, si on ose s'arrêter à tout ce qu'elle bouscule sur le plan des conditions structurelles, économiques et techniques, favorisant ou non le déploiement possible d'une liberté humaine. Car on touche là, avec ce nouveau type de technologies, à quelque chose de résolument nouveau dont on peine à mesurer les conséquences sur les multiples dimensions de nos vies, travail et loisirs compris.
Il faut dire que les prouesses, dont cette intelligence artificielle est à l'origine, ont de quoi impressionner. La puissance et la rapidité de ses calculs comme les prodigieux résultats que ses algorithmes atteignent en matière de production quasi instantanée de textes conversationnels, d'images et de sons utilisables par tout un chacun, paraissent lui assurer un avenir à tout coup prometteur. Il faut dire aussi que cette capacité à recourir à des masses gigantesques de données numériques et à les trier à la vitesse de l'éclair recèle de potentiels côtés positifs, notamment en termes d'avancées scientifiques, et plus particulièrement ces derniers temps en termes de diagnostics médicaux. À condition cependant que ces machines apprenantes restent étroitement encadrées par des humains, selon des principes et des exigences éthiques et politiques réfléchies et connues de tous et toutes, de manière à pouvoir de part en part contrôler, dans la transparence, tous leurs tenants et aboutissants, leurs effets problématiques ou inattendus et leurs toujours possibles biais et bévues.
Derrière les prouesses des machines apprenantes, une désappropriation généralisée ?
Tel est le problème décisif : l'indéniable attractivité de l'IA l'a dotée d'une aura si séduisante qu'on tend, dans le grand public, à faire l'impasse sur les formidables dangers dont elle est en même temps le véhicule. Car telle qu'elle se présente aujourd'hui (aux mains des tout puissants monopoles que sont les GAFAM), telle qu'elle se déploie dans nos sociétés contemporaines (au sein d'un marché capitaliste néolibéralisé) et telle qu'elle est en train de faire son chemin dans nos vies (au travers d'une surveillance généralisée et d'une utilisation dérégulée de nos données numériques), l'IA risque bien de participer à un vaste mouvement de « désappropriation[4] » de nos vies. Oui, c'est bien cela : nous désapproprier d'une série d'habiletés collectives, de manières de faire, de façons d'être et de penser, de nous organiser socialement et politiquement, de nous éduquer ; toutes choses qui étaient jusqu'à présent le propre de notre humanité commune, avec certes les indéniables limitations qu'elles portaient en elles, mais aussi toutes les libertés en germe qu'elles ne cessaient de nous offrir.
L'IA tend à participer à ce mouvement de désappropriation, en remplaçant ces manières de faire et d'être par des machines et des modèles automatisés et interconnectés, au fonctionnement et aux finalités à priori particulièrement opaques. Les voilà en effet aux mains de grands monopoles privés, eux-mêmes fouettés par le jeu d'une concurrence impitoyable et mus par le jeu cruel et impersonnel de l'accumulation infinie du capital. Le tout, en sachant qu'il s'agit de grands monopoles sur lesquels nous n'avons, dans l'état actuel des choses, pratiquement aucun contrôle démocratique, aucun pouvoir de décision citoyen, aucune prise sociale ou individuelle digne de ce nom.
L'IA risque ainsi d'accentuer, d'élargir et de parachever le mouvement de désappropriation que le mode de production capitaliste faisait déjà peser sur la vie des travailleurs et des travailleuses, en touchant cette fois-ci non pas seulement à l'organisation de leur travail ou à l'extorsion d'une survaleur économique, mais en s'immisçant dans, et en bouleversant de part en part les mécanismes d'information, d'organisation, de « gouvernementalité » de la société entière, tout comme d'ailleurs en se donnant les moyens de contrôler plus étroitement la subjectivité de chacun des individus qui la composent. Le tout, en tendant à pousser les sociétés humaines vers la surveillance généralisée, le contrôle bureaucratique systématisé, la fragmentation définitive des liens sociaux et communautaires ; à rebrousse-poil de tous les idéaux démocratiques, d'égalité, de liberté, de fraternité et de diversité que tant d'entre nous continuent à poursuivre par le biais de la lutte sociale et politique.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de commencer cette présentation par une mise en perspective autour de la notion de progrès, et surtout, nous avons voulu placer ce dossier sur l'intelligence artificielle de dernière génération sous la forme d'une insistante interrogation dont nous chercherons à éclairer les enjeux sous-jacents : dernière les prouesses des machines apprenantes, ne se cache-t-il pas une désappropriation généralisée ?
Avec l'IA, en effet, l'affaire est plus que sérieuse, mais peut-être pas où on l'imaginerait de prime abord. Ici, il ne faut pas craindre de s'en prendre aux mythes qui circulent à son propos et qui, par exemple, verraient une sorte de grand ordinateur, super-intelligent et doté de conscience, prendre le dessus sur des sociétés humaines entières, un peu comme dans le célèbre film de Stanley Kubrick, 2001 : L'odyssée de l'espace, où l'ordinateur de bord HAL 9000 a pris le contrôle d'un vaisseau spatial malgré tous les efforts contraires de son équipage. Le problème n'est pas là, loin de là. Pourtant, si les peurs qu'une telle dystopie peut faire naitre sont actuellement dénuées de fondement, il reste qu'on a quand même bien des motifs d'être inquiets au regard des développements contemporains de l'IA de dernière génération.
Les véritables dangers de l'IA
Si aujourd'hui, ainsi que le rappelle Chomsky[5], l'IA dans sa forme actuelle est loin encore de pouvoir rivaliser sérieusement avec la versatilité et l'inventivité de l'intelligence humaine, ce qui fait néanmoins problème, c'est la manière dont ces nouvelles machines apprenantes – avec les impressionnants pouvoirs de mise en corrélation qu'elles recèlent – s'insèrent et se déploient dans les pores de nos sociétés déterminées par les logiques de l'accumulation capitaliste ; elles-mêmes déjà profondément transformées par le déploiement récent des nouvelles technologies de la communication et de l'information (ordinateur, Internet, téléphones intelligents, réseaux sociaux, etc.).
En ce sens, l'IA n'est qu'un pas de plus, une nouvelle étape qu'on serait en train de franchir, l'expression d'un saut qualitatif effectué dans le nouvel ordonnancement d'un monde globalisé, connecté de part en part et mis systématiquement en réseau grâce aux puissances de l'informatique couplées maintenant à celles de l'intelligence artificielle de dernière génération. Avec une nuance de taille cependant : cet ordonnancement tend, par la course aux profits et aux logiques concurrentielles qui l'animent, par l'opacité et le peu de régulation dont elle est l'objet, à court-circuiter les interventions sociales et collectives pensées depuis le bas, ainsi que les démarches démocratiques et citoyennes et toute perspective émancipatrice touchant aux fins poursuivies par l'implantation de ces nouvelles technologies. Tout au moins si nous ne faisons rien pour empêcher son déploiement actuel, si nous ne faisons rien pour tenter d'en encadrer mieux et plus rigoureusement la mise en place, et plus encore pour imaginer les contours d'un autre monde possible et lutter collectivement pour son avènement : un monde dans lequel les nouvelles technologies seraient au service de l'humanité universelle et non son triste contraire.
C'est la raison pour laquelle nous avons voulu penser ce dossier comme une invitation à l'échange et à la discussion, au débat, mais aussi comme un appel à la résistance et à l'action. L'importance et la nouveauté des dangers encourus, tout comme le contexte sociopolitique difficile dans lequel nous nous trouvons, appellent à combiner des forces, à trouver des alliés, à élaborer des fronts amples pour faire connaître l'ampleur des dangers qui sont devant nous, pour faire de l'intelligence artificielle une question politique cruciale auprès d'un large public.
Le côté inédit de ces dangers nous demande en particulier de réfléchir et de travailler sur la nécessité d'une réglementation immédiate et beaucoup plus stricte que celle, balbutiante, que nous connaissons aujourd'hui. Non pas en imaginant qu'on pourra ainsi facilement et définitivement « civiliser » une technologie aux logiques pernicieuses, mais en nous donnant les moyens de gagner déjà de premières batailles sur ce front, aussi minimes soient-elles au départ, pour pouvoir par la suite aller plus loin et s'interroger en profondeur sur le mode de vie qu'on veut imposer de la sorte ainsi que sur la conception du progrès sous-jacente qui en voile toutes les dimensions problématiques.
Car avec l'intelligence artificielle de dernière génération, voilà soudainement les plus intimes des potentialités intellectuelles et artistiques de l'humanité, ses fondements démocratiques, ses outils professionnels d'information, etc., qui risquent d'être profondément chambardées par les dynamiques d'un technocapitalisme dérégulé auquel nous faisons face aujourd'hui.
Un dossier pour débattre et résister
La nouveauté comme la complexité des dangers et les problèmes entrevus obligent à l'humilité et à la prudence, mais il faut s'y arrêter, prendre connaissance de la situation et voir les possibilités de résistance.
Nous allons d'abord tenter avec André Vincent (Intelligence artificielle 101) d'explorer les constituantes technologiques sur lesquelles repose ce qu'on appelle l'IA. On y explique les apports de chacune des quatre constituantes de ce « réseau de neurones apprenant profondément et générant quelque chose » : les machines, les logiciels, les données et l'argent. Et comment tout cela s'imbrique dans diverses applications dans une foule de domaines d'activités. On y examine aussi les diverses formes d'encadrement de l'IA proposées à ce jour ainsi que leur portée. Un glossaire des principaux termes utilisés en IA complète cet article.
Après ce texte d'introduction à l'IA, la partie du dossier, De quelques bouleversements structurels, veut exposer quelques-uns des dangers et des problèmes les plus évidents qui semblent aujourd'hui sauter aux yeux des spécialistes. Et comme en ce domaine, on est loin de l'unanimité, on verra la richesse et la diversité des points de vue, y compris d'importantes oppositions. En particulier quand il s'agit de nommer et de conceptualiser les bouleversements d'ordre systémique qui s'annoncent à travers le développement de l'économie numérique.
Ainsi Maxime Ouellet (Penser politiquement les mutations du capitalisme à l'ère de l'intelligence artificielle) critique ceux qui ont tendance à amplifier le caractère inédit d'une nouvelle forme de capitalisme induite par l'exploitation des données numériques, et qui oublient d'expliquer comment ces transformations s'inscrivent dans la continuité de dynamiques structurelles plus larges du capitalisme de l'après-guerre. Il insiste sur le fait que le développement capitaliste contemporain s'appuie moins sur la forme marchandise prédictive des algorithmes que sur la valorisation financière d'une nouvelle classe d'actifs intangibles (brevets, droits de propriété intellectuelle, fusions et acquisitions, alliances stratégiques, etc.). Il s'oppose ainsi aux thèses de Jonathan Durand Folco et de Jonathan Martineau (Vers une théorie globale du capitalisme algorithmique) qui cherchent au contraire à montrer que l'on assiste à une mutation importante du capitalisme rendue possible par l'utilisation des algorithmes, une mutation du même type que celle apportée par la révolution industrielle du XIXe siècle. Ils veulent mettre en lumière comment l'algorithme est devenu le nouveau principe structurant qui, tout en prenant appui sur lui, réarticule et dépasse le néolibéralisme financiarisé.
C'est aussi cette thèse que tentent de confirmer Giuliana Facciolli et Jonathan Martineau (Au cœur d'une reconfiguration des relations internationales capitalistes), en critiquant l'approche de Cédric Durand[6] sur le « techno-féodalisme ». Sur la base de cette critique, l'autrice et l'auteur veulent démontrer comment les dynamiques du capitalisme algorithmique permettent de mieux comprendre les phénomènes de la périphérisation de certains espaces du capitalisme mondial et de renouveler la compréhension des rapports de dépendance coloniale entre le Nord (États-Unis et désormais Chine) et le Sud global, se traduisant par de nouvelles formes de dépendance de gouvernementalité algorithmique.
On trouvera aussi dans cette première partie un autre axe révélateur de débat entre, d'une part, les thèses défendues par Philippe de Grosbois (L'intelligence artificielle, une puissance médiocre) et, d'autre part, celles promues par Eric Martin (La privation du monde face à l'accélération technocapitaliste). Alors que le premier insiste sur le fait qu'un travail critique sur l'IA doit éviter de lui attribuer des capacités qu'elle n'a pas (« Il n'y a pas d'intelligence dans l'IA »), le second va à l'inverse montrer comment, sous l'emprise du capitalisme et du machinisme formaté à l'IA, on est en train de passer d'une société aux aspirations « autonomes » à des sociétés « hétéronomes » au sein desquelles le sujet se trouve alors « privé de monde » par un processus de déshumanisation et de « démondanéisation ». Deux approches apparemment aux antipodes l'une de l'autre, mais qui toutes deux cherchent à mieux mesurer – véritable défi – l'impact exact de l'IA sur nos vies : avec d'un côté, de Grosbois minimisant la portée d'une telle technologie et rappelant l'importance de poursuivre les tâches non achevées de déconstruction des systèmes d'oppression patriarcale et raciale, pendant que de l'autre côté, Martin insiste sur la nouveauté et le danger majeur que représente cet « oubli de la société » induit par le déploiement de l'IA.
Dans une tout autre perspective, Myriam Lavoie-Moore (Quelques leçons féministes marxistes pour penser une l'intelligence artificielle autrement) explore certains éléments des théories féministes de la reproduction sociale afin de voir si, à travers elles, on peut envisager une production et un usage de l'IA qui serviraient les activités reproductives sans les asservir aux impératifs de la valorisation. En refusant de rejeter en bloc l'adoption de telles technologies, elle fait cependant apercevoir, au fil de son analyse, certaines des limitations qu'elles comportent, notamment en ce qui concerne le rapport entre le temps de travail obligé et les tâches du « care », d'ordre relationnel.
Dans un deuxième temps cependant, De quelques effets bien concrets, certains auteurs ne manqueront pas de nous ramener à la vie ordinaire en montrant les effets immédiats et bien concrets de l'IA.
Ainsi Dominique Peschard de la Ligue des droits et libertés (Capitalisme de surveillance, intelligence artificielle et droits humains) traite des effets pervers associés d'ores et déjà à l'IA. Il insiste autant sur les activités toxiques qu'elle tend à promouvoir (le discours haineux, le partage non consensuel d'images intimes, etc.) que sur les problèmes de santé (la dépendance aux écrans) qui en résultent, les impacts environnementaux qu'elle induit ou encore la surveillance policière qu'elle renforce.
Le texte de Caroline Quesnel et Benoit Lacoursière de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (L'intelligence artificielle comme lieu de lutte du syndicalisme enseignant) va dans le même sens, mais en insistant, pour le domaine de l'éducation, sur les vertus d'une perspective technocritique permettant de résister au risque de la discrimination algorithmique comme à celui du non-respect des droits d'auteur ou encore aux fraudes grandissantes. Elle et il mettent en lumière la nécessité d'un encadrement plus strict de l'IA et l'importance d'appliquer le principe de précaution à celle-ci.
On retrouve la même approche avec Jérémi Léveillé (L'intelligence artificielle et la fonction publique : clarification et enjeux), cette fois-ci à propos de la fonction publique, en montrant comment l'IA « perpétue plutôt le statu quo, c'est-à-dire la marginalisation et la discrimination de certaines populations selon des critères de genre, de religion, d'ethnicité ou de classe socioéconomique », le tout permettant à l'État d'accroitre la productivité et de diminuer les coûts.
De son côté, Jonathan Martineau (Les temporalités sociales et l'expérience du temps à l'ère du capitalisme algorithmique) fait ressortir les effets très concrets que risque de faire naitre l'IA à propos d'une dimension de notre vie d'humain à laquelle on ne prête pas nécessairement toute l'attention requise : notre façon d'expérimenter le temps. Il montre que le déploiement de l'IA brouille la distinction traditionnelle entre temps de travail et temps de loisirs, mais aussi tend à accélérer tous les rythmes de vie ainsi qu'à nous enfermer dans une vision « présentiste » du temps, c'est-à-dire qui privilégie indûment le moment du présent sur ceux du passé et de l'avenir.
Enfin, dans un troisième temps, De quelques considérations sur l'avenir, Jonathan Durand Folco (Dépasser le capitalisme algorithmique par les communs ? Vers un communisme décroissant technosobre) décrit comment l'IA – dans une société post-capitaliste où la prise en charge des communs serait assumée collectivement et démocratiquement – pourrait être utilisée dans une perspective de technosobriété et de décroissance. Faisant cependant ressortir les multiples inconnues comme les nombreux débats qui sont nés à ce propos, son texte se présente comme un exercice prospectif nous permettant de saisir toute l'ampleur des questions en jeu.
On ne sera donc pas étonné de réaliser que si ne manquent pas les dénonciations et points de vue critiques théoriques comme pratiques, notre dossier ne s'est cependant guère attardé aux formes de lutte à mener. C'est que, nouveauté de la thématique de l'IA, bien peu a encore été élaboré, bien peu a été pensé et mis en pratique de manière systématique à propos des luttes globales à entreprendre à l'encontre des dangers et des dérives de l'IA et de ses multiples applications. Tout reste à faire !
Pourtant les défis que la conjoncture contemporaine a placés devant nous obligent à lier étroitement réflexion et action, et par conséquent à réfléchir en situation, en fonction du contexte où l'on se trouve et qui ouvre ou non à la possibilité d'agir collectivement. On ne peut en effet ne pas tenir compte de la réalité des rapports de force sociopolitiques existants. Mais on ne peut en même temps, ainsi que nous le montre ce dossier sur l'IA, ne pas radicaliser nos interrogations sur le cours du monde, c'est-à-dire oser prendre les choses à la racine et par conséquent pousser la réflexion aussi loin que possible, en toute liberté, en n'hésitant pas à aller à rebrousse-poil de toutes les confortables indifférences de l'heure, pour agir ensemble. Puisse ce dossier nous aider à aller dans cette direction !
Par Flavie Achard, Édouard Lavallière, Pierre Mouterde, André Vincent
NOTES
1. Voir à titre d'exemple l'émission spéciale de deux heures de Radio-Canada le 7 décembre 2023, L'intelligence artificielle décodée, <www.youtube.com/watch?v=QFKHd2k_RNE> .
2. Sur le plan culturel, la modernité est née quand, dans le cadre d'une conception générale du monde, ont commencé à s'imposer au XVIIIe siècle, à l'encontre des traditionnelles idées d'immuabilité du monde, de divinité, de foi et de fidélité, les idées nouvelles d'histoire, d'humanité, de raison (les sciences) et de liberté. Et au sein du paradigme culturel de la modernité, les progressistes apparaissaient comme ceux qui avaient repris à leur compte l'idée d'une histoire nous conduisant nécessairement vers le progrès. On pourrait avancer qu'il y avait en fait deux grands courants de progressistes : ceux qui imaginaient, notamment aux États-Unis, « la révolution par le progrès » et ceux qui imaginaient, notamment dans l'ex-URSS, « le progrès par la révolution ».
3. Karl Marx, Le capital, Livre 3, Paris, Éditions sociales, 1976, chap. 48, p. 742.
4. Le terme de « désappropriation » nous semble, dans le cas de l'IA, plus juste que celui de « dépossession » dans le sens où cette désappropriation va bien au-delà du phénomène de l'exploitation par exemple d'un salarié, quand on le dépossède – par l'extorsion d'une plus-value – de la part de valeur qui lui revient à travers son travail. En fait, avec l'IA et ses effets en chaîne, se poursuit et s'accomplit ce mouvement de dépossession en l'élargissant à la société entière et en bousculant les processus cognitifs et émotionnels à partir desquels l'être humain pouvait collectivement et à travers la culture faire preuve d'intelligence – user donc de cette capacité d'unifier le divers – en ayant ainsi les moyens de développer à travers l'histoire un sens de l'innovation inédit.
5. « Contrairement à ChatGPT et ses semblables, l'esprit humain n'est pas un volumineux moteur de recherches statistiques en quête de modèles, avalant des centaines de téraoctets de données et extrapolant la réponse la plus probable à une question ou la solution la plus vraisemblable à un problème scientifique. Bien au contraire, l'esprit humain est un système étonnamment efficace et même raffiné qui fonctionne avec de petites quantités d'informations ; il ne cherche pas à déduire des corrélations sommaires à partir de données, mais à élaborer des explications. […] ChatGPT fait preuve de quelque chose de très similaire à la banalité du mal : plagiat, apathie et évitement. Elle reprend les arguments habituels de la littérature dans une sorte de superbe automaticité, refuse de prendre position sur quoi que ce soit, plaide non seulement l'ignorance mais aussi le manque d'intelligence et, en fin de compte, offre une défense du type « je ne fais que suivre les ordres », en rejetant toute responsabilité sur ses créateurs. » Noam Chomsky, New York Times, 8 mars 2023, traduction du site Les Crises, <https://www.les-crises.fr/la-promes...> .Voir aussi Hubert Krivine, L'IA peut-elle penser ? Miracle ou mirage de l'intelligence artificielle, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2021, p. 79 : « Comme l'écrit Yan Le Cun, « le fait que le monde soit tridimensionnel, qu'il y ait des objets animés, inanimés, mous, durs, le fait qu'un objet tombe quand on le lâche… les humains apprennent ça par interaction. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas faire avec les ordinateurs. Tant qu'on y arrivera pas, on n'aura pas de machines vraiment intelligentes. » […] Pour Descartes, c'est bien connu, « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; il ne l'est pas pour la machine. Bien des bévues de l'IA résultant de calculs très sophistiqués, doivent être corrigées en y faisant tout simplement appel ».
6.Cédric Durand, Techno-féodalisme. Critique de l'économie numérique, Paris, Zones, 2020. Ce dernier rejoint en partie les thèses de Maxime Ouellet sur l'importance des biens intangibles (brevets, droits de propriété intellectuelle, etc.) au sein du capitalisme contemporain.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le 28e cahier des Brigades éditoriales de solidarité avec l’Ukraine est disponible au téléchargement libre

Les Brigades éditoriales de solidarité ont été créées au lendemain de l'agression de la Russie poutinienne contre l'Ukraine. Elles regroupent les éditions Syllepse (Paris), Page 2 (Lausanne), M Éditeur (Montréal), Spartacus (Paris) et Massari (Italie), les revues New Politics (New York), Les Utopiques (Paris) et ContreTemps (Paris), les sites À l'encontre (Lausanne) et Europe solidaire sans frontières, les blogs Entre les lignes entre les mots (Paris) et Utopia Rossa, ainsi que le Centre Tricontinental (Louvain-la-Neuve) et le Réseau syndical international de solidarité et de luttes.

Sexualités et dissidences queers

À la jonction des savoirs universitaires et militants, ce livre entend démystifier l'emprise qu'exercent les normes sur nos sexualités. L'ordre sexuel comporte un ensemble de règles souvent tacites régulant les dimensions les plus intimes de nos vies. De quoi est-il constitué ? Et surtout, qu'a-t-il comme effet sur certain·es membres de la société ?
Cet ouvrage collectif réunit des personnes qui réfléchissent à la libération des pratiques sexuelles et amoureuses à partir de la sociologie, de la sexologie, du travail social ou d'une perspective de terrain.
Il permet une rare prise de parole commune de dissident·es sexuel·les autour des bisexualités, du plaisir, de la culture du consentement, du sexting, du travail du sexe, du cruising gai, de la pornographie, du polyamour, de l'éducation à la sexualité, du chemsex, du BDSM et de l'asexualité.
Face au backlash anti-LGBTQ+, nous refusons d'être écrasé·es, nous refusons de disparaître.
Avec des textes de
MP Boisvert, mathilde capone, Marianne Chbat, Julie Descheneaux, Chacha Enriquez, Jorge Flores-Aranda, Blake Gauthier-Sauvé, Marie Geoffroy, Stéphanie Gingras-Dubé, Adore Goldman, Julie Lavigne, Miko Lebel, Hugues Lefebvre Morasse, Sabrina Maiorano, Mélina May, Rossio Motta-Ochoa, Alex Nadeau, Gabrielle Petrucci, Gabrielle Richard, Em Steinkalik et Gui Tardif.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Écosabotage | Livre à paraître le 9 avril | Est-il temps de recourir à l’écosabotage pour défendre la vie sur Terre ?

Malgré les rapports du GIEC, les COP et les manifestations, la catastrophe climatique s'aggrave. Est-il temps de recourir à l'écosabotage pour défendre la vie sur Terre et infléchir le cours des choses ?
L'essai Écosabotage - De la théorie à l'action, de l'essayiste Anaël Chataignier, va paraître en librairie le 9 avril prochain.
En bref : À l'instar des suffragettes, les écologistes gagneraient-ils à inclure le sabotage dans leur arsenal tactique ? Une réflexion essentielle sur l'activisme dans un contexte d'écocide, doublée d'un manuel d'action militante.
À propos du livre
Incendies allumés par les suffragettes pour obtenir le droit de vote des femmes, déraillements de trains provoqués par la Résistance française pour contrer l'avancée nazie, opérations clandestines menées par le parti de Nelson Mandela pour faire tomber le régime d'apartheid... Le recours au sabotage fait partie intégrante de l'histoire des luttes politiques. Aujourd'hui, comment réagir à la négligence funeste des gouvernements face à la catastrophe climatique ? La désobéissance civile, l'action directe ou le blocage sont-ils de mise ? L'écosabotage gagnerait-il à faire partie de l'arsenal tactique des écologistes ? Considérant que les conditions de possibilité de la vie sur Terre sont menacées par la pollution et les GES, qui sont les véritables saboteurs ? Dans un contexte d'écocide, « saboter des pollueurs » signifie-t-il « désarmer des criminels » ?
Pour Anaël Chataignier, la gravité de la situation actuelle nous impose de parler stratégies, organisation et modes d'action. Car malgré les rapports alarmants du GIEC, les innombrables COP et les manifestations pour le climat, le virage écologique tarde et les pollueurs continuent d'œuvrer en toute impunité. Alors que les limites de la planète sont sans cesse transgressées, ce livre propose de repousser les limites de notre impuissance face à cette destruction. Il offre une contribution importante et légitime à un débat qui anime les luttes écologistes dans un contexte où la catastrophe environnementale s'avère chaque semaine plus grave que prévu. Ça ne peut plus durer.
S'inscrivant dans une longue tradition d'essais ayant fait de la radicalité un jalon incontournable de l'action militante et politique, ce livre prend le parti de (re)mettre de l'avant la pratique du sabotage et de l'action directe qui a été au cœur de bien des mouvements politiques du dernier siècle et demi. Essai de théorie politique et manuel d'action militante, Écosabotage veut aider le mouvement écologiste à repenser ses stratégies, reprendre l'offensive et réellement infléchir le cours des choses. Plaidoyer courageux en faveur de la convergence des luttes et de la diversité des tactiques, il nous invite à « désarmer » ce qui nous tue et à mettre du sable dans l'engrenage pour stopper la destruction du vivant.
À propos de l'auteur
Agrégé et docteur en histoire de l'art, artiste et professeur de dessin, Anaël Chataignier milite au sein de différents collectifs de sensibilité écologique et/ou anarchiste. Écosabotage est son premier essai.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Instrumentaliser une tragédie pour en justifier une autre
Cet après-midi j'ai visionné le film de Jonathan Glazer, La Zone d'intérêt (2023) au Cinéma Beaubien. Un film qualifié par le réalisateur de La liste de Schindler, Steven Spielberg, de « meilleur film sur l'Holocauste que j'ai vu depuis le mien ».
J'en sors profondément ému.
Ovide Bastien, professeur retraité du Collège Dawson
Ici, le paradis : scènes où on voit le commandant d'Auschwitz-Birkenau, Rudolf Höss, en train de vivre paisiblement avec son épouse, Hedwig, et leurs enfants sur un magnifique et grand terrain – belle musique, rires, histoires racontées aux enfants au coucher, très belles fleurs, piscine, jardin de légumes, rivière, Höss frottant affectueusement sa tête sur celle de son cheval et lui disant affectueusement « Je t'aime » ...
Là, directement adjacent à ce terrain, l'enfer : on voit le grand mur surmonté de barbelés du plus grand camp de concentration et centre d'extermination de l'Allemagne nazi, et on entend occasionnellement, au cœur de cette vie familiale idyllique, coups de fusils et cris des victimes de l'Holocauste...
Je ressens une émotion similaire, et tout aussi profonde et bouleversante, lorsque je vois ce qui passe à Gaza et en Cisjordanie... Lorsque je vois la destruction massive, la faim utilisée comme arme de guerre... Lorsque je vois grimper, de jour en jour, le nombre de victimes – présentement, 32 800 Gazaouis morts et 75 200 blessés, la plupart enfants et femmes... Lorsque je vois Israël, alors que l'attention du monde entier se concentre sur Gaza, infliger une brutalité et une répression de plus en plus intenses en Cisjordanie, des colons juifs accaparant de plus en plus de terres, expulsant les familles palestiniennes avec la complicité de militaires israéliens qui effectuent des raids quotidiens durant lesquels, depuis le 7 octobre, ils ont tué 460 Palestiniens et en ont détenu 7 750, généralement sans accusation et sans possibilité de procès...
« Israël, par l'intermédiaire de ses médias et avec l'aide de ses universitaires, parle d'une voix unanime et encore plus forte que lors de la deuxième guerre du Liban en 2006, » commente l'historien juif Ilan Pappé. « Une fois de plus, l'État juif se trouve plongé dans une fureur qui, sous le couvert de la vertu, se traduit par une politique de destruction massive de la bande de Gaza. Il faut analyser l'autojustification honteuse de tant d'inhumanité et d'impunité afin de comprendre la quasi-immunité internationale dont jouit Israël en dépit de ses actions à Gaza. Cette immunité repose avant tout sur de mensonges éhontés, transmis dans une langue de bois qui rappelle les jours sombres de l'Europe des années 1930, » poursuit Pappé. « Toutes les demi-heures, pendant l'assaut de Gaza, les bulletins d'information de la radio et de la télévision décrivent les habitants de Gaza comme des terroristes et le massacre massif qu'Israël leur inflige comme de la légitime défense. Israël se présente à son propre peuple comme la victime vertueuse se défendant contre un grand mal. Le monde universitaire est recruté pour expliquer à quel point la lutte palestinienne est démoniaque et monstrueuse si menée par le Hamas. »[1]
Pappé ne décrit pas ici le massacre qu'Israël commet présentement à Gaza. Il a rédigé ce commentaire en 2010 et se réfère au massacre perpétré par Israël à Gaza en janvier 2009.
Cependant, la ressemblance entre les deux massacres, les justifications données par Israël pour les commettre, ainsi que les réactions de la communauté internationale, est étonnante.
Dans un article précédent <https://www.pressegauche.org/Les-at...> (Presse-toi à gauche, le 12 mars), j'ai puisé abondamment dans l'œuvre d'Ilan Pappé pour montrer que les atrocités actuelles à Gaza ne font que refléter, et peut-être même dépasser, celles que commettaient déjà les sionistes en Palestine lors de la fondation de l'État juif en 1947-8.
Dans celui-ci, je vais expliquer pourquoi cet historien juif, pourtant de renommée internationale, est tellement détesté aujourd'hui dans son propre pays Israël.
Pourquoi on déteste tant Ilan Pappé en Israël
Ilan Pappé est né le 7 novembre 1954 à Haïfa, d'un couple de juifs allemands qui, pour échapper aux premières persécutions nazies, arrivait, dans les années 1930, dans ce qui est aujourd'hui Israël. À 18 ans, il effectue son service militaire obligatoire dans l'armée israélienne et est employé sur les hauteurs du Golan pendant la guerre du Kippour en 1973. En 1978, il est diplômé de l'Université hébraïque de Jérusalem, et, en 1984, il obtient un doctorat de l'Université d'Oxford.
Sa thèse doctorale porte sur la relation entre l'Angleterre et la naissance d'Israël. Et le hasard veut que ce soient Albert Hourani et George Owen, deux intellectuels qui connaissent fort bien la version palestinienne des évènements de 1948, qui le dirigent dans sa recherche.
C'est ainsi que Pappé, qui a souscrit depuis l'enfance à la mythologie sioniste au sujet de la fondation de l'État juif en 1948, découvre graduellement la version du camp qui, jusqu'alors, a représenté pour lui ‘l'ennemi'. On lui a appris que, lorsque les Nations unies, à l'expiration du mandat britannique en Palestine, proposent de diviser la région en deux États, le monde arabe s'oppose à cette proposition alors que les Juifs l'acceptent immédiatement. S'ensuit une attaque militaire des Arabes durant laquelle ceux-ci convainquent les Palestiniens d'abandonner leurs territoires - malgré les appels des dirigeants juifs les invitant à y rester - afin de faciliter l'entrée des troupes arabes.
La tragédie des centaines de milliers de réfugiés palestiniens, selon cette mythologie, ne serait donc pas directement imputable à Israël.
Lorsque Pappé, dans sa recherche doctorale, se met à examiner les archives historiques sur la guerre de 1948, qui viennent tout juste d'être déclassifiées, il découvre une tout autre interprétation. Une interprétation qui le marquera profondément et changera le cours de sa vie.
Il apprend que bien avant l'attaque militaire du monde arabe, qui fut d'ailleurs assez facilement repoussée par les Juifs, les dirigeants du futur État d'Israël, sous la direction de David Ben Gurion, avaient conçu, et mis en branle de façon brutale et impitoyable, l'épuration ethnique de la Palestine. Celle-ci, complétée durant la guerre, correspond à ce que les Palestiniens, jusqu'à ce jour, qualifie de Nakbah (la catastrophe).
De retour dans son pays natal, Pappé commence à donner des cours à l'Université de Haïfa. Peu étonnamment, il enseigne à ses étudiants la nouvelle interprétation de l'histoire d'Israël que son doctorat lui a permis de découvrir. Même si cela dérange et étonne, Pappé est toléré et même apprécié, car un vent nouveau d'ouverture et de pluralisme commence à se faire sentir en Israël.
L'exemple le plus spectaculaire de cette ouverture est sans doute le livre The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947—1949 que publie en 1989 un de ses collègues à l'Université de Haïfa, Benny Morris. Ce livre décrit de façon détaillée les nombreuses expulsions de Palestiniens de leurs villages et villes effectuées par les Juifs en fondant Israël. Des expulsions durant lesquelles eurent lieu des massacres et toutes sortes d'atrocités, incluant des viols.
« Quiconque fréquenterait le monde universitaire israélien au milieu des années 1990 sentirait sans doute un vent d'ouverture et de pluralisme souffler dans les couloirs d'un établissement stagnant qui avait été douloureusement fidèle à l'idéologie sioniste dominante dans tous les domaines de recherche touchant à la réalité israélienne, passée ou présente, » affirme Pappé. « Cette nouvelle ambiance permettait aux chercheurs de revoir l'histoire de 1948 et d'accepter certaines revendications palestiniennes sur ce conflit. Elle donnait lieu à des travaux d'érudition locaux qui remettaient en question de manière spectaculaire l'historiographie des débuts d'Israël. »
Cependant, cette fenêtre d'ouverture disparaît avec une rapidité remarquable, lorsqu'éclate la Seconde Intifada en 2 000, cet immense soulèvement populaire palestinien contre l'occupation, souvent accompagné de gestes violents, et qui ne se terminera qu'en 2005.
« Moins de dix ans plus tard, il aurait fallu un visiteur imaginatif et déterminé pour trouver la moindre trace de cette ouverture et de ce pluralisme, » affirme Pappé. « Sa disparition s'inscrit dans le cadre de la disparition générale de la gauche israélienne au lendemain de l'Intifada. (...) Lorsque l'Intifada a éclaté, la gauche l'a exploitée pour quitter une position inconfortable de patriotisme douteux et se rapprocher du centre consensuel. Là, au cœur de la politique israélienne, les fils perdus ont été accueillis dans un processus d'effacement des différences idéologiques entre la gauche et la droite dans l'État juif, qui s'est poursuivi au cours du siècle suivant. »
Rien n'explique mieux ce grand et rapide tournant idéologique qui a eu lieu en Israël que l'Affaire Katz. Un conflit qui amènera Pappé à quitter son pays natal en 2007 et qui illustre pourquoi il est tant détesté aujourd'hui dans son pays.
L'affaire Katz
À la fin des années 1980, Teddy Katz, un étudiant juif dans la quarantaine de l'Université de Haïfa, d'orientation sioniste mais faisant partie du mouvement appelant à la réconciliation, choisit comme sujet de maitrise les évènements qui se sont déroulés dans certains villages près de Haïfa durant la guerre de 1948. Il demande à Pappé de superviser sa recherche, mais ce dernier lui conseille de choisir un autre professeur. Si c'est moi, lui dit-il, cela pourra possiblement affecter la crédibilité de tes découvertes, étant donné que mon opinion sur la question palestinienne est fort connue.
Katz choisit donc un autre professeur.
Après plusieurs années d'efforts soutenus, comprenant de longs interviews de Juifs et de Palestiniens qui ont été témoins des évènements entourant l'expulsion des Palestiniens de villages où se trouve aujourd'hui un tronçon de l'autoroute n° 2 entre Haïfa et Tel Aviv, Katz rédige une maitrise pour laquelle il obtient 97 %, une note qui reflète celles qu'il avait obtenues dans l'ensemble de ses cours.
Un chapitre de sa maitrise porte sur le village de Tantura, que les forces juives occupaient le 22 mai 1948. À partir des preuves qu'il a recueillies, Katz arrive à la conclusion que lors de la conquête de Tantura, les forces juives auraient tué un grand nombre d'individus, peut-être jusqu'à 225. Il estime qu'une vingtaine d'entre eux sont morts pendant la bataille comme telle, et que les autres, civils et combattants capturés, ont été tués après la reddition du village et alors qu'ils étaient sans armes.
Comme les autres maitrises, celle de Katz est déposée dans la bibliothèque de l'université et ne dérange personne.
En janvier 2001, cependant, tout cela change lorsque le journaliste d'enquête Amir Gilat découvre la thèse dans la bibliothèque et en fait un compte rendu dans le quotidien Ma'ariv. Certains des soldats appartenant à la brigade Alexandroni qui avait capturé Tantura, écrivent à Gilat et protestent avec véhémence, niant qu'un massacre ait eu lieu. Par ailleurs, d'autres soldats de cette même brigade, ainsi que des témoins palestiniens, lui écrivent aussi, corroborant les faits avancés par Katz.
L'association des vétérans d'Alexandroni, habituée à voir des chercheurs ne lui demander de raconter que des histoires d'héroïsme personnel et de bravoure, et non de massacres, est tellement indisposée qu'elle entame une poursuite contre Katz pour diffamation. La somme demandée : 1 million de shekels, soit environ $300 000 Can.
Profondément troublé, Katz demande à son université de l'aider dans la procédure judiciaire. Elle refuse, et décide plutôt de biffer, avant même la tenue d'un procès, son nom de la liste des étudiants distingués, une récompense qu'il avait pourtant obtenue, précise Pappé, non seulement pour sa thèse, mais aussi pour l'ensemble de sa performance dans le cadre du programme de maîtrise.
Pour comprendre ce comportement peu rationnel de la part de l'Université de Haïfa, il importe de comprendre le contexte, poursuit Pappé. La Seconde Intifada avait éclaté à la fin de septembre 2000, avait gagné Israël, et risquait d'atteindre le campus de Haïfa, où 20 % des étudiants étaient des Israéliens palestiniens. Le climat de guerre était tel que l'université imposait des sanctions draconiennes aux étudiants palestiniens qui affirmaient leur identité en brandissant le drapeau palestinien ou appelant à la libération de la Palestine, tandis qu'un comportement similaire de la part d'étudiants juifs - afficher l'identité d'Israël, brandir un drapeau et prendre position contre l'Intifada – était non seulement toléré mais même encouragé.
Peu étonnant donc que, dans un climat de quasi-guerre, Katz, dans les mois précédents son procès du 13 décembre 2000, ait subi harcèlement constant et menaces téléphoniques dans le kibboutz où il vivait. Et que quelques semaines avant ce procès, cet homme de cinquante ans subisse une attaque cérébrale.
Durant le procès, on accuse Katz d'avoir systématiquement fabriqué des documents et de les avoir volontairement remis ‘à l'ennemi'.
« Pour démontrer que Katz avait systématiquement falsifié ses documents, l'avocate de l'accusation, Giora Erdingast, présente six exemples dans lesquels la transcription des bandes audio ne correspond pas à ce qui est écrit dans la thèse, » affirme Pappé. « Bien que consciente qu'il s'agisse des seules citations erronées trouvées parmi plus de 100 citations exactes, et qu'aucune d'entre elles ne remet en cause la conclusion principale selon laquelle des meurtres massifs de paysans innocents avaient eu lieu, Erdingast affirme que ces exemples illustrent que la thèse dans son ensemble est une fabrication. »
Après la deuxième journée de procès, Katz est pâle, épuisé, et déprimé. Il n'en peut plus d'endurer autant de tribulations et de pression. Durant la soirée, il se réunit, sans avertir l'avocat qui le défend, avec des membres de sa famille et un représentant de l'université. Le lendemain, il soumet à la juge une déclaration écrite où il affirme qu'après « avoir vérifié et revérifié les preuves », il reconnaît que sa conclusion « est dénuée de tout fondement », et qu'il n'a « pas voulu suggérer qu'il y a eu un massacre à Tantura. »
À peine quelques heures plus tard, Katz regrette son geste, et annonce à la juge Pilpel qu'il se rétracte, qu'il retire sa déclaration qui vient d'être présentée à la cour. Cependant, celle-ci refuse d'accepter sa rétractation
En raison du règlement conclu à l'amiable, je considère, dit-elle, que l'affaire est close.
Lorsque l'université prend l'initiative de publier sur son site web la déclaration de Katz, même si ce dernier l'a rétractée, Pappé est profondément outré. Il s'attèle à la tâche d'écouter attentivement, et ce pendant trois jours et trois nuits consécutifs, les 60 heures de cassettes audios que Katz lui avait données, et qui contenaient les témoignages oraux de personnes ayant vécu les événements à Tantura en 1948.
« Je ne les avais jamais écoutées auparavant, » affirme Pappé. « Ma défense de Katz était fondée sur l'amitié et la confiance. Ces trois jours et ces trois nuits m'ont non seulement révélé directement l'histoire effrayante des actes meurtriers qui ont eu lieu à Tantura en mai 1948, mais m'ont également persuadé de la nécessité d'étendre le projet d'histoire orale de la Nakbah et du devoir de défendre ces témoignages. Je me suis rendu compte, avec horreur, que c'était ma propre université qui s'acharnait à écraser et détruire les souvenirs sacrés des habitants de ces villages, ainsi que les preuves des crimes commis en 1948. »
Une fois ce travail de moine terminé, Pappé publie sur le site Internet de l'université les témoignages qu'il trouve les plus révélateurs. Cela provoque un tel émoi chez professeurs et étudiants que l'université décide d'établir une commission d'enquête qui devra examiner à nouveau la thèse de Katz. La conclusion de cette commission est toujours la même. La thèse est faible et erronée et doit donc être rejetée. Puis, dans une cérémonie qui rappelle les années les plus sombres de l'Europe des 1930s, l'université organise une cérémonie officielle où la thèse est retirée de la bibliothèque, précise Pappé,
Comme les règles de l'université permettent à Katz de présenter à nouveau sa thèse, il décide d'aller de l'avant. Il approfondit son enquête pendant presqu'un an, et soumet sa thèse, en corrigeant les quelques erreurs apparues dans la première version et en ajoutant des informations encore plus accablantes.
Encore une fois, cependant, la thèse est rejetée. L'argument toujours mis de l'avant pour la rejeter, en mai 2003, est qu'elle est de qualité insuffisante. La véritable raison, insiste Pappé, est autre. On la perçoit comme un acte de trahison contre un État en temps de guerre !
Révolté de voir une institution académique se comporter ainsi, Pappé décide de mener ces propres recherches sur le massacre de Tantura. Ce qu'il découvre, à la fois dans les documents d'archives qu'il consulte et les nouvelles preuves orales qu'il recueille, l'amène à conclure, de façon encore plus catégorique que ne le faisait Katz, qu'un massacre a bel et bien été commis à Tantura en mai 1948.
Les vétérans d'Alexandroni n'osèrent pas me poursuivre en justice, note Pappé, car ils « savaient que je ne céderais pas sous la pression d'un procès et que je l'utiliserais également comme forum pour présenter ce que je croyais être les faits sur la Nakbah au public israélien et international ».
La révolte de Pappé ne se limite pas au seul niveau académique. Il condamne de plus en plus ouvertement la politique insensée qu'Israël met en pratique dans les territoires occupés, politique qu'il décrit ainsi :
« Restriction de l'approvisionnement alimentaire à des communautés entières, conduisant ainsi à la malnutrition ; démolition de maisons à une échelle sans précédent ; assassinat de citoyens innocents, dont beaucoup d'enfants ; harcèlement aux postes de contrôle et destruction de la vie sociale et économique dans les territoires ».
Dès le début des années 2000, Pappé est parfaitement conscient « qu'il n'existe aucune force interne capable d'empêcher Israël de détruire le peuple palestinien et de l'amener à mettre fin à l'occupation ». Il choisit donc, pour faire connaître ses critiques, tous les forums internationaux possibles. Étant donné la politique étatsunienne, l'inaction européenne et l'impuissance et la désunion des États arabes, prédit-il dans ces forums, « le pire est à venir ».
À cause de sa critique mordante du comportement d'Israël, on l'ostracise de plus en plus sur le campus. Un de ses collègues, par exemple, commence à lui faire parvenir des lettres ouvertes, dans lesquelles il l'appelle Lord Haw-Haw, le nom du tristement célèbre Irlandais qui collaborait avec les nazis.
Je me foutais du nom qu'on me donnait, affirme Pappé. Cependant, cet incident illustrait « avec quelle facilité les Israéliens avaient nazifié les Palestiniens, tandis que leur armée recourait à un répertoire de cruautés rappelant les pires régimes du XXe siècle ».
Dans le contexte israélien, m'étiqueter ainsi revenait « à appeler les gens à me tuer », poursuit Pappé. Mais faire cela n'était pas considéré un crime dans mon université, alors que « dénoncer un massacre commis par les Israéliens en 1948 », était perçu comme un geste criminel.
L'ostracisation atteint son paroxysme le 5 mai 2002, lorsqu'une lettre express arrive au domicile de Pappé le convoquant à comparaître devant un tribunal disciplinaire spécial. En raison de sa position dans l'affaire Katz, et de la mauvaise réputation internationale qu'il est en train de donner à son université, on veut son renvoi.
Le jour même, Pappé fait parvenir une lettre à tous ses amis à travers le monde expliquant ce qui lui arrive et demandant leur solidarité.
La réponse à sa demande le laisse bouche bée. Dans l'espace de deux semaines, il ne reçoit pas moins de 2 100 lettres de soutien, avec copie au recteur de l'Université de Haïfa. La solidarité internationale est tellement massive que l'université décide de suspendre immédiatement la procédure disciplinaire.
Si Pappé prend la décision en 2007 de quitter son pays natal, c'est parce que la vie en Israël lui devient de plus en plus insupportable.
Lorsqu'Israël, en 2006, bombarde massivement des civils au Liban, occasionnant la mort d'environ 20 000 Palestiniens et Libanais, il sent que la population israélienne appuie pleinement cette politique génocidaire, de la gauche à la droite de l'échiquier politique sioniste. La seule critique que la population fait au gouvernement, c'est de ne pas autoriser l'armée à faire davantage de frappes destructives. Cette attitude troublante, il la retrouve partout : dans la presse, dans les talk-shows et les émissions téléphoniques, ainsi que dans son entourage immédiat.
Il fait aussi l'objet de menaces de mort de plus en plus nombreuses, parfois par téléphone, parfois par des lettres couvertes d'excréments déposées dans sa boîte aux lettres. Une personne qui l'appelle souvent lui rappelle un jour qu'il connait les mouvements de sa femme et de ses enfants, et il menace de les tuer.
Pappé vit présentement en Angleterre et enseigne l'histoire au département d'études arabo-islamiques de l'Université d'Exeter.
Instrumentaliser une tragédie pour en justifier une autre
Lorsque de jeunes Israéliens faisaient la fête et dansaient dans un kibboutz la nuit du 7 octobre 2023, on pouvait apercevoir, à deux kilomètres à peine, un grand mur surmonté de barbelés. Mais ce mur, et ce qui se passait derrière, n'était pas du tout une Zone d'intérêt pour eux. Ni d'ailleurs pour personne dans le monde. Y compris pour les nombreux pays arabes qui étaient alors occupés à normaliser leurs relations avec Israël.
Tout le monde vaquait paisiblement à ses occupations quotidiennes... travail, histoires aux enfants et petits-enfants à l'heure du coucher, exercice dans le gymnase, consultations thérapeutiques, restaurants, souci au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie...
Puis vint l'attaque féroce.
Cris et coups de feu surgissant soudainement de l'immense mur entourant la bande de Gaza, se dirigeant vers les avant-postes militaires israéliens et tuant atrocement sur leur chemin quelque 1200 Israéliens, de nombreux soldats mais surtout des civils, dont plusieurs enfants, puis retournant à Gaza sur des motos et dans des camionnettes avec 240 otages...
Cris et coups de feu provenant du plus grand camp de concentration du monde, où vivent 2,5 millions de Palestiniens, dont 70 % sont des Palestiniens ou descendants de Palestiniens qui ont été déracinés de leurs maisons et terres par les colonisateurs juifs il y a quelque 75 ans. La moitié d'entre eux sont des enfants, les plus traumatisés au monde, selon une enquête récente... Une immense prison à ciel ouvert où les gens, depuis 15 ans, souffrent atrocement à cause d'un siège total imposé par Israël. Un endroit où il est extrêmement difficile de joindre les deux bouts et où les enfants sont pris au piège, n'ayant aucun avenir devant eux...
Nous savons comment Israël a réagi à l'attaque du Hamas du 7 octobre : bombardement massif de Gaza, destructions et tueries massives, famine utilisée comme arme de guerre.
Le 26 janvier, la Cour internationale de justice estime recevable l'accusation de génocide portée par l'Afrique du Sud contre Israël et entame une enquête formelle.
Le 10 mars, Jonathan Glazer, qui vient de recevoir, lors de la 96e cérémonie des Oscars, le prix du meilleur long métrage international pour La Zone d'intérêt, affirme :
« Tous nos choix ont été faits pour refléter et nous confronter aux réalités actuelles. Non pas pour dire ‘Regarde ce qu'ils ont fait hier', mais plutôt ‘Regarde ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui'. Notre film illustre où mène la déshumanisation, dans ce qu'elle a de pire. Celle-ci a façonné notre passé et elle façonne notre présent. En ce moment même, nous nous tenons ici en tant que personnes qui réfutent leur judéité et l'Holocauste lorsque ceux-ci se transforment en prétexte pour justifier une occupation, qui a plongé dans le conflit tant de personnes innocentes. »[2]
Le 25 mars, la rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, dépose un rapport où elle affirme qu'il « existe des motifs raisonnables » de croire qu'Israël a commis plusieurs « actes de génocides ».
Le même jour une motion de cessez-le-feu est acceptée au Conseil de sécurité de l'ONU, 14 membres votant en faveur et les États-Unis, pour une très rare fois, s'abstenant.
Étant donné que les États-Unis ont utilisé leur droit de veto des dizaines de fois par le passé pour bloquer toute motion du Conseil de sécurité de l'ONU jugée critique à l'égard d'Israël, dont trois depuis l'invasion de Gaza à la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre, plusieurs observateurs en arrivent à la conclusion que cette abstention montre que le fossé grandissant entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou a atteint un point de rupture.
Ce qui arrive quelques heures plus tard semble pourtant indiquer qu'ils se trompent.
« Il s'agit d'une motion non contraignante, » déclare John Kirby, directeur du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. « Elle n'a donc aucun impact sur la capacité d'Israël à continuer de s'en prendre au Hamas. »[3]
« Nous n'avons pas constaté qu'Israël viole le droit international humanitaire, ni en ce qui concerne la conduite de la guerre, ni en ce qui concerne la fourniture de l'aide humanitaire », déclare le porte-parole du Département d'État George Miller. [4]
Ayant obtenu encore une fois le feu vert de son allié étatsunien, Benjamin Netanyahu poursuit de plus bel ses bombardements massifs de Gaza, détruisant toujours plus d'infrastructures, notamment des hôpitaux, et tuant toujours plus de Palestiniens.
Le 27 mars, le lendemain de la résolution de cessez-le-feu du Conseil de sécurité de l'ONU, Al Jazeera nous montre une scène que son caméraman à Gaza vient de capter quelques minutes plus tôt. Deux Palestiniens, non armés et marchant les bras en l'air, sont froidement abattus par des soldats israéliens. Un énorme bulldozer pousse ensuite les deux corps et les enterre dans le sable et les décombres. [5]
Le 28 mars, les juges de la Cour internationale de justice (CIJ) prennent unanimement la décision d'ordonner à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour garantir que les denrées alimentaires de base parviennent sans délai à la population palestinienne de Gaza. Les Palestiniens de Gaza, affirment-ils, sont confrontés à des conditions de vie de plus en plus difficiles, et la famine et le manque de nourriture se répandent. Israël doit prendre « toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer sans délai, en pleine coopération avec les Nations unies, la fourniture sans entrave et à grande échelle, par toutes les parties concernées, des services de base et de l'aide humanitaire nécessaire d'urgence, notamment la nourriture, l'eau, le carburant et les fournitures médicales ». [6]
Les États-Unis ont pris la décision de cesser de financer le principal organisme de l'ONU capable de fournir une aide humanitaire aux Palestiniens (UNRWA), et ceci pour au moins une année supplémentaire. Par ailleurs, depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, ils ont autorisé une centaine de livraisons d'armes à Israël.
Alors que Joe Biden tente de démontrer un profond humanisme en répétant inlassablement « beaucoup trop de civils ont perdu la vie à Gaza, il faut absolument que davantage d'aide humaine parvienne aux populations affamées, nous faisons tout ce qui est humainement possible pour y parvenir », voici ce que l'on apprend vendredi 29 mars :
« Les États-Unis ont autorisé ces derniers jours le transfert à Israël de bombes et d'avions de combat d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, ont déclaré vendredi deux sources au fait de la situation, alors même que Washington exprime publiquement ses inquiétudes au sujet d'une offensive militaire israélienne prévue à Rafah.
« Les nouveaux lots d'armes comprennent plus de 1 800 bombes MK-84 de 2 000 livres et 500 bombes MK-82 de 500 livres, ont déclaré les sources, qui ont confirmé un rapport du Washington Post. » [7]
Comme si tant de déshumanisation hypocrite ne suffisait pas, voici ce que le député républicain Tim Walberg, un pasteur considéré comme un bon chrétien, affirmait le même jour lors d'une réunion privée à Dundee, dans le Michigan :
« On ne devrait pas dépenser un seul sous pour l'aide humanitaire à Gaza. On devrait faire comme à Nagasaki et Hiroshima. Finir tout ça rapidement ». [8]
[1] Ilan Pappe, Out of the Frame : The Struggle for Academic Freedom in Israel <https://www.amazon.ca/-/fr/Ilan-Pap...> , Pluto Press, Kindle Edition. (Ma traduction de l'anglais, pour cette citation et toutes les autres. À moins d'indication contraire, toutes les citations dans cet article proviennent de cette source)
[2] Zoe Guy, Jonathan Glazer Condemns ‘Occupation,' ‘Dehumanization' in Oscars Speech <https://www.vulture.com/article/osc...> , Vulture, le 21 mars 2024. Consulté le même jour.
[3] Jacob Magid, US says ceasefire resolution non-binding ; less influential Security Council members object <https://www.timesofisrael.com/liveb...> , The Times of Israel, le 25 mars 2024. Consulté le même jour.
[4] US says Israel not violating international humanitarian law in its use of US-supplied weapons <https://www.aa.com.tr/en/americas/u...> , le 26 mars 2024. Consulté le même jour.
[5] Visual evidence of Israelis killing unarmed Palestinians <https://www.google.com/search?q=Al+...> , Al Jazeera, le 27 mars 2024. Consulté le même jour.
[6] ICJ orders Israel to take action to address famine in Gaza <https://www.aljazeera.com/news/2024...> , Al Jazeera, le 28 mars 2024. Consulté le même jour.
[7] Reuters, US reportedly approves transfer to Israel of bombs and jets worth billions <https://www.theguardian.com/us-news...> , The Guardian, le 30 mars 2024. Consulté le même jour.
[8] Jennifer Bowers Barhney, ‘Like Nagasaki And Hiroshima !' Republican Congressman Says To ‘Get It Over Quick' in Gaza At Town Hal <https://www.mediaite.com/politics/l...> l, Media-ite+, le 30 mars, 2024. Consulté le même jour.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le grand basculement ?
La guerre Israël-Hamas continue à faire rage dans la bande de Gaza, écrasée par l'aviation israélienne depuis le 10 octobre dernier. Le tribut humain de ces bombardements aériens a été particulièrement lourd, surtout chez les civils gazaouis. De plus, la famine les menace, en raison du blocus israélien. Tsahal est aux portes de Rafah qui est menacée d'anéantissement en cas d'assaut de l'armée israélienne après la "trêve" du Ramadan. Le gouvernement Netanyahou rêve de toute évidence d'en finir avec le Hamas. Il faut souligner en passant que la politique des représailles disproportionnées après chaque opération palestinienne d'envergure remonte aux origines mêmes de l'État hébreu. Par conséquent, les représailles énormes de Netanyahou contre Gaza après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 ne sont pas une nouveauté et elles étaient prévisibles.
Pourtant, quelques lueurs d'espoir apparaissent dans ce conflit.
Tout d'abord, des négociations indirectes sont à l'ordre du jour entre le Hamas et le cabinet Netanyahou, qui vient de leur donner le feu vert. Que donneront-elles ? Aboutiront-elles à un cessez-le-feu permanent et à l'amorce de négociations sérieuses sur l'issue finale de la guerre ? C'est loin d'être certain, vu le gouvernement d'extrême-droite en poste à Tel-Aviv. Il doit cependant faire face à la pression croissante de ses soutiens occidentaux pour qu'il modère ses ardeurs belliqueuses, en particulier du côté de la Maison-Blanche.
Précisément, on remarque un phénomène inédit chez les alliés traditionnels de l'État hébreu, des divisions au sein de leurs classes politiques, observables autant à Ottawa qu'à Washington. Un esprit critique nouveau et plus intense qu'auparavant s'y fait jour, du moins en public, chez une partie notable d'entre elles vis-à-vis de leur protégé israélien. Les tiraillements sont visibles chez les démocrates aux États-Unis et les libéraux au Canada. Si cet esprit critique et ces divisions ne remettent pas en question l'appui à Israël, le bloc pro-israélien qui paraissait inentamable se fissure maintenant.
Cet esprit critique durera-t-il ? Et si oui, combien de temps ? S'il ne permet pas de céder à un franc optimisme, il autorise quand même un certain espoir de voir le soutien inébranlable que les gouvernements occidentaux ont toujours gratifié l'État hébreu, ébranlé.
Ce phénomène d'opposition aux politiques brutales d'Israël à l'égard des Palestiniens et Palestiniennes est encore plus évident au sein des opinions publiques où les manifestations de solidarité avec les Gazaouis et plus largement, les Palestiniens, se multiplient depuis plusieurs semaines.
Le gouvernement Netanyahou se livre, lui, à une sanglante fuite en avant, dépité par l'e désaveu dont il fait l'objet et surtout en raison de considérations politiques internes. Au-delà de toute raison, il multiplie en Cisjordanie les colonies de peuplement, laquelle à son tour devient une poudrière. Qui sème le vent...
Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il s'agit de la première fois que les opinions publiques occidentales s'émeuvent autant du sort des Palestiniens et Palestiniennes et que leurs classes politiques affichent des divisons aussi marquées sur le sujet. Le soutien à la cause palestinienne ne se limite plus à la gauche.
Il arrive toujours un point de rupture de l'histoire où les contradictions politiques deviennent toujours plus difficiles à gérer et où, peut-être approche le point d'éclatement. Les tensions entre le gouvernement Biden et celui de Netanyahou l'illustrent bien.
Les prochaines semaines seront déterminants là-dessus. Verrons-nous enfin la lumière au bout du tunnel ?
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Plus de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable

Un constat alarmant sur le partage de la ressource en or bleu. L'Unesco estime que 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable sûre, selon son rapport annuel publié vendredi 22 mars, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau.
Photo et article tirés de NPA 29. Article publié par reporterre.net
Les premières victimes du manque d'eau dans le monde sont les femmes et les filles, selon l'Unesco. Ce sont elles qui, en zones pauvres et rurales, sont chargées de la collecte de l'eau, facteur d'abandon scolaire accentuant leur vulnérabilité. Dans son rapport, l'organisation indique qu'une meilleure coopération internationale en matière d'accès à l'eau douce jouerait un rôle non négligeable dans l'amélioration de leur quotidien.
Les inégalités risquent de s'accroître encore
L'agence onusienne le reconnaît : « L'objectif de garantir l'accès à l'eau potable à tous d'ici à 2030 est loin d'être atteint. Il est même à craindre que les inégalités continuent de s'accroître dans ce domaine. »

Par ailleurs, « les inégalités dans la répartition des ressources en eau, dans l'accès aux services d'approvisionnement et d'assainissement » sont sources de tensions, qui peuvent elles-mêmes « exacerber l'insécurité hydrique », alerte le rapport. Les auteurs considèrent ainsi que les stratégies de partage des ressources en eau sont bien souvent négligées par les États. Sur les 153 pays partageant des cours d'eau, lacs ou eaux souterraines, « seuls 31 ont conclu des accords de coopération pour au moins 90 % de la superficie de leurs bassins transfrontaliers », souligne le rapport.
25 mars 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lancement du Forum national permanent de lutte contre les violences faites aux femmes des zones rurales, des forêts et des eaux

Le 19 mars, nous, de la Marche mondiale des femmes, avons participé à l'événement : « Marche des femmes : #BrasilporElas dans la lutte contre la misogynie et dans la promotion de l'égalité » organisé par le ministère des Femmes avec la participation du ministère de l'Égalité raciale, du Secrétariat général de la présidence, du ministère de la Pêche, ainsi que des femmes députées et sénatrices.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/30/lancement-du-forum-national-permanent-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-des-zones-rurales-des-forets-et-des-eaux/
À cette occasion, le ministère de la femme a lancé le plan d'action du pacte national pour la prévention du féminicide et le programme « Wings for the Future » destiné aux jeunes femmes. Le programme Wings for the Future vise à accroître la participation des jeunes femmes dans des secteurs tels que la technologie, l'énergie, les infrastructures, la logistique, les transports, la science et l'innovation, en mettant l'accent sur les carrières orientées vers la durabilité socio-économique.
Établi par le décret 11.640/2023, le pacte national de prévention du féminicide vise à prévenir toutes les formes de discrimination, de misogynie et de violence fondée sur le genre à l'encontre des femmes et des filles, par la mise en œuvre d'actions gouvernementales intersectorielles, dans une perspective de genre et d'intersectionnalité :
* Forum national pour l'élaboration de politiques publiques en faveur des femmes du mouvement hip-hop ;
* Forum national permanent de dialogue pour la promotion de stratégies visant à renforcer les politiques publiques en faveur des femmes de Quilombola ;
* Forum pour la promotion de stratégies et le renforcement des politiques publiques en faveur de l'autonomie économique et de la protection des femmes dans le secteur de la pêche, de l'aquaculture artisanale et de la conchyliculture ;
* Victoire de la Marche des marguerites : lancement du Forum national permanent de lutte contre la violence à l'égard des femmes des zones rurales, des forêts et des eaux.
Une autre étape très importante de l'événement a été le lancement du Forum national permanent de lutte contre la violence à l'égard des femmes des zones rurales, des forêts et des eaux, l'une des revendications de la Marche des marguerites. Il s'agit d'un espace de discussion et de proposition de politiques publiques qui tiennent compte de la réalité des femmes dans les campagnes, les forêts et les eaux.
Le Forum sera composé de représentant·es des mouvements sociaux et de représentant·es du gouvernement de différents ministères afin d'articuler les actions et les politiques.
Nous continuerons à marcher jusqu'à ce que nous soyons toutes libres !
https://www.marchamundialdasmulheres.org.br/lancamento-do-forum-nacional-permanente-de-enfrentamento-a-violencia-contra-mulheres-do-campo-da-floresta-e-das-aguas/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Violences sexuelles dans la famille et leurs conséquences sur les femmes et les enfants

Interview de Jeanne Sarson et Linda Macdonald par Francine Sporenda
Jeanne Sarson et Linda MacDonald ont exercé comme infirmières et sont les autrices de « Women Unsilenced : Our Refusal To Let Torturers-Traffickers Win ».
FS : Vous êtes toutes les deux des survivantes de la violence familiale. Comment est-ce que ça a influencé votre décision d'aider les victimes de cette forme particulière de violence ?
Jeanne : Mon background familial, c'est que je suis née dans une famille avec un très mauvais père, et j'ai dû regarder comment la misogynie de mon père faisait souffrir ma mère, avant et après qu'elle soit partie, parce qu'au moment où elle est partie, la société n'acceptait pas que les femmes quittent des relations violentes, alors oui, avoir été témoin de la discrimination et de la misogynie qu'elle a subi m'a beaucoup influencée.
Linda : Oui, absolument. Si je n'étais pas née dans le même type de violence – mon père était aussi très violent et très misogyne – je ne pense pas que j'aurais eu la même connexion avec les enfants qui sont piégés dans des groupes qui pratiquent la torture non-étatique dans le cadre de réseaux criminels permanents, mais même si cela n'a pas été jusqu'à la torture pour moi, cela a été vraiment horrible de juste survivre et d'arriver à sortir de ma famille. Les obstacles auxquels j'ai dû faire face sont au-delà de ce que les gens peuvent même imaginer, donc mon engagement pour la défense des enfants est très fort, et bien sûr aussi des femmes qui ont grandi dans ce genre de familles et qui ont été piégées dans la torture, la prostitution, la pornographie ou le trafic d'êtres humains. Je sais qu'elles n'obtiennent pas l'aide dont elles ont besoin, je sais ce que l'on ressent quand on est abandonnée par la société. Je ressens une très forte connexion avec ces personnes, et une très forte conscience de ma responsabilité de féministe de les soutenir.
FS : La plupart des gens ne savent pas ce qu'est la torture non-étatique. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la torture non-étatique, quels sont ceux qui l'exercent, d'où ils viennent et quelles sont leurs motivations ?
Linda : Je vais vous lire la définition de la torture non-étatique mais je vais aussi préciser ce que le concept d'acteurs (perpétrateurs) non-étatiques signifie. La torture non-étatique (NST, non-state torture) est une forme de torture exercée par des personnes qui ne sont pas membres de l'appareil de l'Etat, en public ou dans le privé, dans le contexte de relations, de la famille, du trafic d'êtres humains, dans la prostitution, dans l'exploitation pornographique, par des groupes et des gangs violents, ces formes tortures étant banalisées comme pratiques ou normes sociales, traditionnelles ou religieuses, qui peuvent être commises au cours de migrations, de déplacements de populations, des troubles politiques ou humanitaires par exemple. Et le terme acteurs non-étatique signifie tout individu ou entité n'agissant pas sous l'autorité légale de l'Etat et cette définition provient de la résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies 1540 de 2004. Les acteurs non-étatiques peuvent être des parents, un conjoint ou d'autres membres de la famille, ils peuvent être des gardiens, des voisins, des gens sur le lieu de travail, des étrangers, des acheteurs de sexe, des proxénètes, des pornographes, ils peuvent être des adultes professionnels auxquels ont fait confiance, des membres de groupes du crime organisé, de gangs ou de cartels, ils peuvent faire partie de réseaux criminels informels, terroristes ou paramilitaires, ils peuvent être du personnel de sécurité, ils peuvent être des mercenaires, des combattants étrangers. Autrement dit, les tortionnaires non-étatiques peuvent exister dans n'importe quel aspect de la vie d'un individu.
FS : Pouvez-vous expliquer comment les façons de gérer ces violences à court terme (vous les nommez troublesome coping) utilisées par les victimes de NST peuvent être dommageables pour elles plus tard ?
Linda : Une des façons de gérer ces situations pour les survivantes de NST que nous avons découverte en interagissant avec elles et en les soutenant est que la dissociation est très commune chez elles. C'est une des principales façons qui leur permet d'endurer de telles douloureuses atrocités telles que le viol collectif, le fait d'être droguées, séquestrées, enfermées dans des cages, et toutes les terribles épreuves auxquelles elles sont soumises. Mais ce qui arrive quand elles quittent le groupe, quand elles deviennent adultes, est qu'elles ne se rappellent pas toujours qui étaient les perpétrateurs à cause de leur dissociation, ce qui fait qu'ils peuvent toujours avoir accès à elles quand elles sont adultes et qu'elles ne comprennent pas qu'elles sont en danger. Leurs souvenirs de ce qui leur est arrivé et du mal qu'on leur a fait ne sont pas clairs dans leur esprit, et c'est ce qui les rend vulnérables.
Ce que nous faisons est de les ramener en arrière de telle sorte qu'elles puissent récupérer ces souvenirs, les clarifier, les voir dans une perspective d'adulte, et réaliser comment on leur a menti et comment elles ont été manipulées quand elles étaient enfants ou jeunes femmes, de façon à ce qu'elles puissent prendre du recul et dire : « ok, maintenant je sais que j'ai été torturée, je comprends les tactiques que mes tortionnaires ont utilisées, je comprends comment j'ai été trompée et comment ont a employé la misogynie pour me manipuler, pour me faire croire que tout était de ma faute, et que si jamais j'osais en parler, je devrais me suicider. Et je sais que tout cela était faux, que je suis une personne qui a des droits humains, je sais qui sont les perpétrateurs, qu'ils ne peuvent plus me manipuler et me priver ainsi de ma liberté. Ce sont les principales façons dont elles gèrent ces situations, et bien sûr, les tortionnaires jouent là-dessus. Quand les femmes guérissent de leurs traumas, elles disent que ça leur devient impossible de se dissocier, parce qu'elles n'en ont plus besoin, parce qu'elles ne sont plus victimes de tortures. C'est une partie de leur guérison, et c'est important de savoir que si vous pouvez guérir de ces tortures non-étatiques, vous pouvez surmonter n'importe quelles violences.
Jeanne : Je peux ajouter spécifiquement que les perpétrateurs droguaient ces femmes quand elles étaient des petites filles, donc elles doivent aussi guérir leurs comportements vis-à-vis de la drogue. Et quand elles en sont guéries, il devient plus facile pour elles de s'attaquer à leur victimisation. Et une autre chose que les gens ne semblent pas comprendre est que les femmes peuvent guérir leurs comportements de dissociation, elles peuvent savoir quand elles commencent à dissocier, donc quand elles peuvent prendre conscience qu'elles commencent à dissocier sur la base de certaines réactions de leurs corps, elles peuvent bloquer leurs réponses de dissociation caractéristiques des survivantes. Nous n'avons pas vu souvent ce type d'information dans la littérature sur ce sujet mais c'est ce que nous avons appris en aidant les femmes à guérir.
FS : Vous avez soigné Sara, une femme qui a été torturée et trafiquée toute sa vie, parce qu'elle a été élevée dans une culture criminelle familiale. Qu'est ce qu'une culture criminelle familiale concrètement ?
Linda : Le crime organisé existe dans de nombreux types de groupe, une culture criminelle familiale est un groupe de crime organisé qui fonctionne sur le mode informel à partir d'une famille. Autrement dit, par exemple il y avait un père et une mère qui étaient tous les deux engagés dans l'organisation des tortures que Sara a dû subir dans le sous-sol de leur maison et qui la trafiquaient et la prostituaient à leurs amis ou à des étrangers ; c'est pour cela qu'on parle de culture criminelle familiale : les principaux perpétrateurs, ses principaux tortionnaires étaient ses parents. Mais c'est aussi une culture criminelle parce que Sara a été la victime de crimes, et c'est une culture, ou une co-culture parce que qu'il s'agit d'un groupe qui avait des pratiques spécifiques, ils avaient leurs propres « valeurs », leur propre code d'éthique, et leurs propres modes de fonctionnement, leur propre culture spéciale dans notre propre culture. Ils croient que ce n'est pas un problème de torturer des enfants et des femmes, ils savent que c'est illégal mais ça n'a aucune importance à leurs yeux, ça fait partie de leur culture, ils ont un système de croyances différent du nôtre et de nos lois, et ils retirent du plaisir d'infliger de la souffrance même si ça va à l'encontre des normes de notre société et de notre culture. Il ne fait aucun doute que leur culture est très cruelle.
FS : D'après ce que j'ai lu dans votre livre, cette culture semble être principalement sous le contrôle d'hommes assistés par des complices femmes. Pourquoi ces femmes aident-elles ces hommes à torturer des femmes et des enfants, Dans les cas d'inceste, parfois la femme est au courant mais elle ne dit rien. Est-ce que c'est un phénomène similaire et pourquoi ces femmes se comportent-elles ainsi ?
Jeanne : D'abord, je voudrais signaler qu'il y a quand même quelques femmes qui, de leur propre gré, sans être sous l'emprise d'aucun homme, commettent ce genre de crimes. C'était le cas de Sara. La mère de Sara a activement participé à la victimisation, au trafic et à la torture de sa fille. Sa mère n'a pas été forcée à le faire, et le père de Sara cherchait plutôt à l'exclure. Il organisait des jeux dans la maison, les enfants aimaient jouer à construire des tentes, et quand sa femme était occupée au travail, il organisait des jeux, des soi-disant jeux avec Sara et les autres enfants et perpétrait des crimes sexuels sur eux. Et ce qui est arrivé à Sara est qu'un jour sa mère a surpris son père qui lui faisait subir une forme de torture, et la mère a dit : « je pourrais aussi bien jouer avec vous et m'amuser ». Il existe des situations comme celle-ci où des femmes participent activement et Linda et moi avons été informées par Sara qu'elle a à un moment recherché une aide psychologique auprès de femmes professionnelles, et il y a eu certaines de ces femmes qui l'ont torturée et trafiquée aussi. C'était un petit groupe mais il n'y avait aucun homme dans ce groupe. En tant que femmes, nous devons reconnaître que tout ce que nous faisons n'est pas contrôlé par les hommes et nous devons accepter une certaine responsabilité pour nos propres actions. En dépit du patriarcat et de la misogynie, dont nous sommes toustes imprégnées, parce que nous naissons dans une culture patriarcale et misogyne, et c'est un des premiers principes que Linda et moi avons dû accepter : que nous devions tenir les femmes pour responsables de leurs propres comportements, y compris leur participation à la torture non-étatique.
Parfois ces femmes nous ont dit que leurs mères avaient aussi été victimisées, et dans ce cas vous avez les mères et les filles qui sont victimes, et parfois aussi les femmes de la famille : les mères et les grand-mères n'étaient pas les perpétratrices de ces crimes mais elles les facilitaient, elles savaient ce qui arrivait à leurs petites-filles et filles, elles avaient même des techniques pour amener ces enfants à se dissocier, à oublier ce qu'on leur faisait. Les femmes participent mais de façon très différente. Soit elles ne savent pas, certaines de ces femmes nous ont dit très clairement que leurs mères ne savaient pas ce qu'on leur faisait, ou elles ne se posaient pas de questions car elles étaient sous le contrôle de leur mari. Sur la question de l'inceste, nous n'utilisons pas ce terme car nous pensons que ce n'est pas une bonne définition du mal qui leur est fait. Sur la durée, cette expression tend à minimiser, donc nous préférons utiliser l'expression de « violence sexualisée », qu'il s'agisse d'abus sexuels ou de torture sexuelle.
FS : Mais l'expression d'abus sexuels ou de tortures sexuelles ne signifie pas que c'est un membre de la famille qui fait ça. Est-ce que ce n'est pas un problème ?
Jeanne : Si vous dites que dans sa famille, Sara a subi des abus sexuels et de la torture sexuelle, vous identifiez qui c'est. L'expression « inceste » minimise la sévérité du crime, parce que ce mot inceste ne dit pas que cela a commencé quand elle était âgée de 2 ans et ne s'est arrêté que quand elle avait 16 ans, donc vous avez 14 ans de violences sexuelles, qui incluent aussi les violences physiques, les violences psychologiques et les violences émotionnelles alors que, quand vous dites « inceste », les gens pensent que cela se limite à du sexe, que la violence n'existe que sous la forme sexuelle. C'est tout ça le mal qui est infligé à des enfants, et c'est pourquoi nous n'utilisons pas le mot inceste. Si vous lisez les articles des journaux, ils disent que le père a eu des relations sexuelles avec sa fille, que c'est ça l'inceste, alors que c'est un problème d'utiliser le mot « sexe » pour identifier un crime, donc nous devons arrêter de faire ça. Nous pouvons appeler ça un « viol familial », toute expression qui montre à quel point la notion de « violence sexuelle » peut être limitative, et c'est la raison pour laquelle nous n'utilisons jamais ce terme.
FS : Vous dites que Sara n'avait aucune limite, ne savait pas dire non, laissait entrer n'importe qui dans son appartement. Pouvez commenter là-dessus et comment vous lui avez appris à poser des limites ?
Linda : Ce qui arrive suite à n'importe quelle forme de violence sexuelle ou n'importe quelle forme de maltraitance ou de torture lorsque les limites d'une personne sont violées, et spécialement si vous avez été victime de n'importe quelle forme de maltraitance étant enfant, c'est-à-dire avant que vous ayez pu développer une forme quelconque de limites, c'est que ces personnes sont si profondément violentées qu'elles ne savent même pas qu'elles ont le droit d'avoir des limites ou que des limites existent. Parce que, suite à la dissociation et à la torture, Sara et les autres femmes que nous avons soutenues ne savaient pas qu'elles avaient un corps, elles étaient déconnectées de leurs corps, elles ne savaient pas qu'elles étaient des personnes. Si vous ne savez pas que vous êtes une personne, vous ne savez pas que votre corps vous appartient, vous ne savez pas que vous avez des droits humains, vous ne savez pas que vous avez le droit d'avoir des limites, ou même ce qu'est une limite : pouvoir dire non, dire aux gens de ne pas vous toucher. C'est une façon importante dont les tortionnaires détruisent, ou essayent de détruire, le sens de lui-même qu'a un enfant en détruisant son droit à dire non et la notion qu'il est propriétaire de son corps et que personne ne devrait vous toucher à moins que vous y consentiez, que vous soyez d'accord.
Nous avons compris qu'elle n'avait pas de limites mais nous ne l'avons vraiment vu clairement que lorsque nous sommes allées chez elle et que nous avons commencé à l'aider à se souvenir de ce qui déclenchait les flashbacks qui la perturbaient la nuit. Nous n'avions pas de bureau, nous louions un espace pour quelques heures, donc nous ne pouvions pas lui demander de passer à notre bureau, et pour nous, cela n'avait pas de sens qu'elle passe nous voir au milieu de la nuit puisque c'était précisément la nuit que ses souvenirs traumatiques lui revenaient. Et nous étions aussi des infirmières, donc nous étions habituées à venir voir des gens chez eux en pleine nuit pour leur administrer des médicaments quand ils étaient en train de mourir. Donc ce n'était pas inhabituel pour nous en tant qu'infirmières de nous rendre chez quelqu'un au milieu de la nuit. Donc nous nous rendions à son appartement et nous frappions à la porte, et quand nous frappions, elle ouvrait la porte mais nous ne pouvions la voir nulle part, elle était derrière la porte, elle se cachait derrière la porte. Elle se conduisait comme si sa maison ne lui appartenait pas, comme si sa porte n'était pas la sienne, comme si son appartement n'était pas le sien, comme si son corps ne lui appartenait pas. Donc nous avons commencé à lui expliquer ce que c'était qu'avoir des limites, que c'était important d'en avoir, qu'elle avait le droit d'en avoir, qu'avoir des limites garantissait sa sécurité, et nous lui avons appris comment ouvrir sa porte et qu'il y avait un trou, un judas dans la porte qui lui permettait de voir et de savoir qui était la personne derrière la porte avant de l'ouvrir et que, si elle ne voulait pas la laisser entrer, qu'elle pouvait dire « non, je ne vous laisse pas entrer », et ils devraient partir.
Et c'était une expérience entièrement nouvelle pour elle de réaliser qu'elle pouvait dire non aux gens. Même chose pour son téléphone : elle prenait juste l'appel automatiquement quand on l'appelait, et elle faisait tout ce que la personne qui l'appelait lui disait de faire, parce c'est ce qu'elle avait appris à faire quand elle était enfant. Ils l'appelaient, utilisaient certains mots auxquels elle était habituée à obéir, ils lui disaient de venir à tel ou tel endroit et y retrouver telle ou telle personne, et elle y allait. Elle a dû apprendre à déconstruire tous ces conditionnements, à se procurer un répondeur et à apprendre que, si elle ne voulait pas répondre, elle pouvait ne pas le faire et pouvait bloquer des numéros si elle ne voulait pas que ces personnes l'appellent, donc ça a été tout un processus d'apprentissage des limites. Et elle a appris qu'elle avait droit à des limites même avec nous : elle savait qu'elle avait le droit de nous dire non, le droit de ne pas répondre à nos questions, et si elle n'y répondait pas, elle n'allait pas être frappée ou maltraitée de quelque façon que ce soit. Cela lui a pris beaucoup de temps pour avoir des limites mais elle en a maintenant et elle sait qu'elle a le droit de décider elle-même exactement ce qui lui arrive, et quand.
FS : Vous avez déjà parlé de dissociation mais est-ce que vous pouvez y revenir un peu et décrire les façons dont ça se manifeste, et quels en sont les symptômes ?
Jeanne : Je dirais que nous avons appris ça essentiellement en tant qu'infirmières, parce que dans notre profession, nous travaillons souvent avec des personnes en crise, avec des gens qui vivent des tragédies, et je ressens très fortement que c'est notre formation d'infirmières et ce que nous avons appris en exerçant cette profession qui nous a aidées à identifier comment Sara et les autres femmes dissociaient. C'était fondamental et Linda et moi avons souvent parlé du fait que nos aptitudes d'infirmières ont été essentielles, et je peux vous donner un exemple : quand Linda et moi avons commencé à aider Sara, en 1993, il n'y avait aucun article, aucun livre nulle part que nous avons pu trouver qui puisse nous dire comment aider quelqu'un qui a été torturé et victime de trafic pendant autant d'années, comment l'aider à se reconstruire. Nous croyions dans sa capacité à guérir, parce qu'en tant qu'infirmières, on travaille à aider les gens à guérir, ou au moins on travaille à les aider à mourir sans souffrances, ce qui est en soi une forme de guérison.
Nous avons donc beaucoup discuté du fait que notre background d'infirmières était précieux dans cette démarche. Avec Sara, au fur et à mesure que nous apprenions, nous faisions régulièrement le bilan de ses progrès, comment grâce à nos interventions elle allait de l'avant, comment elle se libérait de sa victimisation. Ca a pris du temps mais nous pouvions voir qu'elle comprenait de mieux en mieux le monde à l'extérieur de sa famille et la vie qu'elle avait eue. Un jour Linda lui a dit, alors qu'elle observait sa communication non-verbale : « Sara, où sont vos yeux ? » Et elle a répondu : « ils sont derrière ma tête ». Et là nous savions ce qui se passait rien qu'en regardant ses yeux, ses yeux nous disaient qu'elle était en crise, qu'elle était en train de se dissocier des souvenirs dont elle parlait. Et ce qu'elle a fini par comprendre, alors qu'elle se connectait de plus en plus avec son corps, c'est qu'elle ressentait une sensation physique quand elle se dissociait : ses yeux, comme le disait, « se déplaçaient derrière sa tête ». Elle pouvait identifier cette sensation parce qu'elle devenait de plus en plus consciente de ce qui se passait dans son corps, elle faisait plus attention aux sensations qu'elle avait avec ses yeux, et quand elle avait l'impression que ses yeux de déplaçaient derrière sa tête, elle s'est enseigné à elle-même à arrêter ce mouvement, à ramener son attention dans le présent, a s'ancrer dans l'ici et le maintenant, et finalement, comme Linda l'a mentionné plus haut, la dissociation a cessé et elle ne dissocie plus.
Avec d'autres personnes que nous avons aidées, c'est la même chose, on peut voir leurs yeux rouler en arrière vers le haut de leur tête. Dans le cas de ces autres femmes, elles ont aussi appris à contrôler leurs réponses physiques à la dissociation, par exemple une de ces femmes, sa mère qui était mourante lui avait dit qu'elle ne méritait pas de porter une veste bien chaude, ce qui fait qu'elle ne le faisait pas et avait toujours froid en hiver. Elle ne comprenait même pas qu'elle avait un corps, et qu'elle avait une peau sur ce corps. Et quand elle a appris à sentir son corps, elle a réalisé qu'elle avait froid et elle s'est mise à porter des vêtements adéquats pour l'hiver, un manteau, une écharpe et un bonnet, et avoir chaud. Il y a différentes pour les femmes d'apprendre à identifier leurs réponses dissociatives de survie, qui leur ont permis de survivre quand elles étaient victimisées mais qui ne sont plus appropriées quand elles ne sont plus victimes. Elles doivent se débarrasser de leurs réponses traumatiques de façon à ne plus dissocier, et à cesser de se faire du mal inconsciemment.
FS : Vous dites que Sara était suicidaire et que ses agresseurs lui avaient dit qu'elle devrait se tuer. Vous dites aussi « qu'elle entendait encore la voix des agresseurs dans sa tête », ce qui est un énoncé typique chez les personnes qui sont sous l'emprise psychologique et le contrôle de quelqu'un. Pouvez-vous nous parler de cette emprise que les agresseurs ont sur l'esprit de leurs victimes, de telle façon que celles-ci entendent leurs voix dans leurs têtes ?
Linda : Oui, Sara et de nombreuses autres femmes que nous avons soutenues, on leur a appris comment se suicider quand elles étaient enfant, on leur a vraiment appris ça. Les adultes les prenaient avec elles et leur montraient comment et où s'ouvrir les poignets, ou quand elles étaient plus âgées, on les emmenait sur un pont d'où elles pourraient sauter, ou comment conduire sur des routes dangereusement verglacées, provoquer un accident et mourir comme ça. Les perpétrateurs étaient toujours en train de penser à des façons de se protéger au cas où leurs victimes, ces filles et ces femmes, songeraient à les dénoncer. Ils pensaient que si elles parlaient, elles devaient se suicider, elles devraient se tuer car elles auraient détruit leur famille : vous étiez mauvaise et vous deviez mourir. Quand on vous apprend ça alors que vous êtes une petite fille de 3 ou 4 ans, c'est la même chose que si votre mère vous apprenait une comptine pour enfants, et ce qui se passe dans votre vie devient une chanson que vous entendez dans votre tête. Ces filles entendaient des voix, les voix de leurs agresseurs qui leur disaient toutes ces choses, qui leur disaient qu'elles devaient mourir et se suicider.
Et elles n'ont pas de limites, Sara et toutes ces femmes que nous avons aidées, parce que la torture détruit les limites. Une des femmes que nous avons aidées, elle n'avait pas été torturée quand elle était jeune, elle a été torturée quand elle était adulte, et elle a commencé à entendre la voix de son agresseur dans sa tête, et elle pensait que c'était sa propre voix. En fait, nous pensons que beaucoup de femmes qui ont victimisées et qui sont diagnostiquées comme schizophrènes ne sont pas du tout schizophrènes, elles entendent la voix de leurs agresseurs qui leur disent de faire des choses. Ces personnes devaient être écoutées et comprises, et nous devrions faire la différence entre une réponse normale à la torture et la maladie mentale.
Ce que nous avons fait est de leur demander d'écrire ce que disaient les voix qu'elles entendaient dans leur tête, les mettre sur le papier sur une colonne, et sur une autre colonne, mettre ce que leur propre voix leur disait et ce qu'elles pensaient être vrai. Afin de pouvoir faire la différence entre leur voix et celle de leurs agresseurs, de distinguer le vrai du faux, et de voir clair dans leur vie, parce que vous n'avez pas à mourir par suicide, vous n'avez pas à vous tuer si vous dites la vérité. C'est un mensonge, et une torture psychologique extrême. C'était très important, très empouvoirant pour elles, et nous avons beaucoup utilisé cette méthode de leur faire écrire leurs pensées, pour qu'elles entendent leur propre voix, écrivent leur propre voix, et quand Sara l'a fait, les voix des agresseurs ont parlé moins fort, ont disparu peut à peu et maintenant elle sait que, quand de mauvais souvenirs lui reviennent, ce n'est pas une voix dans sa tête, c'est juste le souvenir de ce qu'on lui a dit, elle a une notion claire de la différence entre sa propre voix et ces autres voix, et elle est consciente de tous les mensonges que lui ont dit ses agresseurs, ses tortionnaires. C'est pourquoi nous parlons d'un conditionnement au suicide par les agresseurs, d'un féminicide par suicide, et nous ne savons pas, et probablement nous ne pourrons jamais savoir combien de femmes sont mortes ainsi par « suicide » alors qu'elles ne voulaient pas vraiment se suicider, elles ont juste été conditionnées à le faire parce qu'on les a manipulées, on leur a dit ça depuis qu'elles étaient enfant, donc c'est en fait une forme de féminicide et pas vraiment un suicide.
(Traduction Francine Sporenda)
https://revolutionfeministe.wordpress.com/2024/03/09/violences-sexuelles-dans-la-famille-et-leurs-consequences-sur-les-femmes-et-les-enfants/
Jeanne Sarson et Linda MacDonald ont exercé comme infirmières et sont les autrices de « Women Unsilenced : Our Refusal To Let Torturers-Traffickers Win ».

Les systèmes de prostitution dépénalisés sont un cancer qui s’est propagé à l’Union européenne et au Conseil de l’Europe

Lorsque la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, a publié le 15 février une déclaration appelant à la dépénalisation complète du proxénétisme, de la tenue de maisons closes et de toutes les formes de profit par des tiers, elle a affirmé avoir « consulté des travailleurs et travailleuses du sexe partout en Europe, leurs organisations représentatives, des organisations internationales et des experts compétents… » – écrit Rachel Moran.
C'était une nouvelle pour celles d'entre nous qui sont impliquées dans des organisations composées de survivantes du commerce du sexe, de prestataires de services de première ligne, de militantes pour les droits des femmes et de spécialistes du droit qui se consacrent à la lutte contre les méfaits du commerce du sexe dans le monde. C'était une nouvelle parce qu'en fait,aucune d'entre nous n'avait été consultée.
Aussi bizarre que cela puisse paraître à certains, il n'y a rien de nouveau dans la promotion du proxénétisme sous la bannière des principes des droits de l'homme ; cette prétention est évidemment contre-intuitive, mais nous, dans le mouvement des droits des femmes, entendons cet argument depuis des années. Il y a de nombreuses embûches logiques à franchir pour adhérer à cette ligne de pensée, mais la première et la plus essentielle est la fiction selon laquelle le fait d'être malmenée, léchée, sucée et pénétrée par des inconnus au hasard n'est pas une violation en soi.
De nombreuses femmes font campagne depuis des années contre le commerce mondial du sexe. Certaines d'entre nous, comme moi, ont été exploitées dans les maisons closes et les zones de prostitution. Beaucoup d'autres, non. Ce qui nous unit toutes, c'est la vision selon laquelle le monde a besoin d'un système de décriminalisation partielle, où les personnes exploitées dans la prostitution sont décriminalisées, tandis que les proxénètes qui profitent d'énormes bénéfices et les prostitueurs qui achètent un accès sexuel au corps de femmes vulnérables sont tenus légalement responsables de leur comportement abusif et exploiteur.
Nous assistons depuis plusieurs années à un retour de bâton imaginatif de la part des profiteurs d'un commerce d'exploitation qui doit se réinventer dans le contexte des progrès législatifs réalisés dans ce domaine par les survivantes du commerce du sexe et les organisations de défense des droits des femmes. Le manteau des « droits de l'homme » était probablement à la fois la position la moins appropriée mais la plus influente qu'ils auraient pu choisir pour soutenir leur prétention. De temps en temps, cependant, le masque tombe d'une manière si dramatique qu'elle en devient amusante, comme lorsque l'association Amnesty International a été interrogée au parlement de l'Irlande du Nord en 2014 sur l'implication du proxénète britannique Douglas Fox dans l'élaboration de leur politique en matière de prostitution, ou lorsque la défenseuse des « droits des travailleurs du sexe » et conseillère pour la politique de l'ONUSIDA Alejandra Gil a été reconnue coupable de trafic sexuel au Mexique sur la base d'une série de chefs d'accusation si nombreux et si graves qu'ils lui ont valu une peine de quinze ans dans une prison mexicaine.
Les personnes qui plaident en faveur d'une dépénalisation de l'industrie du sexe ne sont pas toutes motivées par un intérêt personnel aussi évident. Certaines ont pour objectif de faire carrière dans le monde universitaire, des intérêts qui ne sont pas aussi apparents pour l'observateur occasionnel, mais qui sont à mon avis au moins aussi méprisables que les motivations des proxénètes. D'autres, ignorants mais sincèrement bien intentionnés, prônent une décriminalisation générale de tous les aspects du commerce du sexe dans le monde. Quelle que soient leurs bonnes intentions, il n'est pas possible d'adopter cette position sans occulter la nature abusive de ce qui est fait aux femmes qui sont prostituées. Ce n'est que dans cette optique gravement illusoire, lorsque l'idéologie domine et qu'est passée sous silence la réalité de ce qui arrive au corps, à l'esprit et à la psyché des femmes exploitées, que cette position peut avoir un sens. Il ne m'échappe pas qu'il s'agit d'une nouvelle forme de déshumanisation. L'industrie du sexe en est imprégnée ; pourquoi les arguments pour le défendre auraient-ils une saveur différente ?
Je n'ai jamais rencontré d'argument appelant à la décriminalisation totale de tous les aspects de la prostitution qui ne soit pas truffé d'inexactitudes pratiques, d'inversions linguistiques et de dissimulations délibérées. La déclaration de Mme Mijatović en est un bon exemple. Elle y note que « la Belgique est devenue le premier pays européen à décriminaliser le travail du sexe en 2022 » avant de se féliciter de cette décision comme d'un nouveau phare de la législation progressiste, en donnant l'exemple suivant : « La nouvelle loi décriminalise également les tiers qui ne risqueront plus d'être pénalisés pour avoir ouvert un compte bancaire pour des travailleuses du sexe ou loué un logement à cette fin, et elle permet aux travailleurs et travailleuses du sexe de faire de la publicité pour leurs services. » Elle ne mentionne jamais pourquoi une femme soi-disant autonome en prostitution aurait besoin d'un proxénète pour ouvrir un compte bancaire en son nom, ni les tarifs imposés aux femmes pour louer des chambres, à des montants souvent si exorbitants qu'elles doivent se laisser exploiter par sept ou huit hommes avant de pouvoir couvrir le loyer d'une seule journée.
Je suis rentrée de Belgique le 11 février, quelques jours avant la publication de cette déclaration. J'y étais allée pour une mission d'enquête, pour mener quatre entretiens planifiés à l'avance et pour me promener, accompagnée, dans la zone de prostitution. Cette zone est située à quelques pas du Parlement européen. Ce que j'y ai vu m'a bouleversée au-delà des mots et de toute mesure. Des dizaines et des dizaines de femmes, presque nues dans des vitrines, bordaient tout le côté d'une très longue rue, et beaucoup plus de femmes dans les rues secondaires qui y sont reliées et les rues au-delà, et des garçons pré-pubères jouaient dans ces rues secondaires, comme si jouer parmi des femmes exposées comme des objets sexuels à louer était un environnement naturel ou sain pour les enfants ; comme si le fait d'inculquer la perception des femmes comme des marchandises sexuelles dans l'esprit des garçons pouvait créer autre chose que de la violence et de la misogynie chez les hommes qu'ils deviendront.
Les femmes que j'étais allée interviewer représentaient différents domaines d'expertise. Mme Viviane Teitelbaum, vice-présidente du Parlement régional bruxellois, m'a parlé de ses collègues politiques qui ont contribué à créer la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Belgique : « Les politiciens qui ont voté pour la dépénalisation n'ont pas écouté les femmes. Ils ont voté pour un système qui profite aux proxénètes, aux trafiquants, à certains hommes… Ils ont ignoré tous les avertissements, fait fi de tous les messages d'organisations féministes, des femmes qui sont venues témoigner au Parlement. Ils se sont contentés d'écouter les représentants d'un système qui fait de l'argent à partir de la pauvreté des femmes. »
Pascale Rouges, elle-même prostituée depuis de nombreuses années en Belgique, a déclaré : « Vous vous donnez corps et âme. C'est ça le métier, si on peut appeler ça un métier. Tu donnes vraiment tout ton corps, rien ne t'appartient et tu perds ton âme. Je voudrais demander à ces hommes politiques s'ils aimeraient que ce soit une option pour leurs propres enfants. »
Alyssa Ahrabare est la responsable juridique du Réseau européen des femmes migrantes, basé à Bruxelles, qui regroupe plus de cinquante organisations travaillant dans vingt-trois pays de l'Union européenne. Je lui demande quel est le profil des femmes prostituées en Europe. Elle me répond que 70% des femmes prostituées en Europe sont des migrantes. Elle ajoute : « La réalité de la prostitution pour la majorité des femmes prostituées n'est rien d'autre que de la violence. Nous parlons beaucoup de liberté de choix et de liberté sexuelle, mais ce n'est pas ce qu'on observe dans le monde de la prostitution. Les femmes et les filles prostituées se voient dépouillées de leur désir, de leur individualité et de leur humanité. »
Mireia Cresto, directrice exécutive d'Isala, un service de première ligne basé à Bruxelles, déclare : « Il est évident que la nouvelle législation a créé un facteur d'attraction pour le commerce du sexe : les proxénètes et les trafiquants de sexe savent que le territoire belge est désormais propice à leurs profits. En première ligne, pour les femmes et les jeunes filles touchées par le système de la prostitution, la dépénalisation n'apporte ni statut ni protection supplémentaire, puisque pour condamner un proxénète, il faut prouver qu'il a bénéficié d'un profit ou d'un avantage anormal » ; anormal, c'est-à-dire au-delà de celui inscrit dans l'activité régulière de proxénétisme.
La décision du gouvernement belge d'autoriser la frénésie de violations des droits de l'homme dont j'ai été témoin dans les rues de Bruxelles démontre le décalage mortel entre une pensée élaborée en tour d'ivoire et la réalité du terrain. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe se livre à une campagne coordonnée et déterminée visant à étendre la dépénalisation du commerce du sexe à l'ensemble de l'Europe.
La vérité sur les systèmes de prostitution dépénalisée est qu'ils sont un cancer sur cette terre, et en Europe, ses premières cellules sont apparues dans deux structures politiques très importantes, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Les années à venir nous démontreront le courage ou non de nos hommes politiques, en déterminant s'ils exciseront cette tumeur avec détermination ou s'ils laisseront ce cancer social destructeur se propager sur l,ensemble du continent.
Rachel Moran, contributrice invitée, EUREPORTER, 18 mars 2024
Rachel Moran est une militante pour les droits des femmes, une autrice publiée (ci-dessous) et la directrice de la politique internationale et du plaidoyer au Centre international sur l'exploitation sexuelle, une filiale du Centre national sur l'exploitation sexuelle. Sur X : @NCOSE.
https://tradfem.wordpress.com/2024/03/18/les-systemes-de-prostitution-depenalises-sont-un-cancer-qui-sest-propage-a-lunion-europeenne-et-au-conseil-de-leurope/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une nouvelle année scolaire commence sans une seule fille en classe

Le régime des talibans a officiellement annoncé le début de la nouvelle année scolaire, au premier jour de l'année 1403 du calendrier persan (correspondant au 20 mars 2024). Cette année, comme les deux précédentes, la cloche des écoles a sonné sans qu'aucune fille ne soit présente en classe. Aucune n'a été autorisée à entrer dans les écoles ni dans les universités. Elles attendaient, dépitées, derrière les grilles, les larmes aux yeux.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Lorsque Ahrar, 15 ans, frère aîné de Mahla, s'est joyeusement rendu à son école de Kaboul le matin pour entamer sa huitième année d'études, Mahla, 13 ans, le cœur brisé, a déclaré qu'elle aurait voulu être un garçon comme son frère, pour pouvoir aller à l'école et que son genre ne l'empêche pas d'étudier ! Mahla n'est pas la seule dont l'avenir a été volé par les talibans, elles sont des millions.
Selon l'UNICEF, cette année, 330 000 jeunes filles ayant terminé l'école élémentaire ne seront pas autorisées à poursuivre leurs études, rejoignant ainsi les millions de filles déjà exclues des écoles et de l'enseignement supérieur par les talibans, revenus au pouvoir en août 2021. Selon Care International, le nombre de jeunes filles afghanes en âge d'être scolarisées mais qui ne le sont plus s'élève à 2,5 millions.
Priver d'instruction des millions de jeunes filles trois ans consécutifs, interdire aux femmes de travailler et nier leur présence dans la société est une preuve évidente de l'apartheid de genre, pour lequel les autorités talibanes devront bien un jour rendre des comptes devant la justice.
Le Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW) condamne la politique misogyne et l'apartheid de genre imposés par les talibans et exige qu'il y soit mis fin sans délai. Les talibans, conformément à leurs enseignements religieux, ne respectent pas le droit des femmes à l'instruction, au travail et à la liberté, et ne sont pas prêts à abandonner leur politique médiévale : seule une lutte déterminée pourra y mette fin.
Bien que le SMAW fasse l'objet de menaces et de répression brutale de la part des services de renseignements talibans, bien que des dizaines de ses membres aient été arrêtées et torturées et que des centaines d'autres soient portées disparues, nous avons mis en place des dizaines d'écoles clandestines à domicile pour les jeunes filles à qui on interdit de sortir de chez elles.
Afin de maintenir nos 45 écoles en activité dans 12 provinces d'Afghanistan, où des centaines de jeunes filles reçoivent un enseignement, nous avons besoin d'une aide financière et de matériel éducatif. Nous demandons aux institutions et aux personnes qui défendent les droits des femmes, des enfants et aux organisations enseignantes, ainsi qu'à nos amis en Europe, en Amérique, en Australie et dans le monde, de comprendre notre souffrance et de nous soutenir.
– Soutenez la voix des femmes afghanes qui protestent contre les talibans pour obtenir le pain, le travail, la liberté et l'éducation !
– Participez activement à la campagne de collecte d'argent pour aider les écoles pour les jeunes filles afghanes !
Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW)
20 mars 2024, Kaboul – Afghanistan
https://defendafghanwomen.org/2024/03/26/une-nouvelle-annee-scolaire-commence-sans-une-seule-fille-en-classe/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Chili approuve une loi intégrale contre les violences faites aux femmes

Le Chili vient d'adopter une loi intégrale pour prévenir, sanctionner et éradiquer les violences faites aux femmes. Une bonne nouvelle pour les féministes chiliennes qui œuvraient depuis sept ans à ce projet.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
23 mars 2024
Par Agathe Ripoche
Depuis son élection en 2022 à la tête du Chili, Gabriel Boric avait assuré que cette loi contre les violences était une priorité législative pour le pays. Deux ans après, cette promesse se concrétise enfin. Elle est le fruit d'un travail acharné des féministes, ex-ministres, parlementaires et du ministère des Droits des femmes qui travaillent depuis sept ans avec un seul objectif : inscrire cette loi dans la Constitution chilienne. C'est donc chose faite depuis le 6 mars 2024, soit deux jours avant la journée internationale des droits des femmes, où la loi intégrale contre les violences faites aux femmes a fait son entrée dans la Constitution.
Loi intégrale contre les violences faites aux femmes
Jusqu'à présent au Chili, seules des mesures immédiates pouvaient être prises en cas de violences intra-familiales. Désormais, la loi étend son champ d'application aux délits et agressions qui surviendraient en dehors des relations familiales ou affectives. Elle renforce également le rôle juridique du Service national de la femme et de l'égalité de genre, service public chilien, qui pourra désormais agir plus rapidement en cas de féminicides ou suicides forcés, garantissant aide et représentation juridique gratuite aux victimes.
Le texte donne également une définition plus précise de la violence de genre. Sera donc considérée comme telle « toute action ou omission causant la mort, des blessures ou souffrances à une femme en raison de son genre, sans distinction du lieu où elle se trouve, que ce soit dans l'espace public ou privé ; ou une menace ». La définition de violence est même étendue plus largement aux différentes formes que peut prendre celle-ci. Par exemple, la loi entend ainsi par violence aussi bien des violences physiques que psychologiques, sexuelles, économiques ou encore gynécologiques. Le but étant avant tout d'œuvrer pour prévenir ces violences avec la mise en place de programmes et protocoles.
Un autre point important est à souligner dans ce texte. Ce dernier va plus loin que la protection des femmes puisqu'il reconnaît également comme violence de genre toute violence exercée sur les enfants et adolescentes dans le but d'atteindre leur mère ou tutrice. Ces derniers ne sont donc plus considérés comme des témoins mais comme des victimes.
Une loi attendue et saluée
C'est avec beaucoup d'émotion que cette nouvelle a été reçue au Chili. Après l'approbation de la loi, la ministre des droits des femmes, Antonia Orella, a d'ailleurs salué la lutte de toutes les femmes qui ont permis d'obtenir des droits et d'arriver aujourd'hui à adopter une telle loi : « Si nos grands-mères ont rendu possible le travail rémunéré, si les femmes ont pu récupérer la démocratie, si nous avons pu avoir les premières lois sur la violence et la création d'un ministère des droits des femmes, aujourd'hui, nous faisons un pas en avant pour la prochaine génération en adoptant la Loi intégrale contre les violences ». Sur son compte X, elle a aussi tenu à remercier plus particulièrement celles qui ont travaillé toutes ces années pour rendre ce jour possible.
Agathe RIPOCHE
Les Nouvelles News
P.-S.
• FAL. PUBLIÉ LE 23 MARS 2024 :
https://www.espaces-latinos.org/archives/119173
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour survivre, les travailleurs et les travailleuses d’Ukraine ont besoin de l’aide internationale

Alfons Bech s'est rendu à Kyiv à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans le cadre d'une délégation syndicale internationale reçue par la FPU et la KVPU. Le syndicat espagnol UGT était le seul représenté physiquement à Kyiv, les autres ayant participé à la rencontre en visio. Il revient sur des témoignages entendus à cette occasion.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/28/pour-survivre-les-travailleurs-et-les-travailleuses-dukraine-ont-besoin-de-laide-internationale/
Je suis à Kyiv depuis quatre jours. Je faisais partie d'une délégation de solidarité internationale organisée par les syndicats FPU et KVPU. Le 22 février, il y a deux jours, nous avons tenu une conférence, en partie en visio et en partie en présentiel, au siège de la FPU. Bien qu'elle ait été organisée à la dernière minute, elle a été soutenue par la CES, la CIS et de nombreux syndicats nationaux y ont participé. La liste est longue et je ne l'ai pas sous la main mais, pour mémoire, 191 personnes ont participé.
La seule délégation internationale physiquement présente dans le hall de la Maison des syndicats de la place Maïdan était celle de l'UGT de Catalogne. Elle était soutenue par l'UGT de l'État espagnol. Le secrétaire général de l'UGT, Pepe Álvarez, est également vice-président de la CES.
Les interventions des différents délégués internationaux ont manifesté leur soutien à l'Ukraine et à ses syndicats. D'Europe, d'Amérique du Nord, d'Austra- lie, ils ont transmis des messages de solidarité en souhaitant que les travailleurs et les travailleuses puissent bientôt vivre dans de meilleures conditions. Á la fin de la rencontre, le président de la FPU a fait un discours et demandé à ses délégués de rester encore. Il a alors montré une valise contenant un drone et a déclaré que son syndicat faisait don de cet appareil qui aiderait à sauver la vie de ses propres collègues syndicalistes et d'autres travailleurs qui sont sur la ligne de front pour défendre l'Ukraine. C'était un acte intime et solennel ; des photos et des vidéos ont été prises des personnes présentes ainsi que du drone.
Les cheminots poursuivent leur mission de service public
Aujourd'hui, samedi [24 février], deux ans après l'invasion et la guerre totale, je suis allé voir les cheminots. Le camarade Oleksandr Skyba dirige le syndicat des chemins de fer de la KVPU. Nous nous étions rencontrés pour la première fois à Lviv en mai 2022. Et il m'avait promis de me présenter à d'autres camarades cheminots lors de mon prochain passage à Kyiv. Il y avait aussi le dirigeant du syndicat indépendant des cheminots Oleg Chkoliar. Et la camarade Natalia Zemlianska, du syndicat des producteurs et entrepreneurs FPU, qui organise les travailleurs des services ferroviaires et des entreprises auxiliaires, majoritairement des femmes très précaires. Ils voulaient tous savoir ce que faisaient les cheminots en Catalogne et en Espagne, comment ils et elles voyaient la situation en Ukraine. Pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes, la vie a beaucoup changé avec la guerre. Tout d'abord, ils et elles doivent poursuivre leur mission de service public, qui est essentiel, tant pour le transport des personnes que pour l'armée. Les avions ne fonctionnent pas en Ukraine. En plus, il leur faut aussi défendre leurs membres dans un contexte où la guerre est parfois utilisée par l'entreprise et par l'État pour se décharger de leurs responsabilités à l'égard de leurs travailleurs ainsi que des familles fuyant les zones détruites. Un exemple de cette situation critique de négligence : le manque d'équipement dans de nombreuses parties du front. Les soldats doivent se procurer eux-mêmes des articles de base tels que des gilets pare-balles, des gants, des chauffe-mains ou de bons manteaux. Et ils m'expliquent à quel point certains appareils électroniques sont nécessaires à la survie dans la guerre actuelle. Comme ils et elles ne peuvent ni protester ni faire grève en raison de la loi martiale, les moyens de se plaindre au gouvernement, surtout en première ligne, leur font défaut.
Ils me parlent du cas d'un collègue cheminot qui est mort il y a quelques jours parce que sur le front, où il se trouvait, ils n'avaient pas un simple appareil pour se connecter à internet et ils n'ont pas su que des missiles étaient tirés sur leur position ; plusieurs jeunes soldats sont ainsi morts. Ces syndicalistes me demandent de les aider, d'expliquer aux syndicats pourquoi ils et elles ont besoin de ce genre de matériel. Sans être dans une position d'offensive, ils et elles sont là pour sauver la vie de celles et ceux qui résistent à un ennemi bien supérieur en matériel et en nombre. Sans cette aide des syndicats, me dit-on, nous sommes condamnés.
Le premier des droits : défendre leur vie
La conférence des syndicats et des syndicalistes a donné un bon coup de fouet au moral de tous les participants et syndicats ukrainiens. Cependant, Natalia me disait aujourd'hui qu'il ne suffit pas de faire une bonne déclaration de temps en temps. Il faut plus que de bonnes paroles. La situation militaire pèse sur tout et les premiers à comprendre qu'il faut résister et chasser l'ennemi impérialiste russe sont les travailleurs. Natalia veut que nous, syndicats occidentaux, interpelions notre gouvernement pour qu'il fournisse les armes dont ils ont besoin et qu'ils n'ont pas. Nous devons faire quelque chose, car des travailleurs meurent chaque jour et le premier droit des travailleurs est de pouvoir défendre leur propre vie et celle de leur famille. Sans ce droit, les autres droits pourront-ils être défendus ? me demande-t-elle.
La coordinatrice internationale de l'UGT catalane, Cati Llibre, a peut-être mis le doigt sur un point sensible lorsqu'elle a déclaré dans son discours, le dernier prononcé avant la clôture de cet événement :
Nous travaillons pour la paix, nous rejetons et condamnons fermement l'invasion russe de l'Ukraine. Nous sommes convaincus que le droit d'un peuple à se défendre contre une agression extérieure est un droit naturel inaliénable et que nous devons tous ici travailler pour aider nos frères et sœurs syndicalistes qui en souffrent. Nous devons mettre sur la table les moyens pour les aider et travailler ensemble pour lever les barrières qui limitent cette aide et qui nous lient les mains. Même s'il faut pour cela revoir des positions syndicales au niveau international qui ont pu sembler justes en temps de paix mais que les événements de ces dernières années nous obligent à revoir.
Si les agresseurs ne respectent pas les traités internationaux et que, dans le même temps, nous fixons des limites au type d'aide que nous pouvons apporter, nous ouvrons grande la voie à l'impérialisme, à la barbarie et au fascisme pour qu'ils se répandent dans le monde entier.
En tant que syndicalistes, fidèles à notre tradition de lutte pour les droits humains, les libertés et la démocratie, nous sommes obligés de faire nôtre la lutte des travailleurs et des travailleuses ukrainiennes pour leur liberté.
Alfons Bech
Syndicaliste catalan des CCOO, membre du RESU et coordinateur de sa campagne syndicale. Article paru dans Sin permiso, 25 février 2024, traduction Mariana Sanchez.
Texte publié dans Les Cahiers de l'antidote : Soutien à l'Ukraine résistante (Volume 28)
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/23/nous-ecrivons-depuis-lespagne/
https://www.syllepse.net/syllepse_images/soutien-a—lukraine-re–sistante–n-deg-28_compressed.pdf
La Conférence syndicale internationale de solidarité avec l'Ukraine et ses syndicats du 22 février 2024 : un bilan
https://www.pressegauche.org/La-Conference-syndicale-internationale-de-solidarite-avec-l-Ukraine-et-ses
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les syndicats thaïlandais font avancer la campagne de ratification des conventions de l’OIT

En remettant une lettre demandant la ratification des Conventions 87 et 98 de l'OIT au ministre thaïlandais du travail, Phiphat Ratchakitprakarn, dans les locaux du ministère du travail à Bangkok, le coordinateur du réseau et Président de la CILT (Confédération du travail industriel de Thaïlande), Prasit Prasopsuk, a déclaré que la ratification de ces conventions était susceptible de créer un système de relations sociales équitable et offrir une meilleure qualité de vie aux travailleurs et travailleuses thaïlandais.
Tiré de Entre les lignes et les mots
« L'adoption des normes internationales du travail et la protection des droits des travailleurs donneront une bonne image de la Thaïlande au niveau international. Cela renforcera sans aucun doute notre compétitivité commerciale, attirera davantage d'investissements et stimulera la croissance économique. »
Le même jour, vingt syndicalistes de la CILT et du syndicat PTTLU ont également remis au Parlement une lettre au Président de la commission du travail, Saritphong Khruang, demandant au gouvernement d'accélérer la ratification de ces conventions de l'OIT.
En octobre 2023, le gouvernement thaïlandais a mis en place un comité tripartite et deux groupes de travail pour étudier la faisabilité de la ratification de la C87 et de la C98, ainsi que sa cohérence avec le droit du travail thaïlandais. L'étude de faisabilité devrait être achevée d'ici un an.
Toutefois, la Fédération des industries thaïlandaises s'est fermement opposée à la ratification des deux conventions, affirmant que la liberté syndicale entraînerait une augmentation du nombre de grèves. Le ministère de l'intérieur craint que si les travailleurs migrants sont autorisés à former des syndicats, cela ne constitue une menace pour la sécurité et ne dévaste l'économie.
Apsorn Krissanasmit, Président de la SEWFOT (Fédération des travailleurs des entreprises d'État de Thaïlande) et du PTTLU, a déclaré :
« En tant que membre du comité tripartite, j'engagerai continuellement les parties prenantes à ratifier les conventions et à amender le droit du travail, si l'on y trouve des obstacles à la ratification des conventions par le gouvernement et le parlement. Je m'engage à faire en sorte que les avantages que le pays tirera de la ratification soient mieux compris. »
Ramon Certeza, Secrétaire régional d'IndustriALL pour l'Asie du Sud-Est, a déclaré :
« IndustriALL apportera son soutien pour permettre à ses affiliés en Thaïlande de s'engager de manière significative dans le dialogue social en vue de la ratification de ces deux conventions que les travailleurs et travailleuses thaïlandais appellent de leurs vœux »
À l'avenir, le réseau de pilotage 8798 des conventions de l'OIT prévoit de produire davantage de contenus de communication et à destination des médias afin d'améliorer la compréhension des deux conventions par les travailleurs et la société dans son ensemble.
Ce réseau, qui comprend 26 syndicats et organisations de travailleurs, a été créé lors d'un atelier en août dernier.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour un vrai mouvement internationaliste de défense des Palestiniens et des Ukrainiens !

La journée du vendredi 22 mars a vu se produire plusieurs faits importants d'ordre militaro- diplomatique. Celui qui a fait le plus de bruit n'est pas le plus clair. Le massacre d'environ 70 personnes dans une grande salle de concert de la périphérie de Moscou est revendiqué par Daesh après que les médias russes ont entrepris de le mettre sur le dos des Ukrainiens, et alors que l'ambassade US à Moscou alertait publiquement sur un risque d'attentat depuis quelques jours. Nous verrons comment, une semaine après sa prétendue « réélection » par une fraude d'État d'une ampleur historique, et un peu plus d'un mois après l'assassinat de Navalny et les manifestations massives qu'il a suscitées en Russie, le régime poutinien va utiliser cet attentat.
23 mars 2024 | tiré du site aplutsoc | Photomontage : À gauche, la voiture dans laquelle Hind Rajab (à droite), 6 ans, et cinq membres de sa famille sont morts. © Photomontage Armel Baudet / Mediapart avec AFP
https://aplutsoc.org/2024/03/23/pour-un-vrai-mouvement-internationaliste-de-defense-des-palestiniens-et-des-ukrainiens/
Auparavant, dans la journée, deux faits d'une grande importance s'étaient produits. En Russie, le pouvoir a officialisé l'emploi du terme « guerre » pour son « opération militaire spéciale », en prétendant que la guerre est menée, en Ukraine, par « l'Occident global » contre le « monde russe » (et ses alliés « multipolaires »).
Et une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza, visant à bloquer l'offensive israélienne en préparation contre Rafah, c'est-à-dire l'achèvement de la destruction de tout habitat humain dans la bande de Gaza en vue d'en chasser les habitants, a été déposée au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a été, comme d'habitude, repoussée. Un non-évènement, un rituel ? Non, car la résolution était américaine. Les deux votes contre de membres avec droit de veto (plus l'Algérie) étaient ceux de la Russie suivie de la Chine. L'inverse du rituel habituel !
Le motif russe allégué : quand ce sont les États-Unis qui déposent une telle résolution, elle est « hypocrite » et il faut donc voter contre !
Formidable démonstration : il est montré au grand jour que jusque-là, TOUTES les résolutions appuyées ou proposées par la Russie et la Chine pour un cessez-le-feu l'ont été en escomptant bien qu'elles ne passeraient pas, bloquées par les États-Unis, lesquels, de 1967 au 22 mars 2024, ont en effet barré toute résolution exécutoire du Conseil de sécurité à l'encontre de la politique d'occupation israélienne avec ses conséquences : colonisation, ségrégation, crimes contre l'humanité.
Le but n'était pas, il n'a jamais été, de sauver et d'aider les Palestiniens. Il était, il a toujours été, de les utiliser comme moyen mondial de propagande au service de l'ordre existant, dans le monde arabe et partout. En escomptant bien que l'État et l'armée israéliens continuent à les persécuter !
Mais pourquoi ce changement dans la position des États-Unis ? Pas seulement parce que Netanyahou agace Biden. Mais parce que, dans la confrontation « multipolaire » des impérialismes, les États-Unis deviennent perdants au fur et à mesure que se prolonge le massacre à Gaza, et, pire encore, leur propre crise interne en est aggravée, Trump ayant affiché clairement la ligne de soutien total à la réalisation des menaces génocidaires visant tant les Ukrainiens que les Palestiniens.
Déjà engagé dans une confrontation avec l'Iran dont le principal terrain est l'affrontement avec les Houthis autour du détroit de Bab-el-Mandeb, les Etats-Unis ont reçu un clair signal d'alarme avec la rupture par le Niger, plusieurs mois après celle visant la France, de sa coopération militaire avec les États-Unis, imposant le prochain départ des troupes US d'Agadez. Poutine « réélu » semble préparer une mobilisation militaire plus importante et accentue la pression meurtrière sur l'Ukraine, menaçant de rompre le front soit vers Kharkiv, soit vers Odessa en relation, dans ce cas, avec les menaces visant la Moldavie. Et d'autre part le régime nord-coréen a créé depuis des semaines les conditions d'une crise dans la péninsule qui finirait de coincer la Chine dans l'alliance eurasiatique avec la Russie et l'Iran, alors même que son aviation militaire tourne autour de Taïwan.
Quelle est la voie efficace pour la défense des Palestiniens ? Le but immédiat doit bien sûr être un cessez-le-feu, au-delà des discussions sur les perspectives ultérieures permettant de garantir les droits démocratiques et nationaux des Palestiniens et des Judéo-israéliens. Jusque-là, le verrou contre un cessez-le-feu était à Washington. Le début de tournant de Washington, appelé depuis quelques jours d'ailleurs par la vice-présidente Kamala Harris, n'est pas provoqué par les manifestations dites pro-palestiniennes aux États-Unis ou ailleurs, mais par l'évolution géopolitique provoquée par la polarisation sur Gaza, au bénéfice du régime poutinien avant tout, et par ses répercussions sur la crise aux sommets aux États-Unis en pleine campagne présidentielle avec la « question Trump », et dans ce cadre par les risques de recul électoral des Démocrates dans des secteurs de la jeunesse universitaire et des couches afro-américaines et musulmanes.
Ces faits donnent une leçon. On a entendu répéter sur tous les tons, depuis le 7 octobre 2023, qu'on ne pourrait rien comprendre aux crimes du Hamas suivis des crimes de l'armée israélienne sans tout situer dans « le contexte » de la colonisation, remontant (au moins) jusqu'en 1948. La répétition d'un tel truisme avait en réalité pour fonction de tenter d'interdire de comprendre l'opération pogromiste du Hamas et ses suites prévisibles dans son cadre réel, qui ne se réduit pas au seul territoire palestino-israélien mais se situe dans le cadre mondial de la crise du capitalisme, de la lutte des classes et des confrontations entre États. Le 7 octobre a ouvert une phase mondiale de réaction, qui porte en elle la guerre mondiale et qui se heurte à la lutte sociale des opprimés – des grèves américaines à celles des collèges de Seine-Saint-Denis – et tout particulièrement à la résistance ukrainienne, qu'elle vise soit à submerger, soit à lui imposer un « cessez-le-feu » qui, ici, ne serait rien d'autre que la garantie de l'écrasement des populations (à l'inverse de celui qu'il faut exiger à Gaza).
La faillite du « mouvement pro-palestinien » est profonde : il ne sert à rien pour les Palestiniens tant qu'il est aligné sur la logique des camps géostratégiques en taisant le rôle du Hamas et en se focalisant sur le seul Genocide Joe que n'est pas Joe Biden, qui n'est pas non plus, bien sûr, le père Noël, mais seulement le chef d'État flageolant de la première puissance impérialiste en crise. Pire, le « mouvement pro-palestinien » tel qu'il s'est reproduit suite au 7 octobre 2023, ouvre les vannes de l'antisémitisme et interdit systématiquement de relier la cause palestinienne à la défense des autres peuples opprimés, non seulement les Ukrainiens, mais même les Palestiniens lorsqu'ils sont massacrés et torturés par des pouvoirs non juifs, comme en Syrie. La célébration du culte des « enfants massacrés » à Gaza suppose que le massacre continue : ainsi fétichisée, la « cause palestinienne » vise à se nourrir de la souffrance palestinienne (à condition que l'on puisse tenir les Juifs pour responsables), pas à les défendre sérieusement et à les aider à s'organiser eux-mêmes pour leur souveraineté et leurs droits démocratiques, contre Israël et contre le Hamas. Certes, toutes les organisations et tous les secteurs militants appelant à manifester ne sont pas à loger à la même enseigne, et beaucoup cherchent à agir pour un cessez-le-feu immédiat, mais la tonalité dominante et finalement retenue est malheureusement celle-ci, pour une raison politique : l'absence de toute « contextualisation » réelle des évènements se produisant en Palestine dans la situation mondiale.
Disons le brutalement, en comprenant bien sûr que des millions de jeunes et de moins jeunes cherchent sincèrement à agir dans ces manifestations : la répétition mécanique des « manifestations pro-palestiniennes » déclenchée par le 7 octobre n'a pas servi à protéger et à aider les Palestiniens. Oui, il faut manifester pour les Palestiniens, il s'agit de gagner et pas de reproduire l'ordre existant et la souffrance palestinienne !
Les Palestiniens ont besoin d'une solidarité internationaliste efficace. Une solidarité internationaliste efficace pour les Palestiniens doit taper là où ça peut craquer :
- exiger de Joe Biden la pression pour un cessez-le-feu immédiat ;
- stopper l'envoi d'armes à Israël alors que c'est l'Ukraine qui en a besoin ;
- exiger que les moyens militaires et autres porte-avions français servent à sécuriser le ravitaillement de Gaza ;
- lier le soutien aux Palestiniens au soutien aux Ukrainiens et, envers les Palestiniens, soutenir les revendications nationales démocratiques et pas les programmes islamistes visant à les opprimer ;
- soutenir, dans le même esprit, la cause des femmes palestiniennes comme iraniennes ;
- ne surtout pas taire la question des otages ou celles des viols commis le 7 octobre ;
- rechercher systématiquement la solidarité syndicale concrète et les contacts intersyndicaux ;
- soutenir les oppositions démocratiques dans la société israélienne et les mouvements tels que Standing together ;
- ne pas faire du « sionisme » un objet fétiche diabolisé mais dénoncer frontalement le colonialisme, le racisme et l'apartheid.
Avec la question ukrainienne, la question palestinienne soulève douloureusement et immédiatement la nécessité de reconstruire le véritable internationalisme.
VP et OD, le 23/03/2024.

Appel à l’action 17 avril : Journée internationale des luttes paysannes

Le 17 avril, nous marquons la Journée internationale des luttes paysannes, notre journée d'action annuelle qui nous réunit pour commémorer le massacre d'Eldorado do Carajás* en 1996 et honorer la résistance des paysan·nes du monde entier qui persistent dans leur lutte pour la justice sociale et la dignité.
Photo et article tirés de NPA 29
Affiche : Inspirée par la cosmovision andine, notre affiche cette année reflète l'interconnexion de tous les éléments de la nature, l'humanité étant une partie intégrante. Elle illustre comment la Mère Terre soutient les paysan·nes et leurs luttes, défendant leur existence et leurs droits. Selon cette vision, nous pouvons également être une offrande de la terre, en tant que mouvement collectif comme celui des paysan·nes. Représentée comme une force unificatrice, la Mère Terre nous soutient, aux côtés de ses expressions naturelles, les montagnes symbolisant nos ancêtres et notre mémoire collective.mouvement collectif comme celui des paysan·nes. Représentée comme une force unificatrice, la Mère Terre nous soutient, aux côtés de ses expressions naturelles, les montagnes symbolisant nos ancêtres et notre mémoire collective.
Suite à notre 8e conférence internationale en décembre dernier, nous, paysan·nes, jeunes, femmes, hommes et diversités, migrant·es, travailleur·euses du monde rural, peuples autochtones et sans terres, nous tenons debout avec un espoir et une force renouvelés, une conscience accrue, un engagement indéfectible, une unité organisée et une détermination à affronter les crises multiformes. Nous poursuivons une lutte sans relâche contre les génocides, les guerres, les violations de la souveraineté des peuples, les expulsions de familles paysannes, la criminalisation et la persécution des paysan·nes et leaders sociaux, ainsi que l'extractivisme et les violations des droits des paysans. Unis, nous protégeons notre mère la terre contre l'emprise des multinationales de l'agrobusiness, des néocolonialistes, et des forces fascistes et militaires répressives.
Cette dévastation implique de nombreux acteurs dans l'ombre, notamment les institutions néolibérales telles que l'OMC, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International. Leur ingérence dans les politiques agricoles nationales, liées au commerce et à la protection sociale, est évidente. Les accords de libre-échange et d'autres cadres de partenariat économique imposent des conditions néolibérales liées aux prêts et aux programmes d'assistance financière, ou des mesures favorisant les intérêts des corporations, mettant en péril les moyens de subsistance des paysan·nes, des travailleur·euses agricoles et des migrant·es. Pourtant, ce sont les paysan·nes qui nourrissent 70 % de la population mondiale avec une alimentation saine et de qualité.
Assez avec le génocide, les expulsions et la violence !
Aujourd'hui, le monde est le témoin d'une multitude de crises qui touchent chaque aspect de la vie sur terre. Le système capitaliste révèle désormais sa véritable nature destructrice, poussant les paysan·nes en Asie et dans d'autres régions du monde au suicide en raison de dettes impayables. Il corrompt les gouvernements, qui tuent leurs peuples pour favoriser des intérêts privés, violant la nature et l'équilibre écologique, compromettant ainsi l'avenir de l'humanité. Ce système engendre des génocides, non seulement par le militarisme, mais aussi en refusant l'accès à la nourriture, en utilisant la famine comme arme de guerre, comme on le voit actuellement à Gaza. Il prend également la forme d'un génocide lent, comme celui subi par les populations haïtiennes avec des politiques anti-paysannes et une gangstérisation orchestrée pour faciliter une nouvelle intervention étrangère, permettant ainsi l'accaparement des terres paysannes et le pillage des communs.
Le néocolonialisme est inhérent à ce système, s'étendant également à des pays tels que le Niger, où les sanctions de l'Union européenne affectent le droit à l'alimentation des populations. Les conflits politiques et armés provoqués en Libye, en Syrie et au Soudan ont entraîné des déplacements massifs de populations, la destruction d'infrastructures, ainsi que des difficultés d'accès aux terres agricoles. Cette logique capitaliste mine luttes des paysan·nes pour leur droits, la souveraineté alimentaire, les méthodes de production agroécologiques durables et diversifiées, les exploitations agricoles familiales, la préservation de la biodiversité et la paix avec la justice sociale servant de solutions paysannes à la crise alimentaire et climatique**. Elle écrase la diversité sous toutes ses formes de genre et ethniques, et ignore les savoirs agricoles locaux et ancestraux, masquant ses véritables intentions derrière des solutions de développement ne servant que les intérêts économiques d'une minorité. Les capitalistes qui contrôlent et marchandisent nos biens communs entravent les jeunes paysan·nes à accéder à la terre et brisent l'autonomie des celleux qui la travaillent, les poussant vers des conflits agraires, la pauvreté, la famine et une agriculture sans paysan·nes.
Construisons la solidarité, uni·es pour la souveraineté alimentaire !
L'année 2024 a commencé avec les manifestations massives des paysan·nes en Europe, en Asie et dans d'autres parties du monde contre des politiques agricoles défavorables aux agriculteur·trices. Ces manifestations ne se limitent pas à la recherche de prix équitables et d'une vie digne pour les paysan·nes, mais expriment également la nécessité d'une société orientée vers un avenir où l'agroécologie paysanne l'emporte sur les méthodes de l'agrobusiness et où la justice sociale et la dignité de chacun·e sont garanties. Il est impératif de garantir que personne ne soit contraint de quitter sa terre, sa famille et sa culture pour chercher une vie meilleure ailleurs tout en sacrifiant sa vie pour nourrir sa famille.
Nos luttes paysannes, profondément enracinées dans les principes de la souveraineté alimentaire, visent à établir un système inclusif qui promeut les économies rurales et soutient les moyens de subsistance des paysan·nes, tout en cultivant l'espoir d'atténuer des tragédies telles que le suicide, les ruptures familiales et les migrations forcées dans les zones rurales. Reconnaissant la souveraineté alimentaire, l'agroécologie paysanne et l'accès à la terre, au territoire et aux biens communs comme de véritables solutions aux crises globales, La Via Campesina plaide ardemment en faveur de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP), un instrument international crucial pour aborder les crises multiples auxquelles sont confrontés les paysan·nes. De plus, nous plaidons pour l'établissement d'un nouveau cadre commercial international basé sur la coopération et la souveraineté alimentaire pour défier le système commercial néolibéral qui perpétue la faim. Parallèlement, nous nous préparons pour le Forum mondial de Nyéléni en 2025, qui réunira le mouvement international pour la souveraineté alimentaire pour faire face aux défis de la faim et de la pauvreté en favorisant le développement et le renforcement des économies locales.
Le 17 avril, nous occuperons les rues et tous les espaces où les luttes paysannes se font sentir pour réaffirmer avec force notre voie paysanne et renforcer la souveraineté alimentaire dans nos territoires. Nous exhortons vivement tous les membres, alliés et sympathisant·es de La Via Campesina à se mobiliser dès maintenant et tout au long du mois d'avril, uni·es dans une seule voix de solidarité pour soutenir les luttes des paysan·nes contre les crises globales.
Construisons la solidarité ! Assez du génocide, des expulsions et de la violence !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Présidentielle du 24 mars 2024 : Admirable peuple africain du Sénégal !

La présidentielle du 24 mars 2024 a pris la forme d'un referendum pour ou contre la continuité du système néocolonial vermoulu de domination, de servitude volontaire, de prédation et d'autocratie.
Tiré d'Afrique en lutte.
Le peuple sénégalais, en toute souveraineté et maturité, a voté NON et a choisi massivement la voie de la formation rupture incarnée par le candidat Bassirou Diomaye Faye. Ce dès le premier tour, avec un score de plus de 2 400 000 voix, soit plus de 54 %, loin devant Amadou BA, le candidat du pouvoir, qui a obtenu environ 1 050 000 voix, soit 35,7%, pour un taux de participation légèrement supérieur à 61%, avec un total de 19 candidats en lice.
Par ce vote clair, les électeurs ont entendu couper court à toute incertitude, à tout mauvais calcul, à tout faux prétexte pour un éventuel coup fourré. Et cerise sur le gâteau, le tout dans la paix et la sérénité : admirable peuple du Sénégal ! Un fait inédit pour un opposant face à un candidat au pouvoir, un authentique tsunami- selon le mot du doyen des doyens Alla KANE, repris en quelque sorte par la presse internationale qui parle de « tremblement de terre », de « razzia », de « raz de marée » ou de « séisme » politique. Même Macron de la république de France s'est résolu à envoyer au Président démocratiquement élu, Bassirou Diomaye Faye, un message de félicitations en français et même … tenez- vous bien, en wolof !
C'est une loi de l'histoire : aucune révolution, ni même aucun changement significatif dans aucun pays au monde, n'a jamais pu se produire, dans l'histoire contemporaine des luttes des peuples, sans que n'aient été réunies les trois conditions suivantes i) le peuple ne veut plus être dirigé comme avant ; ii) le pouvoir ne peut plus gérer comme avant ; iii) des pans entiers du camp du pouvoir (‘'le système '') basculent peu ou prou, à un moment déterminé de l'exacerbation des antagonismes de classe, dans le camp opposé au pouvoir (‘'l'antisystème'')-CF na contribution : De la Gauche qui se meurt à la Gauche qui vit, in Le Quotidien, du 9 septembre 2021.
Dans ce cadre, il est essentiel qu'à toutes les étapes, le noyau dirigeant de la lutte sache garder le cap, « en restant stratégiquement ferme sur ses orientations de base, et en même temps lucide, ouvert et vigilant dans la conduite politique, autour d'objectifs pertinents, clairement définis et aptes à faire avancer réellement la lutte des masses populaires » (Idem, Ibidem). Sous ce rapport, aucune mauvaise querelle, aucun reproche hypocrite, ne sauraient être opposés à la démarche de la Coalition Diomaye Président, laquelle a su rallier à sa cause et unir autour d'elle l'essentiel des forces vives nationales décidées à en finir avec le régime de régression politique et sociale de l'APR-BBY.
D'un côté, le scrutin du 24 mars consacre, dans une osmose militante intergénérationnelle avec des segments importants parmi leurs devanciers, la montée en puissance de nouvelles générations de patriotes révolutionnaires, souverainistes, anti-impérialistes et panafricanistes, opposés au diktat du dogme néolibéral mondialisé. En même temps, le 24 mars signe l'enterrement de première classe ou, en d'autres termes, la descente aux enfers de certains ténors de ce que l'on appelle abusivement ‘'classe politique'', que ce soient les tenants de la politique politicienne de ‘'la droite classique'' et ses fragments épars, ou les personnages balafrés de ‘'la gauche plurielle'' capitularde.
Le 24 mars marque une importante victoire d'étape dans la lame de fond ou la dynamique politique de révolution démocratique, sociale et citoyenne amorcée plus nettement depuis le 23 juin 2011, prolongée et amplifiée depuis mars 2021. Ni hasard ni miracle spontané, la lutte prolongée d'un peuple debout, uni autour d'un leadership de progrès, de convictions fortes, tenaces et partagées, constitue la clé de la victoire contre le système, ses injustices et ses violences de toutes sortes, tant il est vrai que, sous nos tropiques, la république, l'état de droit et la démocratie restent encore largement un combat de tous les jours et une conquête permanente ; tout comme d'ailleurs la bataille contre le socle économique, social, culturel et idéologique du système, ses valeurs ou contre-valeurs, ses mécanismes de reproduction et de perpétuation, les mentalités et comportements secrétés par lui et sédimentés dans le corps politique et social.
Fort heureusement, soutenant la dynamique de la révolution politique enclenchée, une véritable révolution culturelle est en train de s'opérer à grands pas sous nos yeux, pour le changement positif des mentalités et des comportements, en rupture avec le mimétisme et l'élitisme complexé hérités de l'occident capitaliste. C'est pourquoi quand le président élu Bassirou Diomaye Faye oublie sa personne et déclare : « Le héros de la journée du 24 mars, c'est le peuple sénégalais », il se montre parfaitement en phase avec cette exigence de rupture paradigmatique.
Il en est de même quand, armé symboliquement d'un balai tout au long de la campagne, il déblaie la voie du Jub-Jubël-Jubbënti (Incarner soi-même la droiture -Amener chacun et chacune à pratiquer la droiture - S'employer à corriger tout comportement non conforme à l'esprit de droiture), selon la pédagogie par l'exemple et par le haut. Pareillement quand lui-même et le président Sonko s'engagent publiquement devant le peuple, non à distribuer ou à partager des privilèges ou prébendes, mais plutôt à travailler dur en vue de la réalisation collective des objectifs et engagements du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans une Afrique de progrès.
Félicitations appuyées et méritées à l'ensemble des composantes du peuple sénégalais des villes comme des campagnes, femmes comme hommes, jeunes comme personnes âgées, avec un accent particulier à l'endroit de nos exemplaires compatriotes de la diaspora.
À présent, le plus dur, le plus difficile, restent à faire et pour relever le défi, nous nous devons de changer nous-mêmes pour changer le Sénégal et l'Afrique. Ceux ou celles qui disent : « nous avons renversé la bourgeoisie, c'est maintenant à notre tour de nous servir », rendent un bien mauvais service à la cause ! En reconnaissance des énormes sacrifices consentis et à la mémoire de l'ensemble des martyrs de notre lutte commune, nous avons l'obligation et la lourde responsabilité de ne décevoir ni les attentes immenses ni le formidable espoir de tout un pays, de tout un continent, de tout un peuple, notamment de sa frange la plus vigoureuse, sa vaillante jeunesse.
Des chantiers prioritaires, divers et nombreux, sont à prendre à bras le corps par le président Diomaye et son équipe, comme : lutte contre la vie chère et le chômage ; réconciliation nationale, vérité et justice, non à l'impunité ; refondation des institutions, fin de l'hyper-présidentialisme néocolonial ; rationalisation et diminution de la dépense publique, lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite ; état des lieux et concertations ciblées avec les divers secteurs pour la prise en charge efficiente de leurs préoccupations ; construction nationale, retour définitif de la paix en Casamance, développement endogène et souveraineté alimentaire ; éradication de l'analphabétisme, culture et communication du changement pour la promotion d'une citoyenneté nouvelle de discipline et de responsabilité ; mise en place du nouveau gouvernement pour faire face efficacement et sans retard aux urgences, entre autres.
Dans tous les cas, la mobilisation populaire et citoyenne pour la promotion du Projet politique porté par le Président Diomaye et, en toutes circonstances, pour la défense du nouveau pouvoir face à toutes manœuvres éventuelles de déstabilisation ou de retour en arrière, d'où qu'elles viennent, doit faire constamment l'objet, à tous les niveaux, de toute l'attention requise. Puisse le 4 avril 2024, dédié à la jeunesse et aux forces armées, constituer le coup d'envoi d'une authentique campagne de SET SETAL NATIONAL : setal suniy gox, sellal suniy jikko !
Dakar, le 27 mars 2024
Madieye Mbodj, membre de la Conférence des leaders de la Coalition Diomaye Président
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Rwanda : la France, « principal accélérateur du processus génocidaire »

En 1994, la France, présidée par François Mitterrand, était au cœur du génocide des Tutsi au Rwanda. Trente ans après, il est de notre devoir de connaître et raconter le déroulement et les responsabilités dans cet évènement historique.
Photo et article tirés de NPA 29
Les colons belges en 1922 vont trouver au Rwanda un système politique fortement hiérarchisé socialement. Les dynasties tutsi vont s'imposer, contrairement au pays voisin le Burundi où un partage du pouvoir va s'opérer entre les lignages aristocratiques tutsi et hutu. Au Rwanda, la catégorisation tutsi et hutu revêt avant tout un caractère social :
« Il n'y a pourtant pas de “Hutu” sans “Tutsi” : l'un ne va pas sans l'autre. “Hutu” avait du reste un double sens puisqu'il désignait le dépendant ou l'inférieur dans un rapport de clientèle ou hiérarchique, fût-il lui-même un “Tutsi” »1.
Les colons reprennent à leur compte la théorie des Tutsi descendant·es d'une population hamite provenant d'Éthiopie envahissant le pays et asservissant des Hutu. Cette racialisation d'une domination sociale exercée par une élite tutsi s'intégrait dans les théories racistes issues des penseurs comme Gobineau. Les Tutsi étaient vus comme plus proches des populations européennes qu'africaines. Les colons belges vont donc s'appuyer sur eux pour gouverner le pays :
« Les Batutsi étaient destinés à régner, leur seule prestance leur assure déjà, sur les races inférieures qui les entourent, un prestige considérable… Rien d'étonnant que les braves Bahutu, moins malins, plus simples, plus spontanés et plus confiants, se soient laissé asservir sans esquisser jamais un geste de révolte »2.
Cette idéologie se diffuse dans l'ensemble de la société. Dans les écoles gérées par l'ordre des Pères Blancs, la priorité est donnée aux élèves tutsi pour en faire des fonctionnaires tandis que les Hutu seront systématiquement orientés vers les tâches manuelles. Les colons belges introduisent une ségrégation sociale basée sur l'ethnie.
La « révolution » de 1959
En 1957 le Manifeste des Bahutu paraît. Il réclame la justice sociale et dénonce la situation de discrimination que vivent les Hutu. Cette critique s'intègre dans le cadre colonial et d'ethnicisme contre les Tutsi en dénonçant leur caractère allochtone (qui provient d'un endroit différent, a été transporté (s'oppose à autochtone), NDLR). À la suite de cette parution se forme le parti Parmehutu qui sera soutenu par les colonisateurs belges. Ce changement s'explique par leur volonté de maintenir leur influence au moment de l'indépendance du pays en 1962. Les colons évitent ainsi la formation d'une coalition d'intérêts entre Hutu et Tutsi. En effet, Kayibanda, le dirigeant du Parmehutu : « préféra unir les “Hutu” contre les “Tutsi”, plutôt que coaliser les “Hutu” pauvres et les “petits Tutsi” contre les nantis, “Hutu” et “Tutsi” confondus. »3
Une compétition se développe entre les formations hutu pour gagner le leadership, favorisant les discours de haine contre les Tutsi. En 1959, ce qui sera appelé révolution ne sera qu'un immense pogrom sur l'ensemble du pays, poussant des dizaines de milliers de Tutsi à prendre le chemin de l'exil.
Un pouvoir raciste
En 1962, le pays accède à l'indépendance, fortement encadrée, par la Belgique. Kayibanda est le premier président. Il exercera un pouvoir de plus en plus violent, y compris contre des opposants hutu. Sous son règne on assiste à des véritables campagnes d'épuration ethnique dans les écoles et les administrations contre la minorité tutsi. En juillet 1973, Juvénal Habyarimana prend le pouvoir par un coup d'État. À cette même époque, la France, sous l'impulsion de Giscard d'Estaing, prend pied dans le pays et l'intègre dans son pré-carré. Elle apporte au gouvernement une aide financière, diplomatique et surtout militaire.
En 1990, le Front patriotique rwandais (FPR), composé des Tutsi réfugiés en Ouganda mais aussi de quelques opposants hutu, lance une opération pour s'emparer du pouvoir.
Le FPR est décrit par Paris comme une agression ougandaise soutenue par le monde anglo-saxon. La France est partie prenante de cette guerre tout en prônant, au moins officiellement, une solution diplomatique qui prendra corps avec les accords d'Arusha en 1993. Ces derniers prévoient le démantèlement de l'apartheid anti tutsi, le partage du pouvoir et surtout le départ des militaires français. C'est une claque pour les généraux français.
Génocide
Au moins depuis 1990, les extrémistes partisans du « Hutu power » se préparent à l'extermination des Tutsi. Les responsables français ne pouvaient l'ignorer au vu de leur forte présence dans l'appareil sécuritaire rwandais. Cela est d'ailleurs confirmé par le général Jean Varret, ancien chef de la Mission militaire de coopération d'octobre 1990 à avril 1993. Lors de son témoignage à la commission parlementaire, il rapporte les propos du chef d'état-major de la gendarmerie rwandaise : « ils sont très peu nombreux, nous allons les liquider ».
Les milices et les Forces armées rwandaises (FAR) vont procéder à des exécutions de Tutsi en présence de l'armée française. Des témoignages font état de l'appui de militaires français lors des barrages routiers tenus par les miliciens en 1991 : « Je me suis rendu compte que parmi les militaires il y avait des Français qui demandaient aussi les cartes d'identité des Rwandais où figurait la mention « hutu », « tutsi », ou « twa ». Les Tutsi se faisaient sortir de la voiture et les militaires français les remettaient aux mains des miliciens agacés qui les coupaient à coups de machettes et les jetaient dans une rigole au bord de la grande route asphaltée Ruhengeri-Kigali. »4
L'attentat contre l'avion présidentiel, lors duquel Juvénal Habyarimana trouvera la mort, n'a pas été la cause du génocide, tout au plus le déclencheur d'un processus préparé depuis longtemps. Par contre, cet attentat signe le début du coup d'État des extrémistes hutu. Ils liquident les partisans des accords d'Arusha – ainsi Agathe Uwilingiyimana, Première ministre, et Joseph Kavaruganda, président de la Cour constitutionnelle, et bien d'autres, seront assassinés–, ils forment le Gouvernement intérimaire rwandais (GIR), soutenu par la France. Le génocide des Tutsi commence de manière ordonnée et encadrée par les unités des FAR et les milices des Interahamwe.
Le soutien de la France
La France est le seul État à reconnaître le GIR, n'hésitant pas à recevoir ses membres à l'Elysée. Elle met tout son poids diplomatique aux Nations unies pour soutenir ce gouvernement d'extrémistes. Roméo Dallaire, général canadien en charge de la Mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR), tentera désespérément d'alerter la communauté internationale sur les massacres qui se déroulent au pays des mille collines.
Quant à la banque française BNP Paribas, elle autorisera les transferts d'argent pour l'achat d'armes, en plein embargo décrété par l'ONU.
Le Rwanda va connaître trois opérations militaires françaises. La première, Noroît, est déclenchée officiellement pour protéger l'ambassade et les citoyens français suite à l'offensive du FPR en 1990. Dans les faits, cette opération a pour but d'épauler les FAR contre les offensives du FPR. Pendant trois ans, les soldats français vont mener la guerre contre le FPR. Ils participeront aussi à la formation des miliciens5.
La deuxième est l'opération Amaryllis, débutée deux jours après l'attentat contre l'avion présidentiel. Le but est d'exfiltrer les ressortissants français. Elle laissera sur place les Tutsis travaillant pour l'ambassade de France et d'autres agences françaises. La plupart seront assassiné·es. Ce sont les militaires belges de l'opération Silver Back qui embarqueront près de deux cents Rwandais·es, essentiellement Tutsi, refoulé·es par les militaires français tandis que les miliciens entourent l'aéroport.
Enfin, l'opération Turquoise, composée essentiellement d'anciens de Noroît, est présentée comme une opération humanitaire. Elle servira dans un premier temps à tenter de stopper l'offensive du FPR6. Ce qui explique le refus, par cette opération, de sauver les Tutsi sur la colline de Bisero qui faisaient depuis le début du génocide l'objet d'attaques incessantes de la part des génocidaires. C'est seulement sous la pression conjointe de militaires et de journalistes que les officiers daignèrent intervenir. Turquoise est l'occasion pour les génocidaires de mettre en place une stratégie d'exode des populations qui leur offrait le double avantage de fuir sans difficulté face à l'arrivée du FPR et de maintenir les populations sous contrôle dans les camps de réfugiés au Zaïre. C'est à partir de ces camps que des milices sont organisées. Elles bénéficieront du transfert d'armes organisé par l'armée française.7
Cette présence des génocidaires hutu a aussi complétement déstabilisé la région de l'est du Zaïre puisque leur émanation armée, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), provoquent encore maintenant guerres et massacres contre les populations civiles congolaises.
Les dénégations de la France
Les autorités françaises n'ont eu de cesse de nier leurs responsabilités. Elles ont caché la guerre qu'elles menaient contre le FPR lors de l'opération Noroît. Elles ont ensuite tenté de contester le génocide en parlant de massacre interethnique, et lorsque les informations ont commencé à parvenir en France, les autorités ont parlé d'un double génocide, une manière de brouiller les pistes et d'occulter leurs responsabilités dans le soutien au GIR.
Au niveau juridique, avec l'aide du juge Bruguière, elles tenteront d'accréditer l'idée que l'attentat de l'avion présidentiel a été perpétré par le FPR sous le prétexte qu'il considérait les Tutsi comme des « collaborateurs du régime Habyarimana »8. Doit-on rappeler que c'est le FPR qui a mis fin au génocide des Tutsi ?
La France va se draper dans son rôle de sauveuse des vies humaines avec Turquoise. Une façon de faire taire les critiques à l'international en utilisant le fait que le 21 avril 1994, en plein génocide, les Nations unies avaient retiré les Casques bleus. Sauf que la France a aussi voté pour ce retrait. Afin d'éviter de rendre des comptes, les manœuvres au parlement vont bon train. À la demande de la création d'une commission d'enquête parlementaire par les communistes et les Verts, les dirigeant·es socialistes allumeront un contre-feu en créant une commission d'information n'ayant pas les prérogatives d'investigation. Cette commission évitera autant qu'elle le pouvait de poser les questions embarrassantes. Manœuvres également du parquet pour prévenir, en vain, les procès contre des militaires français de Turquoise pour viol, toujours en cours, grâce à la ténacité d'une socialiste et humanitaire, Annie Faure.
Alors que dans la plupart des pays occidentaux, des génocidaires hutu ont été jugés et condamnés, « en France, le premier procès d'un homme accusé d'avoir participé au génocide n'a eu lieu qu'en… 2014 »9.Rappelons que la femme de Juvénal Habyarimana, une des ferventes partisanes du « Hutu power », vit en France. Mitterrand disait d'elle lors de son exfiltration par l'opération Turquoise : « elle a le diable au corps, elle veut faire des appels publics à la continuation des massacres. ». Cela n'empêchera pas le ministère de la coopération de lui verser 200 000 francs lors de son installation et surtout qu'elle ne soit nullement inquiétée par la justice. Il faudra les actions du Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR) pour que des génocidaires soient démasqués et enfin jugés.
Deux questions
Pourquoi la France s'est-elle tant impliquée au Rwanda ? il n'y a pas de réponse unique. On peut évoquer : le dessein d'être présent dans ce pays comme point d'appui à la politique de contrôle de la République démocratique du Congo (RDC), une volonté d'affirmation de la France vis-à-vis de ses partenaires anglo-saxons suite à la chute du mur de Berlin, la méconnaissance de l'histoire du pays. Védrine secrétaire général de l'Elysée comparait le pogrome de 1959 à la révolution française en parlant de « sans-culotte hutu »10. Il y a aussi l'exigence de montrer aux autres dictateurs africains du pré-carré que la France ne les abandonnait pas. Et, sur le plan personnel, Mitterrand appréciait Habyarimana pour sa francophilie. Les fils des deux présidents ont noué une amitié, Jean-Christophe Mitterrand était alors le conseiller Afrique de l'Elysée.
Comment la France a-t-elle pu être complice d'un génocide ? La présence de la France en Afrique est considérée comme allant de soi par la classe politique. Certes il y a des vues différentes mais l'idée dominante est que le passé partagé avec l'Afrique – du fait de la colonisation – impliquerait une responsabilité particulière, voire un avenir commun. C'est sur ce socle consensuel que toutes les dérives de la politique française en Afrique ont pu prospérer. D'autant qu'au-delà de ce consensus il n'y a ni information, comme on l'a vu avec l'opération Noroît au Rwanda, ni à fortiori de contre-pouvoir. Tout se décide au sein d'un cénacle de quelques personnes à l'Elysée.
Lorsque Habyarimana va demander de l'aide à la France, les soldats français vont être entraînés dans une dynamique de guerre. De la formation et l'encadrement ils seront rapidement sur le front au coté des FAR. L'idéologie anti FPR se diffuse chez les officiers supérieurs français. Les termes khmers noirs, agents de l'Ouganda ou tutsi seront utilisés pour désigner le FPR. La DGSE et même la Direction du renseignement militaire avertiront l'Élysée des massacres perpétrés contre les Tutsi. Mais dans la tradition des interventions françaises, les violations des droits humains sont monnaie courante pour soutenir les dictatures africaines ou les coups d'État. Sauf que là « la France s'intègre dans le mécanisme génocidaire parce qu'elle soutient le régime qui organise l'élimination de la minorité tutsi » et Vincent Duclert, président de la Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi, ajoute : « ce soutien inconditionnel au pouvoir d'Habyarimana, c'est même, je dirais, le principal accélérateur du processus génocidaire »11. Ce constat sans appel est une puissante condamnation de la politique africaine de la France qui, malgré ce drame, demeure inchangée.
Paul Martial
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Burkina Faso : Déclaration sur la situation nationale

C'est avec une profonde affliction que nos organisations font l'amer constat de ce que la situation nationale reste indéniablement marquée par la crise sécuritaire imposée à notre pays, avec son lot de drames et de désolation.
Tiré du site du CADTM.
Au cours de ces trois derniers mois, nous avons à nouveau, enregistré de nombreux blessés et perdu des éléments de nos Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi que des civils, lâchement tués par des hordes sauvages qui écument nos villes et campagnes depuis bientôt une dizaine d'années.
Récemment encore, au cours du week-end du 24 au 25 février 2024 notamment, dans ses régions du nord et de l'est, notre pays a été endeuillé par des tueries à très grande échelle ayant occasionné des centaines de morts d'éléments des FDS, de VDP ainsi que de très nombreuses populations civiles. Plusieurs autres attaques ont été, par la suite, notées par nos organisations ; ce qui dénote du caractère délétère de la situation sécuritaire actuelle de notre pays.
En ces moments extrêmement douloureux et préoccupants pour la nation entière, nos organisations saluent respectueusement la mémoire des victimes, présentent leurs condoléances aux familles des disparus et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Elles encouragent les FDS et les VDP qui, au prix d'énormes sacrifices, assurent la sécurité des Burkinabè.
Ces dures épreuves ne devraient en aucun cas émousser l'esprit de résilience, à fortiori entamer l'engagement du peuple burkinabè à vaincre l'hydre terroriste qui, voilà bientôt dix ans, endeuille nos villes et campagnes.
Hélas, alors qu'elle constitue une condition sine qua-non pour la victoire contre les forces du mal, la cohésion nationale tant souhaitée par les burkinabè est quotidiennement mise à rude épreuve par des actes de gouvernance sociopolitique négatifs, en total déphasage avec cette nécessité de l'heure.
En effet, le constat fait de la division systématique des burkinabè en deux catégories (les « patriotes » et les « apatrides ») constitue l'autre élément de préoccupation majeure du moment. Une division stigmatisante, généralement sous-tendue par des menaces de toute nature proférées par des groupuscules instrumentalisés, des arrestations et détentions arbitraires, des enrôlements forcés à des fins de traitements inhumains et dégradants de toute voix émettant une opinion critique négative sur la gestion actuelle du pouvoir d'Etat.
Aujourd'hui encore, il est ainsi loisible de constater qu'à la suite de la décision du tribunal administratif de Ouagadougou en date du 06 décembre 2023 (suspendant l'ordre de réquisition de Rasmané ZINABA, Bassirou BADJO et Issaka LINGANI), les ordres de réquisition jadis servis à la tête du client, semblent avoir fait place à une pratique tout aussi nocive et dangereuse qui a cours et s'amplifie en ces moments : celle d'arrestations de citoyens (parfois en pleine rue) par des individus vêtus de tenues civiles, encagoulés ou se présentant à visage découvert comme étant des éléments de Forces de sécurité intérieure (FSI).
S'opérant au mépris de toute procédure régulière prescrite par les lois et règlements de la République, ces pratiques ne constituent ni plus, ni moins, que des enlèvements, ainsi que les qualifient à juste titre nos organisations et l'opinion publique nationale et internationale.
En rappel, l'article 3 de la Constitution du Burkina Faso dispose que « nul ne peut être privé de sa liberté, s'il n'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi » et que, « nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de la loi ».
Or, les personnes enlevées le sont généralement sans motif officiel déclaré et sont détenues dans des lieux tenus secrets par leurs ravisseurs.
Il souviendra à tous les Burkinabè que, le vendredi 21 octobre 2022, devant les membres du Conseil constitutionnel, le Chef de l'Etat a solennellement pris l'engagement de respecter et de faire respecter la Constitution, en jurant devant le peuple burkinabè et sur son honneur, « de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois. De tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».
Bien qu'ayant été récemment révisée, notre Constitution n'a ni modifié, à fortiori retiré les dispositions de l'article 3 sus-citées de son corpus. Ces dispositions continuent donc de proscrire les violations des libertés individuelles et collectives, les arrestations arbitraires, les enlèvements et autres disparitions forcées.
De ce fait, il apparait impératif que soit respecté le serment du Chef de l'Etat, au nom des principes de l'Etat de droit, et que cessent ces enlèvements de citoyens burkinabè en totale violation de notre Constitution et des lois de la République.
De la longue liste de personnes (anonymes et connues, dont l'expert en sécurité informatique Younoussa SANFO) ainsi enlevées, nos organisations avaient, dans un communiqué publié le 29 janvier 2024 suite à la tentative d'enlèvement de Moussa DIALLO, Secrétaire général de la CGT-B, cité quelques noms, dont ceux de :
– El hadj Mahamoudou DIALLO, Imam de la mosquée de Sikassossira,
– Anselme KAMBOU, opérateur économique ;
– Wahabou DRABO, ministre des sports sous le MPSR I ;
– Docteur Daouda DIALLO secrétaire exécutif du CISC ;
– Idrissa KABORE, habitant à Pouytenga ;
– Docteur Ablassé OUÉDRAOGO, président du parti Le Faso Autrement ;
– Lamine OUATTARA du MBDHP ;
– Maître Guy Hervé KAM, avocat à la cour et coordonnateur du mouvement SENS.
Depuis, les agents commis aux enlèvements et arrestations arbitraires ont allongé cette liste, avec l'enlèvement de Rasmané ZINABA et de Bassirou BADJO, respectivement les 20 et 21 février 2024 et l'arrestation, le 19 mars 2024, de Gérard Ismaël SANOU, Secrétaire général du Mouvement Sauvons la Kossi (MSK).
Ces commis aux enlèvements semblent également avoir dorénavant mis le cap sur les campus universitaires de Ouagadougou avec l'enlèvement, fin janvier 2024, de Issaka OUEDRAOGO, Alexis NACOULMA, Ousmane TOU et Seydou SAWADOGO, et ceux de Paul DAMIBA et Hamidou SAVADOGO, tous deux délégués de promotion à l'UFR/SVT, mi-février 2024.
A ces enlèvements récurrents s'ajoute la défiance ouverte de l'Autorité judiciaire par les tenants actuels du pouvoir, avec le refus d'exécuter des décisions de justice, comme celles ordonnant d'une part, la suspension de l'ordre de réquisition de Rasmané ZINABA, Bassirou BADJO et Issaka LINGANI et d'autre part, la libération de Anselme KAMBOU et de Maître Guy Hervé KAM.
Il est temps que cela cesse ! Car, quand bien même serions-nous en situation de guerre, il importe de ne point en tirer prétexte mais plutôt, de veiller à ce que ne soient point remis au goût du jour, les pratiques des régimes d'exception d'antan, contre lesquelles le peuple burkinabè s'est vaillamment battu.
Avec de telles pratiques, suscitant rancœurs et aiguisant des sentiments de haine et de vengeance, les appels à l'union des forces des filles et fils du Burkina pour lutter contre le terrorisme risquent hélas d'être et de demeurer vains.
C'est pourquoi, nos organisations, tout en réitérant leur ferme condamnation des attaques terroristes, lâches et barbares contre notre peuple :
1) Dénoncent et condamnent la pratique des enlèvements de citoyens, qui ouvre la voie à toutes les dérives possibles ;
2) Appellent instamment le gouvernement à :
– respecter et faire respecter l'ensemble des dispositions de la Constitution, ainsi que le Chef de l'Etat lui-même en a pris l'engagement lors de sa prestation de serment, le 21 octobre 2022 ;
– faire procéder à la libération sans délai ni condition de toute personne illégalement arrêtée et arbitrairement détenue au regard de la loi ;
– faire proscrire définitivement la pratique des enlèvements de citoyens et de leur détention illégale ;
– asseoir une stratégie de lutte antiterroriste qui favorise une large adhésion et une implication effective et efficiente des populations sur l'ensemble du territoire national ;
– veiller, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, à conformer les pratiques des Forces de défense et de sécurité aux principes des droits humains et aux règles de l'Etat de droit, afin de favoriser la nécessaire collaboration des populations, pour la victoire et la reconquête totale du territoire national ;
– prendre des mesures spéciales et rigoureuses de protection des populations civiles, aussi bien contre les attaques des groupes terroristes que contre toutes dérives de FDS et/ou de VDP.
3) Encouragent fortement la Justice à enregistrer et traiter sans faiblesse, toute plainte pour enlèvement et détention arbitraire de citoyens ;
4) Appellent à nouveau leurs militants et sympathisants, ainsi que toute personne soucieuse du respect des droits humains à se mobiliser contre les enlèvements, détentions arbitraires et disparitions forcées de citoyens et pour la préservation des libertés démocratiques chèrement acquises.
• Non au terrorisme, source de violations des droits humains !
• Pour la mise en œuvre d'une politique intelligente et responsable de lutte contre le terrorisme, mobilisation et lutte !
Ouagadougou, le 27 mars 2024
Ont signé
– Association des Journalistes du Burkina (AJB)
– Association Kébayina des femmes du Burkina
– Balai Citoyen
– Coalition Nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés – Section de Ouagadougou (CCVC/Ouaga)
– Comité de Défense et d'Approfondissement des Acquis de l'Insurrection Populaire (CDAIP)
– Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD)
– Centre d'Information et de Documentations Citoyennes (CIDOC)
– Collectif contre l'Impunité et la Stigmatisation des Communautés (CISC)
– Centre National de Presse Norbert ZONGO (CNP/NZ)
– Mouvement Burkinabè des Droits de l'Homme et des Peuples (MBDHP)
– Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une nouvelle organisation socialiste en Afrique du Sud

120 délégués se sont réunis à l'Université de Wits du 14 au 17 décembre 2023 pour lancer Zabalaza for Socialism (ZASO, Zabalaza signifie lutte), une organisation écosocialiste, féministe et antiraciste.
Tiré de Inprecor 719 - avril 2024
26 mars 2024
Par Inprecor
Les militant·es qui s'étaient regroupé·es au sein de Dialogues for an Anti-Capitalist Future – après la dégénérescence politique du « NUMSA Moment » (une opportunité pour un large regroupement de la gauche suite à l'expulsion du NUMSA, le syndicat de gauche National Union of Metalworkers of South Africa, du COSATU, le Congrès des syndicats sud-africains, et la décision du NUMSA d'explorer la construction d'un mouvement pour le socialisme avec d'autres forces de gauche) – ont pris l'initiative audacieuse de lancer une organisation révolutionnaire. La majorité des délégués provenaient de divers syndicats et mouvements sociaux, ce qui a permis à la ZASO d'avoir une base solide dans le mouvement populaire. La ZASO a été renforcée par l'implication d'un certain nombre d'activistes érudits ayant une longue expérience de la politique de gauche.
Le lancement de ZASO a lieu à un moment très difficile pour la gauche fragmentée en Afrique du Sud. À la veille de célébrer 30 ans de démocratie, le pays s'effondre sous l'impact de l'austérité, de la privatisation et d'autres politiques néolibérales, ainsi que de la corruption systémique. Le 29 mai, des élections nationales et provinciales doivent avoir lieu sans qu'aucun parti de gauche crédible ne soit en lice.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au Chili, « le décrochage est total au sein des classes populaires »

À mi-mandat, le président Gabriel Boric n'a pas encore été en mesure de mener les profondes réformes attendues, nous explique Franck Gaudichaud, spécialiste de l'Amérique latine. À la tête de l'État depuis mars 2022 et élu avec l'espoir de réorienter son pays sur la voie du progressisme, le jeune président Gabriel Boric (38 ans) semble plutôt avoir recentré sa politique, incapable de faire le poids face au bloc conservateur ni de fédérer la gauche autour de son gouvernement.
28 mars 2024 | tiré du journal l'humanité.fr
https://www.humanite.fr/monde/chili/au-chili-le-decrochage-est-total-au-sein-des-classes-populaires
Luis Reygada : À mi-mandat, quel est le bilan de celui qui avait promis de « rouvrir les grandes avenues » du président socialiste Salvador Allende ?
Franck Gaudichaud : Gabriel Boric est arrivé au pouvoir en incarnant l'espoir d'un tournant postnéolibéral, dans un contexte très particulier puisqu'il fait suite à l'explosion sociale de 2019. Il était porté par des demandes très fortes, sociales notamment, et à la tête d'une coalition incluant des partis bien plus à gauche que lui (comme le Parti communiste chilien) et fondamentalement critique des vingt années de gouvernement de la période post-dictature, la Concertation (entre 1990 et 2010), marquée par des compromissions, voire une gestion néolibérale du pouvoir par les gouvernements de gauche durant cette période.
Boric arrive donc avec des promesses de réformes profondes dans un pays où le privé représentait le socle structurant de la société, avec une mainmise sur d'amples secteurs largement libéralisés (éducation, santé, retraites, etc.). De façon générale, c'est donc l'espoir d'un « nouveau Chili » dans lequel le public réussirait à reprendre le dessus sur les forces du marché que Boric avait laissé entrevoir. Sur tous ces aspects, le bilan est extrêmement décevant.
Luis Reygada : Faute de majorité au Congrès ?
Franck Gaudichaud : Oui mais pas seulement. Le gouvernement n'est pas en position de force au sein des institutions, il doit donc négocier en permanence et a fini par gouverner à « l'extrême-centre », en réintégrant y compris des figures centrales du PS au pouvoir. Le président n'a pas su tirer profit de la lune de miel des six premiers mois de son mandat : il a tout misé sur l'approbation du premier projet de Constitution pour consolider une dynamique politique d'orientation progressiste. Son rejet (à 62 %, en septembre 2022 – NDLR) a été une douche froide. Cette défaite a fait du mal à l'ensemble de la gauche et aux mouvements sociaux, ceux-ci sont d'ailleurs aujourd'hui à la peine après un long cycle électoral assez chaotique qui a débouché sur un second processus constituant, dominé par l'extrême droite. Ce second projet constitutionnel a finalement aussi été rejeté – par plus de 55 % des votants. Le gouvernement est apparu comme neutralisé, incapable de reprendre l'initiative politique.
Par ailleurs, le manque de capacité à mobiliser les bases sociales et les mouvements sociaux fait que le gouvernement ne compte pas sur un soutien large et structuré qui lui permette de faire le poids face aux forces de l'opposition. Encore moins de défier l'oligarchie chilienne, qui elle peut compter sur les partis les plus conservateurs et traditionnels pour représenter ses intérêts.
Luis Reygada : Des avancées ont tout de même été réalisées, et les sondages donnent au président un taux d'approbation entre 26 et 30 % ?
Franck Gaudichaud : Tout à fait, ce qui est plus que ses prédécesseurs. Au bout de deux ans, il peut toujours compter sur un socle et il est indéniable qu'il dispose d'un certain ancrage au sein des classes moyennes progressistes diplômées. Mais le décrochage est total au sein des classes populaires.
Il y a eu des avancées en matière sociale (baisse à quarante heures de la durée hebdomadaire du travail, mais avec de nouvelles flexibilisations du travail, hausse des salaires minimums, accès à la santé primaire gratuite facilité…) mais les grandes réformes structurelles (notamment fiscale) n'ont pu voir le jour, et le cadre dominant reste totalement capitaliste et dominé par la même oligarchie. La déception est très grande et renforce l'extrême droite.
Luis Reygada : Une montée aussi favorisée par un contexte sécuritaire défavorable, avec une hausse de la criminalité ?
Franck Gaudichaud : Il est vrai que, en à peu près six ans, le Chili a vu multiplier par deux son taux de crimes les plus violents, avec une claire intensification de l'activité des groupes liés aux cartels de la drogue (comme le cartel vénézuélien nommé « El tren de Aragua »). Cette violence, parfois tristement spectaculaire, frappe beaucoup les couches populaires et moyennes. Toutefois, les chiffres montrent une légère amélioration depuis quelques mois, et nous sommes là face à un autre problème difficile à surmonter, aiguisé par la capacité des médias dominants à imposer dans le débat public les thématiques sécuritaires, sous un angle défavorable à la gauche.
Pour autant, la réponse de Boric au problème de la violence des cartels a aussi beaucoup déçu parmi les siens. La réforme du corps des carabiniers, responsable de graves violations des droits humains notamment en 2019, n'a jamais eu lieu. Boric avait toujours refusé de militariser la question de l'ordre public, c'est désormais chose faite, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, mais aussi du conflit avec le peuple Mapuche, dans le Sud du pays. Il y a là un vrai problème de politique publique au sujet d'une thématique bien plus facile à gérer pour l'extrême droite, qui prône évidemment une militarisation à tout-va, appuyée sur un discours xénophobe et raciste.
Luis Reygada : Nous sommes bien loin du président « de gauche radicale » que la droite aime présenter ?
Franck Gaudichaud : Le président Boric s'est toujours montré disposé à dialoguer, voire à chercher à créer une certaine unité nationale, comme on a pu le voir lors de la commémoration des cinquante ans du coup d'État de 1973. Une stratégie peu payante quand on a affaire à une droite qui n'en veut pas, qui continue à revendiquer – au moins en partie – l'héritage de la dictature, qui s'oppose systématiquement à tout compromis et cherche, au contraire, à « hystériser » en permanence tout débat politique, en pointant par exemple du doigt l'aile gauche du gouvernement dans un pays où l'anticommunisme primaire reste présent. Le récent décès accidentel de l'ex-président Sebastian Piñera, l'un des responsables de la répression de la révolte de 2019, et la façon dont Boric a malgré tout mis en avant sa figure « républicaine », a aussi étonné ou même choqué une partie de sa base militante.
Dans les faits, le président Boric a multiplié les gestes symboliques qui ont montré une évolution de son positionnement idéologique, au point de revendiquer récemment l'héritage du président démocrate-chrétien Patricio Aylwin (1990-1994), figure majeure de l'époque de la transition dans les années 90.
Boric s'était pourtant construit politiquement en opposition à cette période historique. À ce jour, nous pouvons dire que son mandat s'inscrit plus dans une continuité de ce qu'a représenté l'époque de la transition et ses « consensus ». À cinquante ans du coup d'Etat, si l'on doit faire une comparaison, c'est plus à Michelle Bachelet que son administration pourrait ressembler plutôt qu'à celle du gouvernement de l'Unité populaire des années 1970.

Contre le coup d’État judiciaire à Porto Rico, laissez le peuple décider dans les urnes !

Jeudi dernier, le 21 mars, un tribunal de Porto Rico a disqualifié cinq candidatures nationales du Mouvement pour la victoire des citoyens, qui briguent toutes des postes de premier plan au sein du gouvernement et du corps législatif. Trois d'entre eux sont des députés en exercice de l'assemblée législative de Porto Rico. Toutes ces candidatures avaient été certifiées par la commission électorale de l'État de Porto Rico.
Inprecor 719 - avril 2024
26 mars 2024
Par Democracia Socialista de Puerto Rico
Cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale visant à faire échouer Alianza País, une union de forces électorales progressistes qui a menacé la domination des partis néolibéraux qui ont gouverné au cours des six dernières décennies, à savoir le Parti démocratique populaire et le Nouveau parti progressiste.
Cette disqualification est l'attaque la plus récente et la plus forte d'un processus qui a inclus l'imposition d'un nouveau code électoral antidémocratique, l'illégalisation des alliances électorales et une campagne judiciaire contre l'un des députés sortants du Mouvement à la Chambre des représentants.
Ceux d'entre nous qui signent cette déclaration s'opposent à ce coup d'État judiciaire qui attaque les processus démocratiques à Porto Rico et qui s'inscrit dans le cadre des attaques des forces conservatrices contre les processus démocratiques dans la région. C'est le peuple portoricain lui-même qui doit élire ses représentants, et non la Cour. Pour ces raisons, nous nous joignons à la demande « Laissez le peuple décider dans les urnes » et exigeons que la disqualification de ces cinq candidats soit annulée.
Partagez cette pétition en personne ou ajoutez le code QR aux supports que vous imprimez.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des députés et des pairs signent une lettre demandant au gouvernement britannique d’interdire les ventes d’armes à Israël

Les ministres sont de plus en plus pressés d'agir, alors qu'Israël semble vouloir ignorer la résolution de l'ONU sur le cessez-le-feu
28 mars 2024 | tiré du journal The Guardian
https://www.france-palestine.org/Des-deputes-et-des-pairs-signent-une-lettre-demandant-au-gouvernement
Les parlementaires font pression sur le gouvernement britannique pour qu'il interdise les ventes d'armes à Israël, alors que ce pays semble vouloir ignorer la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée cette semaine et appelant toutes les parties à s'engager en faveur d'un cessez-le-feu.
Une lettre signée par plus de 130 parlementaires et adressée au ministre des Affaires étrangères, David Cameron, souligne les mesures prises par d'autres pays, dont le plus récent est le Canada, qui a annoncé la semaine dernière qu'il mettrait fin à toutes ses exportations d'armes vers Israël.
Les ministres sont déjà confrontés aux appels du ministre fantôme des affaires étrangères, David Lammy, à publier l'avis juridique donné aux ministres sur la question de savoir s'il existe un risque sérieux qu'Israël viole le droit humanitaire international, ce qui déclencherait normalement une suspension des ventes d'armes au Royaume-Uni.
La lettre, coordonnée par la députée travailliste Zarah Sultana, a été signée par 107 députés et 27 pairs, dont l'ancien ministre travailliste du Moyen-Orient Peter Hain, le chef du parti national écossais à Westminster, Stephen Flynn, l'ancien ministre fantôme Jess Phillips, l'ancien leader travailliste Jeremy Corbyn et le pair conservateur Nosheena Mobarik.
Parmi les autres signataires figurent l'ancien secrétaire permanent du ministère des affaires étrangères, John Kerr, et l'ancienne ministre travailliste, Tessa Blackstone. Au total, 46 députés travaillistes ont soutenu l'appel, ainsi que la quasi-totalité du parti parlementaire SNP.
La lettre affirme que le statu quo en matière d'exportations d'armes britanniques vers Israël est "totalement inacceptable". Elle affirme que des armes fabriquées au Royaume-Uni sont utilisées à Gaza et rappelle qu'une récente enquête des Nations unies a révélé qu'un avion de chasse F-16 fabriqué à partir de pièces britanniques était probablement à l'origine du bombardement de médecins britanniques à Gaza.
Lors de deux précédentes escalades du conflit à Gaza, les gouvernements britanniques ont suspendu les ventes d'armes à Israël. "Aujourd'hui, l'ampleur des violences commises par l'armée israélienne est bien plus meurtrière, mais le gouvernement britannique n'a pas agi.
Cette lettre fait suite au vote surprise du Conseil de sécurité des Nations unies, lundi, en faveur d'une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, une demande fermement rejetée par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a annulé la visite prévue d'une délégation israélienne à Washington en réponse à l'abstention des États-Unis sur la résolution. Les attaques sur Rafah se sont poursuivies.Les États-Unis ont déclaré que la résolution n'était pas contraignante, mais le Royaume-Uni ne partage pas cette interprétation.
M. Cameron a intensifié ses critiques à l'égard d'Israël ces dernières semaines, mais les ministres affirment qu'une décision sur les ventes d'armes est une décision juridique complexe qui tient compte d'une série de facteurs, notamment des efforts déployés par Israël pour minimiser les pertes civiles. Certaines des critiques du ministre des affaires étrangères ont suggéré implicitement qu'Israël, en tant que puissance occupante, ne respecte pas l'obligation qui lui incombe en vertu du droit international de fournir de la nourriture et de l'eau aux civils palestiniens.
Un nombre croissant d'organisations de défense des droits humains et d'organisations humanitaires ont également demandé la suspension des licences d'armement, notamment Oxfam, Save the Children, Christian Aid, Amnesty International et Islamic Relief.Mme Sultana a déclaré "Le gouvernement israélien semble ignorer la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur le cessez-le-feu, ce qui constitue une nouvelle violation du droit international et rend impossible d'ignorer la nécessité de mettre un terme aux ventes d'armes.
"Le gouvernement britannique doit enfin faire respecter les droits du peuple palestinien, tenir compte de l'appel de 130 parlementaires de tous bords et mettre immédiatement fin aux ventes d'armes à Israël.
Katie Fallon, responsable du plaidoyer à Campaign Against the Arms Trade (Campagne contre la vente d'armes), a déclaré que la réponse du gouvernement à l'interdiction des ventes d'armes "allait de l'obstruction des députés à la répétition de réponses dénuées de sens et, ce qui est le plus inquiétant, à des efforts considérables pour s'assurer que les conseils juridiques du ministère des Affaires étrangères n'admettent jamais définitivement qu'il existe un "risque clair" qu'Israël utilise ces exportations d'armes dans le cadre d'une violation grave du droit humanitaire international".
Par ailleurs, une demande de contrôle judiciaire a été déposée concernant la décision du Royaume-Uni de suspendre son financement à l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Le recours a été lancé par le cabinet d'avocats Bindmans au nom d'un Britannique d'origine palestinienne, dans le but de protéger sa famille constituée de réfugiés enregistrés auprès de l'UNRWA.
Le recours juridique allègue que la décision de suspension a été prise de manière illogique et sans tenir compte des preuves, des obligations internationales ou des cadres décisionnels du ministère des Affaires étrangères.Le Royaume-Uni a suspendu son financement à la suite d'allégations selon lesquelles une douzaine de membres du personnel de l'UNRWA auraient participé à l'assaut sanglant contre Israël le 7 octobre.
Les ministres ont déclaré qu'ils attendaient deux rapports indépendants avant de prendre une décision sur le rétablissement du financement. De nombreux autres pays, dont l'Australie et le Canada, ont déjà rétabli leur financement.
Traduction : AFPS

Attaque terroriste à Moscou : Quand la réaction du gouvernement est plus effrayante que l’attaque terroriste elle-même

Le 22 mars, l'un des pires attentats terroristes de l'histoire de la Russie moderne a été perpétré à l'hôtel de ville Crocus de Moscou : plusieurs hommes armés ont pris d'assaut le bâtiment et ont tiré à bout portant sur une foule de civils. À 16 heures, le 23 mars, les autorités russes faisaient état de 133 morts et de plus de 100 blessés. Nous présentons nos condoléances à toutes les victimes et à leurs proches. Des civils innocents ne devraient pas devenir la cible de la violence politique.
Tiré de Inprecor 719 - avril 2024
27 mars 2024
Par Posle
Intérieur de l'amphithéâtre russe Crocus City Hall, au lendemain de l'attentat terroriste du 22 mars 2024. © Mosreg.ru, CC BY 4.0
Malgré de nombreuses spéculations sur l'implication de fondamentalistes islamiques, nous ne savons toujours pas avec certitude qui sont les auteurs de l'attentat, ni qui en est à l'origine. Toutefois, certaines conclusions peuvent d'ores et déjà être tirées. Tout d'abord, l'attaque terroriste a manifestement pris les autorités russes par surprise.
Récemment encore, Vladimir Poutine qualifiait de « provocation » les mises en garde des services de renseignement occidentaux contre d'éventuelles attaques terroristes dans les villes russes. Le contact direct entre les services de renseignement de la Russie et des pays occidentaux ayant été rompu, et les avertissements publics ayant été ignorés par les autorités russes pour des raisons clairement politiques (des informations sur l'imminence d'attaques terroristes ont été publiées peu avant l'élection présidentielle), le risque d'autres tragédies s'accroît. Les autorités russes attendent de leurs propres citoyens qu'ils paient le prix de la vision conspirationniste du monde du gouvernement et de sa méfiance à l'égard de tout service de renseignement étranger.
Deuxièmement, la capacité de l'État russe est à nouveau remise en question. Elle a été mise à rude épreuve pour la première fois il y a six mois, lors de la mutinerie de Prigozhin. Il s'est avéré que les services spéciaux les plus puissants, dans une ville truffée de caméras vidéo, ont été non seulement incapables d'empêcher ce crime odieux, mais qu'ils ont à peine réussi à en attraper les auteurs. Fait symptomatique, la veille de l'attentat, l'organisme russe de surveillance financière Rosfinmonitoring a ajouté l'inexistant « mouvement public international LGBT » à sa liste de « terroristes et d'extrémistes ». Lorsque la lutte contre des ennemis imaginaires prime, il est trop facile de négliger la véritable menace.
Troisièmement, l'État russe, comme toujours, tentera de tirer profit de cette situation, et c'est pourquoi la réaction de l'État peut être plus effrayante que l'attaque terroriste elle-même. Les députés de la Douma d'État, les Z-blogueurs pro-guerre et l'ancien président de la Russie Dmitri Medvedev demandent déjà la levée du moratoire sur la peine de mort pour les terroristes (que, rappelons-le, l'État russe qualifie également d'opposants pacifiques au régime, notamment Boris Kagarlitsky). Vladimir Poutine n'est pas pressé de reconnaître l'implication des islamistes dans l'attaque terroriste, mais il a déjà détecté une « trace ukrainienne ». Il ne fait aucun doute que l'attentat terroriste sera utilisé pour justifier de nouvelles mesures de répression, l'adoption de nouvelles lois répressives, l'escalade de la violence en Ukraine et, éventuellement, une nouvelle vague de mobilisation.
Cette attaque terroriste n'est pas la première du genre : on se souvient des attentats à la bombe contre des appartements en 1999 ou du siège de l'école de Beslan en 2004. Mais il y a une différence importante : le degré de violence sans précédent dans lequel la société russe a été plongée avec la guerre en Ukraine. Les médias ont déjà rapporté que l'auteur présumé de l'attaque terroriste s'était fait couper l'oreille par les forces de sécurité russes et qu'il avait été contraint de la manger. Les partisans de la droite, toutes tendances confondues, ont déjà commencé à utiliser une rhétorique anti-migrants et islamophobe dans le contexte de l'attaque terroriste. Le régime russe, qui a ouvert la boîte de Pandore d'une violence sans précédent en lançant une invasion totale de l'Ukraine, peut-il la maîtriser ? Étant donné l'incapacité des services de sécurité à prévenir l'attaque terroriste, il y a de fortes raisons d'en douter.
23 mars 2024
Source : Posle.media.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
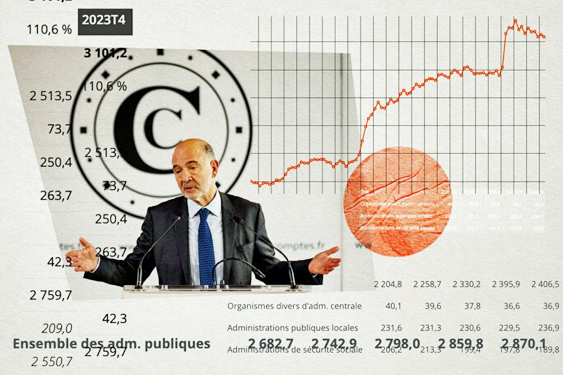
France - Le récit de la peur de la dette sert la destruction de l’État social
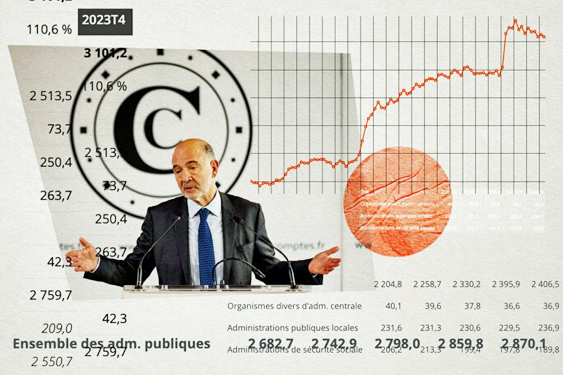
L'annonce d'un déficit public plus élevé que prévu a intensifié le discours lancé voici quelques semaines sur la menace de la dette. Ce récit a pour principale fonction de justifier l'austérité future en préservant les transferts vers le secteur privé.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
27 mars 2024
Par Romaric Godin
C'est une pièce de théâtre sans cesse rejouée dans le spectacle général de l'économie. À intervalles réguliers, un placard s'ouvre et un ministre des finances découvre avec horreur l'existence de titres de dettes qu'il a lui-même placés dans le meuble. S'ensuit une panique générale bien rodée où les portes claquent et où chacun vient crier à la faillite, appeler à la responsabilité, menacer d'une attaque des marchés financiers.
Chacun alors appelle à la baisse de la dépense publique et à l'austérité « pour sauver le pays ». D'ailleurs, voici un employé de bureau du ministère qui se présente avec une pile d'études économiques fort sérieuses montrant que l'austérité renforce « la croissance structurelle ». Contre les populismes, la raison commande de couper dans les dépenses.
La scène se poursuit par un régime d'austérité sévère qui concerne principalement les plus pauvres. La misère croît, le pays voit sa croissance structurelle s'effondrer, et la récession est assurée. Le final est assuré par le même ministre qui jure, la main sur le cœur, qu'on ne l'y prendra plus. Avant de retourner remplir le placard…
La France, en ces premiers mois de 2024, semble être entrée de plain-pied dans ce mauvais vaudeville rejoué cent fois, mais dont les conséquences concrètes sont considérables. Les discours alarmistes sur la dette se multiplient. Comme le souligne auprès de Mediapart Benjamin Lemoine, sociologue et auteur de l'ouvrage L'Ordre de la dette (La Découverte, 2022), « l'effet de surprise politico-médiatique est feint ».
Il rappelle que, « quand les taux d'intérêt étaient au plus bas, grâce à la capacité de la BCE à administrer le marché des emprunts d'État, le souci des pouvoirs publics était la disparition de la dette en tant que problème ». Une fois ce soutien levé, « il convenait de préparer l'opinion à ce qu'on entrevoit aujourd'hui et qui s'apparente à un retour de l'ordre de la dette ». C'est à cette préparation, notamment, que s'attelle Bruno Le Maire depuis plus de trois mois.
Le ministre des finances a en effet ouvert le fameux placard. Soudainement, la dette publique de la France, qu'il a allègrement contribué à creuser à coups de largesses pour le secteur privé, est devenue insoutenable. Et il y a urgence.
Dans son livre-programme titré La Voie française et publié la semaine dernière chez Flammarion, le ministre consacre un chapitre au nécessaire désendettement. Il tente fort maladroitement d'y donner les raisons de l'urgence de la réduction des dépenses. C'est une véritable caverne d'Ali Baba des arguments, allant de la hausse des taux (dont la fin s'annonce en juin prochain) au « déclassement de la France » (avec le recours à des anachronismes grossiers convoquant les trop dépensiers Saint Louis et Louis XIV) en passant par la reine des preuves : la baisse de la croissance.
Depuis que l'on sait que les prévisions de croissance du gouvernement pour 2024 étaient beaucoup trop élevées, la majorité macroniste recourt en permanence à cet argument résumé ainsi par le ministre graphomane dans son livre : « La croissance faible ralentit notre désendettement ; elle doit donc nous amener à trouver dans l'immédiat d'autres leviers pour réduire la dette. »
Le vaudeville se mue alors en un pastiche d'Ubu roi, car réduire les dépenses pour réduire la dette en période de croissance faible, c'est s'assurer d'affaiblir encore davantage la croissance et donc de rendre la dette encore plus difficile à rembourser. La leçon a été clairement montrée au cours de la décennie précédente par la crise de la zone euro.
Bruno Le Maire et les dirigeants d'aujourd'hui étaient alors déjà en vie et actifs. Ils devraient avoir retenu ce fait simple. Mais ils ont désormais une autre histoire à nous raconter, la même, précisément, qu'en 2010-2014, lorsque la croyance dans « l'austérité expansive » proclamée par Jean-Claude Trichet plongeait la zone euro dans une des récessions les plus longues de son histoire.
La réduction en panique de la dette a contribué à alourdir durablement le poids de la dette. Et l'empressement à réduire la dette publique dans la zone euro a-t-il pu améliorer ses capacités à investir dans l'avenir et à construire une économie plus solide et plus durable, comme annoncé ? C'est en fait l'inverse qui a eu lieu.
La Cour des comptes, metteuse en scène du drame de la dette
C'est pourtant ce même récit que l'on retrouve déployé dans l'espace public depuis trois mois. À cet égard, on ne saurait trop sous-estimer le rôle de la Cour des comptes dans la construction de cette narration.
Depuis plusieurs années, l'institution de la rue Cambon s'est muée en gardienne du temple de l'orthodoxie financière. Compte tenu de son indépendance théorique, elle est un point d'appui extrêmement pratique pour construire le récit de panique sur la dette. Elle y joue une partition extrêmement bien rodée pour justifier l'idée d'une dette insoutenable.
Comme son prédécesseur Didier Migaud, le premier président de cette institution, Pierre Moscovici, gestionnaire désastreux pendant son passage à Bercy de 2012 à 2014 (qui avait mené une politique « d'austérité expansive » pendant son mandat, portant la dette publique de 80 à 95 % du PIB), mobilise, lui aussi, les figures classiques de la peur et de la honte pour justifier une politique rapide de désendettement.
Il utilise ainsi la comparaison, éternel levier des politiques néolibérales. Dans un entretien à La Dépêche du 13 mars, le premier président de la Cour des comptes fustige « nos dépenses publiques les plus dégradées de la zone euro ». Puis, il reprend l'argument de l'avenir gâché. Le 12 mars, lors de la présentation du rapport de la Cour sur l'adaptation au dérèglement climatique, il prétendait ainsi que la situation « préoccupante » de nos finances publiques rendrait plus difficile la mobilisation des moyens pour faire face à la crise écologique.
Bref, tout est bon pour justifier la future austérité, même l'injustifiable. Car on voit mal comment on aurait trouvé 20 % du PIB pour faire face au Covid alors que la dette publique était à 100 % du PIB, mais pourquoi on ne parviendrait pas à trouver l'argent nécessaire à l'adaptation climatique avec une dette à 110 % du PIB…
Peurs et tremblements
Une fois posé ce cadre narratif, les médias entrent dans la danse, multipliant les sujets sur la dette, assurant, sondages à l'appui (comme celui publié par La Tribune Dimanche voici dix jours), que la « France a peur » du niveau de la dette et multipliant les titres et textes alarmistes, de la « cure de détox pour notre État drogué à la dette » du Point à la « France au bord du gouffre » de François Lenglet sur TF1.
L'annonce, ce 26 mars, du déficit public pour 2023 à 5,5 %, contre 4,8 % en 2022, est alors traitée comme un choc majeur. Rapidement, un mot s'est imposé à la une des chaînes et des sites d'information : « dérapage ». « Que va faire le gouvernement ? », s'interroge ainsi BFM, alors même que le ratio dette sur PIB a reculé de deux points l'an passé et qu'il n'existe aucune tension sur les marchés financiers.
Peu importe, il faut agir, et vite. Évidemment, Bruno Le Maire sur RTL et Pierre Moscovici sur France Inter viennent renforcer cette idée d'une urgence, reprenant les arguments déjà cités en en ajoutant un dernier : celui de la morale. Car si la dette de la France « dérape », c'est parce que les Français sont nonchalants, incapables de la nécessaire rigueur.
« Nous avons une culture nationale qui fait qu'après les crises, nous ne savons pas réduire assez vite notre dépendance à la dépense », expliquait Pierre Moscovici dans La Dépêche. D'ailleurs, les Français refusent de voir la « vérité » en face, et le premier président de la Cour des comptes demande un « discours de vérité ». Et pour couronner le tout, Bruno Le Maire, lui, affirme que les Français doivent comprendre que « ça ne peut plus être open bar » sur le remboursement des frais médicaux.
Derrière ces leçons de morale, l'idée est bien sûr de préparer les esprits à l'austérité « difficile, mais nécessaire » qui devra frapper ceux qui sont ciblés comme « profiteurs » de la dépense publique. Pour Benjamin Lemoine, « tout est appréhendé à l'aune de la dépense publique et l'on oublie mécaniquement ce qui a produit ce déficit : le discours anti-impôts et la façon dont l'État se fait providence pour le capital ». Une étude de l'Institut de recherches économiques et sociales (Ires) a évalué à près de 200 milliards d'euros par an les aides diverses au secteur privé.
Pour détourner le regard de cette responsabilité, on concentre le problème sur la dépense sociale et les services publics. Ce seraient eux qui seraient responsables du creusement de la dette, et le récit sur la dette permet de justifier à la fois les futures coupes dans les services publics et les transferts sociaux. Ceux-ci ont d'ailleurs déjà commencé avec le coup de rabot de 10 milliards d'euros réalisé en urgence en février et avec les multiples réformes de l'assurance-chômage. Mais plus encore est à venir.
Un final de guerre sociale
Ce récit politique sur la dette, martelé à longueur de temps par le gouvernement, une partie de l'opposition (et désormais même le Rassemblement national) et les « experts », permet avant tout de justifier une politique de classe. On pourrait la résumer ainsi : l'épouvantail de la dette a pour fonction de démanteler ce qui reste de l'État social pour préserver les transferts vers le secteur privé et soutenir sa rentabilité face à une croissance stagnante.
Le spectacle des déplorations sur l'état de la dette publique semble donc venir régler un conflit interne au capital posé par les récents développements économiques sur le dos du monde du travail et des services publics. Benjamin Lemoine insiste sur la pression renaissante des créanciers et du secteur financier. « La qualité d'actifs sans risque n'étant plus explicitement garantie institutionnellement par les rachats de la BCE, il incombe aux gouvernements de rassurer les prêteurs », explique-t-il en résumant : « Si le revolver des maîtres chanteurs de la dette avait été désactivé par ces rachats, il est partiellement réarmé. » Il rappelle que le refinancement sans entraves sur le marché de la dette est « produit politiquement via les promesses de réformes aux investisseurs ».
Mais cette logique vient percuter la situation d'affaiblissement structurel de la croissance et le besoin permanent d'autres secteurs, notamment de l'industrie, de bénéficier de flux publics directs et indirects. Pour régler cette tension, et permettre de satisfaire tous les secteurs du capital, la solution est alors de faire peser l'ordre de la dette sur les dépenses sociales et les services publics. La proposition de hausse de la TVA de Bruno Le Maire pour régler le problème – déjà mise en place sous le quinquennat Hollande – s'inscrit également dans ce cadre de répression sociale.
« Le retour de l'ordre de la dette vient asseoir les inégalités de classes », résume Benjamin Lemoine, qui ajoute : « Il y a un cahier des charges social du maintien de la dette en tant qu'actif sans risques au service des financiers : les plus vulnérables, ceux qui dépendent des services publics, comme les organisations de la main gauche de l'État (santé, éducation, recherche, etc.) sont la variable d'ajustement automatique de cette logique perpétuellement recommencée. »
L'historien de l'économie états-unien Robert Brenner a, dans un article de la New Left Review de 2020, résumé de cette façon ce qu'il pense être un « nouveau régime d'accumulation » et qu'il appelle le « capitalisme politique » par cette formule simple : « la redistribution directe politiquement pilotée de richesse vers le haut pour soutenir des éléments centraux d'une classe capitaliste dominante partiellement transformée ». C'est cette logique qui semble pleinement fonctionner dans le cas français.
« Le maintien de l'ordre de la dette demande un dosage incessant entre le soutien au capital privé et une capacité à assurer sans chocs politiques le service de la dette, et depuis des années cette capacité repose entièrement sur le sacrifice de l'État social », souligne Benjamin Lemoine. Le problème est que cette logique, soutenue par le récit sur la dette, craque de toute part. Non seulement elle ne produit pas de croissance, mais elle affaiblit, par son coût social et environnemental, la capacité de remboursement de la dette. La guerre sociale alimentée par le récit sur la dette est une impasse. Derrière le vaudeville, il y a bien un récit mortifère.
Romaric Godin
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
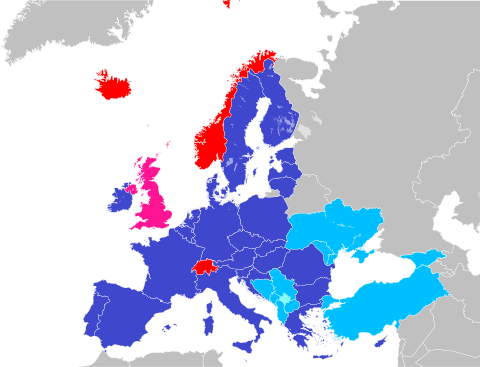
Bruxelles s’inquiète...
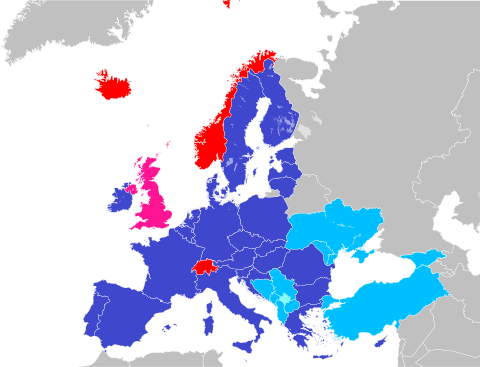
Bruxelles s'inquiète parce que l'instrument favori des bourgeoisies européennes pourrait bien vite ne plus remplir le rôle que peu à peu il a été amené à jouer, à savoir celui de réducteur d'incertitude contrariant l'amplitude de l'oscillation du balancier politique dans les États membres.
Tiré de recherches internationales
Michel Rogalski
* économiste, cnrs ; directeur de la revue recherches internationales.
Au départ simple marché commun favorisant les grands groupes économiques et financiers l'Union européenne s'est vite transformée sous l'empilement de traités successifs, dont la portée était supérieure aux lois nationales, en gangue engluante interdisant toute mise en œuvre de politiques s'écartant du « cercle de la raison ». Les bourgeoisies européennes avaient trouvé là une nouvelle « Sainte alliance » de nature à les protéger de toute secousse politique à même de les menacer. Tout était verrouillé pour que les programmes progressistes et socialement avancés viennent se fracasser sur le mur de l'Europe remplaçant le « Mur d'argent » d'il y a un siècle. Les deux dernières présidentielles françaises ont révélé des questionnements sur la possibilité d'appliquer un programme dans le cadre d'une Union européenne hostile et capable de résister à des changements internes dans un quelconque État
membre. Chaque fois la question du rapport à l'Europe fut posée.
La mise en œuvre d'une véritable alternative de gauche porte en elle les germes d'un affrontement avec le carcan européen constitutionnalisé. Elle est lourde de désobéissances, de résistances, de confrontations, de renégociations. Faut-il plier ou désobéir ? Aucun programme politique de gauche ne sera crédible s'il n'explore pas
cette dimension.
Des précédents avaient de quoi faire réfléchir.
La construction européenne n'a jamais rimé avec démocratie. La campagne sur le Traité constitutionnel européen en 2005 avait déjà désilé les regards. Il ne fut tout simplement pas tenu compte du refus exprimé par référendum par le peuple français auquel on imposa par un vote du Congrès l'adoption du Traité de Lisbonne qui reprenait l'essentiel de ce qui avait été rejeté deux ans plus tôt.
L'enjeu était alors clair. Il s'agissait de constitutionnaliser, c'est-à-dire de graver dans le marbre l'ensemble des traités qui s'étaient empilés au cours de la construction européenne. C'est au refus de ce quitus qu'il convenait de s'attaquer. Quand dix années plus tard, la Grèce s'avise de refuser par référendum les mesures austéritaires proposées par la Troïka (la Banque centrale européenne, la Commission européenne, le FMI) il lui fut répondu par Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne, « qu'il ne pouvait y avoir de choix démocratique contre les traités européens déjà ratifiés » sans qu'aucun chef d'État ne s'en émeuve.
Tout ceci a contribué à une dépolitisation portée par l'illusion de la politique unique entraînant nombre d'électeurs dans la conviction que certes on pouvait changer de gouvernements mais pas des politiques menées. À cela s'ajoute la multiplication des affaires de corruption ayant touché lors de la dernière mandature nombre de députés européens. Sur ce terreau un nationalisme d'extrême droite s'est mis à prospérer à travers le continent et menace désormais les grands équilibres politiques de l'institution européenne. Les sondages prédisent une montée de ces forces permettant aux deux formations qui les représentent – l'ECR et l'ID – d'atteindre chacune une centaine de députés. Si ces deux groupes fusionnaient malgré leurs divergences quant au rapport à la Russie, principal point de discorde, ils formeraient le premier groupe du Parlement européen et pourraient ainsi peser sur la candidature au poste de Commissaire européen dont on connaît l'importance des attributions. Une autre hypothèse fréquemment évoquée envisage la fin de l'actuelle cogestion entre le groupe PPE et le groupe des sociaux-démocrates au profit d'une grande coalition des droites dans laquelle l'extrême droite prendrait une large place, réalisant ce qui s'est déjà produit dans 5 ou 6 États européens. Le débat reste ouvert de savoir pourquoi ce sont ces forces qui ont su labourer les travers de la construction européenne et non pas les forces progressistes.
Bruxelles devrait s'inquiéter car les deux piliers qui ont servi à vendre l'Union européenne ne font plus recette. Il y a longtemps que les discours sur l'Europe censée protéger de la mondialisation ou sur celle devant instiller une dimension sociale font sourire.
La construction européenne présente un cas particulier de la mondialisation. C'est un espace continental où ses formes ont été les plus accentuées et où les traités se sont empilés entraînant chaque fois des délégations de souveraineté : Acte unique, Traité de Maastricht, Pacte de stabilité, le tout repris et rassemblé dans le corset du Traité de Lisbonne et complétés et aggravés par ceux découlant des critères de la gestion de la monnaie unique allant jusqu'à faire obligation aux parlement nationaux à faire viser par la Commission européenne les projets de budgets de chaque pays.
La construction européenne est ainsi devenue le laboratoire de la mondialisation, sa forme la plus avancée et ne peut être considérée comme potentiellement lui être porteuse de résistance. Car elle en réunit tous les ingrédients : marché unique, libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des travailleurs dans un espace où les écarts de salaires s'échelonnent de 1 à 9 et où les normes sociales, fiscales et environnementales sont différentes. Dans un tel espace ce qui s'échange ce ne sont pas des marchandises mais les conditions contextuelles dans lesquelles elles sont produites. Il est vain alors de parler de concurrence libre et non faussée. Les dérives délétères de la mondialisation y ont été multipliées rendant problématiques les conditions de l'exercice de la souveraineté dans cet ensemble européen. On comprend ainsi pourquoi prétendre construire l'Europe pour s'opposer à la mondialisation qu'on n'a pas hésité à présenter comme « heureuse » relève de l'escroquerie et combien il est vain d'espérer que l'Europe sociale vendue dès 1986 par Martine Aubry puisse se réaliser. Il ne s'agissait guère d'autre chose que d'un contre-feu allumé pour sauver l'idée de construction européenne en panne à l'époque. Ce serait l'amplification des « concurrences » qui tirerait les droits sociaux vers le bas et aggraverait les écarts de développement et les nombreuses inégalités sociales et territoriales.
On comprend comment dans un tel contexte les projets d'élargissement de l'UE à 5-6 nouveaux pays membres inquiètent au moment même où l'Europe affiche sa division sur maints problèmes. À l'ancienne division Nord-Sud qui la travaillait vient s'ajouter une opposition Est-Ouest au moment où le couple franco-allemand affiche publiquement ses désaccords sur la conduite de l'assistance à l'Ukraine et où les pays européens se divisent à l'ONU sur le conflit israélo-palestinien. Si l'on ajoute à cela les approches souvent opposées sur le Pacte migratoire en voie d'adoption, la notion d'autonomie stratégique ou la lecture de l'atlantisme, l'élargissement risque de rimer avec ingouvernabilité ou avec dislocation. Conscient de ces obstacles le rapport rédigé par le député Jean-Louis Bourlanges sur les conditions de l'élargissement de l'Europe pose la question des conséquences institutionnelles, c'est-à-dire du mode de gouvernance. La formule d'une « union sans cesse plus étroite entre les peuples européens », reste son mantra.
Pour piloter cet élargissement, il propose « d'étendre le champ d'application du vote à la majorité qualifiée », saut supplémentaire vers une Europe fédérale.
L'Europe ne doit pas être perçue comme une mécanique d'où partiraient oukases et interdits mais bien au contraire comme une structure permissive à même d'accompagner les trajectoires singulières librement choisies de ses États membres. Faute d'une telle orientation l'Europe ne sera plus la solution mais le problème.
Bruxelles devrait s'inquiéter.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En Europe, la colère paysanne explose dans sa diversité

Le début de l'année 2024 a vu des mobilisations agricoles inédites se mettre en place dans tous les pays européens [1]. Morgan Ody, coordinatrice générale de La Via Campesina décrypte la situation.
28 mars 2024 | tiré du site du cadtm par
https://www.cadtm.org/En-Europe-la-colere-paysanne-explose-dans-sa-diversite
Quelle est l'origine de la crise agricole européenne ?
C'est une colère qui vient de très loin. Il faut tout d'abord la raccrocher aux mobilisations agricoles qui ont eu lieu aux Pays-Bas en juin 2022. Ce pays a de gros soucis de nitrates dans le sol depuis des décennies. Le Conseil d'État a imposé de réduire les émissions d'azote. Le plan des autorités néerlandaises, avant d'être abandonné, a suscité une levée de boucliers extrêmement forte dans le monde agricole. Cette situation a profité à un parti agrarien d'extrême droite appelé « BBB », ou Mouvement citoyen-paysan qui est arrivé en tête des élections régionales. Le pays traverse encore une grande instabilité politique.
« La Commission européenne a soutenu l'agribusiness ukrainien contre les petits paysans européens et ukrainiens. Pour soutenir réellement le peuple ukrainien, il faudrait renforcer la capacité de ses petits producteurs à assurer la sécurité alimentaire du pays en priorité. » Morgan Ody
Dans l'État espagnol, en juillet dernier, il y a eu un mouvement agricole qui a émergé dans un contexte de baisse de productivité, de grande sécheresse et d'élections législatives. Mais là c'était une tout autre configuration : le gouvernement central est social-démocrate, les demandes sociales et le problème des importations ukrainiennes ont été mieux solutionnés. Une loi sur les chaines alimentaires a été mise en place qui interdit la vente en dessous du cout de production. Vox, le parti néo-franquiste qui gouverne avec la droite la région de Castille-et-León, a largement investi ces manifestations. La Coag [2], le syndicat membre de ECVC, suite à des débats intenses a décidé de rejoindre les manifestations paysannes et de mettre en avant la question du revenu. Leur présence a permis que l'extrême droite ne réussisse pas à récupérer le mouvement.
Enfin, en décembre 2023 l'Allemagne a été secouée par d'intenses manifestations paysannes. Le gouvernement de coalition entre libéraux, écologistes et sociaux-démocrates a initié des coupes budgétaires drastiques et a donc décidé de supprimer les exonérations fiscales sur le gasoil agricole. La base s'est mise en mouvement contre cette mesure brutale de manière assez spontanée, sans impulsion du Deutscher Bauernverband (DBV) le principal syndicat agricole allemand. L'extrême droite, composée de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) mais aussi de groupuscules néonazis, a essayé également d'infiltrer les barrages. Des pancartes « non au Green Deal, remigration » étaient affichées dans les manifestations. ABL, qui est le syndicat membre de ECVC, très ancré dans l'écologie et le bio, a décidé de participer aux manifestations et barrages. Iels y ont défendu que l'« agriculture est colorée, non brune », en diffusant des tracts et en proposant d'accompagner la réduction progressive de la consommation de carburant. Le syndicat a été bien reçu et a été assez efficace. Le 20 janvier une grande manifestation a été organisée à Berlin, avec la coalition Wir haben es satt [3], qui a regroupé 8 000 personnes, contre les nouveaux OGM et pour une meilleure rétribution du travail agricole.
Quels sont les principaux problèmes auxquels font face les agriculteur.ices européen.nes ?
L'agriculture est dans une situation de ciseaux, d'un côté les couts de production augmentent et de l'autre les prix baissent. Cela est dû aux choix libéraux qui ont été faits depuis 30 ans en matière de politiques agricoles avec l'entrée de l'agriculture dans l'OMC, l'abandon de la régulation de la Pac, la fin des quotas et des stocks. On peut aussi parler de l'ouverture des frontières européennes aux productions ukrainiennes, qui ne pouvaient plus passer par la mer noire, bloquées par la guerre. Les produits ukrainiens beaucoup moins chers ont envahi les pays de l'Est [4] et du Sud européen et ont généré une situation de dumping.
À cette situation s'ajoutent de nouvelles ambitions en matière de transition écologique et de lutte contre le dérèglement climatique. L'Union européenne a souhaité mettre en place le Green deal [5], un pacte vert en vue de réduire l'utilisation des émissions de carbone, de pesticides, promouvoir des systèmes alimentaires durables, augmenter les surfaces en bio, etc. Le Copa-Cogeca [6] s'y est tout de suite opposé alors que ECVC de son côté a salué les objectifs en déplorant le manque d'outils de mise en œuvre. La montée en gamme engendre forcément une augmentation des couts de production, et elle ne peut pas se faire dans le cadre du libre-échange. On a ainsi un pôle qui défend le business contre la transition, et un autre qui défend la sortie du libéralisme pour pouvoir mettre en place des politiques écologiques. À l'heure actuelle on a clairement perdu une bataille, même si un débat intéressant a émergé au niveau européen.
L'agriculture européenne est dans une impasse : ceux et celles qui souhaitent continuer à vendre à l'international en produisant toujours plus ne peuvent pas intégrer dans leur logiciel la crise écologique et climatique. Le capitalisme n'arrive pas à prendre en considération le changement climatique, d'où l'attrait du climatoscepticisme. L'extrême droite se nourri de ça. Ceux et celles qui ne veulent pas regarder la situation en face plongent dans le déni et adoptent des arguments non rationnels et autoritaires. L'enjeu est pour nous de faire comprendre le cul-de-sac dans lequel se trouve l'agriculture productiviste, contre l'extrême droite et proposer des politiques publiques de sortie du libéralisme, de soutien du revenu, et en faveur de la transition. ECVC en interne n'a aucun problème pour défendre ça, les positions sont très partagées au sein de notre mouvement européen. Nous avons d'ailleurs réussi à organiser une grande manifestation européenne le 1er février à Bruxelles, chose que le Copa-Cogeca n'est pas capable de faire. Il y a trop de divergences en interne, entre les pays du Sud européen qui subissent le dérèglement du climat, les pays de l'Est qui doivent faire face aux importations ukrainiennes et ceux du Nord qui ne sont plus compétitifs à l'international. Leur seul dénominateur commun, défendu par les chefs, est l'anti « normes environnementales ». Mais j'ai le sentiment que ce que défendent les dirigeants, une poignée d'agrimanagers, dont Arnaud Rousseau est le symbole, ne correspond pas aux aspirations de la base, qui veut de la régulation. Ce sont les volontés des grands céréaliers et viticulteurs qui ont été satisfaites.
L'Union européenne comptait 9,1 millions de fermes en 2020, dont près d'un tiers en Roumanie (32 %). La surface agricole recouvrait plus de 38 % du territoire européen. La taille moyenne d'une exploitation agricole dans l'UE était de 17,1 hectares, même si 64 % des exploitations agricoles avaient une taille inférieure à 5 hectares. L'Union européenne est l'une des plus grandes puissances agricoles mondiales. En 2023, la production agricole du continent a représenté environ 552 milliards d'euros, selon la Commission européenne. L'État y contribuant le plus est la France (plus de 17 % du total de l'UE), suivie de l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie. Ensemble, ces sept États membres représentent plus des trois quarts de la production agricole totale de l'UE. Le revenu moyen des agriculteurs européens était de 28 800 euros en 2021. Un chiffre en augmentation de 56 % par rapport à 2013. Les inégalités sont fortes d'un bout à l'autre du continent. Les agriculteur.ices du nord-ouest de l'UE (Suède, Danemark, Pays-Bas, nord de l'Allemagne, nord de la France) affichent les revenus les plus élevés, là où la Roumanie, la Slovénie, la Croatie ou encore la Pologne enregistrent les plus faibles revenus de l'UE. (source : https://www.touteleurope.eu/)
Quelles réponses donnent les politiques ?
Les réponses des instances nationales et européennes vont à l'encontre de la transition agroécologique [7]. Ils reviennent par exemple sur des aspects négociés dans la Pac, comme la mesure « jachère » ou le plan Ecophyto. On a le sentiment que le « roi est nu », que les dirigeants nationaux et européens arrêtent de faire semblant de vouloir protéger l'environnement et la santé.
Lors des réformes de la Pac de 2015 et 2023, nous avons demandé plus de régulation et des aides par actif et non liées aux surfaces. Nos demandes n'ont pas été entendues, en revanche une directive dite Unfair trade practices a été adoptée en 2017. Bien trop faible, elle a malgré tout ouvert le chemin des lois Egalim en France et de la chaine alimentaire en Espagne. Dans cette directive, il manque l'interdiction de la vente à perte et pas la transparence. Il est question actuellement de renforcer cette loi européenne, ce qui va dans le sens du « Egalim européen » du président français, mais correspond également aux demandes de la Belgique ou de l'Espagne. Si cette initiative peut permettre de régler la question du prix payé aux paysans au niveau national, elle reste insuffisante pour gérer le problème des importations et donc des Accords de libre-échange.
Y a-t-il quelque chose de commun dans les colères paysannes européennes ?
Les paysan.nes européen.nes sont les victimes d'une même crise environnementale et économique, iels partagent le besoin d'un revenu digne. La transition est une obligation, mais elle est impossible dans le système actuel. La seule réponse pragmatique est la régulation et la sortie du libre-échange, à l'inverse du populisme qui n'en est pas une. Les travailleur.euses de la terre sont largement soutenu.es par les populations [8], perçues comme essentiel.les. Iels partagent le sort des premier.es de cordée, ce qui se reflète dans les alliances fortes tissées avec le mouvement social salarié et écologiste. Je pense que ECVC et les organisations membres sortent renforcées de cette première bataille, bien que peu de revendications ont été entendues.
Propos recueillis par Roxanne Mitralias
mailfacebookprintertwitter
Source : Campagnes solidaires, revue de la Confédération paysanne
Notes
[1] France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Italie, Espagne, Grèce, Irlande, Suisse, Pologne, Roumanie et Bulgarie sont concernés
[3] Nous en avons marre !
[5] D'intenses mobilisations ont eu lieu en Roumanie, Pologne, Bulgarie et la Grèce, en partie liées à cette situation.
[6] Le COPA (Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne), et la COGECA (Confédération générale des coopératives agricoles) regroupent certaines organisations syndicales et professionnelles agricoles et coopératives, dont la FNSEA. https://copa-cogeca.eu/
[7] Ursula von der Leyen, a annoncé le retrait d'un texte qui prévoyait la mise en place de mesures pour réduire de moitié, d'ici à 2030, l'utilisation et les risques des produits phytosanitaires chimiques dans l'Union européenne par rapport à la période 2015-2017.
[8] Un sondage réalisé le 23 janvier chiffre le niveau de soutien au mouvement actuel en France à 82%, soit 10 points de plus que les gilets jaunes au début de leur mobilisation
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











