Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Vers le renouvellement du statu quo ante ou la recherche désespérée d’un accord avec le trumpisme

Alors que les différents sondages de 2024 annonçaient une victoire écrasante du Parti conservateur du Canada, les dernières élections fédérales ont accordé un quatrième mandat au Parti libéral du Canada. La campagne électorale a été dominée par les appréhensions, largement répandues dans la population, provoquées par la guerre commerciale et les menaces d'annexion du Canada formulées par Donald Trump. Ces craintes ont lourdement pesé sur les intentions de vote.
Demain, le nouveau gouvernement Carney devra défendre l'économie canadienne face aux effets des tarifs commerciaux imposés au pays, réaffirmer la souveraineté nationale et même protéger l'unité du territoire. La bourgeoisie canadienne, son gouvernement fédéral et ses gouvernements provinciaux seront sous pression de l'administration américaine, déterminée à assujettir le Canada à ses propres intérêts. Le mouvement syndical, les différents mouvements sociaux et la gauche politique – du moins ce qu'il en reste – devront œuvrer à construire leur unité, manifester une combativité forte et une autonomie politique vis-à-vis des choix des gouvernements de l'oligarchie canadienne afin de résister au projet trumpiste dans une logique de réelle émancipation sociale.
Dynamique électorale et positionnement des partis
Le Parti libéral du Canada (PLC) a fait élire 169 député·es, avec 43,73 % des suffrages. Il devra former un gouvernement minoritaire, n'ayant pas atteint les 172 sièges nécessaires à une majorité. Le Parti conservateur du Canada (PCC) a enregistré une progression significative, avec 143 élu·es et un bond en voix passant de 33,7 % en 2021 à plus de 40 % en 2024.
Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a subi un effondrement, sa députation passant de 25 à 7 élu·es, lui faisant perdre son statut de parti reconnu. Une grande partie de son électorat traditionnel, inquiet des menaces de Trump et désireux d'empêcher une victoire conservatrice, a préféré voter pour le PLC.
Le Bloc québécois a reculé, obtenant 23 député·es. Le Parti vert n'a fait élire qu'un seul représentant, avec seulement 1,23 % des suffrages. Le Parti populaire du Canada (PPC), d'extrême droite, n'a récolté que 0,7 % des voix, soit six fois moins qu'en 2021.
Ces élections ont donc mené à un gouvernement minoritaire, révélant une polarisation de l'électorat autour de deux grands partis néolibéraux, et une marginalisation des tiers partis. La gauche sociale-démocrate et écologiste voit sa représentation parlementaire et son appui populaire réduits à la portion congrue.
Le Parti conservateur porté par une démagogie populiste
Le PCC a défendu un programme ultralibéral, climatosceptique et militariste : baisses d'impôts pour les entreprises, privatisations, déréglementations dans l'exploitation du pétrole et du gaz et attaques contre les droits syndicaux. Il a combiné cette orientation à une démagogie populiste envers les classes laborieuses, se présentant comme le défenseur du pouvoir d'achat et de l'accès au logement.
Par une tournée d'usines et de lieux de travail, il a réussi à bâtir un appui significatif à son programme, en l'arrimant à la colère populaire. Un bloc conservateur s'est ainsi formé, allant des partisans du capital fossile à certains secteurs de la classe ouvrière.
Le mouvement syndical et les mouvements sociaux progressistes ont clairement perçu cette stratégie, mais ils y ont répondu non par une mobilisation unitaire et massive, mais par un appui au PLC et à son nouveau chef.
Face à l'offensive trumpiste, le PLC surfe sur le nationalisme canadien
La direction du PLC a rapidement compris que la montée du PCC dans les sondages traduisait un glissement significatif à droite de l'électorat. Elle a opéré un repositionnement en conséquence.
Dès son arrivée au pouvoir, Mark Carney a aboli la taxe carbone pour les usager·ères, court-circuitant ainsi le slogan « Axe the tax » de Pierre Poilievre. Durant la campagne, il a promis des baisses d'impôts et l'abandon de l'impôt sur les gains en capital introduit par Trudeau. Il a également soutenu des projets d'oléoducs, prôné une hausse de la production pétrolière, promis d'atteindre 2 % du PIB en dépenses militaires, renforcé la surveillance des frontières et restreint l'immigration.
Il a ainsi repris de nombreux éléments du programme conservateur, ce que le PCC a dénoncé comme un pillage de ses idées. Profitant du regain de nationalisme canadien, suscité par les propos de Trump sur l'annexion du Canada, Carney a vanté l'achat de produits locaux, l'indépendance énergétique et la diversification des marchés d'exportation.
Comme l'écrivait Romaric Godin dans Mediapart :
« Trouver de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes risque, par ailleurs, d'être délicat. […] Le marché états-unien représentait en 2024 près de 75,9 % des exportations canadiennes et 62,2 % des importations. »
Le projet de diversification économique paraît donc irréaliste, d'autant que le Canada a depuis longtemps abandonné toute politique de nationalisme économique, notamment les orientations du rapport Watkins. Tous les gouvernements, depuis Mulroney, ont soutenu l'intégration continentale, concrétisée par l'ALENA, puis l'ACEUM. L'objectif du gouvernement Carney est ainsi un retour au statu quo ante, dans l'intérêt de la bourgeoisie canadienne. Mais toute négociation avec Trump impliquera des concessions unilatérales : expansion du capital fossile, hausse des dépenses militaires, durcissement migratoire, renvois de demandeur·euses d'asile et renforcement des frontières.
Le silence gêné du gouvernement face aux dérives autoritaires de Trump montre qu'il est prêt à composer avec Washington pour préserver une autonomie canadienne de façade.
Au Québec : recul du Bloc québécois et impasse du mouvement indépendantiste
Le Bloc québécois a connu un net recul. Centrant sa campagne sur la défense d'une société distincte, il n'a pas remis en cause le fédéralisme ni abordé la question de l'indépendance. Il a promis son soutien au PLC pour la première année et suggéré la création d'un ministère des Frontières, ce qui a provoqué l'ire du chef du Parti québécois.
La victoire du PLC au Québec renforce la légitimité du fédéralisme canadien et affaiblit le projet référendaire du PQ. Collaborer avec le PLC revient à renforcer le statu quo. Croire le contraire relève d'une naïveté politique.
Les fondements de la marginalisation de la gauche politique et sociale
La gauche a été affaiblie par l'appui prolongé du NPD au gouvernement libéral, par les manœuvres parlementaires, l'apathie syndicale et la fragmentation des mouvements sociaux.
Les syndicats, au Québec comme au Canada, n'ont pas mobilisé leurs membres contre les politiques conservatrices. Comme l'écrit Sid Ryan :« La voix de millions de syndiqué·es a honteusement manqué. Cela relève autant de la social-démocratie que du manque d'autonomie politique. »
Le NPD, devenu simple force d'appoint parlementaire, s'est coupé des luttes sociales réelles. Sa stratégie fondée sur des compromis a affaibli sa crédibilité. Son affaissement électoral s'explique aussi par son incapacité à défendre un programme de rupture dans l'action.
Les grandes centrales syndicales ont élaboré des plateformes revendicatives, mais se sont contentées de demander à leurs membres d'interpeller les candidat·es. Le virage à droite du PLC n'a pas été dénoncé. Le Congrès du travail du Canada a rapidement exprimé sa volonté de collaborer avec le gouvernement libéral, confirmant l'abandon de toute autonomie politique.
Le mouvement féministe a certes interpellé les partis, mais ses revendications ont été marginalisées. La mobilisation pour le droit à l'avortement s'est heurtée à la montée d'une droite pro-vie peu contestée.
Le mouvement de solidarité internationale a mené des campagnes, notamment pour la défense du peuple palestinien, sans obtenir d'écho significatif. Ni le PLC ni le PCC n'ont dénoncé la politique génocidaire d'Israël à Gaza.
Les mouvements sociaux sont restés dispersés, chacun agissant dans son domaine sans construire un front commun.
Les voies de la reconstruction de la gauche dans l'État canadien
Ces élections se sont déroulées dans un climat de nationalisme canadien accru. Au Québec, le Bloc a adopté un nationalisme compatible avec le fédéralisme. Ces deux formes de nationalisme supposent que les intérêts nationaux convergent avec ceux des capitalistes, au détriment de la solidarité entre peuples.
La gauche canadienne et québécoise ne pourra se reconstruire qu'en rompant avec ces nationalismes. Elle doit rassembler les classes populaires, les peuples autochtones et les groupes subalternes dans un projet de libération plurinational.
Ce projet doit être féministe, antiraciste, socialiste et décolonial. Il implique le rejet de toute alliance avec le PQ et de toute défense de l'État canadien tel qu'il est, c'est-à-dire fondé sur la négation de la réalité multinationale du territoire.
Une gauche de transformation sociale doit lier son action à un projet écosocialiste, soutenir l'autodétermination des peuples autochtones et québécois, et développer des solidarités avec les mouvements écologistes, féministes et populaires.
Elle doit œuvrer à bâtir un bloc social autour de la justice climatique, de la lutte contre le patriarcat, des réparations envers les peuples autochtones, de la création d'assemblées constituantes populaires, de la nationalisation des ressources et du démantèlement du complexe militaro-industriel canadien.
Les résultats des dernières élections montrent qu'il faut tout reconstruire à partir d'un véritable champ de ruines. Mais il est des combats qu'on ne peut esquiver.
Reprendre la route de la solidarité et mettre à jour nos perspectives
Les premiers constats
La construction d'un réseau militant pancanadien a toujours été laborieuse. Ce défi avait été décrit dans le texte « Le défi de lutter ensemble » d'Andrea Levy et André Frappier, publié dans le numéro 24 des NCS. En 2020, ce texte décrivait la situation politique dans l'État canadien et au Québec et ses défis. Force est de constater que l'arrivée de Trump et la montée du fascisme à nos portes ont modifié la situation. Nous devons regarder maintenant de quelle façon nous pouvons et devons lutter ensemble, et sur quelle base.
Le caractère impérialiste de l'État canadien est toujours bien réel, comme nous l'affirmions en 2020 :
« L'État canadien s'est construit contre les droits des peuples, par l'oppression des peuples autochtones que l'on a dépossédés de leurs territoires et de leurs droits ancestraux, et par l'oppression de la nation canadienne-française. Cet État s'est ensuite développé en instrument des sociétés industrielles et du capital financier, jouant de plus en plus un rôle impérialiste au niveau international en tant que partenaire junior de l'impérialisme américain. »
Une difficulté se posait, d'une part, par la compréhension de la lutte de libération nationale :
« Songer à une stratégie uniquement québécoise de changement de société, c'est ignorer la puissance des institutions financières et des corporations… Souvenons-nous du sort que la Banque centrale européenne a réservé à la Grèce (qui est pourtant un État souverain) il y a quelques années. »
Et, d'autre part, nous considérions la problématique des forces progressistes du Reste du Canada : fragmentée et limitée à des perspectives régionales, tout en s'identifiant à l'État fédéral, comme le CTC le fait.
La montée de l'extrême droite et l'arrivée de Trump ont modifié cette situation. Le mantra est devenu « Sauvons le Canada », avec une posture à droite du Parti libéral qui reprend les politiques de Poilievre. Construire un mouvement de gauche pancanadien devient une nécessité incontournable, mais elle ne pourra se réaliser sans la compréhension, dans le ROC autant qu'au Québec, d'une perspective qui combinera la dynamique de la lutte de libération nationale au Québec, la lutte des Autochtones pour leurs droits ancestraux et la lutte pour une société égalitaire. L'unité de la gauche pancanadienne ne pourra exister si elle tombe dans l'appui aux dominants canadiens en pensant faire barrage à Trump.
Cette absence de perspective a laissé tout le terrain au néolibéralisme et à la droite. Il est urgent de reprendre une perspective unitaire, ouvrière et populaire, au niveau pancanadien. Nous devons nous y consacrer maintenant !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Prise de parole 1er mai 2025 Capitale nationale

À l'heure actuelle, le gouvernement règne sous le signe de l'austérité. Il coupe, il coupe partout dans les services publics, et c'est les femmes qui en paient le prix. Dans le contexte que la Marche Mondiale des femmes a lieu cette année en 2025, il est plus que temps que le gouvernement écoute ce que les femmes ont à dire.
On assiste à un recul des droits des femmes. Pendant la période préélectorale, le gouvernement libéral fédéral, sous la direction du premier ministre Marc Carney, n'a pas cru bon de nommer une ministre au ministère Femmes et égalités des genres. Que doit-on comprendre de ce message ? Que les droits des femmes n'ont pas d'importances pour ce gouvernement ? Qu'il y aura moins financement par projet pour les organismes communautaires féministes et que les droits des femmes s'affaibliront ? Est-ce que Mark Carney nommera une ministre pour le ministère Femmes et égalité des genres dans son nouveau gouvernement ? Nous pouvons nous poser la question.
Que dire des coupes de 1,5 milliard de dollars, au provincial, dans le service de la santé, suite au budget Girard. Ce sera incontestablement des réductions de services, et c'est les infirmières qui réclament de meilleures conditions depuis des années, qui en paieront encore le prix.
En éducation, la hausse du budget de seulement 2,2% ne couvrira pas les augmentations salariales cette année. Par comparaison, les dépenses ont bondi de près de 15 % au cours de l'année qui se termine, soit 5% de plus que la hausse prévue du gouvernement caquiste.
Les travailleuses des CPE subissent des exigences du milieu de travail qui augmentent sans cesse sans que les conditions et les ressources nécessaires suivent. Elles réclament un salaire décent et des conditions de travails dignes. Il me semble que ce n'est pas trop demandé.
En 2025, la hausse du salaire minimum de 0,35$ atteindra désormais un maigre 16,10$ de l'heure. Pour que les travailleurs se sortent la tête de l'eau, il leur faudrait un salaire minimum qui oscille entre 20 et 30 $ de l'heure selon les municipalités. Ce qui implique que de plus en plus de travailleuses et de travailleurs au salaire minimum doivent recourir aux banques alimentaires. Et celles qui en paient le prix sont les mères monoparentales qui sont surreprésentées dans cette catégorie.
Les mesures d'austérités du gouvernement affaibli le bien-être des femmes. Il faut lutter contre ces mesures drastiques, contre le capitalisme que ce gouvernement encourage, pour protéger les femmes travailleuses qui participent à l'économie, mais qui vivent tout de même en majorité sous le seuil de la pauvreté. Il faut protéger ces éducatrices, ces professeurs et ces infirmières, qui jour après jour, travaillent dans des contextes de plus en plus précaires et qui songent à quitter leur milieu de travail. Les femmes tiennent à bout de bras nombre de secteurs. Nous avons besoin d'un gouvernement qui pense à elles et qui répond à leurs besoins.
En terminant, La Marche Mondiale des Femmes aura lieu le 18 octobre prochain. Je vous invite à vous joindre à nous pour ce grand rassemblement féministe.
• Nous nous mobiliserons contre les choix politiques qui ne favorisent pas la redistribution de la richesse et qui promeuvent la privatisation des services publics.
• Nous nous mobiliserons contre l'appauvrissement généré par la division sexuelle et genrée du travail de même que la non-reconnaissance du travail invisible, ici comme ailleurs ;
• Nous nous mobiliserons contre tous les préjugés qui portent atteinte à la dignité des filles, des femmes et de toutes personnes.
Merci !
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
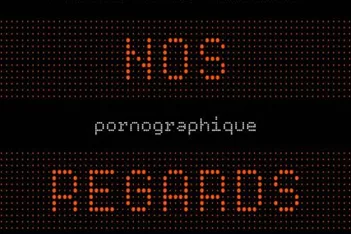
L’affaire French Bukkake

La pornographie est banalisée depuis des années. La pornographie, vous savez, ce ne serait que des images, des représentations de la sexualité, ou une façon de découvrir le sexe ; pour les hommes et pour les femmes.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/28/laffaire-french-bukkake-communique-unitaire/?jetpack_skip_subscription_popup
Alors, le livre Sous nos regards – récits de la violence pornographique tombe à point nommé. Il est une pièce à charge dans ce qu'on appelle désormais « l'affaire French Bukkake » ; impliquant entre autres Julien Dhaussy, Pascal Ollitrault, dit Pascal OP, ainsi que le site Jacquie et Michel (Piron).
« Il y avait quelqu'un dans ce corps, après tout », tel est l'épigraphe de Toni Morisson qui ouvre le livre.
Préfacé par Christelle Taraud et Lorraine de Foucher, ce sont ensuite quinze écrivaines qui portent tour à tour les récits de quinze femmes victimes ; celles-ci seront parties civiles avec d'autres lors du prochain procès.
Malgré les permanences dans la manipulation, les chantages affectifs, les humiliations et les violences, les différentes histoires s'enchainent avec leur singularité particulière. J'ai été marqué d'autant plus par les récits « Je dois vous parler d'eux » et « Boucherie ».
La lecture du livre reste cependant difficile, car les vécus sont glaçants d'horreur. Vraiment. Ils sont la réalité.
N'en déplaise aux consommateurs de porno, ce ne sont pas que des images.
Les vécus, les récits des vécus sont là.
On ne peut alors qu'envoyer notre solidarité vers ces femmes abusées et violentées, physiquement, sexuellement, psychiquement, y compris par des flics.
La pornographie est une forme de prostitution filmée, mais les violences subies vont bien au-delà de la « putophobie ». On est face ici aux tentatives d'anéantissement de femmes précarisées à différents niveaux. On est face ici à des actes de haine pure et simple, assumée ; face à des tentatives de démolissage que même le mot « misogynie » ne parvient pas à décrire pleinement. Et, au regard des conséquences des vidéos mises en ligne, leur utilisation, et au regard du nombre de victimes qui ont tenté de se suicider, on peut plutôt parler de démolissage tout court.
Achetez ce livre, lisez-le, faites-le connaitre ; d'autant plus que les bénéfices des ventes seront versés à la Fondation des femmes, qui elle dispatchera l'argent aux associations qui luttent contre les violences pornocriminelles.
Le procès s'ouvrira bientôt. A nous de nous emparer du contenu du livre pour qu'une remise en question de la pornographie ait lieu et pour que ce procès devienne celui de la pornographie. Pour qu'il puisse « renver[ser] l'humiliation ». Pour que le démolissage cesse. Et pour que « justice soit faite ».
Pascal OP, comme beaucoup d'autres, est la figure incarnée du phallocrate-abouti d'une société particulière. Violent, dénué d'empathie, stratège égocentrique. Il est le « cassos » par excellence d'une société qui valorise la prédation masculine.
Jusque quand ?
yeun lagadeuc-ygouf
https://scenesdelavisquotidien.com/2025/04/22/laffaire-french-bukkake/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tout ceci est impossible

Tout ceci est impossible de Bertrand Carrière avec des textes de Guillaume Lafleur et Robert Daudelin
Une coédition avec la Cinémathèque québécoise
En librairie le 6 mai
La publication exceptionnelle d'un photographe québécois de premier plan.
Au début 2018, le photographe Bertrand Carrière amorçait une résidence à la Cinémathèque québécoise. Depuis son expérience de photographe de plateau, il a développé une relation étroite avec le cinéma. Plusieurs explorations en ont découlé dont _Les images-temps_ réalisées entre
1997 et 2000. Tout ceci est impossible s'inscrit dans la continuité de ce travail et a été réalisé lors de sa résidence à la Cinémathèque.
Cette nouvelle œuvre est maintenant déclinée sous la forme d'un livre, co-publié par les éditions Somme toute et la Cinémathèque québécoise. La juxtaposition des images et leur déploiement sur les pages en font un objet esthétique exceptionnel, accompagné des textes de Guillaume Lafleur
et Robert Daudelin, ainsi que d'une postface de l'artiste. Nous célébrons ainsi la contribution artistique de Bertrand Carrière à l'art des images en mouvement.
ISBN 9782897945558 - 312 pages - 49,95$
Au cours des quarante dernières années, Bertrand Carrière a tissé une œuvre photographique à la fois personnelle et variée. Ses recherches se développent d'abord dans une voie documentaire où il s'intéresse à la mémoire et à l'histoire des lieux. Puis, il a une approche plus intime, caractérisée par une disponibilité du regard aux irrégularités du visible. Son travail a été exposé au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Argentine et en Chine.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
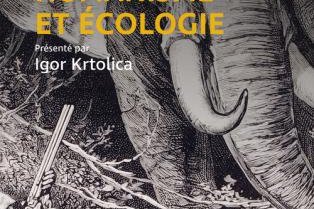
« Antifascisme, humanisme et écologie »

« Antifascisme, humanisme et écologie » par Romain Gary, Igor Krtolica, Presses Universitaires de France, Paris, 2025. EAN : 9782130879381. Date de publication : 30 avril 2025. www.puf.com/antifascisme-humanisme-et-ecologie <http://www.puf.com/antifascisme-hum...>
Infomation publiée le 1^er mai 2025par Marc Escola, escola[a]fabula.org sur le site inyternjet« Fabula : La Recherche en littérature » < www.fabula.org/actualites/127378/romain-gary-igor-krtolica-antifascisme-humanisme-et-ecologie.html <http://www.fabula.org/actualites/12...> >
En 1956, *Romain Gary* reçoit le prix Goncourt avec/Les Racines du ciel/, qui raconte les aventures d'un groupe d'individus désaxés luttant pour la protection des éléphants d'Afrique. Avec ce livre, considéré comme le « premier roman écologique », Gary ne renie pas pour autant les thèmes politiques qui animaient jusque-là son œuvre, puisque le combat écologique y est indissociable des problèmes issus de la Seconde Guerre mondiale : résistance antifasciste, expérience concentrationnaire, risque de guerre nucléaire, antitotalitarisme, luttes de décolonisation, tiers-mondisme, impasses de la société industrielle, etc. Mieux, le mouvement écologique pour la protection de la nature et la lutte politique pour la dignité humaine forment pour lui un seul et même combat. Loin de toute opposition homme-nature, il s'agit dans les deux cas d'une même résistance de la vie./Les Racines du ciel/est le roman de cette résistance.
Autour de l'auteur :
**Romain Gary* *(1914-1980) est le seul écrivain à avoir reçu deux fois le prix Goncourt. Avec « Les Racines du ciel », Gary se tenait pour le « premier écologiste de France ».
Texte présenté et commenté par *Igor *Krtolica*,* maître de conférences à l'université de Picardie Jules-Verne et membre de l'Institut universitaire de France.
Lire un extrait
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
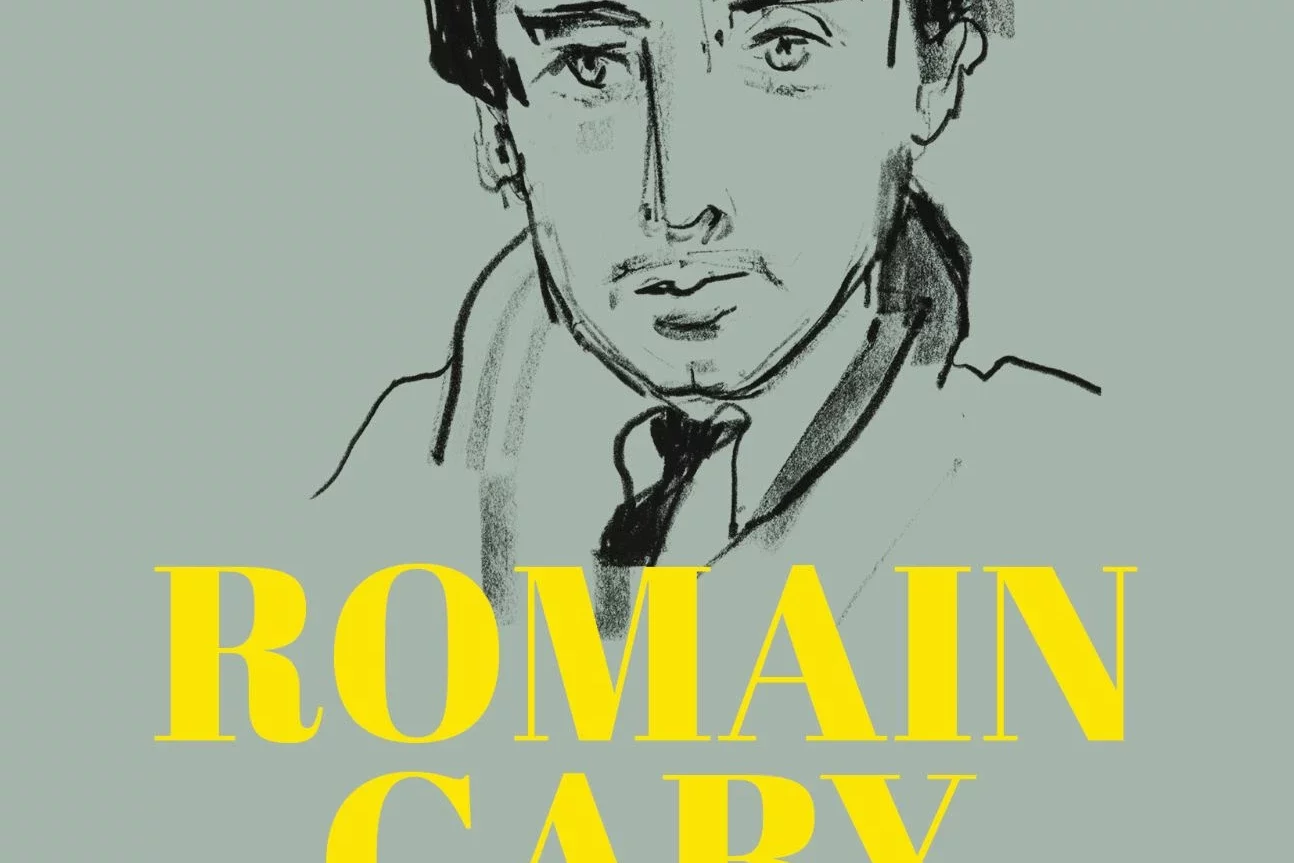
De l’humanisme à l’écologie

Igor Krtolica,/Romain Gary. De l'humanisme à l'écologie/
* Paris, Gallimard, 2025
* EAN : 9782073084958
* 208 pages
* Prix : 19,50 EUR
* Date de publication :08 Mai 2025
Information publiée le30 avril 2025parMarc Escola sur https://www.fabula.org/actualites/127360/igor-krtolica-romain-gary-de-l-humanisme-a-l-ecologie.html
1956 : le prix Goncourt est attribué aux/Racines du ciel/, roman dont le héros, Morel, se bat contre l'extermination des éléphants dans une Afrique en lutte pour son indépendance. Romain Gary le présente comme le premier roman écologique. L'écologie lui permet de résoudre la contradiction politique insoutenable dans laquelle se débat l'Occident après guerre : impossibilité de croire en l'homme, impossibilité de renoncer à y croire. Comment continuer à donner un sens à l'idée de civilisation ? Le maintien de l'idéal humaniste suppose d'en passer par un combat dont l'homme n'est plus le centre.
Tel est le paradoxe ici exploré. Cet essai littéraire et philosophique montre toute la complexité de la pensée de Romain Gary, son ironie et son humour permanents, ses contradictions, son rejet de tout dogmatisme. Et sa modernité : en avance sur son temps, le romancier anticipe les controverses qui animent la pensée écologique contemporaine, où l'humain n'est qu'une partie de la nature mais où la nature devient elle-même inséparable de l'histoire, de la société et de la politique.
Cette synthèse inédite de l'œuvre de Romain Gary est une analyse originale de la tension entre engagement humaniste et cause écologique.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« { L’écologie contre-attaque} » : Marine Tondelier en appelle à l’unité de la gauche au congrès des Écologistes

Réélue le 19 avril 2025, la secrétaire nationale des Verts veut promouvoir une « écologie des 99 % » qui rassemble. Samedi 26 avril, depuis Pantin, elle a appelé la gauche à l'unité pour la présidentielle en refusant de choisir entre ses partenaires.
Tiré de l'Humanité
https://www.humanite.fr/politique/les-ecologistes/lecologie-contre-attaque-marine-tondelier-en-appelle-a-lunite-de-la-gauche-au-congres-des-ecologistes
Publié le 27 avril 2025
Emilio Meslet
photo Eric Tschaen / Rea
Le parti Les Ecologistes se réunit autour de sa secrétaire nationale, Marine Tondelier.
Marine Tondelier a présenté, samedi 26 avril, les principales orientations politiques et stratégiques des Écologistes pour son second mandat en mettant l'accent sur les prochaines municipales et la présidentielle.
C'est ici qu'ils avaient fêté sans demi-mesure, à l'été 2020, leur succès aux élections municipales, lorsqu'ils s'imaginaient encore future force dominante de la gauche. Cinq années ont depuis passé, avec leur lot de gadins électoraux et de reculs environnementaux. Voilà pourquoi, selon Marine Tondelier, l'heure de la « contre-attaque » de l'écologie a sonné, comme elle l'a martelé depuis la Cité fertile, tiers-lieu de Pantin (Seine-Saint-Denis) où elle a été officiellement réinvestie secrétaire nationale à l'issue du congrès des Écologistes. Son score de 73 % est sans appel : les militants lui ont massivement renouvelé leur confiance pour porter leur ligne.Mais quelle ligne ?
Des mois durant, les critiques ont plu sur Marine Tondelier, accusée par ses opposants – Florentin Letissier (8 %), Karima Delli (13 %), et Harmonie Lecerf-Meunier (6 %)– d'être trop floue sur son cap politique. De refuser de trancher entre une « écologie de gouvernement » du premier cité, inspiré par les Verts allemands, et une « écologie populaire » foncièrement anticapitaliste défendue par les deux autres prétendantes.
« L'écologie, ce n'est pas la foi »
« Je vais vous faire plaisir : je vais parler de ligne. J'ai vu que ça manquait à certains », a lancé, un poil revancharde, Marine Tondelier pendant son discours. Elle promet donc une « contre-attaque » de l'écologie mais sans cliver. Si, lors de sa première élection en 2022, la Nordiste voulait un « million de sympathisants » pour son parti, elle place désormais la barre encore plus haut, espérant presque 66 millions de sympathisants puisqu'elle se dit « convaincue que chaque Française, chaque Français a, dans un coin de sa tête, un écologiste qui sommeille en lui ». D'où une stratégie qui flirte avec un populisme quasi ruffiniste : Marine Tondelier prône donc une « écologie des 99 % » qui rassemble contre ces 1 % « responsables de la moitié des émissions mondiales », qu'il faut taper au portefeuille avec, notamment, la taxe Zucman, impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultrariches.
« Ce congrès n'a pas été celui de la clarification », regrette Karima Delli, laquelle veut un projet « pour gagner, pas pour résister ». Un proche de Florentin Letissier dit lui « ne toujours rien comprendre ». « On a encore trop tendance à se dire qu'on a raison et que les gens vont s'en rendre compte, recadre Harmonie Lecerf-Meunier. Maintenant, il faut convaincre parce que l'écologie, ce n'est pas la foi. » « Marine a indéniablement ramené des gens vers nous et nous n'avons jamais eu autant de militants. Mais je voudrais qu'elle parle plus de fond et qu'elle incarne enfin la radicalité », espère une cadre.
Mais dans l'état-major tondelieriste, on assume de ne pas donner dans la lutte des classes : « Nous sommes sur le mode « transition », pas « révolutionnaire », car il nous faudra emmener tout le monde et faire accepter le changement avec une répartition équitable de l'effort », explique la députée Sabrina Sebaihi. Pour des mesures concrètes, il va falloir encore patienter. Le parti vient d'engager un travail programmatique, avec des chercheurs comme l'économiste Anne-Laure Delatte. Celui-ci ne sera dévoilé qu'à la fin août, lors des Journées d'été des Écologistes à Strasbourg. David Cormand, eurodéputé et proche de la secrétaire nationale, indique que le projet des Verts sera guidé par la lutte contre « le productivisme, dont tous ne sont pas sortis, y compris ceux qui se réclament de l'anticapitalisme ».
Le « théorème de l'entonnoir » pour définir un projet commun
Un débat qui ne doit pas empêcher l'union de la gauche et des écologistes pour 2027, d'après Marine Tondelier et sa ligne « antifasciste ». Une volonté consensuelle dans son parti. C'est d'ailleurs l'un des principaux objectifs du texte d'orientation des Écologistes, voté à 85 % par les adhérents. « Nous serons fidèles à la promesse de cet été (le Nouveau Front populaire, NDLR). Et vous ? », lâche-t-elle à chaque parti allié, dont au moins un émissaire était présent dans la salle. La secrétaire nationale veut peser de tout son poids pour faire aboutir le rassemblement à l'heure où « les forces obscures du néonazisme, du néofascisme, du néopétainisme se répandent ».
Elle propose une méthode tirée du « théorème de l'entonnoir » qu'elle a inventée : commencer par définir les contours d'un projet commun et remettre à plus tard la question de l'incarnation une fois que chacun a mis le doigt dans l'engrenage, « sinon on est sûrs de se planter ». Et, pour répondre aux « aspirations profondes du peuple de gauche et de l'écologie », Marine Tondelier veut tout le monde autour de la table : « Peut-être que des partenaires choisiront à notre place en s'isolant, en refusant de travailler avec les autres. Mais nous ne choisirons pas ! »
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

5 mai : Journée des robes rouges

Aujourd'hui, en cette journée de la robe rouge, nous honorons la mémoire des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones assassinées et disparues. Nous portons le rouge pour faire résonner leur voix, trop souvent réduite au silence, et pour rappeler qu'aucune vie ne devrait être oubliée.
Chez Femmes Autochtones Québec, notre cœur est tourné vers les familles et les communautés qui vivent avec une douleur profonde, mais aussi avec une force admirable. À travers le deuil, l'amour demeure, et c'est cet amour que nous portons avec vous aujourd'hui.
Nous vous voyons, nous vous entendons, et nous marchons à vos côtés.
Prise de position d'Unifor
Le 5 mai est la Journée de la robe rouge, une journée de commémoration et de solidarité envers les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées, et l'occasion de renouveler l'engagement collectif du syndicat envers la justice.
Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones continuent d'être la cible d'actes de violence à des proportions qui sont tout simplement inacceptables dans une société qui prétend accorder de la valeur à la justice. En 2019, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a publié une feuille de route exhaustive contenant 231 appels à la justice afin de s'attaquer aux causes systémiques de cette violence. Six ans plus tard, un trop grand nombre de ces recommandations ne sont toujours pas mises en œuvre. Le manque de volonté politique à tous les ordres de gouvernement a pour conséquence que la violence continue.
La découverte des restes de Marcedes Myran et de Morgan Harris dans le site d'enfouissement Prairie Green, situé près de Winnipeg, nous rappelle brutalement que la crise est loin d'être terminée, malheureusement. Bien qu'il ait fallu attendre trop longtemps avant d'entamer les recherches, la décision du premier ministre Wab Kinew d'organiser des fouilles montre ce qui est possible lorsque les gouvernements décident d'écouter, de croire les familles et d'agir.
Les familles et les autorités espèrent encore que les restes d'Ashlee Shingoose, une victime du même tueur en série, puissent être découverts dans un autre site d'enfouissement de la région de Winnipeg.
Il est important de sensibiliser la population à propos de cette crise de violence et de proposer aux membres des occasions de se joindre aux militantes et militants qui se battent pour la justice. Unifor invite ses membres à participer à une discussion qui se déroulera en ligne, le 5 mai à 13 h (heure de l'Est), au sujet du soutien à apporter aux familles des femmes, des filles et des personnes bisexuelles autochtones disparues et assassinées. Cliquez ici pour vous inscrire.
D'ici là, les sections locales d'Unifor sont vivement encouragées à prendre part aux événements organisés dans leurs régions pour souligner la Journée de la robe rouge.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le révisionnisme d’un certain pacifisme - À propos de la Crimée

Presse-toi à gauche ! (PTAG) publie le 38e numéro de Soutien à l'Ukraine résistante des Brigades éditoriales de solidarité. On y trouvera des textes produits par divers camarades ukrainien·nes, ainsi qu'un dossier consacré à la Crimée ; dossier particulièrement utile pour tout·e internationaliste, acquis·e au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui s'inquiète du soutien improbable, apporté par des militants de gauche, au « plan de paix » imaginé par Donald Trump en avril 2025.
Pour rappel, le dit « plan de paix » consacre la loi du plus fort, notamment en reconnaissant la péninsule de Crimée, annexée de force par la Russie de Poutine en 2014, comme un territoire Russe [1].
Pourtant, il se trouve aujourd'hui au sein même des espaces militants, des discours portés au nom de la gauche, du pacifisme et de l'anticolonialisme qui voient dans cette concession une condition somme toute raisonnable. Après tout, la « paix internationale » pourrait bien valoir la peine de céder la Crimée et ses habitant·es au régime de Poutine ; d'ailleurs la Crimée a-t-elle jamais été « vraiment » Ukrainienne ? Et la paix ne serait-elle pas à portée de main si on parvenait à convaincre ce va-t-en-guerre de Zelensky, laquais de l'impérialisme de l'OTAN hier, de l' l'UE aujourd'hui – puisque Trump a officialisé, on ne peut plus publiquement, son soutien à Poutine - d'abandonner sa « prétention patriotique (…) de garder la Crimée ukrainienne » ? (nos italiques).
C'est l'expression mobilisée dans leur article du 25 avril dernier, par les Artistes pour la Paix (APLP). Et ces derniers, « sans vouloir vendre la peau de l'ours trop tôt », se déclarent tout de même « favorables à cette paix possible ». Si ce texte a retenu notre attention, c'est qu'il illustre une tendance de fond, bel et bien repérable dans la gauche au Québec comme ailleurs, et le développement concomitant d'un argumentaire qui se drape de vertu (eux, ils défendent la paix) mais qui procède de contre-vérités et de manipulations historiques tout en souffrant d'amnésies : exit de l'histoire le pacte germano-sovietique, les 1.7 millions d'ukrainien·nes de l'armée rouge qui sont mort·es au combat contre le nazisme, et les crimes russes contre les Tatars de Crimée. Suivant cet argumentaire "pacifiste", les Russes auraient (comme un seul homme) héroïquement résisté aux nazis alors que les Ukrainien·nes et les Tatars, tous aussi antisémites les uns que les autres, auraient (là encore comme un seul homme) collaboré avec l'occupant [2].
À contrecourant de cette relecture sélective de l'histoire, toute à la gloire de la puissance occupante russe, qui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre à la propagande de Poutine lui-même (Collectif d'historiens dans Le Monde, 5 mai 2025), on recommande donc vivement la lecture de ce dossier des Brigades éditoriales de solidarité, pour ne pas « oublier » que :
1. « Le peuple autochtone – les Tatars de Crimée – a été au cours des siècles la principale victime de l'impérialisme russe : ils ont été privés de leurs terres, dépossédés, soumis à un nettoyage ethnique et à l'oppression » (Voir le texte de Sophie Bouchet-Petersen dans ce numéro). En 1944 « en deux jours, toute la population tatare (200 000 personnes) [fut] déportée dans des conditions atroces » (ibid.) ; environ 45% d'entre elles et eux sont morts au cours du trajet ou à leur arrivée dans l'Est de la Russie soviétique (en Ouzbékistan pour la plupart). Certains historiens évoquent un génocide, tout comme les autorités Tatares d'ailleurs.
2. Lorsque le 18 mars 2014, comme le rapporte l'APLP et nous reprenons leurs termes ici « le président russe, Vladimir Poutine, signe avec les dirigeants de Crimée un accord historique sur le rattachement de cette péninsule à la Russie, deux jours après le référendum en Crimée qui a pleinement plébiscité cette option », la Crimée venait d'être conquise par les « petits hommes verts » armés jusqu'aux dents, annexée « au terme d'un référendum bidon que la communauté́ internationale ne reconnait pas » (Sophie Bouchet-Petersen dans ce dossier), qui n'a aucune légitimité en droit international, qui fut tenu dans le contexte d'une répression terrible des opposant·es en Crimée, et qui fut largement boycotté par les Tatars. À l'issue de quoi, le Majlis (Assemblée des Tatars) a été déclaré́ « organisation terroriste » et interdit.
3. Aujourd'hui même, « [D]e nombreux Tatars de Crimée réfléchissent sérieusement à la forme d'autodétermination qu'ils préfèrent et au statut juridique de la Crimée sur la base du cadre juridique international. De leur représentation politique au sein du gouvernement de Crimée à la protection du patrimoine culturel, il existe de nombreuses façons de réaliser l'autonomie ». En revanche, l'enrôlement de force, les disparitions, les meurtres, les viols, la torture, la russification forcée, voire le nettoyage ethnique, bref ce qui est décrit de l'occupation Russe, ne figure pas parmi les projets d'autodétermination envisagés par les Tatars, jusqu'ici, à tout le moins.
Certes, nombre d'ukrainien·nes n'ont pas plus de leçon à donner en matière de respect des droits des minorités et des autochtones, que nombre de Russes ou de Québécois·es par exemple, c'est notamment ce que montre le texte de Mariia Chynkarenko concernant la question de l'autodétermination des Tatars. Pour qui s'y intéresse vraiment, ce texte éclaire précisément la complexité des rapports coloniaux en Crimée. Certes, le révisionnisme historique n'est pas le propre de la propagande Russe, des historiens et des politiciens Ukrainien·nes sélectionnent eux aussi des évènements historiques pour légitimer la domination de l'Ukraine sur la Crimée et sur les Tatars en particulier…
Mais en quoi cela peut-il constituer un argument en faveur d'une Crimée russe lorsqu'on se dit internationaliste et donc anticolonialiste ?
Pour ne pas dire n'importe quoi, peut-être pourrions-nous, comme nous y invite Patrick Silberstein dans son introduction, revenir aux principes de base du droit international, du droit international humanitaire, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du droit des autochtones. Parmi ces principes, il y a bien entendu l'obligation de respecter l'intégrité territoriale des États, y compris, que cela plaise ou non aux pacifistes, celle de l'Ukraine, Crimée comprise. Il y a également l'interdiction des mobilisations forcées dans les territoires occupés (art.51 de la Conv. de Genève), le droit à des procès équitables, le droit à la liberté d'expression, de religion etc. autant de droits dont est privée une large partie de la population de la Crimée occupée, comme le montrent les textes de ce dossier (Halya Coynash et Crima SOS).
Et toujours pour éviter de dire n'importe quoi, peut-être pourrions nous revenir au principe de base de la solidarité internationale, lire et écouter ce que dénoncent et ce que revendiquent les premières et premiers concerné·es.
Bonne lecture.
Martin Gallié (texte révisé par Elsa Galerand)
5 mai 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des militant-es syndicaux dénoncent la privatisation et les attaques contre les droits syndicaux

Avant le départ de la manifestation réunissant plusieurs centaines de personnes à Québec pour le Premier mai, des militant-es syndicaux ont dénoncé les attaques du gouvernement Legault contre la classe travailleuse, particulièrement par son soutien à la privatisation en santé et au niveau des services d'électricité. Ils et elles ont également dénoncé le projet de loi 89 qui s'attaque au droit de grève. PTAG reproduit ici ces interventions.
À l'ouverture de la manifestation du premier mai à Québec, Pierre-Guy Sylvestre, conseiller syndical du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dénonce la privatsation des services publics, et particulièrement de la production et de la distribution de l'électricité.
Isabelle Trépanier et Caroline Gravel de la Fédération interprofessionnelle(FIQ) dénoncent la démolition des services de santé par le gouvernement de la CAQ. Cette démolition passe par la privatisation des services de santé et par la détérioration des conditions de travail du personnel de la santé. (Premier mai, Québec)
François Proulx-Dupéré, secrétaire général du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN dénonce les politiques d'austérité du gouvernement de la CAQ qui se font au détriment des services publics et qui frappent la population de plein fouet. Le capital n'a pas sa place en santé et dans les services publics. Défendons notre droit de grève attaqué par le projet de loi 89 ! Dehors la CAQ ! (Premier mai, Québec)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












