Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Plus de 3 000 personnes participent à la 46e marche et au rassemblement de la Journée internationale des droits des femmes 2024 à Toronto

On estime que 3 000+ personnes (comparativement à environ 2 000 en 2023) ont défilé à l'occasion de la Journée internationale de la femme à Toronto, le samedi 2 mars.
7 mars 2024 | tiré de Rabble.ca | Photo:pk Mutch Crédit : pk Mutch
https://rabble.ca/politics/canadian-politics/over-3k-participate-in-torontos-46th-international-womens-day-2024-march-rally/
Lors d'un sombre samedi matin de mars à Toronto, Gloria Turney, préposée aux services de soutien à la personne et déléguée syndicale du Service Employees International Union, a illuminé la salle et a reçu un tonnerre d'applaudissements de la part des fêtards du rassemblement JIF de Toronto en réponse à son rappel bienvenu : « Lorsque nous nous battons, nous gagnons. » Mme. Turney a également donné plusieurs exemples, dont l'abrogation récente du projet de loi 124 sur la suppression des salaires des conservateurs de l'Ontario. Turney a averti que ces victoires ne se produisent pas facilement ou en agissant seul. Les femmes doivent continuer à travailler ensemble, à renforcer la volonté politique et à renforcer le pouvoir politique si c'est la justice pour tous et toutes que nous voulons..
Cependant, bien qu'il y ait de grandes victoires à célébrer (y compris la décision de la France d'inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution), le déclin des droits des femmes et l'augmentation des violations des droits humains contre les femmes, les personnes trans et queer du monde entier se développent comme un cancer métastasé non traité.
Carolyn Ferns, coordonnatrice des politiques publiques et des relations gouvernementales pour la Coalition ontarienne pour de meilleurs services de garde à l'enfance et coorganisatrice de l'événement de cette année, est du même avis. C'est pour cette raison que « la coalition [de la JIF] ne cesse de croître... Il y a de plus en plus de personnes et d'organisations qui se joignent à nous, représentant des préoccupations et des intérêts divers. Nous constatons de plus en plus l'interdépendance de toutes les questions soulevées. En plus des luttes internationales, il y a des luttes locales comme les récentes attaques contre les femmes trans et les droits des trans au Canada. Aujourd'hui, nous entendons également des militants de la lutte contre la pauvreté et des militants du logement. Tout est interconnecté. »
L'une des féministes, militantes, éducatrices et écrivaines les plus connues du Canada, Judy Rebick, a déclaré que le rassemblement et la marche de cette année représentent « l'un des rassemblements les plus diversifiés de la ville », ajoutant que « la Journée internationale des femmes avait l'habitude de se concentrer sur la question des femmes, par exemple le racisme, les garderies ou la grève d'Eaton. Aujourd'hui, avec la participation d'une grande diversité de femmes, l'accent est mis sur les questions internationales et sur les femmes à l'échelle internationale et intersectionnelle. »
Au cœur du rassemblement de cette année se trouvait le génocide palestinien en cours et, en particulier, l'impact sous-estimé de la guerre sur les femmes et les enfants palestiniens. Plus de 70 % des personnes massacrées en Palestine jusqu'à présent étaient des femmes et des enfants. Julian Arscott, membre du conseil exécutif du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), a assisté au rassemblement avec sa fille de deux ans. « [Les médias] sont totalement biaisés et je pense qu'il n'y a pas eu assez de couverture de l'impact sur les femmes et les enfants. C'est tellement grave qu'ils soient complices de ce qui se passe. »
Dans une déclaration récente, l'ONU a exprimé « ... alarmés par les informations faisant état de prises pour cible délibérées et d'exécutions extrajudiciaires de femmes et d'enfants palestiniens dans des endroits où ils ont trouvé refuge ou alors qu'ils fuyaient. Certains d'entre eux tenaient des morceaux de tissu blanc lorsqu'ils et elles ont été tués par l'armée israélienne ou des forces affiliées. »
Dans son discours au rassemblement, Tamara Abu-Abed, du Mouvement de la jeunesse palestinienne, a condamné la guerre à Gaza et a conclu : « Nous rejetons tout féminisme qui n'est pas anti-impérialiste. »
Anna Lippman, membre du comité directeur d'Independent Jewish Voices (IJV), a ajouté : « Mon féminisme est incomplet sans les femmes palestiniennes. »
Alors que certains événements de la JIF mettent en vedette des experts ou des dirigeants d'organisations, le rassemblement de la JIF à Toronto a amplifié la voix des organisations locales. D'autres groupes se sont manifestés ou ont pris la parole lors du rassemblement, notamment la Dre Catherine Brooks, l'aînée Anishnawbe Kwe, Susan Gapka, membre fondatrice et présidente du Toronto Trans Coalition Project, Sharlene Henry, coprésidente de la York South-Weston Tenant Union, et Sultana Jahangir, des Services aux femmes et aux migrants d'Asie du Sud.
Les Red Bear Singers, un cercle local de femmes autochtones jouant du tambour composé de survivantes des pensionnats indiens, ont joué une chanson d'unité, suivie d'une chanson matinale cherokee qui a été chantée par celles qui ont parcouru à pied le tronçon de 700 kilomètres de la route 16 en souvenir des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.
Comment s'impliquer davantage dans les mouvements pour la justice, l'équité et le changement fondamental ? Ferns a affirmé qu'il y a de plus en plus d'occasions de s'engager. « Il y a beaucoup de groupes qui s'organisent... Parce qu'une attaque contre contre une femme est une attaque contre toutes les femmes. Quand on voit l'injustice s'imposer, je pense que c'est la chose la plus importante.
D'où le slogan de cette année, personne n'est libre tant que nous ne sommes pas tous libres.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sur la lettre récente du CISO à Trudeau

« La page qui fut d'abord blanche, est maintenant parcourue du haut en bas de signes noirs, les lettres, les mots, les virgules et les points d'exclamation, et c'est grâce à eux qu'on dit que cette page est lisible. Cependant à une sorte d'inquiétude dans l'esprit, à ce haut-le-cœur très proche de la nausée, au flottement qui me fait hésiter à écrire… la réalité est-elle cette totalité des signes noirs ? »
Kaveh Boveiri
C'est avec ces mots que Jean Genet, l'écrivain français, commence Un captif amoureux, son dernier livre publié posthume. Cette œuvre est en principe le résultat de rencontres de l'auteur à travers des années avec les Palestiniens ainsi que les activistes de Black Panthers. Le massacre de Shatilaest aussi décrit par l'auteur.
La réponse à cette question rhétorique est claire : Non ! La réalité va au-delà de ce qu'expriment les mots. Genet continue ce passage en disant que pour saisir la réalité il faut aller au-delà des mots et chercher ce qui se trouve entre les lignes.
Par les lignes ou entre les lignes, en général un texte ne porte nécessairement pas une relation immédiate avec la réalité. Ou peut-être ça dépend ! Un texte peut être le résultat d'une décision collective d'un ensemble des gens qui sont soucieux concernant la réalité. Un tel texte aura donc un impact sur la réalité envers laquelle les auteurs prennent une position. Lalettre collectivedu 21 février du Centre international de solidarité ouvrière (CISO) est un tel exemple. Ce document, intitulé Lettre au premier ministre Trudeau pour demander l'annulation de la suspension du financement à l'UNRWA, est signé par les représentants de plus de soixante-cinq syndicats et de plus de 1,6 millions de travailleuses et travailleurs au Québec. Cette lettre vient à la suite de la décision du gouvernement canadien de suspendre le financement à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). L'UNRWA a été créé par l'Assemblée générale en 1949 afin d'offrir aide et protection à quelque 5 millions de réfugiés de Palestine enregistrés.
Avec cette décision, le gouvernement canadien se rejoint à 18 autres pays qui prennent une position semblable. Cette décision vient à la suite de l'allégation de l'autorité israélienne contre une dizaine d'employés de UNRWA d'être impliqués dans l'attaque du Hamas du sept octobre. Avec ce texte, CISO exprime explicitement son inquiétude et son désaccord avec une telle décision avant aucune enquête et l'exprime cruel et démesuré.
Mais qu'un texte soit le résultat d'une décision collective ne garantit pas son impact sur la réalité. Bien qu'elle soit la condition nécessaire, elle n'est pas également la condition suffisante. La présence significative dans le réel de la part des écrivains d'un tel texte est également incontournable. En voyant la participation des membres des organisations signant cette lettre dans la rue (voir la photo), nous témoignons qu'une telle condition est également remplie. De plus, la classe ouvrière québécoise en tant qu'une classe se mobilise, autour detravailleuses et travailleurs pour la Palestine pour se limiter à un seul exemple. Ainsi elle fortifie et aussi matérialise la position politique exprimée dans cette lettre par ses représentants.
Une telle confrontation envers du réel ne se limite ni aux lignes ni aux interlignes de texte.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

8 mars : Ça gronde à Québec

Bienvenue à cette marche du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
Avant de marcher dans les rues de Saint-Roch il est important de reconnaître que nous sommes à la croisée des territoires des nations Huron-Wendat, Wabanaki, Innu, Atikamekw et Malécite. Cette reconnaissance nous rappelle la colonisation du Québec qui a fait tant de victimes autochtones par le passé et qui en fait encore aujourd'hui. Nous voulons réitérer notre solidarité envers nos consœurs autochtones, qui se battent encore aujourd'hui pour faire valoir leurs droits, pour trouver des réponses et obtenir enfin justice et réparations pour toutes ces femmes autochtones disparues et assassinées.
INTRODUCTION
Aujourd'hui nous voulons exprimer notre gronde ! Comme le dit la thématique de cette année : « Ça gronde : solidaire pour nos droits – ici comme ailleurs les femmes se lèvent face aux crises ». Nous exprimons notre colère et notre indignation particulièrement face à la crise le système public qui met à mal notre filet social ; la crise économique qui augmente l'insécurité alimentaire, la pauvreté et l'itinérance ; la crise climatique qui touche de façon disproportionnée les plus vulnérables et enfin les crises internationales et particulièrement les guerres.
Pendant la marche nous allons faire 4 arrêts, dont celui -ci et à chaque arrêt, nous vous présenterons des œuvres artistiques qui ont été faites par une quarantaine de femmes et d'enfants hier après-midi.
Sentez-vous cette gronde qui vous habite ? On va essayer de la sentir toutes ensemble alors je vais demander aux percussions qui sont devant, les batucadas, de nous rythmer cette gronde. Allons-y…. Est-ce que vous êtes capable dans la marche de faire résonner cette gronde avec vos pieds ? Avec les batucadas j'aimerais vous entendre. C'est cette gronde qui va nous animer tout au long de la marche !
Hier, des enfants ont créer des phénix, je les invite à venir sur la scène pour que vous puissiez voir leurs œuvres remplis d'espoir pour l'avenir, car après la colère et le feu qui nous anime, le phénix renait toujours de ces cendres.
CRISE DU SYSTÈME PUBLIC
Pour commencer, nous sommes en diagonale du ministère des finances, parlons de la crise du système public !
Ça gronde ICI parce que nous avons un gouvernement d'entrepreneurs de droite qui pense que tout se règle grâce à la privatisation, qui vient de passer une loi sous bâillon pour reformer le système de santé en allant vers plus de centralisation et de privatisation et en ôtant le pouvoir d'agir de certaines travailleuses, particulièrement les sages femmes et les infirmières. Les infirmières d'ailleurs qui sont toujours en grève pour faire valoir leurs droits et nos droits car, comme elles le disent : leurs conditions de travail sont nos conditions de soins ! Ça gronde face à ce gouvernement qui a fait le choix de se priver de 1,7 milliards de dollars par année en baisse d'impôts dans le dernier budget, trouant encore plus notre filet social qui échappe les plus vulnérables. Comme les femmes sans RAMQ qui doivent payer jusqu'à 1000$ pour un avortement et 18 000$ pour un accouchement.
Ça gronde AILLEURS, face à la monté de l'extrême droite partout dans le monde qui coupe dans les services publics. Comme en Argentine, ou le président s'est engagé à couper à la tronçonneuse les dépenses publiques, ainsi que les aides sociales. Ou au Brésil, ou en Italie, ou en Hongrie, ou aux E.U, Les démocraties tombent les unes après les autres entre les mains de leaders de l'ultra droite, qui se soutiennent entre eux et sabrent dans le système public.
Ça gronde face à cette crise du système public, mais notre feu peut tout changer ! Grâce aux luttes que nous avons menés ensemble dans le passé, nous avons faits des gains importants dans notre système public : les mobilisations des groupes de femmes et des groupes communautaires ont mené à la création des CPE, les syndicats et les groupes de femmes se sont battus pour obtenir l'équité salariale ! Nous devons encore faire pression sur le gouvernement pour sauver notre système public, nos écoles publics, notre système de santé. Un réinvestissement massif dans nos services publics et programmes, c'est urgent !
CRISE ECONOMIQUE
Ça gronde ICI, face à l'inflation et à la montée de l'insécurité alimentaire. Ça gronde car les femmes sont encore plus pauvres que les hommes. Ça gronde parce qu'il n'y a plus assez de logements abordables, salubre et sécuritaire, que l'itinérance augmente de façon dramatique pendant qu'une poignée d'individus s'enrichissent à coup de rénoviction. Ça gronde lorsque des femmes sont contraintes de rester avec un conjoint violent faute de logement ou qu'elles doivent répondre à des avances sexuelles de leur proprio ou coloc pour avoir un toit ou qu'elles doivent couper dans leurs besoins essentiels pour nourrir leurs enfants ou choisir entre s'acheter des fruits ou une boite de tampons. Ça gronde car ce stress constant met en péril leur santé physique et mental.
Ça gronde AILLEURS car pour répondre à la crise économique, le système capitaliste nous pousse à consommer toujours plus et produire à moindre coûts. Au Bengladesh les femmes cousent des dizaines de jeans pour 6$ par jour dans des conditions exécrables, afin que les Joe Fresh, Lululemon, Amazone de ce monde s'en mettent plein les poches. Depuis 2020, les cinq personnes les plus riches du monde ont plus que doublé leur fortune, tandis que les 60 % les plus pauvres ont perdu de l'argent. Alors que les 1 % les plus riches de la planète possèdent 43 % de la richesse mondiale, 1 pers sur 10 souffrent de faim dont les 2/3 sont des femmes et des filles.
Ça gronde face à cette crise du système public, mais notre feu peut tout changer ! En 1995, plus de 800 québécoises ont marché pendant 10 jours pour lutter contre la pauvreté, elles ont entre autres gagnées la perception automatique des pensions alimentaires, un pas vers l‘autonomie économique des femmes ! Récemment, les groupes de lutte à la pauvreté ont gagné le nouveau programme de revenu de base, qui permet à certaines personnes prestataires de l'aide sociale - malheureusement pas toutes- d'être en couple tout en recevant chacun leur chèque, autre pas vers l'indépendance financière des femmes. Nous devons continuer notre lutte pour que chaque être humain puisse vivre dans la dignité et nous demandons une meilleure répartition de la richesse- et pour ça, les plus riches et les grandes entreprises doivent payer leur juste part- pour sortir des crises qui se succèdent et se superposent.
CRISE CLIMATIQUE
Nous nous arrêtons ici, dans cet ilot de chaleur (remarquez qu'il n'y a aucun arbre sur la place) pour parler de la crise climatique.
Ça gronde ICI lorsque l'urgence d'agir face au changement climatique est porté en majorité par des jeunes et des femmes et non par le gouvernement. Que les solutions face aux GES sont d'élargir des routes plutôt que d'investir dans un réseau structurant, ou de subventionner des VUS électriques plutôt que de taxer les véhicules énergivores, ou encore de permettre à des méga-usine de batterie, sous couvert de transition énergétique, de se construire sans BAPE. Ça gronde quand le CALACS de Charlevoix nous dit qu'elles ont observé une augmentation des violences envers les femmes suite au stress dû aux inondations qui ont touché leur région.
Ça gronde AILLEURS partout dans le monde car nous venons de dépasser les 1.5 degrés de réchauffement climatique ! Ça gronde car les femmes vivent les conséquences de la crise climatique de façon disproportionnées. Elles ont 14 fois plus de risque de mourir en cas de catastrophes naturelles. Ce sont aussi elles en majorité qui portent la charge d'acheter bio, local, de passer au zéro déchet. Ça gronde car les émissions des 1 % les plus riches du monde sont deux fois plus élevées que les émissions de CO2 de la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Ça gronde car face aux entreprises pétrolières et gazières qui génèrent des dizaines de milliards en bénéfices nos gouvernements ont trop souvent courbé l'échine et fermé les yeux.
Ça gronde face à cette crise climatique, mais notre feu peut tout changer ! Le rapport de force, c'est à nous de le créer pour que nos décideurs mettent en place des mesures pour nous sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et prendre soin des gens et de la planète. Les groupes sociaux ont réussi à stopper GNL Québec. Des femmes autochtones marchent pour la préservation de l'eau et luttent contre les projets d'oléoducs. Nous demandons une transition énergétique qui ne se fait pas au détriment de nos écosystèmes, nous voulons un BAPE pour le projet Northvolt. Nous réclamons une justice sociale et environnementale qui contraint les plus gros pollueurs !
Sortir la bannière : Pour la défense du climat, abolissons le patriarcat.
CRISES INTERNATIONALES – GUERRES
Dernier arrêt, et non le moindre, pour parler des crises à l'internationale, et particulièrement des guerres et des violences.
Ça gronde ICI, lorsque face aux guerres, aux déplacements de population et aux violences vécues par des femmes et des enfants, le gouvernement décide de restreindre l'accès aux réfugiés, et fait porter le poids de la crise du logement aux personnes immigrantes. Faut-il rappeler les responsabilités de notre pays- parmi les pays les plus pollueurs- face aux nombre croissant de réfugiées climatiques ? Ça gronde lorsque le gouvernement Canadien refuse de reconnaitre le génocide qui se passe en Palestine et qu'il continue à fournir des armes qui tuent des enfants.
Ça gronde AILLEURS , en Ukraine après 2 ans de guerre alors qu'une réfugiée sur quatre subit des violences sexuelles ou physiques après avoir fui le pays ; en Iran ou des femmes se font torturer et tuer pour avoir réclamer le droit d'être libre de dire et porter ce qu'elles veulent ; au Soudan, alors que 6 millions de personnes ont été forcée de quitter leur foyer, et que les femmes et les enfants vivent plus de violences physiques, d'abus et d'exploitation sexuels ; ça gronde en Palestine, où les deux tiers des 30 000 morts sont des femmes et des enfants, où 2 mères sont tuées par heure et où la famine sévit.
Ça gronde face aux guerres et aux violences vécues par les femmes, mais notre feu peut tout changer ! Des femmes ont toujours résisté aux guerres pour protéger leurs enfants, leur territoire mais aussi leur corps trop souvent utilisée comme arme de guerre. Nous ne devons pas fermer les yeux sur ce qu'il se passe dans le monde ni se cacher derrière nos frontières, au contraire, plus que jamais nous devons être solidaires envers toutes ces victimes.
Pour cela, j'appelle 2 organisatrices du mouvement Québec-Palestine à scander quelques slogans avec nous :
Voici la fin de la marche ! Nous avons crié notre colère, et fait sortir ce feu qui nous habite, ce feu qui peut tout changer. Gardons ce feu et laissons-le grandir en nous, restons solidaires et unis pour combattre les injustices ICI et AILLEURS ! On se revoit l'année prochaine, le 8 mars 2025, pour un grand évènement : Le Lancement de la Marche mondiale des femmes !!!
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
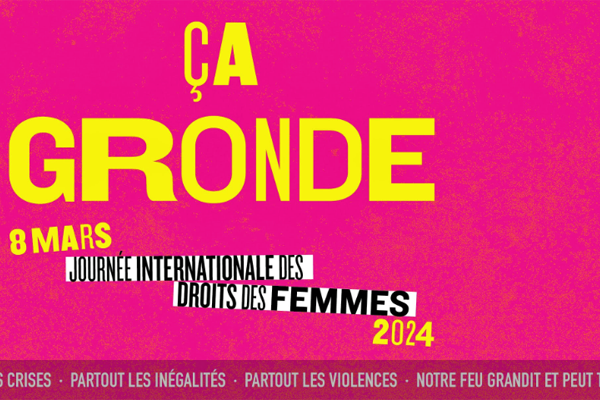
Les Montréalaises descendent dans la rue le 8 mars 2024, Journée internationale des droits des femmes, cette année sous le thème " Paix juste, égalité et libération maintenant ! "

Comme elles le font depuis deux décennies, les membres du collectif Femmes de diverses origines/Women of Diverse Origins, invite toutes les femmes, ami.es et allié.es à se rassembler et à marcher ensemble ce vendredi soir, à partir de 17h30 au départ du square Dorchester.
Il s'agira d'une marche de protestation et de célébration. Nous souhaitons marquer ensemble les victoires remportées sur le long chemin vers l'égalité des sexes. Nous souhaitons aussi rappeler tout le travail qu'il reste à accomplir, collectivement, pour y parvenir. Nous marchons pour nous-mêmes, nos familles, nos communautés, nos enfants et nos petits-enfants.
Chaque année nous rappelons que nous sommes conscientes que nous sommes sur des terres autochtones, où les femmes et les filles autochtones ne sont pas en sécurité, à ce jour.
En 2024, nous marcherons dans un contexte de crise économique très dure. Au Québec, il y a à peine quelques mois, un demi-million de Québécoi.es, exerçant des professions dominées par les femmes, ont mené.es une grève importante parce que des droits fondamentaux comme l'alimentation, le logement, les soins de santé et
l'éducation sont menacés. De son côté, le gouvernement québécois était davantage préoccupé par la mise en oeuvre de la loi 21 interdisant les signes religieux. Cette loi 21 a incontestablement un impact négatif sur les femmes, les poussant à rester la maison et à la dépendance économique.
Nous sommes également préoccupées cette année par l'augmentation alarmante des féminicides et de la violence transphobe.
Au niveau international, la situation actuelle en Palestine a permis de mettre la lumière sur plus de 75 ans de colonialisme et d'occupation. Les rues montréalaises ont répondu aux appels de plus en plus nombreux lancés dans le monde entier, en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et d'une paix juste.
Les personnes migrantes, qui contribuent au bienêtre de tous les Québécois et Québécoises, et qui ont été reconnu.es comme des "anges gardiens" pendant la pandémie du COVID, poursuivent leur lutte pour une régularisation de leur statut migratoire et pour la reconnaissance et l'égalité.
Autour du monde, des nuages de guerre s'amoncèlent, rappelant de manière inquiétante la veille de l'éclatement des deux guerres mondiales. Les grandes puissances ne consultent pas les personnes directement concernées,
qui constitueront la majorité des victimes et des dommages collatéraux. Les immenses dépenses financières utilisées pour l'armement pourraient permettre aux populations de se nourrir, de se loger, de se soigner et de s'éduquer. Le Canada doit se retirer de ces alliances militaires.
Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, nous invitons les Montréalaiseses, Montréalais, et les Québécoises et Québécois à se joindre à nous, en famille, pour une marche de solidarité féministe ce vendredi 8 mars.
Vendredi 8 mars
Rassemblement 17h30 - Square Dorchester (Peel et René Lévesque)
Manifestation 18h
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
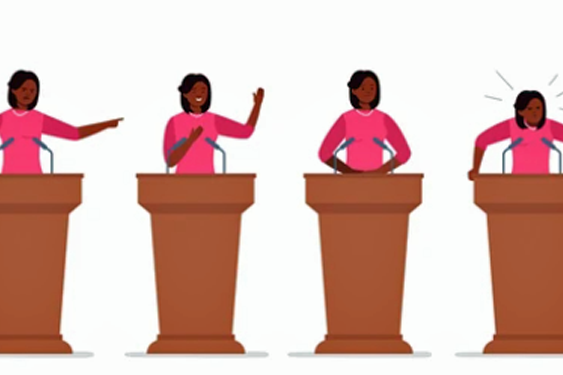
8 mars : Journée international des droits des femmes

𝐍𝐨𝐮𝐬, 𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬, 𝐞𝐧 𝐚𝐯𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐳 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞𝐬 à 𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐞𝐭 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧è𝐭𝐞.
Ç𝐚 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐱 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬. 𝐐𝐮𝐞 𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐭 à 𝐆𝐚𝐳𝐚, 𝐞𝐧 𝐈𝐫𝐚𝐧, 𝐞𝐧 𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧, 𝐚𝐮 𝐌𝐞𝐱𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐨𝐮 𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞. 𝐀𝐮 𝐐𝐮é𝐛𝐞𝐜, ç𝐚 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐟é𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐩é𝐭𝐫é𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞.
Ç𝐚 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥.
Ç𝐚 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥'𝐚𝐜𝐜è𝐬 à 𝐥'𝐚𝐯𝐨𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐩é𝐫𝐢𝐥.
Ç𝐚 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥'é𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐞𝐧 𝐫é𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 à 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐧-𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐬𝐢 𝐜𝐫𝐮𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥'𝐚𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢é𝐭é.
Ç𝐚 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐭é, 𝐥𝐞𝐮𝐫 « 𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 » 𝐛𝐫𝐢𝐬é𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐨𝐥é𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐨𝐫𝐬 𝐪𝐮'𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐚𝐮𝐱 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐠𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢é𝐭é.
Ç𝐚 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐫𝐮𝐞. 𝐂𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐮𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝é𝐛𝐨𝐫𝐝é𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞𝐬 𝐭â𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐝é𝐜𝐨𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐝é𝐬𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥'É𝐭𝐚𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐞𝐧 é𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐮𝐬-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜é𝐬.
Ç𝐚 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 à 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐧𝐭é𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐱𝐭𝐫ê𝐦𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐬𝐞 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 à 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐚𝐬.
Ç𝐚 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐥𝐨𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐞𝐧 𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐱 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝é𝐦𝐮𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐦ê𝐦𝐞 à 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮𝐬.
Ç𝐚 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐞 ! 𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐥è𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳. 𝐍𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 !
𝐑𝐨𝐲𝐬𝐞 𝐇𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬 (𝐂𝐍𝐅)
𝐄𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐍𝐅 𝐝𝐞 𝐐𝐮é𝐛𝐞𝐜 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐢𝐫𝐞
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Présentation sur la réalité du 8 mars

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
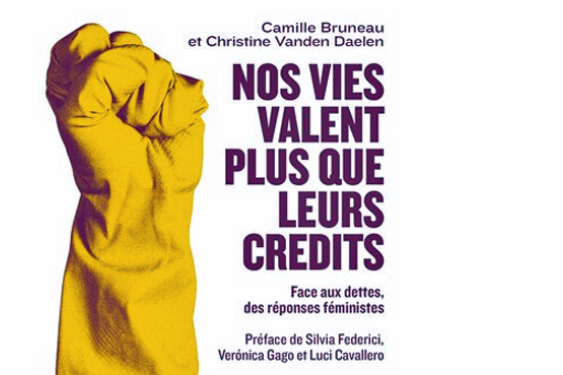
Camille Bruneau - Une lecture féministe de la dette

À la veille de la journée internationale des luttes pour les droits des femmes, nous publions cette interview de Camille Bruneau, autrice de Nos vies valent plus que leurs crédits. Face aux dettes, des réponses féministes par Afrotopiques.
7 mars 2024 | Afrotopiques
https://www.cadtm.org/Camille-Bruneau-Une-lecture-feministe-de-la-dette
Cet épisode a été enregistré a distance, car Camille Bruneau vit en Belgique.
Dans cet entretien, on parle de dette, mais surtout de la réalité matérielle qui découle de ce système politique et économique, et de ses conséquences spécifiques dans la vie des personnes qui expérimentent la condition femme.
On commence l'analyse à partir de l'émergence du capitalisme, on s'arrête sur les dettes coloniales, pour arriver jusqu'aujourd'hui, au cœur des villes mondialisées qui fonctionnent grâce à la chaine globale du care.
Camille Bruneau nous explique comment l'Etat social y est notamment remplacé par la Mère Sociale.
Et elle nous montre aussi comment le féminisme permet de renverser la recevabilité, et propose un autre définition de l'économie et du politique : celle qui met la vie et le prendre soin au centre.
Merci aux sponsors de cette série : l'Ambassade de France au Sénégal et le CCFD Terre Solidaire.
Recherche documentaire, prise de son, réalisation et montage : Marie-Yemta Moussanang
Musique : Amal's game, de Hiba Elgizouli
Graphisme : Akakir Studio 🙏🏽💜
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Agence Santé Québec : Le SPGQ envisage de faire appel aux tribunaux

Québec, le 7 mars 2024 — Devant l'indifférence du ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Christian Dubé, et l'imminence des premiers transferts de personnel vers Santé Québec, le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) envisage maintenant tous les recours possibles, y compris de faire appel aux tribunaux, pour faire valoir les droits de ses membres.
7 mars 2024 | SPGQ
https://spgq.qc.ca/2024/03/agence-sante-quebec-le-spgq-envisage-de-faire-appel-aux-tribunaux/
La demande de rencontre urgente faite au ministre le 15 février 2024 est restée lettre morte. « Nous avons reçu un accusé de réception standard, rien de plus. Visiblement, le ministre se moque du fait que son personnel professionnel ne veut pas être transféré sans le maintien de ses conditions de travail actuelles. Nous avons des discussions avec nos avocats actuellement afin de trouver la meilleure façon de défendre les droits de nos membres », indique Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.
Rencontré par l'employeur la semaine dernière, le personnel n'a pas été rassuré par l'information offerte et il subsiste un flou important quant au sort de chacun. « Ce qui est clair, c'est que plusieurs de nos membres vont se retrouver hors taux et hors échelle. En effet, les salaires des professionnels et professionnelles sont plus élevés dans la fonction publique que dans le réseau de la santé. Cela signifie qu'ils vont recevoir la moitié des augmentations salariales prévues dans la convention collective du réseau de la santé et l'autre moitié en montants forfaitaires jusqu'à ce que leur salaire soit conforme à leur nouvelle convention. Cette situation a de répercussions négatives importantes sur leur progression salariale et le calcul des rentes de retraite », insiste M. Bouvrette.
Pourtant, une solution simple existe et elle fait consensus, tant auprès des membres que des partenaires syndicaux du SPGQ : permettre aux professionnelles et professionnels de conserver leur convention collective. « Selon un sondage auprès de nos membres, 63 % d'entre eux se disent prêt à aller travailler à Santé Québec s'ils conservent leur convention collective et leurs conditions de travail actuelles. Avec la convention collective du réseau de la santé, à peine 8 % d'entre eux ont l'intention de se porter volontaires. Nos membres veulent contribuer à la réforme, mais pas au détriment de leur progression salariale et de leur retraite », fait valoir M. Bouvrette.
Le SPGQ estime que 400 à 500 professionnelles et professionnelles du ministère de la Santé et des Services sociaux devraient être transférés à Santé Québec. Les premiers transferts devraient avoir lieu en juin, selon l'employeur. Seul le personnel ayant obtenu sa permanence après deux ans de service continu aura un droit de refus et de retour dans la fonction publique. En cas de refus, une personne professionnelle peut néanmoins être transférée malgré elle le temps qu'il y ait un autre poste pour elle dans la fonction publique.
À propos du SPGQ
Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35 000 spécialistes, dont environ 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des projets de maisons d’hébergement stoppés – « Arrêtons de mélanger les pommes, les oranges et les bananes. Nous avons besoin d’un financement adapté »

C'est d'une seule voix que l'Alliance des maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2), le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale ainsi que la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes demandent au premier ministre François Legault de mettre fin à l'incohérence dans le financement des maisons d'hébergement.
« Notre premier ministre nous dit qu'on ne doit pas mélanger les pommes, les oranges et les bananes. On le prend au mot : nos maisons d'hébergement ont besoin d'un programme de financement adapté à leur réalité », affirme Maud Pontel, coordonnatrice générale de l'Alliance MH2.
Actuellement, la Société d'Habitation du Québec (SHQ) évalue les projets de maisons d'hébergement pour femmes avec les mêmes grilles que pour les projets de logements sociaux. « C'est inadéquat, illogique et incompréhensible », poursuit madame Pontel, « nos projets requièrent des éléments non négociables : sécurité accrue, lieux de vie communs et agiles (espaces d'hébergement et espaces d'intervention, accueil de femmes avec ou sans enfant, durabilité des aménagements, etc.). C'est indéniable que ça a un impact sur le coût des projets ».
Pour un programme adapté à la réalité des femmes
Nous souhaitons que le premier ministre — qui a démontré son engagement envers la lutte contre la violence faite aux femmes et les féminicides en 2021 — s'investisse dans le dossier et crée un programme de financement spécifique pour le développement immobilier des maisons d'hébergement. Le programme actuel, pas adapté, vient de forcer l'arrêt de projets en Abitibi-Témiscamingue (2), à Montréal (2), à Québec et à Thetford Mines. Plusieurs autres projets sont menacés dans les Laurentides notamment. Des subventions fédérales totalisant plusieurs millions de dollars seront perdues si elles ne sont pas utilisées. En décembre dernier, l'Assemblée nationale adoptait d'ailleurs une motion rappelant l'engagement du gouvernement, il y a trois ans, à réaliser des unités additionnelles dans le réseau des maisons d'hébergement.
Des impacts majeurs sur toutes
L'abandon des projets a au premier chef des conséquences inquiétantes pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale, notamment dans le continuum de services qu'elles reçoivent.
« Quand une femme fuit son conjoint violent, c'est tout un parcours de la combattante qui commence pour réorganiser sa vie et faire valoir ses droits. », dit Louise Riendeau, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. « Les impacts de la violence conjugale sur elle et ses enfants sont nombreux, cela requiert du soutien et de l'accompagnement, dans un lieu adapté et sécuritaire. Si elle croit ne pas pouvoir trouver les ressources dans sa communauté pour traverser ces épreuves, elle risque d'hésiter à dénoncer ».
Ensuite, la situation actuelle fragilise l'existence des maisons d'aide et d'hébergement qui portent ces projets. Elles s'en sont fait garantir le financement par les gouvernements. Or, plusieurs assument les intérêts de prêts hypothécaires leur permettant d'amorcer les différents travaux, les frais d'architectes, les frais de décontamination des terrains, etc. Avec des projets stoppés, ils paient… pour rien.
Enfin, l'incohérence actuelle a à la fois un effet négatif sur la mobilisation des équipes qui s'investissent personnellement dans ces projets avortés et un effet sur la crédibilité des maisons d'aide et d'hébergement face à leurs donateurs.
« Plus que jamais, le gouvernement doit poser un geste fort et rapidement afin d'atteindre ses objectifs de développement de nouvelles maisons d'hébergement », martèle Mylène Bigaouette, de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. « Le développement de nouvelles maisons est essentiel pour répondre aux besoins et assurer la sécurité des femmes victimes de violence et leurs enfants. Les projets qui sont rejetés ou stoppés, ça envoie un très mauvais signal ».
Il est encore temps d'agir, monsieur Legault !
À quelques jours de la Journée internationale du droit des femmes et du dépôt du budget du Québec, nous avons espoir que notre appel sera entendu par le premier ministre Legault. Nous devons aux femmes et à leurs enfants victimes d'hommes violents les bonnes ressources, au bon endroit et au bon moment. Elles ont non seulement droit à un nouveau départ dans la vie. Elles ont aussi le droit de se sentir en sécurité, au Québec.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie publie un manifeste à l’occasion du 8 mars

Nous revendiquons une société égalitaire, où la discrimination n'existe plus, non pas qu'en théorie, mais aussi, et surtout, en pratique ! En cette journée si importante pour les droits des femmes, la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) est particulièrement heureuse de présenter, publiquement, son manifeste pour les droits des femmes : 𝑵𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒐𝒏𝒔.
Co-produit avec Liliane Pellerin, artiste, et Bleu forêt, coop de communication responsable, ce manifeste se veut un outil pour porter les voix et défendre les droits des femmes en Mauricie.
Le manifeste
Nous arrivons
Nous arrivons de la survivance
avec le poids des luttes sur nos épaules
mais nos pas moins lourds sur la balance
nous arrivons avec nos espérances millénaires
et
nos fatigues ancestrales
nos abris nécessaires
nos silences
achevés
nous arrivons de la résistance
avec nos peines torrents
nos colères souterraines
car
dans nos archives et dans nos veines
dans nos mémoires et dans nos jours
trainent encore
la peur au ventre les plafonds de verre le vent de face
la trace
du déséquilibre
nous arrivons chargées d'urgence
avec, en bandoulière, notre sororité et nos miracles
nos miracles
d'être encore là chargées de rêves possibles
parce que nous avons le droit d'exister
entières et pleines
vivantes et souveraines
reconnues
soutenues
légitimes et puissantes
et parce que le Monde en a besoin
nous réclamons sa réparation
au cœur de l'intime jusqu'au bout du commun
le réparer toutes et tous Ensemble
des inégalités
de la brutalité
des injustices et des pillages
de la fatalité
des systèmes qui nous oppressent mais dans lesquelles nous avons marché toutes et tous Ensemble
par habitude et par défaut
parce que le passé parle au futur et qu'il lui dit que ça suffit
nous appelons la guérison
reconstruire toutes et tous Ensemble
autrement, autres mœurs
un Monde respect
un Monde nourricier
un Monde digne
des êtres qu'il enfante
à travers nous
Signature : Le mouvement des femmes de la Mauricie
Autrice : Liliane Pellerin
Le communiqué : Nous avançons ! Manifeste pour les droits des femmes !
Trois-Rivières, le 11 mars 2024 – Dans le cadre des actions pour la Journée internationale des droits des femmes, la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) est fière de lancer une campagne de promotion des ressources d'aide en matière de violences faites aux femmes en Mauricie : Violences faites aux femmes, c'est assez !
Réalisée avec la collaboration des agences Éclaté et Éklore, cette campagne promotionnelle a été créée de manière à répondre à certains obstacles identifiés dans le rapport de recherche Les femmes à la croisée des oppressions en contexte de violence conjugale : Obstacles et pistes d'amélioration dans l'accès et l'utilisation des services en Mauricie et dans les communautés Atikamekw, réalisé par la TCMFM et le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA). En plus de mieux faire connaître les ressources d'aide en matière de violences faites aux femmes, cette action vise à mieux informer et sensibiliser les femmes aux différents visages que peut prendre la violence conjugale, et à lutter contre les violences faites aux femmes.
La TCMFM invite donc la population mauricienne à porter une attention particulière aux affichages dans certains commerces de la région, sur les abribus et autobus et dans les médias sociaux, ainsi qu'aux messages radio dans certains médias de la région. Pour plus de détails, rendez-vous au https://www.cest-assez.org/
Menaces, jugement, exploitation, contrôle, agressions, silences
Agissons toutes.tous pour éliminer les violences faites aux femmes !
Cette campagne est rendue possible grâce à l'appui financier de Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC). La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie est un regroupement régional féministe de défense collective des droits qui a pour mission de favoriser la concertation et d'agir sur les questions mettant en jeu les intérêts et les conditions de vie des femmes.
Pour appuyer le Manifeste, rendez-vous ici.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :




























