Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Comptes rendus de lecture du mardi 20 mai 2025


La simplicité volontaire, plus que jamais...
Serge Mongeau
Serge Mongeau, le père de la simplicité volontaire, nous a quittés à l'âge de 88 ans, il y a une dizaine de jours. Militant écologiste, éditeur et auteur, médecin, il aura grandement influencé de nombreux lecteurs de ma génération et permis la création de mouvements comme le Réseau québécois de la simplicité volontaire, le Mouvement québécois pour une décroissance conviviale et le réseau Transition Québec. Je garde un bon souvenir de notre rencontre, il y a plusieurs années, lors d'un salon du livre. Publié à plusieurs reprises depuis 1985, son ouvrage le plus connu, « La simplicité volontaire », nous fait réfléchir sur notre rapport à la consommation et notre pouvoir d'organiser notre vie d'une façon différente. L'auteur y questionne la société de consommation, mais aussi notre état d'aliénation devant ces nombreuses sollicitations pour toujours posséder davantage. Un très bon bouquin de référence à lire et à relire.
Extrait :
Jamais l'humanité n'a disposé d'autant de richesses, jamais elle n'a possédé de techniques aussi efficaces et puissantes, jamais elle n'a maîtrisé un tel savoir, et pourtant jamais au cours de l'Histoire autant d'êtres humains n'ont été privés de l'essentiel, jamais non plus n'a-t-on prévu dans un avenir si proche autant de changements catastrophiques de l'équilibre naturel, changements dus à l'activité humaine. Les appels à l'action fusent de toutes parts, pour la justice sociale, pour la solidarité, pour le respect de la nature, mais rien n'y fait : ce sont les entreprises multinationales qui contrôlent le monde et, avec la complicité des gouvernements qui se soumettent à leurs desiderata, établissent les priorités nationales et internationales, lesquelles se résument à « profits », « compétitivité » et « libre-échange ».

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes
Jean-Jacques Rousseau
J'ai été heureux de réaliser récemment que l'on enseignait encore au cégep le « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes » de Jean-Jacques Rousseau. C'est, avec le « Contrat social », l'un des principaux ouvrages du grand écrivain et philosophe du XVIIIe siècle. Rousseau y développe sa conception de l'état de nature, qui précède l'État, et de la perfectibilité humaine. Précurseur de la pensée progressiste, il y décrit la propriété privée, dans son sens exact, comme la source de toutes les inégalités. Une œuvre fondamentale !
Extrait :
Voilà donc toutes nos facultés développées, la mémoire et l'imagination en jeu, l'amour-propre intéressé, la raison rendue active et l'esprit arrivé presque au terme de la perfection, dont il est susceptible. Voilà toutes les qualités naturelles mises en action, le rang et le sort de chaque homme établi, non seulement sur la quantité des biens et le pouvoir de servir ou de nuire, mais sur l'esprit, la beauté, la force ou l'adresse, sur le mérite ou les talents, et ces qualités étant les seules qui pouvaient attirer de la considération, il fallut bientôt les avoir ou les affecter, il fallut pour son avantage se montrer autre que ce qu'on était en effet. Être et paraître devinrent deux choses tout à fait différentes, et de cette distinction sortirent le faste imposant, la ruse trompeuse, et tous les vices qui en sont le cortège. D'un autre côté, de libre et indépendant qu'était auparavant l'homme, le voilà par une multitude de nouveaux besoins assujetti, pour ainsi dire, à toute la nature, et surtout à ses semblables dont il devient l'esclave en un sens, même en devenant leur maître ; riche, il a besoin de leurs services ; pauvre, il a besoin de leur secours, et la médiocrité ne le met point en état de se passer d'eux. Il faut donc qu'il cherche sans cesse à les intéresser à son sort, et à leur faire trouver, en effet ou en apparence, leur profit à travailler pour le sien : ce qui le rend fourbe et artificieux avec les uns, impérieux et dur avec les autres, et le met dans la nécessité d'abuser tous ceux dont il a besoin, quand il ne peut s'en faire craindre, et qu'il ne trouve pas son intérêt à les servir utilement. Enfin l'ambition dévorante, l'ardeur d'élever sa fortune relative, moins par un véritable besoin que pour se mettre au-dessus des autres, inspire à tous les hommes un noir penchant à se nuire mutuellement, une jalousie secrète d'autant plus dangereuse que, pour faire son coup plus en sûreté, elle prend souvent le masque de la bienveillance ; en un mot, concurrence et rivalité d'une part, de l'autre opposition d'intérêt, et toujours le désir caché de faire son profit aux dépens d'autrui, tous ces maux sont le premier effet de la propriété et le cortège inséparable de l'inégalité naissante.

La Petite Fadette
George Sand
George Sand, de son vrai nom Amantine Aurore Lucile Dupin, compte parmi les écrivains les plus prolifiques. On lui doit plus de 70 romans, des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des écrits politiques. Elle fut une femme libre, prenant la part des femmes, prônant la passion, fustigeant le mariage et luttant contre les préjugés de la société conservatrice de son temps. « La Petite Fadette » est l'un de ses romans champêtres qui s'intéresse aux monde paysan. La Petite Fadette, Fanchon Fadet, fille laide que l'on surnomme aussi le Grelet, est la petite-fille d'une sorcière de village. On lui donne mauvaise réputation en raison des pouvoirs de sourcière qu'on lui attribue elle aussi. Mais lentement, sûrement, dans une longue et belle ascension, elle deviendra la jeune femme dont les jumeaux Landry et Sylvinet s'éprendront. Vraiment, un très beau roman, comme probablement tous les romans de George Sand.
Extrait :
Eh bien, Fanchon Fadet, puisque tu parles si raisonnablement, et que, pour la première fois de ta vie, je te vois douce et traitable, je vas te dire pourquoi on ne te respecte pas comme une fille de seize ans devrait pouvoir l'exiger. C'est que tu n'as rien d'une fille et tout d'un garçon, dans ton air et dans tes manières ; c'est que tu ne prend pas soin de ta personne. Pour commencer, tu n'as point l'air propre et soigneux, et tu te fais paraître laide par ton habillement et ton langage. Tu sais bien que les enfants t'appellent d'un nom encore plus déplaisant que celui de grelet. Ils t'appellent souvent le màlot. Eh bien, crois-tu que ce soit à propos, à seize ans, de ne point ressembler encore à une fille ? Tu montes sur les arbres comme un vrai chat-écurieux, et quand tu sautes sur une jument, sans bride ni selle, tu la fais galoper comme si le diable était dessus. C'est bon d'être forte et leste ; c'est aussi bon de n'avoir peur de rien, et c'est un avantage de nature pour un homme. Mais pour une femme trop est trop, et tu as l'air de vouloir te faire remarquer. Aussi on te remarque, on te taquine, on crie après toi comme après un loup. Tu as de l'esprit et tu réponds des malices qui font rire ceux à qui elles ne s'adressent point. C'est encore bon d'avoir plus d'esprit que les autres ; mais à force de le montrer, on se fait des ennemis. Tu es curieuse, et quand tu as surpris les secrets des autres, tu les leurs jettes à la figure bien durement, aussitôt que tu as à te plaindre d'eux. Cela te fais craindre, et on déteste ceux qu'on craint. On leur rend plus de mal qu'ils n'en font. Enfin, que tu sois sorcière ou non, je veux croire que tu as des connaissances, mais j'espère que tu ne t'es pas donnée aux mauvais esprits ; tu cherches à le paraître pour effrayer ceux qui te fâchent, et c'est toujours un assez vilain renom que tu te donnes là. Voilà tous tes torts, Fanchon Fadet, et c'est à cause de ces torts-là que les gens en ont avec toi. Rumine un peu la chose, et tu verras que si tu voulais être un peu plus comme les autres, on te saurait plus de gré de ce que tu as de plus qu'eux dans ton entendement.
Robespierre - La fabrication d'un monstre
Jean-Clément Martin
C'est bien évidemment la première biographie que je lisais de Maximilien de Robespierre, qui devait plus tard lui-même se renommer Maximilien Robespierre, l'un des principaux et des plus controversés acteurs de la Révolution française. Le livre est décidément très instructif et réussit bien, comme le veut l'auteur, à remettre les choses en perspective quant au rôle de Robespierre au cours des années 1789-1994, mais le texte est tellement dense, détaillé et chronologique plutôt qu'explicatif, qu'on à parfois de la peine à suivre l'auteur. Mais « Robespierre – La fabrication d'un monstre » est tous compte fait une biographie honnête et éclairante qui contribue à nous prémunir contre les jugements faciles.
Extrait :
Comment un jeune notable est-il devenu l'élu des savetiers ? Reconnaissons que rien ne prédisposait Robespierre à cette évolution. Alors qu'il jouissait d'une position sociale reconnue dans sa ville, il rompt avec son milieu, ou tout au moins ses grandes figures. C'est ce passage complexe qu'il faut expliquer, sans rester en tête à tête avec Maximilien, puisqu'il partage un itinéraire avec beaucoup d'autres de ses semblables, jeunes avocats talentueux, ambitieux et mécontents de leur sort.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza, génocide annoncé – Un tournant dans l’histoire mondiale

Gilbert Achcar
La nouvelle catastrophe subie par le peuple palestinien à Gaza est pire que la Nakba de 1948. C'est le premier génocide perpétré par un État industriel avancé depuis 1945, avec la participation des États-Unis et le soutien de l'Occident, France incluse.
Gilbert Achcar montre que ce génocide n'est ni un accident de l'histoire ni essentiellement une réaction aux tueries perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023, mais qu'il était inscrit dans la trajectoire de l'État sioniste depuis sa fondation. L'auteur analyse le processus historique qui a conduit à la catastrophe actuelle et mène une investigation rigoureuse et documentée de ses conséquences pour la population palestinienne, les peuples de la région et pour les relations internationales dans leur ensemble.
Gilbert Achcar est chercheur franco-libanais, professeur émérite à l'École des études orientales et africaines (SOAS) de l'université de Londres et collaborateur régulier du Monde
diplomatique.
Commentaires de l'édition anglaise
« Adoptant à la fois grand angle et vision rapprochée, le recueil d'essais bouleversants et perspicaces de Gilbert Achcar met en lumière les facteurs historiques et politiques qui ont permis le génocide israélien des Palestiniens de Gaza. Montrant le lien entre le soutien occidental à l'atroce guerre menée par Israël et la banalisation de l'extrême droite mondiale, Achcar ne se contente pas d'analyser la tragédie et de l'interpréter. Il propose également des pistes possibles pour un changement positif qui atténuent quelque peu l'avenir sombre qu'il entrevoit. »
Amira Hass, correspondante de Haaretz pour les territoires occupés de 1967 et autrice de Boire la mer à Gaza.
« Rendant compte et analysant de façon originale et opportune le génocide de Gaza sous de multiples angles, cet ouvrage offre une exploration minutieuse du sens, de la connotation, du contexte et des liens coloniaux qui ont convergé dans cette étroite bande de terre. Gaza, génocide annoncé est l'examen la plus approfondi et le plus complet de ce génocide en rapport avec la Shoah. Considérant le génocide de Gaza comme une conséquence prévisible de l'histoire récente, Achcar tient compte du contexte historique tout au long de son analyse, jusqu'à la toute dernière page. »
Khaled Hroub, chroniqueur et auteur de Hamas : A Beginner's Guide
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La campagne du salaire au travail ménager...
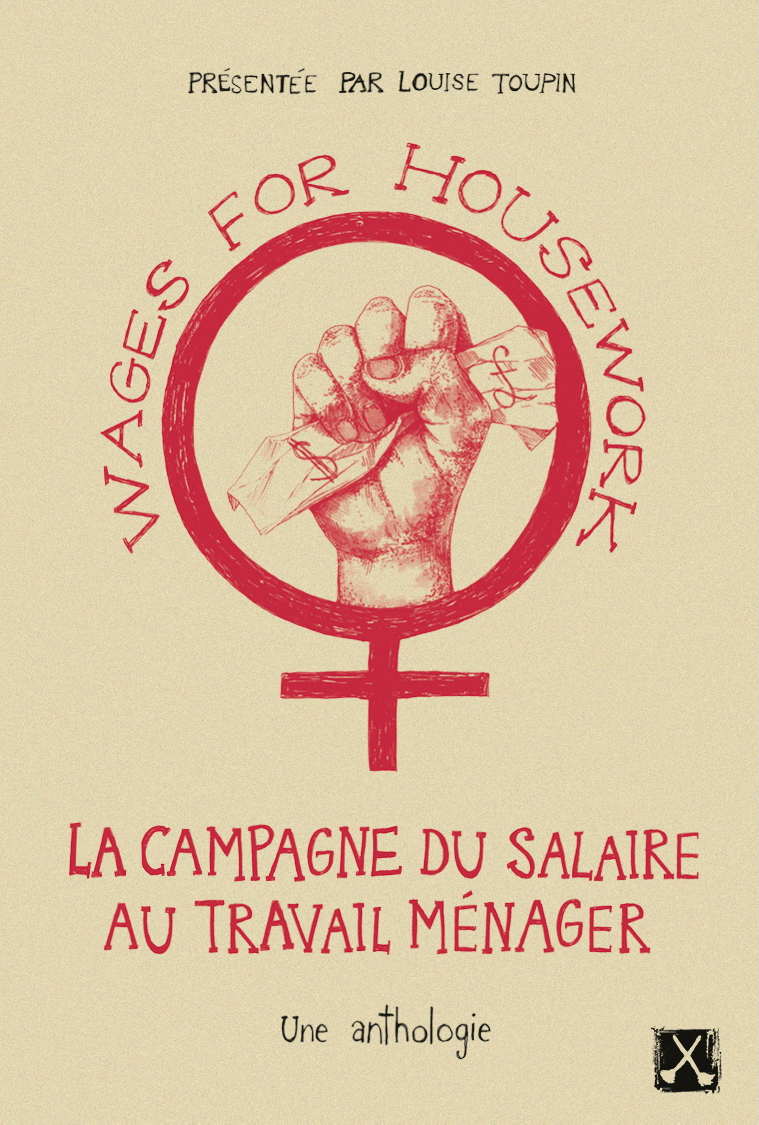
LA CAMPAGNE DU SALAIRE AU TRAVAIL MÉNAGER
Parution le 13 mai 2025 au Québec
Parution le 30 mai 2025 en Europe
https://www.editions-rm.ca/livres/wages-for-housework-la-campagne-du-salaire-au-travail-menager/#tab-description
Présentée par Louise Toupin ·
Avec des textes de Selma James, Mariarosa Dalla Costa, Silvia Federici, Leopoldina Fortunati, Wilmette Brown, Gisela Bock et Barbara Duden, Maria Pia Turri, Wages Due Collective, Black Women for Wages for Housework, Collectif L'Insoumise, Sylvie Dupont et Valérie Simard.
« Nous voulons un salaire pour chaque toilette sale, pour chaque naissance difficile, pour chaque agression sexuelle, pour chaque tasse de café, et pour chaque sourire. »
Si certains écrits de Selma James, de Mariarosa Dalla Costa et de Silvia Federici – instigatrices de la campagne Wages for Housework – ont été traduits en français, aucune anthologie réunissant les textes clés de cette « Internationale des femmes » n'avait jusqu'ici été publiée. C'est ce que propose l'autrice et chercheuse Louise Toupin, après avoir contribué à sauver de l'oubli cette pensée féministe révolutionnaire. Les textes de ces penseuses de premier plan, dont certains sont inédits en français, témoignent de l'originalité et de la force politique du courant de la reproduction sociale. Avant l'heure, ce mouvement proposait une grille d'analyse à l'intersection des questions de genre, de sexe, de race et de classe.
© Chloé Charbonnier
Militante du Front de libération des femmes du Québec (1969-1971) et cofondatrice des Éditions du remue-ménage, LOUISE TOUPIN est chercheuse indépendante et auteure de Le salaire au travail ménager : chronique d'une lutte féministe internationale, 1972-1977 (Remue-ménage, 2014). Elle est en outre coauteure de trois anthologies de textes de militantes féministes publiées aux Éditions du remue-ménage : Québécoises Deboutte ! (1982-1983, avec Véronique O'Leary), La pensée féministe au Québec (2003, avec Micheline Dumont), et de Luttes XXX (2011, avec Maria Nengeh Mensah et Claire Thiboutot). Son livre, Le salaire au travail ménager.Chronique d'une lutte féministe internationale, 1972-1977 est traduit en anglais, en espagnol, en allemand et en italien.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Introduction au livre de Joseph Daher : Gaza : un génocide en cours

Alors que l'écriture de ce livre prenait fin, en janvier 2025, l'État d'apartheid, colonial et raciste d'Israël signait un cessez-le-feu avec l'organisation palestinienne Hamas, suspendant temporairement la guerre génocidaire menée contre la population de la bande de Gaza à la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 [1].
17 mai 2025 | tiré d'entre les lignes entre les mots
Quelques jours après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, le 19 janvier 2025, et la fin du blocage par les autorités d'occupation israéliennes du corridor de Netzarm – qui coupe le territoire en deux, de la frontière israélienne jusqu'à la mer –, des centaines de milliers de personnes palestiniennes déplacées regagnaient le nord de la zone, quand bien même leurs maisons étaient probablement détruites. La trêve est cependant fragile, alors que les menaces et pressions israéliennes, avec le soutien des États-Unis, se poursuivent contre les Palestiniens de la bande de Gaza[2].
Les 2,4 millions d'habitantes et habitants de la bande de Gaza ont vécu depuis octobre 2023 sous des bombardements israéliens constants et d'une violence sans précédent jusqu'à la conclusion de l'accord de cessez-le-feu. Plus de 2 millions de Palestiniennes et Palestiniens ont été déplacés dans le territoire, soit près de 90% de sa population totale. La très grande majorité d'entre elles et eux a été logée dans des tentes de fortune, particulièrement inadaptées aux conditions hivernales.
À la suite de la conclusion du cessez-le-feu, le bilan officiel s'élevait à 61 709 morts – dont 17 881 enfants – et au moins 111 588 blessés. Mais malheureusement, le chiffre est probablement bien plus élevé. Un article publié en juillet 2024 par la revue scientifique médicale britannique The Lancet suggérait que l'attaque alors en cours pourrait d'ores et déjà conduire à 186 000 décès palestiniens. Dans un article paru dans le quotidien The Guardian en septembre, Devi Sridhar, présidente du département de santé publique mondiale à l'université d'Édimbourg, estimait que si la mortalité à Gaza devait se poursuivre au rythme actuel – environ 23 000 décès par mois –, elle pourrait au total atteindre environ 335 500 décès.
Selon un rapport de la Banque mondiale publié à la mi-décembre 2024, 90% de la population dans la bande de Gaza est confrontée à une insécurité alimentaire marquée, dont 875 000 personnes en situation d'urgence et 345 000 personnes en situation d'urgence absolue. En outre, près de 90 % des logements ont été détruits ou sévèrement endommagés. Plus largement, c'est l'ensemble des structures de base du territoire qui sont désormais anéanties : les réseaux de communication sont presque complètement détruits, malgré les efforts des opérateurs locaux pour maintenir de la connectivité ; le secteur privé est également largement réduit à néant, avec plus de 88 % des entreprises détruites ou endommagées, tout comme 70% du réseau routier ; certains secteurs d'activité, tels que l'agriculture ou la pêche, la construction, l'industrie, le transport ou la finance, n'existent tout simplement plus sur le territoire. Le chef du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Achim Steiner, a en effet déclaré à la suite du cessez-le-feu que son organisation estimait qu'environ deux tiers de toutes les constructions ont été détruites ou endommagées par les intenses bombardements de l'armée d'occupation israélienne. Il a ajouté qu'« environ soixante ans de développement ont été perdus dans ce conflit en quinze mois[3] ». La reconstruction de la bande de Gaza pourrait prendre trois cent cinquante ans si le blocus reste en place et était estimée à plus de 53 milliards de dollars[4].
La guerre contre la bande de Gaza constitue sans aucun doute une nouvelle Nakba (catastrophe), encore plus destructrice et meurtrière que celle de 1948, au cours de laquelle plus de 700 000 Palestiniennes et Palestiniens ont été chassés de force de leurs foyers et sont devenus des réfugiés. Ce processus de nettoyage ethnique et d'entreprise génocidaire, qui ne s'est jamais interrompu, s'est poursuivi de manière extrêmement violente durant quinze mois.
En outre, ce livre cherche à inscrire l'histoire de l'oppression des Palestiniennes et Palestiniens par l'État d'Israël dans une approche régionale et internationale. Ainsi, dans sa première partie, qui propose une analyse historique de la trajectoire de la question palestinienne, l'ouvrage examine également le rôle historique joué par l'État d'Israël au Proche-Orient au service de l'impérialisme occidental, et plus particulièrement de la défense des intérêts des États-Unis.
Dans sa deuxième partie, l'ouvrage examine ensuite l'extension de la guerre israélienne au Liban après le 7 octobre 2023, mais plus particulièrement à la suite de l'accélération de la violence israélienne à la mi-septembre 2024. Dans cette partie, nous revenons également brièvement sur l'histoire des agressions et des occupations israéliennes au Liban, dans lesquelles trouve son origine le Hezbollah libanais.
Dans la troisième partie, la chute du régime Assad, au pouvoir en Syrie depuis 1970, est analysée, ainsi que les défis qui se présentent pour les aspirations démocratiques et sociales des classes populaires syriennes.
Dans la section suivante, nous examinons l'impact de la guerre sur les dynamiques politiques régionales du Proche-Orient et différents protagonistes régionaux, comme les monarchies du Golfe, l'Égypte et la Jordanie, ainsi que sur l'Iran et son réseau d'influence régionale.
Finalement, nous abordons la question de la solidarité internationale, ainsi que son importance cruciale dans le cadre de la libération de la Palestine et les liens de cette dernière avec la libération des classes populaires régionales.
Joseph Daher : Gaza : un génocide en cours
Editions Syllepse, Paris 2025, 168 pages, 12 euros
https://www.syllepse.net/gaza-un-genocide-en-cours-_r_25_i_1112.html
Notes
1 Il est à noter également que de nombreux civils israéliens enlevés le 7 octobre 2023 ont été tués par les forces d'occupation israéliennes, notamment du fait de tirs d'obus de char sur des maisons où des Israéliens étaient détenus.
2 L'accord de trêve comprend trois phases devant mener à un arrêt complet des violences israéliennes contre la bande de Gaza et sa reconstruction sur un plan long terme, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé à plusieurs reprises que son pays gardait « le droit de reprendre la guerre » contre le Hamas à tout moment avec l'appui des États-Unis. Début mars 2025, il a d'ailleurs annoncé le blocage de toute aide humanitaire à la fin de la première phase de l'accord de cessez-le-feu.
3 L'ONU estime que si la tendance de croissance de 0,4% observée entre 2007 et 2022 devait se poursuivre, il faudrait pas moins de 350 ans pour que le territoire retrouve les niveaux de PIB de 2022. AFP, « La guerre a effacé 60 ans de développement à Gaza, dit un haut responsable de l'ONU », 25 janvier 2025,
www.lorientlejour.com/article/1445030/la-guerre-a-efface-60-ans-de-developpement-a-gaza-dit-un-haut-responsable-de-lonu-entretien.html
4 « Plus de 50 milliards de dollars nécessaires pour la reconstruction de Gaza », 20 février 2025,
www.lorientlejour.com/article/1448574/update-1-more-than-50-billion-needed-to-rebuild-gaza-world-bank-joint-assessment-says.html
P.-S.
Avec l'aimable autorisation des Editions Syllepse
Via
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/17/introduction-au-livre-de-joseph-daher-gaza-un-genocide-en-cours/

« Israël veut couper tout lien des Palestiniens avec leur terre »
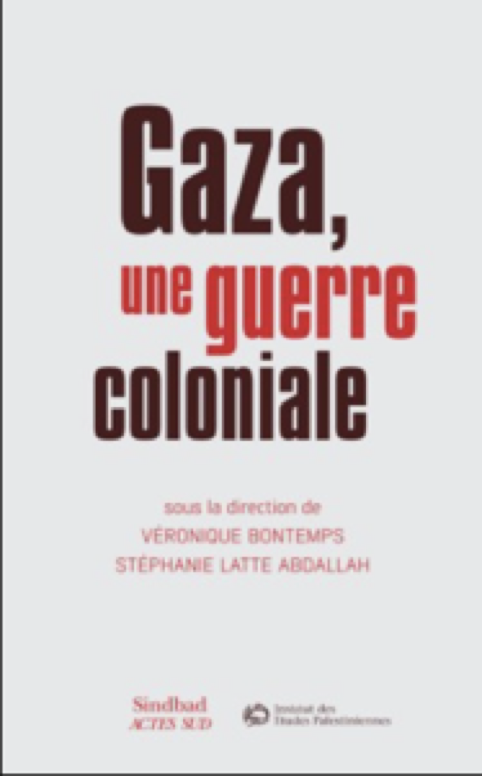
La bande de Gaza est confrontée à « un génocide, un écocide et un futuricide », dénonce l'historienne et politiste Stéphanie Latte Abdallah. Elle a dirigé l'ouvrage collectif « Gaza, une guerre coloniale », paru le 14 mai.
Tiré de Reporterre. Photo : Des ruines autour du camp d'Al Bureij, dans le centre de la Bande de Gaza, le 2 février 2025. Moiz Salhi/Middle East Images/AFP.
Stéphanie Latte Abdallah est historienne et politiste. Elle étudie le Moyen-Orient et les sociétés arabes, s'intéressant notamment aux alternatives sociales et écologiques. Directrice de recherche au CNRS, elle a dirigé avec Véronique Bontemps l'ouvrage collectif Gaza, Une guerre coloniale, paru le 14 mai aux éditions Actes Sud.
Reporterre — Y a-t-il un génocide à Gaza ?
Stéphanie Latte Abdallah — La Cour internationale de justice a pris entre janvier et mai 2024 quatre ordonnances dans l'affaire portée par l'Afrique du Sud mettant en cause l'État israélien pour génocide. À chaque fois, elles ont demandé des mesures conservatoires pour l'empêcher. Ces mesures conservatoires n'ont pas été appliquées. Il apparaît donc clair, de surcroît avec les développements ultérieurs, notamment l'utilisation de la famine comme arme de guerre, et avec le siège total imposé depuis le 2 mars, qu'il s'agit bien d'un cas de génocide.
Aujourd'hui, on compte presque 53 000 tués dans la bande de Gaza et 120 000 blessés, selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé gazaoui, corroborés par l'ONU. Mais différentes projections font état de chiffres bien supérieurs, notamment en raison de milliers de personnes dont les corps sont bloqués sous les décombres, mais aussi des morts indirectes causées par la famine, par la destruction des infrastructures de santé, qui rend impossible de se faire soigner, par un ensemble de maladies chroniques qui ne peuvent être traitées, dont celles causées par la pollution des eaux, etc.
« La pollution des eaux, des sols et de la mer est dramatique »
Une étude publiée dans le journal scientifique The Lancet estimait déjà en juillet 2024 le nombre total de morts à 186 000. On serait donc a minima autour de 200 000 morts, soit 8 à 10 % de la population de la bande de Gaza. C'est absolument terrifiant.
Peut-on aussi parler d'un écocide ?
Oui. Le militaire et les guerres génèrent une très forte toxicité. Cette guerre a ainsi produit une quantité énorme de gaz à effet de serre. Durant les seuls trois premiers mois, du fait des avions de bombardement et de reconnaissance, des drones, on a comptabilisé une émission de CO2 équivalente à celle d'entre 20 et 33 pays à plus faibles émissions pendant un an. 85 000 tonnes de bombes ont été larguées sur ce petit territoire de 360 km2 [à peine plus de trois fois la superficie de Paris] entre octobre 2023 et décembre 2024. Des bombes de deux tonnes ont été employées, ainsi que des bombes au phosphore. Quantité d'entre elles n'ont pas explosé.
Les destructions ont créé plus de cinquante millions de tonnes de gravats, sans compter plus de 350 000 tonnes de déchets qui s'amoncellent. La pollution des eaux, des sols et de la mer est dramatique. Des experts avaient analysé le sol de la bande de Gaza en 2014, après des bombardements qui avaient duré cinquante-et-un jours, et il était déjà toxique. On est aujourd'hui dans une situation sans commune mesure.
« La production agricole, qui permettait une relative autonomie, a été quasiment réduite à néant »
Près de 70 % des zones agricoles ont été rasées et, pour une large partie, sont devenues des zones militaires. Toutes les usines de traitement de l'eau ont été touchées. 83 % des végétaux ont été détruits, l'ensemble de l'élevage (volailles, ovins, caprins) a été décimé, soit par la guerre, soit en raison de la famine pour une consommation immédiate. La production agricole, qui permettait une relative autonomie alimentaire de la bande de Gaza, a été quasiment réduite à néant : entre 70 et 80 % des terres cultivables ont été détruites, de même que les fermes, les puits, les serres, les systèmes d'irrigation... Mais au-delà de l'écocide, je parle aussi d'un « futuricide ».
Que voulez-vous dire par là ?
On détruit le présent, on veut agir sur le passé, l'appartenance, mais aussi sur le futur. Par l'écocide et la destruction de toutes les infrastructures vitales, mais aussi par la destruction des écoles, des universités, des lieux culturels, en s'attaquant également aux souvenirs, aux traces, aux morts même dans les cimetières, le gouvernement israélien entend couper tout lien des Palestiniens et des Palestiniennes de Gaza avec leur terre et les effacer, les arracher au lieu.
Les projets qui sont discutés et qui ont commencé à être mis en œuvre sont ceux d'une occupation durable [70 % de la bande de Gaza est occupée militairement ou soumise à des ordres d'évacuation], d'une nouvelle colonisation assortie de la déportation des Palestiniens dans d'autres pays. Cela place les personnes dans une incertitude que je qualifie de radicale et entend occuper aussi l'espace de projection dans un futur vivable dans ce lieu : cette futurité coloniale est un futuricide pour les Gazaouis, puisqu'ils en seraient exclus. Les colonialismes de peuplement se sont élaborés sur des futuricides des populations autochtones.
Pourquoi l'État israélien se comporte-t-il de façon si abominable ?
Au fil des guerres conduites par Israël contre Gaza, on a observé un abaissement progressif du souci d'éviter ce qui est nommé par ce terme atroce de « dommages collatéraux », pour finalement viser la population civile, véritable objectif de cette guerre. En 2006, a été formulée, à partir de la guerre faite au Liban, la doctrine militaire Dahiya. Elle indique que, pour affaiblir vraiment l'adversaire, il faut viser les infrastructures et les civils, pour pousser la population à se retourner contre le Hezbollah et, ici, le Hamas.
De plus, l'armée israélienne cherche maintenant à éviter au maximum les pertes pour maximiser l'acceptabilité de la guerre auprès de la population israélienne — d'autant qu'elle s'appuie beaucoup sur les réservistes — donc à éviter le corps-à-corps. La guerre est conduite surtout par le ciel, par les drones et les avions de bombardement, mais avec des bombes de diverses précisions, parce que les bombes précises sont plus chères.
« Ce gouvernement ne cache pas son racisme, ni ses intentions »
Quand on vise des personnes qu'on considère de moindre importance, on utilise des bombes peu précises, qui touchent très largement les civils. L'artillerie, elle aussi peu précise, a été privilégiée. Et puis, l'intelligence artificielle s'en est mêlée, pour automatiser la recherche et la destruction des cibles. Pour le dire vite, c'est une forme de néolibéralisation de la guerre : il faut aller vite, pouvoir afficher un certain nombre de cibles atteintes, tout en se déresponsabilisant par la technologie et la mise à distance.
Peut-on dire qu'il y a une désinhibition israélienne à l'égard des effets de la guerre ?
Ah oui, très clairement. Et puis la guerre est menée par un gouvernement d'extrême droite, dont un grand nombre de ministres sont suprémacistes, qui ne fait pas mystère de ses intentions. Les Palestiniens sont à leurs yeux complètement déshumanisés.
Ils considèrent que les Palestiniens sont une race inférieure ?
C'est exprimé très clairement. L'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant a lui-même parlé des Palestiniens comme d'« animaux humains » et les déclarations en ce sens des dirigeants israéliens sont très nombreuses. Ce gouvernement ne cache pas son racisme, ni ses intentions.
Une autre raison de la détermination israélienne serait la présence de ressources pétrolières au large de Gaza. Qu'en est-il ?
Il y a deux grands champs gaziers et pétroliers au large du Liban, d'Israël, mais aussi de Gaza : Leviathan et Karish. Au large de Gaza, les réserves pétrolières seraient de 1,7 milliard de barils, selon les chiffres publiés en 2019 par la Cnuced [Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement]. Il est déjà exploité par Israël depuis 2022 sur sa partie nord, en accord avec le Liban. Mais il y a toute une partie qui ne l'est pas, notamment le long des côtes gazaouies.
On peut donc se demander si l'une des intentions de cette guerre n'est pas aussi de s'approprier l'ensemble du champ. Avec la guerre en Ukraine, il s'est produit une redirection de l'approvisionnement en gaz, Israël en a bénéficié et se voit comme un fournisseur potentiel important de l'Europe. L'extractivisme participe de l'écocide.
Ce qui se passe à Gaza ne présage-t-il pas ce que pourrait devenir un capitalisme totalement autoritaire et violent ?
Je crois que oui. Un capitalisme néolibéral, militarisé, violent, couplé à un humanitaire militarisé, puisque c'est ce qu'ils veulent mettre en place, en empêchant toute forme d'autonomie au territoire. La dépendance de la bande de Gaza a été mise en place au fil du temps et prend une tournure dramatique aujourd'hui avec un siège hermétique.
« En Israël, la militarisation de l'économie va s'accroître plus encore avec ce conflit »
On constate d'ailleurs des coopérations fortes entre l'armée israélienne — notamment son unité 8200, spécialisée dans la tech — et Microsoft et OpenAI. Microsoft est un partenaire de l'armée israélienne de longue date et, sans cette entreprise — et d'autres de la Silicon Valley — l'armée ne pourrait pas avoir développé ces nouvelles technologies et plateformes léthales, ni conduire cette guerre high-tech avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui produit des assassinats de masse. En retour, en Israël, la militarisation de l'économie va s'accroître plus encore avec ce conflit. À une échelle plus globale, une économie plus militarisée encore est en train de s'installer.
Dans le livre que vous codirigez, on lit une histoire très forte qui montre comment, malgré toutes les destructions de la guerre, des paysans ont réussi à relancer une production agricole, marginale, mais réelle. Cela signifie-t-il qu'il sera possible de restaurer Gaza ? Cela ne dément-il pas le concept de futuricide ?
Bien sûr qu'il sera possible de restaurer. Le futuricide est une intention israélienne, cela ne veut pas dire qu'elle sera réalisée. Et il est de la responsabilité morale et politique de la communauté internationale, de l'Europe, de la France, d'agir enfin pour l'empêcher. Les Palestiniens inventent chaque jour des possibilités et des initiatives matérielles et concrètes, artistiques, créatrices, d'envisager l'avenir sur cette terre.
Se projeter dans un avenir, c'est aller contre la futurité coloniale, ne pas l'accepter. Il y a, malgré tout, une énergie impressionnante. Des histoires comme celle-ci sont nombreuses. Un poème de l'universitaire et poète Refaat Alareer, qui a été assassiné par l'armée israélienne le 6 décembre 2024, dit : « Si il est écrit que je dois mourir, alors que ma vie apporte l'espoir, que ma mort devienne un conte ». Il signifie que tant que seront transmises les histoires des gens et de la vie en ce lieu, tout sera possible. Il y aura un futur à Gaza et en Palestine, en dépit de celui qu'on veut leur imposer.
Gaza, une guerre coloniale, sous la direction de Stéphanie Latte Abdallah et Véronique Bontemps, aux éditions Actes Sud, mai 2025, 320 p.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Homophobie et transphobie dans nos écoles
En cette Journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, les médias soulignent la montée inquiétante des deux phénomènes dans nos écoles.
dénoncées par les Artistes pour la Paix le 17 mai
Faits statistiques
Avec raison, ils relatent des résultats d'enquêtes sur le terrain qui révèlent l'inconfort des jeunes, en particulier des gars, face à l'éventualité d'avoir un meilleur ami gai, qui de 66,2% en 2017/18 est monté à un alarmant 84,8% cette année. Chez les femmes, le recul par rapport à l'acceptation des lesbiennes est moins spectaculaire, de 59.6% à 75,3% : les spécialistes rémunérés qui luttent contre de tels phénomènes s'entendent pour y voir des reculs majeurs, et ce dans un laps de temps étonnamment court. Les solidaires Roxane Milot et Manon Massé demandent la solidarité de la part de tous-tes pour contrer cette vague anti-queer.
Solutions médiatisées
On appuie évidemment certaines solutions mises de l'avant pour célébrer l'avancée des femmes par l'ouverture de la Place des Montréalaises par Valérie Plante, célébrant un « Montréal féministe et fier de l'être ». Nathalie Provost, nouvelle ministre fédérale issue de Polysesouvient collectif que les APLP appuient depuis 1990, fêtait cet événement avec Kim Thuy et on soulignait, comme signe d'avancement d'anti-racisme, l'ouverture de la Place Marie-Josèphe Angélique, nommée en l'honneur d'une esclave noire née en 1705 et victime d'un procès expéditif l'ayant accusée et exécutée comme responsable d'un grave incendie en 1734. Les médias s'entendent, entre autres par intérêt financier, pour accuser les réseaux sociaux d'accélérer la montée de l'homophobie, de la transphobie et du racisme, notamment par leur reproduction de discours brefs, injurieux et polarisants.
Montée de l'extrême-droite guerrière
Alors qu'ils censurent notre condamnation du génocide en cours à Gaza, les « radios-poubelles » de Québec vantent Poilievre et Duhaime, ainsi que les discours guerriers de Nétanyahou, Zelensky, Kim Jung-un et Trump, qui malgré sa tendance récente à vouloir favoriser des solutions de paix, n'en a pas moins haussé les dépenses militaires américaines à des niveaux astronomiques, incitant M. Carney à en faire autant dans leur rencontre vantée comme un succès par nos médias. Les Artistes pour la Paix sont censurés en tout : ce n'est qu'hier, que Radio-Canada faisait un reportage détaillé remettant en question l'appui invraisemblable des démocrates américains à un Biden vieillissant, alors que nous félicitions au début juillet 2024 le comédien George Clooney de lancer ce signal d'alarme.
Tandis que nos écoles, mais surtout nos collèges et universités sont définancés par le gouvernement Legault et la ministre Déry, les citoyens de moins en moins éduqués et privés de productions culturelles en pannes de financement ouvrant leurs horizons, se détournent des analyses favorisant la diplomatie plutôt que la guerre, la construction de transports collectifs plutôt que la voiture individuelle et l'opposition aux pipelines et à l'énergie nucléaire coûteux, donc défendus par de riches groupes d'intérêts privés sans éthique inondant les médias.
Issues des cris d'alarme payants pour l'OTAN et les propriétaires de médias également propriétaires d'usines d'armement, des analyses primaires médiatiques de la guerre en Ukraine censurent Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et le professeur Jeffrey Sachs de l'Université Columbia. Et on ignore des publications détaillées sur la révolution du Maïdan à la crédibilité indéniable (i).
Conséquemment, la montée des partis de droite en Europe frappe tout azimut : une pétition « d'initiative citoyenne » d'un million d'Européens appelle impérativement à interdire les « thérapies de conversion » des personnes LGBTQI.
Le Québec est privilégié de voir émerger des initiatives telles que NOUS, nouveau magazine pour tous.tes financé par la Table de la Concertation intersectorielle violence conjugale-Est et les opinions diffusées et les films de Léa Clermont-Dion et de Guylaine Maroist ; mais ils sont à une dose infime par rapport aux films Minecrafts, Thunderbolts, L'amateur, Combattre ou fuir, Star Wars et autres déchets américains toxiques qu'on voit présentement à l'affiche.
Qui va voir Le temps de François Delisle, une dystopie qui annonce vers où le monde court ? Qui a écouté l'émission de Claude Saint-Jarre du 15 mai 2025 de 50 minutes avec comme invité Pierre Jasmin, secrétaire général des Artistes pour la paix parlant de l'actualité guerrière qui développe l'agressivité ambiante qui enfle pour attaquer les plus fragilisés de notre société ? À écouter sur https://www.cfak.ca/balados/a-nous-le-futur
Nostalgie
Les Artistes pour la Paix remerciaient Jean-Daniel Lafond, cinéaste et écrivain, présent le 15 février 2016 à la remise du prix de l'APLP de l'Année à l'autochtone Samian à la Mairie de Montréal, honorant aussi Michel Rivard, encadré par Guylaine Maroist et Judi Richards et dont une chanson été interprétée par le groupe multi-ethnique Surkalen.
Nous déplorions alors à propos de l'exposition de jeunes musulmanes au Musée des Beaux-Arts de Montréal favorisée par la Fondation Michaëlle Jean, l'absence totale de couverture de nos médias francophones, alors que la majorité des artistes couronnées s'exprimait en un français impeccable et que the Gazette et la CBC avaient saisi l'importance de l'événement ! C'était grâce à Nathalie Bondil, maintenant à la tête à Paris de l'Institut du monde arabe qui lance une initiative remarquable (ii). Nous avions alors souligné l'interprétation par Joël Janis d'une superbe version très applaudie d'une chanson non moins superbe de Michel, aux paroles inspirées reproduites dans notre article intitulé l'art de l'inclusion. Nous publiions alors des statistiques alarmantes qui parlaient d'elles-mêmes de la nécessité de développer la politique du vivre-ensemble, par exemples :
• 70% de la population montréalaise n'est pas née à Montréal ;
• 33% sont nés à l'extérieur du Canada ;
• suite à une forte immigration entre 2001 et 2011, 10% sont musulmans ;
• mais malgré leur taux plus élevé de scolarisation, ils souffrent d'un taux de
chômage de 18%, taux qu'on ne peut attribuer seulement à leur plus jeune âge.
C'est aujourd'hui la mode de critiquer le fardeau de l'immigration haïtienne et autre, et vu la censure de nos articles, le nombre de nos membres diminue : nous publierons bientôt, toujours sans subvention, notre infolettre pour inviter les LGBTQIA à se joindre à nous !
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Forum social mondial des intersections 2025 (FSMI)

Face à une époque marquée par des extrémismes croissants, des inégalités sociales exacerbées et une crise écologique sans précédent, le FSMI offre un espace d'articulation. Il vise à rassembler celles et ceux qui agissent pour construire des alternatives durables et solidaires.
L'histoire du FSMI
Le Forum social mondial des intersections 2025 (FSMI) est une démarche qui chemine vers un grand rassemblement ayant lieu du 29 mai au 1er juin 2025. Son principal objectif : encourager des changements systémiques, grâce aux intersections de perspectives, de savoirs et d'espoirs. Il a ainsi pour ambition de décloisonner les milieux d'action, les cultures et les pratiques, tout en créant des connexions intergénérationnelles et transnationales, du local au global. Le FSMI 2025 s'inscrit dans la dynamique du Forum social mondial (FSM), le plus grand rassemblement de la société civile mondiale créé en 2001 au Brésil. Ce dernier réunit, à chaque édition, des milliers de participant·es autour de centaines d'activités (ateliers, conférences, performances artistiques…) axées sur des thématiques variées telles que le développement social, l'économie solidaire, les droits humains ou encore l'environnement.
Le FSMI 2025 se situe comme un important moment de mobilisation pour le prochain Forum social mondial qui aura lieu à Cotonou au Bénin en janvier 2026.
Face à une époque marquée par des extrémismes croissants, des inégalités sociales exacerbées et une crise écologique sans précédent, le FSMI offre un espace d'articulation. Il vise à rassembler celles et ceux qui agissent pour construire des alternatives durables et solidaires.
Nous avons besoin de lieux pour croiser nos perspectives, mutualiser nos savoirs et renforcer nos actions. Le FSMI est un appel à l'espoir et à la solidarité, pour unir la force des initiatives locales et l'ambition d'un changement global indispensable.
Nous sommes fiers de collaborer avec le collectif la Grande transition et le Festival des saveurs pour cette première édition.
L'achat de votre billet pour le FSMI vous donne également accès à ces deux événements ! Consultez leur site web pour découvrir leur programmation, qui se déroulera aussi entre le 29 mai et le 1er juin 2025.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Geonomics », nationalisme et commerce, par Michael Roberts

Dans cette analyse, l'économiste marxiste Michael Roberts revient, à travers le concept à la mode des « geonomics », sur le revirement de certains économistes étasuniens, passant d'une approbation totale du libre-échange à une stratégie protectionniste, afin de battre en brèche leurs espoirs de redresser l'impérialisme américain grâce à cette nouvelle politique.
14 mai 2025 | Tiré de Révolution Permanente
Cet article a été publié le 13 mai 2025 sur le blog Michael Roberts.
Les « geonomics » sont un néologisme utilisé pour parler des théories et politiques économiques internationales. Gillian Tett déclarait récemment dans le Financial Times, que dans le passé, « il était généralement admis que c'était l'intérêt économique rationnel qui régnait, et non pas les magouilles politiques. La politique était considérée comme un dérivé de l'économie, et non l'inverse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump a choqué de nombreux investisseurs, tant elle semble irrationnelle au regard des normes de l'économie néolibérale. Mais « rationnelle » ou non, elle reflète le passage à un monde où l'économie a pris le pas sur les jeux politiques, non seulement en Amérique, mais aussi partout dans le monde ».
Lénine disait que « la politique est l'expression concentrée de l'économie », argumentant ainsi que les politiques des États et leurs « continuations par d'autres moyens », c'est-à-dire les guerres, étaient justifiées en dernière instance par les intérêts économiques des classes dirigeantes et du capital de chaque pays. La politique de Donald Trump aurait renversé ce paradigme : l'économie serait désormais régie par la politique ; les intérêts de classe des bourgeoisies nationales par les intérêts politiques de castes. Et nous aurions donc besoin de théories économiques capables de modéliser ce tournant : place aux « geonomics ».
Voilà que les geonomics émergent pour rendre cette politique respectable et « réaliste ». La démocratie libérale et le multilatéralisme ainsi que l'économie libérale – c'est-à-dire le libre-échange et les marchés libres –, ne sont plus pertinents pour les économistes, formés auparavant à promouvoir un monde économique d'équilibre, d'égalité, de concurrence et d'« avantages comparatifs » pour tous. Tout cela, c'est fini : désormais, l'économie consiste en des luttes de pouvoir menées par des États poursuivant leurs propres intérêts nationaux.
Dans un récent article, les économistes spécialisés dans l'OMC et les politiques commerciales internationales Aaditya Mattoo, Michele Ruta et Robert W. Staiger défendaient que les économistes doivent aujourd'hui considérer que pour exercer leur puissance, les pays n'useront plus de l'aval économique, mais du pouvoir politique brut. Dans cette perspective, dans les prochaines années les États-Unis mettraient de côté leurs gains de productivité et d'investissements intérieurs pour contraindre par la force les autres pays à aller dans leur sens. Ainsi, selon ces économistes, « les pays hégémoniques cherchent souvent à influencer des entités étrangères sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle direct. Ils le font soit en menaçant de conséquences négatives si la cible n'entreprend pas les actions souhaitées, abaissant ainsi l'option extérieure de la contrainte de participation, soit en promettant des avantages positifs si la cible entreprend les actions souhaitées ».
Selon ces chercheurs de la Banque Mondiale, ce virage vers une « économie du pouvoir » peut bénéficier à la fois aux grandes puissances et aux cibles de leurs menaces : « l'hégémonie peut être façonnée de manière à ce que l'économie mondiale en tire profit ». Une opinion qui n'est sûrement pas partagée par la Chine, dont Trump, en tant que dirigeant de la seule puissance hégémonique aujourd'hui, tente d'étrangler l'économie à coup de sanctions, de taxes douanières exorbitantes et de boycott des entreprises et investisseurs chinois partout dans le monde. Les États-Unis sont déterminés à utiliser tous les moyens de politique, y compris la guerre si nécessaire, contre leurs opposants pour maintenir leur place sur l'échiquier mondial et le remodeler en leur faveur. Mais l'agressivité des États-Unis pourrait tout de même être bénéfique pour l'économie mondiale. Que les pays pauvres du monde entier qui sont confrontés à des droits de douane importants sur leurs exportations vers les États-Unis se le tiennent pour dit.
Bien entendu, l'idée d'une coopération internationale entre acteurs égaux pour faciliter le commerce et l'extension des marchés a toujours été une illusion. Il n'y a jamais eu de commerce entre égaux ; il n'y a jamais eu de concurrence « loyale » entre des capitaux de taille à peu près égale au sein des économies ou entre les économies nationales sur la scène internationale. Les grands et les forts ont toujours mangé les faibles et les petits, en particulier lors des crises économiques. Qui plus est, cela fait deux siècles que les puissances impérialistes occidentales pillent sans relâche des milliers de milliards de dollars de ressources des économies périphériques de pays dominés.
Ceci dit, il est vrai qu'une partie des élites capitalistes a changé d'avis sur la politique économique, en particulier depuis la crise financière mondiale de 2008 et la longue dépression qui s'est ensuivie au niveau de la croissance économique, de l'investissement et de la productivité. Dans l'immédiat après-guerre, des agences commerciales et financières internationales ont été créées sous le contrôle, principalement, des États-Unis. La rentabilité du capital dans les principales économies était élevée, ce qui a permis au commerce international de se développer, parallèlement à la renaissance de la puissance industrielle européenne et japonaise. C'est également à cette époque que l'économie keynésienne a dominé, c'est-à-dire que l'État a agi pour « gérer » le cycle économique en cours et soutenir l'industrie au moyen d'incitations et même d'une certaine stratégie industrielle.

Titre : Taux de profit sur le capital du G7 (pondéré) %
Texte du graphique : l'âge d'or, profitabilité ; baisse de la profitabilité ; émergence du néolibéralisme : reprise de la profitabilité ; longue dépression : baisse de la profitabilité.
Cet « âge d'or » des Trente Glorieuses a pris fin dans les années 70, lorsque les taux de profit du capital ont brutalement chuté (si l'on suit la théorie de Marx) et que les grandes économies ont subi le premier effondrement simultané en 1974-75, suivi en 1980-2 par un profond ralentissement de l'industrie manufacturière. L'économie a abandonné le keynésianisme, perçu comme un échec, et est revenue à l'idée néoclassique des marchés libres, de la libre circulation des échanges et des capitaux, de la déréglementation de l'ingérence de l'État et de la propriété de l'industrie et de la finance, et de l'écrasement des organisations syndicales et du mouvement ouvrier.
Mais l'économie ne peut pas échapper à la théorie du profit, et les principales économies ont de nouveau vu les taux de profit de leurs secteurs productifs chuter au début du XXIe siècle. Cette réalité a beau avoir été maquillée par un essor considérable du crédit dans la finance, l'immobilier et d'autres secteurs dits improductifs, elle n'en est pas moins restée une crise sous-jacente de la rentabilité. Dans le graphique ci-dessous, la ligne bleue représente la rentabilité des secteurs productifs américains, et la ligne rouge, la rentabilité globale.

Source : BEA NIPA tables, calculs de l'auteur
Cette stratégie a inévitablement mené à une crise financière mondiale, la crise de la dette européenne et une période de « Longue Dépression » suite à la récession de 2008-2009, aggravée par la crise du Covid en 2020. Le capital européen en est sorti déstabilisé. Suite à un essor prodigieux dans l'industrie, le commerce, ainsi que la technologie, l'économie américaine a vu émerger un nouveau rival que les crises successives des économies occidentales n'ont pas touché : la Chine.
Au début des années 2020, comme le souligne Gillian Tett du Financial Times, « le balancier oscille à nouveau vers un protectionnisme plus nationaliste (avec une touche de keynésianisme militaire), ce qui correspond à un schéma historique. Aux États-Unis, le trumpisme constitue une forme extrême et instable de nationalisme, qui semble désormais être étudiée sérieusement par la toute nouvelle école de « geonomics ». L'intervention et le soutien du gouvernement, de type keynésien, pour protéger et relancer les secteurs productifs affaiblis aux États-Unis est une politique que Biden avait lancée, en parallèle d'une “stratégie industrielle” d'incitations et de financements gouvernementaux en faveur des géants américains de la technologie, associée à des droits de douane et des sanctions contre les rivaux, c'est-à-dire la Chine. Ce que fait Trump aujourd'hui, ce n'est que de durcir cette stratégie. »
La politique protectionniste de Trump sur le plan international s'accompagne au niveau national d'une politique d'intervention qui consiste à décimer les services publics, à mettre fin aux dépenses de protection de l'environnement et du climat, à déréguler la finance et l'environnement, tout en renforçant les forces militaires et de sécurité intérieure (en particulier pour augmenter les déportations et la répression).
Les économistes de droite œuvrent donc pour rendre sensée et enviable cette politique économique brutale aux yeux de la population américaine. Marc Fasteau et Ian Fletcher, deux économistes adulés par la communauté MAGA et membres du “Council for a Prosperous America” (Conseil pour une Amérique prospère), un organisme financé par un groupe de petites entreprises de la production et du commerce intérieur, ont récemment déclaré dans un nouveau livre intitulé Industrial Policy for the United States : « Nous sommes une coalition inégalée d'industriels, de travailleurs, d'agriculteurs et d'éleveurs qui travaillent ensemble pour reconstruire l'Amérique pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants. Nous privilégions l'emploi de qualité, la sécurité nationale et l'autosuffisance nationale par rapport à la consommation bon marché. » Cet organisme défend donc activement l'unité entre le capital et les travailleurs pour « rendre à l'Amérique sa grandeur ».
Fasteau et Fletcher défendent que si l'hégémonie des États-Unis est en difficulté sur la scène internationale, c'est à cause du néolibéralisme et de l'économie de marché néoclassique : « Le laissez-faire a échoué et une politique industrielle solide est le meilleur moyen pour l'Amérique de rester prospère et sûre. Trump et Biden ont mis en place certains éléments, mais les États-Unis ont maintenant besoin de quelque chose de systématique et de complet, y compris des droits de douane, un taux de change compétitif et un soutien fédéral à la commercialisation – et pas seulement à l'invention – des nouvelles technologies. »
La « politique industrielle » que défendent ces deux auteurs repose sur trois piliers : reconstruire les industries nationales clés ; protéger ces industries de la concurrence étrangère par le biais des taxes douanières et de sanctions à l'encontre des économies étrangères qui posent un problème aux exportations américaines ; et enfin, « gérer » le taux de change du dollar de manière que le déficit commercial américain disparaisse – c'est-à-dire dévaluer le dollar.
Fasteau et Fletcher réfutent la théorie ricardienne de l'avantage comparatif, théorie sur laquelle s'appuie encore le discours économique dominant pour affirmer que le « libre » échange international profitera à tous les pays, toutes choses égales par ailleurs. Ils considèrent que le « libre-échange » peut en fait réduire la production et les revenus d'un pays comme les États-Unis en raison des importations bon marché, provenant de pays où la main d'œuvre est peu chère, qui détruisent les producteurs nationaux et affaiblissent la capacité de ces derniers à gagner des parts de marché à l'exportation au niveau mondial.
Ils affirment que les politiques protectionnistes de taxation des importations peuvent stimuler la productivité et les revenus de l'économie nationale. Ce qui les amène à dire que « la politique américaine de libre-échange, forgée à une époque révolue de domination économique mondiale, a échoué tant en théorie qu'en pratique. Des modèles économiques novateurs ont montré comment des droits de douane bien conçus, pour ne citer qu'un exemple de politique industrielle, pourraient nous offrir de meilleurs emplois, des revenus plus élevés et une croissance du PIB ». Ainsi, en suivant leur raisonnement, Fasteau et Fletcher en viennent à affirmer que l'augmentation des taxes douanières fait augmenter les salaires.
Ce que révèle en réalité la position des deux économistes en question, ce sont les intérêts du capital américain à se recentrer sur une économie nationale pour pallier le fait qu'il n'est plus en mesure d'être compétitif sur les marchés comme il l'était jusqu'à présent. Comme l'affirmait Engels au XIXe siècle, le libre-échange est soutenu par la puissance économique hégémonique tant qu'elle domine les marchés internationaux avec ses produits ; mais lorsqu'elle perd sa position dominante, elle adopte des politiques protectionnistes. C'est ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle avec la politique britannique. Aujourd'hui, c'est au tour des États-Unis.
Ricardo (et les économistes néoclassiques d'aujourd'hui) a tort de prétendre que tous les pays profitent du commerce international s'ils se spécialisent dans l'exportation de produits pour lesquels ils disposent d'un « avantage comparatif ». Le libre-échange et la spécialisation fondée sur l'avantage comparatif n'entraînent pas une tendance à l'avantage mutuel. Ils créent davantage de déséquilibres et de conflits. En effet, la nature des processus de production capitaliste crée une tendance à la centralisation et à la concentration croissantes de la production, ce qui conduit à un développement inégal et à des crises.
D'autre part, les apologistes du protectionnisme ont tort de prétendre que les droits de douane et d'autres mesures du même acabit peuvent rétablir la part de marché antérieure d'un pays. Mais Fasteau et Fletcher n'ont pas que les droits de douane en tête. Ils définissent la politique industrielle comme suit : « Un soutien gouvernemental délibéré aux industries, ce soutien pouvant être classé en deux catégories. Premièrement, les politiques générales qui aident toutes les industries, comme la gestion des taux de change et les allègements fiscaux pour la R&D. Il y a ensuite les politiques qui ciblent des industries particulières ou des secteurs particuliers. Deuxièmement, les politiques qui ciblent des industries ou des technologies particulières, telles que les taxes douanières, les subventions, les marchés publics, les contrôles à l'exportation et la recherche technologique effectuée ou financée par le gouvernement. »
La stratégie industrielle de Fasteau et Fletcher ne fonctionnera pas. Dans une économie donnée, la hausse de la productivité et la baisse des prix nécessitent un investissement dans les secteurs qui génèrent de la productivité. Mais l'économie capitaliste est régie par des entreprises avides de profits, qui n'investiront pas dans lesdits secteurs si le taux de profit décroît, à l'image de la situation économique des deux dernières décennies. Fasteau et Fletcher veulent un retour aux politiques de temps de guerre et à la stratégie de la guerre froide pour développer l'industrie nationale, la science et les forces militaires. Mais cela ne fonctionnerait que par le biais d'investissements massifs vers le secteur public, par le biais d'entreprises publiques avec une planification industrielle nationale. Une perspective dont ni Fasteau et Fletcher ni Trump ne veulent entendre parler.
Fasteau et Fletcher affirment que leur politique économique n'est ni de gauche ni de droite, ce qui est vrai d'un certain point de vue. L'utilisation d'une stratégie industrielle du même ordre est revendiquée par les keynésiens de gauche en Grande-Bretagne, par Elizabeth Warren et par Sanders aux États-Unis, et même par Mario Draghi en Europe. Cette « stratégie industrielle » a été adoptée comme politique économique dans la plupart des économies d'Asie de l'Est au cours de la seconde moitié du XXe siècle (bien qu'elle soit de moins en moins utilisée).
Bien entendu, la prétendue neutralité de leur stratégie industrielle ne s'applique pas à la Chine, puisque cette dernière est, en leurs propres termes, « la première menace qui soit à la fois militaire et économique à laquelle les États-Unis sont confrontés en plus de 200 ans ». Ils le disent sans ambages : « Un nombre croissant d'industries chinoises sont en rivalité aiguë avec des industries américaines de grande valeur, et les gains de la Chine sont nos pertes. Les États-Unis ne peuvent rester une superpuissance militaire sans être une superpuissance industrielle. » Voilà en quelques mots les raisons pour lesquelles le capitalisme américain abandonne l'économie néoclassique et son laisser-faire, son libre-échange, qui faisaient jusqu'à présent unanimité dans les institutions économiques. La domination économique des États-Unis et de l'Europe est affaiblie, au point que la Chine pourrait les remplacer d'ici à quelques décennies. Dans ce contexte, plus besoin de prendre des pincettes pour justifier une stratégie protectionniste et impérialiste agressive.
Fini la fable de la libre concurrence, du marché et du commerce, qui de toute façon n'ont jamais existé. Place au réalisme : aujourd'hui, il faut gagner la bataille pour le droit à l'hégémonie et à la domination du capitalisme mondial. Et dans cet âpre combat, la fin justifie les moyens. Voilà ce qu'est réellement la théorie des « geonomics », de plus en plus revendiquées chez certains économistes, et qui ne manqueront pas de se faire bientôt une place dans les départements d'économie des grandes universités américaines et européennes – et ce malgré l'opposition d'arrière-garde des professeurs néoclassiques et néolibéraux actuellement dominants.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Li Anderson : « Il y a des pays où des forces plus progressistes maintiennent vivant l’agenda du travail »

Dans une interview avec Esquerda.net, la députée européenne de l'Alliance de la Gauche et ancienne ministre de l'Éducation de Finlande, Li Anderson, parle de l'agenda progressiste pour le travail dans l'Union européenne et de l'exploitation de la main-d'œuvre en situation irrégulière.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Les économies européennes profitent de la main-d'œuvre en situation irrégulière pour faire baisser la valeur du travail. Cette main-d'œuvre migrante entre dans les pays européens pour répondre aux besoins causés par les crises démographiques européennes, mais elle finit par être ultra-précarisée et surexploitée. Cela a un impact sur l'ensemble du marché du travail européen.
Dans une interview avec Esquerda.net, la députée européenne de l'Alliance de Gauche de Finlande, ancienne ministre de l'éducation et ancienne leader de son parti, parle des défis de l'agenda du travail européen, des attaques que l'extrême droite mène contre les travailleurs et du modèle d'immigration de l'UE.
L'Union européenne traverse une crise démographique, qui a été comblée par le travail des migrants. Mais la droite a attaqué les immigrés tout en les exploitant. Y a-t-il une contradiction ici ?
« Le changement démographique est une réalité dans l'UE. Si nous regardons simplement les chiffres, il est assez clair que notre main-d'œuvre diminue constamment. Elle diminuera d'environ un million par an jusqu'en 2030. Bien sûr, il existe plusieurs solutions à cela, car nous avons également des personnes sous-représentées sur le marché du travail. Il existe encore des pays dans l'UE où les femmes ne peuvent pas participer pleinement au marché du travail. Tous les pays de l'Union européenne font face à des défis majeurs avec les personnes handicapées, par exemple. Elles ne participent pas pleinement au marché du travail. Je n'aime pas le discours qui associe l'immigration uniquement au besoin de main-d'œuvre en Europe. Je pense que la politique d'immigration doit être fondée sur le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme. »
En termes de droits du travail, quelles garanties pouvons-nous donner aux travailleurs migrants ?
« Nous devons veiller à ce que les droits de tous soient respectés de manière égale sur le marché du travail. Nous avons un problème en Europe avec l'insertion au travail des travailleurs migrants, tant dans ces situations transfrontalières qu'au sein des pays. Nous devons travailler encore plus pour renforcer les accords de négociation collective, les syndicats, les services d'inspection nationaux, afin que nous puissions garantir que tous ceux qui travaillent ici ont également droit à un salaire décent et au même respect en ce qui concerne les droits du travail. »
J'ai voulu aborder le sujet car c'est un thème de campagne au Portugal. Nous avons des milliers de personnes qui se trouvent dans des situations fragiles, avec des procédures en attente. Comment, en tant qu'Union européenne, dans un sens plus large et plus global, mettons-nous en œuvre ces politiques ?
« C'est simple. Plus il y a de politiques nationales pour garantir que les gens ne vivent pas sans documents ou sans identification, plus il sera facile de lutter contre les situations irrégulières. En Finlande, avant que l'extrême droite ne commence à modifier la politique migratoire, nous avions un système où, s'il n'était pas possible d'obtenir un permis de séjour permanent pour une raison quelconque, un permis temporaire était accordé. Pourquoi est-ce si important ? Parce que cela signifie que lorsqu'on est dans un pays, on y est légalement et on y travaille aussi légalement. Si nous commençons à restreindre les possibilités pour les gens d'obtenir des permis de séjour, par exemple, ils doivent continuer à vivre d'une manière ou d'une autre. Ils devront manger, ils devront dormir quelque part, ils devront payer un loyer. Dans ce scénario, on crée les conditions pour le travail sans papiers et aussi pour l'exploitation du travail, car cela signifie également que les gens n'ont pas la possibilité de formaliser leur travail. »
La réponse est la régularisation.
« Avoir un système de permis de séjour basé sur l'idée que, si une personne est ici pour une raison quelconque, elle doit pouvoir le faire officiellement, avoir des documents et avoir au moins un permis de séjour temporaire. C'est aussi la meilleure façon de lutter contre l'exploitation du travail. »
Au Portugal, l'agenda politique de la gauche sur le travail s'est concentré sur la récupération des droits perdus pendant la crise de la Troïka, mais aussi sur des propositions pour les travailleurs postés ou sur la semaine de quatre jours. Quelles propositions sur les droits du travail la gauche présente-t-elle dans le reste de l'Europe ?
« Au niveau européen, il existe plusieurs exemples intéressants de pays où des forces plus progressistes maintiennent vivant l'agenda du travail et mettent également en œuvre des politiques. L'Espagne en est un exemple, où ils avancent avec une réforme pour une semaine de travail plus courte. La Pologne a introduit un nouveau jour libre, ce qui n'est pas super révolutionnaire, mais représente quand même moins de temps de travail. Ils sont sur le point de faire une expérience avec une semaine de travail plus courte. En Islande, les syndicats ont réussi à approuver une réforme basée sur un accord collectif pour la réduction du temps de travail. En fait, je pense qu'il existe des exemples inspirants de différentes régions d'Europe sur la nécessité de ce type de politique progressive. La Finlande est, d'une certaine manière, un très mauvais exemple, car ce pour quoi nous luttons actuellement en Finlande, ce sont les piliers essentiels de tout notre modèle de marché du travail, que l'extrême droite tente de démanteler. Ils ont restreint le droit de grève et maintenant ils promeuvent une réforme qui rendra plus coûteux d'être syndiqué, ce qui conduira à une baisse du taux de syndicalisation. Ils attaquent les syndicats d'une manière que nous n'avons jamais vue dans l'histoire de la Finlande. »
Comment caractériserais-tu cette attaque ?
« Ils font un grand changement dans le système. Ils sortent la Finlande du contexte nordique et la transforment en un pays plus semblable à ceux de l'Europe de l'Est en ce qui concerne la législation du travail. Je pense que la Finlande est un exemple effrayant de ce que fait réellement l'extrême droite lorsqu'elle arrive au pouvoir. Quelles sont leurs politiques réelles en ce qui concerne les travailleurs ? Ils font d'énormes réductions d'impôts pour les revenus les plus élevés et pour les entreprises et, en même temps, limitent les droits fondamentaux du travail. Au niveau européen, nous assistons à une très grande lutte. Ce sera une lutte énorme pendant ce mandat sur la direction que prendra l'Union européenne, par exemple, en ce qui concerne les droits des travailleurs et les questions du marché du travail. »
Les économies périphériques européennes, comme le Portugal et l'Espagne, sont construites sur le tourisme. En même temps, nous formons de plus en plus de personnes. Sommes-nous en train de créer un système de fuite des cerveaux de la périphérie vers le centre ?
« Le premier exemple qui me vient à l'esprit est la Grèce, où il y a eu une énorme fuite des cerveaux, de personnes avec un niveau d'instruction plus élevé, après la crise. Cela montre qu'il existe ce danger. Une question que j'ai abordée est que, maintenant que la Commission a l'intention d'accorder un traitement spécial à la défense en termes de règles budgétaires, nous devrions faire de même avec l'investissement dans la recherche et l'éducation, par exemple. Nous avons également besoin d'instruments financiers et d'incitations pour que les États membres investissent dans la recherche et l'éducation, qui n'existent pas actuellement au niveau européen, car, jusqu'à présent, le seul argent qui a bénéficié d'un traitement spécial est l'argent destiné à la défense. Ce serait une façon, je pense, d'aborder la question. Mais le plus grand problème dans cette question est encore lié aux politiques migratoires. Parce que l'UE construit sa propre politique migratoire en se basant sur le recrutement de travailleurs qualifiés hors de l'Union européenne. Cela se voit déjà dans des pays assez proches comme l'Albanie. »
Au Portugal, des résidences spéciales ont également été créées pour attirer des cadres qualifiés d'autres pays.
« Exactement. Si nous regardons les Balkans, par exemple, qui perdent des médecins nouvellement formés dont ils auraient besoin dans leur propre main-d'œuvre, nous nous rendons compte que cela crée vraiment cette périphérie de l'Union européenne. Ce déséquilibre. La discussion réelle que nous devrions avoir est que l'UE voit la migration comme une voie à sens unique où nous pouvons choisir ce que nous voulons. Qu'est-ce que l'UE donne en retour ? Quelle est la relation entre l'Union européenne et le monde extérieur ? Cela devrait faire partie de la discussion sur le marché du travail. »
Maria Luís Albuquerque, commissaire européenne responsable des Services Financiers et de l'Union de l'Épargne et des Investissements, a suggéré de faciliter l'utilisation des pensions des citoyens européens pour l'investissement dans l'industrie militaire. Est-ce une menace pour le système de retraite de l'UE ?
« J'ai entendu dire que cette idée est très populaire au sein du Parti Populaire Européen [parti politique européen, auquel appartiennent le PSD et le CDS]. L'idée d'utiliser tout l'argent des retraites pour les besoins d'investissement que nous avons actuellement. Je pense qu'il y a de meilleures façons d'obtenir de l'argent que d'utiliser l'épargne-retraite des gens. Mon parti est favorable à plus de recettes pour l'Union européenne, nous pourrions donc avoir des taxes environnementales, nous pourrions taxer les riches, il pourrait y avoir une véritable taxe numérique pour les grandes entreprises de réseaux sociaux. Tout cela pourrait être utilisé pour les besoins d'investissement de l'Union européenne, que ce soit dans le domaine du climat, de l'énergie ou tout autre. »
Li Andersson
Daniel Moura Borges
https://www.esquerda.net/artigo/li-anderson-ha-paises-onde-forcas-mais-progressistas-estao-manter-agenda-do-trabalho-viva
Traduit pour l'ESSF par Adam Novak
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74993
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Capitalisme et racisme. L’apport fondamental du marxisme noir

Les marxistes sont souvent accusés d'ignorer ou de minimiser le racisme, voire de le « réduire » à la classe sociale. Mais une telle critique occulte une riche tradition de théorisation marxiste de l'oppression raciale, connue sous le nom de « marxisme noir ».
La tradition de la pensée marxiste noire – qui comprend W. E. B. Du Bois(1868-1963), C. L. R. James (1901-1989) et Frantz Fanon (1925-1961), entre autres – insiste à la fois sur l'importance historique du capitalisme dans l'oppression raciale et sur les conséquences destructrices de cette oppression pour les travailleurs·ses noirs et l'ensemble de la classe travailleuse.
Jonah Birch, collaborateur de Jacobin, s'est récemment entretenu avec Jeff Goodwin, professeur à l'Université de New York et spécialiste des révolutions et des mouvements sociaux, qui a écrit sur Du Bois et la tradition marxiste noire (voir notamment cet article), afin d'échanger sur l'apport durable des marxistes noirs à la pensée critique et révolutionnaire.
Leur discussion a porté sur le rôle central du capitalisme dans l'oppression raciale, sur l'hétérogénéité de la pensée marxiste noire et sur la pérennité de cette tradition théorique aujourd'hui.
13 mai 2025 | tiré du site contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/capitalisme-racisme-marxisme-noire-jeff-goodwin/
***
Jonah Birch – Vous avez récemment fait l'éloge du marxisme noir dans Catalyst. Qu'entendez-vous exactement par « marxisme noir » ?
Jeff Goodwin – Ce terme fait référence aux écrivains, organisateurs et révolutionnaires africains, afro-américains et afro-caribéens qui se sont appuyés sur la théorie marxiste pour comprendre – et mieux, détruire – à la fois l'oppression raciale et l'exploitation de classe, y compris le colonialisme. Il s'agit donc d'une tendance théorique et politique au sein du marxisme. Elle est analogue au féminisme marxiste, qui s'inspire lui aussi de la théorie marxiste pour analyser l'oppression des femmes.
On entend parfois dire que le marxisme a un « problème de race », sous-entendant que les marxistes ne prennent pas la question raciale au sérieux. Mais honnêtement, je ne vois aucune autre tradition théorique ou politique — qu'il s'agisse du libéralisme, du nationalisme noir ou de la théorie critique de la race — qui offre plus d'éclairages sur l'oppression raciale que le marxisme. Et cela est largement dû à la tradition marxiste noire. Bien sûr, on trouve aussi une opposition à l'oppression raciale et au colonialisme dans les écrits de marxistes classiques comme Rosa Luxemburg et Vladimir Lénine, ainsi que chez Karl Marx lui-même. Pourtant, cette tradition marxiste noire reste méconnue, y compris au sein de la gauche.
Jonah Birch – Quels sont, selon vous, les principes fondamentaux du marxisme noir ?
Jeff Goodwin – Le marxisme noir n'est pas homogène, mais son idée centrale est que le capitalisme a été historiquement le principal pilier de l'oppression raciale à l'ère moderne. Par oppression raciale, j'entends la domination ou le contrôle politique, juridique et social des peuples africains et noirs.
Que signifie dire que le capitalisme est le principal pilier ou fondement de l'oppression raciale ? Les marxistes noirs mettent en avant deux caractéristiques fondamentales du capitalisme :
1/ La recherche incessante de main-d'œuvre et de ressources bon marché par les capitalistes
2/ La concurrence entre les travailleurs pour l'obtention d'un emploi
Ces deux dynamiques sont, selon eux, les causes profondes de l'oppression raciale.
L'oppression raciale ne se confond pas avec l'exploitation de classe, mais elle la facilite : elle permet d'exploiter le travail des Noirs et, par extension, de l'ensemble des travailleurs.
Affirmer que le racisme, dans sa forme moderne, est un produit du capitalisme ne revient en aucun cas à minimiser ses conséquences horribles. Bien au contraire. Les marxistes noirs soulignent que les peuples noirs, à l'ère moderne, ont été confrontés à une domination politique et sociale ainsi qu'aux formes extrêmes d'exploitation économique que cette domination a rendues possibles. L'oppression politique des peuples noirs est une injustice en soi, mais elle permet également des formes d'exploitation du travail particulièrement brutales.
Pour être plus précis, l'une des caractéristiques inhérentes au capitalisme est la recherche incessante, par les capitalistes, d'une main-d'œuvre et de ressources bon marché. Cette quête découle du fait que les capitalistes sont en concurrence les uns avec les autres et cherchent donc constamment à réduire leurs coûts de production. L'un des moyens de maintenir une main-d'œuvre bon marché et docile est de l'opprimer politiquement — c'est-à-dire de la dominer et de la contrôler afin de l'empêcher de s'organiser et de résister efficacement. Les capitalistes préféreraient oppresser l'ensemble des travailleurs, mais une alternative consiste à exercer une domination plus marquée sur une partie significative de la classe ouvrière — qu'il s'agisse des femmes, des immigrés ou des travailleurs noirs.
Les marxistes noirs affirment que les Noirs ont été soumis à une oppression terrible de la part des capitalistes, de l'État et de la police, non pas comme une fin en soi ou par pure malveillance raciale. Là où existent des formes massives de domination et d'inégalité raciales, l'objectif est généralement de faciliter l'exploitation et le contrôle du travail noir – pensons à l'esclavage dans les plantations, au métayage ou encore aux emplois précaires et faiblement rémunérés aux États-Unis. Dans de nombreux cas, la domination raciale repose aussi sur la dépossession des terres et des ressources contrôlées par des groupes raciaux spécifiques. Le colonialisme, de toute évidence, s'inscrit dans cette logique : il implique une telle dépossession et est alimenté par la quête incessante des capitalistes de ressources et de main-d'œuvre bon marché.
L'oppression raciale est également souvent soutenue et mise en œuvre par des travailleurs blancs. C'est là qu'intervient une autre caractéristique fondamentale du capitalisme : la concurrence entre les travailleurs pour l'emploi. Mais il est important de souligner que, pour les marxistes noirs, les systèmes d'oppression et d'inégalité raciales à grande échelle ont généralement été des projets portés par de puissantes classes dirigeantes — en lien avec les États qu'elles contrôlent ou influencent — et que ces classes ont un intérêt matériel à dévaloriser et exploiter le travail des peuples africains et noirs, ou à s'emparer de leurs ressources. L'oppression raciale est d'autant plus brutale et durable que ces classes dirigeantes et ces États y trouvent un intérêt économique direct.
Bien sûr, les motivations derrière les actes individuels de racisme sont complexes et ne peuvent pas toujours être expliquées uniquement en ces termes. Mais le marxisme noir ne cherche pas à analyser les comportements individuels : son objectif est d'identifier les forces motrices des institutions de domination raciale à grande échelle. Et son postulat central est que l'exploitation du travail — l'exploitation de classe — constitue généralement cette force motrice. Il est donc essentiel de distinguer le racisme institutionnalisé du racisme interpersonnel.
Jonah Birch – Je remarque que vous parlez des peuples noirs au pluriel. Je suppose que c'est pour souligner l'hétérogénéité des groupes culturels et ethniques d'Afrique qui ont été colonisés ou réduits en esclavage et amenés dans le Nouveau Monde.
Jeff Goodwin – Oui, tout à fait, et cela vaut aussi pour l'ensemble des peuples colonisés. W. E. B. Du Bois écrit quelque part – dans Color and Democracy, je crois – que les peuples colonisés possèdent des histoires, des cultures et des caractéristiques physiques extrêmement variées. Ce qui les unit, ce n'est pas leur race ou leur couleur de peau, mais la pauvreté issue de l'exploitation capitaliste. Leur race, explique Du Bois, est la justification apparente de leur exploitation, mais la véritable raison est la recherche de profits à travers une main-d'œuvre bon marché, qu'elle soit noire ou blanche. Il insiste d'ailleurs sur le fait que l'oppression des travailleurs noirs a aussi eu pour effet d'abaisser le coût de la main-d'œuvre blanche.
Jonah Birch – Comment l'idéologie raciste s'inscrit-elle dans ce contexte ?
Jeff Goodwin – L'idéologie raciste, ou idéologie suprémaciste blanche — c'est-à-dire le racisme en tant que construction culturelle — est généralement élaborée, diffusée et institutionnalisée par les classes dirigeantes et les institutions étatiques afin de justifier et rationaliser l'oppression et les inégalités raciales. L'animosité ou la haine raciale en tant que telles ne sont pas la principale motivation de l'oppression raciale ; l'élément central est la richesse et les profits générés par l'exploitation du travail des Noirs. Mais le racisme légitime cette oppression et contribue à sa perpétuation.
Cela ne signifie pas pour autant que certaines idées racistes et suprémacistes n'aient pas précédé le capitalisme. Cependant, leur portée et leur influence sont longtemps restées limitées, jusqu'à ce qu'elles soient associées aux intérêts matériels des capitalistes et des États puissants. À partir de ce moment, elles ont été systématisées, institutionnalisées et sont devenues une force matérielle à part entière.
Ainsi, la race devient à la fois un critère social et une justification morale de l'oppression politique et sociale, rendant l'exploitation de la main-d'œuvre noire plus facile et plus intensive qu'elle ne pourrait l'être autrement. Mais il y a plus encore. Comme je l'ai mentionné, les travailleurs qui ne sont pas directement opprimés sur le plan racial voient néanmoins leur propre travail dévalorisé et leur pouvoir collectif amoindri par la fracture raciale créée par l'oppression des travailleurs noirs. Pour les marxistes noirs, le racisme est donc un enjeu fondamental, ce qui contredit l'idée que le marxisme aurait un « problème racial ». En aucun cas, les marxistes noirs ne sont des « réductionnistes de classe ».
Lorsque la domination et l'inégalité raciales sont institutionnalisées à grande échelle, elles visent généralement à faciliter l'exploitation et le contrôle de la main-d'œuvre noire.
L'oppression politique des Noirs est en elle-même une injustice, mais elle favorise aussi certaines des formes les plus brutales d'exploitation du travail. Historiquement, les travailleurs blancs ont été exploités, parfois de manière assez impitoyable, mais aux États-Unis, ils n'ont jamais été confrontés à une oppression politique, juridique et sociale comparable à celle des travailleurs noirs.
Le grand socialiste américain Eugene V. Debs (1855-1926) a un jour déclaré que « nous n'avons rien de spécial à offrir aux Noirs », c'est-à-dire rien d'autre que la politique de classe que le Parti Socialiste proposait aux travailleurs blancs. Mais comme l'a démontré William Jones, cette phrase été sortie de son contexte. En réalité, Debs était un fervent adversaire du racisme et il critiquait les socialistes qui ignoraient le racisme ou qui pensaient que la lutte des classes « oblitérait » la nécessité d'affronter les lois et aux institutions racistes. Le racisme constituait un obstacle à la solidarité de classe, pensait Debs, et devait donc être combattu par tous les travailleurs.
L'ouvrage Class Struggle and the Color Line, édité par Paul Heideman, rassemble les écrits de nombreux socialistes et communistes étatsuniens, noirs et blancs, y compris ceux de Debs, illustrant à quel point il était crucial de combattre et de démanteler le racisme au sein de la classe ouvrière et dans la société en général.
Aujourd'hui, il est clair que la plupart des marxistes, en grande partie grâce aux travaux des marxistes noirs, reconnaissent que les diverses institutions, lois et normes d'oppression raciale ne se limitent pas à l'exploitation de la main-d'œuvre noire, mais sont tout aussi néfastes – tout en contribuant à renforcer cette exploitation. Les pratiques racistes sont profondément enracinées dans les lieux de travail, où elles se manifestent directement « au point de production », mais elles s'étendent également à l'ensemble de la société et influencent les relations entre les gouvernements et leurs citoyens. Ces institutions, lois et pratiques racistes doivent être combattues de concert avec la lutte contre l'exploitation de classe.
Jonah Birch – Vous avez mentionné précédemment que les marxistes noirs considèrent que la concurrence entre les travailleurs pour les emplois dans les sociétés capitalistes est liée au racisme. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Jeff Goodwin – Certains marxistes noirs soulignent que les travailleurs blancs peuvent adopter un racisme violent, bien que celui-ci soit différent de celui des capitalistes. L'un des principes fondamentaux du marxisme noir est que le racisme n'est pas uniforme – il prend différentes formes selon les contextes économiques et politiques. Pour les travailleurs blancs, le racisme est souvent motivé par la crainte que les travailleurs noirs – ou certains groupes ethniques, ou encore les immigrés – ne prennent leurs emplois ou ne fassent baisser leurs revenus parce qu'ils sont prêts à travailler pour des salaires inférieurs soit par contrainte, soit par nécessité.
Les capitalistes exploitent naturellement cette peur. Par conséquent, certains travailleurs blancs cherchent à exclure les Noirs (ainsi que certains groupes ethniques blancs) des emplois mieux rémunérés, des secteurs économiques entiers et même des syndicats, souvent par des moyens violents. Cela donne lieu à ce que l'on appelle un marché du travail divisé, où les travailleurs noirs sont relégués à des emplois précaires et moins bien rémunérés, voire totalement exclus du marché du travail.
Là encore, les croyances racistes ou suprématistes deviennent des outils de justification de ces exclusions et ces violences. L'expression « marché du travail divisé » a été développée dans les années 1970 par une sociologue marxiste, Edna Bonacich, mais l'idée remonte au moins à Du Bois.
Il est important de rappeler que les travailleurs n'ont pas le pouvoir d'embaucher ou de licencier – c'est le rôle des capitalistes. Ainsi, les marchés du travail divisés n'apparaissent que lorsque les capitalistes ont un intérêt à répondre aux demandes des travailleurs racistes. Toutefois, il arrive que les capitalistes s'opposent aux exigences des travailleurs visant à exclure les Noirs de certaines professions ou industries, notamment en période de pénurie de main-d'œuvre, qu'il s'agisse de travailleurs qualifiés ou de postes vacants à la suite de grèves. Aux États-Unis, les capitalistes ont souvent eu recours à des travailleurs noirs comme briseurs de grève pour remplacer les travailleurs blancs en grève, ce qui avait pour effet d'affaiblir les grèves et d'attiser les animosités raciales des travailleurs blancs, renforçant ainsi la fracture raciale au sein de la classe ouvrière.
Les marxistes ne considèrent évidemment pas le racisme de la classe ouvrière comme inévitable. À travers l'organisation et les luttes de classe contre les capitalistes, ils estiment que les travailleurs blancs peuvent prendre conscience de la nécessité d'une solidarité de classe large et multiraciale. Ils soulignent que la véritable cause de la pénurie d'emplois bien rémunérés n'est pas la concurrence des travailleurs issus de groupes raciaux différents, mais bien le capitalisme lui-même.
L'implication politique de cette perspective est que les luttes de classe seront – et devront être – une composante essentielle de toute stratégie de libération des Noirs ou de décolonisation, à la fois sur le lieu de travail et dans la société civile. Si, comme le soutiennent les marxistes noirs, l'exploitation du travail des Noirs et leur exclusion des emplois mieux rémunérés constituent le fondement économique de l'oppression raciale, alors il est impératif de saper, voire d'éliminer, ce système. Pour que leur lutte contre l'oppression raciale et l'exploitation de classe soit victorieuse, les travailleurs noirs auront besoin du soutien le plus large possible des travailleurs d'autres groupes raciaux, même si le racisme tend à entraver cette solidarité. D'où la nécessité de combattre ce racisme à chaque instant. La solidarité de classe est d'autant plus cruciale lorsque les travailleurs racialisés opprimés constituent une minorité, comme c'est le cas aux États-Unis.
Jonah Birch – Vous avez mentionné Du Bois, mais qui sont les autres figures clés de la tradition marxiste noire ? Qui sont les principaux penseurs de ce courant ?
Jeff Goodwin – Cette tradition regroupe des intellectuels et militants d'une envergure impressionnante. Une liste non exhaustive de marxistes noirs comprend, outre Du Bois, C. L. R. James (1901-1989), Harry Haywood (1898-1985), Claudia Jones (1915-1964), Oliver Cromwell Cox (1901-1974), Aimé Césaire (1913-2008), Frantz Fanon (1925-1961), Walter Rodney (1942-1980), Claude Ake (1939-1996), Neville Alexander (1936-2012), Manning Marable (1950 -2011) et Stuart Hall (1932-2014). Paul Robeson (1898-1976) était également très proche de ce courant et de Du Bois en particulier. Malcolm X (1925-1965) semblait s'en approcher l'année précédant son assassinat.
Elle inclut également des révolutionnaires africains tels que Kwame Nkrumah (1909-1972), Amílcar Cabral (1924-1973), Agostinho Neto (1922-1979) et Eduardo Mondlane (1920-1969). Des figures majeures des Black Panthers et du mouvement Black Power, dont Huey Newton (1942-1989), Fred Hampton (1948-1969) et Stokely Carmichael (Kwame Ture) (1941-1998), en font aussi partie.
Par ailleurs, James Baldwin (1924-1987), à la fois ami de Martin Luther King Jr (1929-1968) et admirateur des Panthères noires, s'en était rapproché au début des années 1970 – il suffit de lire son livre No Name in the Street. Aucune autre tradition théorique ou politique ayant abordé la question de la domination raciale ne peut s'enorgueillir d'une aussi brillante constellation d'écrivains, d'intellectuels et de révolutionnaires.
Jonah Birch – La question de savoir si W. E. B. Du Bois était marxiste fait débat, non ?
Jeff Goodwin – Jusqu'à récemment, en réalité, il n'y avait en réalité aucune controverse sur ce point. Tout le monde – du moins à gauche – reconnaissait que Du Bois était devenu un socialiste marxien bien avant d'écrire, à l'âge de soixante-cinq ans, son ouvrage majeur, Black Reconstruction in America, ainsi que les nombreux écrits radicaux qui ont suivi. On peut même déceler des influences marxistes et socialistes dans ses travaux antérieurs.
Le marxisme de Du Bois est évident dans son autobiographie publiée à titre posthume. Avec le temps, il s'est rapproché du mouvement communiste – jusqu'à devenir un fervent stalinien – et a officiellement rejoint le Parti Communiste en 1961, à l'âge de quatre-vingt-treize ans, bien que ce dernier ait été considérablement affaibli par le maccarthysme.
Récemment, un groupe de sociologues libéraux a vigoureusement nié ou minimisé cette réalité. Ils ont élaboré ce qu'ils appellent la « sociologie Du Boisienne », une relecture qui expurge toute trace de marxisme – un véritable blanchiment idéologique, pour ainsi dire. Il n'est pas surprenant que ce groupe assimile le marxisme à un « réductionnisme de classe ». Ceux et celles qui s'intéressent à ce débat peuvent consulter un échange entre moi-même et l'un de ces faux « Du Boisiens » dans Catalyst. J'ai écrit ma défense du marxisme noir en réponse à ce négationnisme, qui repose sur une profonde ignorance de Du Bois et de la tradition marxiste noire.
Jonah Birch – Les questions de race et d'ethnicité n'ont-elles pas été abordées par un large éventail de marxistes issus de différentes races et nationalités ?
Jeff Goodwin – Bien sûr. Le marxisme noir n'est qu'une partie – même si je pense que c'est la plus fascinante – d'une tradition marxiste plus large, multiraciale et multinationale, qui cherche à analyser la domination raciale ainsi que l'oppression ethnique et nationale, y compris le colonialisme.
Cette tradition inclut des marxistes classiques comme Rosa Luxemburg (1871-1919) et Vladimir Lénine (1870-1924), mais aussi des penseurs tels que José Carlos Mariátegui (1894-1930), marxiste péruvien qui a écrit sur la « question indienne » en Amérique latine, et Kamekichi Takahashi (1891-1970), un économiste japonais. Elle englobe également des intellectuels sud-asiatiques, comme M. N. Roy (1887-1954) et A. Sivanandan (1923-2018), parmi bien d'autres.
Elle inclut aussi Ho Chi Minh (1890-1969), qui avait des choses très intéressantes à dire sur le racisme européen, comme vous pouvez l'imaginer.
Cette tradition marxiste s'est également développée parmi des intellectuels blancs européens et nord-américains, tels que Otto Bauer (1881-1938), Max Shachtman (1904-1972), qui a écrit sur la race aux États-Unis, et Herbert Aptheker (1915-2003), ami et exécuteur littéraire de W. E. B. Du Bois (1868-1963), qui a écrit un ouvrage majeur sur les révoltes d'esclaves aux Etats-Unis, American Negro Slave Revolts (1943).
Elle s'étend également à des figures plus récentes comme Éric Hobsbawm (1917-2012), Theodore Allen (1919-2005) et Benedict Anderson (1936-2015), célèbre pour son concept de la nation en tant que « communauté imaginée », une idée que l'on peut aussi appliquer à la race et à l'ethnicité.
Enfin, cette tradition comprend des intellectuels sud-africains blancs qui ont participé à la lutte contre l'apartheid, notamment Martin Legassick (1940-2016) et Harold Wolpe (1926-1996).
Jonah Birch – La tradition marxiste noire est-elle toujours vivante ?
Jeff Goodwin – Absolument ! De nombreux intellectuels contemporains continuent d'enrichir cette tradition. Parmi eux, on peut citer l'historienne Barbara Fields (née en 1947), ainsi que Adolph Reed (né en 1947) et son fils Touré Reed (né en 1971). D'autres figures notables incluent Kenneth Warren, Zine Magubane, Cedric Johnson, August Nimtz, Preston Smith, ainsi que le philosophe de Harvard Tommie Shelby (né en 1967), qui se définit lui-même comme un « marxiste afro-analytique ». Et ce ne sont là que quelques intellectuels basés aux États-Unis.
Jonah Birch – Qu'en est-il de Cedric Robinson (1940-2016), auteur du célèbre ouvrage intitulé Marxisme Noir en 1983 ? N'est-ce pas lui qui a popularisé le terme « marxisme noir » ?
Jeff Goodwin – Oui, ironiquement, mais il n'était pas le seul. Je dis « ironiquement » parce que Robinson était un farouche opposant au marxisme. Cedric Robinson (1940-2016), auteur de Marxisme Noir : La formation de la tradition radicale noire (Éditions Entremonde, 2023), a contribué à populariser le terme, sans pour autant l'adopter dans une perspective marxiste. Il considérait que le marxisme, à l'image de la culture « occidentale » dans son ensemble, était fondamentalement aveugle au racisme, voire intrinsèquement raciste, et que ses catégories d'analyse ne pouvaient s'appliquer aux sociétés non européennes. Pour Robinson, comme pour les sociologues « Du Boisiens » que j'ai mentionnés, il n'existait qu'une seule forme de marxisme : un marxisme réductionniste, centré exclusivement sur la classe au détriment des autres formes d'oppression.
Mais parce que Robinson a écrit un livre intitulé Black Marxism, je pense que beaucoup de gens supposent qu'il est lui-même marxiste ou pro-marxiste. Or, rien n'est plus faux. Apparemment, Robinson ne voulait même pas appeler son livre Black Marxism, mais je crois que son éditeur a pensé qu'il se vendrait mieux avec ce titre.
Marxisme noir présente de nombreux défauts, notamment une mauvaise interprétation de la pensée des marxistes noirs actuels, en particulier des idées de Du Bois (1868-1963) et de C. L. R. James (1901-1989). Le point de vue de Robinson sur Du Bois en tant que prétendu critique du marxisme est basé sur une lecture tronquée de l'œuvre de Du Bois et sur une interprétation profondément erronée de Black Reconstruction in America. Son point de vue sur Du Bois est similaire à celui des sociologues « Du Boisiens ». Robinson prétend, sans aucune preuve, que Du Bois et James ont abandonné le marxisme, ce qui leur a permis de découvrir ce qu'il appelle la « tradition radicale noire ». Mais il s'agit là d'une pure fiction : ni Du Bois ni James n'ont abandonné le marxisme.
L'engagement de Du Bois au sein du marxisme et du mouvement communiste n'a fait que s'approfondir au fil du temps, même après le célèbre discours de Nikita Khrouchtchev (1894-1971) en 1956 dénonçant les crimes de Joseph Staline (1878-1953) et l'invasion soviétique de la Hongrie la même année. Comme je l'ai mentionné, il a rejoint le Parti Communiste très tard dans sa vie, quelques années seulement avant sa mort. C'est assez étrange, si l'on y réfléchit, pour quelqu'un qui aurait renoncé au marxisme.
Jonah Birch – On entend souvent parler aujourd'hui de la « tradition radicale noire ». De quoi s'agit-il exactement et quel est son lien avec le marxisme noir ?
Jeff Gookdwin – Cela dépend de la personne à qui l'on pose la question ! Le sous-titre du livre de Cedric Robinson (1940-2016), Marxisme Noir, est La formation de la tradition radicale noire. Lorsque j'ai découvert ce titre, j'ai d'abord pensé que Robinson établissait un lien direct entre marxisme noir et tradition radicale noire, voire qu'il considérait que les marxistes noirs faisaient partie intégrante de cette tradition. Et cela aurait été logique.
Mais pour Robinson, il n'y a aucun lien entre les deux. Le marxisme est essentiellement et à jamais européen et raciste, tandis que la tradition radicale noire est essentiellement et à jamais panafricaine et antiraciste. Robinson insiste donc sur le fait que le marxisme n'a rien à offrir aux antiracistes. Comment le pourrait-il, si le marxisme fait partie de la culture occidentale, qui est irrémédiablement raciste ?
Dans la réalité, les penseurs noirs et les militants révolutionnaires ont largement puisé dans le marxisme pour analyser et combattre le racisme, l'impérialisme et le colonialisme. W. E. B. Du Bois (1868-1963) et C. L. R. James (1901-1989) en sont d'excellents exemples. Ils sont au cœur de la tradition radicale noire, au sens où l'on entend ce terme, tout comme les autres marxistes noirs que j'ai mentionnés.
J'inclurais également dans cette tradition les non-marxistes qui voient et soulignent néanmoins la manière dont le capitalisme est impliqué dans l'oppression et l'inégalité raciales, et qui sont donc anticapitalistes, sans être nécessairement révolutionnaires. Je pense à diverses personnalités sociales-démocrates et chrétiennes-sociales comme A. Philip Randolph (1889-1979), Chandler Owen (1889-1967), Eric Williams (1911-1981) – un élève de C. L. R. James –, Bayard Rustin (1912-1987), Ella Baker (1903-1986) et, bien sûr, Martin Luther King Jr. (1929-1968). Baker, qui a participé à la fondation du Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) en 1960, était d'ailleurs proche des marxistes. Toutes ces personnalités méritent assurément une place dans la tradition radicale noire.
Jonah Birch – Vous suggérez donc que ce qui distingue les radicaux noirs des autres antiracistes – les antiracistes libéraux et les nationalistes noirs – c'est leur anticapitalisme ?
Jeff Goodwin – Oui, le principal critère de distinction est l'anticapitalisme. Nous devons comprendre la tradition radicale noire comme étant à la fois antiraciste et anticapitaliste. Les radicaux pensent que les deux doivent aller de pair. Je ne vois pas comment on peut se dire radical dans ce monde si on ne s'oppose pas par principe au capitalisme.
Pour cette raison, je placerais également certains nationalistes et anticolonialistes noirs, mais certainement pas tous, dans la tradition radicale noire. Les nationalistes qui soutiennent le capitalisme – y compris le « capitalisme noir » – cautionnent par essence l'exploitation et l'inégalité. Il n'y a rien de radical dans cela. C'est la thèse centrale de Frantz Fanon dans Les damnés de la terre. Il mettait en garde contre la bourgeoisie noire – ou la bourgeoisie nationale, comme il l'appelait. Contrairement à Robinson, je ne pense pas que l'antiracisme et l'anticolonialisme fassent à eux seuls de vous un radical. Il y a évidemment beaucoup d'antiracistes et de nationalistes anticoloniaux élitistes et autoritaires.
Jonah Birch – Vous placeriez Martin Luther King Jr dans la tradition radicale noire également ?
Jeff Goodwin – Absolument. Dans les dernières années de sa vie, King a exprimé de plus en plus ouvertement son rejet du capitalisme et son adhésion au socialisme démocratique. Son parcours intellectuel l'avait mis en contact avec de nombreux penseurs socialistes chrétiens et leurs écrits. La thèse de doctorat de King traite de deux théologiens de gauche, Paul Tillich (1886-1965) et Henry Nelson Wieman (1884-1975).
Le chercheur Matt Nichter a récemment mis en lumière le rôle joué par de nombreux socialistes, communistes et ex-communistes dans la Southern Christian Leadership Conference de King. Celui-ci soutenait également fortement le mouvement ouvrier, et les syndicats les plus radicaux du pays l'ont soutenu. Lorsqu'il a été assassiné, il était aux côtés des travailleurs de l'assainissement en grève à Memphis.
King n'a jamais cédé à l'anticommunisme primaire (red-baiting) et se méfiait des libéraux anticommunistes. Il appréciait le soutien des communistes au mouvement des droits civiques. L'un de ses derniers grands discours fut un hommage à Du Bois, à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance. Il y dénonçait ceux qui minimisaient ou occultaient l'engagement communiste de Du Bois, estimant que cela ne faisait que renforcer les stéréotypes négatifs sur le socialisme et le communisme.
En fait, je pense que King doit être considéré comme l'un des plus grands socialistes de l'histoire des Etats-Unis. Dans sa lutte contre la pauvreté, King en est venu à défendre un revenu garanti pour tous, non pas au niveau du seuil de pauvreté, mais au niveau du revenu médian du pays. Une telle proposition soulève évidemment des questions pratiques : les travailleurs gagnant moins que ce revenu garanti pourraient être incités à quitter leur emploi pour en bénéficier ! Mais cette proposition illustre clairement la haine de King non seulement pour la pauvreté, mais aussi pour tout système économique qui prive les gens des ressources matérielles dont ils ont besoin pour s'épanouir et pas seulement pour survivre.
Jonah Birch – Les marxistes noirs contemporains semblent particulièrement critiques à l'égard de ce qu'ils appellent le « réductionnisme racial ». Qu'est-ce que le réductionnisme racial ?
Jeff Goodwin – Le terme est surtout connu grâce au livre de Touré Reed paru en 2020, Toward Freedom : The Case Against Race Reductionism, bien que d'autres l'aient également utilisée. Elle est basée sur la tendance libérale à séparer la classe du racisme, à considérer le racisme comme déconnecté de l'exploitation du travail en particulier. Cela contraste fortement avec un principe majeur du marxisme noir, qui considère que l'exploitation du travail et l'exclusion systémique des emplois mieux rémunérés sont au cœur de l'oppression raciale.
Les libéraux séparent souvent le racisme de la classe et utilisent ensuite le racisme dans un sens général et abstrait – en tant que préjugé irrationnel – pour expliquer l'oppression raciale. C'est encore une fois un argument idéaliste : le racisme en tant qu'idée est à l'origine de l'oppression des Noirs. Si le réductionnisme de classe – que, comme nous l'avons vu, les marxistes noirs rejettent catégoriquement – nous conseille d'oublier la domination raciale, les réductionnistes de race nous conseillent d'oublier les divisions de classe et l'exploitation de classe. Il est donc évident que les marxistes noirs et les radicaux noirs s'opposent à cette évolution théorique.
En d'autres termes, le concept de race devient réductionniste et idéologique lorsqu'il occulte les divisions de classe et l'exploitation au sein d'un groupe racial, ainsi que les intérêts de classe communs qui transcendent les groupes raciaux et constituent une base potentielle pour la solidarité de classe. De même, l'utilisation du racisme ou des idées racistes comme explication devient réductrice si le racisme est déconnecté des intérêts de classe.
Oliver Cromwell Cox(1901-1974), un important sociologue marxiste noir, disait que si les croyances seules suffisaient à opprimer une race, les croyances des Noirs à l'égard des Blancs devraient être aussi puissantes que les croyances des Blancs à l'égard des Noirs. Mais cela n'est vrai que si l'on oublie la classe et le pouvoir de l'État. Dans le même ordre d'idées, Stokely Carmichael(Kwame Ture) (1941-1998) résumait cette idée ainsi : « si un Blanc veut me lyncher, c'est son problème. Mais si l'homme blanc a le pouvoir de me lyncher, alors et seulement alors, c'est mon problème ».
Cox et Carmichael ne font que constater l'évidence : les idées déconnectées du pouvoir sont impuissantes. Tout cela ne veut pas dire que la race et le racisme n'ont jamais d'importance. Ce n'est évidemment pas le cas. Le racisme peut être très important et persistant précisément lorsqu'il est lié aux intérêts matériels de classes et d'États puissants. Il s'agit là d'un principe central du marxisme noir.
Jonah Birch – Je souhaite vous interroger, pour finir, sur le concept de « capitalisme racial ». C'est une autre expression que l'on entend beaucoup ces jours-ci à gauche. S'agit-il d'un concept développé par les marxistes noirs ? Et qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Jeff Goodwin – Les marxistes ont effectivement développé ce terme, mais permettez-moi de commencer par dire que beaucoup d'encre a été gaspillée pour tenter de définir cette expression. Aucun des grands marxistes noirs dont nous avons tant appris n'a jamais utilisé cette expression – ni Du Bois, ni James, ni Cox, ni Fanon, ni Rodney, ni Hall, ni Nkrumah, ni Cabral. Il est donc manifestement possible de parler, et de parler avec perspicacité, de race, de classe, de capitalisme et d'oppression sans utiliser ce terme. Le simple fait d'associer les mots « racial » et « capitalisme » ne garantit pas, comme par magie, que vous comprenez la relation entre le capitalisme et le racisme. Bien sûr, je ne suis pas le premier à le souligner.
Le terme a été forgé par des marxistes sud-africains pendant l'apartheid. Marcel Paret et Zach Levenson ont montré qu'un professeur de Berkeley, Bob Blauner (1929-2016), l'avait utilisé dès 1972, mais c'est avec des figures comme Neville Alexander (1936-2012), Martin Legassick (1940-2016) et Bernard Magubane(1930-2013) que le concept s'est véritablement diffusé dans les années 1970-1980. Leur point de vue était que le capitalisme étant le fondement de l'oppression raciale en Afrique du Sud, la lutte contre l'apartheid devait être anticapitaliste tout en étant une lutte pour les droits démocratiques.
Cette approche s'opposait à celui du Congrès national africain (ANC) de Nelson Mandela (1918-2013) et du Parti Communiste sud-africain. Ceux-ci soutenaient que la lutte pour le socialisme devait être reportée jusqu'à ce qu'une révolution démocratique – une « révolution démocratique nationale », comme ils l'appelaient – ait renversé l'apartheid. Mais cela implique, de manière peu plausible, que l'apartheid n'avait que peu ou pas de rapport avec le capitalisme et l'exploitation des travailleurs noirs. En réalité, l'ANC a fini par abandonner toute perspective socialiste, laissant perdurer les inégalités économiques après la fin du régime ségrégationniste. Quoi qu'il en soit, pour les marxistes noirs, l'expression « capitalisme racial » fait référence au fait que le capitalisme a été le fondement de divers types d'oppression raciale dans les sociétés du monde entier.
Pourtant, de nombreuses personnes croient à tort que le « capitalisme racial » est une idée de Cedric Robinson. S'ils se donnaient la peine de lire son livre, ils verraient qu'il n'utilise pratiquement pas ce terme. Et Robinson – qui, encore une fois, était hostile au marxisme – utilisait le terme très différemment des marxistes noirs. En fait, il comprend le terme d'une manière réductionniste sur le plan racial. Pour Robinson, le capitalisme n'est qu'une autre manifestation de la culture occidentale séculaire, et il est donc intrinsèquement raciste. Pour lui, le capitalisme ne génère pas de systèmes d'oppression raciale, comme l'affirment les marxistes noirs.
Au contraire, le caractère raciste de la culture occidentale, qui remonte à plusieurs siècles, garantit en quelque sorte que tout ordre économique qui lui est associé – féodalisme, capitalisme, socialisme – sera également raciste.
Il s'agit là encore d'un argument idéaliste. Les idées, en l'occurrence celles de la culture occidentale, reproduisent constamment l'oppression raciale à partir d'un pouvoir qui leur est propre, d'abord en Europe, puis dans le monde entier. Mais comment ces idées sont-elles si puissantes ? Cela pourrait-il être lié aux intérêts matériels des classes et des États puissants, comme l'affirment les marxistes noirs ? Robinson fait parfois des gestes dans ce sens, mais la plupart du temps, il ne le dit pas. Pour lui, les idées elles-mêmes sont toutes puissantes. Ce n'est tout simplement pas une explication sérieuse du racisme.
Je dois souligner que de nombreux libéraux semblent apprécier l'expression « capitalisme racial ». Plus que quiconque, ils ont largement contribué à sa diffusion ces dernières années, notamment dans les universités. Les libéraux utilisent cette expression pour désigner une économie dans laquelle les employeurs pratiquent la discrimination à l'encontre des Noirs et des autres minorités. Leur monde idéal est celui d'un capitalisme non racial – l'exploitation du travail sans discrimination. Cet idéal est très éloigné de la vision marxiste noire du socialisme.
Mais au-delà des termes employés, l'enjeu central reste notre compréhension du capitalisme, de la domination raciale et des liens entre les deux. Que l'on utilise ou non l'expression « capitalisme racial » importe peu. La tradition marxiste noire montre qu'il est possible d'analyser ces dynamiques sans recourir à ce concept. Cette expression n'apporte aucune clarté supplémentaire et, selon son usage, elle peut même induire en erreur, en particulier lorsqu'elle est vidée de sa dimension anticapitaliste.
Il est donc essentiel de comprendre précisément en quoi le capitalisme a été, et demeure, le principal moteur de la domination raciale. Autrement dit, on ne peut éradiquer le racisme sans s'attaquer à la structure même du capitalisme, en le démantelant ou, à tout le moins, en le régulant fortement. Tel est le message central de la tradition marxiste noire.
***
Jeff Goodwin est professeur de sociologie à l'Université de New York (NYU) et dirige la section de sociologie marxiste de l'American Sociological Association. Spécialiste des mouvements sociaux et des révolutions, il a publié de nombreux travaux sur ces thématiques, notammentNo Other Way Out : States and Revolutionary Movements, 1945-1991 (2001), une analyse comparative des révolutions modernes, ainsi que Social Movements (2012, coédité avec James Jasper)
Jonah Birch est un collaborateur régulier de Jacobin. Il est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de New York (NYU). Il contribue également à Catalyst : A Journal of Theory and Strategy, une revue affiliée à Jacobin.
Publié initialement dans Jacobin. Traduit de l'anglais pour Contretemps par Christian Dubucq.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :













