Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Nés d’une résistance : nous sommes un journal à Kyiv, et voici notre histoire

Si vous lisez Mediapart, il y a de fortes chances que vous vous intéressiez au journalisme qui ne répond pas aux pressions politiques ou économiques. Ici, au Kyiv Independent, nous sommes faits du même bois. Nous sommes un journal ukrainien sans paywall, sans propriétaire et sans influence extérieure, soutenue par sa communauté.
Tiré du blogue de l'auteur.
Nous sommes une rédaction basée à Kyiv, en Ukraine. Nous racontons la guerre à grande échelle menée par la Russie depuis l'intérieur du pays qu'elle tente activement de détruire. Et nous le faisons en anglais, pour que le monde entier puisse comprendre ce qui se passe - directement par la voix des journalistes ukrainiens sur le terrain.
Cette semaine, Mediapart nous a généreusement offert un espace pour partager notre histoire et inviter ses lecteur·ices à soutenir le journalisme indépendant d'Ukraine à un moment où il est le plus important.
Nous avons récemment lancé une campagne visant à agrandir notre communauté mondiale de membres. Notre objectif est d'atteindre 20 000 membres - et nous voulons expliquer pourquoi c'est important et comment nous en sommes arrivés là.
Un journal né d'une résistance
The Kyiv Independent a été lancé en novembre 2021 par un groupe de journalistes licenciés du Kyiv Post, le plus ancien journal ukrainien en langue anglaise, pour avoir résisté à des volontés d'ingérence dans leur travail.
Plutôt que d'abandonner, nous avons commencé quelque chose de nouveau. Un journal indépendant dès sa conception - n'appartenant pas à un milliardaire, n'étant pas lié à un État ou à un oligarque, et n'étant pas enfermé derrière un paywall.
Nous nous sommes lancés avec une petite équipe et une mission simple : offrir à nos lecteur.ices un journalisme précis et fiable en provenance d'Ukraine, avec une liberté éditoriale totale. Nous ne nous attendions pas à ce que, trois mois plus tard, la Russie lance une invasion à grande échelle.
Lorsque la guerre a commencé, nous avons continué à faire des reportages, souvent depuis des sous-sols, des abris anti-bombes ou en nous déplaçant d'une ville à l'autre. En quelques semaines, des millions de personnes ont lu notre travail. Aujourd'hui, nous sommes l'une des sources de journalisme en langue anglaise les plus fiables d'Ukraine.
Pourquoi nous comptons sur nos lecteur·ices
Aujourd'hui, The Kyiv Independent est une équipe de près de 70 personnes, dont des journalistes, des rédacteur.ices, des gestionnaires et des producteurs basés pour la plupart en Ukraine. Nous rendons compte de la guerre, mais aussi de la politique européenne, de la culture ukrainienne, de la corruption, des droits de l'Homme, des affaires et de l'économie, de la désinformation et de la réalité quotidienne d'une invasion à grande échelle.
Mais ce qui nous différencie, ce n'est pas seulement ce que nous racontons, c'est aussi la manière dont nous sommes financés.
Nous n'avons pas de propriétaire milliardaire. Nous ne recevons pas d'argent de l'État ukrainien. Et nous n'avons pas de paywall.
A la place, nous sommes financés principalement par nos membres - plus de 18 500 personnes dans le monde entier qui nous soutiennent par de petites contributions mensuelles ou annuelles. Ce modèle nous donne la liberté d'informer sans compromis et de rendre notre journalisme accessible à tous.tes, indépendamment de l'endroit où ils vivent ou de leurs moyens financiers.
Pourquoi nous faisons une campagne maintenant
Ce mois-ci, nous avons lancé une campagne pour développer cette communauté. Notre objectif : atteindre 20 000 membres.
Rejoindre notre programme d'adhésion n'aide pas seulement à financer notre rédaction. Elle protège notre modèle. Elle nous permet de lutter contre la désinformation, de couvrir les crimes de guerre et de demander des comptes à celles et ceux qui détiennent le pouvoir, dans notre pays comme à l'étranger.
Nous nous concentrons particulièrement sur des pays comme la France, où le soutien à l'Ukraine et au journalisme indépendant ne va pas de soi, mais où nous avons constaté une réelle solidarité et des lecteur.ices qui se soucient profondément de la liberté de la presse.
C'est pourquoi nous prenons la parole ici sur Mediapart. Nous considérons ce partenariat non seulement comme une tribune, mais aussi comme une mission commune. Nous savons que les lecteur.ices de Mediapart soutiennent les mêmes principes que nous : l'indépendance éditoriale, la recherche de la vérité et un journalisme au service du public et non du pouvoir.
Si vous souhaitez que le journalisme ukrainien reste libre, indépendant et mondial, nous serions honorés de vous compter parmi nos membres.
Pour seulement 5 dollars par mois, vous pouvez devenir membre du Kyiv Independent. Vous soutiendrez ainsi directement notre équipe en Ukraine, vous nous aiderez à voir loin et vous aiderez à ce que notre journalisme reste ouvert à tous.tes.
Merci de nous lire. Et merci à la communauté Mediapart de soutenir les médias indépendants, surtout dans des moments comme celui-ci.
Soutenez le Kyiv Independent - devenez membre ou faites un don unique.
Pour soutenir, cliquez ici.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Primaire de la gauche : « Il faut que ça décolle sinon on va s’emmerder »

François Ruffin, député Picardie Debout de la Somme, est l'invité de #LaMidinale. Pablo Pillaud-Vivien fait cette entrevue avec François Ruffin.
21 mai | tiré de Regards.fr
https://www.youtube.com/watch?v=W7jrIMqmo9I&list=PLJjNfOGIs5-uydm58YFs0qu9nIW_mO4yC
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour un Arctique libre et démilitarisé – Défendre l’indépendance du Groenland – Défendre le peuple groenlandais et la nature

Avec les demandes répétées de Donald Trump pour que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland, et les déclarations de son vice-président J. D. Vance sur le nombre de militaires américains présents sur le territoire, la compétition impérialiste autour du Groenland a franchi une nouvelle étape décisive.
20 mai 2025 tiré de la revue International Viewpoint | Photo : Le vice-président des États-Unis J. D. Vance et son épouse Usha Vance posent avec le personnel de la base spatiale de l'armée américaine Pituffik, au Groenland, le 28 mars 2025.
https://internationalviewpoint.org/spip.php?article9006
Le long combat pour protéger l'Arctique et les peuples inuits contre la guerre et la militarisation traverse une crise profonde. La menace d'une course aux armements au sommet du monde, et d'une nouvelle ruée effrénée vers les ressources naturelles de la population locale, menace non seulement l'existence des Groenlandais·es, mais aussi celle du monde entier. La plus grande garantie de paix et la seule gestion viable de l'Arctique résident dans les organisations et instances représentatives des peuples autochtones, y compris le Parlement groenlandais, l'Inatsisartut, et le Conseil circumpolaire inuit.
Trump dit tout haut ce que l'impérialisme danois « poli » cherche à dissimuler : que dans la logique du capitalisme, les pays, les personnes et les peuples sont, au mieux, des marchandises – au pire, des butins de guerre. C'est pourquoi l'exigence de Trump de renégocier l'alliance vieille de près de 200 ans entre les bourgeoisies danoise et américaine a plongé le Danemark dans une hystérie coloniale complète. Le summum de cette hystérie est sans doute la censure du documentaire sur l'exploitation minière de cryolithe par le Danemark, retiré d'internet cette semaine sous une pression politique évidente impliquant les plus hauts niveaux de l'État. Cette censure profondément partiale, accompagnée de la suppression des sources, rend désormais difficile, voire impossible, pour de nombreux·ses citoyen·nes de s'orienter dans un débat de société crucial.
L'importance de la cryolithe
La panique bourgeoise au Danemark doit être comprise à la lumière de l'immense richesse que les capitalistes danois ont réussi à piller au Groenland par l'extraction de cryolithe. Malgré le fait que l'État danois ait fait payer les capitalistes danois pour leur permettre de voler les ressources minières du Groenland, les héritiers de Theobald Weber (fondateur de l'usine de cryolithe de l'Øresund) ont chacun touché un rendement d'au moins 40 % du million reçu à la mort de leur père. De tels revenus ne proviennent pas d'activités économiques normales, mais uniquement de monopoles et de rentes coloniales. La réinjection de ces profits a bâti le Danemark tel que nous le connaissons aujourd'hui. C. F. Tietgen, le parrain de la bourgeoisie danoise moderne, est à l'origine de la construction de la mine d'Ivittuut. L'extraction de cryolithe doit donc être considérée comme une étape décisive de l'accumulation primitive qui a permis la transformation du Danemark en société industrielle.
Sans la cryolithe, l'aluminium ne serait probablement jamais devenu un métal d'usage courant, et ses potentialités n'auraient pas profité à l'humanité. Le Danemark et les États-Unis se sont partagé les profits de l'exploitation de la cryolithe plus ou moins équitablement. Pour les États-Unis, elle a permis le développement rapide de leur aviation militaire, qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, leur garantit une influence décisive sur le marché mondial. La richesse et la puissance qui en ont découlé ne peuvent être quantifiées. Ce que valait le fait d'avoir un lieu unique au monde où ces minéraux rares étaient disponibles à ciel ouvert – utilisés par la population locale pour tanner les peaux – s'est perdu dans les débats éthiques historiques. Comme d'autres peuples colonisés, les Inuit du Groenland se retrouvent avec un trou dans le sol là où auraient pu se poser les bases du développement de leur propre société et de leur propre économie.
Colonialisme aux États-Unis – et au Danemark
La revendication brutale de Trump pour le contrôle du Groenland n'est que la poursuite du raisonnement colonial, impérial et raciste qui a longtemps défini les politiques danoise et américaine envers le Groenland. Grâce à une longue et difficile lutte politique, le peuple groenlandais a conquis des droits juridiques et formels à l'indépendance. Mais l'impérialisme américain voit d'un œil profondément suspicieux toute formation étatique autochtone. C'est pourquoi, même sous direction démocrate, les États-Unis ont œuvré activement à influencer l'élite groenlandaise et à l'arrimer aux intérêts américains.
Le simple fait que cette exploitation soit aujourd'hui révélée déclenche une hystérie coloniale au Danemark, où le racisme colonial envers nos concitoyen·nes groenlandais·es se déchaîne librement – notamment à travers des idées selon lesquelles l'indépendance du Groenland devrait avoir des conséquences pour les Groenlandais·es vivant au Danemark. Il faut rejeter catégoriquement que le statut du Groenland ait la moindre incidence sur celles et ceux qui vivent au Danemark et font partie de la société danoise. Il est également profondément critiquable que le gouvernement danois, qui affirme pourtant soutenir le slogan groenlandais « Rien sur le Groenland sans le Groenland », ait sillonné l'Europe – sans le Groenland – pour obtenir un appui à la défense du « Royaume » ! Le gouvernement groenlandais est parfaitement capable de négocier les questions de sécurité – comme il le fait déjà pour les concessions et le commerce.
Nos tâches
La classe ouvrière danoise et la gauche ont une responsabilité particulière envers le peuple groenlandais. Il est malheureusement vrai qu'une complaisance marquée a caractérisé une grande partie du mouvement ouvrier danois à l'égard des Groenlandais·es. À quelques exceptions près, trop d'entre nous ont estimé qu'il suffisait de « laisser les Groenlandais décider », évitant ainsi d'avoir à affronter les questions historiques et contemporaines complexes qui concernent le Groenland. Il faut remédier à cela.
Cela commence par l'organisation de débats sur l'histoire et la réalité actuelle du Groenland, en invitant des activistes et des Groenlandais·es vivant au Danemark à partager leurs analyses et points de vue – pas seulement sur le Groenland, mais dans toute la société danoise. Nous pouvons le faire dans tous les milieux où nous sommes actifs. En parallèle, nous voulons que l'enseignement de l'histoire du Groenland et du colonialisme danois soit intégré aux programmes scolaires. Aucun enfant ne devrait voir l'Église de marbre sans savoir qu'à l'époque de son achèvement, elle était aussi surnommée « la mine d'aluminium ».
Nous devons également approfondir notre compréhension des conflits postcoloniaux et des angles morts des populations colonisatrices, notamment parmi les classes populaires. Un exemple monstrueux de cette ignorance est visible lorsque des « experts économiques » s'autorisent à vitupérer, presque sans contradiction, contre l'évaluation de la valeur brute d'une matière première (la cryolithe) comme mesure de ce qu'un pays colonisateur a pris à un pays colonisé. Même si des chercheurs en colonialisme soulignent la pertinence de cet indicateur – puisque pratiquement toute cette valeur a été transférée du PIB groenlandais à celui du Danemark. Il faut également accorder une attention particulière à la question des droits reproductifs et aux efforts délibérés de l'État danois pour empêcher la naissance d'une demi-génération d'enfants groenlandais.
Revendications pour soutenir la lutte des Groenlandais·es pour l'indépendance
Tout en soutenant pleinement le désir d'indépendance du Groenland et en comprenant que les Groenlandais·es ne peuvent croire à un traitement égalitaire, nous voulons entretenir les meilleures relations possibles avec le peuple groenlandais. Nous sommes liés non seulement par l'histoire, mais aussi par des relations familiales et d'amitié. Toutefois, ce désir n'a de sens que si le Groenland est soutenu dans sa pleine maîtrise de son territoire, et nous devons exiger qu'aucune pression économique ne soit exercée pour influencer les choix politiques du peuple groenlandais. De même, nous exigeons que les déplacements entre le Danemark et le Groenland soient rendus abordables pour toutes les personnes ayant de la famille au Groenland. Nous nous opposerons à toute indépendance contrainte par des concessions destructrices ou par des pressions militaires. Nous rejetons aussi toute démarche visant à court-circuiter le peuple groenlandais au profit d'élites réduites.
Nous exigeons donc que le Groenland ait un accès complet et sans entrave à toutes les études sur son sous-sol, et que tous les accords militaires concernant l'Arctique soient soumis à la population arctique. Lorsque l'État danois et la bourgeoisie danoise continuent de clamer combien il est « difficile » de faire de l'argent avec le pillage de l'Arctique, nous exigeons que tous les comptes soient publiés, y compris les paiements de dividendes.
Le développement d'un programme digne de ce nom concernant la relation entre le Groenland et le Danemark, ancienne puissance coloniale, doit se faire avec la pleine implication et l'indépendance du Groenland. Nous saluons à ce titre la contribution de la gauche danoise au parti Inuit Ataqatigiit, et nous leur souhaitons bonne chance pour les élections.
23 février 2025
Traduit par SAP à partir de [Socialistisk Information → https://socinf.dk/for-et-frit-og-afmilitariseret-arktis-forsvar-groenlands-selvstaendighed-forsvar-den-groenlandske-befolkning-og-natur/.**]
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Portugal. « PS menacé, BE et PCP marginaux : les quatre cartes qui montrent la droitisation »

Une nuit noire [du dimanche 18 au lundi 19 mai] pour le PS, un recul de la gauche (à l'exception de Livre – écologistes), une majorité plus importante pour l'Alliance démocratique [AD-droite] et une victoire qui devrait encore s'accroître pour Chega [Assez !, extrême droite]. Le résultat des élections anticipées [après la démission du gouvernement de Luis Montenegro, suite à un vote de confiance lié au débat sur un « conflit d'intérêts », le 11 mars au soir] n'est pas encore définitif et attend l'attribution des quatre mandats par les circonscriptions d'émigration [le 21 mai à 14h le résultat du dépouillement des votes dans les consulats n'est pas disponible]. Mais le tableau est tracé. Le pays a changé, le rose a pâli et la fin du bipartisme décrétée il y a un an s'est imposée.
21 mai 2025 | tiré du site alencontre.org
https://alencontre.org/divers/portugal-ps-menace-be-et-pcp-marginaux-les-quatre-cartes-qui-montrent-le-nouveau-pays-a-droite.html
Avec 20 députés de moins, le PS réalise son troisième plus mauvais résultat au législatif depuis 1975, passant de 28,66% (en 2024) à 23,38% et risquant, une fois les votes de l'émigration comptés, de devenir le troisième parti au Parlement, derrière Chega. La chute est désastreuse.
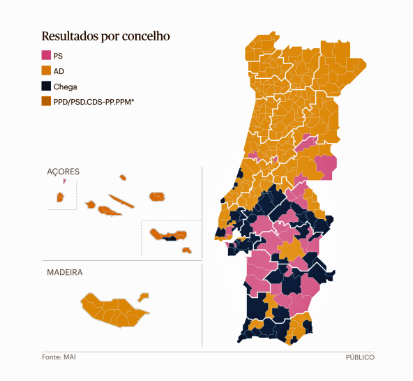
Le PS perd 107 concelhos
Si, en 2024, le PS était le parti le plus voté dans 140 communes/municipalités [concelhos : subdivision des districts/circonscriptions électorales : au nombre de 22], le dimanche 21 mai ce chiffre est tombé à 33. En plus d'avoir perdu la première place dans 107 concelhos (dont 58 sont passées à l'AD et 49 à Chega) du nord au sud du pays, dans 60 concelhos les socialistes n'ont même pas atteint 20% des voix, ce qui, sur un total de 308 concelhos, équivaut à environ un cinquième du pays. Dans les circonscriptions de Beja et Setúbal, le PS n'avait pas perdu depuis 1991.
Le pire résultat du PS a été enregistré dans le concelho de Calheta, dans circonscription de Madère, où les socialistes ont obtenu seulement 7,7% des voix. La Calheta était déjà le concelho où le PS avait obtenu son pire résultat en 2024, mais cette année il a perdu encore plus de voix, tandis que Chega est passé de 9,3% à 17% des voix. Ce n'est que dans les circonscriptions de Bragança, Portalegre, Evora, Beja et Setúbal que le PS a réussi à obtenir plus de 20% des voix dans au moins un concelho.
Avec la progression de Chega de 18,06% à 22,56% des voix sur l'ensemble du territoire national, le nombre de concelhos dans lesquelles le parti a obtenu plus de 30% des voix a également augmenté (avec notamment la circonscription de Faro, où dix concelhos ont dépassé la barre des 30%, comme Vila Real de Santo António, Portimão et Albufeira). Au total, Chega a obtenu plus de 30% des voix dans 37 concelhos.
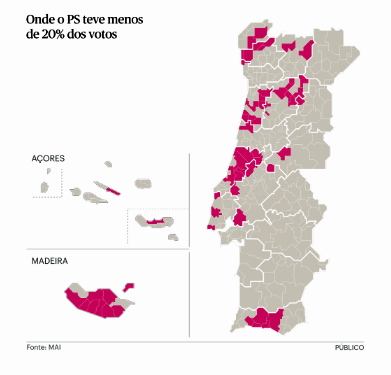
Chega franchit la barre des 30%
Dans la circonscription de Faro, où le parti avait déjà été le plus voté en 2024, s'ajoutent désormais les circonscriptions de Beja, Portalegre et Setúbal, consolidant ainsi l'implantation de Chega dans le sud du pays. Dans le nord du pays, Chega n'a obtenu plus de 30% des voix que dans un seul concelho : Valença, dans la circonscription électorale de Viana do Castelo. Mais dans le sud, il reste très fort. Il y a un an, le meilleur résultat du parti avait été obtenu à Elvas avec 36,53% des voix. Ce dimanche 18 mai, le parti a réitéré cet exploit, mais a augmenté le nombre de voix à 43,51% du total recueilli dans ce concelho.
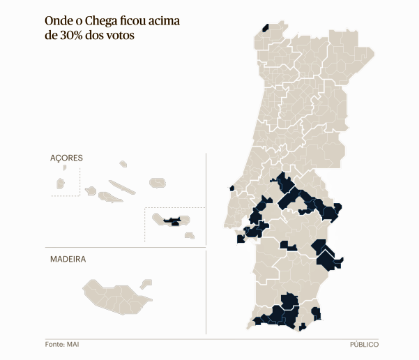
L'Iniciativa Liberal (IL) a quant à elle réussi à se hisser à la quatrième place des partis les plus représentés au Parlement, en élisant un député supplémentaire (elle en compte désormais neuf), même si la progression en termes de voix n'a pas été très significative (de 5,08% à 5,53%). Les libéraux ont obtenu leurs meilleurs résultats dans la zone côtière du pays, avec 60 concelhos enregistrant plus de 5% de leurs suffrages en faveur de l'IL. Le parti de Rui Rocha a obtenu son meilleur résultat à Oeiras [région métropolitaine de Lisbonne], où il a presque doublé le nombre de votes par rapport à la moyenne nationale : 9,7 %. A Braga, où Rui Rocha était tête de liste, à Lisbonne et à Cascais, les libéraux ont également obtenu plus de 9% des votes.
La quatrième place au Parlement était encore convoitée par Livre [écologistes], mais il n'a obtenu que six députés (trois pour Lisbonne, deux pour Porto et un pour Setúbal). Malgré cela, il a été le seul vainqueur à gauche, dépassant la CDU (Coalition démocratique unitaire, PC et les Verts-Os Verdes) et le BE (Bloco de Esquerda, Bloc de gauche) et augmentant sa représentation parlementaire de deux députés. Livre a gagné 50 000 voix, passant de 3,26% à 4,2%, et a dépassé sa moyenne nationale dans 40 concelhos. Cela s'est produit dans les circonscriptions électorales de Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Aveiro, Lisbonne, Setúbal et Faro. Le meilleur résultat a été obtenu à Lisbonne, avec 9,4% des voix, suivie par Oeiras, Porto et Almada [district de Lisbonne].
La croissance de Livre s'est particulièrement marquée sur le littoral du pays, mais il a également progressé dans la circonscription de Faro. Livre, qui est entré au Parlement pour la première fois en 2019, a devancé le BE dans 18 circonscriptions et la CDU dans six. Rui Tavares avait également pour ambition d'être élu à Braga et Aveiro et de ravir des députés à Rui Rocha (IL), mais il n'y est pas parvenu. Néanmoins, Livre a réussi à devancer l'IL, en particulier dans les circonscriptions de Beja, Setúbal, Evora, Castelo Branco et Coimbra.
Tout comme le PS, la Coalition démocratique unitaire (CDU) et le Bloc de gauche (BE) ont également vu leur représentation parlementaire diminuer. La plus grande perte a été celle du BE, qui a été réduit à une seule députée : l'actuelle coordinatrice du parti, Mariana Mortágua. La CDU recule également, mais dans une moindre mesure. La coalition qui réunit le PCP et Os Verdes n'a réélu que des députés communistes.
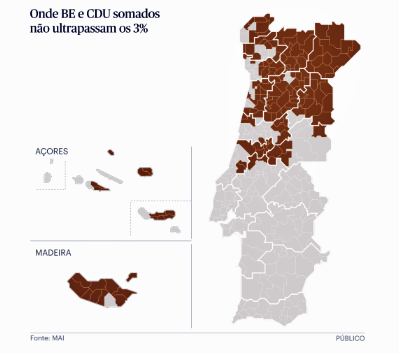
Dans le nord et le centre, on observe une prédominance significative des concelhos où le total des votes du BE et de la CDU ne dépasse pas 3% du total des votes enregistrés. Cette tendance met en évidence la faible implantation électorale de ces forces politiques dans ces régions, contrairement au sud du pays, où, bien que Chega ait progressé en termes de votes, le BE et la CDU restent au-dessus de leur moyenne nationale.
Bragança et les îles les plus abstentionnistes
Avec les votes de l'émigration encore à compter, le taux d'abstention s'élève à 35,62%, légèrement supérieur à celui enregistré en 2024. Toutefois, ce chiffre devrait augmenter, car c'est la tendance observée ces dernières années. Selon les données du secrétariat général du ministère de l'Intérieur, parmi les 20 circonscriptions électorales déjà dépouillées, 17 ont enregistré des concelhos où l'abstention a été supérieure à la moyenne nationale. C'est le cas des Açores, de Madère [45,69% d'abstention] et de Bragance [47,29% d'abstention], par exemple, où aucune commune n'a enregistré une participation supérieure à la moyenne nationale.
Les Açores restent la circonscription électorale avec le taux d'abstention le plus élevé aux élections législatives : 56,19 % des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Braga est quant à elle la circonscription avec le taux d'abstention le plus faible : 30,29 %. En termes de concelhos, Ribeira Grande a été le concelho le plus abstentionniste, avec 62,34%. Le Sardoal, à Santarém, a été le concelho avec le taux d'abstention le plus faible : 26,95 %. (Article publié par le quotidien Publico le 19 mai 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre)
PS : Nous publierons dans les jours qui viennent le message adressé aux membres du Bloco par la commission politique (21 mai) et l'analyse que le BE fait des élections et de la situation.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Stop austérité : de l’argent pour le non-marchand !

Nous publions ci-dessous la version longue du tract que nous distribuerons lors de la grève-manifestation du secteur non marchand, ce jeudi 22 mai à Bruxelles, lors de laquelle nous marcherons au sein du bloc de Commune Colère. Le tract est également disponible en version courte et bilingue fr/nl au format PDF en cliquantici.
19 mai 2025 | tiré du site de la Gauche anticapitaliste
https://www.gaucheanticapitaliste.org/stop-austerite-de-largent-pour-le-non-marchand/
Face à la casse sociale programmée par l'Arizona et les autres niveaux de pouvoirs, il est urgent de nous unir pour lutter. Cette manifestation est un point de convergence pour toutes les luttes en cours depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. La santé, le social, les services publics, l'enseignement, la culture, l'associatif : servons-nous de ce moment pour amplifier la résistance et la faire durer. Toustes dans la rue le 22 mai : l'Arizona veut la guerre de classe, les travailleur·euses ripostent en masse !
Alors que le secteur non-marchand se mobilise massivement depuis plusieurs années(1) pour un refinancement et des conditions de travail dignes, le gouvernement Arizona et ses émanations régionales en Flandre et en Wallonie dessinent une offensive sociale de grande ampleur contre les travailleur·euses du secteur. Dans la santé, la norme de croissance prévue par le fédéral est insuffisante pour répondre aux besoins réels, malgré les fausses promesses de Vooruit ou des Engagés ; les subsides des structures associatives sont rabotés ou menacés d'austérité alors que le secteur est déjà sous-financé ; la petite enfance, en lutte depuis des années contre la pénurie de personnel et pour une révision de la norme d'encadrement, voit ses revendications reportées indéfiniment (alors que le taux de couverture atteint à peine 40% en FWB). Par ailleurs, si les travailleur·euses des arts sont parvenu·es à faire reculer l'Arizona sur le statut d'artiste, les conditions d'octroi de ce statut seront désormais plus strictes. La culture est toujours l'objet d'une offensive trumpiste de George-Louis Bouchez.
De façon plus générale, les graves attaques contre l'ensemble des travailleur·euses (offensives contre les pensions et les allocations sociales, flexibilisation du travail, …) impacteront de plein fouet les femmes*, et toucheront particulièrement un secteur déjà précarisé par des décennies d'austérité néolibérale, dans lequel la pénibilité des conditions de travail cause de nombreuses souffrances, physiques et psychiques.
La plupart de ces métiers ont en commun de concerner le soin, c'est-à-dire de répondre aux besoins sociaux, affectifs, relationnels et éducationnels de la population. Ces fonctions indispensables à la société sont majoritairement portées par des femmes*, comme l'illustre la large féminisation du secteur : la défense du non-marchand est un enjeu féministe et sociétal majeur. En s'attaquant à ce secteur, les gouvernements s'en prennent non seulement aux travailleur·euses, mais également aux usager·ères, qui dépendent de ces structures pour des besoins vitaux : nous sommes toustes concerné·es ! Par leur mépris et leurs sous-financements, l'Arizona et les coalitions régionales illustrent bien la nature de leurs programmes, conformes aux intérêts des capitalistes et en faveur d'un monde soumis à la loi du profit, dans lequel les humain·es n'ont de valeur que s'iels sont productif·ves pour le capital !
Les secteurs de la culture et de l'enseignement se mobilisent déjà depuis plusieurs mois contre la guerre sociale orchestrée par la droite ; la petite enfance était en grève le 16 avril, et le secteur associatif porte de son côté de plus en plus sa voix parmi les mobilisations : nous plaidons pour que la manifestation du 22 mai crée un espace de convergence pour toutes ces revendications et constitue une nouvelle impulsion dans le cadre du plan d'action contre les gouvernements de droite, vers la chute de l'Arizona !
Nous revendiquons :
- Le financement massif et structurel des services publics et non-marchands, à hauteur des besoins (crèches, santé, éducation, culture, services sociaux, infrastructures d'accueil, homes).
- Recrutement massif pour alléger la charge de travail et pour améliorer les services, allant de paire avec une réduction collective du temps de travail sans perte de salaire et avec embauche compensatoire.
- Une sécurité financière pour toustes : pensions pour toustes ; augmentation des allocations sociales garantissant ainsi une vie digne pour chacun·e ; fin du statut de cohabitant÷e ; fin des temps partiels imposés qui maintiennent dans la précarité économique.
- Un système de soin soustrait aux logiques de marché : assurant la gratuité des soins, capable de prendre en compte les réalités des femmes*, des personnes racisées, des personnes sans-papier et des personnes LGBTI+ et orienté en fonction des besoins grâce à une planification démocratique.
- Une société du prendre soin où les fonctions de soins (crèche, soins aux malades, aux personnes âgées,…) ne sont plus assurées majoritairement par les femmes mais collectivisées.
- Une école qui répond à nos besoins et non ceux du capital : ouverte, démocratique et émancipatrice.
- La fin des politiques migratoires racistes et la régularisation sans condition de toutes les personnes sans-papiers pour mettre fin à leur exploitation et garantir un accès complet aux soins et aux droits sociaux.
- Dehors l'Arizona : pour une alliance large des mouvements sociaux et des syndicats, en défense d'une autre société : solidaire, démocratique, féministe, anti-raciste et écologiste !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’accord sur les minerais est-il bénéfique pour l’Ukraine ?

Aujourd'hui, la Verkhovna Rada vote la ratification de l'accord entre les gouvernements de l'Ukraine et des États-Unis sur la création du Fonds d'investissement pour la reconstruction américano-ukrainienne. Malgré les promesses bruyantes de « partenariat » et d'« investissement », le document suscite de sérieuses inquiétudes.
8 Mai 2025 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale
https://aplutsoc.org/2025/05/08/declaration-du-sotsialnyi-rukh-sur-laccord-sur-les-terres-rares/
L'accord, signé le 30 avril, reflète la volonté du capital américain d'accéder sans entrave au sous-sol ukrainien. Dans le même temps, la partie ukrainienne bénéficie de beaucoup moins de droits et d'opportunités. Le document stipule que l'accord prime sur la législation ukrainienne, ce qui limite la capacité à protéger les intérêts nationaux. Les entreprises américaines pourront retirer leurs bénéfices d'Ukraine sans entrave.
Tout cela s'inscrit dans des conditions où le processus d'approbation a été mené en secret, sans débat public. Aucun accord supplémentaire n'a encore été rendu public et il n'existe pas d'évaluation d'experts du projet. Cela porte atteinte à la légitimité de l'accord et prive la société du droit d'influencer les décisions décisives et porte atteinte à la gestion de ses propres terres et de son sous-sol.
L'accord fixe également la voie à suivre pour un modèle d'extraction de matières premières dans la politique économique de l'Ukraine – au lieu de développer des technologies ou l'industrie, il s'agit principalement d'extraire des ressources. Les aspects sociaux et environnementaux sont complètement ignorés. Ni les syndicats, ni les organisations environnementales n'ont été impliqués dans la discussion.
Finalement, l'accord est présenté comme un instrument de sécurité, mais ne garantit rien de concret : l'aide américaine reste conditionnelle et politiquement vulnérable. Dans le même temps, cela crée le sentiment que l'Ukraine a perdu le contrôle de ses propres ressources.
Ce n'est pas une catastrophe, mais un signal d'alarme. La seule façon de changer la situation est de construire une économie véritablement démocratique et socialement orientée, où le peuple contrôle les ressources et où les partenariats internationaux sont basés sur l'égalité et non sur la subordination.
8 mai 2025
Sotsialnyi Rukh
Publication originelle de cette déclaration : https://rev.org.ua/chi-korisna-ukra%d1%97ni-ugoda-pro-korisni-kopalini-top-5-problem/
Source : RESU / PLT.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Creuse, bébé, creuse » : comment l’extraction et l’exportation de matières premières essentielles peuvent aggraver le piège des ressources en Ukraine

L'intérêt pour les richesses minérales de l'Ukraine a explosé dans un contexte de concurrence mondiale pour les matières premières essentielles à la transition vers les énergies vertes et les nouvelles technologies. Cette transition, présentée comme une voie vers le développement durable et la lutte contre le changement climatique, cache de plus en plus une lutte géopolitique acharnée pour les ressources, où différents acteurs s'efforcent de s'assurer le contrôle des chaînes d'approvisionnement.
20 mai 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
L'attention mondiale se concentre désormais particulièrement sur « l'accord minier » entre l'Ukraine et les États-Unis, dans lequel les premières propositions de Donald Trump visant à échanger l'aide militaire américaine contre l'accès à une partie importante des richesses minérales de l'Ukraine ont révélé la nature cynique de cette course mondiale. Cet accord, présenté comme « des minerais en échange d'armes », a déclenché de vifs débats sur la question de savoir si l'Ukraine possède réellement la quantité et la qualité de minerais stratégiques capables de justifier des attentes aussi astronomiques et les ambitions coloniales de la nouvelle administration américaine.
Après l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, le gouvernement ukrainien a intensifié ses efforts pour positionner des ressources telles que le lithium, le titane, le graphite et les terres rares comme des atouts stratégiques destinés à attirer les investisseurs étrangers. L'objectif principal est de canaliser ces investissements vers la reconstruction d'après-guerre, en mettant particulièrement l'accent sur une « reprise menée par le secteur privé », qui sera coordonnée par BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde.
Dans le même temps, il est bien connu que les accords basés sur l'exploitation des ressources naturelles profitent rarement aux pays où ces ressources se trouvent. L'expérience de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine en est la preuve.
L'exemple de la République démocratique du Congo (RDC) est particulièrement révélateur. En février 2024, l'Union européenne et le Rwanda ont signé un accord sur les minerais visant à établir un partenariat stratégique sur des matières premières essentielles telles que le tantale, l'étain, le tungstène, l'or et le niobium. Dans le même temps, il est bien établi que les groupes rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, contrôlent des zones minières dans l'est de la RDC et font passer clandestinement des minerais au Rwanda, qui entrent ensuite dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces rebelles sont accusés de graves violations des droits humains, notamment de violences sexuelles systématiques et de crimes de guerre. Cette spirale de violence a régulièrement suscité des appels à l'UE pour qu'elle mette fin à son accord sur les matières premières avec le Rwanda afin d'éviter de contribuer à une nouvelle escalade du conflit.
La course mondiale aux matières premières essentielles peut provoquer des ingérences étrangères et mettre en danger les pays et les communautés qui deviennent la cible d'un extractivisme prédateur. La Bolivie, par exemple, est depuis longtemps au centre de la lutte mondiale pour les ressources minérales stratégiques. Le président bolivien Evo Morales a nationalisé les vastes réserves de ressources naturelles du pays, y compris le lithium, peu après son arrivée au pouvoir en 2006. Dans le cadre de plans visant à industrialiser la chaîne de production du lithium, des accords ont été signés avec la Chine et la Russie, prévoyant des partenariats avec la société publique YLB, des investissements dans les infrastructures locales et des transferts de technologie. La destitution de Morales en 2019 est directement liée à sa politique de nationalisation du lithium, qui a restreint l'accès des entreprises occidentales, dont Tesla, et favorisé le rapprochement avec la Chine et la Russie. Cet extractivisme prédateur dans la course aux matières premières est illustré par la réaction d'Elon Musk aux accusations selon lesquelles Tesla aurait été impliqué dans le coup d'État en Bolivie : « On fera un coup d'État contre qui on veut ! Faites avec. »
L'exploitation minière et l'utilisation des ressources minérales représentent environ la moitié de la capacité industrielle de l'Ukraine et jusqu'à 20% de sa main-d'œuvre. En 2024, les recettes provenant des exportations de minerais ne représentaient que 8,1% des exportations totales. Par rapport à 2021, ces chiffres ont baissé de près de 60%. En même temps, l'expérience de l'Ukraine avec ses propres ressources minérales — du charbon, qui a alimenté l'industrialisation soviétique, au lithium moderne, essentiel à la transition énergétique — montre un schéma familier : tant les acteurs externes qu'internes ont toujours cherché à profiter de cette richesse, souvent au détriment de la souveraineté du pays et de son développement économique durable.
Ce cycle d'exploitation s'inscrit parfois dans une dynamique mondiale plus large associée à ce qu'on appelle la « malédiction des ressources » ou le « syndrome hollandais », un paradoxe selon lequel les pays riches en ressources naturelles sont souvent confrontés à l'instabilité économique, à la montée de la corruption et aux abus des intérêts étrangers. Le « syndrome hollandais » apparaît généralement lorsque d'importants afflux de devises étrangères, provenant principalement des exportations de matières premières, entraînent un renforcement de la monnaie nationale, rendant les autres secteurs d'exportation moins compétitifs et entraînant le déclin de l'industrie manufacturière ou des exportations à forte valeur ajoutée. En même temps, cette vision, qui utilise les notions de « malédiction » et de « nature », a tendance à essentialiser la dynamique coloniale qui consiste à extraire systématiquement les ressources de la périphérie pour le développement du centre. Le discours sur la « malédiction » des pays riches en ressources présente les questions de dépendance et d'inégalité comme inévitables, découlant du simple fait de posséder des ressources. Ce faisant, il néglige souvent la persistance des structures de pouvoir coloniales.
Dans le contexte de l'intégration de l'Ukraine dans l'UE, les matières premières critiques sont devenues l'un des sujets de négociation, d'autant plus que l'UE cherche à garantir la continuité des chaînes d'approvisionnement pour la transition énergétique et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. En 2021, dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Ukraine et l'UE sur les matières premières, les réserves ukrainiennes de 22 des 34 minéraux essentiels à l'UE ont été identifiées. Depuis lors, la coopération s'est approfondie : l'Union européenne propose un « accord gagnant-gagnant » visant à promouvoir le développement durable et le partenariat stratégique.
Le piège des ressources : l'économie ukrainienne et les exportations de matières premières
L'Ukraine figure parmi les leaders mondiaux en matière de réserves et de production de minéraux essentiels, notamment le minerai de fer, le charbon, le manganèse, le titane, le graphite et les terres rares. Cette richesse minérale a joué un rôle crucial dans le développement de l'Empire russe et de l'Union soviétique. L'exploitation des gisements de charbon, de minerai de fer, de manganèse et d'uranium de l'Ukraine a été essentielle à l'industrialisation et à la puissance militaire de l'URSS. L'Ukraine a également joué un rôle clé dans la production de concentrés de titane, fournissant 90% de la production totale de l'ancienne Union soviétique. Les concentrés de titane sont utilisés comme matières premières pour la production d'alliages et de pigments de titane, largement utilisés dans les industries aérospatiale, militaire, médicale et chimique. Fait intéressant, sous la loi martiale, l'Ukraine a vendu la United Mining and Chemical Company (UMCC), la plus grande entreprise publique de production de minerai de titane du pays. Cette entreprise a été créée en 2014, lorsque l'État a repris le contrôle de deux entreprises clés du secteur du titane qui appartenaient auparavant à l'oligarque Dmytro Firtash. L'objectif stratégique de l'UMCC était de passer de l'exportation de matières premières à la fabrication de produits plus avancés technologiquement. Cependant, malgré son potentiel, l'entreprise n'a pas modernisé sa production et est restée un exportateur de matières premières. L'État n'a finalement pas réussi à exploiter le potentiel de l'UMCC et a perdu le contrôle de cet actif stratégique : à la suite d'une vente aux enchères en octobre 2024, à laquelle une seule entreprise a participé, l'homme d'affaires azerbaïdjanais Nasib Hasanov est devenu le nouveau propriétaire.
À l'époque soviétique, l'Ukraine produisait une large gamme de biens industriels et était l'un des principaux fournisseurs de charbon, de fonte, de minerai de fer et d'acier. Cependant, elle restait dépendante des importations de composants et de technologies de haute précision provenant d'autres républiques soviétiques. La plupart des fabricants ukrainiens ne disposaient pas de cycles de production complets, ce qui rendait la coopération avec les usines de l'URSS coûteuse. Au lieu de transformer ses propres matières premières, l'Ukraine les exportait vers d'autres républiques pour y être transformées, renforçant ainsi sa dépendance économique et les déséquilibres structurels façonnés par les priorités de l'Union plutôt que par son propre développement industriel.
Depuis son indépendance en 1991, la structure des exportations de l'Ukraine est restée principalement orientée vers les matières premières. L'industrie ukrainienne a continué à dépendre d'intrants bon marché, principalement l'énergie provenant de Russie, tout en exportant des produits à faible valeur ajoutée à des prix mondiaux plus élevés. Cependant, au lieu de profiter des termes de l'échange favorables pour diversifier et moderniser l'économie, les profits supplémentaires ont été distribués à un cercle restreint de « l'élite », ce qui a conduit à la concentration d'actifs importants entre les mains d'un petit groupe d'oligarques. En 2000, les métaux et les produits minéraux représentaient la moitié des exportations de l'Ukraine et, avec les produits agroalimentaires et chimiques, ces secteurs représentaient un peu plus de 70% des exportations totales du pays.
Certaines études citent l'Ukraine comme un exemple peu étudié du « syndrome hollandais » causé par une dépendance excessive aux ressources. Selon les chercheurs, la dépendance excessive de l'Ukraine à l'égard des exportations d'acier et de métaux ferreux, qui représentent près de 30% du total des exportations, a conduit à une structure économique faussée, caractérisée par la désindustrialisation, la vulnérabilité aux fluctuations mondiales des prix des matières premières et la stagnation de la production de haute technologie. Ils affirment que l'Ukraine souffre d'une variante du « mal hollandais », qui n'est pas due aux exportations d'énergie, mais à un modèle basé sur les matières premières qui canalise les ressources vers des secteurs à faible productivité et à la recherche de rentes plutôt que vers l'innovation et la fabrication. Lorsque les prix mondiaux de l'acier et des métaux ferreux ont augmenté, les recettes d'exportation de ce secteur ont considérablement augmenté, stimulant la demande de hryvnia sur les marchés des changes et renforçant ainsi la monnaie. Ça a rendu les produits ukrainiens plus chers pour les acheteurs étrangers, ce qui a profité aux exportateurs d'acier pendant le boom des marchés des matières premières, mais a nui à d'autres secteurs, comme la construction mécanique et la technologie, dont les produits sont devenus moins compétitifs à l'étranger. Dans le même temps, bien que l'Ukraine présente des symptômes similaires à ceux du syndrome hollandais, tels que la désindustrialisation, la prédominance des exportations de matières premières et la faiblesse des secteurs de haute technologie, il convient de noter que le déclin des industries de haute technologie a commencé plus tôt, après l'effondrement de l'Union soviétique, lorsqu'elles n'ont pas été en mesure de rivaliser au niveau mondial. La rupture des liens de coopération dans l'espace post-soviétique, le manque d'investissements et la perte de marchés, en particulier après la crise financière de 1998 en Asie et en Russie, ont accéléré le déclin des producteurs ukrainiens. L'orientation de l'Ukraine vers les matières premières est donc devenue une adaptation forcée plutôt que le résultat d'un effet d'éviction causé par l'appréciation de la monnaie induite par les exportations de matières premières.
La crise économique mondiale de 2008 a porté un coup dur à l'économie ukrainienne. Le secteur financier s'est effondré, révélant la dépendance critique de l'Ukraine à l'égard des matières premières, qui avait alimenté la croissance au début des années 2000. La crise a aussi entraîné un déclin rapide des industries à valeur ajoutée restantes qui n'avaient pas réussi à se moderniser : par exemple, la production de voitures, d'autobus et de tracteurs a baissé respectivement de 98%, 90% et 77% entre 2007 et 2021. En fin de compte, la dépendance à l'égard des exportations de matières premières a créé un cercle vicieux dans lequel la croissance économique est restée liée à la volatilité des marchés mondiaux des matières premières, entravant la modernisation d'autres secteurs.
Aujourd'hui, la structure des exportations de l'Ukraine reste dominée par les matières premières et les produits peu transformés.
Cependant, alors qu'en 2008, les produits métallurgiques représentaient 43,2% des recettes totales d'exportation de l'Ukraine, leur part était tombée à 24,9% à la fin de 2017. Cette baisse est principalement due à la chute des prix mondiaux de l'acier, à la perte de compétitivité de l'acier ukrainien sur les marchés internationaux, à une baisse importante des investissements dans le secteur sidérurgique et, enfin, à la guerre. Aujourd'hui, le secteur agricole génère environ la moitié des recettes d'exportation de l'Ukraine. En 2024, les matières premières représentaient plus de 66% des exportations totales de l'Ukraine, les https://eba.com.ua/en/bdo-v-ukrayini-pidtrymuye-plan-dlya-ukrayiny-pro-zbilshennya-eksportu-na-50-do-2030-roku-vid-logistyky-do-tehnologij/] restant les principales sources de revenus d'exportation. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB est actuellement d'environ 10%, soit la moitié seulement de la référence de l'OCDE.
Depuis son indépendance, l'économie ukrainienne est restée dépendante des exportations de matières premières peu transformées. Cette dépendance a rendu l'Ukraine vulnérable aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux des matières premières, contribuant à la désindustrialisation et entravant le développement des industries de haute technologie.
La géopolitique des matières premières essentielles de l'Ukraine
Les matières premières essentielles telles que le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, les terres rares, le cuivre et le silicium sont indispensables à la fabrication de semi-conducteurs, de batteries et d'une large gamme d'appareils de haute technologie. Leur rôle important est particulièrement évident dans le secteur des énergies renouvelables. Les terres rares sont essentielles à la production d'aimants permanents, qui sont des composants essentiels des éoliennes et des moteurs de véhicules électriques. Parallèlement, les réseaux électriques nécessitent des quantités importantes de cuivre et d'aluminium , le cuivre étant le matériau de base de presque toutes les technologies liées à l'électricité.
La saisie agressive des ressources naturelles de l'Ukraine est un élément clé de la stratégie militaire de la Russie. L'occupation des territoires ukrainiens a permis au Kremlin de prendre le contrôle de vastes réserves de minéraux essentiels, de ressources énergétiques et de terres agricoles. Il n'est donc pas surprenant que la Russie se soit récemment fixé pour objectif de supprimer complètement sa dépendance vis-à-vis des importations de matières premières essentielles d'ici 2030. Selon le directeur de Rosnedra, Evgeny Petrov, « grâce à une série de mesures prises,nous prévoyons d'éliminer d'ici 2030 notre dépendance vis-à-vis des importations de 12 matières premières rares, notamment le lithium, le niobium, le tantale, les métaux rares, le zirconium, le manganèse, le tungstène, le molybdène, le rhénium, le vanadium, le spath fluor et le graphite. Pour une ressource high-tech comme le lithium, on espère y arriver d'ici 2028. » Depuis 2014, et surtout après l'invasion à grande échelle de 2022, la Russie cible systématiquement les gisements de lithium, de titane, de terres rares, de charbon, de pétrole et de gaz. La Russie se prépare déjà activement à l'exploration géologique de minéraux critiques dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, en particulier dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Les médias russes ont accordé une attention particulière au gisement de lithium de Shevchenkivske dans la région de Donetsk et au gisement de lithium de Kruta Balka dans la région de Zaporijia. Au final, le contrôle de la Russie sur les réserves ukrainiennes va accélérer son expansion dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et augmenter considérablement sa pression sur l'UE et d'autres pays en consolidant son contrôle sur les matières premières critiques. Les ambitions de la Russie sont encore renforcées par son partenariat de plus en plus étroit avec la Chine. Des commentateurs russes ont évoqué la coordination des stratégies de la Russie et de la Chine en matière de métaux rares comme une « arme commune » contre l'influence occidentale et pour contrôler les chaînes d'approvisionnement essentielles aux technologies de pointe. En même temps, la Russie développe activement sa coopération avec les pays du Sud dans le domaine des matières premières essentielles. Par exemple, fin 2023, la Bolivie et la Russie ont annoncé un investissement de 450 millions de dollars dans un projet pilote de production de lithium dans le désert de sel d'Uyuni, en Bolivie. En échange, Rosatom construit un centre de recherche et de technologie nucléaire en Bolivie.
La Chine occupe une position dominante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de matières premières essentielles, tant au niveau de l'extraction que de la transformation, comme le cuivre, le cobalt, le lithium, le graphite et les terres rares. Par exemple, la Chine représente près de 100% de la transformation mondiale du graphite sphérique, environ 80% du gallium, environ 60% du raffinage du lithium et du germanium, et plus de 60% de la transformation du cobalt.
Compte tenu de la domination mondiale de la Chine et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement ukrainien a intensifié ses efforts pour promouvoir les matières premières essentielles du pays en tant qu'atout stratégique afin d'attirer les investissements occidentaux et de soutenir la reconstruction après la guerre. Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que l'une des principales priorités du gouvernement était de développer un nouveau modèle économique pour l'Ukraine, dans le but de faire du pays un centre de ressources pour l'Europe. Selon le Guide de l'investissement en Ukraine, publié par la Kyiv School of Economics et le ministère de l'Économie, l'Ukraine possède 117 des 120 types de minéraux les plus courants. Le gouvernement souligne également que l'Ukraine figure parmi les dix premiers producteurs mondiaux de plusieurs minéraux stratégiques, notamment le titane, le manganèse, le minerai de fer, le zirconium, le graphite et l'uranium.
Dans le même temps, les États-Unis font pression sur l'Ukraine pour qu'elle accélère l'extraction et l'exportation de matières premières essentielles dans le cadre de leur stratégie visant à réduire la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine. Étant donné que la Chine représente plus de 70% des importations américaines de terres rares et qu'elle a récemment imposé des restrictions à l'exportation, toute nouvelle restriction pourrait avoir de graves conséquences. En 2023 et 2024, la Chine a imposé des restrictions à l'exportation de gallium, de germanium, de graphite et d'antimoine, et en décembre 2024, elle a complètement interdit la fourniture de gallium, de germanium et d'antimoine aux États-Unis, invoquant la sécurité nationale. Ces mesures faisaient suite aux restrictions imposées par les États-Unis au secteur chinois des semi-conducteurs. En réaction, Washington a commencé à voir les vastes réserves minérales de l'Ukraine comme une alternative pour renforcer sa sécurité nationale. Les restrictions à l'exportation imposées par la Chine sur les technologies de pointe en matière de transformation sapent directement les efforts des États-Unis et de l'UE pour développer leur capacité industrielle dans ce domaine, alors que les deux parties recherchent activement des équipements et des compétences de pointe. Cependant, la plupart de ces solutions de haute technologie sont concentrées en Chine, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des quatre décennies d'investissement. Au cours de cette période, les États-Unis et l'UE ont non seulement réduit leur capacité de production, mais aussi considérablement réduit le financement de la recherche et du développement dans ce secteur, ce qui les a placés dans une position désavantageuse. Ces dernières années, les États-Unis se sont efforcés de retrouver leur rôle dans le secteur des terres rares. La seule mine de terres rares de Mountain Pass, en Californie, qui était à l'arrêt depuis longtemps, a repris sa production en 2017. Cependant, jusqu'à récemment, les matières premières extraites étaient envoyées en Chine pour être transformées.
La coopération de l'Ukraine avec les États-Unis est devenue de plus en plus transactionnelle depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui a présenté l'accès aux ressources ukrainiennes comme une compensation pour les milliards de dollars d'aide fournis par les États-Unis pendant la guerre. Les négociations actuelles sont tendues : l'Ukraine cherche à obtenir des garanties de sécurité, mais l'approche américaine reflète la logique de Trump, qui consiste à rechercher des avantages directs des investissements étrangers tout en limitant l'influence de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement critiques. Cette stratégie est similaire au modèle chinois « ressources contre infrastructures », notamment l'accord Sicomines de 2007 en République démocratique du Congo, dans le cadre duquel la Chine devait investir 3 milliards de dollars dans les infrastructures en échange de droits miniers évalués à 93 milliards de dollars. Si cet accord a apporté à la RDC des capitaux dont elle avait grand besoin, le pays a par la suite cherché à le renégocier, exprimant ses inquiétudes quant au fait de ne pas recevoir une part équitable des bénéfices. Une partie des infrastructures promises n'a pas été entièrement réalisée ou a été construite avec des matériaux de mauvaise qualité. Parallèlement, les bénéfices des activités minières sont principalement allés à des entreprises chinoises, tandis que la RDC n'a reçu qu'une part relativement faible des revenus réels. L'accord sur les minerais conclu entre les États-Unis et l'Ukraine risque de perpétuer les schémas de contrôle extérieur et de répartition inégale des bénéfices, au détriment de ce pays riche en ressources. De tels accords peuvent entraîner une augmentation des coûts des projets, car ils obligent souvent les gouvernements à coopérer avec des entreprises spécifiques sans appel d'offres concurrentiel. Des problèmes de qualité et de contrôle peuvent survenir, car les entrepreneurs contrôlent généralement le financement et la mise en œuvre des projets, ce qui limite la capacité de surveillance du gouvernement. La structure complexe et non transparente augmente le risque de mauvaise gestion, et l'absence de concurrence et la nature à long terme de ces accords peuvent créer des déséquilibres financiers qui profitent à l'investisseur au fil du temps. L'accord signé par l'Ukraine et les États-Unis le 30 avril 2025 accorde aux États-Unis un accès quasi exclusif à de nouvelles licences pour l'extraction de minéraux et de matières premières essentielles, comme le souhaitait le président Trump. Si l'accord n'oblige pas l'Ukraine à rembourser l'aide américaine antérieure ni à transférer la pleine propriété des ressources, il ne prévoit pas non plus de garanties de sécurité de la part des États-Unis.
L'Union européenne dépend à 100% de la Chine pour tous les éléments de terres rares lourds, notamment le dysprosium (aimants dans les véhicules électriques et les éoliennes), l'erbium (dispositifs à fibre optique, lasers), le lutétium (détecteurs, imagerie médicale), le terbium (phosphores pour écrans), le thulium (lasers, appareils de radiographie portables) et autres – et à 85% des éléments de terres rares légères, comme le cérium (matériaux de polissage), le lanthane (batteries, verre optique), le néodyme (aimants, lasers, verre), le praséodyme (alliages, aimants, verre) et le samarium (aimants, réacteurs nucléaires, verre). Bien que la dépendance de l'UE à l'égard de la Chine pour d'autres matières premières essentielles soit légèrement moins importante, elle reste significative. Par exemple, la Chine fournit 71% des importations de gallium de l'UE, 97% de son magnésium, 40% de son graphite naturel et 62% de son vanadium. En raison de cette dépendance, l'UE s'intéresse de plus en plus à l'Ukraine depuis quelques années comme fournisseur potentiel de matières premières essentielles.
Les matières premières critiques de l'Ukraine dans le contexte de l'intégration européenne
En juillet 2021, avant l'invasion russe, l'Union européenne et l'Ukraine ont signé un protocole d'accord visant à renforcer l'intégration des chaînes de valeur dans les secteurs des matières premières critiques et des batteries. À la suite de la signature du protocole d'accord, une feuille de route a été élaborée, décrivant les mesures spécifiques convenues par les deux parties pour établir un partenariat stratégique. Il est à noter que cet instrument ne prévoit pas la création d'un organisme indépendant chargé de surveiller les activités dans ce domaine. La participation du public n'est pas envisagée, tandis que les représentants des secteurs économique et industriel sont prioritaires. Dans l'ensemble, la formulation de ces documents reste assez vague. Bien que l'UE exprime son intention d'intégrer l'Ukraine dans la chaîne de valeur des matières premières et des batteries, les documents signés ne mentionnent pas explicitement la production de produits finis directement en Ukraine.
En mars 2023, le gouvernement ukrainien a adopté la loi « sur les modifications de certains actes législatifs ukrainiens visant à améliorer la législation dans le domaine de l'utilisation du sous-sol », qui vise à déréglementer le secteur. Elle supprime notamment la nécessité d'obtenir l'autorisation des autorités locales, du Service national de géologie et des ressources minérales, du Service national du travail et d'autres organismes pour accéder au sous-sol, exploiter des gisements, prélever de l'eau et concevoir des installations minières. Ces changements, qui visent à attirer les investissements et à réduire les charges administratives pour les entreprises, ont en fait exclu les communautés du processus décisionnel. La loi autorise aussi la délivrance de permis spéciaux d'utilisation du sous-sol sans enchères aux entreprises qui ont fait des études géologiques à leurs frais. Même si cette pratique existe dans d'autres pays pour stimuler les investissements, elle comporte souvent des risques de corruption : les entreprises peuvent faire des recherches minimales et ensuite acquérir des actifs précieux sans concurrence. L'absence de vérification indépendante des résultats des recherches géologiques crée d'autres possibilités d'abus. En plus, dans le cadre des efforts de déréglementation en cours, le Conseil des ministres a adopté la résolution n°749 le 4 juillet 2023, qui supprime l'obligation de coordonner avec le ministère de la Protection de l'environnement et des Ressources naturelles la vente de permis pour les sites où des explorations géologiques ont déjà été menées. Le cas du secteur naturel de la forêt vierge de Makove Boloto (« marais aux coquelicots ») dans la région de Rivne, où un permis d'extraction de tourbe a été accordé, illustre clairement ce problème. Ce permis couvrait toute la superficie du secteur, officiellement créé fin 2021, et ouvrait effectivement la voie à sa destruction, car l'extraction de la tourbe implique l'élimination complète de la végétation et de la couche arable. Des cas similaires se sont produits dans la réserve naturelle de Starovyzhivskyi et à proximité de la réserve historique et culturelle de Busha.
Les matières premières critiques font désormais l'objet d'une section spécifique dans l'instrument « Ukraine Facility » doté de 50 milliards d'euros pour la période 2024-2027. Selon le plan de l'Ukraine au titre de cet instrument, le partenariat avec l'UE vise à approfondir l'intégration des chaînes de valeur dans les secteurs des matières premières critiques et des batteries en développant les ressources minérales de l'Ukraine sur la base d'une approche durable et socialement responsable. En même temps, le secteur devrait être réglementé selon les normes de l'UE, en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que des lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Cependant, les normes spécifiques auxquelles le gouvernement fait référence ne sont pas précisées. Ces documents internationaux sont volontaires et fournissent des orientations pour des pratiques commerciales éthiques, mais ils n'ont pas force de loi s'ils ne sont pas intégrés dans la législation nationale. De même, si le gouvernement fait référence au respect des principes ESG, il ne précise pas quelles normes, quels indicateurs ou quels mécanismes de vérification seront appliqués. Le paysage des normes ESG est lui-même fragmenté, avec des niveaux d'ambition et d'application variables. L'une des réformes décrites dans le plan est l'élaboration d'une étude visant à évaluer la législation actuelle en matière de reporting environnemental, social et de gouvernance dans le secteur minier. Le fait que le gouvernement prévoie d'« approuver et publier l'étude » alors qu'il a déjà mis en œuvre des mesures de déréglementation importantes dans le secteur montre clairement que les considérations ESG n'ont pas été systématiquement intégrées dans les réformes initiales. Des formulations telles que « introduction progressive de l'obligation de reporting ESG » et le respect du principe « ne pas causer de préjudice significatif » – dans la mesure du possible dans des conditions de guerre ou de reconstruction après-guerre – soulignent plutôt une approche formelle, orientée vers l'UE, de ces engagements.
L'adoption du règlement de l'UE sur les matières premières critiques en mars 2024 renforcera encore la coopération déjà établie. En décembre 2024, le Parlement ukrainien a approuvé un programme national actualisé pour le développement de la base minérale et des matières premières de l'Ukraine pour la période allant jusqu'en 2030, qui sert d'indicateur de la mise en œuvre de la facilité pour l'Ukraine. Le programme actualisé définit les critères de classification des ressources minérales comme stratégiquement importantes. Dans l'ensemble, cette loi vise à élargir considérablement les projets d'extraction à grande échelle. Il est à noter que dans la section consacrée à la tourbe, la loi souligne que l'exploitation de nouveaux gisements de tourbe, qui nécessite un drainage, entraîne la perte des fonctions biosphériques, une augmentation des risques environnementaux dans la région et la transformation des tourbières de puits de carbone en sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Bien que le document reconnaisse la nécessité d'aligner l'extraction de la tourbe sur la politique climatique et environnementale de l'État, il ne prévoit pas de mécanismes pratiques ni de garanties pour assurer cette harmonisation. La loi prévoit également la poursuite des investissements dans les gisements de houille et l'expansion de l'extraction du lignite (charbon brun). À l'heure actuelle, le programme national semble contredire le plan national de l'Ukraine en matière d'énergie et de climat, qui prévoit l'élimination progressive du charbon dans le secteur de l'électricité d'ici 2035, conformément aux objectifs du Pacte vert européen.
Les risques du piège des ressources : les leçons à tirer
La proposition du gouvernement ukrainien d'utiliser les ressources minérales comme un moyen d'attirer l'aide internationale risque de reproduire les modèles d'exploitation typiques d'autres pays dépendants des ressources. Mettre l'accent sur l'exportation de matières premières essentielles pour garantir un soutien extérieur pourrait renforcer la dépendance à long terme vis-à-vis des acteurs étrangers, compromettant ainsi les efforts visant à reconstruire une économie diversifiée et autosuffisante. Une dépendance excessive à l'exportation de matières premières essentielles pourrait donner aux États étrangers un moyen de pression sur la politique économique de l'Ukraine. Un exemple parlant est la dépendance de l'Ukraine vis-à-vis des ressources énergétiques russes et leur impact sur les processus politiques et économiques ukrainiens, en particulier lorsque la Russie a utilisé ses approvisionnements en gaz comme moyen de pression politique et de chantage économique, tentant à plusieurs reprises de prendre le contrôle d'infrastructures stratégiques, notamment le réseau de transport de gaz ukrainien.
L'histoire du contrôle oligarchique en Ukraine, en particulier dans des secteurs tels que la métallurgie et la production de titane, où les matières premières étaient exportées au lieu d'être transformées dans le pays, montre comment la mainmise des élites sur les ressources et la faiblesse de la gouvernance peuvent détourner les revenus miniers destinés à la reconstruction nationale vers des intérêts privés. Ça risque de renforcer le rôle de l'Ukraine en tant que fournisseur de matières premières plutôt que de la transformer en producteur de biens à forte valeur ajoutée. Exporter des matières premières, c'est aussi passer à côté d'opportunités de développer les secteurs manufacturiers nationaux, et avec eux, des revenus et des emplois potentiels.
En même temps, l'exploration et l'extraction de matières premières essentielles sont des projets à haut risque et à forte intensité de capital, généralement accessibles uniquement à un petit nombre de grandes entreprises. Ces initiatives minières nécessitent des investissements initiaux importants, allant de 500 000 à 15 millions d'euros par projet, et impliquent des étapes longues et complexes : exploration géologique, études de faisabilité et obtention des permis d'exploitation. La mise en production industrielle d'un gisement minéral peut prendre des années et coûter entre 1 million et plus d'un milliard de dollars américains, selon le type de mine. Des études indiquent que, en moyenne, il faut jusqu'à 16,5 ans entre la phase d'exploration et le début de la production. Les grands groupes commerciaux ukrainiens qui ont accès à des capitaux sont capables de participer à des projets miniers à grande échelle. Mais leur implication soulève de sérieuses questions sur la transparence, la répartition équitable des bénéfices et le risque que les profits tirés des ressources essentielles de l'Ukraine finissent une fois de plus entre les mains d'un petit groupe d'individus, au lieu de contribuer à un développement économique global et à l'intégration avec l'Union européenne.
La volatilité des prix mondiaux des matières premières peut aussi déstabiliser l'économie ukrainienne. L'expérience de l'Ukraine en tant qu'exportateur de métaux ferreux illustre clairement ce risque. Au cours de la dernière décennie, les entreprises sidérurgiques ukrainiennes ont été très vulnérables aux fluctuations imprévisibles des prix mondiaux, qui ont eu un impact direct sur les volumes d'exportation, les revenus des entreprises et la balance des paiements du pays. Actuellement, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la guerre, la stagnation du marché intérieur et les conditions d'exportation de plus en plus défavorables, notamment les droits de douane, limitent les activités du secteur sidérurgique ukrainien. Selon les représentants du secteur, la production d'acier devrait baisser de 9% en 2025, avec une chute des exportations de 16%. Cette dépendance vis-à-vis des exportations de matières premières signifie que les chocs extérieurs peuvent rapidement déstabiliser l'économie, perturber les recettes budgétaires de l'État et mettre en péril des emplois.
En plus, l'extraction de matières premières essentielles pose des risques environnementaux importants, tels que des émissions importantes de gaz à effet de serre, la pénurie et la pollution de l'eau, la dégradation des sols et la perte de biodiversité. L'utilisation de l'eau constitue un défi supplémentaire, car de nombreuses mines sont situées dans des régions déjà confrontées à des pénuries, et les activités d'extraction et de transformation contaminent souvent les ressources en eau locales avec des substances toxiques et des métaux lourds. L'extraction du cuivre et du lithium est particulièrement gourmande en eau, ce qui exerce une pression supplémentaire sur des ressources déjà limitées. L'expansion physique des zones minières entraîne la déforestation, l'érosion des sols et la destruction des habitats naturels, menaçant la biodiversité locale. En plus, dans l'extraction des terres rares, même dans les meilleures conditions, seulement environ 2% de la masse extraite contient des matériaux précieux, même si les concentrations peuvent atteindre jusqu'à 20% dans certains gisements. Ces minerais contiennent souvent des impuretés nocives comme l'arsenic, le thorium, le fluor et l'uranium. Pendant des décennies, des quantités importantes de ces sous-produits toxiques ont été rejetées dans l'environnement, se répandant dans l'air et l'eau. En conséquence, les polluants sont entrés dans la chaîne alimentaire, et des études à grande échelle ont établi un lien entre l'exposition à ces polluants et des effets graves à long terme sur la santé, notamment des troubles du développement chez les enfants, une augmentation de l'incidence des maladies osseuses et d'autres maladies chroniques.
En fin de compte, alors que le gouvernement se concentre entièrement sur la participation du secteur privé à la reconstruction de l'Ukraine, en donnant la priorité aux projets d'extraction de matières premières essentielles à long terme, le pays risque une fois de plus d'être pris au piège dans le cercle vicieux qui consiste à servir de fournisseur de matières premières pour d'autres économies.
Maryna Larina, 14 mai 2025
https://commons.com.ua/en/resursna-pastka-ukrayini/
Traduction de l'ukrainien : Pavlo Shopin en Français Deepl revue ML
https://www.reseau-bastille.org/2025/05/18/creuse-bebe-creuse-comment-lextraction-et-lexportation-de-matieres-premieres-essentielles-peuvent-aggraver-le-piege-des-ressources-en-ukraine/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Philippe Bihouix : « Le monde d’après sera celui de la sobriété systémique »

Alors que les ressources se raréfient et que le monde s'automatise toujours plus, l'ingénieur pionnier des low-tech Philippe Bihouix prône dans cet entretien une « sobriété systémique » organisée par l'État. Philippe Bihouix est ingénieur. Après avoir été l'un des premiers à alerter sur la pénurie à venir des métaux, il a été un pionnier en France de la low-tech. Il a publié, avec Vincent Perrot, la BD Ressources (éd. Casterman). Cet entretien de notre série Le Monde d'après a été enregistré au Musée des arts et métiers, en partenariat avec celui-ci.
Lisez ce grand entretien ci-après ou écoutez-le ci-dessous ou sur une plateforme d'écoute de votre choix et regardez-le en vidéo.
24 avril 2025 | tiré de reporterre.net |Photo de Bihouix : Mathieu Génon
https://reporterre.net/Philippe-Bihouix-Le-monde-d-apres-sera-celui-de-la-sobriete-systemique
Reporterre — Vous êtes ingénieur et avez été l'un des premiers à alerter sur la pénurie prochaine des matières premières. Comment imaginez-vous le monde d'après le capitalisme ?
Philippe Bihouix — C'est un monde où l'on est réconciliés avec le vivant, mais aussi où l'on a réussi à s'organiser collectivement autour d'une sobriété systémique. Je ne parle pas ici d'un retour à l'âge de pierre — l'image est convoquée chaque fois que l'on évoque une trajectoire autre que l'astrocapitalisme promu par Elon Musk [le patron, notamment, de Tesla] ou Jeff Bezos [le patron, notamment, d'Amazon] —, mais d'un monde où l'on a fait évoluer nos valeurs et, d'une certaine manière, nos rêves.
Les vieux rêves de l'humanité ont peut-être toujours été les mêmes : l'immortalité, l'abondance, la capacité à avoir des esclaves qui nous servent. Dans l'Antiquité, il y avait des esclaves humains, puis il y a eu des esclaves machines, qui désormais ne suffisent plus. On nous promet donc à présent des esclaves robots, avec cette idée que l'on va tous avoir des assistants personnels.
Je pense donc que, dans le monde d'après, il y aura à la fois des enjeux techniques et technologiques autour de la préservation des ressources et de la réduction de l'extractivisme, et surtout un enjeu d'affirmation de valeurs et de rêves. Au fond, il est important d'avoir un récit — c'est par exemple le cas de Donald Trump : on peut lui reprocher mille choses, mais il embarque des gens avec lui. Il faut que l'on trouve des contre-récits : voilà l'enjeu de ce monde d'après.
Qu'est-ce que la sobriété systémique ?
Le mot sobriété s'est invité dans le débat public avec l'explosion des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Et ce terme, comme d'autres qui l'ont précédé — par exemple « développement durable » —, est polysémique. L'acception qu'en a le gouvernement renvoie à la notion d'efficacité, en particulier industrielle, avec l'idée qu'en électrifiant certains process qui fonctionnent aujourd'hui avec des énergies primaires (le gaz, le charbon, le fioul), nous allons pouvoir consommer moins.
Ce mot peut aussi renvoyer à la sobriété individuelle, avec l'idée, par exemple, de baisser le chauffage chez soi. Cela a une efficacité technique indéniable… mais c'est problématique pour les personnes souffrant déjà de précarité énergétique. La sobriété individuelle demande des efforts substantiels.
La sobriété systémique, elle, renvoie à quelque chose de différent : elle ne repose pas sur une somme de gestes individuels et sur l'idée qu'au fond, tout serait toujours un peu de notre faute. La sobriété systémique, c'est quelque chose qui est organisé, favorisé, influencé voire imposé par la puissance publique via des décisions réglementaires et fiscales.
Pouvez-vous donner un exemple ?
Imaginons que l'on veuille aller vers un monde où les voitures seraient de petite taille. En tant qu'ingénieur, il est évident que pour réduire les émissions de CO2, il faudrait déjà que les véhicules soient moins lourds, moins puissants, moins rapides. La puissance publique pourrait donc réfléchir à une fiscalité sur les gros véhicules, à certaines obligations réglementaires, à des aides fléchées de telle ou telle manière…
Mais aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas se permettre que leurs produits ne se vendent pas. Cela a pour conséquence de créer de l'inflation technologique entre concurrents : si telle entreprise propose tel service pour sa voiture, l'autre doit aussi le faire — ce qui entraîne une utilisation plus importante de ressources. Il y a donc aussi cet aspect culturel à déconstruire.
« La sobriété systémique doit être organisée par la puissance publique »
De façon générale, avec l'arrivée de l'automatisation, de la robotisation et à présent de l'intelligence artificielle — en bref, avec le remplacement des humains par des machines —, nous consommons davantage de ressources. Le problème est que toutes les organisations — entreprises et administrations — sont incitées à fonctionner de cette manière : c'est meilleur pour le résultat net, cela augmente la qualité des produits et, en plus, une machine ne fait pas grève.
Dans le même temps, cela crée des externalités environnementales négatives et entraîne un pillage des ressources. D'autant plus qu'on ne met personne au travail pour réparer tout ce que l'on abîme.
C'est un problème : nous abîmons de plus en plus d'endroits.
Bien sûr. Au-delà du réchauffement climatique, l'époque de l'Anthropocène se caractérise par les milliards de tonnes de ressources extraites par les humains, et par la création de déchets. À un moment donné, il sera nécessaire que davantage de personnes travaillent dans des secteurs ayant pour but de réparer ces dommages. Cela dit, il y a déjà des activités professionnelles qui promeuvent des promesses technoréparatrices de la planète : la géo-ingénierie, la capture et le stockage de carbone…
Mais ces innovations peuvent servir de justification à la continuation des destructions en cours, non ? Tout comme les plans d'adaptation au changement climatique, comme celui lancé par le gouvernement français en mars 2025.
Il y a des gens de bonne foi, des jeunes ingénieurs, qui ont envie de faire des choses allant dans le bon sens. Mais je ne sais pas si, en effet, ces innovations permettent de justifier le maintien de notre trajectoire actuelle.
Dans les années 2010, il y a d'ailleurs eu un débat assez aigu autour de la question de l'atténuation ou de l'adaptation au changement climatique. Durant ces années-là, la plupart des gens qui travaillent sur le climat, les écologistes, ne voulaient pas entendre parler d'adaptation en ce qu'elle était un renoncement à la trajectoire de décroissance qu'ils appelaient de leurs vœux.
C'est seulement à partir de 2020 que finalement, les émissions continuant à croître chaque année, il a été question de mettre les deux fers au feu : à la fois l'atténuation mais aussi l'adaptation.
Au fond, cette situation relève de choix politiques. Par exemple, la non-rénovation énergétique des bâtiments en France est le fruit d'un choix politique de l'État.
Ce n'est en effet pas une fatalité. Mais en l'occurrence, si l'on prend l'exemple du secteur de la ville et du bâtiment, il se caractérise par sa grande inertie. Pour transformer l'ensemble des bâtiments, il faudrait multiplier par vingt la vitesse à laquelle nous allons aujourd'hui, dégager des moyens financiers, impliquer des filières industrielles… Ce n'est pas si évident que cela.
En revanche, il existe déjà des solutions low tech. Elles ne sont pas basées sur l'adaptation du bâti en tant que tel, qui est une chose complexe à mettre en œuvre, mais sur l'adaptation comportementale ou organisationnelle.
On pourrait par exemple s'inspirer de ce qui se passe en Espagne. Que font les Espagnols en cas de forte chaleur ? Ils ne vont pas à l'école aux mêmes heures que d'habitude et ils font la sieste. Il s'agit là d'une adaptation organisationnelle, d'une adaptation des rythmes de vie, d'une adaptation culturelle.
Il y a plein de choses à inventer. Par exemple, concernant l'utilisation de l'énergie en période de pénurie, on pourrait imaginer dans un futur proche de flécher prioritairement celle-ci vers les services essentiels, comme les hôpitaux et les transports. Et que, par exemple, pendant deux jours à la maison, je m'enveloppe dans une couette plutôt que de mettre le chauffage.
« On pourrait imaginer dans un futur proche de flécher prioritairement l'énergie vers les services essentiels »
En fait, aujourd'hui, nous sommes très capricieux en tant que citoyens-consommateurs, alors que la plupart des services auxquels nous avons accès fonctionnent au cordeau. Prenons l'exemple du train : quand je prends un TGV roulant à 300 km/h et qu'il s'arrête en pleine voie, si, dans les deux minutes, je n'ai pas d'explications de pourquoi le train est arrêté, je vais twitter rageusement et dire que les employés de la SNCF sont des feignasses. Je simplifie bien sûr en disant cela, mais je pense que nous sommes vraiment devenus très exigeants en tant que consommateurs [Philippe Bihouix est ingénieur à la SNCF].
Peut-être que demain nous reviendrons à des logiques où l'on acceptera des dégradations de performance, lesquelles auront été décidées de manière plus démocratique que technocratique.
Ce monde où tout marche parfaitement ne marche pas si parfaitement que ça. Par exemple, le tissu ferroviaire a disparu, et les gens sont obligés de prendre leur voiture parce qu'il n'y a plus de services publics à proximité.
Il est certain qu'il faut remettre la priorité sur les trains du quotidien. Cela dit, il faut toujours faire attention aux comparaisons avec le passé. La situation du ferroviaire a beaucoup évolué : le nombre de trains qui circulent a énormément augmenté, mais le réseau est quasiment resté le même. Le nombre de trains du quotidien est tellement énorme aujourd'hui que toute perturbation génère des problèmes en cascade. La situation est donc compliquée.
Quoi qu'il en soit, il est évident que des choix politiques et financiers sont faits aujourd'hui, et que certains secteurs sont laissés pour compte. Je pense notamment à la justice ou à l'hôpital public. Que se passe-t-il à l'hôpital ? À l'image de ce qui se passe dans le monde agricole, on assiste à une inflation technologique. Le problème est que les machines et leur maintenance coûtent extrêmement cher. Cela fait que de plus en plus d'argent est investi dans les machines au détriment des humains.
Voilà pourquoi le discernement technologique est important : les machines permettent un certain nombre de choses souhaitables et bénéfiques — en permettant aux humains de s'éviter certains actes professionnels pénibles — mais, dans le même temps, il y a une course en avant stupide qui crée des besoins artificiels et, par ricochet, de la production qui permet de les assouvir. L'idée serait de trouver une espèce de juste mesure entre les deux.
Les « low-tech » sont-elles la technologie du monde d'après ?
Les low-tech, au départ, renvoient à la question des ressources. Je suis passionné par les notions de ressource non renouvelables et d'inéluctabilité de la consommation des ressources. Lorsqu'il est en fin de vie, le recyclage est en effet beaucoup plus complexe et donc impraticable malgré ce que l'on nous dit. Or l'un des paramètres de cette question du recyclage est l'inflation technologique : les objets qui nous entourent contiennent de plus en plus de choses bizarres. Des circuits intégrés miniaturisés, des écrans, des afficheurs… Cette course extractiviste nous éloigne d'une possible logique de circularité. L'idée est donc de ne pas produire des objets se caractérisant par leur haute technologie, mais plutôt par leur basse technologie.
Cela renvoie à un monde de sobriété, d'économie de ressources et de durabilité. À l'heure où la question des ressources vient heurter celle des limites planétaires, et alors que l'on assiste à une raréfaction des ressources, il faudrait faire de la sobriété tout court, en renonçant à des choses dont nous n'avons pas besoin. Ensuite, nous pourrions faire de la sobriété de dimensionnement, d'usage, de fonctionnement, par exemple en partageant des voitures, des bâtiments, des objets…

Par ailleurs, nous pourrions aller vers un monde avec beaucoup plus de réparation, de maintenance et d'entretien des objets. Cela demanderait évidemment des évolutions réglementaires et fiscales. Mais, au fond, si nous avons tendance à acheter du neuf, c'est tout simplement parce que c'est moins cher. Nous pourrions donc bricoler un peu plus — de quoi sauver un peu la planète mais aussi nous rendre plus résilients et souverains par rapport à des chaînes de valeur mondiales très complexes, dont nous ne savons pas si elles survivront à des chocs géopolitiques.
Et puis, cela permettrait la mise en œuvre d'activités sociales intéressantes, de choses à faire ensemble, de savoirs à se transmettre. Auparavant, il y avait la fierté ouvrière et artisanale. Dans le futur, nous pourrions très bien développer une fierté autour de notre capacité à savoir maintenir des objets.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un programme ne peut se contenter de présenter une vision politique et une philosophie gouvernementale

Le mandat de la révision du programme est interprété par le texte Programme actualisé - ÉBAUCHE version 1 [1] - comme visant à faire du programme de QS une « vision politique guidant une philosophie gouvernementale générale de transformations sociales et politiques ». La révision « doit mettre de côté des engagements politiques trop spécifiques et présenter les grandes orientations politiques du parti, en dehors des réflexions conjoncturelles. » Cela signifie que cette version du programme élimine les analyses précises de la situation dans laquelle Québec solidaire doit œuvrer et des revendications précises que devrait défendre Québec solidaire comme parti ou comme gouvernement.
Cette conception du programme implique que le programme ne porte pas d'orientations et des revendications précises en ce qui concerne l'élaboration des plates-formes électorales et ne fournit aucune précision sur les actions proposées comme parti de la rue sur les enjeux précis en dehors des périodes électorales. Alors que la situation économique, politique et écologique évolue à vitesse grand V et nous place devant de nouveaux enjeux, on ne peut se contenter d'en rester à des considérations idéologiques générales et à un travail de réécriture formelle et se contenter « d'éliminer les éléments caducs et trop spécifiques. »
Le programme de Québec solidaire doit tracer :
• une analyse des problématiques qui traversent la société dans laquelle nous vivons, que ce soit aux niveaux local, national ou international ;
• les orientations et les propositions que nous faisons à la population, qui permettraient de résoudre ces problématiques dans une perspective de transformations sociales visant égalité et émancipation ;
• et des stratégies permettant de parvenir à réaliser notre projet de société. Cela signifie qu'il identifie les forces sociales pouvant se saisir de ces propositions ainsi que les initiatives qu'elles peuvent prendre pour résister immédiatement, afin de concrétiser des perspectives en termes de débouché politique.
Nous appliquerons cette conception du programme à la critique du premier chapitre de l‘ébauche d'actualisation du programme intitulé : créer une économie verte et solidaire.
CHAPITRE 1 : CRÉER UNE ÉCONOMIE VERTE ET SOLIDAIRE )
Introduction
L'introduction souligne que « pour Québec solidaire, un système économique est au coeur de cette crise (environnementale) : le capitalisme », que « Québec solidaire entend, à terme, dépasser le capitalisme », qu'il vise à « donner au peuple du Québec les moyens concrets d'exercer sa souveraineté sur son économie et son avenir, sur un territoire sain », et qu'il va promouvoir « une économie axée sur un principe du commun pour assurer une création de richesse au service de la collectivité » et qu'il prendra « des mesures déterminantes pour réorienter le modèle de développement québécois vers plus d'écoresponsabilité et de démocratie. »
Si on peut se questionner sur ce que signifie l'expression du dépassement à terme du capitalisme. Parler d'un modèle de développement faisant plus de place à l'écoresponsabilité, c'est flou à souhait. On a ici une bonne illustration de ce que l'on entend par la réduction du programme à une vision politique. En fait, dans cette approche, l'analyse de la situation économique et politique est escamotée, les classes sociales, leurs intérêts divergents et les rapports de force entre ces dernières sont invisibilisés. On verra que cela demeure une constante dans l'ensemble du texte de l'ébauche.
Les objectifs d'une économie solidaire
La seule priorité affirmée en ce qui a trait à la lutte aux changements climatiques est celle de réaliser, « d'ici 2050, une économie décarbonisée, c'est-à-dire de réduire de 95% les émissions de gaz à effet de serre (GES) en dessous du niveau de 1990. »
Cette seule priorité clairement définie ne se distingue en aucune façon de celle avancée par les autres partis politiques au Canada et au Québec. Aucune cible pour 2030 ; aucune reprise des propositions du GIEC et des groupes écologistes en termes de cible. On se contente de généralités sur l'accélération de la transition socioécologique sans en définir le contenu.
En ce qui concerne la biodiversité, le texte affirme que « nous devons en arriver à une société où la cohabitation harmonieuse entre territoires protégés et territoires développés deviendra la règle et non l'exception. » Mais aucun des fondements de la perte de la biodiversité ne sont identifiés soit la prédation des ressources naturelles (mines et forêts), l'artificialisation générale des sols, l'agriculture industrielle centrée sur des monocultures et sur la production carnée. Sans constats essentiels on en reste à des généralités.
« Considérant ce qui précède, Québec solidaire vise, à long terme, la socialisation des activités économiques. Il est normal que l'économie devienne l'affaire du peuple et non d'une minorité. »
Un programme ne doit-il pas d'expliquer pourquoi il n'en est pas ainsi et comment parvenir à faire de l'économie l'affaire du peuple et d'indiquer les obstacles qui devront être renversés pour ce faire. On indique bien la création par le gouvernement d'entreprises collectives, mais est-ce pour entrer en concurrence avec les entreprises occupant déjà le terrain. Où vont être pris les fonds qui vont permettre la création de telles entreprises ?
Comment atteindre nos objectifs
« Québec solidaire propose de sortir du modèle économique dual (privé-public) pour adopter un modèle quadripartite : 1. une économie sociale… 2. une économie domestique … 3. une économie publique étatique et paraétatique… 4. une économie privée … Considérant ce qui précède, Québec solidaire vise, à long terme, la socialisation des activités économiques. » « Considérant ce qui précède, Québec solidaire vise, à long terme, la socialisation des produits et des services. » L'économie privée est définie comme « composée d'entreprises dont le but est de produire et de vendre des produits et des services. » Cette définition fait disparaître la notion de profit et le capital financier et foncier.
Cette conception du modèle économique quadripartite n'explique pas qu'il y a une économie dominante, l'économie capitaliste et que celle-ci informe les autres secteurs de l'économie. L'économie domestique est articulée à l'économie capitaliste et fournit un soutien à la reproduction de la force de travail capitaliste. L'économie domestique est un des lieux de l'exploitation des femmes au service de l'économie capitaliste : utilisation du travail gratuit des femmes dans la production, la formation et l'entretien de la force de travail pour l'économie capitaliste. Faut-il entretenir ou favoriser le dépérissement de l'économie domestique ? La socialisation des tâches domestiques peut se concrétiser par la généralisation de garderies publiques, cafétérias publiques, ateliers de réparation de vêtements … ne devrait-elle pas être développée ? Soeit-on favoriser le salaire au travail ménager ou la socialisation des tâches domestiques ?
L'économie sociale est le plus souvent prise dans les obligations du marché. L'économie publique est constamment soumise aux pressions à la privatisation, comme le révèle clairement la privatisation du système de santé. La socialisation ne peut se réduire à l'économie sociale ou aux coopératives, qui ne sont pas en rupture avec l'économie capitaliste. On voit comment les Caisses Desjardins ont été remodelées selon les normes du grand capital financier.
L'économie privée capitaliste est dominée par les grandes entreprises (souvent multinationales) et les grandes banques qui contrôlent nombre de PME. Que signifie la socialisation des produits et des services, si les grandes entreprises continuent à déterminer les choix de production et de consommation en s'appuyant sur la propriété des entreprises et de banques.
« Il est normal qu'elle devienne l'affaire du peuple et non d'une minorité. Il faut que la logique de l'accumulation illimitée du profit cesse de guider notre économie, c'est impératif pour réussir la nécessaire transition écologique. » Comment y parvenir ? Quels sont les obstacles ? Quels intérêts contradictoires sont-ils en jeu ?
La socialisation (expropriation des grandes entreprises et contrôle des travailleurs et des travailleuses et des citoyen-nes) des principaux moyens de production et d'échange, la socialisation des banques sont inévitables si nous voulons casser la domination de la minorité capitaliste dominante. Éviter de poser cette nécessité, c'est croire que nous pouvons changer la dynamique d'évolution de l'économie sans remettre en cause les pouvoirs les plus structurants sur cette économie.
Approche différente de la socialisation, la nationalisation de certaines industries stratégiques (leur mise sous contrôle gouvernemental) sera nécessaire pour assurer la transition socioécologique. Québec solidaire établira trois critères qui mènent à la nationalisation :
1. Le caractère stratégique d'une ressource ou d'un secteur pour la transition socioécologique
2. Une grande quantité de capital est nécessaire pour l'achat d'entreprises existantes soit pour des investissements
3. La démonstration de l'échec du secteur privé à gérer cette ressource ou ce secteur.
Ce paragraphe sur la nationalisation est plus clair que ce qui avait dans le programme qui demeurait toujours au conditionnel. Ne faudrait pas définir les ressources et les entreprises stratégiques au lieu de s'en tenir à un critère abstrait. Faut-il exclure l'expropriation sans compensation d'entreprises qui se sont payées depuis longtemps par leur prédation sur les richesses naturelles du Québec ? Les nationalisations doivent-elles être inspirées par une logique technocratique comme cela a été le cas pour Hydro-Québec ou les nationalisations ne doivent-elles pas jeter les bases d'une socialisation -démocratisation de ces secteurs de l'économie. La disponibilité d'une grande quantité de capital nécessaire à la reconstruction de l'économie et au financement de la transition énergétique passera par la socialisation des banques… et la création d'une banque centrale dans un Québec indépendant.
Occupation et aménagement du territoire
Les propriétaires immobiliers doivent être expropriés et les grandes entreprises de construction doivent être placées sous le contrôle public pour pouvoir faire de la construction de logements sociaux une priorité. Les grandes entreprises de construction sont guidées par la logique du marché, par la recherche de ventes les plus lucratives. Et comment la richesse se concentre de plus en plus dans les sommets de la société, elles produisent des condos de luxe pour une clientèle fortunée et ne se lancent pas dans la construction de logements à faible coût.
L'eau et l'énergie
L'eau
Le texte reprend à son compte le principe de l'eau comme bien commun, mais des enjeux essentiels sont passés sous silence : les dégâts causés par Hydro-Québec par les barrages hydro-électriques, l'utilisation industrielle massive de l'eau par les minières et les projets énergivores (aluminium, batteries et hydrogène dit vert) ; et l'exportation d'eau en vrac et sa mise en marché par des embouteilleurs. Ces situations doivent être dénoncées, pour clarifier les cibles des luttes qui seront à mener. L'ébauche parle de redevances. Pourquoi ? Cela veut-il dire qu'on n'exclut pas une certaine privatisation de cette ressource.
L'énergie
« La souveraineté énergétique du Québec doit être prise en charge par le secteur public et la transition vers un autre système énergétique doit comprendre en priorité les économies d'énergie et les énergies renouvelables. La stratégie de l'État québécois doit être établie démocratiquement par toute la collectivité, dans laquelle les personnes salariées des secteurs impliqués ont leur mot à dire en collaboration avec les citoyennes et citoyens des différentes communautés concernées. »
Mais le texte ne propose aucune transformation du modèle énergétique : offre infinie, centralisation, exportation massive ni aucun plan de réduction de la production et de la consommation d'énergie au Québec et la réorientation d'Hydro-Québec vers la sobriété énergétique. Il faudrait orienter toute l,économie, notamme l'énergie, vers la décroissance démocratiquement planifiée en accord un rôle central aux travailleuses et travailleurs et aux collectivités territoriales.
Si la production de l'hydro-électricité est importante et est essentielle pour l'éclairage et le chauffage. Une grande partie de l'énergie utilisée au Québec provient de l'importation des énergies fossiles ? Pourquoi, parce que le système de transport est basé sur des autos et camions qui fonctionnent aux énergies fossiles et que le transport public est sous-développé.
Au lieu de faire ce lien, on reporte la question des transports à une partie intitulée nos activités économiques : nous déplacer, produire, consommer et jeter. On nous propose de « préparer un vaste plan de transport à l'échelle du Québec. Québec solidaire entend diminuer la prédominance de l'auto privée comme principal moyen de transport » et de préparer « un vaste plan de transport du Québec , incluant le développement du transport des personnes et des marchandises. »
Mais on ne nous dit rien sur ce plan. On n'identifie pas les intérêts en jeu. On n'explique pas que les grands de l'auto veulent continuer à développer l'ampleur du parc automobile. On n'inscrit pas ce plan dans une logique d'économie d'énergie et de métaux.
Comme le rappelait le Réseau Militant Écologiste dans nombre de ces publications, une politique énergétique alternative (proposition du RMÉ) passera par
• La nationalisation des énergies propres et renouvelables et le renforcement du rôle des entreprises publiques dans ce domaine, notamment celui d'Hydro-Québec.
• Le refus de la privatisation d'Hydro-Québec – et l'abrogation de toutes les lois privatisant l'énergie au Québec.
• Le rejet de la filière batteries et de l'auto électrique comme solution à la crise climatique et la production locale de moyens de transports publics (tranis, autobus, tramways) pour les personnes, et la nationalisation des chemins de fer existants pour le transport des marchandises.
• L'implantation des initiatives prioritaires de sobriété et de décroissance énergétiques, notamment la réduction du parc automobile, l'accessibilité au transport en commun public, gratuit et adapté aux réalités régionales, dla rénovation massive et écologique des logements, la durabilité et la réparabilité des biens.
• Le soutien à la recherche et l'innovation publiques dans le domaine de l'énergie propre et renouvelable.
• La mise en place d'une planification écologique et démocratique qui réponde de manière résiliente aux besoins énergétiques de la population aux échelles locale, régionale et nationale, et qui donne un rôle primordial et décisionnel aux travailleuses et travailleurs concerné·es.
• La mise en place des mécanismes démocratiques et décentralisés pour une participation citoyenne directe dans la gestion des ressources énergétiques.
• Le soutien des municipalités dans le développement et la gestion des microréseaux intelligents énergétiques adaptés à leurs besoins.
• Le refus de la relance de la filière nucléaire, y compris l'exploitation de l'uranium.
L'agriculture et l'alimentation
L'agriculture est traitée de la même façon, on nous présente une série de principes les plus intéressants les uns que les autres. :
« •La souveraineté alimentaire du peuple québécois. •La sécurité alimentaire de la population québécoise. •Une agriculture écoresponsable. •Une surveillance étroite de la salubrité des aliments et l'identification de leur provenance et de leur composition. •La valorisation du métier d'agriculteur, agricultrice. •La sécurité du revenu et la qualité de vie des agriculteurs et agricultrices. •Le soutien à la relève agricole, particulièrement des agricultrices. •Le bien-être animal. •La protection et l'occupation dynamique du territoire agricole. Une mise en valeur des paysages et de la biodiversité des territoires. •La protection du secteur agroalimentaire dans les accords de libre-échange. • La préoccupation de contribuer à nourrir la planète dans le respect d'un commerce juste et équitable. »
Là encore, on se contente d'élaborer de grands et beaux principes. On ne propose pas d'affronter directement le pouvoir des grandes entreprises de l'agro-industrie ni celui des grandes chaînes de distribution. On se contente de « soutenir » un autre modèle. Mais il ne pourra s'imposer tant que l'agriculture sera soumise aux lois du capital.
Pourtant, l'agro-industrie productrice des matériels agricoles et des semences et la grande distribution déterminent les conditions de la production agricole, les prix payés aux producteur·trices, les conditions de travail dans la chaîne de production et de transformation. Elles dictent aussi les politiques de transport, de transformation, de conservation et de mise en marché. Il est donc essentiel de remettre en cause ce pouvoir ; sans parler de l'endettement des producteurs agricoles par le capital financier.
Mais surtout, on ne dit rien sur la façon d'appliquer les grands principes mentionnés. On ne précise pas quels sont les obstacles et les groupes d'intérêts devront être confrontés pour appliquer ces principes. Peut-on par exemple parler de bien-être animal, sans préciser comment dépasser les grands élevages industriels et la production carnée centrée sur l'exportation. Peut-on parler de défense de la biodiversité, sans indiquer comment les monocultures et l'élevage industriel, l'utilisation de polluants chimiques, l'exploitation des forêts constituent des attaques à la biodiversité. Peut-on assurer la souveraineté alimentaire sans définir un programme de définanciarisation du secteur agricole pour mettre fin à l'endettement des producteurs agricoles. Et ainsi de suite…
Les mines et la forêt
« Afin de concrétiser la responsabilité publique et collective des ressources naturelles québécoises, Québec solidaire préconise de placer l'industrie minière sous une étroite surveillance publique, en nationalisant, au besoin, des minéraux stratégiques. De plus, afin de réaffirmer la souveraineté de l'État et de la collectivité sur le territoire québécois, un gouvernement solidaire élaborera une nouvelle loi sur les mines à la suite d'une consultation populaire. Un gouvernement solidaire transformera le secteur forestier en commençant par surveiller et évaluer en continu les entreprises publiques, privées ou coopératives qui interviennent en forêt à partir de critères et d'objectifs socioécologiques, avec retrait de contrat en cas d'échec. »
Pour l'industrie forestière, le programme propose également de placer, au besoin, cette industrie sous contrôle public, mais on refuse d'affirmer que ce contrôle public ne peut reposer que sur la nationalisation/socialisation des grandes entreprises de cette industrie. Le contrôle public n'est pas défini dans cette ébauche d'actualisation du programme.
Il faut analyser et décrire les ravages du modèle forestier actuel et préciser la nécessité de réduction des volumes de coupes, la récupération des droits de coupes par les communautés locales et soutenir la gestion de proximité par les communautés locales et les nations autochtones.
L'ébauche d'actualisation du programme souligne la nécessité de nationalisation, du moins partielle et avance des propositions qui décrivent ce que serait une gestion écosystémique de la forêt. Ce n'est pas sans intérêt, mais le but d'un programme est d'indiquer les voies de la construction du pouvoir populaire permettant d'imposer cette démocratie économique et l'usage des ressources naturelles pour satisfaire les besoins de la majorité de la population. Sinon, on en reste aux grands principes, on ignore les combats réels qui sont à mener.
Une orientation générale en matière d'utilisation sobre des ressources naturelles nécessitera une rupture avec l'économie capitaliste afin de remettre à la majorité populaire la possibilité de faire les choix économiques et écologiques nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels et à la protection de la nature.
Encadrer le libre-échange et la finance
« Suivant la même logique, Québec solidaire mettra de l'avant certains principes devant guider à une refondation de cadre international en matière de finance : limitation des activités spéculatives ; abolition du secret bancaire ; interdiction des transactions avec les paradis fiscaux ; et meilleure taxation des institutions financières. »
Il ne s'agit pas seulement d'encadrer le libre-échange, il faut définir les secteurs stratégiques de l'économie qui ont été délocalisés et qui doivent être relocalisés.
La socialisation des banques est nécessaire pour disposer du capital-argent et être capable de financer les investissements nécessaires à la réorientation de l'économie dans le sens de la post-croissance et de la production de biens au service de la majorité populaire.
L'ébauche ne développe pas assez les leviers fiscaux. Pourtant, sans réforme radicale de la fiscalité, la transition écologique et sociale restera impraticable. Il faut donc : taxer massivement la richesse, les profits et les héritages ; fermer les échappatoires fiscales et lutter contre l'évitement fiscal des grandes entreprises, repenser le rôle de la Caisse de dépôt et les autres sociétés para-étatiques similaires, pour en faire un outil de transformation économique et non un fonds spéculatif.
Humaniser le travail
Le programme de Québec solidaire de 2019 divisait cette section en six parties : 1. politique de plein emploi, 2. reconnaissance du travail non rémunéré, 3. réduction du temps de travail, 4. protection des emplois, 5. santé et sécurité au travail et 6. droits syndicaux, 7. La discrimination du travail, 8. le salaire minimum.
Si le texte de l'ébauche suit, dans l'ensemble, la même structure, les revendications retenues sont moins précises. Cela est vrai tant de la réduction du temps de travail, des mesures concernant les droits syndicaux que la discrimination ou le salaire minimum. Au lieu de fixer une cible à la réduction du temps de travail réduction de la semaine de travail à 35 heures, puis à 32 heures sans baisse des salaires comme cela était faite dans le programme initial, on écrit « un gouvernement solidaire réduira le temps de travail et accordera une plus grande flexibilité aux travailleurs et travailleuses dans leurs horaires de travail, notamment afin de faciliter la conciliation famille-travail. » Des revendications précises permettent d'utiliser le programme non seulement comme un guide pour de futures politiques gouvernementales, mais également pour un guide pour l'action et dans les luttes extraparlementaires avec nos allié-es des mouvements sociaux, notamment les syndicats.
Conclusion
En conclusion, l'ébauche d'actualisation du programme fait un rappel essentiel, mais tardif : « une élite, une minorité a tout avantage à conserver le système tel qu'il est. Elle est composée des personnes qui profitent financièrement de la destruction de l'environnement, qui exploitent les travailleuses et les travailleurs et qui près du pouvoir, qui veulent conserver leurs privilèges et ceux de leurs amis. Ces élites feront tout en leur pouvoir pour ralentir la transition, tout en prétendant être très préoccupées par les changements climatiques, bien sûr » et d'ajouter : « Pour affronter ces forces réactionnaires, le Québec doit compter sur une longue tradition profondément ancrée de pratiques démocratiques, écologiques, autogestionnaires, coopératives et communautaires ».
C'est sûr, mais n'est-ce pas l'objectif de ce programme de préciser ces pratiques, de proposer des stratégies et les alliances qu'il faut nouer pour parvenir à nos objectifs de transformations sociales. C'est pourquoi un programme ne peut être réduit à présenter une vision politique et une philosophie gouvernementale générale, et il doit être également un guide pour la lutte, y compris sur le terrain extraparlementaire.
L'ébauche de révision du programme de Québec solidaire affirme vouloir sortir du capitalisme « à terme », mais il n'explicite pas ce qu'il oppose comme alternative systémique. L'idée d'une économie « au service du bien commun » reste floue si elle n'est pas accompagnée d'un projet clairement anticapitaliste, écosocialiste, démocratique et planifié.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le « vote stratégique » aux dernières élections et ses conséquences antidémocratiques

Le système électoral canadien, vestige de l'ère pré-démocratique, perdure parce que certains y trouvent leur compte. Les élections fédérales de 2025 ont suscité beaucoup de gros titres concernant les enseignements pouvant être tirés du scrutin, notamment la perte de ce qui semblait être une victoire assurée des conservateurs, la résurrection spectaculaire du Parti libéral sous la direction de son nouveau chef Mark Carney et l'effondrement du soutien électoral aux tiers partis du pays : les Verts, le Bloc Québécois et surtout le NPD.
The ‘strategic voting' election and its undemocratic consequences
2 mai 2025
Dennis Pilon
Tiré de Canadian Dimension
Traduction Johan Wallengren
L'impact des menaces de Trump d'annexer le Canada et d'imposer des droits de douane très pénalisants sur les produits canadiens a clairement été signalé par la plupart des commentateurs comme étant à l'origine de ces résultats. Mais on s'est beaucoup moins intéressé à la manière dont les institutions électorales canadiennes ont rendu la réponse à ces menaces beaucoup plus compliquée et moins démocratique qu'elle ne devrait l'être. Si l'on regarde au-delà des manchettes, on voit que le principal défi auquel les électeurs et électrices ont été confrontés lors de cette élection tournait réellement autour du vote stratégique. Le système majoritaire uninominal (SMU) à un tour du Canada amplifie la pression exercée sur les électeurs et électrices pour qu'ils/elles votent de manière stratégique tout en les privant des informations nécessaires pour le faire efficacement. Et là où le bât blesse, c'est qu'il n'y aurait pas du tout besoin de voter stratégiquement si notre mode de scrutin était plus représentatif, plus inclusif et, en fin de compte, plus démocratique – en d'autres termes, une forme ou une autre de représentation proportionnelle (RP).
Permettez-moi de revenir en arrière pour expliquer un peu plus en détail ce qu'est le vote stratégique et pourquoi il domine les élections dans notre système électoral. Le principe même d'un système censément démocratique est que les électeurs et électrices votent directement pour le camp qu'ils/elles veulent voir triompher. C'est ce que les théoriciens de la chose appellent un vote « sincère ». Or, le mode de scrutin en vigueur peut avoir une influence sur la décision des citoyens et citoyennes de voter sincèrement ou non. Le SMU fonctionne de telle manière que le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre de voix remporte tous les suffrages. S'il n'y a que deux candidat(e)s en lice, il est fort probable que l'une ou l'autre de ces personnes obtienne la majorité. Mais dans le cadre du système multipartite du Canada, de nombreux sièges sont remportés avec une majorité relative (un candidat(e) obtient plus de voix que les autres, mais pas au point de faire pencher la balance générale en sa faveur). Les électeurs et électrices doivent alors se demander non seulement si un vote sincère leur permettrait d'obtenir le résultat souhaité, mais aussi s'ils/elles ne risquent pas d'élire par inadvertance une personne qu'ils/elles ne soutiennent pas vraiment. C'est là que la notion de stratégie entre en jeu. Prenons un exemple concret. Dans la circonscription de Nanaimo-Cowichan, la députée NPD sortante a été battue par une candidate conservatrice qui n'a obtenu que 35 % des voix, tandis que les candidats libéraux, verts et NPD ont respectivement récolté 28, 18 et 18 % des voix. Avant de voter, quelqu'un d'opposé aux conservateurs devait se demander quel candidat des autres partis avait de bonnes chances de l'emporter. Étant donné que la circonscription avait porté au pouvoir des candidats des partis néo-démocrate et vert par le passé, il était logique que quelqu'un d'autre qu'un conservateur l'emporte. Mais choisir le candidat non conservateur ayant le meilleur potentiel n'était pas évident, comme l'ont clairement montré les résultats.
Le problème du vote stratégique est que, de par la conception de notre SMU, les électeurs et électrices ne disposent pas des informations nécessaires pour faire des choix stratégiques. Pour savoir quel parti est le mieux à même de battre les conservateurs dans la circonscription de Nanaimo-Cowichan, les électeurs et électrices auraient besoin d'informations sur les intentions de vote des autres électeurs et électrices au niveau de la circonscription, ce qui aurait un coût prohibitif. Sans ces informations, les électeurs et électrices doivent se fier à leur intuition pour savoir qui est le candidat le mieux placé pour emporter la mise, ce qui revient généralement à se fier aux affiches visibles de la campagne locale, aux sondages au niveau national et à tous les indices qu'ils/elles peuvent recevoir du parti qu'ils/elles souhaitent voir gagner. Quelques jours avant les élections, les réseaux sociaux abondaient de commentaires selon lesquels les organisateurs et organisatrices du NPD tentaient désespérément de faire comprendre aux électeurs et électrices des circonscriptions où siégeaient des député(e)s néo-démocrates sortants que le NPD était dans les faits le choix stratégique pour battre les candidats conservateurs et candidates conservatrices dans ces circonscriptions, et non les libéraux. Mais de nombreux électeurs et électrices qui ont utilisé les sondages nationaux largement diffusés comme guide ont plutôt choisi les libéraux, contribuant ainsi aux pertes du NPD et aux gains des conservateurs.
Ce qui est particulièrement frustrant à propos de cet impact manifestement négatif du vote stratégique est qu'en modifiant simplement nos institutions électorales de manière qu'elles offrent aux électeurs et électrices des moyens plus directs d'enregistrer leurs préférences de vote, il n'y aurait plus lieu de voter stratégique. N'importe quel mode de scrutin à représentation proportionnelle ferait l'affaire. Il y a trois raisons essentielles à cela. La première est que dans le cadre de la RP, les électeurs et électrices savent que leur vote compte pour l'élection d'une personne déterminée. Dans le cas du SMU, il en va tout autrement, puisque d'ordinaire la moitié des voix sont « perdues » et ne contribuent à l'élection de personne, alors qu'un système de RP permet généralement de convertir de 90 à 95 % des voix en sièges. La deuxième raison est que les électeurs et électrices n'auront pas à craindre qu'en votant pour qui ils/elles veulent, ils/elles risquent de favoriser l'élection d'une personne à laquelle ils/elles sont fortement opposé(e)s, sachant que la RP ne donne pas toutes les voix au candidat ou à la candidate qui arrive en tête, ce qui élimine le risque de fractionnement des voix entre des partis ayant des idées en commun. La troisième raison est que la proportionnelle mettrait fin aux gouvernements dits « majoritaires » sans l'être vraiment, le parti gagnant ayant remporté une majorité des sièges sans avoir obtenu la majorité du vote populaire. Presque tous les gouvernements majoritaires au Canada ne l'ont pas été au sens littéral. Depuis 1921, nous avons organisé 31 élections fédérales, mais seulement deux d'entre elles (1940 et 1958) ont vu un parti remporter une nette majorité du vote populaire (51 % ou plus). De toute évidence, lors de l'élection qui vient de se dérouler, de nombreux électeurs et électrices ont voté stratégiquement non pas parce qu'ils/elles ont soudainement trouvé les libéraux plus attrayants, mais parce qu'ils/elles craignaient que les conservateurs soient en mesure de remporter une majorité avec beaucoup moins de 50 % du vote populaire (comme ils l'ont fait en 2011 avec seulement 39 % des voix). L'adoption de la RP éliminerait ces préoccupations stratégiques.
Des appels ont été lancés en faveur de réformes mesurées du système électoral canadien. Par exemple, Justin Trudeau s'est présenté en 2015 en promettant de « faire en sorte que chaque vote compte ». Sa solution de substitution au SMU consistait en un scrutin majoritaire à un tour, soit une formule qui a cours en Australie, où elle est qualifiée de vote alternatif. Il est facile de voir comment l'utilisation du scrutin de liste aurait pu offrir aux électeurs et électrices non conservateurs de Nanaimo-Cowichan quelques options pour éviter de diviser le vote, mais dans l'ensemble ce mode de scrutin tend également à surreprésenter les partis les plus importants, à laisser de nombreux électeurs et électrices sans représentation et à créer des gouvernements majoritaires n'ayant obtenu qu'une part minoritaire des votes. Autrement dit, une grande partie des aspects négatifs associés au vote stratégique ne peuvent être évités avec cet autre mode de scrutin.
Vu que l'adoption de la RP faciliterait l'acte de voter et supprimerait les dilemmes du vote stratégique, pourquoi n'y procédons-nous pas ? La réponse courte est qu'il y a des partis qui privilégient leurs intérêts propres. Fondamentalement, les deux principaux partis traditionnels au pouvoir au niveau fédéral ne veulent pas de la RP pour les raisons exposées ci-dessus. De fait, un scrutin proportionnel permettrait aux gens de mieux s'exprimer au moyen de leur vote et cela mettrait fin à l'habitude de porter au pouvoir un parti ne bénéficiant que d'une majorité relative, c'est-à-dire soutenu par une minorité de votants. Dans le cadre d'un système de RP, les partis devraient probablement partager le pouvoir, ce qui imposerait une plus grande transparence des décisions gouvernementales et rendrait plus difficiles les accords financiers en coulisses sur lesquels les deux grands partis ont coutume de s'appuyer. Un tel système permettrait également aux électeurs et aux électrices de rendre les partis pour lesquels ils/elles votent plus responsables, du fait d'avoir l'option de voter pour un autre parti cadrant avec leurs préférences. Certains politiciens et politologues malavisés tentent de faire valoir que nous n'avons pas adopté un système de RP parce que ce mode de scrutin ne correspond pas aux valeurs canadiennes ou serait source de confusion et conduirait à un gouvernement instable. Mais ces commentateurs n'apportent aucune preuve crédible à l'appui de ces affirmations. En réalité, il ne s'agit généralement que de justifications post hoc d'un statu quo qui sert des intérêts politiques plutôt que le bien public.
Les élections fédérales de 2025 illustrent les défaillances de nos institutions électorales et le déficit démocratique qui en découle. Or, il est important de rappeler que les élections de ce type n'ont jamais été conçues ni maintenues avec des objectifs démocratiques à l'esprit. Le système électoral canadien est un vestige de l'ère pré-démocratique qui perdure parce que certains y trouvent leur compte. Depuis l'époque de la Confédération, il y a eu dix réformes du mode de scrutin au niveau provincial au Canada, ce qui prouve que nos élites politiques ne sont que trop heureuses de changer les règles (et de les rétablir au besoin) lorsqu'elles se sentent menacées et/ou que cela peut servir leurs intérêts. Changer le système électoral au niveau fédéral n'est donc pas simplement un impératif sur le plan technique, mais également un moyen d'injecter plus de substance démocratique dans notre système politique. Pour y parvenir, un mouvement de réforme démocratique devra prendre corps. Il n'est pas surprenant que lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes, nos partis dominants préfèrent que les électeurs et électrices canadiens restent enfermé(e)s dans une camisole de force d'options de vote stratégiques limitées à bonnet blanc conservateur et blanc bonnet libéral.
Dennis Pilon est un ancien membre du collectif éditorial de Canadian Dimension. Il est actuellement professeur et directeur du département de politique de l'Université York. Un panorama de ses écrits sur la démocratie canadienne et la réforme du système électoral (en anglais) est offert ici.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :













