Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

États-Unis : Trump au pied des monarchies du Golfe

Le président Donald Trump s'est rendu dans la semaine du 12 mai dans trois monarchies du golfe Persique, où il a été adulé, a fait l'éloge des régimes féodaux, a conclu des accords et a accepté des pots-de-vin, tout en opérant un changement important dans la politique américaine au Moyen-Orient. Au milieu de magnifiques palais et mosquées, entourés de chevaux arabes et sous l'effet des danses à l'épée, M. Trump et les monarques se sont mutuellement fait des éloges.
Tiré de Inprecor
21 mai 2025
Par Dan La Botz
La responsabilité du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane (MBS) dans le meurtre horrible du journaliste Jamal Khashoggi, lors d'une visite au consulat saoudien à Istanbul, comme l'avait précédemment signalé la CIA, n'a jamais été mentionnée. Les gouvernements autoritaires et les violations des droits humains de l'Arabie saoudite, du Qatar ou des Émirats arabes unis n'ont pas non plus été mentionnés. Au contraire, Trump a fait l'éloge de MBS pour avoir fait entrer l'Arabie saoudite dans l'ère moderne. Il a rejeté les critiques précédentes du gouvernement américain à l'encontre des monarchies en déclarant : « C'est à Dieu de juger, mon travail consiste à défendre l'Amérique et à promouvoir les intérêts fondamentaux de la civilité, de la prospérité et de la paix ».
Le voyage de Trump était axé sur les accords conclus avec les entreprises américaines. Il a affirmé avoir conclu des contrats d'une valeur de 2 000 milliards de dollars, notamment pour la vente d'avions Boeing et de moteurs General Electrics. Il a signé un accord visant à faire des Émirats arabes unis la plus grande installation d'IA en dehors des États-Unis. Il a également affirmé que les monarchies du Golfe allaient investir des milliers de milliards de dollars en Amérique. Une alliance entre puissances pétrolières semble scellée. L'émir du Qatar a adopté le slogan de Trump, « Drill baby, drill ». Les monarchies accueillent depuis des décennies des bases militaires américaines, et des milliers de soldats américains font des États-Unis la puissance militaire dominante de la région.
Affaires de la famille Trump
La corruption de Trump et sa propension à accepter des pots-de-vin ont été mises en évidence. Le Qatar a offert à Trump un avion de luxe Boeing 747-8 d'une valeur de 400 millions de dollars, destiné à remplacer l'actuel Air Force One. Ou peut-être s'agissait-il d'un cadeau au département de la défense des États-Unis ? Quoi qu'il en soit, Trump a déclaré qu'il accepterait l'avion et qu'il le placerait dans sa bibliothèque présidentielle à la fin de son mandat. Ses détracteurs estiment qu'il s'agit d'un pot-de-vin qui viole la clause d'émoluments de la Constitution, laquelle interdit au président d'accepter des cadeaux de la part de gouvernements étrangers. Les Émirats arabes unis ont conclu un accord sur les cryptomonnaies d'une valeur de 2 milliards de dollars avec World Liberty Financial, qui appartient… aux fils de Trump, Donald Jr. et Eric.
Bien que le sujet ait été évité, la visite de Trump a également renforcé les nombreux autres investissements de sa famille dans la région : une tour résidentielle à Riyad, une Trump Tower de 47 étages à Jeddah. Trump International Hotel and Tower à Dubaï, Trump International Golf Course à Doha et Trump International Hotel & Golf Club à Oman.
Politique étrangère
Le voyage ne s'est toutefois pas résumé à des pots-de-vin et à des transactions commerciales. Le président des États-Unis a profité de l'occasion pour opérer un sérieux changement dans la politique étrangère du pays. Tout d'abord, il convient de noter qu'il ne s'est pas rendu en Israël et n'a pas rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou, pas plus qu'il n'a adapté ses décisions pour lui plaire. Trump a annoncé qu'il levait les sanctions contre la Syrie et a rencontré le président intérimaire de la Syrie, Ahmed al-Charaa, qui était autrefois affilié à Al-Qaïda et dont la tête était mise à prix pour 10 millions de dollars jusqu'en décembre dernier. Netanyahou, cependant, craint que la Syrie ne devienne un agresseur et l'a attaquée plus de 600 fois depuis qu'Assad a été évincé en décembre 2024.
Trump a également annoncé que les États-Unis et l'Iran s'étaient « en quelque sorte » mis d'accord sur un accord nucléaire, ce qui pourrait conduire à une normalisation des relations. Ici aussi, Netanyahou ne sera pas satisfait de cette évolution, car il souhaite que les États-Unis se joignent à Israël pour bombarder l'Iran.
Et tandis qu'Israël poursuivait ses bombardements sur Gaza et avançait dans ses projets de nouvelle invasion et d'occupation, Trump a mentionné en passant à ses hôtes et aux médias la famine qui sévit à Gaza et qu'Israël nie.
Trump est versatile, il est donc difficile de savoir ce qui se passera en fin de compte. Pour l'instant, il semble que le président américain place sa confiance dans les monarchies du Golfe, et non en Israël.
Dan La Botz, traduit par la rédaction de l'Anticapitaliste et publié le 22 mai 2025
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
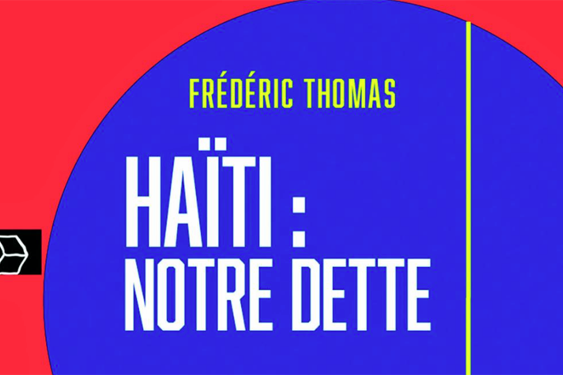
Haïti, notre dette : Une étincelle du feu qui nous embrase
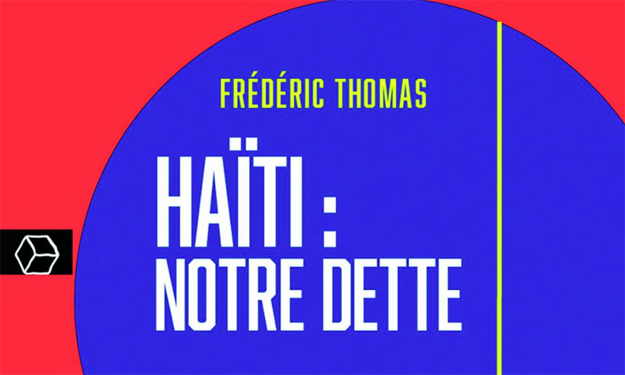
Dans sa belle introduction, Haïti, notre dette, Frédéric Thomas parle du passé « On vous a arrachés à vos terres et à vos familles. Enlevés de la Côte d'Or, du Dahomey, du pays des Aradas. Parqués à fond de cale, vous n'aviez rien, vous n'étiez rien. On vous a jetés, couverts de chaînes, à des milliers de kilomètres de là sur un territoire qui vous était étranger » et jette un pont vers le présent et le futur : « Le temps est passé, mais votre promesse demeure. Je vous dois une part de mon confort, de mes droits et de mes armes. Et moi, contrairement à la France, je paie mes dettes ».
Avril 2025 | tiré du site d'Inprecor
Un petit livre, mais contrairement à d'autres Frédéric Thomas ne caricature pas, n'oublie pas, n'efface ni les un·es et ni les autres, ne gomme pas des contradictions. Un coup pour coup magnifiquement écrit…
Des personnes esclavisées et d'ancien·nes esclaves, des afro-caraïbien·nes se sont libéré·es, seul·es. Un événement inouï, « L'onde de choc se poursuit jusqu'à nous et continue de faire vaciller les pouvoirs », impardonnable pour les maitres du monde. « L'exemple toxique de ce premier État noir, issu d'une révolte d'esclaves, a de quoi hanter le présent, entretenir les rêves, les révoltes et les peurs ».
L'auteur parle des politiques de la France, des réécritures de l'histoire, de l'inégalité entre États, du regard colonial d'un temps bloqué, de l'Ordonnance de Charles X (17 avril 1825), « une victoire acquise par la lutte se mue en une indépendance concédée par le pouvoir vaincu ». Il revient sur la révolution, les plantations de cannes à sucre, les administrateurs et les propriétaires, les petits blancs, les noirs libres, les esclaves des plantations, « et toutes les relations sociales sont saturées, structurées et surdéterminées par la violence esclavagiste », Les Jacobins noirs de C.R.L. James, le racisme et la peur panique des colons, François-Dominique Toussaint Louverture.
« La révolution s'inscrit dans la voie ouverte par les révolutions américaine et française ». Le décret de la liberté générale, l'abolition de l'esclavage, le rôle de Léger-Félicité Sonthonax, « l'écho de l'insurrection est désormais mondial ». Il ne faut pas se tromper, « l'initiative réelle revient aux esclaves qui se sont soulevés et exercent une pression prodigieuse sur toutes les forces en présence ». Ce geste libérateur ne peut être accepté, il sera nié, transformé en concession du pouvoir (une habitude des dominants, hier comme aujourd'hui !). Et pourtant, l'auteur a raison de le souligner, « la révolution haïtienne dessine d'autres “nous”, qui se rient de ces autorités »…
Dans le chapitre suivant, Frédéric Thomas analyse le pacte néocolonial, « L'enjeu est pourtant de penser ensemble la domination internationale et celle de la classe dominante haïtienne », la situation néocoloniale de dépendance, l'architecture de la société coloniale et le nouveau pouvoir qui émerge de la révolution haïtienne, le modèle d'agriculture intensive, « La plantation est une plateforme d'import-export dont le centre de décision est délocalisé », le travail libre qui rappelle le temps de l'esclavage, « la résistance têtue des anciens esclaves, refusant de retourner dans les plantations », le maintien du marqueur de l'esclavage et du colonialisme, et aussi « un projet d'agriculture et de société alternative », les clivages internes à la société haïtienne, l'oligarchie, le mythe fondateur et l'échec économique. L'auteur conclut ce chapitre sur les comptes à rendre de l'État français et sur la mise en place d'une politique de réparation...
Des soulèvements, le moment 1825, « Haïti est la nation la plus inégalitaire du continent le plus inégalitaire du monde », la répétition des chocs « sur fond de catastrophes naturelles, d'instabilité politique et de pauvreté », l'humanitaire et « les manières de passer à côté d'Haïti », celles et ceux qui parlent d'urgence mais pas d'histoire et qui oublient les droits et les résistances, les mobilisations de 2008, les colères contre la corruption et la vie chère, la confusion internationale entre « la pire des politiques [et] la politique du pire », les regards partagés par les ONG et les diplomates internationaux, les gravats du silence, « les peurs enfouies depuis cette fameuse nuit d'août 1791 », le pouvoir d'occulter le pouvoir, les responsabilités invisibilisées, l'humanitaire comme justification de « ce que l'on fait, ce qu'on ne fait pas et ce qu'on laisse faire », le refus d'une « transition de rupture », l'accord de Montana, le gouvernement d'Ariel Henry, les bandes armées et le refus « de mettre en place un réel embargo sur les armes en provenance des États-Unis », l'oligarchie et les élites, les fonctionnements mafieux. Contre la construction de réalités falsifiées et mensongères, contre l'occultation des pouvoirs et des responsabilités, il nous faut réhabiliter l'histoire et les paroles des populations haïtiennes pour rompre avec les stratégies du pacte néocolonial…
Frédéric Thomas termine par un chapitre « réparation ». Contre l'idée qu'il ne s'est rien passé, il faut regarder les Haïtiens et les Haïtiennes en face, reconnaître les faits, les responsabilités, fixer une politique de réparations, « La France a une dette envers Haïti qu'elle doit rembourser ».
Donnons à voir l'extraordinaire du soulèvement de 1791, démystifions les lectures monochromes de la modernité, analysons le « double mécanisme d'extraversion et de dépossession » et la superposition des scènes internationale et nationale, refusons le nationalisme étroit sans dimension anticoloniale et internationaliste, défaisons ce qui se fait en notre nom...
Nous avons besoin de tels livres pour que nos luttes quotidiennes se confondent avec l'embrasement du monde… « La révolution haïtienne est une promesse qui doit être tenue ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

222 ans après : un drapeau à 400 millions pour couvrir l’échec d’un État

« Yon sèl Drapo, Yon sèl Pèp, Yon sèl Nasyon ». Le slogan est beau. Il évoque l'unité, la souveraineté, le patriotisme. Mais à l'heure où le Pouvoir exécutif prévoit de débourser environ 400 millions de gourdes pour les festivités du 18 mai 2025, ce message résonne comme une gifle donnée au visage d'un peuple affamé, traqué, trahi.
Par Smith PRINVIL
À Cap-Haïtien, ville-héroïne de notre histoire révolutionnaire, se prépare un événement de prestige : décorations, vols charters pour les officiels, sécurité renforcée, spectacles culturels — tout, sauf la sincérité. Le paradoxe saute aux yeux : pendant que les autorités fuient la Plaine du Cul-de-Sac devenue zone rouge, elles s'envolent pour célébrer le drapeau dans une ville à l'abri, comme pour maquiller l'effondrement de la République par un folklore national.
Mais quelle nation célèbre-t-on à 400 millions de gourdes quand des enfants meurent de faim à La Saline, quand les hôpitaux publics ferment faute de moyens, quand des enseignants attendent des mois de salaires impayés, quand des milliers de familles vivent dans des camps sous des tentes depuis des années ? Quel peuple honore-t-on quand on ignore les cris des déplacés internes, fuyant les gangs armés qui ont annexé des communes entières avec la complicité tacite de l'État ?
Les critiques fusent et elles sont légitimes. Car il ne s'agit pas ici d'un acte patriotique, mais d'une manœuvre de diversion, voire de détournement de fonds publics. Un gouvernement sans légitimité, incapable de garantir la sécurité ou de redresser l'économie, choisit de noyer le désespoir national dans des paillettes commémoratives. C'est une stratégie vieille comme le monde : quand on ne peut gouverner, on parade.
Ce 18 mai, les uniformes seront repassés, les discours seront écrits à la hâte, les caméras seront braquées sur les estrades. Mais ce qu'on ne verra pas, c'est la blessure profonde du peuple haïtien, trahi une fois de plus par ceux qui parlent en son nom. Car derrière chaque gourde dépensée, il y a un choix. Et ce gouvernement a choisi le spectacle plutôt que la justice, l'image plutôt que l'action, l'oubli plutôt que la mémoire.
Haïti ne se libérera pas à coups de fanfares, ni de slogans vides. Le drapeau n'est pas un décor, c'est un symbole de lutte, né dans le sang des esclaves insurgés, levé par Dessalines et Catherine Flon comme promesse de liberté et de dignité. Ce drapeau ne saurait être réduit à un alibi budgétaire pour un pouvoir discrédité.
Le véritable hommage au bicolore, c'est le respect de la vie humaine, la reddition de comptes, la justice sociale. C'est de permettre aux enfants d'apprendre sans peur, aux agriculteurs de cultiver sans être rançonnés, aux citoyens de marcher dans les rues sans tomber sous les balles.
Le peuple haïtien ne demande pas une fête, il demande un futur.
Et ce futur ne viendra pas des podiums officiels, mais du réveil de la conscience collective.
Smith PRINVIL
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Appel de Paris pour la protection du peuple palestinien

La protection du peuple palestinien est devenue une urgence absolue. À Gaza, après quelques semaines de suspension, les massacres de masse ont repris, accompagnés d'un siège total et d'une famine généralisée ainsi que des déplacements forcés de populations ; au moins 53 000 Palestinien·es ont été tué·es suite aux opérations militaires israéliennes ; la bande de Gaza est dévastée et devenue inhabitable.
Tiré d'Orient XXI.
En Cisjordanie — y compris Jérusalem-Est — en dix-neuf mois, plus de 1 500 attaques de l'armée et des colons ont fait près de 962 morts et plus de 7030 blessé·es palestinien·es ; plus de 40 000 Palestinien·es y ont été déplacé·es de force.
Cependant, alors que le peuple palestinien vit la pire période de son histoire, la légitimité de son combat pour la justice et l'autodétermination face à la volonté d'effacement dont il fait l'objet, est réaffirmée par le droit international. Dans le prolongement de l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ), l'Assemblée générale des Nations unies a exigé par son vote du 18 septembre 2024 la fin de l'occupation israélienne du territoire palestinien et le démantèlement des colonies avant le 18 septembre 2025.
Dès lors, la France et l'Europe doivent s'acquitter de leurs obligations. Elles doivent, comme le précise la résolution de l'ONU, « favoriser, conjointement avec d'autres États ou séparément, la réalisation des droits du peuple palestinien à l'autodétermination et s'abstenir d'entretenir des relations conventionnelles avec Israël dans toutes les situations où celui-ci prétend agir au nom des Palestiniens ou pour des questions les concernant ».
Il y a 80 ans se construisaient les bases d'une justice internationale avec la création de l'ONU, dont la Charte fondait les conditions de la paix. Les États membres adoptaient trois ans plus tard la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Marquons cet anniversaire par notre refus solennel que la loi du plus fort l'emporte sur le droit international en Palestine.
L'Assemblée générale de l'ONU a décidé le 3 décembre 2024 de la tenue d'une conférence internationale. Elle se tiendra du 17 au 20 juin 2025 à New York. Elle aura pour mission « d'examiner l'application des résolutions de l'Organisation des Nations Unies relatives à la question de Palestine ».
En préalable de cette conférence internationale sous l'égide de l'ONU, nous lançons solennellement un appel pour la protection du peuple palestinien et la mise en œuvre du droit international.
Nous, signataires de cet appel, sommes convaincu·es que c'est l'application du droit international qui garantira la protection du peuple palestinien en lui permettant de vivre enfin en paix et en sécurité. Pour cette raison, nous demandons à la France de reconnaître l'État de Palestine dans le cadre du droit à l'autodétermination du peuple palestinien.
De la même façon, nous sommes convaincu·es que seuls la fin de l'occupation et l'arrêt de l'oppression du peuple palestinien permettront à Israël de connaître également la paix et la sécurité. En conséquence nous demandons à la France et aux États membres de l'Union européenne d'appliquer sans tarder les mesures énoncées par la résolution votée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 septembre 2024.
Liste des 55 premiers signataires
– Xavier Dolan, cinéaste réalisateur
– Ken Loach, cinéaste réalisateur
– Adèle Haenel, actrice
– Reda Kateb, acteur
– Roger Waters, auteur-compositeur-interprète
– Blanche Gardin, actrice
– Swann Arlaud, acteur
– Yvan Le Bolloc'h, acteur
– Annie Ernaux, romancière
– Corinne Masiero, actrice
– Robert Guédiguian, cinéaste
– Ernest Pignon-Ernest, plasticien
– Elias Sanbar, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO
– Edwy Plenel, journaliste
– Fabien Gay, journaliste rédacteur en chef de l'Humanité, Sénateur de Seine Saint-Denis
– Denis Sieffert, journaliste, directeur de Politis
– Denis Robert, réalisateur
– Alain Gresh, journaliste, fondateur et directeur d'Orient XXI
– Catherine Tricot, directrice de la revue Regards
– Thomas Vescovi, cofondateur de Yaani
– Daniel Mermet, journaliste
– Rony Brauman, ex-directeur de Médecins sans frontières
– Raphaël Pitti, médecin urgentiste
– Yanis Varoufakis, économiste grec
– Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes
– Olivier Faure, député de Seine et Marne, 1er secrétaire du Parti socialiste
– Olivier Besancenot, porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste
– Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de La France insoumise
– Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français
– Aymeric Caron, député de Paris, président de Révolution écologique pour le vivant
– Gisèle Jourda, sénatrice, présidente du groupe d'amitié France Palestine au Sénat
– Richard Ramos, député du Loiret, président du groupe d'amitié France-Palestine à l'Assemblée nationale
– Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis
– Thomas Portes, député de Seine-Saint-Denis
– Raymonde Poncet-Monge, sénatrice du Rhône
– Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine
– Johann Soufi, avocat et procureur, spécialisé en droit international
– Monique Chemillier-Gendreau, professeure émérite de droit public
– Ziad Majed, politologue, professeur universitaire et chercheur
– François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles
– Agnès Levallois, vice-présidente de l'iReMMO
– Anne-Marie Eddé, professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
– Bertrand Badie, professeur émérite à l'IEP de Paris, chercheur au CERI
– Didier Fassin, professeur au Collège de France
– Sylvain Cypel, journaliste
– Pascal Boniface, géopolitologue
– Sophie Bessis, historienne et journaliste, secrétaire générale adjointe de la FIDH
– Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT
– Caroline Chevé, secrétaire générale de la FSU
– Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT
– Nathalie Tehio, présidente de la Ligue des Droits de l'Homme-LDH
– Pierre Stambul, porte-parole de l'Union juive française pour la paix
– Youlie Yamamoto, porte-parole d'ATTAC
– Anne Tuaillon, présidente de l'Association France Palestine Solidarité-AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour les dirigeants de l’Inde et du Pakistan, la fièvre de la guerre est une aubaine

Les gouvernements de l'Inde et du Pakistan se sont éloignés du bord du gouffre à propos du Cachemire parce qu'aucun des deux ne peut se permettre une guerre à grande échelle. Une rhétorique belliqueuse et un climat de nationalisme strident ont aidé les deux gouvernements à faire face à des problèmes sur le front intérieur.
Tiré du site du CADTM.
Le conflit armé entre l'Inde et le Pakistan représentait une menace considérable pour le sous-continent. Cela aurait été une guerre qu'aucun pays ne peut se permettre. Le 10 mai, le président américain Donald Trump aurait négocié un premier cessez-le-feu entre les deux parties.
Cette annonce a été suivie d'une réunion des directeurs généraux des opérations militaires (DGMO) le 12 mai, lors de laquelle les deux parties ont accepté de respecter leur engagement de ne pas s'engager dans des actions agressives ou hostiles. En outre, l'Inde et le Pakistan « envisageront des mesures immédiates pour assurer la réduction des troupes ».
L'accord de paix actuel semble fragile, notamment en raison des nouvelles prises de position du premier ministre indien Narendra Modi et de son homologue pakistanais Shehbaz Sharif. Néanmoins, toute désescalade des tensions doit être saluée dans l'intérêt de la stabilité et de la paix régionales. Il semble improbable que l'une ou l'autre des parties puisse remporter une victoire décisive, qui entraînerait probablement la région dans une période de crise et d'incertitude prolongée.
Battre le tambour
Tout a commencé le 7 mai, lorsque l'armée de l'air indienne a mené une série de frappes aériennes visant des sites au Pakistan et au Cachemire administré par le Pakistan. Cette offensive avait pour nom de code « Opération Sindoor ». L'agression militaire a été déclenchée par une attaque meurtrière contre des touristes à Pahalgam, au Cachemire, le 22 avril, qui a entraîné la mort de vingt-six civils.
Les autorités indiennes ont affirmé que les opérations visaient neuf sites identifiés comme des « infrastructures terroristes ». En réponse, l'armée pakistanaise a affirmé que les frappes n'avaient visé que six sites, entraînant la mort de trente et un civils. Du côté indien, des rapports indiquent qu'au moins quarante civils ont été tués et de nombreux blessés, principalement dans le secteur de Poonch à Jammu, lorsque les troupes pakistanaises ont procédé à des tirs d'artillerie lourde le long de la ligne de contrôle (LoC) en représailles à l'attaque indienne.
L'incident de Pahalgam s'est avéré avantageux pour Modi, dont l'administration était déjà aux prises avec divers problèmes. Le gouvernement indien a dû faire face à une forte contestation publique, notamment pour la loi controversée sur le Waqf (amendement), ainsi qu'à des arrêts de la Cour suprême qui ont mis en évidence des violations constitutionnelles de la part de l'administration. En outre, les défis économiques et la hausse du chômage ont contribué au mécontentement croissant. En outre, la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane à l'Inde a introduit des incertitudes supplémentaires.
Modi et ses alliés n'ont pas assumé la responsabilité des graves lacunes en matière de sécurité qui ont contribué à l'incident tragique de Pahalgam. Au lieu de cela, ils ont exploité la situation pour susciter la panique, la frénésie, l'hystérie guerrière, le chauvinisme et une nouvelle vague d'islamophobie. Ils ont réussi à galvaniser une nation entière autour d'une menace sécuritaire perçue comme étant posée par des terroristes soutenus par le Pakistan. La quasi-totalité de la nation s'est ralliée à eux dans leur quête de vengeance à la suite de l'attaque.
Les principales chaînes de médias ont facilité cette situation en propageant quotidiennement des fake news sur le Pakistan. Ces médias se sont transformés en champs de bataille, enflammant des millions de citoyens à travers le pays à coup d'informations erronées. Le gouvernement a même dû intervenir le 9 mai pour empêcher les médias de continuer à diffuser de fausses informations et d'attiser l'animosité.
Le gouvernement Modi a intentionnellement orchestré ce climat pour renforcer sa popularité, en particulier à l'approche des élections législatives dans l'État du Bihar. Il sert également à détourner l'attention des masses laborieuses de l'Inde des problèmes matériels auxquels le pays est confronté, tels que la hausse du chômage, les inégalités, la pauvreté et diverses formes de privation. Des rapports indiquent que le taux de chômage des jeunes a atteint 16,1 % lors du premier trimestre 2025.
Le compte de médias sociaux de l'unité d'information publique de l'armée indienne a salué les frappes transfrontalières comme un cas de « justice rendue ». Pourtant, il n'y a aucun signe d'arrestation des militants qui étaient réellement responsables des attaques terroristes à Pahalgam, tandis que la « justice » dont parle l'armée a impliqué des actions meurtrières dirigées contre des civils non armés, y compris des enfants.
La réponse du Pakistan
Les actions de l'Inde sont arrivées à point nommé pour les dirigeants pakistanais. Le pays est aux prises avec de graves crises économiques et d'endettement, des troubles politiques au Baloutchistan et une détérioration des relations avec l'Afghanistan. Autant de facteurs qui ont rendu le gouvernement actuel, dirigé par Sharif et les militaires, impopulaire auprès de la population du pays.
La réponse pakistanaise à l'attentat terroriste de Pahalgam, en même temps officieuse et semi-officielle, a été de prétendre qu'il s'agissait d'une « opération sous fausse bannière ». L'incident a été suivi d'une éruption de manie guerrière chauvine.
Les présentateurs télévisés, comme leurs homologues indiens, ont joué un rôle important dans le développement de l'hystérie guerrière. Les ministres, les hommes politiques de l'opposition et les chefs militaires ont fait des déclarations belliqueuses à l'unisson. Dans les jours qui ont précédé les premières frappes indiennes, le sentiment dominant au Pakistan était que l'Inde reculait par peur.
Deux points méritent d'être soulignés pour replacer l'attitude du Pakistan dans son contexte. Tout d'abord, l'establishment a encouragé et protégé les groupes djihadistes, du moins dans le Cachemire administré par le Pakistan. Ensuite, une réponse impétueuse de l'Inde a objectivement aidé le régime hybride pakistanais assiégé de l'intérieur, qui est au pouvoir depuis l'éviction d'Imran Khan.
Dans ce régime hybride, ce sont les militaires qui mènent la danse. Les représentants du gouvernement civil, le Premier ministre Sharif et le président Asif Ali Zardari, tiennent le rôle de serviteurs obéissants pour assurer leur maintien au pouvoir. Ayesha Siddiqa, spécialiste reconnue de l'armée pakistanaise, a rapporté en février dernier qu'« une source bien informée à Islamabad » estimait que les dirigeants militaires « se préparaient à relancer le militantisme – à une échelle comparativement plus faible mais perceptible » après l'hiver, afin de faire pression sur l'Inde pour qu'elle négocie sur la question du Baloutchistan.
Le Pakistan est confronté à un mouvement séparatiste armé au Baloutchistan, qui est géographiquement la plus grande de ses quatre provinces, limitrophe de l'Iran et de l'Afghanistan. La Chine a construit un énorme port à Gwadar sur la côte du Baloutchistan, et le Baloutchistan est un maillon crucial de l'initiative « la Ceinture et la Route ». Le Pakistan a accusé à plusieurs reprises l'Inde d'armer et d'entraîner l'Armée de libération du Baloutchistan, une organisation militante responsable d'attaques de guérilla contre des installations de sécurité et des travailleurs chinois au Baloutchistan.
Guerre de basse intensité
Malgré la fanfare qui entoure cette prétendue guerre et l'hystérie généralisée qui règne de part et d'autre de la frontière, bien sûr, aucune des deux armées n'a réellement pénétré en territoire ennemi. Des missiles et des drones ont été lancés en sus des tirs d'artillerie et des attaques transfrontalières. Les gouvernements et les médias des deux pays ont célébré avec beaucoup d'enthousiasme chaque fois que leurs forces ont intercepté un drone ou un missile « ennemi » à l'intérieur de leurs frontières respectives.
Selon Pravin Sawhney, éminent spécialiste militaire indien, le pays n'était même pas dans une situation de pré-guerre, qui implique généralement une mobilisation considérable des forces terrestres à travers les frontières. Nous avons assisté à une crise militaire – une version intensifiée des incidents habituels le long de la ligne de contrôle, en particulier au Jammu-et-Cachemire.
L'Inde et le Pakistan se sont livrés à trois guerres de vaste ampleur au sujet du Cachemire dans le passé, et les deux pays sont dotés de l'arme nucléaire. Aucun des deux pays ne peut supporter le coût d'un nouveau conflit à part entière. L'économie pakistanaise est actuellement confrontée à de graves difficultés ; elle est très endettée et doit rembourser de nombreux prêts. Avec un taux de croissance économique faible d'un peu plus de 2 %, il ne peut se permettre de s'engager dans une nouvelle guerre majeure.
Bien que l'économie indienne soit considérablement plus forte et plus grande, Modi a fait miroiter à l'Inde la perspective de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars et d'émerger comme puissance économique et géopolitique majeure. Toute chance d'atteindre ces objectifs repose sur la stabilité de l'Inde, et une guerre avec un voisin doté de l'arme nucléaire a peu de chances d'attirer les investisseurs, sans parler des dommages qui en résulteraient pour le tourisme. Nous avons déjà assisté à des annulations de vols dans les deux pays, et il n'est dans l'intérêt stratégique ou économique d'aucune des deux nations que les récentes tensions dégénèrent en quelque chose de plus grave.
En outre, l'Inde comprend qu'il est peu probable que les Chinois restent passifs en cas d'attaque contre le Pakistan. Cela n'est et dû aux hostilités traditionnelles entre l'Inde et la Chine, mais également au fait que la Chine a investi environ 62 milliards de dollars dans le corridor économique Chine-Pakistan. Cet investissement englobe un large éventail de projets d'infrastructure et d'énergie destinés à relier la région occidentale de la Chine au port de Gwadar, au Pakistan.
Le golfe du Bengale et la mer d'Oman sont indispensables pour l'initiative « la Ceinture et la Route ». La Chine serait profondément préoccupée si les actions belliqueuses de ce qu'elle perçoit comme des gouvernements irresponsables dans ces deux nations finissaient par mettre en péril ses investissements. Impliquer les Chinois dans un conflit pourrait s'avérer désastreux pour l'Inde, car la guerre moderne repose largement sur des technologies de pointe, pour lesquelles la Chine possède un avantage considérable.
Il est donc dans l'intérêt de l'Inde et du Pakistan de maintenir des actions militaires de faible intensité, car cette stratégie leur procure des avantages politiques significatifs à un coût minime. Toutefois, cette approche impose un lourd fardeau à leurs populations civiles. Après l'euphorie initiale qui a suivi les attentats, l'atmosphère en Inde – en particulier dans les régions du nord et de l'ouest – est passée de la célébration à la panique et à l'appréhension quant aux victimes potentielles. Cela est survenu lorsque le Pakistan a indiqué qu'il riposterait.
Si les capitalistes indiens ont d'abord soutenu la ferveur guerrière, la fermeture des aéroports et le détournement des vols qui s'en est suivi les ont considérablement inquiétés. Le secteur industriel indien a depuis lors publié des déclarations appelant à la retenue. Le 9 mai, les marchés boursiers indiens et la roupie ont subi une baisse notable avant de regagner le terrain perdu le 12 mai avec l'accord de cessez-le-feu.
Nouvelle normalité
Les deux parties cherchaient à désamorcer l'escalade après les premières manifestations d'agression, en attendant le moment propice pour apaiser leur public national. Une méthode viable pour y parvenir consistait à pouvoir invoquer la pression internationale.
Si la Chine entretient des relations étroites avec le Pakistan, son influence sur l'Inde est limitée. Les États du Golfe ont une certaine influence sur les deux pays, mais pas autant que les États-Unis. Des pays comme la Russie et l'Iran pourraient éventuellement jouer un rôle de médiateur et contribuer à empêcher la situation de dégénérer en une crise plus grave ; toutefois, leur influence ne serait pas suffisante pour éviter de nouvelles tensions.
Dans l'état actuel des choses, la seule puissance à laquelle l'Inde et le Pakistan se sentent obligés de prêter attention est celle des États-Unis. Historiquement, les États-Unis ont joué un rôle dans la facilitation de la paix entre les deux États. Après le début des actions militaires indiennes, des signes ont montré que Washington façonnait indirectement les actions et les communications de l'Inde, en soulignant la nature « ciblée, mesurée et non escalatoire » des frappes, conçues pour répondre aux attentes de Donald Trump.
M. Trump a affirmé que les États-Unis avaient facilité une série de discussions qui ont abouti à un accord ; le gouvernement indien n'a ni confirmé ni infirmé cette affirmation. Pour soutenir ses partisans et entretenir un sentiment de ferveur guerrière, Modi a adopté un ton défiant et triomphant lors d'un discours à la nation le 12 mai.
Il a proclamé que l'Inde avait établi une « nouvelle normalité » en matière de réponse aux attaques terroristes et a présenté le cessez-le-feu comme une suspension temporaire des opérations du côté indien, les actions du Pakistan devant être surveillées de près dans les jours à venir. La réaction de l'establishment pakistanais a été tout aussi belliqueuse.
Si le cessez-le-feu a mis fin aux opérations armées, les agressions verbales et diplomatiques se sont poursuivies. À ce jour, la suspension du traité sur les eaux de l'Indus n'a pas été annulée. Ces mesures concernent aussi bien l'arrêt des visas que l'expulsion des diplomates, la fermeture des frontières, la restriction de l'espace aérien et la suspension des échanges commerciaux. En fin de compte, ce sont les citoyens des deux pays, ainsi que les Cachemiris de part et d'autre de la frontière, qui ont été les plus touchés et qui restent les otages de cette crise persistante.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Chhattisgarh (Inde) : Arrêt immédiat de la guerre contre les citoyens

Lors d'une opération « anti-Naxal » mercredi (21 mai 2025), les forces de sécurité ont tué vingt-sept maoïstes, dont Nambala Keshav Rao, également connu sous le nom de Basavaraju, le secrétaire général du Parti communiste indien (maoïste) interdit, dans le district de Narayanpur au Chhattisgarh. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont exprimé leur jubilation et leur fierté concernant le succès de l'opération Kagaar.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Alternative Viewpoint dénonce fortement cet assassinat ciblé. Le motif sous-jacent semble être une campagne de longue date visant à s'emparer des terres, des eaux et des forêts des communautés [indigène] adivasi du Chhattisgarh, présentée sous le couvert d'opérations anti-maoïstes qui profitent réellement aux intérêts des puissances économique. Le mouvement maoïste indien a initialement émergé en réponse à l'aliénation des terres. Cependant, il a depuis évolué en un mouvement plus large s'opposant à l'aliénation des ressources naturelles, en particulier des forêts. L'État a été responsable de l'orchestration de massacres pour réprimer la résistance, la région de Bastar au Chhattisgarh étant un exemple notable.
Le gouvernement porte la responsabilité des décès de ses citoyens, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur semblant prendre plaisir aux exécutions ciblées se produisant sous leur surveillance. Depuis le début de l'« opération Kagaar », la simple suspicion d'affiliations maoïstes a conduit à la mort de 31 personnes, dont 15 femmes, en seulement 21 jours. De plus, il y a eu de nombreux rapports de violations des droits de l'homme à travers le Chhattisgarh.
Il est essentiel de comprendre que le maoïsme est associé à des régions souffrant de pauvreté endémique, d'exploitation, de corporations envahissantes et de perte de terres et de moyens de subsistance. Il l'est également à des questions liées à la dignité et à l'autonomie tribales. Cette question va au-delà d'un problème élémentaire de maintien de l'ordre ; elle englobe des thèmes plus larges de privation et d'aliénation. Le ministre de l'Intérieur a fixé une date limite pour l'éradication des Naxalites au 31 mars 2026. Cette perspective réductionniste et intéressée, qui suppose que l'aliénation peut être résolue uniquement en éliminant ceux qui sont aliénés, soulève des préoccupations cruciales.
Malgré la proposition d'accord de paix du CPI (maoïste), le gouvernement a intensifié sa répression. Le meurtre indiscriminé des peuples autochtones pour s'approprier les ressources naturelles est un phénomène troublant aux racines historiques profondes. Le gouvernement Modi-Shah a poursuivi cette approche répressive avec un nouvel élan depuis l'« opération Green Hunt » du Parti du Congrès. « L'opération Kagaar » se présente comme la manifestation la plus flagrante de cette violence persistante.
Bien que nous ne soutenions pas nécessairement les politiques maoïstes, Alternative Viewpoint condamne les meurtres ciblés et inhumains des membres du CPI (Maoïste) et des peuples tribaux, ainsi que l'autoritarisme antidémocratique qui a permis ces actions. Nous nous opposons à la guerre menée par l'État contre les citoyens afin de priver les communautés indigènes de leurs droits. Nous appelons tous les démocrates à résister à chaque instance de répression et de meurtre de l'État.
Alternative Viewpoint
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’extermination comme moyen de négociation : comprendre la stratégie d’Israël à Gaza

Depuis le dévoilement de l'« opération Chars de Gédéon », la nouvelle offensive israélienne visant à « conquérir » définitivement toute la bande de Gaza, il est devenu de plus en plus évident que les décisions prises au sein du gouvernement israélien ne visent pas un objectif stratégique unique, mais plutôt une logique récurrente d'épuisement.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Israël ne choisit pas entre la conquête totale et le confinement technocratique via un plan de cessez-le-feu négocié par les pays arabes. Il utilise ces options comme des moyens de prolonger la guerre et d'instrumentaliser sa durée plutôt que d'y mettre fin. Aucune n'est une véritable alternative à l'autre.
Ce n'est pas un paradoxe, mais une méthode. L'opération « Gideon's Chariots », qui vise à concentrer plus de deux millions de Palestiniens à Rafah et à « nettoyer » le reste de Gaza, n'est pas seulement un plan de conquête. C'est un fantasme de stérilisation déguisé en rationalité logistique. Sa brutalité ne réside pas seulement dans ses intentions – militaires et démographiques – mais aussi dans son caractère illimité, car il s'agira d'une occupation sans gouvernance ni responsabilité.
Elle imagine Gaza comme un champ chirurgical : vide de densité sociale et de politique, un terrain aplati où l'armée israélienne peut opérer sans entrave et où les civils sont transformés en captifs ou en débris. Là où l'extermination peut se poursuivre derrière le voile de la logistique humanitaire. Mais voilà : si Israël annonce son planen divulguant une grande partie de ses contours, s'assurant que l'issue finale de l'extermination est connue de tous, il en retarde également la réalisation.
Le rejet de la proposition égyptienne pour la gouvernance d'après-guerre à Gaza, quant à lui, relève moins d'une réfutation stratégique que d'une manœuvre temporaire : il reporte la stabilisation de Gaza, suspend la possibilité d'une architecture d'après-guerre et garantit à Israël son rôle d'arbitre unique en matière de circulation, d'aide, de reconstruction et de survie. La proposition, qui avait obtenu le soutien de la Ligue arabe, prévoyait un cessez-le-feu, la libération des prisonniers et la création d'une administration technocratique palestinienne à Gaza sous l'égide régionale et internationale. L'autorité gouvernementale serait civile, non affiliée au Hamas et éventuellement liée à l'Autorité palestinienne. Les forces de sécurité arabes, principalement égyptiennes et émiraties, auraient maintenu l'ordre public. Israël aurait, en théorie, conservé la possibilité de frapper si le Hamas se réarmait, mais la logique fondamentale était celle d'une gouvernance pacifiée et d'une reconstruction supervisée de l'extérieur.
Mais cette alternative, présentée comme un endiguement pragmatique, révèle sa propre structure de contrôle. Elle n'offre ni libération ni souveraineté aux Palestiniens. Elle ne rétablit pas la vie politique palestinienne. Au contraire, elle imagine une Gaza dépolitisée, administrée par des technocrates étrangers, où la gouvernance est réduite à la gestion et où la résistance est métabolisée en menaces pour la sécurité.
Oui, cela met fin aux massacres, mais cela poursuit le processus de destruction par d'autres moyens. Oui, il met fin au nettoyage ethnique et au génocide, mais il n'offre qu'un répit minimal.
Dans ce scénario, le Palestinien devient administrable mais non représentable — visible dans les tableurs et les systèmes de surveillance, mais invisible en tant que sujet de l'histoire. Là où « Gideon's Chariots » propose l'élimination de l'interlocuteur, le plan égyptien offre sa neutralisation. Là où le premier vise l'effacement, le second garantit le confinement.
De cette manière, Israël ne se contente pas de combattre le Hamas. Il gère le temps de l'effondrement des infrastructures de Gaza, de la diplomatie régionale et de ses propres contradictions internes. Les soi-disant « plans » qu'il fait circuler ne sont pas des plans d'action, mais des instruments de désorientation. En alternant escalade militaire et non-engagement diplomatique, Israël piège ses adversaires comme ses alliés dans un théâtre d'attente sans fin.
Ces plans ne deviennent pas des résolutions, mais des pièges littéraux : ils enhardissent certains, humilient d'autres et érodent la cohérence de toute vision alternative. Mais Israël reste dans le terrain suspendu des deux plans. D'un côté, il cherche à récupérer ses prisonniers avant d'anéantir complètement Gaza. D'autre part, il vise à apaiser les gouvernements arabes qui sont restés silencieux, n'ont pas rompu leurs liens avec Israël et ont progressivement – mais sûrement – proposé une alternative au génocide par une politique de stérilisation. Sans oublier que la perspective de détruire complètement la population de Gaza reste d'actualité, ce qui sert la gestion de la coalition par Netanyahou et son désir d'émerger comme un leader historique ayant mis fin de manière décisive à la question palestinienne.
Cela n'est nulle part plus évident que dans les relations d'Israël avec les États du Golfe. En signalant son ouverture à la normalisation et à des accords de sécurité régionale – tout en aggravant la catastrophe humanitaire –, Israël évite de se voir imposer des ultimatums clairs. La perspective d'une Gaza reconfigurée sous contrôle arabe est présentée comme une hypothèse, une possibilité lointaine, tandis que des faits irréversibles sont fabriqués sur le terrain : des quartiers entiers sont rayés de la carte, des populations déplacées, des infrastructures réduites en poussière.
Derrière le langage de la planification se cache une campagne de stérilisation et de concentration, une vision de Gaza non pas comme un foyer, mais comme un lieu de détention. Des rapports divulgués font état de transferts forcés, de Palestiniens envoyés en Libye ou ailleurs en Afrique, esquissant un avenir marqué par l'expulsion sous le couvert du pragmatisme. En d'autres termes, Israël manœuvre, cajole, accepte, revient sur sa parole, recommence à verser le sang et, en fin de compte, hésite à mettre en œuvre ses propres plans.
Mais même cette stratégie montre des signes de fatigue. L'armée est à bout. Les réservistes sont épuisés. Le soutien public, autrefois monolithique, est désormais fracturé, en particulier autour de l'incapacité du gouvernement à récupérer les prisonniers israéliens et de son mépris pour leur vie. L'élite politique peut afficher son unité, mais la cohésion sociale s'effrite. La confiance même qui liait autrefois la nécessité militaire à la légitimité civile s'érode.
Ces signes d'érosion ne sont pas seulement internes. Plus la guerre se prolonge, plus Israël perd sa légitimité internationale. Les mandats de la CPI, les décisions de la CIJ, les accusations de génocide qui s'intensifient ne sont pas seulement des condamnations morales, mais les signes d'un début d'isolement institutionnel.
Et pourtant, plutôt que de changer de cap, Israël redouble d'efforts, s'appuyant sur l'ambiguïté et l'usure, espérant épuiser l'indignation mondiale comme il espère épuiser la résistance palestinienne : par le retard, la confusion, la normalisation de l'effondrement et, bien sûr, par la coercition via l'instrumentalisation de l'antisémitisme.
À l'heure actuelle, ce qu'Israël recherche, c'est une « instabilité stable » dans laquelle Gaza est rendue inhabitable mais gouvernée, massacrée mais silencieuse, présente mais politiquement annulée. Les deux plans – celui qu'il met en œuvre et celui qu'il rejette – servent cette logique. Que ce soit par une guerre totale ou un confinement contrôlé, l'objectif reste le même : effacer la Palestine en tant que sujet de l'histoire et la remplacer par une population qui peut être contrôlée, administrée ou éliminée. La réussite de cette entreprise reste incertaine. Mais les fissures sont visibles dans la désillusion des soldats et dans la rage des familles des prisonniers israéliens.
Les négociations de cessez-le-feu comme forme d'interrogatoire
La manière dont Israël a mené les négociations de cessez-le-feu, pris dans un cycle perpétuel de propositions, de rejets, de reprise des hostilités et d'insistance sur des positions inacceptables, ressemble beaucoup à la dynamique entre les interrogateurs israéliens du Shin Bet et les prisonniers palestiniens soumis à leurs tactiques de pression.
Dans les salles du Shin Bet, la manipulation du temps devient une arme et le langage un outil de désorientation. La vérité n'est pas révélée par la clarté ou le dialogue, mais extraite par l'épuisement : torture physique, jeux psychologiques, faux-semblants d'amitié et promesses facilement trahies. Le but n'est pas de comprendre le sujet, mais de le détruire – pas seulement d'obtenir des aveux, mais de le faire s'effondrer.
« Si tu parles, je te donnerai une cigarette. Si tu donnes un nom, tu pourras te reposer. Si tu nous donnes une personne, une seule, nous t'apporterons peut-être de la nourriture, une couverture ou quelque chose pour te réchauffer. » Chaque geste se fait passer pour de la miséricorde, chaque acte est lié à la logique de l'accord. C'est une gouvernance par l'épuisement.
Mais il ne s'agit pas seulement d'une scène d'interrogatoire. C'est une relation dans laquelle le massacre, la négociation et la mesure s'alimentent mutuellement : le massacre produit la crise qui rend la négociation lisible ; et la négociation devient l'espace où l'impact de la violence est mesuré. Chaque bombardement israélien n'est pas suivi d'un silence, mais d'une évaluation : la résistance s'est-elle adoucie ? La communauté s'est-elle brisée ? Sont-ils prêts à céder ?
La négociation n'est pas une déviation de la violence ; c'est l'une de ses modalités — stratégique, affective, diagnostique. Parler de négociation ici, c'est parler d'un calibrage de la ruine et d'un test de l'esprit et de la fatigue. Tout comme l'interrogateur teste les limites de l'endurance du prisonnier.
Et pourtant, dans son cachot, le prisonnier palestinien aspire parfois à revoir son interrogateur, car dans un monde aux portes closes et à la famine lente, celui-ci devient le seul à confirmer son existence, la seule socialité possible.
L'ironie est que plus vous montrez de faiblesse, plus ils vous privent. Plus vous vous soumettez, plus ils serrent la vis. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'une négociation de besoins, mais d'une architecture de l'humiliation calibrée pour que même votre volonté de parler devienne une marque supplémentaire de dépossession, ou un moment pour soutirer tout ce que vous pouvez à votre interlocuteur et vous assurer qu'il ne cache rien.
Lorsque les analystes, les diplomates et les commentateurs invoquent le terme « négociations », il s'agit en réalité d'un interrogatoire, car sa structure est conçue pour épuiser l'autre jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et lorsque l'effondrement ne suffit pas, l'élimination suit. Dans ce paradigme, Israël ne recherche pas d'interlocuteurs, mais cherche à démanteler ceux qu'il convoque à la table des négociations.
Au-delà du binaire
Si les négociations israéliennes fonctionnent comme une forme d'interrogatoire, il est tout aussi important de rappeler que les Palestiniens ont non seulement reconnu cette structure, mais qu'ils ont également saboté à plusieurs reprises son fonctionnement. En effet, l'histoire de la lutte palestinienne est celle du refus des conditions imposées par l'occupant : celle de parler sans permission, de refuser de s'exprimer lorsqu'on y est contraint, de survivre sans chercher à être reconnu. Il ne s'agit pas d'une rébellion romantique, mais d'une lucidité forgée sous la pression. Une ruse politique forgée dans les cellules de prison, les salles d'interrogatoire, les maisons en ruines et les tables de négociation.
On demande depuis longtemps aux Palestiniens de jouer leur défaite, d'incarner la retenue tout en faisant preuve de modération et en dénonçant la violence de manière sélective. Mais à chaque fois, ils refusent ce rôle. Le prisonnier qui choisit le silence plutôt que les aveux ; le gréviste de la faim qui déplace la temporalité de la domination en soumettant son corps au temps lui-même ; la mère qui insiste pour nommer son enfant mort non pas victime, mais martyr ; le camp qui refuse de se dissoudre dans la poussière de l'humanitarisme — ce ne sont pas seulement des actes de résistance, mais des refus de capture.
C'est précisément ce refus qui brise le faux dilemme que l'Israël offre aujourd'hui au monde : extermination ou confinement, « chars de Gédéon » ou plan égyptien.
Il ne s'agit pas d'alternatives, mais plutôt de complicités structurelles. L'une éliminerait les Palestiniens en tant que sujets par la stérilisation militaire, l'autre les désarmerait et les contrôlerait par le biais d'une bureaucratie internationale. L'une est un génocide déclaré, l'autre une disparition contrôlée.
Cette dichotomie elle-même devient instable, car les fractures traversent désormais l'architecture morale de l'ordre international, dont la complicité et le deuil sélectif sont quotidiennement démasqués. Elles traversent les fondements mêmes d'Israël : une armée à bout de souffle, un leadership politique incohérent et une société qui se fracture sous le poids d'une guerre sans fin et de l'attente du retour du messie. Ces fractures traversent tous les lieux où le choix entre extermination et confinement est refusé, et où une troisième possibilité, fugitive, commence à poindre.
Cette troisième voie, bien que difficile à nommer, est déjà en train de se concrétiser. Elle bat au cœur des réseaux de solidarité mondiale qui ne demandent plus la permission, mais exigent des comptes. Elle grandit dans toutes les salles d'audience où le mot « génocide » est prononcé, non pas comme une métaphore, mais comme une accusation juridique. Elle vit dans la reconnaissance que la Palestine n'est pas une crise humanitaire à gérer, mais une cause politique à revendiquer.
Elle vit dans la conscience que la Palestine a vidé de leur sens les revendications de l'ordre libéral, mis à nu ses fondements et saturé son vocabulaire, tout en continuant d'affirmer sa présence.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Mondoweiss
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le règne de l’indignité et de l’irraison : Adresse à signer !

A la destruction systématique de la bande de Gaza et à l'hécatombe de sa population, s'ajoutent la famine et la destruction des moyens médicaux comme compléments de la guerre génocidaire
L'État d'Israël a décidé qu'aucun Palestinien ne doit rester sur sa terre.
Nous regardons, anéantis et envahis d'une incommensurable honte en l'universalité, la première phase du nettoyage ethnique de l'enclave qui se prolonge par celui annoncé en Cisjordanie.
Laisserez-vous le Président des États-Unis faire de Gaza une « Riviera » ?
Le peuple palestinien subit un génocide, une guerre d'extermination au sens où Raphaël Lemkin l'entendait : « acte de génocide dirigé contre un groupe national en tant qu'entité et les actes en cause sont dirigés contre des individus, non pas à titre individuel, mais en tant que membres de leur groupe nationali ».
Si la Charte des Nations Unies reconnait à l'État agressé le droit de se défendre (article 51), ce droit s'applique -t-il à une puissance exerçant une occupation illégale ? Cela mérite discussion. En tout état de cause, aucun État n'a le droit d'utiliser une force disproportionnée, ainsi qu'en fait usage actuellement l'État colonisateur. Le principe de proportionnalité introduit le fait qu'une action ne doit pas être plus dévastatrice que les dommages déjà subis. Pourtant, dans sa riposte, l'État d'Israël a fait le choix d'une violence aveugle qui viole le principe de proportionnalité en ne respectant aucun équilibre entre l'objectif, sauver les otages, et les moyens employés. L'objectif véritable : étant d'exterminer le maximum de Palestiniens.
Si la notion de principe énonce des exigences d'optimisation des valeurs et des intérêts, alors que les normes et les règles sont souvent présentées comme de nature ontologique, logique ou méthodologique, le principe de proportionnalité ne prime-t-il pas sur les autres règles et normes ? N'est-ce pas encore plus vrai lorsqu'un Premier ministre affirme qu'il faut éradiquer le Hamas et qu'il reçoit en retour le soutien d'une grande partie de la communauté internationale, et notamment de ses soutiens occidentaux, qui s'élèvent comme lui contre la « barbarie » ? Dans ces conditions, il lui est facile de décider du quota de proportionnalité.
Qui est le plus barbare ? Celui qui lutte contre une occupation coloniale illégale et pour son droit inaliénable à l'auto-détermination, même s'il commet ce faisant des actes criminels, ou celui qui, pour se venger et surtout pour réaliser des desseins coloniaux et expansionnistes d'extrême droite, cherche à éliminer de sa terre tout un peuple ? Celui qui aide un État à commettre, sur une grande échelle et de manière planifiée et systématique, des crimes de génocide, des crimes de guerre ? Celui qui détourne les yeux faisant semblant de ne pas savoir, alors que les corps s'amoncellent sous les gravats, ou de ne pas voir dans la profondeur des yeux des enfants l'inhumanité d'un monde se réclamant de la démocratie et des droits humains ?
Pourquoi face à ce désastre pour l'humanité, des pays, sans aucun état d'âme, aident l'État d'Israël en lui fournissant une aide soit militaire soit financière ?
Vous ne pouvez ignorer qu'en aidant ou en assistant ce pays, en lui reconnaissant son droit à se défendre alors qu'il est l'occupant, ces pays engagent la responsabilité internationale de leur État et se rendent complices de l'occupation illégale, de la colonisation, de l'apartheid, du nettoyage ethnique en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et même en ce qui concerne les Bédouins en territoire sous juridiction israélienne, sans oublier les crimes de guerre commis depuis plus de 78 ans et qui violent, malgré les nombreuses résolutions du Conseil de Sécurité ou celles de l'Assemblée générale, aussi bien l'ensemble des droits humains que les droits des populations civiles en temps de guerre garantis par la 4e Convention de Genève.
Affirmerez-vous en août prochain, lors du 75e anniversaire de l'adoption de cette Convention, qu'elle est une grande avancée pour la protection des populations civiles alors que l'armée d'occupation israélienne détruit systématiquement les écoles, les hôpitaux, les refuges, les centres de l'UNRWA et que la réunion des Hautes Parties Contractantes des Conventions de Genève, prévue le 7 mars dernier, a été annulée à la dernière minute en raison de la position déplorable du gouvernement suisse et de l'Europe ?
Faut-il vous rappeler qu'un État tiers n'a pas besoin de participer directement à un acte internationalement illicite – à l'instar des États-Unis, coresponsables de la guerre génocidaire menée par leur allié israélien – pour en partager la responsabilité ; il suffit qu'il fournisse une aide volontaire à la réalisation d'un fait illicite ou à la prolongation dans le temps de cet acte et cela concerne tous les États favorisant, entre autres, leurs entreprises afin qu'elles signent des contrats de ventes de composants ou d'armes à l'État israélienii.
Notons que, dans le cas du peuple palestinien et par rapport à l'acte internationalement illicite israélien, sont en cause des obligations considérées comme « essentielles » pour la « communauté internationale tout entière ». Rappelons ici qu'en 1970, dans un arrêt célèbre la Cour internationale de Justice avait précisé qu'« une distinction essentielle doit être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre État ....
Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnesiii ».
Il va de soi que l'une des conséquences directes du fait internationalement illicite est qu'il existe à la charge de tous les sujets de droit international l'obligation de réparation. La réparation, qui consiste dans l'obligation d'effacer les conséquences du fait internationalement illicite, apparaît avant tout comme un mécanisme de sanction de la violation du droit international.
Pourquoi assumez-vous une telle précipitation au chevet de l'Ukraine envahie, tandis que la Palestine est abandonnée, isolée, emmurée, meurtrie, ethniquement « nettoyée », depuis plus de 78 ans sans susciter une véritable indignation de votre part ?
La dignité de la communauté internationale exige que cette dernière soutienne l'État sud africain pour avoir rappelé les principes intangibles du jus cogens (norme impérative) et qu'elle se dresse contre les attaques et les menaces dont ce pays est la cible, notamment celles de la nouvelle administration états-unienne.
Que répondez-vous au fait que les mesures provisoires de la Cour Internationale de Justice n'ont pas été respectéesiv, et encore moins mises en œuvre ?
Au nom de l'universalité, au nom de l'humain, assumez-vous d'avaliser encore plus de famine, plus de destruction massive, plus de déplacements de population ?
N'êtes-vous pas là, en tant que membres de la communauté internationale, pour contrer le fait que les rapports de force politiques ne l'emportent pas sur les normes du jus cogens quant au droit international et au droit humanitaire international mis en place pour réguler les usages de la force et protéger les populations civiles ?
Nous, Peuple des Nations, exigeons que vous, les États, en tant que membres de la communauté internationale représentant le Peuple des Nations, vous œuvriez en toute urgence à la mise en place de garde-fous pour éviter la déstructuration du droit international, voire le déchirement de la régulation des rapports de force afin que les rapports sociaux internationaux et les relations internationales ne soient pas façonnés par le rôle dominant des États-Unis dont la dérive à l'extrême droite est aujourd'hui le principal danger qui pèse sur la planète.
Soyez humains, si vous en êtes encore capables : vous avez la possibilité de stopper le génocide et le nettoyage ethnique du peuple palestinien !
Du futur de la Palestine dépend le futur de notre monde !
SIGNEZ ET FAITES SIGNER
ic.intl.responsibility.palestine@gmail.com
Mireille Fanon Mendes France
Pour la Fondation Frantz Fanon
https://fondation-frantzfanon.com/
https://centenaire.fondation-frantzfanon.com/
Gilbert Achcar
Professeur émérite en relations internationales, SOAS, Université de Londres
Notes
iAxis Rule in Occupied Europe : Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress,
Washington, Carnegie Endowment for International peace, 1944, p. 79
ii Companies Profiting from the Gaza Genocide : https://afsc. org/companies-2023-attack-gaza
iii CIJ, Arrêt Barcelona Traction, Recueil, 1970, § 33. « Erga omnes » means « in relation to everyone ».
iv https://news.un.org/fr/story/2024/03/1144476
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Contre les faiseurs de guerre, construisons le chemin de la paix

52 000 vies palestiniennes détruites par le gouvernement Netanyahou à Gaza, dont 16 000 enfants selon l'UNICEF.
1200 Israéliens tués lors l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, près 600 autres et depuis.
57 otages, dont 34 déclarés morts, toujours retenus dans les tunnels du Hamas dans la Bande de Gaza.
Plus de deux millions de déplacé(e)s de force à Gaza et en Cisjordanie, parfois plusieurs fois.
Signer la pétition cliquez ici
photo Serge D'Ignazio
Après plus de deux mois de blocage de l'aide humanitaire par Israël, la famine s'installe. Face à la mort et à la destruction semée avec le plus grand mépris des vies humaines par le Hamas et la coalition d'extrême droite au pouvoir en Israël, nous devons agir.
Un autre chemin est possible. En Israël et Palestine des milliers de citoyens se mobilisent pour exiger une paix juste et durable pour les deux peuples.
Plus de 1500 réservistes ont signé une lettre ouverte dénonçant la poursuite de la guerre à Gaza. Et nombre d'entre eux refusent de reprendre les armes. D'autres sont objecteurs de conscience et refusent de faire leur service militaire obligatoire.
Le gouvernement israélien tente de faire taire les voix d'opposition de la société civile.
Les Gazaouis protestent également. Ils sont descendus dans les rues par centaines pour dénoncer la responsabilité du Hamas dans la fin du cessez-le-feu avec des slogans forts – « Hamas dehors », « Hamas terroristes » ou encore « Nous ne voulons pas mourir ».
Ces manifestations ont été réprimées de manière brutale et sanglante par le Hamas.
Nous affirmons notre solidarité internationale envers les manifestants palestiniens et israéliens, et notre admiration pour leur courage.
Depuis 2015, Standing Together, mouvement de citoyens juifs et palestiniens d'Israël, se bat quotidiennement, comme nombre d'ONG israéliennes et palestiniennes sur le terrain, contre l'occupation, et pour qu'une solution pacifiste, juste et équitable émerge.
Après le 7 octobre, des “gardes humanitaires” ont été organisées, s'opposant physiquement aux colons israéliens qui bloquaient le passage de camions apportant de l'aide à Gaza. Des campagnes d'affichage pour montrer la réalité de la guerre ont également été menées. Et des manifestations ont lieu toutes les semaines pour s'opposer à la politique meurtrière de Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir.
Ces voix, ainsi que celles d'ONG israélo-palestiniennes, comme Women Wage Peace, Women of the sun, les Combattants pour la paix, et le Cercle des familles endeuillées, doivent être relayées et amplifiées, afin que leurs revendications soient défendues par la communauté internationale, et par la France en particulier.
L'association Les Guerrières de la Paix œuvre également chaque jour sans relâche, sur le terrain, en lien direct avec les activistes de ces ONG pour porter leurs voix.
Comme l'expliquent inlassablement les militants de Standing Together, deux camps s'opposent dans ce conflit, mais ce ne sont pas ceux que l'on nous présente habituellement. En fait, il y a le camp des faiseurs de guerre, composé du gouvernement israélien et du Hamas, et celui de la paix, incarné par les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes, dont de larges secteurs refusent la guerre.
Nous appelons donc le gouvernement français à répondre à leur appel, et à mettre en œuvre au plan international les revendications du camp de la paix :
– Un cessez le feu immédiat dans la bande de Gaza,
– La libération de tous les otages,
– La libération des prisonniers palestiniens détenus arbitrairement,
– La fin de l'occupation, de la colonisation et de la politique d'apartheid, conformément à la résolution de l'ONU du 18 septembre 2024,
– L'opposition à tout projet de nettoyage ethnique,
– Un embargo total et immédiat sur les armes, munitions et composants militaires livrés à Israël,
– L'entrée massive de l'aide humanitaire aux populations civiles,
– La reconnaissance d'un État de Palestine souverain et indépendant,
– L'arrestation de Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et les dirigeants du Hamas afin qu'ils soient jugés par la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'Humanité.
Un “sommet des peuples pour la paix” s'est tenu à Jérusalem les 8 et 9 mai et fut la plus grande convention de paix jamais tentée au Moyen-Orient. Ce doit être l'occasion pour la communauté internationale d'intensifier la pression sur le gouvernement israélien afin qu'il accepte le plan régional pour la paix soutenu par l'Union européenne, les Nations Unies, les chefs de la Ligue arabe et l'Autorité palestinienne.
Seul un plan pour une paix juste et durable, sur la base d'une égalité de droits, permettra aux peuples palestinien et israélien de vivre en sécurité. Contre les faiseurs de guerre, faisons triompher les bâtisseurs de paix.
Suite à la tribune à l'initiative du Réseau d'Actions contre l'Antisémitisme et tous les Racismes (RAAR) publiée le 14 mai 2025 dans le Nouvel obs*, le RAAR lance une pétition nationale pour amplifier et promouvoir plus largement les revendications des voix de la paix en Israël et Palestine :
***
Rédacteur :
Réseau d'Actions contre l'Antisémitisme et tous les Racismes (RAAR)
***
Premiers signataires :
Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis ; Geneviève Garrigos, conseillère de Paris, Pierre Tartakowsky, président d'honneur de la LDH, Marine Tondelier, secrétaire nationale Les Ecologistes-EELV, Raymonde Poncet Monge, sénatrice écologiste du Rhône ; François Sauterey, Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) ; Emma Rafowicz, députée européenne, présidente des Jeunes Socialistes ; Christian Picquet, exécutif national du Parti communiste français ; Raquel Garrido, ancienne députée, fondatrice de L'Après ; Corinne Narassiguin, sénatrice de Seine-Saint-Denis ; Aminata Niakaté, porte-parole Les Ecologistes, conseillère de Paris ; Benjamin Stora, historien ; Dominique Soppo, Président de SOS Racisme ; Fabienne Messica, Ligue des Droits de l'Homme ; David Belliard, candidat écologiste à la Mairie de Paris ; Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris ; Karim Ziady, conseiller de Paris délégué ; Sophie Wahnich, directrice de recherche CNRS ; Kader Chibane, président du Pôle Ecologiste Région IDF ; Annie Lahmer, conseillère régionale IDF ; Frédérique Reibell, membre du Raar ; Rachel Lefevre, avocate et membre du Raar ; Lisa Hazan, étudiante et écrivaine ; Aurélien Taravella, conseiller départemental Place publique (31) ; Leila Kennouda, Génération.s 46 ; François Béchieau, secrétaire national du Mouvement des Progressistes, conseiller de Paris ; Gérard Delahaye, CGT UD Paris, collectif confédéral travailleurs migrants, conseil d'administration de la fondation Copernic ; Rosa Bursztein, humoriste ; Natacha Chetcuti-Osorovitz, sociologue ; Philippe Marlière, politiste ; Albert Herszkowicz, membre du Raar ; Philippe Corcuff, professeur des universités en science politique à Sciences-Po Lyon ; Sara Horchani, fondatrice de l'association Libertés-Culture et artiste ; Alain Policar, politiste ; Mohamed-Nour Hayed, écrivain, poète et conférencier franco-syrien ; Claudie Bassi, présidente du MRJ-MOI ; Liliane Turkel, vice-présidente de MRJ-MOI ; Benjamin Bibas, journaliste ; Emmanuel Revah, humoriste, membre du Raar ; Diane Richard, militante féministe ; Paul Lévy, membre du Raar ; Thérèse Filippi, membre du Raar ; Jan Feigenbaum, bibliothécaire militant à Pantin solidaire, à SUD-CT et à la FSU ; Martine Leibovici, membre du Raar ; Lorenzo Leschi, Collectif Golem ; Dan Zisso, Défendre la Démocratie israélienne (membre de la coordination), Jcall et La Paix maintenant ; Ludovic Arberet, syndicaliste ; Zéphyr Isard, cosecrétaire des Jeunes Ecologistes Midi-Pyrénées ; Wassim Allouka, Belgian Friends of Standing Together ; Sylvie Cohen, Amis de Standing Together en France ; Gérard Lévy, conseiller municipal aux Clayes, conseiller communautaire SQY78 ; Gaspard Ringelheim, étudiant ; Aurélien Ringelheim, comédien ; Fouad Benyekhlef, militant associatif (Belgique) ; Sophie Bournazel, syndicaliste CNT ; Aurélie Brenta, Amis de Standing Together ; Marianne de Brunhoff, Amis de Standing Together en France ; David Desmartis, membre du Raar ; Sharon Geczynski, socio-anthropologue ; Mohamed Ghili, Mouvements des progressistes ; Renaud Barne, Belgian Friends of Standing Together ; Lucie Cariès, réalisatrice ; Léo Lévy-Lajeunesse, membre du Raar ; Hélène Henry, militante de la LDH (section-régional-comité national) ; Eva Hadas-Lebel, Les Amis de Standing Together France ; Laure Vermeersch, cinéaste ; Sender Vizel, dessinateur ; Héloïse Godet, actrice, autrice ; Celine Benzekry, retraitée ; Grégory Benzekry, musicien (Dubamix) et syndicaliste ; Martine Lalande, Syndicat de la Médecine générale ; Francis Kandel, Amis de Standing Together en France ; Paule Ouanhnon, EELV ; Julie Palkowski-Amimeur, Amis of Standing Together ; Aurélie Pavis, militante du Raar ; Pierre Philibert, LDH ; Sarah Pinto, professeure ; Nenad Rabrenovic, musicien ; Thibault Moers, enseignant ; Cécile Moscovitz, journaliste ; Andreas Motsch, professeur agrégé, université de Toronto ; Denis Renard, PCF ; Jean-Loup Kastler, conseiller municipal Ferney-Voltaire ; Yoram Krakowski, psychologue ; Antoine Malamoud, L'Après ; Catherine Markstein, Amis de Standing Together ; Rosita Winkler, retraitée, Amis de Standing Together ; Clothilde Ménard, professeure ; Harsh Kapoor ; Yaël Aberdam ; Ben Assor, hôtelier ; Fatima Bendahmane ; Ylhem Benhacene, EELV ; Bernard Bloch ; Charles Bouhanna ; Danielle Bouhanna ; Véronique Bover, culture ; Julien Chanet, membre du Raar ; Jacques Chastrusse, retraité ; Claire Chastrusse ; Frédéric Chastrusse, ingénieur ; Théo Ferroni ; Véronique Friocourt, tech ; Nicole Garosi, membre du Raar ; Estelle Gauron ; Déborah Gol ; Nathan Hancart, université d'Oslo ; Ka In 't Zandt, psychologue ; Hugues Joscaud, retraité ; Maria Kakogianni ; Laetitia Kramarz ; Elise Levy ; Muriel Lutz, bénévole ; Clémence Miellet ; Sandra Naranjo, société civile ; Tù-Tâm Nguyen, bibliothécaire médicale ; Jean-Pierre Rafier ; Simon Rakovsky ; Nadine Raquillet, retraitée ; Romain Roussel ; Lila Routier Dalnoky ; Catherine Saltiel, retraitée ; Julie Samit ; Jérôme Sclafer, médecin ; Anne-Marie Simonpoli, médecin ; Lea Sitbon ; Myriam Suchet ; Shana Weber ; Bastien Zaouche, musicien ; Michèle Zmirou ; Emmanuel Gottlob ; Françoise Balais, attachée culturelle ; Julia Leschi, travailleuse ; Robert Hirsch, membre du Raar ; Daniel Aptekier-Gielibter, membre du RAAR,UJRE ; Johanna Cincinatis, Journaliste ; Lucas Pisano, Étudiant ; Philippe Sultan Copernic ; Alice Timsit, Conseillère de Paris ; Éric Audrain, membre du RAAR, Syndicaliste ; Patrick Vergain, LDH ; David Quesemand, Cinéaste ; Jean-Pierre Fournier, enseignant ; Dominique David, Retraité ; Denis MARX, militant associatif Lyon ; Janette Habel, Politologue ; Sarah Raquillet, Ergothérapeute.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Israël accélère son plan pour prendre « tout le contrôle » de la bande de Gaza

Pour ne pas perdre le soutien international, le premier ministre Benyamin Nétanyahou annonce parallèlement une reprise minimale de l'aide humanitaire dans l'enclave assiégée et affamée. Son objectif reste la réoccupation de Gaza et le nettoyage ethnique. Le Canada, la France et le Royaume-Uni disent lundi soir s'opposer « fermement à l'extension des opérations militaires israéliennes à Gaza ».
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
19 mai 2025
Par Rachida El Azzouzi
« Nos meilleurs amis dans le monde – des sénateurs que je connais comme de fervents partisans d'Israël – ont prévenu qu'ils ne pourraient pas nous soutenir si des images de famine massive apparaissaient […]. Nous devons éviter la famine tant pour des raisons pratiques que diplomatiques. Sans soutien international, nous ne pourrons pas mener à bien notre mission victorieuse. »
Ce message a été diffusé par le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, qui cède ainsi aux pressions de ses plus précieux soutiens, notamment les États-Unis, pour mieux atteindre ses objectifs : dérouler son plan dévoilé le 5 mai, qui passe par la prise de contrôle « de tout le territoire » de la bande de Gaza, et le déplacement de la plupart de ses 2,4 millions d'habitant·es vers l'extrême sud du territoire. Ni plus ni moins qu'une annexion, et un nettoyage ethnique, en violation flagrante du droit international, allègrement bafoué depuis plus d'un an et demi par le gouvernement le plus extrémiste de l'histoire d'Israël.
Dans une vidéo publiée sur son compte Telegram, Nétanyahou a confirmé lundi 19 mai son feu vert de la veille : il a autorisé « une aide humanitaire minimale – nourriture et médicaments uniquement – » pour ne pas perdre le soutien international, alors qu'une famine généralisée menace Gaza après près de trois mois du plus long blocus qu'ait connu l'enclave, où l'armée israélienne intensifie depuis ce week-end sa guerre génocidaire. Depuis le 2 mars, plus rien n'entre dans le territoire anéanti et affamé. Tout est bloqué : l'aide humanitaire, les médicaments, le carburant, la nourriture.
« Nous sommes engagés dans des combats intenses et de grande ampleur à Gaza, et nous progressons », a déclaré Benyamin Nétanyahou, promettant « d'agir de manière à ce que personne ne puisse […] arrêter [Israël] ». Le ministre des finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a appuyé ses déclarations, affirmant qu'Israël « détruisait tout ce qu'il reste de la bande de Gaza » et que « l'armée ne ménageait aucun effort ». Il a ajouté : « Nous conquérons, purifions et restons à Gaza jusqu'à la destruction du Hamas. »
Depuis la reprise des attaques israéliennes sur Gaza le 18 mars et la rupture d'un cessez-le-feu de deux mois, « la situation est pire que jamais », témoigne auprès de Mediapart un travailleur humanitaire palestinien par messagerie WhatsApp. « Plusieurs enfants sont morts de malnutrition, tandis que beaucoup d'autres sont toujours hospitalisés pour recevoir des soins. Nous subissons actuellement des pénuries alimentaires et des prix exorbitants. »
La litanie macabre du bilan quotidien des bombardements israéliens qui tuent ou mutilent la population s'élève ces derniers jours à plusieurs centaines de victimes, dont des dizaines d'enfants. Au total, au moins 53 339 personnes ont été tuées à Gaza, en majorité des civils, selon les dernières données du ministère de la santé à Gaza.
Ordres d'évacuation
Les personnalités politiques israéliennes les plus fanatiques s'en frottent les mains, à l'image du député Zvi Sukkot, qui s'enorgueillissait vendredi 16 mai, dans une émission de débat à la télévision israélienne, et alors que des dizaines de Palestinien·nes avaient été tué·es la veille au soir : « Tout le monde s'est habitué à ce que l'on puisse tuer 100 Gazaouis en une nuit, en temps de guerre, et tout le monde s'en fiche. »
Lundi 19 mai, au lendemain d'un week-end meurtrier, la défense civile de Gaza a annoncé la mort de plus d'une vingtaine de personnes dans des bombardements à Khan Younès, notamment autour de l'hôpital Nasser, au sud du territoire (les hôpitaux demeurent des cibles). C'est dans ce gouvernorat notamment qu'Israël entend en partie déployer son opération militaire de grande ampleur pour réoccuper le territoire et instaurer une présence durable, baptisée « Chariots de Gédéon », en référence au personnage biblique.
L'armée israélienne a ainsi appelé lundi 19 mai au matin des habitant·es de l'enclave à évacuer divers secteurs du sud de la bande de Gaza. « À l'attention des habitants du gouvernorat de Khan Younès, Bani Suheila et Abasan : l'armée de défense israélienne va lancer une offensive sans précédent pour détruire les capacités des organisations terroristes dans cette zone. Vous devez évacuer immédiatement vers l'ouest », a écrit en arabe Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne sur Telegram. « À partir de maintenant, le gouvernorat de Khan Younès est considéré comme une zone de combat dangereuse », a-t-il ajouté.
Parallèlement, Israël mène des pourparlers indirects, qui n'ont guère de chances d'aboutir, pour un cessez-le-feu avec le Hamas.
Lundi soir, dans un communiqué transmis par l'Élysée, la France, le Royaume-Uni et le Canada ont haussé le ton face à la politique israélienne. Les quatre pays disent s'opposer « fermement à l'extension des opérations militaires israéliennes à Gaza » et jugent « le niveau de souffrance humaine à Gaza intolérable ». « Nous demandons au gouvernement israélien d'arrêter ses opérations militaires à Gaza et d'autoriser immédiatement l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza », déclarent les trois pays.
« Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Nétanyahou poursuit ces actions scandaleuses. Si Israël ne met pas fin à la nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l'aide humanitaire, nous prendrons d'autres mesures concrètes en réponse », ajoute le texte, qui se conclut par la réaffirmation de leur détermination « à reconnaître un État palestinien ».
Les ONG court-circuitées
L'incertitude demeure totale quant à la reprise très limitée de l'aide humanitaire et à ses modalités de distribution, alors que les ONG alertent toutes depuis des semaines sur le risque de « famine de masse », et que le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a de nouveau sonné l'alarme lundi, à l'ouverture de la réunion annuelle des États membres de l'organisation à Genève.
La diplomatie israélienne a annoncé lundi 19 mai que des camions transportant de la nourriture pour bébé allaient être autorisés à passer et que, « dans les jours à venir, Israël [faciliterait] l'entrée de dizaines de camions d'aide ». Mais aucune date précise n'a été donnée. Le bureau des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations unies (Ocha) a confirmé « être en pourparlers avec les autorités israéliennes sur la façon dont cela se déroulerait compte tenu des conditions sur le terrain ».
Des sources évoquent une trentaine de camions, ce qui est dérisoire au vu des besoins humanitaires immenses dans l'enclave, et alors que des tonnes de nourriture sont bloquées à la frontière.
Le ministre des finances suprémaciste, Bezalel Smotrich, a, de son côté, réaffirmé qu'une entreprise civile américaine commencerait bientôt à distribuer une « aide minimale » à Gaza directement aux civils, sans passer par le Hamas. « Pas un seul grain n'atteindra le Hamas ni ne mettra en danger nos soldats », a-t-il déclaré.
Smotrich fait référence à la très controversée Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Enregistrée à Genève (Suisse) au début de l'année 2025 et fondée par les États-Unis, principaux alliés militaires d'Israël, elle inquiète les ONG, qui doutent de son impartialité. Aux contours encore flous, cette structure vise à court-circuiter les organisations humanitaires traditionnelles, avec le soutien de l'administration américaine et grâce à des accords privilégiés avec les autorités israéliennes. Elle a annoncé mi-mai qu'elle entendait commencer à distribuer de l'aide dans la bande de Gaza assiégée d'ici la fin du mois.
Dans un message posté sur Telegram, le ministre de la sécurité nationale, autre figure de l'extrême droite israélienne, Itamar Ben Gvir, qui permet à Nétanyahou de se maintenir au pouvoir, a dénoncé la reprise de l'aide humanitaire, une « décision prise […] dans l'urgence », qui est une « grave erreur » et qui donnera « de l'oxygène » au Hamas. Smotrich lui a répondu indirectement en l'accusant de « mélange de populisme de la part de quelqu'un qui cherche toujours à être plus à droite que la droite »…
Vingt-deux pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et l'Australie, ont exigé lundi d'Israël une « reprise complète de l'aide à la bande de Gaza, immédiatement », demandant qu'elle soit organisée par les Nations unies et les ONG. L'ONU et les organisations humanitaires « ne peuvent pas soutenir » le nouveau modèle pour la livraison de l'aide à ce territoire palestinien décidé par le gouvernement israélien, ont écrit les services diplomatiques de ces pays dans une déclaration commune transmise à l'AFP par le ministère allemand des affaires étrangères.
Rachida El Azzouzi
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












