Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

28 septembre : Journée internationale de l’avortement sécurisé

Au Québec, toutes les régions ne sont pas toutes desservies de la même façon en matière d'accès à l'avortement. De plus, l'accès s'avère encore plus restreint pour les personnes sans couverture de la RAMQ, du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) ou d'assurances privées.
Ce n'est pas en prohibant ou en limitant le droit à l'avortement que l'on empêche toute procédure d'interruption de grossesse. Ainsi, le manque d'accès à un avortement sécurisé dans le monde met à risque la santé des femmes.
Ici, au Québec, toutes les régions ne sont pas toutes desservies de la même façon en matière d'accès à l'avortement. De plus, l'accès s'avère encore plus restreint pour les personnes sans couverture de la Régie d'assurance-maladie du Québec (RAMQ), du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) ou d'assurances privées. Ces personnes peuvent être des étudiantes internationales, des travailleuses avec un permis de travail temporaire, des personnes sans statut, etc.
Ces femmes n'ont pas non plus accès à des soins gynéco-obstétricaux de base (contraception, test Pap, dépistage de maladies transmises sexuellement, soins de grossesse, planification familiale). Les coûts des interruptions volontaires de grossesse (IVG) de premier trimestre peuvent atteindre tout près de 500 $. Les délais nécessaires pour amasser des fonds peuvent souvent retarder l'intervention. Les montants peuvent s'élever à plusieurs milliers de dollars si l'interruption s'effectue au cours des 2e et 3e trimestres.
Pour leur venir en aide, la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) coordonne un fonds de dépannage afin de couvrir ces frais. Profitons de cette Journée internationale de l'avortement sécurisé pour faire un don : https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/18811d1f-3087-496c-a7f2-c6b2274ee894
La Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) est un regroupement féministe de défense de droits et d'éducation populaire en matière de santé sexuelle et reproductive.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pourquoi tenir une Journée nationale des centres de femmes du Québec ?

Les centres de femmes jouent un rôle essentiel dans nos communautés. Ils offrent un espace sécuritaire où les femmes peuvent se rassembler, partager leurs expériences, et trouver du soutien. Ces lieux sont des endroits pour que les femmes prennent du pouvoir sur leur vie par l'éducation populaire autonome et la défense de leurs droits.
D'où l'importance de tenir annuellement notre Journée nationale des centres de femmes du Québec.
Le 1er octobre, cette journée nationale dédiée aux centres de femmes du Québec permettra de reconnaître à l'échelle de la province l'immense contribution de ces centres à notre société.
Ils sont souvent à l'avant-garde des luttes pour l'égalité, offrant des services variés.
Cette journée est aussi l'occasion de sensibiliser le public et les décideurs politiques aux enjeux qui touchent les femmes.
Joignez-vous à nous pour célébrer et soutenir les centres de femmes du Québec ! Ensemble, continuons à bâtir une communauté plus forte et plus juste.
Trouvez ici le centre de femmes le plus près de chez vous !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une plateforme de référence sur le contrôle coercitif voit le jour

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale dévoile une nouvelle plateforme web qui vise à vulgariser auprès du grand public et de professionnel.le.s la notion de contrôle coercitif, alors même que celui-ci pourrait devenir une infraction criminelle sous peu.
« Parler de contrôle coercitif permet de nombreuses prises de conscience, notamment vis-à-vis de formes plus subtiles de violence, autant chez les victimes que chez les proches et les professionnel.le.s qui les entourent. Mieux connaître le contrôle coercitif et le risque qu'il représente, c'est se donner les moyens, collectivement, d'agir face à la violence conjugale bien plus tôt dans la trajectoire des victimes, et bien avant que le pire arrive. » explique Annick Brazeau, présidente du Regroupement.
Des outils et des histoires pour comprendre, repérer et agir face au contrôle coercitif
Cette plateforme novatrice – controlecoercitif.ca – propose des contenus vulgarisés et personnalisés, selon les publics. Face au défi de faire comprendre un terme nouveau et méconnu, le Regroupement a choisi de proposer plusieurs façons de l'explorer.
La visite commence par une expérience interactive qui met en scène des récits de femmes – écrits et audio – inspirés de faits vécus. Le site web propose de plonger dans le coeur du contenu via une bibliothèque, dans laquelle il est possible de trier les articles et les outils grâce à des filtres, ou via trois parcours guidés – Comprendre, Repérer, Agir – qui suggèrent un fil de lectures. D'autres utilisatrices ou utilisateurs pourront choisir de passer par la foire aux questions pour s'initier à la notion de contrôle coercitif.
Le site web, en français pour l'instant, sera accessible en anglais dans quelques semaines et sera bonifié avec le temps avec de nouveaux contenus, notamment vidéos.
Un contexte politique et social favorable
Un projet de loi d'initiative parlementaire (C-332) visant à criminaliser le contrôle coercitif a franchi plusieurs étapes décisives dans les derniers mois. Après avoir été adopté à l'unanimité par la Chambre des Communes en juin 2024, il est désormais étudié par le Sénat en deuxième lecture depuis le 17 septembre dernier.
Dans le sillon de plusieurs autres pays avant lui, le Canada pourrait devenir la 5e nation à faire du contrôle coercitif une infraction criminelle.
« Au contact des plus de 6000 professionnel.le.s que nous avons formés, nous avons été témoins du pouvoir transformateur qu'amène la notion de contrôle coercitif. Si une telle loi entrait en vigueur, il serait d'autant plus nécessaire de faire connaitre au plus grand nombre ce qu'est le contrôle coercitif, partout à travers le Canada » souligne Karine Barrette, avocate et chargée du projet Améliorer la pratique judiciaire au Regroupement.
La nouvelle plateforme annoncée aujourd'hui est une modeste contribution aux efforts de grande envergure qui devront être menés au Québec et au Canada pour que les victimes reconnaissent le contrôle coercitif et pour que les professionnel.le.s et les proches qui les entourent le détectent et puissent agir en conséquence.
Qu'est-ce que le contrôle coercitif ?
– Le contrôle coercitif, c'est une nouvelle paire de lunettes pour voir au-delà de la violence visible et des incidents isolés.
– Le contrôle coercitif désigne une série de stratégies utilisées par un partenaire ou un ex-partenaire pour isoler, contrôler, terroriser sa victime et la priver de liberté, petit à petit.
– C'est une prise de contrôle discrète et progressive de la femme victime par le partenaire, qui n'exerce pas forcément de violence physique.
Consultez la plateforme au controlecoercitif.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La marche mondiale des femmes : une force féministe pour transformer le monde !

En 2023, nous avons célébré le 25ème anniversaire de la première Rencontre Internationale de la Marche mondiale des femmes, notre mouvement d'action féministe qui a vu le jour en octobre 1998 à Montréal, au Québec.
tiré de Entre les lignes et les mots
Nous sommes devenues un mouvement social international-féministe, anticapitaliste et anti-impérialiste enraciné dans les luttes et contextes locaux, lié à la lutte des classes. Nous sommes aujourd'hui organisées en coordinations nationales dans 61 pays.
Nos valeurs et actions visent un changement politique, économique et social pour une transformation radicale du monde. Ces valeurs sont axées sur la mondialisation de la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples, le respect et la reconnaissance de la diversité entre les femmes et la force des alliances entre les femmes et avec d'autres mouvements sociaux progressistes.
Aujourd'hui, l'avancée de nouvelles formes de colonialisme, de racisme, de misogynie, d'accumulation par dépossession et les impacts du changement climatique nous obligent à développer de nouvelles formes de résistance et à forger des alternatives en mesure de soutenir les luttes des femmes et les possibilités de solutions transformatrices.
Lors de la 13ème Rencontre Internationale en 2023, quatre domaines d'action ont émergé, inspirés par les luttes locales des femmes, autour desquels la MMF entend approfondir son analyse et renforcer son action jusqu'en 2025 :
– La défense des biens communs contre les entreprises transnationales
– L'économie féministe basée sur la viabilité de la vie et la souveraineté alimentaire
– L'autonomie au regard du corps et de la sexualité
– La paix et la démilitarisation
Nous œuvrons pour renforcer l'analyse, les pratiques et les secteurs du mouvement féministe en vue d'un changement structurel, de l'égalité et de l'autonomie réelles de toutes les femmes.
Tous les cinq ans, une action internationale de la Marche mondiale des femmes nous appelle et nous mobilise toutes, reliant nos processus d'organisation et nos luttes au niveau local à la force mondiale du féminisme en mouvement.
Les actions internationales sont des moments de construction et d'expression de notre synthèse politique, lorsque nous présentons nos dénonciations et nos propositions articulées aux niveaux local, régional et international. Notre résistance avance avec nos propositions et nos pratiques de construction de la force, d'auto-organisation des femmes, du féminisme comme axe d'alternatives systémiques.
En 2025, du 8 mars au 1 octobre, nous marcherons dans le monde entier contre les guerres et le capitalisme et pour le « buen-vivir » et la souveraineté de nos corps et de nos territoires.
La 6ème Action Internationale débutera au Sahara Occidental le 8 mars avec des marches et des actions simultanées dans le monde entier et se terminera par un rassemblement international au Népal le 17 octobre.
Nous lions notre lutte contre les sociétés transnationales à la lutte pour la justice sociale en organisant une semaine, laquelle débutera le 24 avril, lors de la journée de solidarité féministe contre les sociétés transnationales, et s'achèvera le 1er mai.
Rejoignez la Marche mondiale des femmes
Vous êtes un groupe de femmes ou un comité de femmes dans un groupe mixte et souhaitez rejoindre à la Marche mondiale des femmes ? Vous pouvez contacter le
Secrétariat international de la Marche mondiale des femmes.
Kızılırmak Cad. No:13/8 Kavaklıdere 06420 – Ankara – Turquie
Tél : +90 533 138 60 73
Courriel : info@marchemondiale.org
Site Web : www.marchemondiale.org
NOUS RÉSISTONS POUR VIVRE,
NOUS MARCHONS POUR TRANSFORMER !
Télécharger le document :WORLD-MARCH-OF-WOMEN-fr
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Projet de loi n°69 : Le gouvernement doit faire les choses dans l’ordre selon des groupes de la société civile

Au lendemain de la fin des consultations particulières sur le projet de loi n°69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, des groupes issus de la société civile réitèrent leur demande de suspendre les procédures parlementaires sur ce projet de loi et de le réviser de fond en comble, après un véritable débat public large sur l'énergie effectué dans le cadre d'une commission indépendante et lors de laquelle l'ensemble des voix de la société québécoise auront été entendues.
Ce débat public, réclamé de toutes parts depuis près de deux ans par de nombreux groupes et spécialistes, devrait constituer le socle sur lequel plusieurs scénarios de plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) devront être élaborés et débattus en misant sur une approche systémique plutôt qu'une approche en silo. Ces scénarios devraient notamment inclure :
– l'identification des véritables besoins en énergie pour réussir la décarbonation complète du Québec ;
– les multiples impacts de la production d'énergie sur le territoire ;
– les différents usages possibles de l'énergie ;
– les mesures garantissant l'accès aux services énergétiques et un niveau de vie décent pour toutes et tous, en conservant les tarifs d'électricité à un niveau accessible pour les ménages à faible revenu pour répondre à leurs besoins essentiels ;
– les options liées à la sobriété, la réduction de la demande, à l'efficacité énergétique et aux sources d'énergies renouvelables.
Ces scénarios devraient être débattus au sein d'une institution indépendante du gouvernement. Les groupes réitèrent leur offre de collaboration à cet égard.
Les groupes sont également préoccupés par les éléments suivants :
Le projet de loi ne permettra pas la décarbonation du Québec et la protection du territoire. Si le présent est garant de l'avenir, rien ne permet de croire que l'avalanche de nouvelle puissance bénéficierait nécessairement aux entreprises existantes qui veulent verdir leurs opérations et à qui on refuse les quelques mégawatts nécessaires, comme les Forges de Sorel. Le PL-69 favorise plutôt de nouveaux projets industriels, souvent initiés par des multinationales ayant peu ou même rien à voir avec la décarbonation.
Des impacts importants sur les tarifs. L'ajout massif de capacités électriques favorisé par le PL-69 ferait inévitablement augmenter les tarifs résidentiels et commerciaux, puisque les nouvelles infrastructures coûtent beaucoup plus cher que les capacités existantes et que le gouvernement cherche à appâter les industries avec une électricité à rabais. Les commerces et les ménages, surtout les moins nantis, assumeraient ainsi une part disproportionnée des coûts de la transition.
Un projet de privatisation. Sous le prétexte d'accélérer l'ajout de capacités énergétiques sans preuve à l'appui, le PL-69 ouvrirait des brèches béantes dans le caractère public du secteur électrique québécois, et ce, sans l'aval de la population. En 1962, nous avons collectivement rejeté la mainmise du privé sur l'électricité lors d'une élection référendaire qui a façonné le Québec d'aujourd'hui. De la même façon, nos décisions d'aujourd'hui façonnent le Québec de demain.
Un projet de loi qui ne priorise pas la sobriété énergétique, bien que cela permette de minimiser la construction de nouvelles infrastructures et ainsi contrôler les coûts de production, l'impact tarifaire et les impacts sur le territoire.
Pour toutes ces raisons, nous demandons au gouvernement de mettre le PL-69 de côté, le temps d'élaborer collectivement une politique énergétique et un PGIRE, un outil demandé depuis longtemps par les groupes, qui exprimera clairement la volonté de la population quant à son avenir. Les groupes insistent sur la nécessité que cette politique énergétique et ce PGIRE soient adoptés à la suite d' un véritable débat public – volonté qu'il sera ensuite possible d'enchâsser dans une loi qui serait le fruit d'un véritable processus démocratique.
Signataires
Mélanie Busby, Front commun pour la transition énergétique
Bruno Detuncq, Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ)
Émilie Laurin-Dansereau, ACEF du Nord de Montréal
Maxime Dorais, Union des consommateurs
Michel Jetté, GroupMobilisation (GMob)
Alice-Anne Simard, Nature Québec
Patricia Clermont, Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)
Charles-Edouard Têtu, Équiterre
Jacque Lebleu, Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville
Shirley Barnea, Pour le futur Montréal
Patrick Bonin, Greenpeace Canada
Jean-François Lefebvre, Imagine Lachine-Est
Andréanne Brazeau, Fondation David Suzuki
André Bélanger, Fondation Rivières
Arnaud Theurillat-Cloutier, Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique (TJC)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
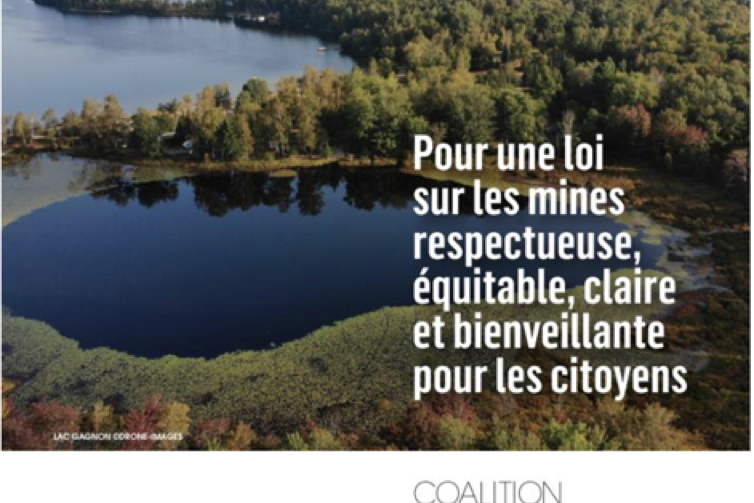
Mémoire de la Coalition QLAIM dans le cadre des travaux entourant le projet de loi 63 pour une loi des mines respectueuse, claire et bienveillante pour les citoyens
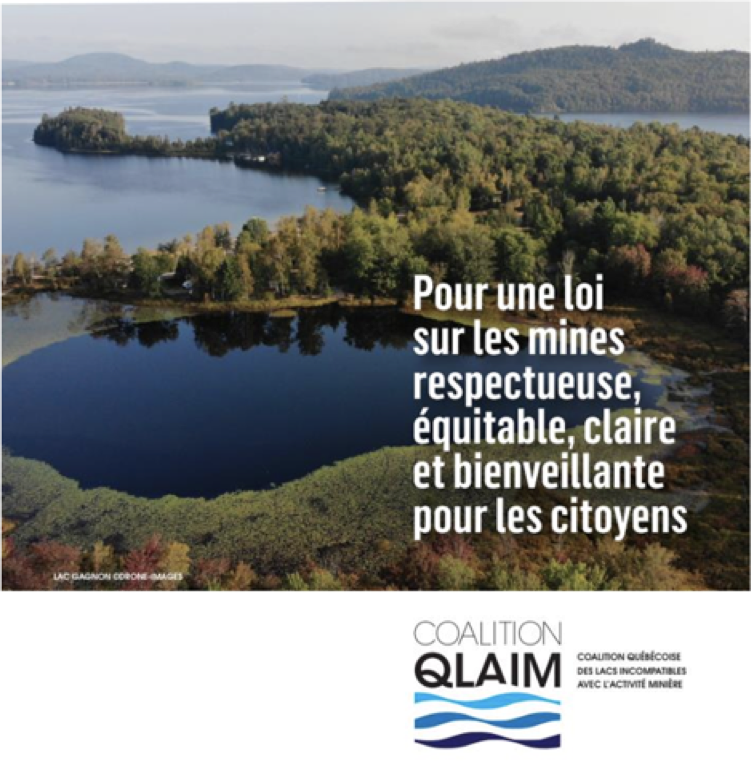
Une nouvelle coalition regroupant de nombreuses associations de protection des lacs du Québec voit le jour le 23 janvier 2023 : la Coalition québécoise des lacs incompatibles avec l'activité minière, ou la Coalition QLAIM. La demande mondiale pour les minéraux a explosé et plusieurs régions du Québec vivaient un boom de claims miniers sans précédent. Cette création de la Coalition QLAIM survient à l'occasion du Forum – Intégration des activités minières : acceptabilité sociale et cohabitation organisé par l'Union des municipalités du Québec, ce même janvier 2023. Au 25 septembre, en date de cette commission parlementaire, la Coalition compte quelque 150 membres, provenant de plusieurs régions du Québec, notamment de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie.
La Coalition QLAIM est portée par un vaste mouvement citoyen qui trouve aberrant que des entreprises privées obtiennent un titre minier (claim) lui donnant accès au sous-sol sans que les élus locaux aient pris part à la décision. La Coalition est aussi membre actif de la Coalition Québec meilleure mine (QMM) et endosse son action ainsi que son mémoire. Notre mémoire met particulièrement en lumière les enjeux de la loi qui favorise les conflits d'usage entre l'industrie minière et les communautés, notamment celles qui ont des économies florissantes pouvant être affectées négativement par l'industrie minière.
Des lacs et un mode de vie à protéger
À notre avis, la Loi sur les mines fait la démonstration d'une absence de démocratie dans la gestion sur le précieux territoire public québécois, puisqu'un claim est octroyé automatiquement sans dialogue, sans respect des communautés locales et des peuples autochtones. La Coalition QLAIM incarne un mouvement citoyen attaché au territoire, attaché à un mode de vie grandissant, celui de vivre en permanence en toute quiétude entre lacs et rivières. Ces citoyens bénéficient déjà d'une économie équilibrée avec la nature. Nous désirons protéger ces droits de pouvoir habiter dans ces régions que nous considérons incompatibles avec l'activité minière. Pour ce que nous sommes et ce que nous portons, la Coalition QLAIM s'est donc donnée pour mission de contribuer à changer les lois actuelles afin de non seulement protéger les lacs du Québec de l'activité minière et les populations qui en dépendent, mais aussi de convaincre l'État québécois d'accorder plus de considération envers les contribuables et les élus de ces régions.
Le pouvoir du nombre, le pouvoir de l'attachement territorial La Coalition QLAIM est un mouvement bénévole aux ressources financières très limitées, mais pourvu de ressources plus importantes : des humains attachés à leurs territoires qui souhaitent influencer le gouvernement pour que l'industrie minière ne vienne pas altérer le territoire où ils vivent depuis des générations. La Coalition QLAIM représente un pouvoir alternatif : le pouvoir des électeurs. Les entreprises minières ne votent pas, et elles ont suffisamment de ressources pour se représenter elles-mêmes sans l'aide du gouvernement. Aucune ressource publique pour les aider à nous convaincre des bienfaits communautaires de cette industrie n'est justifiable. Le gouvernement du Québec doit mettre autant sinon plus d'écoute du côté de ses électeurs que du côté des lobbyistes, et seulement ainsi le développement minier pourrait être harmonieux. Il est indispensable de planifier le territoire en collaboration avec les gouvernements locaux, plutôt que d'autoriser des projets sans demander l'opinion des élus, sinon à la toute fin et trop tard. L'activité minière pourrait être harmonieuse dans ces conditions, mais le Projet de loi n° 63 ne prend pas cette direction. Les aspirations sociales, écologiques et économiques changent : nos institutions doivent s'adapter.
Section 2 : Notre exposé général
Une loi qui évite l'essentiel
Depuis la formation de notre coalition, nous avons lu et étudié plusieurs documents portant sur le cadre légal et sur la pratique de développement minier au Québec. Nous avons aussi participé aux rencontres en ligne et avons soumis plusieurs mémoires lors de la consultation de 2023 du ministère des Ressources naturelles et des Forêts et de la ministre responsable Maïté Blanchette Vézina, intitulée Démarche participative sur un développement harmonieux de l'activité minière. Nous l'avons fait avec toute l'énergie bénévole de notre mouvement dans le seul espoir de faire comprendre que du développement minier harmonieux, c'est impossible sans un véritable pouvoir pour les MRC dans la gestion du territoire public à partir de la demande d'un titre d'exploration jusqu'à la fermeture d'un projet minier.
C'est avec enthousiasme que nous avons donc pris le temps de lire le projet de loi n° 63 modifiant la Loi sur les mines et d'autres dispositions afin de voir si nos préoccupations ont été entendues et nos recommandations intégrées.
Ce projet de loi s'est attaqué aux lieux de consensus évidents, soit la spéculation sur le territoire public et l'exclusion de l'exploration sur les terres privées. De plus, de nouveaux pouvoirs, qui restent à être précisés, sont accordés au ministre pour considérer les enjeux de consentement des peuples autochtones et d'acceptabilité sociale des communautés. Les lieux de dissension, donc les véritables zones de réformes, n'ont pas été investis, notamment celui de partager le pouvoir décisionnel de l'État - soit la province québécoise - avec les peuples autochtones, les MRC, les élus locaux et les citoyens qui demeurent profondément attachés à ces territoires.
Sans respect et équité, pas de développement harmonieux
Dans sa forme actuelle, nous sommes convaincus que le projet de loi n° 63 ne permettra pas un développement harmonieux sur le territoire car, pour l'activité minière sur le territoire public, il n'y a pas de changement dans le régime minier, si ce n'est que de retirer des pouvoirs aux citoyens qui pouvaient acheter des claims pour protéger leurs lacs et rivières. En retirant ce pouvoir, nous nous attendions à ce que le gouvernement comprenne que les citoyens réclament d'avoir un mot à dire sur l'utilisation du territoire public souvent derrière chez eux. Nous vous rappelons que les territoires publics forment plus de 92% du territoire et qu'ils ne sont pas gérés par des élus locaux. C'est beaucoup de territoires sans démocratie !
La loi doit absolument répondre au besoin de décentralisation des pouvoirs vers les MRC, décentralisation que demande un développement minier harmonieux. Les MRC maîtrisent plus le territoire et l'élection des élus locaux est beaucoup plus en phase avec les aspirations locales. Pour nous, c'est une question de respect.
Bien que nous reconnaissions certaines améliorations à la loi, il en demeure que celles-ci ne touchent pas au fond du problème. Trop de droits pour les entreprises minières et trop peu pour les citoyens.
Nous réclamons de l'équité. Les municipalités et les citoyens nécessitent eux aussi de l'aide lorsqu'une entreprise minière cherche à s'établir dans leur communauté. Il faut prévoir un fond de soutien aux communautés durant l'ensemble des étapes d'un développement minier, notamment pour l'accès aux connaissances et pour assurer une démocratie publique, pas privatisée par les promoteurs.
Sans pouvoirs aux MRC, pas de développement harmonieux
Si le citoyen n'arrive plus à acheter des claims comme moyen de protéger son arrière-pays, quels outils le gouvernement du Québec donnera-t-il en échange pour atteindre son dit développement harmonieux ? En lui enlevant cette seule manière de se prémunir contre le développement minier, la loi doit redonner des outils de protection où il a une voix au chapitre de l'élaboration d'un projet affectant le territoire public derrière ou autour de sa maison, son village, sa communauté. En ce moment, le seul outil qu'il reste aux citoyens pour avoir accès à leurs arrière-pays sans exploitation minière et forestière est l'aire protégée. C'est une manière très aménagiste de voir le monde et, surtout, très conflictuelle.
À quel moment au Québec les citoyens pourront-ils véritablement contribuer à la planification locale de leur territoire public et avoir préséance sur des entreprises privées qui sont plus consultées qu'eux ? Au-delà de réserver le territoire aux entreprises forestières et minières, ou de les mettre sous cloche de verre pour de la conservation, nous, les citoyens, pouvons-nous développer notre territoire public sans mines ? Il y aurait ces Tables régionales de gestion intégrée des ressources et du territoire public qui, aux dires de plusieurs, sont des instances peu porteuses qui diluent, encore, le pouvoir des MRC et, encore plus, celui des peuples autochtones. Qu'estce qu'une entreprise privée fait dans des lieux de concertation qui ne la concerne pas ? N'est-ce pas aux citoyens de décider d'abord et aux compagnies privées de s'adapter aux décisions politiques et culturelles qui les animent ?
Les MRC ont été créées en 1979 dans le but de décentraliser la planification et la gestion du territoire, et d'entendre les élus de cette époque. Les MRC étaient un compromis puisque les régions voulaient une gouvernance régionale plus étendue afin d'éviter les interventions en silo, parfois peu adaptées des ministères provinciaux dans les régions. Encore en 2024, le gouvernement provincial tente de contourner ces MRC pour préserver le contrôle sur les ressources naturelles, comme la Couronne britannique le faisait avec ses colonies. Ironique qu'une province autonomiste aime calquer son colonisateur. Cette centralisation bénéficie néanmoins à un groupe : les entreprises minières puisqu'elles peuvent plus aisément influencer quelques individus par des activités de lobbying.
Sans clarté et bienveillance, pas de développement harmonieux
Bien que considérée par l'industrie minière comme un des principaux risques d'affaires, tel que rapportée par une enquête de Ernst & Young1 en 2024, nous constatons que l'acceptabilité sociale n'est pas mesurée et n'est nommée nulle part dans la Loi sur les mines ou son préambule. Ainsi, lorsque le premier ministre mentionne « il n'y aura pas de mine sans acceptabilité sociale », nous savons que ces mots n'ont aucune portée légale. Il importe que les lois précisent le flou existant qui favorise les décisions discrétionnaires plutôt que la clarté prévisible.
Il faut absolument trouver la bonne manière de mesurer l'acceptabilité sociale.
Si l'opinion de la population demeure inconnue du début à la fin, aucune approche scientifique ne résiste ? On fait l'inventaire des poissons, des mammifères, de la flore et des invertébrés mais on ne demande pas ce que pense la population locale d'un projet ? Pourquoi cette peur de lui demander ? L'État veut-il rester libre de disposer de l'arrière-pays ?
Finalement, nous sommes estomaqués de ne voir aucune modification au chapitre XXIV de la loi, soit l'expropriation. Après avoir vu les documentaires et lu les nombreux documents portant sur le désastre Malartic, il est difficile de comprendre comment, 10 ans plus tard, si peu de bienveillance émerge des autorités. Comment une société avancée en est-elle arrivée à accepter qu'une entreprise privée procède ainsi à des expropriations de citoyens ? Si le sous-sol appartient à l'État, tous les citoyens affectés devraient bénéficier d'un accompagnement équitable, peu importe le promoteur, avec des règles nationales quant à l'éligibilité et les montants.
Le gouvernement doit assumer son rôle d'arbitre bienveillant en donnant un cadre au processus de compensation ou d'expropriation pour éviter des ententes de gré à gré très inégales.
Section 3 : Nos recommandations
Aperçu de nos recommandations
Dans sa forme actuelle, le projet No 63 ne permettra pas un développement harmonieux et il est évident que le conflit sera exacerbé par une Loi qui reste, à nos yeux, la même. Notre mémoire vise essentiellement à contribuer concrètement, à aider les parlementaires à doter le Québec d'une Loi sur les mines modernes qui saura redonner confiance à la population. L'industrie minière ne remporte pas l'affection de nombre de Québécois et sa volonté de sortir de ses régions traditionnelles pour occuper tout le territoire ne va que détériorer cette situation.
Nous invitons le gouvernement à écouter ses citoyens plus que les entreprises et, conséquemment, à modifier la loi sur les mines tel que demandé par la société civile depuis des années.
Recommandation 1 – Partager le pouvoir décisionnel sur les claims avec les MRC
Les pouvoirs provinciaux sur le sous-sol public doivent concrètement être partagés avec les MRC dans le cadre de ses fonctions de planification, de gestion et de décision quant au territoire qu'elle administre. La MRC, et les peuples autochtones, doivent être parties prenantes de la décision avant l'octroi des claims pour pallier les failles de la délimitation des Territoires incompatibles à l'activité minière (TIAM) qui protège surtout des activités actuelles et passées, plutôt que les projets d'avenir.
Recommandation 2 - Définir l'intérêt public
Des conditions devraient être établies - acceptabilité sociale, sensibilité écologique et activités économiques conflictuelles - pour que la ministre puisse retirer ou suspendre des claims qui seraient contradictoires aux priorités territoriales que le dispositif des TIAMs ne semble pas pouvoir assurer de manière dynamique.
Recommandation 3 - Mesurer l'acceptabilité sociale
Les études d'impact inventorient absolument tout sauf l'opinion de la communauté qui fréquente ce territoire. L'acceptabilité sociale des projets miniers - et tous les autres grands projets à fort impact - doit être clarifiée à partir d'un processus démocratique prévu dans la loi, afin que le Conseil des ministres ait accès à cette information avant d'autoriser ou de rejeter un projet. Le flou entretient le cynisme face aux projets et la confiance indispensable envers l'État.
Recommandation 4 - Assurer une responsabilité publique de l'expropriation
En étudiant la section d'expropriation de la Loi sur les mines, nous constatons qu'aucun encadrement n'est proposé quant aux enjeux de cohabitation des riverains avec les projets miniers. La responsabilité est laissée à l'industrie, qui n'ayant aucun cadre de référence, peut agir arbitrairement et affecter l'équité de traitement de l'ensemble des Québécois. Nous demandons que le gouvernement du Québec, le propriétaire du sous-sol, exprime dans la loi sa responsabilité quant à l'accompagnement des riverains du projet minier - les propriétés adjacentes à la propriété minière - notamment pour l'aider à établir l'éligibilité aux indemnisations et les montants justes et équitables selon les conditions du projet.
L'analyse et les recommandations détaillées
Recommandation 1 : Partager le pouvoir décisionnel sur les claims avec les MRC
Analyse
● La loi sur les mines n'a ajouté aucun pouvoir aux MRC et aux municipalités sauf pour les terres privées. Effectivement, pour les terres privées, on inverse la posture gouvernementale (art. 304) : l'accès au sous-sol est interdit et d'emblée sous un Territoire incompatible à l'activité minière (TIAM) sauf si la MRC souhaite lever le TIAM pour exploiter le sous-sol.
● Au niveau de l'octroi des claims, outre l'ajout dans le Règlement des mines de l'obligation de faire une demande d'une autorisation pour travaux d'exploration à impacts (ATI) en y incluant des consultations, le projet de loi n'a pas proposé de partager le pouvoir décisionnel avec les MRC et les municipalités en amont de l'octroi des claims.
● Nous savons que les Orientations générales d'aménagement du territoire (OGAT) ont été bonifiées notamment en facilitant le processus de délimitation d'un TIAM.
● Mais le TIAM demeure un outil de protection des activités passées et actuelles, ce n'est pas un outil de protection des projets en cours et futurs. Les aspirations communautaires, si elles sont adéquatement formulées dans un plan de développement, doivent pouvoir être prises en compte et protégées. Nous pensons que de donner un pouvoir décisionnel à la MRC est la manière de protéger les aspirations communautaires sur le territoire public.
Proposition de modifications
Nous recommandons de modifier un article ou en ajouter dans la section III CLAIM de la Loi sur les mines, proposant un lieu de dialogue avec la MRC et les municipalités concernées avant d'octroyer un droit minier difficile à révoquer et promettant à une entreprise privée de pouvoir explorer et développer librement.
La proposition :
● À l'article 47 de la Loi sur les mines, il est stipulé que « le claim s'acquiert par la présentation d'un avis de désignation sur carte et par son inscription au bureau du registraire ». Nous pensons que c'est à ce moment que la MRC doit faire partie du processus décisionnel, puisqu'elle est celle qui connaît le territoire et saura informer la province si des projets d'un autre secteur économique, social ou écologique sont en développement dans ce secteur et s'il y aura conflit d'usage.
● Nous proposons de modifier l'article 47 ainsi : “le claim s'acquiert par la présentation d'un avis de désignation sur carte, par son inscription au bureau du registraire et par un avis de la MRC concernée”.
● Nous proposons de créer un article qui préciserait la modalité de cet avis de la MRC. Par exemple, « Le bureau du registraire demande un avis à la MRC qui inclura un droit de refuser un claim, sur un motif d'intérêt public, notamment pour éviter ou limiter les impacts sur les communautés locales et autochtones, ou démontrant l'activité en développement sur ce territoire public, que ce soit un processus de protection ou de développement en cours ».
● Nous proposons aussi que dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que le Schéma de développement et d'aménagement de la MRC soit plus dynamique et plus participatif afin que, justement, le développement et la protection du territoire soient plus à jour pour le bureau du registraire. Par ailleurs, les MRC devront rendre ce processus de planification du schéma nettement plus participatif pour être légitime, dynamique et mis à jour.
● Ceci garantira une mise à jour territoriale et réduira à la source le conflit potentiel.
Recommandation 2 : Définir l'intérêt public
Analyse
● Nous reconnaissons qu'il y a eu plusieurs lieux dans la nouvelle proposition de Loi sur les mines où a été ajoutée la phrase « pour des motifs d'intérêt public » et à différents moments. Les lois québécoises ont très souvent ces possibilités discrétionnaires et ces ajouts semblent suggérer que c'était effectivement manquant au regard des autres lois québécoises. Le plus important selon nos demandes est l'article 52.1 : « Le ministre peut imposer à un titulaire de droit exclusif d'exploration, au moment où il le juge opportun, des conditions et des obligations qui, malgré les dispositions de la présente loi, peuvent, notamment, concerner les travaux à effectuer, dans les cas suivants : 1° pour un motif d'intérêt public, notamment pour éviter ou limiter les impacts sur les communautés locales et autochtones ; 2° pour permettre la priorisation ou la conciliation des utilisations et de la protection du territoire. »
● Malheureusement, ce motif d'intérêt public est associé à un pouvoir discrétionnaire de ministre sans un réel encadrement définissant l'intérêt public et pour quel bénéficiaire. Les pouvoirs discrétionnaires sont difficiles aussi à exercer car la décision créée inévitablement un sentiment d'injustice face à la loi. À l'instar de l'acceptabilité sociale, la loi mériterait d'être claire autant pour les promoteurs que les citoyens.
Proposition de modifications
Tel que proposé dans la recommandation 1, nous pensons que la MRC peut aussi en appeler à l'intérêt public avant l'octroi d'un claim plutôt qu'après. Ce sera ainsi plus préventif.
Par ailleurs, nous pensons que l'intérêt public doit être défini notamment en ce qui a trait à l'acceptabilité sociale, au consentement des peuples autochtones et aux seuils écologiques d'effondrement qui devraient guider la décision du Premier ministre avant même d'octroyer un claim.
Nous proposons que la définition d'intérêt public soit ajoutée au début de la loi à partir des écrits juridiques ou la jurisprudence qui le qualifient déjà.
Par exemple, la définition du Grand dictionnaire terminologique est : « Ensemble des intérêts vitaux qui sont favorables à tous les citoyens » auquel devrait s'ajouter l'esprit de la Loi sur le développement durable, soit que ce qui est d'intérêt public aujourd'hui pourrait ne pas l'être dans 25 ans. Nous proposons d'ajouter « maintenant et à long terme ».
Cette même définition pourrait aussi servir aux commissaires du BAPE qui pourrait vérifier si, effectivement, le projet répond à l'intérêt public avec, en main, une étude d'impact et une mesure d'acceptabilité sociale.
Recommandation 3 : Mesurer l'acceptabilité sociale
Analyse
● Outre l'intérêt public accroché au pouvoir de la ministre, la Loi sur les mines n'aborde pas l'acceptabilité sociale. Le mot ne s'y trouve pas bien que l'industrie la reconnaisse comme un risque d'affaire important et qu'elle soit aussi source de conflits sociaux.
● Évidemment, on comprend que ce serait plus la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la Loi sur la qualité de l'environnement qui encadreraient le processus d'acceptabilité sociale. À notre connaissance, ces deux lois ne le font pas non plus.
● La Loi sur la qualité de l'environnement définit toutefois ce qui constitue des grands projets à risque pour l'environnement dans l'annexe I du Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets. Il s'agit de la liste des projets assujettis à la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.
● Ainsi, l'acceptabilité sociale n'est qu'un mot dans la sphère publique sans portée légale et réglementaire.
● À notre avis, il est fondamental de demander l'opinion des communautés qui sont attachées aux territoires et c'est une donnée que les élus doivent avoir en main pour savoir comment faire évoluer un projet.
● Il y a une Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Nous comprenons que cette loi s'applique aux compétences municipales qui, typiquement, excluent les pouvoirs sur le territoire public.
● Les MRC ont des pouvoirs sur les territoires publics mais n'ont pas de cadre juridique pour faire un référendum sur les projets proposés sur les territoires publics. Certaines MRC ont choisi d'avoir un préfet au suffrage universel alors il y a des modalités électorales dans ce contexte.
Recommandations dans ce contexte
● Nous sommes d'avis que, pour les projets que notre société a définis comme assez grands ou risqués pour l'environnement, soit ceux situés dans l'Annexe 1 du Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, un cadre référendaire devrait être mis en place dans un Loi sur les élections et les référendums pour les Municipalités régionales de comtés.
● Ce cadre référendaire s'appliquerait aux projets situés dans les territoires publics.
● Nous savons qu'une telle loi n'existe pas pour l'instant et démontre tout le malaise de faire exister les MRC pour vrai. Mais devant toutes ces MRC qui choisissent un préfet au suffrage universel, un mouvement de démocratie locale est déjà en route et la suite logique serait d'octroyer des pouvoirs référendaires aux MRC notamment et surtout lorsque des projets de telles envergures arrivent sans nécessairement avoir une compatibilité ou une continuité avec le développement territorial actuel.
● Il est impératif que la MRC analyse la proposition, consulte la population et informe le gouvernement de la posture locale. C'est ainsi que la population se sentira protégée par des instances locales qui sont plus réactives aux opinions citoyennes.
● À notre avis, cette consultation référendaire pourrait être tenue au moment du dépôt d'un avis de projet, à la consultation sur les enjeux prévue dans la Procédure d'examen et d'évaluation des impacts sur l'environnement, pour éviter de faire l'étude d'impact si les décideurs constatent la très faible adhésion au projet.
● Après l'étude d'impact, il est trop tard, le conflit s'intensifie à l'approche du BAPE et ternit la réputation de l'entreprise, des citoyens et du gouvernement. Le modèle d'absence de consultation en amont est un modèle conflictuel en soi.
● À ce moment, soit au dépôt de projet, il y a un réel projet avec un aménagement et la consultation porterait sur l'idée même du projet, sa justification, plutôt que sur ses impacts.
● Les études d'impact sont un outil décisionnel mais surtout un plan d'implantation du projet. Les citoyens n'ont pas besoin de tous ces détails pour former leurs opinions sur un tel projet.
● Puis, les ressources sont mieux investies, pour le promoteur et la communauté, en ne s'engageant pas ouvertement dans un conflit pendant l'étude d'impact. Cette responsabilité incomberait aux MRC et le gouvernement provincial financerait l'activité à sa demande.
● À titre de comparaison, en 1995, la Commission nationale du débat public en France fut fondée avec cette prémisse qu'il fallait d'abord dialoguer sur l'opportunité du projet avant de discuter sur la manière de faire le projet. Le modèle québécois cumule les deux activités en même temps, ce qui confond le pourquoi du comment.
● Le BAPE demeure une institution fondamentale pour notre mouvement citoyen. Mais nous souhaitons une consultation plus en amont, et le BAPE pourrait assister la MRC à l'organisation de cette consultation locale pour bien définir les limites géographiques de cette consultation référendaire pré-étude d'impact.
Recommandation 4 : Assurer une responsabilité publique de l'expropriation
Analyse
● Le projet de loi n° 63 ne propose aucune modification à la Loi sur les mines à la section V « expropriation et indemnisation ».
● Pour qu'un projet soit acceptable d'un point de vue du public, il est irrespectueux de déléguer une responsabilité d'expropriation et d'indemnisation à une entreprise privée sans cadre de protection, d'accompagnement et d'équité entre les Québécois.
● Le cadre d'éligibilité - enjeux de nuisances et distances du projet minier - et le cadre d'indemnisation - les valeurs des propriétés ou autres pertes d'usufruit ne sont pas définies dans la loi ou par règlement.
● Comme le sous-sol appartient à l'État, qui est représenté par la province, il a comme devoir d'encadrer l'aspect le plus traumatisant d'un projet minier.
● Les riverains vivent de l'anxiété dès l'arrivée des foreuses car il n'y a pas de cadre légal prévisible pour les accompagner et leur assurer un avenir juste et équitable, indépendant du promoteur ou indépendant des compétences de négociation d'un riverain.
Recommandations dans ce contexte
● Le projet de loi n° 63 doit reprendre la section V concernant l'indemnisation et l'expropriation.
● Selon le principe de développement durable pollueur-payeur, c'est au promoteur minier de payer l'ensemble des indemnisations.
● Toutefois, par l'imputabilité de l'État face à la santé et la sécurité de ses citoyens, l'État doit établir un cadre équitable envers l'ensemble de sa population - chaque Québécois devrait avoir les mêmes conditions d'indemnisation et d'expropriation devant un projet minier (ou autres) et envers les entreprises minières - chaque entreprise devrait payer le même prix pour installer une mine près de milieu habité.
● L'éligibilité à un rachat volontaire des propriétés ou à une indemnisation si un résident souhaite rester doit être déterminée en fonction du projet avec l'aide notamment de la direction régionale de la santé publique. L'éligibilité se caractérise surtout par la distance aux différentes nuisances (bruits, vibration, lumière, poussière, etc.) et c'est la santé publique qui dispose de l'expertise et de la légitimité aux yeux des citoyens.
● C'est la santé des riverains qui doit primer et guider la décision de l'État dans l'accompagnement des riverains face à un projet minier.
● Le cas de la Fonderie Horne est d'une grande évidence. Si l'État avait planifié et encadré l'indemnisation et l'expropriation, il ne serait pas dans une apparence de négligence créant un profond enjeu de confiance avec l'État et les citoyens
● Les indemnisations doivent aussi être encadrées par le développement d'une entente d'indemnisation proposée collaborativement entre l'entreprise et la municipalité, à entériner par le gouvernement au moment du décret si le projet est autorisé
● Pour la valeur de la propriété, il faudra établir un cadre d'évaluation du prix du marché pré-mine pour recouvrer la valeur pour les résidents qui, pour la plupart, en ont fait leur unique fonds de pension. Une question de respect, encore ici.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La CSN dénonce la privatisation progressive du secteur de la production, du transport et de la distribution d’électricité au Québec.

Nous publions des extraits du mémoire déposé par la CSN à la commission sur le projet de loi 69 concernant la bonne gouvernance des ressources énergétiques. La CSN demande que le gouvernement Legault "sursoie à l'adoption de PL 69 et qu'il devance une consultation publique large sur le PGIRE."
16 septembre 2024 | tiré du site de l'Assemblée nationale du Québec
Pour lire le mémoire de la CSN sur le projet de loi 69, cliquez sur l'icône :
Synthèse
La CSN salue la volonté du gouvernement de mettre en place un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE). Cela dit, elle émet des recommandations concernant le PGIRE qui visent à garantir un meilleur processus de consultation, un meilleur suivi de sa mise en œuvre, une plus grande cohérence sur la durée de l'horizon de planification, et de meilleures garanties que l'ensemble des externalités sociales, économiques et environnementales seront dument pris en compte. Ce dernier aspect est d'autant plus important que le Québec n'est pas en voie d'atteindre ses cibles en matière de lutte aux changements climatiques.
Le débat sur le PGIRE est fondamental, étant donné les erreurs récemment commises. La CSN se questionne en effet sur l'allocation rapide de blocs d'énergie à des projets industriels dans un contexte où le Québec ne dispose plus de surplus d'électricité à moyen et long terme. Cela survient de surcroi^t dans une situation où la planification de la demande d'électricité par le gouvernement et Hydro-Québec est déficiente, peu de temps après la signature de contrats d'exportation fermes avec les États de la Nouvelle-Angleterre et celui de New York.
La CSN déplore les nombreuses dispositions du projet de loi qui remettent en question le monopole d'Hydro-Québec sur les activités de production, de transport et de distribution d'électricité. L'accroissement de la place du privé est particulièrement inopportun en raison du caractère stratégique de l'électricité propre qu'elle produit au regard de la lutte aux changements climatiques. Depuis 1963, la nationalisation de l'hydroélectricité a généré des retombées qui sont au cœur du développement économique et social du Québec moderne. La confédération est d'avis qu'Hydro-Québec est encore en mesure de répondre à la demande d'électricité du Québec à moyen et long terme, si le gouvernement lui en donne les moyens.Il est impératif de préserver le patrimoine collectif que représente H-Q et d'assurer son caractère entièrement public.
La CSN est satisfaite que la Régie de l'énergie retrouve le pouvoir de fixer les tarifs relatifs au transport et à la distribution d'électricité, mais aurait toutefois souhaité qu'elle soit aussi responsable de la détermination de la composante des tarifs relatifs à la production. Par ailleurs, la CSN s'inquiète de l'augmentation anticipée des tarifs résidentiels qui ne manquera pas de survenir, malgré la mise sur pied du Fonds d'aide à la clientèle domestique d'Hydro- Québec, à la suite des investissements substantiels annoncés par Hydro-Québec et de l'octroi de nombreux blocs d'énergie à des secteurs industriels émergents.
Enfin, la confédération n'est pas convaincue que les modifications législatives et réglementaires proposées sont nécessaires ou que les bons choix sont faits. Au surplus, nous ne savons pas quels sont les contours du futur PGIRE, ce qui biaise fondamentalement le débat actuel. La CSN appelle donc le législateur à ajuster les dispositions du PL69 concernant le PGIRE, mais à sursoir à l'adoption des autres dispositions, et ce, dans le but d'accélérer le processus de consultation et d'adoption du plan.
Conclusion
Selon le gouvernement, le projet de loi no 69 vise à adapter l'encadrement du secteur de l'énergie afin de permettre au Québec de réaliser ses grands objectifs en matière de transition énergétique et de décarbonation de son économie, dans le respect du principe d'acceptabilité sociale. Toutefois, ces objectifs allégués servent largement de prétextes au développement des secteurs industriels émergents et à la privatisation progressive du secteur de la production, du transport et de la distribution d'électricité au Québec.
La CSN se questionne sur l'allocation rapide de blocs d'énergie à des projets industriels dans un contexte où le Québec ne dispose plus de surplus d'électricité à moyen et long terme, en raison de la planification déficiente de la demande d'électricité par le gouvernement et Hydro-Québec, de me^me que la signature de contrats d'exportation fermes avec les États de la Nouvelle-Angleterre et celui de New York il y a à peine quelques années. Les nombreux projets industriels viennent ajouter à la demande d'électricité découlant de la transition énergétique et il est d'ores et déjà clair que les infrastructures de production additionnelles rendues nécessaires se traduiront par des augmentations importantes de tarifs, incluant la clientèle résidentiele. De plus, puisqu'il n'existe actuellement aucune planification intégrée des ressources énergétiques compatibles avec la politique-cadre sur les changements climatiques, il n'existe aucune garantie que la politique industrielle actuelle n'aille pas à l'encontre des objectifs de décarbonation de l'économie québécoise.
Par ailleurs, la CSN est préoccupée par les nombreuses dispositions qui viennent réduire le ro^le d'Hydro-Québec dans la production, le transport et la distribution d'électricité. Depuis 1963, la nationalisation de l'hydroélectricité a généré des retombées qui sont au cœur du développement économique et social du Québec moderne. Pour des raisons économiques et relatives aux finances publiques [1], ce serait une grave erreur de faciliter l'accroissement de la place du privé. La CSN croit qu'Hydro-Québec est en mesure de répondre aux besoins énergétiques de la société québécoise dans l'avenir. Il est impératif de préserver le patrimoine collectif que représente H-Q et d'assurer son caractère entièrement public.
En conclusion, bien qu'elle ait mis de l'avant des propositions spécifiques relatives au projet de loi, la CSN considère qu'il est impossible d'avoir un débat éclairé sur le PL 69 tant que les modalités du PGIRE ne seront pas connues. Elle appelle donc le législateur à ajuster les dispositions du PL 69 concernant le PGIRE, mais à sursoir à l'adoption des autres dispositions, dans le but d'accélérer l'adoption du plan. Par la suite, le gouvernement aura le loisir de consulter la population sur la nécessité de modifier ou non son cadre législatif.
Recommandation 16 Que le gouvernement sursoie à l'adoption de PL 69 et qu'il devance une consultation publique large sur le PGIRE.
Recommandations
Recommandation 1
Que le législateur modifie le projet de loi no 69 et donne à un organisme indépendant le mandat de mener des consultations, d'effectuer des recommandations et de faire un suivi relatif à la planification intégrée des ressources énergétiques. Qu'il soit introduit au PL 69 des spécifications au mode de consultation de la population et de la société civile de manière qu'il soit ouvert, inclusif et transparent.
Recommandation 2
Que les producteurs privés d'électricité assument la totalité des coûts de transport d'électricité qu'ils occasionnent à Hydro-Québec.
Recommandation 3
Que le gouvernement évite d'intervenir trop directement dans les activités de la Régie de l'énergie et d'Hydro-Québec et qu'il les laisse réaliser leurs missions en s'appuyant sur leurs expertises techniques.
Recommandation 4
La CSN s'oppose à la possibilité, pour Hydro-Québec, de privatiser les infrastructures de son réseau hydroélectrique.
Recommandation 5
Qu'Hydro-Québec soit le maître d'œuvre dans la production d'énergie éolienne sans prise de participation d'entreprise privée à but lucratif. La CSN réitère son opposition au modèle d'appels d'offres au privé.
Recommandation 6
La CSN réitère son opposition à toute forme de privatisation du transport et de la distribution d'électricité´ au Québec.
Recommandation 7
La CSN demande que tout contrat d'approvisionnement à venir entre un autoproducteur existant et Hydro-Québec soit assorti d'une garantie de protection des emplois.
Recommandation 8
Que la Régie de l'énergie conserve le mandat d'analyser de manière exhaustive et objective tout projet d'envergure de production d'électricité post-patrimoniale afin de garantir l'intérêt public.
Recommandation 9
Qu'Hydro-Québec demeure le maître d'œuvre de l'organisation et du développement du réseau électrique sur le territoire québécois, spécialement du réseau hydroélectrique. Seule Hydro-Québec doit pouvoir développer et opérer des complexes hydroélectriques de plus de 50 MW.
Recommandation 10
Que les demandes industrielles d'énergie qui se présentent ne soient pas traitées au cas par cas et que le gouvernement se dote de critères précis permettant de décider de donner suite ou non à l'approvisionnement électrique de chaque projet d'envergure. Les projets doivent s'inscrire dans le cadre d'une vision globale de la politique industrielle qui est cohérente avec les objectifs gouvernementaux en matière de transition énergétique et de lutte aux changements climatiques.
Recommandation 11
Que le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) annoncé par le gouvernement du Québec guide les décisions de donner suite ou non à l'approvisionnem ent électrique des projets de demandes industrielles d'énergie.
Recommandation 12
Que le gouvernement du Québec redonne à la Régie de l'énergie le pouvoir de déterminer l'ensemble des composantes des tarifs d'électricité, y compris celle relative à la production, dans le cadre d'un processus qui garantit la transparence et la participation du public.
Recommandation 13
Que la contribution fiscale qui financera le Fonds d'aide à la clientèle domestique d'Hydro- Québec, qui reste à définir, soit progressive et exempte les ménages à faible revenu, si le gouvernement persiste avec la proposition de le mettre en place.
Recommandation 14
Qu'Hydro-Québec continue d'offrir la tarification dynamique aux clients résidentiels qui le souhaitent, mais seulement sur une base volontaire, et qu'elle déploie des options tarifaires s'adressant aux entreprises, qui sont plus à même de moduler leur consommation dans le temps que les ménages. Toutefois, l'option d'un mode de tarification spéciale dans le secteur résidentiel pourrait être envisageable, mais seulement pour les ménages habitant des résidences luxueuses qui ont une consommation intensive d'électricité.
Recommandation 15
Que les tarifs d'électricité demeurent en lien avec les coûts réels d'exploitation d'Hydro- Québec et que la tarification basée sur les coûts marginaux ne soit pas utilisée pour augmenter les profits de la société d'État. Que des moyens alternatifs soient mis en place pour réduire la consommation de pointe et les investissements dans les moyens de production, notamment en accélérant le développement des programmes d'efficacité énergétique (économie d'énergie et gestion de la demande) et des mesures d'économie d'énergie.
Recommandation 16
Que le gouvernement sursoie à l'adoption de PL 69 et qu'il devance une consultation publique large sur le PGIRE
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] D'un point de vue comptable, Hydro-Québec représente un actif important pour le secteur public québécois et contribue de façon positive à la cote de crédit de la province
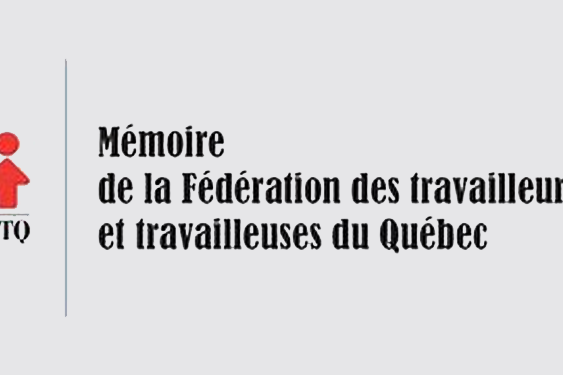
La FTQ s’oppose à l’adoption du projet de loi 69
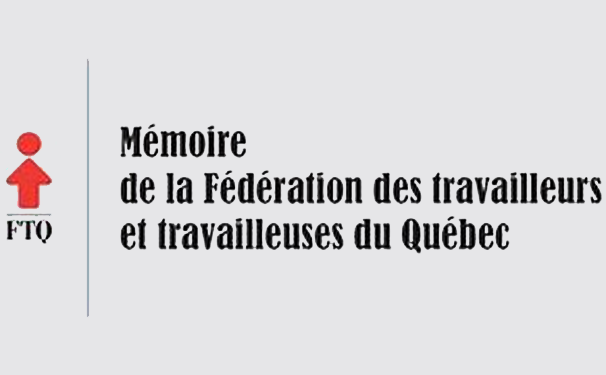
Comme, il l'écrit en conclusion de son mémoire, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec rejette le projet de loi 69. Dans son mémoire elle "réitère sa position ferme contre l'adoption du projet de loi n° 69 dans sa forme actuelle. Le projet de loi, tel que rédigé, présente des risques significatifs pour la gouvernance démocratique des ressources énergétiques et ne tient pas suffisamment compte des impacts environnementaux critiques et des enjeux de gouvernance et de transparence des processus décisionnels qu'il crée.. Nous publions ci-dessous d'importants extraits de son mémoire et la liste de ses recommandations.
5 septembre 2024 | tiré du site de l'Assemblée nationale
Pour lire l'ensemble du mémoire, cliquez sur l'icône :
Introduction
Alors que notre énergie a historiquement été gérée avec une forte dimension publique et démocratique, ce projet de loi semble orienter la gestion des ressources énergétiques vers un modèle privé, dénationalisé et nettement moins transparent, remettant en question les acquis de plusieurs décennies de gestion publique de l'énergie au Québec. Il vient également politiser cette gestion, car si le ministre de l'Économie devient insidieusement responsable des décisions, celles-ci seront prises à courte vue et en accord avec l'orientation politique du gouvernement en place et non pas nécessairement en fonction de la sécurité énergétique, de l'environnement ou de l'intérêt social collectif, détruisant ainsi l'héritage des générations passées.
Dans ce contexte, il est crucial de réexaminer ce projet de loi dans la perspective du bien commun, en veillant à ce que la gestion de l'énergie reste ancrée dans les valeurs de transparence, de participation citoyenne, de préservation de l'environnement et de justice sociale qui ont historiquement guidé le développement énergétique du Québec. Conséquemment, la FTQ recommande le rejet du projet de loi dans sa forme actuelle ainsi que la suspension du processus de consultation, et ce, jusqu'à ce qu'un Plan de Gestion Intégrée des Ressources Énergétiques (PGIRE) soit élaboré, afin de garantir une planification cohérente et durable de la transition énergétique. Le présent mémoire vise donc à offrir une critique constructive du projet de loi 69, à mettre en lumière les risques majeurs qu'il pose pour la survie du filet social québécois, à souligner les incohérences dans l'approche présentée par le gouvernement et à proposer des recommandations substantielles pour une politique énergétique cohérente et durable.
(...)
Les angles abordés
Ce mémoire est structuré en plusieurs sections principales de la façon suivante :
1. Une offensive de centralisation au détriment de l'environnement et de la gouvernance démocratique : Analyse des implications de la centralisation des décisions énergétiques au sein du ministère de l'Économie et réduction du rôle du ministère de l'Environnement.
2. Modifications terminologiques et privatisation des infrastructures énergétiques : Discussion sur les impacts des changements terminologiques proposés dans le projet de loi 69, comme le passage de « consommateur » à « client » et évaluation des risques liés à la privatisation accrue des infrastructures énergétiques.
3. Tarification et sécurité énergétique : Examen des conséquences de la modulation tarifaire résidentielle et de l'incertitude tarifaire après 2026, ainsi que du rôle de la Régie de l'énergie.
4. Enjeux environnementaux : Exploration des impacts environnementaux potentiels et des défis en matière de biodiversité et de changements climatiques.
5. Cohérence dans l'élaboration du PGIRE : Propositions pour l'adoption d'un Plan de Gestion Intégrée des Ressources Énergétiques (PGIRE) avant la mise en œuvre de tout changement législatif et règlementaire.
Une offensive de centralisation au détriment de l'environnement et de la gouvernance démocratique
Le projet de loi 69 est une attaque frontale contre la protection de l'environnement et la transparence démocratique, en centralisant de manière drastique les pouvoirs décisionnels énergétiques au sein du MEIE. Sous prétexte de simplifier la gestion des ressources énergétiques, ce projet de loi marginalise le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ainsi que celui des Ressources Naturelles et des Forêts (MRNF), concentrant ainsi un pouvoir immense entre les mains d'un seul ministère. Cette manœuvre nous apparaît comme une tentative de museler les voix discordantes (mais nécessaires à la santé démocratique) et de s'assurer que les décisions énergétiques du Québec servent principalement des intérêts économiques étroits, au mépris des impératifs sociaux et environnementaux.
Le MEIE s'arroge désormais le contrôle du PGIRE et l'établissement des cibles énergétiques, reléguant au second plan les considérations environnementales essentielles à la durabilité du Québec (art. 4, PL-69). En donnant carte blanche à un ministère motivé par une logique purement économique, ce projet de loi ouvre la voie à des décisions hâtives, irresponsables et incohérentes dont les conséquences sur la biodiversité, les écosystèmes et le filet social québécois pourraient être dévastatrices pendant plusieurs générations. La mainmise du MEIE sur la gestion des forces hydrauliques de l'État, y compris la perception des redevances (art. 7, 8, PL-69), est un autre exemple criant de cette centralisation dangereuse qui subordonne l'ambition climatique à des intérêts financiers à court terme.
La centralisation des décisions sous l'égide du MEIE constitue, selon la FTQ, une voie directe vers un échec de l'ambition climatique du Québec. En autorisant le ministre de l'Économie à approuver des projets énergétiques sans l'obligation de consulter les autres ministères (art. 4, PL-69), le projet de loi 69 contourne les contre-pouvoirs et vient réduire les règles de gouvernance nécessaires au bon maintien du filet social. Le gouvernement semble prêt à sacrifier les écosystèmes locaux sur l'autel du profit, ignorant les risques graves et irréversibles pour la biodiversité, les habitats naturels et les communautés y vivant.
La FTQ exprime de sérieuses réserves face à cette orientation centralisatrice à l'encontre des principes de transparence et de responsabilité. Le projet de loi 69 met en péril la gouvernance démocratique en limitant les occasions pour les acteurs de la société civile de participer au processus décisionnel. Notons d'ailleurs la modification à l'article 7 de la Loi sur la Régie de l'énergie venant remplacer « 12 régisseurs » par « d'au plus 12 régisseurs » dans sa composition, indiquant clairement un effort de réduction de la capacité de surveillance et d'échange de la Régie. L'article 45, lui, élimine l'obligation pour Hydro-Québec de procéder par appel d'offres pour certains contrats d'approvisionnement en électricité, à moins que le gouvernement n'en décide autrement, restreignant les garanties de transparence et ouvrant la porte à des décisions prises à huis clos, sans véritable consultation publique. Selon la FTQ, cet article doit être révisé pour réintroduire cette exigence, qui est essentielle pour maintenir la transparence et garantir que les contrats énergétiques sont attribués de manière équitable et en conformité avec l'intérêt public.
La FTQ souligne également, l'article 67 du projet de loi qui, une fois de plus, permet au gouvernement de contourner et d'affaiblir les contre-pouvoirs en permettant au ministre de l'Économie d'intervenir directement dans les décisions de la Régie de l'énergie sous prétexte de préoccupations économiques. Ceci nous apparaît comme une tentative flagrante de politisation des processus régulatoires menaçant l'indépendance de cette institution. L'introduction de ce biais politique risque d'affaiblir les critères techniques, scientifiques sociaux et environnementaux au profit de priorités économiques en rendant quasi-obsolète le rôle même de la Régie.
En centralisant ainsi de manière inquiétante les pouvoirs au sein du MEIE, le PL-69 compromet à la fois la protection environnementale et la qualité de la gouvernance démocratique. Il est impératif de réexaminer ce projet sous l'angle de la transparence, de la participation citoyenne, de la transition juste et de la justice environnementale, afin d'éviter des dérives potentielles qui pourraient nuire gravement au bien commun des Québécoises et des Québécois.
(...)
Conclusion
La FTQ réitère sa position ferme contre l'adoption du projet de loi n° 69 dans sa forme actuelle. Le projet de loi, tel que rédigé, présente des risques significatifs pour la gouvernance démocratique des ressources énergétiques et ne tient pas suffisamment compte des impacts environnementaux critiques et des enjeux de gouvernance et de transparence des processus décisionnels qu'il crée. En l'absence d'une vision intégrée pour la gestion des ressources énergétiques, le projet de loi centralise des pouvoirs excessifs au sein du ministère de l'Économie, au détriment d'une approche équilibrée et concertée. Cette façon de procéder chronologiquement incongrue et ne peut qu'exacerber les risques de dérives énergétiques.
La FTQ appelle à la suspension immédiate des travaux parlementaires sur ce projet de loi et demande la mise en place d'un Plan de gestion intégré des ressources énergétiques (PGIRE) avant toute reprise des discussions. Ce plan doit inclure une évaluation exhaustive des impacts environnementaux et économiques, garantir que les décisions énergétiques du Québec soient alignées avec les engagements internationaux en matière de biodiversité et de lutte contre les changements climatiques et assurer un processus décisionnel inclusif qui mettra de l'avant l'expertise des travailleuses et travailleurs ainsi que des nombreux acteurs de la société civile.
La FTQ tient à souligner avec force que la gestion des ressources énergétiques ne peut être laissée au hasard ni soumise à des décisions précipitées. Les choix que nous faisons aujourd'hui définiront l'avenir non seulement de notre économie, mais aussi de notre environnement, de notre qualité de vie, et de notre place sur la scène internationale en tant que chef de file de la transition énergétique juste. Le Québec ne peut se permettre de balayer sous le tapis les préoccupations légitimes soulevées par la société civile, les experts, et les travailleuses et travailleurs qui seront les premiers touchés par les conséquences de ce projet de loi. Ainsi, la FTQ appelle le gouvernement à se hisser à la hauteur des défis de notre époque en exigeant que les décisions prises soient à la mesure de l'histoire que nous souhaitons écrire : celle d'un Québec visionnaire, inclusif, responsable, et engagé envers les générations futures. Il est fondamental que le gouvernement prenne le temps nécessaire pour élaborer un plan nous permettant de naviguer vers un avenir qui soit à la fois ambitieux, créatif et juste.
En conclusion, le moment est venu pour le Québec de démontrer son leadership en empruntant les chemins difficiles, mais nécessaires, afin de garantir un avenir où l'économie, l'ambition climatique et la justice sociale sont indissociables. Il est essentiel que les services d'électricité demeurent publics, avec Hydro-Québec comme responsable des opérations et propriétaire des actifs actuels et futurs. Cette gestion publique est cruciale pour assurer une énergie accessible, équitable et durable, tout en protégeant les intérêts de l'ensemble de la population québécoise. La FTQ se tient prête à collaborer pleinement à cette tâche, tout en restant vigilante et résolue à défendre les intérêts de ses membres et de l'ensemble des Québécoises et Québécois.
Listes des recommandations
Recommandation no 1
La FTQ recommande que le projet de loi 69 soit modifié pour garantir la participation obligatoire à titre d'intervenants, du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et du ministère des Ressources Naturelles et des Forêts (MRNF) lors des demandes de projet liées aux ressources énergétiques.
Recommandation n o 2
La FTQ recommande que les impacts environnementaux et sociaux soient évalués par des experts indépendants et que ces évaluations soient intégrées dans le processus décisionnel, afin de prévenir les décisions hâtives et irresponsables qui pourraient compromettre la durabilité écologique du Québec.
Recommandation no 3
La FTQ recommande que l'obligation d'appel d'offres pour tous les contrats d'approvisionnement en électricité soit conservée.
Recommandation no 4
La FTQ recommande la mise en place de garanties claires pour l'indépendance de la Régie de l'énergie, et s'oppose fermement à toute ingérence gouvernementale dans ses décisions. L'article 67 doit être modifié pour éliminer la possibilité de politisation des processus régulatoires.
Recommandation no 5
La FTQ recommande que des mesures pour une transition énergétique juste et équitable soient intégrées, en soutenant les travailleuses et travailleurs et les communautés affectées par ces transformations.
Recommandation no 6
La FTQ recommande de maintenir une gestion exclusivement publique des infrastructures énergétiques afin de préserver leur statut de bien commun, crucial pour la collectivité et propose même que le mandat d'Hydro-Québec soit étendu à l'ensemble de la production, du transport et de la distribution électrique quelle qu'en soit la source et que les sources renouvelables soient nationalisées.
Recommandation no 7
La FTQ recommande de renforcer les mécanismes de régulation de la Régie qui assurent une prévisibilité et une stabilité à court et long terme, tout en tenant compte des impacts de l'inflation et des enjeux de vie chère exacerbés depuis la pandémie et réitère le besoin pressant de dépolitiser le mandat de la Régie.
Recommandation no 8
La FTQ recommande de renforcer les mesures environnementales dans le projet de loi 69 en rendant obligatoires les évaluations d'impact pour tous les projets énergétiques d'envergure.
Recommandation no 9
La FTQ recommande d'intégrer des mesures claires et inclusives propres à une transition énergétique juste afin de s'assurer que les décisions économiques respectent nos engagements en matière de biodiversité et de lutte contre les changements climatiques dans un esprit de dialogue social.
Recommandation no 10
La FTQ recommande de mettre en place le PGIRE avant tous changements législatifs ou règlementaires, permettant ainsi de planifier efficacement les besoins énergétiques du Québec, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique dans une perspective de transition juste avec l'ensemble des acteurs de la société civile, tout en tenant compte des limites planétaires
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour qu’il y ait une suite du monde…
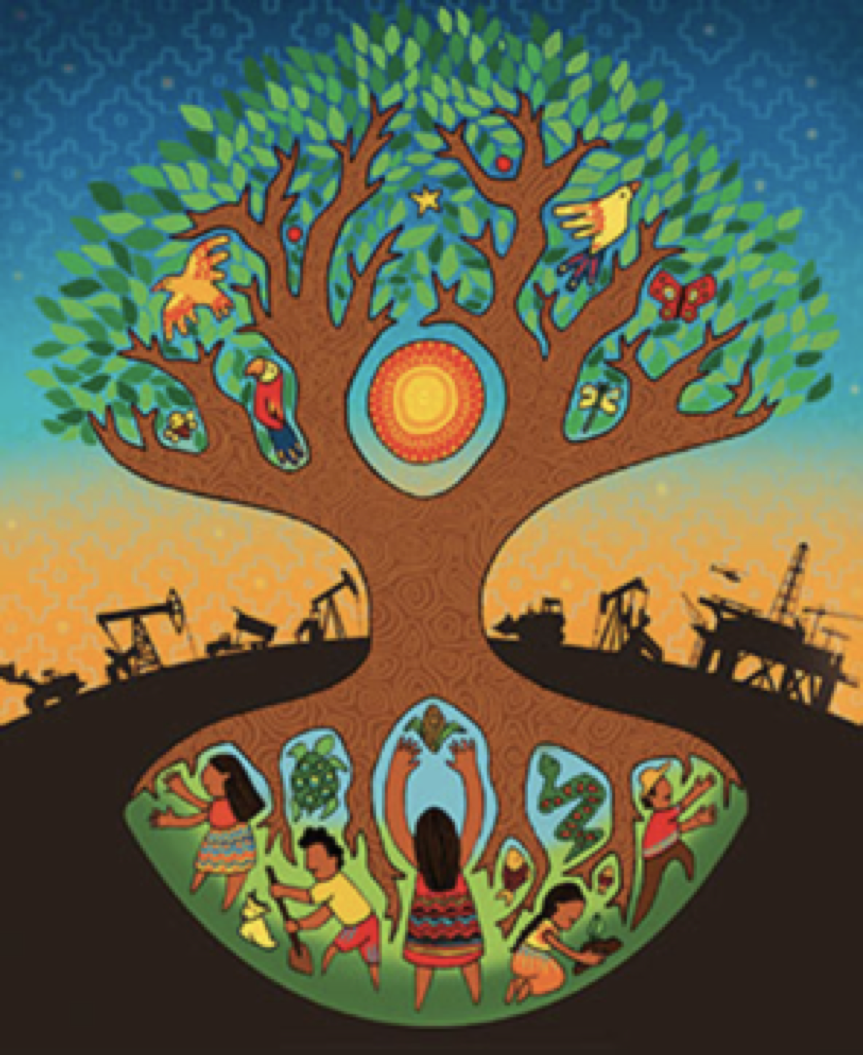
Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans une quinzaine de villes du Québec pour qu'il y ait une suite du monde.
Jacques Benoit
Co-initiateur de la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique – DUC
Co-rédacteur du Plan de la DUC
Membre de GMob (GroupMobilisation)
En 2018, GMob (GroupMobilisation) avait rédigé la DUC, laDéclaration d'Urgence climatique, pour qu'il y ait une suite du monde. Cette déclaration disait que l'état d'urgence climatique dans lequel nous étions faisait courir des risques aux générations futures en menaçant les niveaux de sécurité :
• Économique, avec l'augmentation des inégalités ;
• Santé humaine, avec les risques de pandémie ;
• Alimentaire, par les précipitations violentes et les sècheresses sévères détruisant les récoltes ;
• Environnement, par la fonte du couvert de glace arctique et antarctique ;
• Et sécurité nationale et internationale, où des migrations massives déstabilisent des nations entières.
Pour qu'il y ait une suite du monde, des citoyennes et des citoyens de partout au Québec avaient déposé la DUC dans leurs conseils municipaux, et plus de 525 municipalités au Québec avaient reconnu l'urgence climatique. Suivant ce courant, les partis Québécois, Québec solidaire, Parti Vert et NPD-Québec, de même que le BQ, NPD, le Parti Vert du Canada avaient signé la DUC, et le gouvernement du Canada et celui du Québec avaient également reconnu l'urgence climatique.
En septembre 2019, 500 000 personnes marchaient dans les rues de Montréal, pour qu'il y ait une suite du monde… Mais 6 mois plus tard, le monde se voyait confiné par la pandémie de la COVID-19, une pandémie dont le risque était décrit dans la Déclaration d'urgence climatique…
Bâtir prend du temps, mais détruire, quelques instants.
Pour qu'il y ait une suite du monde, nous devons maintenant reprendre là où nous étions, avant que la pandémie ne détruise nos solidarités.
Pour qu'il y ait une suite du monde, nous devons nous rappeler que l'urgence de 2018 n'est pas moins urgente aujourd'hui. Six ans plus tard, alors que les événements extrêmes ne cessent de s'aggraver et de s'additionner partout, nous devons rebâtir notre mouvement.
Pour qu'il y ait une suite du monde, nous devons sortir de nos luttes en silos, et focusser sur ce qui nous unit, notre bien commun, ce bien commun que certain.e.s veulent accaparer.
Ce bien commun, c'est notre seule solution, la seule solution pour lutter contre ce qui cause le réchauffement planétaire, la pollution de l'air, la perte de biodiversité et la destruction de notre environnement.
Le bien commun, c'est la seule voie qu'il nous reste pour qu'il y ait une suite du monde.
Pour qu'il y ait une suite du monde…
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
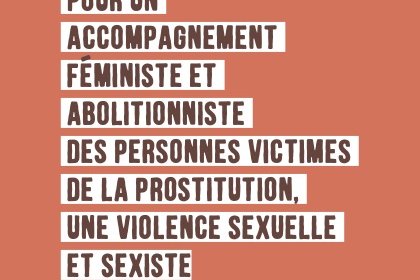
Pour un accompagnement féministe et abolitionniste des personnes victimes de la prostitution, une violence sexuelle et sexiste
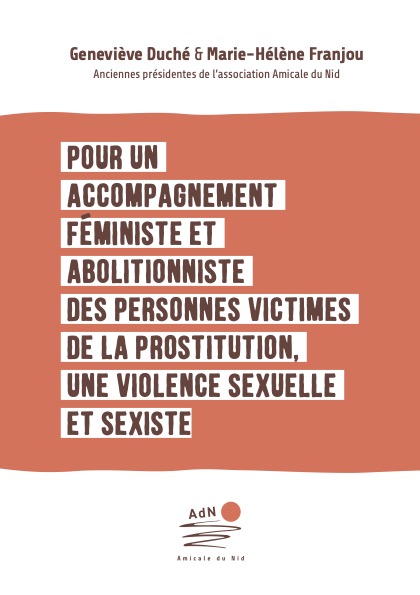
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/26/pour-un-accompagnement-feministe-et-abolitionniste-des-personnes-victimes-de-la-prostitution-une-violence-sexuelle-et-sexiste/
Vous trouverez ci-dessous la possibilité d'accéder au livre écrit par Geneviève Duché et Marie-Hélène Franjou. Ce travail a été confié à l'Amicale du Nid pour son édition voulant, par-là, marquer notre passage comme présidentes de cette association et inscrire dans son histoire la mutation que nous y avons provoquée et confirmée vers un abolitionnisme cohérent et une analyse féministe de la prostitution.
Le livre est disponible à la consultation et au téléchargement sur le site dans cet article :
https://amicaledunid.org/actualites/pour-un-accompagnement-feministe-et-abolitionniste-des-personnes-victimes-de-la-prostitution-une-violence-sexuelle-et-sexiste-genevieve-duche-et-marie-helene-franjou-anciennes-presid/
Ainsi que dans la rubrique « ressources » de manière permanente :
https://amicaledunid.org/ressources/pour-un-accompagnement-feministe-et-abolitionniste-des-personnes-victimes-de-la-prostitution-une-violence-sexuelle-et-sexiste-genevieve-duche-et-marie-helene-franjou-anciennes-presid/
Quatrième de couverture :
En France, La prostitution est incluse dans les violences contre les femmes depuis 2010. En 2016, l'Assemblée Nationale a voté une loi « visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées » – loi appelée « Olivier-Coutelle » – qui complète l'abolitionnisme français, instauré en 1960, par l'interdiction de l'achat d'un acte sexuel.
Pour faire comprendre l'importance de cette loi et la nécessité de la faire appliquer, pour faire comprendre l'urgence d'une lutte efficace contre le système prostitutionnel qui nourrit l'exploitation sexuelle des plus vulnérables, les autrices proposent une analyse féministe du système prostitutionnel. Elles s'appuient à la fois sur les témoignages de nombreuses personnes ayant subi ou subissant la prostitution ou la pornographie et sur leur expérience de bénévoles à l'Amicale du Nid, association abolitionniste qui confie l'accompagnement des victimes vers la sortie de la prostitution à des professionnel·les du travail social et de la santé.
Leurs analyses montrent les origines de la prostitution et ses effets sur les personnes victimes de cette violence sexiste et sexuelle ainsi que les difficultés de leur accompagnement social dans une société qui privilégie les « besoins » masculins, en particulier en ce qui concerne la prostitution des mineur·es qui ne cesse d'augmenter.
Aucune égalité réelle entre les femmes et les hommes ne peut exister si la société considère que le corps des femmes est un corps disponible. Les autrices montrent que le combat pour l'abolition du système prostitutionnel n'est ni « charitable », ni « moralisant » mais qu'il est un combat féministe et donc politique, à mener avec les personnes victimes de ce système et pour l'égalité et l'émancipation de toutes et tous.
Ce travail veut enrichir la réflexion des bénévoles et des professionnel·les et leurs pratiques dans les domaines de la prévention et de l'accompagnement social des victimes de violences sexistes et sexuelles et contribuer à préciser le cadre médico-social, législatif, politique des actions contre le système prostitutionnel.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.












