Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le surréalisme comme mouvement révolutionnaire
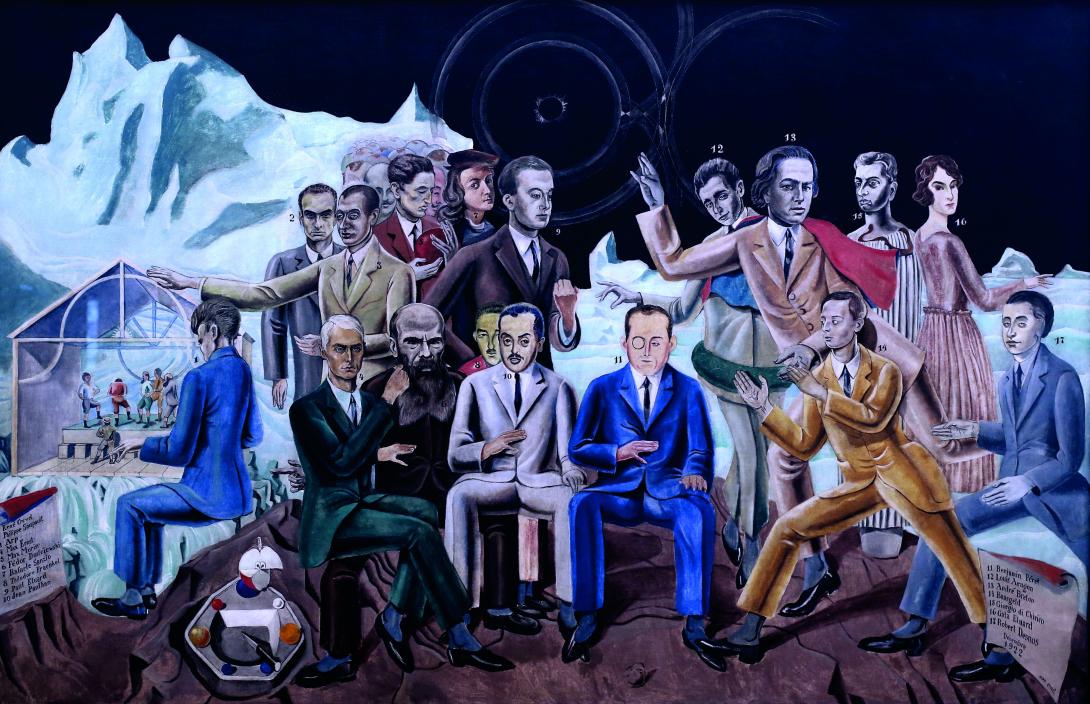
Le surréalisme n'est pas, et n'a jamais été, une école littéraire ou un courant artistique « d'avant-garde » (comme le cubisme ou le fauvisme), mais une vision du monde, un mode de vie, et une tentative éminemment subversive de réenchanter le monde. Il est aussi une aspiration utopique et révolutionnaire à « transformer le monde » (Marx) et « changer la vie » (Rimbaud) : deux mots d'ordre identiques, selon André Breton. C'est une aventure en même temps poétique et politique, magique et ludique. Elle a commencé à Paris il y a cent ans, en 1924. Elle continue aujourd'hui.
Tiré de Inprecor 724 - septembre 2024
29 septembre 2024
Par Michael Löwy
Au rendez-vous des amis. Max Ernst 1922. Aragon, Breton, Desnos ... Eluard,
Le surréalisme est, dès son origine, un mouvement international. Cependant, dans les pages suivantes nous allons nous occuper surtout du groupe surréaliste de Paris, d'abord autour d'André Breton, mais qui a continué son activité après le décès de l'auteur des Manifestes du surréalisme.
L'aspiration révolutionnaire est à l'origine même du surréalisme et prend d'abord une forme libertaire, dans le Premier Manifeste du Surréalisme (1924) d'André Breton : « Le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore ». En 1925, le désir de rompre avec la civilisation bourgeoise occidentale conduit Breton à se rapprocher des idées de la révolution d'Octobre, comme en témoigne son compte rendu du Lénine de Léon Trotsky. S'il adhère en 1927 au Parti communiste français, il ne garde pas moins, comme il s'en explique dans la brochure Au grand jour, son « droit de critique ».
C'est le Second Manifeste du Surréalisme (1930) qui tire toutes les conséquences de cet acte, en affirmant « totalement, sans réserve, notre adhésion au principe du matérialisme historique ». Tout en faisant valoir la distinction, l'opposition même, entre le « matérialisme primaire » et le « matérialisme moderne » dont se réclame Friedrich Engels, André Breton insiste sur le fait que « le surréalisme se considère comme lié indissolublement, par suite des affinités que j'ai signalées, à la démarche de la pensée marxiste et à cette démarche seule ».
Un marxisme émerveillé
Il va de soi que son marxisme ne coïncide pas avec la vulgate officielle du Komintern. On pourrait peut-être le définir comme un « marxisme gothique », c'est-à-dire un matérialisme historique sensible au merveilleux, au moment noir de la révolte, à l'illumination qui déchire, comme un éclair, le ciel de l'action révolutionnaire.
Il appartient en tout cas, comme celui de José Carlos Mariategui, de Walter Benjamin, d'Ernst Bloch et de Herbert Marcuse, à un courant souterrain qui traverse le 20e siècle : le marxisme romantique. C'est-à-dire une forme de pensée qui est fascinée par certaines formes culturelles précapitalistes et qui rejette la rationalité froide et abstraite de la civilisation industrielle moderne – mais qui transforme cette nostalgie du passé en force dans le combat pour la transformation révolutionnaire du présent. Si tous les marxistes romantiques s'insurgent contre le désenchantement capitaliste du monde – résultat logique et nécessaire de la quantification, mercantilisation et réification des rapports sociaux – c'est chez André Breton et le surréalisme que la tentative romantique/révolutionnaire de réenchantement du monde par l'imagination atteint son expression la plus éclatante.
Le marxisme de Breton se distingue aussi de la tendance rationaliste/scientiste, cartésienne/positiviste, fortement marquée par le matérialisme français du 18e siècle – qui dominait la doctrine officielle du communisme français – par son insistance sur l'héritage dialectique hégélien du marxisme. Dans sa conférence à Prague (mars 1935) sur « la situation surréaliste de l'objet » il insistait sur la signification capitale du philosophe allemand pour le surréalisme : « Hegel, dans son Esthétique, s'est attaqué à tous les problèmes qui peuvent être tenus actuellement, sur le plan de la poésie et de l'art, pour les plus difficiles et qu'avec une lucidité sans égale il les a pour la plupart résolus […]. Je dis qu'aujourd'hui encore c'est Hegel qu'il faut aller interroger sur le bien ou le mal-fondé de l'activité surréaliste dans les arts ». Quelques mois plus tard, dans son célèbre discours au Congrès des écrivains pour la défense de la culture (juin 1935), il revient à la charge et ne craint pas de proclamer, à contre-courant d'un certain chauvinisme antigermanique : « C'est avant tout dans la philosophie de langue allemande que nous avons découvert le seul antidote efficace contre le rationalisme positiviste qui continue ici à exercer ses ravages. Cet antidote n'est autre que le matérialisme dialectique comme théorie générale de la connaissance. »
Breton et Trotsky
La suite de l'histoire est connue : de plus en plus proches des positions de Trotsky et de l'opposition de gauche, la plupart des surréalistes (sans Louis Aragon !) vont rompre définitivement avec le stalinisme en 1935. Ce n'est en rien une rupture avec le marxisme, qui continue à inspirer leurs analyses, mais avec l'opportunisme de Staline et ses acolytes qui « tend malheureusement à annihiler ces deux composantes essentielles de l'esprit révolutionnaire » qui sont : le refus spontané des conditions de vie proposées aux êtres humains et le besoin impérieux de les changer.
En 1938 Breton rend visite à Trotsky au Mexique. Ils vont rédiger ensemble un des documents les plus importants de la culture révolutionnaire au 20e siècle : l'appel « Pour un art révolutionnaire indépendant », qui contient le passage célèbre suivant : « pour la création culturelle [la révolution] doit dès le début même établir et assurer un régime anarchiste de liberté individuelle. Aucune autorité, aucune contrainte, pas la moindre trace de commandement ! […] Les marxistes peuvent marcher ici la main dans la main avec les anarchistes ». Comme l'on sait, ce passage est de la plume de Trotsky lui-même, mais l'on peut supposer aussi qu'il est le produit de leurs longues conversations au bord du lac Patzcuaro.
C'est dans l'après-guerre que la sympathie de Breton pour l'anarchie va se manifester plus clairement. Dans Arcane 17 (1947) il rappelle l'émotion qu'il ressentit lorsque, enfant encore, il découvrit dans un cimetière une tombe avec cette simple inscription : « ni Dieu ni Maître ». Il énonce, à ce propos, une réflexion générale : « au-dessus de l'art, de la poésie, qu'on le veuille ou non, bat aussi un drapeau tour à tour rouge et noir » – deux couleurs entre lesquelles il refuse de choisir.
D'octobre 1951 à janvier 1953, les surréalistes vont collaborer régulièrement, avec des articles et des billets, avec le journal le Libertaire, organe de la Fédération anarchiste française. Leur principal correspondant dans la Fédération était à ce moment le communiste libertaire Georges Fontenis. C'est à cette occasion qu'André Breton écrira le texte flamboyant intitulé « La claire tour » (1952), qui rappelle les origines libertaires du surréalisme : « Où le surréalisme s'est pour la première fois reconnu, bien avant de se définir à lui-même, et quand il n'était encore qu'association libre entre individus rejetant spontanément et en bloc les contraintes sociales et morales de leur temps, c'est dans le miroir noir de l'anarchisme ». Malgré la rupture intervenue en 1953, Breton n'a pas coupé les ponts avec les libertaires, continuant à collaborer à certaines de leurs initiatives.
Révolutionnaires impénitents
Cet intérêt et cette sympathie active pour le socialisme libertaire ne conduisent pas pour autant les surréalistes à renier leur adhésion à la révolution d'Octobre et aux idées de Léon Trotsky. Dans une intervention le 19 novembre 1957, André Breton persiste et signe : « Contre vents et marées, je suis de ceux qui retrouvent encore, au souvenir de la révolution d'Octobre, une bonne part de cet élan inconditionnel qui me porta vers elle quand j'étais jeune et qui impliquait le don total de soi-même ». Saluant le regard de Trotsky, tel qu'il apparaît, en uniforme de l'armée rouge, dans une vieille photographie de 1917, il proclame : « Un tel regard et la lumière qui s'y lève, rien ne parviendra à l'éteindre, pas plus que Thermidor n'a pu altérer les traits de Saint-Just ». Enfin, en 1962, dans un hommage à Natalia Sedova qui venait de mourir, il appelle de ses vœux le jour où enfin « non seulement toute justice serait rendue à Trotsky mais encore seraient appelées à prendre toute vigueur et toute ampleur les idées pour lesquelles il a donné sa vie ».
Le surréalisme est peut-être ce point de fuite idéal, ce lieu suprême de l'esprit où se rejoignent la trajectoire libertaire et celle du marxisme révolutionnaire. Mais il ne faut pas oublier que le surréalisme contient ce qu'Ernst Bloch appelait « un excédent utopique », un excédent de lumière noire qui échappe aux limites de tout mouvement social ou politique, pour révolutionnaire qu'il soit. Cette lumière émane du noyau infracassable de nuit de l'esprit surréaliste, de sa quête obstinée de l'or du temps, de sa plongée éperdue dans les abîmes du rêve et du merveilleux.
Après Breton
En 1969, quelques figures de proue du surréalisme parisien, comme Jean Schuster, Gérard Legrand et José Pierre, décident que, compte tenu de la mort d'André Breton en 1966, il est préférable de dissoudre le Groupe surréaliste.
Cette conclusion est cependant rejetée par de nombreux autres surréalistes, qui décident de poursuivre l'aventure. Malheureusement, la plupart des comptes-rendus académiques ou grand public sur le surréalisme tiennent pour acquis que le groupe s'est « dissous » en 1969. Pour la plupart des historiens de l'art, le surréalisme n'était rien d'autre qu'une des nombreuses « avant-gardes artistiques », comme le cubisme ou le futurisme, qui ont eu une durée de vie très courte.
Vincent Bounoure (1928-1996) est celui qui a donné l'impulsion à la nouvelle période d'activité surréaliste, et il est resté une figure inspirante jusqu'à son dernier jour. Poète doué et essayiste brillant, il était, comme sa compagne Micheline, fasciné par l'art océanien de Nouvelle-Guinée, sur lequel il a écrit plusieurs essais.
L'autre figure marquante du groupe après 1969 fut Michel Zimbacca (1924-2021), poète, peintre, cinéaste et personnage attachant. Son documentaire sur les « arts sauvages », L'invention du monde (1952), est considéré comme l'un des rares tableaux véritablement surréalistes ; Benjamin Péret a écrit le texte mytho-poétique qui commente les images. Le groupe surréaliste se réunissait aussi souvent dans l'appartement qu'il partageait avec sa compagne Anny Bonnin, dont les murs étaient décorés de merveilleuses peintures de lui-même et d'autres surréalistes, ainsi que d'une remarquable parure de plumes indigènes d'Amazonie. Bounoure et Zimbacca étaient le lien vivant entre le mouvement surréaliste de l'après-1969 et le groupe fondé par André Breton en 1924.
Le Bulletin de liaison surréaliste
Dans les années 1970-1976, les surréalistes parisiens qui refusaient de baisser les bras se sont regroupés – en étroite relation avec leurs amis de Prague – autour d'une modeste revue, le Bulletin de liaison surréaliste (BLS). Le Bulletin comprend un débat sur « le surréalisme et la révolution » avec Herbert Marcuse. Parmi de nombreux autres joyaux, un article de l'anthropologue Renaud en soutien aux Indiens des États-Unis réunis à Standing Rock en juillet 1974.
Dans le dernier numéro du BLS d'avril 1976, une déclaration collective est publiée en faveur d'un jeune cinéaste surréaliste brésilien, Paulo Paranagua, et de sa compagne, Maria Regina Pilla, arrêtés en Argentine et accusés de « propagande subversive ». Initié par les surréalistes, l'appel a été publié par Maurice Nadeau dans la Quinzaine littéraire, et signé également par des intellectuels français de renom, tels que Deleuze, Mandiargues, Foucault et Leiris.
Les surréalistes parisiens entretenaient des relations étroites avec le groupe de Prague, qui vivait dans une semi-clandestinité sous le régime stalinien imposé à la Tchécoslovaquie après l'invasion soviétique de 1968. Ils pouvaient se rencontrer de manière informelle dans des maisons privées, mais leur Journal Analogon était interdit et ils ne pouvaient pas exposer leurs œuvres ou leurs films. En 1976, à l'initiative de Vincent Bounoure, les surréalistes de Paris et de Prague publient ensemble, en France aux Éditions Payot, un recueil d'essais, la Civilisation surréaliste.
Continuer malgré le reflux
Le groupe surréaliste a toujours été très politique, depuis 1924. Après 1969, cela reste vrai, mais ne signifie pas qu'il s'agit d'adhérer à des organisations politiques existantes. Quelques membres ont participé à des organisations trotskistes (Ligue communiste révolutionnaire, section française de la Quatrième Internationale), d'autres à la Fédération anarchiste ou à la CNT anarcho-syndicaliste. Mais la plupart des surréalistes parisiens n'appartenaient à aucune organisation ; l'esprit commun était anti-autoritaire et révolutionnaire, avec une tendance libertaire dominante. C'est cet esprit qui a inspiré leurs activités et les déclarations communes publiées au cours de ces années.
En 1987 une déclaration commune a été publiée, en soutien aux communautés indigènes Mohawk qui luttent pour leurs terres contre l'État canadien. Plusieurs autres déclarations favorables aux mouvements indigènes seront publiées au cours des prochaines années. Ceci est bien sûr lié à la tradition anti-autoritaire et anticolonialiste du mouvement, et à son rejet de la civilisation occidentale moderne. Mais cette empathie et le vif intérêt pour les « arts sauvages » sont aussi l'expression d'un état d'esprit romantique/révolutionnaire anticapitaliste : les surréalistes croyaient – comme le premier romantique, Jean-Jacques Rousseau, qui louait la liberté des Caribéens – que l'on pouvait trouver, dans ces cultures « sauvages » – les surréalistes n'aimaient pas le mot « primitif » –, des valeurs humaines et des modes de vie qui étaient, à bien des égards, supérieurs à la civilisation impérialiste occidentale.
En 1991 fut publié un Bulletin surréaliste international n° 1, à Stockholm, avec la réponse des groupes de Paris, Prague, Stockholm, Chicago, Madrid et Buenos Aires à une enquête sur la tâche actuelle du surréalisme. Le groupe de Paris insiste dans son texte sur le fait que « le surréalisme n'est pas un ensemble de recettes esthétiques ou ludiques, mais un principe permanent de refus et de négativité, nourri aux sources magiques du désir, de la révolte, de la poésie […]. Ni Dieu ni maître : plus que jamais cette vieille devise révolutionnaire nous semble pertinente. Elle est inscrite en lettres de feu sur les portes qui mènent, au-delà de la civilisation industrielle, à l'action surréaliste, dont le but est le réenchantement (et la réérotisation) du monde ».
Leurs célébrations et les nôtres
Pour protester contre les célébrations pompeuses du cinquième centenaire de la soi-disant « découverte des Amériques » (1992), les surréalistes ont publié en 1992 le Bulletin Surréaliste International n° 2, avec une déclaration commune signée par les groupes surréalistes d'Australie, de Buenos Aires, du Danemark, de Grande-Bretagne, de Madrid, de Paris, des Pays-Bas, de Prague, de Sao Paulo, de Stockholm et des États-Unis. Inspiré d'un essai écrit par la poétesse surréaliste argentine Silvia Grenier, ce document célèbre l'affinité élective du surréalisme avec les peuples indigènes, contre la civilisation occidentale qui a opprimé les peuples indigènes et tenté de détruire leurs cultures : « dans la lutte contre ce totalitarisme étouffant, le surréalisme est – a toujours été – le compagnon et le complice des indigènes ». Le Bulletin est publié en trois langues – anglais, français, espagnol – par les surréalistes de Chicago, qui fournissent en couverture un collage de Franklin et Penelope Rosemont représentant Colomb en Père Ubu d'Alfred Jarry.
Le Musée d'art moderne de Paris (Centre Georges-Pompidou) a ouvert une grande exposition d'art surréaliste au printemps 2002, sous le titre « Révolution surréaliste ». L'exposition n'avait en fait aucune signification révolutionnaire et tentait de présenter le surréalisme comme une expérience purement artistique, utilisant de « nouvelles techniques ». À l'entrée du musée, les visiteurs pouvaient prendre gratuitement un dépliant de quatre pages, qui expliquait que « le mouvement surréaliste voulait prendre une part active à l'organisation de la société » (?),qu'il avait eu une grande influence sur la société, et notamment sur « la publicité et les vidéoclips »… Agacé par ce fatras conformiste, Guy Girard proposa au groupe surréaliste de préparer un dépliant alternatif, sur un même 4 pages, avec des lettres similaires, mais un contenu totalement différent : le surréalisme y est décrit comme un mouvement révolutionnaire dont l'aspiration à la liberté et l'imagination subversive visaient à « abattre la domination capitaliste » ; le dépliant était illustré d'images de femmes artistes comme Toyen ou Leonora Carrington, quasiment absentes de l'exposition, ainsi que d'une photo historique de 1927 : « Notre collaborateur Benjamin Péret insultant un prêtre »… Les membres du groupe ont ensuite soigneusement déposé une pile du dépliant surréaliste sur le dépliant « officiel », afin que les visiteurs le ramassent. Le plus drôle, c'est que les commissaires de l'exposition, interpellés par le tract surréaliste, ont retiré leur propre pièce futile, et l'ont remplacée par une nouvelle, qui essayait de prendre en compte le fait que le surréalisme était un mouvement subversif anti-autoritaire qui dénonçait « la Famille, l'Église, la Patrie, l'Armée et le colonialisme »…
Les différents tracts et déclarations du groupe ont finalement été publiés dans le livre susmentionné, Insoumission Poétique. Tracts, Affiches et déclarations du groupe de Paris du mouvement surréaliste 1970-2010 (Paris, Le Temps des Cerises, 2010). Guy Girard a édité le livre, rassemblé le matériel et les illustrations, et rédigé une brève présentation pour chaque document.
Le temps des rêves
Entre 2019 et 2024, cinq numéros d'une nouvelle revue parisienne ont vu le jour : Alcheringa. Le surréalisme aujourd'hui. Alcheringa est un mot issu d'une langue aborigène d'Australie, signifiant « le temps des rêves », évoqué par André Breton dans son essai Main Première. Enfin, en été 2024 a eu lieu, à la Maison André Breton de Saint-Cirq-la-Popie, l'Exposition surréaliste internationale « Merveilleuse Utopie » organisée par Joël Gayraud, Guy Girard et Sylwia Chrostowska.
Quelles que soient ses limites et ses difficultés, le mouvement surréaliste à Paris a maintenu vivantes, au cours des 50 dernières années, la flamme rouge et noire de la rébellion, le rêve anti-autoritaire d'une liberté radicale, l'insoumission poétique aux pouvoirs en place et le désir obstiné de réenchanter le monde.
Le 18 juin 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le dernier repas, chef d’œuvre de Maryse Legagneur

Dimanche soir 29 septembre, en direct à la Maison du cinéma de Sherbrooke, le sourire de Maryse Legagneur, musicothérapeute et réalisatrice de cinéma, s'illumina par la nouvelle de son portable que Le dernier repas venait de remporter Le Grand Prix du Jury du Festival montréalais des Films Black, comme il avait remporté deux semaines plus tôt la compétition du Festival de cinéma de la ville de Québec (Quebecor) : à prévoir, donc, de nombreuses autres récompenses, puisque ce chef d'œuvre québécois entreprend tout juste sa carrière.
Il raconte la fin de vie de Célestin, héros déchu joué et par Fabrice Yvanoff Sénat dans les nombreux flashbacks de sa jeunesse haïtienne, et par Gilbert Laumord à l'intense présence agonisante dans un hôpital de Montréal ; il se meurt sous nos yeux, non sans avoir goûté plusieurs plats haïtiens préparés par sa fille Vanessa qui s'était pourtant séparée de lui très jeune, victime en ricochet d'une partie de la violence subie en Haïti. Rassurez-vous : ces plats ne contenaient ni chien ni chat, tel que colporté honteusement et frauduleusement par le sinistre duo Trump-Vance, afin de gagner des votes américains anti-immigrants.
Préparés sous nos yeux par la tante qui en veut au vieil homme d'avoir détruit sa sœur (la mère de Vanessa), les plats alléchants - pour lesquels on distribue au cinéma des recettes en fiches colorées -, forment un lien filial miraculeusement restitué au père, sommé d'enfin délier sa langue sur son passé ; or on sait, depuis la madeleine de Proust, combien les saveurs déterrent des souvenirs enfouis.
Musicien mis en prison et condamné à mort parce qu'il avait omis de faire jouer à la radio l'hymne au père Duvalier de la nation, le jeune dessine à la craie sur un mur de sa prison des touches de piano sur lesquelles il s'exerce, vulnérable. La musicienne Maryse Legagneur sait utiliser l'imaginative bande sonore de Jenny Salgado, qui amalgame les images fabuleuses de Mathieu Laverdière en un tout qui reste cohérent et tendu, malgré les nombreux allers-retours dans le passé.
Le calvaire des prisonniers est suggéré par le Libera du Requiem de Gabriel Fauré dans un arrangement feutré qui convient parfaitement à l'atmosphère voulue, par le pianiste Émile Naumoff. Heureusement, ce musicien est bulgare et non pas russe, puisqu'on a vu dans le film italien L'Enlèvement de Marco Bellochio, sur le rapt d'un enfant juif ignoblement enlevé à sa famille par le pape Pie IX, la symphonie expressionniste principale carrément censurée dans les critiques, entrevues et même crédits du film, parce qu'elle est du russe Dimitri Shostakovitch et sans doute interprétée par Valery Gergiev, du Mariinsky de St-Pétersbourg.
Violent par l'authenticité qui dicte à la réalisatrice de respecter des témoignages recueillis pendant des années, le dernier repas s'adoucit grâce à la présence de deux femmes, dont l'héroïne principale, interprétée avec beaucoup de nuances par Marie-Évelyne Lessard et sa tati personnifiée par la non moins excellente Mireille Métellus. Tous les visages éprouvés des acteurs, cadrés de très près, certains recrutés dans la diaspora haïtienne persécutée en République dominicaine, nécessitent une interprétation de rare qualité par ces comédiens plongés dans des huis-clos angoissants de chambre d'hôpital, de cuisine intime ou de geôle surpeuplée au sinistre Fort-Dimanche reconstitué.
On reste néanmoins frappés par l'aspect documentaire de l'œuvre, aidé par plusieurs dialogues en créole, sans paysage de mer ni végétations tropicales, à part un immense quennetier inquiétant dans sa solennité, car on enterre des prisonniers parmi ses racines. Mon fils et moi fûmes aussi impressionnés que la salle, réservant un silence respectueux au générique puis éclatant en ovation debout.
L'extraordinaire pauvreté haïtienne, une punition raciste mondiale
Il y a des parallèles à faire avec les fiables informations de l'exemplaire journaliste Marie-Ève Bédard, déformées en direct par Radio-Canada résumant ses récits d'horreur en « conflits d'Israël contre Hamas et le Hezbollah », niant la volonté de génocide palestinien (i) par Nétanyahou qui bombarde Gaza, la Cisjordanie et les réfugiés palestiniens au Liban. Non, je ne pleurerai pas la mort de l'islamiste Hassan Nasrallah (ii), chef du Parti de Dieu (quelle prétention : est-il allé le rejoindre avec les cent vierges promises ?). De même, le chef d'œuvre cinématographique décrit rappelle le sort des Haïtiens, avec l'indifférence occidentale envers les communautés bombardées ou affamées (Libye, Soudan, Yémen, Kurdistan etc.) et celle condamnée à la misère dictatoriale pour s'être affranchie du racisme et du colonialisme français dès le début du 19e siècle, avec le grand Toussaint Louverture.
Certains observateurs préfèrent voir en Haïti un drame auto-infligé, puisque ses près de 4000 morts depuis le début de l'année 2024 sont le résultat de bandes armées incontrôlées, tout comme l'étaient aussi aux mains des tontons-macoutes les milliers de martyres dont ce film restitue la stature humaine héroïque. Mais la communauté internationale n'est-elle pas la plus grande responsable, celle d'aujourd'hui ignorant les admonestations d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations-Unies, qu'on soupçonne de vouloir reproduire l'intervention malheureuse des Casques Bleus appelés en renfort après le tremblement de terre de 2010 ? Sans préparation, ces troupes importées du Népal auraient répandu le choléra ? Parce que le Premier ministre Harper avait refusé d'envoyer des Casques bleus canadiens bien préparés qu'il était occupé à démanteler, comme M. Trudeau poursuivrait cette démolition par opposition à l'ONU : doit-on comprendre que nos politiciens approuvent les vitupérations anti-ONU de leur allié génocidaire Nétanyahou ?
Haïti est aidée par les UNESCO, UNICEF et UNHCR que le Canada devrait financer, plutôt que de dépenser plus de trente milliards de $ annuels pour l'OTAN guerrière. On lira de Jonathan Katz The Big Truck That Went By : How the World Came to Save Haiti and Left Behind a Disaster, qui calcule que des $657 millions déboursés par le Canada en aide post tremblement de terre jusqu'en septembre 2012, environ 2% parvinrent au gouvernement haïtien. De même, de l'aide de $500 millions de la Croix-Rouge américaine, six maisons permanentes seulement seraient encore debout. Préjugeant le gouvernement Préval trop peu fiable parce que démocratique et opposé à l'extrême-droite haïtienne, le Canada (via le ministre Lawrence Cannon), la France et les États-Unis manœuvrèrent (infos de Wikileaks rapportées par Yves Engler) pour installer au pouvoir Michel Martelly, adolescent d'abord impliqué dans les Tontons Macoutes de Bébé Jean-Claude Duvalier, qui aurait ensuite gagné ses galons dans les coups d'état anti-Aristide 1991 et 2004. Le film « Haïti trahie » d'Elaine Brière le raconte en détails, comme le dénonce aussi un appel récent APLP co-signé par plus d'une centaine de personnes contactées en grande partie par Bianca Mugyenyi et son conjoint Yves (iii).
Enfin, les merveilleux discours solidaires de Haïti, prononcés à l'ONU (encore avant-hier) par la Première ministre des Barbades (iv) qui a libéré son pays de la Reine d'Angleterre, sont à lire, de même que la référence dans cet article à ma collègue uqamienne Martine Delveaux.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Des personnalités du monde de l’art condamnent la censure anti-trans et anti-palestinienne au Royal Exchange Theatre de Manchester

Kingsley Ben-Adir, Khalid Abdalla, Pooja Ghai et April De Angelis font partie des plus de 200 personnalités du monde des arts et du théâtre qui ont signé une lettre ouverte au Royal Exchange Theatre de Manchester condamnant le théâtre pour avoir censuré des références à la libération du peuple palestinien et aux personnes trans dans une œuvre récemment commandée.
Tiré d'Agence médias Palestine.
La lettre critique l'annulation de la nouvelle production du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, mise en scène par Stef O'Driscoll, qui selon les signataires interprète la pièce à travers « le prisme de la culture « rave » contemporaine (…) et (reflète) la diversité et la richesse culturelle qui font la renommée de Manchester ».
Les signataires, qui comprennent des dramaturges, des metteurs et metteuses en scène, des interprètes et des artistes dont près de la moitié vivent ou travaillent à Manchester, y expriment aussi leur consternation devant le constat que cette institution financée par des fonds publics « a censuré un appel à la libération de la Palestine près d'un an après le début du génocide israélien contre la population palestinienne de Gaza »
Les artistes affirment que les efforts visant à supprimer les références aux droits des transgenres sont « injustifiables à une époque où la violence anti-trans ne cesse de s'accroître et où les provocations politiques de la part des politicien·nes britanniques et de certains médias sont nombreuses ».
Le théâtre Royal Exchange a censuré les expressions « Palestine libre », et a aussi tenté de censurer l'expression « droits des trans », selon une déclaration de la metteuse en scène Stef O'Driscoll.
Les artistes demandent au théâtre de s'excuser et de « prendre des mesures significatives et visibles pour remédier à ses graves manquements ».
La lettre ouverte dans son intégralité
Nous, artistes, travailleurs et travailleuses dans le domaine de la culture, condamnons la censure exercée par le Royal Exchange Theatre sur les expressions de solidarité avec le peuple palestinien et avec la communauté trans, une censure qui a conduit à l'annulation de la production du Songe d'une nuit d'été mise en scène par Stef O'Driscoll.
Metteuse en scène de théâtre très respectée, O'Driscoll est connue pour son engagement en faveur de la politique décoloniale et de la libération collective. O'Driscoll a expliqué que cette production du Songe d'une nuit d'été explorait la pièce à travers le prisme de la culture « rave » contemporaine, la mise en scène devant refléter la tradition d'activisme politique de cette sous-culture, ainsi que la diversité et la richesse culturelle qui font la renommée de la ville de Manchester.
La récente déclaration du Royal Exchange contient des affirmations trompeuses sur le manque de « récit cohérent » de la production pour justifier ses actions, ce que la metteuse en scène Stef O'Driscoll a clairement réfuté dans une précédente déclaration. The Exchange n'inclut à aucun moment dans sa déclaration les expressions « Palestine libre » ou « droits des trans » et fait plutôt de vagues références à des « questions complexes ». Les expressions « Palestine libre » et « droits des trans » sont de simples déclarations de droits humains fondamentaux. Leur caractérisation par Royal Exchange de « questions complexes » est une tentative d'obstruction visant à échapper à toute responsabilité.
Nous condamnons cet acte de censure raciste et transphobe commis par le Royal Exchange Theatre.
Qu'une institution publique censure un appel à la liberté palestinienne près d'un an après le début du génocide perpétré contre la population palestinienne de Gaza par Israël – armé et soutenu par le Royaume-Uni et d'autres États occidentaux, réduisant au silence les artistes palestinien·nes en les tuant et en détruisant leurs infrastructures culturelles – montre un niveau choquant de complicité dans l'impunité accordée à Israël. La tentative de censure des références aux droits des trans est également injustifiable à une époque où la violence anti-trans s'accroît et où les provocations politiques de la part des politicien·s britanniques et de certains médias sont nombreuses.
Le Royal Exchange Theatre est un bâtiment historiquement lié à la traite négrière situé dans une ville qui s'est enrichie grâce à l'industrie du coton, construite grâce au travail des Africains et Africaines réduit.es en esclavage. Le Royal Exchange ne peut donc point prétendre être un espace apolitique à l'écart des violences coloniales passées et actuelles. La seule façon pour les institutions artistiques britanniques de s'opposer à l'exploitation systémique, à la déshumanisation politique des communautés marginalisées et à la complicité du Royaume-Uni dans la violence coloniale et le génocide en cours, est de soutenir activement l'égalité, la dignité et la libération de toutes les personnes opprimées.
Nous savons qu'un nombre considérable d'employé.es du Royal Exchange partagent notre dégoût face aux actions de sa direction. Cette lettre a pour but de demander à la direction du théâtre d'offrir des excuses sincères pour avoir silencié ces appels à l'égalité des droits et à la libération, et de s'engager à prendre des mesures significatives, quantifiables et transparentes pour remédier à ses graves manquements.
En tant qu'artistes, travailleurs et travailleuses dans le domaine de la culture, nous soutenons l'égalité fondamentale et le droit à la dignité du peuple palestinien et de la communauté trans. Nous soutenons la lutte pour la libération collective et pour une fin de l'occupation, de l'apartheid et de l'oppression violente. Nous soutenons le droit des artistes britanniques à exprimer leur solidarité avec les communautés marginalisées, et le droit des artistes issu.e.s de communautés marginalisées à participer à la création artistique et à l'offre public de celle-ci, ainsi qu'à faire valoir leurs droits intrinsèques.
Si les institutions culturelles ne permettent pas aux artistes d'exprimer librement leur désir de liberté, d'égalité et de libération collective, ces institutions n'ont jamais été véritablement les nôtres. Un théâtre qui refuse d'accueillir les Palestiniens et Palestiniennes, les personnes transgenres et celles et ceux qui les soutiennent, n'est pas digne de représenter nos communautés.
Nous exigeons que :
- le Royal Exchange s'excuse d'avoir tenté de faire taire les expressions de libération palestinienne et trans.
Dans sa propre déclaration de vision et de mission, le Royal Exchange affirme : « Nous présenterons des excuses lorsque nous aurons fait quelque chose de mal. » Dans la section Politiques de son site Web, le Royal Exchange déclare : « La transparence avec tous nos publics, clients, visiteurs, collaborateurs, artistes, pigistes et bénévoles, est une valeur que nous tenons à cœur. »
- le Royal Exchange reconnaisse que ses tentatives visant à faire taire les expressions de libération collective étaient racistes et transphobes.
Au moins 41 000 Palestinien.ne.s ont été tué.e.s par le génocide israélien à Gaza, et une lettre parue dans le journal scientifique, Lancet, estime que le bilan pourrait atteindre 186 000. Les personnes transgenres au Royaume-Uni sont victimes d'un nombre record de crimes haineux alimentés par les politiques et discours de déshumanisation proférés par les politicien·nes , le système de santé et par certains médias.
- le Royal Exchange clarifie sa propre position sur le racisme, la transphobie et la libération collective.
Comment le Royal Exchange peut-il prétendre soutenir les artistes transgenres et tous·tes les artistes alors qu'il ne défend pas leur droit à vivre librement et à en exprimer l'exigence ? Comment le Royal Exchange peut-il valoriser « l'égalité, la diversité et l'inclusion » tout en réduisant au silence tout soutien à celles et ceux qui sont confronté.es à l'exclusion violente, à l'oppression et au meurtre en raison de leur nationalité, de leur race, de leur origine ethnique et/ou de leur identité de genre.
- le Royal Exchange prenne des mesures significatives, visibles, et quantifiables pour remédier à ses graves manquements.
Le Royal Exchange doit s'engager publiquement à ce que les expressions de libération des Palestinien.ne.s et des transgenres (ainsi que celles de toutes les autres luttes pour l'égalité des droits et la libération collective) ne soient plus jamais étouffées dans ses productions. Cet engagement public doit être pris en consultation avec les Palestiniens et les Palestiniennes, les personnes transgenres, les autres communautés marginalisées et les membres de la communauté artistique, afin de fixer des objectifs, des délais et des résultats susceptibles d'être évalués. La direction du Royal Exchange doit organiser des réunions régulières tout au long de ce processus avec les dits groupes afin de garantir que les appels à la libération et à la liberté contre l'oppression ne soient plus jamais étouffés dans ses murs.
Ce texte est signé en solidarité avec le peuple palestinien, les personnes transgenres et toutes celles et tous ceux qui luttent pour leurs droits et leur libération.
Les travailleur-euses de l'art sont invité-es à le signer ici
Signataires
Khalid Abdalla Actor
Kingsley Ben-Adir Actor
April De Angelis Playwright
Bill Bankes-Jones Director
Naomi Evans Author : Everyday Racism
Pooja Ghai Artistic Director : Tamasha
Enyi Okoronkwo Actor
Valerie Synmoie Theatre Executive Director : Tamasha
Adele Thomas Opera Director
Daniel York Loh Writer / Actor
Sînziana Cojocărescu Artistic Director : BÉZNĂ Theatre
Ruth Daniel CEO : In Place Of War
Yara Rodrigues Fowler Novelist
Emma Reynolds Illustrator and Author
Lucy Sheen Actor / Writer / Director and Filmmaker : BEATS.org
Dani Abulhawa Director / Performer / Academic
Faiza Abdulkadir Fundraiser : HighRise Theatre
Elina Akhmetova Dance / Theatre / Film / Performance & Choreography
Alia Alzougbi Artists & Cultural Producer
Ravina Al-Zarifa Supporting Artist
Alan Jones Photographer
Audrey Albert Visual Artist
Heather Alderson Visual artist
Aisha Allinson Writer
Cindya Angel Dancer
Divya Avula Visual artist – Manchester
Stella Barnes Theatre and Participatory Arts Practitioner
Morgan Bassichis Performer
Sarah Bedi Director / Writer
Marcus Berdaut Creative Producer
Dylan Best Visual Artist
Giovanni Bienne Actor : Equity LGBT+ Councilor
Irene Bindi Artist and Editor
Adelheid Bjornlie Writer
Luz Blanco Santos DJ / Creative Producer / Facilitator
Roo Bramley Musician and stage performer
Jamie Brown Musician
John-Paul Brown Visual Artist
Tam Dean Burn Actor / Theatremaker
Nafeesah Butt Theatremaker : TEAM
Yasmin Butt Theatre Booking Coordinator
Jen Calleja Writer
Elena Cantu Front of House Staff
Anthony Capildeo Writer and Editor
Cathy Chapman Writer, Lit Fest Volunteer
Julie Cheung-Inhin Actor
Taghrid Choucair-Vizoso Cultural Worker / Curator /Artist
Dominic Cisalowicz Visitor Fundraiser
Dæmon Clelland Artist / Performer / Curator
Anna Cole Associate
Paule Constable Lighting designer
Joseph Conway Producer / Writer : Manchester Theatre for Palestine
Algernon Cornelius Musician
Alastair Curtis Director : The AIDS Plays Project
Mohamed-Zain Dada Playwright
Helen Davies Visual artist
Marion Dawson Theatre Captioner
Guido Di Bari Dancer
Emma Dibb Designer and academic
Meray Diner Filmmaker
Campbell Edinborough Associate Professor in Creative Practice
Jessica El Mal Artist and curator
Heidi El-Kholy Designer
Lizzie Eldridge Writer
Leonor Estrada Francke Theatre Director/ Performer
Sorcha Fhionntain Playwright
Jude FireSong Performance Poet / Speculative Fiction Writer / Artist
Elaine Fisher Visual Artist
Joey Frances Poet
Jasmine Gardner Visual artist
Tommy Garside Actor
Ruth Geye Playwright
Becks Gio Joe Artist-Curator
Nathan Godfrey Engagement Coordinator
Lisa Goldman Writer / Dramaturg / Director
Pauline Goldsmith Actor / Writer
Jacob Gower Writer
Gráinne Gráinne O'Mahony Theatremaker / Arts Comms Worker
Leila Greci Programme and partnerships manager
Jade Grogan Editor
Alexander Guedeney Visual Artist
Noor Hadid Actress / Front of House Staff
Daisy Hale Producer
Kit Hall Dancer / Choreographer / Producer
Rida Hamidou Playwright
Annie Hanauer Choreographer
Bonnie Hancell Poet
James Harker Playwright
Tessa Harris Writer
Jan-Sarah Harrison-Shakarchy Visual artist
Zainab Hasan Actress
Sabrin Hasbun Writer
Jo Hauge Live Artist
Alex Haydn-Williams Editor
Leila Herandi Actor
Azhar Herezata-Ala Poet
Jay Hermann Director
Hazel Holder Voice Coach
Lewys Holt Artist
Kirsty Housley Director / Dramaturg / Writer
Laura Howard Lighting Designer
Tuheen Huda Performance Artist / Writer / Poet.
Sonia Hughes Artist
Sameena Hussain Director
Sarah Impey Artist : Equity REC
Irvine Iqbal Actor
Deeqa Ismail Fine artist
Leveret Jaques Sound designer
Jayce Jayce Salloum Visual Artist
Tom Jeffreys Writer
Joe Clark Actor
Jessie Jones Communications Manager
Nick Jones Producer / Story Teller
Adele Jordan Artist
Jamil Keating Artist / Theatremaker : Co-Director of Northern Light Film CIC, Associate Artist of CNOA, Member of Divergency
Susan Kempster Choreographer
Rahela Khan Visual Artist
Michael Kitchin Producer
Karol Kochanowski Visual artist
Lora Krasteva Performance artist
Jo Lane Writer / Director
Jo Lansley Artist
Ruth Lass Actress
Em Laxton Sound designer
Ciara Leeming Photographer / Writer
Jazmine Linklater Editor / Writer : Corridor8
Alexandra Lort Phillips Producer
Caroline Magee Actor / Playwright
Tanushka Muna Director
Emily Marsden Cultural Worker
Sara Masry Actor
Chloe Massey Actor
axmed maxamed Writer
MJ McCarthy Composer / Sound Designer
Elizabeth McLoughlin Artist (Painter)
Prema Mehta Lighting Designer
Leila Mimmack Actor
Hussein Mitha Artist
Nicola Moore Visual Artist / Art Therapist
Ishana Moores Events staff
Sam Murray Painter
Chris Myers Actor : Theatre Workers for a Ceasefire
Sînziana Myers Writer
Martha Nabila Writer
Emma Nafz Stage Manager
Rehab Nazzal Visual Artist / Filmmaker / Educator
Kate Neilan Marketer of Books : Unbound
Sinéad Nunes Marketing Manager : Heart of Glass
Fionn Ó Loingsigh Actor
Ioana-Melania Pahome Artist-Curator
Polly Palmerini Visual arts
J.C. Pankratz Playwright
Emma Jayne Park Dancer / Theatre Maker
Kim Pearce Theatre Director
Miranda Pennell Filmmaker
Joshua Pharo Lighting Designer
Ergo Phizmiz Composer / Writer / Director : Avanthardcollective
Aniela Piasecka Dance Artist and Choreographer
Jamie Potter Theatremaker
Cara Powell Producer
Em Pren Deaf Theatremaker
Candice Purwin Illustrator and Graphic Novelist
Sara Ramirez Actor / Producer
Jake Rayner Blair Actor / Theatremaker
Khadija Raza Set and Costume Designer
Devan Reid Artist
Mais Robinson Facilitator
ML Roberts Writer / Performer
Danusia Samal Actor / Playwright
Kareem Samara Musician / Composer
Lenni Sanders Writer
Michal Sapir Musician / Writer
Aran Savory Artist
Iona Schwalowsky-Monks Visual Artist
Davina Shah Agent : TEAM
Rajha Shakiry Designer
Sabine Sharp Scholar
Evie Siddal Visual and Performance Artist
Eleanor Sikorski Choreographer / Filmmaker / lecturer
Greg Simmons Screenwriter
Christine Singer Writer
Beth Sitek Producer
Eyal Sivan Filmmaker
James Skull Writer, assistant director, actor
Ceallach Spellman Actor
Abena Louisa D B St Bartholomew-Brown Morgan Actor
Amanda Stoodley Designer
Sam Swann Actor
Laura Swift Editor
Humera Syed Actor
Karl Taylor Producer : BUZZCUT
Giles Thomas Composer / Sound Designer
Abir Tobji Producer
Jo Tyabji Director
Jamie Tyson Musician
Josie Underwood Theatremaker : Silent Faces
Paula Varjack Theatremaker
Borja Velez Playwright
Jai Vethamony Actor
Clara Vulliamy Author and Illustrator
Darcy Wallace Choreographer
Sylvia Waltering Visual artist
Stephanie Webber Visual artist
Hilary White Writer
Don Wilkie Record Label Owner : Constellation Jack Young Writer
Traduction : BM pour l'Agence Média Palestine
Source : Artists for Palestine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
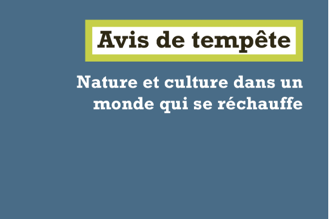
Andreas Malm et "Avis de tempête" : Nature et culture dans un monde qui se réchauffe

Dans un monde qui se dirige vers le chaos climatique, la nature est morte. Elle ne peut plus être séparée de la société. Tout n'est plus qu'un amalgame d'hybrides, où l'homme ne possède aucune puissance d'agir particulière qui le différencie de la matière morte. Mais est-ce vraiment le cas ?
Dans cette polémique cinglante avec les philosophies néomatérialistes et celles du « tournant culturel » – dont Bruno Latour est la figure centrale –, Andreas Malm développe un contre-argument : dans un monde qui se réchauffe, la nature revient en force, et il est plus important que jamais de distinguer le naturel du social. C'est en attribuant aux humains une capacité d'action spécifique que la résistance devient concevable.
Ce livre pose des questions urgentes à l'heure où l'inaction climatique à l'échelle mondiale inquiète de plus en plus de gens : quel rôle doivent jouer la pensée théorique et la science dans la lutte contre le réchauffement mondial ? Ce qui s'écrit aujourd'hui est-il à la hauteur du défi ? Comment enfin réarmer conceptuellement un militantisme écologique à même de le relever ?
« Andreas Malm s'attaque à la pensée de Latour et Descola », Reporterre, 3 novembre 2023.
« Les violentes conséquences naturelles du réchauffement climatique, pour le marxiste Andreas Malm, exigent de repenser la distinction entre rapports sociaux et causes naturelles, pour mieux comprendre leur combinaison et lutter efficacement pour le climat. » La vie des idées, 7 décembre 2023.
« Avis de tempête : Lénine contre Latour », Socialter, 8 janvier 2024.
Andreas Malm
Andreas Malm est maître de conférences en géographie humaine en Suède et militant pour le climat. Il est l'auteur de L'anthropocène contre l'histoire (2017), Comment saboter un pipeline (2020), La chauve-souris et le capital (2020) et Fascisme fossile (avec le Zetkin Collective, 2021).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
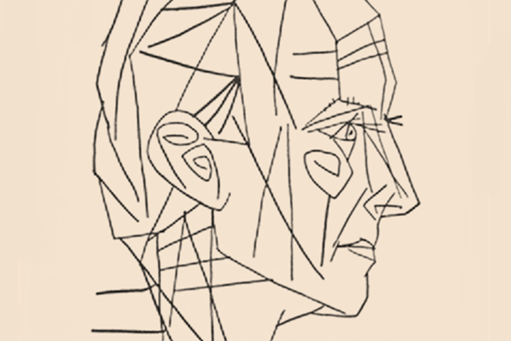
Un poème peut transformer le monde

Paris. Vendredi, 4 octobre 2024. Les éditions de Minuit republient Liberté de Paul Eluard, de son vrai nom Eugène Grindel (1895-1952), également connu sous les pseudonymes Didier Desroches, Jean du Haut, Maurice Hervent.
PHOTO : Portrait de Paul Eluard par Pablo Picasso
Il fallait bien brouiller les pistes pendant la résistance. Eté 1941. Paris sous occupation allemande. La destinataire initiale du poème est Nusch Eluard (1906-1946), de son nom de naissance Maria Benz, alsacienne, muse incomparable des surréalistes. Paul Eluard lui dédie, après sa mort, ces vers terribles, gravés sur la stèle de sa tombe au cimetière du Père Lachaise : « Vingt-huit novembre mille neuf cent quarante six. Nous ne vieillirons pas ensemble. Voici le jour en trop. Le temps déborde. Mon amour si léger prend le poids d'un supplice ». L'auteur explique la genèse de Liberté : « En composant les premières strophes, je pense révéler, pour conclure, la femme que j'aime. Mais, je m'aperçois rapidement que le seul mot qui se présente à mon esprit est liberté. Ainsi la femme que j'aime incarne un désir plus grand qu'elle ». Le poème, entamé en 1941, est achevé en mai 1942. Le manuscrit est confié à Max-Pol Fouchet, directeur de la revue littéraire et poétique Fontaine à Alger, foyer de l résistance intellectuelle. Le poème est publié, pour la première fois, en juin 1942 sous le titre Une seule pensée pour éviter l'interdiction. Max-Pol Foucher reçoit néanmoins un avertissement des autorités pétainistes : « La Censure centrale remarque depuis longtemps que votre revue, de caractère strictement littéraire, publie des poèmes, des contes, des analyses critiques où l'on trouve des allusions transparentes aux événements politiques, allusions nettement hostiles ».
Liberté est également publiée à Paris, en septembre 1942, par le groupe La Main à plume, dans une plaquette de vingt-huit pages, tirée en cinq mille exemplaires, clandestinement distribuée dans les universités, les lycées, les usines. Le poète, menacé d'arrestation, quitte son domicile. De novembre 1943 à mars 1944, Nusch et Paul Eluard se réfugient dans l'hôpital psychiatrique de Saint Alban en Lozère. Ils rentrent à Paris au printemps 1944. Paul Eluard fonde, avec Louis Parrot, L'Eternelle Revue avec l'exergue : « Une fois de plus, la poésie mise au défi se regroupe, crie, accuse, espère ». De santé fragile, le poète est foudroyé par une crise cardiaque à l'âge de cinquante-six ans. Le gouvernement français, engoncé dans les guerres coloniales, refuse de lui accorder des funérailles nationales.
Dès décembre 1942, Liberté est reproduit, en France et à l'étranger, dans de nombreuses publication, dans la revue France Libre à Londres notamment. Le poème est souvent repris sans nom d'auteur. Il gagne d'emblée le domaine public. Il est illustré par des artistes de renom, mis en musique par Francis Poulenc. Pendant l'été 1943, le compositeur crée Figure humaine, cantate pour double chœur mixte a capella. Jean Lurçat réalise une tapisserie aujourd'hui conservé au Centre Beaubourg Paris. Le service britannique Political Warfare Executive publie Liberté dans la Revue du Monde Libre et le largue par avion sur la France dans le cadre des opérations Nickel Raid. Deux aviateurs y laissent la vie.
Cinq dessins Liberté, j'écris ton nom, encre, gouache et graphite sur papier, commandés en 1953 par l'éditeur Pierre Seghers à Fernand Léger (1881-1955), un an après le décès du poète, donation de Louise et Michel Leiris en 1984, sont visibles au Centre Beaubourg Paris. Paul Eluard est représenté pensif, coloré de vert, de bleu, de jaune et de rouge. Fernand Léger réalise un livre accordéon, imprimé au pochoir, en tirage limité de 212 exemplaires. En novembre 2016, l'ouvrage reparaît à l‘identique. Au cinquième étage du siège du Parti communiste français, construit par Oscar Niemeyer place du colonel Fabien à Paris, trône le poème Liberté illustré par Fernand Léger, une tapisserie tissée en avril 1963 dans les Atelier Tabard Frères à Aubusson.
Paul Eluard s'engage tout au long de sa vie contre le colonialisme. Il soutient les marocains pendant la guerre du Rif (1921-1927). Il s'oppose, à l'exposition coloniale de 1931, dirigée par le maréchal Hubert Lyautey, honorée de la présence du sultan du Maroc, Mohammed Ben Youssef. Le pavillon marocain est un palais avec une porte monumentale, entouré de patios. L'orientalisme dans son expression la plus caricaturale. J'ai visité récemment le château d'Hubert Lyautey dans le petit village lorrain de Thorey, à une trentaine de kilomètres de Nancy, grande demeure surchargée de tableaux pittoresques, d'objets artisanaux, de photographies avec les deux sultans de l'entre-deux-guerres. Au dernier étage, une peinture géante représentant Moulay Youssef, un salon marocain archaïque, désuet. Des personnages pathétiques veillent sur l'héritage.
Tract Ne visitez pas L'Exposition Coloniale. « Brigandage colonial. On a envoyé en Afrique, en Asie, des navires, des pelles, des pioches pour créer du travail contre un salaire misérable, comme un don fait aux indigènes. Il est donc naturel, prétend-on, que le labeur de ces millions d'esclaves nous rapporte des montagnes d'or. Nous tenons les zélateurs de cette entreprise pour des rapaces. Les Hubert Lyautey, les Jacques-Louis Dumesnil, les Paul Doumer, qui tiennent le haut du pavé dans la France du Moulin Rouge, ne sont que des figurants du carnaval des squelettes. Les promesses de l'affiche de recrutement des troupes coloniales sont éloquentes : une vie facile, des négresses alléchantes, des pousse-pousse tirés par les indigènes. Rien n'est épargné pour la promotion. Un sultan chérifien en personne bat la grosse caisse à la porte de son palais en carton-pâte. Les conquérants des paradis coloniaux s'enorgueillissent du Luna-park de Vincennes. Contre les discours patriotiques, les exécutions capitales, exigez l'évacuation immédiate des colonies et la mise en accusation des généraux, des fonctionnaires responsables des massacres du Maroc, d'Annam, du Liban » (André Breton, Paul Eluard, Benjamin Péret, Georges Sadoul, Pierre Unik, André Thirion, René Crevel, Louis Aragon, René Char, Maxime Alexandre, Yves Tanguy, Georges Malkine).
Une contre-exposition s'intitule La Vérité sur les colonies. L'artiste allemand John Heartfield, de son nom d'état civil Helmut Herzfeld (1891-1968), ami de Louis Aragon, réalise un photomontage de deux poings levés, noir et blanc, couverture de la revue Social Kunst, n° 8, 1932, préfiguration des luttes pour l'indépendance. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Une photographie de Man Ray est publiée dans le magazine Vogue de mai 1926 sous le titre Visage de nacre, Masque d'ébène. L'égérie Kiki de Montparnasse pose avec un masque africain. Le négatif décline des spectres. Aux lendemains de l'exposition coloniale, des œuvres déshabillent l'imaginaire occidental. Se tournent en dérision les fantasmes esclavagistes. Le magazine Vu publie, en 1934, un hors série sur la colonisation. Sur une d'Alexandre Liberman. un colosse noir porte la civilisation occidentale sur la tête. Projection délirante. Force physique, mollesse cérébrale. Victor Hugo lui –même, concepteur de la colonisation africaine, anti-esclavagiste convaincu, raciste avéré, n'appelle-t-il pas les noirs les pieds plats. Années trente, les génies du jazz se révèlent. Se célèbrent les métissages, au nez et à la barbe du suprématisme. En 1934, Nancy Cunard publie à Londres Negro Anthology, avec 250 textes d'auteurs de 155 autrices et auteurs africains, caraïbéens, américains. L'ouvrage de neuf cents pages n'est traduit en français aux éditions du Sandre qu'en 2023.
Je reçois, aujourd'hui même, un opus d'une vingtaine de pages signé Raoul Vaneigem, titré Abolir la prédation, redevenir humain, Appel à la création mondiale de collectivités en lutte pour une vie humaine libre et authentique, éditions Grevis. L'incipit, d'une formule percutante dont le philosophe a le secret, résume l'enfer actuel. « Nous avons fait de l'homme la honte de l'humanité. Du plus lointain des temps à nos jours, aucune société n'atteint le degré d'indignité et d'abjection attesté par une société agro-marchande qui passe, depuis dix-mille ans, pour la civilisation par excellence. Ce qui s'impose ainsi, en fait, c'est la dénaturation de l'être humain. On chercherait en vain parmi les carnassiers les plus impitoyables, une cruauté aussi délibérée, une férocité aussi inventive. L'opinion publique préformée prend parti pour l'un ou l'autre belligérant, comme s'il s'agissait d'un match de football. Les paris sont ouverts. Les hourras des spectateurs couvrent les hurlements des foules massacrées. Les rapacités financières orchestrent la dénaturation humaine, rythment les apathies, ponctuent les frustrations, déchaînent la haine meurtrière ».
Manque, pour comprendre cette traversée des ténèbres, la pensée percutante, turbulente, du philosophe Gilles Deleuze. « Nous vivons dans un monde plutôt désagréable, où non seulement les gens, mais les pouvoirs établis ont intérêt à nous communiquer des affects tristes. Les affects tristes diminuent notre capacité d'agir. Les pouvoirs établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves. Les tyrans, les preneurs d'âmes, ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous réprimer que de nous angoisser, d'administrer nos petites terreurs intimes, de neutraliser les surgissements de la vie. Leur arme de dissuasion est la mort. Les vampires ne nous lâcheront pas tant qu'ils ne nous auront pas communiqué leur névrose, leur angoisse, leur castration, leur ressentiment, leur immonde contamination » (Gilles Deleuze).
Les humains perdent leur créativité. Ils ne pilotent plus leur destinée. Les ethnocides, les liberticides engouffrent l'insoutenable, l'invivable dans des régions entières. Le génocide le plus atroce, le plus brutal, le plus sanglant se justifie par des raisons sécuritaires. Qui vole aujourd'hui au secours des palestiniens en dehors des indignations de la rue ? Des voix juives intelligentes, courageuses, s'élèvent, au sein de l'impérialisme américain, contre l'ignominie sioniste. Légitime défense du pot de fer contre le pot de terre. Les discours fascistes, les actes monstrueux, les arguments fallacieux trouvent échos favorables dans les grands médias. Les consciences dévoyées s'abreuvent au spectacle des civils abattus à bout portant, des villes rasées par les bombes au phosphore blanc. Le profit prospère dans la destruction. La vie est un crime aux yeux des exterminateurs, des sociopathes détenteurs de pouvoir étatique. Contrairement aux psychopathes qui se défoulent sur des souffre-douleurs particuliers, les sociopathes ciblent des collectivités entières. Le massacre se digitalise. La boucherie se rentabilise. Les gouvernances décrédibilisées, noyées dans leur emphatique ignorantisme, aspirées par le vide, se militarisent faute d'autres moyens de s'imposer. Le pire se professe comme une fatalité. C'est la mort qui se démocratise. Je me dis : l'humanité touche le fond, elle ne peut que remonter. Je constate que le fond se creuse encore plus. Les incultes deviennent les maîtres, les charlatans les gourous, les intellectuels médiatiques les marionnettes. Les jeunes sous tutelle. Les vieux sous curatelle. La peur, une drogue populaire. Que revoit-on aujourd'hui dans plusieurs capitales européennes ? Des défilés de chemises noires, des revenants phalangistes, des spectres fascistes.
Dans ce monde à la dérive, déshumanisé, technocratisé, déconscientisé, robotisé, le salut ne peut venir que de l'art et de la poésie. Comme en Mai 68. Nous avons chanté, le temps d'une fête révolutionnaire, pacifique, le désir de liberté et la liberté des désirs. Les graines semées tardent à refleurir. Les monstruosités déculpabilisées, des dévastations décriminalisées sont de retour. Le poème est plus vital, plus salutaire que jamais. Réciter Liberté de Paul Eluard. Regarder Guernica de Pablo Picasso. Combiner leurs variations allégoriques. Leurs correspondances métaphoriques. Et l'âme étincelle de mille espérances.
Mustapha Saha
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Manifestation parisienne pour un cessez-le feu au Moyen-Orient

Un an après le 7 octobre, le Moyen-Orient est au bord de l'embrasement. Comptable d'une victoire envers ses partisans pour sa réélection, le Premier ministre Netanyahou, fort du soutien américain, fait face à plusieurs fronts. A Paris, des voix s'élèvent pour un cessez-le feu.
De Paris, Omar HADDADOU
Mépris et vol en éclats du Droit international !
L'escalade au Moyen-Orient a pour point d'orgue un refus du cessez-le feu par Benyamin Netanyahou qui, les mains libres, profiterait, selon des spécialistes du Moyen - Orient, du calendrier électoral américain pour mener à terme sa stratégie d'éradication du Mouvement de Résistance Islamique HAMAS. A ce propos, il sentencie : « Israël changera la réalité sur le terrain ».
Et le Président turc de rétorquer le même jour (hier 7 octobre ) : « Israël paiera tôt ou tard le prix de ce génocide ».
Outre Atlantique, l'administration Biden, soucieuse de l'échéance présidentielle du 5 novembre, remue ciel et terre pour l'apaisement entre l'état hébreu et l'Iran. Mais le Premier ministre, faisant fi des « recommandations » de son mentor américain, a déjà esquissé sa feuille de route pour venir à bout de toute résistance au Moyen-Orient et détruire les infrastructures nucléaires iraniennes (Natanz). Pari risqué ! font observer des Analystes.
D'où les débats nourris sur les rapports de force dissymétriques, articulés, d'une part, par une puissance militaire soutenue par la première armée au Monde, recourant aux bombes pénétrantes au phosphore et à l'intelligence artificielle, et de l'autre, une résistance régénérante à travers l'élan de solidarité régionale, biaisant toute prédiction quant à l'issue du conflit.

L'assassinat du chef du Hizbollah, Hassan NasrAllah, n'a fait qu'intensifier les hostilités, ponctuées par le lancement de 200 missiles sur le territoire israélien.
Sommes-nous à un point de bascule vers une guerre à grande ampleur ?
L'opinion internationale, ou du moins les esprits dotés de discernement cartésien, retiendront qu'un an après les événements du 7 octobre et leur bilan tragique de 41. 000 morts et 96 000 blessés, dont 60 % des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza, et 1 205 côté israélien, la Paix revendiquée à cor et à cri et la libération des otages, semblent compromises.
Intraitable, le Premier ministre de l'Etat hébreu a défendu bec et ongle son entreprise, n'hésitant pas à tancer Emmanuel Macron : « Un embargo sur les armes à destination d'Israël. Quelle honte ! » et d'ajouter « Soyez assurés, que Israël gagnerait même sans leur soutien ». « Nous continuerons à combattre ».

Hier sur les chaines françaises, le grand Rabbin de France, Haïm Horsia, se voulait le chantre de l'engagement pacifique : « Il faut parler de Paix ! Israël doit vivre dans l'espérance et non pas dans la haine ».
Ironie du déroulé belliqueux, l'aviation israélienne a mené, ce lundi, des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Le Ministère de la Santé a fait état de 2 083 morts, 9 869 blessés et 1,5 millions de déplacé-e-s.
Dans l'agenda de Tsahal pour les heures à venir, serait inscrit un bombardement « de la zone côtière du sud du Liban ».
La guerre et son cortège de victimes, épandue tel un torrent quittant son lit, échappe aux Instances internationales, à savoir l'ONU, la Cour Pénale Internationale (CPI) et la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), réduites à des organes de Constat ! Les Peuples, témoins du dictat de l'Occident qui s'approprie la Démocratie et référencie la barbarie, prennent acte de la domination et ses alliances concertées.
Netanyahou a les mains libres. Hier, il a encore promis de « continuer le combat pour l'anéantissement du Hamas et le retour des otages ».
En France, le chef de l'Etat et son Premier ministre Michel Barnier ont opéré un braqué de 360°, témoignant leur soutien à Netanyahou.
Une position qui a sorti de ses gonds ce samedi 5 novembre, Place de la République, le Nouveau Front Populaire et son satellite La France Insoumise, menée par un Mélenchon furibond et indigné de la situation au Moyen-Orient . Marquant leur solidarité avec les peuples libanais et palestinien, des dizaines de milliers de manifestants (es) ont défilé dans Paris, appelant au cessez-le feu, dénonçant « la connivence des Etats-Unis et de l'Europe, la lâcheté de certaines monarchies arabes et la passivité des Instances internationales, face au génocide ».
Dans le cortège couroucé, nous avons pu, par chance, échanger (en arabe) avec Soumaya Kriki, une rescapée de la guerre au Liban. Elle parlait posément, puis évoquant la tragédie au sein de sa famille et au village, elle s'est mise à tonitruer : « Je viens du sud du Liban, terre des Combattants ! J'ai assisté à des guerres atroces dans mon pays, mais celle-ci est la plus ignominieuse, la plus féroce (charissa). Le crime n'en finit pas. Tout est « boucherie ! ». « Ils bombardent les centres de santé, les crèches. Ils appellent cela se défendre. Tout le monde dit, on est vivants ! mais on ne sait pas de quoi sera fait demain ... »
Les larmes roulant sur ses joues émaciées, elle balbutie, anéantie : « Le Monde nous a abandonnés ! »
O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
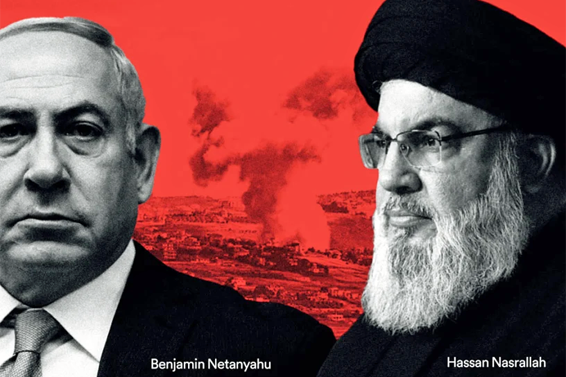
Il ne revenait pas à Netanyahou d’exécuter Nasrallah.

Samedi 28 septembre 2024 : le Hezbollah vient de confirmer que son chef, Hassan Nasrallah, a été tué par le bombardement israélien du quartier de Beyrouth où il se trouvait. Il n'est pas le seul : le bombardement a fait officiellement « au moins 6 morts et 90 blessés », s'ajoutant aux centaines de civils tués ces derniers jours au Liban. Un million de personnes ont fui le Sud du Liban, certains passant en Syrie – faut-il être terrorisé pour se réfugier en Syrie …
28 septembre 2024 | tiré du site d'Author
https://aplutsoc.org/2024/09/28/il-ne-revenait-pas-a-netanyahou-dexecuter-nasrallah/
Hors de question de pleurer Nasrallah. Sa mort a été célébrée à Idlib, où n'existe pas la moindre sympathie pro-israélienne. Les dizaines de milliers de victimes syriennes, libanaises et palestiniennes des nervis, des tueurs et des tortionnaires du Hezbollah sont en droit d'acter cette élimination avec satisfaction, mais ils le font avec une double amertume.
D'abord, c'est à elles et à eux qu'elle appartenait, pas à Netanyhaou et pas à l'Etat israélien.
Netanyahou est dans une impasse à Gaza. 45 000 morts et sans doute plus, des centaines de milliers de personnes acculées dans les décombres à la famine, au trauma et à la maladie, mais impossible de « détruire le Hamas » : possible seulement de massacrer les Gazaouis.
Et c'est bien – on y reviendra – parce qu'il y a risque réel de génocide comme sortie barbare de cette situation du point de vue de Netanyahou et de l'extrême-droite israélienne, que la proclamation obsessionnelle du « génocide », souvent antérieure, d'ailleurs, à octobre 2023, occulte la situation réelle de massacre et de destruction qui conduirait à un génocide effectif, lequel doit être interdit maintenant en imposant un cessez-le-feu et la libération conjointe des otages du Hamas et des prisonniers politiques palestiniens en Israël.
Cessez-le-feu et libérations conjointes doivent être imposés par une campagne internationaliste globale, impliquant les syndicats portuaires, pour stopper les livraisons d'armes, principalement nord-américaines, à Tsahal. Ce que n'est pas le mouvement « pour la Palestine » dans les universités occidentales, toujours hurlant au « génocide » mais inefficace pour empêcher son arrivée effective.
Ce sont les contradictions internes à l'impérialisme nord-américain et la pression de l'opinion publique qui, en cas de défaite de Trump et donc de victoire de K. Harris aux présidentielles US, risquent de faire de l'impasse dans laquelle Netanyahou s'est mis à Gaza, le commencement de la fin pour lui.
C'est pourquoi l'appareil sécuritaire et militaire israélien s'est lancé dans ce qui n'est pas une opération « pour la défense d'Israël », mais une opération de diversion visant à ressouder la population judéo-israélienne de plus en plus divisée à propos de Gaza, des otages et de Netanyahou, et à entretenir la peur mondiale d'une guerre régionale avec l'Iran.
C'est en effet l'Iran, avec la bénédiction russe, qui a poussé le Hamas à la provocation et au pogrom du 7 octobre 2023, tout en n'ayant jamais eu l'intention de transformer la prétendue « tempête d'Al-Aqsa » en guerre totale : le Hezbollah et les Houthis n'ont jamais tenté d'aider sérieusement ni le Hamas, ni, encore moins, la population de Gaza dont ils n'ont cure.
Les habitants judéo-israéliens, palestiniens et druzes du Nord d'Israël sont effectivement victimes des missiles et des menaces du Hezbollah qui n'ont cependant jamais affaibli, bien au contraire, l'Etat israélien lui-même. De même que la fin des menaces du Hamas pourrait venir du cessez-le-feu, de la libération des prisonniers politiques et de la reconnaissance du droit palestinien à un Etat, de même le commencement de la fin du Hezbollah, dont la domination est vomie par la société libanaise, pourrait venir rapidement d'une telle politique. Les gens déplacés et menacés au Nord d'Israël ne sont qu'un prétexte.
Depuis trois semaines, par les méthodes du terrorisme d'Etat, Israël a porté de très grands coups au Hezbollah, organisation totalement réactionnaire par ailleurs. Le fait que ces coups soient portés par Israël et avec ces méthodes écarte toute portée ou finalité « progressiste » à cette opération.
Il s'agit pour Netanyahou, bloqué à Gaza au seuil d'un génocide effectif qui n'a pas eu lieu mais qu'il faut empêcher, de faire diversion, de retrouver une assise élargie dans la société israélienne, et de faire planer le danger d'une guerre régionale totale avant les élections nord-américaines, en espérant du coup peser en faveur de son candidat qui est aussi celui de Poutine : Donald Trump.
Surtout, et c'est là le point le moins abordé, qui est justement occulté par ces opérations, celles-ci servent aussi à couvrir les actes pogromistes et la colonisation renforcée contre les Palestiniens de Cisjordanie, évoluant vers une « purification ethnique » de fait, que Netanyahou et les siens veulent rendre irréversible, alors que l'élimination de cette colonisation est une condition pour le respect des droits nationaux palestiniens et donc pour toute paix.
L'amertume avec laquelle les centaines de milliers d'arabes victimes du Hezbollah peuvent acter l'élimination de Nasrallah et compagnie, est donc causée par le fait que le droit moral de les juger et de les punir leur revenait à eux, et à nuls autres, et certainement pas aux « organes » israéliens.
Mais elle est double, car il s'y ajoute le fait que ces organes ne tuent pas seulement, et ne tuent pas principalement, des cadres du Hezbollah. De même qu'ils s'acharnent de fait sur la population de Gaza en disant affronter les soldats du Hamas (qui se réservent les souterrains, interdits aux Gazaouis), de même au Liban, ce sont des centaines et des centaines de victimes civiles et, d'ores et déjà, un million de réfugiés, qui sont les principales cibles de fait. Et, parmi ces cibles, des dizaines et des dizaines de réfugiés syriens qui avaient fui Bachar el Assad et le Hezbollah, et, parmi ces réfugiés, des milliers et des milliers de ces réfugiés syriens qui ne veulent pas et ne peuvent pas retourner en Syrie.
Il est d'ailleurs permis de se demander si les organes israéliens n'ont pas eu une aide discrète de … Bachar el Assad, dont le régime est silencieux sur les attaques aux bippers et opérations menées ces dernières semaines. Bachar n'est pas gêné par les massacres de grande ampleur : en cas de « purification ethnique » en Cisjordanie et de génocide réel à Gaza, lui, l' « antisioniste » et « anti-impérialiste », compte bien survivre encore et encore …
Les objurgations des grands de ce monde à la « retenue » par peur d'une « guerre régionale » s'adressent théoriquement à Israël, mais ne l'inhibent pas, et s'adressent donc en réalité plutôt à l'Iran. Techniquement et militairement, il est difficile à l'Etat iranien de riposter. De plus, il connait une crise interne et, surtout, la population iranienne lui est hostile et le risque existe aujourd'hui pour ce régime qu'une guerre, au lieu de mâter les résistances populaires, soient saisie par elles pour en finir. « Femme, Vie, Liberté » : réprimé, ce mouvement est vivant, très fort, dans la conscience du plus grand nombre. Par ailleurs, l'Iran est en train de se doter de l'arme nucléaire mais ne l'a probablement pas encore. Pour l'ensemble de ces raisons, une intervention iranienne directe demanderait une aide russe, alors que la Russie est « occupée » en Ukraine. Le passage à une guerre régionale, ce que les dirigeants savent à Téhéran comme à Tel-Aviv, est donc très difficile. Contraints, théoriquement et par leurs propres discours belliqueux, à une vengeance « terrible », les dignitaires iraniens et ceux du Hezbollah risquent de n'avoir, pour tout de suite du moins, à leur disposition qu'une guerre terrestre de position dans le Sud du Liban, tentant peut-être d'avancer au Nord d'Israël voire au Golan, alors même que les chars israéliens se massent à la frontière en position d'attaque.
Pour conclure ces remarques écrites à chaud, il faut bien comprendre que la rapide description donnée dans cet article s'inscrit dans un cadre général, qui est celui de la lutte des classes à l'échelle mondiale à l'époque de la multipolarité impérialiste. Le pogrom du 7 octobre 2023 a été une provocation visant à déclencher la guerre israélienne de destruction de Gaza, faisant ainsi le jeu de Poutine et attisant toutes les tendances les plus réactionnaires à l'échelle mondiale : campisme « de gauche », trumpisme « de droite », etc. Le spectre d'une guerre régionale entre un prétendu « axe de la résistance » « antisioniste et anti-impérialiste », et Israël étayé par les Etats-Unis, joue ici un rôle clef – en tant que spectre, en tant que cette guerre n'éclate pas complétement. Les grands bénéficiaires de cette défense objective de l'ordre mondial par le désordre et par la guerre ont été Poutine et Trump. Mais rien n'est gagné pour eux. La situation mondiale, assombrie, n'a pas totalement reflué dans un sens réactionnaire, ce qui se serait produit en cas de défaite ukrainienne écrasante. Trump pourrait ne pas gagner et donc perdre, et Poutine n'a pas non plus gagné ; Netanyahou se sent donc, à juste titre, menacé. Il a donc ouvert un second front en jouant au bord du gouffre avec le spectre de la guerre régionale.
VP, le 28/09/24.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lutte hégémonique et classes populaires rurales. Le combat antifasciste à la lumière de Gramsci

La faiblesse de la gauche et la force de l'extrême droite dans un certain nombre de territoires ruraux et semi-ruraux, mais aussi de petites villes, est une composante essentielle du débat stratégique actuel, que doit affronter la gauche de rupture. En s'appuyant sur une lecture de Gramsci et sur un effort d'actualisation de l'élaboration gramscienne au regard des coordonnées sociales et politiques de notre temps, Yohann Douet propose une contribution importante à ce débat.
Tiré de la revue Contretemps
2 octobre 2024
Par Yohann Douet
***
Les apports potentiels de la pensée de Gramsci au combat contre l'extrême droite sont innombrables, ne serait-ce que parce que son parcours politique et intellectuel est indissociable de la lutte contre le fascisme [1]. Dans cet article, je m'appuierai sur les résultats de mon ouvrage L'Hégémonie et la révolution – Gramsci penseur politique mais je développerai des réflexions qui n'y sont pas traitées directement [2]. Je discuterai de la manière dont les réflexions gramsciennes peuvent éclairer un problème politique décisif pour nous : la division des classes populaires, et le fait qu'une partie importante d'entre elles vote pour l'extrême-droite [3].
On le sait, l'espace politique français est aujourd'hui structuré selon une tripartition entre – pour utiliser les termes de Julia Cagé et Thomas Piketty [4] – un « bloc libéral-progressiste » (le macronisme au sens large), un « bloc national-populiste » (l'extrême-droite) et un « bloc social-écologiste (la gauche). Le premier bloc, qui attire largement les voix des classes dominantes, correspond à ce que Bruno Amable et Stefano Palombarini appellent le « bloc bourgeois [5] ». C'est entre les deux autres blocs politiques que se répartissent la plus grande part des votes des classes populaires.
La gauche (le bloc « social-écologiste ») réunit un vote beaucoup plus urbain tandis que l'extrême droite (le bloc « national-patriote [6] ») attire massivement les voix des classes populaires des « villages et des bourgs [7] ». Or il se trouve que, malgré des différences majeures, cette configuration historique présente des analogies frappantes avec celle qu'a connue Gramsci.
De l'Italie des années 1920…
De son temps, les classes populaires (ou « subalternes ») étaient séparées en deux groupes : d'un côté, une classe ouvrière urbaine et concentrée dans le Nord, politiquement organisée et massivement socialiste et communiste ; de l'autre, et ce second groupe est largement majoritaire en Italie, une paysannerie pauvre peu organisée (« désagrégée »), notamment dans le Sud (le Mezzogiorno) dominé économiquement et politiquement par le Nord. La paysannerie du Sud pouvait se mobiliser et agir collectivement, parfois d'une manière très radicale (occupation de terres, émeutes, voire insurrections, etc.) mais ses mobilisations étaient peu organisées, n'étaient pas organiquement liées au mouvement ouvrier et n'étaient pas nourries par une critique élaborée de l'ordre social [8].
Précisons que ni la classe ouvrière ni la paysannerie méridionale n'étaient massivement fascistes. Le fascisme italien avait sa base sociale dans la petite-bourgeoisie (urbaine et rurale). Mais, notamment à cause de la division entre classe ouvrière et paysannerie et entre Nord et Sud, les puissants mouvements sociaux de 1919-1920 (le biennio rosso) ne sont pas parvenus à l'emporter jusqu'au bout dans une révolution, et cet échec historique a rendu possible l'arrivée au pouvoir du fascisme deux ans plus tard (octobre 1922).
Dans cette situation, Gramsci affirme que la classe ouvrière urbaine doit construire son hégémonie sur la paysannerie – le terme d'hégémonie signifiant ici l'alliance entre ces deux classes, sous la direction de la première. La classe ouvrière doit donc parvenir à entraîner la paysannerie dans la lutte contre le capitalisme et la domination bourgeoise, et cela en renforçant l'activité politique de la paysannerie. Cela ne peut passer à ses yeux que par l'intermédiaire d'organisations sociales et politiques (en premier lieu le parti communiste), qui doivent donc lutter non seulement pour les intérêts ouvriers mais aussi pour les intérêts paysans (l'amélioration de leur niveau de vie, la possession des terres qu'ils travaillent, leur participation à la vie politique, etc.) [9].
Pour Gramsci, les politiques hégémoniques s'opposent aux politiques « économico-corporatives ». Peut ainsi être qualifiée d'« économico-corporative » une politique du mouvement ouvrier qui ne défend que les intérêts économiques particuliers (corporatistes, donc) de la classe ouvrière, en négligeant ceux de la paysannerie. En Italie, au moins depuis le début des années 1900, plutôt que de lutter radicalement avec la paysannerie contre la domination bourgeoise, une partie importante du mouvement ouvrier (les socialistes réformistes) accepte des compromis avec la bourgeoisie aux dépens de la paysannerie, notamment en prélevant des impôts sur le Sud de l'Italie à l'avantage du Nord industriel [10].
Cette politique corporatiste s'accompagne de préjugés et même d'un racisme des habitants du Nord envers ceux du Sud :
« On sait quelle idéologie les propagandistes de la bourgeoisie ont répandue par capillarité dans les masses du Nord : le Midi est le boulet de plomb qui empêche l'Italie de faire de plus rapides progrès dans son développement matériel, les méridionaux sont biologiquement des êtres inférieurs, des semi-barbares, voire des barbares complets, c'est leur nature [11] ».
Réciproquement, il souligne que les paysans du Sud ont aussi des préjugés envers les ouvriers du Nord qu'ils estiment être privilégiés, et ils ont par exemple participé à différentes occasions, en tant que soldats, à la répression de grèves ouvrières.
En somme, avant et encore plus après l'arrivée du fascisme au pouvoir, les subalternes étaient séparés par des clivages sociaux, territoriaux, politiques et idéologiques et la conscience de classe restait cantonnée à un niveau économico-corporatif.
… à la France des années 2020
L'une des tâches politiques cruciales aujourd'hui est, comme à l'époque de Gramsci, d'unifier les classes populaires qui sont clivées entre classes populaires urbaines et classes populaires rurales et péri-urbaines. Étant donné que le bloc urbain est plus organisé et plus progressiste politiquement, c'est en partant de lui que l'unité des classes populaires doit et peut être reconstruite. Le bloc de gauche urbain est donc le candidat naturel au rôle de « pôle hégémonique » principal. Il s'agit donc de construire son hégémonie sur les classes populaires rurales [12], c'est-à-dire de les entraîner dans une lutte politique émancipatrice.
(Re)conquérir politiquement les campagnes et les bourgs n'est certes pas le seul problème actuel. Il reste crucial de consolider, mobiliser et organiser les secteurs sociaux votant largement pour la gauche, qu'il s'agisse des classes moyennes progressistes des métropoles (a fortiori les jeunes et précaires), des classes populaires stables du public et/ou proches d'un syndicat, ou encore des habitant-e-s des quartiers populaires (en particulier les racisé-e-s). La convergence des votes de catégories sociales aussi diverses – notamment pour Jean-Luc Mélenchon aux présidentielles de 2022 – demande à être pérennisée et le bloc électoral qui s'est dessiné doit être transformée en un véritable « bloc social » (dans le sens d'Amable et Palombarini), qui correspondrait à un ensemble cohérent et relativement stable de demandes et d'intérêts socio-économiques. Dans le cas des quartiers populaires, la mobilisation durable des abstentionnistes jouera incontestablement un rôle décisif, ce qui impliquera de mettre en avant des représentant-e-s issus de ces quartiers et de travailler localement à renforcer l'activité politique des habitant-e-s. Dans l'ensemble, il s'agit, pour le dire schématiquement, d'accroître l'unité, l'ampleur et l'activité du bloc déjà acquis à la gauche de gauche et à prédominance urbaine.
Mais il est également décisif, sur le plus long terme, d'exercer une activité hégémonique en direction des classes populaires rurales et de promouvoir également dans « les villages et les bourgs » une activité politique progressiste.
Les zones rurales ne sont évidemment plus peuplées majoritairement de paysan-nes comme à l'époque de Gramsci. S'il existe des ruralités plus prospères (régions touristiques, zones résidentielles à proximité des villes, etc.) marquées également par un vote FN/RN important, on se concentrera ici sur une configuration spécifique : celle des « campagnes en déclin », dans le Nord et l'Est notamment [13]. Il s'agit de régions désindustrialisées (contrairement au Mezzogiorno non encore industrialisé des années 1920), peuplées largement d'« “ouvriers conservateurs” encadrés par une petite et moyenne bourgeoisie dont la domination locale repose plus sur le capital économique que sur le capital culturel [14] ». Ces territoires se caractérisent par une gauche faible et par une politisation tendancielle à droite et surtout à l'extrême droite.
La « conscience du monde social » n'y est pas dichotomique (« nous » contre « ceux d'en haut ») mais, comme l'a formulé le sociologue Olivier Schwarz, « triangulaire [15] ». Le « nous » (classes populaires rurales) s'oppose en effet, d'un côté, à « ceux d'en haut » (les décideurs, les privilégiés urbains, notamment parisiens) et, de l'autre, à « ceux d'en bas » (les précaires, vus comme « cassos », et les assisté-e-s suspectés profiter de système, fréquemment assimilés aux racisé-e-s). Dans une telle vision du monde, il importe donc de se distinguer de ceux d'en bas, d'être reconnu-e comme respectable et méritant-e, tout en étant par ailleurs protégé-e dans la mesure du possible de la désindustrialisation et de la concurrence internationale. Or le FN/RN promet précisément de protéger les classes populaires blanches, en particulier rurales, de leur garantir une certaine respectabilité et de leur conserver les maigres acquis qu'elles peuvent avoir, comme par exemple la propriété de leur logement [16].
Chez ces classes populaires rurales, le sentiment de solidarité est loin d'avoir disparu, mais il est limité à des cercles restreints. Dans la vie quotidienne, il est ainsi limité à la famille ou au groupe amical (sur le mode du « déjà, nous » ou « nous d'abord [17] »). En politique, il est fréquemment limité aux français-e-s blanc-he-s (et méritant-e-s). Une telle solidarité s'apparente d'une certaine manière à la vision « économico-corporative » dont parlait Gramsci, qui désignait par là la défense des intérêts économiques de groupes sociaux particuliers en faisant abstraction des autres groupes.
En proposant la « préférence nationale », le FN/RN peut jouer de cette solidarité limitée et économico-corporative, mais il va plus loin en la retournant contre d'autres groupes sociaux populaires, puisqu'il promet la satisfaction d'intérêts économiques minimaux aux dépens des étrangèr-e-s et racisé-e-s. Tout en approfondissant ainsi les clivages existant au sein des classes populaires, le FN/RN vise à détacher les classes populaires blanches (et méritantes) pour les inclure dans un bloc social transclasse incluant les classes exploiteuses, bloc ayant pour ciment une conception racialisée de l'appartenance nationale.
Toujours est-il qu'au sein des classes populaires, l'idée selon laquelle on ne peut se protéger du système capitaliste néolibéral, et s'y ménager une place vivable et digne, qu'aux dépens d'autres secteurs populaires acquiert une très grande force lorsqu'il est impossible d'envisager un horizon au-delà de ce système et que l'on se résigne à l'accepter passivement. Cette logique est certes loin d'expliquer à elles seules le racisme, qui relève également d'autres causes structurelles, mais elles le renforcent, le cristallisent et contribuent à le politiser.
Un autre élément décisif doit être relevé : ce que Benoît Coquard appelle les « affinités transclasses [18] » entre les classes populaires rurales et la petite bourgeoisie locale. Il existe une certaine proximité, dans les modes de vie, les sociabilités mais aussi les visions du monde social entre d'une part les petits patrons, les commerçants et les artisans, et d'autre part les salariés de l'artisanat et des petites entreprises. Le salarié peut être ami avec et prendre pour modèle de réussite l'artisan à son compte, le président du club de chasse, le cafetier, le petit patron du coin – et éventuellement son petit patron [19].
Ce faisant, c'est la vision du monde très droitière de la petite bourgeoisie locale qui va influencer la vision du monde des classes populaires rurales, et devenir la norme dans ces territoires, l'adhésion à une telle vision politique de droite ou d'extrême-droite devenant même un gage de respectabilité et un moyen d'intégration (pour obtenir un emploi par exemple). Les membres de la petite bourgeoisie sont ainsi des « leaders d'opinion [20] » à l'échelle locale, des gens que l'on écoute.
En ce sens, ils peuvent jouent le rôle « d'intellectuels organiques » de l'extrême droite, sans que ce soit délibéré et sans qu'ils soient le plus souvent militants du FN/RN. Il faut préciser que lorsque Gramsci parle d'intellectuels, et d'intellectuels organiques en particulier, il ne pense pas forcément à des gens spécialisés dans une activité intellectuelle (lire, écrire, discourir, etc.). Il définit en effet les intellectuels par leur « fonction de connexion et d'organisation [21] » de la vie sociale, et par le fait de diffuser certaines visions du monde.
Gramsci peut écrire, à propos du sud de l'Italie, que « le paysan méridional est lié au grand propriétaire terrien par l'intermédiaire de l'intellectuel » petit-bourgeois [22], les intellectuels étant ici les prêtres, les petits fonctionnaires ou les professions libérales (notaires, médecins, etc.), qui incitent la paysannerie à la résignation et renforcent en son sein le sentiment d'impuissance. Il parle à ce propos d'un « monstrueux bloc agraire » formé par « la grande masse paysanne amorphe et inorganisée, les intellectuels de la petite et de la moyenne bourgeoisie rurale et les grands propriétaires fonciers [23] ».
Dans la mesure où, sans abolir complètement « l'effervescence » paysanne, ce bloc agraire assure une certaine stabilité aux rapports sociaux méridionaux et reconduit par conséquent la position subordonnée du Sud agricole et quasi-féodal par rapport au Nord capitaliste, Gramsci estime qu'il remplit une « fonction d'intermédiaire et de contrôleur au service du capitalisme septentrional et des grandes banques. Son unique but est de maintenir le statu quo [24] ».
Dans la France des années 2020, on l'a vu, les classes populaires rurales sont liées à l'extrême-droite par l'intermédiaire de la petite-bourgeoisie locale, qui joue objectivement un rôle d'intellectuel organique. Pour désigner cet ensemble de rapports socio-politiques on pourrait parler, par analogie avec le « bloc agraire » de Gramsci, de « bloc rural » [25]. Et, tout comme le bloc agraire méridional gramscien servait en définitive le capitalisme italien (au sein duquel le Nord était dominant), le bloc rural français contemporain sert les intérêts du capitalisme néolibéral (dominé par les métropoles) dans la mesure où le vote d'extrême-droite fait obstacle à toute alternative véritable, passant nécessairement par une gauche de rupture.
L'analyse du bloc social rural est seulement esquissée ici, et demanderait à être développée[26]. Elle peut néanmoins permettre de mieux comprendre comment l'extrême-droite peut obtenir des scores électoraux importants dans des zones où elle n'a qu'une faible présence militante, si bien que des candidat-e-s fantasques glaçants, comme des personnes se photographiant sur les réseaux sociaux avec une casquette nazie, ayant fait une prise d'otage ou étant sous curatelle, ont pu dépasser 20% ou 30%, et se qualifier au second des législatives [27]. Si le FN/RN n'a pas nécessairement besoin de militantisme local pour atteindre de tels résultats, c'est en effet pour plusieurs raisons qui se renforcent réciproquement :
1) Il se nourrit de la logique du système néolibéral et des demandes de protection économico-corporatives que celui-ci produit. D'un côté, le FN/RN tire une certaine rente électorale de son image de parti anti-système, ce que renforce le fait qu'il n'a jamais exercé le pouvoir au niveau national ; de l'autre, l'alternative qu'il prétend incarner ne remet pas en cause les fondements du néolibéralisme. Une telle alternative, illusoire dans la mesure où elle reste intérieure au système néolibéral, apparaît pourtant plus réaliste que celle incarnée par la gauche de rupture aux yeux de celles et ceux qui se résignent à ce système.
2) Ses idées sont périodiquement reprises par les partis de gouvernement et perpétuellement diffusées dans les grands médias, les classes populaires rurales formant le secteur social où l'on regarde le plus la télévision [28]. On pourrait ici pousser l'analogie et comparer le rôle de la télévision dans la France rurale contemporaine au rôle de l'Église dans l'Italie des années 1920. Les médias de masse constituent un appareil idéologique agissant au cœur même des foyers, et ne demandent pas la même présence dans l'espace social que l'appareil idéologique clérical, avec son clocher et son prêtre dans chaque village. Il faut certes relativiser l'influence directe et immédiate de la télévision, dont le message est toujours interprété et décodé par les auditeurs-rices en fonction, notamment, de l'influence des « leaders » ou « relais d'opinion » de leur entourage. Cela étant, dans le cas qui nous intéresse, ces intermédiaires semblent bien renforcer le caractère réactionnaire du message des grands médias.
3) Le FN/RN est favorisé par les rapports sociaux qui rattachent les classes populaires à la petite bourgeoisie dans le cadre du « bloc rural ».
Briser le bloc rural
Gramsci affirmait en son temps la nécessité de construire l'hégémonie du mouvement ouvrier sur la paysannerie du Sud et de briser le « monstrueux bloc agraire » méridional entre la paysannerie, les intellectuels petits-bourgeois et les grands propriétaires. Comment espérer aujourd'hui mener avec succès une politique hégémonique en direction des classes populaires rurales et notamment briser le « bloc rural » ?
1) Pour parvenir à rendre les projets de gauche audibles et potentiellement hégémoniques, il est bien entendu nécessaire de s'adresser d'une manière concrète aux classes populaires rurales et de se confronter à ce qui les préoccupe comme la question du transport (et surtout de la voiture individuelle, étincelle du mouvement des Gilets jaunes) dans les zones rurales et péri-urbaines et la question de la propriété du logement – cela sans abandonner bien sûr les objectifs de décarbonation de l'économie et la défense du logement social.
Dans leur ouvrage, Julia Cagé et Thomas Piketty voient une analogie entre, d'une part, l'importance pour les classes populaires rurales de la propriété de leur logement aujourd'hui et, d'autre part, l'attachement à la propriété de la terre pour la paysannerie française autrefois. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, cette question aurait contribué à détourner la paysannerie de la gauche (marxiste), perçue comme trop collectiviste, et à renforcer la tripartition de l'espace politique (qui aurait prédominé de 1848 à 1910). Même s'il est indispensable de rappeler la différence entre un moyen de production (la terre) et un moyen d'habitation, l'analogie reste éclairante et on peut l'étendre jusqu'à la situation italienne des années 1920. En ce sens, une politique hégémonique concrète de la gauche envers les classes populaires rurales devrait donner une réponse aux problèmes de la voiture individuelle et de la propriété du logement comme – toute proportion gardée – elle devait au temps de Gramsci proposer une solution à la question méridionale et à la question de la terre.
Sur la question du logement, Cagé et Piketty relèvent dans le programme du RN aux présidentielles de 2022 la promesse d'une extension du prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, chaque famille pouvant de plus selon cette mesure bénéficier de la part de l'État d'un prêt de 100 000 euros sans intérêt, qui n'aurait plus à être remboursé après la naissance d'un troisième enfant. Si cet élément relativement secondaire du programme n'est vraisemblablement pas la cause principale de la tendance des propriétaires de milieux populaires à voter pour l'extrême-droite, qui peut s'expliquer par d'autres raisons plus fondamentales [29], elle témoigne indéniablement de la capacité du FN/RN à saisir les préoccupations des classes populaires rurales.
2) Même le discours le plus adapté et le programme le plus pertinent ont besoin de relais d'opinions au niveau local, jouant le rôle d'intellectuels organiques diffus présents dans les territoires. Pour le dire simplement, il s'agit d'éviter que seuls les petits patrons de la région se fasse entendre. Dans la mesure où « les groupes sociaux qui portent typiquement le vote à gauche sont soit absents de ces villages et bourgs populaires, du fait notamment du départ des jeunes diplômés ne trouvant pas de débouchés sur le marché de l'emploi local, soit dans un entre-soi ignoré des classes populaires locales », la solution serait, dans l'idéal, que des catégories sociales plus marquées à gauche viennent ou reviennent s'installer dans des campagnes populaires [30]. La relocalisation d'emplois diplômés (dans la santé et l'éducation par exemple) pourrait permettre qu'émergent de nouveaux modèles de réussite plus progressistes que le petit entreprenariat local. Ce type de solution pourrait passer par une reconstruction des services publics atrophiés dans ces territoires [31].
3) La défense des services publics constitue du reste une revendication non économico-corporative et au contraire potentiellement hégémonique. Dans leur principe, ils sont censés être universels et en tant que tels ils répondent aux intérêts des classes populaires urbaines comme rurales, racisées ou non. C'est autour de telles revendications hégémoniques que l'on peut espérer reconstruire l'unité des classes populaires. Le problème est bien sûr qu'une telle reconstruction des services publics ne pourra être mise en œuvre qu'une fois la gauche de rupture déjà au pouvoir, et que les classes populaires rurales ne pourront en éprouver les effets positifs qu'à plus longue échéance encore.
4) Gramsci écrit en 1926 que « le prolétariat détruira [le] bloc agraire méridional dans la mesure où il réussira, à travers son Parti [le parti communiste], à organiser en formations autonomes et indépendantes des masses toujours plus importantes de paysans pauvres [32] ». Si l'on essaie d'adapter cette formule à notre situation, on peut dire que briser le bloc rural suppose de construire une organisation politique radicale de masse, présente physiquement sur tout le territoire. Dans la mesure où, sans relais d'opinion locaux, les discours progressistes risquent de rester hors sol, il s'avère nécessaire de s'implanter localement, sur le long terme, dans les bourgs et si possible dans les villages : le slogan « Une cellule du parti pour chaque clocher », lancé par le dirigeant communiste italien Pietro Secchia en 1945 et adopté par le PCI, indique toujours la direction à prendre, quand bien même serait-il impossible de réaliser intégralement cet objectif. La croissance et l'implantation d'une telle organisation demandera une lutte politique de longue haleine, âpre et acharnée : une « guerre de position », aurait dit Gramsci. Or si la France insoumise, sous sa forme actuelle, excelle dans l'action rapide, lorsqu'il s'agit de se mobiliser d'une manière ponctuelle pour une échéance électorale importante, l'intervention durable et l'implantation territoriale présentent bien plus de problèmes (comme en témoignent par exemple ses scores généralement plus faibles aux élections locales). Pour mener la guerre de position et la lutte hégémonique en direction des classes populaires rurales, il faut un véritable parti, de masse, structuré, ramifié, présent localement, sensible à la particularité des différentes zones d'intervention et s'appuyant sur des militant-e-s, des représentant-e-s et même des élu-e-s issu-e-s des classes populaires [33]. Bref, cette lutte hégémonique ne pourra être menée avec succès que si elle passe, non par un mouvement gazeux, mais par un processus d'organisation moléculaire [34].
5) Même si l'on en avait la volonté, la construction d'une telle organisation politique de masse serait difficile ne serait-ce que parce qu'il existe peu de points d'appui dans les campagnes et les bourgs. Il serait donc indispensable de s'appuyer sur les structures existantes, comme les associations locales et surtout les syndicats, qui restent les organisations populaires progressistes les plus massives et présentes localement. En effet, « dans les petites villes rurales, où le RN accumule un nombre de voix assez important, les militant-e-s de gauche sont de plus en plus rares. Souvent, seuls les réseaux syndicaux restent actifs pour défendre les valeurs progressistes contre les idées d'extrême droite, que ce soit sur les lieux de travail ou dans les quartiers [35] ». En ce sens, il serait indispensable de renforcer, à un niveau local comme national, les liens organiques entre partis de gauche radicale et syndicats de lutte, qui sont parfois trop relâchés, ou marqués par une certaine tension. Le soutien explicite apporté par la CGT au NFP est sur ce plan un signe encourageant.
6) Les luttes et mouvements sociaux, qu'il s'agisse de grèves locales ou de mouvements d'ampleur nationale, restent des occasions particulièrement favorables au recul de l'extrême-droite et à formation de nouvelles solidarités de classe, par-delà les clivages des classes populaires. Cela s'est en particulier constaté dans le cas du mouvement des Gilets jaunes. Celui-ci a dans certains cas permis la transformation d'une conscience « triangulaire » du monde social en une conscience « dichotomique » où le « nous » est principalement opposé à « ceux d'en haut » [36]. Comme l'écrit Benoît Coquard, « l'irruption des Gilets jaunes à l'automne 2018 a ouvert une brèche inattendue, dans des coins de France profondément rétifs aux engagements collectifs et à la rébellion politique [37] ». De plus, leurs revendications et surtout les formes d'action radicales qu'ils ont adoptées se sont avérées inconciliables avec le culte de l'autorité et la défense unilatérale de la police portés par le FN/RN. Dans l'ensemble, le mouvement des Gilets jaunes a montré le potentiel politique des classes populaires rurales et péri-urbaines, et a ainsi constitué une « fissure [38] » importante dans le bloc rural. Il peut ainsi être vu comme une phase de « guerre de mouvement » populaire, mais qui a malheureusement trop peu nourri la guerre de position de la gauche.
À cet égard, l'attitude réticente voire hostile d'une grande partie des directions syndicales envers ce mouvement a été une faute sociale et politique majeure, l'inverse même de ce que devrait être une politique hégémonique visant à unifier l'ensemble des classes populaires. Les occasions de rapprochement entre organisations progressistes et classes populaires rurales sont rares et précieuses, il faut donc savoir les saisir et cela n'a pas été fait au niveau national, même si de nombreux-ses militant-e-s syndicaux-les ont participé localement au mouvement des Gilets jaunes. Comme l'a écrit Gramsci, « négliger et, pis, mépriser les mouvements dits spontanés, c'est-à-dire renoncer à leur donner une direction “consciente”, à les élever à un plan supérieur en les insérant dans la politique, […] peut avoir souvent de très graves et très sérieuses conséquences [39] ».
Conclusion
Les concepts gramsciens d'hégémonie, de corporatisme, d'intellectuels organiques, de guerre de position et de mouvement restent particulièrement pertinents pour analyser et éclairer la lutte contre l'extrême-droite. Il est certes nécessaire, sous peine de tomber dans une application dogmatique et mécanique de conceptions formulées il y a près d'un siècle, de spécifier ce que notre situation a d'unique et de différent de celle de l'Italie des années 1920, raison pour laquelle il est indispensable de s'appuyer sur les résultats des travaux de sciences sociales contemporains.
Toujours est-il que, s'il reste quelque chose de parfaitement actuel dans ce que nous a légué Gramsci, c'est bien sa célèbre devise : « pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté ». Pessimisme face aux ravages du capitalisme, mais optimisme en ce qui concerne la capacité des subalternes organisé-e-s à le renverser. Les classes populaires gagnées par l'extrême-droite ne parviennent pas à dépasser le pessimisme, ne voient pas d'horizon au-delà de la concurrence généralisée et ne conçoivent la satisfaction de leurs demandes qu'au détriment d'autres groupes subalternes.
Le FN/RN est bien, comme le disait Trotsky du fascisme, « le parti du désespoir contre-révolutionnaire [40] ». Pour le vaincre, la meilleure arme reste donc de faire naître, et de faire éprouver concrètement, un espoir révolutionnaire.
*
Illustration : Marche des gilets jaunes à Gannat 8 Décembre 2018 © Sylvain Néron
Notes
[1] L'un des objectifs principaux des textes de Gramsci, avant comme après son emprisonnement (novembre 1926), est de penser et de lutter contre le fascisme. Voir Yohann Douet et Ugo Palheta, « Comprendre et combattre le fascisme avec Gramsci » [Podcast], Spectre.
[2] Yohann Douet, L'Hégémonie et la révolution – Gramsci penseur politique, Paris, Éditions Amsterdam, 2023. Un extraitde l'ouvrage et une recension par Hendrik Davi ont été publiées dans Contretemps.
[3] Le présent article reprend et complète l'intervention que j'ai donnée aux AMFIS 2024 dans le cadre du panel « Penser nos luttes avec Antonio Gramsci » organisé par Contretemps, aux côtés de Galatée de Larminat et Stathis Kouvélakis, que je remercie pour leurs discussions enrichissantes que nous avons eues sur ces questions et leurs précieuses remarques.
[4] Julia Cagé et Thomas Piketty, Une histoire du conflit politique. Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022, Paris, Seuil, 2023.
[5] Bruno Amable et Stefano Palombarini, L'illusion du bloc bourgeois. Alliances sociales et avenir du modèle français, Paris, Raisons d'agir, 2017. Alors que Cagé et Piketty parlent de « blocs politiques », Amable et Palombarini étudient plutôt des « blocs sociaux », c'est-à-dire des « alliances sociales » entre différents groupes, qui excèdent la seule dimension électorale. Un bloc social est pour eux « constitué par les groupes protégés par une stratégie » politico-économique (ibid., p. 22), comme la stratégie néolibérale dans le cas du bloc bourgeois, lequel reste toutefois trop étroit pour former un bloc social dominant d'une manière stable.
[6] Cagé et Piketty incluent LR dans ce bloc, ce qui pourrait être discuté, mais faire un choix différent ne modifierait pas fondamentalement les tendances générales.
[7] Cagé et Piketty (ibid., p. 95) répartissent la population française entre 12 millions de personnes habitant dans des villages (agglomérations de moins de 2000 habitants), 21 millions dans des bourgs (agglomérations entre 2000 et 100 000), 22 millions dans des banlieues (communes secondaires des agglomérations de plus de 100 000 habitants) et 11 millions dans des métropoles (agglomérations de plus de 100 000 habitants). À mesure que l'on passe des villages aux bourgs, aux banlieues et aux métropoles, on constate que le vote national-populaire décroît et qu'à l'inverse le vote pour le bloc social-écologiste croît (pour la présidentielle 2022, voir ibid., p. 718). Remarquons que, si Cagé et Piketty n'avaient pas fait le choix discutable d'inclure les bourgs jusqu'à 100 000 habitant-e-s mais, disons, jusqu'à 10 000, le survote pour l'extrême-droite aurait vraisemblablement été encore plus marqué.
[8] Il en allait différemment de la paysannerie du Nord (notamment dans la plaine du Pô, caractérisée par une agriculture moderne), qui était beaucoup plus organisée, notamment dans des « ligues paysannes » d'obédience socialiste. Ce fut d'abord pour briser par la violence de telles organisations paysannes (avec le squadrisme), après deux années de mobilisation sociale en 1919-1920, que le mouvement fasciste a été soutenu par les grands propriétaires terriens et a pris toute son ampleur.
[9] Si la bourgeoisie française a pu construire une forte hégémonie sur la paysannerie au cours de la Révolution française c'est précisément parce que, d'après Gramsci, certains intérêts de ce type ont été satisfaits.
[10] Je m'appuie ici par la suite sur « Quelques thèmes sur la question méridionale », texte dont Gramsci avait commencé la rédaction quelques semaines avant son emprisonnement (novembre 1926), et qui est par conséquent resté inachevé. Ce texte se trouve dans Antonio Gramsci, Écrits politiques, Paris, Gallimard, 1975-1980, tome 3, p. 329-356 (noté ci-dessous EP III).
[11] EP III, p. 333.
[12] Le terme « rural » est pris ici en un sens large et renvoie également à des villes moyennes, en particulier les « bourgs » en déclin. Chez Cagé et Piketty, les « bourgs » rassemblent les communes jusqu'à 100 000 habitants (tant qu'il ne s'agit pas de communes secondaires de communes plus grandes).
[13] Benoît Coquard, Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin, Paris, La Découverte, 2019. Les ressorts du vote FN/RN dans la région plus attractive qu'est le Sud-Est (région PACA en l'occurrence) ont été étudiés par Félicien Faury, Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l'extrême droite, Paris, Seuil, 2024. Pour une réflexion sur les logiques présidant au vote FN/RN (en partie – mais en partie seulement – différentes selon les zones), voir l'entretien avec Benoît Coquard et Félicien Faury mené par Fabien Escalona : « Hégémonie sur le terrain, normalisation, racisme : les ressorts du vote RN », Médiapart, 27 juin 2024.
[14] Ibid., p. 173.
[15] Olivier Schwarz, « Vivons-nous encore dans une société de classe ? Trois remarques sur la société contemporaine française », La Vie des idées, 22 septembre 2009.
[16] L'un des résultats frappants du travail de Cagé et Piketty est la corrélation forte, chez les classes populaires, entre le fait d'être propriétaire de son logement et le fait de voter pour le « bloc national-patriote ». Ils caractérisent ainsi le vote FN/RN comme un vote de « petits-moyens accédant à la propriété ».
[17] Benoît Coquard, Ceux qui restent, op. cit., chapitre 7, p. 173-190.
[18] Ibid., p. 35.
[19] Ces logiques d'affinités transclasses jouent plus nettement dans le cas de sociabilités masculines (les sociabilités des femmes dépendant plus fréquemment des sociabilités de leurs conjoints), raison pour laquelle on ne féminise pas ici.
[20] La notion de « leaders d'opinion (opinion leadership) ou « relais d'opinion » a été développée par les sociologues Paul Lazarsfeld et Elihu Katz dans le cadre de la théorie de la « communication à deux étages (two-step flow of communication) » soutenant que les discours politiques ou médiatiques ne prennent toute leur force de conviction que s'ils sont relayés à un niveau local par des figures relativement influentes.
[21] Cahier 12, §1, in Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Paris, Gallimard, 1978-1996, tome 3, p. 314. Gramsci ne définit pas les intellectuels par le contenu intrinsèque de leur activité mais par leur place dans les rapports sociaux, et la catégorie des intellectuels acquiert ainsi une extension bien plus vaste que dans les usages courants du terme. À ses yeux, peuvent donc faire partie des intellectuels des figures apparemment éloignées telles que le philosophe professionnel, le prêtre, l'entraîneur sportif, le journaliste, le policier, l'ingénieur, l'économiste, l'instituteur, le médecin, etc. » (Fabio Frosini, « De la mobilisation au contrôle : les formes de l'hégémonie dans les « Cahiers de prison » de Gramsci », Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, n° 128-2, 2016), ou encore le chef d'entreprise capitaliste et le militant d'un parti politique. Que dans les « campagnes en déclin » le rôle d'intellectuels organiques soit joué par les membres d'une petite-bourgeoisie « dont la domination locale repose plus sur le capital économique que sur le capital culturel » (selon la formulation de Benoît Coquard) n'est que relativement paradoxal si l'on poursuit l'élargissement de la notion d'« intellectuels » initié par Gramsci.
[22] EP III, p. 348.
[23] Ibid., p. 345.
[24] Ibid., p. 348.
[25] Cette analogie – comme toute analogie historique – est évidemment imparfaite. En particulier, l'extrême-droite qui attire les votes populaires ruraux n'est pas assimilable aux propriétaires terriens dominants dans le bloc agraire méridional de Gramsci, qui exploitaient économiquement la paysannerie. Alors que, dans l'Italie des années 1920, le capitalisme développé dans le Nord s'articulait à des rapports sociaux quasi-féodaux dans le Sud, le capitalisme (sous sa forme néolibérale) subsume directement tout le territoire français, même s'il avantage certaines zones aux dépens d'autres.
[26] La notion de « bloc social » renvoie ici, comme chez Amable et Palombarini, à une alliance entre groupes sociaux rassemblés derrière une stratégie politico-économique, avec la promesse d'une satisfaction – quand bien même serait-elle illusoire – de certains intérêts économico-corporatifs des classes populaires rurales blanches par une stratégie de préférence nationale. Mais elle renvoie également, comme chez Gramsci, aux rapports sociaux concrets qui rattachent les différents groupes constituant le bloc en question (classes populaires rurales, petite bourgeoisie rurale, représentants de l'extrême-droite, etc.).
[27] « Casquette nazie, propos racistes et antisémites, prise d'otage : ces candidats RN aux législatives qui font polémique », France bleu, 3 juillet 2024.
[28] Sur l'analyse gramscienne des médias, voir Yohann Douet (entretien avec Frédéric Lemaire), « Gramsci, critique des médias ? », Acrimed, décembre 2020.
[29] En effet, la proportion de propriétaires est bien plus forte en milieu rural, lequel est tendanciellement lié au vote d'extrême-droite pour de nombreuses raisons, comme on l'a vu. De plus, la propriété de son logement signifie que l'on a quelque chose à perdre (économiquement et symboliquement) et peut vraisemblablement être propice à une conscience sociale « triangulaire ».
[30] Benoît Coquard, « Les obstacles à “la reconquête du vote populaire rural” : discussion sur l'ouvrage de Cagé et Piketty », The Conversation, 20 septembre 2023.
[31] Ibid.
[32] EP III, p. 356.
[33] Xavier Vigna (entretien avec Mathieu Dejean), « La gauche n'a pas de stratégie nationale pour reconquérir ses territoires perdus », Médiapart, 28 juillet 2024.
[34] Gramsci emploie le terme de « moléculaire » comme synonyme de capillaire ou diffus, notamment pour qualifier la politique qui se fait au niveau le plus fin, local et particulier.
[35] Julian Mischi, « Comment l'extrême droite française prospère au détriment de la gauche », Revue l'Anticapitaliste, n° 158, juillet 2024. Julian Mischi le montre à partir du cas d'une petite ville de 3000 habitants, localité rurale et ouvrière du centre-est de la France, où le vote RN est important et en progression constante mais où le syndicalisme CGT des cheminot-e-s reste un pôle de politisation progressiste actif.
[36] Voir Zakaria Bendali, Raphaël Challier, Magali Della Sudda, Olivier Fillieule, « Le mouvement des Gilets jaunes : un apprentissage en pratique(s) de la politique », Politix, 2019/4, n° 128, p. 143-177.
[37] Benoît Coquard, Ceux qui restent, op. cit., p. 173.
[38] Gramsci parle lui aussi des « fissures du bloc agraire » méridional (EP III, p. 351).
[39] Cahier 3, §48, in Antonio Gramsci, Cahiers de prison, op. cit., tome 1, p. 296
[40] Léon Trotsky, « Le tournant de l'Internationale Communiste et la situation en Allemagne », 26 septembre 1930.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
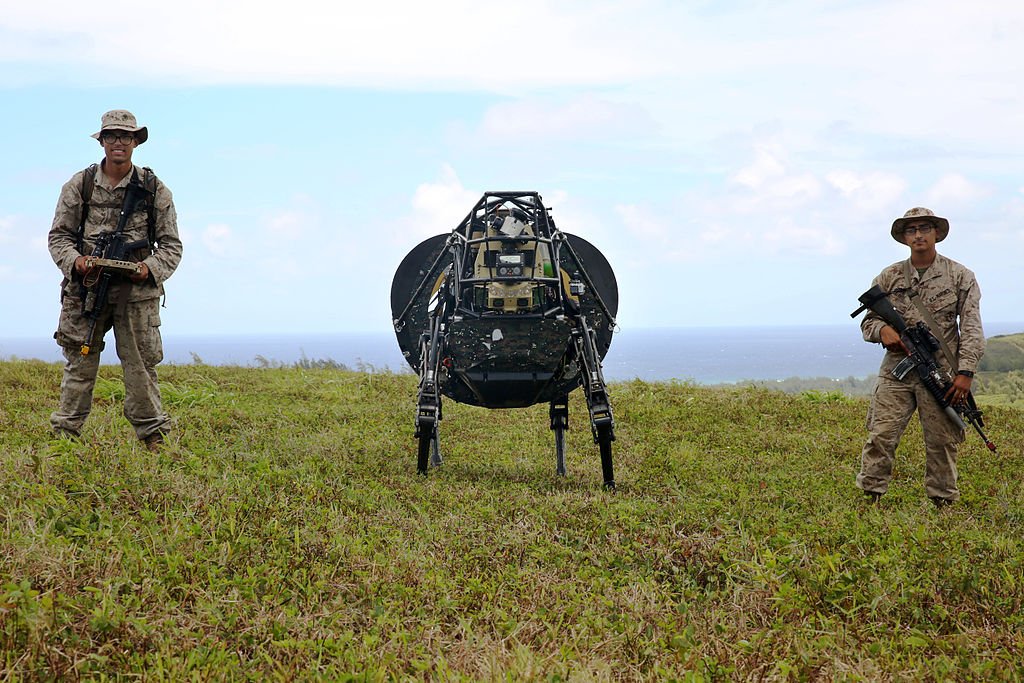
Penser les transformations des systèmes militaro-sécuritaires

L'économiste marxiste Claude Serfati a publié il y a quelques mois un livre intitulé Un monde en guerres, aux éditions Textuel. Nous en avions publié un compte-rendu, de Nicolas Pinsard, auquel Claude Serfati répond ici. Il revient notamment sur sa conception de l'impérialisme contemporain, le rôle des hauts fonctionnaires conçus comme « capitalo-fonctionnaires », mais aussi les transformations des systèmes militaro-sécuritaires liées à l'intelligence artificielle.
Tiré de la revue Contretemps
3 octobre 2024
Par Claude Serfati
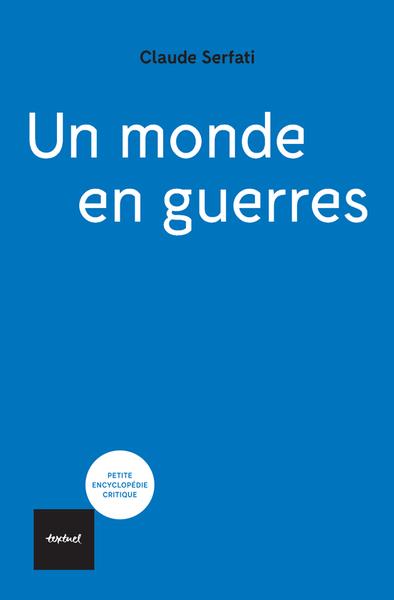
L'objectif d'Un monde en guerres est de fournir aux lecteurs – chercheurs et citoyens engagés – quelques clés de compréhension sur les interactions des dynamiques contemporaines qui sont à l'œuvre sur le plan économique, environnemental et géopolitique [1]. La note de Nicolas Pinsard, qui a été publiée dans Contretemps, propose non seulement une recension de cet ouvrage, mais elle formule quelques pistes de recherche inspirées par sa lecture. Sa note était initialement destinée à commenter la présentation de mon ouvrage dans un séminaire académique [2], et Nicolas Pinsard inscrit son interpellation dans le cadre de l'école de la régulation dont il signale la quasi-absence d'intérêt pour le militarisme et les conflits armés.
Je le remercie pour l'effort de lecture et l'intérêt de ses commentaires. Ma réponse sera plus brève que sa note puisqu'elle ne portera que sur les points qui relèvent de cette 'interpellation'. J'aborde la multipolarité capitaliste hiérarchisée qui caractérise l'impérialisme contemporain puis la place des « capitalo-fonctionnaires » dans le capitalisme français. Je précise ensuite la contribution de l'intelligence artificielle à la consolidation des systèmes militaro-sécuritaires, une hypothèse qui conteste fortement celle d'une « autonomisation de la technique vis-à-vis de l'État » défendue par Nicolas Pinsard dans sa note. Je suis enfin moins optimiste que lui sur le rôle important que la Haute Administration française pourrait jouer dans la « bifurcation écologique » qu'il propose car mes analyses m'éloignent de l'hypothèse d'une neutralité instrumentale des institutions étatiques.
Une multipolarité capitaliste hiérarchisée
La première réserve formulée par Nicolas Pinsard (remplacé dans la suite de ce texte par NP) concerne la focalisation de l'ouvrage sur les rivalités entre les grandes puissances impérialistes et l'absence d'analyse de « la relation de ces États avec les zones périphériques ». Cette critique est factuellement discutable.
D'une part, l'ouvrage décrit, comme NP le mentionne, la « reprimarisation des économies latino-américaines » – c'est-à-dire les politiques industrielles fondées sur l'exportation de ressources naturelles. D'autre part, il décrit les mécanismes d'asservissement des pays du Sud par la dette, un processus qui prolonge et amplifie ce qui se passa à l'ère de l'impérialisme d'avant la première guerre mondiale. Surtout, l'ouvrage propose un présentation détaillée des processus de dépendance produits par les chaines de production mondiales (CPM) qui sont mises en place par les grands groupes. Les CPM systématisent la captation de valeur des pays dépendants au profit des pays développés et en ce sens, elles donnent une nouvelle physionomie à la domination des pays impérialistes.
De plus, une large partie du chapitre consacré à l'antagonisme entre les États-Unis et la Chine s'intéresse à la ‘route de la soie', qui constitue un modalité de domination différente des mécanismes mis en place par les impérialismes occidentaux il y a plus d'un siècle.
Plutôt que la lacune regrettée par NP, la question non traitée dans l'ouvrage par manque de place pour en aborder ses enjeux théoriques est celle des pays de second rang qui sont à la fois des pays dominés par les grands impérialismes mais aussi en position d'exploiter des pays de rang inférieur. Je résume donc ici brièvement ma position.
Je définis l'impérialisme à la fois comme une configuration du capitalisme dominée par le capital monopoliste et financier et comme une structure de l'espace mondial dominée par quelques pays. Selon moi, la réflexion sur ces pays intermédiaires doit partir du constat d'une hiérarchisation de l'espace mondial bien plus complexe que celle d'avant 1914, même si les théoriciens marxistes de l'impérialisme établissaient déjà une hiérarchie au sein des puissances impérialistes. L'exemple le plus spectaculaire qu'ils donnaient était alors celui de la Russie [3]. Dans la lignée des travaux du sociologue brésilien Ruy Mauro Marini, Alex Callinicos, Patrick Bond et d'autres marxistes emploient aujourd'hui le terme de ‘sous-impérialisme' pour qualifier une liste plus ou moins longue de pays (Afrique du Sud, Brésil, Inde, Iran, Israël, Pakistan, Turquie, etc.) qui se trouvent dans cette position intermédiaire.
Plutôt que l'objectif d'une classification individuelle des pays, j'inscris le débat sur la hiérarchisation de l'espace mondial dans le le cadre d'analyse de l'impérialisme contemporain. Il est indéniable que la contestation de l'ordre mondial dominé par le « bloc transatlantique » et en particulier des États-Unis qui en sont le pilier, redessine les alliances interétatiques, avec la Chine et la Russie comme pôles impérialistes majeurs de cette contestation.
Dans ce nouveau contexte, quelques pays, qualifiés de sous-impérialismes, tentent d'émerger comme puissances régionales. En résumé, l'espace mondial contemporain est structuré par une multipolarité capitaliste hiérarchisée. Cette hypothèse est donc très éloignée de celle qui parle d'un « Sud global » qui serait homogène dans sa contestation de la domination occidentale et qui est parfois à tort qualifié d'anti-impérialiste (au motif qu'anti-occidental = anti-impérialiste) [4].
D'autre part, l'interdépendance provoquée par le marché mondial s'est considérablement renforcée. Ses effets sont ambivalents : la multipolarité capitaliste crée des rivalités entre les grandes puissances mais elle incite également à leur coopération contre les exploités et dominés [5]. J'aborde cette ambivalence dans Un monde en guerres à propos de l'antagonisme entre la Chine et les États-Unis. A partir des années 1990, leur interdépendance économique a créé un jeu ‘gagnant-gagnant' pour les classes dominantes des deux pays à la suite de l'intégration de la Chine dans le marché mondial. Depuis la fin des années 2000, elle met au contraire le monde au bord de l'abîme conflictuel.
Nier les mutations de l'impérialisme depuis un siècle serait donc absurde, mais celles-ci n'ébranlent pas les fondements des analyses marxistes formulées au début du vingtième siècle. Elles ne les rendent pas plus obsolètes en raison de la domination étatsunienne ou sous prétexte que l'interdépendance créerait une classe capitaliste transnationale qui marginaliserait les Etats dominants.
Le capitalisme, une structure fondée sur des forces sociales
Dans mes travaux, je qualifie les systèmes militaro-industriels (SMI) de prolongement des fonctions de défense de l'Etat sur le terrain économique. Cette définition semble convenir à NP qui me reproche néanmoins une « hésitation sur la façon de concevoir l'articulation entre SMI et État et les capitalo-fonctionnaires ».
J'utilise le terme capitalo-fonctionnaires pour souligner dans le cas de la France à quel point le mode de formation et de reproduction des classes dominantes mélange les genres. Les études empiriques sur la trajectoire des élites françaises sont d'ailleurs nombreuses qui documentent ce que de façon trop partielle, on nomme le « pantouflage ».
Au départ (le dix-neuvième siècle), ce terme désignait la trajectoire des hauts fonctionnaires qui poursuivaient ou achevaient leur carrière dans les grandes entreprises. Cependant, comme je l'ai analysé [6], le régime bonapartiste de la cinquième République a considérablement augmenté les passerelles entre le monde de la Haute Administration, l'appareil gouvernemental et les grandes entreprises [7], dont une grande partie est depuis six décennies successivement nationalisée et privatisée, généralement pour confirmer l'adage : socialisation des pertes, privatisation des profits.
Cette osmose des élites publiques et privées est facilitée par leur formation dans les mêmes grands corps des grandes écoles, en premier lieu l'Inspection générale des finances à l'ENA et les corps des Ingénieurs des Mines et des Ponts et Chaussées et de l'armement à Polytechnique. Contrairement aux craintes de NP, constater ce mode singulier de reproduction des classes dominantes de la France ne supprime en aucun cas les différences fonctionnelles qui existent en France comme ailleurs entre le capital et les institutions étatiques (et la différenciation en leur sein). Il est effet communément admis par l'analyse marxiste [8] qu'une des singularités du capitalisme par rapport aux modes de production antérieurs est la séparation entre le rapport d'exploitation directe (la relation capital-travail) et la domination politique de l'État, garant de la reproduction des rapports sociaux et à ce titre doté d'une existence propre.
Or, NP conclut de l'expression « classe de capitalo-fonctionnaires » que j'utilise que « l'État n'aurait pas d'espace propre et par conséquent qu'il n'y aurait pas d'autonomie relative de cette institution vis-à-vis du capital et en particulier du secteur de l'armement ». Ce faisant, il confond le niveau de la reproduction des agents sociaux– au sens de l'agency anglophone – et celui des structures sous-jacentes du capitalisme. Ce débat est récurrent en sciences sociales [9].
Cette confusion des niveaux, c'est par exemple celle que font les analyses qui observent une internationalisation des Conseils d'administration des grands groupes mondiaux et en concluent à la domination d'une classe capitaliste transnationale et même pour certains, à l'emprise d'un État capitaliste transnational sur la planète [10]. Ces analyses négligent le fait que les rapports sociaux capitalistes demeurent territorialement circonscrits par des frontières et politiquement construits autour d'États.
La France est un pays capitaliste dans lequel la proximité ‘physique' des classes dominantes avec les institutions étatiques a toujours été une composante vitale de leur reproduction face à des exploités insoumis (1830,1848,1870,1936, 1968, etc.). Cette réalité n'est pas démentie par le fait que, selon les études des cabinets conseils, la France est un des pays occidentaux dont les grands groupes – concrètement le CAC 40 – comptent le plus d'administrateurs étrangers [11].
L'intelligence artificielle ne provoquerait pas de changement majeur dans les processus de travail…
L'hypothèse centrale du chapitre « L'intelligence artificielle au cœur de l'ordre militaro-sécuritaire » d'Un monde en guerres est la suivante. A rebours de ce que permettrait leur usage socialement maitrisé afin de satisfaire les besoins de l'humanité, les technologies qui reposent sur l'IA transforment simultanément les données en source d'accumulation de profits, elles renforcent le pouvoir sécuritaire des États et elles introduisent de nouvelles formes de guerre grâce à leur utilisation par les militaires. En somme, l'IA offre des potentialités d'utilisation contre les êtres humains dans tous les domaines de leur vie en société en tant qu'ils sont à la fois salariés, citoyens et ‘civils' menacés par les guerres.
NP conteste cette rupture. En effet, sur le plan des processus de production (de travail), il se demande si « Les ressorts de cette technologie ne sont […] pas in fine relativement classiques ? ». Cet « éternel retour » des technologies me semble une description inappropriée de la réalité. Elle néglige en particulier les effets cumulatifs produits par les innovations technologiques car celles-ci s'intègrent à des systèmes techniques déjà existants dans des conditions qui dépendent de l'environnement socio-économique.
L'IA est certes une technologie à portée générale, comme le furent la machine à vapeur, l'électricité et l'électronique, dont elle est d'ailleurs un développement. Mais ce qui lui confère cette ubiquité qui nous atteint en tant que « salariés, citoyens et civils » tient au fait que ses développements prennent place d'emblée à l'échelle internationale et sont donc un enjeu de rivalités militaro-économiques.
Or, depuis la fin des années 2000, l'espace mondial est marqué par une combinaison explosive : la « longue dépression » économique des grandes économies occidentales initiée par la crise financière de 2008 se produit dans un contexte de dégradation environnementale qui provoque à son tour le durcissement de la concurrence économique accélérée et exacerbe les rivalités militaires. Ne pas prendre en compte ce contexte a pour conséquence d'analyser les dynamiques technologiques ‘en soi'.
En réalité, en dépit des espoirs placés par certains, les technologies digitales dont l'IA est un prolongement, n'ont pas redonné de la vigueur à l'expansion économique. Elles n'ont pas non plus déclenché un nouveau cycle Kondratiev qui est censé naitre, selon les Schumpetériens, des « grappes d'innovation » (clusters) qui arriveraient à maturité.
Dans ce contexte, la combinaison d'une baisse de la rentabilité du capital et d'un régime d'accumulation à dominante financière, pour reprendre l'expression introduite par François Chesnais dès le milieu des années 1990, transforme la « quatrième révolution industrielle » fondée sur le digitalisation en une menace sur des dizaines de millions d'emplois hautement et moyennement qualifiés, alors que la vague précédente avait frappé en premier lieu les emplois non-qualifiés.
La substitution du capital au travail est certes inscrite dans l'évolution longue du capitalisme, mais un fait nouveau est que les grands groupes disposent désormais d'un réservoir mondial de main-d'œuvre– ce que Marx nomme une« armée industrielle de réserve » est désormais planétaire . Elle est composée de centaines de millions d'êtres humains dont la mise en concurrence par les grands groupes mondiaux est facilitée par la digitalisation de leurs chaines de production grâce à l'IA.
… mais au sein de l'État
NP conteste la radicalité des changements opérés par l'IA dans les processus de travail mais il observe en revanche une rupture majeure introduite par l'IA dans les relations entre l'État et la technique. Il écrit « Il me semble que la rupture se produit dans le rapport même État-technique ».
NP propose alors la notion de ‘Machinisme d'État' pour décrire l'inversion qu'il détecte dans le rapport Etat-technique et conclut son analyse du rôle de l'IA avec cette question : « La technique, via l'IA, ne s'est-elle pas autonomisée au point de ne plus être simplement un outil dans les mains de l'État ? ». Ailleurs, l'interrogation devient plus affirmative : « L'État semble entrer dans un nouveau régime de domination sociale qui se caractérise donc par une autonomisation de la technique vis-à-vis de l'État ». Cette formulation est malheureuse – même si dans une note de bas de page, NP note qu'« il ne s'agit pas ici d'avoir une lecture techniciste du régime de domination sociale dans lequel l'État joue un rôle central ».
Pour argumenter son hypothèse de la perte de contrôle de l'IA par l'Etat, NP établit une analogie avec l'analyse du machinisme faite par Marx, mais il en donne selon moi une interprétation erronée. Il est vrai que lorsque Marx insiste sur la rupture dans les rapports de travail introduite par la machine, il souligne son autonomie conquérante. Dans le chapitre 15 du Capital intitulé ‘Machinisme et grande industrie' mais aussi dans les fragments sur les machines présents dans les Grundrisse [12], Marx montre à quel point ce qu'il nomme le « système automatique des machines » s'impose comme une force qui subjugue la force de travail.
Cependant, cette autonomie de la machine s'exerce contre le producteur, elle ne se réalise nullement vis-à-vis du capitaliste. En effet, la machine, en tant qu'objet technique, s'intègre dans des rapports de production dominés par le capital. C'est pourquoi, la machine qui « est le moyen le plus puissant d'accroître la productivité du travail, c'est-à-dire de raccourcir le temps nécessaire à la production des marchandises, […] devient comme support du capital […] le moyen le plus puissant de prolonger la journée de travail au-delà de toute limite naturelle ».
L'asservissement du salarié à la machine est un moyen d'augmenter le contrôle des rythmes et de l'intensité de son activité en plus d'exproprier le travailleur de ses connaissances comme cela est longuement discuté parmi les lecteurs de Marx. La machine est donc autonome vis-à-vis des ouvriers, mais Marx conteste vigoureusement l'idée que la technique deviendrait une force autonome vis-à-vis des capitalistes : « Le capital emploie les machines […] dans la seule mesure où celles-ci permettent au travailleur d'augmenter la part de son travail pour le capital » [13].
Le procès de travail (rythme, procédures, etc.) demeure donc soumis à la discipline du capital . Celle-ci est imposée grâce à l'usage des machines et elle est confortée par l'ensemble des dispositifs de surveillance managériaux. Décider d'un autre usage du ‘système automatique des machines' est certes possible, mais ceci exige une prise en main de leur avenir par celles et ceux qui produisent les richesses. Tel est le sens de la section du même chapitre 15 du Capital consacrée aux lois sur la protection des travailleurs des deux sexes [14]. En sorte que les luttes sociales peuvent contribuer à améliorer le sort des salariés, mais « qu'au-delà d'un certain point, le système capitaliste est incompatible avec toute amélioration rationnelle ».
Le même raisonnement qui est proposé par Marx sur l'usage des machines dans les relations de production capitalistes doit s'appliquer à l'analyse de la relation de l'IA aux institutions étatiques puisque celles-ci constituent le socle politique de la reproduction des rapports sociaux. Les technologies de contrôle sont mises au service d'une politique sécuritaire car l'utilisation de l'IA à des fins militaires resserre également le filet du contrôle social intérieur au nom de la sécurité nationale.
Or, NP minimise ces changements lorsqu'il écrit que « le fait que l'IA facilite le fichage de la population ne représente pas en soi une rupture, car comme indiqué par Serfati, le fichage s'inscrit plus généralement dans la pratique courante des États vis-à-vis de leur population ». Cette remarque me parait inexacte. Des fiches anthropométriques du début du vingtième siècle introduites de façon pionnière par l'Etat français pour surveiller et punir les roms à la vidéosurveillance et les autres instruments de contrôle et de répression sociale systématisés en Chine et désormais en France grâce aux Jeux Olympiques, « le fichage » a acquis une efficacité périlleuse en l'espace d'un siècle. Ici, une fois encore, cela n'est pas dû à l'autonomisation de la technique qui submergerait les Etats, mais au contraire à sa pleine utilisation par leurs dirigeants. Se borner à constater que « le fichage est une pratique courante » minimise donc les bouleversements que l'IA provoque dans le contrôle exercé par l'Etat sur ses citoyens (en plus de ses effets dans le domaine militaire).
Le seul argument avancé par NP pour défendre l'hypothèse d'une autonomisation de la technique vis-à-vis de l'État est tiré des analyses d'experts mentionnées dans Un monde en guerres sur le degré d'imprévisibilité produit par l'incorporation de l'IA dans les équipements militaires : risque de déclenchement intempestif d'armes nucléaires, ‘surréaction' à une attaque ennemie, etc. Or, même si ces risques existent, cela ne signifie pas que la technique dicte sa conduite aux Etats ! L'imprévisibilité et la contingence ont toujours été des leviers puissants de l'évolution historique, y compris du cataclysme planétaire produit par les deux guerres mondiales.
De même, l'équilibre de la terreur qui s'est instauré entre les grandes puissances après 1945 et qui a jusqu'à maintenant évité une nouvelle utilisation des armes nucléaires ne vaut pas garantie qu'un gouvernement – voire certains agents ‘non-étatiques' qui bénéficient de la prolifération nucléaire – ne les utiliseront pas. L'idée qu'il aurait existé dans le passé des Etats rationnels et souverains qui maitrisaient leurs actions – dont la guerre fait partie – n'existe que dans la théorie ‘réaliste' des relations internationales qui est adoptée par une partie des dirigeants états-uniens.
L'IA consolide les systèmes militaro-sécuritaires
L'affirmation de l'autonomisation de la technique qui échapperait aux acteurs (pour NP à l'Etat) fait partie d'une longue tradition de recherche. Max Weber utilisait l'image de la « cage de fer » qui risquait d'enfermer la société si le procès de rationalisation qui témoigne de la supériorité du capitalisme – et auquel la technique apporte une contribution essentielle-, allait trop loin.
Un monde en guerres en donne également une illustration en résumant la vision de Jacques Ellul, ce penseur original de la technique. On peut également citer Lewis Mumford, pionnier de l'analyse des effets désastreux du « capitalisme carbonifère » qui parle de « la « passive dépendance à la machine » qui a caractérisé une large partie du monde occidental [15].
En réalité, loin de l'hypothèse d'un processus technique qui leur échapperait, les détenteurs du pouvoir étatique ont toujours suscité les innovations technologiques afin de maintenir l'ordre intérieur mais surtout de préparer la guerre à l'extérieur. L'attraction des Etats européens pour la technique fut décuplée à partir du dix-neuvième siècle lorsque l'expansion capitaliste s'est préoccupée de l'innovation technologique à des fins de profit. Cette convergence des objectifs capitalistes et de ceux des Etats a assuré un fondement solide aux systèmes militaro-industriels (SMI) qui se sont créés après la seconde guerre mondiale. Les SMI constituent depuis déjà huit décennies la forme la plus aboutie de l'incorporation des technologies sophistiquées dans les institutions étatiques. Leur dimension structurelle rend un peu terne l'hypothèse d'un machinisme d'Etat » dont NP affirme l'apparition récente grâce à l'IA.
Comment expliquer l'enracinement des systèmes militaro-industriels après la seconde guerre mondiale dans les grands pays impérialistes ? Quels sont les mécanismes qui ont facilité leur auto-reproduction et selon quelles modalités nationales ? La réponse à ces questions exige de combiner d'une part les transformations de l'espace économique mondial depuis la Seconde guerre mondiale et la course technologique sans fin entre « l'épée et le bouclier » et d'autre part les stratégies du « bloc social » qui, dans les grands pays, est aux commandes des systèmes militaro-industriels. à ces transformations « objectives ».
En bref, il est nécessaire d'associer dans l'analyse les facteurs ‘objectifs' et l'action transformatrice des forces sociales. Ainsi que Marx et Engels le rappellent, « L'histoire ne fait rien, […] elle ‘ne livre pas de combats'. C'est au contraire l'homme, l'homme réel et vivant qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ces combats » [16].
Cette méthode d'analyse ne se contente pas d'explorer le passé, elle permet également de répondre à la question : Comment expliquer la prospérité contemporaine des SMI ? Dans ce cadre théorique, Un monde en guerres consacre une place importante à la régénération du SMI étatsunien qui est produite par les géants du numérique (les GAFAM) qui contrôlent les trajectoires de l'IA. L'insertion de grands groupes civils au sein du « complexe militaro-industriel » augmente la porosité entre les fonctions militaires extérieures et sécuritaires intérieures de l'Etat. En résumé, ces transformations du SMI et sa métamorphose en système militaro-sécuritaire reflètent et confortent au plan organisationnel l'agenda de sécurité nationale qui, depuis trois décennies, rapproche la lutte contre les ennemis extérieurs et intérieurs.
Ce n'est donc pas l'IA qui s'autonomise vis-à-vis de l'Etat, ce sont au contraire les potentialités de l'IA qui sont accaparées et améliorées par les institutions étatiques afin de servir leurs objectifs. Ceci se traduit par une reconfiguration du SMI états-unien et de nouvelles relations entre institutions publiques et groupes privés. L'IA décuple les capacités des technologies biométriques [17] et renforce les fonctions « autoritaristes » de l'Etat, pour reprendre le terme utilisé par Poulantzas.
Pour conclure
En conclusion de sa note, NP, écrit que « le machinisme d'État pourrait néanmoins représenter une brèche sur laquelle le mouvement social pourrait s'appuyer pour rendre techniquement possible la bifurcation écologique par le biais de la planification ». Pour cela, il est « nécessaire de répondre à cette question [l'imprévisibilité intrinsèque produite par le machinisme d'Etat, C.S.] pour rendre politiquement possible la bifurcation écologique ».
J'ai expliqué dans cette note que l'hypothèse d'« imprévisibilité intrinsèque » faite par les experts militaires a peu à voir avec un dessaisissement des Etats de leur pouvoir de décision. Elle s'inscrit au contraire dans des processus d'utilisation de l'IA à des fins militaires et sécuritaires dont les décideurs acceptent – et en partie créent – une imprévisibilité des résultats.
Un dirigeant de l'armée d'un pays qui se nomme lui-même « start-up nation » (Israël) a bien résumé l'état d'esprit des gouvernements lorsqu'il a mentionné l'utilisation de l'IA à Gaza en déclarant que les objectifs des bombardements, « ne sont pas leur précision, mais l'ampleur du dommage créé ». En somme, l'objectif est une « intensification algorithmique des destructions » [18] qui accepte une dose d' « imprévisibilité », c'est-à-dire des « dommages collatéraux » dans le jargon des militaires.
Je suis favorable à la « bifurcation écologique » envisagée par NP mais je ne suis donc pas convaincu par le fait qu'elle viendra d'une récupération du « machinisme d'Etat ». Selon NP, cette récupération pourrait en effet être réalisée grâce au « rôle important [de] l'administration étatique comme partie exécutive des décisions politiques prises en amont », une idée qu'il déclare emprunter à l'ouvrage récent de Cédric Durand et Razmig Kecheuyan [19].
Or, mes recherches sur les systèmes militaro-industriels ont mis en évidence l'épaisseur institutionnelle de l'Etat – en termes moins convenables : elles cernent une des dimensions de l'hypertrophie bureaucratique des Etats – , elles s'opposent donc aux conceptions instrumentales de l'Etat. De plus, mes travaux sur le rôle de l'Etat dans les politiques économiques menées en France depuis la seconde guerre mondiale – en particulier depuis l'élection de Mitterrand en 1981 – m'ont tout autant éloigné de l'hypothèse illusoire d'une « neutralité instrumentale » de la Haute Administration (Conseil d'Etat, Cour des Comptes, cabinets ministériels, etc.) qui serait suffisamment flexible pour mettre les institutions de la Ve République au service des politiques d'alternance post-capitaliste.
Notes
[1] Je remercie Stathis Kouvelakis pour ses remarques formulées lors de l'édition de ce texte.
[2] Séminaire « Appropriation étatique et développement », MSH Paris-Nord, 26 avril 2024.
[3] Voir par exemple les différentes classifications faites par Lénine dans son ouvrage L'impérialisme, stade suprême du capitalisme (et dans ses notes préparatoires appelées ‘Cahiers sur l'impérialisme') ainsi que par Trotski qui écrit dans son Histoire de la révolution russeque « La Russie payait ainsi (par sa participation à la guerre du côté franco-anglais, C.S.) le droit d'être l'alliée de pays avancés, d'importer des capitaux et d'en verser les intérêts, c'est-à-dire, en somme, le droit d'être une colonie privilégiée de ses alliées ; mais, en même temps, elle acquérait le droit d'opprimer et de spolier la Turquie, la Perse, la Galicie, et en général des pays plus faibles, plus arriérés qu'elle-même » (souligné par moi) .
[4] Je développe ce point dans la conclusion d'Un monde en guerres.
[5] La coopération des pays dominants dans la mise en œuvre des mesures antiouvrières est un des rôles assigné aux institutions internationales, financières (FMI, Banque mondiale) et commerciales (OMC).
[6] Claude Serfati (2022), L'Etat radicalisé. La France à l'ère de la mondialisation armée, La fabrique, Paris.
[7] Voir par exemple le rapport de Pierre-Yves Collombat, « Commission d'enquête sur les mutations de la Haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République », Sénat, 4 octobre 2018.
[8] Ellen Meiksins-Wood (1995), Democracy Against Capitalism, Verso, Londres et New York.
[9] Chez les marxistes, ce débat fut relancé dans les années 1960 par les hypothèses d'Althusser. Celui-ci, selon Jean-Marie Vincent conçoit « un procès de production sans sujets, ni fins, c'est-à-dire un ensemble de structures en interaction » alors qu'au contraire pour Marx, « la structure sans les rapports sociaux et sans les supports (humains et matériels) de ces rapports n'a pas de sens », voir Jean-Marie Vincent « Le théoricisme et sa rectification » dans Contre Althusser, 10/18, 1974, disponible en ligne. http://jeanmarievincent.free.fr/spi...
[10] J'ai critiqué ces points de vue dans Claude Serfati, « The new configuration of the capitalist class », in Leo Panitch, Gregory Albo et Vivek Chibber (dir.), Registering Class, Socialist Register 2013.
[11] Voir par exemple « 2022 France Spencer Stuart Board Index ».
[12] Pour un accès en ligne, voir la version anglaise.
[13] Dans le même texte, Marx réfute avec la même vigueur l'hypothèse faite par certains économistes que la machine serait devenue « une source de valeur indépendante du temps de travail ».
[14] Marx y décrit en particulier la situation des femmes et des enfants et les effets provoqués par la législation du travail.
[15] Lewis Mumford (1934) , Technics and Civilisation, New York, Harcourt, p.426.
[16] Karl Marx et Friedrich Engels, La Sainte-famille, https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/09/kmfe18440900r.htm
[17] Défenseure des droits, « Technologies biométriques : l'impératif respect des droits fondamentaux », 2021
[18] Voir mon article « L'alliance périlleuse de l'IA et du militaire » La vie de la recherche scientifique, (revue du Syndicat national des chercheurs scientifiques et du SNEsup), 2024, 437 (juin-juillet-août).
[19] Cédric Durand et Razmig Keucheyan (2024), Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, La Découverte, Zones.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En Amazonie bolivienne, les autorités dépassées par des feux incontrôlables

La Bolivie a décrété l'état de catastrophe nationale le 30 septembre face aux incendies qui ravagent l'Amazonie. Dépassées, les autorités locales attendent l'aide internationale, qui peine à arriver.
3 octobre 2024 | tiré du site de reporterre.net | Photo : Un pompier volontaire combattant les incendies de forêt dans les environs de Santa Cruz, en Bolivie, le 11 septembre 2024. - © Handout / Bolivian Civil Defense / AFP
https://reporterre.net/En-Amazonie-bolivienne-rien-ne-peut-arreter-les-megafeux
Chili, correspondance
Maux de tête, difficultés respiratoires, démangeaisons des yeux... Les symptômes s'accumulent pour les habitants de l'est de la Bolivie, qui vivent depuis trois mois sous un épais nuage de fumée, provoqué par les incendies de forêt incontrôlables. Selon les autorités locales de la région de Santa Cruz, la plus peuplée et la plus dévastée par les flammes, plus de 7 millions d'hectares de l'Amazonie ont brûlé, soit la surface de l'Irlande. C'est huit fois plus que les grands incendies de 2022 en Europe.
« Santa Cruz est passée d'un paradis à l'enfer », a déclaré Jhonny Rojas, coordinateur des opérations d'urgence de cette région bolivienne. Les fumées ont atteint plusieurs villes du pays, comme Cochabamba ou La Paz, où la qualité de l'air a été qualifiée de « très mauvaise », obligeant les écoles à fermer pour protéger la santé des élèves. Les pompiers, qui manquent de moyens, luttent quotidiennement pour éloigner les flammes des maisons, et sont rejoints par des habitants qui prêtent main-forte, souvent sans équipement ni protection.
« Depuis trois mois, nous luttons contre les feux avec nos propres forces, en mettant nos vies en danger avec des moyens limités. Ça n'a pas été suffisant, nous sommes débordés », indique la communauté autochtone Monte Verde, l'un des territoires assiégés par les feux. La moitié de leurs terres ancestrales a brûlé et plusieurs familles ont perdu leur maison, leur bétail, leur potager et ont dû être évacuées. C'est cette communauté qui, le 25 septembre dernier, a exigé du président Luis Arce qu'il déclare l'état de catastrophe nationale, un décret qui facilite le transfert de ressources économiques du gouvernement vers les régions, et l'appui de l'aide internationale.
Des spécialistes sont venus du Brésil, du Chili ou encore de France pour aider à définir la stratégie de combat des feux, mais les autorités restent dépassées par l'ampleur des incendies. Le gouverneur régional de Santa Cruz, Mario Aguilera, appelle à « une action plus puissante », car la Bolivie, pays le plus pauvre d'Amérique du Sud, manque de « spécialistes et d'équipements pour endiguer ces incendies ».
Début septembre, à La Paz, capitale bolivienne perchée à 3 600 mètres d'altitude dans les Andes, des communautés indigènes et organisations environnementales se sont réunies pour manifester contre la pratique des brûlis, qui serait à l'origine des incendies. Ces brûlages (supposément) contrôlés sont utilisés sur les propriétés agricoles et forestières pour brûler la terre avant les semences.
« Si la sécheresse aggrave la propagation des incendies, la plupart des feux sont d'origine criminelle », a affirmé une manifestante. En réponse à cette crise, le gouvernement de Luis Arce a suspendu pour une durée indéterminée la loi qui autorise les brûlis, en déclarant une « pause écologique ».
D'autres pays de la Région, comme le Brésil et le Pérou, font face à des incendies de grande ampleur, provoqués par de mauvaises pratiques agricoles et les effets du dérèglement climatique. Selon l'Observatoire régional de l'Amazonie, au cours des cinq dernières années, le feu a détruit près d'un demi-million d'hectares de la plus grande forêt tropicale de la planète.
Les organisations environnementales sud-américaines considèrent que les dommages sur la faune et la flore sont irréversibles. Selon l'observatoire européen Copernicus, ces incendies ont entraîné une forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis l'Amazonie, la plus importante depuis vingt ans.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :













