Derniers articles

Éloge d’un fauteuil maudit

Montréal, le 3 février 2025. - Le collectif Cummings&Pifko présente "Éloge d'un fauteuil maudit", une exposition audacieuse et engagée qui propose une perspective inédite sur le fauteuil roulant, à travers des œuvres-installations en 2D et 3D. Accessible et inclusive, cette exposition incarne la pratique du « Crip art », une approche artistique novatrice et militante qui dénonce le capacitisme sous toutes ses formes.
Le Crip art : Un art pour penser et vivre autrement
Le Crip art est une pratique artistique profondément ancrée dans l'expérience vécue des personnes en situation de handicap. Il reflète un besoin de créer, penser, vivre et présenter l'Art autrement, tout en contestant les normes sociales et les oppressions liées au capacitisme.
Dans "Éloge d'un fauteuil maudit", le fauteuil roulant, souvent stigmatisé, devient un objet d'art porteur de récits intimes et collectifs. Chaque œuvre revisite cet objet sous des angles inattendus, interrogeant notre rapport au handicap et à la diversité capacitaire.
Une exposition inclusive et accessible
Toutes les œuvres sont conçues pour être accessibles à des publics ayant des capacités diversifiées, incarnant les valeurs d'inclusion chères au collectif. L'exposition propose un voyage à travers la grande et la petite histoire du fauteuil roulant, tout en rendant hommage à celles et ceux qui en font usage. Chaque œuvre comporte une zone d'outils technologiques inclusifs de communication (ZOTIC).
Un collectif né d'une rencontre artistique
Fondé en 2019, le collectif Cummings & Pifko est né d'une œuvre-installation unique, catalyseur de la fusion entre deux univers artistiques complémentaires :
● Sigmund Pifko, artiste multidisciplinaire, illustrateur, peintre, graphiste, adepte de l'art numérique et de la scénographie artistique. Doté d'une curiosité insatiable, il explore chaque sujet dans une optique de recherche-création.
● Gaëtane Cummings, artiste de la Diversité capacitaire, s'inspire de son vécu en fauteuil roulant pour transformer les expériences avilissantes liées au handicap en créations engagées. Elle mêle performance, documentaire, peinture, installation, art numérique, intervention et poésie pour faire de l'Art son espace de liberté et de dénonciation.
Informations pratiques
● Dates : 26 février au 11 mai 2025
● Vernissage : 08 mars 2025
● Lieu : Maison de la Culture St-Laurent, Centre d'exposition Lethbridge,
Bibliothèque du Boisé, 2727 Boul Thimens , H4R 1T4
Station de métro : Côte Vertu/Ligne orange, Autobus : 128 Nord, 171 Ouest, 121
et 126 Est
● Accessibilité : Exposition inclusive pour les publics de la Diversité capacitaire
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Infamie ou simulacre de condamnation ?

Les déboires de l'ancien Président, Nicolas Sarkozy, n'en finissent pas ! Jugé depuis le 6 janvier et jusqu'au 10 avril par le Tribunal de Paris pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs, il est sous bracelet électronique.
De Paris, Omar HADDADOU
A force de s'abreuver cupidement et goulûment de la puissance de son pouvoir népotique et d'en faire un passe-droit contre la Loi, l'ex chef d'Etat, Nicolas Sarkozy, 70 ans, réfute de clore sa carrière politique tel un vulgaire justiciable. Un roturier de la Droite française, tombé de haut ! Lui qui, en 2005 en déplacement à Bobigny, en qualité de ministre de l'Intérieur, signait et persistait de « nettoyer la cité au Kärcher ! ».
Quel mépris à la personne humaine des quartiers défavorisés !
Anéanti, l'homme traine aujourd'hui sa déchéance politique comme un forçat son boulet. Débouté par la Cour de Cassation, il s'en prend à la Justice française et la menace par la saisine de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Factuellement, il demeure le seul Président français condamné, ce vendredi 7 février 2024, par le Parquet de Paris à porter un bracelet électronique dans « l'affaire des écoutes ». Un scandale politicofinancier sur fond d'un non-dit, à savoir la liquidation préméditée du leader libyen Mouammar Kadhafi et des témoins du sérail. L'opération aurait été ourdie par l'ex chef de l'Etat, un Philosophe notoirement islamophobe et quelques sbires.
Ce procès dans lequel Sarkozy est condamné à 1 an de prison ferme, va durer 4 mois au Tribunal de Paris. Hier, face à la présidente, Mme Nathalie Gavarino, le prévenu - accablé par les témoignages des responsables libyens faisant état d'un financement de sa campagne présidentielle - a nié en bloc tout versement pécuniaire libyen de sa 1ère campagne électorale de 2007.
A la barre, il déclare : « Je confirme que je n'ai reçu aucun financement libyen. Jamais ! Jamais ! Jamais, je n'ai reçu un centime de Kadhafi. Les innocents ont le droit de s'indigner ».
Furibond, il balaie d'un revers de main la rencontre avec le fils du dirigeant libyen, Seif El Islam : « Je ne l'ai jamais rencontré ni échangé avec lui. Ce ne sont que des ragots ».
Déployant son art de plaidoirie d'ancien Avocat maîtrisant le Droit, il défie la juge et bat en brèche les témoignages à charge des sept dignitaires libyens : « L'idée d'un virement de 50 millions d'euros qui ne laissent pas de trace, est une idée baroque ! Qu'est-ce que c'est ces gens-là ? Quelle est leur crédibilité ? 50 millions à Genève, ça n'a aucun sens. C'est même gênant pour la Justice française, que des gens racontent n'importe quoi ! » s'insurge-t-il.
Excédé, Sarkozy perd ses nerfs : « Je me défends depuis 3h30 sur des témoignages d'hurluberlus et je dois maintenant répondre sur des comptes Cactus de Monsieur Gaubert avec lequel je n'ai plus de rapport depuis 1995 et un compte de Monsieur Takieddine, c'est fort de café ».
Décidemment certains élus de la République nous rappellent fidèlement les Hold-Up du Western américain. Ils se partagent le magot et disparaissent dans la nature, chacun leur côté !
Les cols blancs de la Droite sévissent ainsi depuis des années. Leurs démêlés nauséabonds avec la Justice s'inscrivent dans la légitimé de dinosaures véreux, réhabilités avec suffisance !
Outre les 12 prévenus mis en cause dans cette sordide et avilissante entreprise, digne de la Camorra cilicienne, deux anciens Ministres, et non des moindres, de la même famille, Claude Guéant et Brice Hortefeux, sont soupçonnés d'avoir pris part à un « Pacte de Corruption ».
Une ignominie qui n'a pas empêcher Sarkozy de narguer le Peuple en s'adonnant à un footing, escorté par des gardes du corps.
D'où le déchaînement des réseaux sociaux : « Il mérite la prison sans ménagement de peine. Mais il a encore des amis très puissants qui le protègent » peut-on lire. « Sarko, prison à vie pour l'assassinat de Kadhafi ! ». « Nous avons été gouvernés par des voyous ! » écrit une citoyenne.
Nicolas Sarkozy avait touché le Graal de la notoriété à lui donner le tournis. Il se délectait du Pouvoir comme l'oiseau-mouche le nectar de la fleur. Futé comme un renard, il s'est édifié et consolidé un Empire relationnel à faire plier la République. Bourgeoisie française, puissants Industriels, patrons de médias, lui déroulaient le tapis rouge en pleine disgrâce. Brûlé par le feu de la culpabilité, il pond un ouvrage « Le temps des combats » pour le chevet de ses amis (es) intimes et promet de reprendre vie dans ses cendres, tel un Phénix.
Piégé par l'affront, Sarkozy ne se remettra pas de sitôt !
O.H
INFOLETTRE
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Ruée sur l’intelligence artificielle : une dangereuse illusion au service de la Big Tech

Les intelligences artificielles génératives, type ChatGPT, suscitent des investissements faramineux, dopés par des promesses délirantes. Elles renforcent le projet libertarien et technoféodal des milliardaires de la tech.
10 février 2025 | tiré de reporterre.net | Photo : Le japonais milliardaire Masayoshi Son, ami de Trump, lors d'un sommet « Transformer le business corporate grâce à l'intelligence artificielle » en février 2025. - © The Yomiuri Shimbun via AFP
https://reporterre.net/Ruee-sur-l-intelligence-artificielle-une-dangereuse-illusion-au-service-de-la-Big-Tech
La frénésie mondiale autour de l'intelligence artificielle (IA) générative n'est-elle qu'un vaste miroir aux alouettes ? Une hallucination collective autour d'une technologie largement surcotée, désastreuse écologiquement et qui ne profitera qu'à la Big Tech elle-même ? C'est la crainte soulevée par une partie des observateurs du secteur, au moment où la « course à l'IA » que se livrent les grandes puissances — au cœur des préoccupations du Sommet sur l'IA organisé les 10 et 11 février à Paris — atteint une intensité inédite.
Les IA génératives sont des algorithmes capables de générer des contenus, des images ou des textes notamment, à l'instar de ChatGPT. Avec des résultats certes impressionnants et inquiétants dans les domaines de l'éducation, militaire ou de la surveillance par exemple. Mais elles suscitent une surenchère d'annonces et d'investissements faramineux. À tel point que les alertes sur l'éclatement possible d'une bulle spéculative se sont multipliées en 2024, de la banque d'affaires Goldman Sachs à l'essayiste fin connaisseur du secteur Cory Doctorow.
« Beaucoup de gens se sont rués sur ces technologies sans les avoir évaluées, juste par peur de rater le coche dans un contexte de concurrence généralisée », commente Raja Chatila, professeur émérite d'intelligence artificielle, de robotique et d'éthique à Sorbonne Université.
L'IA, « planche de salut du capitalisme »
Ce qui nourrit cette spéculation, c'est d'abord la promesse que ces IA génératives sauvent une croissance économique en berne. Elles généreraient d'importants gains de productivité en libérant les salariés de tâches répétitives ou en traitant rapidement d'énormes quantités de données. Malgré quelques usages efficaces de cette technologie dans des secteurs bien spécifiques, les gains massifs peinent pourtant à se concrétiser et les annonces de croissance mirobolantes sont déjà relativisées et remises en question.
« Cette technologie apparaît comme une planche de salut du capitalisme, un peu comme le développement de l'informatique après le choc pétrolier dans les années 1970, dit Félix Tréguer, chercheur associé au Centre Internet et société du CNRS et membre de La Quadrature du Net. Pourtant, on retrouve le même paradoxe de Solow qu'à l'époque : les gains de productivité attendus ne sont pour l'instant pas observés en pratique. »
« Ces IA ont un intérêt économique pour optimiser certains mécanismes mais leur utilité est hautement exagérée. Elles peuvent rédiger des compte-rendus de réunion ou résumer des textes. Et encore, il faut vérifier derrière qu'il n'y a pas d'erreur », ajoute Raja Chatila.
« Leur utilité est hautement exagérée »
Le contraste colossal entre les sommes engagées et le peu de certitudes quant aux bénéfices attendus s'explique également par la puissance de conviction des multinationales du numérique. Pour développer ces IA particulièrement gourmandes en ressources, elles doivent lever des investissements toujours plus exorbitants. Et pour justifier cette fuite en avant, les géants de la Big Tech, Alphabet (Google), Microsoft, Meta (Facebook) ou Amazon en tête, possèdent une force de frappe inégalée pour déployer leur propagande.
« Ce sont eux qui fixent l'agenda. Eux que les gouvernements consultent pour comprendre ces sujets. Ils entretiennent la course dont ils sont les acteurs, ce qui leur permet de dominer encore davantage le marché », dit Raja Chatila.
Outil d'exploitation des travailleurs
La rationalité économique de ces acteurs peut aussi paraître plus évidente lorsque l'on élargit la focale. L'enjeu n'est peut-être pas tant la rentabilité immédiate des IA génératives que l'ancrage irréversible dans nos vies et dans le monde du travail d'outils numériques au service du capital.
« Cela correspond à un schéma ancien : la technologie se substitue au travail humain et transforme les rapports de force. L'informatisation des usines dans les années 1970 avait déjà entraîné une contestation sociale. Les travailleurs pointaient alors un sentiment de déqualification, de dépossession de l'outil de travail, par une technologie qui les pressurisait au lieu de les émanciper. On reproduit aujourd'hui les mêmes promesses technologiques », analyse Félix Tréguer. Sans compter les très nombreux travailleurs précaires exploités pour entraîner tous ces algorihmes « intelligents ».
Dans ce rapport de force social, l'IA servirait également à faire diversion en portant l'attention sur le futur, censé être amélioré par le progrès technique, assimilé au progrès tout court : « Toutes les promesses liées à l'IA sont une manière pour les élites de promettre des lendemains qui chantent, et donc de différer les concessions sociales et les réformes économiques », dit encore Félix Tréguer.
En matière de fantasmes sur l'avenir, la Big Tech va même très loin : l'IA générative est mobilisée pour annoncer l'advenue prochaine d'une « intelligence artificielle générale » (IAG). Autrement dit, le mythe d'une IA égalant le cerveau humain, puis le surpassant en devenant une « super intelligence » dont les capacités dépasseraient notre entendement.
Nouvelle religion technoféodale
Sam Altman, PDG d'OpenAI, le concepteur de ChatGPT, prédit rien de moins que l'avènement de l'IAG dès cette année. D'autres prophètes, comme Elon Musk, apparaissent presque timorés en annonçant sa survenue pour 2026. Or, la plausibilité même qu'une IAG puisse exister un jour est hautement débattue dans la communauté des chercheurs (cela supposerait pour commencer de définir « l'intelligence » humaine). Beaucoup sont surtout extrêmement sceptiques quant à la pertinence du modèle actuel des IA génératives pour avancer sur cette voie.
« Par construction, ces systèmes ne sont pas capables de raisonner, et n'ont aucune connexion avec la réalité du monde. Les IA génératives progressent mais ont des limitations inhérentes à leur structure », estime Raja Chatila.
« Ces systèmes ne sont pas capables de raisonner »
Véhiculer le mythe de l'IAG présente toutefois plusieurs intérêts bien compris par la Big Tech. En entretenant l'imaginaire des machines « intelligentes », déjà bien ancré dans l'inconscient collectif par les œuvres de science-fiction, ils imposent l'idée que le développement de ces technologies serait inéluctable, dévitalisant toute critique éventuelle. Les thuriféraires de l'IA se comportent de surcroît en pompiers pyromanes : agitant d'un côté la menace existentielle que ferait peser sur l'humanité une IAG hors de contrôle, façon Terminator, ils soulignent l'importance de rapidement développer de « bonnes » IA ; les leurs.
Projet élitiste et libertarien
« Beaucoup d'acteurs phares du secteur croient vraiment, sincèrement, à l'arrivée de l'IA générale. C'est une croyance presque religieuse dans la Silicon Valley », note Nicolas Rougier, chercheur en neurosciences computationnelles à l'Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique). « Cela participe du courant de pensée qui, depuis les années 1970 rêve de fusionner l'homme et la machine, et d'atteindre l'immortalité, ajoute-t-il. Pour eux et quelques élus uniquement évidemment. C'est un courant très élitiste. »
C'est un dernier moteur important qui permet de comprendre la dynamique actuelle : ces IA génératives sont la dernière incarnation du projet politique, technosolutionniste et libertarien, que rêvent d'imposer au monde les milliardaires de la tech.
« Avec l'IA et leurs capitalisations boursières impressionnantes, ces acteurs acquièrent un pouvoir considérable, économique mais aussi politique », dit Jean-Gabriel Ganascia, professeur à Sorbonne Université, à Paris, et chercheur en intelligence artificielle. « Ils ont l'ambition de démanteler l'État pour y substituer une nouvelle féodalité via leur pouvoir technologique et cette promesse que tous les problèmes seront solubles dans l'IA. »
Lire aussi :Intelligence artificielle : « Nous devons combattre le fanatisme technologique »
Cette menace d'une prise du pouvoir par un nouveau technoféodalisme, pointée de plus en plus vivement dans le débat public, trouve sa meilleure allégorie en la personne d'Elon Musk. L'homme le plus riche du monde, égérie planétaire de l'extrême droite, a rejoint le gouvernement étasunien sous la houlette de Donald Trump et mène une sidérante politique de démantèlement accéléré de l'État fédéral.
Il y a quelques années, le multimilliardaire promettait la voiture 100 % autonome pour 2020 et des humains sur la planète Mars en 2021. Aucun de ces fantasmes ne s'est réalisé, mais Tesla et SpaceX, ses entreprises dans chacun de ces secteurs, ont magistralement prospéré. Lorsqu'il annonce l'avènement de l'IA générale pour 2026, rien n'oblige à le croire. La prophétie grandiloquente en dit en revanche beaucoup sur ses ambitions, et celle de ses pairs, pour l'avenir du monde.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Amazon est partout, la résistance l’est tout autant !

En réponse au soudain départ d'Amazon du Québec, une vaste campagne de boycottage est lancée qui ne se limite pas qu'au territoire québécois. La mobilisation s'étend maintenant aussi au Canada. L'empire tentaculaire de Jeff Bezos s'étend par ailleurs sur toute la planète. Son appétit à détruire tout syndicat sera globalement mis au défi. Désormais, nous vivons dans un monde où la loi du plus fort se confond avec celle des entreprises.
Tiré d'Alter Québec.
Il existe de nombreux points de résistance à l'international, incluant le Sud global : le Népal, l'Inde, le Bangladesh, la Colombie, le Brésil et l'Afrique du Sud joignent leurs forces dans cette lutte transnationale face à Amazon.
Ici, on boycotte Amazon
Dès aujourd'hui, les sept installations d'Amazon au Québec et le centre de livraison à Montréal ont suspendu toutes leurs activités. Le processus de fermeture s'étendra jusqu'au 22 mars prochain. La décision est survenue peu après la première syndicalisation au Canada. Ensemble, les 250 employé.es de l'entrepôt DXT4 à Laval, la CSN, des groupes de travailleur.euses, des internautes et différents réseaux de la société civile unissent leurs voix pour appeler à un boycottage de la multinationale.
Amazon n'est pas qu'un géant du Web. Il est le cinquième plus grand employeur au monde. Sa réputation dépasse les frontières : conditions de travail éprouvantes, surveillance algorithmique, pressions intenses et salaires insuffisants. Comment une entreprise dont la fortune dépasse 2 000 milliards de dollars peut-elle refuser de payer ses employé.es à un niveau décent ? Ce que l'on sait avant tout c'est que l'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché est au cœur de ses tendances impérialistes.
Les luttes dans les pays du Nord
Il est crucial de reconnaître la nature transnationale de cette bataille contre Amazon. En novembre dernier, le mouvement Make Amazon Pay marquait sa cinquième année consécutive. Lancé en 2020 par l'UNI Global Union, ce mouvement dénonce les abus de la multinationale. Aujourd'hui, il compte plus de 80 syndicats, 400 parlementaires, des écologistes et des organisations de la société civile. Ces groupes militents pour la défense de la justice sociale, fiscale et environnementale, ayant des allié.es dans plus de 30 pays.

Aux États-Unis, les travailleur.euses connaissent bien les répressions antisyndicales d'Amazon. Le 19 décembre 2024, le syndicat Teamsters avec des milliers d'employé.es déclenche la plus grande grève contre Amazon de l'histoire américaine. Parmi leurs revendications : de meilleurs salaires et des conditions de travail dignes.
L'Allemagne joue un rôle clé dans la contestation. Le syndicat ver.di mène une campagne depuis plus de dix ans, obligeant Amazon à respecter la négociation collective.
En France, le groupe militant ATTAC organise des grèves dans plus de 30 villes contre l'évasion fiscale de l'entreprise.
Au Royaume-Uni, les travailleur.euses dénoncent l'intimidation antisyndicale et les conditions de travail déplorables. À Coventry, l'adhésion aux syndicats explose de 50 % en raison des surcharges de travail, de la suppression des heures supplémentaires et des sanctions disciplinaires abusives.
Le Sud global se mobilise
On reconnaît souvent la volonté de se soulever face au géant du e-commerce en Europe ou en Amérique du Nord, mais la résistance s'internationalise jusqu'au Sud global. Ces pays, pourtant qualifiés de moins industrialisés, sont au cœur du plan d'innovation de Bezos. Amazon s'impose, dépasse les frontières et fortifie son empire sur les marchés d'ailleurs.
Au Népal, la campagne Make Amazon Pay Day encourageait les travailleur.euses à rejoindre les piquets de grève lancés par leurs camarades allemands.
À New Delhi, des centaines d'employé.es dénoncent des conditions de travail dangereuses et faiblement rémunérées. L'été dernier, la canicule a aggravé les risques sur les lieux de travail, exposant les travailleurs à des blessures sans aucun soutien.
Au Bangladesh, les travailleurs.euses du textile dans huit villes manifestaient dans les rues en demandant un salaire minimum de 207 dollars par mois, une revendication ignorée par Amazon, qui refuse toujours de signer des accords de sécurité.
À Bogotá, les travailleur.euses syndiqué.es manifestent devant un centre d'appel d'Amazon, dénonçant ses pratiques abusives.

En 2022, l'UNI Global Union décerne son prix Breaking Through au syndicat de Franco da Rocha et Região, au Brésil. Ce syndicat milite pour l'amélioration des conditions de travail dans le e-commerce, marqué par l'adhésion de plus de 600 employé.es.
Le combat trouve un terrain fertile en Afrique du Sud. Dans quatre villes, des militant.es protestent contre Amazon ayant bafoué les droits des communautés autochtones en construisant sur leurs terres sacrées. Les sud-africain.es se rallient derrière cette cause globale, qui rappellent leur histoire coloniale d'exploitation et d'inégalité systémique.
Amazon est partout, la résistance l'est tout autant
Par son geste au Québec, la multinationale tente de fragiliser le mouvement. Est-ce un jeu à sommes nulles comme tente de le faire croire l'élite du high-tech ? Au sein d'un système d'économie globale, Amazon utilise les travers l'oppression pour tirer son profit. Les travailleurs.euses méritent de défendre leur dignité.
« Une entreprise qui ne respecte pas nos lois ne devrait pas être autorisée à faire des affaires ici. »
– Caroline Senneville, présidente de la CSN
Dans le contexte politique actuel, marqué par cette soudaine alliance entre les GAFAM et Trump, la mondialisation se complexifie et prend une nouvelle forme : puissante, agressive, mais surtout, imprévisible. Du Québec aux quatre coins du globe, une chose demeure : l'union fait la force. Amazon est partout, mais la résistance l'est tout autant.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Appel de syndicalistes : pour la justice sociale, écologique et démocratique, le sursaut unitaire est possible, construisons-le ensemble !

Un large ensemble de militant·es et de responsables syndicaux appelle à « renforcer les collectifs unitaires sur le terrain » et exhorte à l'unité pour constituer une alternative politique. « Face à l'extrême droite aux portes du pouvoir, rester sur son quant-à-soi risque de se payer très cher pour tous et toutes. »
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/05/appel-de-syndicalistes-pour-la-justice-sociale-ecologique-et-democratique-le-sursaut-unitaire-est-possible-construisons-le-ensemble/
Syndicalistes, actifs et retraités, engagés en défense du monde du travail, en lutte pour la justice sociale, pour l'égalité femmes-hommes, pour les services publics, en solidarité avec les travailleurs immigrés, pour des politiques respectueuses de l'environnement… nous sommes en colère.
Nous sommes en colère d'avoir vu le Président de la République bafouer le résultat des législatives, tourner le dos au front républicain qui avait barré la route à l'extrême droite, ignorer l'arrivée en tête du Nouveau Front populaire (NFP), pour lui préférer, avec M. Barnier et son gouvernement, puis avec celui de M Bayrou, un front antirépublicain chargé de poursuivre, sous la surveillance du Rassemblement national (RN), la même politique néolibérale de régression sociale et d'injustice fiscale répondant aux intérêts du patronat et de la finance, d'absence de politique industrielle ambitieuse, d'ignorance de l'urgence écologique et de stigmatisation des immigrés.
Nous sommes en colère d'avoir vu le RN dicter ses injonctions au gouvernement et consolider ses possibilités de conquête du pouvoir. Ses idées réactionnaires et racistes sont reprises par la droite au pouvoir, elles occupent les médias, les classes dirigeantes se font petit à petit à son arrivée aux affaires et la purge sociale que promeuvent la droite et les macronistes ne peut que lui profiter.
Nous sommes aussi en colère et inquiets devant le spectacle donné par le NFP, miné par des forces centrifuges, incapable de prendre des initiatives collectives et d'engager un dialogue avec les mouvements sociaux pour se nourrir de leurs réflexions et exigences, pour incarner une alternative crédible. Certes, au parlement, ses député.es ont agi ensemble dans le débat budgétaire. Certes au niveau local, les initiatives existent pour essayer de faire vivre l'unité. Mais cela ne suffit pas à relancer la dynamique populaire qui permettrait au NFP d'élargir son assise pour l'emporter.
Dans ce contexte inquiétant, l'unité syndicale, son renforcement et son approfondissement, sont essentiels pour faire entendre des exigences fortes dans le débat public.
Au-delà, le dialogue à rétablir et la convergence d'exigences partagées entre partis, associations, syndicats et simples citoyen.es aspirant à une logique transformatrice doit permettre, dans le respect de l'indépendance des fonctions et de l'égalité des responsabilités, de créer une nouvelle dynamique dans la société. Certes les réticences des mouvements sociaux à s'engager dans une telle démarche sont compréhensibles tant pèse lourd l'instrumentalisation dont ils ont été l'objet dans le passé. Mais, face à l'extrême droite aux portes du pouvoir, rester sur son quant-à-soi risque de se payer très cher pour tous et toutes.
Dans le contexte actuel, une condition pour gagner la majorité est d'affirmer la nécessité d'une rupture avec les politiques néolibérales menées depuis des décennies. Mais cela ne suffit pas. Aux paniques identitaires dont se nourrit le RN pour proposer des réponses réactionnaires et racistes, nous devons opposer la perspective d'une société désirable fondée sur l'égalité pour toutes et tous, la justice sociale et environnementale, le dépassement des fractures territoriales, le renouveau des services publics, la sécurité dans tous ses aspects, la solidarité et la démocratie. Bref un nouvel imaginaire émancipateur auquel le mouvement social peut contribuer.
Enfin pour que les partis de la gauche et de l'écologie politique aient une chance de l'emporter électoralement, il faut évidemment qu'ils restent unis, ce qui suppose en particulier de se doter d'une candidature unique, désignée en commun pour la prochaine élection présidentielle. Mais cette unité des partis, pour indispensable qu'elle soit, ne suffit pas. Pour gagner il faut être capable de rassembler au-delà et de créer une dynamique populaire unitaire.
C'est pourquoi, avant qu'il ne soit trop tard, nous appelons l'ensemble des citoyennes et citoyens, organisations et partis qui se reconnaissent dans les valeurs sociales, écologiques et démocratiques, à s'engager ensemble dans ce combat pour reprendre la main sur notre destin collectif.
Nous appelons les militants syndicaux, associatifs et citoyens engagés à renforcer les collectifs unitaires sur le terrain, à les multiplier et à les coordonner dans les départements et les régions, à réfléchir à de grands meetings régionaux avec des personnalités unitaires, à participer et à s'associer aux différents appels et initiatives portant la même exigence d'unité, à intensifier les rencontres avec la population afin de construire avec elle les exigences qui serviront de base à la constitution d'une alternative.
Si rien n'est encore joué, le temps presse. Le sursaut unitaire est possible. Construisons-le ensemble !
Pour signer cet appel c'est ici
Premiers signataires :
Gérard ASCHIERI, éducation, ancien responsable national – Claude DEBONS, transports, ancien responsable national – Pierre KHALFA, télécoms, ancien responsable national et membre du CESE – Bernard THIBAULT, cheminot, ancien responsable confédéral – Patrick ACKERMANN, Télécoms Idf, ancien responsable national – Alain ALPHON-LAIR, secteur santé 30 – Verveine ANGELI, Télécoms IdF, ancienne responsable nationale – Michel ANGOT, FP territoriale 94, ancien responsable départemental – Nathalie ARGENSON, militante secteur santé 30 – Handy BARRE, magasinier cariste, responsable syndical Rouen 76 – Jean-Paul BEAUQUIER, militant éducation 13 – Jacques BENNETOT, militant syndicaliste paysan 76 – Eric BEYNEL, libraire, ancien responsable national secteur douanes – Walid BEYK, cheminot retraité 26 – Gérard BILLON, secteur construction, 92 Malakoff, ancien responsable national – Richard BLOCH, cheminot Sarcelles, défenseur syndical – Mariano BONA, responsable transports 38 – Gérard BONHER, secteur recherche 63 – Bruno BOTHUA, secteur construction/bois, responsable national – Jean Claude BRANCHEREAU, secteur bancaire Normandie, ancien responsable national – Catherine BRIE-ANDLAUER, déléguée cheminote Ile de France – Patrick BRODY, commerce IdF, ancien responsable national – Jean BRUNACCI, retraité La Poste, responsable régional Pays de la Loire – Laurence BUNEL, militante employée municipale 78 – Marie-Claire CAILLETAUD, ingénieure, secteur énergie Ile de France, conseillère honoraire CESE – Anne CARASSO, sociologue du travail, ergologue, militante 13 Aubagne – Christophe CARRERE, militant cheminot Paris – Patrick CHAMARET, cheminot retraité IdF, ancien responsable national – Jo CHAPUIS, secteur social, ancien responsable départemental 43 – Yves CHAUMARD, retraité SNCF Noisy le Sec – Danielle CLAMOTE, Infirmière, militante syndicale Nièvre – Jean Pierre CÔTÉ, cheminot Vosges – Laurent COOPER, retraité SNCF – Pierre COURS-SALIES, universitaire Toulouse – Monique COUTEAUX, enseignement privé Idf, ancienne responsable régionale et nationale – Jean CRESPEAU, militant Loire Atlantique – Armand CREUS, ancien responsable syndical, Meyropole de Lyon – Thierry CUVILLIER, cheminot retraité, Montoire-sur-Loir – Olivier CUZON, enseignant, responsable départemental 29 – Loic DAGUZAN, responsable organisme consommation IdF – Bruno DALBERTO, cheminot, ancien responsable national et secteur international transport – Françoise DAPHNIS, militante retraitée services publics Paris – Jean François DAVOUST, cadre retraité France Télécoms 37 – Joël DECAILLON, cheminot, ancien responsable national et européen – René DEFROMENT, secteur bâtiment, ancien responsable régional Auvergne – Béatrice DELAFOND, retraitée collectivité territoriale 79 – Christian DELLACHERIE, cheminot, ancien responsable national – Jacques DELALLEE, retraité RATP Paris, ancien responsable régional – Christophe DELECOURT, Fonction publique IdF, responsable national– Alain DELMAS, cadre retraité Orange 33 – André DELUCHAT, cadre La Poste Ile de France, ancien responsable confédéral – Philippe DETREZ, enseignant, ancien responsable départemental 59 et confédéral – Jean Michel DREVON, éducation nationale 69, ancien responsable national – Bernard DUBRESSON, ancien responsable départemental Nièvre – Bernard DUFIL, secteur bancaire, ancien responsable national – Olivier DUPUIS, ingénieur EDF RTE 92 – Patrick EADE, responsable associatif Pays de la Loire – Gilles ERARD, militant syndical cheminot, Nantes – Antoine FATIGA, Transport et Domaines skiables Auvergne Rhône Alpes ancien responsable régional – Bernard FILAIRE, cheminot Auvergne, ancien responsable départemental – Gérard FILOCHE, inspection du travail – Alain FONTAINE, retraité cheminot 44 – Olivier FRACHON, EDF Ile de France, ancien responsable national – Guy GAGNEPAIN, retraité SNCF, Pantin – Gilbert GARREL, cadre retraité cheminot Paris, ancien responsable national – Jean GASNIER, cheminot, ancien responsable transports Pays de Loire – Jean Philippe GASPAROTTO, responsable syndical, Caisse des dépôts, Paris – Yves GAUBY, secteur construction Vaucluse, responsable national – Karl GHAZI, Paris – Jacqueline GIRAUD EYRAUD, ancienne responsable régionale PACA – Dominique GUIBERT, éducation 94, ancien responsable départemental – Jean Albert GUIDOU, défenseur des travailleurs migrants Paris – Pierre HERITIER, ancien responsable confédéral – Joëlle HERVE, retraitée éducation nationale Ile et Vilaine – Nadine HUE, militante cheminote Nantes – Henri JACOT, Université Lyon – Christian JONCRET, retraité SNCF Villeneuve Saint Georges – Guy JUQUEL, syndicaliste IdF, ancien responsable secteur Europe/international – Pablo KRASNOPOLSKI, militant enseignant retraité 94 – Bernard LAMIZET, Marseille, ancien professeur Science Po Lyon – Françoise LAMONTAGNE, IdF, ancienne responsable spectacle/INA et membre du CESE – Frédéric LARRIVÉE, Finances publiques 13 – Francoise LAROCHE, Marseille, éducatrice protection judiciaire de la jeunesse, ancienne responsable nationale – Philippe LATAUD, EDF, ancien responsable départemental et confédéral – Joël LE COQ, Le Mans, ancien responsable national transports – Jean Christophe LE DUIGOU, secteur Finances, ancien responsable confédéral – Corinne LE FUSTEC, éducation populaire, Plérin 22 –Gérard LEIDET, Professeur retraité Marseille – Serge LEQUEAU, retraité La Poste, ancien membre du CESER Bretagne puis du CESE – Didier LE RESTE, cheminot 75, ancien responsable national – Jacques LERICHOMME, éducation, PACA, ancien responsable national – Graziella LOVERA, retraitée infirmière hospitalière, ancienne responsable départementale 84 et confédérale – Jean MALIFAUD, Universitaire 75, ancien responsable national – Jean Claude MAMET, Blog syndicollectif 94 – Sophie MANGON, formatrice, syndicaliste 78 – Claude MARACHE, cadre retraité cheminot 89, ancien responsable national – Florence MAROIS, militante retraitée Industries électriques gazières 31 – Christiane MARTY, recherche et développement secteur Energie IdF – Claude MICHEL, secteur spectacle, ancien responsable national et membre du CESE – Freddy MIKA, Directeur d'école retraité PACA – Marc MORVAN, 75 – Joël MOULIN, Retraité secteur bancaire 42 Firminy – Pierre MOUROT, ministère sports Paris – Jean Louis MOYNOT, métallurgie, ancien responsable confédéral – Didier NIEL, métallurgie Paris – Alain PAUBERT, militant retraité énergie Rouen – Patrice PERRET, cheminot Champagne Ardennes, ancien responsable régional et national – Jean Yves PETIT, ancien responsable régional transport PACA et national – Gilles PICHAVANT, militant cheminot 44 – Thierry PLEYBER, militant cheminot 44 – Jean-Paul QUINQUENEAU, télécoms Orange, Maine et Loire – Didier QUINT, syndicaliste santé et services sociaux région Normandie – Stéphanie RENIER, enseignante retraitée 85 – Martine RITZ, syndicaliste, comédienne, Nantes – Jean-Louis ROBERT, enseignement supérieur 75 – Jean-Marie ROUX, secteur banques, ancien responsable national – Nicole SERGENT, éducation, ancienne responsable régionale IdF et nationale – Bernard SINOQUET, bibliothécaire retraité Services Publics Territoriaux 80 – Danielle SINOQUET, ancienne responsable nationale et membre du Conseil d'administration SNCF – Baptiste TALBOT, fonctionnaire territorial 93, ancien responsable national – Pascale TEXIER, militante cheminote 44 – Philippe TEXIER, militant cheminot Cote d'Or – Laura THIEBLEMONT, assistante sociale, fonctionnaire territoriale élue à Rouen CD76 – Eric THOUZEAU, cheminot Pays de Loire, ancien responsable national – José TOVAR, enseignant 93, ancien responsable national – Corinne TURPIN, bibliothécaire syndicaliste 78 – Patrick VANCRAYENEST, transport routier Normandie, ancien responsable national – Christine VANDRAME, militante Aubagne 13 – Yves VANDRAME, militant Aubagne 13 – Patrick VASSALO, Fonction publique finances Île-de-France – Gisèle VIDALET, cadre La Poste 31 – Benoit VINCENT, ancien responsable national et représentant des salariés au CA de la SNCF, Hauts de France – Henri WACSIN, militant cadre cheminot, Nord Pas de Calais.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

À +2 °C, trois fois plus de régions seront touchées par des chaleurs insoutenables

Avec un réchauffement de 2 °C, la part du globe concernée par des pics de chaleur dangereux pour les humains sera trois fois plus étendue qu'aujourd'hui, selon une étude. Une hausse attendue pour le milieu du siècle.
Tiré de Reporterre
6 février 2025
Par Magali Reinert
Des volontaires sprayent de l'eau sur les gens pour lutter contre la chaleur en mai 2024, à Hyderabad, au Pakistan, où il faisait entre 46 et 48 °C. - © Jan Ali Laghari / ANADOLU / Anadolu via AFP
Notre planète va devenir de plus en plus inhabitable à cause des vagues de chaleur. Selon une nouvelle étudepubliée le 4 février 2025 dans Nature Reviews Earth and Environment, les risques liés aux stress thermiques vont s'étendre fortement dans les décennies à venir.
Aujourd'hui, les régions du monde où des adultes en bonne santé sont en danger lors d'un épisode caniculaire représentent à peine 2 % des terres continentales. Une proportion qui passerait à 6 %, soit environ la surface des États-Unis, avec un réchauffement de 2 °C (par rapport à la température de l'ère pré-industrielle) attendu au milieu du siècle.
Un tiers des terres dangereuses pour les plus de 60 ans
Les risques sont encore plus critiques pour les personnes de plus de 60 ans : la proportion de régions dangereuses pendant les canicules passerait d'un cinquième des terres émergées aujourd'hui à un tiers, sous un climat à plus 2 °C par rapport à l'ère préindustrielle.
Et avec une hausse globale de température de 4 °C, ce serait alors 60 % de la surface émergée du globe qui pourrait connaître des pics de chaleur mortels pour les plus âgés, toujours selon l'étude.
En Europe, les vagues de chaleur de 2003 et 2022 avaient causé à chaque fois plus de 60 000 décès. Elles avaient contribué à la prise de conscience des effets mortels du changement climatique sur les plus âgés.
« Les personnes les plus fragiles ne seront plus les seules personnes à risque »
« Cette étude montre que les personnes les plus fragiles ne seront plus les seules personnes à risque en cas de pic de chaleur et que les stress thermiques vont devenir une question de santé publique globale », commente Benjamin Sultan, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement.
Pour identifier ces zones à risques, les chercheurs ont regardé les projections des chaleurs extrêmes sous un climat à plus 2 °C, et en particulier là où les conditions de chaleurs et d'humidité atteignent un seuil critique pour la vie humaine. Autrement dit, le seuil au-delà duquel notre organisme devient incapable de réguler la température corporelle si certaines précautions ne sont pas prises, comme une bonne hydratation.
Les zones de seuils de réchauffement incompensables (au-delà desquels la température du corps s'élève de manière incontrôlable) à droite, mortelles à gauche, pour les jeunes adultes (en haut) et le reste de la population adulte (en bas). © Nature Reviews Earth & Environment
L'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud seront particulièrement touchées, selon l'étude. « Comme on l'a vu en 2024, l'humidité très forte avant la mousson aggrave fortement l'effet des pics de chaleur. Aux Philippines, la température est montée à 39 °C en avril et la température ressentie à cause de l'humidité était de 45 °C », dit Benjamin Sultan. Car le stress thermique n'est pas lié qu'à la température mais aussi à l'humidité de l'air.
Avec un fort taux d'humidité, le corps transpire moins, ce qui limite le refroidissement de l'organisme lié à l'évaporation de l'eau. « Les périodes avant la mousson seront critiques dans les régions intertropicales, même avec des températures moins fortes que dans d'autres régions », dit le chercheur.
Chaque dixième de degré compte
Premier auteur de l'étude, Tom Matthews du King's College London souligne l'importance de ces résultats pour évaluer le coût de l'inaction climatique. Un message déjà largement repris par la communauté scientifique. Chaque année, plus d'une centaine de scientifiques du monde entier publient dans la revue médicale Lancet un décompte sur les effets du changement climatique sur la santé. Selon la dernière édition de novembre 2024, la mortalité liée au pic de chaleurs chez les plus de 65 ans a plus que doublé à cause du changement climatique en 2023.
« Il est important de rappeler que chaque dixième de degrés gagné réduit la population exposée. Une baisse de 2,7 °C à 1,5 °C de réchauffement global permettrait, selon les derniers travaux du Giec, de diviser par cinq la population exposée à des chaleurs extrêmes », insiste Benjamin Sultan.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Portrait d’ensemble

Nous avons tort d'aborder de façon isolée les nombreux défis qui se posent à nous en matière d'environnement.
Le réchauffement climatique, la montée des océans, la pollution de l'air, la contamination des sols, des eaux, la destruction des forêts et des milieux naturels, les sécheresses, la désertification, la disparition accélérée des espèces animales et végétales, les conséquences environnementales (et éthiques) de la consommation carnée et de l'agriculture et de la pêche intensive, la surabondance des déchets, sur terre, sur les rives des cours d'eau, dans l'océan, les échecs (cachés) du recyclage, l'incapacité de disposer des déchets nucléaires, leur prolifération, la pollution spatiale avec des volumes en perpétuelle croissance de débris spatiaux en orbite, et j'en passe, sont tous liés les uns aux autres, plutôt de près que de loin, et la conséquence d'un même aveuglement nourrit par la croissance sans fin du capital. En faire et communiquer le portrait d'ensemble permettrait beaucoup mieux, à coup sûr, d'ébranler les consciences.
Il y a longtemps que la crise climatique se prépare et que nos problèmes environnementaux s'amplifient et nous conduisent à des catastrophes. S'attaquer à ces problèmes sans vue d'ensemble, avec des mesures de substitution, en défendant la croissance sans fin des profits, permettait jusqu'ici à nos oligarchies (appelons-les par leur nom) de les ignorer tout en laissant croire qu'on leur accordait l'importance voulue. Et aux populations du monde, tenues à l'écart des discussions, souvent occupées ailleurs, de les ignorer ou, pis encore, de les nier.
Une parenthèse ici, à ce sujet, pour dresser le portrait de cette autre forme de pollution, celle des consciences, pour que nous sachions bien à quoi nous en tenir. Selon les données colligées par l'Observatoire international Climat et Opinions Publiques, et pour ne nous en tenir qu'aux changements climatiques, au Canada, 65 % des gens sont d'avis qu'ils sont bel et bien d'origine humaine, 24 % ne savent pas ou sont d'avis qu'ils sont d'origine naturelle, et 11 % qu'il n'y a tout simplement pas de changements climatiques. Comme on le devine, ces chiffres sont encore plus navrants aux États-Unis, où 52 % des gens sont d'avis qu'ils sont bel et bien d'origine humaine, 31 % ne savent pas ou sont d'avis qu'ils sont d'origine naturelle, et 17 % qu'il n'y a tout simplement pas de changements climatiques.
Rétablir les liens
Rétablir les liens entre les différentes formes de pollutions en offrant une vue d'ensemble de la dégradation de notre environnement aura l'effet d'un coup de massue pour plusieurs et nous fera envisager, je l'espère , cette nécessaire décroissance dont j'ai parlé dans une précédente chronique ; une nécessaire décroissance de la population, mais bien sûr aussi des activités industrielles et d'extraction, de la production et de la consommation.
L'extraction du pétrole et des matières premières, par exemple, pollue l'eau et dégrade et pollue les sols ; elle nécessite souvent la déforestation et produit des gaz à effets de serre responsables du réchauffement climatique ; elles sont à la fois la cause et la conséquence d'une consommation grandissante, de la surconsommation, qui entraîne la croissance des parcs automobiles, des flottes aériennes et navales, des transports et échanges par voies terrestre, maritime et aérienne, augmentant du coup la production de gaz à effets de serre, l'étalement urbain, la destruction des milieux naturels et la disparition des espèces animales et végétales ; une quantité ahurissante de déchets aussi, dont de dangereux déchets radioactifs et persistants dans l'environnement. Sans compter tout ce que j'ai mentionné plus haut... Sans compter non plus que cette approche productiviste, capitaliste, inégalitaire, entraîne des conflits, des guerres elles aussi destructrices de notre environnement. On n'en sort pas ! À moins de changer de cap…
Dans son excellent essai « Faire que ! », l'auteur Alain Deneault, aborde la question « quoi faire ? », que nous nous posons tous devant l'étendue des défis environnementaux, mais il le fait en déplaçant progressivement la question vers un mode d'action – « faire que » – quant à ce que nous devons faire et que nous serons amenés à faire pour changer la donne. Il nous explique que nous devrons de toute manière nous adapter aux changements climatiques et à la destruction de nos environnements et que nous le ferons nécessairement – et le plus tôt sera le mieux – en réorganisant nos activités au niveau local, dans un environnement de nécessaire décroissance.
Dans « Moins ! La décroissance est une philosophie », le philosophe japonais Kohai Saito en appelle aussi – et le plus tôt sera le mieux encore une fois – à un changement de paradigme, à cette remise en cause du capitalisme et de la poursuite d'une croissance économique illimitée, affirmant qu'il « n'y a pas de solution à la crise écologique dans le cadre du capitalisme ».
Les précurseurs et défenseurs de la décroissance sont nombreux. Dans leur ouvrage « Aux origines de la décroissance », les auteurs Cédric Biagini, David Murray et Pierre Thiesset en font une excellente recension en nous présentant les vues de cinquante penseurs aux origines de cette conception du vivre ensemble. On y retrouve entre autres des intellectuels comme Günther Anders, Hannah Arendt, Georges Bernanos, Murray Bookchin, Albert Camus, Jean Chesneaux, Guy Debord, Lanza del Vasto, Michel Freitag, Gandhi, Patrick Geddes, André Gorz, Alexandre Grothendieck, Michel Henry, Aldous Huxley, Ivan Illich, Rabindranath Tagore, Henry David Thoreau, Léon Tolstoï et Simone Weil.
État des lieux
Voici ce qui pourrait contribuer sommairement à un tel portrait d'ensemble.
Réchauffement climatique – L'Organisation météorologique mondiale confirmait dans un communiqué émis le 10 janvier que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température supérieure d'environ 1,55 °C aux valeurs préindustrielles. Le communiqué mentionne que les dix dernières années, de 2015 à 2024, ont été les plus chaudes jamais enregistrées ; que l'année 2024 a probablement été la première année civile où la température moyenne mondiale a dépassé de plus de 1,5 °C la moyenne de la période 1850-1900 ; que l'année 2024 se distingue par des températures exceptionnellement élevées à la surface des terres et des mers et une chaleur océanique intense ; et que l'objectif de température à long terme figurant dans l'Accord de Paris n'est pas devenu inaccessible mais qu'il est gravement compromis.
Nappes phréatiques – Le niveau des nappes phréatiques baisse de plus en plus rapidement dans le monde entier selon des données recueillies par le Swiss Science Today en janvier 2024. Elle s'est accélérée au cours des années 2000. Les réserves d'eau souterraine diminuent particulièrement vite dans les régions arides du monde où l'agriculture pompe l'eau du sol, comme la Californie, la Méditerranée et l'Iran.
Contamination des sols – Dans une entrevue accordée en février 2024, l'agronome, biogéochimiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et spécialiste de la contamination des sols agricoles, Matthieu Bravin, explique que de récents inventaires réalisés à l'échelle mondiale ont dénombré plus de 350 000 substances susceptibles d'être émises dans l'environnement et de devenir ainsi des contaminants. Et parmi ces substances, seuls 6 % ont fait l'objet d'études scientifiques ces cinquante dernières années, que ce soit sur leur toxicité ou leur accumulation dans l'air, l'eau ou le sol.
Déforestation : Selon les données publiées en novembre 2024 sur le site Web notre-planète.info, la déforestation récente se concentre au Brésil, en Indonésie, en Bolivie et en République Démocratique du Congo. La tendance est particulièrement préoccupante en Asie : alors qu'en 2022, la région avait réduit la déforestation de 16 % par rapport à la période de référence 2018-2020, elle a augmenté de 13 % en 2023. Entre 2015 et 2023, la perte de forêt a augmenté de 351 %.
Déchets : Selon un rapport publié par Statista en mars 2022, l'humanité génère près de deux milliards de tonnes de déchets solides municipaux chaque année, soit suffisamment pour remplir 822 000 piscines olympiques. En valeur absolue, c'est la Chine qui produit le plus de déchets municipaux avec 395 millions de tonnes par an, suivie par les États-Unis avec 265 millions de tonnes. Les États-Unis se classent toutefois bien plus haut lorsque l'on considère la quantité annuelle générée par habitant, avec environ 812 kg par résident américain. Le volume de déchets généré sur Terre est amené à augmenter à mesure que la population mondiale continue de croître et devient plus riche et consomme davantage. La Banque mondiale estimait que la production mondiale de déchets devrait augmenter de 70 % entre 2016 et 2050.
Recyclage du plastique – Le Monde diplomatique relevait dans un texte de Mohamed Larbi Bouguerra publié dans son édition de novembre 2024, la véritable escroquerie du recyclage du plastique à l'échelle mondiale, une mesure inefficace et dilatoire mise en place pour permettre aux multinationales du secteur pétrolier de poursuivre leurs activités lucratives - sans trop se soucier de l'environnement.
Déchets radioactifs – Selon un texte publié l'an dernier par la Fondation David Suzuki, l'industrie nucléaire prétend que le stockage de déchets hautement radioactifs dans des dépôts géologiques profonds est sûr, et qu'il s'agit du moyen le plus sécuritaire d'éliminer des quantités croissantes de déchets, sauf que jusqu'à présent, un seul site a depuis peu été approuvé – le site d'Onkalo en Finlande – malgré plus de quatre-vingt ans de production de déchets nucléaires.
Milieux naturels – Selon le World Widlife Fun, la dégradation et la destruction des habitats naturels sont aujourd'hui les principales menaces au regard de la biodiversité de la planète. Fragmentés, pollués, diminués, les écosystèmes naturels souffrent de l'expansion des activités humaines intensives comme la déforestation, l'urbanisation, le surpâturage ou la pêche non durable.
Disparition des espèces animales et végétales – Dans un article paru dans dans Statista en octobre, Tristian Gaudiot explique que la biodiversité de la planète poursuit son déclin. Sur les 163 040 espèces répertoriées en début d'année, 45 321 pourraient disparaître de la surface de la Terre dans un avenir proche, soit 28 % du total des espèces étudiées. Les cycadales – des plantes visuellement proches des palmiers et des fougères – sont le groupe le plus menacé, avec plus de 70 % d'espèces en voie d'extinction. La dégradation de la biodiversité est aussi particulièrement importante au niveau des écosystèmes aquatiques. Le taux d'espèces menacées atteint ainsi 41 % chez les amphibiens et plus de 35 % chez les requins, les raies et les récifs coralliens.
Sources : Alloprof, Aux origines de la décroissance (Cédric Biagini, David Murray et Pierre Thiesset), Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Faire que ! (Alain Deneault), Fondation David Suzuki, Fondation Jean Jaurès, La revanche de la nature (Aymeric Caron), Le Devoir, Le Monde diplomatique, Notre-planète.info, Observatoire international Climat et Opinions Publiques, Organisation météorologique mondiale, Presse-toi à gauche, Statista, Ski-se-Dit, Swiss Science Today, World Widlife Fun (WWF).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Un nouveau concept écologique : "L’humanicide"

Le droit international n'a pas encore intégré l'écocide, et il est peu probable qu'il le fasse pour l'humanicide. En attendant, il est urgent d'agir, ici et maintenant, pour arrêter la course à l'abîme. L'humanicide n'est pas inévitable, on peut encore l'empêcher. Mais le temps se fait court...
Billet de blog 28 janvier 2025
Un nouveau concept écologique : l'humanicide"
Le Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) de l'Exeter University (Royaume-Uni) vient de publier en janvier 2025 son nouveau rapport sur le changement climatique, intitulé "Current climate policies risk catastrophical societal and economic impacts". Ce document, d'une teneur scientifique indiscutable, a suscité beaucoup de commentaires dans la presse, qui se transmettent, presque exclusivement, à une des prédictions du document : la possibilité, dans le pire scénario, qu'à partir des années 2050 le PIB planétaire tombe à 50% de son niveau actuel. Pour les medias mainstream, en effet, le PIB est le seul critère qui compte, la mesure de toutes les choses.
Pour ceux qui, comme le philosophe humaniste grec Protagoras (Ve siècle AC), pensent que "l'être humain est la mesure de toutes les choses", le rapport de l'IFoA contient une autre information, mille fois plus importante et inquiétante : dans le scénario du pire - la température monte à 3° au-dessus de l'époque préindustrielle - la mortalité humaine pourrait atteindre la moitié de l'humanité, autour de 4 milliards d'êtres humains, victimes de la faim, du manque d'eau, des maladies, des catastrophes "naturelles" (incendies, inondations, etc.), des conflits.
On peut considérer le rapport de l'IFoA trop pessimiste ou trop optimiste, mais il donne une idée approximative de l'ordre de grandeur des risques encourus avec le changement climatique. Et pas dans un siècle : dans quelques décennies.
On connaît en droit international le concept d'écocide : la destruction ou l'endommagement irrémédiable d'un écosystème par un facteur anthropique, notamment par un processus de surexploitation de cet écosystème, intentionnelle ou non (je reprends la définition de Wikipédia). On connaît aussi, bien entendu, celui de génocide : un crime consistant en l'élimination concrète intentionnelle, totale ou partielle, d'un groupe national, ethnique ou encore religieux, en tant que tel.
Je pense qu'il faudrait maintenant introduire un nouveau concept dans la réflexion sur le droit international : l'humanicide, l'extermination concrète, totale ou partielle, de l'humanité en tant que telle. Certes, elle n'est pas intentionnelle : les criminels ne planifient pas l'humanicide, ils sont simplement indifférents aux conséquences humaines de leurs actions. Conduisant leurs pratiques en fonction d'un seul critère - la maximisation du profit - ils sont les responsables du changement climatique. Qui sont eux ? L'oligarchie fossile - les formidables intérêts liés au pétrole, au charbon et au gaz , incluant non seulement l'exploitation des ressources fossiles, mais aussi l'industrie automobile, la pétrochimie et des nombreuses autres branches de la production capitaliste, incluant les banques qui les financent - ainsi que leur expression politique : les gouvernements négationnistes ou inactifs. Donald Trump n'est que le dernier exemple, à la fois grotesque et brutal, d'un refus de toute mesure, même la plus minimale, pour empêcher ou limiter le réchauffement global.
L'association Attac utilise le concept de "criminalité climatique en bande organisée", pour désigner les responsables des catastrophes climatiques meurtrières partout dans le monde aujourd'hui. Mais si les prévisions de l'Exeter University se confirment, on se trouvera confrontés à un degré de "criminalité climatique" d'une nature infiniment plus grave.
Le droit international n'a pas encore intégré l'écocide, et il est peu probable qu'il le fasse pour l'humanicide. En attendant, il est urgent d'agir, ici et maintenant, pour arrêter la course à l'abîme. L'humanicide n'est pas inévitable, on peut encore l'empêcher. Mais le temps se fait court...
Michael Löwy

Varisheh Moradi : « La résistance, c’est la vie »

IRAN – Dans une lettre envoyée depuis la prison d'Evin, activiste kurde condamnée à mort, Varisheh Moradi déclare que son cas représente une lutte plus large contre la répression de l'État en Iran et ajoute : « Je veux renverser le destin qui se répète toujours. La résistance, c'est la vie » (le célèbre slogan kurde « Berxwedan Jiyan e ».
Tiré de Entre les lignes et les mots
Dans une lettre envoyée depuis la prison d'Evin à Téhéran, la travailleuse humanitaire iranienne Varisheh Moradi, condamnée à mort, a déclaré que son cas représente une lutte plus large contre la répression de l'État en Iran.
« Pour nous, les femmes combattantes emprisonnées, cette sentence ne concerne pas seulement moi et mes codétenues : elle représente un verdict contre une société entière », écrit Moradi.
Bien qu'elle soit condamnée à mort, la lettre de Moradi suscite une certaine résistance, soulignant le soutien national et international croissant en faveur de l'abolition de la peine de mort en Iran.
Elle a souligné que les récentes frappes au Kurdistan témoignent d'une résistance civile généralisée contre le régime.
« La société nous soutient, et cette solidarité est une expression puissante de la lutte civile en cours contre la tyrannie du régime en Iran », écrit Moradi.
Moradi a été condamnée à mort en novembre par le tribunal révolutionnaire de Téhéran pour « rébellion armée ».
Ses ennuis judiciaires ont commencé le 1er août 2023, lorsque les forces de sécurité du renseignement l'ont enlevée alors qu'elle voyageait de Marivan à Sanandaj.
Selon l'organisation de défense des droits humains, Hengaw, Moradi a subi de graves tortures au centre de détention du département du renseignement de Sanandaj, notamment au cours d'un incident au cours duquel elle aurait vomi du sang et perdu connaissance.
Après avoir passé cinq mois en isolement dans le quartier 209 de la prison d'Evin, contrôlé par le ministère du Renseignement, Moradi a été transférée dans le quartier des femmes en décembre 2023.
Voici sa lettre :
« J'ai été condamnée à mort, et nous aussi. Pour nous, les femmes combattantes emprisonnées, cette sentence ne concerne pas seulement moi et mes codétenues : elle représente un verdict contre toute une société.
C'est le rêve du régime pour nous tous : supprimer (lire : exécuter) toute la communauté. Mais, sans aucun doute, il rencontrera une résistance. Le soutien national et international à l'abolition de la peine de mort s'est accru et nous a apporté un soutien considérable.
Nous n'avons pas cédé aux accusations et aux pressions infondées imposées par l'appareil de sécurité, et nous avons résisté. La société nous soutient, et cette solidarité est une puissante expression de la lutte civile en cours contre la tyrannie du régime en Iran. La récente grève du peuple du Kurdistan est un autre exemple de cette résistance commune, et elle mérite d'être saluée.
En prison, parce que la lutte est active et de première ligne, et parce qu'elle concerne directement tout le monde, les questions de fond prennent naturellement le pas sur des questions comme les appartenances politiques ou nationales, qui occupent une place secondaire. Il s'agit d'une véritable résistance contre les tentatives de marginalisation des questions fondamentales des détenus.
Une résistance remarquable se poursuit contre le déni et la violation des droits humains dans les prisons iraniennes. Nous, les femmes, avons entrepris cette résistance, d'une part en raison de l'oppression aggravée à laquelle nous sommes confrontées dans le système patriarcal et misogyne actuel, et d'autre part en raison de notre détermination inébranlable à obtenir la liberté.
Chaque mardi, la campagne « Non aux exécutions » se déroule dans plusieurs prisons iraniennes, un acte fédérateur qui met en lumière l'essence fondamentale et humaine de notre lutte. Il s'agit d'une revendication collective visant à mettre en avant le droit à la vie et à demander l'abolition de la peine de mort en Iran. Ces « mardis non aux exécutions » représentent la solidarité humaine contre les exécutions commanditées par l'État, qui sont utilisées comme un outil pour instiller la peur et la terreur dans la société.
Cette oppression est le résultat d'un système débridé qui a pour objectif de mener le monde vers la destruction et d'éroder l'essence même de l'humanité. L'humanité, le cœur de notre existence commune, est ce pour quoi nous luttons. Notre lutte n'est pas seulement la nôtre : elle est menée au nom de toute l'humanité, de toute la société et pour la défense de notre nature collective.
En tant que « femmes combattantes emprisonnées », notre rôle nous donne la force de parler des revendications de toute une société. Adopter une position de principe donne aux chercheuses de vérité sociale le pouvoir de lutter pour elle. C'est cette « vie libre » qui doit remplacer la « fausse vie », que nous devons transformer et nous l'avons transformée.
Le système patriarcal qui domine le monde, dans toutes ses dimensions, est fondamentalement en contradiction avec l'essence de l'existence humaine et avec l'humanité elle-même. Il constitue, par essence, un défi à la vie. Nous avons redéfini ce système, nous libérant de ses interprétations sexistes, classistes et dogmatiques, pour nous concentrer plutôt sur la vérité de son existence.
Depuis des millénaires, ce système s'est écarté du chemin de l'humanité, s'attaquant aux femmes – et, par extension, à la vie elle-même – avant de soumettre les hommes et plus tard d'agresser la nature. Le but ultime de ce système ? Le profit maximum. Une cupidité alimentée par un esprit déformé.
Et quelle est la réponse ? Sans aucun doute, la résistance. C'est là que réside le point de divergence : certains s'intègrent au système, cherchent à obtenir leur part et justifient son existence, tandis que les esprits libres et les libertaires s'opposent et tentent de corriger le cours des choses.
Tout au long de l'histoire, ces assoiffés de liberté ont cru en une vie en harmonie avec la nature, mère de toute vie. Ils ont adapté leurs croyances aux conditions de leur époque et au pouvoir auquel ils étaient confrontés, luttant avec détermination pour atteindre leur but ultime : une vie humaine. Une vie bonne, vraie, belle et libre.
Nos prédécesseurs, chacun dans leur domaine intellectuel, ont cherché à définir le problème et à lutter pour le résoudre. Ils ont parfois fait face à l'oppression par la foi, parfois par le raisonnement philosophique, parfois par l'expression littéraire, et parfois par des arguments fondés sur la classe sociale.
Dans tout cela, les femmes ont toujours été présentes, toujours parmi les opprimées, toujours parmi les victimes. Pourtant, elles ont rarement été le sujet central de ces luttes – elles n'étaient qu'une partie périphérique du récit de l'oppression, plutôt que ses principales victimes.
Aujourd'hui, nous avons laissé derrière nous les vieux paradigmes. Nous pensons que le défi le plus crucial de la vie contemporaine est la question du genre à laquelle nous sommes confrontés. Ce n'est qu'une fois que l'inégalité entre les sexes sera résolue que d'autres défis auront une chance d'être relevés. Le système épistémologique dominant s'efforce sans relâche de déformer et de détourner le problème central et d'éviter les vraies solutions. Mais ce siècle est le siècle des femmes, et les femmes ont acquis la force intellectuelle et pratique de lutter pour leurs droits. Les progrès de la technologie et de la science sont également devenus des alliés de tous les combattants de la liberté, y compris les femmes.
Les femmes, armées de nouvelles connaissances scientifiques et d'une volonté forgée par le besoin de libération et de liberté, ont fait des progrès considérables dans la lutte pour l'égalité. Des efforts des femmes penseuses, scientifiques, écrivaines et artistes aux femmes ordinaires qui tentent de vivre dans la dignité et de ne pas être considérées comme des marchandises. Ces gains collectifs constituent une base solide pour faire avancer la liberté.
Les femmes kurdes ne sont pas en reste dans cette lutte. S'appuyant sur leur riche héritage culturel et social, elles ont participé à cette « lutte pour la vie » et ont contribué à enrichir la résistance et la solidarité. Aujourd'hui, les femmes kurdes sont devenues des symboles de la lutte et de l'effort féminins.
Le 26 janvier marque l'anniversaire de la libération de Kobané des forces de l'EI, un événement largement reconnu comme « le début de la fin de l'EI ». L'aube qui a suivi cette obscurité a apporté les premiers rayons de lumière. Les femmes kurdes, au vu et au su du monde, ont participé à cette guerre et ont défié le paradigme patriarcal. Elles sont allées encore plus loin et sont devenues les commandantes du combat. Elles se sont battues comme des phares de lumière et d'espoir contre l'obscurité et l'oppression et ont montré la puissance de la lutte déterminante du siècle – le « défi des femmes ».
J'ai personnellement participé à la guerre de Kobané pendant cette période et j'ai subi des blessures qui me font encore souffrir aujourd'hui. Cette douleur me rappelle constamment le prix que j'ai payé pour l'humanité. Peut-être que cela satisfait un peu ma conscience de savoir que j'ai, dans une certaine mesure, rempli mon devoir envers l'humanité.
Je suis un camarade de ceux qui, après une vie de lutte, ont dit au moment de leur martyre : « Écrivez sur ma pierre tombale que j'ai quitté ce monde en étant encore redevable à mon peuple. » D'eux, j'ai appris que lutter pour la vérité et l'humanité est une dette que chacun de nous doit payer, sans rien attendre en retour.
Chaque fois que la victoire de Kobané est célébrée, la joie et la fierté qui naissent de cette attitude digne renouvellent ma détermination. L'une des accusations portées contre moi aujourd'hui est d'avoir résisté aux ténèbres. Je suis l'ami de ceux qui ont sauvé l'humanité. Cette vérité simple mais profonde met en évidence de quel côté se trouvent ceux qui m'accusent.
Le système patriarcal ne peut tolérer la résistance des femmes, et encore moins leur victoire et leurs célébrations contre une force obscure et anti-humaine. Nous avons été les premières à reconnaître le danger qui menaçait l'humanité et nous y avons fait face sans hésitation, ce qui a permis à l'humanité de remporter une victoire significative. Aujourd'hui, elles cherchent à se venger de leur défaite de diverses manières.
Ce moment est particulièrement significatif car il coïncide avec la conclusion du centenaire des plans conçus pour notre région. Nous sommes les héritiers blessés de Sykes-Picot, les enfants d'un peuple qui a subi jusqu'au plus profond de lui-même l'oppression de Lausanne. Nous avons été pendus à des cordes, tués par toutes sortes d'armes, soumis à des attaques chimiques et avons vécu le génocide dans tous les recoins de notre patrie fragmentée. Et maintenant, accablés par une multitude de problèmes politiques et sociaux, nous sommes entrés dans l'ère de la technologie et de l'intelligence artificielle.
Mais nous sommes résolus à ce que, dans ce siècle, non seulement nous prévenions le génocide physique, mais nous définissions aussi le « génocide culturel » et le combattions de toutes nos forces. « Femme, vie, liberté » est notre slogan et une manifestation symbolique de notre paradigme idéologique – un paradigme qui aborde directement les questions fondamentales du monde et de l'humanité d'aujourd'hui.
Ce paradigme refuse de se limiter aux frontières nationalistes, sexistes ou de classe. Il cherche à aborder les problèmes de manière globale et avec une perspective élargie. De nombreux problèmes étant devenus mondiaux, la mondialisation de la lutte est l'approche la plus logique. Certains problèmes sont communs à toute l'humanité, il est donc naturel que notre combat soit fondé sur des valeurs communes.
Femme, Vie, Liberté reflète les aspirations universelles de la plupart des habitants de cette planète : une vie libre et démocratique. C'est pourquoi le monde soutient les femmes emprisonnées. Le monde, témoin de notre combat pour les valeurs universelles, est à nos côtés. Et nous, à notre tour, continuerons à avancer sur cette voie.
La région est en train de se remodeler. De nombreuses forces dessinent la carte politique et sociale de la région. L'absence de volonté populaire dans cette nouvelle configuration est flagrante. Maintenant que les forces populaires ont gagné en force et sont en mesure de s'exprimer, il faut renforcer ce front : le front de la société et du peuple. La région est empêtrée dans de nombreuses compétitions et conflits, et parallèlement à cela, d'importantes stratégies sont proposées. Il est essentiel que cette lutte passe également par la recherche de solutions aux problèmes sociétaux.
Notre problème n'est pas personnel. Être emprisonné et risquer la peine de mort sur le chemin de la lutte politique et sociale fait partie intégrante du parcours. Par conséquent, nos réflexions et nos actions concernant la résolution des problèmes politiques et sociaux s'inscrivent dans ce contexte.
C'est ainsi que nous donnons un sens à notre vie. Nous quittons le moule individualiste pour nous fondre dans le collectif, en poursuivant un objectif collectif. Le concept de « nation démocratique » est la thèse et la doctrine qui incarnent tous ces objectifs. Dans le cadre de cette solution, les besoins de toutes les personnes et de toutes les classes sociales sont satisfaits. C'est une solution qui profite à tous et ne nuit à personne. C'est la voie par laquelle nous pouvons donner un sens à la vie.
Je crois que la vie ne doit pas être vécue avec un sens ou une transcendance. De nombreux projets visant à donner un sens à la vie ont fait l'objet d'attaques hostiles et les pionniers de ces efforts ont sacrifié leur vie pour atteindre leurs objectifs. Cependant, ces sacrifices n'ont pas instillé la peur mais ont plutôt créé l'espoir de continuer la lutte et la vie. Moi aussi, j'ai emprunté ce chemin et j'ai fait face à ma situation actuelle.
Lors de mon interrogatoire, le même interrogateur qui avait interrogé Farzad Kamangar s'est assis devant moi et m'a dit qu'il y a 15 ans, Farzad était resté assis au même endroit mais n'avait rien pu faire et s'était créé la mort. Je lui ai dit que si je suis assis ici aujourd'hui, c'est le résultat des efforts et de la lutte de Farzad. Farzad, par sa mort, a tracé pour nous le chemin d'une « vie qui a du sens ».
Il nous a redonné la vie. Si un Farzad a été pendu, des centaines d'autres ont suivi son chemin. Car Farzad, Shirin, Farhad, Soran et nous tous croyons que chaque pas sur le chemin de la liberté peut être une épreuve, et qu'en sacrifiant notre vie pour la liberté, nous sortons victorieux de cette épreuve.
Aujourd'hui, je pense plus à notre lutte qu'à ma condamnation, à mon peuple, au peuple et aux jours qui attendent notre région. La lutte est notre préoccupation principale, et notre condamnation n'en est qu'une partie. Le soutien que nous apportons et l'opposition à notre condamnation font partie de la lutte précieuse que l'humanité mène pour une vie humaine, noble, belle, juste et libre.
Sur ce chemin, le principe directeur de ma lutte est le suivant : « Je veux renverser le destin qui se répète toujours dans les pièces tragiques de la vie en faveur de la liberté. Dans cette pièce intitulée Vérité, qui ne peut être achevée que par la lutte, le destin échouera cette fois-ci. »
Femme, vie, liberté
La résistance, c'est la vie
Une prisonnière condamnée à mort –
Quartier pour femmes de Varisheh Moradi, prison d'Evin
28 janvier 2025
Via Iran Wire
https://kurdistan-au-feminin.fr/2025/01/30/varisheh-moradi-la-resistance-cest-la-vie/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Rapport de janvier 2025 : Les femmes à l’avant-garde des manifestations en Iran

Le mois de janvier 2025 a été marqué par une vague de protestations dans tout l'Iran, les femmes jouant un rôle de premier plan.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/06/rapport-de-janvier-2025-les-femmes-a-lavant-garde-des-manifestations-en-iran/?jetpack_skip_subscription_popup
Une vague de résistance en Iran
De Téhéran à des villes plus petites comme Sanandaj et Ilam, des femmes de tous âges sont descendues dans la rue pour réclamer la justice, une aide économique et la fin de la discrimination. Leur présence a été frappante, démontrant une résistance inébranlable face à une répression croissante.
La fréquence et l'ampleur des manifestations
Les manifestations n'étaient pas des incidents isolés, mais un phénomène quasi quotidien tout au long du mois. Les informations indiquent que des manifestations ont éclaté dans de nombreuses provinces, notamment à Téhéran, au Khouzestan, au Kurdistan, à Ispahan, à Gilan, au Khorasan du Sud, à Mazandaran, à Fars, en Azerbaïdjan de l'Est, en Azerbaïdjan de l'Ouest, à Ilam et à Hormozgan.
Les femmes ont participé à des manifestations planifiées ou spontanées, reflétant le mécontentement croissant à l'égard des politiques du régime iranien.
Parmi les groupes les plus actifs figuraient les enseignantes, les travailleuses du secteur de la santé, les retraitées et les étudiantes. Les retraités, en particulier ceux du secteur des télécommunications, ont organisé des manifestations hebdomadaires dans de nombreuses villes, tandis que les enseignants et les infirmières ont organisé des sit-in et des manifestations de rue pour réclamer des salaires équitables et le respect des promesses du gouvernement.
Les protestations ont été particulièrement importantes parmi les enseignants retraités de la classe 2023, qui ont organisé des manifestations hebdomadaires pour réclamer leurs prestations non payées. Le régime iranien n'a cessé d'ignorer leurs demandes, ne leur laissant d'autre choix que de descendre dans la rue. Nombre de ces retraités se rendent à Téhéran depuis différentes villes et ont formé un mouvement de protestation très organisé et persistant.
Les principales revendications
Les revendications des manifestants sont diverses mais interconnectées. Les difficultés économiques sont restées au premier plan, les femmes réclamant une augmentation des salaires, des pensions reflétant l'inflation et la fin de la corruption du gouvernement. Beaucoup ont également réclamé des libertés politiques, dénonçant la répression permanente du régime à l'encontre des activistes et les arrestations arbitraires de manifestants.
Les manifestants ont notamment demandé l'abolition des lois discriminatoires, y compris les restrictions sur les codes vestimentaires et les possibilités d'emploi.
Au-delà des griefs économiques, de nombreux manifestants ont souligné que le peuple iranien reconnaissait le régime comme son principal oppresseur. Les manifestations ont également été alimentées par la frustration suscitée par la politique étrangère du régime iranien, de nombreux citoyens condamnant l'agenda guerrier du régime alors que l'économie nationale s'effondre. Le sentiment dominant parmi les manifestants est que le véritable changement ne peut venir que d'une mobilisation massive dans les rues.
Aperçu des manifestations en Iran
Le 6 janvier 2025, les éducateurs retraités de l'année 2023 ont organisé un grand rassemblement de protestation après que 16 mois se soient écoulés sans qu'ils aient reçu 60% de leur prime de retraite (gratification de fin de service). Au cours de la manifestation, les retraités ont scandé : « L'éducateur est réveillé, il en a assez des discriminations – avec toutes ces ressources, la condition de l'Iran est ruinée – Nos revenus sont dans la gueule du dragon – Iran, le pays des hauts revenus, qu'est-ce que tu es devenu ? »
Peu après, les forces de sécurité de l'État ont tenté de disperser la manifestationpacifique en utilisant du gaz poivré. Cette agression a mis en péril la sécurité physique de plusieurs enseignants retraités, qui réclamaient le paiement de leurs prestations dues depuis longtemps.
En réponse, ils ont scandé : « S'il y avait une justice, aucun enseignant ne serait ici ».
Les enseignants retraités ont organisé des manifestations similaires dans 15 autres villes, avec les femmes en première ligne.
Le 27 janvier 2025, des groupes de retraités de la Compagnie des télécommunications ont organisé des rassemblements de protestation – au moins dans les provinces de Téhéran, Zanjan, Kermanshah, Ispahan et Ilam – en réponse à l'absence de réponse des autorités à leurs revendications professionnelles et à leurs besoins de subsistance.
À Téhéran, les manifestants sont descendus dans la rue en scandant : « Notre ennemi est ici même ; ils mentent lorsqu'ils disent que l'ennemi est l'Amérique ».
À Ilam, les retraités protestataires ont souligné dans leurs slogans la nécessité d'appliquer les réglementations en matière de protection sociale. A Kermanshah, ils ont déclaré : « Un retraité éveillé en a assez de l'oppression et de la coercition ».
En outre, à Ispahan et à Zanjan, les manifestants ont crié : « Ne tardez pas plus longtemps – résolvez notre problème maintenant. »
Slogans de défi
Les slogans scandés par les manifestants révèlent la profondeur du mécontentement du peuple iranien à l'égard du régime : Nous n'avons vu aucune justice, seulement des mensonges à n'en plus finir
– Ô Dieu de la justice, décapite ceux qui commettent l'injustice.
– Ni le parlement ni le gouvernement ne se soucient du peuple
– Notre ennemi est ici même ; ils mentent lorsqu'ils disent que l'ennemi est l'Amérique.
– Aucune nation n'a jamais connu autant d'injustice.
– Assez de bellicisme, notre table reste vide.
– Le siège du commandement des télécommunications de l'imam nous a privés de nos droits.
– Nous disons que les salaires sont trop bas, mais le prix du pain augmente.
– Lâchez les foulards, maîtrisez l'inflation
– Iran, terre de richesses, qu'es-tu devenu ?
– Si un seul acte de détournement de fonds était pris, notre problème serait résolu.
– Les retraités sont réveillés et en ont assez de l'oppression.
Ces chants signifient que l'on est passé de griefs purement économiques à des appels plus larges en faveur d'un changement systémique. Les femmes manifestantes, souvent en première ligne, ont clairement indiqué qu'elles n'étaient pas simplement en quête de réformes, mais une transformation fondamentale du paysage politique iranien.
La réponse du régime : Répression et intimidation
Le régime iranien a réagi en intensifiant la répression, déployant des policiers anti-émeutes et des agents en civils pour disperser les rassemblements. Des rapports en provenance de Téhéran et d'Ispahan ont confirmé l'utilisation de gaz lacrymogènes et des arrestations massives, de nombreuses femmes étant détenues puis libérées sous caution et sous la menace. Les forces de sécurité tentaient également de freiner la mobilisation en ligne en restreignant l'accès aux applications de messagerie et aux réseaux sociaux fréquemment utilisées par les militants.
Malgré ces mesures, les manifestations se sont poursuivies. Les femmes, sans se laisser décourager par les menaces, ont trouvé de nouveaux moyens de s'organiser, notamment des manifestations éclair et des actions coordonnées dans différents quartiers afin de submerger les forces de sécurité.
Le sentiment croissant de solidarité entre les manifestants s'étend au-delà des rues, puisque les manifestations à l'intérieur des prisons ont également fait écho aux mêmes slogans. Les manifestants à l'intérieur et à l'extérieur des murs des prisons partagent une cause commune, ce qui renforce encore l'unité et la détermination du mouvement.
Le rôle croissant des femmes dans le mouvement de protestation iranien
Le mois de janvier 2025 a renforcé le rôle crucial des femmes dans la résistance iranienne. Qu'il s'agisse de mener des chants ou de faire face aux forces de sécurité, les femmes ont consolidé leur place au cœur de la lutte pour la justice et la liberté. Leur participation massive envoie un message clair : Les femmes iraniennes refusent d'être réduites au silence.
Leurs voix se faisant de plus en plus fortes, il devient impossible d'ignorer les appels au changement.
https://wncri.org/fr/2025/02/04/les-femmes-a-lavant-garde-en-iran/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

8 mars 2025 : grève féministe !

Avec les femmes du monde entier, pour les droits des femmes, toutes en grève féministe et en manifestations !
Stop à l'extrême droite, à la droite réactionnaire, au gouvernement et à sa politique libérale et autoritaire !
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/10/8-mars-2025-greve-feministe/?jetpack_skip_subscription_popup
Le 8 mars, journée internationale de mobilisation pour les droits des femmes, nous appelons à la grève du travail, des tâches domestiques, de la consommation. Sans les femmes, tout s'arrête ! Nous sommes déterminées à lutter, à faire entendre nos voix pour obtenir l'égalité.
Solidaires avec les femmes du monde entier !
Afghanes, Iraniennes, Palestiniennes, Soudanaises, Kurdes, Ukrainiennes, nous sommes solidaires de toutes celles qui encore aujourd'hui sont emmurées, exécutées, qui font face à des bombardements massifs, au génocide, à l'exode, sont victimes de viols de guerre, peinent à nourrir leur famille et elles-mêmes, de toutes celles qui se défendent farouchement pour recouvrer ou obtenir leur liberté et leurs droits, qui sont confrontées aux conflits armés, aux régimes fascisants, réactionnaires, théocratiques et colonialistes.
Nous sommes solidaires des femmes et des populations subissant de plein fouet les conséquences dramatiques du changement climatique, aggravé par les politiques productivistes et capitalistes.
Non à l'Extrême Droite !
Les idées d'extrême droite qui prônent la haine de l'autre, le racisme, la misogynie, les LGBTQIA+ phobies, le validisme, se banalisent, et sont aux portes du pouvoir, voire y accèdent partout dans le monde, à l'image de Trump aux États-Unis… Les femmes, les minorités de genre, les migrant·es en sont les premières cibles.
En France, nous dénonçons les propos racistes du ministre de l'intérieur, nous exigeons la régularisation et l'ouverture des guichets pour que tou·te·s les immigré·es puissent rester ici. Nous refusons l'abrogation du droit du sol à Mayotte et la remise en cause de l'Aide Médicale d'État.
Nous voulons vivre et pas survivre !
Les différents gouvernements ne font rien contre les inégalités salariales et les bas salaires qui touchent particulièrement les femmes (62% des personnes payées au SMIC sont des femmes). Quant aux mères isolées touchant le RSA, elles sont confrontées à de multiples difficultés pour trouver un emploi (problème de garde d'enfants, de transports…). Particulièrement touchées par la crise du logement cher, les femmes sont majoritaires parmi les personnes expulsables et sont de plus en plus nombreuses à vivre dans la rue. Les femmes sont majoritaires parmi les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté !
Nous exigeons l'abandon de la réforme du RSA, qui oblige les bénéficiaires à faire 15h de travail forcé, gratuit et sans contrat !
Nous exigeons l'abrogation des réformes sur l'assurance chômage restreignant les droits des chômeur·ses.
Rémunérons le travail à sa juste valeur, à salaire égal entre femmes et hommes !
Pour l'égalité salariale, du temps pour vivre, des salaires et une retraite décente !
Le gouvernement n'a aucune volonté de réduire les inégalités salariales, de 27% en moyenne entre les femmes et les hommes. La transposition de la directive européenne sur la transparence salariale vise à renforcer l'application du principe d'une même rémunération « pour un même travail ou un travail de valeur égale ».
Nous exigeons la transposition immédiate de cette directive, la revalorisation salariale des métiers féminisés (éducation, soins, nettoyage…)., l'interdiction du temps partiel imposé, la transformation des CDD en CDI et la réduction du temps de travail avec embauches correspondantes.
Nous nous battons pour l'abrogation de la réforme Macron des retraites, et pour une réforme des retraites favorable aux femmes, la retraite à 60 ans avec une réduction du nombre d'annuités.
Des Services publics au service de nos besoins !
Malgré la paupérisation croissante et le manque crucial d'aide publique sur les territoires, le gouvernement Bayrou va continuer le démantèlement des services publics de la Santé, de l'Éducation, du Logement…. Les femmes en seront doublement pénalisées : parce qu'elles sont majoritaires dans la fonction publique, et qu'elles devront se substituer aux services de la petite enfance et de la prise en charge de la dépendance.
Nous exigeons un service public national de l'autonomie tout au long de la vie, à la hauteur des besoins, avec les moyens correspondants, sans oublier une prise en charge réelle du 4ème âge.
Nous exigeons la création d'un vrai service public de la petite enfance pour en finir avec les crèches privées à but lucratif et les maltraitances liées aux économies de personnels dans ces structures. Nous sommes opposées à la recommandation de la Cour des comptes de développer « la garde parentale, moins onéreuse pour les finances publiques » qui n'est qu'une incitation au retour des femmes à la maison.
Pour un réel partage du travail domestique !
Nous ne pouvons nous satisfaire que rien ne bouge dans la répartition des tâches au sein des couples et ce depuis des années. Cette inégalité dans la répartition du travail domestique se traduit par des inégalités dans la sphère professionnelle et est l'un des facteurs des inégalités salariales et patrimoniales. Nous dénonçons le mirage des « nouveaux pères » car les femmes en font toujours beaucoup plus que les hommes, qui de fait prennent plus souvent les tâches valorisantes, en laissant les tâches ménagères à leur compagne. C'est tout l'enjeu d'une éducation non sexiste qui puisse permettre d'en finir avec les stéréotypes de genre.
Notre corps nous appartient !
L'inscription dans la constitution de l'IVG ne doit pas masquer les obstacles liés au manque de moyens du service public de la santé pour recourir à l'IVG.
Nous réclamons la réouverture des plus de 130 centres d'interruption volontaire de grossesse fermés.
Nous dénonçons les offensives réactionnaires qui s'en prennent aux droits des personnes LGBTQIA+ qui veulent limiter le droit de vivre librement son orientation sexuelle et son identité de genre. Nous exigeons une transition libre et gratuite pour toutes et tous.
Nous dénonçons les offensives transphobes réactionnaires, notamment les propositions de loi qui remettent en cause toute possibilité de transition des mineur·es, et nous demandons la fin des mutilations et des traitements hormonaux non consentis.
Femmes handicapées, nous subissons toutes les violences. Privées de nos droits à l'autonomie, à l'éducation, à l'emploi, aux soins et à la procréation. Nous voulons notre indépendance économique, l'accessibilité universelle à l'ensemble des lieux et bâtiments.
Halte aux violences sexistes et sexuelles !
Le procès des 51 violeurs de Gisèle Pélicot a rappelé que les violeurs sont des hommes ordinaires, et que la culture du viol persiste dans les différentes strates de la société. La nomination de Darmanin mis en cause pour des violences sexistes et sexuelles comme garde des sceaux est une véritable provocation.
Nous continuons à compter nos mortes car il n'y a aucune volonté politique de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, dont les violences obstétricales et gynécologiques, nous voulons une loi-cadre intégrale qui mette en avant prévention, éducation, protection, accompagnement, sanction et garantisse les moyens pour la prise en charge de l'ensemble des victimes, femmes, enfants et minorités de genre. Les plus touchées par les violences sexistes, dont les violences économiques, sont celles qui souffrent déjà de multiples oppressions : femmes victimes de racisme, migrantes, sans papiers, femmes précarisées, en situation de handicap, femmes lesbiennes et bi, femmes trans, femmes en situation de prostitution et celles victimes de l'industrie pornocriminelle. Nous demandons la mise en place d'actions concrètes pour lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles, protéger les victimes et combattre les réseaux de traite prostitutionnelle et de proxénétisme.
Nous exigeons les 3 milliards nécessaires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Nous refusons que les enfants violé·es, maltraité·es, incesté·es continuent le plus souvent à être abandonné·es à leur sort !
Pour l'éducation, pour les enfants, l'Éducation à la Vie Affective Relationnelle et Sexuelle pour toutes et tous maintenant !
Le dernier rapport du Haut conseil à l'égalité note que le sexisme progresse chez les adolescents et les jeunes hommes. Nous dénonçons fermement les attaques portées par le précédent gouvernement contre le projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) reprenant les propos des associations réactionnaires de parents qui y sont farouchement opposées. Nous exigeons l'adoption et la mise en place immédiate du projet de programme EVARS, dans la continuité des lois votées pour l'éducation à la sexualité à l'école. L'EVARS aide à déconstruire les stéréotypes, à comprendre les inégalités, à comprendre l'injustice des dominations qui s'exercent par les hommes sur les femmes, à prendre conscience de son corps et de son intimité et à respecter l'autre et soi-même.
Mobilisées tous les jours contre le patriarcat, les politiques libérales et autoritaires et contre l'extrême droite.
Le 8 mars, nous manifesterons, nous serons en grève féministe.
Nous serons en grève sur nos lieux de travail (santé, commerce…), en grève du travail domestique et en grève de la consommation !
Quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête !
Signataires et soutiens
Premières signataires de l'appel
ActionAid France, AFRICA93, APEL-Égalité, Association Panafricaniste des Droits Civiques des femmes, Attac France, CGT, Collectif Faty KOUMBA : Association des Libertés, Collective des mères isolées, Droits de l'Homme et non-violence, FAGE, Féministes Révolutionnaires Paris, Femmes Egalité, Fondation Copernic, Force Féministe (57), FSU, Fête des 3 Quartiers ( F3Q), Genre et altermondialisme, HFE /Handi Femme Epanouie, Handi-Social, Las Rojas Paris, Le Planning familial, Le Planning Familial 94, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Mouvement des Femmes Kurdes En France, Mouvement de la Paix, Organisation de Solidarité Trans (OST), Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France ( Stop-Vog ), UNEF le syndicat étudiant, Union Etudiante, Union syndicale Solidaires, Union des femmes Socialistes (SKB)
En soutien
APRES, Égalités, ENSEMBLE !, Gauche démocratique et sociale GDS, Gauche Ecosocialiste (GES), Génération.s, La France insoumise, Mouvement jeunes communistes de France, NPA-l'Anticapitaliste, NPA – Révolutionnaires, Parti Communiste Français, Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), Parti de Gauche, PEPS 31, Révolution Écologique pour le Vivant (REV), Union Communiste Libertaire
Télécharger l'appel : Appel 8 mars 2025 (1)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’ère du néofascisme et ses particularités

Chaque jour qui passe, et à un rythme accéléré ces dernières années, il devient de plus en plus évident que nous assistons à une nouvelle ère de montée de l'extrême droite à l'échelle mondiale, similaire à l'ère de la montée des forces fascistes entre les deux guerres mondiales du XXe siècle.
Tiré du blogue de l'auteur.
Gilbert Achcar
Professeur, SOAS, Université de Londres
L'appellation « néofascisme » a été utilisée pour désigner l'extrême droite contemporaine, qui s'est adaptée à notre époque parce qu'elle était consciente que la reproduction du modèle fasciste observé au siècle dernier n'était plus possible, dans le sens où il n'était plus acceptable pour la majorité des gens.
Le néofascisme prétend respecter les règles fondamentales de la démocratie au lieu d'établir une dictature pure et simple comme l'a fait son prédécesseur, même lorsqu'il vide la démocratie de son contenu en érodant les libertés politiques réelles à des degrés divers, selon le niveau de popularité réel de chaque dirigeant néofasciste (et donc de son besoin ou non de truquer les élections) et du rapport des forces entre lui et ses adversaires. Il existe aujourd'hui un large éventail de degrés de tyrannie néofasciste, allant du despotisme quasi-absolu dans le cas de Vladimir Poutine à ce qui conserve encore un espace de libéralisme politique comme dans les cas de Donald Trump et de Narendra Modi.
Le néofascisme diffère des régimes despotiques ou autoritaires traditionnels (tels que le gouvernement chinois ou la plupart des régimes arabes) en ce qu'il se fonde, comme le fascisme du siècle dernier, sur une mobilisation agressive et militante de sa base populaire sur une assise idéologique similaire à celle qui caractérisait son prédécesseur. Cette assise comprend diverses composantes de la pensée d'extrême droite : fanatisme nationaliste et ethnique, xénophobie, racisme explicite, masculinité affirmative et hostilité extrême aux acquis des Lumières et aux valeurs émancipatrices.
Quant aux différences entre l'ancien et le nouveau fascisme, les plus importantes d'entre elles sont, premièrement, que le néofascisme ne s'appuie pas sur les forces paramilitaires qui caractérisaient l'ancienne version – non pas dans le sens qu'il en est dépourvu, mais qu'il les maintient dans un rôle de réserve dans les coulisses, lorsqu'elles existent – et, deuxièmement, que le néofascisme ne prétend pas être « socialiste » comme son prédécesseur. Son programme ne conduit pas à l'expansion de l'appareil d'État et de son rôle économique, mais s'inspire plutôt de la pensée néolibérale dans son incitation à réduire le rôle économique de l'État en faveur du capital privé. Cependant, la nécessité peut le faire aller dans la direction opposée, comme c'est le cas avec le régime de Poutine sous la pression des exigences de la guerre qu'il a lancée contre l'Ukraine.
Alors que le fascisme du XXe siècle s'est développé dans le contexte de la grave crise économique qui a suivi la Première Guerre mondiale et a atteint son apogée avec la « Grande Dépression », le néofascisme s'est développé dans le contexte de l'aggravation de la crise néolibérale, en particulier après la « Grande Récession » qui a résulté de la crise financière de 2007-2008. Alors que le fascisme du siècle dernier s'est emparé des hostilités nationales et ethniques qui prévalaient au cœur du continent européen, dans le contexte des pratiques racistes abjectes en cours dans les pays colonisés, le néofascisme s'est épanoui sur le fumier d'un ressentiment raciste et xénophobe contre les vagues croissantes d'immigration qui ont accompagné la mondialisation néolibérale ou qui ont résulté des guerres que celle-ci a alimentées, en parallèle avec l'effondrement des règles du système international. Les États-Unis ont joué un rôle clé dans l'échec du développement d'un système international fondé sur le droit après la fin de la Guerre froide, plongeant ainsi rapidement le monde dans une Nouvelle Guerre froide.
Le néofascisme peut sembler moins dangereux que son prédécesseur parce qu'il n'est pas fondé sur des apparences paramilitaires et parce que la dissuasion nucléaire rend improbable une nouvelle guerre mondiale (mais pas impossible : la guerre en Ukraine a rapproché le monde de la possibilité d'une nouvelle guerre mondiale plus que tout autre événement depuis la Seconde Guerre mondiale, même par rapport au plus fort de la Guerre froide au temps de l'URSS). La vérité, cependant, est que le néofascisme est plus dangereux à certains égards que l'ancien. Le fascisme du XXe siècle s'appuyait sur un triangle de puissances (l'Allemagne, l'Italie et le Japon) qui n'avaient pas la capacité objective de réaliser leur rêve de domination mondiale, et étaient confrontées à des puissances économiquement supérieures (les États-Unis et la Grande-Bretagne), en plus de l'Union soviétique et du mouvement communiste mondial (ce dernier a joué un rôle majeur dans la lutte politique et militaire contre le fascisme).
Quant au néofascisme, sa domination sur le monde augmente, sous l'impulsion du retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis sous une forme beaucoup plus conforme au néofascisme que lors de son premier mandat. Ainsi, la plus grande puissance économique et militaire du monde est aujourd'hui le fer de lance du néofascisme, avec lequel convergent divers gouvernements en Russie, Inde, Israël, Argentine, Hongrie et dans d'autres pays, tandis que la possibilité que des partis néofascistes arrivent au pouvoir dans les principaux pays européens (en France et en Allemagne, après l'Italie, et même en Grande-Bretagne) se profile à l'horizon, sans parler des pays de second rang d'Europe centrale et orientale en particulier.
S'il est vrai que la possibilité d'une nouvelle guerre mondiale reste limitée, notre monde est confronté à une perspective qui n'est pas moins dangereuse que les deux guerres mondiales du XXe siècle, à savoir le changement climatique qui menace l'avenir de la planète et de l'humanité. Le néofascisme pousse le monde vers l'abîme avec l'hostilité flagrante de la plupart de ses factions aux mesures écologiques indispensables, exacerbant ainsi le péril environnemental, surtout au moment où le néofascisme a pris les rênes du pouvoir sur la population la plus polluante du monde proportionnellement à son nombre : celle des États-Unis.
Traduit de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 4 février. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Démondialisation de crise

La mondialisation heureuse (pour le Capital) appartient à un passé déjà lointain. La crise de la démondialisation lui a succédé, ouvrant un espace aux conflits géopolitiques entre États et à des replis protectionnistes partiels.
Hebdo L'Anticapitaliste - 739 (30/01/2025)
Par Pierre Rousset
Crédit Photo
Wikimedia Commons
Cependant, on ne se libère pas facilement des interdépendances tissées par la formation d'un marché mondial unique et l'internationalisation des chaînes de production. Elles sont toujours vivaces, alors que d'autres enjeux s'invitent à l'attention des gouvernants, comme les guerres et le réchauffement climatique.
Rapport de forces avec les USA
Les premiers signaux envoyés par Donald Trump sont ambivalents. Il a nommé à des postes clés de farouches opposants à Pékin, mais a suspendu l'interdiction de TikTok. Et que penser de la place de « président bis » que semble occuper Elon Musk, ce grand investisseur et soutien de Xi qui a proposé un plan de règlement de la question taïwanaise au profit de Pékin (l'homme le plus riche du monde s'accorde tous les droits d'ingérence) ? Xi Jinping doit avoir bien du mal à prévoir si un deal sera souhaitable et possible avec Trump – pour une fois on le comprend. Est-ce un signe si sa politique reste très prudente sur le front des monnaies ? Les temps étaient mûrs pour renforcer le rôle international du yuan, il n'en profite pas pour l'heure. Le bras de fer technologique et commercial entre les deux puissances est engagé, il pourrait aboutir à l'imposition au monde d'un duopole sino-étatsunien ou, inversement, à des affrontements armés.
Les États-Unis restent dominants sur le plan militaire, ainsi que pour les semi-conducteurs de pointe. Ils exigent que le champion néerlandais des puces d'intelligence artificielle, Nvidia, renonce à livrer ses produits haut de gamme à la Chine. En dépit de subventions massives à la recherche, les entreprises chinoises semblent incapables de combler leur retard en ce domaine crucial. Du coup, Pékin menace de bloquer l'exportation vers les États-Unis de plusieurs métaux essentiels à la production des semi-conducteurs (gallium, germanium…). Vous avez dit interdépendance ?
Entre l'Europe de l'Ouest et Poutine
L'influence chinoise s'étend notablement de l'Afrique à l'Amérique latine, mais cela ne saurait remplacer les liens avec les pays capitalistes développés. Or, l'accès aux États-Unis devrait se restreindre. En conséquence, Xi Jinping pourrait se tourner vers l'Europe de l'Ouest, l'Australie, la Corée du Sud — mais il y a la guerre en Ukraine de son copain Poutine, allié à la Corée du Nord ! Est-ce le moment de sacrifier cette amitié indéfectible ? Difficile alors qu'avec le réchauffement climatique, les régions polaires s'ouvrent à l'exploitation et aux communications maritimes. Pékin n'est pas un pays riverain de l'Antarctique et a besoin de Moscou pour participer au grand jeu stratégique engagé dans cette région, à l'heure où Donald Trump veut prendre possession du Groenland !
Le sort du monde dépend pour une part de dirigeants comme Donald Trump et Xi Jinping, ce qui n'a rien de rassurant. Au chaos par en haut, opposons donc l'internationalisme par en bas.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump menace surtout ses alliés

Élu, et bien élu, Donald Trump s'installe au sommet de la première puissance mondiale. Débarrassé de ses adversaires démocrates qui terrassés, se retrouvent sans chef et sans programme. Car ils ont plus perdu que lui même n'a gagné. Arrivé au pouvoir dans des conditions beaucoup moins impréparées que la première fois, il a à ses côtés des équipes qui ont mis quatre années à peaufiner leur programme, rêvent de l'appliquer sans tarder et ont acquis une expérience en matière de gestion gouvernementale.
Tiré de :La chronique de Recherches internationales
Il a depuis longtemps identifié ses ennemis et n'entend pas perdre de temps à s'en débarrasser. Il a prévenu, des têtes allaient tomber et il allait détricoter prestement toutes les décisions prises durant le mandat Biden. Qu'importe si des recours en justice bloqueront en partie ses actes. Cela ne freinera pas son ardeur.
On ne peut se dispenser d'évoquer le souvenir de l'alignement des astres qui avait accompagné au début des années 80 l'élection de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher que beaucoup considèrent comme le début d'une nouvelle ère à partir de laquelle s'était propagée la vague néolibérale mondialisée qui avait balayé la planète et mis en avant la thématique de la révolution conservatrice reprise en partie par Trump et son équipe. Mais le contexte n'est plus le même.
À l'époque la domination américaine sur le monde n'était pas contestée. Quarante ans plus tard, les États-Unis n'ont plus ce pouvoir. Entretemps, certes l'Union soviétique et ses alliés se ont effondrés, mais la Chine dès les années 2000 et son adhésion à l ‘OMC a émergé et est devenue rivale systémique. La guerre d'Ukraine et plus encore celle d'Israël a fait apparaître l'isolement de l'Occident et a révélé un « Sud global » certes disparate mais ayant en commun la volonté de ne pas apparaître alignés sur la première puissance mondiale. Bref, les États-Unis ne peuvent à eux-seuls prétendre façonner le monde ou y dicter leur loi. Leur hégémonie se limite désormais au petit monde, celui qu'on appelle l'hémisphère occidental.
Et c'est dans cet espace-là que désormais ils peuvent prétendre ambitionner de faire bouger les lignes. Leurs slogan « America first » ou « Make America Great Again », au-delà de leur portée électorale non-négligeable, ne vise en réalité qu'à maintenir un chef de filât reconnu par leurs alliés, mais très peu au-delà. Garder leur place au sein de leur camp, voilà leur ambition, même si, sujet non-invoqué, la dégringolade profonde est celle de l'Occident. En son temps l'inflexion d'Obama vers le « pivot asiatique » avait déjà anticipé cette posture poursuivie par le premier mandat de Trump à travers sa politique d'affrontement commercial.
Les chiffres sont impitoyables et sans appel. Tout d'abord le poids des pays occidentaux dans l'économie mondiale s'est affaibli au fur et à mesure que la mondialisation progressait. Cette perte d'influence s'est traduite pour les pays du G-7 par un passage de 50 % à 31 % du PIB mondial des années 1980 à aujourd'hui. Ce sont les pays non-occidentaux notamment les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine) qui en bénéficièrent, en particulier la Chine. Aujourd'hui le noyau dur des Brics a déjà dépassé la production des pays du G7. Les États-Unis sont dans l'incapacité d'agir contre cette tendance lourde et ils se retournent contre leurs alliés traditionnels qu'ils espèrent pouvoir affaiblir à leur profit.
Car c'est bien sur eux que pèsera le poids principal des mesures annoncées telles qu'elles transparaissent dans les décrets présidentiels en cours de signature.
Mais dans l'ordre interne, il y a d'abord tout ce qui relève du règlement de compte – voire de la vengeance – réservé aux adversaires et les arrangements offerts aux amis. Les charrettes ont donc commencé et il a été annoncé que le critère essentiel désormais retenu serait celui de la loyauté, manière de contrer ce qu'il appelle « l'État profond ». Les « persécutés » par Biden seront amnistiés. Une large place sera accordée aux fidèles soutiens, surtout à ceux qui n'auront pas oublié de manier le carnet de chèques de façon généreuse pour abonder la campagne, notamment ceux qui sont désignés comme des oligarques souvent appuyés sur les Gafam, bref une dizaine de milliardaires.
Dans son discours d'adieu, Joe Biden alla jusqu'à déclarer : « une oligarchie prend forme en Amérique faite d'extrême richesse, de pouvoir et d'influence qui menace déjà notre démocratie entière, nos droits élémentaires, nos libertés, et la possibilité pour chacun d'avoir une chance équitable de s'en sortir ». Constat lucide mais concernant une situation qu'il avait peut-être laissée se développer lui-même. Car il est un peu tard pour découvrir la montée des « multimilliardaires, des super, ultra-riches, les personnes les plus fortunées de la planète qui commencent à contrôler tout le système, des médias à l'économie ».
Mais l'obsession migratoire est le domaine où le nouveau président a dégainé le plus vite et, fait nouveau, a militarisé le sujet en mobilisant la garde nationale. D'emblée blocage des frontières, en particulier celle du Mexique et expulsion de migrants en situation irrégulière – estimés par lui-même à 11 millions - ont été mise en œuvre, avec plus ou moins de succès. Les recours en justice et refus des pays d'admettre leurs ressortissants ont grippé le processus. Un bras de fer s'est engagé d'où il est ressorti largement gagnant face à la Colombie, au Brésil, et au Guatémala. Les pays concernés viendront eux-mêmes chercher leurs ressortissants. Les menaces d'élévation de droits de douane ont joué leur plein effet. Mais il faudra néanmoins construire de nombreux centres de rétentions – utiliser à nouveau Guantanamo – pour amorcer un tel processus qui est engagé et marquera tout au long le deuxième mandat. Le droit du sol est menacé malgré son inscription dans la Constitution.
Dans l'ordre international, le discours est radical et concerne essentiellement ses alliés. Les marges de manœuvre face à la Chine sont réduites, tant à cause du rapport de force que des intérêts que certains des oligarques qui le soutiennent partagent avec celle qui constitue pour eux à la fois un fournisseur et un débouché non-négligeable. Le rapport à la Russie et au-delà l'implication américaine dans la guerre d'Ukraine reste le plus difficile à cerner. Les déclarations ne sont guère nombreuses et il n'est pas certains qu'une posture soit encore élaborée. Le sentiment qui prévaut n'est pas escalatoire, mais l'on sent bien que ce conflit a pour l'instant fabriqué deux gagnants – la Chine et les États-Unis – et deux perdants – la Russie et l'Europe, y compris l'Ukraine. La logique voudrait qu'on laisse s'essouffler les belligérants en participant le moins possible aux frais. Le cas israélien fait exception tant les deux États sont liés par des liens d'une extrême intensité. Les États-Unis et d'une façon générale l'Occident ont laissé Israël faire le sale boulot, c'est-à-dire mener sa guerre régionale et accumuler victoire sur victoire – Hamas, Hezbollah, Syrie, Iran – en fournissant armes, logistique, présence militaire de la 6éme flotte, et argent sans compter.
L'accord de cessez-le-feu qui reprend pour l'essentiel le plan Biden d'il y a plusieurs mois a maintenant une double paternité puisque Trump le revendique également. Pour qu'il ait fini par être entériné par Nétanyahou, il a bien fallu qu'il comporte des contreparties non publiques : connivence sur la poursuite de la colonisation de la Cisjordanie, dispersion de la population de Gaza en Jordanie ou en Égypte et/ou fourniture d'armes très offensives pour détruire le dispositif nucléaire iranien. Les milieux sionistes-chrétiens évangéliques très influents dans l'entourage de Trump pèseront de toutes leurs forces pour continuer à amarrer durablement Israël aux États-Unis. Le premier chef d'État à se rendre à Washington sera Benjamin Nétanyahou.
Mais l'essentiel des mesures envisagées concernent les pays alliés des États-Unis. Le Canada, le Mexique, Panama, le Groenland, l'Europe sont déjà ciblés sous des prétextes parfois fantaisistes. Trump propose ainsi au Canada de devenir le 51ème État américain proposant de réduire la fiscalité et les droits douaniers alors que les trois pays d'Amérique du Nord constituent un bloc commercial – l'Alena -, d'annexer le Groenland pour raison de sécurité, de s'en prendre aux pays de l'Otan accusés de ne pas augmenter leurs dépenses militaires et menacés d'être privés du parapluie militaire américain. Il espère trouver en Europe même des complices comme l'Italie ou la Pologne qui relaieraient ses menaces et introduiraient le désarroi et la désunion et n'hésite pas à encourager là où il le peut la montée des forces d'extrême droite. Il faut ajouter à ce sombre tableau le retrait annoncé de l'Accord de Paris sur le climat ainsi que celui de l'Organisation Mondiale de la Santé ou l'arrêt pendant au moins 90 jours de tous les programmes d'aide à l'étranger en ménageant l'Égypte et la Jordanie, mais pas l'Ukraine.
Il est peu sûr qu'un programme aussi ambitieux puisse se réaliser sans réactions des cibles visées qui ne manquent pas de moyens de rétorsions. Trump n'a pas compris qu'une position hégémonique suppose des faux frais qu'on ne peut supprimer sans perte de l'influence du soft power.
Cette chronique est réalisée en partenariat rédactionnel avec la revue Recherches internationales à laquelle collaborent de nombreux universitaires ou chercheurs et qui a pour champ d'analyse les grandes questions qui bouleversent le monde aujourd'hui, les enjeux de la mondialisation, les luttes de solidarité qui se nouent et apparaissent de plus en plus indissociables de ce qui se passe dans chaque pays.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Des théories pour saisir l’insécurité alimentaire

Commun à tous les phénomènes, des théories proposent toujours des explications à ces derniers. L'insécurité alimentaire ne fait pas exception. Plusieurs théories concourent ou tentent d'expliquer le fond de ce phénomène. Parmi ces théories, trois d'entre elles qui bénéficient d'une solide réputation auprès des communautés scientifiques sont passées en revue.
La théorie de Robert Malthus
Du point de vue historique, la première théorie qui propose une certaine explication jugée cohérente au phénomène de l'insécurité alimentaire a été élaborée par Thomas Robert Malthus en 1798 (Azoulay et Dillon, 1993). D'après cette théorie, expliquent les auteurs, l'inexistence des denrées alimentaires suffisantes est la première cause de l'insécurité alimentaire. Dans une telle dynamique, pour contre carrer ce phénomène il suffit d'augmenter le niveau de la production. Cette théorie est à la base de la première définition de la sécurité alimentaire proposée par la FAO au cours des années 70. À travers cette assertion Malthus semble donc inscrire la sécurité alimentaire dans la dynamique de la territorialité, c'est-à-dire la sécurité alimentaire des personnes dépend de la disponibilité des aliments dans la communauté au quelle évoluent ces personnes. La vision de la territorialité qui est dégagée dans l'analyse de Malthus précède bien ce dernier. Car, selon Vertus Saint-Louis (2003), les grands fleuves ont été déjà perçus pour accrocheurs des grandes civilisations parce qu'ils ont été à la fois des voies de communication naturelles et des lieux de naissance des grandes agricultures ; population et alimentation sont liées. C'est dans cette optique que, selon l'historien, Hérodote a qualifié l'Égypte un don du Nil.
Toutefois la théorie de Malthus est bien étudiée, il en résulte qu'une fois que la production agpri augmente, automatiquement la faim décroit ou disparaît. Donc, un lien étroit est déduit entre la production agricole et la satisfaction du besoin de se nourrir, en décelant cette théorie. Mais même si qu'il y ait un lien étroit entre la production agricole (disponibilité des aliments) et la satisfaction du besoin de se nourrir (finalité), le lieu de consommation des aliments ne devrait pas forcement le lieu de la production, comme dans les systèmes agraire traditionnels où un lien était établi entre le champ et l'assiette. D'ailleurs la Banque Mondiale, se basant sur le coût d'opportunité et les avantages comparatifs, grâce au marché international, elle encourage à l'État des pays sous-développés de se concentrer sur la réduction des inégalités sociales au lieu de produire localement, pour pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire (Courade, 1989).
En clair, le marché international est là pour satisfaire la demande alimentaire. Autrement dit, la disponibilité des aliments peut être assurée par le marché. Cependant, la Banque Mondiale, à travers sa proposition, semble ignorer quelques réalités. S'appuyant totalement sur l'approvisionnement à l'échelle international, c'est ignorer que les grandes puissances peuvent se servir de l'arme alimentaire pour torpiller les petits pays. Car pour Stéphanie Rivoal (2015), l'alimentation peut transformer en une arme de nature économique, politique et de guerres avec des effets divers. Également, l'alimentation peut être un moyen pour enrichir les producteurs agricoles étrangers au détriment des agriculteurs locaux. Mais encore, c'est banaliser les grands chocs économiques internationaux qui peuvent provoquer la flambée des prix des produits agroalimentaires. C'est ce qui se passait en 2008 (Soha, 2010).
Comparant la base de l'énoncé de la Banque Mondiale avec la théorie de Malthus, la deuxième semble être favorable à la souveraineté alimentaire portée par la via Campesina en 1996. Car la fédération des organisons paysannes définit la souveraineté alimentaire comme étant « le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles » (Gasselin, Jarrige et al., 2020 : 9). Dans la logique de la souveraineté alimentaire, la petite agriculture familiale est privilégiée afin de finir avec la dépendance alimentaire des pays du Sud (Alahyane, 2017). Néanmoins, la disponibilité des aliments locaux ne garantit pas la sécurité alimentaire, elle peut être seulement considérée comme une étape dans la sécurité alimentaire. Étape, parce qu'il pourrait avoir de production suffisante dans une communauté alors que la faim progresse dans cette même communauté, du fait que tout le monde n'est pas producteur. Car ceux qui ne sont pas producteurs, ils pourraient ne pas avoir un accès suffisants aux aliments faute de moyens financiers. Et ceux qui sont des producteurs pourraient eux-mêmes ne pas avoir assez de moyens financiers pour compléter leurs diètes alimentaires. Une telle situation a été observée au Mali à Sikasso, où la production agricole est au top, par contre selon Dury et Bocoum (2012) cité par Emmanuel Lankouande et al. (2020), la région connait une malnutrition infantile élevée. La question ne tourne pas seulement autour de la question de la disponibilité des aliments, mais également autour de celle de l'accessibilité aux aliments et d'autres paramètres.
La théorie de Amartya Sen
Selon Piguet (2010), Escheir est l'un des premiers à évoquer la question accès aux aliments. Il l'a appelé la partie gauche de « l'équation alimentaire ». Suivant l'auteur, la croissance de la production des biens alimentaires ne peut pas résoudre automatiquement le problème de la faim, bien qu'important. Il s'agit avant tout d'une question d'accès. Dans ce débat Amartya Sen s'est inscrit dans la même logique. Ainsi, explique-t-il que le fond de la question de la problématique de la faim n'est pas dans la disponibilité totale des aliments, mais dans l'accessibilité des personnes aux aliments. Donc l'existence des aliments sur le marché (disponibilité) n'a aucun sens pour la population dans la mesure où elle n'a pas les moyens financiers pour se procurer de ces aliments. C'est pourquoi il évoque la notion de capabilités (Sen 1981), cité Edmond Lankouande et al. (2020). Néanmoins, la notion de capabilités apparaîtrait un peu flou. Donc pour élucider cette notion, Sen (1985) a expliqué les capabilités par les rapports existants entre l'accès aux aliments (moyens financiers), rendement nutritionnels (âge, sexe, préférence alimentaire), des conditions environnementales, le niveau d'éducation, les caractéristiques sanitaires, cité Edmond Lankouande (2020).
La deuxième définition de la sécurité alimentaire élaborée par la FAO en 1996 trouve ses racines dans cette fameuse théorie de Sen.
Suivant les analyses de Emmanuel Bénicourt (2006), la théorie de Sen a donc lié le phénomène de l'insécurité alimentaire au manque de pouvoir des populations pour réaliser certains accomplissements. C'est une sorte de déficit de libertés de la part des individus qui sont incapables de réaliser cet accompagnement, celui de nourrir. Cet état de fait se réfère à une dynamique du sous-développement, car dans la logique de Sen, suivant le même auteur, le développement est perçu comme la réalisation d'une vie meilleure. C'est pourquoi Sen concentre sa définition du développement sur la notion de « fonctionnement ». De cette manière il évoque la capacité des personnes à réaliser certaines actions ou certains types d'états dont être bien nourri, être libre de la morbidité, être mobile, etc. En général, ces états sont appelés « le fonctionnement » des personnes. Suivant cette logique, les personnes sont libres pour choisir et réaliser ses « fonctionnements » en se basant sur des droits dont disposent ces dernières.
Toutefois pour Vertus Saint-Louis (2003) la question alimentaire tourne autour de la politique, en substance il porte à déduire que la théorie de Sen explique la vulnérabilité alimentaire des populations comme étant la résultante des actions politiques, parce que ce sont des actions politiques à travers des politiques publiques qui permettront aux citoyens de réaliser ou non certains accomplissements qui impliquent les multiples dimensions de la vie des personnes. D'ailleurs pour Patrick Hassenteufel (2014), inaction publique vaut action publique en sociologie politique. Fort de cette approche, la sécurité alimentaire peut-être insérée dans la grille des états ou actions assimilées au bien-être et que certaines personnes sont incapables de réaliser, parce que des bases ne sont pas jetées suivant des stratégies de développement.
Certes la théorie de Sen explique l'insécurité alimentaire par l'inaccessibilité des personnes aux aliments, elle assimile donc cette situation d'inaccessibilité à l'incapacité des personnes à réaliser certains fonctionnements dont celui de se nourrir, mais elle n'explique pas réellement les facteurs qui sont responsables cet état d'incapacité. C'est ce qui fait la limite de cette théorie et que peut expliquer la théorie dynamiste de Georges Balandier.
La théorie dynamiste de Georges Balandier
La théorie de Georges Balandier décrit la dynamique sociale comme un tout qui comprend des dynamismes internes et externes et qui sont responsables de certaines réalités dans des sociétés. Selon la dynamique interne tous les changements viennent de l'intérieur même de la communauté. Ils actualisent ce qui existe déjà sous forme latente, recouverte et cachée, parfois refoulée. Quant à la dynamique externe, elle est caractérisée par les forces venant d'autres systèmes et qui pèsent sur le système intérieur jusqu'à le dominer et détruit sa propre régulation. En ce sens, le système extérieur impose une régulation étrangère du système intérieur. Cela est possible inévitablement par le contact du système intérieur avec une autre société qui provoque une dynamique de prise de conscience de certaines lacunes ou différences, une aspiration vers quelque chose d'autres. Donc, la dynamique du dedans apparaît continuellement confrontée à une dynamique du dehors, par contre il est possible que ce qui semble être imposé par la dynamique du dehors soit en réalité des mécanismes internes qui jusqu'alors n'étaient pas perçus (Defour, 1994), cité par Jambere Bajoje (2011).
Par conséquent, au sujet de l'insécurité alimentaire, dans le temps les systèmes agraires traditionnels avaient un étroit lien avec l'alimentation des populations, c'est-à-dire la sécurité alimentaire des populations étaient inévitablement assurée par la production locale. Or dans la dynamique de la globalisation et de la mondialisation, l'alimentation des peuples tend vers son uniformisation à travers la logique de marché, un état de fait imposé de l'extérieur pour sécuriser l'alimentation des populations et que subissent les systèmes agraires locaux. Ce lien entre la production agricole locale et la consommation alimentaire est désormais dissout parce que la dynamique externe participe à la destruction des systèmes agraires traditionnels qui sont de la dynamique interne. De ce fait, l'insécurité alimentaire observée dans des régions du monde pourrait être perçu comme le résultat de la marchandisation de l'alimentation qui est imposée par la dynamique du dehors.
Néanmoins, cette fameuse théorie de Balandier ne prend pas en compte l'interdépendance des systèmes, où les uns ne sont pas responsables la faiblesse des autres, ce qui peut amener à la domination des uns sur les autres.
Le point sur ces théories
En effet, les trois théories analysées nous portent à comprendre que, du point de vue théorique, les manières d'appréhender l'insécurité alimentaire ont évolué au cours du temps. Également, elles nous permettent de comprendre le fondement des diverses approches issues de l'insécurité alimentaire et de la sécurité alimentaire. Toutefois chacune de ces théories a leurs limites. Ainsi, la première théorie néglige l'homme dans sa totalité. La deuxième théorie, à savoir la théorie d'Amartya Sen, appréhende l'homme dans sa dimension plus ou moins complète, mais n'explique pas les facteurs réels qui provoquent l'incapacité des populations à accéder à l'alimentation. Et, la troisième théorie explique les facteurs qui impliquent l'inaccessibilité des populations à l'alimentation, alors qu'elle ne met pas en cause l'interdépendance des systèmes.
Après avoir analysé ces théories qui tentent d'expliquer le phénomène de l'insécurité alimentaire, en dépit de leurs limites, la théorie de Sen me semble plus convenable pour pouvoir mieux analyser et expliquer ce phénomène. Car à travers cette théorie, les problèmes du développement peuvent être abordés comme des défis ou des obstacles à la sécurité alimentaire ou le bien-être et la liberté en général.
Lopkendy JACOB
Ingénieur-Agronome (FSAG/UNEPH), Maîtrisant en Sciences du Développement
(FE/UEH).
Quelques références
Alahyane, S. (2017). Souveraineté alimentaire ou le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes. In Politiques Étrangères. P. 167-177.
Azoulay, G. et Dillon J. (1993). La sécurité alimentaire en Afrique : Manuel d'analyse et d'élaboration des stratégies. In Tiers-Monde, tome 35, N°139.
Gasselin P., Jarrige F. et al. (2020). La souveraineté alimentaire. Concept et conditions d'une mise en œuvre durable. 35 p.
Bénicourt, E. (2006). Amartya Sen : Une nouvelle ère pour le développement ? Réponse à Alexandre Bertin. In Revue du Tiers Monde, No 186. Édition Armand Colin. P. 443-447.
Hassenteufel, P. (2014). Sociologie politique : L'action publique. 2ème Édition Armand Colin. 311 p.
Lankouande, E. et Sirpe, G. (2020). Analyse dimensionnelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle : Approche des capabilités. Documents de recherche de l'observatoire de la francophonie économique (DROPE) No 8. 17 p.
Rivoal, S. (2015). L'arme alimentaire. In géo-économie, No 73. P. 9-27.
Vertus, S. (2003). Système colonial et problèmes d'alimentation : le cas de Saint-Domingue au XVIIIème siècle. Les Éditions du CIDIHCA, Montréal. 231 p.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Tout comme Trump, Milei annonce le retrait de l’Argentine de l’Organisation mondiale de la santé

Le président argentin Javier Milei a annoncé le retrait du pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon le porte-parole présidentiel Manuel Adorni lors d'une conférence de presse mercredi (5), pour des raisons de "souveraineté sanitaire".
05 février 2025
La décision, selon Milei, "est basée sur les profondes divergences concernant la gestion de la santé, en particulier la pandémie de Covid-19", a ajouté le porte-parole.
"Nous, Argentins, ne permettrons pas à une organisation internationale d'interférer dans notre souveraineté, et encore moins dans notre santé", a-t-il souligné.
Le porte-parole a également déclaré que "cela donne au pays une plus grande flexibilité pour mettre en œuvre des politiques adaptées au contexte d'intérêts dont l'Argentine a besoin, ainsi qu'une plus grande disponibilité des ressources, et réaffirme notre cheminement vers un pays souverain en matière de santé".
La décision du gouvernement argentin va dans le sens du décret signé par le président américain Donald Trump pour que les États-Unis quittent l'OMS et, dans le même temps, gèlent les financements américains pour les programmes de lutte contre le sida dans les pays en développement.
Le départ des États-Unis, le plus grand contributeur de l'organisme international de santé, a forcé l'OMS à revoir ses programmes et ses priorités, a déclaré l'agence onusienne.
Le porte-parole du gouvernement d'extrême droite a également fait valoir que l'Argentine "ne reçoit pas de financement" de l'OMS et a expliqué que "pour cette raison, [le retrait] du pays ne représente pas une perte de fonds ou de qualité des services [de santé]" offerts par l'État.
"Cela donne également au pays une plus grande flexibilité pour adopter des politiques et réaffirme la voie de la souveraineté en matière de santé", a-t-il ajouté. "Les décisions argentines doivent être prises par les Argentins", a-t-il réaffirmé.
L'Argentine est l'un des 194 membres de l'OMS, ainsi qu'un membre du Conseil exécutif de l'organisation, en raison de ses politiques de santé publique et de sa participation historiquement active au sein de l'OMS.
*Avec l'aide de Leandro Melito (AFP)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Pour la défense de la souveraineté nationale mexicaine face aux agressions impérialistes de Donald Trump !

L'imposition, par le gouvernement impérialiste de Donald Trump, de droits de douane de 25 % sur les exportations du Mexique et du Canada vers les États-Unis et de 10 % sur la Chine – sous l'argument d'une ingérence caractérisée que ces pays ne font rien pour arrêter le flux de fentanyl vers le marché nord-américain – n'est qu'un prétexte pour rompre les accords de libre-échange avec ces nations et imposer de nouvelles règles commerciales en leur faveur.
3 février 2025 tiré de inprecor.fr
https://inprecor.fr/node/4553
C'est le début d'une guerre commerciale mondiale visant à enrayer le déclin d'un impérialisme qui ne peut plus supporter seul une course folle aux armements, le coût de ses agressions militaires contre les différents peuples du monde, le paiement de sa dette publique colossale et, surtout, le maintien de son hégémonie dans le domaine scientifique et technologique.
Comme à la fin de l'Empire romain, les États-Unis cherchent à maintenir leur position de « nation la plus puissante du monde », au prix de l'imposition d'énormes tributs et de la soumission des autres peuples du monde à leurs desseins.
Cette guerre commerciale s'accompagne d'un programme politique d'extrême droite qui cherche à détruire les droits du travail, le droit des femmes à disposer de leur corps, à victimiser la dissidence fondée sur le genre, à nier l'existence du changement climatique et à annuler les réductions de gaz à effet de serre, à encourager la haine, le racisme et la xénophobie à l'égard des travailleur·ses migrant·es. Il n'est pas étonnant que la cérémonie d'investiture de Donald Trump se soit terminée par un salut fasciste du milliardaire Elon Musk.
Il n'est pas exagéré de dire que Donald Trump et toute la bande d'extrémistes de droite qui l'accompagnent sont une menace pour l'humanité.
Nous saluons la réponse ferme de la présidente Claudia Sheinbaum Pardo, qui a dénoncé comme hypocrites les accusations selon lesquelles le gouvernement mexicain serait lié au trafic de drogue et a imposé des sanctions réciproques sur les importations de produits fabriqués aux États-Unis, mais nous considérons qu'il est nécessaire de promouvoir un front des nations progressistes d'Amérique latine et des Caraïbes pour arrêter l'offensive impérialiste menée par Donald Trump et pour construire un Front national antifasciste qui promeuve des mobilisations pour la défense de notre souveraineté, de nos travailleurs migrants et pour la solidarité internationaliste avec tous les peuples du monde, y compris la classe ouvrière des États-Unis et du Canada.
Le fascisme ne passera pas !
Mexico, le 2 février 2025, traduit par Fabrice Thomas.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

En Colombie, la présidence de Petro : une agitation interne, un choc et un bouleversement social

Avec près de trente mois de mandat (depuis août 2022), la présidence de Gustavo Petro a été la première expérience historique d'un projet de gauche populaire en Colombie, proposé comme alternative au pouvoir de l'ancienne et puissante oligarchie foncière, financière, commerciale et bureaucratique, détentrice d'immenses privilèges.
https://rebelion.org/petro-conmocion-interior-timonazo-y-estallido-social/
28/01/2025
Les contextes et les formes politiques ne sont pas figés, comme voudraient peut-être le faire croire ceux qui sont chargés ou contaminés par des préceptes idéologiques désuets et anhistoriques. Il y en a, et ils pullulent dans tous les espaces responsables des configurations sociales, économiques, culturelles et politiques, avec la prépondérance des infrastructures technologiques qui soutiennent aujourd'hui la communication humaine.
Tout bouge sans cesse, tout change et s'écoule dans la dialectique perpétuelle de la nature, qui embrasse les multiples dimensions de la vie sociale dans une mutation fiévreuse et irrépressible.
L'ultra-droite colombienne, tout en jouant à bloquer et à détruire la ligne de rupture, dirigée et promue par le président Gustavo Petro, planifie dans un avenir proche (2026) son retour dans les espaces du gouvernement, dont elle a été évincée par un puissant mouvement social (avril 2021), placé en mode d'explosion géologique qui a secoué les parties les plus profondes de la société nationale jusqu'à ce qu'il fasse levier sur la montée du pouvoir populaire jusqu'aux points centraux du gouvernement.
Avec près de trente mois de mandat (depuis août 2022), la présidence de Gustavo Petro a été la première expérience historique d'un projet de gauche populaire en Colombie, proposé comme alternative au pouvoir de l'ancienne et puissante oligarchie foncière, financière, commerciale et bureaucratique, détentrice d'immenses privilèges.
Trente mois de turbulences et de conflits politiques aigus ont permis à la résistance et au bloc populaire d'accéder à de nouveaux espaces et à de nouvelles ressources politiques en faveur des droits de millions de Colombiens, même s'ils ne sont pas aussi complets qu'ils le souhaiteraient, comme dans le cas de la paix, de la réforme agraire, des changements professionnels, de l'épuration militaire/policière, de la garantie du droit à la vie (massacres et assassinats de dirigeants sociaux), du monopole des pieuvres médiatiques, de l'utilisation irréprochable des fonds environnementaux et de la transparence dans la gestion des budgets (Unité de risque, Agence foncière, redevances, Sena, Sae, infrastructures éducatives, etc.).
Compte tenu de l'écart de voix enregistré lors de l'élection présidentielle de 2022, la formation du gouvernement et des équipes ministérielles avec la participation de représentants des groupes traditionnels, associés aux fractions bureaucratiques du clientélisme bipartisan, nommés ministres et directeurs à des postes élevés dans l'appareil d'état, peut s'expliquer, Toutefois, leur influence excessive a suscité la perplexité, la critique et le scepticisme des grands groupes populaires régionaux et sectoriels qui n'ont pas apprécié les concessions bureaucratiques et budgétaires accordées aux mafias et aux clans reconnus dans les bureaux des gouverneurs et des maires, qui continuent à piller les deniers publics en complicité avec des fractions et des agents du camp progressiste.
De même, il y a absence notable d'une stratégie plus cohérente pour le dialogue et l'action partagée avec les expressions des modes de production des petites économies qui impliquent des millions de personnes dans la production de produits laitiers, de sucre, de café, de riz, de panneaux, d'avocats et de détail, bien que le gouvernement se prépare (par le biais du Département pour la prospérité sociale) à canaliser d'importantes allocations budgétaires pour soutenir les économies populaires liées à l'innovation sociale et à l'esprit d'entreprise.
Mais là où de grandes difficultés sont apparues, c'est pour faire face à la violence invétérée de la Colombie, qui est un héritage colonial et bipartisan, ancré dans les profondeurs de la nation ; c'est un phénomène multiforme qui, malgré de multiples études et analyses, n'a pas été éradiqué une fois pour toutes.
C'est ce qu'a tenté de faire le président Petro avec son programme de paix totale, avec l'approbation d'une loi (loi 2272 de 2022) et l'organisation de tables rondes de dialogue et de négociation avec les principaux agents de la violence politique (acteurs de la guérilla) et de la violence criminelle (néo-paramilitaires d'Urabeños et gangs urbains).
L'une de ces tables rondes, celle formée très tôt avec l'ELN, a montré dès le départ un développement plausible avec l'organisation d'un plan de travail, d'une méthodologie et d'un corps thématique pertinent qui a pratiquement assumé et lucidement recueilli plus de 30 ans de rencontres et de désaccords de cette organisation révolutionnaire avec l'État oligarchique colombien. Le sujet le plus élaboré, dans ce scénario avec plusieurs cycles de réunions, a été celui de la démocratie et de la participation populaire, qui a réussi à construire un document historique dans la perspective de l'éradication de l'ancien État d'exclusion, qui a encouragé la violence contre la société et les secteurs populaires à travers ses appareils militaires/policiers, bureaucratiques et judiciaires.
Malheureusement, le manque d'expertise ou les préjugés excessifs (voire la mauvaise foi) d'importants gestionnaires officiels de la paix ont conduit à la faillite d'un tel mécanisme de concertation. La non-application du précepte établissant l'exécution immédiate des pactes (afin de dissiper la méfiance populaire naturelle à l'égard d'un État menteur et trompeur comme le nôtre) sur des questions telles que la pleine reconnaissance de la nature politique et rebelle - et non criminelle - des forces de guérilla et la protection humanitaire des populations assiégées par le néo-paramilitarisme des Urabeños a miné jusqu'à la ruine cet effort de paix louable et audacieux.
Aujourd'hui, la violence augmente sur tout le territoire national, avec le Catatumbo comme épicentre, avec des liens géopolitiques forts en raison de l'implication d'autres États et d'autres conflits à l'échelle continentale, que l'ultra-droite veut manipuler (en promouvant et en exigeant l'invasion militaire de Caracas) pour faciliter son offensive mondiale en agitant le drapeau de la sécurité, qui sera utilisé par le fascisme pour manipuler électoralement les citoyens au cours des 18 prochains mois jusqu'à l'élection présidentielle colombienne de juin 2026, où les risques pour le bloc populaire sont extrêmement élevés, compte tenu du retour de Trump aux commandes de l'État impérialiste américain et de la guerre cybernétique massive (avec l'intelligence artificielle à bord) pour tromper et submerger la foule.
L'exacerbation de la violence dans sa version actuelle (dans le troisième cycle de ce phénomène), avec des situations dramatiques comme celle du Catatumbo, qui entraîne des déplacements massifs et de nombreux morts (mais pas à l'échelle de ce qui se passe à Gaza avec le peuple palestinien, qui révèle la « polpotisation » des démocraties libérales occidentales), a évidemment provoqué l'intervention du président Gustavo Petro, pour contenir les dommages au tissu social local et redresser la gestion de la paix.
Comme pour donner un « coup de barre » nécessaire au scénario qui se dessine (et à celui qui a pris forme ces derniers mois avec la crise fiscale et budgétaire due au blocage parlementaire de l'ultra-droite), Petro a pris la décision de recourir à un instrument que lui offre la Constitution pour faciliter la gestion de processus perturbateurs aux tendances très explosives pour son action gouvernementale.
En ce sens, le chef de la Casa de Nariño a eu recours à la Conmoción interior, institutionnalisée par l'article 213 de la Constitution et réglementée par la loi 137 de 1994, pour résoudre les problèmes qui altèrent gravement l'ordre public et la citoyenneté dans le Catatumbo et le département de Cesar, et qui affectent également le fonctionnement financier du gouvernement central, soumis à un blocus fiscal par l'ultra-droite saboteuse, retranchée dans les pouvoirs législatif, judiciaire et médiatique.
L'utilisation de la Conmoción interior et de l'exceptionnalité démocratique par un dirigeant de gauche dans des fonctions présidentielles ne correspond pas aux schémas autoritaires et militaristes avec lesquels l'ultra-droite fasciste utilise cette figure, qui a été adoptée pour soi-disant corriger l'arbitraire qui accompagnait l'état de siège permanent décrété à partir de 1950 jusqu'en 1991.
Le bouleversement interne en cours pourrait bien atteindre les niveaux d'un « vide signifiant » qui servira pour la direction nationale populaire à synthétiser un dispositif stratégique dans le conflit avec l'ultra-droite, qui anticipe une victoire écrasante lors de la succession présidentielle de 2026.
C'est un dispositif qui peut contribuer à réorganiser et à relancer la stratégie de paix, à recomposer les relations avec le gouvernement bolivarien de Caracas (qui a déjà fait un pas important avec le dialogue entre les deux présidents et la réunion des ministres de la défense à San Cristóbal), de donner de nouveaux canaux au potentiel d'une éventuelle « explosion sociale » (avril 2021) dans les termes de ce qui a été dit à Cali par Fabio Arias, le président de la CUT, et de promouvoir un nouveau système d'alliances latino-américaines face aux manifestations agressives de l'impérialisme rapace de Trump, qui mène déjà une vaste offensive contre la population migrante aux États-Unis et se propose d'annexer le Canada, le Groenland, de reprendre le canal de Panama, de tirer parti de l'hégémonie de l'État terroriste d'Israël au Moyen-Orient et d'entrer librement au Mexique, en déclarant terroristes au préalable les cartels de drogue de ce pays, tout en contestant la voie de l'intégration de Taïwan par l'État central chinois, la présence russe dans l'est de l'Ukraine pour contenir l'expansionnisme fasciste de l'OTAN et les prétentions légitimes du Venezuela sur la Guyane.
En résumé, le bouleversement interne et ses décrets réglementaires (pour faire les arrangements fiscaux nécessaires et protéger les libertés démocratiques contre les risques de militarisme), dans l'administration du président Petro, devraient permettre un « coup d'opinion » (https://rebelion. org/29-meses-del-gobierno-petro-entre-agrio-y-dulce/ ) qui canalisera une éventuelle explosion sociale de la même manière qu'en avril 2016, récupérera le chemin de la paix et consolidera la transition politique démocratique dans les termes du schéma façonné par les puissantes mobilisations pour la paix et contre le despotisme d'ultra-droite en 2016, 2019, 2020 (drapeaux rouges), 2019, 2020 (drapeaux rouges), dans la révolte populaire historique d'avril 2021 et la défaite électorale de l'ultra-droite fasciste aux élections présidentielles de 2022.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

De quelle défaite Milei est-il le nom ?

Un an après la formation du gouvernement de Javier Milei, son projet politique commence à se préciser. L'ajustement fiscal le plus drastique de l'histoire récente et la passivité sociale face à cet ajustement marquent la fin d'un cycle qui avait commencé en 2001. Bien que Milei ait capitalisé sur le mal-être social, son programme autoritaire a ouvert une confrontation qui n'a pas encore été résolue.
Martin Mosquera, éditeur principal de Jacobin América Latina revient ici sur cette situation de défaite pour les classes populaires et dresse quelques perspectives pour y remédier.
5 février 2025 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/argentine-defaite-exteme-droite-milei-gauche-antifascisme/
***
Les contradictions et les tensions du nouveau cycle politique ouvert par l'élection de Javier Milei il y a un an se sont accrues ces derniers mois avec une intensité sans précédent. Le pays hypermobilisé que nous avons connu au cours des deux dernières décennies, sous le nom de « blocus populaire de l'ajustement » (Piva, 2015) ou d'« impasse hégémonique » (Rosso, 2022), a cédé la place à une nouvelle réalité. Selon le Financial Times, l'Argentine subit actuellement « l'ajustement fiscal le plus drastique jamais vu dans une économie en temps de paix ». Ce qui est surprenant, c'est que non seulement ce processus se soit déroulé sans explosion sociale, que beaucoup attendaient, mais aussi que le gouvernement ait réussi à maintenir un niveau de popularité élevé et à consolider son pouvoir. Quelque chose de fondamental a donc changé.
Comme le souligne Adrián Piva (2024a), la classe ouvrière argentine subit une défaite sociale silencieuse, « un ralenti », sans qu'un événement catastrophique l'ait jusqu'ici consolidée, mais dont les effets graduels permettent de comprendre la situation actuelle. Cette dynamique marque la fin du long cycle ouvert en 2001. Suite à la crise et à l'explosion sociale de cette année-là, un « blocus populaire à l'ajustement et à la restructuration » s'est formé, avec des rapports de force partiellement favorables qui, pendant des années, ont empêché la mise en œuvre intégrale des réformes économiques exigées par les classes dirigeantes. Aujourd'hui, la passivité sociale face à l'ajustement de Milei marque la fin de ce cycle politique.
Le gouvernement Milei s'inscrit dans une stratégie politique qui s'appuie sur les contradictions et les crises actuelles. Il réussit à se lier à des secteurs de la population qui se sentent frustrés et anxieux face à la détérioration économique, au désordre social et au sentiment que les élites politiques traditionnelles sont devenues incapables d'offrir des solutions. Milei a compris la gravité de la crise sociale et politique et a réussi à capitaliser sur ce malaise et à se positionner comme étant le seul capable de « faire quelque chose » et, surtout, de « faire quelque chose de différent ».
Milei, cependant, ne propose pas seulement d'appliquer un programme d'ajustement économique sévère ; il cherche aussi à exacerber le rapport de force actuel, en prenant des risques qui pourraient soit redéfinir les limites de ce qui est politiquement possible en Argentine, soit provoquer une réaction sociale qui freinerait sa politique. Son projet va au-delà d'un plan classique de stabilisation ou de restructuration de l'activité productive visant à surmonter la stagnation de la dernière décennie. Il aspire bien davantage à une rupture profonde qui modifierait structurellement les relations de pouvoir et la dynamique du capitalisme argentin. Dans ce contexte, le caractère autoritaire de son projet prend tout son sens.
Ce projet, cependant, est encore loin de se concrétiser, et une issue définitive ne semble pas imminente. Face à la tentation de tomber dans des interprétations trop pessimistes, fréquentes en période de recul, il est important de se convaincre que l'avancée de l'autoritarisme n'en est qu'à ses débuts et que son succès est loin d'être garanti. Sa consolidation dépendra de la lutte sociale et politique toujours en cours dont l'issue reste indéterminée. Nous ne sommes pas face à un « équilibre hégémonique », mais nous ne sommes pas non plus face à une défaite stratégique. La confrontation se déroule dans un scénario à la définition encore incertaine et dans une tension constante.
« Il n'y a pas d'alternative »
Contrairement à d'autres événements historiques, la défaite sociale que nous avons subie n'a pas pris une forme classique, celle d'une crise économique catastrophique aux effets régulateurs – dans le style des hyperinflations des années 1980 en Amérique latine, y compris celle de 1989 en Argentine – ou celle d'une défaite ouvrière de grande ampleur – comme celle des mineurs britanniques sous le thatchérisme ou celle des contrôleurs aériens sous l'administration Reagan –, pour ne citer que quelques exemples emblématiques.
Dans le contexte actuel, la défaite sociale est le produit d'une combinaison de facteurs moins visibles : une décennie de stagnation économique avec ses effets négatifs sur l'action collective (travail informel, travail au noir, démoralisation, etc.), une inflation élevée et persistante qui a épuisé et désemparé la population, et l'inquiétude politique générée par l'échec du dernier gouvernement péroniste, qui a laissé derrière lui un profond sentiment de frustration et de désorientation (Piva, 2024a). La classe ouvrière, affaiblie, fragmentée et épuisée par ces processus, doit maintenant faire face à l'attaque autoritaire et ultra-libérale de Javier Milei, dont l'objectif est de donner à cette défaite encore partielle une dimension stratégique de grande envergure.
Il faut souligner l'importance du moment politique de cette séquence. Le gouvernement d'Alberto Fernández est un exemple paradigmatique de la manière dont une administration dite progressiste, confrontée à une crise structurelle, est parvenu à démoraliser son propre camp social. Cela ne s'explique pas fondamentalement par des problèmes de compétence personnelle ou des conflits internes au sein de la coalition au pouvoir, mais principalement par les défis structurels auxquels était alors confrontée l'économie argentine, qui n'ont pas permis de reproduire le cycle kirchneriste qui avait précédé.
Dans un texte écrit avec Adrián Piva après la victoire du péronisme en 2019, nous avons analysé les limites structurelles auxquelles le nouveau gouvernement péroniste serait confronté et averti qu'il pourrait avoir un impact démoralisateur et ouvrir la voie à une défaite sociale qui ne résulterait pas d'une offensive directe de la droite. En référence à un précédent proche, nous avons comparé cette situation à la fin du long cycle « antilibéral » en France de 1995 à 2010.
Tout comme dans notre situation actuelle, en l'absence de victoires sociales, l'attente encore vigoureuse de changement s'est alors reportée sur le terrain électoral et a provoqué la défaite de Sarkozy et le triomphe du Parti socialiste avec un discours d'opposition « à l'austérité et à la finance ». Et lorsque le nouveau gouvernement socialiste de Hollande a montré qu'il était déterminé à poursuivre fondamentalement la politique tracée par la droite, il a provoqué une démoralisation politique qui a clos le cycle qu'avait ouvert la démobilisation sociale. En d'autres termes, ce n'est que par l'action successive des deux forces politiques opposées qu'a pu être refermé le « cycle antilibéral » français : d'abord une droite agressive, puis une social-démocratie continuiste, qui a fait sien le there is no alternative thatchérien et démoralisé son propre camp social.
D'une manière plus générale, c'est ce scénario qui, comme le souligne à juste titre Piva, a caractérisé le changement de cycle politique en Europe dans les années 1980. Alors que, en Amérique latine, les dictatures militaires ont été nécessaires pour y parvenir, en Europe, la montée des classes populaires à la fin des années 1960 a été stoppée par une convergence de facteurs moins brutaux : une stagnation économique prolongée avec des caractéristiques inflationnistes et la mise en œuvre de politiques d'ajustement par des gouvernements de gauche provoquant la démoralisation et la désaffection du bloc social qui avait soutenu le pacte de l'après-guerre. François Mitterrand et l'Union de la gauche en France, le Compromis historique et le PS de Benito Craxi en Italie, le PSOE en Espagne et le PASOK en Grèce en sont des exemples représentatifs.
Le socialisme européen a fini par devenir l'exécuteur ultime de la prescription selon laquelle « il n'y a pas d'alternative », un héritage condensé dans la célèbre phrase de Margaret Thatcher à propos de son plus grand succès politique : Tony Blair et le New Labour.
L'ensemble de ces processus a produit une inflexion négative de la situation politique, en générant un sentiment d'impasse, de perplexité et d'épuisement qui a ouvert la voie à l'offensive néolibérale. Contrairement à certaines interprétations réductrices des analyses de Gramsci, selon lesquelles tout projet sociopolitique ne peut progresser et se stabiliser que s'il devient hégémonique avant ou pendant sa mise en œuvre, l'offensive néolibérale en Europe occidentale ne s'est pas appuyée sur un consensus majoritaire, ni même passif (le cas de l'Europe de l'Est est différent). L'hégémonie n'est venue qu'après la défaite de la classe ouvrière et la restructuration de la société sur des bases néolibérales. La force de son offensive n'était pas fondée sur un large consentement populaire, mais sur la détérioration des relations de pouvoir et l'érosion du champ social qui avait sous-tendu le pacte de classe de l'après-guerre. Les travaux de Stuart Hall et de Bob Jessop mettent clairement en évidence le caractère non hégémonique du populisme autoritaire de Thatcher.
Droitisation d'un côté, résignation de l'autre
L'attention se concentre généralement sur les conséquences de l'impasse sociale sur la force relative de la classe ouvrière, ce qui conduit souvent à négliger la manière dont le « blocage populaire », « l'impasse hégémonique », a également eu un impact positif sur la base sociale de la droite. Plus de deux décennies de « blocus » n'ont pas seulement alimenté l'impatience des classes dirigeantes, mais ont également profondément marqué leur base sociale, en particulier les classes moyennes anti-populistes. Ce phénomène est essentiel pour comprendre la droitisation autoritaire de ce secteur social.
Même si des politiques orthodoxes ont été appliquées dans certaines circonstances, les classes dirigeantes et les partis traditionnels ont dû faire face à une forte résistance sociale au cours de cette période. En fait, la stagnation économique prolongée est le signe d'une situation non résolue dans le domaine des rapports de classe. Le kirchnerisme et le « gradualisme » de Macri, chacun à sa manière, ont fini par en prendre acte et à s'adapter à ces rapports de force. Cette dynamique a généré une radicalisation croissante de la base électorale de l'anti-péronisme, qui a perçu le « blocus populaire » comme un veto anti-démocratique.
Macri a capitalisé sur ce sentiment en accusant le péronisme de bloquer tout gouvernement issu de l'opposition. Même si en de nombreuses occasions, le péronisme a contribué à assurer la gouvernabilité et s'est peu impliqué dans les mobilisations sociales, le lien entre la protestation de rue et le principal parti d'opposition a servi la politique de Macri, qui n'a pas manqué de dénoncer en maintes occasions les « actions violentes » qui entraveraient le fonctionnement normal d'un gouvernement non péroniste. La dénonciation des « tonnes de pierres » jetées sur la police lors des manifestations de masse contre la réforme des retraites de 2017 en est un exemple emblématique.
Ces mobilisations ont marqué un tournant pour le gouvernement de Macri, qui n'a pas réussi à s'en remettre. Mais elles ont également renforcé dans sa base sociale l'idée que des mesures plus drastiques et répressives étaient nécessaires pour venir à bout de ce blocage « corporatif », politiquement intéressé.
Comme l'explique Javier Balsa dans son livre ¿Por qué ganó Milei ? (2024), Macri a sans attendre saisi l'opportunité de justifier l'échec de son gouvernement, ce qui lui permettait en même temps d'ouvrir la porte à un second mandat beaucoup plus radical. Macri a considéré qu'il avait échoué parce qu'il avait été trop prudent dans la mise en œuvre des réformes nécessaires (« gradualisme ») et parce que le péronisme et la mobilisation sociale l'avaient empêché de mettre en œuvre son programme. Son nouveau programme et sa nouvelle stratégie en ont donc résulté naturellement : la nécessité d'une « thérapie de choc » néolibérale et d'un affrontement répressif direct avec ceux qui l'empêcheraient de gouverner. Macri est allé jusqu'à déclarer publiquement qu'il était prêt à assumer qu'il puisse y avoir des victimes lors des affrontements. Au-delà de son échec, il a pu mettre en place les conditions conceptuelles d'une radicalisation autoritaire de sa base électorale, assuré qu'il pourrait l'exploiter, lui ou son candidat. Mais c'est Milei qui, candidat sans lien avec les partis traditionnels, a incarné le plus fidèlement ce programme.
L'anti-progressisme et la « culture woke »
La montée de l'extrême droite à l'échelle mondiale a coïncidé avec une réaction virulente contre ce que ces courants appellent « l'idéologie du genre » ou « la culture woke ». Il ne faut pas y voir seulement une résistance aux avancées du féminisme : c'est aussi une stratégie efficace de l'extrême droite pour canaliser et politiser divers mécontentements sociaux, en particulier dans l'électorat jeune masculin.
Les résultats des élections de 2023 en Argentine reflètent l'efficacité de cette stratégie : les hommes de moins de 30 ans ont joué un rôle décisif dans la victoire de Milei. Si cette tranche d'âge avait voté comme le reste de la société, l'extrême droite n'aurait pas gagné (Balsa). Cette droitisation « anti-woke » des hommes jeunes semble devenir un phénomène mondial (Main, 2018).
Cela ne signifie pas que le féminisme soit responsable de la montée de l'extrême droite, comme ont commencé à l'insinuer certains milieux aux nostalgies sexistes et conservatrices évidentes mais aussi certains secteurs progressistes, avec une vision simpliste qui ne s'appuie sur aucun argument fondé et ne prend pas en compte les aspects fondamentaux du processus historique en cours : la détérioration des conditions de vie, le désordre économique, la frustration politique. Or les grands événements historiques sont souvent le résultat de l'interaction complexe de multiples facteurs, et il est essentiel de tirer les leçons du rôle joué par la gauche et les mouvements sociaux ces dernières années, y compris le féminisme.
Je m'attarderai sur un aspect. En 2018, alors que Javier Milei était un inconnu sur la scène politique, Agustín Laje, pionnier de la droite alternative en Argentine, a déclaré que « la révolte de la jeunesse la conduira à s'opposer à l'idéologie du genre » et que celle-ci « représente le statu quo, quelque chose de contraire à ce que signifie être jeune ». Ces déclarations, pratiquement ignorées à l'époque, révèlent déjà une sensibilité à une tendance latente et à une stratégie possible : celle d'exploiter le malaise de secteurs de la jeunesse masculine qui, sous l'effet de crises matérielles et symboliques, commençaient à voir dans la montée du féminisme la source d'un mal-être croissant.
En réalité, Laje a repris les arguments politiques savamment élaborés depuis des années par l'alt-right américaine, qui a compris très tôt qu'il existait une série de mécontentements dans la population masculine qui n'étaient pas pris en compte et propices à une politisation réactionnaire. Milo Yiannopoulos, l'une des figures les plus influentes de l'alt-right anglo-saxonne, a comparé la montée en puissance de ce courant à la rébellion de la jeunesse de mai 68, mais à l'envers : alors que cette jeunesse se révoltait contre la morale conservatrice de la gauche, l'alt-right se présente comme une nouvelle droite portée par une résistance à la prétendue moralisation qui accompagne le politiquement correct et la culture woke (Reguera, 2018). Selon Yiannopoulos, dans un contexte où les attentes matérielles des nouvelles générations ne sont pas satisfaites, la jeunesse se rebelle à la fois contre ses conditions de vie et contre les contraintes morales d'une culture oppressive perçue comme faisant partie du même système social. La réaction antiféministe actuelle de la jeunesse pourrait ainsi être interprétée comme une version inversée de 68.
Comme je l'ai souligné dans un texte précédent, « si le fascisme diffère d'autres mouvements réactionnaires ou autoritaires en ce qu'il appelle à la révolte (contre les politiciens, la finance, les élites, etc.), ce qui lui permet de capitaliser sur les frustrations sociales de différentes natures (situation économique, normes culturelles répressives…) et de se revendiquer d'un programme libérateur », alors « la tendance gauchiste-libérale à la moralisation et à une conception punitive de la vie sociale lui prépare le terrain » (2018). En ce sens, une moralisation excessive émanant des secteurs progressistes peut être contre-productive, car elle transforme les conflits sociaux en batailles dont l'enjeu est l'affirmation de vertus individuelles. Non seulement cela fragmente les mouvements populaires en réduisant leur potentiel unificateur, mais cela contribue également à ce que des secteurs mécontents, en particulier parmi les jeunes, voient dans l'extrême droite un moyen de résister à un discours qu'ils perçoivent comme excessivement condamnatoire ou coercitif.
Qu'est-ce que l'extrême droite ?
La nature de l'extrême droite fait l'objet d'un débat intense dans le monde entier. Selon une interprétation largement répandue, il s'agit d'une version légèrement plus radicale du conservatisme classique, conçue essentiellement comme une prise de contrôle politique d'une droite traditionnelle en crise et sans intention réelle de remettre en question les fondements de la démocratie libérale conventionnelle. Des exemples tels que Giorgia Meloni, qui a une affiliation fasciste directe mais gouverne comme une conservatrice plus ou moins traditionnelle, sont des références clés pour cette interprétation.
Les gouvernements Trump et Bolsonaro ont également joué un rôle dans le renforcement de l'idée que l'extrême droite ne représente pas une nouveauté radicale sur la scène politique. La première administration Trump, après la panique déclenchée par sa victoire, a buté sur le caractère fortement anti-césarien du système politique américain, qui, libéral au sens le plus « contre-majoritaire » du terme, utilise ses fameux « poids et contre-poids » pour empêcher toute incursion politique d'interférer avec les objectifs stratégiques de l'État américain et de la classe dirigeante.
Diverses raisons ont enrayé l'avancée autoritaire dans des cas tels que Trump et Bolsonaro, outre, évidemment, les résistances politiques. Cependant, je voudrais en souligner une qui est restée ignorée : la pandémie. Paradoxalement, la crise sanitaire a « protégé » contre d'éventuelles impulsions autoritaires. Malgré le débat libéral sur l'autoritarisme numérique et étatique lié aux restrictions sanitaires – qui a eu des échos même à gauche (souvenez-vous des déclarations extravagantes d'Agamben à l'époque) – cette crise a affecté tous les gouvernements et les a obligés à concentrer leurs politiques publiques pendant deux ans.
L'absence de mesures efficaces contre la pandémie, un crime humanitaire en tout état de cause, a eu son corrélat politique dans l'impossibilité d'aggraver significativement les mesures autoritaires. La pandémie a érodé le capital politique des gouvernements Trump et Bolsonaro, dans la mesure où l'urgence sanitaire a débouché sur une impasse politique. Cela étant, à la fin du premier mandat de Trump, le sentiment était que le système démocratique en était, dans l'ensemble, sorti indemne. De même, le gouvernement Bolsonaro, qui semblait augurer du retour du fascisme, n'a pas réussi à progresser de façon significative vers un régime autoritaire. Cela a conduit, dans ces deux cas, à privilégier l'idée que l'extrême droite ne représente pas une menace réelle et que les barrières institutionnelles continuent à jouer leur rôle de frein.
Mais cette analyse reste superficielle et limitée à des phénomènes politiques spécifiques et mal compris. Au cours de la dernière décennie, les expériences autoritaires se sont multipliées avec succès dans un certain nombre de pays, en particulier de la périphérie : la Turquie, l'Inde, la Hongrie, la Pologne, la Russie, les Philippines, l'Égypte, ou encore le Salvador. Pour comprendre la nature de ces processus, il ne faut pas se limiter à l'analyse des formes politiques propres au fascisme classique, avec son parti unique et son État corporatiste-totalitaire. À ne considérer que deux catégories, la démocratie libérale et le fascisme, on retrouvera les termes de certains débats sur l'extrême droite, où les opinions sont polarisées entre ceux qui voient des signes de fascisme dans toute forme d'autoritarisme et ceux qui minimisent les risques autoritaires parce que les institutions démocratiques libérales restent actives.
L'extrême droite n'est plus vraiment une nouveauté, et des catégories plus précises, telles que « autoritarismes compétitifs » ou « régimes hybrides » (Levitsky et Way, 2004 ; Diamond, 2004), ont été proposées dans des études universitaires pour décrire certains des phénomènes contemporains dont nous avons discuté. Il s'agirait d'une subversion intrinsèque de la démocratie libérale, qui maintiendrait l'apparence extérieure d'un régime fondé sur des élections mais sous une forme partiellement manipulée (au moins partiellement). Ces concepts se réfèrent à des systèmes politiques qui conservent des caractéristiques démocratiques formelles, telles que des élections périodiques et le multipartisme, mais dans lesquels les appareils de pouvoir limitent au maximum les libertés politiques, sociales et civiles. Le régime électoral existe, mais il est contrôlé par en haut, avec des dispositions répressives qui le privent de toute substance véritablement démocratique. Le meilleur exemple d'un tel régime politique est sans doute la « démocratie illibérale » d'Orban qui, après sa victoire en 2010, a procédé au démantèlement progressif des éléments démocratiques du système politique.
On trouve là un écho du concept d'« étatisme autoritaire » formulé par Poulantzas dans les années 1970. Même si Poulantzas se référait alors à un État fort en tant que centre de la reproduction capitaliste dans le cadre de l'État-providence, son concept acquiert une pertinence renouvelée dans le contexte actuel. Auteur d'une analyse remarquable des « régimes d'exception », tels que le fascisme ou les dictatures militaires, Poulantzas considérait que ce type de régime était susceptible de se stabiliser sous la forme d'un régime politique « normal » et d'aller au-delà d'un régime temporaire face à une situation de crise. L'étatisme autoritaire, comme les régimes hybrides qu'évoquent les études contemporaines,n'implique pas nécessairement la dissolution des institutions démocratiques, mais se caractérise par un renforcement de l'appareil d'État et une concentration du pouvoir politique autour d'une figure forte. Cela se traduit, selon Poulantzas, par le recours croissant aux méthodes répressives, le contrôle des médias, la manipulation des élections et la prééminence de l'exécutif sur le législatif, avec pour objectif de stabiliser le régime politique sur des bases autoritaires, sans remettre en cause en apparence la démocratie libérale.
La progression de l'autoritarisme, on le voit, est généralement un processus graduel. Cette caractérisation s'oppose aux représentations, souvent mythifiées, d'événements passés où le changement de régime politique passait nécessairement par un processus de rupture radicale. C'était le cas des dictatures militaires où, du jour au lendemain, les militaires ont pris le contrôle de l'État, suspendu la constitution, imposé l'état de siège, etc. Les représentations de l'effondrement de la République de Weimar, souvent mythifiées, soulignent la rapidité avec laquelle les nazis ont réussi à s'imposer et à instaurer leur dictature.
Le fascisme italien offre, à l'inverse, une variante significative. Mussolini a gouverné pendant un certain temps en coalition avec les partis traditionnels, avec déjà des ministres fascistes dans son gouvernement, tout en instaurant progressivement un régime autoritaire. Les études actuelles sur le fascisme parlent ainsi souvent de « processus de fascisation » (Ugo Palheta, 2021) et soulignent qu'il ne s'agit pas d'un régime qui s'instaure du jour au lendemain, mais d'un processus graduel, qui connaît des sauts et des ruptures, et dont le développement s'étend généralement sur toute une période.
Le projet 2025 de la fondation Heritage Foundation pro-Trump présente un scénario explicite visant à transformer le gouvernement américain en un régime de ce type pendant la seconde mandature de Trump. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le système politique américain, avec son caractère libéral contre-majoritaire, comporte de nombreux mécanismes d'exclusion politique qui pourraient faciliter une telle transformation. Il s'agit notamment de la faible participation électorale, d'un système bipartite extrêmement restrictif qui interdit pratiquement toute incursion démocratique d'une nouvelle formation politique, de la normalisation des méthodes brutales de répression et du recours à des lois d'exception inscrites dans les institutions telles que le Patriot Act, adopté en 2001 et toujours en vigueur, et d'autres politiques sécuritaires mises en œuvre sous le prétexte de lutter contre le terrorisme.
Il n'est pas certain que Trump parvienne à imposer un changement de cette ampleur et il peut en aller de même pour d'autres expériences d'extrême droite. Le résultat final sera déterminé par la lutte politique. Mais que la mobilisation politique contre une menace autoritaire puisse la faire échouer ne veut pas dire que cette menace n'existait pas.
En sciences sociales, ces conceptions sont qualifiées de « prédiction suicidaire ». La « prédiction suicidaire » se réfère à des situations dans lesquelles l'acte même de prédire un phénomène social influence son développement de telle manière qu'il finit par l'empêcher de se produire. Un exemple récent est celui de la pandémie : la courbe ascendante des infections et des décès a fait augurer d'une catastrophe sanitaire potentielle et conduit les gouvernements à mettre en œuvre des mesures préventives qui ont fait que la prédiction ne s'est pas réalisée. Ne considérant que le résultat final, comme dans le cas de la pandémie, et ignorant la catastrophe qui s'annonçait, certains secteurs soutiennent que la menace était inexistante. Si nous envoyons un signal d'alarme clair et que nous parvenons à déclencher une mobilisation politique adéquate, nous pouvons réussir à provoquer « l'auto-destruction » de cette prédiction. On ne doit pas être surpris que ce négationnisme s'enracine dans des secteurs de gauche.
Le gouvernement de Milei doit être considéré comme un projet autoritaire en devenir dans la perspective d'un autoritarisme compétitif. Il suffit d'observer comment, avec un pouvoir politique limité et dans un contexte économique défavorable, il a réalisé des avancées rapides et significatives dans le renforcement autoritaire de l'État. La persécution judiciaire des mouvements sociaux et territoriaux, qui en quelques mois ont été réduits à leur plus simple expression minimale ; le « protocole antipiqueteros », qui restreint radicalement la possibilité de manifester ; la déclaration d'« essentialité » dans certains secteurs, qui annule en pratique le droit de grève ; les pouvoirs législatifs délégués à l'exécutif, qui permettent un exercice césarien du pouvoir ; le projet de réforme restrictive du système électoral ou encore l'intensification de la répression contre les mobilisations sont des signes clairs d'une transformation à l'œuvre.
La « bataille culturelle »
On peut dire qu'il existe deux grands types d'extrême droite dans le monde. Même si de nombreuses nuances en distinguent les diverses déclinaisons nationales, pour les besoins de l'argumentation nous retiendrons que l'extrême droite prend deux formes fondamentales.
La première, la plus ancienne, a aujourd'hui perdu de son importance au niveau mondial : son principal représentant est le Rassemblement national de Marine Le Pen en France. La stratégie de Le Pen pourrait être considérée, dans un sens assez strict, comme un « gramscianisme d'extrême droite ». Elle est fondée sur une lutte politico-culturelle prolongée visant à gagner des positions dans tous les domaines de la société française, en s'appropriant par mimétisme l'histoire et les valeurs nationales (la république, la laïcité, etc.) tout en « lepénisant » peu à peu la France. Le lien que le lepénisme établit avec les traditions culturelles nationales s'apparente d'assez près à un schéma gramscien, voire laclausien [de Ernest Laclau – NdT] : il s'agit d'une réarticulation réactionnaire des thèmes conventionnels (les « signifiants vides ») du sens commun national, où la république et la laïcité sont réinterprétées et instrumentalisées dans la dénonciation raciste du « communautarisme » d'une minorité musulmane.
Il y a d'autre part l'extrême droite que l'on pourrait qualifier de « trumpiste » : c'est une extrême droite plus « bolchevique » que « gramscienne ». Elle vise à quitter les marges pour investir par la force le centre, par une guerre de mouvement rapide et, de ce point de vue, s'apparente davantage au fascisme historique. Par des manœuvres rapides, profitant d'un contexte d'instabilité et de crise générale, portée par une vague de colère sociale, elle parvient à s'emparer du pouvoir en peu de temps.
Cette extrême droite s'appuie sur deux stratégies complémentaires pour affronter la « bataille culturelle ». D'une part, elle cherche à galvaniser sa propre base sociale fortement sur-conditionnée idéologiquement, ce qui lui permet de s'enraciner durablement dans un électorat de masse, même si cette base n'est pas suffisamment large pour conformer une majorité électorale. Tant dans l'opposition qu'au gouvernement, elle se renforce dans une logique de polarisation qui élargit sa base à chaque confrontation, quelle qu'en soit l'issue. C'est plus l'impact idéologique de l'affrontement que son résultat concret qui importe le plus souvent. Pour consolider une majorité sociale et électorale, elle se donne pour objectif d'obtenir dans le domaine économique et managérial des résultats qui ne laissent aucun doute quant à la nature de l'idéologie qui a réussi à s'imposer et à offrir une issue à la situation. Cette construction polarisante présente des similitudes avec les néo-populismes latino-américains, qui s'appuient pour la plupart sur une « minorité intense » et une base électorale majoritaire acquise par les succès économiques.
C'est de cette deuxième forme que relève Milei. Même si son administration souligne souvent l'importance de la « bataille culturelle » et va jusqu'à utiliser des clichés gramsciens, son approche s'inscrit clairement dans la stratégie « trumpiste ». Le principal « appareil d'hégémonie », voire le seul, est Milei lui-même, qui proclame en permanence, haut et fort, son intention de rompre avec un siècle de collectivisme économique. Quand son administration obtient certains succès économiques, sa stratégie vise à montrer clairement, dans chaque cas, à quelle idéologie est dû ce succès.
Mileinomics
Je me limiterai à quelques remarques sur les possibilités de réussite économique de Milei, car c'est un sujet qui nécessiterait un texte distinct. Sa stratégie économique repose sur un modèle qu'a déjà connu l'Argentine : une appréciation artificielle de la monnaie nationale et un processus de déréglementation et d'ouverture aux importations visant à réduire l'inflation et à générer un « effet de richesse ». La relève des taux de change facilite un flux permanent de dollars dans la « sphère financière » et la spéculation à court terme. Cette politique a pour double effet de discipliner politiquement, d'une part, par le déclin des secteurs industriels non compétitifs et l'affaiblissement des syndicats, tout en essayant par ailleurs de maintenir un climat de stabilité économique à court terme. Il s'agit d'une politique par essence temporaire, qui est conduite à déboucher sur des crises aiguës, prenant la forme d'une récession, de dévaluations brutales et d'une aggravation des conflits sociaux.
Le facteur temps joue ici un rôle clé. La première fois que cette stratégie a été appliquée, par le ministre Martínez de Hoz, pendant les dernières années de la dictature militaire, elle a duré moins de trois ans et n'a servi qu'à prolonger la durée de vie du régime pendant une courte période, avant de conduire à une dévaluation brutale et à l'explosion des mobilisations syndicales. En revanche, sous le régime de Menem, une stratégie similaire a pu être développée pendant une décennie entière, ce qui a permis de consolider la défaite stratégique de la classe ouvrière et de remodeler la société selon les canons du néolibéralisme. En 2016 et 2018, bien qu'avec moins d'intensité, le gouvernement Macri a également tenté, pendant une brève période, de recourir à une appréciation du taux de change, ce qui a provoqué une panique bancaire et s'est soldé par une forte dévaluation de la monnaie.
Milei sera-t-il Martínez de Hoz, Menem ou Macri ? La possibilité de disposer du temps nécessaire pour reproduire un processus similaire au menemisme dépendra à la fois de l'afflux de dollars et de la capacité à empêcher ou à contourner une résistance sociale importante. Toute cette stratégie repose sur la possibilité de stabiliser la situation par un afflux constant de dollars. Dans les années 1990, les privatisations et l'endettement ont permis cette stabilisation mais aujourd'hui la marge est beaucoup plus étroite, en raison d'un endettement élevé et de l'absence d'actifs publics importants à privatiser. Les nouveaux gisements de gaz, de pétrole et de minerais pourraient peut-être générer un apport de devises suffisant pour prolonger le régime. De même un prêt du FMI, préconisé par l'administration Trump, serait essentiel pour gagner du temps et s'affranchir du contrôle des capitaux.
Le facteur temps ne conditionne donc pas seulement la durée de la période de stabilité, mais aussi la capacité du gouvernement à tirer parti du contexte (effet richesse, discipline monétaire, stabilité) pour imposer des transformations structurelles qui affaiblissent la capacité de réaction des forces sociales. Le véritable enjeu n'est pas seulement de savoir combien de temps peut durer une telle stratégie, mais si elle marquera durablement les relations sociales et économiques avant que ce modèle économique ne s'épuise ou ne cède la place à un modèle plus durable.
Enfin, bien qu'il ne soit plus fait référence à la dollarisation depuis la fin de la campagne électorale, elle conserve un poids symbolique et politique important. Initialement présentée comme une solution définitive aux problèmes économiques du pays, la dollarisation a évolué vers un modèle de « concurrence monétaire », similaire à celui du Pérou et du Venezuela, dans lequel circulent plusieurs monnaies ayant cours légal, avant tout la monnaie locale et le dollar. Au-delà de sa faisabilité technique, cette proposition témoigne aussi de l'univers mental du gouvernement. La dollarisation n'est pas seulement une stratégie économique, elle représente l'idéal post-politique et post-démocratique d'une économie autogérée. Elle suppose que l'économie peut fonctionner de manière autonome, libérée de toute interférence politique, comme une machine autorégulée qui se libère de toute nécessité de prise de décision démocratique. La perte du contrôle de la monnaie laisserait le pays à la merci, sous une forme particulièrement brutale, de ce que Marx décrivait comme la « contrainte muette des rapports économiques » (une formule qui donne son titre au récent ouvrage de Søren Mau). C'est une conception de nature autoritaire dans la mesure où elle vise à soustraire l'économie à toute forme de contrôle démocratique.
Cette stratégie post-démocratique de dollarisation est en résonance avec la situation de la zone euro, où les politiques économiques sont largement déterminées par des institutions transnationales, loin de tout contrôle démocratique au niveau national. La dollarisation est donc sous-tendue par un projet de dépolitisation radicale, le rêve d'une économie qui fonctionne automatiquement, sans intervention collective ni décision politique. Autrement dit, on a là une version concrète et prosaïque de l'extravagante utopie anarco-capitaliste d'un marché sans État.
La gauche continue de sous-estimer le danger de l'extrême droite
Au vu de ces éléments d'analyse des processus politiques en cours, on doit constater que, pour l'essentiel, la gauche a sous-estimé et mal interprété la montée fulgurante de l'extrême droite.
Une première erreur a été de supposer que le soutien électoral à Milei n'était que l'expression d'un vote de protestation, comme si l'agitation sociale pouvait être canalisée par n'importe quel camp et que la captation de cette agitation par l'extrême droite n'était que contingente et éphémère. Cette interprétation ne prend pas en compte le processus de reconfiguration idéologique et sociale qui a précédé sa brusque irruption, un processus qui montrait des signes alarmants depuis au moins 2019.
Par ailleurs, la gauche, en majorité, a pensé que, même en cas de victoire électorale, Milei ne parviendrait pas à élargir son assise minoritaire tant parlementaire qu'institutionnelle. C'était négliger les conditions de gouvernabilité offertes par le régime hyperprésidentiel argentin, ainsi que la prédisposition transversale de la classe politique à soutenir des réformes économiques impopulaires que personne n'avait été en mesure de mettre en œuvre au cours de la décennie précédente, mais qui bénéficiaient d'un soutien profond au sein des élites politiques et économiques.
Une autre erreur a été de supposer que, s'il parvenait à se stabiliser sur le plan institutionnel, la mise en œuvre du programme de Milei l'amènerait rapidement à se confronter à sa propre base électorale. Cette analyse ignorait le processus de droitisation qui avait conduit de larges secteurs sociaux, y compris dans les couches populaires, à accepter des sacrifices au nom d'un changement perçu comme inévitable et nécessaire pour rétablir l'ordre dans la société. Cette tendance a été confirmée par des enquêtes d'opinion très sérieuses (Balsa, 2024), qui montrent comment le mécontentement et la crise ont été utilisés pour légitimer des politiques d'ajustement et d'autoritarisme par la promesse d'un retour à la normale.
Enfin, certains secteurs de la gauche n'ont pas compris que ce qu'ils ont appelé « l'impasse hégémonique » (Rosso 2015, Dal Maso, 2023) se caractérisait par une instabilité intrinsèque. Non seulement elle ne peut se prolonger indéfiniment, mais sa dynamique même sape progressivement ses fondements, créant ainsi les conditions de son dépassement. L'émergence d'un leadership autoritaire qui parvient à débloquer la paralysie politique est l'une des voies typiques de ce dépassement. C'est à cette logique que Gramsci se réfère lorsqu'il qualifie une telle conjoncture de « catastrophique ». Ce concept de « situation dans laquelle les forces en lutte s'équilibrent de façon catastrophique » contribue à expliquer l'émergence de leaders césariens. Toute analyse qui invoque le concept d'impasse catastrophique de Gramsci, mais omet les dynamiques d'auto-érosion qu'il décrit, ne fait qu'utiliser ce concept de façon superficielle et prétentieuse, sans en saisir le sens (Mosquera, 2023a).
En synthèse, ces erreurs d'analyse ont conduit à l'illusion que les politiques d'ajustement déclencheraient une réaction populaire plus ou moins immédiate. Un tel pronostic ignorait pourtant à la fois la démobilisation et la démoralisation sociales engendrées par l'épuisement du cycle politique précédent et la droitisation autoritaire croissante d'une partie considérable de la société. Or cette radicalisation n'affecte pas seulement les classes moyennes historiquement anti-populistes, mais commence également à imprégner, bien que de manière encore limitée, les secteurs populaires.
Si une partie de l'opinion publique progressiste semble aujourd'hui commettre l'erreur inverse en se laissant impressionner par la force conjoncturelle de Milei et en considérant comme déjà perdue une lutte qui se poursuit, ce qui est surprenant c'est que la gauche marxiste, elle, ne semble pas avoir évolué dans sa caractérisation du phénomène. Comme Karl Popper l'a souligné à propos des discours pseudo-scientifiques, il est toujours possible de recourir à des arguments ad hoc pour valider l'hypothèse centrale, à savoir, ici, la non-viabilité du gouvernement Milei. À gauche, cela revient généralement à postuler un report temporaire où l'effondrement du capitalisme, la rupture des masses avec le réformisme – pour citer les exemples classiques – ou, dans le cas présent, la réaction sociale à la politique d'ajustement, sont perçus comme des processus qui prennent simplement « plus de temps que prévu ».
Il y a aussi une autre façon d'introduire une hypothèse salvatrice ad hoc, très courante dans la gauche trotskiste : s'il n'y a pas de grandes mobilisations, c'est du fait des directions politiques ou syndicales qui les bloquent. Les masses veulent en découdre, mais ce sont les directions qui freinent. Cette argumentation largement répandue pose de nombreuses questions. Il est difficile en effet de comprendre qu'elle soit toujours défendue si ce n'est, selon les termes de Jonathan Haidt, que ce genre de croyance perdure par sa capacité à renforcer la cohésion de groupe de ceux qui la défendent plutôt que par son rapport à la réalité (2012). Pourquoi, en d'autres circonstances, avec les mêmes directions, les luttes parviennent-elles à se développer ? Les directions bureaucratiques bloquent-elles et se positionnent-elles toujours à la droite de leur base ? La nature contradictoire de la bureaucratie syndicale qui, comme le souligne E. Mandel, se nourrit du blocage mais aussi de la défense partielle des revendications des travailleurs, ne la pousse-t-elle pas à agir dans certaines circonstances ? Et la passivité de la bureaucratie n'est-elle pas aussi un indicateur du niveau d'activité et d'auto-organisation de la base et de sa prédisposition à la lutte ? Comme l'écrit justement D. Bensaïd (1995) :
Si les conditions objectives sont si favorables, comment expliquer que les conditions d'une solution à la crise de direction n'aient pas été résolues, ne serait-ce que partiellement ? L'explication dérive inévitablement vers une représentation policière de l'histoire hantée par la figure récurrente de la trahison, quand les conditions les plus propices sont sabotées par des « directions traîtres » et que l'allié le plus proche est toujours, potentiellement, le pire ennemi (1995).
Cette tendance à se cramponner à ses propres hypothèses, malgré l'absence de vérification par les faits, conduit la gauche à adopter une attitude qui, à l'instar de Pannekoek dans sa critique de Kautsky, pourrait être décrite comme une forme de « radicalisme passif ». Elle fait de la politique, pour reprendre l'expression par laquelle Sartre caractérisait le trotskisme dans les années 1950, un « art de l'attente ». Il s'agit d'une attitude passive qui s'en remet à l'événement rédempteur, au lieu de concevoir la politique comme une pratique d'intervention consciente et stratégique, capable de s'ajuster au rythme réel et incertain de la lutte des classes.
Quelle stratégie ?
Antécédents historiques
Dans les années 1930, Trotsky a écrit certaines de ses pages les plus brillantes à propos de l'Allemagne, « dont la qualité d'étude concrète d'une conjoncture politique est inégalée dans les analyses se réclamant du matérialisme historique » selon les termes de Perry Anderson. Dans ces textes, Trotsky défend la politique du « front unique » pour affronter le fascisme, dans la continuité des concepts élaborés par l'Internationale communiste au cours de la décennie précédente. Dans des conditions d'isolement comparables – l'un déporté sur une île turque, l'autre emprisonné dans une prison fasciste – Trotski et Gramsci ont fait partie des quelques voix qui, comprenant la menace de la montée du fascisme, se sont opposées au cours sectaire imposé par le stalinisme qui a finalement facilité l'accès au pouvoir d'Hitler en Allemagne.
Ces écrits continuent d'offrir de précieuses leçons. En premier lieu, ils analysent correctement la menace représentée par l'extrême droite et le danger d'une défaite historique qui pourrait détruire physiquement et institutionnellement les organisations du mouvement ouvrier. De là résulte l'urgence de mettre en œuvre une politique unitaire qui rassemble tous les courants de la classe ouvrière pour faire face à cette menace. Ensuite, ils soulignent l'importance de ne pas subordonner la lutte antifasciste à la bourgeoisie libérale, dont la politique alimente souvent les causes dont se nourrit l'extrême droite (comme l'illustre, dans un cas contemporain, le retour de Trump après le bref intermède de Biden). Enfin, ils insistent sur la nécessité de maintenir l'indépendance des militants révolutionnaires dans les cadres unitaires.
Les écrits de Trotsky sur l'Allemagne sont de véritables joyaux politiques et rhétoriques, propres à émouvoir tout militant conscient des bifurcations historiques et des urgences de l'action. Ses lettres à un « ouvrier social-démocrate » et à un « ouvrier communiste » sont un condensé de sa perception aiguë de la crise politique et de son appel à l'action, à quoi s'ajoute la virtuosité littéraire d'écrits conçus dans un but éminemment pratique. En revanche – comme l'a souligné Perry Anderson – ses analyses de l'Espagne et de la France témoignent d'un certain sectarisme à l'égard de la petite bourgeoisie et de ses partis, un défaut de lucidité en comparaison avec ses écrits sur l'Allemagne.
Cette politique unitaire se fondait sur le diagnostic qu'une révolution socialiste se profilait à l'horizon. Pour Trotsky, la lutte contre le fascisme était indissociable de l'objectif de renversement du capitalisme dans un avenir relativement proche. Il ne s'agissait pas d'adopter une politique sectaire « classe contre classe » – comme celle des staliniens – mais de reconnaître la nécessité d'unifier la classe ouvrière pour bloquer l'offensive fasciste, de réaliser une unité capable de canaliser cette force dans une contre-offensive contre la bourgeoisie, dans un contexte où l'acuité de la crise offrait encore la possibilité d'une issue révolutionnaire. Tout comme pour Lénine pendant la Première Guerre mondiale, l'action politique consiste à transformer la lutte contre le symptôme en une lutte contre la cause, à transformer la guerre impérialiste en guerre civile et en révolution sociale. Trotsky a appliqué ce raisonnement à l'analyse du fascisme, qui était à ses yeux la manifestation exacerbée de la crise ultime du capitalisme. Pour le révolutionnaire russe, la crise politique aiguë de l'époque était porteuse aussi bien de la possibilité d'une révolution que d'une contre-révolution, un dilemme qui exigeait une intervention stratégique résolue.
On peut se demander si cette analyse était tout à fait juste dans son contexte historique. Certains ouvrages d'auteurs de l'École de Francfort, tels que Ouvriers et employés à la veille du Troisième Reich d'Erich Fromm ou Études sur la personnalité autoritaire d'Adorno, montrent que l'influence de l'autoritarisme au sein de la classe ouvrière était plus profonde qu'on ne le pensait à l'époque. Pour Otto Bauer le fascisme n'était pas dirigé contre une révolution qui était déjà vaincue, mais contre le socialisme réformiste – syndicats, démocratie, droits du travail – qui existait encore. Angelo Tasca a défini le fascisme comme une « contre-révolution posthume et préventive » : posthume, parce qu'elle était consécutive à la défaite des tentatives révolutionnaires de la classe ouvrière ; préventive, parce que la classe ouvrière, bien qu'affaiblie, restait une menace potentielle à neutraliser définitivement.
Le fascisme visait à transformer une défaite partielle de la classe ouvrière en une défaite totale aux conséquences catastrophiques. Trotsky, comme le révèle une lecture attentive, fait montre d'une compréhension lucide de cette dynamique même si son optimisme quant à la capacité de réaction du mouvement ouvrier ait finalement été exagéré. Les lectures postérieures, qui exagèrent la parité dans l'équilibre des forces entre le fascisme et le mouvement ouvrier, ne rendent pas pleinement compte de la complexité et de la richesse de son analyse.
Perspectives actuelles
Entre la situation des années 1930 et notre réalité actuelle, il y a une discontinuité radicale qui a eu des conséquences politiques. Après la défaite du socialisme au XXe siècle, notre horizon historique a changé. La situation actuelle ne reflète pas la polarisation des années 1930, quand la confrontation entre la gauche révolutionnaire et l'extrême droite était plus équilibrée. Aujourd'hui, l'initiative et la radicalisation sont incontestablement du côté de l'extrême droite, tandis que la gauche et les secteurs populaires sont sur la défensive, se limitant, au mieux, à résister à l'offensive réactionnaire. Dans ce contexte, penser que la gauche anticapitaliste peut rivaliser avec l'extrême droite sur le terrain de l'« anti-système » est une erreur stratégique (Canary, 2024). Il n'existe pas d'« espace commun anti-système », politiquement abstrait ou instable, comme cela aurait pu être le cas dans certaines conjonctures de polarisation politique exacerbée.
L'un des effets de l'absence d'une telle polarisation est que, loin de provoquer l'effondrement des formations de la gauche classique au profit d'options plus radicales, la progression de l'extrême droite tend à renforcer les organisations réformistes traditionnelles telles que le PSOE en Espagne, le PT au Brésil ou le Parti démocratique en Italie, et à isoler la gauche radicale. Il ne faut pas s'en étonner : confrontés à l'urgence de freiner politiquement l'extrême droite, les secteurs populaires se protègent avec les instruments politiques les mieux positionnés pour accomplir cette tâche, quelles que soient leurs limites. Ainsi, l'irruption de l'extrême droite a mis fin aux processus de « pasokisation » du centre-gauche et le PASOK a même réussi à se relever après le désastre de Syriza.
Cela signifie-t-il, comme le veut le bon sens libéral, que la gauche devrait se tourner vers le centre pour gagner les secteurs modérés et tenter d'isoler l'extrême droite ? En aucun cas : c'est cette stratégie qui nous a conduits là où nous en sommes.
Une gauche qui se subordonne aux politiques néolibérales finit par éroder le lien fragile qui existe encore entre le mouvement syndical et les vestiges de la culture de gauche. Pour faire face à l'extrême droite, nous ne pouvons pas nous soumettre aux politiciens néolibéraux responsables du désastre actuel. Ce n'est pas une alliance entre la gauche et le « centre » libéral qui permettra de vaincre l'extrême droite. Au-delà d'accords temporaires pour faire barrage à des personnalités comme Trump, Le Pen ou Bolsonaro lors d'échéances électorales déterminées, une alliance durable ne ferait que renforcer les éléments sociaux et politiques dont se nourrit l'extrême droite.
Dès lors, comment équilibrer de façon cohérente la critique de la capitulation néolibérale de la gauche et le scepticisme à l'égard de la stratégie consistant à disputer à l'extrême droite la « rébellion anti-establishment » ?
Il existe, dans les rangs de la gauche, une explication simple et populaire de la montée de l'extrême droite, liée à la prise de conscience que nous traversons une période de grande agitation sociale, fruit de décennies de politiques néolibérales. En s'adaptant au consensus néolibéral ou en se positionnant comme un allié subordonné et modérément critique de l'« extrême centre », la gauche a perdu ses liens avec sa base sociale. Dans ce scénario, l'extrême droite, avec un discours fort et une image d'extériorité au système politique néolibéral, a capitalisé sur le mécontentement en occupant l'espace acquis à la gauche, mais laissé vide quand elle a renoncé à incarner l'agitation et de la rébellion. D'où la « rébellion de droite » à laquelle nous assistons aujourd'hui. Il suffirait alors à la gauche de se repositionner comme porte-parole du mécontentement pour regagner, petit à petit, les marges sociales attirées par l'extrême droite. Il faudrait opposer au radicalisme de la droite un radicalisme symétrique de la gauche, en rejetant toute « politique du moindre mal » et toute alliance avec des secteurs réformistes partisans du statu quo néolibéral.
Si cette argumentation contient des éléments de vérité, notamment en ce qui concerne les effets de la capitulation néolibérale de la gauche institutionnelle, elle soulève malheureusement aussi des problèmes insurmontables. Une partie de son impact réside dans son caractère rassurant quand elle situe le problème sur un terrain familier pour la gauche. Il suffirait de « récupérer » le radicalisme perdu. C'est faire peu de cas du fait que ceux qui sont tentés par cette analyse sont, en général, ceux qui n'ont jamais renoncé à cette radicalité et qui, pourtant, ne sont clairement pas sortis de la marginalité alors que l'extrême-droite progresse fortement partout dans le monde. Le radicalisme de gauche n'a pas le même rendement politique que le radicalisme de droite.
Cette analyse se heurte aussi à un problème empirique particulièrement évident dans le cas de Milei. En Argentine, il existe depuis plus d'une décennie une gauche radicale ayant une influence parlementaire et une présence dans les médias. C'est le cas du Front de gauche et des travailleurs – Unité (FITU). Alors que Milei était encore un inconnu, la gauche trotskiste argentine jouait déjà un rôle important dans le paysage politique. On peut donc se demander pourquoi la crise tant attendue du péronisme ne lui a pas apporté de bénéfices électoraux ou politiques significatifs et a plutôt favorisé l'extrême droite.
Une autre question élémentaire se pose inévitablement : alors que le peuple disposait d'une gauche radicale plus forte et plus structurée que l'extrême droite, pourquoi cette dernière est-elle parvenue à accéder au gouvernement tandis que la gauche trotskiste se maintient à des pourcentages électoraux oscillant entre 3 % et 6 % et qu'elle a même subi un revers lors des dernières élections ? L'argument qu'avancent certains, comme quoi cette gauche se serait modérée ou parlementarisée, ne résiste pas à l'analyse la plus élémentaire. Au-delà des difficultés liées à des tactiques ultra-gauches et sectaires, il s'agit de courants combatifs et sincères, clairement opposés au consensus néolibéral dominant (Mosquera, 2023b). La gauche trotskiste semblait idéalement placée pour exploiter un vote de protestation. Pourtant, non seulement elle n'y est pas parvenue, mais elle a même régressé.
Cette caractérisation repose aussi sur une ambiguïté fondamentale quant au concept de « gauche ». Il est vrai que les partis dominants – progressistes, réformistes et modérés – ont généré une profonde frustration qui a facilité la progression de l'extrême droite. Mais cette gauche n'a jamais été radicale et n'a pas vocation à l'être, et sa politique gouvernementale dans le passé n'a pas nécessairement conduit à la montée de l'extrême droite. En revanche, la gauche vraiment radicale existe, mais reste marginale. Que faire alors ?
Il faut donc affiner la tactique et l'analyse du contexte. Il faut comprendre que le processus politique évolue dans une direction différente et pose des problèmes différents. Il n'y a pas de mal-être ou de radicalisme qui soit politiquement vide. Jusqu'à un certain point, on peut apporter une réponse sociologique en identifiant les secteurs sociaux radicalisés, principalement la classe moyenne historiquement anti-péroniste. Tenter de devenir l'aile gauche de ce radicalisme ne mène qu'à l'isolement ou, pire, à la capitulation devant la droite. Les exemples ne manquent pas, tel le PSTU au Brésil pour n'en citer qu'un.
La montée de l'extrême droite traduit une période de reflux, encore partiel et limité, marqué par la démobilisation et la démoralisation du camp progressiste, alors que la radicalisation du camp de la droite s'accentue. Il ne s'agit pas de polarisations liquides et instables, ni d'agitation qui seraient en dispute. La stratégie pour faire face à cette nouvelle période historique passe obligatoirement par la reconnaissance de cette réalité fondamentale.
La caractérisation classique du fascisme par Angelo Tasca comme « contre-révolution posthume et préventive » nous offre une analogie pour saisir le processus que nous voulons caractériser. À l'instar du fascisme qui n'a pas attaqué frontalement la révolution, mais est venu parachever le processus quand les menaces révolutionnaires avaient déjà régressé, l'ultra-droite ne cherche pas ici à rompre avec l'« équilibre hégémonique », mais parvient à s'imposer parce que la situation était déjà en « déséquilibre » et qu'il fallait quelqu'un pour mener le processus à son apogée.
Bien qu'il s'agisse à première vue d'une différence mineure, on a bien deux conceptions substantiellement différentes : celle qui considère que l'autoritarisme naît de la faiblesse des classes dirigeantes face à la résistance populaire, ce qui les oblige à recourir en urgence à des mesures extrêmes et celle qui considère qu'il est le produit du fait que les classes dirigeantes connaissent une situation de force relative qui leur permet de parachever ce qu'elles avaient déjà entrepris. Dans le premier cas, nous sommes confrontés à une situation typique de polarisation, où la progression de l'extrême droite peut paradoxalement être le signe d'une opportunité pour la gauche. Dans le second, il s'agit d'une phase ultra-défensive, avec le danger d'une évolution réactionnaire et des risques physiques autant qu'institutionnels pour la gauche et les classes populaires. Les tâches qui découlent de chacun de ces scénarios sont donc très différentes.
Conclusion
Notre analyse qui reste générale ne permet pas de définir avec précision l'architecture concrète d'une tactique politique qui exigerait une évaluation aussi bien des acteurs que des opportunités et des risques dans une conjoncture donnée. Nous pouvons cependant proposer une caractérisation générale et suggérer une direction à suivre. Si, comme je le soutiens ici, nous traversons un moment défensif, il est essentiel de donner la priorité à l'action coordonnée et unifiée des classes populaires, au-delà des divergences politiques et de la concurrence entre les courants politiques. C'est une position que partagent, sur le plan des principes et même sur le plan théorique, les organisations même les plus sectaires, tout en restant généralement réticentes à la mettre en pratique.
Nous devons, en tant que socialistes, nous fixer l'objectif de battre le gouvernement Milei dans la rue, par une mobilisation populaire d'où émergeraient des rapports de force plus favorables. Mais si un tel scénario ne se concrétise pas, l'affrontement politique se déplacera inévitablement sur le terrain électoral. Et, si nous écartons toute vision délirante du rapport de force actuel, il est clair que la gauche socialiste n'a aucune chance de vaincre Milei avec ses seules forces sur ce terrain. C'est précisément ici que s'inscrit le débat sur la position à adopter face à l'opposition néo-populiste qu'incarne le kirchnerisme.
Le péronisme semble, quant à lui, semble prêt à s'adapter à ces novelles contingences en proposant la formation d'un « front démocratique » très large incluant des secteurs de la droite traditionnelle. Si de tels accords peuvent éventuellement permettre d'obtenir une victoire électorale temporaire, ils compromettent fortement la possibilité de saper les bases sociales de l'extrême droite. Le cas du gouvernement actuel de Lula en est un exemple éloquent : bien qu'extrêmement populaire durant son second mandat, grâce à l'impact significatif des politiques de redistribution que permet une conjoncture économique favorable, le Lula modéré d'aujourd'hui, contraint par ses alliances, ouvre la voie à un possible retour de l'extrême droite brésilienne comme en témoignent les résultats défavorables des récentes élections municipales.
La gauche doit donc être à la fois indépendante et unie. S'intégrer ou s'adapter au péronisme conduit à une perte d'accumulation politique et à un brouillage stratégique qui mettrait en danger la construction d'un projet anticapitaliste de masse et en reléguerait la gauche au rôle de partenaire mineur des forces politiques gravitant vers l'« extrême centre ».
Il est essentiel de dénoncer simultanément les tournants droitiers du péronisme et ses alliances avec les secteurs conservateurs. Le péronisme occupe conjoncturellement une place centrale, qu'on le veuille ou non, dans la possibilité de parvenir à une éventuelle défaite électorale de l'extrême droite. Mais plus il penche à droite, plus il est probable que son programme finisse par être une version modérée des réformes de Milei, sans leur composante autoritaire. Le plus grand danger de cette dynamique est de recréer les conditions d'un retour de l'extrême droite, comme le suggèrent plusieurs expériences contemporaines.
Si une mobilisation sociale se dével

Lula devrait visiter un campement dans le Minas Gerais et annoncer des mesures pour la réforme agraire

Le président de la République, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), devrait visiter un campement du Mouvement des travailleurs sans terre (MST) dans le Minas Gerais le 25 février, d'où il fera des annonces qui auront un impact sur l'agenda de la réforme agraire. L'information a été confirmée par des sources du pouvoir Exécutif.
06 février 2025
Parmi ces annonces figure la signature de décrets d'expropriation de cinq zones symboliques pour le MST, où des familles attendent une régularisation depuis plus de dix ans. Au total, les campements totalisent 9 400 hectares et sont situés dans les États de Minas Gerais, Pará, Goiás, Paraná et Rio Grande do Sul. L'annonce a été faite par le ministre du développement agraire (MDA), Paulo Teixeira, à la fin du mois de décembre de l'année dernière.
Une autre promesse du ministre qui devrait enfin être annoncée par le président Lula est le programme Desenrola Rural, qui vise à garantir l'effacement de 80 % de la dette actuelle des travailleurs ruraux, ainsi qu'un plan de paiement échelonné du reste de la dette.
Le MST a rencontré le président Lula et ses ministres au cours des derniers mois et a exprimé son mécontentement quant au peu d'avancement du programme de réforme agraire au sein de son gouvernement.
Parmi les principales revendications du mouvement figurent l'extension du programme d'acquisition de nourriture (PAA), qui permet aux écoles et aux institutions publiques d'acheter de la nourriture directement auprès des établissements ruraux, ainsi qu'un plan visant à installer les 65 000 familles qui campent à travers le pays d'ici la fin de ce mandat présidentiel.
Ceres Hadich, dirigeante nationale du mouvement, estime que les livraisons sont encore en deçà des attentes des travailleurs sans terre. Cependant, elle pense que la visite du président et les annonces qui seront faites sont des signes importants de la reprise de la réforme agraire dans le pays.
"Nous avons beaucoup discuté avec lui [le président Lula] de son intention de faire des annonces à la population. Les livraisons sont encore peu nombreuses, nous le lui avons dit lors de la dernière réunion, mais le symbolisme de la reprise du processus d'acquisition de zones pour la réforme agraire, de la création de nouvelles colonies, de la reprise des politiques publiques pour les colonies, est très important", a-t-il déclaré.
Campo Grande Quilombo
Selon les interlocuteurs du MST, le site choisi était le Campo Grande Quilombo, situé dans la municipalité de Campo do Meio, dans le sud du Minas Gerais. La zone appartenait à la Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo (Capia), l'ancien administrateur de Usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool S/A. L'entreprise a fait faillite dans les années 1990 sans payer les droits du travail de ses employés, qui ont décidé d'occuper la zone et de la revendiquer dans le cadre de la réforme agraire.
"Ce sera une joie d'accueillir le président dans notre camp et une occasion de dialoguer avec lui sur l'agenda agraire dans le Minas Gerais et les défis auxquels nous sommes confrontés pour surmonter ce gouverneur Zema, qui est un revirement et un ennemi des travailleurs. Nous espérons que l'agenda sera confirmé. Nous allons préparer une grande fête pour l'accueillir", a déclaré le dirigeant national du MST dans le Minas Gerais, Silvio Netto. En octobre 2024, la Cour supérieure de justice (STJ) a décidé que l'entreprise ne pouvait pas être réorganisée judiciairement, ce qui a été célébré par le MST. « Cette décision de justice montre que le gouverneur Zema, en plus d'être un lâche et un menteur, n'a pas respecté la loi en promouvant une expulsion illégale, ce qui a conduit à un procès contre l'État de Minas Gerais devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, en raison de sa lâcheté contre son propre peuple », a déclaré Netto à Brasil de Fato MG, faisant référence à l'une des 11 tentatives d'expulsion dont le camp a fait l'objet en 27 ans.
En août 2020, en pleine pandémie de Covid-19, la police militaire de MG a procédé à une violente tentative d'expulsion, qui s'est soldée par la destruction des cultures et d'une école construite par les travailleurs. Brasil de Fato a contacté le bureau du gouverneur du Minas Gerais pour connaître sa position sur l'expropriation imminente de la zone et la responsabilité de l'administration actuelle dans la tentative d'expulsion de 2020, mais n'a pas reçu de réponse.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les dirigeants latino-américains s’opposent à Trump

La belligérance de Donald Trump à l'égard des dirigeants latino-américains soulève la possibilité d'une résistance régionale plus concertée, qu'un bloc populaire de gauche serait bien placé pour mener.
https://jacobinlat.com/2025/02/los-lideres-latinoamericanos-estan-oponiendose-a-trump/
3 février 2025
Les premiers jours du mandat de Donald Trump ont démontré que sa précédente rhétorique isolationniste n'était qu'une façade. Ses déclarations sur la conquête du Groenland, la « reconquête » du canal de Panama et l'invasion du Mexique ont fait les gros titres, et il semble que l'administration Trump ait laissé tomber les formalités de l'impérialisme « léger » pour embrasser pleinement la version surdimensionnée de Trump. Mais comme tous les gloutons, il a peut-être avalé plus qu'il ne pouvait mâcher.
Dimanche, Trump s'est engagé dans une querelle verbale avec le président colombien de gauche, Gustavo Petro, qui a refusé d'accepter un avion militaire américain transportant des immigrants colombiens enchaînés. Alors que le contenu des messages de Trump et de Petro sur les médias sociaux faisait le tour des médias américains, la plupart d'entre eux ont proclamé que Trump était le vainqueur de l'échange et sont rapidement passés au scandale suivant. Cependant, si les médias avaient décidé d'être un peu plus attentifs, ils auraient vu que le défi public lancé par Petro à Trump a fonctionné, que l'administration Trump a accepté de permettre aux immigrants de rentrer chez eux dans la dignité et a décidé de ne mettre en œuvre aucune des sanctions dont Trump les avait menacés. Le lendemain, les mêmes Colombiens qui avaient été enchaînés précédemment sont arrivés à Bogota sans menottes à bord de l'avion présidentiel colombien.
Les journalistes se sont précipités pour les interviewer dès leur descente de l'avion sur le tarmac. Les histoires qu'ils ont racontées témoignaient de la cruauté de l'administration Trump et de la déshumanisation des migrants qui a caractérisé la politique américaine au cours de l'année écoulée. Alors que de nombreuses personnes se précipitaient devant les caméras, une femme avec un enfant dans les bras s'est arrêtée pour raconter son histoire. Elle a expliqué qu'elle avait traversé le désert de Sonoran avec son enfant lorsqu'elle a été volée par des coyotes et menacée de mourir de faim, avant d'être rattrapée par l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) et forcée de rester en détention. En conclusion, elle a dénoncé les détentions et les disparitions, une expression qui rappelle certaines des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Amérique latine, lorsque les dictatures militaires et les paramilitaires faisaient disparaître de force des éléments « indésirables » de la société, qu'il s'agisse de gauchistes, de syndicalistes, d'homosexuels, de toxicomanes, de travailleurs du sexe ou simplement de pauvres gens qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment.
Un autre homme, José Erick, demandeur d'asile, a été interviewé par des journalistes dans le hall de l'aéroport et a raconté une histoire similaire : il a traversé le désert et a été contraint de subir une privation de sommeil pendant sa détention par l'ICE, une pratique que la journaliste colombienne Diana Carolina Alfonso considère comme une forme de torture, interdite par le droit international. Erick a ensuite raconté comment il avait demandé l'asile pour rejoindre le reste de sa famille aux États-Unis et échapper à la violence, un problème qui, en Colombie, est alimenté par des armes fabriquées aux États-Unis. Un autre homme a été invité à répondre aux accusations de Trump selon lesquelles les personnes à bord étaient des criminelles. Je suis ingénieur en mécatronique », a-t-il répondu, “Trump a besoin de meilleures informations sur les personnes qui étaient à bord de cet avion”.
Le retour très médiatisé des migrants, dans des conditions plus humaines, a mis en lumière, pour l'Amérique latine et les Caraïbes, les horreurs de la politique intérieure et étrangère de Trump. Pour M. Petro, il s'agit d'une victoire morale.
Le président Petro a également jeté les bases d'une coalition régionale capable de surmonter les divisions idéologiques et d'unir la majeure partie de l'Amérique latine autour d'un programme commun contre les menaces de l'administration Trump, y compris les tarifs douaniers. Cela a pris la forme d'une réunion d'urgence de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) convoquée au Honduras par la présidente de ce pays, Xiomara Castro. Bien que la réunion ait été annulée après que la Colombie et les États-Unis soient parvenus à un accord, d'autres dirigeants ont manifesté leur mépris pour le traitement réservé par Trump à leurs citoyens.
Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine de gauche, a également fait les gros titres pour sa réponse ironique à M. Trump, notamment en ce qui concerne sa proposition de renommer le golfe du Mexique « golfe de l'Amérique ». Elle a répondu en proposant que le continent nord-américain soit rebaptisé « Amérique mexicaine », citant pour preuve une carte espagnole de l'époque coloniale.
En réponse à la récente approbation par Google du changement de nom proposé par Trump, le ministère mexicain des affaires étrangères a envoyé une plainte officielle à l'entreprise, lui rappelant qu'il s'agissait d'une violation du droit international. Toutefois, malgré une brève période de rejet d'un vol d'expulsion la semaine dernière, le Mexique a fait preuve de diplomatie quant à ses projets d'accueil des migrants. Néanmoins, si les choses s'enveniment, il pourrait refuser à l'administration Trump l'utilisation de son espace aérien, ce qui rendrait ses vols d'expulsion vers d'autres pays extrêmement coûteux.
L'administration Trump n'a pas perdu de temps pour s'aliéner des alliés régionaux potentiels mis à part les gouvernements d'extrême droite du Salvador et de l'Argentine. Même le président de centre-droit du Panama, José Raúl Mulino, s'est retrouvé dans une position inconfortable après que M. Trump s'en soit pris au pays en affirmant faussement que le canal de Panama était aux mains des Chinois et que les États-Unis pourraient devoir le « reprendre ». M. Mulino a clairement indiqué que ces déclarations violaient les traités Torrijos-Carter, qui ont rendu la souveraineté du canal au peuple panaméen en 1999 après près d'un siècle d'occupation américaine.
Le fait que Trump ait attaqué certains des alliés traditionnels des États-Unis dans la région pourrait pousser leurs dirigeants à renforcer leurs relations avec la Chine, la Russie et l'Europe, donnant ainsi un élan à une nouvelle vague d'intégration latino-américaine. La perspective d'une réponse concertée de l'Amérique latine à l'administration Trump, au-delà des divisions entre la gauche et la droite, reste peu probable, mais l'agression récente des États-Unis et un bloc de gauche populaire dans la région la rendent beaucoup moins éloignée. Ce bloc pourrait à lui seul exercer une pression significative sur l'administration américaine actuelle. Même lorsqu'il y aura alternance des partis au pouvoir dans ces pays, les récentes actions américaines mettront du temps à être oubliées.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les racines du conflit en RDC

Les protestations ayant secoué Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo ces dernières semaines, ont mis en lumière plus que jamais la plus récente crise que traverse le pays depuis bientôt quatre ans. Considérée par Médecins sans frontières (MSF) comme une « crise négligée » du public ou des médias, ce sont plus de sept millions de personnes qui ont dû fuir leur foyer depuis 1994, dont 500 000 personnes depuis janvier 2025.
Tiré d'Alter Québec.
En 2023, MSF rapporte avoir pris en charge 25 000 victimes de violences
sexuelles. Entre janvier et mai 2024, le Nord-Kivu comptait 70 % du nombre de
ces violences sur un total de 17 000. Quant à la famine, elle atteint 25 millions de
personnes selon l'ONU autour des Grands Lacs, dont 6,2 uniquement dans l'est
du Congo.
Le présent article revient sur l'histoire de la violence dans cette région
de l'Afrique. Il fut rédigé avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu annoncé par
le M23, le 4 février dernier.
Percée des rebelles
Dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, les rebelles effectuent des percées majeures en matière de territoire. Les bandes armées ont annoncé, le 27 janvier dernier, avoir capturé Goma, chef-lieu du Nord-Kivu et troisième ville au pays, après une avancée rapide forçant l'évacuation de 178 000 personnes en deux semaines, rapporte l'Associated Press.
Le président Félix Tshisekedi accuse notamment le Rwanda, partageant une frontière avec les deux provinces, de financer les actions du M23, qui compte environ trois mille combattant.es. Le groupe armé reçoit l'assistance des forces rwandaises, au nombre de trois mille à quatre mille.
Malgré un processus initié par l'Angola, appelé « processus de Luanda », au sein duquel un cessez-le-feu fut signé entre Kigali et Kinshasa en août 2024, le M23 reprend ses offensives. Par la suite, dans le cadre de ce même processus, les deux pays avaient tenté, lors d'un sommet en décembre 2024, de trouver un terrain d'entente face à la situation, en vain.
Ce processus « fait face à des obstacles, notamment la difficulté de faire respecter les engagements pris pendant les séances de négociation », affirme Marie-Joelle Zahar, professeure titulaire de science politique à l'Université de Montréal, spécialisée dans les conflits armés, la résolution des conflits et la consolidation de la paix.
Un retour aux racines du conflit
Cette crise d'une ampleur sans précédent s'inscrit dans un contexte historique entre la République démocratique du Congo et certains de ses pays voisins, en particulier le Rwanda. Rappelons que le génocide de 1994 dans ce pays a contraint des habitant.es d'origine hutue de trouver refuge chez leur voisin.
En 1996, commence ce qu'on va appeler la première guerre du Congo, d'une durée de six mois, initiée par le Rwanda afin de piller les camps de la population hutue réfugiée dans les deux provinces du Kivu. Mobutu est destitué et son successeur, Laurent-Désiré Kabila, prend les commandes. Il contraint les réfugiés hutus à retourner au Rwanda, ce qui attise la colère du peuple tutsi.
C'est ce qui déclenche la deuxième guerre du Congo en 1998, avec un objectif qui se rapproche des idées qu'ont les rebelles tutsis aujourd'hui : contrôler des ressources minières. « Il y a un intérêt économique pour le Rwanda, les minerais rares ont toujours permis aux groupes armés de la région de se fournir des armes et de créer des alliances », explique madame Zahar.
Elle se terminera en 2002 et aura causé la mort de cinq millions de personnes, principalement de famine, ce qui en fait le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre est marquée par l'assassinat du président Kabila, en janvier 2001.
Des rebelles hutus décident ensuite de s'allier avec le Congo contre les rebelles tutsis congolais ou rwandais, bien que le génocide au Rwanda soit chose du passé. Puis, après des élections démocratiques en 2006 remportées par Joseph Kabila, le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), un groupe armé tutsi qui attise ces tensions entre les deux populations, voit le jour.
Un accord de paix entre les groupes rwandais et congolais est conclu le 23 mars 2009, mettant fin à près de trente-deux mois de conflits. Au cours de cette période, environ 400 000 personnes sont déplacées, portant le nombre global à 1,2 million de réfugié.es au pays.
Le nom « M23 », le successeur du CNDP, fait référence à cette date du 23 mars. Formé en 2012, il se constitue en majeure partie de ces mêmes rebelles tutsis, qui sont en minorité, comparés aux forces hutues. Même si leurs actions cessent en 2013, les conséquences de leurs 19 mois d'activités ont des répercussions désastreuses. Entre mars 2013 et octobre 2023, trois millions de personnes ont dû fuir leur domicile uniquement à l'intérieur des provinces de l'Est, passant de 2,6 à 5,6 millions de déplacés internes.
Quelle solution pour le pays ?
Pour Marie-Joelle Zahar, l'intervention militaire, à l'image d'autres conflits, n'est pas une issue : « La victoire militaire ne fait qu'approfondir la haine, et retarder l'éclatement d'un nouveau cycle de violence ».
Le président Tshisekedi qui ne désirait plus voir la mission de l'ONU dans l'Est, au risque d'une escalade, « changera peut-être d'idée à ce sujet, étant donné l'importance que les camps de l'Organisation vouent à la protection des civils dans la région », pense madame Zahar.
Elle pose, en revanche, la question d'un accord pour la région du Kivu : « Comme les accords précédents n'ont pris en compte que la réalité globale du pays, faut-il plutôt négocier un accord qui porte sur les problématiques spécifiques de la région ? », conclut-elle. Ces réponses aux enjeux locaux sont certainement une exigence nécessaire pour qui veut une réconciliation durable dans cette région de l'Afrique, qui n'est toutefois pas à portée de main.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Afrique du Sud : Donald Trump prend le parti de l’apartheid

Le président américain a annoncé suspendre les financements vers Pretoria après la promulgation par son homologue sud-africain de la loi d'expropriation foncière. Le média guinéen “Le Djely” estime que cette décision de Donald Trump, proche d'Elon Musk, révèle son “racisme”.
Tiré de Courrier international. Article publié à l'origine dans ledjely.com
Décidément, le fameux slogan “America First” peut aussi se traduire par “Les amis d'abord”, voire même “Les Blancs d'abord”. Autrement, on ne voit pas en quoi la loi que vient de promulguer Cyril Ramaphosa menace les intérêts américains si prétendument chers à Trump. Voilà qui révèle peut-être une facette moins avouable du leader républicain : le racisme. Alors même que certains, y compris en Afrique, se bornaient à ne voir chez lui qu'un certain patriotisme exubérant ou décomplexé.
Bien sûr, personne n'a envie de revivre une réforme agraire aussi bâclée que celle que l'ancien président Robert Mugabe [1987-2017] avait opérée au Zimbabwe. Une réforme conduite sur fond de violence et de populisme qui, au-delà d'exacerber les tensions raciales, peut ruiner certains acquis du pays, notamment dans le secteur agricole.
4 % des terres appartiennent à des Noirs
Mais il n'est pas non plus envisageable de faire l'impasse sur les fortes disparités qui minent la société sud-africaine en rapport avec la propriété foncière. Derrière la réputation de puissance économique du continent africain, l'Afrique du Sud cache des inégalités qu'elle se doit de régler impérativement. Et le cas du foncier est symptomatique des écarts que certains assimilent plutôt légitimement à de l'injustice.
En effet, selon les chiffres issus du Land Audit Act (2017), plus de vingt-cinq ans après l'apartheid, aboli en 1991, “seulement 4 % des terres arables appartiennent à des Noirs, alors qu'ils représentent 81 % de la population. À l'inverse, 72 % des terres sont détenues par 36 000 fermiers blancs, alors que les Blancs ne représentent guère plus de 8 % de la population.” Comment voudrait-on qu'un tel statu quo soit maintenu en l'état ?
Correction ou confiscation ?
Certes, la question est à aborder avec tact et délicatesse, les équilibres étant fragiles. Mais il est évident que ces disparités doivent être corrigées. Sauf que, manifestement, le président Donald Trump ne veut pas de cette correction. C'est pourquoi, usant de la manipulation dont il est coutumier, il prétend déjà que c'est d'une confiscation de terres dont il s'agirait. Ce que Cyril Ramaphosa a démenti, en assurant qu'il s'agit plutôt d'une “procédure légale qui garantit l'accès à la terre d'une manière juste et équitable, conformément à la Constitution”.
Des explications qui risquent de ne pas suffire pour convaincre Donald Trump. Le président américain devenu très proche d'Elon Musk, dont le salut nazi, le 20 janvier dernier, dans le sillage de l'investiture du 47e président, n'était pas sans rappeler qu'à sa naissance, [à Pretoria] en 1971, l'Afrique du Sud vivait sur le régime de ségrégation raciale de l'apartheid. Ceci pourrait donc expliquer cela.
Boubacar Sanso Barry
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mayotte : Après la tempête

Un terrible cyclone - le pire depuis près d'un siècle - a ravagé la région. Il a rasé des maisons et détruit des infrastructures. Au lendemain de la tempête, les autorités n'ont pas réagi assez vite pour aider les survivants, qui avaient même du mal à trouver de l'eau potable. Les gens étaient désespérés. Les gens étaient traumatisés.
Tiré d'Afrique en lutte.
Le président du pays est alors arrivé sur place. Il s'est présenté devant une foule et, dans un langage offensant, a déclaré avec colère aux habitants qu'ils avaient de la chance d'être là où ils se trouvaient. En France.
Les problèmes de Mayotte n'ont pas commencé lorsque le cyclone Chido a frappé l'archipel en décembre. L'ancienne colonie française était déjà le département le plus pauvre de France et l'une des régions les plus mal loties de l'Union européenne sur presque tous les indicateurs sociaux. Cela fait bien longtemps que les autorités françaises n'assurent pas aux habitants de Mayotte un accès adéquat à l'eau potable et à l'assainissement.
Le cyclone a aggravé une situation déjà inacceptable.
Des efforts de reconstruction sont désormais en cours. Les élèves retournent enfin à l 'école cette semaine, même si de nombreux établissements scolaires restent très endommagés par la tempête.
Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui est la suivante : les autorités françaises vont-elles se contenter d'un travail de reconstruction minimal ? Ou saisiront-elles l'occasion de répondre enfin aux besoins urgents des habitants ?
L'insulte du président Macron à la population de Mayotte au lendemain du cyclone n'était pas un bon début. Et ce n'était pas le seul mauvais présage.
Plutôt que de faire face aux conséquences de décennies de sous-investissement de la France à Mayotte ou de prendre en compte comment des événements météorologiques extrêmes comme celui-ci deviendront probablement plus fréquents avec le changement climatique, certains responsables politiques cherchent plutôt quelqu'un à blâmer.
Et, comme c'est souvent le cas, apparemment partout ces jours-ci, les migrants sont le bouc émissaire favori. Selon les estimations, près d'un tiers de la population de Mayotte est sans papiers, bien que ce chiffre puisse être surestimé.
Les autorités françaises, y compris le président Macron, ont laissé entendre que les mesures officielles pour répondre aux impacts du cyclone sur Mayotte comprendraient une répression de l'immigration clandestine. Ces mesures anti-immigration devraient faire partie d'un nouveau projet de loi qui sera présenté par le gouvernement français dans les semaines à venir.
Il est difficile de voir comment la diabolisation des migrants permettra de remédier à l'insécurité et aux mauvaises conditions sanitaires à Mayotte. Ce n'est pas à cause de personnes migrantes pauvres et impuissantes que la France n'est pas parvenue à améliorer le logement, la santé, l'éducation et d'autres services de base à Mayotte depuis des décennies.
Le gouvernement français est en situation de pouvoir et de responsabilité. Il devrait cesser de s'en prendre aux plus démunis et s'atteler à la tâche pour que les conditions de vie à Mayotte atteignent au moins le niveau de celles de la France métropolitaine.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Viol et esclavage sexuel dans le conflit au Soudan

La guerre civile au Soudan, marquée par des atrocités, fait rage, semant la souffrance et la terreur depuis maintenant 20 mois. Nous avons déjà parlé de certains des crimes horribles perpétrés par les parties belligérantes. Dans le conflit qui oppose les Forces armées soudanaises (SAF) aux Forces de soutien rapide (RSF) et leurs milices alliées, nous avons observé des atrocités commises par les deux camps.
Tiré d'Afrique en lutte.
Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les RSF. Nous savons qu'elles sont responsables de pillages et d'incendies criminels, de meurtres et de viols, d'attaques contre des infrastructures civiles essentielles, comme des hôpitaux et des marchés, de la destruction de quartiers entiers et de nettoyage ethnique dans la région du Darfour.
Aujourd'hui, de nouvelles preuves indiquent que les combattants des Forces de soutien rapide et leurs milices alliées ont violé des dizaines de femmes et de filles, dont certains cas dans des conditions d'esclavage sexuel.
Belkis Wille d HRW est revenue récemment d'une enquête de terrain dans l'État soudanais du Kordofan du Sud, où elle a documenté ces atrocités, ainsi que d'autres rapportées la semaine dernière.
« Les survivantes ont décrit avoir subi des viols collectifs, devant leur famille ou pendant de longues périodes, y compris alors qu'elles étaient détenues comme esclaves sexuelles par des combattants RSF »
Belkis a recueilli des preuves auprès de survivantes et d'autres témoins, révélant qu'environ 79 filles et femmes, âgées de 7 à 50 ans, ont déclaré avoir été violées. Le nombre réel est certainement plus élevé. La plupart d'entre elles vivaient dans des campements informels pour personnes déplacées dans la région des monts Nouba, dans l'État du Kordofan du Sud.
Les survivantes et les témoins ont déclaré que les agresseurs étaient tous des membres des RSF en uniforme ou des membres de milices alliées. Certains incidents ont eu lieu dans une base des RSF.
Les lois de la guerre sont claires sur ce type d'atrocités.
Les violences sexuelles dans les conflits constituent une violation grave du droit international humanitaire et un crime de guerre. Les violences sexuelles peuvent constituer des crimes contre l'humanité lorsqu'elles sont commises dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Lorsque des personnes sont détenues dans des conditions d'esclavage et soumises à des violences sexuelles, il s'agit d'esclavage sexuel.
Les pays membres des Nations unies et de l'Union africaine devraient agir de toute urgence. Trois choses au moins sont désespérément nécessaires.
Premièrement, ils devraient aider les survivantes. Jusqu'à présent, les victimes n'ont pratiquement pas eu accès à des services.
Deuxièmement, ils devraient protéger les autres femmes et filles contre de telles atrocités.
Troisièmement, ils devraient faire en sorte que justice soit rendue pour ces crimes odieux. Cela implique de recueillir davantage de preuves et de prendre des mesures pour punir les auteurs de ces crimes.
Les Nations unies et l'Union africaine devraient déployer d'urgence une mission de protection des civils au Soudan. Cette mission devrait être chargée, entre autres, de lutter contre les violences sexuelles, afin de pouvoir contribuer à la réalisation de ces trois objectifs. Et elle devrait disposer des ressources nécessaires pour y parvenir.
Le monde doit reconnaître l'ampleur des violences sexuelles au Soudan et agir rapidement.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
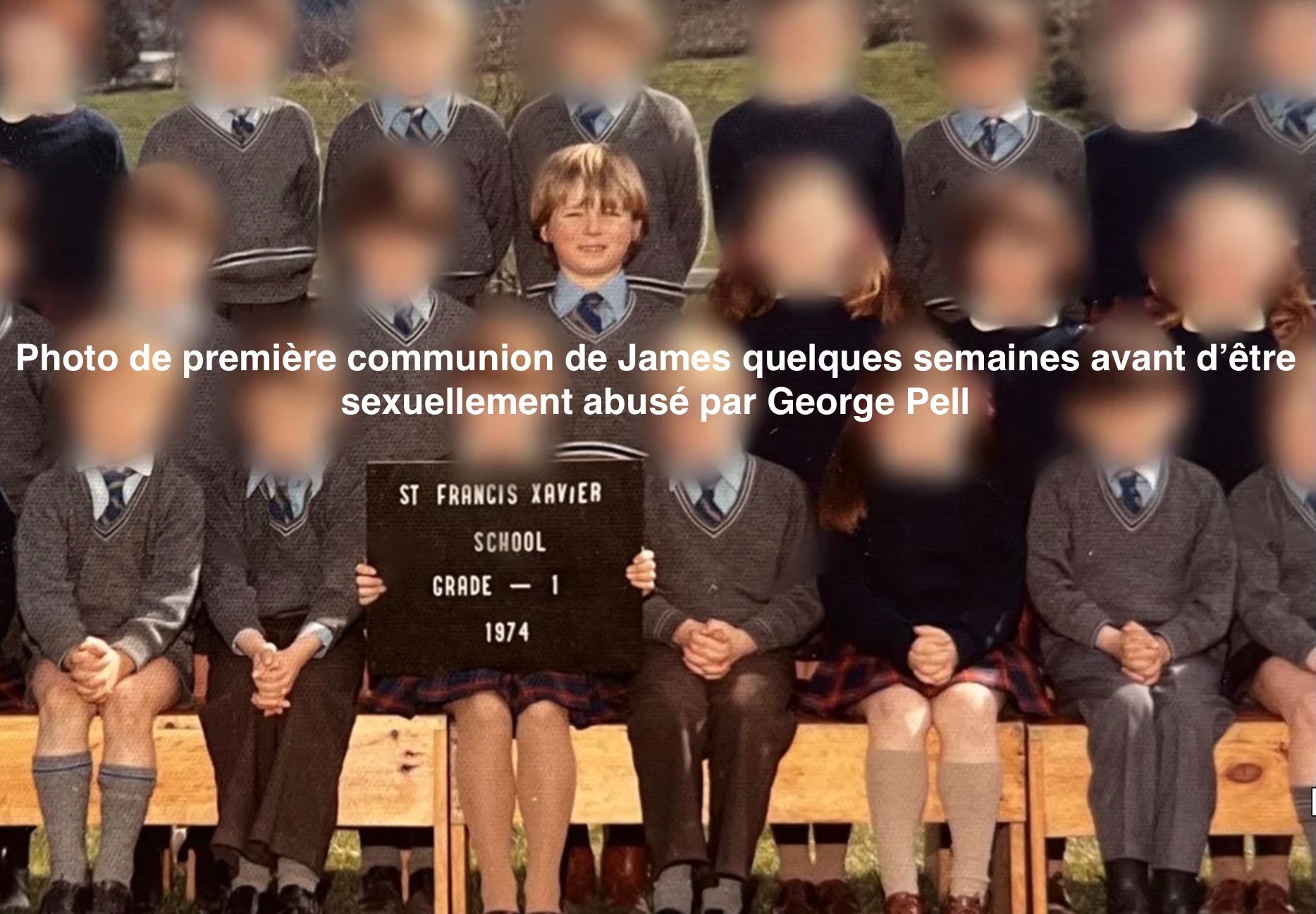
« L’Église catholique australienne et Donald Trump : l’art d’imposer un récit en niant toute culpabilité
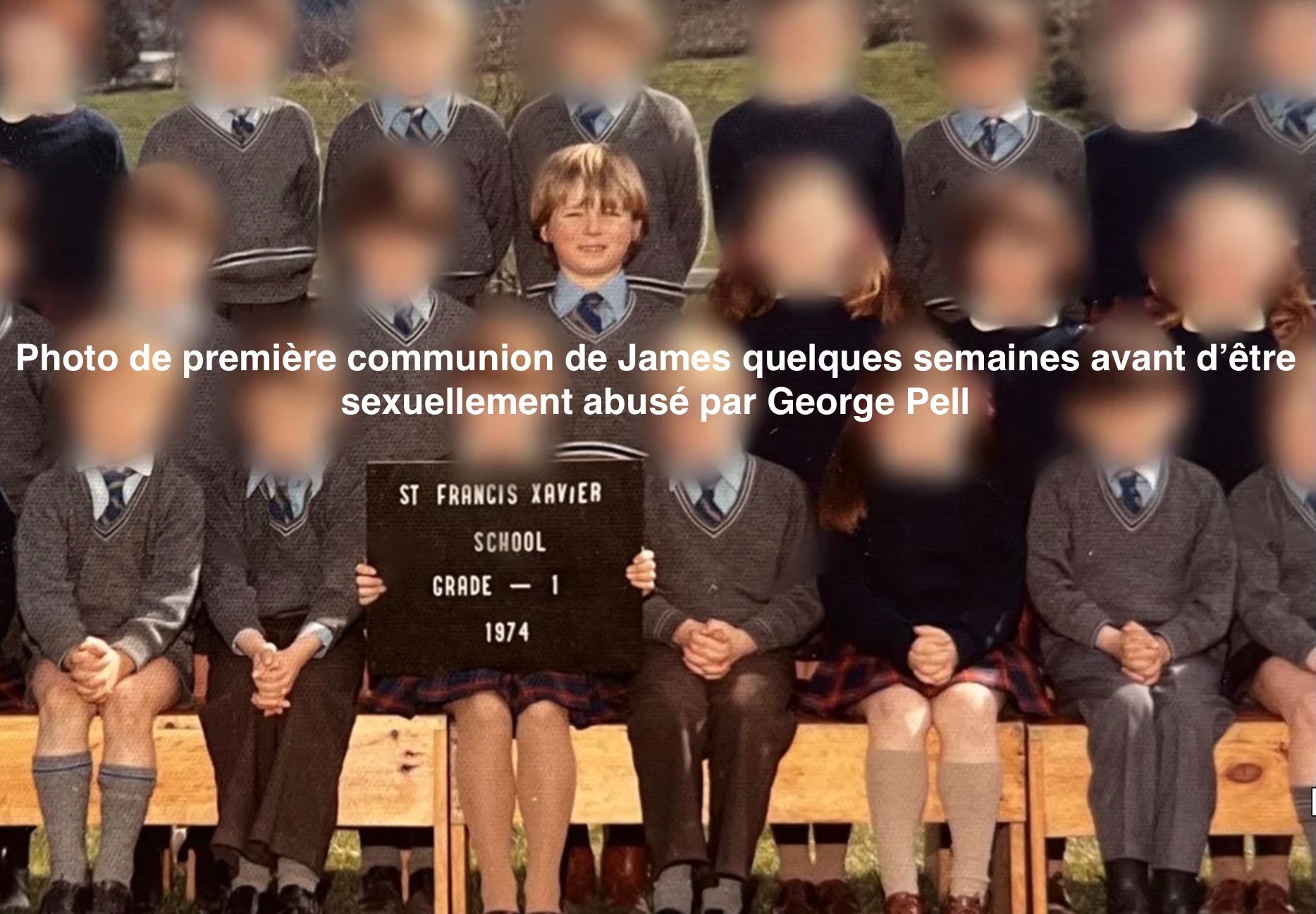
Glorifier le coupable et vilipender ses victimes : tel fut, affirme la journaliste Louise Milligan, le comportement de l'Église catholique australienne dans l'affaire du feu cardinal George Pell. Un comportement qui accentue la blessure dont souffrent les victimes du cardinal, et qui amenait récemment d'autres de celles-ci à se manifester pour la première fois, à contacter Milligan, et à lui détailler les abus qu'elles ont subies de la part du cardinal.
CE N'EST PAS FACILE DE SUIVRE DONALD TRUMP, qui, lors de son premier mandat, a choisi deux juges catholiques conservateurs à la Cour suprême et, lors de son deuxième, a choisi comme vice-président le catholique extrêmement réactionnaire qu'est J. D. Vance.
Trouvé coupable de fraude financière et d'agression sexuelle, Trump nie toute culpabilité...
Les médias ‘fake news' mènent une campagne de dénigrement contre moi, dit-il. On utilise le système de justice comme arme pour me punir, alors que je suis complètement innocent !
L'économie américaine, disent la plupart des économistes, va plutôt bien en termes de croissance, de chômage, de transition vers l'énergie propre, et l'inflation, qui a monté beaucoup surtout à cause de la pandémie COVID 19, baisse de façon significative...
Non, dit Trump, l'administration Biden fut la pire de l'histoire des Etats-Unis et l'économie, qui sous Biden a connu un taux d'inflation record, est en train de crouler !
La réalité importe peu.
Que le taux d'inflation, au début des années 1980, dépasse carrément ce qu'il était sous Biden, atteignant 14% (et le taux d'intérêt 18%), tout cela n'a pas d'importance.
Ce que dit Trump devient un récit auquel adhère immédiatement une partie substantielle de la population américaine.
Lorsque la foi est énorme, les faits importent peu.
L'Église catholique ne maitrise peut-être pas aussi bien que Trump l'art de gérer un récit. Ni celui de nier systématiquement toute culpabilité en alléguant être simplement victime d'une campagne de dénigrement. Cependant, comme le démontre le cas du cardinal Pell en Australie, sa compétence dans ce domaine est tout de même assez remarquable.
L'affaire cardinal Pell
MI-MARS 2019, LE CARDINAL GEORGE PELL, le plus grand leader de l'Église catholique australienne et alors bras droit du pape François au Vatican, est reconnu, dans un verdict unanime d'un jury de douze membres, coupable d'abus sexuel de deux mineurs dans la cathédrale de Melbourne dans les années 1990. Sa sentence : six ans de prison.
Le cardinal maintient qu'il est innocent et dépose une plainte auprès de la Cour d'appel de l'État de Victoria.
En aout 2019, cette cour, dont les membres ont visionné la vidéo du témoignage choc de la victime menant au verdict du jury, rend sa décision : le verdict est maintenu tel quel.
Grand batailleur, le cardinal revient à l'attaque et adresse un nouveau recours, cette fois à la Cour suprême d'Australie. L'avocat qu'il choisit pour sa défense, Robert Richter, est un des plus illustres du pays. Le cardinal ne l'a pas retenu à cause de ses croyances religieuses – il est athée – mais en raison de sa compétence. Il est renommé pour avoir réussi à défendre avec succès même certaines figures les plus notoires de la pègre de Victoria.
La cour accepte d'entendre son appel.
Les victimes sont bouleversées et se sentent dépitées. Elles soupçonnent que les profonds liens d'amitié que le cardinal Pell entretient depuis fort longtemps avec les gens les plus puissants d'Australie, en particulier l'élite politique et financière, ont contribué à ce revers qu'elles vivent.
Début avril 2020, la Cour suprême rend sa décision : elle blanchit le cardinal.
Contrairement au jury et la Cour d'appel de Victoria, elle n'a pas visionné la vidéo du témoignage choc de la victime. Elle estime néanmoins que la Cour d'appel de Victoria et le jury n'ont pas suffisamment tenu compte de toutes les preuves présentées par l'avocat Richter, certaines de celles-ci ne permettant pas, à son avis, d'affirmer hors de tout doute la culpabilité du cardinal.
Après avoir passé 404 jours en prison, le cardinal Pell est donc libéré.
La nouvelle fait rapidement la manchette à travers le monde.
À peine quelques heures après cet acquittement, le pape François laisse clairement entendre, sans mentionner explicitement le cardinal Pell, que ce dernier a été, comme Jésus, injustement jugé et condamné. Lors d'une messe qu'il est en train de célébrer dans sa résidence Santa Maria à Rome, le pape affirme :
En ces jours de Carême, nous avons vu la persécution que Jésus a enduré et comment les docteurs de la loi se sont acharnés contre lui, le jugeant avec sévérité alors qu'il était innocent. Je voudrais prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui, parce que quelqu'un leur en veut, subissent une peine injuste.
Et, dans les minutes qui suivent, le bureau de presse du Vatican exprime la satisfaction de l'Église de voir la cour rétablir la ‘vérité' de ‘l'innocence' du cardinal :
Le Saint-Siège, qui a toujours exprimé sa confiance dans l'autorité judiciaire australienne, se félicite de la décision unanime de la Haute Cour concernant le cardinal George Pell, l'acquittant des accusations d'abus sur mineurs et annulant sa peine. En confiant son affaire à la justice de la Cour, le cardinal Pell a toujours clamé son innocence et a attendu que la vérité soit établie.
Après avoir posé ces deux gestes de solidarité envers son ex-bras droit au Vatican, le pape François en pose un troisième quelques mois plus tard.
Le 12 octobre 2020, il accorde une audience privée au cardinal Pell, et, signe évident qu'il veut que celle-ci soit largement diffusée à travers le monde et devienne virale dans les réseaux sociaux, il autorise la production d'un bref clip vidéo où on l'entend dire chaleureusement au cardinal, Je suis content de te voir... ça fait plus qu'un an, une allusion au temps que Pell a passé en prison.
De retour à Rome, le cardinal, de toute évidence pour illustrer son innocence, accorde beaucoup d'interviews, dans lesquelles il laisse entendre qu'il y aurait peut-être une ‘connexion possible' entre le cauchemar judiciaire qu'il à vécu en Australie et sa mission dans les finances du Vatican.
À la mi-décembre 2020, le cardinal Pell publie Prison Journal, un livre rassemblant des extraits du journal intime qu'il avait tenu lors de son long séjour en prison. Lors du lancement de ce livre, il louange Donald Trump, un politicien dont les opinions conservatrices ressemblent beaucoup aux siennes, et qui vient de nommer à la Cour suprême des Etats-Unis trois juges très conservateurs, dont deux catholiques.
Sa contribution est positive. Certes, Trump est un peu barbare, mais à certains égards importants, il est « notre » barbare (chrétien), affirme le cardinal.
Lorsque trois archevêques américains lisent Prison Journal, ils couvrent immédiatement d'éloges le cardinal Pell, un le comparant à Saint Ignace de Loyola, Martin Luther King, et même à Jésus !
Le 10 janvier 2023, le cardinal Pell subit soudainement un arrêt cardiaque qui lui sera fatal.
Grand reporter à Paris Match, François de Labarre publie, quelques mois plus tard, Vatican Offshore – l'argent noir de l'Église. De Labarre raconte qu'en 2014, le pape François, dans sa recherche d'un administrateur chevronné et rigoureux qui pourrait faire le ménage dans un Vatican plongé dans une montagne de corruption financière, a retenu les services du cardinal Pell. Adhérant à l'hypothèse que faisait circuler à Rome le cardinal Pell à la suite de sa libération de prison, il affirme que les accusations de pédophilie portées contre le cardinal en Australie ne seraient qu'un coup monté par ses adversaires au Vatican qui craignaient la perte de leur assiette au beurre. Pour salir et discréditer le cardinal Pell, cette mafia en soutane, soutient De Labarre, a carrément inventé toute cette histoire d'abus sexuel, se joignant à des médias australiens assoiffés de scandales et à la police corrompue et anti-Église catholique de Victoria pour faire subir au pauvre cardinal des années de persécution !
Dans sa recension de Vatican Offshore [dans la revue Présence en juin 2023, Louis Cornellier qualifie le livre de Grand reportage, aussi solide que consternant ! . Il n'en fait pas la moindre critique.
L'Église célèbre les funérailles du cardinal Pell de façon grandiose
L'ÉGLISE CATHOLIQUE AUSTRALIENNE SAIT FORT BIEN que si le cardinal Pell a réussi à sortir de prison parce que la Cour suprême a conclu que le jury ainsi que la Cour d'appel de Victoria n'avaient pas suffisamment tenu compte de certaines preuves qui, à son avis, ne permettaient pas de conclure, hors de tout doute, la culpabilité, cela ne voulait nullement dire que le cardinal était forcément innocent ! Car on ne peut pas confondre le fait de ne pas être reconnu coupable hors de tout doute et le fait d'être, en réalité, innocent.
Cette nuance a d'autant plus d'importance que le cardinal Pell, au moment de son décès, se trouvait toujours dans une situation on ne peut plus embarrassante, les charges rejetées par la Cour suprême n'étant pas les seules portées contre lui. Il y en avait encore 27, et celles-ci provenaient de 14 présumées victimes.
Quelques exemples.
• Un homme allègue que Pell, alors séminariste, a abusé sexuellement de lui, alors enfant de chœur de 12 ans, dans un camp de jeunes de l'île Phillip en 1961 ;
• Un autre dit que, lorsqu'il était enfant, Pell l'emmenait hors du foyer pour enfants où il était pupille de l'État et le violait ;
• Un autre allègue que lorsqu'il vivait au Saint-Joseph's Home for Children à Ballarat, Pell, qui venait chez eux en été pour utiliser la piscine et jouer avec les enfants, a à plusieurs reprises mis ses mains dans son costume de bain et inséré son doigt dans son anus, lui causant une douleur considérable ;
• Deux anciens élèves de St Alipius allèguent que Pell avait saisi à plusieurs reprises leurs parties génitales, et parfois tellement fort que cela était douloureux, alors qu'il nageait avec eux dans la piscine Eureka à Ballarat en 1978-79.
De plus, de nombreuses victimes en Australie accusaient le cardinal Pell, et ce depuis plusieurs années, d'avoir protégé les prêtres, qui se trouvaient alors sous son autorité, et qui les avaient abusés sexuellement alors qu'ils étaient mineurs, tout en cherchant systématiquement à les discréditer. La Commission royale sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels sur enfants avait écouté ce qu'alléguaient ces victimes, écouté la défense présentée par le cardinal, mené une enquête rigoureuse et tiré ses conclusions.
Cependant, comme le cardinal Pell, au moment où cette commission publiait son rapport final en 2017, était en train de subir un procès durant lequel la cour entendait le témoignage choc d'une victime qui alléguait avoir été, avec son copain adolescent, abusé sexuellement par le cardinal, la commission avait temporairement supprimé de son rapport les conclusions susmentionnées. Ceci, dans le soucis de ne pas influencer indument l'esprit des jurés appelés à statuer sur la culpabilité ou l'innocence du cardinal.
La Cour suprême d'Australie ayant libéré le cardinal Pell de prison en 2020, la commission procédait alors à rendre publiques ses conclusions dans cette affaire. Et celles-ci étaient, pour le cardinal, on ne peut plus dévastatrices. Plus que tout autre membre ecclésial important qui avait témoigné devant la commission, le cardinal se voyait écorché et carrément discrédité.
Dans ces pages jusqu'ici secrètes, affirme David Marr, le verdict rendu par la commission est on ne peut plus clair : afin de protéger les enfants de la communauté catholique qu'il servait en tant que prêtre à Ballarat, et ensuite comme évêque à Melbourne, Pell aurait pu agir, mais il ne l'a tout simplement pas fait.
Les excuses que Pell a données à la commission pour avoir fait si peu pour la protection des enfants sont disséquées et rejetées une à une. Les commissaires rejettent comme invraisemblables, inconcevables, insoutenables et inacceptables les principales affirmations contenues dans les preuves présentées par le cardinal.
Non seulement l'Église catholique sait, au moment du décès du cardinal Pell, tout ce qui précède, mais elle est aussi consciente d'une autre affaire embarrassante.
Exactement cinq semaines avant le décès du cardinal, un dénommé David reçoit une lettre du National Redress Scheme, le programme national public de réparation créé le 1er juillet 2018 en réponse à la Commission royale sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels sur enfants. Nous avons terminé notre enquête au sujet de ton allégation d'avoir été abusé sexuellement par le cardinal Pell alors que tu étais âgé de huit ans, dit la lettre. Nous avons informé l'Église que nous reconnaissons, après enquête, le bien fondé de ton allégation et que nous allons t'octroyer une compensation de $95 000.
Malgré cette montagne de faits qui devraient normalement conduire une institution, qui affirme toujours prioriser les plus démunis et exploités de la terre, à faire preuve d'une certaine modestie, l'Église catholique organise pour le cardinal Pell le 2 février 2023, un peu à la Donald Trump, des funérailles de grande solennité et pompe.
Le récit qu'elle tente d'imposer dans l'opinion publique, avec un certain succès d'ailleurs, est que le décédé est innocent, que ses accusateurs sont des menteurs, et qu'il fut un soldat de la vérité, et possiblement un futur saint.
Au moins 275 prêtres – dont l'évêque Paul Bird du diocèse de Ballarat qui avait été informé de la compensation de $95 000 versée à David, et 75 séminaristes sont présents dans la cathédrale St. Mary de Sydney ce jour-là. Sont aussi présents plusieurs des plus prestigieux politiciens du pays, des représentants des médias, et même un juge.
L'archevêque Anthony Fisher affirme, lors de la messe funéraire, que le cardinal Pell portait un amour extraordinaire envers les séminaristes. Il a passé 404 jours en prison pour des crimes qu'il n'a jamais commis, dit-il. Le comparant à ‘Richard the Lionheart', le grand roi guerrier d'Angleterre au 12ième siècle, l'archevêque affirme que le lion dont le rugissement s'est tari de manière inattendue il y a 23 jours, a été victime d'une campagne médiatique, policière et politique visant à le punir... (...) Son influence fut énorme et celle-ci va se prolonger dans le futur.
L'ex-premier ministre australien, Tony Abbott, un catholique qui, dans sa jeunesse, a passé quelques années au séminaire en vue de la prêtrise, affirme que le cardinal est le plus grand catholique que l'Australie ait jamais produit et l'un de ses plus grands fils.
Le frère du cardinal, David Pell, affirme que les accusations portées contre son frère sont carrément fausses. Mon frère, dit-il, a été la victime d'une longue campagne de dénigrement.
Pour imposer le récit glorifiant le cardinal Pell tout en discréditent ses victimes, l'Église n'hésite pas à recourir à d'autres moyens. Dès qu'un de ses membres ose remettre en question cette interprétation de la réalité, l'Église cherche à le réduire au silence en le punissant.
En septembre 2022, le prêtre dominicain australien, Peter Murnane, publie Clerical Errors : How Clericalism Betrays the Gospel and How to Heal the Church, un livre dans lequel il dénonce carrément l'hypocrisie crasse dont fait preuve l'Église dans l'affaire Pell. L'Église dans laquelle j'œuvre comme pasteur depuis des décennies, et que j'aime profondément, est en train de trahir les valeurs évangéliques les plus fondamentales, dit-il !
Afin de mener la recherche pour son livre, et aussi pour prendre congé un certain temps de confrères dominicains qu'ils trouvaient carrément cléricalistes, Murnane avait demandé d'aller vivre seul en appartement un certain temps, et son supérieur avait acquiescé à sa demande.
Cependant, dès qu'apparaît son livre, il reçoit de son provincial dominicain, un ami de l'archevêque Fisher qui est lui-même un grand ami du cardinal Pell, le ‘précepte formel' suivant, qui, dans l'arsenal dominicain relatif à l'obéissance, est l'équivalent d'un lance-roquettes :
Tu as un mois pour revenir dans notre communauté et retirer de circulation le livre que tu viens de publier. Si tu ne le fais pas, tu pourrais en subir de graves conséquences, n'excluant pas le renvoi de notre ordre.
Peter Murnane, avec lequel je corresponds régulièrement, n'a pas retiré de circulation son livre. Il vit toujours en appartement, et a lui-même décidé de se distancer de sa communauté religieuse, tout en maintenant de profonds liens d'amitié avec plusieurs Dominicains.
Comme moi, Murnane trouve farfelue la thèse avancée dans le livre Vatican Offshore selon laquelle les accusations contre le cardinal Pell ne représenteraient qu'un simple coup monté contre lui par la mafia corrompue au Vatican. Dans L'affaire cardinal Pell : simple "coup monté par ses adversaires" ?(2023) je démolis d'ailleurs, de façon assez percutante, je crois, cette thèse simpliste. Au lieu de représenter, comme l'allègue Louis Cornellier dans Présence, un Grand reportage, aussi solide que consternant, j'affirme que ce livre reflète un journalisme d'enquête superficiel, sensationnel, voire carrément biaisé.
L'immense douleur de voir ton agresseur présenté comme un quasi saint tout en étant toi-même vilipendé
VOIR À LA TÉLÉVISION L'ÉGLISE CÉLÉBRER DE FAÇON AUSSI GRANDIOSE les funérailles de celui qui les a agressés sexuellement alors qu'ils n'étaient qu'enfant ou adolescent, représente, pour les victimes du cardinal, une douleur immense.
Une douleur qui est d'autant plus profonde et dévastatrice que, durant ces funérailles, on parle d'eux comme s'ils n'étaient que des menteurs, des personnes confuses ou délirantes, ou comme s'ils faisaient partie d'une vaste conspiration contre le cardinal.
Et une douleur qui s'ajoute à toutes les autres souffrances et traumatismes découlant des abus subis dans le passé.
Les faits d'abus « ne datent pas de 30 ans », affirme mon ami théologien Jean-Guy Nadeau, « car ils se sont produits encore hier dans l'âme des victimes et se produiront probablement encore demain, voire toute la vie. » Il ne s'agit pas seulement, poursuit-il, d'un acte « ou une série d'actes du passé, mais des conséquences quotidiennes toujours présentes de ces actes sur le plan de la santé physique, psychologique, sur le plan des relations humaines, de la relation à soi ou de la relation à Dieu : la honte, l'impression de saleté, les angoisses, les cauchemars, les réveils nocturnes ou les insomnies, les maux de ventre ou autres, (...) les relations amoureuses et parentales difficiles ou même impossibles ».(1)
La reporter Louise Milligan, autrice de Cardinal : The Rise and Fall of George Pell (2017), connaît la souffrance, si bien décrite par Jean-Guy Nadeau, qu'ont enduré et qu'endurent encore aujourd'hui les victimes du cardinal.
Depuis qu'elle a initié son enquête il y a neuf ans, Milligan a rencontré douze des quatorze victimes du cardinal. Elle croit leurs témoignages et s'en trouve profondément touchée et bouleversée.
Je ne peux pas parler au nom des multiples accusateurs de Pell, dont la plupart ne se sont jamais rencontrés et qui se trouvaient à des endroits différents à des moments différents, affirme Milligan. Je ne peux pas parler au nom de la police de l'État de Victoria, du ministère public, de la cour d'appel de l'État de Victoria, des décideurs du ‘National Redress Scheme' ou des éminents Australiens qui ont présidé pendant cinq ans la Commission royale d'enquête sur les abus sexuels commis sur des enfants, qui ont lu d'innombrables documents relatifs à la connaissance qu'avait Pell des agresseurs et qui ont conclu qu'il était au courant et qu'il n'avait rien fait pour les arrêter.
Mais je peux parler en mon nom, en tant que journaliste qui a rencontré un grand nombre de ces hommes qui ont déclaré que Pell avait volé leur innocence. (...) Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait des allégations convaincantes, tragiques et bien documentées à son encontre. Et il y en a de plus en plus. (...) Je ne peux tout simplement pas me détourner et faire comme si ces hommes n'existaient pas. D'autant plus que l'Église sait maintenant qu'un organisme indépendant a évalué certaines de leurs plaintes, les a validées et leur a accordé une indemnisation.
Milligan connaît trois hommes qui ont porté des accusations contre le cardinal Pell et qui ont reçu des paiements de réparation, et au moins deux qui ont reçu des règlements civils. Et il y au moins quatre affaires civiles présentement en cours, dit-elle.
Ce qui révolte le plus les victimes, poursuit Milligan, est la tendance systématique de l'Église de toujours éviter de reconnaître sa propre responsabilité. Une révolte, dit-elle, qui a récemment amené des victimes du cardinal, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant, à prendre contact avec elle et à lui décrire les abus qu'ils ont subis.
Une autre victime se manifeste et contacte Louise Milligan
CE N'EST QU'EN DÉCEMBRE 2024 QUE LOUISE MILLIGAN trouve enfin le courage de faire ce qu'elle avait toujours évité de faire jusqu'alors, sachant que cela serait trop éprouvant pour elle sur le plan émotionnel : s'asseoir, et visionner au complet l'enregistrement télévisé des funérailles du cardinal Pell tenues le 2 février 2023.
Alors qu'elle est en train de visionner la vidéo, plus précisément au moment même où elle arrive au discours de l'ex-premier ministre Tony Abbott dans lequel il déclare que le cardinal Pell est le plus grand catholique que l'Australie ait jamais produit et l'un de ses plus grands fils, une déclaration qui suscite de longs et bruyants applaudissements dans la cathédrale St. Mary's, son téléphone se met soudainement à sonner.
À l'autre bout du fil se trouve Andrew, une victime de Pell.
C'est la toute première fois qu'Andrew se manifeste et contacte Milligan.
Alors qu'Andrew raconte son histoire, il s'arrête souvent, éclatant en sanglots, et s'excusant chaque fois. Milligan démontre de l'empathie, et l'encourage à poursuivre.
C'est alors que je vivais une thérapie que j'en suis venu à comprendre qu'il fallait que je dise la vérité. Une compensation financière ne m'intéresse absolument pas. Celle-ci serait, à mon avis, de ‘l'argent sale'. M'ouvrir, dire ma souffrance devrait me permettre de faire mon deuil, de me réconcilier avec moi-même.
Andrew explique à Milligan que l'abus le plus violent et horrifique qu'il a subi provenait du prêtre avec lequel le cardinal Pell vivait dans un presbytère, Gerald Ridsdale.
Milligan sait que Ridsdale est considéré comme un des pédophiles les plus prolifiques d'Australie. Elle écoute avec compassion Andrew.
Ridsdale me forçait souvent à pratiquer le sexe oral et tentait le sexe anal, se fâchant contre moi parce qu'il ne parvenait pas à me pénétrer. Il me donnait fréquemment des coups de poing dans l'estomac et me frappait à la tête, raconte Andrew.
Pell venait parfois me rendre visite avec Ridsdale. Il me décrivait à Ridsdale comme étant « mon garçon ». Lorsqu'il faisait cela, tous les deux échangeaient de regards. Des regards qui traduisaient une sorte de plaisanterie privée. Leur petit secret, pour ainsi dire...
En 2002, Pell, alors archevêque de Sydney, avait allégué que l'avortement était un pire scandale moral que l'abus sexuel de mineurs par le clergé. Et lorsque l'avocate de la Commission royale sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels sur enfants, Gail Furness, demandait au cardinal, qui témoignait en février 2016 par vidéoconférence depuis Rome, comment c'était possible qu'il puisse totalement ignorer le fait que le prêtre avec lequel il vivait dans le presbytère à Inglewood, Ridsdale, abusait sexuellement beaucoup de mineurs, un fait qui était pourtant de notoriété publique dans cette ville, Pell, alors bras droit du pape François, répondait :
Je... Je ne peux pas dire avoir déjà su que tout le monde était au courant. Je savais qu'un certain nombre de personnes le savaient. (...) C'est une histoire triste, et qui m'intéressait peu. (It is a sad story, and it was not of much interest to me). (2)
Le ‘Redress Scheme', explique Milligan, a conclu en août 2024 qu'un jeune garçon, James, avait effectivement été violé par voie anale par Pell dans un gymnase. James a reçu une lettre l'informant qu'il recevrait donc une indemnisation de $95 000.
Milligan a rencontré ce garçon, aujourd'hui adulte, et sa mère âgée, Carmel, il y a quelques semaines à Ballarat.
Voilà la plainte, affirme Milligan, que James a déposée auprès du ‘Redress Scheme' :
Le gymnase était vide, et à l'intérieur du gymnase, il y avait un petit trampoline, et Pell m'a mis dessus. Je me souviens qu'il m'a dit 'Baisse ton pantalon'. J'ai cru qu'il allait me fouetter avec sa ceinture. Il ne l'a pas fait. Il m'a mis quelque chose dans le cul - je suppose que c'était son pénis. C'était très douloureux. Je saignais des fesses par la suite. Il m'a ensuite laissé dans le gymnase.
Une fois qu'il avait déposé sa plainte et que l'Église en avait été notifié, James raconte à Milligan qu'il a rencontré par hasard l'évêque Paul Bird, du diocèse de Ballarat, dans une bibliothèque.
L'évêque Bird lui a demandé : Comment t'appelles-tu ?
Lorsque je lui ai donné mon nom complet, dit James, il m'a tout simplement tourné le dos.
Il m'a snobé. Il m'a complètement snobé.
Le diocèse de Ballarat n'a pas accepté de reconnaître l'abus que James avait subi, souligne Milligan. Il a aussi refusé de reconnaître les abus subis par les autres plaignants qui, selon la lettre du ‘Redress Scheme' adressée à James, se sont manifestés et ont contribué à la décision de reconnaître le bien-fondé de la plainte de James.
(1) Jean-Guy Nadeau, Une profonde blessure : les abus sexuels dans l'Église catholique, Médiapaul, 2020, p. 158.
(2) Cette citation provient de Chrissie Foster et Paul Kennedy, Still Standing, Penguin Random House Australia, p. 183.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Slavoj Zizek : Les gauchistes* falsifient le choix auquel les Ukrainiens sont confrontés en temps de guerre.

e qui parait le plus noir, c'est ce qui est éclairé par l'espoir le plus vif
« Toutes les femmes sont discriminées sauf la mienne »
Le Blog
Adresses internationalisme et démocr@tie
En temps de guerre, les questions fondamentales de survie, de moralité et d'identité dominent non seulement le discours, mais exposent également les fissures des idéologies politiques mondiales. Au milieu de la clameur des récits médiatiques et des cadres partisans bien ancrés, quelques voix parviennent à s'élever au-dessus de la mêlée, offrant des critiques incisives et s'attaquant aux vérités inconfortables que les autres éludent souvent.
Slavoj Zizek, le philosophe slovène connu pour son mélange éclectique de psychanalyse, de marxisme et de critique culturelle, continue de remettre en question la pensée conventionnelle sur la politique mondiale, la guerre et les dilemmes complexes de l'idéologie de gauche.
Dans une interview accordée au Kyiv Independent, Zizek aborde le rôle de l'humour en temps de guerre, les racines de la romantisation de longue date de la Russie en Occident et l'échec de la gauche face à la lutte pour la survie de l'Ukraine.
Cet entretien a été revu pour des raisons de longueur et de clarté
6 février 2025 | tiré du site entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/06/slavoj-zizek-les-gauchistes-falsifient-le-choix-auquel-les-ukrainiens-sont-confrontes-en-temps-de-guerre/
The Kyiv Independent : La menace persistante d'une attaque nucléaire russe au cours des trois dernières années a aiguisé l'humour noir des Ukrainiens, qui s'épanouit souvent en temps de guerre. Pourquoi pensez-vous que cela choque encore les observateurs extérieurs que les gens puissent (et aient besoin de) rire face à la mort ?
Slavoj Zizek : Je me méfie de ceux qui réagissent à la souffrance d'autrui par des larmes et des manifestations publiques spectaculaires de sympathie. D'après mon expérience, les personnes qui se comportent ainsi ne sont généralement pas celles qui ont vraiment souffert. Il s'agit d'une performance émotionnelle, détachée de la réalité de ce que signifie endurer la douleur.
Je me réfère souvent à l'histoire d'un aborigène australien qui reçoit la visite d'observateurs occidentaux animés d'intentions bienveillantes. L'aborigène leur dit : « Si vous êtes venus ici pour compatir à notre souffrance et exprimer votre compassion, rentrez chez vous. Mais si vous êtes venus ici pour vous battre à nos côtés, restez. » Je pense que cela capture parfaitement cette hypocrisie totale, la même que celle que nous voyons à plus grande échelle envers les habitants de l'Ukraine, de Gaza, et d'ailleurs aujourd'hui.
Lorsque la souffrance est insupportable, tu ne peux pas te laisser aller à un deuil trop profond parce que tu es encore au milieu de cette souffrance. Soit tu te retires complètement et tu deviens une sorte d'énergumène, soit tu t'en sors par l'humour. Même à Auschwitz, les Juifs faisaient des blagues sur leur situation difficile – c'était leur façon de gérer l'horreur. Ce n'est que plus tard, dans les années 1950, qu'ils ont commencé à prendre une certaine distance émotionnelle par rapport à tout cela et que le deuil sérieux et la réflexion sur ces tragédies ont commencé.
« Quand la souffrance est insupportable, tu ne peux pas te livrer trop profondément au deuil parce que tu es encore en plein dedans. »
La même chose s'est produite pendant les guerres de Yougoslavie, notamment après le massacre de Srebrenica. Face à un tel traumatisme, les gens ont développé des blagues pour faire face. L'humour était le seul moyen de survivre émotionnellement. Je ne vois rien d'irrespectueux là-dedans.
As-tu lu les mémoires classiques de Primo Levi sur l'Holocauste, « Si c'est un homme » ? Il y décrit des moments qui, malgré l'horreur, sont presque comiques. Par exemple, lors de la sélection mensuelle où les prisonniers devaient courir devant un officier SS qui décidait rapidement s'ils étaient encore assez sains pour travailler ou s'ils devaient être envoyés dans les chambres à gaz, les prisonniers se préparaient à ce moment fugace de jugement. Ils se pinçaient les lèvres, les joues ou le ventre pour paraître plus rouges et en meilleure santé. Ce sont des scènes absurdement tragiques et pourtant sombrement comiques.
Il y a des moments qui vont au-delà de l'horreur, et même de l'héroïsme. Dans les camps de concentration – ou les goulags staliniens, d'ailleurs – la situation était si désespérée qu'il n'y avait pas de place pour l'image traditionnelle de l'héroïsme. Vous ne pouviez pas jouer le rôle du brave martyr, se dressant avec défi et disant : « Allez-y, tuez-moi, je ne trahirai jamais mes principes ». Les conditions étaient tout simplement trop extrêmes pour cela.
Personne ne devrait avoir honte de trouver de l'humour ou d'autres moyens de faire face à la guerre. Ce n'est pas une trahison de la situation – cela peut même vous donner la force de mieux vous battre.
The Kyiv Independent : Oui – une sorte de clarté émerge lorsque vous comprenez pleinement la réalité à laquelle vous êtes confronté.
Slavoj Zizek : As-tu vu le documentaire « Real » d'Oleh Sentsov ? C'est l'une des meilleures œuvres cinématographiques que j'ai jamais vues. Sentsov a découvert lors d'une permission (de l'armée) que sa caméra montée sur un casque avait capturé des images d'une bataille, et il a utilisé ces images pour créer le film.
Ce que j'aime dans « Real », c'est la façon dont il évite deux pièges courants lorsqu'il s'agit de dépeindre la guerre. D'une part, il évite le faux pacifisme – la notion simpliste selon laquelle la guerre n'est qu'une violence et une tuerie dénuées de sens. D'autre part, il évite également de romancer l'héroïsme. Il ne se laisse pas aller à l'idée que la guerre est noble.
Le titre n'est pas une référence à la « vraie » horreur mais plutôt le nom de code d'une position (vers laquelle Sentsov essaie d'organiser l'évacuation de son unité pendant l'attaque) – il y a des noms de code de clubs de football comme le Real Madrid, Barcelone, et ainsi de suite.
Le film de Sentsov capture l'absurdité absolue de la guerre. Il met en lumière quelque chose de crucial : le véritable héroïsme ne consiste pas à s'évader dans l'imaginaire de la guerre comme quelque chose de glamour ou d'honorable. Il s'agit de faire face à la violence insensée et dénuée de sens de la guerre tout en reconnaissant la nécessité de se battre.
Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'après avoir terminé le film, si j'ai bien compris, Sentsov lui-même est retourné au front. Pour moi, c'est cela le véritable héroïsme.
The Kyiv Independent : Malgré les horreurs de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, nous constatons qu'une fascination pour tout ce qui est russe perdure dans la culture occidentale. Il semble que le monde n'ait pas encore dépassé les représentations de Voltaire de l'Empire russe luttant pour sortir de la barbarie et embrasser les Lumières. Ils sont attirés par cela. Qu'est-ce qui explique, selon toi, ce romantisme de longue date ?
Slavoj Zizek : On s'est toujours demandé si la Russie pouvait vraiment être démocratique. Cependant, il ne faut pas la simplifier à l'extrême. De nombreux personnages considérés comme des héros russes – d'Ivan le Terrible à Pierre le Grand et Catherine la Grande – se voyaient comme des modernisateurs occidentaux autoritaires. Même Staline fait partie de cette tradition.
Lorsque Staline était jeune, quelqu'un lui a demandé comment il définirait un bolchevik. Sa réponse fut la suivante : « Une combinaison de dévouement messianique russe et de pragmatisme américain ». Cela révèle une dynamique intéressante – les bolcheviks ont toujours été secrètement épris de l'énergie et du dynamisme du modèle américain. Leur défi était de trouver comment fusionner cela avec leur vision idéologique.
C'est pourquoi je ne rejetterais pas Poutine comme une relique d'une vieille tradition russe. Non, Poutine représente le pire d'une tendance de longue date dans l'histoire russe, une tendance qui remonte à des personnages comme Ivan le Terrible et Pierre Ier – des modernisateurs autoritaires qui ont cherché à faire entrer la Russie dans la modernité, mais à leurs propres conditions, en utilisant un contrôle brutal et centralisé. Cette modernisation autoritaire a un fort précédent historique, qui s'étend même aux traditions de l'Extrême-Orient.
Par exemple, au début du 20e siècle, le panasiatisme a émergé dans des pays comme la Chine et le Japon. Ces pays étaient confrontés à un dilemme similaire : comment rattraper l'Occident en termes de technologie et d'économie sans perdre leur identité culturelle au profit du libéralisme occidental. Leur solution ? Le fascisme.
Ne regarde pas seulement Alexandre Douguine, mais toute la foule d'idéologues qui gravitent autour de Poutine. Leur idée centrale – c'est une pure horreur – est cette notion d'Eurasie, cette identité mystique euro-asiatique. C'est un raisonnement tellement stupide, vulgaire et fasciste. D'une part, tu as cet orientalisme primitif : embrasser l'idée que l'Orient est passif, arriéré, stupide. D'autre part, tu as cette caricature du libéralisme occidental, une sorte d'autodestruction décadente par un individualisme excessif. Bien sûr, ils positionnent la Russie comme le « bon équilibre » magique – la synthèse supposée parfaite d'un individu dans une société harmonieuse et libre.
The Kyiv Independent : Certains membres de la gauche ont remis en question votre soutien à l'Ukraine. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont du mal à considérer cette guerre comme un exemple typique de résistance d'une petite nation à une grande puissance coloniale ?
Slavoj Zizek : Je trouve incroyable le nombre de pseudo-gauchistes qui sont attirés par cette étrange fascination pour la Russie. Même s'ils admettent que Poutine est horrible, ils s'accrochent à l'idée que la Russie, moins touchée par le consumérisme occidental, préserve en quelque sorte des relations humaines plus « authentiques ». Par exemple, un idiot m'a dit un jour que si l'Occident n'est que promiscuité et libertés sexuelles, en Russie, le « véritable amour » est encore possible.
Cette notion romancée de la Russie est souvent associée à un autre dogme gauchiste : l'OTAN est le mal absolu. Selon ce point de vue, toute personne en conflit avec l'OTAN doit avoir quelque chose de bon ou de vertueux. Selon cette logique, l'Ukraine n'a pas le droit d'être soutenue parce qu'elle est considérée comme menant simplement une « guerre par procuration » au nom de l'OTAN.
Cela m'inquiète qu'ils traitent les Ukrainiens comme des sortes d'idiots – ils falsifient le choix auquel les Ukrainiens sont confrontés. Cette simplification excessive ignore complètement la réalité. Pour les Ukrainiens, le choix n'est pas entre la paix et la guerre – il s'agit de résister ou de disparaître en tant que nation. Les Russes l'ont clairement fait comprendre.
Lorsque les gens disent : « Nous devrions cesser de soutenir l'Ukraine et pousser à la négociation avec la Russie », je réponds : « Peut-être – mais cette décision devrait en fin de compte revenir aux Ukrainiens. » Cependant, sont-ils conscients que la force actuelle de l'Ukraine pour négocier, si elle existe, est entièrement due à sa résistance ? Sans le soutien de l'Occident, l'Ukraine n'aurait jamais atteint une position où des négociations sont même possibles. C'est tout à fait clair.
The Kyiv Independent : Nous avons constaté des efforts, en particulier de la part de la droite, y compris d'une partie du cercle du président américain Donald Trump, pour discréditer Zelensky – en le dépeignant à tort comme corrompu, trop dépendant de l'aide étrangère, et en se moquant de son sens des médias plutôt que de reconnaître que c'est une force. À cela s'ajoute le fait que la gauche pousse l'idée que l'Ukraine est engagée dans une « guerre par procuration ». Que révèlent ces changements dans l'opinion publique mondiale sur la dynamique du pouvoir politique, la manipulation des médias et la façon dont ils façonnent la perception du public face à une guerre d'anéantissement total ?
Slavoj Zizek : Le problème est qu'aucun des deux camps n'écoute les contre-arguments. Par exemple, ici en Slovénie, lorsque j'ai fait remarquer que traiter la défense de l'Ukraine comme une guerre par procuration pour l'OTAN revient essentiellement à insulter les Ukrainiens, les gens ne semblent pas le comprendre. Les Ukrainiens sont présentés comme s'ils pouvaient choisir la paix mais décidaient plutôt de s'engager dans une guerre qui déplace un quart de leur population, juste pour le plaisir d'une guerre par procuration. Mais en réalité, il en va de leur survie. Ils ne l'entendent pas de cette oreille. Ils prétendent que la paix est la valeur la plus importante, mais voici l'ironie : dans mon pays, la gauche qui prétend cela soutient également la mémoire des partisans de Yougoslavie, en particulier en Slovénie, qui se sont battus contre l'occupation allemande. Les partisans faisaient quelque chose de très similaire, et sans doute plus extrême, que ce que font les Ukrainiens aujourd'hui. Ils résistaient à l'Allemagne, exécutaient souvent des otages et se livraient à des actes violents. Pendant ce temps, l'idéologie des gens de droite qui collaboraient avec les Allemands était que la résistance ne pouvait pas se permettre parce qu'elle menaçait la nation slovène. Voici donc le paradoxe : les mêmes personnes qui défendent la résistance aujourd'hui – alors que la Slovénie était beaucoup plus vulnérable que l'Ukraine, sans le soutien de l'OTAN – prônent maintenant la paix, en ignorant les complexités de la situation.
Ils prétendent que l'Ukraine est folle, l'accusant de vouloir pousser l'Occident à utiliser des armes nucléaires. Mais le vrai débat en Occident, c'est que personne ne parle de la première utilisation d'armes nucléaires – c'est la Russie qui profère constamment ces menaces. Tous les six mois, Poutine et ses alliés, en particulier le fou (vice-président du Conseil de sécurité russe) Dmitri Medvedev, ne cessent d'intensifier la rhétorique. Medvedev n'est qu'un outil pour Poutine – il dit les choses les plus extrêmes tandis que Poutine sait comment manipuler la situation. Ce qui est fou, c'est que lorsque la Russie menace d'utiliser pour la première fois des armes nucléaires, c'est accepté comme un fait. Mais lorsque l'Ukraine veut simplement se défendre (en frappant des cibles en territoire russe), elle est qualifiée de fou qui cherche à provoquer la Russie. Je trouve cela humiliant.
J'ai fait une fois cette comparaison : c'est comme si une femme, l'Ukraine dans ce cas, était brutalement violée. Désespérée, elle essaie de faire quelque chose – que ferais-tu si tu étais dans cette situation ? Je ne peux qu'imaginer qu'en tant qu'homme, peut-être que tu te gratterais, que tu essaierais de frapper ses yeux, ou que tu ferais tout ce que tu peux pour survivre. Et puis la réponse de l'Occident serait de dire à cette femme : « C'est trop douloureux, ne le provoque pas. »
Cette désorientation fondamentale m'horripile. Je pense qu'elle contribuera à la fin de la gauche telle que nous la connaissons. Une certaine forme de gauche survivra, mais à l'heure actuelle, dans des endroits comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, la véritable opposition se situe entre les centristes modérément conservateurs – comme le Parti travailliste du Royaume-Uni, qui est maintenant largement modéré – et les conservateurs extrêmes. C'est la même chose avec les démocrates : ce sont eux qui sont modérément conservateurs face à Trump.
N'est-ce pas un triste monde quand les seuls choix sont entre les conservateurs modérés qui prétendent être des libéraux, et les figures extrêmes comme Trump qui se nourrissent de la rage des gens ordinaires ? Je suis pessimiste, je dois l'admettre.
Kate Tsurkan29 janvier 2025
Kate Tsurkan est reporter au Kyiv Independent et écrit principalement sur des sujets liés à la culture. Ses écrits et traductions ont été publiés dans The New Yorker, Vanity Fair, Harpers, The Washington Post, The New York Times et ailleurs. Elle est cofondatrice du magazine Apofenie.
* Dans la littérature anglo-saxonne et dans les textes qui y font référence le terme gauchiste ne renvoie pas « à une maladie infantile » mais désigne simplement le militant engagé à gauche. – NDR.
https://kyivindependent.com/slavoj-zizek-putin-represents-the-worst-of-a-longstanding-trend-in-russian-history/
Communiqué par ML
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’Ukraine et l’UE. Une question à étudier du point de vue ukrainien.

Une tribune de Vitaly Dudin ,cofondateur de Sotsialnyi Rukh, pour Solidaritet, journal socialiste danois à l'occasion d'une rencontre avec l'Alliance Rouge-Vert danoise. Le syndicat ukrainien des infirmières « Sois comme Nina », invité par son homologue danois participe à cette rencontre.
27 janvier 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières | Traduction Deepl Pro relue ML.
Si l'Ukraine veut espérer adhérer à l'Union européenne, les droits du travail doivent être une priorité beaucoup plus importante. C' est également nécessaire pour renforcer la résilience de la société.
Le rapport d'étape 2024 de la Commission européenne sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE a fait l'effet d'une douche froide pour le gouvernement ukrainien. Parmi les nombreuses exigences auxquelles l'Ukraine doit répondre, le domaine du marché social et du travail ressort comme critique par rapport aux conditions d'adhésion à l'UE.
L'Ukraine obtient même la plus mauvaise note dans ce domaine parmi les dix pays candidats, juste derrière le Kosovo. Ce mauvais classement révèle également les années de négligence systématique dans le pays, antérieures à l'invasion russe et liées au démantèlement de la réglementation. Mais aussi à la marginalisation des syndicats par les gouvernements successifs.
En conséquence, la détérioration des conditions de vie des travailleurs ukrainiens est aujourd'hui devenue un obstacle direct aux perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
Le dialogue social : un idéal oublié
Au sein de l'Union européenne, le « dialogue social » – ou les négociations entre les partenaires sociaux – est désormais une institution bien établie et une image de la façon dont les désaccords peuvent être résolus par la démocratie, la négociation et la reconnaissance mutuelle entre les employeurs, les syndicats et les gouvernements.
En Ukraine, le principe du dialogue social a été marginalisé. Le Conseil social et économique tripartite national officiel (NTSEC) – qui était censé être le moteur des réformes coopératives du marché du travail – est inactif depuis 2021. Sans plateforme de dialogue social fonctionnelle, les syndicats sont amenés à réagir de manière défensive aux initiatives gouvernementales au lieu de façonner de manière proactive l'élaboration des politiques.
Au niveau local, l'ébranlement de la pratique des négociations antérieures est encore plus évident. Invoquant l'état d'urgence militaire qui a suivi l'invasion, les employeurs ont été autorisés à suspendre unilatéralement les conventions collectives. De grandes entreprises comme les chemins de fer nationaux ou le plus grand producteur d'acier du pays, ArcelorMittal, n'ont pas tardé à tirer parti de cette situation.
La nouvelle législation viole des normes européennes essentielles contenues dans la Charte sociale européenne, qui garantit le droit à la négociation collective et à des salaires équitables.
L'affaiblissement du mouvement syndical est important dans la conjoncture. Le nombre de membres a chuté, avec une perte estimée à 700 000 membres depuis 2022. Ce déclin reflète la destruction des emplois, les effets de la guerre et l'affaiblissement de la capacité des syndicats à défendre les droits des travailleurs.
Sécurité au travail : qui protège les travailleurs ?
La guerre elle-même a porté un coup majeur à la sécurité des travailleurs, mais cela ne change rien au fait que la protection du travail dans le pays était déjà insuffisante. Le système en vigueur se concentre étroitement sur les mesures réactives, alors que dans l'Union européenne, par exemple, la prévention joue un rôle beaucoup plus important.
Le projet de nouvelle loi sur la sécurité au travail du gouvernement ukrainien (projet de loi n° 10147) a été vivement critiqué pour son approche néolibérale. Il accorde aux employeurs beaucoup plus d'autonomie et de liberté, tout en supprimant des garanties pour les travailleurs, notamment en réduisant le financement des mesures de sécurité et de protection lors des travaux dangereux.
Malgré une certaine inspiration des directives européennes, le projet de loi ne respecte pas les normes minimales – notamment en ce qui concerne le travail intérimaire et l'accès aux données de sécurité à des fins de prévention-.
Avec plus de 200 décès liés au travail dans l'industrie d'ici 2023 – dont la moitié directement liée à la guerre – la nécessité d'une réforme globale est urgente. Pourtant, les propositions actuelles risquent d'affaiblir encore davantage la protection. Par rapport à la législation actuelle, elles laissent encore plus de questions à la discrétion de l'employeur. Il s'agit notamment de la contribution minimale à la santé et à la sécurité au travail, ainsi que de la fréquence à laquelle les employés doivent être informés sur les questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
Une inspection du travail en crise
La Commission européenne a identifié l'inefficacité de l'inspection du travail ukrainienne comme une lacune majeure. L'absence d'un cadre juridique clair empêche les inspecteurs d'appliquer efficacement la législation du travail. La situation s'est aggravée sous l'état d'urgence, les inspections ayant été suspendues et le contrôle encore affaibli.
Suite aux pressions exercées par l'UE, certaines propositions ont été faites pour renforcer l'inspection du travail, mais encore de façon limitée. Tant que l'Ukraine ne suivra pas l'exemple d'autres pays candidats qui ont adopté des lois dédiées à l'inspection du travail, son système restera inadapté.
L'absence de mesures dissuasives contre les violations liées au travail signifie que les employeurs qui exploitent la loi continueront à le faire sans entrave. Cela compromet à la fois les droits du travail et les ambitions européennes de l'Ukraine.
Des réformes au profit des travailleurs, pas seulement de Bruxelles.
Remédier à ce type de faiblesses systémiques est loin d'être une simple formalité pour l'adhésion à l'UE. C'est une nécessité pour la stabilité et la résilience de l'Ukraine. Garantir une application rigoureuse du droit du travail, renforcer le dialogue social et améliorer l'environnement de travail sont des réformes qui profitent à l'ensemble de la société.
Les syndicats ukrainiens doivent profiter de cette occasion pour travailler avec des partenaires internationaux et affirmer leur rôle dans l'élaboration de l'avenir du marché du travail du pays. La guerre a montré que la solidarité et la justice ne sont pas seulement des idéaux à atteindre mais des outils concrets et essentiels à la survie nationale.
Le respect des droits du travail et des réformes solides renforceront non seulement les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne mais aussi sa cohésion sociale face à la poursuite de l'agression russe.
En donnant la priorité au bien-être de l'ensemble de la main-d'œuvre, l'Ukraine peut jeter les bases d'une véritable intégration européenne et montrer que les valeurs démocratiques, les droits des travailleurs sont au cœur de sa future trajectoire .
À propos de l'auteur
Vitalii Dudin
Docteur en droit du travail, cofondateur de l'ONG ukrainienne Sotsialnyi Rukh
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Ukraine : infirmières sur la ligne de front

Dans un contexte d'hostilités intenses, le système médical ukrainien est dans un état critique. Dans de nombreux villages et villes, les hôpitaux ferment leurs portes et ceux qui continuent de fonctionner souffrent d'une grave pénurie de personnel, d'équipements et de médicaments.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Malgré les conditions difficiles, de nombreux professionnel·les de la santé restent dévoué·es à leur travail : ils et elles tentent de fournir aux gens les médicaments et l'assistance nécessaire et répondent aux appels, même sous le feu de l'ennemi.
« Si quelqu'un meurt, nous l'enterrons nous-mêmes »
Le village de Katerynivka dans la communauté d'Illinivska dans l'oblast de Donetsk est situé à trois kilomètres de la ligne de front. Depuis plusieurs mois, il n'y a plus d'électricité, d'eau ni de gaz, plus de la moitié des bâtiments ont été détruits et les autres sont très endommagés. Certains habitant·es vivent dans des sous-sols et il est dangereux de se déplacer dans le village en raison des bombardements réguliers.
Sur plus de 600 habitants, il n'en reste que 30 à Katerynivka, pour la plupart des retraité·es. Les soins médicaux sont assurés par deux infirmières, Olena Lobova et Inna Tur, qui ont également décidé de rester dans le village aussi longtemps que possible. Selon elles, les gens n'ont nulle part où aller, et certains d'entre eux ne sont même pas transportables.
«
Mon père a 85 ans, il est aveugle et souffre de troubles mentaux. Certains d'entre eux ont des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux, de thrombophlébites et de nombreuses autres maladies. Ils ne survivront pas au déplacement. Bien sûr, c'est effrayant qu'ils soient bombardés, mais c'est aussi un grand risque de partir
» explique Olena Lobova.
Malgré la situation difficile, les infirmières parviennent à fournir des soins médicaux aux résident·es. Elles ont emporté de la clinique détruite tout ce qui pouvait leur être utile dans leur travail. En raison des problèmes de communication dans le village, les deux femmes doivent régulièrement rendre visite aux habitants en personne, ce qu'elles font pendant de courtes pauses entre les bombardements fréquents. Au cours d'une conversation de vingt minutes avec Olena, nous avons compté une douzaine d'explosions. La femme explique que les bombardements sont monnaie courante dans le village.
En raison de l'absence d'électricité, les infirmières ne peuvent pas procéder à des examens complets et se limitent donc à de simples manipulations : elles mesurent la tension artérielle, font des injections, pansent les plaies et administrent des pilules en cas de blessures. Les médicaments sont apportés au village par des bénévoles ou par les villageois eux-mêmes, qui se déplacent parfois jusqu'à la ville la plus proche. Les patients les plus graves doivent être transportés à Kostiantynivka, et les habitants doivent s'organiser eux-mêmes, car les ambulances ne répondent pas aux appels en raison du danger élevé.
«
L'ambulance a cessé de venir chez nous pendant l'été. Si quelqu'un meurt, nous l'enterrons nous-mêmes, car le ‘rituel' [représentant religieux] ne vient pas non plus. Nous creusons nous-mêmes les tombes tant que nous pouvons nous rendre au cimetière. Si la situation empire, nous enterrerons les gens dans les jardins », explique l'infirmière Inna Tur.
Les deux femmes expliquent leur décision de rester à Katerynivka par la volonté de soutenir leurs proches et les résident·es qui ont constamment besoin de soins médicaux et risquent de ne pas survivre au déménagement. Mais même si elles décidaient d'évacuer, elles n'auraient pas les moyens financiers de le faire.
«
Depuis trois ans, mon partenaire et moi travaillons à temps partiel. Par exemple, mon salaire est d'un peu plus de 5 000 hryvnias par mois [116 euros], alors que la location d'un appartement coûte 10 000 [232 euros]. De plus, nous devons quand même vivre avec quelque chose. Mais même si on part, il faut chercher un emploi, et c'est très difficile. J'ai déjà 50 ns, et à cet âge, on ne veut pas vraiment m'embaucher. Mais à la maison, on peut toujours compter sur le soutien de ses voisin·es, car la difficile situation que nous connaissons a rapproché les gens », explique Olena Lobova.
Un autre village de la communauté de Illinivska, Oleksandro-Kalynove, est situé à cinq kilomètres de Katerynivka. Bien que la situation n'y soit pas aussi critique, il est toujours dangereux d'y vivre. Tetiana Nahorna, une infirmière locale, précise qu'elle avait déjà changé trois fois de locaux à cause des explosions qui ont brisé les fenêtres.
«
Aujourd'hui, je reçois des patients à la maison de la culture, mais les fenêtres ont déjà été détruites deux fois. Cependant, ce n'est pas la régularité des bombardements qui est stressante – on s'habitue aux explosions. C'est l'accalmie prolongée qui m'effraie, car elle est généralement suivie d'un bombardement intense » explique l'infirmière.
Bien que le village soit moins peuplé, Tetiana Nahorna a encore beaucoup de travail à accomplir. Elle s'émeut que le stress entraîne une aggravation des maladies chroniques chez les habitants, qui sont pour la plupart des retraités. Il y a quelques mois, l'infirmière a dû prodiguer des soins d'urgence. Tard dans la soirée, un obus a frappé une maison, occupée par des parents âgés et leurs deux filles. La retraitée et l'une de ses filles ont été tuées, tandis que son mari et l'autre fille ont été grièvement blessés. L'ambulance a refusé de venir au village : elle a dit qu'elle attendrait sur la route, où les habitant·es devraient amener les victimes. Pour la première fois de sa vie, Tatiana Nagornaya a dû s'occuper de personnes gravement blessées.
« J'ai ressenti une incroyable poussée d'adrénaline à ce moment-là. Vous voyez les morts et les blessés allongés, mais vous faites votre travail automatiquement, sans réfléchir. Vous ne réalisez l'horreur que plus tard » se souvient l'infirmière. Les blessés ont finalement été transportés à l'ambulance, puis à l'hôpital.
Tatiana raconte qu'elle a souvent pensé à évacuer vers un endroit plus sûr. Cependant, elle devrait alors chercher un nouvel emploi, ce qui n'est pas si facile. En outre, de nombreux villageois seraient privés de soins médicaux.
Ce travail n'est pas fait pour tout le monde
Lyubov Lizogubova, médecin généraliste du village de Hrakovo, dans la communauté de Chkaliv, dans la région de Kharkiv, a dû travailler sous l'occupation et dans un contexte de combats intenses. Pendant plus de six mois, ce village a été sous le contrôle des troupes russes et se trouvait en fait sur la ligne de front. À la suite des combats, 70 à 80% des logements ont été détruits et l'électricité n'a été rétablie qu'en mai 2023. Liubov Lizogubova se souvient que pendant les bombardements intenses, les habitants se sont cachés dans des sous-sols humides pendant des mois, ce qui a gravement nui à leur santé. Les gens ont souffert de maladies chroniques, d'infections et d'épuisement, avec peu ou pas de traitement disponible.
« Le plus difficile, c'est le sentiment d'impuissance. Les gens manquaient cruellement de médicaments. Par exemple, on m'a donné 50 comprimés pour la tension artérielle et 20 personnes ont demandé de l'aide. J'ai dû distribuer la quantité minimale à tout le monde, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution » raconte la médecin.
Liubov a informé les habitants du village de la situation difficile des médicaments et leur a demandé de partager leurs stocks afin qu'elle puisse aider les patients les plus graves. Les gens ont répondu à l'appel. Ainsi, ils ont même réussi à sauver un homme atteint d'un cancer qui avait développé une hémorragie interne.
«
Nous avons rassemblé dans le village des médicaments pour arrêter l'hémorragie et lui avons fourni l'assistance nécessaire. Plus tard, nous avons réussi à amener l'homme dans un territoire contrôlé par l'Ukraine » se souvient la docteure.
Liubov Lizogubova a quitté Hrakovo en juillet 2022, lorsque l'intensité des bombardements a rendu la vie dans le village insupportable. À l'époque, il ne restait plus que 47 habitants sur les 700 que comptait le village. Cependant, elle est revenue dès qu'elle l'a pu. Elle a installé une clinique dans l'une des maisons vides, détruite par les combats que les propriétaires ont accepté qu'elle utilise. Aujourd'hui, Hrakovo se rétablit progressivement : un complexe ambulatoire mobile a été installé dans le village et des équipements et des médicaments ont été livrés. Cependant, malgré ces changements positifs, Lyubov Lizogubova est inquiète pour l'avenir.
«
J'ai déjà 50 ans et je peux travailler encore dix ans. Mais il n'y a pas d'autres filles dans le village qui soient diplômées de l'école de médecine. Qui me remplacera un jour ? Le village de Zaliznychne, où est notre clinique ambulatoire, se trouve à côté de chez nous, et l'ambulancier doit s'y rendre depuis Chkalovske (son nouveau nom est Prolisne, note de l'auteur). Le village voisin de Mospanove n'a pas non plus de médecin. Il n'y a pas de changement », se désole-t-elle.
Selon elle, ce sont surtout les personnes âgées qui restent dans les villages et qui sont les premières à avoir besoin de soins médicaux. Cependant, les conditions de travail offertes par le système national de santé n'attirent pas les jeunes professionnels dans les régions estime Liubov Lizogubova.
Tetiana Nahorna est également attristée par la situation de pénurie de personnel soignant dans les régions d'Ukraine. Elle est convaincue que pour reconstruire le pays, il faut accorder l'attention nécessaire à la disponibilité de spécialistes médicaux dans les zones rurales.
« Très souvent, un rendez-vous chez le médecin dans un village n'a lieu qu'une fois par semaine. Or, il y a beaucoup de grands-parents qui ne peuvent pas se déplacer seuls. Il est nécessaire que le médecin de famille ait une voiture et du carburant pour pouvoir rendre visite à ses patient·es, leur donner des recommandations et réagir à temps en cas de détérioration de leur état de santé » souligne Tetiana Nahorna.
La situation du personnel de santé n'est pas meilleure dans certaines villes. Lyudmyla Pukha, infirmière dans un service pédiatrique de l'un des hôpitaux de Myrhorod, dans l'oblast de Poltava, déplore les importantes réductions de personnel médical dans son établissement en raison des réductions d'effectifs. Nous avions déjà abordé ce sujet dans l'un de nos reportages.
« Nous recevons maintenant huit patients par jour. Du coup, une seule personne assure toutes les fonctions : accueil des patients, tenue des dossiers, injections, perfusions, radios. La nuit, je dois remplir les fonctions d'infirmière et faire le ménage. Nous ne pouvons pas tout gérer. Nous avons besoin d'au moins une ou deux infirmières supplémentaires » estime Liudmyla Hryhorivna.
La femme souligne qu'elle reçoit 13 500 hryvnias [313 euros] par mois pour son travail extrêmement difficile, dont il reste environ 10 500 hryvnias [243 euros] après impôts. Elle affirme que des personnes sont prêtes à travailler dans un établissement de santé, mais qu'en raison de la charge de travail élevée et du faible salaire, les gens ne sont pas pressés de venir.
Malgré la situation difficile du secteur de la santé, ces exemples montrent qu'il existe des travailleur·euses de la santé pour qui les intérêts des patients sont une priorité. L'une de ces professionnelles de la santé est Svitlana Sydorenko, ancienne responsable du poste paramédical du Centre d'assistance médicale et sanitaire de Pryluky, dans l'oblast de Chernihiv. Cette femme a défendu à plusieurs reprises les intérêts des patients, ce qui a suscité le mécontentement de la direction du centre médical, qui a tenté de la licencier. En réponse, la travailleuse de la santé a créé un syndicat pour protéger les intérêts des médecins et des infirmières qui étaient menacés de licenciement collectif.
Svitlana a expliqué qu'elle était tombée en disgrâce auprès de la direction il y a plusieurs années, lorsqu'elle a commencé à défendre les droits des patients.
« J'ai toujours voulu que tout soit conforme à la loi et que les gens reçoivent des soins médicaux au moins conformes aux forfaits approuvés par le NHSU [Service de santé]. J'ai eu un patient, un homme pauvre qui souffrait d'alcoolisme. Il devait être opéré d'une hernie inguinale. Selon le protocole, le patient était censé être admis au service des urgences, puis à l'hôpital. Cependant, l'homme a été immédiatement envoyé au bloc opératoire, où on lui a demandé de payer 10 000 hryvnias [232 euros] pour l'opération. Lorsque j'ai appris cela, j'ai défendu le patient, car des fonds budgétaires avaient été alloués à cette opération » raconte Svitlana Sydorenko. Selon elle, la direction de l'établissement médical a trouvé toutes sortes d'excuses pour ne pas pratiquer l'opération, et ce n'est qu'après qu'elle ait déposé une plainte auprès du NHSU et du ministère ukrainien de la santé que le patient a bénéficié d'une opération gratuite.
Svitlana Sydorenko a acquis de l'expérience dans la protection de l'intérêt général devant les tribunaux lorsqu'elle a défendu les droits sociaux des employé·es. En 2021, le directeur d'un établissement médical a licencié une femme malgré le fait qu'elle devait s'occuper d'un jeune enfant. Svitlana Sydorenko a réussi à obtenir sa réintégration devant les tribunaux. L'employeur a alors utilisé les nouvelles dispositions du droit du travail. L'article 13 de la loi ukrainienne sur l'organisation des relations de travail sous la loi martiale permet à un employeur de suspendre un contrat de travail de sa propre initiative. Svetlana Sydorenko a de nouveau saisi la justice et le tribunal municipal, puis la cour d'appel, lui ont donné raison.
L'année dernière, Svitlana Sydorenko a elle-même pris la tête du Centre d'aide médicale et sanitaire de Pryluky. Elle se bat actuellement pour le sauver et pour traduire en justice ceux qu'elle considère comme responsables de la faillite de l'institution médicale (comme indiqué dans le registre unifié des décisions de justice). Svitlana a réussi à faire ouvrir une enquête criminelle. Elle est convaincue qu'il est important de préserver l'établissement médical, car il garantit l'accès aux soins médicaux pour les patient·es des villages environnants.
Dans le même temps, Svitlana Oleksandrivna ne reçoit pas de salaire pour le moment, car l'institution médicale a été privée de financement : selon elle, ni le NHS ni le budget local ne fournissent d'argent. Elle a également déclaré que l'institution avait d'importantes dettes. Nous aimerions ajouter que Svitlana Sydorenko est une mère célibataire et qu'elle vit avec une modeste allocation de l'État de moins de 3 000 hryvnias [69 euros] par mois. Elle pense que l'Ukraine doit créer un système médical entièrement basé sur l'aide aux personnes. Elle explique sa position dans la vie active comme suit :
«
Notre vie est déjà difficile. Par conséquent, si vous avez l'occasion d'aider une personne, vous devez l'aider et ne pas penser à la manière d'en tirer davantage… Plus nous aiderons les personnes vulnérables, plus la société se développera. Sinon, nous en arriverons à marcher sur les cadavres, en ignorant la douleur des autres, et c'est le chemin de la dégradation
».
Les conditions économiques difficiles et les opérations militaires ont considérablement compliqué le travail du système national de santé. Cependant, les conditions préalables à cette crise étaient connues bien avant les événements actuels et il existait un sous-financement systémique des soins de santé. Cela s'est traduit par un manque chronique de financement pour les équipements médicaux et les médicaments nécessaires, des salaires bas pour les travailleur·euses de la santé, ce qui a conduit à une migration massive du personnel vers le secteur privé ou à l'étranger. Les soins de santé ont été particulièrement touchés dans les régions, où le manque de financement et l'ignorance de certains fonctionnaires locaux ont entraîné la fermeture de cliniques et de centres paramédicaux, limitant ainsi l'accès de la population aux soins médicaux.
Néanmoins, quelle que soit la difficulté de la situation, de nombreux travailleur·euses de la santé en Ukraine exercent leurs fonctions courageusement, malgré des conditions de travail difficiles et une faible rémunération. Elles et ils sont bien conscient·es des difficultés que rencontrent les gens pour accéder aux soins de santé et font de leur mieux pour les aider dans des circonstances difficiles. Ces personnes sont la preuve que la principale priorité de la future réforme des soins de santé devrait être de créer un système basé sur une compréhension approfondie des besoins sociaux de la population, où l'objectif principal sera de soutenir systématiquement la population en tant que fondement de l'État, et où les travailleurs du secteur de la santé auront des conditions de travail décentes.
Oleksandr Kitral, 5 février 2025
Publié par Commons.
Illustration Katya Gritseva.
Traduction Patrick Le Tréhondat.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le trompe-l’œil de la politique migratoire dans l’État espagnol

Depuis des années, la politique migratoire est au centre des grands débats de nos sociétés. Il est vrai qu'elle a toujours été là, mais cela ne peut masquer la certitude que nous sommes à une époque où le débat migratoire s'impose largement sur des positions réactionnaires formulées en termes d'identité et d'exclusion.
6 février 2025 | Hebdo L'Anticapitaliste - 740
https://lanticapitaliste.org/opinions/international/le-trompe-loeil-de-la-politique-migratoire-dans-letat-espagnol
En Espagne, le débat prend une configuration spécifique. Le rôle de l'État espagnol dans la distribution internationale du travail limite ses fonctions à des tâches productives secondaires, à faible valeur ajoutée, qui requièrent une énorme quantité de main-d'œuvre peu qualifiée.
Vague réactionnaire et reflux politique
Cela devrait conduire à une position consistant à faciliter l'arrivée de la main-d'œuvre, mais cela est en contradiction avec au moins deux autres éléments sous-jacents. D'une part, la vague réactionnaire a fait croître les positions politiques sur ces questions, en plaçant la migration comme un phénomène à craindre et en criminalisant les migrantEs dans le cadre de la politique d'exclusion et de sécurité. D'autre part, il y a une contradiction : les classes populaires autochtones peuvent bénéficier d'une certaine ascension de classe au fur et à mesure que des emplois moins valorisés sont confiés à des migrantEs, mais elles peuvent aussi, pour cette même raison, avoir des attentes et être déçues par leur accès au travail.
À cela s'ajoute la démobilisation qui, au-delà des mouvements sectoriels, affecte la politique dans son ensemble dans l'État espagnol. Après la quasi-liquidation du cycle de mobilisation et de nouvelles formes politiques entre 2010 et 2020, la situation actuelle est celle d'un reflux, avec de petits signes de mobilisation qui annoncent une possible réarticulation politique des mouvements populaires, mais qui restent très peu actifs et en position de faiblesse évidente face aux forces de l'État.
Large soutien populaire pour la régularisation
C'est, en gros, le scénario dans lequel s'inscrivent les derniers mouvements autour de la question migratoire. La proposition de régularisation massive rassemble plusieurs ONG et associations dans le but de mettre en avant la demande de légalisation de la situation de milliers de personnes qui vivent et travaillent dans l'État espagnol dans une situation de précarité absolue. La campagne pour la régularisation1 est simple et a un objectif clair : elle estime qu'il y a environ un demi-million de personnes sans papiers dans notre société et demande leur régularisation par le biais d'un mécanisme législatif tout aussi simple. Ce qui est peut-être le plus significatif, c'est qu'elle a été rédigée et soutenue par un large éventail d'organisations qui, grâce à une argumentation simple, ont obtenu un large soutien populaire — plus de 600 000 signatures — et l'accord de tous les groupes politiques, à l'exception du parti d'extrême droite VOX. Toutefois, ce soutien est encore faible, étant donné que le seul le vote qui a eu lieu doit permettre son traitement au Congrès, lequel pourrait modifier ou rejeter la proposition.
Dans leur argumentation, les organisations mettent l'accent sur la nécessité politique et sociale de reconnaître légalement la situation des centaines de milliers de sans-papierEs qui vivent de fait dans l'État espagnol. Insister sur ce point est une sagesse incontestable, tout comme rappeler les diverses régularisations qui ont eu lieu dans différents pays européens. De cette manière, la discussion est placée au bon endroit, en soulignant que les migrantEs font partie de notre société et que leur régularisation doit venir, à la fois en raison de la légitimité qu'ils ont en tant que tels et en raison des nécessités de l'État lui-même.
Toutefois, il convient de noter que la campagne, par son nom même, « essentielEs », souligne la nécessité de régulariser ces personnes qui, bien qu'en situation irrégulière, exercent des fonctions d'assistance, de nettoyage ou de soins de santé de base, qui sont fondamentales pour la viabilité de la communauté. Ce raisonnement rend visible le rôle des migrantEs dans notre monde, mais il a un côté pervers, car il soutient l'instrumentalisation d'un groupe qui, pour beaucoup, n'est acceptable que s'il vient travailler.
Une apparente position progressiste du gouvernement
Les prochaines étapes se situent au niveau des groupes parlementaires : le Bureau du Congrès doit fixer une date pour le débat afin de discuter et d'approuver, de modifier ou de rejeter le texte. Sur le papier, il semble que l'option la plus facile soit que les partis soutenant le gouvernement introduisent des modifications pour réduire le champ d'application, en exigeant une durée de séjour minimale pour bénéficier de la régularisation ou en introduisant d'autres types de conditions. Cependant, il pourrait aussi le laisser mourir ou même choisir de le soutenir en bloc tel quel s'il apparaît que les votes contre seront majoritaires. Ainsi le gouvernement et ses partenaires maintiennent apparemment une position progressiste tout en blâmant la droite pour son rejet. En tout état de cause, le gouvernement ne semble pas du tout intéressé par une régularisation qui créerait des problèmes avec de nombreux partenaires européens et donnerait des armes à l'extrême droite, et il n'a pas non plus les éléments pour la faire passer en raison de sa faiblesse parlementaire.
D'autre part, le gouvernement a déjà réagi en dehors du Parlement, en modifiant le décret sur les étrangerEs2, qui facilite l'accès à la régularisation par « arraigo », la formule la plus courante pour obtenir des papiers. Le gouvernement estime que quelque 300 000 personnes bénéficieront de cette mesure ainsi que des modifications contenues dans le décret. Ce faisant, il mise sur l'activité gouvernementale et laisse de côté l'option de la régularisation massive. Il va sans dire que, dans ce cas, le lien avec le travail n'est pas seulement discursif, mais exécutif : seulEs celleux qui ont un emploi ou la possibilité immédiate d'en obtenir un sont régulariséEs, ce qui consolide l'instrumentalisation des migrantEs.
Bien entendu, il incombe à la gauche politique de progresser dans un domaine où, jusqu'à présent, elle n'a guère apporté plus que quelques slogans. Le vide politique est énorme et nécessite un travail en profondeur pour aider à articuler une réponse sociale, main dans la main avec les migrantEs, pour apporter une proposition sérieuse autour de la migration en tant que question politique brûlante, mais aussi pour élaborer, au-delà, une politique antiraciste systématique, remettant en question les frontières et abordant le droit de tous d'aspirer à une vie digne et sans racisme.
Juanjo Álvarez, militant d'Anticapitalistas
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












