Derniers articles

La nouvelle législation belge sur la prostitution : Distinguer la réalité de la fiction

En lisant les récents titres tels que « Les travailleuses du sexe belges bénéficient d'un congé de maternité et d'une pension en vertu d'une loi inédite », on pourrait penser que la Belgique est en train de réaliser une avancée positive sans précédent pour les femmes. Mais la réalité est quelque peu différente.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/12/18/la-nouvelle-legislation-belge-sur-la-prostitution-distinguer-la-realite-de-la-fiction/?jetpack_skip_subscription_popup
Une législation similaire est en place en Allemagne et en Nouvelle-Zélande depuis des années. Mais essayer de faire entrer une pratique fondamentalement exploiteuse et dangereuse dans le cadre du droit du travail ne la transforme pas en quelque chose de sain et de respectueux, à l'instar du métier de serveuse ou des soins de santé. Croire le contraire est un symptôme de pensée magique qui serait attachante chez un enfant en bas âge mais qui est férocement irresponsable chez un adulte.
Mais, la BBC a dit qu'elle allait assurer la sécurité des femmes, leur permettre de refuser des « clients » et leur accorder des avantages et des pensions. La BBC – la BBC ! – ne peut pas s'être trompée à ce point ? Mais en vérité, il y a une longue histoire de médias grand public qui se laissent convaincre par les intérêts particuliers. Il suffit de penser à la façon dont les barons du tabac et de l'amiante ont longtemps trompé la vigilance de tant de personnes. Et la BBC aurait-elle un dossier équilibré sur cette question ?
L'industrie de la sexploitation fait fortune. Non pas pour les femmes qui en sont la matière première, mais pour des tiers – proxénètes, trafiquants, tenanciers de maisons closes et grands sites web qui inondent les ondes de pornographie violente, misogyne et raciste et d'immenses catalogues de femmes que les hommes peuvent louer pour en user et en abuser sexuellement.
Tout comme les barons du tabac et de l'amiante, les proxénètes se sont emparés des institutions, des gouvernements et même des agences des Nations unies. Les organismes de financement, comme l'Open Society Foundation et ses filiales, la Fondation Bill et Melinda Gates, Mama Cash, la Fondation Ford et de nombreuses filiales des Nations unies, exigent souvent un soutien à la « décriminalisation du travail du sexe » comme condition d'obtention du financement.
En conséquence, les organisations de femmes qui ne soutiennent pas ce principe sont privées de financement et celles du Sud, en particulier, n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour créer un site web et sont donc plus ou moins inconnues au niveau international. Les lobbyistes de l'industrie du sexe peuvent donc affirmer, sans sourciller, que « toutes les organisations dirigées par des travailleuses du sexe » soutiennent la « décriminalisation du travail sexuel ». Mais ils n'expliquent évidemment pas qu'ils entendent par là : la dépénalisation de l'ensemble de l'industrie, y compris les proxénètes et les tenanciers de maisons closes (aujourd'hui redéfinis comme « gérants »), la publicité et les clients. Ils pourraient dire haut et fort que, bien sûr, le trafic sexuel serait illégal, mais pas qu'ils l'ont redéfini de telle sorte que la plupart des trafiquants de sexe passeraient à travers les mailles du filet sans être inquiétés.
Malgré tous ces avantages – médias dociles, mainmise sur les principales institutions, financement généreux des fantassins, etc. -, les proxénètes ont essuyé de sérieux revers ces dernières années.
En septembre 2023, le Parlement européen a voté en faveur d'une résolution qui définit la prostitution comme une forme de violence, à la fois cause et conséquence de l'inégalité persistante entre les femmes et les hommes, et qui encourage les États membres à adopter une approche fondée sur le modèle nordique.
Cette année, Reem Alsalem, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes, a présenté aux Nations unies un rapport novateur qui définit également la prostitution comme une forme de violence et plaide en faveur du modèle nordique. Elle a ensuite rédigé un excellent document de synthèse sur la lutte des femmes pour sortir de la prostitution et sur le soutien dont elles ont désespérément besoin.
Cette année encore, la Cour européenne des droits de l'homme a statué que la loi française sur le modèle nordique ne violait pas la Convention européenne des droits de l'homme.
Cette décision a évidemment porté un coup dur aux proxénètes et à ceux qui les encouragent, qui ont l'habitude de dominer le discours. Mais leurs problèmes remontent à plus loin. Il fut un temps, il y a une quinzaine d'années, où ils présentaient l'Allemagne comme le modèle que tous les pays devraient suivre.
Mais l'Allemagne, avec ses méga-bordels propres et efficaces et son million d'hommes payant pour des actes sexuels chaque jour, s'est révélée n'être pas si propre que cela. Il s'est avéré que ces méga-bordels étaient remplis de femmes migrantes, la plupart victimes de la traite des êtres humains depuis les régions les plus pauvres d'Europe de l'Est et d'Afrique subsaharienne, qui subissent des horreurs inimaginables, et qu'il existe une clandestinité rampante largement contrôlée par des syndicats du crime organisé et des gangs de motards. Les problèmes pour les femmes et pour la société étaient trop difficiles à ignorer, et les proxénètes ont donc changé leur fusil d'épaule.
L'Allemagne a une législation, ont-ils dit, ce qui signifie, comme l'a expliqué Franki Mirren, la meneuse de claques de l'industrie du sexe, que « le travail sexuel est contrôlé par le gouvernement et n'est légal que dans certaines conditions spécifiées par l'État ». Ce qui est vraiment le mieux pour les « travailleuses du sexe », insistent les proxénètes, c'est la décriminalisation qui, selon Mirren, implique « la suppression de toutes les lois spécifiques à la prostitution », comme cela a été mis en œuvre en Nouvelle-Zélande en 2003. Cela convenait au lobby des proxénètes, car la faible population de la Nouvelle-Zélande et son isolement géographique font qu'il est difficile pour le lobby de l'abolition de la prostitution, beaucoup moins bien financé, de contester les affirmations hyperboliques de son succès.
Mais nous avons contesté ces affirmations et un nombre croissant de femmes néo-zélandaises qui ont vécu l'expérience du système ont courageusement commencé à parler de sa réalité (voir les liens à la fin de cet article pour des exemples). Peu à peu, la prise de conscience du fait que le système néo-zélandais était lui aussi loin d'être parfait a commencé à se répandre.
Les abolitionnistes allemands·e ont compilé des données sur le nombre d'homicides commis par des proxénètes et des parieurs, sur des femmes impliquées dans la prostitution sous différents régimes. Nous avons dressé un tableau de ces données qui montre clairement que le nombre d'homicides est beaucoup plus élevé en Nouvelle-Zélande, avec son système décriminalisé, en Allemagne et aux Pays-Bas, avec leur système légalisé, qu'en Suède, en Norvège et en France, qui ont adopté le modèle nordique.
Il serait tentant de suggérer sur cette base que le modèle nordique est plus sûr pour les femmes. Mais la vérité est que la prostitution est l'activité la plus dangereuse au monde et que rien ne peut la rendre sûre. Ce que fait le modèle nordique, lorsqu'il est bien appliqué, c'est de réduire la taille de l'industrie, le nombre de femmes impliquées et le nombre d'hommes qui achètent des services sexuels, ce qui, heureusement, entraîne une diminution du nombre de meurtres.
En résumé, les proxénètes avaient un sérieux problème de relations publiques.
Leur solution ? La Belgique !
En 2022, la Belgique a dépénalisé la prostitution en fanfare : Le premier pays européen à dépénaliser la prostitution ! Le début d'une révolution européenne éclairée ! Et ainsi de suite.
Mais un peu plus d'un an plus tard, la Belgique a adopté une nouvelle législation sur le « travail du sexe » – la législation qui vient d'entrer en vigueur dans les articles triomphants de la BBC et d'autres. Mais attendez une minute – la caractéristique principale de la décriminalisation totale n'est-elle pas qu'il ne devrait pas y avoir de lois spécifiques à la prostitution ? Cela ne signifie-t-il pas que la Belgique n'a plus de décriminalisation et qu'elle a maintenant une légalisation Tout à fait. Mais qu'est-ce qui est gênant entre les proxénètes et leurs partisan·es ? S'ils disent que c'est la dépénalisation, alors c'est la dépénalisation, d'accord ?
Espace P, une organisation belge qui apporte son soutien aux « travailleuses du sexe », a utilement publié le texte de la nouvelle législation en anglais. Elle prévoit des contrats de travail légaux, qui donnent accès aux prestations de sécurité sociale habituelles des employé·es, ainsi qu'à certaines protections spéciales. Cela signifie que le gouvernement belge reconnaît désormais la prostitution comme un travail normal, même s'il nécessite quelques garanties supplémentaires.
L'une des principales garanties est que les « employeurs » ne peuvent pas obliger les « travailleuses du sexe » à « avoir des relations » avec un « client » spécifique ou à se livrer à une pratique spécifique, et qu'un tel refus ne peut pas être considéré comme une « rupture du contrat de travail et ne doit pas entraîner de conséquences négatives pour la “travailleuse du sexe” sur le plan de l'emploi ». Toutefois, si elle exerce ce droit de refus plus de dix fois en six mois, la loi prévoit des services de médiation pour aider à la résolution du problème.
Il reste à voir comment cela fonctionnera dans la pratique. Esther, survivante de la prostitution et experte politique du NMN, est sceptique. La loi ignore les forces du marché et la coercition causée par les exigences des acheteurs, et la manière dont cela se répercutera sur ce que les propriétaires de maisons closes considèrent comme des services normaux. Les femmes qui refusent certaines pratiques (comme la pénétration anale ou le fisting) risquent de ne plus trouver beaucoup d'acheteurs une fois que ces pratiques seront considérées comme des services normaux. Comment les propriétaires de maisons closes réagiront-ils à cette situation ? Pourront-ils même se maintenir à flot si les femmes refusent les actes sexuels dangereux popularisés par le porno en ligne ?
C'est un peu comme les femmes sur OnlyFans contraintes de faire des choses de plus en plus extrêmes à cause de la concurrence et de leur besoin de gagner de l'argent. Les trafiquants seront moins chers que les maisons closes en contraignant les femmes qu'ils contrôlent, qui n'auront pas de contrat de travail. Cela conduira soit à un système à deux vitesses (l'une des principales choses dont se plaignent les proxénètes et leurs meneurs dans le cadre de la « légalisation »), soit les propriétaires de maisons closes utiliseront leur pouvoir de persuasion pour s'assurer que les femmes qu'ils emploient ne refusent jamais une pratique, comme ils le font en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'en a témoigné Chelsea Geddes.
Esther a résumé la situation : « Une femme seule avec un acheteur pourra-t-elle refuser un acte sexuel pour ces raisons ? Les personnes qui rédigent ces lois n'ont aucune idée de la manière dont la coercition et cette industrie fonctionnent réellement ».
Un autre problème est que, selon le système de sécurité sociale belge, vous n'avez pas droit aux allocations de chômage si vous quittez volontairement un emploi ou si vous refusez d'en accepter un qui vous est proposé. Quelles sont les conséquences de cette situation, maintenant que la prostitution est officiellement acceptée comme un travail normal ? Les chômeuses seront-elles contraintes d'accepter un emploi dans une maison close ? Les femmes qui quittent une maison close se verront-elles refuser les allocations de chômage et seront-elles donc contraintes de rester dans la prostitution contre leur gré ? Que signifierait le « droit » de refuser des actes sexuels spécifiques dans ces circonstances ? Nous supposons que cela ne signifie pas qu'elle peut refuser d'avoir des « relations » avec n'importe quel client tout en étant payée.
Dans cet article, nous n'avons abordé que quelques-unes des contradictions inhérentes à tout système de prostitution régularisé, que les proxénètes et leurs pom-pom girls préféreraient que nous ne soulignons pas. Esther a beaucoup écrit sur de nombreuses autres contradictions et sur le fait que la prostitution ne pourra jamais se conformer aux normes modernes de santé et de sécurité, aux réglementations en matière d'emploi et à la législation sur l'égalité. Prétendre que c'est le cas risque d'avoir des conséquences négatives pour les autres travailleurs et travailleuses et de conduire à un affaiblissement des normes, en particulier pour les femmes. Si une « travailleuse du sexe » fait des fellations dans le cadre de son contrat de travail, qu'est-ce qui empêcherait le patron de n'importe quelle autre entreprise d'inclure dans la description de votre travail le fait de faire des fellations à des clients importants et à des cadres ?
En définitive, ce nouveau développement est très éloigné de la prétendue libération proclamée si bruyamment. En réalité, elle inscrit dans la loi le droit des hommes à l'accès sexuel aux femmes et place les femmes dans une position de subordination par rapport aux hommes. Cela n'est pas compatible avec les aspirations d'une société démocratique moderne et égalitaire. C'est pourquoi nous demandons l'adoption du modèle nordique.
Témoignage des femmes néo-zélandaises
La réalité du commerce sexuel dépénalisé en Nouvelle-Zélande
Sur #DECRIM : Chelsea Geddes sur le système de prostitution dépénalisé de la Nouvelle-Zélande
« Je rêvais souvent de quelque chose de mieux, mais au fond de moi, j'ai toujours su que c'était un rêve
»
« Je crois que la prostitution légalisée renforce et enhardit les attitudes misogynes chez les hommes
»
Sara Smiles : Mon histoire dans le monde du viol rémunéré.
https://nordicmodelnow.org/2024/12/11/belgiums-new-prostitution-legislation-separating-fact-from-fiction/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Remettre le monde à l’endroit : point sur les i concernant la « prostitution des mineures », des enfants.

Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/01/10/remettre-le-monde-a-lendroit/?jetpack_skip_subscription_popup
Remettre le monde à l'endroit : point sur les i concernant la « prostitution des mineures », des enfants.
Si la prostitution des mineures est constamment dans les médias, la couverture du sujet a pour angle mort le trou béant qui existe entre la vie d'un enfant et celle des adultes ainsi que le rôle des adultes et de la société entière dans la construction et la protection des enfants.
On nous rebat les oreilles avec les chiffres accablants(20 000 enfants victimes ?) et les risques accrus présentés par les réseaux sociaux. On réfléchit aux facteurs de risque et à la population visée en mettant l'accent sur l'adolescente en situation difficile.
Les images choisies et le discours mentionnent des jeunes filles vulnérables comme si la vulnérabilité était la cause du problème et son explication. Leur vulnérabilité est présentée comme une porte d'entrée vers la prostitution… alors qu'en réalité elle n'en est que le moyen. Mais les enfants sont vulnérables, par définition ! Ce sont les adultes qui les exploitent.
Les enfants ne font qu'évoluer dans la société que nous, les adultes, créons. Et ce sont les adultes qui voient en eux des proies faciles et opportunes et abusent de leur vulnérabilité.
Les adultes gagnent de l'argent, connaissent le coût psychologique et humain de leurs actions, la stratégie de l'agresseur, le besoin dans l'adolescence de se sentir important, vu, valorisé. Ils savent la difficulté de cette période de la vie qu'ils ont déjà vécue. Surtout, ils savent mille fois plus de choses que les enfants sur la sexualité.
Ne nous méprenons pas : les enfants mis en situation de prostitution ne sont pas idiots, ou incapables d'accomplir des choses merveilleuses, ce n'est pas cela qu'on dit. Mais il faut du temps et de l'expérience pour apprécier l'existence du bien et du mal, la réalité de l'humanité et la bonté et la saleté humaine. Quand les expériences fondamentales d'un enfant tournent autour de personnes qui les considèrent comme des proies faciles pour leurs idées perverses, on ne peut pas construire un autre monde dans sa tête et, oui, on est sur-vulnérable. La vulnérabilité n'autorise pas les adultes à faire n'importe quoi. Depuis quand être vulnérable autorise l'autre (adulte ou enfant) à traiter un être humain comme un objet ou un moins que rien ?
Comme il est facile de trouver des annonces sur internet et de contacter « comme si de rien n'était » un proxénète ou un enfant, ou de trouver du contenu pédocriminel ! On dirait presque une pêche à la ligne de canard à la fête foraine. La prostitution des enfants en France, ce sont des chiffres faramineux mais pour chaque enfant, combien d'adultes pédocriminels et violeurs ?
Le monde à l'endroit
Pour chaque vidéo sur internet, combien d'hommes pervers à se masturber ? Combien d'adultes qui se sont dit que c'était acceptable ? Combien d'adultes pour s'exciter sexuellement exclusivement quand c'est une situation de contrainte ? Combien d'adultes se sont dit que ce n'est pas grave parce qu'ils lui donnent de l'argent de poche, lui qui n'a même pas l'âge d'être embauché pour un travail rémunéré ? Combien d'adultes se sont confortés dans leur choix en se disant qu'elle était « consentante » par la simple présence de l'enfant ? Combien d'adultes pour gâcher la vie des adultes de demain pour satisfaire leur perversité ?
La vulnérabilité des enfants n'est pas leur responsabilité et ils et elles n'en ont d'ailleurs souvent pas conscience, surtout pendant l'adolescence. Pourtant, ils et elles sont physiquement et psychologiquement différents des adultes. Il nous appartient de dire la vérité, pour remettre les adultes à leur place et regarder bien en face nos obligations et responsabilités et notre société.
Il faut remettre le monde à l'endroit !
A lire également :notre guide à destination des pros
Rosalie
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/tribunes/le-monde-a-lendroit/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le début de l’IA populaire ?

Comme Prométhée qui a dérobé le feu aux dieux de l'Olympe pour en faire don aux humains, DeepSeek a donné l'IA à la population en général et surtout aux universitaires du monde entier en leur fournissant un puissant code source ouvert peu dispendieux capable de faire compétition aux géants de l'industrie.
En dévoilant officiellement son dernier né, DeepSeek-R1 le 20 janvier, le jour de l'investiture de Donald Trump, l'entreprise basée à Hangzhou dans l'est de la Chine, a révolutionné l'intelligence artificielle (IA). Le président américain qui a lancé Stargate, le plan IA sur cinq ans de 500 milliards de dollars, a qualifié l'arrivée de cette IA, de signal d'alarme pour l'industrie technologique américaine. En quelques jours DeepSeek-R1 a battu ChatGPT et est devenue l'application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store américain d'Apple, se retrouvant parmi les cinq meilleures IA conversationnelles dans le classement de l'Université de Berkeley.
Changement de paradigme
Alors qu'OpenAI voulais augmenter significativement ses tarifs, DeepSeek-R1 a des prix 95 % inférieur. En rendant disponible au monde entier une IA ayant les capacités des meilleurs moteurs privés actuellement sur le marché à des coûts de l'ordre du million de dollars plutôt que du milliard, DeepSeek fait comme Prométhée et donne à la majorité des humains l'accès à une invention équivalente à celle du feu. Les universités, écoles de formation, petites entreprises et surdoués de toute la planète qui ne pouvaient que regardés envieux les puissantes entreprises informatiques développé ces outils à technologie privée qui étaient hors de porté de prix pour eux, ont déjà téléchargé par centaines de milliers le nouveau logiciel libre.
Les caractéristiques du logiciel sont tellement révolutionnaires qu'on pourrait avancer que c'est en janvier 2025 qu'est née l'IA populaire. L'ancien paradigme qu'il fallait avoir des milliards de dollars pour espérer créer quelque chose de valable en IA est maintenant mort et enterré. Le patron d'OpenAI, Sam Altman, a estimé il y a quelques jours que son entreprise est maintenant du « mauvais côté de l'Histoire » parce que son modèle d'intelligence artificielle (IA) n'est pas ouvert et que les développeurs ne peuvent pas les télécharger gratuitement et modifier leur code source.
Les gros se relèveront
Avec des entreprises comme Meta, Google, Microsoft, Nvidia et OpenAI, les États-Unis qui dominaient le secteur doivent maintenant se battre pour conserver leur première place. La diminution de 1000 milliards en quelques jours de leur valeur en bourse n'est qu'une perte à court terme pour les investisseurs de ces puissances de l'informatique. Plusieurs commencent déjà à se refaire. Ils profiteront comme toutes les autres parties prenantes de cette industrie de la très importante baisse des coûts de production.
Au cours du mois de janvier, Meta a indiqué qu'il dépenserait jusqu'à 65 milliards de dollars en 2025 pour étendre ses infrastructures d'IA. Microsoft pense investir 80 milliards cette année. Son patron Mark Zuckerberg a aussi annoncé « plusieurs centaines de milliards de dollars » d'investissements dans l'intelligence artificielle au cours des années à venir.
Pour sa part OpenAI, associé à Oracle et à SoftBank, a projeté d'injecter rapidement 100 milliards de dollars et jusqu'à 500 milliards au cours des prochaines années. Apple, qui était très en retard au niveau de l'IA, pourrait aussi profiter du nouveau paradigme pour se mettre à niveau.
En France, l'entreprise « Mistral AI », qui vient de lancer son propre nouveau modèle « Mistral Small 3 », voit un élément important et complémentaire de sa technologie dans DeepSeek-R1.
Les défis à régler de l'intelligence artificielle
Ce don aux humains ordinaires de la planète du Prométhée DeepSeek ne veut pas dire que tout est maintenant au beau fixe dans l'industrie de l'IA. Son empreinte environnementale augmente sans cesse. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), une requête sur ChatGPT consomme dix fois plus qu'une recherche sur Google, soit 2,9 Wh d'électricité. Or ChatGPT traite actuellement environ 1 milliard de requêtes par jour provenant de 300 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Les fermes de serveurs ont consommé en 2023 environs 1,4 % de l'électrique mondial et cela pourrait monter à 3 % d'ici 2030. L'approvisionnement mondial en électricité pourrait donc devenir insuffisant d'ici aussi peu de temps qu'en 2027.
Les centres de données nécessitent par ailleurs des systèmes de refroidissement qui consomment beaucoup d'eau. On parle entre 4,2 et 6,6 milliards de mètres cubes d'eau en 2027. Selon une étude parue dans la revue scientifique Nature Computational Science, le matériel qui sert à la production de l'IA, comme les cartes mémoire, graphiques et les serveurs ont créés 2,600 tonnes de déchets électroniques en 2023 et pourrait atteindre 2,5 millions de tonnes en 2030.
Les robots conversationnels sont aussi sujets à des hallucinations. Celle baptisé Lucie en France a récemment du être retiré au bout de trois jours pour avoir fournis des calculs incohérents comme le poids d'un trou de gruyère et parlé d'œufs de vache. Un développeur informatique américain, Tyler Glaiel, a eu comme réponse d'une AI à la question « peut-on faire fondre des oeufs », que c'était possible et que la façon la plus courante était de le chauffer à l'aide d'une cuisinière ou d'un four à micro-ondes. Il y a aussi la possibilité que des hallucinations servent de références à des questions futures.
De plus, les réponses des IA peuvent être manipulées ou soumises à de la censure. Quand il est interrogé sur la crise du Covid, la censure en Chine ou les Ouïghours, DeepSeek R1 répond par des éléments de propagande chinoise.
Michel Gourd
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Intelligence artificielle : la surprise chinoise

Effondrement du marché boursier. Des pertes de plusieurs millions de dollars pour les entreprises technologiques. Surprise et stupéfaction face aux progrès de la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le moment DeepSeek.
tiré de Viento Sur
https://vientosur.info/inteligencia-artificial-capitalismo-y-geopolitica/
Le 27 janvier, un tremblement de terre a traversé l'échiquier géopolitique international. Wall Street a vu les prix s'effondrer. À l'avant-garde de cet effondrement se trouvaient les actions des entreprises technologiques, qui ont entraîné le reste vers le bas, puis ont eu un impact sur les marchés boursiers mondiaux. Un vrai lundi noir. En quelques heures, les grandes entreprises technologiques ont perdu près de 1 000 milliards de dollars ce jour-là.
Qu'est-ce qui avait causé une telle dissolution ? L'annonce qu'une entreprise chinoise a mis sur le marché un assistant d'Intelligence Artificielle qui utilise des processeurs à faible coût, qui seraient plus efficaces dans le traitement des données et donc moins énergivores. Son coût de production est bien inférieur à celui de ses semblables d'origine américaine, tout comme son coût pour le public. Sinon, il est open source, ce qui signifie que tout utilisateur peut en savoir plus sur ses sources, voir comment l'algorithme a été construit et même l'adapter à ses besoins.
Cependant, DeepSeek R1 n'est pas sans restrictions. Par exemple, pour « éviter les contenus qui menacent la sécurité nationale », il ne donne pas d'informations sur la place Tiananmen ou Taïwan. En outre, les services sont réglementés de manière à ce que « les valeurs socialistes fondamentales soient respectées »
Le moment DeepSeek
En 1957, l'URSS a lancé son satellite Spoutnik 1 dans l'espace, ce qui a surpris le monde et suscité de grandes attentes, tout en indiquant clairement que l'Union soviétique avait été en avance dans la course à l'espace et que cela pouvait constituer une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Cet événement est depuis connu sous le nom de moment Spoutnik.
La situation posée par le lancement par l'entreprise chinoise d'un modèle de chatbot de recherche IA, capable de rivaliser avec des avantages avec les moteurs de recherche ChapGPT, Gemini ou Meta AI, peut être assimilée, en raison de sa surprise et de son choc, à ce moment de la fin des années 50 du siècle dernier.
Bien sûr, il y a des différences. Le lancement de Spoutnik 1 a eu lieu en pleine guerre froide, qui a connu son moment le plus dangereux avec la crise des missiles de Cuba, qui a confronté deux modèles différents d'accumulation et de gestion de la main-d'œuvre. Au contraire, le lancement de DeepSeekR1 s'inscrit dans le cadre de la dialectique dispute-collaboration entre les deux grandes puissances de l'époque, les États-Unis et la Chine.
Sinon, ce lancement a signifié « le début de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique » qui, selon Meta AI, « a eu un impact significatif sur l'histoire de l'exploration spatiale et a marqué une nouvelle ère dans laquelle l'humanité a commencé à comprendre l'espace ». Au contraire, l'apparition du moteur de recherche DeepSeekR1 est un nouveau chapitre dans la lutte pour le leadership géopolitique dans le domaine technologique, en particulier dans l'IA la plus avancée...
Géopolitique et technologie
Ces derniers temps, les deux grandes puissances ont pris des mesures protectionnistes. Les États-Unis, sous l'administration Biden, ont élargi les contrôles établis par la première administration Trump. Il a interdit la vente de produits de haute technologie à la Chine, puis a fait pression sur le Japon et les Pays-Bas pour qu'ils se joignent à l'interdiction d'exporter des équipements de fabrication de puces avancés vers la République populaire. La réponse de la Chine à ces obstacles ne s'est pas fait attendre. Il a restreint l'exportation de deux minéraux clés – le germanium et le gallium – essentiels à la production de puces de pointe, et a également interdit l'achat de produits de la société américaine Micron.
Les principales entreprises américaines de haute technologie ont averti opportunément que la politique protectionniste nuirait à leur propre industrie et finirait par favoriser la production chinoise. À la fois parce qu'elle interdisait à leurs entreprises de participer au marché chinois – elles exportaient quelque 400 000 millions de dollars par an en puces – et parce qu'elles favorisaient la recherche de substitution en République populaire.
Ils avaient raison. La société DeepSeek a été fondée en 2023, au moment où les États-Unis commençaient à renforcer leurs restrictions. Peu de temps après, et de manière surprenante, les entreprises chinoises ont annoncé des résultats très positifs dans la production d'un type de puces compétitives, même supérieures à celles développées par Nvidia et AMD aux États-Unis. Il est devenu clair que les restrictions imposées par les États-Unis n'ont pas retardé le développement chinois ; au contraire, ils l'ont stimulé.
C'était maintenant au tour de la R1, qui utilise des puces fabriquées par Nvidia. Ces puces ne sont pas à la pointe de la technologie, elles sont donc moins chères. Le budget de formation du nouveau moteur de recherche ne représente que 10% de ce qui est investi dans ChatGPT. Ces données remettent en question les gros investissements réalisés par Microsoft ou Meta AI, par exemple, lorsque l'entreprise chinoise y est parvenue avec beaucoup moins de ressources. Il se peut qu'à partir de maintenant, les critères d'évaluation de l'efficacité des dépenses et des investissements dans la haute technologie changent.
L'instant de l'instant
La Chine a annoncé le 20 janvier le lancement de DeepSeek R1, quelques heures avant que Donald Trump, déjà président par intérim, n'annonce, en grande pompe, un investissement de 500 000 milliards de dollars dans le projet Stragate, conçu pour construire des centres de données basés sur de nouvelles entreprises d'IA. C'est le début de l'âge d'or des États-Unis qui annonce le jour de son investiture.
Le moment DeepSeek, qui a laissé Donald Trump très instable et minimisé son annonce, était-il le produit de l'évolution logique du calendrier du projet ou ce moment a-t-il été politiquement pensé ? En d'autres termes, le fait de le faire connaître le 20 janvier était-il une décision de l'entreprise qui le produit ou de l'État chinois ?
Quelle que soit la réponse, il est clair que la Chine progresse dans la réduction de l'écart technologique avec les États-Unis. Ce n'est pas pour rien que Trump et Elon Musk ont annoncé qu'ils chercheraient un accord stratégique avec la République populaire. C'est parce qu'il existe une forte interdépendance économique entre les puissances et que les nouvelles technologies jouent un rôle central dans cette intégration conflictuelle. C'est que le contrôle de l'IA, le plus avancé des processus technologiques actuels, sera décisif dans la résolution du différend actuel entre les deux grandes puissances.
Ainsi, la collaboration compétitive s'impose, si un nouveau cygne noir n'apparaît pas...
29/01/2025
Eduardo Lucita est membre du collectif EDI – Economists of the Left
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Une reconfiguration du capitalisme ?

Cet article est un chapitre d'une note de la Fondation Copernic à paraître aux Éditions du Croquant, « Que faire de l'IA ? », 2025 ».
Les possibles-ATTAC nº 41 (hiver 2024-2025)
« Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain ; le moulin à vapeur, la société avec le capitalisme industriel » écrivait Marx dans Misère de la philosophie (1847). La combinaison du big data, du cloud et de l'IA pourrait-elle donner naissance à une nouvelle forme de capitalisme ? Il faut certes se défier de tout déterminisme technologique et, disons-le, Marx n'y échappe pas avec cette formulation. En fait, les rapports sociaux entretiennent avec le développement scientifique et technique un double lien. D'une part, l'utilisation d'une technologie, plutôt qu'une autre parmi toutes celles qui sont potentiellement disponibles, dépend de la configuration des rapports sociaux et en particulier des rapports de production. D'autre part, la technologie utilisée peut elle-même participer d'une reconfiguration de ces rapports sociaux.
Ainsi par exemple, l'invention du grand moulin hydraulique a été faite au début de l'Empire romain. Cette invention n'a jamais été utilisée à l'époque où elle a vu le jour parce que les grands propriétaires d'esclaves n'en avaient pas besoin. Elle réapparaît un millier d'années plus tard au XIe siècle dans le contexte de rapports sociaux différents dans le cadre de la domination seigneuriale. Le grand moulin s'impose contre le petit moulin à bras des paysans pour conforter la domination seigneuriale et reconfigure en partie cette dernière1.
Il est utilisé dans la production de textiles dans des centres spécialisés, accroissant ainsi les échanges, entraînant l'apparition de nouvelles couches sociales que ce soit leurs travailleurs ou les « bourgeois » propriétaires. De même, la généralisation du machinisme, permise par l'invention de la machine à vapeur, en Angleterre, berceau du capitalisme industriel, supposait qu'auparavant en soient créées les conditions politiques et sociales : reprise du mouvement des enclosures au XVIIIe siècle qui rend disponible la main d'œuvre pour travailler dans les fabriques ; victoire politique des forces contre-révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle ; écrasement de la révolte luddiste au début du XIXe siècle. Ce n'est qu'à partir du moment où ces conditions politiques et sociales ont été remplies que la « révolution industrielle », marquée par un bouquet d'innovations techniques, allait être une arme aux mains de la classe dominante britannique pour permettre la mise en place du capitalisme industriel.
Cependant, même s'il faut refuser tout déterminisme technologique, la question ne se pose pas moins de savoir quelles sont les conséquences de l'introduction de technologies numériques nouvelles dans l'organisation du capitalisme ou, pour le dire autrement, le mode d'accumulation du capital en sera-t-il transformé ? Il nous faut pour cela revenir sur l'histoire du capitalisme lui-même.
Du capitalisme fordiste au capitalisme financier
Après la seconde guerre mondiale, sur la base des rapports de forces de l'époque, se met en place dans les pays du Nord ce que les économistes régulationnistes ont appelé le « capitalisme fordiste ». Si les formes concrètes qu'il peut prendre diffèrent suivant les pays, ce type de capitalisme possède néanmoins des traits communs. Il s'agit d'un capitalisme essentiellement organisé sur une base nationale avec un pilotage macroéconomique effectué par l'État dans le cadre de politiques contracycliques dites « keynésiennes ». Au niveau international, les accords de Bretton-Woods assurent une stabilité financière et économique et l'hégémonie des États-Unis, malgré l'existence du bloc soviétique. La finance est bridée, que ce soit à l'échelle nationale ou mondiale. Un nouveau rapport salarial se met en place sur la base de compromis sociaux institutionnalisés caractérisés par l'existence de conventions collectives nationales ou de branches, ce qui limite les effets de la concurrence entre les entreprises. Ce qui domine, c'est le modèle de la grande entreprise managériale intégrée dans laquelle les actionnaires sont, de fait, contenus, avec une organisation du travail taylorienne qui autorise une production de masse, l'augmentation régulière des salaires avec un partage des gains de productivité permettant une consommation de masse. Se met en place parallèlement un État social avec le développement de la protection sociale.
Cet agencement s'adosse à la seconde révolution industrielle apparue à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle (électricité, automobile, téléphone). Cette vague d'innovations naît durant la grande dépression de la fin du XIXe siècle (1873-1896) qui marque la fin du capitalisme concurrentiel, celui analysé par Marx, et la naissance du capitalisme monopoliste caractérisé par la formation de firmes géantes avec une structuration oligopolistique des marchés et la mise en place du taylorisme qui va s'imposer progressivement malgré une forte résistance ouvrière. Elle sera brisée en Europe pendant la première guerre mondiale au nom de l'Union sacrée et aux États-Unis par une violence de classe d'un niveau inouï. Le mouvement continu de concentration industrielle, combiné à cette nouvelle organisation du travail, permet une forte croissance de la productivité et crée les conditions d'une production de masse standardisée. Mais ce capitalisme est pris d'emblée dans une contradiction entre la production de masse et l'insuffisance de la demande solvable. En effet, à une production de masse doit correspondre une consommation de masse, ce qui nécessite l'accroissement du pouvoir d'achat des salariés qui forment désormais la majorité de la population, ce à quoi se refusent les classes dirigeantes. Cette contradiction va être à l'origine de la crise des années 1930 et sera résolue après la seconde guerre mondiale par la mise en place du capitalisme fordiste.
On a alors affaire à un ordre productif cohérent capable d'assurer sur la longue durée les conditions d'une accumulation efficace du capital. Rétrospectivement cette période apparaît comme un « âge d'or », mais les « Trente Glorieuses » ne l'étaient pas pour les salarié·e·s soumis à une division du travail hiérarchique aliénante, ni pour les femmes enserrées dans une domination patriarcale, ni pour les équilibres écologiques avec une « société de consommation » où les « désirs » de consommation sont façonnés par les grandes entreprises.
Cette forme particulière de capitalisme entre progressivement en crise à la fin des années 1960 sous la conjonction de plusieurs éléments qui se combinent. D'une part, l'internationalisation croissante des grandes entreprises rend de moins en moins efficace les politiques macroéconomiques menées au niveau national. D'autre part, la période de reconstruction de l'après-guerre et la première phase d'équipement des ménages se terminent, ce qui amoindrit l'effet d'entraînement de la demande solvable. Enfin, la multiplication des révoltes ouvrières, la montée d'un puissant sentiment de remise en cause du capitalisme lui-même dans de nombreux pays, indiquent clairement que le fordisme a atteint ses limites. Les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 servent de détonateurs à la crise qui se traduit par une forte chute de la rentabilité du capital et par la « stagflation », combinaison d'une stagnation économique et d'une forte inflation Au milieu des années 1980 se met en place un nouveau mode de gestion des entreprises dont l'objectif est la valorisation continue du cours de l'action en Bourse et l'augmentation des dividendes versés aux actionnaires. L'entreprise est mise au service des actionnaires. Les intérêts des dirigeants deviennent étroitement liés à ceux des actionnaires avec une explosion de la rémunération des dirigeants (stock options, salaire lié au cours de l'action, bonus…). C'est cette envolée des profits non réinvestis qui, en permettant de dégager des liquidités très importantes, a nourri la financiarisation de l'économie.
Cette financiarisation a été permise et s'est développée avec la déréglementation des marchés financiers qui a levé tous les obstacles à la liberté de circulation des capitaux et qui a fortement réduit les contrôles publics sur les institutions financières. Elle a abouti à une globalisation du capital, la mondialisation néolibérale. Mais la stagnation des salaires, voire dans certains pays leur recul, a fait resurgir un vieux problème du capitalisme vu en leur temps par Marx et Keynes. Le salaire est certes un coût pour chaque entreprise qui cherche donc à payer ses employés le moins cher possible. Mais c'est aussi un élément décisif pour assurer une demande solvable surtout dans des pays où l'énorme majorité de la population est salariée. Ainsi, aux États-Unis et dans l'Union européenne, 60 % à 70 % de la demande est d'origine salariale et cette demande a des conséquences sur la hauteur de l'investissement productif. Or nous avons assisté depuis les années 1970 à une baisse tendancielle des gains de productivité à tel point que certains économistes ont pu parler de « stagnation séculaire ».
Comment en effet soutenir l'activité économique, source de profits, quand les salaires stagnent ou régressent ?
La réponse du néolibéralisme à cette question a été : de moins en moins de salaires, mais de plus en plus de dettes. Si ce modèle a été totalement adopté par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Irlande, tous les pays capitalistes développés s'y sont plus ou moins engagés. Aux États-Unis, cette logique n'a pas concerné simplement les biens immobiliers mais aussi les dépenses courantes des ménages, notamment les plus pauvres. Grâce à un marketing bancaire souvent à la limite de l'escroquerie et à des techniques financières « innovantes » (titrisation, réalimentation permanente du crédit…), les institutions financières ont repoussé au maximum les limites possibles de l'endettement.
C'est l'origine de la crise financière de 2007-2008.
La crise a commencé quand les ménages les plus exposés ont été dans l'incapacité de rembourser leurs emprunts et elle s'est répandue comme une traînée de poudre, les pare-feux permettant de cloisonner l'incendie ayant été détruits systématiquement par la déréglementation financière. Cette crise peut donc être considérée comme une crise du régime d'accumulation du capitalisme néolibéral. C'est ce qui s'est passé dans la sphère de production qui a été à la racine de la crise qui s'est déclenchée dans la sphère financière. Si les classes dirigeantes ont été capables de colmater les brèches par des politiques monétaires « non conventionnelles », elles n'ont pas réussi à stabiliser le système dans son ensemble, ce d'autant plus que la crise écologique qui s'aggrave jour après jour mine les bases physiques sur lesquelles il est construit. C'est dans ce cadre qu'il faut regarder l'arrivée des nouvelles technologies.
Les effets paradoxaux des innovations techniques
Le dernier quart du Xxe siècle a vu l'apparition d'une nouvelle base technologique avec la « révolution numérique ». La mise en place du capitalisme néolibéral s'est accompagnée d'une transformation des conditions de la production permises par l'arrivée d'une grappe de nouvelles technologies. Les effets en ont été contrastés. À l'exception des États-Unis pendant une courte période à la fin des années 1990 et au début des années 2000, la baisse des gains de productivité a continué.
On connait le fameux paradoxe de Robert Solow, « prix Nobel » d'économie » : « On voit des ordinateurs partout sauf dans les statistiques de la productivité ». Et de fait, en dépit des apparentes fabuleuses avancées de l'informatique, les gains de productivité se sont ralentis partout, passant d'environ 5 % par an dans les années 1950 à moins de 1 % avant la crise sanitaire et même une baisse nette de la productivité en Europe depuis. Pour le dire encore autrement, la loi dite de Moore à propos des progrès fulgurants des ordinateurs reste pour le moment confinée aux ordinateurs eux-mêmes sans développer la productivité des autres secteurs, en tout cas dans des proportions comparables.
L'introduction des nouvelles technologies numériques est censée booster une productivité atone, notamment par l'automatisation du travail. Or après des décennies, et malgré une sophistication croissante de ces outils, il n'en est rien. Comment expliquer ce paradoxe ? Une première explication renvoie à la déconnexion entre l'évolution croissante des profits des entreprises et la quasi-stagnation de l'investissement productif, une part de plus en plus importante des profits étant, sous une forme ou une autre, redistribuée aux actionnaires. Le néolibéralisme se caractérise par une utilisation des profits à des fins essentiellement de rentabilité financière, ce qui se traduit par un arbitrage favorable à la distribution des dividendes aux actionnaires et aux rachats par les entreprises de leurs propres actions plutôt que d'augmenter les investissements nets. Mais ce déficit d'investissements ne peut tout expliquer, car les entreprises continuent malgré tout d'investir avec le renouvellement accéléré des équipements. Et, prises dans une logique concurrentielle et dans un discours idéologique les incitant sans cesse à adopter les dernières technologies numériques, elles sont souvent amenées à une fuite en avant où, à côté de leur fonctionnement traditionnel qu'elles dominent plus ou moins, s'ajoutent de nouveaux processus peu maitrisés avec de nouveaux métiers qui viennent se surajouter aux anciens. Loin donc d'être un facteur de rationalisation, l'introduction des technologies numériques a été un facteur de complexité supplémentaire et donc de perte de productivité, ce d'autant plus que la destruction du modèle social entrepris depuis des décennies ne prédispose pas à une haute productivité des salarié.es. Toute la question est de savoir si l'introduction massive de l'IA va changer cette situation ou va au contraire l'aggraver.
De plus, des études de plus en plus nombreuses commencent à avancer l'idée que les innovations techniques autour de l'informatique qui sont apparues depuis la fin du XXe siècle n'apportent pas autant de changements que l'on pourrait croire parce que les nouveaux objets nous font faire différemment les mêmes choses qu'autrefois et non pas des choses nouvelles. Exemples : on achète les billets de train par internet mais ce n'est pas ça qui nous fait voyager plus ou autrement ; le click and collect dans les grandes surfaces ne transforme pas nos habitudes alimentaires et ne nous fait pas manger davantage ni mieux. C'est une des différences avec le cycle antérieur du capitalisme fordiste qui a produit de nouveaux objets qui ont modifié en profondeur notre façon de vivre par rapport aux générations précédentes. Est-ce que l'apparition du big data, du cloud et de l'IA pourront changer cette situation ? La généralisation des algorithmes va-t-elle aboutir à une révolution des objets et à une transformation radicale de la sphère des services ?
Mais une telle éventualité est-elle soutenable ? En effet, l'empreinte écologique du monde numérique est colossale. Contrairement à ce que véhicule une vision naïve, le monde numérique est loin d'être immatériel. Il est constitué de métaux rares, de pétrole et s'appuie sur une infrastructure considérable et énergivore. De plus, même si l'efficacité énergétique des appareils électroniques s'améliore au fil du temps, on assiste assez classiquement à un effet rebond car non seulement ils sont de plus en plus nombreux, envahissant notre vie quotidienne, mais étant de plus en plus sophistiqués, leur fabrication génère des dégâts écologiques de plus en plus importants. Cet effet rebond est d'autant plus fort que la concurrence entre les entreprises du secteur favorise le renouvellement régulier des appareils, avec comme conséquence l'amoncellement des déchets électroniques. Avec l'IA et la concurrence nouvelle qu'elle induit entre les firmes, on assiste à la recherche continue d'une puissance de calcul et de stockage des données de plus en plus importante avec la construction de supercalculateurs et la multiplication des data centers énormes consommateurs d'énergie. La généralisation des technologies numériques va donc accroître la contradiction entre le respect des équilibres écologiques et la dynamique d'un capitalisme reconfiguré par les technologies numériques.
La valorisation du recours aux algorithmes passe sous silence que rien ne serait possible sans une intervention massive des « travailleurs du clic » qui collectent, transforment les données ou « entraînent » les algorithmes2.
Cette « tâcheronisation » du travail avec des emplois précarisés et sous-payés est l'envers du décor de l'intelligence artificielle. Il faut y ajouter les emplois « ubérisés » des travailleurs des plates-formes, rémunérés à la tâche et ceux de la logistique soumis à une discipline de travail déshumanisante. Enfin, il faut noter que les usagers des plates-formes fournissent un travail souvent gratuit qui permet l'amélioration de leur fonctionnement par exemple le fait de noter des contenus. Loin de disparaître, le travail humain est la condition de l'existence de la généralisation de la numérisation et du développement de l'IA.
Un nouveau capitalisme ?
Nous assistons à un double phénomène. D'une part, les impératifs de l'accumulation du capital influencent le développement des algorithmes. D'autre part ces derniers transforment le processus de l'accumulation3.
Quoi que l'on puisse penser des usages possibles des données massives et de l'IA, il faut partir d'un constat : aujourd'hui les technologies numériques sont utilisées et développées par les entreprises en tant que moyen d'accumulation du capital. Elles utilisent pour cela gratuitement les expériences fournies par l'activité humaine qu'elles transforment en données, données elles-mêmes transformées en produits prédictifs destinés soit à cibler les acheteurs de leurs produits, soit à être vendus à des acteurs économiques qui les utiliseront à leur tour pour cibler les consommateurs finaux.
La logique de l'accumulation capitaliste s'applique ici à fond : pour être de plus en plus efficace pour prédire et formater les comportements des consommateurs finaux, il faut augmenter sans cesse la quantité de données disponibles, leur variété, mais surtout utiliser des données qui renvoient aux comportements les plus intimes. On assiste ainsi à une accumulation exponentielle des données, le big data, permise par l'arrivée du cloud qui permet de les stocker et de les utiliser dans des machines apprenantes formatées par l'apprentissage profond, le deep learning. De plus, l'invention des « larges modèles de langage » (LLM) permet la génération de textes de plus en plus performants (IA générative) et les progrès considérables de la performance des processeurs graphiques (GPU) permet qu'un même ensemble d'algorithmes puissent être utilisés dans une grande variété de situations.
Cette grappe d'innovations est d'abord utilisée dans un nouveau type d'entreprise, la plateforme, qui est techniquement un ensemble d'ordinateurs en réseau gouvernés par des algorithmes et dont la fonction est d'être un intermédiaire qui facilite les interactions entre plusieurs groupes d'utilisateurs, particuliers ou agents économiques (plateforme dite multiface) ou qui sert d'intermédiaire entre le consommateur et les produits ou services qu'il désire (plateforme dite revendeur)4.
Mais ces technologies numériques peuvent être utilisées dans à peu près tous les secteurs de la vie sociale. Loin de se réduire aux entreprises de plateformes, la logique algorithmique infuse l'ensemble de l'économie et, au-delà la vie sociale dans son ensemble. Ainsi les entreprises traditionnelles non seulement utilisent massivement les données qui leurs sont fournies par les firmes numériques, mais produisent elles-mêmes des objets connectés fournissant à leur tour de nouvelles données. De plus, la capacité prédictive de l'IA tend à faire de l'être humain un simple accessoire de la machine.
Même si l'être humain reste le décideur en dernier ressort, qui osera aller contre la « recommandation » d'une machine ayant mouliné des milliards de données ? La décision humaine ne relèverait plus d'un débat et d'une confrontation entre des choix distincts basés sur des options politiques et des conceptions éthiques différentes, mais sur le traitement statistique probabiliste de milliards de données. Car il s'agit non seulement d'anticiper les comportements des consommateurs mais aussi d'influencer leur consommation future.
Ce dernier objectif n'est, en soi, pas nouveau. De « la réclame » lors de la création des grands magasins, que décrit Zola dans Au bonheur des dames, à la publicité moderne, contrôler et influencer les consommateurs a toujours été un objectif allant de pair avec une marchandisation croissante. Cependant la publicité traditionnelle agit de l'extérieur sur les individus - elle est donc repérable -, et de façon globale, même si elle se veut ciblée, ce qui limite malgré tout sa portée. L'IA agit au contraire de manière quasi invisible, ciblant les individus à partir de leurs comportements antérieurs. Pire même, le développement des robots conversationnels (chatbot) permet à la plateforme d'échanger directement avec les personnes qui les utilisent, leur soutirant ainsi de nouvelles informations sur elles-mêmes, informations qui seront ensuite transformées en données qui serviront à la production de nouveaux produits. Ainsi, la production de marchandises est maintenant soumise à un processus de numérisation des activités humaines. L'extraction de données personnelles, qui permet la manipulation des comportements, tend à devenir le carburant de l'accumulation du capital. En elle-même cette accumulation de données ne servirait pas à grand-chose si elle n'était pas réinjectée d'une façon ou d'une autre dans le circuit de production des marchandises, c'est-à-dire de biens et de services ayant une utilité sociale, une « valeur d'usage », pouvant être soit fournis « gratuitement » en échange de l'abandon de leurs données par les utilisateurs, soit monétisés et vendus.
Le développement de l'IA, le cloud computing et le big data vont-ils entraîner une nouvelle logique d'accumulation du capital ? Tout d'abord, il faut noter le développement de phénomènes rentiers qui peuvent faire penser à l'avènement d'un « techno-féodalisme ». Ces rentes peuvent être de plusieurs sortes5 : rente liée à la propriété intellectuelle ; rente liée à l'utilisation d'actifs « intangibles » (logiciels, bases de données, procédures informatiques, etc.) qui, une fois l'investissement initial réalisé, peuvent être reproduits à des coûts marginaux6 négligeables ; rente dite « d'innovation dynamique » permise par l'accumulation de données dans les chaînes de valeur contrôlées par les firmes. Remarquons toutefois que ce phénomène de rente est consubstantiel au fonctionnement du capitalisme – Marx parlait même de « féodalisme industriel » – et s'est considérablement aggravé avec la naissance du capitalisme monopoliste où les profits des firmes reposent à la fois sur l'exploitation du travail et sur l'existence de rentes liées à leur pouvoir de marché.
On retrouve ce même pouvoir de marché dans le cas des plateformes à travers « l'effet réseau » qui se manifeste doublement : d'une part, plus le nombre de personnes utilisant un service croît et plus ce service devient utile et efficace pour ses utilisateurs ; d'autre part, un nombre croissant d'utilisateurs augmente la valeur économique du service en question. La valeur ou l'utilité à rejoindre la plateforme dépend du nombre d'utilisateurs. L'effet réseau pousse donc au monopole avec pour conséquence que le « vainqueur prend tout », winner-take-all. Ce n'est donc pas a priori la plateforme la plus performante qui l'emporte, mais celle qui, pour une raison ou une autre, réussit à attirer de plus en plus d'utilisateurs. Ces derniers sont d'ailleurs prisonniers de cette plateforme, le coût du changement étant élevé, car la quitter fait perdre ce qui en est l'atout principal, le nombre très élevé d'utilisateurs.
Il faut insister sur un point concernant la formation du prix des services rendus par la plateforme. Le pouvoir de marché de l'effet réseau lui permet d'élever ses prix au-dessus de ses coûts alors même que le service est rendu à un coût marginal quasi nul. Il s'agit donc de prix administrés par la plateforme et qui ne correspondent à aucune réalité économique nécessaire, si ce n'est la volonté de faire les profits les plus élevés possibles. Mais là aussi on retrouve de fortes similitudes dans le capitalisme moderne.
Contrairement à ce qu'affirme l'économie standard, le prix n'est en général pas le mécanisme d'adéquation entre l'offre et la demande sur un marché, tout simplement parce que le marché n'existe pas, sauf pour quelques produits et pour les actifs financiers. Pour qu'un marché existe, il faut une institution qui l'organise et qui permette de mettre en relation acheteurs et vendeurs. Pour des millions de produits disponibles, il n'y a pas de marché au sens strict du terme et les prix sont administrés par les entreprises. Ces dernières, campagnes de publicité à l'appui, essaient de faire distinguer leurs produits par des qualités réelles ou supposées, le prix n'étant qu'un des éléments du choix du consommateur. Parler ici de « marché » est abusif et signifie simplement que la validation sociale de la production se fait a postériori dans l'échange.
Toutefois il est clair que des modifications substantielles du capitalisme sont en cours : apparition d'un nouveau type d'entreprise, la plateforme ; d'un moteur nouveau de l'accumulation, les données ; recomposition des frontières entre travail gratuit et travail rémunéré ; nouveau type de travail polarisé à l'extrême qui combine emplois précarisés et sous-payés, régis de plus en plus par des contrats commerciaux (auto-entreprenariat), et emplois de haut niveau ultra qualifiés ; nouvelle forme de capital qui s'entremêle avec le capital financier et le capital industriel, le capital numérique ou algorithmique, qui a sa propre logique et qui tend à se diffuser dans toutes les sphères de la vie sociale.
Cette nouvelle forme de capital repose certes sur l'exploitation du travail mais aussi, à une échelle jamais vue, intègre dans son processus de valorisation les données issues de l'expérience humaine. Ce qui est nouveau, c'est que les plateformes s'appuient sur l'exploitation du comportement des utilisateurs pour développer et revendre une capacité à prédire leurs comportements. Cet effet boucle a pu se retrouver sous une forme différente dans le capitalisme fordiste où les salarié·e·s.e.s participaient à leur propre exploitation et oppression en échange de pouvoir accéder à des biens de consommation dont ils étaient les producteurs. La différence essentielle tient au fait que ce qui était un processus en grande partie extérieur, en surplomb – d'où les révoltes ouvrières de la fin des années 1960 – devient maintenant, de fait, quasi invisible et donc intériorisé.
Cette nouvelle configuration ne remplace pas le capitalisme financiarisé du néolibéralisme, bien au contraire. Tout d'abord, la logique néolibérale, tout entière tournée vers la marchandisation de toutes les activités sociales, a été la condition pour que le capitalisme numérique voit le jour, que ce soit par la déréglementation du secteur des nouvelles technologies, en particulier celui des télécommunications, ou par le durcissement considérable du droit de propriété intellectuelle et la possibilité de marchandiser les données. Ensuite ce capitalisme numérique ou algorithmique s'articule avec le capitalisme financier, industriel ou commercial. Si la logique d'accumulation néolibérale, dominée par le poids déterminant des actionnaires, notamment des institutions financières, n'a pas disparue, elle est de plus en plus en plus dépendante des plateformes et des machines algorithmiques.
Tend ainsi à se combiner dans le fonctionnement des entreprises à la fois la logique entrepreneuriale qui fait de la concurrence le moteur de l'action et la logique algorithmique qui s'appuie sur des processus prédictifs aboutissant à des décisions automatisées, logique qui se décline aussi au sein des institutions publiques. Enfin, les firmes numériques participent pleinement au jeu du capitalisme financier (cotations boursières, rachat d'entreprises, etc.).
Il faut pour terminer souligner un point. Le capitalisme a toujours fonctionné historiquement avec l'hégémonie d'une grande puissance, le Royaume-Uni au XIXe siècle, les États-Unis par la suite. Le déclin relatif de l'hégémonie états-unienne et la montée impressionnante de la Chine comme postulant à cette hégémonie structurent en grande partie les relations internationales. Cette lutte pour la suprématie se joue en grande partie sur le terrain des technologies numériques comme le montrent les mesures de rétorsion prises par les États-Unis contre la Chine. Dans cette situation, non seulement la plupart des pays, en particulier l'Union européenne, sont dans une situation de subordination, mais la question de la régulation de l'IA, afin qu'elle puisse rester sous contrôle politique et citoyen risque de passer au second plan.
Novembre 2024
NOTES
1. Voir Pierre Dockes, La libération médiévale, Flammarion 1979 et Mathieu Arnoux, Le temps des laboureurs, Albin Michel 2012.
2. Voir Antonio A. Casilli, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Seuil 2019.
3. Nous nous appuyons ici sur quatre ouvrages qui, au-delà de leurs divergences, synthétisent et globalisent une énorme production de travaux : Cédric Durand, Techno-féodalisme. Critique de l'économie numérique, Zones 2020 ; Maya Bacache Beauvallet, Marc Bourreau, Économie des plateformes, La Découverte, 2022 ; Jonathan Durand Folco et Jonathan Martineau, Le capitalisme algorithmique. Accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle, Écosociété 2023 ; Yanis Varoufakis, Les nouveaux serfs de l'économie, LLL 2024. Voir aussi Daniel Bachet, Les marchés réorientés : plateformes, intelligence artificielle et capitalisme algorithmique, https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-40-ete-2024/dossier-ou-en-est-l-altermondialisme-dans-le contexte-de-la-crise-globale-du/article/les-marches-reorientes-plateformes-intelligence-artificielle-et-capitalisme
4. Ces définitions sont issues de Maya Bacache-Beauvalleyt et Marc Bourreau, op cit.
5. Nous reprenons ici l'essentiel de la taxonomie mise en évidence par Cédric Durand, op cit.
6. Le coût marginal désigne le coût de production d'une unité supplémentaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« La RD Congo est une réserve pour les dominants »

Dans Barbarie numérique, une autre histoire du monde connecté, le sociologue Fabien Lebrun explore les conséquences d'un monde toujours plus connecté, notamment en République démocratique du Congo, où une grande partie des minerais nécessaires à cette « révolution numérique » sont disponibles. Pour lui, cette situation est l'une des principales causes des guerres dans l'est du pays depuis trente ans.
Tiré d'Afrique XXI.
Nous avons toutes et tous des minerais de sang dans la poche et sommes les complices indirect·es de crimes abominables pour répondre aux injonctions du monde numérique. C'est du moins le propos défendu dans Barbarie numérique, une autre histoire du monde connecté (préfacé par le philosophe québécois Alain Deneault, avec un avant-propos du prix Nobel de la paix Denis Mukwege), du sociologue Fabien Lebrun. Dans cet ouvrage, il revisite la « révolution numérique » au prisme de l'histoire du capitalisme mondial et de la République démocratique du Congo (RD Congo). Pour lui, la « transition » (qu'elle soit énergétique ou numérique) vantée par « l'idéologie du capital » n'existe pas. Seule l'addition de besoins et de technologies (production d'hydrocarbures et extractivisme pour les énergies renouvelables, la numérisation et l'intelligence artificielle) et l'accumulation financière demeurent, avec des conséquences environnementales et sociétales désastreuses.
En RD Congo, où la situation dans l'Est s'est détériorée ces derniers jours avec l'offensive du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, ses habitant·es sont exploité·es depuis toujours pour nourrir une mondialisation effrénée, estime le sociologue. « Scandaleusement » riches, ses terres sont convoitées au mépris des Congolais·es qui vivent dessus. Hier, il s'agissait d'esclaves. Puis du caoutchouc et des minerais pour les armes (dont l'uranium qui a servi pour construire la bombe atomique lâchée le 6 août 1945 sur Hiroshima). Aujourd'hui, le cobalt, le tantale, le tungstène et autres terres rares nécessaires pour les smartphones et les batteries électriques suscitent autant d'appétit que l'or au temps des conquistadors, qui ont pillé les Amériques à partir du XVIe siècle.
La thèse défendue par l'auteur peut être toutefois interprétée comme une forme de dépolitisation des guerres à répétition dans la région. Comme le soulignent par exemple Christoph Vogel et Aymar Nyenyezi Bisoka dans Afrique XXI, ces points de vue (comme d'autres) ont tendance à enfermer l'Afrique « dans une vision réductrice ». « Ces récits tendent à réduire l'Afrique à un simple réceptacle de politiques extérieures », écrivent les chercheurs. Selon eux, ces discours perpétuent l'idée du « fardeau de l'homme blanc », ce qui « justifie ainsi les interventions internationales sous prétexte de paix, de stabilité et de développement ».
Fabien Lebrun avance l'idée que ce « technocolonialisme » utilise les mêmes pratiques que le colonialisme et le néocolonialisme : travail forcé, fraude, financements de groupes armés… Les « minerais de sang » sont au cœur d'une plainte déposée en France et en Belgique les 16 et 17 décembre 2024 par la RD Congo contre des filiales du géant américain Apple pour recel de crimes de guerre, blanchiment de faux et tromperie des consommateurs. Celui-ci a annoncé avoir suspendu ses livraisons, ce qui, selon les avocats de Kinshasa, ne l'exonère pas de ses crimes passés.
Dans cet entretien, le sociologue, également auteur d'un essai sur le rôle néfaste des écrans sur les enfants (On achève bien les enfants. Écrans et barbarie numérique, éditions Le bord de l'eau, 2020, 16 €), lie le « boom minier » des années 1990 aux guerres à répétition dans le pays depuis trois décennies. Il estime qu'il est nécessaire de revoir notre rapport à la connexion et aux technologies, d'« entamer une décroissance minérale et numérique » pour préserver des vies en RD Congo.
« Les puissances capitalistes financent les milices »
Michael Pauron : Dans Barbarie numérique, vous connectez les guerres qui déchirent l'est de la RD Congo depuis trente ans à l'exploitation des minerais nécessaires pour construire les appareils connectés... N'est-ce pas dépolitiser ces conflits qui ont bien souvent des ressors socio-politiques plus complexes ?
Fabien Lebrun : Les ressources dont a besoin la « révolution numérique » sont très mal réparties sur terre : la RD Congo est sans doute le seul pays au monde qui dispose dans son sol et son sous-sol de la quasi-totalité de la table de Mendeleïev [qui recense tous les éléments chimiques connus, NDLR]. Et, depuis trente ans, des centaines de milices évoluent dans la région. Qui finance ? Les puissances capitalistes et aussi le secteur extractif mondial. Pour moi, d'un point de vue économique et industriel, c'est l'élément central de ces guerres à répétition. Tout cela correspond à la période de la numérisation et de la miniaturisation.
Rappelons que, chaque année, sont vendus environ 1,5 milliard de smartphones, 500 millions de téléviseurs, 500 millions de PC, 200 millions de tablettes, 50 millions de consoles de jeux vidéos… Sans oublier les milliards d'écrans, d'objets connectés (comme le réfrigérateur, la voiture…) qui dépendent de minerais et de métaux dont une grande partie se trouve en Afrique centrale – du moins pour les plus stratégiques.
Michael Pauron : Pour vous, tout tend à prouver que le retour du groupe armé soutenu par le Rwanda, le M23, en 2021, est intimement lié aux minerais… Quelle est votre hypothèse ?
Fabien Lebrun : En 2021, Félix Tshisekedi passe un accord avec l'Ouganda pour faciliter la construction de routes et l'acheminement de produits miniers, forestiers et agricoles. Presque au même moment, plusieurs rapports montrent qu'il va falloir davantage de tantale et de minerais stratégiques pour la 5G et pour la voiture électrique notamment.
Dans ce contexte, plusieurs observateurs estiment que le Rwanda, qui ne veut pas se voir priver de certaines sorties et donc d'une partie de ce marché, a réactivé le M23 en réaction aux accords entre l'Ouganda et la RD Congo. Je penche pour cette hypothèse, d'autant que le M23 a rapidement mis la main sur la mine de Rubaya, dans le Rutshuru, où sont présentes 15 % des réserves mondiales de coltan. Cela étant dit, certains réfugiés du M23 sont en Ouganda. Kampala a donc au minimum fermé les yeux.
Michael Pauron : La RD Congo accuse le Rwanda de piller ses sous-sols. On sait que l'Ouganda en profite également... Cette situation pourrait-elle exister sans la complicité de certaines élites congolaises ?
Fabien Lebrun : Il y a des intérêts divergents et contradictoires des élites de la région. Pendant les deux guerres du Congo [de 1996 à 1997 et de 1998 à 2002, NDLR], les armées sur place qui découvrent toutes ces richesses se sont fait beaucoup d'argent. Il y a eu toute une économie de guerre. Ensuite, les armées ne pouvaient pas rester sur place. Des groupes ont donc été téléguidés. Quatre-vingt-dix pour cent des minerais 3TG [étain, tantale, tungstène et or, NDLR] estampillés rwandais sont congolais. Et ce pillage bénéficie de la complicité de Congolais, c'est évident.
Félix Tshisekedi (comme Joseph Kabila avant lui) pourrait stopper ce pillage mais les Forces armées de RD Congo participent largement à cette exploitation, comme les centaines de groupes armés. Les élites congolaises y compris locales signent des contrats, bradent les terres de leur population et se font beaucoup d'argent.
« L'Histoire permet de voir une continuité »
Michael Pauron : Mi-décembre 2024, la RD Congo a déposé plusieurs plaintes en France et en Belgique contre des filiales d'Apple qui exploitent des « minerais de sang ». Quelles pourraient-être les conséquences d'une telle démarche ?
Fabien Lebrun : Il y a déjà eu une plainte en 2019 aux États-Unis (1) d'un collectif de juristes contre Apple, Dell, Microsoft et Tesla pour complicité de mort d'enfants dans des mines de cobalt congolaises. La plainte a finalement été rejetée en mars 2024. Mais le fait que ce soit un État qui attaque est inédit. Tant mieux si cette plainte conduit à une prise de conscience plus large, car il y a déjà eu de nombreuses campagnes contre les minerais de sang sans que cela ne change quoi que ce soit.
Michael Pauron : À travers l'histoire de la RD Congo et de la « révolution numérique », vous dénoncez une continuité du capitalisme, de la traite négrière à l'extractivisme des métaux nécessaires pour construire nos appareils connectés. Quels sont les points communs entre le commerce triangulaire et l'exploitation des mines en RD Congo ?
Fabien Lebrun : La démarche du livre est de remettre en perspective le dernier quart de siècle du numérique avec cette grande histoire du capitalisme. À travers la technologie et l'histoire du Congo, on reprécise ce qu'on entend par capitalisme et son développement, ses racines et sa naissance. On peut se concentrer sur ses pratiques, son rapport à la terre et à l'exploitation minière.
Je pars de ce que Karl Marx appelait « l'accumulation primitive du capital (2) », à savoir la longue période de la traite négrière et du commerce triangulaire, du XVIe au XIXe siècle, qui met en relation Europe, Afrique et Amérique. Il s'agit du commencement de la mondialisation, qui participe aux premiers profits, ou capitaux, notamment européens à travers les conquistadors et les colons (espagnols, portugais, français, hollandais et anglais). Nous assistons à la naissance de l'extractivisme : l'or et l'argent, énormément puisés sur le continent américain dès le XVIe siècle, ont fait la richesse de l'Espagne et du Portugal.
Plonger dans l'Histoire permet de voir une continuité dans l'apparition conjointe d'une révolution industrielle – ou de la transformation du capitalisme – et un besoin de prélèvement de ressources naturelles. Le Congo est à ce titre emblématique : des hommes, des femmes et des enfants ont été « prélevé·es » pendant la traite négrière afin de répondre à la demande de sucre, de café ou encore de cacao en Europe ; à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, la forêt a été exploitée de manière intensive dans ce pays, notamment pour le caoutchouc avec l'expansion de l'automobile et de l'industrie du pneu ; durant les guerres du XXe siècle, des métaux essentiels à l'industrie de l'armement sont exploités au Congo – citons l'uranium du Katanga et la course aux armements durant la guerre froide ; et, dans les années 1990, avec l'informatisation du monde, le pays répond une nouvelle fois présent avec la richesse de son sous-sol et sa diversité minéralogique.
« L'état d'esprit colonial perdure »
Michael Pauron : Vous expliquez que la notion d'extractivisme avait pratiquement disparu. Quand réapparaît-elle ?
Fabien Lebrun : Le concept d'extractivisme est revenu il y a vingt-cinq ans lors d'une période qu'on a qualifié de « boom minier », qui correspond au développement du numérique mais aussi à la forte demande des pays émergents (Inde, Chine…). Plusieurs travaux montrent une forte augmentation de la pression sur les terres, principalement dites « métalliques ». Cette période a été rapprochée du XVIe siècle, baptisé « le siècle de l'or ». C'est une continuité.
Michael Pauron : Vous parlez également de la continuité du colonialisme, que vous qualifiez de néocolonialisme ou de « technocolonialisme ». Qu'entendez-vous par là ?
Fabien Lebrun : L'état d'esprit des structures coloniales et des institutions ainsi que leurs pratiques perdurent à travers une division internationale du travail et une production mondialisée. Les pratiques criminelles se poursuivent dans ce nouveau stade du capitalisme : extractivisme, fraude et travail forcé qu'on peut comparer à l'esclavagisme. En définitive, il faut faire travailler les Congolaises et les Congolais pour alimenter notre mondialisation.
Michael Pauron : Le colonialisme se perpétue également à travers le vocabulaire, comme l'expression de « scandale géologique » pour qualifier la RD Congo...
Fabien Lebrun : L'expression vient des colons belges, et plus exactement du géologue Jules Cornet au début des années 1880, d'abord pour parler du Katanga, puis de l'ensemble de la RD Congo. À travers ce terme, on voit bien la convoitise et la potentielle goinfrerie : le sol est considéré riche en matière première pour pouvoir développer différents marchés, différentes marchandises, différents produits de la société occidentale. Derrière cette expression, on parle d'un lieu voué à être exploité. C'est une réserve pour les dominants. On parle de la terre pour la maltraiter. On a là un lieu, un territoire qui va participer à l'économie mondialisée. Une projection utilitariste. Ni la nature ni l'humain ne comptent.
« Il n'y a pas de transition, il y a addition et accumulation »
Michael Pauron : Dans votre ouvrage, vous remettez en cause le narratif de ce capitalisme numérique, comme les mots « dématérialisation » et « transition ». Pourquoi les considérez-vous comme inappropriés ?
Fabien Lebrun : Au niveau de l'idéologie, de l'utilisation des mots et de la langue, le terme « dématérialisation » est en effet un de mes pires ennemis. Il est central dans l'idéologie capitaliste contemporaine. « Dématérialiser » sous-entend « numériser » et « informatiser ». À travers ce terme et d'autres, comme « cloud », « cyberespace »..., on cherche à rendre « éthéré » des choses sur lesquelles on n'aurait pas de prise. Or un smartphone c'est 60 métaux et la voiture électrique c'est 70 métaux, la quasi-totalité des 88 disponibles dans la croûte terrestre. Plus on vend des technologies efficaces et plus on miniaturise, plus on recourt à l'ensemble de la table de Mendeleïev. Dans les vingt à trente prochaines années, il va falloir extraire plus de métaux qu'on en a extrait dans toute l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais été dans une société aussi matérielle. Parler de « dématérialisation » est simplement faux.
C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une puissance de calcul qu'il faut rendre plus performante, et qui est basée sur une somme de données qu'il faut traiter, stocker, analyser. On va multiplier la construction des centres de données (les « data centers »), ce qui correspond à du béton, du verre, de l'acier et de l'eau pour refroidir.
Les énergies renouvelables reposent sur le même type de ressources. L'idéologie du capital appelle ça une « transition ». Or il n'y a pas de transition, il y a addition et accumulation, comme le montre très bien l'historien Jean-Baptiste Fressoz, et conformément au principe du capitalisme qui repose sur une croissance infinie.
Elon Musk sait que les minerais s'épuisent, raison pour laquelle il veut aller les chercher sur la Lune et sur les autres planètes ou sur les astéroïdes. Emmanuel Macron et d'autres veulent aller les chercher dans les fonds marins. La Russie et la Chine veulent aller sous les pôles. Tous pensent que le XXIe siècle est un siècle extractiviste et que ces nouveaux secteurs permettront d'éviter l'effondrement du capitalisme. Or cet effondrement est déjà entamé.
Michael Pauron : Votre ouvrage prône la déconnexion. Comment y parvenir dans un monde ultra connecté ? Comment limiter la marche technologique actuelle pour sauver des vies congolaises ?
Fabien Lebrun : Beaucoup de gens me disent que c'est impossible. Mais si on réfléchit à la production de tous ces appareils connectés, on tombe forcément sur l'Afrique centrale, et en particulier sur la RD Congo, qui concentre de nombreuses problématiques liées à la production des technologies connectées. Dans ce cas, si on pense à la place que prennent ces appareils dans notre vie et les conséquences que cela engendre au Congo, il m'apparaît évident qu'il faut revoir nos technologies, la façon dont elles sont conçues, et sans doute accepter qu'elle deviennent moins performantes, moins efficaces, afin qu'elles exigent moins de pression sur la terre, la géologie, le foncier et l'humain.
Il faut réintroduire la notion de limite. On n'a pas le choix. Il va falloir entamer une décroissance minérale et numérique. Se déconnecter d'un seul coup est compliqué mais il faut politiser la technologie car elle donne une direction à notre monde, à notre société et à différentes formes de dominations et d'oppressions. Tout cela devrait être débattu dans toutes les assemblées, dans toutes les administrations et dans toutes les entreprises.
Il faut se questionner sur nos besoins réels et non pas sur ceux créés par l'industrie. Un téléphone à clapet, c'est une trentaine de métaux, soit deux fois moins de pressions qu'un smartphone. D'un point de vue coût-bénéfice, un smartphone avec soixante métaux est inutile.
Notes
1- Le collectif international Rights Advocates (IRAdvocates) représentant quatorze victimes congolaises avait porté plainte en décembre 2019 devant la Cour fédérale. Les parties civiles reprochent à ces sociétés d'avoir tiré profit du travail forcé d'enfants dans les mines de cobalt en RD Congo.
2- Karl Marx, Le Capital. Critique de l'économie politique, 1867.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mali. L’État rompt avec l’ordre libéral dans les mines industrielles

Depuis le coup d'État militaire de 2020, les autorités maliennes se sont engagées dans un bras de fer tendu avec les compagnies étrangères titulaires des permis miniers. Les deux parties se disputent âprement les revenus du sous-sol autour de la nouvelle législation.
Tiré d'Afrique XXI.
En novembre 2024, l'État malien emprisonne Terence Holohan, le PDG de la compagnie australienne Resolute Mining, qui extrait de l'or dans le sud du Mali depuis 2008. En décembre, la justice malienne émet un mandat d'arrêt contre Mark Bristow, le PDG de l'entreprise canadienne Barrick Gold, qui réplique par la suspension de ses opérations à Loulo-Gounkoto (1). Décrite comme l'une des plus grandes entreprises aurifères au monde, Barrick Gold exploite l'or dans l'ouest du Mali depuis sa fusion avec la société anglaise Randgold, en 2018. C'est au Mali que cette dernière avait commencé l'exploitation aurifère, en 1996, grâce au rachat des actifs de la compagnie austro-américaine BHP-Utah.
Les motifs de ces actions judiciaires convergent vers l'accusation que ces compagnies spolient l'État. Parallèlement, l'État impose désormais les dispositions du code minier de 2023, qui lui est beaucoup plus favorable, aux contrats en vigueur signés antérieurement.
Avant le coup d'État de 2020, le Mali s'était toujours abstenu d'incarcérer les représentants des groupes miniers. Qui plus est, depuis 1987, il s'était résolu à recourir à l'arbitrage international pour résoudre ses différends avec les compagnies minières étrangères. Et, jusque-là, le Mali ne les contraignait pas à se conformer à la nouvelle réglementation tant que les contrats étaient en cours de validité.
En réalité, ces inflexions traduisent l'affirmation d'une rupture de l'État malien avec l'ordre libéral qui s'est imposé au monde depuis la chute du mur de Berlin. Et cette rupture s'inscrit dans une certaine profondeur historique.
À l'indépendance, la nationalisation
L'ordre libéral repose sur des idées et des pratiques qui prônent le désengagement de l'État dans la production au profit des acteurs privés et la privatisation des actifs publics. D'après Daniel Yergin et Joseph Stanislaw (2), la plus grosse vente des actifs publics dans le monde s'est produite après la chute du mur de Berlin.
Dans le secteur extractif malien, il s'est traduit notamment par la suppression de toutes les entreprises publiques ; la limitation à 20 % de la participation de l'État au capital des entreprises mixtes ; l'absence de représentant de l'État dans les mines ; le transfert de l'autorité judiciaire vers le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi).
Ancienne colonie française, le Mali accède à l'indépendance en 1960 sous la présidence socialiste de Modibo Keïta, un civil. Avec l'aide de l'URSS, l'État crée dès 1961 le Bureau minier du Mali, une société nationale. Celle-ci est rebaptisée Société nationale de recherches et d'exploitation des ressources minières (Sonarem) en 1963. Son rôle est d'entreprendre l'exploration et l'extraction des ressources du sous-sol. En 1963, le Mali met en place son premier code minier postcolonial, qui fait implicitement de la Sonarem l'unique entité autorisée à entreprendre les activités minières à caractère industriel. En d'autres termes, les entreprises privées sont exclues du droit de propriété sur les ressources minérales. Ces entreprises ne peuvent s'engager dans la recherche et l'extraction des ressources que pour le compte de l'État, contre rémunération. Il s'agit d'une rupture avec le libéralisme colonial fondé sur la reconnaissance du droit de propriété privée.
Le socialisme, « seul gage de la stabilité »
Ainsi, dans la période 1963-1968, seules deux entreprises privées occidentales interviennent dans le secteur extractif malien pour le compte de l'État. Il s'agit de la société allemande Klöckner (pour l'étude de faisabilité sur l'exploitation des gisements de phosphate de Tilemsi, dans le Nord) et de la compagnie anglaise Selection Trust (pour l'exploration de diamant à Kéniéba, dans l'Ouest). La plupart des travaux géologiques sont menés par l'État en partenariat avec l'URSS et non plus avec la France. Jusque-là acteur principal de l'exploration minière, la France est écartée à la suite des tensions nées de la dislocation de la Fédération du Mali.
Les mines ne sont pas le seul secteur que l'État nationalise dans les années 1960. La plupart des secteurs de l'économie sont concernés. Par exemple, 1960 voit la naissance de la Société malienne pour l'importation et l'exportation (Somiex), qui détient le monopole sur le commerce (3). À l'époque, l'étatisation de l'économie s'inscrit dans la stratégie d'importation de l'État socialiste. Pour les dirigeants du moment, comme Seydou Badian Kouyaté (4) (ministre du Développement de 1962 à 1965), le socialisme est « le seul gage de la stabilité politique ».
En novembre 1968, le gouvernement de Modibo Keïta est renversé par un coup d'État militaire mené par le lieutenant Moussa Traoré, qui deviendra plus tard général d'armée. Ce putsch montre que l'importation du socialisme au Mali n'a pas assuré la stabilité politique. L'une des rhétoriques de légitimation du nouveau pouvoir est l'élimination du socialisme. L'insertion de l'ordre libéral dans l'économie malienne en général et dans les mines en particulier est, dès lors, progressive, allant de la reconnaissance du droit de propriété privée à la vente des actifs publics.
Les pressions de la France
À l'arrivée aux affaires de Moussa Traoré, le Mali s'est déjà rapproché de la France pour rompre avec la nationalisation de l'économie. Cet engagement a été pris par le gouvernement de Modibo Keïta dans le cadre des accords monétaires franco-maliens (1967), dont l'une des conséquences immédiates est la dévaluation du franc malien la même année. La libéralisation de l'économie malienne était la condition posée par le gouvernement de Gaulle pour coopérer à la convertibilité du franc malien, créé depuis 1962 (5).
Au cours des deux ans qui suivent la prise du pouvoir par les militaires, plusieurs missions diplomatiques françaises se rendent au Mali pour rappeler l'exigence française de l'application de ces accords. L'extrait suivant du compte rendu de la mission conduite auprès de Moussa Traoré, en janvier 1970, par Yvon Bourges (alors secrétaire d'État aux Affaires étrangères), témoigne de la pression française sur le dirigeant malien :
- Monsieur Yvon Bourges a souligné avec la plus grande insistance les graves préoccupations que causait au gouvernement français l'aggravation de la situation générale du Mali sur les plans économique et financier, et en particulier la détérioration constante du compte d'opération, la persistance du déficit budgétaire et l'absence de tout signe de redressement des sociétés d'État et de la Banque du développement du Mali. Il a insisté très vivement sur la nécessité de prendre dans tous ces domaines des mesures immédiates […] et indiqué que l'effort de la France en faveur du Mali ne pourrait se poursuivre que si le gouvernement malien donnait des preuves de sa bonne volonté d'aboutir : l'heure n'est plus aux déclarations d'intention mais aux actes.
C'est dans ce contexte que le gouvernement de Moussa Traoré libéralise l'économie, en cassant le monopole des entreprises publiques. L'une des mesures emblématiques est la suppression, en 1971, du monopole de la Somiex sur le commerce. Pour le cas particulier des mines, l'État reconnaît le droit de propriété privée sur celles-ci grâce à la réforme du code minier de 1969, qui met fin également au monopole de la Sonarem.
Attirer les investisseurs étrangers
Par ailleurs, l'État supprime, dès 1969, la disposition légale qui excluait la privatisation des entreprises publiques sous Modibo Keïta. Cela signifie qu'au Mali le mouvement de privatisation est antérieur aux programmes d'ajustement structurel (PAS) des institutions financières internationales, qui ne commencent qu'en 1982. Néanmoins, c'est dans le cadre des PAS – autrement dit sur l'injonction de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international – que la plupart des entreprises publiques sont dissoutes, comme la Somiex, en 1988.
Le gouvernement Moussa Traoré ne dissout pas d'entreprise minière. Au contraire, en partenariat avec l'URSS, il crée une entreprise publique extractive en 1983, la Société de gestion et d'exploitation des mines d'or de Kalana (Sogemork). Le gouvernement vend, toutefois, des données géologiques nationales aux compagnies étrangères : l'américaine Ree-Co Minerals Inc, l'austro-américaine BHP-Utah et la canadienne Iamgold. En outre, pour offrir une meilleure protection juridique aux groupes miniers étrangers, le gouvernement consent, à partir de 1987, au transfert de l'autorité judiciaire de l'État vers le Cirdi. Ce dernier appartient au groupe de la Banque mondiale et siège à Paris.
Comme l'illustre l'extrait suivant d'un entretien à Bamako, en 2017, avec un ancien haut fonctionnaire des mines, ces politiques libérales visaient à rendre le sous-sol attractif :
- Nos pays ont décidé de créer les meilleures conditions pour attirer les investisseurs. C'est là où on a mis la stabilisation du régime, c'est là où on a mis les exonérations douanières, les exonérations fiscales ; c'est là où on a conçu la limitation de la participation, c'est là où on a mis tellement de petites choses qui pouvaient attirer les investisseurs. Et dont l'objectif était de permettre à ces investisseurs de rentrer le plus facilement dans leurs fonds. Donc, les garanties participaient de cela, les avantages fiscaux participaient de là, la fiscalité et mieux encore, même en ce qui concerne le règlement des différends. On a décidé que ces différends ne seront plus réglés dans nos pays, que c'est le Cirdi qui sera l'instance de règlement des différends entre les sociétés minières et nous. Les sociétés minières, en réalité, ce ne sont pas des sujets de droit international. Ce sont les États qui sont sujets de droit international. Mais par cet artifice juridique, on les a élevées au même niveau que nous.
Dans le même sens, en juillet 1995, Ibrahim Abba Kantao (directeur national de la Géologie et des Mines) soutient dans L'Essor (média public) que, sans les multinationales, le développement des industries extractives au Mali sera impossible : « Je ne pense pas que la libéralisation du secteur minier soit préjudiciable à notre pays. [...] Et tant qu'on ne prône pas le libéralisme, nos ressources n'auront pas de chance d'être exploitées. »
En 1991, un code minier ultralibéral
L'introduction de l'ordre libéral au Mali et plus généralement en Afrique ne s'est pas opérée uniquement sous la pression de l'extérieur. Elle est le fruit de la « rencontre (6) » entre des volontés locales et extérieures.
En mars 1991, le pouvoir de Moussa Traoré est renversé à son tour par un coup d'État militaire conduit par le colonel Amadou Toumani Touré, communément appelé ATT. Celui-ci deviendra plus tard général d'armée, comme son prédécesseur. ATT rend le pouvoir aux civils un an plus tard, avant de le reprendre par les urnes en 2002. Cependant, dans la courte période 1991-1992, son gouvernement franchit un pas décisif. Il dissout la Sogemork en février 1992.
Un an plus tôt, avec l'assistance de la Banque mondiale, son gouvernement élabore un nouveau code minier, le plus favorable aux compagnies privées de toute l'histoire du Mali, y compris la période coloniale. Ce code octroie des exonérations douanières aux entreprises sur les produits pétroliers pour toute la durée de leur contrat, soit trente ans, alors que dans le code précédent (1970) ces exonérations n'étaient concédées qu'en phase de recherche géologique. En outre, il baisse la taxe ad valorem (taxe sur la valeur des ventes) de 5 % à 3 %. Aussi, contrairement au code de 1970 qui ne prévoit pas de seuil de participation de l'État dans les sociétés mixtes, celui de 1991 limite cette participation à 20 %. De plus, le code de 1991 cantonne les droits de l'État sur les produits miniers à la stricte perception des impôts et dividendes.
Les injonctions de la Banque mondiale
La plupart de ces dispositions seront reprises dans les codes ultérieurs, jusqu'à celui de 2023. Contrairement à ses successeurs, le code de 1991 impose peu de contraintes écologiques aux multinationales. Enfin, il leur garantit la stabilité fiscale tout en leur permettant de choisir le code qui leur paraît le plus favorable. En d'autres termes, l'État ne les contraint pas à se soumettre à la nouvelle réglementation, mais les multinationales sont libres de migrer vers elle à leur guise.
Ainsi, les multinationales, dont les activités étaient jusque-là régies par le code minier de 1970, obtiennent les avantages de celui de 1991. C'est ce qui explique pourquoi, de 1991 à 2017, les plus importantes mines d'or maliennes étaient régies par le code de 1991, bien qu'initialement soumises à celui de 1970. C'est le cas des mines de Loulou (exploitée par Randgold puis Barrick Gold), Syama (exploitée par BHP-Utah, Randgold puis Resolute Mining), Sadiola (exploitée par Iamgold et la sud-africaine Anglogold Ashanti puis la canadienne Allied Gold). Lorsqu'il est question de renouveler leur contrat d'extraction de la mine de Sadiola, en 2017, Anglogold Ashanti et Iamgold sont réticentes à se voir appliquer le code de 2012 alors en vigueur, revendiquant les avantages du code de 1991. C'est le principal point de désaccord avec l'État.
Le point culminant de la libéralisation de l'extraction industrielle des mines maliennes est la dissolution, en 2000, de la dernière société publique minière, la Sonarem, par le gouvernement Alpha Oumar Konaré. Cela fait écho à l'idée de la Banque mondiale selon laquelle les États doivent se désengager de l'extraction au profit du privé pour leur stabilité politique. Lors d'une interview réalisée en 2021, un ancien conseiller de cette institution a expliqué que cette idée avait été diffusée en Amérique latine d'abord, puis en Afrique : « C'est la Banque mondiale qui a commencé à dire : “Voilà, vous avez un potentiel en cuivre, en or, etc. Vous ne pouvez pas continuer à exploiter par vous-mêmes ces gisements. Parce que le risque est trop grand. Vous avez un gisement de cuivre et le prix du cuivre tombe : vous ne pouvez plus continuer à sortir du cuivre. Et vous faites ça avec l'argent de la nation.” La Banque mondiale a dit : “Laissez les compagnies minières prendre ce risque d'investir.” »
Rangold, « l'une des grosses plaies »
Les pressions que les militaires exercent sur les firmes transnationales minières résultent d'idées antérieures à leur arrivée au pouvoir sur le partage jugé inéquitable des ressources. Cette perception de certains hauts cadres était aussi celle de beaucoup de citoyens maliens.
Interviewé en 2017, le représentant malien d'une multinationale confiait que sa propre épouse l'accusait de complicité de pillage des ressources du Mali. Même certains de ceux qui s'enrichissaient avec l'or du Mali admettaient que l'État gagnait moins que les compagnies étrangères. Les avantages du code de 1991 étaient perçus comme abusifs par de hauts responsables de l'administration des Mines, qui s'en ouvraient régulièrement, y compris en public.
Pour le cas particulier de Randgold (devenue Barrick Gold), de hauts fonctionnaires chargés du recouvrement des revenus miniers de l'État ne cachaient pas leur exaspération qu'elle n'ait versé aucun dividende au Mali depuis le démarrage de l'exploitation de la mine de Loulo, en 2005. L'extrait suivant de l'entretien réalisé avec l'un d'eux, par l'auteur de ces lignes, en 2017, en témoigne :
- L'une des grosses plaies du secteur minier actuellement concerne Randgold. À chaque réunion, nous attirons l'attention des gouvernants sur ce point-là. Depuis la création de Loulo, il y a bientôt vingt ans, Randgold n'a pas payé un franc de dividende à l'État. Parce que dans leur convention, il y a un paragraphe qui dit que tant que [la mine] doit un franc à un actionnaire, il ne peut pas y avoir de dividende tant que ce montant n'a pas été soldé. Donc, Randgold a profité de cette clause pour endetter la mine régulièrement, bien que faisant des profits extrêmes. On a toujours dénoncé ça. À chaque fois qu'un nouveau ministre des Finances vient ou un ministre des Mines, ils disent qu'ils vont revoir la situation. Mais après ça, quand ils rencontrent la société, on n'entend plus rien.
En réalité, la critique des politiques libérales de l'État et des multinationales remonte aux années 1990. Si les gouvernements successifs ont souvent été dénoncés pour leur bienveillance à l'égard des multinationales, aucun n'a pris de décision radicale. La critique restait donc dans le vide.
La fin de l'âge d'or du libéralisme ?
En comblant ce vide par des poursuites pénales contre des responsables de compagnies étrangères, par l'imposition d'un nouveau code minier rétroactif, par le rehaussement de la participation de l'État dans le capital des sociétés minières à 30 % avec la possibilité d'obtenir cette part en produits miniers, ainsi que par la création d'une société publique minière (2022), les militaires au pouvoir rompent avec l'héritage des programmes d'ajustement structurel. Indéniablement, c'est la fin de l'âge d'or du libéralisme dans l'extraction minière industrielle au Mali.
Avant eux, d'autres militaires, autour du capitaine Amadou Haya Sanogo, tombeur d'ATT en 2012, ont esquissé une posture de fermeté à l'égard des compagnies minières. C'est ainsi qu'ils se sont rendus, armés, sur le site aurifère de Sadiola, dans l'Ouest, pour inspecter le local où l'or était transformé en lingots. Mais le pouvoir de Sanogo fut trop éphémère pour s'imposer.
À ce stade, il est difficile de parler de retour de l'histoire. Car, contrairement au pouvoir de Modibo Keïta, le pouvoir actuel ne revendique pas le monopole de l'État sur les mines et n'a pas aboli le droit de propriété privée. Les nationalisations en cours diffèrent de celles de la décennie 1960 en ceci qu'elles ne portent pas sur l'appropriation totale des activités d'extraction industrielle minière. Il s'agit plutôt du rachat par l'État de mines antérieurement exploitées par les multinationales. Mais les deux régimes ont en commun de s'inscrire dans le renforcement de l'entrepreneuriat d'État, entretenu par rhétorique de la souveraineté nationale.
Notes
1- Les deux parties ont entamé un nouveau cycle de discussions le 28 janvier.
2- Daniel Yergin, Joseph Stanislaw, La Grande Bataille : les marchés à l'assaut du pouvoir, Paris, Éditions Odile Jacob, 2000.
3- Journal officiel malien, 15 novembre 1960.
4- Seydou Badian Kouyaté, Les Dirigeants africains face à leur peuple, Paris, François Maspero, 1964.
5- Loi n° 62-54 A.N.-R.M « portant réforme monétaire en République du Mali ».
6- Anna Lowenhaupt Tsing, Friction : délires et faux-semblants de la globalité, Paris, La Découverte, 2020.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sheinbaum contre Trump

Je pense aux menaces d'augmentation des droits de douane contre la Colombie et contre le Panama que D. Trump prétend reprendre. Beaucoup ne savent pas que tout cela, mêmes ces menaces proférées sont en violation de la Charte de l'Organisation des États américains que les États-Unis ont contribué à fonder. Son art. 20 stipule : « Aucun État ne peut utiliser ou encourager l'utilisation de mesures coercitives de caractère économique ou politique en vue de contraindre la volonté d'un autre État pour en tirer quelque avantage que ce soit ».
Democracy Now, 29 janvier 2025
Traduction et organisation du texte, Alexandra Cyr
Amy Goodman : (…) Jeudi, la Présidente du Mexique, Mme Claudia Sheinbaum, rejoindra d'autres leaders latinoaméricains.es à Teguicigalpa au Honduras. C'est une réunion d'urgence pour s'entendre sur la réponse à donner aux expulsions de masse et autres décisions du Président américain. Dans un de ses premiers décrets, il désigne les cartels mexicains « d'organisations terroristes » et poursuit en envoyant 1,500 soldats.es à la frontière avec le Mexique. Voici la réponse de Mme Sheinbaum à une question d'un.e journaliste à ce sujet.
Journaliste : Les cartels étant considérés comme des organisations terroristes, quelles mesures le Mexique va-t-il prendre dans de futurs cas comme celui-ci Mme la Présidente ?
Mme Sheinbaum : Nous combattons ces groupes criminels et ce que nous demandons, c'est de la collaboration et de la coordination. Les décisions unilatérales n'aident pas. La collaboration, oui. Nous procédons en ce moment à une analyse des implications pour diverses organisations non liées au crime pour qui par cette décision pourraient être confrontée à des problèmes économiques. Quoi qu'il en soit, nous voulons faire une proposition aux États-Unis avec qui nous devons travailler pour que nous puissions collaborer.
A.G. : En même temps, Mme Sheinbaum s'est moquée de la volonté du Président Trump de renommer le Golfe du Mexique, « Golfe de l'Amérique » tel qu'il l'a annoncé durant une récente conférence de presse. Elle s'est installé devant une carte datant de 1607 où la majorité de l'Amérique du nord est identifiée comme « Amérique mexicaine ».
Mme Sheinbaum : Les Nations unies ont reconnu le nom de « Golfe du Mexique ». Mais pourquoi ne pas adopter le terme Amérique mexicaine ? Ça a belle allure n'est-ce pas ? Depuis 1607, la Constitution de Apatzingan parlait d'Amérique mexicaine, donc, allons-y, utilisons ce vocable. Ça a belle allure n'est-ce pas ? Alors, le Golfe du Mexique se nomme ainsi depuis 1607 et il est aussi reconnu internationalement.
A.G. : Cette semaine, Google a annoncé qu'il renommerait le Golfe du Mexique, « Golfe d'Amérique » sur son moteur Google Map pour les utisateurs.rices américians.es.
Pour aller plus loin quant aux 100 jours de la Présidente mexicaine, Mme Sheibaum, nous rejoignons Edwin Ackerman, sociologue et professeur à l'Université de Syracuse. Il est l'auteur de « Origins of the Mass Parties : Dispossession and the Party-Form in Mexico and Bolivia.
Professeur Ackerman, soyez à nouveau le bienvenu sur Democracy Now. Pourquoi ne répondez-vous pas à ce que nous venons juste de diffuser ? Et donnez-nous vos commentaires sur les 100 premiers jours de la première Présidente du Mexique.
Edwin Ackerman : Merci beaucoup de votre invitation.
Je pense que ces 100 derniers jours ont été définis par une constante tension dans les négociations avec l'administration Trump ; nous pourrons en parler un peu plus. Mais je voudrais aussi souligner qu'intérieurement, ces 100 jours ont valu la peine publiquement au Mexique. Ils ont été marqués par une série de réformes constitutionnelles, environ une douzaine, au cours de ces trois mois. Il faut se rappeler que Mme Sheinbaum a été élue avec une forte majorité, soit les deux tiers dans les deux Chambres. C'est en quelque sorte un héritage de la popularité de son prédécesseur appelé familièrement AMLO. À titre personnel elle détient un niveau de popularité qui lui a permis de mettre de l'avant de très importantes réformes constitutionnelles qui vont des droits des autochtones, aux droits au logement et probablement le plus controversé portant sur la sécurité nationale. N'est-ce pas une très importante partie de ces 100 jours ?
Il y a aussi eu le dévoilement du très important plan économique de six ans qui devrait toucher plusieurs éléments de ce qu'on appelle, industrialisation pour substituer aux importations. C'est une sorte de politique qui a existé dans les pays d'Amérique latine durant les années 1950 jusqu'aux années 1970 approximativement et qui a donné une croissance économique significative en développant la production nationale pour remplacer les importations de façon stratégique.
Ceci dit, la violence des cartels continue. C'est clairement un enjeu de long terme. Elle n'a pas diminué d'aucune façon. On voit quelques signes de baisse dans le taux d'homicide mais par ailleurs, il y a des concentrations significatives de la violence, des poches notamment dans l'État de Sinaloa (qui se sont renforcées) au cours des trois derniers mois. La ville de Culiacan a été paralysée par la violence. Donc ça continue et c'est très sérieux.
Finalement, je veux mentionner les relations avec D. Trump qui a menacé (le Mexique) de droits de douane supplémentaires en lien avec le trafic et la production de Fentanyl au Mexique. Ou plutôt, présumément la production de Fentanyl dans le pays et encore la question de savoir comment gérer les expulsions, non seulement celle des citoyens.nes du Mexique mais encore plus difficile celle des non citoyens.nes qui arriveront sur le sol mexicain ; c'est un autre niveau de complications dans les négociations.
Juan Ganzalez (d.n.) : Professeur Ackerman je voulais vous demander si vous pourriez nous en dire plus sur les réformes qui ont été adoptées. (Mme Sheinbaum) profite de 80% d'appuis positifs par le public mexicain. Beaucoup qui n'ont pas voté pour elle la soutienne maintenant. Certaines de ces réformes comme la baisse de l'âge de la retraite pour les femmes de 65 ans à 60 ans. Quel est son argumentation à ce sujet ?
E.A. : D'accord. Il y a eu une série de réformes qui expliquent en partie sa popularité comme vous l'avez mentionné. En particulier celles qui visent les femmes. Elle a expliqué lors de ces conférences matinales que, pour des raisons historiques, ce sont les femmes qui ont toujours absorbé une part très importante des tâches domestiques sans salaire. Comme elle l'a souligné encore une fois, c'était ainsi pour des raisons historiques. Donc, pour elle c'est une raison de baisser leur âge d'accès à la retraite contrairement aux hommes.
J.G. : Et il y a eu des changements majeurs du côté des ressources naturelles du Mexique, par exemple pour ce qui est des bénéfices sociaux que les compagnies pétrolières et autres industries critiques devront appliquer. Pouvez-vous nous parler de cela aussi ?
E.A. : D'accord. Il y a eu d'importants changements dans le secteur de l'énergie ; le gouvernement en veut une part plus importante ou devenir un actionnaire plus important dans les marchés et recentrer son rôle. En examinant la liste des réformes vous voyez que c'est le thème dominant. Par exemple, dans un secteur un peu différent, celui du logement, une importante réforme est maintenant en place qui transforme l'existant fond national de crédit qui est là depuis des décennies, et lui donne maintenant l'obligation de mettre de ces crédits dans la construction de logements abordables. C'est faire de cette institution de fonds une agence active dans la construction avec le but de construire un million de nouveaux logements au cours des six prochaines années. L'État s'introduit directement dans l'enjeu du logement.
A.G. : Mme Sheinbaum est une scientifique du climat et elle est l'ancienne mairesse de Mexico. Pouvez-vous nous parler de ce que représente l'arrivée de D. Trump à la présidence et comment Mme Sheinbaum devrait répondre ? J. Trudeau est allé souper à Mar-a-Lago et il a dû démissionner. (…) Mme Sheinbaum n'a pas fait ça ni rien de semblable (…) même quand la menace d'augmentation des droits de douanes contre son pays (…) est arrivée (…) mais elle accepte le retour des migrants.es citoyens.nes du Mexique expulsés.es par avion.
E.A. : D'accord, c'est exact. Donc, je pense que le gouvernement mexicain a adopté une stratégie basée sur son expérience antérieure durant le premier mandat de D.Trump. Il faut se rappeler que AMLO était au pouvoir une partie du temps. Nous avons quelques archives, une sorte d'histoire de la manière de négocier avec D. Trump. Il semble que le gouvernement ait évalué que la diplomatie, une sorte de pensée diplomatique stratégique, valait mieux que les confrontations publiques pour atteindre des résultats. On a vu plusieurs exemples de ça durant le premier mandat Trump dans ses interactions avec AMLO. Il y a aussi eu des menaces d'augmentation des droits de douanes à cette époque. Plusieurs de ces mesures ont été neutralisées après avoir été brandies. Je pense que Mme Sheinbaum a été capable jusqu'à maintenant d'en faire autant.
Je pense que cela a à voir avec certaines choses. Premièrement, il faut se placer avant les années Trump. Il n'est pas exagéré de dire que, du point de vue mexicain à propos de beaucoup d'enjeux, il n'y a pas de différence entre les administrations démocrates ou républicaines. Si vous pensez à la construction du mur, elle a commencé sous une administration démocrate sous Clinton en 1994 et s'est poursuivie sous Obama. Donc, ce mur n'est pas le propre de D. Trump. Quant aux expulsions de masse, je ne doute pas que votre auditoire est bien au fait que durant les administrations Obama et Biden il y en a eu un nombre significatif encore plus important que durant le premier mandat de D. Trump. Et même les pressions pour que le Mexique prenne des mesures contre l'entrée de migrants.es de l'Amérique centrale aux États-Unis ont été exercées avant que D. Trump ne le fasse. Il y a donc une longue expérience de négociations ou de conversations évidemment très difficiles (entre ces deux pays) dans des conditions complètement inégales.
Ensuite, je veux dire aussi que l'administration mexicaine pense que cette histoire de droits de douanes est un bluff. Pas seulement parce que de telles menaces ont déjà existé sans rien donner de concret mais aussi parce qu'il y a des raisons structurelles pour que cette imposition n'aie pas lieu ; les États-Unis se tireraient dans le pied. Non seulement les prix pratiqués aux États-Unis augmenteraient et seraient refilés aux consommateurs.rices mais plus largement cet usage des droits de douanes est lié à un stade de développement du capitalisme qui n'existe plus. Le point de vue qui guide D. Trump prétend que vous pouvez propulser les capitalistes nationaux alors que nous sommes à l'âge de la globalisation du capital. Par exemple, vous imposez des droits de douane aux importations venant du Mexique, est-ce que l'on sait si ces produits ont été produit avec des capitaux mexicains plutôt qu'américains ou internationaux ? Donc, cela établit des limites à la politique des droits de douane.
J.G. : Professeur, je veux que nous continuions sur ce sujet parce que clairement, puisque le Mexique est le plus important partenaire commercial des États-Unis en ce moment, cette politique serait contreproductive pour le Mexique mais aussi pour de plus petits pays d'Amérique latine.
E.A. : C'est vrai.
J.G. : Je pense aux menaces d'augmentation des droits de douane contre la Colombie et contre le Panama que D. Trump prétend reprendre. Beaucoup ne savent pas que tout cela, mêmes ces menaces proférées sont en violation de la Charte de l'Organisation des États américains que les États-Unis ont contribué à fonder. Son art. 20 stipule : « Aucun État ne peut utiliser ou encourager l'utilisation de mesures coercitives de caractère économique ou politique en vue de contraindre la volonté d'un autre État pour en tirer quelque avantage que ce soit ». Croyez-vous que cette politique du Président Trump va renforcer l'opposition de l'Amérique latine contre les États-Unis ?
E.A. : Je le crois. On soupçonne que cela est en train d'arriver en ce moment. Il y a des discussions, des possibilités de réunions pour rafraîchir certaines tentatives de collaboration qui existaient déjà sous des formes institutionnelles. Cela a été particulièrement en marche durant ce qui a été une première vague dite « vague rose » qui a commencé au début des années 2000 quand une série de gouvernements progressistes sont arrivé au pouvoir sur tout le continent sud-américain. Certains de ces efforts ont ensuite été abandonnés ou mis de côté lorsque les formations de droite ont été élues dans ces pays. Mais une nouvelle vague rose arrive qui est partiellement intéressée et ce avant la prise du pouvoir par D. Trump, à créer des liens plus solides politiquement pour coordonner les réponses et économiquement pour une certaine intégration de leurs économies. On a beaucoup entendu parler de cela au cours des trois derniers mois.
A.G. : Je vous remercie Professeur Ackerman. (…) Dernière heure : La Présidente du Honduras, Mme. Xiomara Castro déclare qu'elle a annulé la réunion de mardi de la CELAC (Communauté des États latinos américains et caraïbéens) pour manque de consensus.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’ennemi numéro un du Mexique

Il n'y a pas de place pour l'erreur. Le président des États-Unis, Donald J. Trump, aujourd'hui pour la deuxième fois, n'est pas un simple homme dérangé qui laisse libre cours à ses caprices et à ses excentricités politiques. Au-delà de sa personnalité dure et abominable, il est, et a toujours été, un homme d'affaires qui, en tant que tel, vient à personnifier les tendances idéologiques et politiques qui ont pris racine dans un large secteur de la société américaine. Et c'est là que réside le danger.
https://rebelion.org/el-enemigo-numero-uno-de-mexico/
27 janvier 2025
Plusieurs éléments, même contradictoires, s'entremêlent dans cette idéologie : le classisme, le racisme, la xénophobie, le nationalisme exacerbé et agressif, la nostalgie d'une époque imaginaire où les États-Unis ont émergé en puissance, par conséquent un expansionnisme et un néocolonialisme ravivés qui nous renvoient plus au XIXe siècle ou au début du XXe qu'au XXIe. Par son homophobie et son suprémacisme WASP (blanc, anglo-saxon, protestant), entre autres.
L'idée centrale de Trump (au moins au niveau de la propagande), qui avait déjà pénétré un large secteur de la société américaine depuis sa campagne de 2016 mais encore plus dans cette campagne de 2024, est incarnée dans le slogan Make America great again (MEGA). On y voit l'attitude défensive face au déclin de la puissance américaine sur la scène planétaire et le monde multipolaire. Un déclin lent mais très perceptible. Les prévisions indiquent que d'ici quelques années, la Chine sera la première puissance mondiale dans l'ordre économique, technologique et peut-être militaire. Le groupe croissant des BRICS apparaît à ses côtés, qui vise à éliminer le dollar en tant que monnaie dominante dans le commerce et la finance au niveau international. La balance commerciale des États-Unis est déficitaire avec les principales nations dans les termes de l'échange : le Mexique, la Chine et le Canada. Malgré la tendance présumée à la relocalisation des entreprises, 59 milles nouvelles entreprises ont été créées en Chine en 2024 en tant qu'investissement direct étranger (IDE), ce qui impliquait une augmentation de 9,9% en glissement annuel (https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/01/18/economia/china-arribaron-59-mil-empresas-de-inversion-extranjera-en-2024-1306).
L'idéologie politique et sociale du trumpisme est alimentée centralement par le néoconservatisme qui a émergé dans la seconde moitié des années 1970 en réponse à la révolution culturelle et au virage à gauche du Parti démocrate après 1968, contre la guerre du Vietnam, dans les luttes pour les droits civils des minorités et la révolution sexuelle. La « révolution conservatrice » a été menée par des idéologues et des politiciens tels que Raymond Aaron, Patrick Moynihan, Daniel Bell, Newt Gringrich, Milton Friedman et d'autres, qui ont atteint le pouvoir politique avec l'arrivée de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis et l'accession de Margaret Thatcher comme première ministre de Grande-Bretagne. Ils ont postulé la réduction des impôts, la déréglementation des marchés et la contraction de l'État uniquement à ses fonctions minimales de sécurité nationale et de sécurité publique, au détriment des fonctions sociales telles que l'éducation, la santé et l'assistance aux pauvres.
La différence entre Trump et ceux qui l'entourent et leurs prédécesseurs dans les années 1980 et 1990 est qu'ils étaient libéraux en ce qui concerne le commerce. Trump a incorporé le protectionnisme comme expression du nationalisme extrême. Mais, comme pour eux, sa base est constituée par les secteurs religieux traditionnels et le conservatisme ancestral de la société américaine. À présent, il a également intégré les secteurs intermédiaires avec ses aspirations et les groupes qui se sentent menacés ou ont été touchés par l'ouverture du commerce aux fabricants asiatiques, beaucoup d'entre eux entrant par le Mexique par l'ancien ALENA, puis l'AEUMC, y compris le prolétariat des anciennes industries situées dans le nord du pays. Ajoutez à cela son aversion xénophobe pour les immigrants, chez qui il voit également une menace pour l'emploi blanc parce qu'ils acceptent des salaires plus bas et changent le profil démographique du pays.
Or ce Trump 2.0 ou « reloaded », comme il est traité dans la presse, propose un isolationnisme virtuel et un discours impérialiste qui réédite la politique américaine du XIXe siècle et du début du XXe. Dans son discours d'investiture, il a fait référence à la Loi sur les ennemis étrangers de 1798, à la Destinée manifeste et aux anciens présidents McKinley et Theodore Roosevelt, des protectionnistes qui, depuis la guerre avec l'Espagne décadente, ont étendu leurs domaines territoriaux à Porto Rico, aux Philippines et à Cuba. Il s'agit d'un revers idéologique d'au moins 150 ans, mais avec la puissance technologique et militaire supérieure que les États-Unis conservent encore aujourd'hui. Sur cette base, il propose de conquérir le Groenland, de récupérer le canal de Panama pour les États-Unis et même d'annexer le Canada en tant que nouvel État de l'Union américaine. Des objectifs que même l'impérialisme le plus extrême ne s'était pas fixés jusqu'à récemment, peut-être en pratique irréalisables pour des raisons que je n'exposerai pas ici.
Trump, un grand magnat de l'immobilier, bien qu'il ait eu quelques échecs dans ce domaine, n'arrive pas seul. Depuis sa campagne, et plus encore lorsqu'il a triomphé aux élections de novembre, il a intégré plusieurs des hommes les plus riches des États-Unis et du monde. Elon Musk, le plus haut représentant de l'oligarchie technologique, se distingue comme un proche conseiller et promoteur de l'actuel président, et nouveau fonctionnaire en charge du département de l'efficacité du gouvernement, également nouvellement créé. Entre autres tâches, il cherchera à moderniser les instruments de gestion pour la collecte des tarifs que le président a l'intention de facturer, et à appliquer une « austérité franciscaine » pour réduire les dépenses et réduire l'énorme déficit budgétaire dont il a hérité. Avec Trump, l'oligarchie pétrolière arrive à la Maison-Blanche, détruisant des projets d'économie verte et des sources d'énergie propre, cherchant à augmenter considérablement la production de pétrole brut et de ses dérivés et proposant de revitaliser l'industrie nationale de l'essence, aujourd'hui menacée par des unités d'origine asiatique.
L'intégration de ces personnages, devenant à la fois grands hommes d'affaires et fonctionnaires de l'État, soulève à nouveau le vieux débat parmi les marxistes sur l'État : la classe capitaliste a-t-elle tendance à occuper directement la direction des institutions de l'État ou à déléguer cette fonction aux professionnels de l'administration publique, une bureaucratie d'État comme celle proposée par Max Weber ?
L'administration Trump est consciente de la détérioration et du déclin de son pays dans le contexte mondial et cherche à l'inverser en peu de temps avec des mesures radicales qui nichent dans l'imaginaire collectif d'une grande partie de la société américaine : retrouver son rôle non seulement hégémonique mais dominant dans le contexte mondial. Il parle ainsi, de manière populiste, d'une « révolution du bon sens » et d'un nouvel « âge d'or » du pouvoir américain.
Quant au Mexique, Trump a depuis longtemps ouvert ses cartes. Les points de pression sur le gouvernement récemment installé de Claudia Sheinbaum sont connus : la menace d'imposer des droits de douane en dehors de l'AEUMC et maintenant la demande de le revoir avant 2026 ; la déclaration déjà exécutée de considérer les cartels de drogue comme des gangs terroristes, ce qui ouvre la porte à une plus grande ingérence, même territoriale, dans notre pays ; la fermeture de la frontière avec le Mexique pour prévenir l'immigration illégale et lutter contre le trafic de drogues, en particulier le fentanyl ; la transformation une nouvelle fois du Mexique – comme il l'a fait en juin 2019 – en un tiers pays sûr pour retenir les migrants d'autres pays ici et expulser ceux qui se trouvent déjà sur le territoire américain ; la reprise de la construction du mur frontalier suspendu par l'administration de Joe Biden ; pour expulser des centaines de milliers de travailleurs mexicains (qui, selon les estimations, pourraient atteindre cinq millions) qui sont sans documents d'immigration aux États-Unis.
Le nouveau président yankee est donc présenté comme la plus grande menace et le plus grand ennemi du Mexique en ce moment. Son argument essentiel s'appelle la force. Il peut ainsi contourner les lois et les traités (tels que l'AEUMC et les conventions sur les droits de l'homme), intervenir dans d'autres territoires, violer les droits des travailleurs immigrés et menacer d'autres pays à la convenance de l'oligarchie financière qui a directement pris le pouvoir politico-militaire de ce qui est encore la plus grande puissance mondiale. La guerre tarifaire entre les États-Unis et le Mexique, si elle était déclenchée, tuerait dans le berceau le soi-disant Plan Mexique, qui tente d'attirer des investissements industriels et de services en tirant parti de l'avantage comparatif que l'AEUMC donne à notre pays, et même les entreprises du secteur automobile déjà établies sur notre territoire pourraient émigrer.
Et Trump trouve notre pays dans des conditions de grande vulnérabilité. Avec un déficit budgétaire historique de 5,9% du PIB hérité du gouvernement de López Obrador et que Claudia Sheinbaum doit de toute urgence réduire (c'est-à-dire sans marge pour augmenter les dépenses sociales en faveur des personnes expulsées massivement) ; avec une dette publique qui atteint un niveau record, de 16 billions de pesos ; avec une faible croissance économique prévue à 1,2% par la CEPALC pour 2025, la plus faible du continent américain ; avec près de 80% de notre commerce extérieur qui dépend des États-Unis ; avec l'intention de relocaliser l'industrie et les services en suspens, en raison des doutes que la réforme judiciaire et la disparition des organismes autonomes suscitent quant à la sécurité juridique dans le pays, et en raison des problèmes de sécurité publique eux-mêmes ; avec la dépendance croissante de la balance des paiements mexicaine à l'égard des envois de fonds du nord ; avec des réductions budgétaires pour le service consulaire, qui aurait entre ses mains la responsabilité de défendre les Mexicains menacés d'expulsion ; et sans avoir conclu le remplacement à l'Institut national des migrations, toujours en charge de l'infortuné Francisco Garduño et aussi avec un budget insuffisant, le Mexique sera, une fois de plus, le troisième pays sûr dont Trump a besoin pour plaire à ses électeurs anti-immigrants.
De plus, déjà en 2019, Trump a soumis le gouvernement mexicain en le forçant, sous la menace d'augmenter les droits de douane, qu'il répète maintenant, à recevoir des immigrants sans papiers de toutes nationalités expulsés par les États-Unis et à fermer les frontières nord et sud en utilisant l'armée et la Garde nationale, donnant un virage radical à la politique d'immigration que López Obrador avait initialement proposée. Quelque temps plus tard, Trump se moquait de cet épisode tragique pour des myriades de travailleurs migrants et leurs familles et pour le pays, racontant comment il a mis à genoux le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Marcelo Ebrard. « Je n'ai jamais vu quelqu'un plier comme ça », a-t-il déclaré lors d'un rassemblement avec des supporters dans l'Ohio en 2022.
Pendant des décennies, le Mexique a fondé ses relations étrangères presque exclusivement sur le Nord. L'ALENA et l'AEUMC sont l'expression de cette politique préférentielle ou obligatoire, tout comme la coopération militaire des gouvernements récents, y compris ceux d'Andrés Manuel López Obrador et de Claudia Sheinbaum Pardo. Cela est corroboré par d'autres formes de dépendance : financière, technologique, monétaire (en raison de l'afflux croissant d'envois de fonds qui contribuent aux réserves nationales et à la stabilité du peso).
Aujourd'hui, le Nord menace de se retourner contre le Mexique, et nos liens avec le Sud et les autres blocs internationaux sont trop faibles pour y trouver suffisamment de soutien pour résister. La solitude du pays dans le nouveau contexte géopolitique qui devrait être menaçant semble être la destination de l'ère Trump 2.0 qu'on inaugure.
Il est vrai que la politique agressive du trumpisme dans les différents ordres fait face à de nombreux inconvénients pour son propre pays, tels que la pression au niveau des salaires due aux pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, et ils trouveront des formes de résistance - ils les trouvent déjà - à la fois au pays et à l'étranger. Pourtant, c'est une menace qui tend maintenant à être établie à long terme pour le Mexique, un pays pour lequel la croissance a été construite sur une dépendance négociée dont les règles ont maintenant changé.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Brésil : « Le gouvernement a célébré l’accord Mercosur-Union européenne »

Bientôt deux ans après le retour de Lula au pouvoir, Israel Dutra, membre de la direction du MES (Movimiento Esquerda Socialista) et du PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) du Brésil, dresse pour nous un tableau de la situation sociale et politique.
16 janvier 2025 | Hebdo L'Anticapitaliste - 737
Peux-tu établir un bilan des dernières élections municipales au Brésil fin 2024, et en particulier des résultats de la gauche ?
Le résultat des élections municipales d'octobre a renforcé la formation des forces dites du « centrão » qui en réalité n'est pas un courant de centre, mais un secteur de droite qui s'allie tantôt avec le gouvernement, tantôt avec l'opposition plus conservatrice...
Quatre éléments principaux peuvent être mis en évidence :
∙ Une forte tendance à réélire les maires en place, en raison des manipulations de fonds publics, fonds électoraux, investissements publics et autres avantages concentrés dans les mains de ceux qui sont déjà au gouvernement municipal ;
∙ Une grande apathie du mouvement de masse, accrue par l'abstention et le nombre de votes blancs et nuls ; il n'y a pas eu de grands événements ou de rassemblements de masse au cours de la période électorale. Le poids du financement public (un fonds d'un milliard de dollars pour tous les partis) a également provoqué une distorsion entre le grand nombre de personnes payées par les grands partis pour faire la campagne et la majorité militante des autres, réduisant l'espace pour le travail bénévole et l'action spontanée ;
∙ Au sein de la droite et de l'extrême droite, le résultat a été plus contradictoire. Alors que l'extrême droite a gagné des positions, avec des postes de maires et de conseillers municipaux, Bolsonaro a été davantage remis en question en tant que leader, alors que de nouveaux secteurs de droite ont émergé régionalement. Le renforcement des partis liés au « centrão », tels que le MDB (Movimiento democratico brasileno) et le PSD (Partido social democratico), témoigne de cette tendance ;
∙ La gauche en général et particulièrement le PT (Partido dos trabalhadores) et le PSOL lorsqu'il était allié au PT a été affaiblie comme cela a été le cas à Sao Paulo et à Belem (où le PSOL a perdu la mairie).
Malgré tout, le PSOL garde un poids significatif, remportant d'importantes victoires électorales, conservant et même augmentant son nombre de conseillerEs dans les principales capitales. L'élection de Porto Alegre — où le PSOL a remporté un siège, même si le candidat du PT a perdu au second tour — est un exemple.
Qu'en est-il de la campagne visant à envoyer Bolsonaro en prison après la publication du rapport de la police fédérale sur la tentative de coup d'État du 8 janvier 2023 ?
Après les élections, la situation nationale a connu des changements majeurs. Outre l'entrée en scène des jeunes secteurs du prolétariat (dont nous parlerons plus loin), Bolsonaro et ses pairs ont vu leur situation se compliquer fortement avec la révélation de plans de coup d'État incluant l'assassinat de Lula, du vice-président Alckmin et du ministre de la Cour suprême, Alexandre de Moraes. La violence et l'improvisation de ces plans, qui ont été révélés par la police fédérale, accusant 37 personnes, dont Bolsonaro, ont suscité une grande indignation au sein de la population. Malheureusement, il n'y a pas eu de grandes mobilisations pour cette campagne. Nous avons plaidé pour l'arrestation immédiate de Bolsonaro et de tous les auteurs du coup d'État, ce qui inclut des dirigeants politiques, des militants et même des chefs d'entreprise.
Quelles sont les grandes luttes du moment ? Vous pouvez notamment parler de la « VAT », la grève de Pepsico et la lutte contre le « 6 × 1 » ?
Les « bonnes nouvelles » viennent des lieux de travail. Un mouvement s'est formé contre le régime 6 × 1 (6 jours travaillés, 1 jour de repos) — qui est le temps de travail actuel dans la plupart des cas — exigeant une réduction de la semaine de travail. Ce mouvement a été organisé et centralisé par un mouvement national appelé « VAT » (Vida Além do Trabalho, « La vie au-delà du travail ») dont le principal dirigeant est Rick Azevedo, le conseiller PSOL le mieux élu à Rio de Janeiro. Un rassemblement national a été organisé le 15 novembre et a réuni des milliers de personnes, en particulier des jeunes, dans les rues afin de faire pression pour que le projet de loi sur la réduction du temps de travail soit adopté par le Parlement. La pétition en ligne a recueilli plus de 3 millions de signatures.
Parallèlement, les salariéEs de la multinationale Pepsico (Pepsicola) ont mené une grève de grande ampleur pendant neuf jours, donnant ainsi un retentissement national à la lutte contre le régime 6 × 1. Cette grève a été exemplaire, car bien qu'elle n'ait pas obtenu de résultats significatifs — seulement des victoires sur une partie des revendications initiales — elle a mis à l'ordre du jour la lutte pour la réduction de la journée de travail.
Qu'en est-il des autres mouvements sociaux, des sans-terre, des sans-abri ?
Nous sommes dans une période de grand reflux des mouvements sociaux, avec de nombreux secteurs sur la défensive. Il y a de grandes revendications, motivées par les inégalités dans le pays. Le MST (Mouvement des Sans-Terre) a adopté un ton plus critique à l'égard des mesures gouvernementales, tant en ce qui concerne la réforme agraire que les questions environnementales. C'est justifié, car on a de plus en plus l'impression que les choix du gouvernement fédéral en matière d'agenda économique sont une continuation de l'ajustement [du FMI], comme le paquet que le ministère des Finances veut approuver, qui comprend des coupes budgétaires dans plusieurs domaines sociaux. C'est absurde et nous faisons campagne contre ces coupes.
D'autre part, le mouvement environnemental commence à organiser sa mobilisation pour une année décisive, puisqu'en 2025 nous aurons la COP30 au Brésil, au cœur de l'Amazonie. Et les mouvements sociaux organiseront un vaste programme parallèle de mobilisation et de débats.
Quelles sont les mesures d'austérité budgétaire du ministre Haddad ? Qui s'y oppose et propose de les combattre ?
La proposition du ministre des Finances, Haddad, est accueillie avec euphorie par la fédération des banquiers (Febraban). Elle consiste à suivre le prétendu « plafond de dépenses », qui a été configuré par le prétendu « nouveau cadre fiscal », qui n'est rien d'autre qu'un modèle qui évite les dépenses publiques afin de continuer à payer les titres de la dette.
Le résultat concret est de réduire les prestations pour les plus pauvres (les personnes ayant besoin d'une assistance sociale) et de geler les salaires des fonctionnaires, ainsi que de réduire la croissance du salaire minimum pendant quelques années.
Il y a quatre semaines, nous avons lancé, avec des dirigeantEs politiques, des intellectuelLEs et des leaders sociaux, un manifeste contre ce train de mesures, qui n'a cessé de gagner en force et en soutien. Pour sortir de la crise budgétaire, il faudrait taxer les plus riches, lutter contre les privilèges, s'attaquer aux profits abusifs des banques et rouvrir le débat sur la dette publique.
Quelles sont les réactions à propos de l'accord Mercosur-Union européenne ?
Le Brésil a un poids fondamental dans une série d'accords politiques internationaux ayant un impact géopolitique. La position de Lula, par exemple sur la Palestine, dénonçant ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie comme un génocide, était correcte et importante.
Récemment, nous avons eu des réunions comme celle du G20 au Brésil. L'année prochaine, la COP30 se tiendra en Amazonie. C'est dans ce cadre que l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur a été annoncé, sous les vives protestations de pays comme la France.
Le gouvernement a célébré l'accord Mercosur-Union européenne comme une victoire, mais les mouvements sociaux émettent de fortes réserves. En particulier au sein du MST et de la Via Campesina, selon leurs dirigeants cela conduirait à une recolonisation européenne des pays du Mercosur. Il en résulterait un renforcement du modèle historique, oppressif et prédateur de la monoculture agro-exportatrice. Il s'agirait d'une étape dans la « reprimarisation » fondée sur quatre secteurs économiques majeurs : les produits agricoles, les minéraux, le bétail et la cellulose. La question des droits de douane par rapport aux secteurs industriels nationaux suscite des inquiétudes.
Propos recueillis par la Commission Amérique latine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Des climatosceptiques étasuniens ont infiltré le Parlement européen

Venu des États-Unis, un groupe de réflexion d'extrême droite et climatosceptique œuvre à démanteler les lois environnementales de l'Europe. Et ce, avec l'aide de députés européens.
Tiré de Reporterre. Légende de la photo : Le Heartland Institute transmet ses idées climatosceptiques au parlement européen. Wikimedia commons/ CC BY-SA 3.0/Diliff
La vague climatosceptique étasunienne est-elle en train de déferler sur l'Union européenne ? C'est la question que soulève une enquête du journal britannique The Guardian. Celui-ci a révélé le 22 janvier qu'un groupe de réflexion climatosceptique étasunien œuvrait, avec l'aide d'eurodéputés d'extrême droite, à démanteler les réglementations environnementales européennes.
Nommé le Heartland Institute, ce groupe d'influence a eu de nombreuses positions climatosceptiques. « [Il] a des liens avec l'administration Trump et a bénéficié de financements de la part d'entreprises comme ExxonMobil et de riches donateurs républicains américains », indique The Guardian. D'après le journal, les relations ont été établies il y a deux ans avec deux eurodéputés autrichiens du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ), groupe d'extrême droite et antimigration.
Ils ont permis au président du Heartland Institute, James Taylor, d'être accueilli au Parlement européen. Là, il a notamment pu rencontrer « des hommes politiques hongrois pour discuter de la politique climatique et de la loi sur la restauration de la nature [visant à stopper l'effondrement de la biodiversité] », poursuit l'article. Cela a pu avoir des conséquences sur la position de la Hongrie : « Plus tard dans le mois, le vote de la loi a été retardé lorsque la Hongrie a retiré son soutien, mais le projet de loi a finalement été adopté. »
« Un négationnisme climatique décomplexé »
Cette ingérence « n'est pas une surprise », réagit auprès de Reporterre l'eurodéputée La France insoumise Manon Aubry. « On observe déjà des groupes d'influence d'extrême droite œuvrer par exemple sur la question de l'avortement. Cela s'étend à l'écologie. »
Ce cas est révélateur de la rapidité avec laquelle l'extrême droite climatosceptique est arrivée à percer au sein des institutions européennes. L'Institut Heartland profite « d'une période où le sentiment anticlimat de la droite augmente fortement », estime The Guardian. « Nous craignons de voir renaître un négationnisme climatique décomplexé », a réagi Kenneth Haar, du Corporate Europe Observatory, auprès du quotidien.
Depuis les élections de juin dernier, ayant abouti à un nouveau Parlement européen plus à droite, le terrain de jeu est encore plus favorable. « Au fur et à mesure que le nombre de députés d'extrême droite grandit, que la quantité d'États d'extrême droite augmente, le nombre de leurs relais aussi, constate Manon Aubry. Et leur impact sera plus grand du fait de la victoire de Trump. Ils pourront mettre la pression en disant : “Dérégulez ou l'on vous met des droits de douane.” »
Des effets déjà visibles
Pour l'eurodéputée, l'effet de cette offensive de dérégulation est déjà visible au niveau de la Commission européenne : « Les premiers textes qu'elle a proposés — le paquet dit “Omnibus” — visent à déréguler les normes écologiques et sociales sur les entreprises [1]. Elles venaient pourtant d'être adoptées sous le mandat précédent. Cette influence sur la Commission européenne et le Conseil européen, c'est nouveau. Avant, elle se limitait à quelques députés. »
Au niveau du Parlement européen, tout dépendra de l'attitude de la droite. « L'Institut Heartland est susceptible de devenir l'un de ceux qui aideront à créer une alliance politique étroite entre les conservateurs et l'extrême droite qui sera très destructrice » pour le climat, s'inquiétait auprès du Guardian Kenneth Haar, du Corporate Europe Observatory.
« Ensemble, droite et extrême droite ont la majorité, confirme Manon Aubry. Et le cordon sanitaire se défait à vitesse grand V. L'extrême droite a de plus en plus de responsabilités, la charge de plus en plus de rapports. Ils ont compris qu'ils pouvaient gagner. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’agence de Musk le nomme chef du gouvernement

Je pense depuis longtemps que les médias américains seraient plus lucides sur l'ascension et le retour de Donald Trump si cela se passait à l'étranger, dans un pays étranger, où nous sommes habitués à ce que les correspondants étrangers écrivent avec une autorité plus incisive. Ayant suivi avec une inquiétude croissante les développements des dernières 24 et 36 heures à Washington, j'ai pensé tenter une telle dépêche. Voici une histoire qui devrait être écrite ce week-end :
La junte de Musk saisit des bureaux gouvernementaux clés
WASHINGTON, D.C. - Ce qui a commencé jeudi comme une purge politique des services de sécurité intérieure s'est transformé vendredi en un véritable coup d'État. Les unités techniques d'élite alignées sur l'oligarque des médias Elon Musk se sont emparées des systèmes clés du Trésor national bloquant l'accès extérieur aux dossiers du personnel fédéral et mettant hors ligne les réseaux de communication du gouvernement.
1 février 2025 | tiré de Doomsday Scenario
https://www.doomsdayscenario.co/p/musk-s-junta-establishes-him-as-head-of-government?fbclid=IwY2xjawIN-ylleHRuA2FlbQIxMQABHaS3YaDqfWqR-4kpGdSBep4riPlDT37lpGE0rq6ahq2YmR5RHkUVD1OtPA_aem_El8ovcsvVVzd1yQNPFZIQQ
Avec une rapidité qui a stupéfié même les observateurs politiques de longue date, les forces loyales à la junte de Musk l'ont installé au poste de chef du gouvernement non élu et pratiquement incontesté en quelques jours seulement, mettant à mal le système constitutionnel de cette démocratie de longue date et sa fière tradition d'État de droit vieille de près de 250 ans. Après s'être installées dans des ministères clés ainsi que dans un bâtiment adjacent au complexe présidentiel, les forces de M. Musk ont commencé à émettre des directives à l'intention des fonctionnaires et à forcer la démission d'agents jugés insuffisamment loyaux, comme le chef de l'autorité aéronautique du pays.
Le nouveau président de ce pays du G7, un oligarque de niveau intermédiaire nommé Donald Trump, est apparu, au milieu des mesures prises par Musk, comme étant de plus en plus un simple chef d'État en figure de proue. Trump est un criminel condamné qui a un long passé de corruption. Il est revenu au pouvoir à la fin du mois de janvier après un intermède de quatre ans au cours duquel il a promis des châtiments et des représailles contre les opposants étrangers et l'« État profond » national. Il a été accusé d'avoir tenté de renverser la transition pacifique du pouvoir qui l'avait destitué en 2021, mais des éléments loyalistes du système judiciaire ont réussi à bloquer ses poursuites et son incarcération, facilitant ainsi son retour au pouvoir.
Au cours des deux dernières semaines, les factions présidentielles loyalistes et les équipes soutenues par Musk ont lancé de vastes purges illégales, dignes de Staline, au sein des forces de police nationales et des procureurs, ainsi que des bureaux connus sous le nom d'inspecteurs généraux, qui sont généralement chargés d'enquêter sur la corruption du gouvernement. Alors que les chiffres officiels de ces évictions sans précédent ont été tenus secrets, des rumeurs ont circulé dans la capitale selon lesquelles le nombre de fonctionnaires de carrière touchés par les premières purges pourrait s'élever à plusieurs milliers, les commissaires politiques continuant d'évaluer les antécédents des membres des forces de police.
Le président vieillissant et mentalement affaibli, qui adhère depuis longtemps à la pensée conspirationniste, a passé une grande partie de la semaine à tenir des propos étranges sur les minorités raciales et ethniques opprimées du pays, qu'il a accusées sans preuve d'être à l'origine d'un accident d'avion mortel survenu de l'autre côté de la rivière, en face de la résidence présidentielle. Les attaques infondées et racistes contre ces minorités ont été l'un des principaux fondements de l'ascension imprévue de Trump dans le monde politique, après une carrière de magnat de l'immobilier et d'animateur de télé-réalité. Elles remontent à sa première annonce de candidature à la présidence en 2015, lorsqu'il a exprimé son indignation face à l'envoi de « violeurs » dans le pays par son voisin du sud.
Dès son retour à la présidence, il a mobilisé les forces de sécurité paramilitaires d'extrême droite pour mener des descentes dans les églises, les écoles et les lieux de travail, afin d'identifier et d'expulser les minorités raciales, y compris celles qui vivaient depuis longtemps en harmonie avec la majorité chrétienne blanche du pays. Il a également immédiatement fait libérer de prison quelque 1 500 partisans qui avaient participé à son insurrection ratée de 2021, dont des membres de milices violentes d'extrême droite lui ayant juré allégeance dès leur libération, en cas de troubles civils futurs. Par ailleurs, alors même qu'il relâchait des criminels violents dans les rues, M. Trump a retiré par décret la protection de sécurité gouvernementale accordée depuis longtemps à d'anciens militaires et responsables de la santé qu'il accuse de l'avoir trahi.
Soulignant son apparente déconnexion de la réalité, des informations ont fait surface selon lesquelles le président avait ordonné aux forces militaires de provoquer une catastrophe environnementale et d'inonder des régions d'une province séparatiste connue sous le nom de Californie et dirigée par un opposant politique très en vue. Cette décision met en lumière la façon dont l'armée, qui avait résisté aux prises de pouvoir inconstitutionnelles de Trump lors de sa première administration, est maintenant dirigée par un ministre de la Défense soumis, une personnalité favorisée de la télévision, inexpérimenté et confronté à une série d'allégations embarrassantes concernant son comportement en état d'ébriété sur le lieu de travail.
Les alliés étrangers, qui se sont longtemps alignés sur les États-Unis sur la scène internationale, ont été déstabilisés par la rhétorique nationaliste et impérialiste de plus en plus inquiétante provenant des comptes de médias sociaux du président, en grande partie postés sur un réseau détenu et géré par Trump lui-même, et se sont inquiétés. Lors de conversations privées dans les ambassades de la capitale, ils ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que le président mobilise l'armée pour réaliser des ambitions territoriales jusqu'ici inimaginables, notamment s'emparer de leur voisin du nord, qui partage la plus longue frontière non défendue du monde, et potentiellement coloniser le Panama et le Groenland.
Le ministre de la Défense du pays, qui a déjà déclaré qu'il ne pensait pas que les femmes devraient être autorisées à servir dans des rôles de combat, et le nouveau ministre de l'Intérieur de Trump, qui est apparu à la télévision nationale portant l'uniforme paramilitaire de la force de sécurité frontalière au cœur de l'ascension politique de Trump, ont passé une grande partie de leurs premiers jours à faire écho et à amplifier l'hystérie du président au sujet des minorités raciales et ethniques. Ces fonctionnaires et d'autres représentants du gouvernement ont également annulé immédiatement toutes les célébrations officielles des fêtes religieuses et des fêtes des minorités ethniques, et ont cherché à effacer les sites web officiels, ainsi que tout enseignement de la longue histoire de ces minorités dont le pays peut être fier, aux travailleurs comme aux écoliers. Dans la nuit de vendredi à samedi, quelques heures après le départ des journalistes, le cabinet du ministre de la Défense a annoncé qu'il interdirait aux médias indépendants de l'establishment de travailler dans les quartiers généraux militaires du pays et qu'il les remplacerait par des organes de presse proches de la droite.
Le ministre de la Propagande de l'administration a également annoncé vendredi, apparemment sans grande préparation, qu'il allait déclencher une guerre commerciale immédiate, inattendue et apparemment irréfléchie avec les deux principaux partenaires économiques du pays. Une mesure qui, si elle était mise en œuvre, bouleverserait l'économie nationale, perturberait les chaînes d'approvisionnement et accélérerait le retour d'une crise inflationniste qui a ébranlé la politique intérieure au cours des cinq dernières années et qui semblait tout juste revenir à la normale. Ironiquement, c'est cette même crise inflationniste et les promesses de Trump de baisser le prix des œufs lors de sa campagne électorale qui ont ouvert la voie à sa victoire électorale imprévue en novembre.
Les autres oligarques du pays ont observé avec inquiétude l'ascension inattendue et rapide de Musk au pouvoir, ainsi que la concurrence entre les grandes entreprises de médias et de technologie qui sont en lien avec l'empire commercial de Musk (comme Meta, Amazon, Disney, Paramount, Apple et OpenAI). Ces entreprises ont rapidement négocié et payé des pots-de-vin au président pour permettre la poursuite de leurs activités sans entrave. Les conditions initiales de paiement allaient de cadeaux d'un million de dollars pour l'inauguration présidentielle à des paiements de 15 et 25 millions de dollars de la part de Disney et Meta pour financer la construction d'un sanctuaire présidentiel. Le paiement le plus élevé jamais enregistré est celui de 40 millions de dollars effectué par Amazon, qui a été organisé comme un cadeau pour l'épouse du président en échange de la possibilité pour l'entreprise de médias de tourner un biopic hagiographique.
On ignore également les termes précis de l'accord qui ont permis ces pots-de-vin et paiements, ainsi que la date à laquelle les paiements ultérieurs sont attendus. Cependant, Trump a décidé de licencier et d'affaiblir les organismes de surveillance du gouvernement qui ont longtemps gêné l'élite financière du pays, ce samedi.
Tout au long de la semaine de prise de pouvoir, qui s'est déroulée à un rythme effréné et semble de plus en plus irréversible d'heure en heure, ni les leaders parlementaires loyalistes ni ceux de l'opposition n'ont soulevé d'objection significative à l'encontre du nouveau régime ou du démantèlement du système constitutionnel d'équilibre des pouvoirs du pays. Quelques membres du corps législatif gériatrique ont publié des messages épars sur les réseaux sociaux pour condamner la décision, mais le Parlement, dont les deux chambres sont contrôlées par des membres dits « MAGA » triés sur le volet pour leur loyauté envers le président, est rentré chez lui plus tôt que prévu pour le week-end, alors que les forces de Musk se répandaient dans les rues de la capitale.
Le rôle éventuel que les forces de Musk permettraient au Parlement de jouer dans la nouvelle structure gouvernementale n'était pas clair au moment de son retour à l'Assemblée nationale, connue sous le nom de Capitole.
Notes
1. Églises écoles et lieux de travail : Les agents chargés de l'application des lois sur l'immigration pourront désormais arrêter des migrants dans des lieux sensibles comme les écoles et les églises, après que l'administration Trump a rejeté les politiques limitant les endroits où ces arrestations pourraient avoir lieu, alors que le nouveau président cherche à tenir ses promesses de campagne de procéder à des expulsions massives. La mesure annoncée mardi annule les directives qui, depuis plus d'une décennie, empêchent deux agences fédérales clés de l'immigration - l'Immigration and Customs Enforcement et le Customs and Border Protection - de mener des opérations de contrôle de l'immigration dans des endroits sensibles.
2. La vengeance de Trump contre Milley envoie un signal inquiétant aux hauts gradés de l'armée. Le général Mark A. Milley a été chef d'état-major des armées des États-Unis de 2019 à 2023.
Cette semaine, le président Trump a révoqué le dispositif de sécurité du général à la retraite Mark Milley et a annoncé une enquête sur la conduite de l'ancien chef d'état-major interarmées, mettant en œuvre les représailles promises tout en envoyant un message effrayant aux hauts gradés de l'armée.
Trump, qui a également révoqué l'habilitation de sécurité de Milley dans des ordres adressés au secrétaire à la Défense Pete Hegseth, est depuis longtemps en conflit avec Milley, qui s'est exprimé ouvertement contre le président dans des livres et des commentaires publics.
Richard Kohn, professeur émérite à l'Université de Caroline du Nord et expert des relations civilo-militaires, a déclaré que la décision de Trump découragerait les officiers supérieurs de faire leur travail et de conseiller honnêtement le président, notant qu'un ancien chef d'état-major interarmées n'a jamais vu ses détails de sécurité révoqués auparavant.
3. Amazon. Quelques jours avant l'élection de novembre, Bezos est intervenu pour empêcher le Washington Post, dont il avait fait l'acquisition en 2013, de soutenir la vice-présidente Kamala Harris. « Les soutiens présidentiels ne font rien pour faire pencher la balance d'une élection », a écrit Bezos dans un éditorial expliquant sa décision. « En réalité, les soutiens présidentiels créent une impression de partialité. Une impression de non-indépendance. Y mettre fin est une décision de principe, et c'est la bonne. »
Le milliardaire a également insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune contrepartie dans sa décision.
Les employés du journal étaient furieux et des dizaines de lecteurs ont annulé leur abonnement en signe de protestation. Au cours des mois qui ont suivi, une série de rédacteurs et d'écrivains de renom ont quitté le Post ou ont démissionné de son comité de rédaction. Plus tôt cette semaine, la dessinatrice Ann Telnaes, lauréate du prix Pulitzer, a démissionné du journal après que le Post a supprimé son dessin représentant Bezos et d'autres personnalités de la Silicon Valley rendant hommage à une statue de Trump.
Traduction avec le logiciel DeepL
et André Frappier
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Merci Trump !

Dans le drame du triangle Groenland-Danemark-États-Unis, Trump devrait être remercié. D'une part, parce que ce drame montre à quel point la relation entre le Danemark et le Groenland sous la forme du royaume danois est dépassée et offre une chance de changer cette relation, et d'autre part, parce qu'une perception réaliste du rôle du Danemark dans le monde en tant que petit État doit enfin se matérialiser.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/01/29/groenland-des-inuits-a-dedommager/
L'illustration est tirée de l'article de Wikipédia intituléExercice Strikeback.
Le problème en tant qu'équation de pouvoir
La raison ?
La crainte que l'indépendance du Groenland ne crée un vide de pouvoir dans l'Arctique que la Russie et la Chine combleront militairement et en termes d'accès aux minerais stratégiques.
Qui ?
Les déclarations de Trump sont avant tout un message adressé à Moscou et à Pékin, puis à Copenhague et à Nuuk.
Résultats attendus :
Expansion de la présence militaire et civile américaine au Groenland et augmentation des contacts directs en dehors de Copenhague entre les deux pays.
Résultats souhaitables :
Construction d'une véritable communauté d'égaux, le Groenland et les îles Féroé ayant nettement plus d'influence sur la défense, la sécurité et les affaires étrangères qui concernent les deux pays.
Les récentes déclarations de Trump sur la possibilité d'utiliser des moyens militaires ou économiques pour prendre le contrôle du Groenland parce que la propriété du pays est cruciale pour la sécurité militaire et économique des États-Unis ont déclenché l'une des plus grandes tempêtes politiques de ces derniers temps au Danemark et au Groenland, un véritable choc pour un petit État qui a presque toujours fait volontiers ce que disait le grand frère. Bien que l'on ne sache jamais ce que Trump veut dire – l'une de ses principales astuces politiques, qu'il partage ironiquement avec Poutine, consiste à créer de l'incertitude – cet événement représente l'une des crises les plus graves dans les relations entre le Danemark et les États-Unis au niveau gouvernemental, malgré la tentative de Lars Løkke de lutter contre les incendies : « Je n'ai pas l'impression que nous soyons dans une crise de politique étrangère ». Mais il faut y voir une réaction traditionnelle du ministère des affaires étrangères lorsque les choses s'échauffent vraiment. Et après l'investiture de Trump, le sifflet a pris une autre tournure.
Le vice-président J.D. Vance, dans une interview accordéeà Fox News Sunday avant son investiture, n'a rien fait pour minimiser le conflit : « Nous n'avons pas besoin d'utiliser la force militaire. Ce que les gens oublient toujours, c'est que nous avons déjà des troupes au Groenland. Le Groenland est stratégiquement très important pour l'Amérique », soulignant que les États-Unis pourraient utiliser la force militaire s'ils le souhaitaient. Le fait qu'il n'y ait pas de crise est directement contredit par le fait que, en réponse à la question explicitede Mette Frederiksen, Trump ne rejettera pas les droits de douane sur les exportations danoises vers les États-Unis. Elle ne dira pas non plus après sa conversation avec Trump et la réunion au sein de la commission de la politique étrangère :
« Il a été suggéré par les États-Unis qu'il pourrait malheureusement se produire une situation dans laquelle nous travaillerions moins ensemble qu'aujourd'hui dans le domaine économique. »
La raison, bien sûr, est qu'en tant que Première ministre, elle veut avertir la population et les milieux d'affaires qu'une crise se profile, qui pourrait avoir des conséquences économiques désagréables pour le Danemark.
Et lorsque Trump a répété son désir de prendre le contrôle du Groenland lors d'une conférence de presse après son investiture, le Premier ministre a dû une fois de plus convoquer les chefs de parti pour un briefing confidentiel – mais cette fois-ci, pas les « ailes extrêmes », comme l'opposition de gauche et de droite est si joliment appelée.
La déclaration de Trump intervient à un moment où les relations entre le gouvernement autonome groenlandais et le gouvernement danois sont déjà au plus bas, alors que les héritages coloniaux continuent de faire surface, plus récemment sous la forme du scandale de la spirale (pose obligatoire de stérilet), de l'utilisation par les municipalités danoises de tests de parentalité qui ne s'appliquent qu'aux Européens blancs et du racisme latent dont sont victimes de nombreux Groenlandais au Danemark. Et même si le président et le présidium du Parlement danois, sous la pression de Mette F, ont dû introduire l'interprétation simultanée au Parlement danois, ont rejeté le piétinement du ministère des Affaires étrangères concernant la nomination d'un Groenlandais comme ambassadeur du Royaume au Conseil de l'Arctique, et ont récemment annoncé qu'ils allaient désormais allouer une somme non spécifiée à deux chiffres d'un milliard d'euros pour la modernisation de la défense dans l'Arctique. Et maintenant, après le début de la crise Trump, il est soudain possible d'examiner l'utilité des tests de parentalité. Dans l'ensemble, ces revirements doivent laisser une étrange sonnerie dans les oreilles groenlandaises : – Pourquoi quelque chose ne se produit-il que lorsqu'il y a une pression extérieure ?
L'importance de la sécurité du Groenland pour les États-Unis
Mais pourquoi Trump, le premier président debout des États-Unis, fait-il aujourd'hui ces déclarations inédites dans les relations internationales des États ? Si tu fais bouillir les déclarations et que tu essaies d'en trouver la substance, il le fait à cause de la perspective de l'indépendance du Groenland, entendue comme une sécession complète du Danemark. Quelque chose qui, aux yeux de Trump, risque de créer un vide de pouvoir dans une région vitale pour la défense du continent nord-américain – auquel le Groenland appartient géographiquement – et qui contiendrait d'importants gisements de minéraux et de métaux stratégiques, cruciaux pour le maintien de la supériorité technologique et militaire américaine. Jusqu'à présent, la Chine est le seul arbitre du raffinage de ces matériaux critiques et a récemment imposé un embargo sur l'exportation de certains des matériaux les plus importants pour la fabrication de la microélectronique. Et n'oublions pas qu'il pourrait y avoir beaucoup d'argent dans le processus d'extraction, ce qui pourrait profiter au futur pouvoir oligarchique des États-Unis.
Ce qui est surprenant lorsque Trump fait une déclaration aussi forte sur les matières premières essentielles, c'est que les États-Unis eux-mêmes possèdent de grandes quantités de ce que l'on appelle les éléments de terres rares. Le fait est que les États-Unis sont contraints d'envoyer des matières premières concentrées pour être raffinées en Chine : le plus grand producteur de terres rares du monde occidental, American Mountain Pass, envoie toute sa production en Chine, écrit Information. Ni les États-Unis ni l'Union européenne ne disposent de la technologie nécessaire pour le traitement, mais la Chine, oui – les terres rares en question se trouvent dans de nombreux endroits, ce n'est donc pas l'extraction qui pose un problème. Ils s'appuient donc sur des chaînes de valeur mondiale hautement spécialisées. En outre – toujours selon Information – la composition géologique des gisements de terres rares au Groenland n'est pas optimale et elles se trouvent en même temps que l'uranium, dont le gouvernement groenlandais a interdit l'exploitation.
Les conditions géographiques, climatiques et de transport rendent également difficile une exploitation minière rentable – ce que le rapport « Pour le bien du Groenland » de 2014 soulignait déjà. L'un des pères du rapport était le professeur de géologie Minik Rossing, qui a également exprimé son scepticisme sur la Deadline de DR récemment. À cela s'ajoute la nécessité de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. En outre, le Groenland n'a pas de droits de propriété privée sur les terres, ce qui, avec la nouvelle loi sur les projets à grande échelle, serait perçu aux yeux des Américains comme une contrainte sévère pour une industrie extractive. Le Groenland n'est pas étranger au pillage des ressources de la terre qui a lieu ailleurs dans le monde, où les sociétés minières frappent comme des oiseaux de proie, mettant la terre à sec et laissant aux habitants les déchets toxiques et le nettoyage.
Mais les États-Unis – et l'UE aussi – construisent d'autres chaînes de valeur selon des lignes plus nationales dans le cadre de leurs tentatives de rompre leur dépendance à l'égard de la Chine, alors peut-être que les considérations stratégiques finiront par l'emporter sur les considérations commerciales.
Mais surtout, Trump ne veut tout simplement pas risquer que l'influence russe ou chinoise s'accroisse à mesure que l'influence danoise se réduit dans un pays qui s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés mais qui ne compte qu'environ 56 000 habitants. Les grandes puissances ne tolèrent pas le vide de pouvoir.
Et il n'y a rien de nouveau là-dedans. Car faut-il que Trump s'inquiète, les outils du contrôle américain n'existent-ils pas déjà ? Avec la doctrine Monroe de 1823, les États-Unis ont déjà affirmé qu'ils ne laisseraient pas des puissances extérieures s'établir sur les continents américains. Cette déclaration a été systématiquement suivie de la guerre hispano-américaine, qui a donné aux États-Unis Porto Rico et le contrôle de Cuba dans les Caraïbes, ainsi que l'achat des Antilles danoises en 1917. De la même manière, jusqu'à aujourd'hui – et plus récemment avec l'invasion du Panama en 1989 – les États-Unis n'hésitent pas à envahir directement ou à subvertir secrètement des pays américains s'ils estiment qu'ils sont confrontés à une prise de pouvoir « communiste », c'est-à-dire à un changement des relations de pouvoir en faveur des pauvres dans les pays en question – ou qu'ils se sont simplement mis en travers des intérêts et de la politique des États-Unis.
Dans le cas du Groenland, la vente des Indes occidentales signifiait que les États-Unis reconnaissaient en même temps la souveraineté du Danemark, bien que la doctrine Monroe s'appliquât toujours. Avec la Seconde Guerre mondiale, l'importance stratégique du Groenland est devenue évidente – d'abord parce que les États-Unis avaient besoin d'une station d'escale pour les avions qu'ils fournissaient à l'Angleterre, et plus tard, lorsque les États-Unis sont entrés en guerre eux-mêmes après l'attaque de Pearl Harbor, ils devaient également empêcher que le pays soit utilisé par les nazis pour menacer l'Amérique du Nord. L'ambassadeur danois à Washington, Kauffmann, est donc confronté à un ultimatum : soit les États-Unis occupent le Groenland sans autre forme de procès, soit un accord est conclu en vertu duquel le Danemark peut influencer les conditions de l'occupation et les États-Unis garantissent l'approvisionnement du pays. Kaufmann a sagement opté pour cette dernière solution.
En 1946, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont étudié la possibilité d'acheter le Groenland au Danemark – la guerre froide avait commencé. En 1951, la relation a été cimentée lorsque le Danemark et les États-Unis ont conclu un accord de défense, qui est de facto irrévocable car il faut que les deux parties y mettent fin. Par cet accord, les États-Unis se sont engagés à défendre le Groenland contre toute attaque. L'accord a également allégé la charge financière du Danemark.
Le développement des fusées en tant qu'armes de guerre que l'Allemagne nazie avait commencé a été poursuivi par les superpuissances afin que les fusées aient une portée beaucoup plus grande et puissent délivrer des têtes nucléaires. Et comme le nord du Groenland se trouve sur la trajectoire directe des fusées russes vers l'Amérique du Nord, les États-Unis ont construit une énorme base à Thulé – l'actuelle base spatiale de Pittufik – pour leurs bombardiers stratégiques, le stockage des armes nucléaires et un radar à très longue portée qui peut avertir les États-Unis et le Canada d'une attaque de fusées russes. En outre, le Groenland joue également un rôle dans la surveillance de ce que l'on appelle le GIUK gap, par lequel les sous-marins russes équipés d'armes nucléaires peuvent passer pour aller et revenir de la grande base libre de glace de la flotte russe du Nord sur la péninsule de Kola, à l'est de la Norvège.
Le traité de défense donne effectivement aux États-Unis les coudées franches pour faire ce qu'ils veulent dans le domaine de la défense. Le scandale de la lettre secrète du premier ministre social-démocrate H.C. Hansen, datant de 1957, montre bien que le Danemark en était parfaitement conscient. Lalettre secrète de Hansen de 1957, qui selon la devise « don't hear, don't see », permettait aux États-Unis de stocker des armes nucléaires sur la base de Thulé. La publication de cette lettre en 1995 a constitué une rupture de confiance cruciale dans les relations entre le Danemark et le Groenland. Mais elle n'a pas modifié la liberté de mouvement des États-Unis au Groenland. Même si les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont signé un addendum à l'accord de défense à Igaliku en 2004, par lequel le Groenland a rejoint l'accord de défense et les États-Unis ont été tenus de notifier aux deux autres pays les changements majeurs dans la présence militaire américaine.
Le changement climatique, qui ouvre des voies de navigation beaucoup plus courtes entre l'Europe et l'Asie et donne potentiellement accès à de vastes ressources, et les tensions géopolitiques croissantes sous la forme d'un antagonisme grandissant entre les États-Unis et leurs alliés d'une part, et la Russie et la Chine d'autre part, ont remis l'Arctique sous les feux de la rampe (voir « L'Arctique, l'Atlantique Nord et la politique de sécurité » dans « L'OTAN est-elle sûre ? », Éditions Solidarité). Sur le plan militaire, la Russie a rouvert et modernisé un certain nombre de bases de l'Arctique, par ailleurs fermées. Il s'agit en premier lieu de la base aérienne de Nagurskoye, dans l'archipel de la Terre François-Joseph. En outre, le changement climatique permet d'utiliser toute l'année la route maritime du Nord, c'est-à-dire la route au nord de la Sibérie, ce dans quoi la Russie et la Chine investissent massivement. Principalement à des fins civiles et commerciales, mais bien sûr aussi à des fins militaires. Les États-Unis et les pays de l'OTAN la perçoivent comme une menace potentielle pour la route d'approvisionnement vulnérable entre l'Amérique et l'Europe à travers l'Atlantique Nord.
Dans un commentaire paru le 8 janvier dans le média de défense OLFI, le rédacteur en chef Peter Ernstved Rasmussen décrit avec justesse la relation entre le Danemark et le Groenland comme suit :
« Le gouvernement danois a fait son propre lit. Au lieu d'équilibrer les relations avec le Groenland, les gouvernements successifs ont poursuivi la mentalité de race maîtresse. Les Groenlandais se sentent provoqués à juste titre. Les États-Unis aussi, car nous n'avons jamais voulu prendre la sécurité au sérieux. Maintenant, la facture arrive, et elle sera coûteuse. »
Il est clair pour tout le monde que le Danemark est incapable de faire respecter sa souveraineté – quels que soient les efforts et la volonté de sacrifice de l'équipage militaire. Une patrouille en traîneau à chiens – Sirius – et quatre frégates qui peuvent à peine naviguer ne suffisent pas pour cette zone si étendue. Une véritable application de la souveraineté nécessitera des ressources que le Danemark, même s'il est l'un des pays les plus prospères du monde, ne pourra jamais mobiliser. Et ce, malgré la décision politique prise ces dernières années de déverser des milliards dans la défense de l'Arctique. Pour compenser l'insuffisance de la défense aérienne du Danemark au Groenland, il a également été envisagé aux États-Unis d'intégrer le Groenland au NORAD, le Commandement de l'aérospatiale et de la défense de l'Amérique du Nord.
Mais rien n'a été fait. Et pourquoi ? Parce que les politiciens, les officiers et les fonctionnaires du ministère de la Défense préfèrent dépenser l'argent pour quelque chose qui compte dans le calcul des objectifs de force de l'OTAN. L'Arctique ne compte pas, et l'OTAN n'a même pas de stratégie pour l'Arctique. Il s'agit là d'un nouveau scandale parmi tant d'autres au sein de l'armée, qui jette un doute légitime sur la sagesse de déverser d'innombrables milliards dans une défense avant qu'elle n'ait été dotée des compétences financières et managériales nécessaires.
Et qu'en est-il de l'indépendance ?
On pourrait commencer par faire le tri dans la langue, car il y a beaucoup de confusion sur ce que l'on entend réellement au Groenland et en groenlandais par ce que l'on traduit en danois par « autodétermination », « autonomie », « indépendance » et « détachement ».
Le mécontentement des Groenlandais à l'égard des relations entre le Danemark et le Groenland n'est pas nouveau. Il n'a cessé de croître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre qui a rompu l'isolement du Groenland ; grâce au stationnement de troupes américaines dans des bases réparties dans tout le pays et au fait que les États-Unis étaient responsables de l'ensemble de l'approvisionnement du pays, la population groenlandaise s'est vu montrer un monde extérieur au pays. Lorsque le démantèlement des empires coloniaux européens s'est accéléré après la guerre mondiale, avec notamment la création du Comité de décolonisation de l'ONU, le Danemark a anticipé cette évolution en faisant du Groenland un comté danois en 1953 – en suivant le modèle portugais. En 1946-1951, le Portugal a transformé son Império Colonial Português en « provinces d'outre-mer » qui faisaient partie intégrante de la mère patrie. Cela a empêché les décolonisateurs trop zélés de s'immiscer dans les affaires des colonies et d'exiger leur indépendance.
L'intégration du Groenland au Danemark, soutenue par la plupart des Groenlandais, a également accéléré le développement qui allait conduire plus tard à l'autonomie locale (1979) puis à l'autonomie gouvernementale (2009). La tentative de danification du Groenland a bien sûr échoué, mais le reste de la modernisation de l'ensemble de la société groenlandaise a à la fois jeté les bases de l'État-providence – par exemple, les plus grands fléaux du Groenland que sont la tuberculose et la rougeole ont été éradiqués – et créé ses propres contradictions.
Contradictions parce que les Groenlandais étaient les spectateurs d'un développement auquel ils ne se sentaient pas associés et qu'ils se sentaient encore, à bien des égards, comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Par exemple, les salaires au Groenland étaient fixés en fonction d'un critère de lieu de naissance. Dans le même temps, de nombreux jeunes Groenlandais ont commencé à faire des études au Danemark, ont appris le danois et l'anglais, et sont devenus de plus en plus difficiles à refuser lorsqu'il s'agissait de déterminer leur propre situation. Les jeunes Groenlandais ont été influencés par des mouvements tels que la rébellion de la jeunesse et la lutte anti-impérialiste, et cette évolution a conduit à une organisation et à des revendications politiques, allant de l'autonomie locale et de l'auto-gouvernement à un désir généralisé d'une certaine forme d'indépendance.
Toutefois, il convient de noter qu'un sondage réalisé par l'Université du Groenland en 2024 montre que les Groenlandais interrogés considèrent la situation économique, le chômage et l'augmentation du coût de la vie comme les problèmes les plus urgents. Les questions de sécurité et de défense sont bien moins importantes sur la liste.
« Indépendance », « Autodétermination », « Sécession » ?
Les options politiques futures du Groenland peuvent être résumées comme suit :
– Indépendance totale
– Indépendance au sein d'un Commonwealth calqué sur le Commonwealth britannique avec des États égaux.
– Libre association, où le Groenland est indépendant mais a des accords avec d'autres pays dans des domaines politiques sélectionnés (par exemple, la sécurité et la défense).
La veille du Nouvel An, Múte Egede, le président du gouvernement autonome du Groenland, a prononcé son discours du Nouvel An, dans lequel il a notamment déclaré, dans la traduction danoise de Naalakkersuisut [le gouvernement autonome] :
«
Il est temps pour nous de faire un pas nous-mêmes et de façonner notre avenir, également en ce qui concerne les personnes avec lesquelles nous devrions coopérer étroitement et aussi celles qui devraient être nos partenaires commerciaux. Car notre coopération avec d'autres pays et nos relations commerciales ne peuvent pas continuer à se faire uniquement par l'intermédiaire du Danemark.
Ces dernières années, Inatsisartut [le parlement du Groenland] et Naalakkersuisutont travaillé ensemble pour prendre des mesures afin de rédiger notre constitution, qui est la base de notre sécession d'avec le Danemark.
»
Le mot « sécession » n'apparaît qu'une seule fois, tandis que le mot « indépendance » apparaît quatre fois. Une grande partie de la confusion sur ce qu'ils veulent réellement est probablement due à des traductions imprécises du groenlandais au danois. Pour le parti Naleraq et Pele Broberg, cependant, le langage est clair : l'indépendance signifie un détachement complet du Danemark. Pour IA – le parti frère de SF et EL, actuellement le plus grand parti du Groenland et qui forme avec Siumut la coalition gouvernementale actuelle et Siumut, l'« indépendance » signifie probablement quelque chose comme une construction politique dans le voisinage des deux dernières options.
Et il est judicieux que le Groenland profite de la crise créée par les déclarations de Trump pour obtenir de meilleures conditions selon ses propres termes. Il doit être difficile pour le gouvernement groenlandais d'attendre constamment que des pressions extérieures tirent le gouvernement danois vers l'auge.
Le royaume danois est-il uni ?
Au cours du débat du Parlement danois sur l'introduction de l'interprétation simultanée, il s'est passé quelque chose d'étrange que peut-être peu de gens ont remarqué. Mette Frederiksen a infligé à Inger Støjberg un violent remaniement qui, à première vue, semblait disproportionné car le remaniement portait notamment sur l'importance du Groenland pour l'OTAN et sur la politique de défense et de sécurité du Danemark. Mais ce que Mette Frederiksen a fait, c'est envoyer à Nuuk les premiers signaux indiquant qu'ils étaient – enfin – prêts à discuter de l'organisation et de la fonction du royaume danois.
Elle avait flairé quelque temps auparavant que la relation avec le Groenland était essentiellement une question de sécurité.
Après tout, le Groenland fait partie de l'étrange entité connue sous le nom de « royaume danois ». On pense que ce terme est apparu pour la première fois dans la thèse de doctorat « Rigsfællesskabet » de l'avocat Frederik Harhoff en 1993 (Frederik Harhoff, Rigsfællesskabet, Klim 1993).
Superficiellement, le mot donne l'impression que les participants sont égaux, quelque chose comme le Commonwealth britannique. Mais ce n'est pas le cas. Le royaume danois est une construction informelle qui n'est décrite dans aucune loi, qui n'a donc aucune signification juridique et qui, en tant que telle, n'est pas une coopération entre des entités politiques égales. Le Groenland et les îles Féroé font partie du royaume danois et sont soumis à la Constitution danoise. Cependant, le Parlement danois a délégué des responsabilités aux gouvernements autonomes des deux pays. Par conséquent, la loi de 2009 sur l'autonomie du Groenland stipule également que « la décision sur l'indépendance du Groenland est prise par le peuple groenlandais ». Le gouvernement groenlandais doit ensuite entamer des négociations avec le gouvernement danois, après quoi un accord doit être approuvé par un référendum au Groenland et enfin par le Parlement danois. Cette situation est similaire à la soi-disant « union » entre l'Angleterre et l'Écosse, où le parlement de Westminster a également le dernier mot, indépendamment de ce que le peuple écossais pourrait décider lors d'un référendum.
Sans minimiser les liens étroits qui existent entre les habitants du Groenland et du Danemark – environ 17 000 Groenlandais vivent au Danemark et 6 à 7 000 Danois au Groenland – le Groenland joue un rôle pour le Danemark avant tout dans ses relations avec les États-Unis, où, comme le dit le premier ministre, il ne devrait pas y avoir plus qu'une feuille de papier A4 entre les deux pays. Quelque chose qui cadre bien avec le fait que si Mette F a qualifié d'« absurde » le désir de Trump d'acheter le Groenland la dernière fois, cette fois-ci, le Premier ministre est resté silencieux. Jusqu'au jour où, alors que le fils de Trump effectuait un voyage éclair à Nuuk et que le premier ministre avait annulé au pied levé une visite à Copenhague, elle a pris la parole pour dire que « toute discussion [sur l'avenir du Groenland] doit commencer à Nuuk » et pas ailleurs, que le Danemark était une ancienne puissance coloniale qui avait commis des erreurs assez grossières en cours de route, que le désir d'indépendance du Groenland était légitime, mais aussi que les États-Unis étaient l'allié le plus important du Danemark.
Le petit État du Danemark a pu jusqu'à présent jouer la « carte du Groenland », précisément parce que dans la structure non légalisée actuelle, il n'est pas question de pays égaux. Même si le terme « communauté » est censé impliquer l'égalité. En réalité, le royaume danois est une invention danoise dont le but réel est de maintenir pour le Danemark une importance que sa taille ne justifie pas vraiment – si le Groenland était retiré du Danemark, la superficie du royaume diminuerait de 98%.
Le Danemark en tant que petit État
La dissolution du Danemark-Norvège en un seul royaume après les guerres napoléoniennes en 1814, puis la dissolution de l'État tout entier après la guerre perdue contre la Prusse et l'Autriche en 1864, ont réduit le Danemark à un petit État. Sa survie en tant qu'État indépendant dépendait d'un équilibre entre une bonne relation avec son voisin le plus proche, l'Allemagne, et la protection d'une autre grande puissance ou d'une alliance d'États.
Après la Seconde Guerre mondiale, le Danemark a dû réorganiser ses relations d'alliance. Une alliance de défense nordique a d'abord été tentée, mais les différences entre les intérêts de la Norvège et de la Suède étaient trop importantes, et finalement, le gouvernement social-démocrate, influencé par le coup d'État communiste de Prague en 1948, a accepté de rejoindre le Pacte atlantique – plus tard l'OTAN, dont la puissance dominante était les États-Unis. Les États-Unis étaient désormais le principal garant de la sécurité du Danemark dans le monde occidental, un rôle qu'ils ont conservé depuis, malgré quelques accrocs sur la route, comme la critique de la guerre américaine au Vietnam et la politique de la note de bas de page. C'est dans ce contexte qu'il faut voir le long silence puis les déclarations très prudentes de Mette Frederiksen, dont le but principal est de ne pas irriter le président américain Trump.
L'alliance avec les États-Unis a été construite à tel point que les déclarations de Trump sur le Groenland ont fait l'effet d'une véritable « bombe au ministère d'État » (Hans Engell dans le P1Genstartde DR, 15 janvier). Dans le même temps, la crise a montré au Danemark et aux Danois que le Danemark est en fait un petit État – malgré les tentatives des premiers ministres successifs de s'affirmer et de manger des cerises avec les grands en se joignant, par exemple, presque automatiquement aux aventures américaines en Afghanistan et en Irak. Mais quand on mange des cerises avec les grands, on se retrouve souvent avec des cailloux dans la tête.
Le fait qu'il ne faut rien avoir à dire aux États-Unis ressort de la manière très prudente dont le gouvernement s'exprime, même s'il est désormais clair que la conversation de 45 minutes de Mette Frederiksen avec Trump a été extrêmement franche, du moins de la part de ce dernier.
Et bien que plusieurs dirigeants de l'UE aient pris leurs distances avec les déclarations de Trump, il n'y a pas eu de réaction unifiée, ce qui aurait pu être bienvenu par ailleurs. Car les autres pays européens de l'OTAN n'auraient pas dû conclure quoi que ce soit non plus.
La réaction du Danemark est apparemment de travailler à huis clos pour ne pas contrarier l'homme de Washington. Mais cela ne peut qu'exercer une forte influence sur la politique du gouvernement lorsque la personne en qui vous aviez le plus confiance vous attaque soudainement. Une réponse possible pourrait être de mettre en attente le prochain accord de base bilatéral avec les États-Unis pour le moment.
Une nouvelle communauté
Dès 2018, l'un des meilleurs diplomates du service extérieur, Taksøe-Jensen, a suggéré de dissoudre le royaume danois dans son livre « Hvis Grønland river sig løs – en rejse i kongerigets sprækker ». Et un autre diplomate de haut rang, Zilmer-Johns, a fait une remarque similaire un peu plus tard. Lorsqu'il a pris sa retraite, il s'est exprimé et a déclaré àWeekendavisenen avril 2023 qu'au lieu de rafistoler le royaume danois, dont aucune des parties n'est satisfaite, le Danemark devrait entamer une discussion sur – ce à quoi une autre communauté pourrait ressembler.
Zilmer-Johns avait remarqué que parmi les politiciens groenlandais et féroïens, il y avait un manque fondamental de confiance dans le fait que le Danemark sauvegarderait pleinement les intérêts des deux autres royaumes. Enfin, Zilmer-Johns déclare :
« C'est aussi pour cela que je pose la question : Devrions-nous plutôt créer une communauté moderne où nous ne sommes pas préoccupés par ce que nous ne voulons pas ensemble, mais où nous nous concentrons sur ce que nous voulons ensemble ? Je suis sûr qu'il y aura un fort intérêt dans les trois parties du royaume, également dans le domaine de la défense et de la sécurité. »
Alors que le parti Naleraq souhaite une sécession complète, le parti IA au pouvoir estime que l'indépendance qu'ils souhaitent relève du domaine danois, sous peine d'être avalés par les États-Unis. L'une des figures clés de la politique groenlandaise, Aqqaluk Lynge – cofondateur du parti IA et dirigeant de longue date de la Conférence circumpolaire inuit (CCI) – a décrit le royaume danois dans une interview à P1 Morgen comme quelque chose qui a donné au Groenland la prospérité, la sécurité et la sûreté. Par conséquent, l'idée que se fait l'IA de l'avenir du Groenland n'est pas celle d'un État, mais d'une communauté d'égaux avec les autres parties du royaume. Auparavant, Aja Chemnitz (IA), qui est l'un des deux députés groenlandais, avait déclaré : « IA pense que nous ne pouvons plus attendre que le Groenland ait sa propre politique étrangère, de sécurité et de défense. Le Groenland doit avoir un droit de veto sur les affaires étrangères et la sécurité de notre pays. » « Rien sur nous, sans nous ».
Enfin, Aqqaluk Lynge déclare sans ambages dans un article d'opinion sur Altinget de 2023 que
« … il [est] assez peu probable que les grandes puissances reconnaissent une nouvelle formation étatique dans l'Arctique.Par conséquent, nous ne nous approcherons pas d'un Groenland indépendant reconnu par la communauté internationale dans un avenir proche. »
Et il réitère sa position dans un article surKNR :
« Nous n'avons notre liberté qu'au sein du royaume danois, il faut en tenir compte. Nous avons fait de gros efforts pour l'obtenir au sein du Commonwealth, et cela peut changer très rapidement, comme le menace Trump ».
Naturellement, les États-Unis tenteront de contourner Copenhague s'ils estiment qu'il est dans leur intérêt de le faire. Au cours de la première administration Trump, les États-Unis ont rouvert le consulat à Nuuk, ce qui a provoqué une telle nervosité au sein du département d'État qu'ils se sont empressés d'envoyer un représentant à Nuuk pour un séjour permanent. Dans la nouvelle ère Trump, nous assisterons probablement à d'autres contacts, prêts, accords de coopération, etc. visant à rapprocher le Groenland des États-Unis. Parallèlement, l'UE redoublera également d'efforts – Ursula von der Leyen et Múte Egede ont ouvert un bureau de l'UE à Nuuk peu avant Noël. Le nouvel aéroport de Nuuk, qui peut accueillir des vols long-courriers, est un autre élément du relâchement des liens entre le Groenland et le Danemark et une porte d'entrée vers une plus grande influence américaine.
Quel que soit l'avenir politique choisi par le Groenland – et les îles Féroé – il est temps que le Danemark prenne le taureau par les cornes et se rende compte que le temps est compté pour l'actuel royaume danois, nettoie les derniers vestiges du paternalisme danois et entame des négociations sérieuses avec le Groenland et les îles Féroé sur le type de communauté que les deux pays souhaitent. Sans une diligence raisonnable, le danger est que la prédiction diplomatique de Zilmer-John : « Si nous ne le faisons pas, nous courons le risque que cela déraille », devienne réalité, et cela ne profite qu'aux États-Unis.
Lynge exprime l'opinion de nombreux Groenlandais lorsqu'il déclare dans une interview vidéoà Berlingske le 21 janvier.
« Nous ne supporterons pas que les gens de MAGA courent ici en jouant au fandango ».
Donc merci à Trump, mais non merci.
Niels Frølich
Membre de l'équipe éditoriale de Critical Review En savoir plus
https://solidaritet.dk/tak-trump/
Communiqué par ML
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Grève générale en Serbie

De nombreux acteurs sociaux ont appelé à une grève générale le vendredi 24 janvier (appelée officiellement par les étudiant·es et lycéen·enes) qui a été marquée par des rassemblements de masse, qui se sont poursuivis samedi et dimanche, portant le nombre de manifestations à plus de 150. Au moins 22 000 personnes ont manifesté à Novi Sad, 15 000 à Niš dimanche, 6 000 à Kragujevac. Pour la ville de Belgrade, on estime qu'environ 35 000 personnes se sont rassemblées près du bâtiment du gouvernement, tandis que 20 000 autres personnes se sont rassemblées au rond-point près de la municipalité. Belgrade compte 1,3 million d'habitant·es et la Serbie 6,60 millions.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Les manifestations, qui ont débuté en novembre et réclament que les autorités rendent des comptes et que justice soit rendue pour l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad, le 1er novembre dernier, qui a fait 15 victimes. Cette contestation est devenue le plus grand défi auquel les autorités ont été confrontées depuis que le Parti progressiste serbe a pris le pouvoir en 2012. Le président Aleksandar Vucic a appelé à « punir sévèrement » les responsables de la tragédie qui s'est produite dans la gare, mais rien n'a été fait.
Mais pour beaucoup les dirigeants corrompus, par l'intermédiaire desquels des proches de fonctionnaires ont passé les commandes de construction de cet auvent, sont les symboles d'un régime qu'ils et elles ne supportent plus. Ils et elles demandent également que Vucic lui-même soit tenu pour responsable.
Les étudiant·es sont mobilisé·es en permanence depuis novembre 2024. Ils et elles expliquaient en décembre dernier « Nous avons suspendu nos études, organisé des assemblées générales et voté des revendications, créé des groupes de travail. Nous avons occupé les locaux des facultés et les avons adaptés à notre vie quotidienne. Nous avons installé des cuisines, des dortoirs, des pharmacies, des ateliers, des cinémas et des salles de classe qui dispensent des cours pendant la grève. En trois semaines, presque tous les bâtiments universitaires de Serbie sont devenus des centres d'auto-organisation politique 24 heures sur 24. Nous recevons le soutien de nos concitoye·nes, dont les dons nous permettent de vivre. Chaque jour, d'autres groupes vulnérables de la société se joignent à notre lutte... Nous mettons en pratique le principe de la démocratie directe. Lors de ces réunions, tout le monde a une voix égale et le droit de décider de toutes les questions ».
De son côté, le syndicat indépendant des éducateur·trice, de nombreuses écoles et personnes employées dans l'éducation se sont opposé·es à la décision des syndicats « représentatifs » de poursuivre les négociations avec le ministère de l'Éducation. Des troupes de théâtre de Belgrade, ainsi que le Théâtre national serbe de Novi Sad, puis le Théâtre national de Sombor, ont annulé leurs représentations et ont lu une déclaration de protestation contre la tentative d'assassinat d'une étudiante en référence à la voiture qui a foncé le 16 janvier sur un rassemblement étudiant.
Plus tôt le 15 janvier, le syndicat TENT a décidé de se mettre en grève et demande « la satisfaction des revendications des étudiant·es, la détermination des responsabilités dans la situation catastrophique de l'industrie électrique - mais aussi la destitution du directeur général de l'EPS AD, de l'ensemble du directoire, du conseil de surveillance, de l'Assemblée de EPS, et le Ministre des Mines et de l'Énergie. » Trois jours plus tard entre 53 000 et 55 000 personnes ont participé à une manifestation devant la Télévision Rodio de Serbie (RTS), sous le mot d'ordre « Notre droit à tout savoir » ce qui constituait selon un quotidien serbe l'un des plus grands rassemblements de l'histoire de la Serbie. À la suite du mouvement étudiant, d'autres secteurs de la société serbe se mettent en mouvement qui vient de culminer avec ce week-end de grève générale.
A la suite de ces manifestations, le premier ministre serbe, Milos Vucevic a démissionné le 25 janvier. « Afin d'éviter de ne pas augmenter davantage les tensions dans la société, j'ai pris cette décision », a-t-il déclaré. Une première victoire du mouvement des étudiants.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Submersion migratoire » : Bayrou reprend la rhétorique du RN et prépare une offensive anti-immigrés

Lundi soir sur LCI et mardi à l'Assemblée, François Bayrou s'est fait le porte-parole du programme raciste du RN en évoquant un risque de « submersion migratoire ». Le PS a donc été obligé d'agiter la censure. Toute forme de stabilité offerte à ce gouvernement se paiera par une offensive raciste
28 janvie4 2025 | tiré de Révolution permanente
https://www.revolutionpermanente.fr/Submersion-migratoire-Bayrou-reprend-la-rhetorique-du-RN-et-prepare-une-offensive-anti-immigres
Macron avait déjà repris et popularisé des poncifs racistes de l'extrême droite : « ensauvagement », « décivilisation ». Son bras-droit, Gérald Darmanin alors ministre de l'Intérieur avait en 2020 déploré l'« ensauvagement de la société ». Le Premier Ministre François Bayrou, soutien de la première heure du Président, s'essaye désormais à la théorie conspirationniste et suprémaciste du « grand remplacement » en évoquant lundi soir sur LCI une « submersion migratoire » à Mayotte et en France. À l'Assemblée ce mardi, le chef du gouvernement a persisté en précisant qu'il parlait de submersion migratoire à Mayotte, où les Comoriens sont traités en étrangers sur leur archipel, avant d'ajouter « et ce n'est pas le seul endroit en France ». Un discours réitéré qui ne laisse pas le doute quant à la volonté d'assumer cette rhétorique empruntée à l'extrême-droite, que Jean Marie Le Pen avait popularisé en 1989 : « Nous sommes menacés par une vague, une submersion », affirmait-il.
Ces déclarations de Bayrou ont cependant reçu des réponses contradictoires. D'un côté, un secteur de la macronie avait déjà préparé le terrain. Lundi, Le Figaro publie une interview de Maud Bregeon, députée macroniste et ancienne porte-parole du gouvernement Barnier, dans laquelle celle-ci plaide pour remettre sur la table les mesures les plus dures de la loi Immigration. Mardi sur France Info, la députée de la Marne, Laure Miller, a soutenu les propos de Bayrou : « Si vous discutez avec n'importe qui dans la rue, vous verrez qu'il y a ce sentiment de submersion migratoire ». Mais il a également causé quelques remous chez les députés macronistes, du moins sur la forme. « Je n'aurais jamais tenu ces propos et ils me gênent » a ainsi affirmé Yaël Braun-Pivet qui n'a pourtant pas hésité à voter il y a un an la Loi Immigration. « Ce n'était pas le meilleur mot à utiliser », concède un ministre aux journal Les Echos. Bruno Retailleau (Intérieur) et Gérald Darmanin (Justice) se sont sans surprise félicités qu'ils reprennent leurs rhétoriques racistes.
Une offensive qui ouvre une crise avec le PS
Le Parti Socialiste, qui a jusque-là très bien plié pour refuser de censurer le gouvernement Bayrou-Retailleau, a été obligé de réagir à des propos d'un racisme aussi décomplexé, mais qui affleuraient déjà dans la déclaration de politique générale de Bayrou : « L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui se déploie […]. Mais que trente familles s'installent et le village se sent menacé. » Les dirigeants du Parti Socialiste ont donc claqué la porte des négociations en cours visant à trouver un accord en vue de la CMP ce jeudi autour du budget 2025.
Désormais, le Parti Socialiste veut faire monter les enchères et parle plus volontiers de censure.Cette sortie aura des « conséquences déflagratoires » a réagi le député PS Laurent Baumel. La menace est plus prégnante encore au sein de de l'entourage d'Olivier Faure : « Le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, la sénatrice socialiste Corinne Narassiguin, son collègue député Arthur Delaporte, ou encore l'eurodéputée Chloé Ridel… Désormais, les menaces des cadres socialistes sont à prendre au pied de la lettre », pointe L'Opinion. Mais si rien n'est gravé dans le marbre, comme l'ont illustré le cirque autour des menaces de censure lors du discours de politique générale, il reste que la tension est remontée d'un cran suite aux propos de Bayrou.
Un accord précaire : la crise politique de retour au premier plan
Cette crise ouverte avec le PS illustre la très relative stabilité de l'accord obtenue par Bayrou. Un coup à « gauche » sur la question du budget et le « conclave » sur les retraites, un coup à droite pour contenter l'aile droite de son gouvernement, Retailleau et les LR. Une stratégie à très haut risque qui vise à tenter d'élargir son socle et de résoudre la quadrature du cercle d'une Assemblée structurellement divisée et instable.
Or cette fois, en voulant consolider son bloc sur la droite et tester le RN qui reste une clé pour une non-censure avec un PS polarisé, Bayrou risque de ruiner le tour de dressage qu'il avait réussi avec les socialistes et se met à la portée d'une censure du RN, comme Barnier. Et l'extrême droite est gourmande et n'a pas tardé à réagir. « Ce que l'on attend de lui, ce sont des actes qui suivent les constats et pour l'instant on a beaucoup de constats et très peu d'actes », a réagi Marine Le Pen au Palais-Bourbon. Pour l'heure, pas d'accord ni avec le PS ni avec le RN.
Une offensive qui présage de l'offensive autoritaire et raciste à venir
Mais la précipitation des macronistes à passer à l'après-budget témoigne de leurs ambitions racistes et sécuritaires. Sentiment d'insécurité, sentiment de « submersion » disent-ils, alors que Retailleau, Darmanin et les médias capitalistes saturent l'espace de discussions plus écœurantes les unes que les autres : violence de mineurs, guerre contre la drogue, restriction de droits délirants pour les prisonniers…
En menant une campagne permanente contre les réfugiés avec ou sans titres de séjour, comme avec la circulaire Retailleau qui veut rendre quasi-impossible la régularisation, les capitalistes préparent des offensives racistes contre toutes les personnes d'origine étrangère. Le « sentiment de submersion » de Bayrou s'arrête au prénom, à la couleur de peau ou à la manière de s'habiller ou de manger, il ne regarde pas la situation administrative.
Dans le monde entier, les partis de l'extrême centre néolibéral, se convertissent ouvertement aux thèses de l'extrême droite. En Allemagne, la démocratie-chrétienne (CDU) est prête à voter avec l'AfD, un parti nostalgique du nazisme, pour déporter des étrangers. En temps de crise, la démocratie capitaliste montre son vrai visage : raciste, policière et profondément anti-ouvrière.
Dans ces conditions, maintenir la « stabilité » d'un tel régime comme s'y engage le Parti Socialiste ou les directions syndicales en trouvant des accords avec le gouvernement pour ne pas le censurer, ou en participant au dialogue social, c'est permettre à ce gouvernement de mener des attaques racistes violentes qui vont s'abattre contre la population d'origine immigrée.
Toutes les oppositions en parole des directions syndicales à la loi immigration de 2024 ne valent rien si celles-ci s'acharnent à sauver le gouvernement qui ne rêve que de pourrir toujours plus la vie des travailleurs immigrés. La lutte contre l'extrême droite, si elle est sincère, doit passer par une lutte décidée contre ce gouvernement, son budget austéritaire et ses lois racistes !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
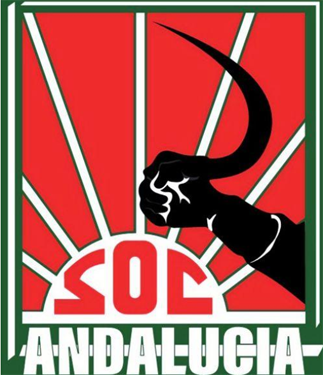
Le malaise andalou. Une approche de la question nationale andalouse
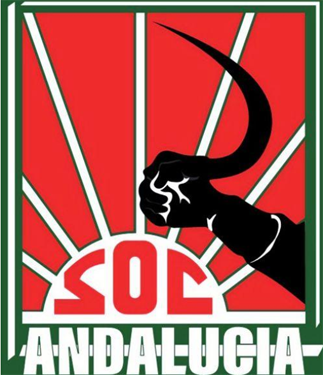
Nous avons voulu compléter notre dossier sur la question nationale par une contribution sur les nations qu'on associe généralement au « régionalisme », dont l'Andalousie est un exemple.
18 janvier 2025 | tiré du site inprecor.fr | Illustration : Le syndicat des ouvriers agricoles, Sinidicato Obrero del Campo, aujourd'hui SAT, a joué un rôle très important dans les mobilisations paysannes depuis la fin des années 1970.
Malaise. État de malaise physique ou spirituel. [Ou particulièrement, sentiment indéfini de ne pas être bien physiquement.]
Dictionnaire de María Moliner. Le sud, un jour, se lèvera
Une nation se lèvera
Fatiguée et blessée
République d'Andalousie
Tino Tovar, pasodoble de comparsa du Carnaval de Cadix « Tic Tac », année 2018.
Le présent texte se veut une approche de la question nationale andalouse en essayant d'analyser comment elle opère dans le panorama politique actuel et comment elle constitue un fait fondamental pour la libération sociale en Andalousie, quelle relation elle entretient avec la construction de l'État espagnol pour conclure par une proposition sur la façon dont nous devrions y faire face dans le but d'avancer vers une révolution écosocialiste en Andalousie et à partir de l'Andalousie.
Le malaise andalou
En Andalousie, nous avons un malaise : l'étrange sensation de vivre dans une crise permanente. Il ne s'agit pas d'une exagération, mais d'un malaise collectif face au rôle social et économique qui nous incombe. En d'autres termes, et pour faire simple, tout le monde en Andalousie sent, d'une manière ou d'une autre, que nous sommes plus pauvres que le reste de l'Espagne. Que nous pourrions être obligés de partir pour avoir un avenir, que l'on se moque de notre façon de parler ou que les choses sont plus difficiles ici.
Les facteurs sont multiples et les visions différentes, certaines contradictoires et d'autres complémentaires. Il ne s'agit pas d'un problème temporaire, ni d'un phénomène imputable aux derniers gouvernements ou aux crises économiques de la dernière décennie. Le malaise andalou est vieux de plusieurs siècles et s'inscrit dans l'identité de notre peuple. L'Andalousie ne peut être comprise sans le malaise andalou.
Mais comme je l'ai dit, le malaise andalou n'est pas seulement un sentiment, c'est un fait matériel. Ce malaise a une base réelle. Regardons quelques données.
En 2024, le nombre de personnes en risque de pauvreté en Andalousie est le plus élevé d'Espagne 1, le taux AROPE qui mesure le pourcentage de personnes en risque de pauvreté (idem) ou d'exclusion sociale est également le plus élevé d'Espagne (idem) et le nombre de personnes ayant des difficultés à joindre les deux bouts est supérieur de 7 points à la moyenne nationale (idem).
Le taux de chômage est beaucoup plus élevé que la moyenne de l'État, les salaires sont nettement inférieurs à la moyenne de l'État, six des dix municipalités aux revenus les plus faibles de l'État sont andalouses et même l'espérance de vie est plus faible.
C'est donc un fait qu'il existe en Andalousie une situation spécifique d'appauvrissement et d'inégalité dont souffrent directement les classes populaires et que l'Andalousie a joué un rôle de périphérie politique, sociale, économique et culturelle au sein de l'État espagnol.
La question est maintenant de savoir comment ce malaise andalou fonctionne politiquement, quelle est sa signification, comment il est canalisé et à qui il profite.
Les mauvaises réponses
Au cours des dernières décennies, différentes réponses politiques au malaise séculaire de l'Andalousie et à la situation spécifique d'oppression vécue par les classes populaires andalouses sont apparues.
À l'heure actuelle, nous pouvons distinguer trois catégories principales de réponses au malaise andalou, qui sont terriblement erronées et qui nous mènent dans des voies sans issue, comme je le décrirai ci-dessous.
Le premier de ces groupes pourrait être appelé le chauvinisme identitaire. Il s'agit de la tendance à placer la culture et l'identité au centre de la question andalouse comme une cause et non comme une conséquence de l'évolution matérielle et historique de notre peuple. Dans ce type de réponse, la cause de notre oppression est notre culture et notre façon d'être.
Cette réponse se décline en deux versions. L'une, profondément réactionnaire et classiste, affirme plus ou moins explicitement que la responsabilité de la situation socio-économique de l'Andalousie réside dans les prétendues caractéristiques culturelles des classes populaires andalouses. L'autre version, prétendument plus progressiste, est une forme d'autosatisfaction de la situation de l'Andalousie –se rattachant au mythe de l'Andalousie exotique ou orientale si typique du 19e siècle –, nie le malaise andalou et présente l'Andalousie comme un paradis de vertus où il fait bon vivre, précisément en raison de notre culture et de notre identité.
Ces deux visions du chauvinisme identitaire sont profondément ancrées dans la population andalouse et dans le reste de l'Espagne et nous conduisent à la même impasse et à la même paralysie.
Sur la scène politique andalouse, ces éléments ont été particulièrement utilisés dans leur version la plus prétendument progressiste par des positions politiques qui suggèrent une sorte de régionalisme andalou interclassiste qui présente la libération andalouse comme une conséquence directe d'un développement culturel et identitaire particulier, en ignorant la question des classes, de la libération sociale et de la construction même du régime espagnol, comme je l'expliquerai plus loin.
Un deuxième groupe de réponses erronées au malaise andalou est ce que nous pourrions appeler l'anti-catalanisme. Cette idée est profondément ancrée dans la société andalouse et c'est l'élément le plus utilisé par l'État espagnol pour canaliser l'agitation andalouse.
Ces réponses sont basées sur l'idée que l'origine de la situation d'oppression économique de l'Andalousie se trouve dans le développement d'autres territoires en Espagne. Elles partent d'un fondement réel – celui des rôles différents joués par les territoires et les nations dans la construction de la notion même d'Espagne et du sacrifice de certains d'entre eux – pour désigner le peuple catalan (ou basque) dans son ensemble comme l'ennemi d'une Espagne dont l'Andalousie serait le fer de lance, la zone la plus lésée par toute revendication nationale de l'une ou l'autre des nations sans État.
Mais l'idée qui sous-tend cette réponse erronée est un fort interclassisme. La conception des nations, des peuples ou des territoires comme un tout univoque et homogène avec des intérêts égaux, comme s'ils n'étaient pas liés à la classe sociale. Un territoire prétendument privilégié est présenté dans la construction territoriale de l'État comme s'il s'agissait de son peuple, et non d'une classe sociale qui dirige à la fois ici et dans l'État, et qui est responsable du rôle joué par l'Andalousie.
Le plus curieux est que l'État qui « répartit » n'est pas pointé du doigt. Cette théorie est toujours dirigée contre la Catalogne (ou Euskadi) mais jamais contre l'État. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de cette vision, il n'y a pas une défense de l'Andalousie en soi, mais de l'Andalousie comme fer de lance de l'Espagne, comme la plus espagnole des « Espagnes ».
C'est actuellement l'axe fondamental du discours de la droite et de l'extrême droite en Andalousie, incluant la création d'un nouveau régionalisme andalou conservateur qui tente de redéfinir les symboles, l'histoire et l'identité andalouses.
Nous trouvons un troisième groupe de mauvaises réponses : ce n'est qu'une question de classes sociales. Ses partisans en viennent à proposer une résolution plus simple de la question : la nier. Ils affirment simplement qu'il n'y a pas de problème territorial en ce qui concerne l'Andalousie et que tous les indices socio-économiques de l'Andalousie répondent exclusivement à la question des classes, niant ainsi l'oppression spécifique de l'Andalousie. Tant sur le plan matériel que sur le plan culturel.
Cette réponse a généralement été défendue par la gauche centraliste, à la fois les plus socio-libéraux et ceux historiquement regroupés autour du Parti communiste espagnol, ou maintenant Sumar/Izquierda Unida ou Podemos. Bien qu'ils se réfèrent généralement aux luttes andalouses des années 1970 et 1980, ils y font toujours allusion comme à une lutte du passé, appréhendée avec nostalgie et dans le contexte particulier de la transition espagnole et de sa défense. Elles ne sont jamais évoquées comme un problème actuel ou comme une oppression majeure qui croise la question de la classe ou du patriarcat.
En somme, ils nient l'existence d'un malaise andalou endémique, il n'y a donc pas pour eux de question nationale andalouse mais simplement la question de la classe ouvrière en Espagne.
Cette réponse refuse de comprendre la composition des classes populaires andalouses, leur situation socio-économique et donc leurs expressions culturelles, identitaires, politiques et combatives. C'est un refus de comprendre la situation en Andalousie.
Face à ces trois réponses erronées, il convient de s'interroger sur l'origine et le développement du malaise andalou et sur son maintien.
L'origine du malaise andalou
Il est courant, lorsqu'on parle de l'Andalousie, de dire qu'il s'agit d'une terre « arriérée », de souligner que la clé pour comprendre la situation socio-économique de l'Andalousie est qu'elle est « sous-développée ». Ainsi s'insinue l'idée largement répandue selon laquelle le développement économique est une échelle univoque, à sens unique, dans laquelle l'Andalousie se trouve simplement à quelques échelons du reste de l'État espagnol.
Cette idée, qui est largement utilisée dans l'analyse de nombreuses régions du monde, est très utile pour maintenir le statu quo, ce qui est bénéfique pour les classes dirigeantes qui profitent de la façon dont l'État espagnol a été construit, en termes de classes et de territoire.
Elle leur est très utile pour deux raisons principales : premièrement, parce qu'elle nous place, nous les victimes du malaise andalou, dans une position purement passive, puisque nous ne pouvons qu'attendre que l'évolution naturelle nous fasse gravir l'échelle du développement ; deuxièmement, parce qu'elle ne nous montre qu'une seule voie possible : le développement le long de cette échelle à sens unique, le long de laquelle d'autres territoires ont déjà progressé avant nous.
C'est essentiellement faux. Et ce, pour une raison fondamentale : l'Andalousie n'est pas sous-développée. L'idée que l'origine de la situation de l'Andalousie est qu'elle est arrivée tardivement au développement capitaliste parce que les structures sociales, économiques et politiques d'une période précapitaliste s'y sont prolongées, est fausse.
Comme le soulignent des auteurs tels que Delgado Cabeza, Arenas Posadas et García Jurado, non seulement l'Andalousie n'est pas arrivée tardivement au développement du capitalisme, mais elle a joué un rôle de pionnier dans le développement du capitalisme dans la péninsule ibérique.
La conquête et la colonisation castillane de l'Andalousie entre le 11e et le 15e siècle et la colonisation ultérieure de l'Amérique à partir des côtes andalouses ont jeté les bases de la construction, entre le 15e et le 18e siècle, d'un développement particulier du capitalisme que des auteurs comme García Jurado appellent le « capitalisme seigneurial andalou », dans lequel un processus de prolétarisation précoce de la main-d'œuvre, la privatisation et la clôture des terres et l'importance du marché 2 sont apparues très tôt.
À cela s'ajoutent les institutions politiques issues de la conquête d'Al-Andalus, qui jouent le rôle de garant de la propriété privée des moyens de production, notamment de la terre, et d'une répression brutale au bénéfice des élites.
Très tôt est apparu le « problème de la terre », qui était déjà utilisée comme marchandise, avec des ouvriers sans terre prolétarisés par la spoliation des terres et qui a atteint son apogée au début du 19e siècle avec le désamortissement 3.
À partir du 17e siècle, le chômage est apparu comme un problème structurel et majeur en Andalousie4, où il existait une énorme classe de journaliers totalement dépossédés des moyens de production et obligés de vendre leur force de travail pour survivre.
Ce développement précoce du capitalisme en Andalousie, en lien avec les institutions héritées de la conquête d'Al-Andalus, la formation d'une classe sociale mêlant la seigneurie castillane et le problème de la terre et du commerce avec la colonisation de l'Amérique, ont eu un effet sur tous les aspects de la société andalouse.
C'est précisément ce développement particulier du capitalisme andalou qui façonne les structures sociales, la démographie, la culture, les secteurs économiques et l'identité de l'Andalousie.
Et à son tour, c'est ce qui façonne l'Andalousie en tant que nation. En ce sens, il est intéressant d'observer l'Andalousie à la lumière de ce que Gramsci a écrit sur la question méridionale. Il a compris que l'Italie du Sud fonctionnait, sur le plan politique et économique, comme une « immense campagne, par opposition à l'Italie du Nord, qui fonctionne comme une immense ville » 5. Et c'est précisément ces caractéristiques économiques et politiques et le rôle joué par le Sud qui ont formé et développé une question nationale pour le Sud. Il en va de même en Andalousie, où un fait national s'est constitué sur la base d'éléments matériels, sur un développement particulier du capitalisme qui a façonné toutes les structures sociales et l'identité nationale.
Ainsi, l'État espagnol moderne repose sur deux questions étroitement liées : la classe et le territoire. L'État espagnol, et la notion même d'Espagne, se sont constitués comme un artefact au bénéfice d'une classe sociale qui s'est formée au fur et à mesure que le capitalisme se développait, et qui tirerait profit de ce processus. Et qui, en même temps, il se construisait sur la base d'une distribution territoriale des secteurs économiques, des bénéfices et des politiques, qui généraient directement des territoires sacrifiés. L'Andalousie était l'un de ces territoires.
La clé de cette construction territoriale de l'État espagnol a été et continue d'être l'extractivisme. C'est la relation constituée avec certains territoires, transformés en zones sacrifiée par le biais d'un capitalisme purement extractif.
L'Andalousie sert de lieu d'extraction de matières premières manufacturées dans d'autres lieux, elle sert de zone d'implantation pour les industries les plus polluantes, de décharges dangereuses ou de stockage de déchets nucléaires (le seul cimetière nucléaire de l'État se trouve en Andalousie). Nous sommes également un territoire d'où l'on extrait une main-d'œuvre bon marché grâce à l'émigration de millions de personnes ou dans lequel on place certains secteurs productifs qui génèrent peu de valeur ajoutée, ont un impact environnemental énorme et répartissent très mal la richesse, comme le tourisme ou la construction. Le même processus peut être observé dans l'extraction de revenus par le biais du logement, le territoire étant le plus touristique d'Europe, ou au niveau culturel avec l'appropriation de la culture andalouse en tant que culture espagnole, avec l'exemple flagrant du flamenco.
Par conséquent, l'Andalousie n'est pas arrivée tardivement au capitalisme, et elle n'est pas non plus en retard. L'Andalousie joue un rôle pionnier et fondamental dans le capitalisme espagnol, elle joue un rôle de périphérie en expropriation permanente. L'Andalousie a été et est sacrifiée quotidiennement au profit de la classe sociale qui dirige l'État. Pour reprendre l'idée de Manuel Delgado Cabeza, l'Andalousie n'est pas arriérée, mais elle est l'arrière-cour du développement des autres.
Comme nous l'avons souligné, les bénéficiaires du rôle de l'Andalousie ne sont pas les classes populaires du nord de l'État, de la Catalogne, du Pays basque ou de Madrid. Les bénéficiaires de tout ce processus de construction territoriale de l'État espagnol sont l'oligarchie et les élites qui profitent de cette expropriation permanente de la richesse. Les élites andalouses aussi, ne l'oublions pas.
C'est pourquoi, en Andalousie, le malaise andalou a une explication qui rend inséparables la question nationale et la question sociale. On ne peut comprendre l'une sans l'autre, car la configuration nationale même de l'Andalousie repose sur les intérêts de la classe privilégiée. En d'autres termes, l'intérêt des classes laborieuses andalouses passe par une transformation, subversive, du rôle de zone sacrifiée que l'État espagnol a donné à l'Andalousie, c'est-à-dire qu'il passe aussi par la libération nationale de l'Andalousie.
Ainsi, nous bannissons du chemin de la libération de l'Andalousie toute hypothèse qui indiquerait la nécessité d'une approche interclassiste de la question andalouse ou d'une alliance avec les élites andalouses ou l'oligarchie andalouse.
Il n'est pas possible, même avec une vision étapiste telle que proposée par certains courants nationalistes à d'autres moments de l'histoire, de promouvoir une sorte de « révolution nationale » en alliance avec une bourgeoisie progressiste, car celle-ci a pleinement intérêt au maintien du statu quo, puisque la situation d'oppression en Andalousie correspond pleinement à ses intérêts matériels.
Une souveraineté andalouse pour construire l'écosocialisme
Par conséquent, une fois que nous avons vu l'origine du malaise andalou et comment l'État espagnol a été configuré sur l'imbrication des privilèges de classe et de l'inégalité territoriale, dont les classes ouvrières andalouses sont les perdantes, il ne nous reste qu'une seule réponse.
Une réponse qui aurait pour objectifs simultanés la libération sociale de la classe ouvrière et le dépassement du rôle de périphérie extractive dont souffre l'Andalousie. De plus, elle incorporerait de manière intersectionnelle la lutte contre l'oppression hétéropatriarcale subie par les femmes et les personnes LGTBIQ+, l'antiracisme, tout cela dans le cadre de la crise écologique d'une planète aux ressources limitées.
C'est là que le concept de souveraineté entre en jeu. Pour l'expliquer, je cite Nancy Fraser lorsqu'elle explique que la clé est de savoir comment et qui décide de l'utilisation de ce qui reste une fois qu'on a reproduit la vie et reconstitué ce qui a été dépensé. Fraser souligne que « la manière dont une société utilise ses capacités excédentaires est centrale : elle soulève des questions fondamentales sur la manière dont les gens veulent vivre – où ils choisissent d'investir leurs énergies collectives, comment ils entendent équilibrer le “travail productif” avec la vie de famille, les loisirs et d'autres activités – ainsi que sur la manière dont ils aspirent à se comporter avec la nature non humaine et sur ce qu'ils entendent léguer aux générations futures. Les sociétés capitalistes ont tendance à laisser ces décisions aux “forces du marché” » 6.
C'est précisément en Andalousie que nous subissons une double usurpation de la capacité à décider, de la souveraineté, sur tout ce qui est important dans la société. D'une part, en subissant un modèle économique, le capitalisme, qui accorde cette souveraineté aux « forces du marché » ; et d'autre part, en subissant un type de capitalisme, extractif et périphérique, qui nous place dans une situation de dépendance totale et d'infériorité. En tant qu'hommes et femmes de la classe ouvrière et de l'Andalousie, la subalternité est double.
Carlos Arenas Posadas a dit (et j'ai lu Oscar García Jurado) que « les peuples pauvres sont ceux qui n'ont pas la liberté de gérer leurs ressources, ceux qui n'ont pas les moyens de développer pleinement leur potentiel ».
Par conséquent, l'idée de souveraineté que nous devons défendre est précisément cela. La capacité des sujets politiques à décider démocratiquement comment, quoi, combien et quand produire, comment distribuer démocratiquement, comment utiliser notre temps, nos corps et comment nous relier les uns aux autres, aux autres sujets politiques, aux animaux non humains et à la planète.
Celles et ceux qui souffrent de ces oppressions croisées entre classe, nation andalouse, hétéropatriarcat et race sont les classes populaires andalouses et, à ce titre, sont constitué·es en tant que sujet politique pour lequel nous revendiquons la souveraineté.
La seule réponse utile pour les classes populaires andalouses est donc cette idée de souveraineté comme projet politique qui mise sur la capacité à décider de nos vies dans le but de renverser l'oppression de classe et le rôle de périphérie extractive, c'est-à-dire l'oppression nationale, que nous subissons en Andalousie.
Une telle souveraineté impliquerait de décider de notre propre voie, qui ne consiste pas à continuer à gravir l'échelle du développement capitaliste. Il ne s'agit pas de promouvoir un développement avec les mêmes valeurs et paramètres que ceux suivis par d'autres territoires, mais plutôt de le renverser.
De promouvoir un développement endogène écosocialiste, en partageant les richesses, selon les clés indiquées par l'économie écoféministe et en affrontant la crise climatique et énergétique de manière équitable, dans une relation saine avec la planète.
Seule cette proposition, qui comprend que l'oppression de classe en Andalousie ne peut être envisagée qu'en recoupant le fait national andalou et la construction territoriale de l'État espagnol qui condamne l'Andalousie à l'extractivisme, a le potentiel de comprendre l'identité même du peuple andalou.
Le peuple andalou a été façonné par des processus historiques et par le développement économique et social. C'est précisément ce processus qui a généré ses caractéristiques, ses éléments culturels, ses institutions sociales, ses expressions de toutes sortes, ses traditions et son identité. Tout ce processus constitue un fait complexe, contradictoire et différencié, avec ses propres expressions et une réalité différenciée.
La seule façon d'essayer de l'organiser et d'avancer vers une rupture avec le capitalisme pour façonner une Andalousie écosocialiste sera de comprendre ce fait national et de formuler une proposition pour résoudre ses contradictions : la souveraineté andalouse pour l'écosocialisme.
Si, par contre, la gauche de transformation sociale continue à ne pas comprendre la question nationale andalouse, il sera impossible non seulement que l'Andalousie cesse de souffrir des douleurs, silencieuses et séculaires, qui provoquent ce malaise andalou, mais il ne sera jamais possible non plus de se connecter réellement avec le seul peuple capable de surmonter ce malaise : la classe ouvrière andalouse.
Il ne sera jamais possible de transformer un peuple qui ne se comprend pas. En tant que révolutionnaires, notre obligation est de faire la révolution écosocialiste dans le lieu et le moment historique où nous vivons. Notre lieu s'appelle l'Andalousie.
Le 16 décembre 2024
Notes
1. « L'état de la pauvreté en 2024 ». Réseau européen de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Espagne.
2. Approximación al capitalismo andaluz, Oscar García Jurado.
3. Le désamortissement ou désamortisation (desamortización en espagnol) est un processus économique entamé en Espagne à la fin du 18e siècle par Manuel Godoy et qui s'est prolongé jusqu'au 20e siècle, consistant à mettre aux enchères publiques des terres et des biens improductifs détenus dans l'immense majorité des cas l'Église catholique ou les ordres religieux, qui les avaient accumulés par le biais de nombreux legs ou donations, ainsi que des propriétés foncières appartenant à la noblesse.
4. Oscar García Jurado, idem.
5. Gramsci, Antonio. « Rapport sur le troisième congrès du parti communiste italien », publié dans l'Unitá, 24 février 1926. Dans « La question méridionale », Antonio Gramsci.
6. Nancy Fraser, Le capitalisme est un cannibalisme, 2025.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Autriche : Un gouvernement d’extrême droite en vue

Le chancelier conservateur Karl Nehammer, qui s'était engagé lors des élections législatives autrichiennes du 29 septembre à ne pas être le marchepied de Kickl pour la chancellerie, vient de démissionner de ses postes de chancelier et de chef de parti le 4 janvier en lui laissant la voie libre.
19 janvier 2025 | tiré du site de la gauche anticapitaliste
https://www.gaucheanticapitaliste.org/autriche-un-gouvernement-dextreme-droite-en-vue/
En septembre, le Parti autrichien de la liberté (FPÖ), d'extrême droite, dirigé par Herbert Kickl, devenait le premier parti avec 28,85 %, juste devant le Parti populaire autrichien (ÖVP), conservateur de droite, avec 26,27 %. Les sociaux-démocrates, 21,1 %, avaient exclu d'emblée toute coalition avec le FPÖ à un niveau national. Les conservateurs ont pu choisir s'ils préféraient gouverner avec Kickl ou avec les sociaux-démocrates.
Les négociations avec les sociaux-démocrates et les libéraux de « Neos » en vue d'une coalition gouvernementale ont été interrompues par « Neos » et les conservateurs. Les deux n'étaient pas du tout disposés à négocier ne serait-ce qu'une participation des riches et des super-riches à l'assainissement nécessaire du budget (réintroduction d'un impôt sur les successions ou sur la fortune), tant la pression exercée par le capital était forte. Les sociaux-démocrates avaient également proposé des alternatives telles qu'une taxe sur les banques — tout a été balayé d'un revers de main.
Depuis, les conservateurs se sont déclarés prêts à former un gouvernement avec l'extrême droite. Kickl a fait du lobbying avec succès en promettant de mettre en œuvre le programme économique des conservateurs s'il pouvait en échange occuper la chancellerie et des ministères importants.
Une politique contre la classe ouvrière
Le FPÖ et l'ÖVP savent que la mise en œuvre du programme économique de l'ÖVP entraînera un changement d'humeur de la population.
Il est prévu de détruire, ou du moins d'affaiblir considérablement, le système de santé ; de s'attaquer aux travailleurEs du secteur public (gel des salaires des enseignantEs et des infirmières…) et aux retraitéEs (gel des pensions et relèvement de l'âge légal de départ à la retraite) ; de mettre en place une « réforme du marché du travail », c'est-à-dire de réduire les prestations et de durcir les conditions d'emploi ; d'augmenter les impôts de masse.
En raison des procédures en cours contre des représentants de premier plan de l'ÖVP et du FPÖ, les deux partis voient d'un bon œil l'affaiblissement des contrôles démocratiques et de l'État de droit. Ils prévoient aussi de s'attaquer à l'indépendance de la télévision et de la radio publiques et d'exercer une influence massive sur la presse papier.
L'affaiblissement de la « chambre des travailleurs » (Arbeiterkammer ou AK, dont l'origine remonte à la révolution de 1918-1919), voire sa destruction par la réduction ou la suppression des cotisations à cette chambre, est un autre point de départ. Il en va de même pour l'indépendance de la justice (suspension des procédures, empêchement des enquêtes et de l'ouverture de nouvelles procédures), de la Cour des comptes, de l'Institut de statistique publique d'Autriche ou encore de l'administration publique.
Racisme et réaction au cœur du programme
En renforçant encore les mesures xénophobes et anti-minorités, le mécontentement doit être détourné vers des boucs émissaires présumés (réfugiéEs, migrantEs, chômeurEs, bénéficiaires de l'aide sociale, LGBTIQ+ ou encore artistes critiques envers la société). En outre, le FPÖ et l'ÖVP soutiennent tout ce qui alimente la crise climatique et prônent l'abandon des objectifs climatiques.
De larges alliances pour la défense des droits démocratiques et sociaux et contre l'« orbanisation » sont désormais une nécessité. Leur succès dépendra de l'engagement total de la social-démocratie et des syndicats (les organisations à gauche de la social-démocratie ne jouent qu'un rôle très limité en Autriche). C'est un très grand défi compte tenu des décennies paralysantes du partenariat social, durant lesquelles les temps de grève moyens se mesuraient en minutes, voire en secondes par personne et par an !
Parallèlement, nous devons développer un programme de gauche offensif et démystifier non seulement le populisme de droite du FPÖ, mais aussi l'idéologie néolibérale des « Neos ».
Article initialement publié sur l'Anticapitaliste, le 16 janvier 2025
Crédit Photo : DR
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La russification forcée des enfants ukrainiens

Ce dossier se place dans la continuité d'une précédente enquête qui a servi de base à une communication envoyée en décembre 2022 au bureau du procureur de la Cour pénale interna- tionale (CPI). Celle-ci a contribué au dépôt, en mars 2023, de mandats d'arrêt contre Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova. Ce nouveau volet de notre en- quête révèle que Russie-Unie (R-U, voir enca- dré Russie-Unie), le parti politique de Poutine, a contribué à planifier, coordonner et exécu- ter la déportation, la russification et l'adoption des enfants ukrainiens. L'enquête souligne la dimension génocidaire de cette entreprise qui vise à incorporer les enfants ukrainiens à la na- tion russe. L'intention génocidaire se traduit dans les propos des membres de Russie-Unie qui répètent que l'Ukraine n'existe pas, que les terres et le peuple ukrainiens sont russes, et qui témoignent d'une volonté fanatique de russifier les enfants ukrainiens. La nouvelle communica- tion appelle donc la CPI à étendre ses mandats à d'autres hauts responsables et à requalifier ces crimes afin d'accroître la pression judiciaire sur le pouvoir russe.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Trois ans de guerre en Ukraine : manifestons les 23 et 24 février

Le Comité français du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (RESU), en ce début d'année 2025, appelle à participer massivement aux manifestations, actions, débats publics et autres initiatives qui seront organisés par les défenseurs·euses du peuple ukrainien à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion généralisée déclenchée par Poutine le 24 février 2022, et notamment à la manifestation prévue à Paris le dimanche 23 février.
7 janvier 2025 | tiré d'inprecor.fr
https://inprecor.fr/node/4526
Les actions menées autour de cette date auront une importance particulière en raison de l'avènement de Donald Trump à la présidence américaine, et des diverses pressions diplomatiques et économiques qui vont s'ajouter à l'agression meurtrière des armées russes et nord-coréennes et à l'occupation, pour imposer à l'Ukraine l'acceptation de celle-ci. La majorité des forces d'extrême droite en Europe pèsent en ce sens.
Nous rejetons les pressions menées au nom de « la paix » alors qu'elles ne contestent pas l'occupation, la russification des régions occupées, les déportations de populations et notamment d'enfants, et alors que pour l'impérialisme russe, l'Ukraine ne doit pas exister. Cette « paix »-là, c'est la légitimation d'annexions et c'est la poursuite de la guerre et de l'oppression.
Le Comité français du RESU réaffirme qu'il n'y aura pas de paix sans la justice que revendique la résistance populaire ukrainienne, armée et non armée. C'est pourquoi nous œuvrons à sa victoire pour une paix durable parce que juste contre les armés d'invasion de l'impérialisme russe. Et c'est aussi pourquoi nous nous insérons dans la solidarité internationaliste avec les luttes des mouvements sociaux, syndicaux, féministes et démocratiques en Ukraine.
Le Comité français du RESU soutient parallèlement la résistance antiguerre en Russie et au Bélarus.
Le Comité français du RESU appelle les gouvernements et États européens à fournir les moyens militaires et la protection aérienne que l'Ukraine demande – et aussi à annuler sa dette extérieure.
Le Comité français du RESU continuera de porter, dans la gauche et les mouvements sociaux français et dans les actions de solidarité avec l'Ukraine, la voix des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui luttent à la fois contre le démantèlement des services publics, de la santé et de l'éducation, et contre l'invasion et l'occupation. En effet les politiques néolibérales du pouvoir portent atteinte aux droits des travailleuses et des travailleurs, à la résistance et à la lutte contre l'invasion russe.
Publié le 5 janvier 2024 par le RESU
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Géorgie : soulèvement pour la démocratie dans le Caucase – Le peuple géorgien face au gouvernement

Ashley Smith, de Tempest, et Ilya Budraitskis, de Posle Media, ont interrogé les activistes et universitaires géorgiens Ia Eradze, Luka Nakhutsrishvili et Lela Rekhviashvili sur les racines du soulèvement, sa trajectoire et la place de la Géorgie dans le capitalisme mondial et l'ordre impérialiste.
17 janvier 2025 | tiré du site inprecor.fr
La Géorgie, petite nation caucasienne de 3,8 millions d'habitant·es, est entrée dans une crise profonde. Son peuple s'est soulevé contre le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, à la suite de l'adoption de sa « loi sur l'influence étrangère » d'inspiration russe, de sa loi homophobe sur la propagande anti-LGBTQ, du truquage des récentes élections et de la suspension des négociations d'adhésion à l'UE.
C'est le milliardaire Bidzina Ivanishvili qui tire les ficelles du Rêve géorgien. Il est l'oligarque le plus riche du pays et possède une fortune de 6,4 milliards de dollars, ce qui représente presque le budget total du gouvernement et un cinquième du PIB du pays. Lui et son parti, malgré leurs accrochages avec l'Occident et leur inclinaison vers la Russie, collaborent avec toutes les puissances impérialistes et les multinationales pour piller et exploiter le peuple, les richesses et les ressources du pays.
Excédé par cet autoritarisme et cette exploitation, le peuple géorgien est entré dans une phase de protestation massive contre son gouvernement, en faveur de la démocratie et de l'égalité. Le Rêve géorgien a réagi avec la plus grande brutalité, en réprimant les manifestations et en arrêtant les protestataires. Mais le mouvement ne montre aucun signe de recul et, à l'heure où nous publions, les manifestations de masse se poursuivent, pour le vingt-quatrième jour consécutif. Le pays est sur le fil du rasoir.
Ashley Smith, de Tempest , et Ilya Budraitskis , de Posle Media, se sont entretenus avec des militants et des universitaires géorgiens, Ia Eradze, Luka Nakhutsrishvili et Lela Rekhviashvili, à propos des racines du soulèvement, de sa trajectoire et de la place de la Géorgie dans le capitalisme mondial et dans l'ordre impérialiste.
Ilya Budraitskis Ashley Smith : Le peuple géorgien s'est soulevé, dans le cadre d'un nouveau mouvement de protestation de masse, contre le gouvernement. Les racines de ce mouvement sont, en partie, une réaction aux résultats des récentes élections qui ont ramené le Rêve géorgien au pouvoir. Quels étaient les thèmes de la campagne électorale ?Qui étaient les partis d'opposition et quels étaient leurs programmes ? La population s'est-elle montrée satisfaite de ces propositions ? Quels ont été les résultats officiels ? Les élections ont-elles été truquées ?
Luka Nakhutsrishvili : Nous sommes au cœur d'un soulèvement démocratique de masse contre le gouvernement du Rêve géorgien. Des centaines de milliers de personnes manifestent pacifiquement sur la place principale de Tbilissi et dans les villes et villages du pays. Au cours des deux dernières semaines, des marches de protestation ont été organisées à travers tout Tbilissi, en permanence. Des groupes professionnels et de quartiers de plus en plus nombreux ont commencé à s'auto-organiser. C'est un phénomène sans précédent dans notre histoire récente.
L'origine immédiate des protestations est la profonde crise de légitimité provoquée par le parti au pouvoir, qui suit le modèle adopté par Viktor Orban en Hongrie pour transformer son gouvernement en un régime autoritaire. Mais le Rêve géorgien est allé plus loin que la démocratie illibérale à la Orban en truquant les élections et en réprimant les manifestant.e.s d'une manière qui rappelle davantage le Belarus et la Russie. La suspension des négociations d'adhésion avec l'Union européenne n'a été que la dernière goutte d'eau.
Au cours des deux dernières années, le Rêve géorgien a pris un virage d'extrême droite spectaculaire. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2012, il se disait social-démocrate et était intégré au groupe socialiste du Parlement européen. Alors que beaucoup craignaient qu'il ne penche vers la Russie, il est resté favorable à l'intégration de l'UE et à l'adhésion à l'OTAN.
Mais depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, il a fait volte-face en optant pour l'euroscepticisme, en se ralliant au nationalisme de droite, en prônant une politique réactionnaire vis-à-vis des questions de genre, en faisant entrer les théories conspirationnistes dans le débat politique et en exprimant ouvertement sa sympathie à l'égard de la Russie.
Le Rêve géorgien a fait campagne sur la base d'un discours de peur, en arborant le slogan « choisissez la paix, pas la guerre », accompagné d'images montrant d'un côté une Géorgie florissante et de l'autre une Ukraine détruite. Le message était clair : si vous votez pour l'opposition, la Géorgie finira par être envahie et occupée par la Russie.
En ce qui concerne le socle du Rêve géorgien, s'il a perdu beaucoup d'électeurs favorables à l'intégration dans l'UE, il a gagné le soutien des électeurs nationalistes d'extrême droite qui approuvent leur loi anti-LGBT, s'opposent au projet supposé de Washington d'entraîner la Géorgie dans une guerre mondiale et expriment leur hostilité à l'égard des bureaucrates de l'UE qui, selon eux, violent la souveraineté de la Géorgie. Le reste de leurs électeurs les a soutenus par peur de la guerre, cyniquement exploitée par le Rêve géorgien.
Lors des élections, les quatre principaux partis d'opposition se sont regroupés en coalitions pour s'opposer à Rêve géorgien. Ce sont des partis issus des milieux technocratiques, la plupart d'entre eux étant rattachés au gouvernement précédent, et ils se sont révélés incapables de répondre aux préoccupations de la grande majorité des électeurs. La plupart ne les aiment pas et ont voté pour eux de manière tactique pour battre Rêve Georgien ou au moins les empêcher d'obtenir une majorité absolue et de gouverner seuls.
IB & AS : En fin de compte, le Rêve géorgien a obtenu la majorité malgré des accusations largement répandues selon lesquelles il aurait truqué les résultats. Est-ce vrai ?
LN : Oui. Les sondages indiquaient qu'il resterait le parti le plus important mais qu'il n'aurait pas assez de voix pour former un gouvernement seul (comme le parti d'extrême droite de Kaczynski après les élections de l'année dernière en Pologne). Personne n'avait prévu qu'il gagnerait avec 54 % des voix. Pour parvenir à ce résultat, il a eu recours à toutes les combines que l'autoritarisme permet d'imaginer, en convertissant en outil au service de son pouvoir la précarité des conditions de vie de la majeure partie de la population, dont il avait préalablement tout fait pour qu'elle perdure.
Le parti a organisé ce que nous appelons un « carrousel de vote » pour que ses partisans puissent voter à plusieurs endroits et obtenir ainsi des résultats plus élevés. Rêve géorgien a également fait pression sur les gens pour qu'ils votent pour lui en menaçant de leur couper l'accès à notre système minimal de protection sociale, y compris les soins médicaux. Ils ont intimidé les travailleurs du secteur public, comme les enseignants, avec la menace de leur faire perdre leur emploi.
Les forces de sécurité ont dit à des personnes dont des proches étaient en prison que si elles ne votaient pas Rêve géorgien, elles ne bénéficieraient pas d'un procès équitable. Elles ont confisqué les cartes d'identité de ceux dont elles savaient qu'ils soutenaient les partis d'opposition afin de les empêcher de voter.
Ils ont entravé le vote des centaines de milliers d'émigré.e.s. Pourquoi ? Parce que ces personnes avaient quitté le pays en raison de leur exaspération à l'égard des responsables politiques et de la pauvreté, et qu'elles sont plus enclines à voter pour l'opposition.
Rêve géorgien a ensuite invalidé la plainte déposée par le président pour que les élections soient déclarées inconstitutionnelles en raison de violations massives des lois électorales. Ils n'ont même pas attendu la décision du tribunal qu'ils contrôlent pour convoquer le parlement, ce qui est clairement contraire à la Constitution. Le Rêve géorgien a donc tout fait pour amplifier la crise de légitimité provoquée par la façon dont il a ouvertement et gravement truqué les élections.
IB & AS : L'élément déclencheur du soulèvement est la décision de Rêve géorgien de suspendre le processus d'adhésion à l'Union européenne. Pourquoi a-t-il pris cette décision, d'autant plus qu'une majorité de Géorgien.ne.s est favorable à l'intégration ?
Ia Eradze : Rêve géorgien a probablement suspendu les négociations d'adhésion parce que la fraude électorale n'a suscité que peu de protestations. Il ne veut pas non plus accepter les conditions de l'UE en matière de réformes démocratiques, qui menaceraient son maintien au pouvoir. Enfin, la Russie a sans doute exercé des pressions en coulisses.
La suspension des pourparlers a transformé la situation et réveillé les personnes qui, comme moi, étaient sous le choc des résultats de l'élection. Je me suis senti paralysé pendant environ deux semaines. Je ne pouvais rien faire. Il y a bien eu des manifestations après les élections, organisées par les partis d'opposition, mais elles n'ont pas été très suivies.
La faible participation était le fruit d'une paralysie collective. Il a fallu des semaines pour que les gens comprennent l'énormité du trucage qui a permis à Rêve géorgien de remporter une telle victoire. La colère a commencé à s'accumuler sous la surface. L'annonce par Rêve géorgien de la suspension des négociations d'adhésion, qui viole notre Constitution, a fait sauter le bouchon de cette colère accumulée qui a jailli dans tout le pays.
À bien des égards, cette annonce a été une chance. Je craignais vraiment qu'ils ne fassent semblant de participer aux négociations de l'UE, en simulant des accords, tout en instaurant un régime autoritaire. Cela aurait été bien pire. Heureusement pour nous, ils sont allés trop loin et nous nous trouvons maintenant au beau milieu d'un mouvement de masse contre le gouvernement.
La plupart des gens ne protestent pas seulement à cause de la question de l'adhésion à l'UE. Nous sommes dans la rue pour empêcher un gouvernement autoritaire de continuer à fouler aux pieds notre Constitution, nos droits et nos conditions de vie. Nous manifestons pour défendre notre démocratie contre la transformation par le Rêve géorgien de toutes les institutions de l'État, des écoles aux tribunaux, en outils au service de ses intérêts et de ceux des oligarques qui le contrôlent.
Le gouvernement a réagi à notre soulèvement avec une brutalité extrême. Il a commencé à faire des descentes chez les gens pour trouver les personnes qui, selon lui, préparent une révolution. Ils ont arrêté certains dirigeants de l'opposition. Le régime devient chaque jour plus autocratique. Près de 500 personnes ont été arrêtées et la plupart d'entre elles ont été passées à tabac ; certaines ont été torturées ( le représentant du ministère public lui-même a jugé que le traitement de nombreuses personnes détenues relevait de la torture). Ces derniers jours, nous avons vu des personnes être enlevées dans la rue par la police. Parmi les prisonniers, il y a des professeurs, des étudiant.e.s et des lycéen.e.e ;s, des artistes et des médecins.
IB & AS : À quoi ressemblent les manifestations ? Quels sont les groupes et les catégories de personnes concernés et pour quelles raisons l'adhésion à l'UE est-elle importante pour eux ? S'agit-il des mêmes que ceux qui ont protesté contre la loi spéciale ? Quelles sont les principales revendications des manifestants ?
Ia E : Elles sont énormes. Un fort pourcentage des 3,8 millions d'habitant.e.s du pays se sont joint.e.s aux manifestations. À Tbilissi, qui compte environ un million d'habitant.e.s, chaque jour, tout au long de la journée et de la nuit, au moins 100 000 personnes manifestent et, certains jours, plus de 150 000.
Ces manifestations sont bien plus importantes que celles qui ont eu lieu au printemps contre la loi sur les agents de l'étranger, et elles n'ont pas lieu qu'à Tbilissi. Elles se produisent dans tout le pays, pas uniquement dans les grands centres mais aussi dans les petites villes de la campagne.
Elles sont bien plus diverses que les manifestations du printemps. Des personnes de tous âges ont rejoint le mouvement. Les jeunes sont présents en force, mais aussi tous les autres. Il y a diverses catégories de personnes, depuis les professions libérales jusqu'aux ouvriers, qui y participent. C'est vraiment beau à voir.
Tout le monde se rend compte du danger qui nous guette. Je fais moi-même partie d'une association qui organise des actions pour la défense de l'éducation. D'innombrables autres groupes dans différents secteurs de la société font de même. Rien de tout cela n'est très coordonné. C'est comme si des flux d'initiatives organisées séparément convergeaient pour former des manifestations massives.
Lorsque je me réveille le matin, je regarde le programme des manifestations pour savoir à laquelle je souhaiterais participer. Un jour, je me suis retrouvée à quatre manifestations différentes. Si elles sont si nombreuses, c'est parce qu'elles sont toutes auto-organisées.
C'est une réalité qui va à l'encontre de ce qu'en disent les médias gouvernementaux qui tentent de présenter la contestation comme une conspiration, un « Maïdan » fomenté par des puissances étrangères et leurs agents locaux. Ce n'est absolument pas le cas. Elle est spontanée et décentralisée. S'il y avait une planification aussi centralisée, vous iriez aux rassemblements et vous verriez une tribune avec des prises de parole organisées. Il n'en est rien. En fait, sur la place principale de Tbilissi où se déroulent les manifestations, il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de discours et les partis d'opposition ne dirigent pas les manifestations.
Il n'y a même pas de slogans scandés au cours de la journée. La plupart des manifestations consistent simplement en une contestation silencieuse du gouvernement. Cependant, l'énergie qui s'en dégage est étonnante. Mais le mouvement trouve progressivement sa voix collective ; il a déjà formulé deux exigences fondamentales : de nouvelles élections et la libération immédiate de tous les protestataires et activistes emprisonnés.
LN : Au vu du degré de décentralisation de ce mouvement de protestation, il est intéressant de se pencher sur son mode d'expression. Les manifestant.e.s tirent des feux d'artifice pour le Nouvel An et réalisent des spectacles laser sur le bâtiment du Parlement, devenu le symbole de tout ce qui ne va pas dans ce pays. Ils organisent des concerts et tapent sur les barrières métalliques que les forces de sécurité installent pour contenir les manifestations et les empêcher d'accéder au Parlement.
Plus tard dans la nuit, les manifestations se transforment en affrontements de rue entre « partisans » et forces spéciales. Preuve de sa peur et de son choix de la répression, le gouvernement a interdit les feux d'artifice, les lasers et les masques de protection du visage.
Ia E : Je tiens à souligner qu'au milieu de cette spontanéité, les gens commencent à s'organiser en petites initiatives qui se rejoignent dans les manifestations. Aussi décentralisée soit-elle, la planification existe, les objectifs sont déterminés et un mouvement est en train de s'organiser.
Par exemple, les manifestations ont ciblé une série d'institutions publiques pour dénoncer leurs calomnies à l'encontre du mouvement ou leur indifférence face à la brutalité du régime. Parmi ces institutions, citons le Service public de radiodiffusion, le Théâtre national le Ministère de l'éducation, la Maison des écrivains, le Centre national du cinéma, le Palais de justice et le Centre national pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement.
Dans certains cas, des fonctionnaires ont rejoint les manifestants à l'extérieur, et ce fut très émouvant de voir cela. Les fonctionnaires ont également commencé à signer des pétitions et à organiser des défilés, en dépit des pressions exercées par un gouvernement qui cherche à effacer la frontière entre la loyauté vis-à-vis d'un parti et les institutions de l'État.
Les partis d'opposition ne jouent pratiquement aucun rôle dans le mouvement. Ils ont été mis à l'écart, malgré ce qu'en disent les médias occidentaux. Les gens disent en plaisantant que ces partis devraient au moins faire quelque chose comme de proposer du thé chaud lors des manifestations.
LN : Les médias de l'opposition surreprésentent leur présence pour des raisons évidentes. Ils veulent améliorer leur image. Il en va de même pour la propagande du Rêve géorgien dans les médias, qui cherche à faire croire que ces manifestations sont organisées par l'« opposition radicale ». Mais lorsqu'on se trouve sur les lieux des manifestations, on s'aperçoit que cette dernière ne représente qu'une force négligeable et qu'elle ne fait pas grand-chose.
Certains de ces responsables politiques sont tellement conscients de leur rôle insignifiant qu'ils refusent désormais d'être interrogés lors des manifestations. Par conséquent, les personnes qui répondent aux questions sont des jeunes, dont beaucoup portent des masques à gaz, et ce qu'ils disent a beaucoup plus de sens que tout ce qu'on peut entendre de la part des politiciens.
IB & AS : Ces manifestations semblent très similaires à la révolte de Maidan en Ukraine.Celui-ci a débuté parmi les étudiant.e.s, puis, face à la répression brutale, le mouvement s'est rapidement étendu au reste de la société, se transformant en un soulèvement de masse très actif qui a fait chuter le gouvernement. Avec les divisions au sein du gouvernement, les démissions et le personnel politique de l'opposition qui a rejoint les manifestations, pensez-vous que le soulèvement géorgien pourrait suivre la même trajectoire ?
Ia E : Il est désormais inimaginable que cette crise puisse être résolue de manière institutionnelle, pacifique et légale. Notre pays est le théâtre d'une confrontation à grande échelle entre le peuple et le gouvernement...
LN : L'escalade est évidente. Le gouvernement est entré dans une logique de surveillance, de descentes de police et de répression brutale. Mais cela n'a dissuadé personne de descendre dans la rue. Le mouvement exige maintenant, non pas de nouvelles élections, mais le départ du gouvernement lui-même, et ce dès maintenant. Le sentiment général est que c'est nous ou eux. Le mouvement a atteint un point de bascule et nous verrons s'il s'intensifie au point de remettre en question la capacité du Rêve géorgien à gouverner.
En ce qui concerne les similitudes avec le Maïdan ukrainien, paradoxalement, c'est le Rêve géorgien qui reprend le scénario du Maïdan, qu'il s'agisse d'annuler les négociations avec l'UE comme l'avait fait Ianoukovitch, d'interdire les masques ou de mobiliser les voyous dans les rues. Ils semblent incapables de comprendre que le soulèvement actuel n'est rien d'autre qu'une tentative de « Maïdanisation » de la Géorgie par ses ennemis internes et externes. Cette obsession de Maïdan pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a lamentablement échoué à comprendre - et à réprimer - ces protestations.
Lela Rekhviashvili : Le Rêve géorgien a également usé et abusé de l'insurrection de Maïdan pour effrayer les gens et les dissuader de protester. Ils ont dit que si l'on défie l'État de cette manière, la Russie interviendra et nous nous retrouverons envahis, occupés et en guerre comme l'Ukraine. Ils ont fait cela tout au long de la campagne électorale.
Mais le Rêve géorgien, dans son arrogance et peut-être sa bêtise, a suscité précisément cette opposition de masse qu'il avait présentée comme la pire des choses possibles. Leur autoritarisme est la principale cause de cette énorme vague de manifestations. Nous sommes maintenant sur le fil du rasoir, entre un gouvernement de plus en plus autocratique et un mouvement de masse qui ne montre aucun signe de recul.
IB & AS : Le scénario que vous décrivez ressemble à celui de nombreux autres soulèvements dans le monde, dans lesquels le fonctionnement normal d'un gouvernement ne permet pas de résoudre une crise. Souvent, dans de telles situations, la population met en place des mécanismes de substitution au gouvernement, des assemblées populaires, qui peuvent constituer un substitut à l'État. Y a-t-il des éléments indiquant que tous ces mouvements d'auto-organisation que vous décrivez se rassemblent pour former des niveaux plus élevés d'unité et de prise de décision démocratique ?
LN : Pas encore. Pour l'instant, les gens se mobilisent et trouvent de nouveaux moyens de résister aux gaz lacrymogènes, d'échapper à la répression et d'éviter les rafles et les arrestations auxquelles se livrent les autorités.
Ia E : Les gens commencent à s'organiser. Différents groupes et mouvements convergent vers des projets communs. Le meilleur exemple en est la façon dont de nombreuses forces se sont rassemblées pour protester contre le traitement partial de cette question par la chaîne de télévision publique et exiger qu'elle retransmette en direct la manifestations et qu'elle interroge des participant.e.s, ce qui a finalement contraint la chaîne à céder. Il y a des exemples, mais les gens ne se sont pas encore réunis en assemblées populaires pour discuter du mouvement et planifier collectivement des initiatives.
LN : Même ceux d'entre nous qui analysent et écrivent commencent à peine à y voir clair dans ce qui s'est passé au cours du mois dernier. Tout cela nous a pris par surprise. Comme le mécontentement suscité par les élections truquées n'a pas pu déboucher sur une protestation durable, nous avions commencé à nous préparer à une résistance lente organisée au sein de communautés plus restreintes. Mais voilà que les manifestations ont éclaté et se sont transformées en un véritable mouvement de lutte contre le gouvernement.
IB & AS : La Géorgie semble coincée entre plusieurs grandes puissances impériales - les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et la Chine - en raison de son rôle de point de transit pour le commerce mondial. Expliquez-nous le rôle de la Géorgie dans le capitalisme mondial. Est-ce que la suspension de l'adhésion à l'UE qu'imposerait le Rêve géorgien changerait sa position dans le capitalisme mondial ? Serait-t-elle alors davantage intégrée au capitalisme russe ?
LR : La Géorgie est un pays périphérique typique, dans lequel les puissances impériales ont, sous couvert de développement, favorisé la constitution d'un système économique prédateur. L'UE et les États-Unis ont largement orienté la politique économique du pays depuis le début des années 1990, concourant ainsi à la naissance de contradictions insoutenables. D'une part, ils veulent que la Géorgie soit démocratique, mais d'autre part, eux et les capitalistes locaux, en particulier l'oligarque le plus puissant, Ivanishvili, veulent piller le pays pour leur profit.
Leur programme de développement est impossible à mettre en œuvre et à appliquer dans le cadre d'une démocratie. Pourquoi ? Parce que le pillage et la paupérisation suscitent une opposition qui remet en cause cette stratégie de développement. Pour juguler cette résistance, il faut recourir à la répression et, ce faisant, basculer dans l'autoritarisme.
Le secteur de l'énergie est un bon exemple de cette contradiction, d'autant plus que l'objectif commun de l'UE et du gouvernement géorgien est de faire de la Géorgie une « plaque tournante de l'énergie » et un maillon d'un corridor énergétique « vert ». Dans les années 1990, mais surtout depuis la Révolution des Roses de 2003, les gouvernements occidentaux, les agences d'aide ( comme l'USAID) et les banques de développement (comme la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement) ont joué un rôle majeur dans la création d'institutions publiques destinées à faciliter la privatisation et la déréglementation du secteur de l'énergie.
En 2008, la Géorgie avait privatisé toutes les centrales hydroélectriques héritées de l'ère soviétique à l'exception de deux d'entre elles. Alors que les institutions occidentales appuyaient la privatisation et la création d'une économie dépendante des investissements directs étrangers (IDE), ce sont des capitaux essentiellement russes qui ont racheté les centrales électriques et les installations de distribution d'énergie.
Lorsque les possibilités d'attirer des IDE par le biais de privatisations se sont taries, le gouvernement - toujours en coopération avec des intervenants occidentaux - a commencé à soutenir la construction de nouvelles centrales hydroélectriques dans le cadre du programme de transition écologique de l'Union européenne. En 2024, le gouvernement avait signé des contrats pour 214 nouvelles centrales hydroélectriques dans tout le pays, même si les capacités existantes couvrent presque la demande d'électricité domestique. Pour attirer les capitaux, il a proposé des terrains et des ressources en eau à des prix minimaux et a promis que l'État protégerait les investisseurs contre toute une série de risques financiers, juridiques et politiques.
En raison de la nature extractiviviste des nouveaux projets hydroélectriques, des mouvements populaires à l'échelon local ont réussi à s'opposer à ces projets et parfois à les annuler ou à les entraver, en particulier les grands projets tels que Namakhvani, Nenskra et Khudoni.
Le gouvernement a reçu un nouvel encouragement à relancer tous ces projets de centrales hydroélectriques contestés et à en proposer de nouveaux en 2022, lorsque l'UE a commencé à créer un « corridor d'énergie verte » traversant l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Roumanie et la Hongrie, et qu'elle s'est engagée à financer la pose d'un câble électrique sous-marin traversant la mer Noire. Les institutions européennes, et tout particulièrement la Communauté européenne de l'énergie, ont collaboré à l'élaboration des projets qui ont permis au gouvernement géorgien de présenter les exportations d'électricité comme un élément clé de son programme de développement et de prendre l'engagement que toutes les grandes centrales hydroélectriques précédemment contestées seraient construites.
Au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis que cette nouvelle énergie hydroélectrique a été présentée comme un programme de « transition verte » et une panacée pour le développement, une série de capitalistes locaux ont appris de quelle manière il leur était possible de tirer profit de ce programme, certains rattachant de nouvelles centrales à la cryptomonnaie, ce qui a permis de créer un puissant lobby local favorable à la poursuite de l'expansion de ce secteur.
Le Rêve géorgien déclare que les mouvements d'opposition à l'hydroélectricité sont l'un de ses principaux ennemis. Il déclare ouvertement que la consolidation de son pouvoir, au travers notamment de l'adoption de la Loi sur les agents étrangers, est essentielle pour éliminer cette opposition au développement économique de la Géorgie.
C'est ce que je veux dire lorsque j'affirme que le programme de développement que le gouvernement géorgien a élaboré en collaboration avec les puissances occidentales, mais aussi au profit d'autres acteurs, notamment les capitaux russes et chinois (qui ne sont pas présents dans le secteur de l'énergie, mais qui sont importants dans les infrastructures de transport), est difficile, voire impossible, à mettre en œuvre démocratiquement. C'est pourquoi le Rêve géorgien, à l'instar de ses prédécesseurs politiques, évolue vers l'autoritarisme afin de mieux servir les intérêts du capital local et international.
Lorsque nous insistons sur le fait que la rupture du processus d'intégration à l'UE est dangereuse, ce n'est pas parce que nous en méconnaissons les conséquences problématiques ou que nous ignorons comment le populisme de droite ébranle les économies centrales et périphériques de l'Europe, ni comment de nombreux pays européens foulent aux pieds leur adhésion aux droits de l'homme, au droit international, à l'ONU, à la CPI et à la CIJ en poursuivant leur guerre conjointe, leur génocide, en Palestine.
Au contraire, il est parfaitement clair pour nous que la tendance actuelle à la consolidation autoritaire permet de dérouler le même programme de développement économique problématique sous un jour encore plus brutal, en supprimant même toute possibilité de s'y opposer. Cela signifie que nous sommes à la périphérie de l'Europe sans être protégés des pires effets de cette position périphérique par les mécanismes les plus élémentaires de protection des droits sociaux et politiques.
Et maintenant, qu'en est-il de la Russie et de la Chine ? Nous ne pouvons pas vraiment dire grand-chose sur la Russie, car tous les accords qu'elle a conclus l'ont été en coulisses, et non en public. La Russie a-t-elle exercé des pressions sur la Géorgie ? C'est probable, mais nous n'avons pas de précisions sur la nature de ces pressions. Toutefois, nous pouvons clairement observer que les responsables russes se déclarent satisfaits de la désagrégation des relations entre l'UE et la Géorgie.
La Chine est également restée discrète, mais ses intérêts économiques sont clairs. Elle considère la Géorgie comme un pays de transit qui lui permet d'accéder au marché européen. La Géorgie est particulièrement importante depuis que l'invasion impérialiste de l'Ukraine par la Russie a coupé la route nord de la Chine vers l'Europe.
L'un des itinéraires de substitution, appelé corridor médian des Nouvelles routes de la soie (Belt and Road Initiative, BRI), qui passe par la Géorgie, est devenu beaucoup plus important. La dernière chose que la Chine souhaite, c'est toute forme d'instabilité qui perturberait ses échanges commerciaux. Elle se désintéresse de la question de l'adhésion comme de l'autoritarisme, du moment que la route reste ouverte.
LN : La façon dont Lela présente le Rêve géorgien est bien meilleure que celle des campistes, qui laissent entendre qu'il s'agit d'une sorte de parti anti-impérialiste. La réalité, cependant, est beaucoup plus banale : La Géorgie est un régime oligarchique, dans lequel Ivanichvili s'assure de la loyauté de l'élite en accordant des avantages aux hommes d'affaires et aux responsables politiques moins fortunés, tandis que toutes les institutions publiques significatives, en particulier le système judiciaire, sont mises sous tutelle pour protéger leurs intérêts. Il existe donc une dynamique interne autonome qui reproduit le système oligarchique en Géorgie. Elle n'est en aucun cas réductible à une simple interaction avec le capital mondial ou occidental.
Les campistes ne le comprennent pas et finissent par excuser tout ce que fait le Rêve géorgien, depuis l'adoption de la Loi sur les agents étrangers jusqu'au trucage des élections, en passant par la répression du mouvement actuel. Mais, contrairement à la lecture qu'en font de nombreux campistes, la façon dont Rêve géorgien gère la situation n'est en aucun cas une simple réaction à « l'impérialisme occidental », ce qui justifierait indirectement leurs mesures autoritaires comme étant de l'autodéfense.
Les campistes se contentent de dénoncer l'Europe en raison de son histoire coloniale, de son présent néocolonial et de sa complicité avec le génocide, comme si c'était la fin de l'affaire. Bien que cela soit en grande partie vrai, ils présentent souvent la Chine comme une alternative en dépit de sa nature autocratique et de sa complicité avec notre exploitation et l'oppression dont nous sommes victimes. Ce n'est pas une solution de rechange.
Je pense qu'il est catastrophique pour la gauche d'abandonner ses principes démocratiques et de se faire le chantre du virage autoritaire du Rêve géorgien au nom de la souveraineté. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est aussi un désastre politique. Toute personne engagée dans une politique d'émancipation devrait refuser cette approche.
Si la gauche s'y rallie, elle est assurée de rester isolée et sans influence dans le plus grand mouvement de lutte pour la démocratie et l'égalité que nous ayons connu depuis des générations. Elle placera la gauche de l'autre côté des barricades qui se dressent devant ce mouvement.
LR : Cette gauche campiste singe le dévoiement par le gouvernement de concepts tels que la souveraineté et le discours décolonial. Ce faisant, elle s'aligne sur un gouvernement qui sert nos oligarques et le capital international et qui réprime violemment son propre peuple.
Les États autoritaires, de la Russie à la Hongrie en passant par la Chine, se servent cyniquement du terrible bilan de l'Occident en matière d'impérialisme et de colonialisme pour justifier leur propre domination prédatrice. Les partisans de la gauche qui acceptent cela sont dangereusement attirés par une alliance rouge/brune, comme Sara Wagenecht en Allemagne.
IB & AS : Compte tenu de cette situation de plaque tournante, comment toutes ces puissances qui ont des intérêts en Géorgie, pour différentes raisons, ont-elles réagi au soulèvement et à la crise que traverse actuellement la Géorgie, la Chine, la Russie, les Etats-Unis, l'Union européenne ?
LN : A ce stade, seules les puissances occidentales ont condamné la répression et la violence perpétrées par le gouvernement. Elles n'ont pas non plus reconnu les résultats des élections, alors que la Chine, la Turquie, l'Iran et la Russie ont félicité Rêve géorgien pour sa victoire. La Russie a également déclaré que si Rêve géorgien avait besoin d'aide, elle serait prête à envoyer des troupes.
Ia E : Si les gouvernements de l'UE ont condamné la brutalité de Rêve géorgien, ce n'est pas le cas des banques de développement occidentales. Pourquoi ? Parce que le Rêve géorgien montre qu'il a bien l'intention de continuer à rembourser ses emprunts et à mener à bien les projets de développement auxquels il a souscrit. Il semblerait que les banques fassent passer leurs intérêts économiques avant la démocratie. En même temps, il est clair que le Rêve géorgien et les élites économiques qui le soutiennent ont énormément profité des projets de développement financés par ces banques. Cela me permet de souligner, une fois de plus, que la trajectoire de développement économique suivie par la Géorgie n'a été ni imposée au gouvernement par l'Occident, ni inévitable, mais qu'il s'agit plutôt du choix conscient et plutôt lucratif du gouvernement du Rêve géorgien d'accepter les règles du système de développement dominant à l'échelle mondiale.
LN : Dans le pire des cas, l'UE cessera d'exercer une pression réglementaire et politique sur la Géorgie en faveur de la démocratisation et continuera à faire des affaires avec elle, même avec ce gouvernement lamentable, comme elle le fait avec l'Azerbaïdjan, la Serbie et d'autres pays d'Europe centrale et d'Asie centrale. La Serbie pourrait être un cas particulièrement intéressant en tant que pays qui semble bloqué de façon durable dans sa procédure d'adhésion. Tout en dénonçant l'autoritarisme de la Serbie, l'UE conclut des contrats très impopulaires relatifs à l'extraction du lithium sur son sol.
Les campistes à l'étranger ou nos souverainistes locaux pourraient interpréter cela comme le fait que l'Occident laisse enfin un pays souverain tranquille. Mais en réalité, ce sera un problème pour nous, car l'horizon des normes démocratiques, rattaché au cadre européen, est un outil indispensable pour exercer une pression populaire sur un gouvernement qui, par ailleurs, entend réduire la démocratie à néant. En ce sens, l'UE est, pour les manifestant.e.s, le symbole de la primauté du droit, des droits civiques et de l'égalité.
À ce stade, au niveau des masses, l'aspiration à l'Europe et le discours sur la « défense de l'avenir brillant et européen de la Géorgie » semblent être le seul langage disponible pour exprimer les exigences en matière de démocratie et de justice sociale. La question qui se pose alors est de savoir comment le peuple reformulera ces exigences au cas où l'horizon européen viendrait à s'effondrer. Comment pouvons-nous lutter pour la démocratie politique et l'égalité économique en étant coupés des normes démocratiques et des droits de l'homme établies par l'« Occident collectif » ?
IB & AS : Dans cette situation évolutive, que devraient préconiser, selon vous, la gauche géorgienne, les mouvements sociaux et les syndicats ? Est-il possible de construire une alternative politique à gauche pour défier le Rêve géorgien et les partis d'opposition pro-capitalistes ?
Ia E : C'est très difficile à dire parce que dans le passé, il y a eu des tentatives qui n'ont rien donné. Je suis très optimiste aujourd'hui, car le tournant autoritaire de Rêve géorgien a poussé les gens à une sorte de réveil politique.
Nous devons commencer à discuter de la création d'un parti. Pour l'instant, les gens commencent à parler de l'organisation d'un mouvement sur la base d'une plate-forme qui réunirait certaines des forces auto-organisées afin de présenter des revendications communes. Cela pourrait enclencher un processus.
LN : Dans le même temps, de plus en plus de gens ressentent le besoin de se syndiquer dans des syndicats pour la plupart nouveaux, qui ne seront pas soumis aux intérêts du parti Rêve géorgien. Il s'agit d'une réponse immédiate à deux phénomènes : beaucoup ont découvert que la grève était l'outil pacifique de protestation et de résistance le plus efficace, mais comme, d'un point de vue purement juridique, il n'est pas facile de faire une grève en Géorgie, l'organiser à travers un syndicat apparaît comme le moyen le plus pratique de s'y essayer. Plus important encore, de nombreux fonctionnaires ont commencé à chercher des moyens de se syndiquer en réaction aux récentes modifications très sévères de la législation sur la fonction publique adoptés à la hâte par Rêve géorgien, qui permettront bientôt aux dirigeants des différentes institutions publiques fidèles au parti de licencier plus facilement ou de faire pression sur les fonctionnaires critiques du gouvernement. Tout d'un coup, les grèves et les syndicats, qui auraient été considérés comme des anachronismes « gauchistes » ou « soviétiques » il y a quelques semaines, se retrouvent maintenant au centre de l'attention comme une nécessité organique qui surgit du milieu des protestations.
Notre première tâche est donc de développer la lutte et de la maintenir. La réponse autoritaire du gouvernement à notre mouvement pousse les gens à réfléchir à des stratégies et des tactiques que l'opposition libérale a tenté de discréditer, comme la grève générale pour préserver notre démocratie.
IB & AS : Quelle position la gauche internationale doit-elle adopter dans cette situation ?Et que pouvons-nous faire pour aider la lutte de la Géorgie pour l'autodétermination, la démocratie et l'égalité ?
LR : La gauche internationale est en fait confrontée à la même question que la gauche géorgienne : comment sortir du cadre opaque d'un conflit entre l'UE et la Russie ? La clé est de comprendre et d'expliquer comment les rivalités géopolitiques écrasent les pays périphériques.
Aucune personne qui se réclame de la gauche ne devrait s'attendre à ce que les puissances impériales - les États-Unis, l'UE, la Russie et la Chine - servent nos intérêts. Quelles que soient leurs rivalités, elles ont en commun des visées prédatrices et soutiendront un régime autoritaire pour s'assurer qu'elles pourront les mettre en œuvre. Il est important de noter que la concurrence inter-impérialiste et la lutte pour l'hégémonie créent de nouveaux risques et de nouvelles vulnérabilités pour les États périphériques, qui doivent être pris au sérieux.
Il serait souhaitable que la gauche internationale entre davantage en contact avec les militant.e.s et les activistes géorgien.ne.s. À ce stade, il existe un fort sentiment d'appartenance à la gauche géorgienne. À ce stade, il existe une forte tendance pour une grande partie de la gauche à rechercher des personnes qui confirment son schéma erroné et trompeur selon lequel l'impérialisme occidental est le seul coupable, qui accusent un mouvement populaire de masse d'être sa proie et qui disculpent le régime oligarchique local.
Si la gauche internationale suit l'exemple de ces personnes, elle finira par apporter son soutien à la mainmise du Rêve géorgien sur le capitalisme périphérique. Certains dans la gauche occidentale gagneraient à cesser d'être tellement autocentrés qu'ils limitent leur critique à l'impérialisme occidental exclusivement. Je ne leur demande pas de ne pas critiquer l'Occident, mais de le faire plus sérieusement et de critiquer également les acteurs non occidentaux. C'est la seule façon de maintenir une position cohérente qui s'oppose non seulement à l'Occident mais aussi au capitalisme et à l'impérialisme où qu'ils soient.
LN : Ce que je demande fondamentalement à la gauche internationale, c'est de reconnaître nos préocupations locales, l'autonomie du peuple géorgien dans le choix de ses priorité dans sa lutte pour la démocratie et contre ce régime autoritaire. Arrêtez de ressasser les discours sur un « second Maïdan » et une « révolution de couleur ». Cela peut vous donner un sentiment de rectitude, mais cela vous amène aussi à nous trahir et à excuser le régime qui nous opprime.
Ia E : Je trouve étonnant qu'à gauche, on puisse oublier qu'à la périphérie aussi, il y a des gens et des peuples qui peuvent prendre leurs affaires en main. Cette attitude politique est fondée sur le désespoir. C'est notre capacité d'action collective qui est est au cœur de la solidarité dans notre pays et avec d'autres partout dans le monde. Je vous le demande, soutenez notre lutte contre Rêve géorgien.
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro, Source - Tempest, 1 janvier 2025.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Trump : vers l’affrontement

Que se passe-t-il et que risque-t-il de se passer aux États-Unis, et en même temps dans le monde, suite à l'élection de Trump n°2 et de son aréopage de néofascistes, où brille l'homme le plus riche du monde qui a célébré leur victoire par deux saluts nazis, Elon Musk ?
Pour tenter de répondre, commençons par mettre en garde nos amis, lecteurs et camarades contre la pire des postures – assez répandue, c'est pourquoi il faut la combattre – celle qui dit que « business as usual », qu'après tout Biden ce n'était déjà pas terrible (certes), que ce sont tous des capitalistes (scoop !), et qu'après tout, maintenant que Trump est investi, on l'attend toujours, sa « dictature » et les millions et millions de deportees …
Juste une petite aggravation de l'ordinaire, vraiment ?
Un suprématiste blanc harceleur et tatoué est à la tête de l'armée (Pete Hegseth) et le Sénat a accepté. Une agente notoire de Poutine est à la tête du renseignement, Tulsie Gabbart. A l'heure où j'écris cet article, l'audition de Robert Kennedy Jr, pour la Santé (sic) est chahutée au Sénat. Mais les budgets de la recherche médicale ont déjà été massacrés – c'est le mot – en quelques jours.
Surtout, Trump a pondu des dizaines de décrets dont le sens juridique et constitutionnel est clairement de passer par-dessus le droit et la constitution. Il a aboli le droit du sol par décret, alors qu'il s'agit du 14° amendement : on peut toujours dire, par conséquent, que c'est sans valeur. Non : c'est programmatique, cela ouvre la voie à l'affrontement, dont l'enjeu est la transformation de la démocratie bourgeoise américaine en un régime, pour le moins, bonapartiste.
La menace de suspension des fonctionnaires locaux qui ne marcheraient pas avec les fédéraux pour rafler les migrants, comme le dépôt d'une proposition de loi visant à permettre la réélection de Trump en 2028, vont dans le même sens.
Et il prépare un décret obligeant les amérindiens à choisir entre leur peuple (Navajos, Dakotas …) et la citoyenneté américaine, et qui les rendrait expulsables (où ça ?!) s'ils font le « mauvais » choix !
Ce décret vise aussi de facto à mettre fin à la relative sanctuarisation de ce qui reste des terres des peuples dits premiers, ouvrant la voie au forage tous azimuts, cette politique incendiaire et criminelle résumée dans le slogan sexiste : Drill, baby, drill !
Alors, certes, la rafle soudaine de 11 millions de personnes n'a pas eu lieu, ou pas encore. La frontière Sud est plus fermée que jamais. Des rafles ont lieu, et la Colombie a tenté de s'opposer à l'atterrissage d'un avion de personnes kidnappées, provoquant des représailles douanières – tarifs douaniers haussés de 25% puis de 50% – provoquant une riposte colombienne similaire, dans laquelle les États-Unis sont commercialement perdants.
Cet exemple montre que la politique intérieure et la politique internationale se confondent plus que jamais. Tous les chefs d'État du monde prennent au sérieux ce qui, sous Trump n°1, aurait passé pour sa plus grande bouffonnerie : la menace d'annexion du Groenland, de blocus du Canada, de mainmise sur le canal de Panama.
Pour comprendre les enjeux, prenons un peu de recul. Le « POTUS » (président des États-Unis) est un personnage contradictoire : il a le pouvoir de tuer des civils et de bombarder des villages au Yémen, mais pas celui de désarmer qui que ce soit au Texas ou dans le Maine. Pour Trump, il s'agit aussi de surmonter cette vieille contradiction – et plutôt pour permettre à ses partisans armés d'agir.
Ses milices existent, il a tout de suite libéré la bande du 6 janvier 2021, mais la base la plus massive pour un fascisme sui generis est sans doute fournie par la New Apostolic Reformation, qui recrute à la fois parmi les protestants et les catholiques des adeptes de l' « avènement du royaume » dont Trump est pour eux le Saint Jean Baptiste : des talibans.
Renforcement bonapartiste du pouvoir présidentiel sous la pression latente ou ouverte de la violence politique : c'est bien la question du régime qui se pose aux États-Unis, qui ne sont pourtant pas la France, car ils n'ont eu qu'une seule constitution, certes évolutive par amendements, depuis 1789, une constitution qui est le marqueur de l'identité nationale. Si Trump gagne, c'est un énorme chamboulement comportant, y compris, des possibilités de sécessions d'États. Si Trump perd … aussi, mais dans l'autre sens !
Avant l'investiture du 20 janvier, Chicago avait été désignée dans les discours trumpistes comme le premier point focal de l'affrontement : des rafles étaient annoncées contre les quartiers latinos. Le 19 janvier, le « tsar des frontières » Tom Homan a commencé à reculer devant Chicago. Le puissant syndicat des écoles primaires, le Chicago Teachers Union, avait commencé à prendre des mesures de protection des enfants. Et le conseil municipal avait voté à la majorité le refus de coopérer du personnel local avec les agents fédéraux.
Trump se trouve devant trois grands obstacles ou fêlures potentielles. A l'échelle internationale, le projet d'isolement de la Chine par réconciliation avec la Russie (en lui livrant l'Ukraine) n'a aucune garantie de réussite. Dans son propre bloc de pouvoir, Elon Musk est de fait une figure concurrente, représentant du sommet mondial du grand capital, où se rencontrent le capital fixe technologique le plus productif, la finance la plus spéculative et la plus parasitaire, et la collusion avec l'État indispensable à ces messieurs les libertariens, qui ne sauraient s'en passer. Mais la contradiction décisive de Trump est la troisième.
C'est la résistance potentielle non seulement des migrants et des femmes, mais du salariat nord-américain et notamment, bien sûr, du salariat syndicalement organisé. Le Project 2025, programme de destruction des syndicats dans le secteur public, et d'intégration de ceux-ci aux entreprises dans le secteur privé, élaboré par le vieux think tank néolibéral qu'est la Heritage Foundation, est considéré comme le mandat des principaux capitalistes à Trump ; le ralliement de Musk et des têtes d'affiches de la Silicon Valley en a procédé.
Il est vrai que les directions syndicales ne se préparent pas à l'affrontement. Celles des Teamsters et des Dockers ont donné des gages à Trump. La plus combative, la nouvelle direction de l'UAW, United Automobile Workers, a gagné de grandes grèves sur les salaires fin 2023, mais a perdu sur son appel au vote Harris. Après avoir lancé un appel au regroupement de la working class – on parle bien ici de working class et pas de middle class – après l'élection de Trump, son dirigeant Sean Fain a déclaré au Washington Post, le 19 janvier, qu'il était « prêt à travailler avec Trump »¸notamment sur les tarifs protectionnistes. Cette grave reculade de sa part est significative de la pression qui s'exerce au moment présent.
S'il est erroné de croire que les ouvriers étatsuniens ont massivement voté Trump, il est exact qu'une partie conséquente de sa base électorale est formée d'ouvriers et d'employés ou d'anciens salariés déclassés et comporte une partie de la base syndicale. Le syndicat des dockers de la côte Est, International Longshoremen's Association, avait appelé à la grève sur toute la côte Est, du Texas au Maine, contre les mesures déqualifiantes de rationalisation des ports. La grève devant démarrer le 15 janvier et son caractère massif ne faisait pas de toute. Trump a surpris une partie de ses proches en disant soutenir les dockers et a reçu les chefs syndicaux à Mar-a-Lago. En leur présence, il aurait téléphoné aux syndicats patronaux et obtenu un accord, désamorçant la grève. L'accord protège dans l'immédiat les 85 000 syndiqués de l'ILA de la déqualification et de la précarité … mais pas les futurs nouveaux embauchés.
Disons-le, c'est là un coup de maître de la part de Trump, au sens bonapartiste, qui confirme que sans sa tête à lui, il n'a d'autre mandat que de lui-même. Mais Project 2025 n'est pas un programme orienté vers une alliance présidentielle avec la bureaucratie syndicale, à la façon péroniste, c'est bien un programme de destruction de tout cadre collectif pour précariser et ubériser. Ce bon coup ne fait donc que reporter la contradiction.
Au moment présent, Project 2025 semble commencer à s'appliquer, mais pas n'importe où : dans l'enseignement. A partir d'un décret coupant les financements publics aux écoles enseignant une « théorie critique de la race » – c'est-à-dire expliquant aux élèves, comme on le fait en Europe, que les races n'existent pas et que le racisme est condamnable -, s'amorce une attaque généralisée. La National Education Association (3 millions de membres) est déjà en pointe dans la défense des migrants qui sont les enfants de bien des écoles. En son sein, le syndicat de Chicago appelle à une action nationale dès le mardi 4 février. Se rejoignent ici la défense de tous les enfants contre les mesures anti-migrants, la défense des écoles publiques avec le refus du « vol » de l'argent public au profit du privé, et le refus de la mise au pas idéologique des écoles que veulent imposer les talibans de la New Apostolic Reformation.
On le voit, les batailles se préparent. Mais leur terrain est international : la résistance des peuples, des femmes, du salariat, à Trump et à Musk, sera aussi leur résistance à Poutine et les enjeux se concentrent rapidement sur l'Europe. Cette situation est une raison de plus, ici même, pour imposer l'unité afin de battre au plus vite l'exécutif illégitime de Macron et Bayrou, car la démocratie en France sera nécessaire aussi pour la contre-attaque européenne contre l'ordre gris-brun des Trump, des Musk et des Poutine !
Vincent Présumey, le 31/01/2025.
Cet article est destiné à la parution dans le prochain numéro de la revue D&S (Démocratie & Socialisme) qui devient un organe de l'APRES à la suite de la fusion décidée conjointement entre l'APRES et la GDS.
Source : Aplutosoc : https://aplutsoc.org/2025/02/01/trump-vers-laffrontement-par-vp/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La tragicomédie trumpienne

Le retour à la présidence de Donald Trump illustre parfaitement un propos de Karl Marx qui disait essentiellement ceci l'histoire se répète en deux temps, la première fois comme une tragédie et la seconde fois comme une farce.
Le debut du second mandat de Trump prend toutes les allures d'une bouffonnerie, à commencer par le portrait officiel de Trump lui-même, à peine retouché de la photo d'identité judiciaire prise alors qu'il faisait l'objet d'accusations criminelles voici quelques années.
Il existe des périodes où une puissance hégémonique essoufflée devient sa propre caricature en se repliant sur une interprétation littérale, pour ne pas dire figée et hors contexte de ses heures passées de grandeur. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner certaines des annonces que Trump a faites lors de son intronisation : rebaptiser le golfe du Mexique en "golfe d'Amérique", entamer une guerre commerciale avec son plus proche allié, le Canada, expulser sans discernement les sans-papiers, ne reconnaître juridiquement que deux genres (masculin et féminin), ce qui écarte de la reconnaissance légale les gens trans et non binaires.
Le trumpisme nie, comme tout mouvement réactionnaire, les réalités qui lui déplaisent au profit "des valeurs fondamentales qui ont fait l'Amérique". La formule ne provient pas de lui, mais elle résume fort bien sa tendance idéologique.
Trump et son cabinet seront-ils en mesure de réaliser leur projet de renforcer l'impérialisme américain ? C'est plus que douteux. Les mesures proposées sont même plutôt susceptibles de l'affaiblir encore davantage. Ce qui caractérise les intentions qui animent Trump et ses lieutenants, c'est l'irréalisme qui marque plusieurs d'entre elles. Par exemple, elles vont fragiliser les liens entre les États-Unis et l'Union européenne de même que ceux avec le Canada.
Laisser planer la menace d'une invasion du Groenland, province du Danemark, petit pays très respecté de l'Europe, ne peut que diminuer la crédibilité de Washington sur le Vieux-Continent.
Pareil pour le canal de Panama : une attaque américaine contre ce petit pays aviverait les tensions entre les gouvernements de la région et la Maison-Blanche. De plus,Trump menace le Mexique d'une guerre commerciale (comme avec le Canada) ; une initiative inconsidérée qui aboutirait à lui mettre à dos cet important pays.
Dans quelle mesure l'administration Trump est-elle sérieuse dans ses projets ? Difficile à dire, bien qu'on décèle pour certains d'entre eux une part de bluff. Exagérer la puissance du pays qu'on dirige pour intimider partenaires, concurrents et adversaires relève d'une stratégie d'intimidation qui vise à masquer l'affaiblissement de son impérialisme.
Et le peuple américain dans tout ça ? En termes de vote populaire, Trump l'a emporté de très peu sur Harris (49,8% pour le premier, 48,3% pour la seconde). Il ne s'agit donc pas d'un triomphe populaire pour Trump. Le noyau dur du trumpisme est minoritaire. Plusieurs analystes estiment qu'une bonne partie de ceux et celles ayant appuyé Trump l'ont fait davantage par protestation contre Biden et les démocrates (à tort ou à raison) que par adhésion à l'idéologie réactionnaire des trumpistes. La base électorale de ceux-ci est donc fragile.
Si Trump et ses séides essaient de réaliser intégralement leur programme de répression sociale, ils vont se heurter à la farouche opposition des nombreux groupes visés. Des troubles sociaux sont donc prévisibles. Les démocrates auront alors une chance de remporter une majorité (de quelle ampleur ? ça reste à voir) au moins à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat dans deux ans.
Du côté démocrate justement, l'impopularité de Biden et la dégelée électorale que le parti a subi vont favoriser (du moins, on peut l'espérer) des remises en question sur la politique économique, sociale et étrangère au profit d'une autre axée sur une meilleure redistribution de la richesse et d'une ouverture réelle à certaines causes, la palestinienne par exemple. Dans certaines régions, le mécontentement de l'électorat d'origine arabe a contribué à la défaite de Harris.
Si ce retournement arrivait, l'électorat se trouverait lors du prochain scrutin présidentiel en face d'un véritable choix entre des démocrates progressistes et des républicains réactionnaires.
Alexis de Tocqueville, qu'on cite souvent pour comprendre les fondements de la démocratie américaine, jugeait que le danger qui menaçait celle-ci était l'éventuel despotisme de la majorité. Or, l'examen de l'évolution de la société américaine depuis quelques décennies nous amène à penser que certaines analyses de Marx sont plus pertinentes pour comprendre son évolution. En effet, depuis au moins les années 1980, on observe la montée fulgurante d'inégalités sociales et du renforcement très marqué du capitalisme financier, favorisé entre autres par les traités de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. C'en est rendu que même des millionnaires s'en alarment. Le règne des multimilliardaires menace le type de capitalisme auquel ils sont habitués et qui les sert d'habitude si bien. Un autre aspect de la situation à surveiller. De quoi passionner les analystes politiques de toute obédience idéologique.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Jean-François Delisle

La boule de démolition de Trump

Au cours de sa première semaine de mandat, le président Donald Trump a lancé une boule de démolition qui a brisé des institutions, enfreint des lois et semé la pagaille. L'effet est vertigineux.
Hebdo L'Anticapitaliste - 739 (30/01/2025)
Par Dan La Botz
Traduit par la rédaction
Pour commencer, Trump a utilisé la grâce présidentielle pour libérer plus de 1 550 personnes impliquées dans l'insurrection du Capitole le 6 janvier 2021, renversant ainsi les décisions du ministère de la Justice et des tribunaux fédéraux. Parmi les personnes libérées figurent deux leaders d'extrême droite, Enrique Tario des Proud Boys et Stewart Rhodes des Oath Keepers, tous deux condamnés pour sédition à des peines de 22 et 18 ans de prison. Ils sont désormais libres d'organiser leurs mouvements fascistes.
Efficacité et suppression des lois contre la discrimination
Trump veut un contrôle total du gouvernement et agit en ce sens. Il a licencié une vingtaine d'inspecteurs généraux indépendants chargés de promouvoir l'économie et l'efficacité et de prévenir les gaspillages, les fraudes et les abus. Dans le même temps, il a créé un ministère de l'Efficacité gouvernementale (DOGE) dirigé par le milliardaire Elon Musk, afin de moderniser la technologie et de maximiser l'efficacité du gouvernement. Divers groupes de surveillance et syndicats ont intenté une action en justice pour stopper le DOGE.
Trump a également supprimé tous les postes du gouvernement fédéral qui travaillaient sur les programmes de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité (DEIA) destinés à garantir l'équité en matière d'emploi pour tous, quels que soient le genre, la race ou le handicap. Il a qualifié ces programmes de « radicaux et inutiles ». Trump a abrogé le décret 11 246, promulgué par le président Lyndon Johnson en 1965 pour mettre fin à la discrimination dans les marchés publics. Il a également annoncé que le gouvernement fédéral ne reconnaissait que deux genres, l'homme et la femme, et que les mois de l'histoire des NoirEs et des femmes ne seraient plus célébrés.
Contre les immigrantEs, la santé et les fonctionnaires fédéraux
Trump a déclaré une « urgence nationale » à la frontière sud et a envoyé des troupes américaines sur place pour stopper ce qu'il appelle « l'invasion d'immigrants ». Il a fermé l'application utilisée pour prendre des rendez-vous en matière d'asile et a annulé 30 000 rendez-vous prévus. Le président a également révoqué la liberté conditionnelle humanitaire temporaire pour 30 000 réfugiéEs du Nicaragua, du Venezuela, de Cuba, d'Haïti et d'Ukraine qui vivent et travaillent aux États-Unis. Les centaines de milliers d'immigrantEs originaires de nombreux autres pays qui bénéficient d'un statut de protection temporaire, un autre programme accordant un droit de séjour temporaire, sont eux aussi en proie à la peur. La police de l'immigration peut désormais cibler les hôpitaux, les écoles et les églises, ce qui était auparavant interdit. Trump a tenté de mettre fin à la citoyenneté de naissance par décret, mais un tribunal fédéral l'en a empêché en déclarant que son action était inconstitutionnelle.
Le président a ordonné une pause sans précédent de 10 jours de toutes les activités des agences de santé et de services sociaux telles que les Centers for Disease Control et les National Institutes of Health, interrompant toutes les communications externes ainsi que les publications scientifiques et les conférences. Enfin, Trump a retiré les États-Unis de l'OMS (Organisation mondiale de la santé).
Le conseiller à la sécurité nationale du président Trump, Mike Walz, a demandé à 160 assistants employés au Conseil de sécurité nationale de rentrer chez eux et de ne rien faire jusqu'à ce que la nouvelle administration décide de leur avenir. Vingt fonctionnaires du ministère de la Justice ont également été réaffectés. Trump a reclassé des milliers d'employéEs fédéraux dans la catégorie « Schedule F », ce qui permet de les licencier plus facilement, et il pourrait retirer la protection de la fonction publique à l'ensemble des 2,5 millions d'employéEs fédéraux.
Champ libre aux compagnies pétrolières
Tenant sa promesse « Drill baby drill », Trump a déclaré une « urgence énergétique nationale », même si les États-Unis produisent plus de pétrole que n'importe quel autre pays. Il ouvre davantage de terres aux compagnies pétrolières pour le forage et la fracturation, même si les lois des États et des municipalités peuvent encore réglementer la production de pétrole. Il annule également toutes les réglementations fédérales visant à prévenir le changement climatique.
En matière de politique étrangère, Trump a changé le nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique, et affirme vouloir reprendre le contrôle du canal de Panama et faire passer le Groenland du statut de pays danois à celui de possession américaine, et il est prêt à envisager le recours à la force militaire pour y parvenir. L'avalanche de décrets et d'actions a eu raison de ses adversaires. Pour l'instant.
Dan La Botz, traduction par la rédaction
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Donald Trump est plus faible qu’il n’en a l’air

L'administration de Donald Trump fait tout ce qu'elle peut pour projeter une image de puissance inarrêtable dans ses premiers jours en tant que président. Mais des fissures commencent déjà à apparaître.
Tiré de la revue Contretemps
29 janvier 2025
Par Branko Marcetic
Comme promis, Donald Trump a donné le coup d'envoi de sa présidence en faisant preuve de « rapidité et de force ». S'appuyant sur ce qu'il a appelé un soutien « massif », avec une « victoire éclatante dans les sept États-clés (swing states) et au niveau national (popular vote) », Trump a lancé ce que ses alliés ont appelé une stratégie de « choc et d'effroi », faisant allusion à la campagne de bombardements massifs qui a permis l'invasion de l'Irak par les États-Unis.
Trump a émis des dizaines de décrets sur des sujets aussi variés que le retrait des États-Unis d'accords internationaux, l'annulation de directives de l'ère Biden, les préparatifs d'une purge à grande échelle des personnels fédéraux et la lutte contre les bêtes noires des conservateurs tels que la citoyenneté de naissance et l'énergie éolienne.
En bref, il semble que les pires craintes au sujet d'une deuxième présidence Trump se réalisent : un inarrêtable rouleau-compresseur de droite qui laissera un pays très différent derrière lui dans les ruines de ce qu'il aura détruit. C'est certainement ce que le président voudrait faire croire à son opposition démoralisée. Mais malgré tous les grands discours, la présidence de Trump et son projet politique sont plus fragiles qu'aucun des deux camps ne le pense.
Des problèmes dans la coalition
Tout d'abord, des fissures ont déjà commencé à apparaître dans la coalition de Trump, et ce avant même son investiture. À la fin de l'année dernière, un clivage tendu s'est formé entre les partisans de l'« Amérique d'abord » qui veulent restreindre l'immigration, et les milliardaires qui soutiennent les visas H-1B [visas destinés à des travailleurs∙euses très qualifié∙es], représentés par des personnalités telles que Vivek Ramaswamy [1] (aujourd'hui excommunié pour avoir dénigré les travailleurs∙euses étatsunien∙nes dans un tweet) et Elon Musk [2].
Les fissures sont particulièrement visibles autour de Musk. Ayant utilisé son soutien de 277 millions de dollars à la campagne pour se frayer un chemin dans le cercle rapproché de Trump, et devenir apparemment tout à la fois conseiller, porte-parole et membre officieux du gouvernement du nouveau président, il a déjà marché sur les pieds de Trump une première fois en menant la charge pour torpiller à la dernière minute un accord du Congrès sur le plafond de la dette, devançant Trump lui-même.
L'influence démesurée de Musk sur le mouvement « Make America Great Again » (MAGA) autour de Trump, qu'il n'a réellement rejoint qu'il y a six mois, a rapidement irrité des personnalités MAGA de longue date comme Steve Bannon, qui a juré de faire « déguerpir » Musk et s'est plaint que la politique des États-Unis soit façonnée par « les personnes les plus racistes de la planète, les Sud-Africains blancs », faisant référence à Musk et à plusieurs autres investisseurs sud-africains en capital-risque dans le domaine de la technologie.
La tolérance de Trump et de son équipe à l'égard de Musk semblait déjà s'épuiser une semaine après l'élection. Depuis, Trump a dû s'abaisser jusqu'à nier publiquement avoir « cédé la présidence à Musk »., Maintenant le milliardaire de la technologie vient de priver en partie le président de son grand jour en faisant la une des journaux lors de l'inauguration pour ce qu'un éminent suprémaciste blanc a célébré comme un salut [nazi] « carrément en mode Sieg Heil ». Le fait que de telles fissures apparaissent avant même que Trump ne prenne ses fonctions est un signe particulièrement inquiétant pour le président, qui a sermonné les Républicains en leur disant qu'ils devaient « se serrer les coudes » s'ils voulaient réussir.
Des difficultés à gérer les crises
Une autre vulnérabilité du trumpisme est que le président hérite de plusieurs crises potentielles.Sur le plan intérieur, Trump hérite des retombées de plusieurs catastrophes naturelles historiques, notamment des incendies de forêt qui continuent de ravager la Californie, l'État qui contribue pour 14 % au PIB du pays – l'État a désormais besoin d'une aide vitale, que Trump et ses alliés ont menacé de transformer en enjeu de conflit politique et que l'un de ses décrets anti-immigrés a déjà mis en péril [3]. Sans parler des innombrables autres urgences qui pourraient survenir au cours de son mandat, que ce soit la prochaine série de catastrophes climatiques qui ne manqueront pas de se produire, ou le prochain krach financier.
Il est bon de se rappeler que si son prédécesseur a obtenu de piètres résultats en matière de réaction aux catastrophes, Trump n'était pas non plus très brillant en situation de crise lorsqu'il était à la Maison Blanche, que ce soit face à l'ouragan Maria à Porto Rico ou dans sa réaction chaotique et mortifère à la pandémie qui a contribué à lui faire perdre l'élection il y a cinq ans.
Au-delà des frontières des États-Unis, le cessez-le-feu à Gaza a peut-être débarrassé Trump d'un important casse-tête politique pour l'instant, mais comme Benajamin Netanyahou menace de relancer la guerre dans quelques semaines – et que Trump semble lui donner son soutien pour le faire – l'horreur à Gaza et tout ce qui en découle pourraient bien finir par devenir un désastre pour Trump après en avoir été un pour Biden. Il en va de même pour une éventuelle guerre avec l'Iran qu'Israël et son lobby étatsunien [4] prévoient d'imposer à Trump.
Pendant ce temps, en Ukraine, si les négociations prévues par Trump échouent et que la Russie continue simplement à avancer sur le champ de bataille pour atteindre ses objectifs par des moyens militaires, Trump sera mis dans la position soit d'accepter ce qui serait présenté comme une défaite des États-Unis, soit d'intensifier un engagement militaire dans la guerre et de replonger les Étatsunien∙nes dans une crise comportant une dimension nucléaire.
L'une ou l'autre de ces solutions non seulement réduirait à néant « l'héritage de paix » que Trump prétend laisser derrière lui comme il l'a bruyamment fait savoir, mais constituerait également une trahison majeure des attentes d'une opinion publique lasse de la guerre (lassitude qui a contribué à le porter au pouvoir), empoisonnant lentement l'agenda domestique de Trump de la même manière que cela a été le cas pour Biden.
En attendant, même si personne dans l'entourage de Trump ne semble le savoir ni s'en soucier, la mise en œuvre de ce « programme de paix » ne contribuerait guère à résoudre le problème central qui l'a amené à la Maison Blanche : la colère populaire face à la hausse exponentielle du coût de la vie. En fait, cela pourrait même bien aggraver la situation.
D'introuvables résultats pour les classes travailleuses des États-Unis
L'une des mesures phares de Donald Trump, l'instauration de droits de douane généralisés sur les importations en provenance des deux voisins les plus proches des États-Unis et de la Chine, devrait renchérir tous les produits, des légumes à la bière, en passant par les jouets, les voitures et une multitude d'autres biens de consommation.
Dans le même temps, la pièce maîtresse de son programme intérieur est une nouvelle réduction d'impôts pour les riches, que les Républicains du Congrès prévoient de financer en s'attaquant aux programmes de protection sociale tels que Medicare et Medicaid [5]. Trump s'est d'ailleurs déjà tiré une première balle dans le pied dans ce domaine : affirmant vouloir démanteler des « pratiques impopulaires, inflationnistes, illégales et radicales », il a notamment annulé une directive du président Biden visant à explorer les moyens de réduire le coût des médicaments délivrés sur ordonnance.
Trump et son équipe font le pari qu'il suffira de déchaîner encore et toujours la production de combustibles fossiles pour faire baisser les prix. Mais les États-Unis étaient déjà le plus grand producteur d'énergies fossiles de l'histoire de l'humanité lorsque les prix se sont emballés sous la présidence Biden, et bon nombre des causes de la crise du coût de la vie – comme la flambée des prix du logement et les factures médicales exorbitantes – ne sont pas dues à un manque de combustibles, mais à l'appât du gain.
On peut douter que Trump aille plus loin que les maigres mesures de son prédécesseur démocrate dans la lutte contre cette cupidité. C'est peut-être la contradiction fondamentale au cœur de la présidence de Trump qui s'ouvre : il a fait campagne en tant que champion du travailleur américain pourfendant le marécage de Washington, mais il a maintenant remis les rênes du gouvernement à un groupe de créatures sorties de ce même marécage, à savoir les treize milliardaires nommés à son cabinet (un record) et les nombreux autres milliardaires à qui il a offert des places au premier rang lors de son investiture. Sa mitraille de décrets a largement consisté jusqu'à présent à faire progresser les objectifs du grand capital inscrits dans le « Projet 2025 », celui-là même qu'il jugeait si toxique pour lui politiquement qu'il s'en était tenu éloigné pendant la campagne.
Il faut savoir que pendant que Trump fait tout cela, et qu'il hisse la corruption à un niveau rarement atteint [6], un récent sondage censé montrer le soutien de l'opinion publique à certaines des positions de Trump a également révélé qu'une large majorité d'Étatsunien∙nes, tous partis confondus, pensent que le système politique du pays ne fonctionne pas si ce n'est au profit des riches et des élites. Cela peut représenter un grand point faible pour Trump, alors qu'il entreprend d'appliquer ce qui se présente de plus en plus comme un programme ploutocratique.
Ne donnons pas à Trump ce qu'il veut
Enfin, l'entourage de Trump est bien trop optimiste, quand il pense aujourd'hui que le premier mandat Trump a simplement été gâché par des saboteurs et un « establishment » revanchard. Trump et son équipe ont souvent été leurs propres pires ennemis, mettant le feu aux poudres en paroles et en actes, suscitant inutilement des controverses qui ont entravé sa présidence et sapé le soutien de l'opinion publique. On a pu entrevoir un court instant une approche plus disciplinée, mais de nombreux éléments de la campagne et de ces dernières semaines – y compris la volte-face soudaine sur l'accord relatif au plafond de la dette, qui a semé la zizanie dans son propre parti – suggèrent que les choses n'ont pas beaucoup changé.
En réalité, quoi qu'il dise en public, Donald Trump n'arrive pas au pouvoir avec de grandes réserves de soutien dans la population, ni même avec une base électorale particulièrement impressionnante. En fin de compte, Trump n'a remporté l'élection que par une marge de 1,5 point, soit la moitié de l'avance républicaine lors des élections de mi-mandat en 2022, une performance qui avait été considérée comme un échec à l'époque.
Il entame sa présidence avec une cote de popularité plus élevée qu'en 2017, mais toujours bien en deçà du soutien majoritaire avec lequel les présidents des États-Unis commencent généralement leur mandat, et bien en-dessous de la popularité de Biden lors de son investiture en 2021. Les audiences télévisées de l'investiture de Trump ont été nettement inférieures à celles de son premier mandat et à celles d'il y a quatre ans.
Cela n'indique pas exactement un public complètement « trumpisé », prêt à accorder une absolution illimitée à Trump pour une interminable série de scandales et de controverses. On peut plutôt y voir un électorat à bout, mécontent de la politique, qui a choisi Trump et les Républicains dans le vain espoir qu'ils feraient au moins un meilleur travail que l'autre camp – et qui pourrait être prêt à les mettre eux aussi à la porte s'ils n'y parviennent pas.
On a trop tendance à oublier que Biden et son équipe sont également arrivés au gouvernement portés par des attentes populaires ambiguës (sur une base électorale nettement plus large, cependant), avec de grandes ambitions pour une présidence sociale qui remodèlerait le pays, le maintiendrait à l'écart des guerres à l'étranger et ouvrirait un avenir politique à leur parti en allant vite et fort dans leur programme. Ils ont même bénéficié d'une cote de popularité élevée après cent jours.
Puis tout s'est effondré, car la présidence Biden a plié et s'est effondrée sous le poids de ses propres contradictions internes : Biden a confié les rênes de l'État aux représentants des milieux d'affaires ; il a eu le plus grand mal à maintenir la cohésion de son étroite majorité, a poursuivi dans la voie néolibérale des aides aux entreprises et des coupes dans les dépenses sociales, et n'a pas pu résister à la tentation d'impliquer les États-Unis dans de nouveaux conflits armés. Ce n'était pas la première campagne présidentielle de l'histoire des États-Unis à croire sa victoire déjà acquise pour finalement s'effondrer rapidement, et ce ne sera certainement pas la dernière.
Il est tout à fait possible que rien de tout cela ne se réalise, que Trump et les siens évitent ces écueils et connaissent un succès politique au-delà de leurs rêves les plus fous. Mais il est au moins aussi probable que les vulnérabilités et les contradictions internes du mouvement Trump créent des ouvertures qu'une opposition bien organisée pourrait exploiter avec un certain sens stratégique, tout comme les constantes erreurs politiques imputables à Biden l'ont fait pour sa présidence. S'il ne fait aucun doute que Trump fera beaucoup de dégâts au cours des quatre prochaines années, le voir comme un conquérant triomphant et indomptable pourrait bien être exactement ce qu'il veut.
*
Publié initialement sur Jacobin. Traduction et notes : Mathieu Bonzom
Illustration : Wikimedia Commons.
Notes
[1] Ex-candidat aux primaires présidentielles républicaines où il s'était posé en fervent soutien de Trump (NdT).
[2] Tandis que les commentateurs de gauche les moins pessimistes concernant la nouvelle élection de Trump ont tenté une comparaison avec la réélection de George W. Bush bientôt suivie de difficultés pour lui, on se souviendra que les divisions du camp républicain concernant l'immigration avaient joué un rôle important dans les défaites républicaines dans ces années-là (NdT).
[3] Couper des financements fédéraux aux collectivités ayant pris des mesures favorables aux immigré∙es pourrait conduire ces dernières à des coupes budgétaires notamment liées à la lutte contre les incendies (NdT).
[4] Cette expression désigne généralement l'organisation American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), et quelques autres (NdT).
[5] Système public de couverture santé pour les personnes âgées et à faibles ressources, respectivement (NdT).
[6] L'auteur fait ici allusion au lancement par Trump, quelques jours avant son inauguration, d'une cryptomonnaie portant son nom et qui lui aurait permis de multiplier sa fortune (déjà multimilliardaire) par dix ; certains experts contestent cependant cette estimation – avec des arguments renvoyant essentiellement à la volatilité (pour ne pas dire pire) des cryptomonnaies. Si ces réserves peuvent relativiser une lecture en termes de corruption massive, elles pourraient constituer un exemple supplémentaire de « fausse puissance » chez Trump (NdT).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment les hommes « puissants » d’internet ont fait gagner Trump

Des influenceurs étasuniens dont l'audience se compte en dizaines de millions de personnes ont soutenu Donald Trump dans sa campagne présidentielle. Une galaxie où le conservatisme rencontre le déni climatique et le complotisme.
Tiré de Reporterre
22 janvier 2025
Par Louise Mohammedi
Connaissez-vous Joe Rogan, Theo Von ou encore Adin Ross ? Aux États-Unis, ces influenceurs sont des célébrités. Et ils ont été des soutiens actifs de Donald Trump lors de sa campagne, allant même jusqu'à l'inviter sur leur chaîne YouTube ou Kick — plateforme de streaming controversée à cause de sa modération laxiste qui tente de concurrencer Twitch, le leader du secteur.
Pour Donald Trump, les influenceurs occupent désormais une place centrale dans la promotion et la consolidation de sa politique anti-environnementale. Leur soutien lui permet non seulement de diffuser ses idées auprès d'une nouvelle audience, mais aussi de maintenir sa visibilité pour légitimer ses actions contre l'environnement.
C'est durant la campagne présidentielle étasunienne que ces créateurs aux dizaines de millions d'abonnés se sont exhibés sur leurs réseaux sociaux avec le milliardaire de 78 ans. Des rencontres planifiées, bien ficelées, qui ont permis au président fraîchement investi de propager ses idées auprès de la nouvelle génération.
Racisme, conspirationnisme et déni climatique
Un terrain de jeu idéal pour Donald Trump qui s'affiche fièrement avec ces influenceurs et tire partie de leur audience. Il leur a même adressé un message le 6 novembre dernier après sa victoire électorale : « Je veux rapidement remercier quelques personnes : les Nelk Boys, Adin Ross, Theo Von, Bussin'With The Boys, et enfin le puissant Joe Rogan. » Une bande qui comptabilise au total plus de 38,6 millions d'abonnés sur Instagram.
Ces personnalités sont des hommes aux idées conservatrices, masculinistes, proches ou faisant partie de l'extrême droite. Le plus « puissant » d'entre eux est Joe Rogan, un ancien acteur devenu influenceur qui anime le podcast le plus écouté au monde sur la plateforme Spotify. Habitué des polémiques, ce créateur de contenus a plusieurs fois proféré des expressions racistes et diffusé des théories conspirationnistes. C'est aussi lui que Mark Zuckerberg, patron de Meta, a choisi pour publiciser son virage trumpiste.
Le climat n'a pas été épargné. En mai 2023, Joe Rogan a vanté une théorie du complot qui relie le réchauffement climatique au champ magnétique dans son podcast, niant ainsi la responsabilité anthropique du changement climatique en cours. De son côté, Theo Von, influenceur et podcasteur aux 3 millions d'abonnés sur YouTube, a contreditle biologiste Seth Beaudreault en août 2019, en lui expliquant que les scientifiques perpétuent de fausses histoires sur le changement climatique.
Un échange gagnant-gagnant
Pour Lluis de Nadal, chercheur à l'université de Glasgow qui travaille sur le populisme et les mouvements sociaux, YouTube joue un rôle croissant en tant que source d'information, en particulier chez les jeunes. Aux États-Unis, 37 % des 18-29 ans s'informent avec les influenceurs selon une étude du Pew Research Center. « C'est un phénomène inquiétant étant donné la quantité progressive de contenu sur YouTube remettant en question le consensus scientifique sur le changement climatique », dit-il.
Apparaître dans des podcasts ou vidéos sur les réseaux sociaux auprès d'influenceurs puissants a été une chance pour Donald Trump. Il y a touché une nouvelle audience, et son électorat découvre une nouvelle personnalité du web. Tout le monde y trouve son compte : le président gagne en visibilité, et l'influenceur gagne en abonnés.
Dans ses interventions chez des influenceurs, Donald Trump est confortablement reçu : pas de journaliste pour le contredire, le ton est bienveillant, voire amusant. Personne ne vérifie les faits ou ne bouscule le magnat de l'immobilier. Une occasion de propager ses idées en toute liberté.
« Utiliser les influenceurs permet de court-circuiter le travail des journalistes »
« Le fait d'utiliser les influenceurs permet finalement de court-circuiter le travail classique des médias et des journalistes qui utilisent du contradictoire et qui n'hésitent pas à confronter Donald Trump », souligne Valérie Masson-Delmotte, chercheuse en sciences du climat.
C'est le 26 octobre 2024 que le nouveau président des États-Unis est apparu dans le podcast de Joe Rogan. Dans cette vidéo, qui comptabilise plus de 50 millions de vues sur YouTube, Donald Trump a colporté près de 32 fausses informations selon CNN, dont 5 concernant l'environnement et l'énergie.
Il a notamment minimisé la menace du changement climatique et affirmé que le niveau de la mer n'augmentera pas autant que ce qui est prévu par « ces pauvres imbéciles », surnom donné par Donald Trump aux scientifiques. Joe Rogan tente toutefois d'intervenir et laisse entendre « que certaines choses autour du climat sont légitimes », sans aller jusqu'à contredire le futur président.
Biais cognitifs et gros business
Selon Valérie Masson-Delmotte, cette rhétorique est une « technique pour adoucir le propos et banaliser le fait de raconter des mensonges ». Mais pour Alexandre Monnin, philosophe et auteur de Politiser le renoncement, Joe Rogan s'est surtout pris à son propre jeu. « S'il a toujours affirmé que le changement climatique n'avait pas de lien avec les activités humaines, il n'était à l'origine pas un pro-Trump. Mais il a dû se tourner vers lui pour satisfaire sa communauté », révèle-t-il. Il avait initialement soutenu Robert Kennedy Junior — complotiste antivaccin nommé depuis ministre de la Santé par Trump—, un acte de trahison avant ce ralliement pour sa communauté qui a demandé à l'influenceur de se ressaisir et de se faire l'écho de Donald Trump. Pour son business, Joe Rogan n'a pas eu le choix.
Les créateurs sont également un atout pour Donald Trump pour disséminer de fausses informations, les influenceurs utilisant des codes plus simples pour le grand public que ceux utilisés par les scientifiques. « On est pris par ce qu'ils nous racontent. On a envie d'écouter et d'y croire, explique Albin Wagener, chercheur en analyse de discours. On aura plutôt tendance à écouter les paroles de nos influenceurs préférés. C'est un biais cognitif. Même si cette source balance une énormité, on se dit que plusieurs centaines de milliers voire millions de personnes écoutent, et que l'information n'est peut-être pas si fausse que ça. »
Les influenceurs sont ainsi devenus « des instruments de propagande pour Trump, c'est-à-dire qu'ils installent un récit alternatif par de la manipulation de masse », s'inquiète le chercheur. « Les personnalités issues du web l'assument, en tout cas elles s'en accommodent. »
« Ils encouragent cette politique climaticide »
La banalisation de discours réactionnaires outre-Atlantique, a rendu la lutte d'autant plus difficile à cause des insultes et du cyberharcèlement auquel elle expose. Pour Albin Wagener, cette progression démontre que le milliardaire a gagné la bataille culturelle aux États-Unis. « Donald Trump ne cherche pas à faire adhérer des gens à sa cause, mais il veut les faire douter, dit-il. « C'est en exploitant cette incertitude qu'il a gagné. En tout cas, il a une longueur d'avance. » Les changements de politique de fact-checking dans le groupe Meta, et la politique déjà en place sur X permettront ainsi à d'autres acteurs de construire une communauté importante et diffuser une idéologie réactionnaire et anti-écologique.
En participant à l'ascension de Donald Trump au pouvoir, certains influenceurs ont ainsi donné le ton. « Ils encouragent cette politique climaticide qui attend les États-Unis, ou en tout cas ils la fantasment », alerte Albin Wagener. Le nouveau président étasunien tout fraîchement investi pourra alors freiner, voire démanteler, toutes actions visant à protéger l'environnement. Grâce à l'influence des créateurs de contenus, cette politique a gagné en crédibilité auprès d'un public majoritairement jeune. Public qui devra pourtant faire face aux conséquences du changement climatique.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les criminels de guerre veulent massacrer en silence

À huis clos. Ni journaliste étranger, ni témoin. Et pourtant, malgré les interdits, le monde entier sait, a les moyens de savoir. La guerre que mènent les dirigeants israéliens contre la population gazaouie, par les bombes, les snipers, la faim, la soif, les entraves à tout passage d'aide humanitaire dans le nord du territoire, les destructions de toutes les conditions d'existence et de tous les lieux d'histoire et de culture de la société sont filmés, chaque jour, par les Palestiniens eux-mêmes. Et par leurs journalistes. Au prix de leur vie. Quelque 180 journalistes directement ciblés et assassinés. Comme ils et elles le sont en Cisjordanie et à Jérusalem-Est où les colons tuent, spolient, expulsent, aidés par l'armée.
Tiré de France Palestine solidarité.
La guerre, c'est aussi la guerre de l'information. S'y inscrit le vote par le Parlement israélien, fin octobre dernier, de deux textes interdisant l'activité de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui fournit assistance et protection à près de six millions de réfugiés de Palestine au Moyen-Orient. En jeu, bien sûr, la volonté d'affamer la population, de mettre un terme à toute reconnaissance internationale des droits des réfugiés palestiniens, mais aussi tenter d'empêcher ou de délégitimer tout témoignage.
Faire taire, c'est aussi accuser les Israéliens qui refusent le massacre. Journalistes, en particulier au quotidien Ha'aretz, enseignants, notamment d'histoire, cinéastes, militantes et militants d'ONG, ne subissent plus seulement la censure mais aussi le risque d'accusation de trahison s'ils soutiennent les droits des Palestiniens, accusés dès lors de soutien à « organisation terroriste ». La loi d'octobre dernier permet de licencier des enseignants à ce motif. La Nakba ? Elle n'a pas existé. Des crimes de guerre ou contre l'Humanité dans le territoire occupé ? Faux. Prouver le contraire est un crime… Attaquer les garants d'une certaine démocratie, fût-elle réservée aux seuls Israéliens juifs, relève de la panoplie des criminels. Les mêmes qui voulaient mettre un terme à l'indépendance de la Cour suprême ou qui ont voté les lois de 2011 sanctionnant toute commémoration de la Nakba, interdisant tout appel au boycott et tendant à museler les ONG.
Les Palestiniens, eux, y sont habitués depuis longtemps. Qu'il s'agisse, dans la période récente, de la loi (2011) permettant à des « comités d'admission » d'accepter ou non des Palestiniens dans telle ou telle ville, tel ou tel quartier ou de la loi fondamentale de 2018 qualifiant Israël d'État-nation du peuple juif et légalisant la ségrégation qui existait de facto. Le 7 novembre dernier, le Parlement a aussi adopté une loi qui permet d'expulser vers Gaza tout Palestinien considéré comme « terroriste » ainsi que sa famille.
Mais certains gouvernements, comme le gouvernement français, s'acharnent encore à refuser toute sanction et même l'application des mandats d'arrêts de la CPI.
Isabelle Avran
Note de la rédaction : un dernier projet : une loi autorisant les colons à l'achat de terre directement aux Palestiniens en « Judée-Samarie », pour « élimination de la discrimination » !
Une étape supplémentaire franchie pour éliminer l'UNRWA et la question des réfugiés
Le 28 octobre 2024, le Parlement israélien a adopté – à une écrasante majorité – deux projets de loi qui ciblent l'UNWRA et les réfugiés palestiniens du territoire occupé.
Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Agence, avait alerté sur le fait que « ces projets de loi ne feraient qu'aggraver les souffrances des Palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza, où les gens vivent un véritable enfer depuis plus d'un an ».
Selon la loi sur la cessation des activités de l'UNWRA, l'Office n'effectuera aucune mission, ne fournira aucun service – directement ou indirectement – sur le territoire souverain de l'État d'Israël. Situées en réalité dans Jérusalem-Est occupée depuis 1967 et annexée en 1980, deux structures sont gravement impactées : dans un délai de trois mois, le quartier général de l'agence onusienne devrait fermer et les Palestiniens du camp de Shuf'at seraient définitivement abandonnés.
Une deuxième loi révoque le statut diplomatique des employés internationaux et leur immunité, entraînant le possible refus de visas et permis de résidence. Sans immunité internationale, le personnel international de l'UNWRA ne pourra entrer en Palestine occupée et s'y déplacer.
Cette loi interdit toute coordination entre l'Agence et les autorités israéliennes chargées de l'administration du territoire occupé (COGAT). Cette instance (sous l'autorité du ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich) contrôle l'aide et les services entrant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Les lois israéliennes nouvellement adoptées constituent une violation flagrante du droit international. Elles contredisent les mesures provisoires de la Cour internationale de justice de mars 2024, dont l'obligation pour le régime israélien de coopérer avec les Nations unies, et d'assurer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
GT réfugié·es
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Crise et particularité du capitalisme chinois

Le régime chinois n'a jamais été aussi opaque qu'aujourd'hui. Nous vivons un moment d'incertitude, ne sachant pas encore comment Donald Trump va abattre ses cartes concernant la Chine. Entre crise climatique et démondialisation chaotique, nous vivons des temps sans précédent. Tentons néanmoins un décryptage, sans chercher à lever les points d'interrogation, avec Pierre Rousset.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
26 janvier 2025
Par Pierre Rousset
Selon les chiffres officiels publiés le 17 janvier, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine aurait cru de 5 % en 2024 et l'objectif assigné par Xi Jinping aurait été atteint, comme (presque ?) toujours. En décembre pourtant, des économistes chinois « de poids » avaient émis de sérieux doutes à ce sujet, dont Gao Shanwen qui estimait la croissance à environ 2 % seulement – avant de se voir sévèrement sanctionné. En fait, depuis la crise du Covid-19, les mesures de relance n'ont pas permis le rétablissement de la consommation. Le pays traverse une crise de surproduction. Le décalage entre une faible demande intérieure et une hausse marquée des exportations s'accroit encore.
Mutation capitaliste grippée
Deuxième puissance économique mondiale, la Chine est devenue une composante majeure de l'ordre capitaliste international, mais sa formation sociale reste très complexe, marquée par une histoire spécifique. Comme le soulignent mon ami Au Loong-yu ou Romaric Godin dans Mediapart du 24 septembre, il faut prendre en compte les caractéristiques propres du capitalisme chinois pour comprendre comment le pays est aujourd'hui confronté à des impasses qui sont celles des pays occidentaux avancés (surcapacité industrielle, épuisement de la financiarisation, limites de la croissance technologique pour reprendre les termes de Godin), alors qu'elle n'a pas achevé sa mutation, engagée par Deng Xiaoping après l'écrasement du mouvement ouvrier, étudiant et populaire en 1986.
L'achèvement de cette mutation capitaliste est grippé par le poids à tous les échelons de l'appareil bureaucratique, par la corruption systémique et par les modifications du pouvoir introduites par Xi Jinping quand il a décidé de devenir président à vie : marginalisation accrue des structures gouvernementales et fin de la collégialité dans les directions du PCC au profit de sa seule fraction. La collégialité constituait un gage de continuité et un garde-fou. La grande différence entre le processus de la pleine réintégration de la Russie et de la Chine dans le marché mondial, c'est qu'à Pékin, il y avait un pilote efficace dans l'avion. Ce succès est avant tout celui des trois prédécesseurs de Xi, plutôt que celui de ce dernier.
Dettes, corruption et marasme
L'éclatement de la « bulle immobilière », avec la faillite du géant Evergrande en 2021, illustre la place des liens, souvent familiaux, entre le public et le privé dans le système capitaliste chinois. Si cette crise a pris une telle ampleur, c'est qu'à chaque échelon il y a eu collusion entre bureaucrates au pouvoir et leurs proches dans le secteur privé pour multiplier les investissements, sources de profits légaux et illégaux. Ses conséquences sont profondes en raison du poids des dettes accumulées, mais aussi des conséquences sociales. Xi Jinping se refuse à déployer une politique de protection sociale. Pour préparer leur retraite et prévoir leurs dépenses de santé (payante), de nombreux Chinois modestes ont acheté sur plan des appartements qui n'ont jamais été construits ou se sont logés dans des villes restées largement fantômes.
De nombreux Chinois modestes ont acheté sur plan des appartements qui n'ont jamais été construits ou se sont logés dans des villes restées largement fantômes
Les parents craignent aujourd'hui que leurs enfants vivent plus mal qu'eux. Le chômage des jeunes est très élevé et les diplômes n'assurent plus l'accès à un emploi décent. La population s'appauvrit et doit épargner face à un avenir très incertain. Harold Thibault, dans un reportage du Monde publié le 9 janvier, décrit les commerces et restaurants désertés par les « les déclassés de la consommation ». Xi Jinping exhorte la population à faire preuve de résilience avant que l'économie ne se redresse, mais les entreprises sont soumises à une concurrence féroce qui les amène à rogner sur tout.
La volonté de pouvoir absolue rend paranoïaque. Xi Jinping incarcère des hommes d'affaires, « discipline » la finance, purge de façon répétée l'appareil du parti, l'état-major de l'armée, les services secrets… La Chine reste un marché qui ne peut être ignoré, mais y investir est devenu un jeu risqué, plongeant dans la perplexité le capital international. On peut parler d'une véritable crise de régime aux soubresauts imprévisibles.
Crédit PhotoWikimedia Commons
Démondialisation de crise
La mondialisation heureuse (pour le Capital) appartient à un passé déjà lointain. La crise de la démondialisation lui a succédé, ouvrant un espace aux conflits géopolitiques entre États et à des replis protectionnistes partiels.
Cependant, on ne se libère pas facilement des interdépendances tissées par la formation d'un marché mondial unique et l'internationalisation des chaînes de production. Elles sont toujours vivaces, alors que d'autres enjeux s'invitent à l'attention des gouvernants, comme les guerres et le réchauffement climatique.
Rapport de forces avec les États-Unis
Les premiers signaux envoyés par Donald Trump sont ambivalents. Il a nommé à des postes clés de farouches opposants à Pékin, mais a suspendu l'interdiction de TikTok. Et que penser de la place de « président bis » que semble occuper Elon Musk, ce grand investisseur et soutien de Xi qui a proposé un plan de règlement de la question taïwanaise au profit de Pékin (l'homme le plus riche du monde s'accorde tous les droits d'ingérence) ? Xi Jinping doit avoir bien du mal à prévoir si un deal sera souhaitable et possible avec Trump – pour une fois on le comprend. Est-ce un signe si sa politique reste très prudente sur le front des monnaies ? Les temps étaient mûrs pour renforcer le rôle international du yuan, il n'en profite pour l'heure pas. Le bras de fer technologique et commercial entre les deux puissances est engagé, il pourrait aboutir à l'imposition au monde d'un duopole sino-étatsunien ou, inversement, à des affrontements armés.
Le bras de fer technologique et commercial pourrait aboutir à l'imposition au monde d'un duopole sino-étatsunien ou à des affrontements armés
Les États-Unis restent dominants sur le plan militaire, ainsi que pour les semi-conducteurs de pointe. Ils exigent que le champion néerlandais des puces d'intelligence artificielle, Nvidia, renonce à livrer ses produits hauts de gamme à la Chine. En dépit de subventions massives à la recherche, les entreprises chinoises semblent incapables de combler leur retard en ce domaine crucial. Du coup, Pékin menace de bloquer l'exportation vers les États-Unis de plusieurs métaux essentiels à la production des semi-conducteurs (gallium, germanium…). Vous avez dit interdépendance ?
Entre l'Europe de l'Ouest et Poutine
L'influence chinoise s'étend notablement de l'Afrique à l'Amérique latine, mais cela ne saurait remplacer les liens avec les pays capitalistes développés. Or, l'accès aux États-Unis devrait se restreindre. En conséquence, Xi Jinping pourrait se tourner vers l'Europe de l'Ouest, l'Australie, la Corée du Sud — mais il y a la guerre en Ukraine de son copain Poutine, allié à la Corée du Nord ! Est-ce le moment de sacrifier cette amitié indéfectible ? Difficile alors qu'avec le réchauffement climatique, les régions polaires s'ouvrent à l'exploitation et aux communications maritimes. Pékin n'est pas un pays riverain de l'Antarctique et a besoin de Moscou pour participer au grand jeu stratégique engagé dans cette région, à l'heure où Donald Trump veut prendre possession du Groenland !
Le sort du monde dépend pour une part de dirigeants comme Donald Trump et Xi Jinping, ce qui n'a rien de rassurant. Au chaos par en haut, opposons donc l'internationalisme par en bas.
Pierre Rousset
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les menaces qui pèsent sur une Syrie démocratique et progressiste

À un moment presque inattendu, le régime de Bachar Al-Assad s'est effondré le 8 décembre 2024 face à l'offensive éclair dirigée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham, soutenu par la Turquie.
Tiré du site de la revue Contretemps.
Cette date met ainsi fin à cinq décennies de la dynastie tyrannique Al-Assad. Issu du parti Baath, Hafez Al-Assad prend le pouvoir par un coup d'État en novembre 1970. Tout en poursuivant des politiques de redistribution des ressources suivant un modèle social-étatique qui domine depuis le début des années 1960 mais également suivant des logiques clientélistes, il écarte de manière extrêmement violente toute opposition à son pouvoir, jetant ce faisant les bases d'un autoritarisme d'État qui se poursuivra jusqu'à la chute du régime. À partir des années 1980, se développent, dans le giron du régime, des réseaux entre le secteur public et le secteur privé ainsi qu'une nouvelle bourgeoisie.
Sur le plan régional, une inflexion violemment hostile est opérée à l'égard de l'Organisation de libération de la Palestine par Hafez Al-Assad qui entend contrôler la scène politique palestinienne ainsi que le Liban. En 1990, le régime syrien s'allie aux États-Unis dans la coalition contre l'Irak et il met sous sa tutelle le Liban dont, au sortir de la guerre civile, il contrôle la vie politique et sécuritaire tout en assurant le droit au Hezbollah de mener la résistance contre l'occupation israélienne. Au début des années 2000, alors que les États-Unis ouvrent une ère de lutte contre le « terrorisme », le régime syrien fait l'objet d'une offensive diplomatique étasunienne essentiellement en raison de son soutien au Hezbollah.
Entretemps, le « contrat social » en Syrie consistant à légitimer la terreur d'État par le volet social se brise peu à peu au cours des années 2000. En effet, sous le mandat de Bachar Al-Assad, les logiques répressives sont toujours d'une brutalité terrifiante, les services publics deviennent de plus en plus délabrés, les politiques de libéralisation économique s'accélèrent aux dépens des classes populaires urbaines et paysannes, les privatisations renforçant la corruption et la monopolisation des ressources par le clan Al-Assad.
Dans ce contexte, le soulèvement du peuple syrien pour ses droits sociaux et démocratiques de 2011 est violemment réprimé par le régime et, assez vite, l'ingérence des puissances régionales et internationales conduit à une guerre multidimensionnelle aux conséquences dévastatrices, dont la responsabilité incombe en premier lieu au régime de Bachar Al-Assad.
À l'aune de ce contexte, on ne peut que se réjouir pour le peuple syrien à présent libéré de la dictature des Al-Assad. Dans le même temps, la situation présente de nombreuses inconnues quant aux politiques que vont mener les nouveaux dirigeants à Damas, quant aux moyens pour le peuple syrien dans sa pluralité de réellement prendre en main son destin, et quant à l'unité de la Syrie et à sa position vis-à-vis du colonialisme israélien dans la région. Toute incertaine qu'elle soit, la nouvelle conjoncture ouvre en tous cas de réelles possibilités de changement pour le peuple syrien.
Dans cette optique attentive aux questions sociales, démocratiques et coloniales, et soucieuse d'éclairer les enjeux et les défis complexes face auxquels se trouve le peuple syrien, la rédaction de Contretemps propose une série d'articles sur le sujet dont les points de vue variés ne sont pas nécessairement convergents mais permettent chacun d'éclairer les divers aspects de la situation. Après un premier article de Bassam Haddad, nous publions un article de Joseph Daher qui analyse notamment la menace que représentent les vestiges de l'ancien régime, puis la manière dont le Hayat Tahrir al-Cham (HTC) cherche à asseoir son pouvoir sur la nouvelle Syrie.
***
La chute du régime de Bachar el-Assad s'inscrit dans la continuité des processus révolutionnaires qui ont débuté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2011. Le renversement du régime de la famille Assad au pouvoir depuis 1970 est le produit de toutes les luttes qui ont été menées depuis le soulèvement populaire de mars 2011. L'offensive militaire conduite par les groupes d'opposition armés, qui a débuté en novembre 2024, lui a porté le coup de grâce quelques semaines plus tard, en décembre.
De nombreuses questions se posent quant à l'avenir de la Syrie, et notamment au sujet des principales menaces qui pèsent sur la mise en place d'une société démocratique. Certains commentateurs, intellectuels et activistes libéraux et démocrates se sont focalisés sur les « feloul », c'est-à-dire les résidus de l'ancien régime, en particulier les secteurs de la sécurité et de l'armée, comme étant la principale menace actuelle pour le pays. Sur les réseaux sociaux, il est souvent fait mention d'un scénario égyptien, celui du coup d'État mené par Sisi contre le président Morsi, qui faisait partie de la confrérie des Frères musulmans, en juillet 2013.
D'un autre côté, une partie des commentateurs et des démocrates est relativement peu critique, voire pas du tout, à l'égard de ce gouvernement dirigé par les HTC. Ils saluent généralement la façon dont le groupe salafiste conduit la transition.
Cet article se propose d'étudier les principales menaces qui pèsent sur l'avenir démocratique de la Syrie, autrement dit pour la justice sociale et l'égalité de tous et toutes dans le pays. En premier lieu, il analysera la menace représentée par les résidus de l'ancien régime, puis il examinera la politique du HTC en vue de consolider son pouvoir sur la nouvelle Syrie.
Quelle était la nature du régime Assad ?
Tout d'abord, il est important d'analyser la nature de l'ancien régime. La famille Assad avait établi un régime despotique et patrimonial en Syrie. Ce régime despotique et patrimonial était un système de pouvoir autocratique et héréditaire absolu qui reposait sur l'appropriation de l'État par un petit groupe d'individus liés par des liens familiaux, tribaux, communautaires et clientélistes, dont le symbole était le palais présidentiel occupé par Bachar al-Assad et sa famille. Les forces armées étaient dominées par une garde prétorienne (force dont l'allégeance va aux dirigeants et non à l'État) incarnée par la quatrième brigade commandée par Maher al-Assad, tout comme les ressources économiques et les organes moteurs de l'administration. Le régime syrien a instauré un capitalisme de copinage dominé par un petit groupe d'hommes d'affaires totalement dépendants du palais présidentiel (Bachar al-Assad, Asma al-Assad et Maher al-Assad), qui ont profité de la position dominante garantie par ce dernier pour amasser des fortunes considérables. La nature rentière de l'économie a également renforcé la nature patrimoniale de l'État. En d'autres termes, les centres de pouvoir (politique, militaire et économique) au sein du régime syrien étaient concentrés au sein d'une famille et de sa clique, les Assad, à l'instar de ce qu'il en était en Libye sous Mouammar Kadhafi, en Irak sous Saddam Hussein ou dans les monarchies du Golfe. Cela a poussé le régime à utiliser toute la gamme des ressources violentes à sa disposition pour protéger son pouvoir.
La mise en place de ce système patrimonial moderne a commencé sous la direction d'Hafez al-Assad, après son arrivée au pouvoir en 1970. Il a patiemment construit un État dans lequel il pouvait asseoir son pouvoir par divers moyens tels que le communautarisme confessionnel, le régionalisme, le tribalisme et le clientélisme, qui étaient gérés au moyen de réseaux informels de pouvoir et de parrainage. Cette politique s'est accompagnée d'une répression brutale de toute forme de dissidence. Ces outils ont permis au régime d'intégrer, de renforcer ou d'affaiblir des groupes appartenant à des ethnies et à des communautés religieuses diverses. Cela s'est traduit au niveau local par la collaboration de différents éléments inféodés au régime, notamment des fonctionnaires de l'État ou du Ba'th, des agents des services de renseignement et des membres influents de communautés locales (religieux, représentants de tribus, hommes d'affaires, etc.) qui en assuraient la direction. Hafez al-Assad a également ouvert la voie à la libéralisation de l'économie, en opposition aux politiques radicalement étatiques des années soixante.
L'arrivée au pouvoir de Bachar al-Assad en 2000 a considérablement renforcé la nature patrimoniale de l'État, avec un poids croissant des « capitalistes de connivence ». Le renforcement des politiques néolibérales du régime a conduit à un glissement croissant de sa base sociale, constituée à l'origine de paysans, de fonctionnaires et de quelques franges de la bourgeoisie, vers une sorte de coalition au cœur de laquelle se trouvent les « capitalistes de connivence » – l'alliance de courtiers politiques en quête de rente (menée par la famille de la mère d'Assad, les Makhlouf) et la bourgeoisie qui soutient le régime et les classes moyennes supérieures. Ce glissement s'est accompagné de l'affaiblissement des organisations corporatistes traditionnelles de travailleurs et de paysans et des réseaux qu'elles entretenaient, ainsi que de la cooptation à leur place de représentants des milieux d'affaires et de la classe moyenne supérieure. Toutefois, cela n'a pas permis de contrebalancer ou de compenser son ancienne source de soutien. Plus généralement, la nature patrimoniale renforcée de l'État et l'affaiblissement de l'appareil du parti Ba'th et des organisations corporatistes ont rendu les liens clientélistes, tribaux et sectaires d'autant plus importants, ce qui s'est reflété dans la société.
Après le soulèvement de 2011, la répression et la politique du régime se sont largement appuyées sur sa principale assise, ancienne et nouvelle : les capitalistes de copinage, les services de sécurité et les grandes institutions religieuses liées à l'État. Dans le même temps, il a mis à profit ses réseaux en faisant jouer les liens sectaires, clientélistes et tribaux pour obtenir un soutien populaire. Au cours de la guerre, l'accentuation de la dimension communautaire et clientéliste alaouite du régime lui a permis d'éviter des désertions importantes, tandis que les liens clientélistes ont été essentiels pour attacher au régime les intérêts de groupes sociaux disparates.
L'assise populaire du régime a mis en évidence la nature de l'État et la manière dont l'élite au pouvoir était liée au reste de la société, ou plus précisément ici à sa base populaire, par un mélange de formes modernes et archaïques de relations sociales, et non dans le cadre d'une société civile étendue et structurée. Le régime ne pouvait s'appuyer que sur des pouvoirs coercitifs, ce qui impliquait des opérations de répression et l'instauration de la peur, mais pas seulement. Le régime a également pu compter sur la passivité, ou du moins l'opposition non-active, d'une grande partie des agents de l'administration urbaine et plus généralement des couches moyennes dans les deux principales villes de Damas et d'Alep, bien que leurs banlieues aient souvent été des foyers de révolte. Cela participait de l'hégémonie passive imposée par le régime.
De plus, cette situation a démontré que la base populaire du régime ne se limitait pas aux secteurs et groupes issus des populations alaouites et/ou des minorités religieuses, bien qu'ils soient prédominants, mais incluait des personnalités et des groupes de diverses communautés religieuses et ethniques qui apportaient leur soutien au régime. Plus généralement, de larges secteurs de la base populaire du régime, mobilisés au travers de leurs liens sectaires, tribaux et clientélistes, agissaient de plus en plus en tant qu'agents de la répression exercée par le régime.
Cette capacité de résilience a eu un prix, en plus d'accroître considérablement la dépendance du régime à l'égard d'États et d'acteurs étrangers. Les caractéristiques et les tendances anciennes ont été amplifiées. Un petit groupe de « capitalistes de connivence » a considérablement renforcé son pouvoir, alors que de larges secteurs de la bourgeoisie syrienne avaient quitté le pays en retirant massivement leur soutien politique et financier au régime. Cette situation a contraint le régime à adopter un comportement de plus en plus prédateur en aspirant les ressources qui lui étaient de plus en plus indispensables sur les milieux d'affaires restés dans le pays. Dans le même temps, les caractéristiques clientélistes, sectaires et tribales du régime ont été renforcées. L'identité sectaire alaouite du régime a été renforcée, en particulier dans les institutions clés telles que l'armée et, dans une moindre mesure, dans les administrations de l'État. Dans le même temps, les frustrations de la population alaouite se sont accrues ces dernières années en raison de l'appauvrissement continu de la société et des exactions des milices du régime à leur encontre.
Plus globalement, on comprend ainsi que le fait de considérer le régime comme uniquement alaouite, malgré l'alaouitisation de certaines institutions, notamment de son appareil répressif armé, ne permet pas de saisir sa dynamique et son mode de domination. En outre, le régime ne sert pas les intérêts politiques et socio-économiques de la population alaouite dans son ensemble, bien au contraire. Les morts de plus en plus nombreux dans l'armée et les diverses milices étaient en bonne partie des Alaouites ; l'insécurité et les difficultés économiques croissantes ont en fait créé des tensions et attisé l'animosité des populations alaouites à l'égard des responsables du régime.
La chute du régime a démontré sa faiblesse structurelle, à la fois militaire, économique et politique. Il s'est effondré comme un château de cartes. Cela n'est guère surprenant, car il semblait évident que les soldats n'allaient pas se battre pour le régime d'Assad au vu de la médiocrité de leurs salaires et des conditions qui leur étaient faites. Ils ont préféré fuir ou simplement ne pas se battre plutôt que de défendre un régime pour lequel ils n'ont que très peu de sympathie, notamment parce que beaucoup d'entre eux ont été enrôlés de force.
La dépendance du régime à l'égard de ses alliés étrangers est devenue cruciale pour sa survie, démontrant ainsi sa faiblesse. La Russie, le principal parrain international d'Assad, a détourné ses forces et ses ressources vers sa guerre impérialiste contre l'Ukraine. En conséquence, son engagement en Syrie a été nettement plus limité que lors d'opérations militaires comparables au cours des années précédentes. Ses deux autres principaux alliés, le Hezbollah libanais et l'Iran, ont été considérablement affaiblis par Israël depuis le 7 octobre 2023. Tel-Aviv a procédé à l'assassinat des dirigeants du Hezbollah, dont Hassan Nasrallah, a décimé ses cadres par ses attaques aux bipeurs et a pilonné ses positions au Liban. Le Hezbollah est sans aucun doute confronté à son plus grand défi depuis sa création. Israël a également lancé des vagues de frappes contre l'Iran, révélant ainsi ses faiblesses. Il a également intensifié les bombardements des positions de l'Iran et du Hezbollah en Syrie au cours des derniers mois.
Ses principaux soutiens étant ainsi accaparés et affaiblis, la dictature d'Assad se trouvait dans une position vulnérable. En raison de toutes ses faiblesses structurelles, du manque de soutien de la population, du manque de fiabilité de ses propres troupes et de l'absence de soutien international et régional, elle s'est avérée incapable de résister à l'avancée des forces rebelles, et ville après ville, son pouvoir s'est effondré comme un château de cartes.
Dans ce contexte, nous pouvons affirmer que le Palais présidentiel est politiquement mort. La famille d'Assad a quitté le pays, la quatrième brigade dirigée par Maher al-Assad n'existe plus en tant qu'unité militaire organisée et ce qui restait de ses principaux réseaux de pouvoir, que ce soient les copains-capitalistes, les chefs religieux ou chefs tribaux, etc. sont devenus inutiles et réduits à un petit nombre d'individus dépourvus de tout pouvoir. Entre-temps, certains chefs de tribus, leaders religieux et représentants des chambres économiques viennent de se rallier aux nouvelles autorités en place, comme en témoigne le fait qu'ils ont adopté le nouveau drapeau syrien.
Retour de l'ancien régime ?
Dans cette optique, le modèle du coup d'Etat égyptien est-il applicable en Syrie ? L'ancien régime et ses vestiges constituent-ils la principale menace pour la Syrie ? Je pense qu'il s'agit d'une analyse qui pose problème. Il y a deux raisons principales qui sont liées : la différence de nature du régime ainsi que le fait qu'une menace ne peut pas être réduite à des individus mais qu'elle est plutôt le fait de structures de pouvoir.
Contrairement à ce qui se passe en Syrie, la chute du dictateur Hosni Moubarak n'a pas signifié la fin du régime égyptien. Dans le cas de l'Egypte, le système politique ressemblait davantage à une forme de néo-patrimonialisme. Le népotisme et le copinage y étaient présents à travers la famille Moubarak et le sont encore aujourd'hui dans le gouvernement dirigé par Sisi. En d'autres termes, il s'agit d'un système républicain autoritaire institutionnalisé avec un degré plus ou moins élevé d'autonomie de l'État par rapport aux dirigeants qui sont susceptibles d'être remplacés. En effet, dans l'État égyptien, les forces armées constituent l'institution centrale du pouvoir politique. Aucune famille ne possède l'État au point d'en faire ce que ses membres désirent, comme ce fut le cas dans le régime syrien de la famille Assad. C'est le haut commandement militaire qui domine collégialement l'État égyptien. Cela explique pourquoi les militaires ont fini par se débarrasser de Moubarak et de son entourage pour sauvegarder le régime en 2011. Gamal Moubarak et ses acolytes ont été évincés de la coalition au pouvoir et les réseaux de l'ancien parti dirigeant, le Parti national démocratique, de même que le pouvoir du ministère de l'Intérieur, ont été ébranlés en conséquence.
Pareillement, même avec l'arrivée au pouvoir des Frères musulmans lors de l'élection de Morsi à la présidence en 2012 cela ne signifiait pas la fin du régime égyptien dirigé par le haut commandement militaire. De plus, Morsi et la confrérie ont d'abord tenté de former une alliance directement avec l'armée dès les premiers jours du soulèvement en 2011, conscients qu'ils étaient de son poids politique et de son rôle répressif depuis des décennies. Dès les premiers jours de la révolution, la confrérie a agi comme un rempart contre les critiques et les protestations à l'égard de l'armée jusqu'au renversement de Morsi en juillet 2013. Avant cette date, ils ont dénoncé ceux qui manifestaient contre l'armée en les qualifiant de contre-révolutionnaires et de séditieux. La constitution de décembre 2012 soutenue par les Frères musulmans maintenait le budget de l'armée à l'abri du contrôle parlementaire et garantissait le pouvoir des forces armées. Morsi et les Frères musulmans se sont opposés aux mobilisations populaires et ouvrières en Égypte, les ont même réprimées et ont défendu l'armée. En effet, Morsi a nommé Sisi à la tête de l'armée en toute connaissance du fait qu'il avait fait emprisonner et torturer des protestataires.
Malgré tous les efforts de collaboration déployés par la Confrérie, l'armée a renversé Morsi et a réprimé massivement le mouvement des Frères musulmans et toutes les formes d'opposition, militante de gauche et démocrates inclus.es. En fin de compte, l'armée et la Confrérie représentaient des ailes différentes de la classe capitaliste, avec des soutiens régionaux différents, qui ne pouvaient pas trouver de solution de conciliation. L'armée, bien plus puissante, a finalement décidé de mettre en place son pouvoir dictatorial direct, au détriment de tout le monde en Égypte. Sisi a mis en place le régime le plus répressif que l'Égypte ait connu depuis des décennies, un régime néolibéral dictatorial qui a mis en œuvre de la manière la plus brutale l'ensemble des recommandations d'austérité du FMI, entraînant un appauvrissement massif et une inflation galopante.
Dans ce contexte, à aucun moment et jusqu'à aujourd'hui, le cœur du pouvoir en Egypte n'a été évincé, bien au contraire. Dans le cas de la Syrie, comme expliqué auparavant, les structures de pouvoir liées au Palais présidentiel n'existent plus et les comparaisons avec le scénario égyptien ne sont donc pas pertinentes.
Cela dit, des individus de l'ancien régime, en particulier des milices, des services de sécurité et de la quatrième brigade, peuvent représenter une menace pour la stabilité de la Syrie. Ils ont intérêt à alimenter les conflits à caractère communautaire, en particulier dans les régions côtières où ils sont principalement basés depuis la chute du régime d'Assad, et dans une moindre mesure à Homs. C'est ce qu'ont montré les attaques menées contre les forces du HTC près de la ville côtière de Tartous, qui ont fait 14 morts et 10 blessés le 25 décembre. En réponse, les forces du HTC ont lancé des opérations « à la poursuite des restes des milices d'Assad ». De même, l'Iran a également intérêt à créer de l'instabilité en jouant sur les tensions communautaro-confessionnelles par le recours à des individus liés à ses réseaux dans le pays.
Certains des éléments liés à l'ancien régime étaient également impliqués dans les dernières mobilisations à Homs et dans les régions côtières qui ont fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant le saccage d'un sanctuaire alaouite à Alep, survenue quelques semaines avant. Pour autant, il ne faudrait pas en conclure que ces manifestations ne sont rien d'autres que des manipulations organisées de l'extérieur par l'Iran ou par des éléments de l'ancien régime ; il existe en effet des craintes au sein de la population alaouite à l'égard du nouveau pouvoir, le HTC, en lien avec des appels à la vengeance qui suivi la chute du régime.
Voilà pourquoi il faut être attentif à l'augmentation des incidents, jusqu'à présent isolés ou en tout cas sans caractère généralisé, de nature sectaire qu'on observe depuis la chute du régime, et en particulier aux exécutions et aux assassinats perpétrés dans une dynamique de vengeance. Cela a été le cas contre des individus qui ont été impliqués dans des crimes sous l'ancien régime, dans lesquels se mêlent souvent des motivations de vengeance à la fois politiques et sectaires, en particulier contre les Alaouites. Les crimes du régime Assad ont déchiré la société syrienne, laissant derrière eux un héritage d'atrocités et de souffrances généralisées. Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en place une action coordonnée pour répondre aux besoins immédiats des victimes et d'établir des mécanismes de justice transitionnelle globale et à long terme. Il est essentiel de s'attaquer aux séquelles de la brutalité systémique du régime Assad pour tracer la voie d'une paix durable. La justice transitionnelle peut jouer un rôle crucial dans la prévention des actes de vengeance et de l'aggravation des tensions intercommunautaires.
En plus d'un processus encourageant la justice transitionnelle et la punition de tous les individus impliqués dans des crimes de guerre, qu'ils appartiennent à l'ancien régime ou à des groupes armés de l'opposition, seul un nouveau cycle politique permettant une large participation par en bas des classes populaires pour débattre et décider des questions démocratiques et sociales les plus diverses peut restaurer la stabilité à longue échéance.
Conclusion
Les éléments résiduels de l'ancien régime, en particulier les services de sécurité et l'armée, constituent sans aucun doute une menace pour la stabilité de la Syrie à court terme, comme nous l'avons mentionné plus haut. Ils doivent être arrêtés et jugés pour leurs crimes.
Cependant, et sans sous-estimer les menaces que représentent ces groupes d'individus, ils ne constituent pas une menace au sens où ils pourraient revenir au pouvoir et réimposer une dictature. Ils n'ont pas les moyens politiques, militaires et économiques d'atteindre un tel objectif. Il est important de comprendre la nature du régime d'Assad et la différence avec le cas égyptien. Alors que l'ancien régime syrien est structurellement mort, comme en témoigne la disparition du Palais présidentiel et de ses réseaux, en Égypte, les centres de pouvoir au sein du haut commandement militaire sont restés au pouvoir en dépit de la chute de Moubarak en 2011 et de la présence de Morsi à la présidence entre juillet 2012 et juillet 2013.
La compréhension de ces différentes dynamiques est également importante pour contrer les accusations d'être des « feloul » (nostalgiques de l'ancien régime ; ndt) lancées par certains commentateurs et médias proches du nouveau pouvoir, le HTC, à l'encontre de tous ceux qui le critiquent ou manifestent contre lui. Cela permet de discréditer les individus et les groupes ainsi que leurs revendications politiques. De même, il y a quelques semaines, la manifestation en faveur d'un État démocratique et laïque de Damas a fait l'objet de telles accusations, car plusieurs personnes ont été présentées, parfois à tort, comme des partisans de l'ancien régime. Au-delà de la présence de quelques individus susceptibles d'être des partisans de l'ancien régime parmi des milliers et des milliers de manifestant.e.s, l'objectif réel était de jeter le discrédit sur la manifestation et les revendications qui s'y rattachaient. De plus, il y a une volonté de présenter des sujets tels que la laïcité et le socialisme comme étant associés à l'ancien régime et/ou à une importation occidentale afin de les discréditer.
En fait, ceci renvoie à la deuxième partie de l'article. Encore une fois, si des groupes d'individus liés à l'ancien régime constituent une menace pour la stabilité du pays, c'est la consolidation du pouvoir du HTC et de ses associés de l'Armée nationale syrienne (ANS), soutenue par la Turquie et le Qatar, qui constitue une véritable menace pour une Syrie démocratique et progressiste.
La consolidation du pouvoir de HTC, une menace pour une future Syrie démocratique et progressiste
Le rôle prépondérant de HTC dans l'offensive militaire qui a entraîné la chute du régime Assad en décembre 2024 a valu à l'organisation et à son chef Ahmed al-Chareh (Al-Joulani) une immense popularité. Ils bénéficient depuis lors d'une forme de légitimité « révolutionnaire » dont ils se servent pour consolider leur domination politique et militaire dans les régions qu'ils contrôlent.
Si le groupe a évolué politiquement et idéologiquement, abandonnant ses ambitions djihadistes transnationales pour se muer en une force qui s'inscrit dans le cadre national syrien, cela ne signifie pas pour autant que HTC serait devenu un acteur favorable à une société démocratique et à la promotion de l'égalité et de la justice sociale, bien au contraire.
Dans cette perspective, il est important d'analyser comment ils cherchent à consolider leur pouvoir sur la société et à établir un nouvel ordre autoritaire.
Le HTC consolide son pouvoir
Après la chute du régime, Ahmed al-Chareh a commencé par rencontrer l'ancien Premier ministre Mohammed al-Jalali pour organiser la passation de pouvoir, avant de nommer Mohammed al-Béchir à la tête du gouvernement de transition chargé d'expédier les affaires courantes. Celui-ci était auparavant à la tête du Gouvernement du Salut (SG). Il exercera en tout état de cause ses fonctions jusqu'au 1er mars 2025. Le nouveau gouvernement est composé uniquement de personnes issues des rangs de HTC ou proches de celui-ci.
Ahmed al-Chareh a également nommé de nouveaux ministres, des responsables de la sécurité et des gouverneurs pour diverses régions, affiliées à HTC ou aux groupes armés de l'ANS qui en sont proches. Par exemple, Anas Khattab (également connu sous le nom de Abou Ahmed Houdoud) a été nommé chef des services de renseignement. Membre fondateur de Jabhat al-Nosra, il était le principal responsable de la sécurité du groupe djihadiste. Depuis 2017, il dirige les affaires internes et la sécurité de HTC. Suite à sa nomination, il a annoncé la restructuration des services de sécurité sous son autorité.
De même, la formation de la nouvelle armée syrienne est le fait d'Ahmed al-Charaa et de ses associés au pouvoir. Ils ont nommé des commandants deHTC parmi les plus hauts gradés, notamment le nouveau ministre de la défense et commandant de longue date du HTC, Mourhaf Abou Qasra, qui a été nommé général.
En procédant à la réorganisation de l'armée syrienne, le gouvernement de HTC cherche également à consolider son contrôle et sa suprématie sur les groupes armés dispersés du pays en justifiant ses mesures et ce processus par l'interdiction faite à toute autre entité de porter des armes en dehors du contrôle de l'État, les ministères syriens de la défense et de l'intérieur étant les seuls autorisés à détenir des armes. Si l'unification de tous les groupes armés au sein d'une nouvelle armée syrienne ne soulève pas d'opposition en soi, de larges secteurs de la communauté druze à Soueida ou des Kurdes dans le nord-est s'y opposent toujours, en l'absence de certaines garanties, telles que la décentralisation et un véritable processus de transition démocratique.
Dans l'une de ses dernières interviews, Ahmed al-Chareh a également déclaré que l'organisation de futures élections pourrait prendre jusqu'à quatre ans et la rédaction d'une nouvelle constitution jusqu'à trois ans. Au même moment, une « Conférence du dialogue national syrien », réunissant 1 200 personnalités qui devait initialement se tenir les 4 et 5 janvier 2025 a été reportée à une date inconnue. Aucune information n'a été donnée sur la manière dont ces personnalités ont été sélectionnées, si ce n'est que chaque gouvernorat sera représenté par 70 à 100 personnalités, en tenant compte de tous les segments des différentes classes sociales et scientifiques, avec des représentants des jeunes et des femmes.
Des avocats syriens ont récemment lancé une pétition demandant que soient organisées des élections libres à leur chambre syndicale à la suite de la désignation par les nouvelles autorités d'un conseil syndical non élu.
Le HTC cherche à consolider son pouvoir tout en effectuant une transition contrôlée ; il cherche en même temps à apaiser les craintes à l'étranger, à établir des contacts avec les puissances régionales et internationales et à être reconnu comme une force légitime avec laquelle il est possible de négocier. L'un des obstacles à cette normalisation est le fait que HTC est toujours considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis, la Turquie, les Nations Unies tandis que la Syrie est toujours sous le coup de sanctions. En outre, dans le cadre de la Loi d'autorisation de crédits pour la défense nationale pour l'année fiscale 2025, le président américain Joe Biden a signé le 23 décembre la reconduction de l'application de la loi César jusqu'au 31 décembre 2029, malgré la chute du régime de Bachar el-Assad. Promulgué cinq ans plus tôt par l'ancien président Donald Trump, ce texte prévoit des sanctions à l'encontre de tous les acteurs – y compris étrangers – qui aident le régime syrien à se procurer des ressources ou des technologies susceptibles de renforcer ses activités militaires ou de contribuer à la reconstruction de la Syrie.
Mais des signes laissant présager un changement d'orientation des capitales régionales et internationales à l'égard de HTC sont d'ores et déjà observables. Il est clair qu'Ankara est le principal soutien politique et militaire de la nouvelle Syrie, tandis que le Qatar jouera un rôle majeur comme pilier de son économie. Parallèlement, El-Chareh s'efforce d'établir des relations avec d'autres États arabes et des acteurs régionaux et internationaux. Par exemple, le chef du HTC a rencontré une délégation saoudienne à Damas et a fait l'éloge des plans de développement ambitieux du royaume saoudien, en référence à son projet Vision 2030, et a exprimé son optimisme quant à une future collaboration entre Damas et Riyad. Pour l'Arabie saoudite et les autres monarchies du Golfe, l'évolution des relations avec les nouveaux dirigeants syriens dépendra de leur capacité à répondre à leurs préoccupations relatives à la situation politique dans le pays et à éviter que la Syrie ne devienne une nouvelle source d'instabilité régionale. Une délégation syrienne s'est rendue dans le Royaume saoudien, composée notamment du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du chef des services de renseignement.
Du côté des puissances occidentales également, un changement de cap est perceptible, y compris de la part des États-Unis. La responsable pour le Moyen-Orient de la diplomatie américaine, Barbara Leaf, après avoir rencontré Ahmed el-Chareh à Damas fin décembre, a déclaré qu'ils avaient eu une « bonne réunion, très productive et approfondie » sur la suite de la transition politique dans ce pays. Elle a également qualifié Ahmed el-Chareh d'« homme pragmatique », annonçant que Washington levait la prime de 10 millions de dollars qui était placée sur sa tête depuis 2013 en raison de son rôle au sein de Jabhat al-Nosra.
Les récentes déclarations d'el-Chareh sur la possibilité d'une dissolution de HTC pourraient également contribuer à la résolution de certains de ces problèmes.
Qui plus est, 90 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce qui rend son pouvoir d'achat très faible et a donc un impact négatif sur la consommation intérieure. Alors qu'en Syrie le travail ne manque pas, les gens ne sont pas suffisamment payés pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Dans ce contexte, les Syrien.ne.s dépendent de plus en plus des sommes envoyées par les émigré.e.s pour survivre.
Certains responsables du nouveau gouvernement, comme Ahmed el-Chareh lui-même, ont annoncé qu'ils s'efforceraient d'augmenter les salaires des travailleurs de 400 % dans les jours à venir, ce qui porterait le salaire minimum à 1 123560 livres (environ 75$, 72€). Bien qu'il s'agisse d'un pas dans la bonne direction, cela ne suffirait pas à répondre aux besoins des gens alors que le coût de la vie continue à augmenter. De fait, le média Kassioun a estimé en octobre 2024 que le coût moyen de la vie pour une famille syrienne composée de cinq personnes à Damas était de 13,6 millions de livres (environ 1077 dollars ou 1033 euros). Le salaire minimum était lui de 8,5 millions (environ 673 dollars, 645 euros).
Pour couronner le tout, l'influence des puissances étrangères en Syrie reste une source de menace et d'instabilité, comme l'a démontré la dernière invasion par Israël et la destruction encore en cours des infrastructures militaires. Sans oublier les attaques et les menaces constantes de la Turquie dans le nord-est de la Syrie, en particulier dans les zones où les Kurdes sont en majorité.
L'un des plus grands problèmes, dans la mer d'incertitude dans laquelle se trouve le pays, c'est que la plupart des acteurs politiques de premier plan, y compris le HTC, n'ont pas de programme économique politique alternatif.
Le HTC n'a rien d'autre à proposer que le système économique néolibéral et, conformément aux mécanismes et aux formes de capitalisme de connivence qui existaient sous le régime précédent, le groupe s'efforce de conforter ces façons d'agir au sein des réseaux d'affaires (où l'on retrouve aussi bien d'anciens que de nouveaux personnages). Au cours des années passées, le Gouvernement de Salut d'Idlib a favorisé le développement du secteur privé, et des hommes d'affaires proches de HTC et d'al-Joulani lui-même.
Dans le même temps, la plupart des services sociaux – en particulier la santé et l'éducation – ont été assurés par des ONG et des organisations non gouvernementales internationales.
Bassel Hamwi, président de la Chambre de commerce de Damas, a déclaré qu'après la chute du régime, le nouveau gouvernement syrien nommé par HTC a annoncé aux chefs d'entreprise qu'il adopterait un système d'économie de marché et intégrerait le pays dans l'économie mondiale. M. Hamwi a été « élu » à son poste actuel en novembre 2024, quelques semaines avant la chute d'Assad. Il est également président de la Fédération des chambres de commerce syriennes.
Le HTC n'a rien d'autre à proposer que le système économique néolibéral et, conformément aux mécanismes et aux formes de capitalisme de connivence qui existaient sous le régime précédent, le groupe s'efforce de conforter ces façons d'agir au sein des réseaux d'affaires.
Al-Chareh et son ministre de l'économie ont également tenu de nombreuses réunions avec des représentants de ces chambres économiques et des hommes d'affaires de différentes régions pour leur exposer leurs idées en matière d'économie et écouter leurs doléances, dans l'optique de satisfaire leurs intérêts. La grande majorité des représentants des différentes chambres économiques de l'ancien régime occupent toujours leurs postes.
Au bout du compte, ce système économique néolibéral, combiné à l'autoritarisme du HTC, débouchera très certainement sur des inégalités socio-économiques et un appauvrissement continu de la population syrienne, ce qui a été l'une des principales raisons du soulèvement de 2011.
Le nouveau ministre de l'économie membre de HTC a réaffirmé cette orientation néolibérale quelques jours après, déclarant que « nous passerons d'une économie socialiste […] à une économie de marché respectant les lois islamiques ». Indépendamment du fait qu'il est totalement faux de qualifier le régime antérieur de socialiste, l'orientation de classe du ministre se reflète clairement dans l'accent mis sur le fait que « le secteur privé… sera un partenaire efficace et contribuera à la construction de l'économie syrienne ».
Pas un seul mot sur la place des travailleurs, des paysans, des agents de l'État, des syndicats et des associations professionnelles dans l'économie future du pays.
En dernière analyse, la façon dont la reconstruction se déroulera dépendra des forces sociales et politiques qui en seront partie prenante et des rapports de forces qui s'établiront entre elles. À cet égard, la construction d'organisations syndicales autonomes et de masse sera essentielle pour améliorer les conditions de vie et de travail de la population et, plus généralement, pour lutter en faveur des droits démocratiques et d'un système économique fondé sur la justice sociale et l'égalité.
Une idéologie réactionnaire
Dans le même ordre d'idées, le HTC a fait plusieurs déclarations et pris plusieurs décisions qui confirment la nature réactionnaire de son idéologie.
Quelques jours plus tard, Aïcha al-Dibs, nouvellement nommée à la tête des Affaires féminines et seule femme à ce jour à faire partie du gouvernement de transition, répondant à une question sur l'« espace » qui serait accordé aux organisations féministes dans le pays, a déclaré que si « les actions de ces organisations soutiennent le système que nous allons construire, elles seront les bienvenues », ajoutant : « Je ne vais pas ouvrir la voie à quiconque n'est pas d'accord avec ma façon de penser » Elle a poursuivi l'entretien en développant une vision réactionnaire du rôle des femmes dans la société, en exhortant les femmes à « ne pas aller au-delà des limites que Dieu a fixées à leur nature » et à être bien conscientes de l'importance de leur rôle d'éducatrices au sein de la famille ».
En complément, le ministère syrien de l'éducation a modifié les programmes scolaires dans une optique plus islamo-conservatrice, notamment en retirant la théorie de l'évolution des programmes de sciences, en présentant les Juifs et les Chrétiens comme ceux qui se sont « égarés » du vrai chemin ou en remplaçant les références à la « défense de la nation » par la « défense d'Allah ». Devant les nombreuses critiques suscitées par ces changements, le ministre de l'Éducation a annoncé le jour suivant que « les programmes de toutes les écoles syriennes restent en l'état jusqu'à ce que des comités spécialisés soient formés pour examiner et évaluer les programmes. Nous avons seulement imposé la suppression de tout ce qui faisait l'apologie du défunt régime Assad, et nous avons substitué dans tous les manuels scolaires des images du drapeau de la révolution syrienne à celles du drapeau du régime disparu… ». Ainsi, certains des changements qui avaient été effectués ont été annulés.
Il est donc insuffisant de faire des déclarations floues sur la tolérance envers les minorités religieuses ou ethniques ou sur le respect des droits des femmes. La question fondamentale est la reconnaissance de leurs droits en tant que citoyens et citoyennes égaux et égales participant à la prise de décision sur l'avenir du pays. De façon plus générale, les responsables de HTC ont clairement affiché leur préférence pour un régime islamique et l'application de la charia.
Pas de solution pour la question kurde
Dans le même temps, il est peu probable que HTC soit disposé à soutenir les demandes des FDS et de l'AANES, en particulier en ce qui concerne les droits nationaux des Kurdes. C'est que les régions du nord-est sont riches en ressources naturelles, en particulier pour le pétrole et l'agriculture, et qu'elles sont donc stratégiquement et symboliquement importantes. En réalité, HTC n'est pas différent du Conseil national syrien et de la Coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution, deux coalitions de l'opposition en exil qui sont hostiles aux droits nationaux des Kurdes.
Avec la chute du régime, la Turquie est devenue le principal intervenant régional dans le pays. En soutenant Hayat Tahrir al-Cham, Ankara consolide son pouvoir sur la Syrie. Le principal objectif de la Turquie, outre le fait de procéder au retour forcé des réfugiés syriens et de profiter des futures retombées économiques de la phase de reconstruction, est de nier les aspirations des Kurdes à l'autonomie, et plus particulièrement de saper les bases de l'AANES. Cela créerait un précédent défavorable à l'autodétermination kurde en Turquie.
Le principal objectif de la Turquie, outre le fait de procéder au retour forcé des réfugiés syriens et de profiter des futures opportunités économiques durant la phase de reconstruction, est de nier les aspirations kurdes à l'autonomie, et plus particulièrement de saper les bases de l'AANES.
Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de HTC que l'intégrité territoriale de la Syrie était « non négociable » et que le PKK « n'avait pas sa place » dans le pays. Quelques jours plus tard, le président Erdogan a déclaré que les FDS « ou bien diront adieu à leurs armes, ou bien seront enterrées en terre syrienne ». L'armée turque n'a par ailleurs cessé de bombarder la population civile et certaines infrastructures essentielles du nord-est de la Syrie depuis la fin de l'année 2023.
Si HTC n'a pris part à aucune confrontation militaire contre les FDS au cours des dernières semaines, l'organisation n'a pas pour autant fait entendre une opposition aux attaques menées par la Turquie, bien au contraire. Mourhaf Abou Qasra, un des principaux commandants de HTC et nouveau ministre de la Défense du gouvernement de transition, a déclaré que « la Syrie ne sera pas divisée et qu'il n'y aura pas de fédéralisme inchallah. Si Dieu le veut, toutes ces régions seront placées sous l'autorité de la Syrie ». De même, al-Chareh s'oppose lui aussi au fédéralisme.
En outre, al-Chareh a déclaré à un journal turc que la Syrie établirait une relation stratégique avec la Turquie à l'avenir, et il a ajouté : « Nous n'acceptons pas que des territoires syriens puissent menacer et déstabiliser ni la Turquie ni quoi que ce soit d'autre ».
Il a également déclaré que toutes les armes devaient passer sous le contrôle de l'État, y compris celles qui se trouvent dans les zones tenues par les FDS.
Tout cela alors que les responsables des FDS ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils voulaient négocier avec les HTC. Le commandant des FDS Mazloum Abdia déclaré qu'il était favorable à la décentralisation de l'État et à l'auto-administration, mais pas au fédéralisme, tout en étant ouvert à l'idée de s'intégrer dans une future armée nationale syrienne (avec des garanties). Il a déclaré que les FDS n'étaient pas une extension du PKK et qu'elles étaient prêtes à renvoyer les combattants non syriens immédiatement après la conclusion d'une trêve.
Al-Chareh a déclaré ces derniers jours qu'il négociait avec les FDS dans le but de dénouer la crise dans le nord-est de la Syrie et que le ministère syrien de la défense intégrerait les forces kurdes dans ses rangs. Mais il reste à savoir comment et dans quelles conditions.
Une course contre la montre pour la défense d'un espace démocratique
La grande majorité des organisations et forces sociales démocratiques à l'origine du soulèvement populaire de mars 2011 ont été réprimées dans le sang. D'abord et avant tout par le régime, mais aussi par diverses organisations islamiques fondamentalistes armées. Il en a été de même pour les institutions ou entités politiques alternatives locales mises en place par les protestataires, telles que les comités de coordination et les conseils locaux qui assuraient des services de proximité à la population. Il existe néanmoins des groupes et des réseaux civils, bien que principalement liés à des organisations de type ONG, sur l'ensemble du territoire syrien, et en particulier dans le nord-ouest de la Syrie, mais dont la dynamique est différente de celle qui prévalait au début du soulèvement.
Il existe néanmoins des groupes et des réseaux civils, bien que principalement liés à des organisations de type ONG sur l'ensemble du territoire syrien, et en particulier dans le nord-ouest de la Syrie, mais dont la dynamique était différente de celle qui prévalait au début du soulèvement.
Dans le même temps, d'autres expériences de lutte se sont développées, même si elles sont de moindre intensité. Par exemple, depuis la mi-août 2023, il y a des manifestations populaires et des grèves dans le gouvernorat de Soueida, peuplé principalement par la minorité druze, De manière plus générale, le mouvement de protestation n'a cessé de souligner l'importance de l'unité syrienne, de la libération des prisonniers politiques et de la justice sociale, tout en exigeant la mise en œuvre de la résolution 2254 de l'ONU qui préconise la mise en place d'une transition politique. Ce sont de fait les réseaux et groupes locaux qui ont proposé une figure de proue de la contestation, Mouhsina al-Mahithawi, qui a été nommée récemment au poste de gouverneur de la province de Soueïda.
D'autres villes et régions sous le contrôle du régime syrien, notamment les gouvernorats de Daraa et, dans une moindre mesure, les banlieues de Damas, ont également été le théâtre de manifestations ponctuelles, bien qu'à une échelle beaucoup plus réduite.
Ces formes de contestation ont pour partie préparé le terrain au soulèvement qui s'est produit dans les jours précédant la chute de la dynastie Assad.
Plus généralement, l'expérience accumulée au cours des premières années du début du soulèvement populaire, qui a été la plus dynamique en termes de résistance civile populaire, a été préservée grâce à leur transmission par les militant.e.s qui ont vécu ces expériences et grâce à une documentation sans précédent sur le soulèvement, comprenant des écrits, des enregistrements vidéo, des témoignages et autres. Ces vastes archives documentaires sur le mouvement de résistance civile ont vocation à être intégrées à la mémoire populaire et à constituer une ressource cruciale pour ceux et celles qui résisteront à l'avenir.
Depuis la fin du régime Assad, les initiatives locales se multiplient pour mettre en place des comités locaux ou des réseaux d'activistes de formes variées dans les différentes régions, afin d'encourager l'auto-organisation, la participation par le bas et de garantir la paix civile. Des manifestations ont déjà eu lieu, notamment pour dénoncer certaines déclarations réactionnaires à l'encontre des femmes.
Ceci dit, nous devons regarder en face l'absence criante d'un bloc démocratique et progressiste indépendant, capable de s'organiser et de s'opposer clairement au nouveau pouvoir en place. La construction de ce bloc prendra du temps. Il devra combiner les luttes contre les autocrates, l'exploitation et toutes les formes d'oppression. Il devra avancer des revendications en faveur de la démocratie, de l'égalité, de l'autodétermination kurde et de la libération des femmes afin de créer une solidarité entre les exploité.es et les opprimé.es du pays.
Pour promouvoir ces revendications, ce bloc progressiste devra construire et reconstruire les organisations populaires, depuis les syndicats jusqu'aux organisations féministes, en passant par les organisations communautaires, ainsi que les structures nationales qui permettront de les fédérer. Cela nécessitera une collaboration entre les acteurs démocratiques et progressistes de l'ensemble de la société.
En outre, l'une des tâches essentielles consistera à s'attaquer à la principale division ethnique du pays, celle qui oppose les Arabes aux Kurdes. Les forces progressistes doivent mener une lutte sans merci contre le chauvinisme arabe afin de surmonter cette division et de forger une solidarité entre ces populations. Il s'agit là d'un défi qui se pose depuis le début de la révolution syrienne en 2011 et qui devra être relevé et résolu de manière progressiste si l'on veut que le peuple syrien soit réellement libéré.
Conclusion
Il est important de rappeler que HTC est surtout le produit de la contre-révolution menée par le régime syrien, qui a réprimé dans le sang le soulèvement populaire et ses organisations démocratiques, et qui s'est de plus en plus militarisé. La progression de ce type de mouvements fondamentalistes islamiques est le résultat de diverses raisons, notamment le fait que le régime ait facilité leur développement, la répression du mouvement de contestation qui a conduit à la radicalisation de certains éléments, la meilleure organisation et discipline de leurs groupes et, enfin, le soutien de pays étrangers.
Par la suite, HTC, comme d'autres organisations islamiques fondamentalistes armées, a constitué à bien des égards la deuxième aile de la contre-révolution, derrière le régime Assad. Leur vision de la société et de l'avenir de la Syrie s'oppose aux objectifs initiaux du soulèvement et à son message universel de démocratie, de justice sociale et d'égalité. Leur idéologie, leur programme politique et leurs pratiques ont fait preuve de violence non seulement à l'égard des forces du régime, mais aussi à l'égard des groupes démocratiques et progressistes, tant civils qu'armés, des minorités ethniques et religieuses et des femmes.
En conclusion, la sauvegarde et la lutte pour une société démocratique et progressiste ne passent pas par la confiance dans les autorités actuelles de HTC ou par l'attribution de bonnes notes ou de satisfecits pour la gestion de la phase de transition, mais par la construction d'un contre-pouvoir indépendant rassemblant des réseaux et des associations démocratiques et progressistes. Le calendrier d'organisation des élections et de rédaction d'une nouvelle constitution, ou la sélection des personnalités qui participeront à une « conférence de dialogue national », peuvent faire l'objet de débats et de critiques, mais le problème essentiel est l'absence de participation de la base au processus décisionnel et l'incapacité à faire pression sur HTC pour lui imposer des concessions. Le pouvoir de décision est uniquement entre les mains de HTC. Ce cadre bénéficie également du soutien de ses principaux soutiens, la Turquie et le Quatar, mais aussi, plus généralement, de la grande majorité des puissances régionales et internationales. Plus globalement, elles ont pour objectif commun de (ré)imposer une forme de stabilité autoritaire en Syrie et dans la région. Cela ne signifie évidemment pas pour autant qu'il y ait une unanimité parmi les puissances régionales et impériales. Elles ont chacune leurs intérêts propres, souvent antagonistes, mais elles ne veulent pas d'une déstabilisation du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
L'espoir d'un avenir meilleur est dans l'air après la chute d'Assad. Tout cela dépendra de la capacité des Syrien.ne.s à reconstruire les luttes à partir de la base. Actuellement, le pouvoir et le contrôle des HTC sur la société ne sont pas encore complets, car leurs capacités humaines et militaires sont encore trop limitées pour imposer pleinement leur autorité sur l'ensemble de la Syrie, et il existe donc un certain espace pour s'organiser. Cet espace doit être mis à profit.
En fin de compte, seule l'auto-organisation des classes populaires luttant pour des revendications démocratiques et progressistes ouvrira la voie vers une libération et une émancipation réelles.
Au moins maintenant, cette opportunité existe mais nous sommes engagés dans une course de vitesse ; les classes populaires de Syrie doivent s'organiser pour faire fructifier tous les sacrifices consentis pour que se réalisent enfin les aspirations initiales de la révolution à la démocratie, à la justice sociale et à l'égalité.
*
Publié initialement sur Syria untold, 4 janvier 2025, traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepL.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au bout de plusieurs décennies, un mouvement insurrectionnel en perte de vitesse – Les maoïstes philippins sous pression

Après avoir été longtemps la force de gauche la plus puissante du pays, le Parti communiste maoïste des Philippines subit une érosion due à la répression et aux promesses d'amnistie faites par le gouvernement à ceux qui acceptent de se rendre. Les explications d'Alex de Jong.
Photo et article tirés de NPA 29
Le Parti communiste maoïste des Philippines (CPP), qui se trouve à la tête de l'une des guérillas les plus anciennes au monde et compte des dizaines de milliers de membres, reste une référence pour une partie de la gauche radicale au niveau international.
La Ligue internationale de la lutte des peuples (ILSP), représentée aux États-Unis par des organisations telles que Bayan, définit sa ligne politique dans un cadre fixé par le CPP. Aux Philippines même, le CPP et le mouvement « national-démocratique » qu'il dirige demeurent la force dominante à gauche. C'est pourquoi l'évolution récente du parti est une question qui intéresse les socialistes internationalistes du monde entier.
Aussi longtemps que subsisteront une pauvreté de masse et un système politique ostensiblement dominé par les riches, les matériaux susceptibles d'alimenter un mouvement de guerilla seront toujours là.
Ces dernières années, il est apparu clairement que le PPC était soumis à une pression croissante. Après que l'alliance avec le président Rodrigo Duterte a volé en éclats en 2017, la répression violente exercée contre le parti, ses fronts de guérilla et ses partenaires légalement reconnus s'est intensifiée1. [Une stratégie gouvernementale combinant les opérations meurtrières et les incitations matérielles à l'abandon du mouvement a permis d'affaiblir l'insurrection. Fin 2022, Le décès de l'idéologue et président fondateur du parti, Jose Maria Sison, exilé aux Pays-Bas,a marqué une date symbolique. Plus significatif encore a été ce qui est arrivé à Benito et Wilma Tiamzon au mois d'août de la même année. Ce couple s'était radicalisé alors qu'ils étaient étudiants au début des années 1970 et l'un comme et lautre étaient devenus des militant.e.s de premier plan du PPC au cours des décennies qui ont suivi. En avril 2023, le parti a confirmé le fait qu'il et elle avaient été tués par l'armée quelque huit mois plus tôt. Au moment de leur mort, Benito Tiamzon était président du comité central et Wilma Tiamzon était la secrétaire générale. Un article paru sur le site d'information Rappler expliquait comment le couple avait été traqué par l'armée pendant des mois sur l'île de Samar, autrefois bastion du CPP et de sa branche armée, la Nouvelle Armée Populaire (NPA). Ils ne sont pas les seuls membres haut placés du CPP à avoir été tués ces dernières années. Moins de six mois auparavant, Ka Oris (Jorge Madlos), ancien commandant et porte-parole de la NPA, avait été tué. À la fin de l'année 2020, le corps d'Antonio Cabanatan a été retrouvé. Membre du comité exécutif du parti, Cabanatan était l'un des responsables de la funeste décision de boycotter les élections de 1986. Parmi les autres dirigeants du CPP-NPA tués ces dernières années figurent également des membres du comité central du parti et des commandants de haut rang de la NPA.
Des signes de recul
Pour des raisons évidentes, il est difficile de recueillir des informations sur la situation du CPP/NPA clandestin. Les déclarations du parti, formulées sous forme de slogans, ne sont pas très significatives : la révolution « avance à grands pas » et « la crise du système pourri ne cesse de s'aggraver », et il en est ainsi depuis des décennies. Les données recueillies par l'ONG Armed Conflict Location Event Data (ACLED) montrent une légère diminution des affrontements armés impliquant la NPA au cours de la période 2016-2023, mais ne précisent pas qui en est (ICG) à l'origine. Selon un rapportdu centre d'études et de recherches International Crisis Group, le nombre de personnes tuées dans le conflit est de l'ordre de quelques centaines par an, l'année 2024 étant probablement moins meurtrière que les précédentes. Ang Bayan, le journal du parti, présente des rapports détaillés sur les activités de la NPA. En additionnant les chiffres qui y sont donnés, on obtient un tableau assez semblable du nombre de pertes annuelles, la plupart des affrontements se déroulant dans un petit nombre de régions. Le parti affirme qu'il « érode » le potentiel militaire de l'État philippin, mais dans un pays de près de 120 millions d'habitant.e.s, où l'âge moyen est de moins de 26 ans et où le chômage est massif, l'armée peut facilement trouver de nouvelles recrues.
Globalement, la conclusion selon laquelle le parti a été affaibli par rapport aux dernières années de la présidence de Gloria Macapagal-Arroyo, au cours de la première décennie des années 2000, se révèle inévitable. Ces années-là avaient vu une augmentation de l'activité de la NPA et un renforcement du parti au regard de la crise qu'il avait traversée dans les années 1990. À la suite de l'effondrement du régime de Ferdinand Marcos en 1986, lequel avait instauré la loi martiale en 1972, le parti a été pris par surprise par ce qui était à bien des égards une restauration de la « démocratie d'élite » de la période précédant Marcos. Les révélations sur la façon dont des centaines de camarades ont été torturé.e.s et tué.e.s lors de purges paranoïaques au cours des années 1980 ont mis à mal la confiance dans la capacité de la NPA à représenter une alternative2.
Derrière une façade d'unité idéologique monolithique, avec Sison comme figure d'autorité en toute chose, le CPP a toujours été un mouvement assez décentralisé dont les différentes expériences ont produit un certain pluralisme idéologique. Cette situation est devenue manifeste lorsqu'une période de débats intenses a débuté au sein du mouvement. Au début et jusqu'au milieu des années 90, les partisan.e ;s de la ligne dure maoïste sont parvenus à y mettre un terme par des expulsions massives, qui ont conduit des unités entières du parti à annoncer qu'elles s'en séparaient. Une grande partie de la gauche philippine est née de ces scissions et désaffiliations. Lorsque le CPP est sorti de cette crise, il avait considérablement fondu. Extrêmement hostile aux autres composantes de la gauche, il a entrepris une campagne d'assassinats de « faux militants de gauche », notamment des responsables paysans qui avaient adopté une stratégie différente3 et des membres d'autres groupes révolutionnaires4. [Bien qu'il ne soit plus jamais parvenu à se rapprocher de son plus haut niveau du milieu des années 1980, après avoir « réaffirmé » le maoïsme, le CPP, désormais plus homogènement stalinien et rigide sur le plan organisationnel, a été en mesure de récupérer une partie du territoire perdu au cours de la présidence d'Arroyo, qui devenait de plus en plus impopulaire.
En parcourant les écrits stéréotypés du parti, on constate que les déclarations du CPP ne laissent entrevoir que tout ne va pas pour le mieux. Au lieu des centaines de fronts de guérilla que le parti revendiquait dans les années 1980, les déclarations récentes font état de « plus de 110″ fronts de guérilla. En 2007, le parti avait fixé un délai de cinq ans pour que la lutte armée aboutisse à une « impasse stratégique », mais après avoir admis que l'objectif n'avait pas été atteint, aucun nouveau délai n'a été fixé, ce qui signifie que la guérilla se trouve dans la même phase qu'il y a quarante ans. Dans ses rapports, la NPA affirme avoir des « milliers » de combattants, mais selon les dires du gouvernement, la NPA ne compte plus que 1 500 combattant.e.s permanent.e.s. Les deux parties ont fait des déclarations trompeuses. Comme dans le passé, les deux parties ont déjà fait des déclarations douteuses, ces chiffres ne peuvent pas être acceptés sans réserve.
L'indication la plus claire que le parti est confronté à des difficultés a été son communiqué de 2023 à l'occasion de l'anniversaire de sa fondation. De telles déclarations sont censées donner une orientation générale pour l'année à venir. Le document de 2023 était quelque peu différent, car il annonçait un « mouvement de rectification » pour surmonter « les erreurs et les tendances négatives, les faiblesses et les lacunes ». » Nombre de fronts de guérilla de la NPA ont stagné « , écrit le parti, et il y a eu de » graves revers « . Ces revers sont imputés à des déviations de la ligne maoïste : Puisque la ligne est censée être correcte et les « conditions objectives » excellentes, les revers sont forcément le résultat d'une déviation par rapport au maoïsme. Par conséquent, la réponse aux difficultés du parti consiste à renforcer le maoïsme. Ce type de logique circulaire est bien connu au sein du parti. Le fait que le CPP qualifie cet appel de « mouvement de rectification » mérite cependant d'être souligné. Il n'a qualifié une campagne de « mouvement de rectification » qu'à deux reprises auparavant : lors de la fondation du parti à la fin des années 1960, lorsqu'il s'est séparé du Partido Komunista ng Pilipinas5, et lors de la campagne contre les dissident·es au milieu des années 1990. L'utilisation de l'expression « mouvement de rectification » témoigne de la gravité du problème.
Un paysage en mutation
Comment le mouvement en est-il arrivé là ? Une partie de la réponse réside dans le fait que le cours suivi par le parti sur le long terme depuis le début des années 1990 a été un mouvement de déclin, même si, comme nous l'avons vu, ce recul n'a pas été constant. Le parti est profondément attaché à une perception de la société philippine comme étant non pas capitaliste, mais « semi-féodale ». Le problème fondamental du pays, affirme le parti, est « l'exploitation semi-féodale » à la campagne, c'est-à-dire une exploitation qui ne passe pas par l'exploitation d'une main-d'oeuvre salariée, « libre », mais qui repose sur la coercition directe. L'archétype de cette exploitation est le métayer, qui vit et travaille sur des terres appartenant à un propriétaire et qui est contraint de lui remettre une grande partie de sa récolte et d'effectuer des travaux non rémunérés pour lui. De cette lecture, le parti déduit de manière mécanique et directe que la lutte révolutionnaire consiste fondamentalement à mener une guérilla qui s'appuie sur la paysannerie.
Quel que soit le bien-fondé de son analyse pour les Philippines du milieu du vingtième siècle ou même des années 1980, elle se heurte de plus en plus à la réalité. Bien que l'économie philippine reste largement basée sur l'agriculture et l'exportation de produits agricoles, les rapports de production ont changé de manière significative depuis la fondation du CPP. Parmi les » opérateurs agricoles « , le statut de métayer est passé de plus d'un tiers dans les années 1960 à seulement 15 % il y a déjà une dizaine d'années. La proportion de personnes qui travaillent comme paysans a diminué de moitié au cours de la même période6. [Les travailleuses et travailleurs salariés des secteurs formel et « informel » constituent aujourd'hui la majorité de la population active. La paysannerie a diminué en proportion de la population active et en termes d'importance pour la production économique. D'autre part, le secteur des services a connu une croissance rapide, ce que n'avaient pas prévu les maoïstes, qui supposaient que le développement économique emprunterait nécessairement la voie de l'industrialisation, qu'ils considéraient comme bloquée par l'impérialisme. Mais en 2020 encore, Sison déclarait qu'aucun changement « qualitatif » ne s'était produit depuis les années 1960, ni d'ailleurs depuis la période du colonialisme américain. Le programme du CPP est de moins en moins pertinent, mais le parti a passé des décennies à dénoncer ceux qui ne partagent pas son point de vue selon lequel les Philippines sont une société non capitaliste et semi-féodale.
Le dogmatisme théorique va de pair avec des embardées dans la pratique. La plus spectaculaire d'entre elles a été la tentative du parti, en 2016, de forger une alliance avec le président récemment élu, M. Duterte. Lorsque Duterte a été élu, il était inconnu sur le plan politique pour la plupart des gens, mais pas pour le PPC. Pendant des décennies, Duterte avait été à la tête de Davao City, la ville la plus importante du sud du pays, où il entretenait une relation mutuellement bénéfique avec le parti. Duterte avait adopté une approche non interventionniste à l'égard des clandestins qui, en retour, ne troublaient pas la paix dans « sa » ville de Davao et fermaient les yeux sur l'utilisation d'un escadron de la mort comme outil de lutte contre la criminalité. Duterte, bien évidemment, a mis en place cet instrument à l'échelle nationale, ce qui s'est traduit par des milliers d'assassinats. Cela n'a pas fait obstacle à une période de lune de miel entre le président et le parti. Le premier signal indiquant que le mouvement étendrait son alliance avec Duterte au-delà de Davao a été donné par les déclarations de Sison. Sison a en effet annoncé que la présidence de Duterte serait bénéfique pour « l'unité nationale », et Duterte a proposé aux maoïstes des postes ministériels. Le CPP a poliment proposé à plusieurs de ses partenaires légallement reconnus d'occuper ces postes. L'une d'entre eux, Liza Maza, a continué à occuper un poste ministériel auprès de Duterte jusqu'en août 2018. Par la suite, Liza Maza est devenue secrétaire générale de l'ILSP.
Une photo datant de septembre 2016 illustre bien l'évolution des relations. Prise le 26 septembre dans la salle à manger d'apparat du palais présidentiel de Malacañang, elle montre Duterte en compagnie de membres de son équipe de négociation et de celle du Front national-démocratique ( FND), l'étiquette utilisée par le CPP pour mener à bien ses activités diplomatiques. Les sourires emplissent la pièce, Duterte lève le poing avec les représentant.e.s du FND. À ses côtés, Luis Jalandoni, l'actuel président du FND, ainsi que Wilma et Benito Tiamzon. Ces deux derniers avaient été libérés le mois précédent. Au cours des mois suivants, les relations se sont détériorées et, en février 2017, le cessez-le-feu entre le gouvernement et la NPA a été rompu.
Avec le recul, on ne voit pas très bien ce que le CPP pensait tirer de cette tentative d'alliance. Tant que Duterte n'était qu'une figure régionale, les relations amicales avec le CPP étaient à son avantage, car cela garantissait qu'ils ne l'importuneraient pas. Mais dès qu'il est devenu président, cette possibilité n'a plus existé. C'est probablement Sison, en sa qualité de président du groupe d'experts du FND, qui a soutenu avec le plus d'enthousiasme l'idée de transformer les relations existantes avec Duterte en une alliance nationale. Pendant des mois, le FND a continué à discuter de réformes profondes avec un gouvernement qui n'a jamais eu l'intention de les mettre en œuvre. De toute évidence, Sison a surestimé l'influence qu'il exerçait sur Duterte, qui avait été autrefois un de ses étudiants.
Un avenir incertain
Les déclarations du CPP sont répétitives, mais les déclarations du gouvernement philippin prédisant la défaite imminente de l'insurrection le sont tout autant. Aussi longtemps que subsisteront une pauvreté de masse et un système politique ostensiblement dominé par les riches, les matériaux susceptibles d'alimenter un mouvement de guerilla seront toujours là. Hormis un recul important pendant le COVID, l'économie philippine a connu une forte croissance au cours des dernières années, notamment grâce à l'essor du secteur des services. Mais cette croissance n'a guère profité aux pauvres du pays, en particulier dans les campagnes reculées. Après six décennies, le CPP ne va pas disparaître soudainement.
Lorsque le cessez-le-feu a été rompu, le parti a semblé retourner à la normale. Il y a cependant une différence. Sous Duterte, le gouvernement n'a pas seulement relancé le recours à la répression meurtrière et à la chasse aux activistes de terrain, marqué.e.s comme « rouges », il les combine désormais avec des mesures de grâce et d'aide financière pour les rebelles qui se rendent, ainsi qu'avec un soutien aux communautés qui abandonnent le soutien qu'elles apportaient jusqu'alors à la NPA. Le gouvernement actuel de Marcos Jr poursuit cette politique. Il est évident que le gouvernement gonfle l'ampleur et le succès de ce programme, mais l'utilisation de la « carotte et du bâton » n'est pas sans succès. À propos de la répression réussie d'une rébellion menée par les communistes dans les années 1950 aux Philippines, Edward Lansdale, expert en contre-insurrection de la CIA, disait qu'une promesse qui semble crédible était plus importante qu'un changement réel. Selon le rapport déjà évoqué de l'ICG, « les rebelles se sont retrouvés de plus en plus à la dérive et sur la défensive. Les arrestations et les redditions de combattants se sont succédé à un rythme soutenu ».
Les difficultés du CPP et du bloc d'organisations sociales qui reprennent sa ligne politique ne se développent pas dans un isolement total par rapport au reste de la gauche. Le mouvement dirigé par le CPP reste la force la plus puissante de la gauche philippine. Et si la répression se concentre sur le CPP, elle ne s'y limite pas. Plusieurs membres de la section philippine de la Quatrième Internationale, le RPM-M, ont également été tués, par exemple.
La société philippine est en train de changer, l'urbanisation progresse et la composition des classes laborieuses se transforme. La gauche doit avoir la volonté de rompre avec les vieux dogmes et les vieilles divisions et de faire face à de nouvelles questions telles que la crise climatique. Il est peu probable que le PPC y parvienne, mais il y a, surtout dans sa périphérie « émergée », beaucoup de jeunes militant.e.s dévoué.e.s qui sont plus motivé.e.s par le désir de changer la société que par le dogme maoïste. Mais pour l'instant, c'est la droite qui domine, comme le montre la popularité de Duterte dans le passé et du président Marcos Jr aujourd'hui. Lors des élections de 2022, Leody de Guzman, du parti socialiste Lakas ng Masa, s'est présenté à l'élection présidentielle avec pour colistier le célèbre militant et universitaire Walden Bello. La campagne a ouvert une nouvelle voie, puisqu'il s'agissait de la première campagne présidentielle ouvertement socialiste de l'histoire des Philippines, mais avec 0,17 % des voix, le résultat a déçu les militant.e.s. Un nouveau pôle d'attraction de gauche reste à construire.
Publié par Tempest le 2 janvier 2025, traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Il a demande a l’Égypte et à la Jordanie d’accueillir les Ghazaouis : Le plan d’une nouvelle « Nakba » de Donald Trump

Donald Trump a déclaré s'être entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie et avec le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi au sujet de l'avenir de Ghaza, les exhortant à accueillir une partie de la population de l'enclave martyrisée. « Je préférerais m'impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements dans un endroit différent, où ils pourraient peut-être vivre en paix pour une fois », a assuré le président américain.
Tiré d'El Watan.
C'est la dernière sortie du fantasque Donald Trump. Samedi, le président américain fraîchement investi a suggéré de transférer une partie de la population de Ghaza vers l'Egypte, la Jordanie et d'autres pays arabes, à titre temporaire ou même définitif, a-t-il laissé entendre. Le prétexte avancé est de permettre de « faire le ménage », comme il dit, et de « nettoyer » Ghaza, au sens littéral du terme, c'est-à-dire déblayer et reconstruire l'enclave dévastée par quinze mois de bombardements sans relâche.
Mais connaissant Trump et son soutien sans réserve à l'entité sioniste, on ne peut s'empêcher de songer aux conséquences démographiques de ce plan improbable qui appelle en réalité à provoquer une nouvelle Nakba, comme en 1948, à l'encontre du peuple palestinien, en faisant déplacer massivement les Palestiniens de Ghaza. Auquel cas, « nettoyer » ce territoire ravagé, comme le proclame Trump, sous-entend commettre un nouveau « nettoyage ethnique », sous une autre forme, purement et simplement.
D'après Associated Press, c'est « au cours d'une séance de questions-réponses de 20 minutes avec les journalistes à bord d'Air Force One » que Trump a fait part de son étrange plan pour Ghaza. « Le président Donald Trump a déclaré samedi qu'il aimerait voir la Jordanie, l'Egypte et d'autres pays arabes augmenter le nombre de réfugiés palestiniens qu'ils accueillent, issus de la bande de Ghaza, ce qui pourrait permettre de déplacer suffisamment de population pour ‘'nettoyer'' la région déchirée par la guerre et faire table rase du passé », rapportait hier l'agence AP.
Ghaza « est un chantier de démolition »
Le président des Etats-Unis a indiqué qu'il s'était entretenu plus tôt dans la journée, ce samedi, avec le roi Abdallah II de Jordanie et qu'il s'entretiendrait ensuite avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. « J'aimerais que l'Egypte prenne des gens », a lancé le leader US, selon AP. « Il s'agit d'un million et demi de personnes pour nettoyer tout le territoire. Vous savez, au cours des siècles, cette région a connu de nombreux conflits.
Je ne sais pas, mais il faut que quelque chose se passe », a-t-il affirmé. Trump a confié avoir félicité la Jordanie pour avoir accueilli des réfugiés palestiniens, avant de lancer à l'adresse du roi Abdallah II : « J'aimerais que vous en acceptiez davantage, parce que je regarde toute la bande de Ghaza en ce moment, et c'est un vrai gâchis.
C'est un vrai gâchis. » Pour le président américain, le transfert des habitants de Ghaza « pourrait être temporaire ou à long terme ». A ses yeux, Ghaza « c'est littéralement un chantier de démolition à l'heure actuelle. Presque tout a été démoli, et les gens meurent là-bas ».
Et de souligner : « Je préférerais donc m'impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements dans un endroit différent, où ils pourraient peut-être vivre en paix pour une fois ». Lors de son investiture le 20 janvier, le successeur de Joe Biden avait estimé que Ghaza « doit vraiment être reconstruite d'une manière différente ».
Trump parlait comme un businessman, un cynique magnat de l'immobilier, sans un mot pour l'horreur génocidaire subie par la population palestinienne de l'enclave sauvagement pilonnée durant quinze mois. Il lâche : « Ghaza est intéressante. C'est un endroit phénoménal, au bord de la mer. Il y fait très beau, vous savez, tout va bien.
On pourrait en faire de belles choses, mais c'est très intéressant ». Réagissant à cette déclaration, Sami Abou Zuhri, un porte-parole du Hamas, a répliqué à Trump en disant, selon des propos rapportés par RT Arabic : « Les habitants de Ghaza ont enduré la mort pour ne pas quitter leur patrie et ils ne la quitteront pas.
Il n'est donc pas nécessaire de perdre du temps avec des projets que M. Biden a essayés et qui ont été une raison de prolonger les combats ». Et d'ajouter : « La mise en œuvre de l'accord (de cessez-le-feu) résoudra tous les problèmes dans la bande de Ghaza, et les tentatives de contournement de l'accord n'ont aucune valeur. »
Une livraison de bombes débloquée
De son côté, Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas, a indiqué hier à l'AFP que « les Palestiniens feront échouer la proposition de Trump comme ils ont fait échouer tous les projets de déplacement pendant des décennies ».
Le Jihad Islamique a également répliqué à la proposition de Trump via un communiqué où on peut lire : « Ces déclarations déplorables s'alignent sur les pires facettes de l'agenda de l'extrême droite sioniste et poursuivent la politique de déni de l'existence du peuple palestinien ». Pour le Jihad Islamique, ce genre de sorties ne fait qu'encourager « la perpétration continue de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ».
Côté israélien, on ne pouvait qu'applaudir la dernière trouvaille de Donald Trump comme l'a fait le ministre d'extrême-droite Bezalel Smotrich pour qui la proposition du président US « est une excellente idée », selon des propos repris par Al Jazeera. « Aider les habitants de Ghaza à trouver d'autres endroits pour commencer une nouvelle vie est une excellente idée ».
Les Palestiniens « pourront établir une nouvelle et belle vie ailleurs », s'est réjoui l'extrémiste ministre israélien des Finances. Smotrich a ajouté qu'il travaillerait volontiers avec le cabinet de Netanyahou « pour s'assurer que l'idée qu'un grand nombre d'habitants puissent quitter Ghaza pour les pays voisins soit mise en œuvre ».
Pour sa part, son acolyte dans la coalition d'extrême-droite israélienne, le ministre de la Sécurité nationale sortant, Itamar Ben-Gvir, a également accueilli avec ferveur le plan de Trump visant à « nettoyer » Ghaza, en déclarant, selon Al Jazeera : « Je félicite le président Trump pour son initiative visant à transférer la population de Ghaza vers la Jordanie et l'Egypte. »
Il a fait savoir dans la foulée qu'une de ses demandes « au Premier ministre Benjamin Netanyahu est d'encourager la migration volontaire ». Ben-Gvir renchérit en disant que lorsque « le président de la plus grande puissance mondiale propose une migration volontaire des Palestiniens, il est sage pour notre gouvernement de l'encourager et de la mettre en œuvre ».
Par ailleurs, Donald Trump a déclaré durant son échange avec les journalistes à bord du Air Force One ce samedi qu'il a ordonné de « débloquer une livraison de bombes de 2000 livres (907 kg) » au profit d'Israël. « M. Trump a déclaré qu'il a mis fin à la suspension par son prédécesseur de l'envoi de bombes de 2000 livres à Israël » indique Associated Press. « Nous les avons libérées aujourd›hui. Ils (les Israéliens) les attendaient depuis longtemps », a annoncé le président américain.
A la question de savoir pourquoi avoir débloqué ces bombes particulièrement dévastatrices, il a répondu : « Parce qu'ils les ont achetées ». Joe Biden avait interrompu la livraison des bombes de ce calibre en mai 2024 « afin d'empêcher Israël de lancer un assaut généralisé sur la ville de Rafah, au sud de la bande de Ghaza », précise AP. « Des civils ont été tués à Ghaza à cause de ces bombes et d'autres moyens utilisés pour s'attaquer aux centres de population », avait alors déploré Biden dans une interview à CNN, rappelle AP.
La Jordanie rejette tout projet de déplacement de Palestiniens
La Jordanie a réitéré, hier, son rejet de la réinstallation des Palestiniens hors de leur terre, après l'appel du président Trump à « nettoyer » la bande de Ghaza. « Nos principes sont clairs, et la position inébranlable de la Jordanie en faveur du maintien des Palestiniens sur leur terre reste inchangée et ne changera jamais », a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, cité par Anadulu lors d'une conférence de presse conjointe à Amman avec Sigrid Kaag, coordinatrice principale des Nations unies pour l'aide humanitaire et la reconstruction à Ghaza.
Le rejet par la Jordanie du déplacement des palestiniens « est inébranlable et essentiel pour parvenir à la stabilité et à la paix que nous appelons tous de nos vœux », a-t-il ajouté. « La solution à la question palestinienne se trouve en Palestine ; la Jordanie est pour les Jordaniens et la Palestine est pour les Palestiniens », a encore affirmé Safadi. Décrivant Ghaza comme un « chantier de démolition », Donald Trump a appelé, samedi, à « vider » l'enclave sinistrée et à réinstaller les Palestiniens en Jordanie et en Égypte.
Une proposition qui intervient une semaine après l'entrée en vigueur, le 19 janvier, d'un accord de cessez-le-feu dans la Bande de Gaza, suspendant la guerre génocidaire qu'Israël mène depuis le 7 octobre 2023 et qui a tué plus de 47 300 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d'enfants, et en a blessé plus de 111 400 autres."
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












