Derniers articles
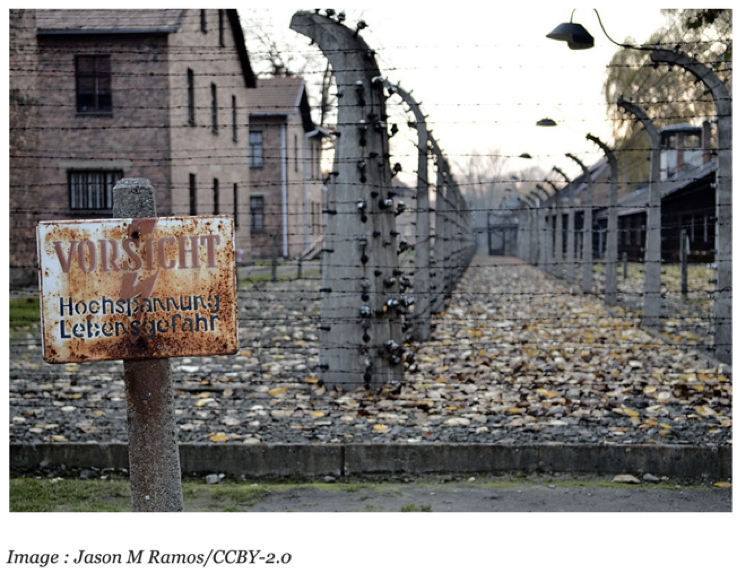
Israël, Netanyahou et la commémoration de la libération d’Auschwitz
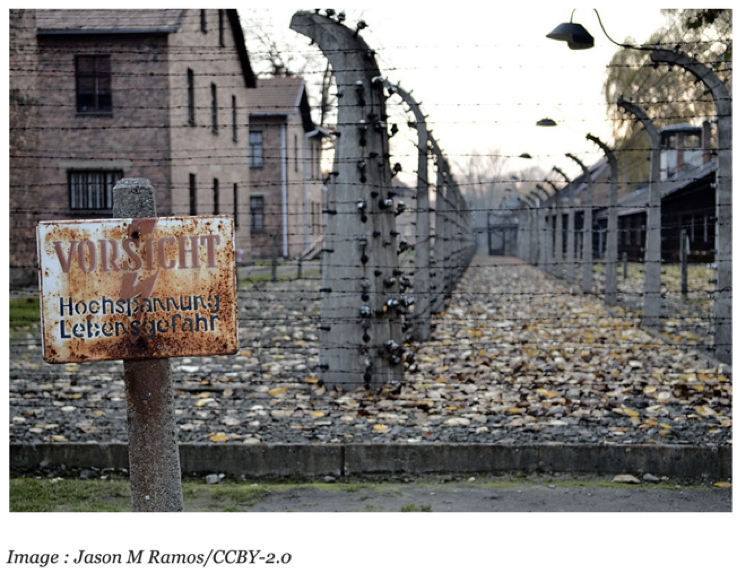
Benjamin Netanyahou ne participera pas à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Quelle en est la raison ?
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Le journaliste Gideon Levy a été plus rapide que moi cette semaine. Dans un article intitulé « Auschwitz-La Haye-Netanyahou » dans le quotidien « Haaretz », il a traité d'un sujet que je voulais également aborder cette semaine dans ma chronique de blog. Il est donc juste de commencer par le citer. « Le Premier ministre Benjamin Netanyahu », écrit-il, « n'assistera pas cette année à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, car en raison du mandat d'arrêt lancé contre lui par la Cour internationale de justice de La Haye, il est à craindre qu'il ne soit arrêté. Cette ironie amère et quelque peu grossière de l'histoire crée un nœud surréaliste que jusqu'à présent, personne n'aurait pu envisager. Essayons d'imaginer Netanyahou atterrissant à Cracovie, arrivant à l'entrée principale d'Auschwitz et se faisant arrêter par des policiers polonais au-dessous de l'enseigne 'Arbeit macht frei' ».
Plus loin, il ajoute : « Le fait que, de tous les endroits du monde, Auschwitz soit le premier lieu que la peur fasse éviter à Netanyahou a un caractère hautement symbolique et une charge de justice historique énorme ». Levy brosse un tableau qui donne à réfléchir : « Soit une cérémonie pour le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les dirigeant.e.s de la planète défilent en silence, les dernier.e.s rescapé.e.s de la Shoah encore en vie marchent à leurs côtés, et le Premier ministre de l'Etat construit sur les cendres de la Shoah n'est pas là. Il est absent parce que son pays s'est transformé en un État pestiféré et parce qu'il est poursuivi par le tribunal le plus éminent en matière de crimes de guerre ». Levy conclut sa chronique par cette observation incroyable : « Netanyahou ne sera pas à Auschwitz parce qu'il est recherché pour crimes de guerre ».
Effectivement, cet « incident » a un caractère de paradigme. Mais malgré le fait qu'environ la moitié de la population israélienne souhaite la chute politique de Netanyahu, que beaucoup espèrent qu'il finira en prison à l'issue de son procès et qu'il se soit déjà rendu coupable de tellement d'actes répréhensibles (y compris à l'intérieur d'Israël) que l'on peut trop bien comprendre la haine dirigée contre lui (et sa famille), Netanyahou lui-même n'est qu'un personnage secondaire dans ce que Gideon Levy évoque. Très souvent, des personnes de rang inférieur sont tenues pour responsables de fautes et de délits qui ont été causés ou initiés « en haut » du système hiérarchique concerné. En Israël, en ironisant sur le fonctionnement de la hiérarchie militaire, il est devenu monnaie courante de parler de la culpabilité du « garde à la porte du camp militaire » C'est devenu courant.
Il en va autrement lorsque c'est une pratique sociale ou politique qui est condamnée, mais pour laquelle il n'est pas possible de sanctionner l'ensemble d'une collectivité (comme par exemple lors du boycott de l'Etat d'apartheid sud-africain, qui a pu être mis en œuvre dans le cadre d'une entente internationale). Dans ce dernier cas, le chef d'État concerné ou d'autres fonctionnaires de haut rang sont tenus pour responsables en tant que représentants symboliques de la collectivité. En condamnant Netanyahu, c'est « Israël » qui est condamné.
Cela doit être souligné, car la responsabilité ministérielle pour les crimes de guerre incombe certes à l'institution dirigeante, mais elle est habituellement de nature plutôt abstraite. La barbarie (physique) du crime se déroule en revanche « sur le terrain ». En tant que gouvernant, Netanyahu porte la responsabilité de la politique qu'il a tracée et ordonnée, et donc des directives militaires qui en découlent dans la guerre actuelle. Bien qu'il refuse sans cesse d'assumer toute responsabilité, et notamment celle du désastre du 7 octobre, ce ne sont pas forcément ses instructions qui ont généré les crimes de guerre concrets. C'est autre chose qui doit être pris en compte ici.
La barbarisation de l'armée israélienne
Car ce qui est apparu lors des opérations de l'IDF dans la bande de Gaza l'année dernière, c'est l'extrême brutalisation des troupes combattantes en action, dont les crimes de guerre se sont multipliés (et se multiplient encore) à un point tel que l'on a assez vite commencé à parler de génocide contre la population civile de Gaza. Le débat sur la question de savoir s'il s'agit effectivement d'un génocide n'est pas abordé ici ; la polémique ardente sur la question de la désignation ne fait que détourner l'attention de l'essentiel - de la barbarisation incontestable de l'armée israélienne et de son activité guerrière. Il suffit de se pencher sur l'accumulation des crimes de guerre pour comprendre que dans cette guerre, quelque chose a pris forme qui dépasse de loin la personne de Netanyahu. Une technique de combat est devenue la norme, avec laquelle la mort d'un nombre incroyable de civils, parmi lesquels surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées, ainsi que la destruction monstrueuse d'infrastructures et des ressources de la vie civile sont devenues « des choses tout à fait naturelles ».
Il a déjà été expliqué ici la semaine dernière (dans un article sur les recherches du docteur Lee Mordechai de l'université hébraïque de Jérusalem ndt) que l'accusation de crimes de guerre commis est établie depuis longtemps et que personne ne pourra prétendre plus tard ne pas avoir été au courant. Le fait que les médias établis d'Israël privent la population du pays de comptes-rendus sur les actes de barbarie commis en son nom, qu'ils les cachent même carrément, ne peut être accepté comme explication du silence général sur ces crimes - celui qui veut savoir peut tout savoir. Il faut certes vouloir savoir.
De la même manière, la « justification » des crimes de guerre à partir du pogrom perpétré contre des Israéliens juifs le 7 octobre n'a pas de fondement recevable dès lors que l'on récuse le bien-fondé de la mobilisation de l'armée pour assouvir des désirs collectifs de vengeance et de représailles. Le meurtre d'enfants par une armée (considéré comme un « dommage collatéral ») ne peut pas constituer une « réparation » de sa propre souffrance. Et encore moins lorsque ses conséquences s'accroissent pour atteindre une disproportion aussi éclatante.
Ce qui frappe avant tout, c'est le plaisir, le sadisme et la joie de nuire manifestés par les soldats au cours de ce massacre qui n'en finit pas. Le 7 octobre a dégénéré en permis de détruire à outrance et d'anéantir sans scrupule des vies humaines. Jamais dans aucune guerre, les soldats sur le champ de bataille n'ont été des apôtres de l'humanité - « les soldats habitent sur les canons » et généralement ils font de leurs ennemis des « steaks tartare ». Pour la population civile ennemie, la situation devient particulièrement difficile lorsque des avions de combat modernes sont massivement utilisés. Mais ce qui peut s'expliquer sur le champ de bataille par la logique interne de ce que la guerre a toujours été dans son essence - l'absence d'inhibition légitimée dans le meurtre d'êtres humains et la dévastation des conditions de vie matérielles - fait frémir lorsqu'il s'avère qu'une collectivité entière se range derrière les crimes de son armée nationale.
Le peu que la population israélienne a pu apprendre de l'horreur de la réalité de Gaza a été (et est encore aujourd'hui) rejeté avec une indifférence effrayante comme étant une contre-vérité, une exagération, une propagande perfide de l'autre camp ou, par facilité, rationalisé en attribuant la responsabilité des crimes de guerre aux habitant.e.s de Gaza eux-mêmes (« ce sont eux qui ont commencé ») ou en déclarant ouvertement ne pas pouvoir éprouver de compassion pour eux.
Aussi bien le comportement plus brutal des soldats que l'indifférence de la population civile israélienne découlent d'un long et constant processus de déshumanisation des Palestiniens. 57 ans d'occupation barbare et l'effacement déjà ancien du conflit israélo-palestinien de l'ordre du jour politique d'Israël et du reste du monde ( mené délibérément en particulier par Netanyahou) ont fini par produire des résultats inévitables. La vie humaine palestinienne ne compte pas beaucoup pour la grande majorité des Juifs israéliens, surtout après le 7 octobre, et encore moins lorsqu'il s'agit des habitant.e.s de Gaza, qui sont presque tous et toutes désigné.e.s par le gouvernement israélien actuel comme des terroristes du Hamas.
Trahison de la mémoire d'Auschwitz
La mise sur le même plan de la catastrophe de Gaza et d'Auschwitz n'est pas justifiable - elle est d'ailleurs contestée par Gideon Levy dans sa chronique. Mais il est inutile de revenir là-dessus. Cela fait trop longtemps que la politique israélienne instrumentalise la singularité d'Auschwitz à des fins politiciennes qui n'ont rien à voir avec elle. On ne peut tirer aucune leçon de la Shoah, ni même le postulat idéologique de la nécessité d'un « refuge pour le peuple juif », comme cela devrait être clairement démontré aujourd'hui avec une évidence très frappante.
Tout au plus pourrait-on dégager de la Shoah l'idée directrice d'une société qui s'efforcerait de minimiser, voire de rendre impossible, que des êtres humains soient sacrifiés, et ce en tant que message abstrait. C'est peut-être ce qu'a voulu dire Walter Benjamin en évoquant la « faible force messianique » qui est transmise à chaque génération existante par rapport aux générations passées. Et c'est précisément en cela que se manifeste l'effroyable trahison qu'Israël a commise (pas seulement actuellement, mais maintenant avec une démesure qu'il a lui-même choisie) à l'égard de la mémoire d'Auschwitz. Et c'est en cela, précisément, que réside l'horreur du symbole : le Premier ministre israélien ne participera pas à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, de peur d'être arrêté comme criminel de guerre, ce qu'il est en tant que représentant d'Israël.
Moshe Zuckermann
• Traduit de l'allemand pour ESSF par pierre Vandevoorde
Publication originale 28 décembre 2024 :
https://overton-magazin.de/top-story/israel-netanjahu-und-der-auschwitz-gedenktag/
• Repris dans le quotidien Il Manifesto le 8 janvier 2025 :
https://ilmanifesto.it/israele-e-il-tradimento-della-memoria-di-auschwitz
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une homélie qui indispose drôlement Donald Trump

Le bon Dieu a le dos large...
Le 23 mars 1933, Adolf Hitler affirme que Les Églises chrétiennes sont un élément essentiel pour la sauvegarde de l'âme du peuple allemand.
Le 11 octobre 1973, Augusto Pinochet décrit son coup d'état du 11 septembre qui renversait brutalement du pouvoir le président chilien démocratiquement élu Salvador Allende comme le jour où la main de Dieu se fit présente pour nous sauver !
Lors de son discours d'inauguration le 20 janvier dernier, Donald Trump, se réfère à la tentative d'assassinat contre lui et affirme qu'il a été sauvé par Dieu afin que l'Amérique puisse redevenir un pays formidable !
Je vais ramener le bon sens à notre pays, dit Trump.
Fini le temps où dans nos écoles les enfants apprennent à critiquer et dénigrer leur pays (une allusion, de toute évidence, à l'esclavage, au racisme, aux manœuvres secrètes de la CIA pour renverser des gouvernements, au soutien de dictatures, etc.).
Où on ouvre nos frontières du sud à des millions de criminels : des gens qui violent les femmes, des fous qui sortent des asiles, des gens qui sèment le bordel dans nos villes.
Où on privilégie systématiquement et injustement l'embauche de femmes et non d'hommes, de noirs, de latinos, etc., au lieu d'hommes blancs.
Où le système de justice est transformé en arme pour persécuter des gens complètement innocents comme moi ! Où on prétend qu'il n'y a pas seulement des hommes et des femmes dans ce monde.
Où on invente une soi-disant crise environnementale, impose des règlements, oblige le monde à acheter une voiture électrique et restreint la production de pétrole, ce qui fait monter en flèche les prix.
Où on tente de limiter la liberté d'expression sur Facebook, X, etc., en exigeant que ces derniers s'assurent que ce qui se dit dans ces réseaux sociaux correspond à la vérité et ne fait pas de tort à nos jeunes.
Toutes les entrées illégales seront immédiatement stoppées et nous commencerons à renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels dans leur pays d'origine. (...) J'enverrai des troupes à la frontière sud pour repousser l'invasion désastreuse de notre pays.
Je pourrais continuer à énumérer les nombreuses déclarations fracassantes de Donald Trump, lequel, quelques jours plus tard, renvoyait dans leurs pays d'origines – Colombie, Brésil, Honduras, etc. – mains et pieds attachés comme s'il s'agissait de criminels, des milliers d'immigrants et ceci, à bord d'avions militaires américains.
Cependant, je préfère reproduire l'homélie remarquable qu'a prononcée en présence de Donald Trump l'évêque anglicane Mariann Edgar Budde lors d'une cérémonie religieuse qui avait lieu dans la cathédrale nationale de Washington le 21 janvier.
L'aspect impérialiste et parfois farfelu du nouveau président saute aux yeux. Faire en sorte que le Canada devienne, via une guerre commerciale, une partie des États-Unis. Prendre de force le canal de Panama ainsi que le Groenland. Faire fi du traité de libre-échange et imposer un tarif de 25% sur tout produit provenant du Canada ou du Mexique.
Dans son discours à Davos, Trump affirme que l'inflation sous Biden a atteint un niveau record, ce qui est complètement farfelu : en 1980 elle atteignait 14% ! Il affirme, à Davos, devant les riches de la planète, que s'ils ne veulent pas payer de tarifs, ils doivent déménager leurs entreprises aux États-Unis, ce qui est encore complètement farfelu : ce sont les Américains qui paieraient les tarifs imposés par Trump, non pas eux !
La révérende Mariann Edgar Budde lance des flèches à Trump au niveau des valeurs humaines et spirituelles. Faire appel au mépris et au racisme n'est pas du tout une bonne façon de gérer un pays, lui laisse-t-elle clairement entendre.
L'homélie de l'évêque
Elle débute son homélie en citant le passage suivant de l'Évangile de Matthieu 7:24-29 :
Ô Dieu, tu nous as créés à ton image et tu nous as rachetés par l'intermédiaire de Jésus, ton Fils : Regarde avec compassion toute la famille humaine ; enlève l'arrogance et la haine qui infectent nos cœurs ; fais tomber les murs qui nous séparent ; unis-nous dans des liens d'amour ; et fais en sorte qu'à travers nos luttes et notre confusion nous puissions accomplir tes desseins sur la Terre ; afin qu'en ton temps, toutes les nations et toutes les races puissent te servir dans l'harmonie autour de ton trône céleste ; par Jésus-Christ notre Seigneur.
Jésus a dit : "Quiconque entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les inondations sont venues, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, mais elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les flots ont déferlé, les vents ont soufflé et battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Quand Jésus eut achevé de dire ces choses, les foules furent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non comme leurs scribes.
Rejoints par de nombreuses personnes à travers le pays, nous nous sommes réunis ce matin pour prier pour l'unité de la nation - non pas pour un accord, politique ou autre, mais pour le type d'unité qui favorise la communauté au-delà de la diversité et de la division, une unité qui sert le bien commun.
L'unité, dans ce sens, est le seuil requis pour que les gens puissent vivre ensemble dans une société libre, c'est le roc solide, comme l'a dit Jésus, dans ce cas, sur lequel on peut construire une nation. L'unité n'est pas la conformité. Ce n'est pas une victoire de l'un sur l'autre. Ce n'est pas une politesse lasse ni une passivité née de l'épuisement. L'unité n'est pas partisane.
L'unité est plutôt une façon d'être ensemble qui englobe et respecte les différences, qui nous apprend à considérer les multiples perspectives et expériences de vie comme valables et dignes de respect, qui nous permet, dans nos communautés et dans les lieux de pouvoir, de nous soucier sincèrement les uns des autres même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Ceux qui, dans notre pays, consacrent leur vie ou se portent volontaires pour aider les autres en cas de catastrophe naturelle, souvent au péril de leur vie, ne demandent jamais à ceux qu'ils aident pour qui ils ont voté lors des dernières élections ou quelles sont leurs positions sur un sujet particulier. C'est en suivant leur exemple que nous sommes au meilleur de nous-mêmes.
L'unité est parfois sacrificielle, de la même manière que l'amour est sacrificiel, un don de soi pour le bien d'autrui. Dans son sermon sur la montagne, Jésus de Nazareth nous exhorte à aimer non seulement nos voisins, mais aussi nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent, à être miséricordieux comme notre Dieu est miséricordieux et à pardonner aux autres comme Dieu nous pardonne. Jésus a fait des pieds et des mains pour accueillir ceux que sa société considérait comme des parias.
Je reconnais que l'unité, dans ce sens large et étendu, n'est qu'une aspiration. L'unité à laquelle nous appelle notre Dieu est exigeante et reflète ce qu'il y a de meilleur et de plus noble en chacun de nous. Toutes nos prières ne servent pas à grand-chose si dans notre comportement, nous ne faisons qu'accentuer et exploiter les divisions qui existent entre nous.
Nos Écritures sont très claires : Dieu n'est jamais impressionné par des prières lorsque nos actions ne vont pas dans le même sens. Dieu ne nous épargne pas non plus les conséquences de nos actes qui, en fin de compte, comptent plus que nos paroles de prières.
Ceux d'entre nous qui sont rassemblés dans cette cathédrale ne sont pas naïfs face aux réalités de la politique. Lorsque le pouvoir, la richesse et des intérêts concurrents sont en jeu, lorsque les points de vue sur ce que l'Amérique devrait être, sont en conflit lorsque des opinions fortes s'expriment à travers un éventail de possibilités et que des compréhensions radicalement différentes de ce que doit être la bonne ligne de conduite, il y aura des gagnants et des perdants lorsque des votes seront exprimés ou que des décisions seront prises qui détermineront le cours de la politique publique et la priorisation des ressources. Il va sans dire que dans une démocratie, les espoirs et les rêves de chacun ne se réaliseront pas au cours d'une session législative, d'un mandat présidentiel ou même d'une génération. Les prières spécifiques de chacun - pour ceux d'entre nous qui sont des personnes de prière - ne seront pas toujours exaucées comme nous le souhaiterions. Mais pour certains, la perte de leurs espoirs et de leurs rêves sera bien plus qu'une défaite politique, elle se traduira par une perte d'égalité, de dignité et de moyens de subsistance.
Dans de telles conditions, une véritable unité entre nous est-elle même possible ? Et pourquoi devrions-nous nous en préoccuper ?
J'espère que nous nous en soucions, car la culture du mépris qui s'est normalisée dans notre pays menace de nous détruire. Nous sommes tous bombardés quotidiennement de messages provenant de ce que les sociologues appellent aujourd'hui le complexe industriel de l'outrage , dont certains sont dirigés par des forces extérieures dont les intérêts sont favorisés par une Amérique polarisée. Le mépris alimente nos campagnes politiques et les réseaux sociaux, et nombreux sont ceux qui en tirent profit. Mais c'est une façon carrément dangereuse de diriger un pays.
Je suis une personne de foi et, avec l'aide de Dieu, je crois que l'unité de ce pays est possible - pas une unité parfaite, certes, car nous sommes tous imparfaits comme personnes – mais assez forte pour nous permettre de continuer à croire et à travailler à la réalisation des idéaux des États-Unis d'Amérique - idéaux exprimés dans la Déclaration d'indépendance, avec son affirmation de l'égalité et de la dignité innées de l'homme.
Prier Dieu afin qu'il nous aide à atteindre l'unité a du sens - nous avons besoin de son aide - mais seulement si nous sommes prêts à entretenir les fondations dont dépend l'unité. À l'instar de l'analogie de Jésus avec la construction d'une maison de foi sur le roc de ses enseignements, par opposition à la construction d'une maison sur le sable, les fondations dont nous avons besoin pour l'unité doivent être suffisamment solides pour résister aux nombreuses tempêtes qui la menacent.
Quels sont les fondements de l'unité ? En m'inspirant de nos traditions et textes sacrés, je dirais qu'il y en a au moins trois.
Le premier fondement de l'unité consiste à honorer la dignité inhérente à chaque être humain, qui est, comme l'affirment toutes les confessions représentées ici, le droit de naissance de tous les peuples en tant qu'enfants du Dieu unique. Dans le discours public, honorer la dignité de chacun signifie refuser de se moquer, de rabaisser ou de diaboliser ceux avec qui nous sommes en désaccord, et choisir au contraire de débattre respectueusement de nos différences et, chaque fois que cela est possible, de chercher un terrain d'entente. Si un terrain d'entente n'est pas possible, la dignité exige que nous restions fidèles à nos convictions sans mépriser ceux qui ont leurs propres convictions.
Un deuxième fondement de l'unité est l'honnêteté, tant dans les conversations privées que dans les discours publics. Si nous ne sommes pas disposés à être honnêtes, il ne sert à rien de prier pour l'unité, car nos actions vont à l'encontre des prières elles-mêmes. Nous pourrions, pendant un certain temps, éprouver un faux sentiment d'unité chez certains, mais pas l'unité plus solide et plus large dont nous avons besoin pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés.
Pour être juste, nous ne savons pas toujours où se trouve la vérité, et beaucoup de choses vont à l'encontre de la vérité aujourd'hui, et ce de manière stupéfiante. Mais lorsque nous savons ce qui est vrai, il nous incombe de dire la vérité, même lorsque - et surtout lorsque - cela nous coûte.
Un troisième fondement de l'unité est l'humilité, dont nous avons tous besoin, car nous sommes tous des êtres humains faillibles. Nous commettons des erreurs. Nous disons et faisons des choses que nous regrettons. Nous avons nos angles morts et nos préjugés, et nous sommes peut-être les plus dangereux pour nous-mêmes et pour les autres lorsque nous sommes persuadés, sans l'ombre d'un doute, que nous avons tout à fait raison et que quelqu'un d'autre a tout à fait tort. Car nous sommes alors à deux doigts de nous étiquetter comme les bonnes personnes, par opposition aux mauvaises personnes.
La vérité est que nous sommes tous des personnes, capables du meilleur comme du pire. Alexandre Soljenitsyne a judicieusement observé que « la ligne de démarcation entre le bien et le mal ne passe pas par les États, ni par les classes, ni par les partis politiques, mais par chaque cœur humain et par tous les cœurs humains ». Plus nous en prenons conscience, plus nous avons de place en nous pour l'humilité et l'ouverture à l'autre au-delà de nos différences, car en fait, nous sommes plus semblables les uns aux autres que nous ne le pensons, et nous avons besoin les uns des autres.
Il est relativement facile de prier pour l'unité dans les occasions solennelles. Cependant, il est beaucoup plus difficile à réaliser cette unité lorsque nous sommes confrontés à de réelles différences dans l'arène publique. Mais sans unité, nous bâtissons l'édifice de notre nation sur du sable.
Avec un engagement en faveur de l'unité qui intègre la diversité et transcende les désaccords, et les solides fondations de dignité, d'honnêteté et d'humilité qu'une telle unité requiert, nous pouvons faire notre part, à notre époque, pour aider à réaliser les idéaux et le rêve de l'Amérique.
Permettez-moi de vous adresser un dernier appel, Monsieur le Président. Des millions de personnes vous ont fait confiance. Comme vous l'avez dit hier à la nation, vous avez senti la main providentielle d'un Dieu aimant. Au nom de notre Dieu, je vous demande d'avoir pitié des personnes de notre pays qui ont peur en ce moment. Il y a des enfants gays, lesbiennes et transgenres dans des familles démocrates, républicaines et indépendantes qui craignent pour leur vie.
Et les personnes qui cueillent nos récoltes et nettoient nos immeubles de bureaux, qui travaillent dans nos élevages de volaille et nos usines d'emballage de viande, qui lavent la vaisselle dans les restaurants et qui travaillent de nuit dans les hôpitaux - ils ne sont peut-être pas citoyens ou n'ont pas les papiers nécessaires, mais la grande majorité des immigrants ne sont pas des criminels. Ils paient des impôts et sont de bons voisins. Ils sont des membres fidèles de nos églises, mosquées et synagogues, gurdwara et temples.
Ayez pitié, Monsieur le Président, des membres de nos communautés dont les enfants craignent que leurs parents leur soient enlevés. Aidez ceux qui fuient les zones de guerre et les persécutions dans leur propre pays à trouver ici compassion et accueil. Notre Dieu nous enseigne que nous devons être miséricordieux envers l'étranger, car nous avons été un jour des étrangers sur cette terre.
Que Dieu nous donne à tous la force et le courage d'honorer la dignité de chaque être humain, de dire la vérité dans l'amour et de marcher humblement les uns avec les autres et avec notre Dieu, pour le bien de tous les habitants de cette nation et du monde.
Trump réagit à l'homélie
Comme on pouvait s'y attendre, Trump n'a pas tardé à réagir, faisant appel encore une fois au mépris pour tenter de neutraliser une personne qui l'accusait justement de gérer les États-Unis en faisant constamment appel au mépris.
Sur son Truth Social, il dénonce la « soi-disant évêque » la qualifiant de « radicale de gauche qui déteste Trump ». Trump, qui a grossièrement fait entrer Dieu « dans le monde de la politique » en affirmant que Dieu l'avait sauvé afin qu'il puisse restaurer la splendeur des États-Unis, accuse maintenant l'évêque d'avoir fait entrer « son église dans le monde de la politique d'une manière très indigne ». Son homélie, insiste-t-il, était « méchante dans le ton », « ennuyeuse » et « peu inspirante ». Elle et son église doivent absolument venir s'excuser !
La révérende Mariann Edgar Budde a riposté à Trump. Je ne suis pas une radicale de gauche. Sa réaction me désole. Je ne vais pas m'excuser...
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La privatisation tranquille de l’électricité ou comment échouer sa transition énergétique en 4 étapes faciles (1 et 2)

Tout électrifier (ou presque). Voilà une des principales recommandations des organisations internationales pour la lutte aux changements climatiques. Mais cela implique en même temps de décarboner toute la production électrique (37,5 % des émissions de GES à l'échelle mondiale). Or, à travers le monde, si l'installation des panneaux solaires et des éoliennes connaît une croissance importante, elle masque souvent la croissance aussi importante du charbon et du gaz « naturel » dans le secteur électrique. Encore aujourd'hui, 59 % de l'électricité produite dans le monde repose sur des carburants fossiles. Pourquoi la décarbonation du secteur électrique n'a pas lieu, ou du moins pas suffisamment vite ? Dans son livre The price is wrong (Verso, 2024), l'économiste Brett Christophers nous livre des clés pour comprendre la situation internationale, mais aussi pour analyser au Québec les dangers du projet de réforme de la loi sur l'énergie (PL69).
13 janvier 2025
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/environnement-ressources-et-energie/privatisation-electricite-1/
La privatisation tranquille de l'électricité ou comment échouer sa transition énergétique en 4 étapes faciles (1 )
Pas les prix, mais les profits
Le prix de production de l'électricité provenant des panneaux solaires et des éoliennes a chuté radicalement dans les dernières décennies. Selon certaines estimations (contestables), il serait même compétitif avec le prix des centrales au charbon et au gaz. Pour les économistes orthodoxes, la transition énergétique ne pouvait se passer qu'à cette condition : when the price is right (lorsque le prix serait le bon).
En réalité, comme le rappelle l'économiste Brett Christophers, dans une économie capitaliste dominée par la propriété privée, ce n'est pas les prix qui déterminent principalement les investissements dans les énergies renouvelables, mais les perspectives de profitabilité. Pour développer un projet éolien, le promoteur privé doit principalement s'appuyer sur des dettes (à plus de 70 %) plutôt que des actions, contractées auprès d'une institution financière (banque ou fonds d'investissements). Ces institutions ne prêtent que si le projet est dit « bancable », soit remboursable, avec ses intérêts, ce qui suppose une évaluation de la profitabilité. Or, sur les marchés de l'électricité dérégulés, ce profit n'est pas au rendez-vous pour les énergies renouvelables (solaire et éolienne), du moins pas suffisamment pour les investisseurs financiers.
C'est la principale raison économique pour laquelle la décarbonation du secteur électrique est si lente : les profits y sont trop bas et surtout trop imprédictibles. Résultat : les États où les énergies renouvelables ont connu une croissance rapide sont tous des États où les subventions (directes ou indirectes) ont été massives, prédictibles et suffisantes pour garantir de hauts taux de profit, comme en Allemagne ou en Chine. Lorsque ces subventions s'effondrent et que les mécanismes du marché opèrent dans le secteur électrique, les profits ne sont pas aux rendez-vous et les investissements sont ralentis, au détriment du climat.
L'échec de la transition énergétique, c'est l'échec du néolibéralisme
Si les marchés de l'électricité sont défavorables aux énergies solaires et éoliennes, c'est parce qu'ils ont subi d'importantes transformations de type néolibéral et parce que leur fonctionnement a principalement été établi sur la base de l'opération de centrales traditionnelles (aux carburants fossiles et à l'énergie nucléaire). À la fin des années 1980, au moment même où les gouvernements et notamment le GIEC réalisaient la nécessité de sortir des carburants fossiles, l'électricité, principalement sous monopole public, a été graduellement transformée en un marché privé. Ainsi, l'électricité est de moins en moins publique à mesure que se développent les énergies solaires et éoliennes.
Ces transformations se sont opérées en quatre grandes étapes interreliées : 1) le dégroupage vertical (unbundling) des entités de production, de transport et de distribution de l'électricité ; 2) la dé-monopolisation de la production électrique (introduction de la compétition) ; 3) la privatisation des entreprises publiques de production d'électricité ; 4) et la commercialisation (marketisation), soit l'introduction de mécanismes de marché pour réguler la vente d'électricité entre les divers acteurs (générateurs, fournisseurs, revendeurs, distributeurs, etc.), qui a notamment pour effets d'attirer des spéculateurs et de créer une grande volatilité des prix.
Mises ensemble, ces transformations ont créé de toutes pièces des marchés de l'électricité dérégulés et dominés par l'investissement privé. Sur ces marchés, les fournisseurs d'énergies renouvelables ne parviennent pas à dégager suffisamment de profits, surtout pas de manière prédictible, entre autres en raison du caractère intermittent de leur production et des difficultés de stockage de l'électricité. Résultat : les investisseurs ont bien moins intérêt à développer les énergies renouvelables que des centrales thermiques (charbon, gaz).
En bref, la meilleure façon de rater la décarbonation du secteur électrique est d'en privatiser l'investissement. Au moment où il faut opérer des transformations inédites de l'économie, la privatisation se révèle encore une fois la meilleure façon de perdre encore plus le contrôle démocratique de l'orientation de nos sociétés… et du climat.
Dans un prochain billet, nous verrons en quoi le projet de loi 69 engage le Québec dans cette direction, ce qui pourrait bien faire perdre le caractère « exceptionnel » de notre réseau électrique public.
La privatisation tranquille de l'électricité ou comment échouer sa transition énergétique en 4 étapes faciles (2/2)
Dans un précédent billet, nous avons expliqué pourquoi le pouvoir privé sur l'investissement dans les énergies renouvelables limite leur développement. Dans ce billet, nous analyserons comment ces enseignements peuvent nous servir à comprendre la situation au Québec et le projet de loi 69 sur l'énergie.
L'exception du Québec : combien de temps encore ?
La situation de l'électricité au Québec est bien différente de celle des marchés de l'électricité ailleurs dans le monde à deux égards : non seulement notre électricité est déjà décarbonée, mais elle est en plus contrôlée principalement par un monopole public et n'est pas vendue aux consommateurs finaux en fonction de mécanismes du marché.
En effet, au Québec, comme dans certains États des États-Unis, le prix de l'électricité est fermement régulé par des commissions publiques (ici, la Régie de l'énergie), sur la base du coût d'opération. Cet encadrement, qui s'est imposé dans nombre d'États dès le milieu du XXe siècle, repose sur une conception de l'électricité comme un service public indispensable à la satisfaction des besoins sociaux plutôt que comme une marchandise.
En quoi l'analyse des transformations néolibérales des marchés de l'électricité peut donc nous être utile pour comprendre l'exception québécoise ? Elle peut se lire comme un avertissement porté contre le projet de loi 69 sur l'énergie (PL69), que le gouvernement de la CAQ souhaite adopter dans les prochains mois. En d'autres termes, le PL69, en ouvrant davantage la porte au privé dans le secteur électrique, ne représente pas seulement une perte de pouvoir pour Hydro-Québec, mais surtout un risque pour la transition énergétique.
Dans la transition (à venir), nous aurons vraisemblablement besoin de plus d'électricité, en particulier pour électrifier le secteur des transports (y compris dans un scénario où l'usage de « l'autosolo » est grandement réduit). La question se pose à savoir dans quelles conditions se mènera cette expansion. Dans ce contexte, le PL69 représente le plus sûr moyen de perdre le contrôle non seulement des recettes de l'électricité, mais aussi des priorités et du rythme du développement de la production électrique.
En effet, le PL69 constitue la première étape vers l'imposition d'un marché dérégulé. Plusieurs des articles (28, 38, 115, 116) du projet de loi ouvrent encore davantage au dégroupage vertical d'Hydro-Québec et ainsi préparent à l'établissement d'un marché concurrentiel de l'électricité. Davantage, car la production d'électricité est déjà une entité séparée d'Hydro-Québec et soumise à une certaine logique de marché, à la différence du transport et de la distribution (dont les prix sont régulés par la Régie de l'énergie). Ce dégroupage a été établi dans les années 1990 pour répondre aux exigences de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Cela a eu pour principal effet de rouvrir la porte à l'expansion de la production électrique privée, notamment avec le développement éolien, les minicentrales hydroélectriques privées (2009-2013) et le développement de centrales privées de cogénération ou à la biomasse. Contrairement à une opinion répandue, Hydro-Québec possède aujourd'hui 80 % de la production électrique et non la totalité.
Le PL69 n'impose pas la création d'un marché dérégulé de l'électricité, mais il correspond clairement à la première des quatre étapes de privatisation observées dans d'autres juridictions et analysées par Brett Christophers (voir notre autre billet). La poursuite de cette voie pourrait éventuellement mener à l'établissement d'un marché complètement dérégulé de l'électricité à l'échelle nord-américaine et, par le fait même, à d'importantes hausses de tarifs pour les particuliers. Cette idée n'est pas strictement spéculative, comme en fait foi un rapport datant de 2020 du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), qui propose l'instauration d'un « marché commun intégré de l'électricité » entre les provinces de l'Est et les États étatsuniens voisins.
Garantir le profit privé ou rater la transition
Quelles conséquences cette privatisation tranquille de l'électricité pourrait-elle avoir sur la transition énergétique ? Deux scénarios se présentent. Soit la transition énergétique se fait au rythme compatible avec notre responsabilité climatique, mais ce serait alors uniquement grâce à de vastes subventions publiques garantissant de hauts taux de profitabilité pour le privé. Soit la transition ne respectera pas le rythme qu'exige la crise climatique, car les énergies renouvelables ne seront pas suffisamment rentables aux yeux des investisseurs.
Le premier scénario est évidemment préférable pour le climat, mais pas pour les finances publiques et le contrôle démocratique de l'économie. Les taux de profit de la production des éoliennes privées au Québec sont aujourd'hui artificiellement élevés, autour de 9 à 15 %, contre des taux de 5 à 8 % au plus haut ailleurs dans le monde. Cela s'explique par le fait qu'Hydro-Québec garantit non seulement le prix, mais aussi l'achat de toute la production et ainsi l'équilibrage sur le réseau et ce, au détriment de sa propre production provenant des barrages.
À l'inverse de cette tendance, comme le soutient Brett Christophers, la propriété publique des infrastructures d'électricité renouvelable constitue le moyen le plus sûr, le plus rapide et le plus efficace pour réaliser la transition énergétique. Hydro-Québec, malgré son caractère encore opaque, sa dimension peu démocratique et son historique colonial face aux peuples autochtones, constitue une pièce centrale de notre avenir écologique. La privatiser en tout ou en partie serait la voie la plus sûre pour perdre beaucoup de fonds publics ou échouer tout simplement la nécessaire sortie des carburants fossiles.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le coup d’assommoir de Retailleau !

Implacable ! Bruno Retailleau fait du gringue à un groupuscule identitaire et remet une couche contre les Immigrés (e) à travers la circulaire du 24 janvier 2025, renforçant son pouvoir vertical par des injonctions aux Préfets. La Gauche se mobilise, Éric Lombard met en garde.
De Paris, Omar HADDADOU
Le migrant est à l'Autorité ce qu'une goutte de mercure à la coupelle d'un Laborantin : Insaisissable !
Intraitable, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, nouveau rouleau compresseur investi pour bannir, précariser et reconduire aux frontières, se mure dans un acharnement répugnant. Dans sa ligne de mire ? L'Immigré (e) auquel il promet « la fermeté ».
En s'offrant la meute de journalistes et les déclarations à l'emporte-pièces, lors de son déplacement ce vendredi 24 janvier dans les Yvelines, il s'est projeté dans le triomphalisme, là où ses prédécesseurs se sont cassés les dents sur la gestion du flux migratoire.
Gageons qu'il repartira avec un parafeur attestant qu'il a brassé du vent !
Le futur nous le prouvera, encore une fois !
Ainsi en a décidé la Gauche - devenue un cas de conscience pour le camp présidentiel - dont la victoire a été confisquée pour éviter une gouvernance du Nouveau Front populaire (NFP). Ses ténors esquissent d'ores et déjà les feuilles de route pour l'échéance municipale de mars 2026 et la présidentielle de 2027. Parmi eux, l'ancien Président socialiste François Hollande qui avance ses pions, sans tambour ni trompette.
N'en déplaise au locataire de la Place Beauvau, le phénomène migratoire épouse aujourd'hui les aspirations d'une cause juste, au même titre que la Palestine. Et partant, il demeure corrélé au paradigme des inégalités entre l'Europe aisée et l'Afrique disetteuse dépossédée. L'aspiration trouve indubitablement ses sources dans la rapacité vertigineuse et les ravages coloniaux.
Occultant les sacrifices des Bâtisseurs immigrés de la France, Retailleau à la fibre « extrêmdroitisée » et fraîchement « némésisée » (Némésis), se réjouit de la fermeté de sa circulaire négationniste du « Vivre ensemble ». Surfant sur les principes de la République, il durcit la défunte circulaire Valls 2012, en retoquant le texte par le laconique (3 pages au lieu de 12), mais ô combien violent à l'endroit des immigrés :
« La régularisation n'est pas un droit ! » martèle-t-il « Les Français nous demandent de reprendre la main, de reprendre le contrôle, de diminuer l'Immigration. Et moi, je l'assume en luttant pied à pied contre l'Immigration irrégulière. Je souhaite que mon message de fermeté et d'Autorité soit perçu ! ».
Treize ans se sont écoulés sous d'autres auspices. Retailleau ne déroge pas aux fanfaronnades stériles des baptêmes du feu. Caprice pathologique des nouveaux élus de la République. Vous l'aurez compris : changer les acronymes !
Seigneur quel ouvrage d'airain ! A.P.S (Autorisation Provisoire de Séjour) des années 90 se dote de nouvelles orientations exhumées in extrémis : A.E.S (Admission Exceptionnelle au Séjour). Petit peuple, prend ton surligneur fluo et passe le sur l'adjectif ! Pour la patronne des Députés écologistes, Cyrielle Chatelain, le ministre poursuit, par ce texte, une croisade idéologique ».
En effet, l'A.E.S répond à « des conditions strictes définies par la loi et demeure une voie exceptionnelle d'admission au séjour ».
Les communautés visées y voient une campagne raciste par un Politique qui s'est récemment incliné devant la mémoire du tortionnaire des Algériens (es). Ses messages implicites cachent une Ukase de raviver les chaudières de l'expulsion massive, sous couvert de délégations fallacieuses, comme celle « d'inviter les Préfets à fonder leurs décisions au titre au titre du pouvoir d'appréciation qui leur appartient ». Ses saillies ont plongé la classe politique dans un émoi d'animosité et de guerre de tranchées, acculant le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, à le rappeler à l'ordre par l'objection suivante : « Nous avons besoin d'une Immigration de travail ! ». Quant à la Présidente du groupe LFI-NFP, Mathilde Panot, son ton se veut orageux : « Vous ne respectez rien ! Ni les résultats des urnes, ni la souveraineté du Peuple » lance -t-elle au Premier ministre, François Bayrou ».
« Votre ministre de l'Intérieur s'est illustré par ses déclarations racistes ! »
Et si une troisième dissolution provoquée par la valse des mentions de censure, venait à chambarder le paysage politique ?
O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Projet Mauricie de TES : chronique d’une catastrophe annoncée

Il y a un peu plus d'un an TES Canada, filiale de la multinationale belge TES, annonçait un projet de production d'hydrogène vert combinant hydro-électricité, énergie éolienne et solaire. Pour rendre le projet acceptable socialement les promoteurs insistent sur le fait qu'il s'agit d'un investissement exclusivement privé de $4 milliards. On s'aperçoit vite du contraire.
Un bloc de 150 MW à bas prix provenant de notre richesse collective ferait l'envie de beaucoup d'entreprises d'ici, assorti de généreux crédits d'impôt fédéral et provincial, de crédits carbones, d'avantages fiscaux et autres mesures offertes aux grandes entreprises. D'autres fonds publics (Banque du Canada, Investissement Québec, CDPQ) pourraient éventuellement contribuer au projet. La présence de l'ex-président de la CPDQ parmi les membres de la direction de TES Canada s'avère heureuse pour une firme à la recherche d'investissements publics. Hydro-Québec va-t-il fournir encore plus de MW si l'usine énergivore vient à manquer d'énergie ? Aucun projet de production d'hydrogène sur la planète ne verrait le jour sans un investissement massif de fonds publics.
Très tôt également le projet a semé des doutes dans la communauté scientifique quant à sa pertinence et à son efficacité. Existe-t-il un réel besoin de produire ce genre de gaz (méthane) au Québec ? Les experts parlent d'un procédé compliqué, inefficace, énergivore et coûteux. L'utilisation d'un tel gaz pour chauffer les bâtiments ou déplacer le trafic lourd exigerait de trois à dix fois plus d'électricité que d'autres moyens éprouvés. Au moment où notre hydro-électricité est de plus en plus sollicitée et nos barrages à leur plus bas niveau un tel gaspillage d'énergie fait-t-il du sens ?
TES veut implanter un méga projet éolien de 800 MW pour ses besoins en énergie mais prévoit en vendre une partie à Hydro-Québec pendant les froids d'hiver. À quel prix ? Depuis 25 ans Hydro-Québec achète de l'énergie éolienne à des firmes privées mais toujours à perte, comme pour l'hydrogène aucun promoteur éolien ne survivrait sans perfusion de fonds publics. De sorte que les consommateurs québécois vont financer la production éolienne et la production d'hydrogène de TES soit par des hausses tarifaires et/ou par une baisse des transferts au Trésor public. Nous sommes en présence d'un double scandale financier.
Outre les surcoûts anticipés du projet de TES, la majorité des projets éoliens en milieu habité rencontrent une forte opposition créant dans les communautés une division sociale qui impacte sévèrement voisins, familles, amis, commerces, organismes, élus, agriculteurs ; tous s'affrontent dans un climat anxiogène et délétère. D'un milieu rural paisible les riverains qui se sont fait enfoncé dans la gorge un projet dont ils ne voulaient pas se retrouvent soudainement en zone industrielle. Désabusés ils font le bilan de leurs pertes : leurs paysages patrimoniaux, leur quiétude, le patrimoine familial amputé, des liens sociaux brisés et la perte de confiance dans le processus démocratique.
M. Fitzgibbon, ex-ministre de l'Économie et de l'Énergie a qualifié le projet Mauricie de « magique ». En effet ce projet a tout d'une illusion, d'un tour de passe-passe orchestré par des professionnels de détournement légal de fonds publics. Comment expliquer la « disparition » comme par magie de cet âpre défenseur du projet ? Où sont les spécialistes que les élus et les citoyens de la Mauricie réclament pour leur expliquer comment ce projet peut être bénéfique et rentable ? Pourquoi les MRC, les députés et ministres se sont-ils coupés de la population ? Total Énergies, 4 ième plus grosse firme pétrolière au monde, a abandonné son méga projet pilote d'hydrogène vert dans le sud de la France, identique au projet Mauricie, pour des raisons de rentabilité et de problèmes techniques.
M. Éric Gauthier, directeur-général de TES dit vouloir éduquer la population mais pour l'instant c'est la société civile qui joue le rôle d'éducateur dans ce dossier.
TES Canada a promis un projet entièrement privé, mensonge, il a promis l'acceptabilité sociale, il s'en éloigne de plus en plus, il promet maintenant des retombées économiques de $5.6 milliards. Très impressionnant de constater le montant des dépenses de ce projet qui seraient éventuellement à la charge des contribuables.
Le projet Mauricie a tous les traits d'un éléphant blanc : un méga projet d'infrastructures qui s'avère plus coûteux que bénéfique et dont l'exploitation devient un fardeau financier. Le maire Angers de Shawinigan et l'expert technique de TES M. Pollet de l'UQTR l'ont très bien exprimé : « ça va prendre beaucoup d'argent ».
Il subsiste encore aujourd'hui au Québec ce relent historique qui fait en sorte qu'on laisse des gens pour qui le profit est le motif principal décider de ce qui est bon pour nous.
Le projet Mauricie de TES est un plan affairiste qui gaspille nos précieuses ressources énergétiques et financières au détriment de la sobre transition énergétique recherchée.
Au nom de l'intérêt public ce projet doit être abandonné rapidement afin de limiter les dégâts. Les citoyens de la Mauricie ont hâte de retrouver leur quiétude, leurs familles et leurs amis tout en restant ouverts à des projets rassembleurs.
Claude Charron, comité des riverains des éoliennes de l'Érable (CRÉÉ)
Membre des organismes Vent d'Élus (ventdelus.ca)
Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska (PCÉNY)
Regroupement Vigilance Énergie Québec (RVÉQ)
• https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=C27A7F35C3F49B2A%2115590&authkey=!AHJJN9vp8_2Ew0s
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mobilisation urgente : Boycottez Amazon en appui aux 3,100 travailleurs et travailleuses licenciés

Voici quelques informations pertinentes en lien avec le Réseau militant intersyndical et la mobilisation en cours autour d'Amazon.
(…).
Cher-es camarades,
Pour punir ses travailleurs de Laval qui se sont syndiqués et éviter d'avoir à négocier une convention collective, la multinationale a décidé de mettre à la porte 1700 travailleurs/euss d'entrepôt ainsi que que quelques 1,400 autres dont l'emploi dépend d'elle. Toutes les livraisons seront dorénavant gérées par des sous-traitants non syndiqués.
Un mouvement d'appui aux travailleurs mis-à-pied s'est mis en branle avec un appel à boycotter Amazon. Nous reprenons les revendications mentionnées sur la page facebook de ce mouvement https://www.facebook.com/boycottamazon.ca
« COMMENT BOYCOTTER AMAZON ?
– Désabonnez-vous de Prime ! Fermez votre compte Amazon dès aujourd'hui !
– Cessez de commander sur Amazon ! Appelez le gouvernement à répliquer à cette insulte !
– Rejoignez notre campagne ! Diffusez nos tracts ! Affichez ! Parlez-en au monde autour de vous !
NOS REVENDICATIONS :
– Garder les entrepôts ouverts ! Maintenir les emplois des travailleurs ! Respect des droits syndicaux !
– Plus une cenne d'argent public pour Amazon ! »
Solidairement,
CAP intersyndical provisoire
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Voyage dans l’univers Rebelle

Souvenirs du futur du captif du phare, titre paradoxal pour un roman fleuve d'environ 450 pages, divisé en trois tomes à paraître aux éditions Grenier le vendredi 28 décembre 2024. La première de couverture annonce déjà les couleurs avec un paysage futuriste annonçant le désastre. Kder, le personnage principal, nous transporte dans sa trajectoire de vie de combattant de l'ordre mondial à l'ère cybernétique.
Les scènes du roman se déroulent dans un cadre visionnaire, une projection vers l'avenir, un instantané de l'accélérante décadence du capitalisme et du capitalocène. Sans phare, nous vivons avec Kder ses luttes épiques tant sur le plan sentimental que pour un monde nouveau. Personnage attachant, un peu tourmenté, alliant le rationnel de ses choix de bataille avec comme toile de fond l'Amour dans son essence le plus pur. La résilience de Kder inspire et fait germer l'espoir de vaincre ce système inique comme il a triomphé de la mort. Roman palpitant par contre qui serait de lecture un brin ardue par son langage parfois un peu trop spécialisé sans le lexique heureusement présent en début de chaque tome.
Dès le début du livre, Z Fall nous entre d'emblée dans un monde fantasmagorique, baroque, un peu glauque, déjanté sur les bords. Interloqué.e, mais fasciné.e, l'attrait de l'inconnu, la curiosité, le désir de découverte intiment à continuer le voyage. Comme dans un film, la diégèse, le scénario, l'intrigue naissante et le caractère attachant du personnage transportent dans un univers surréaliste. Souvenirs du futur du captif du phare vous happe et vous prend dans les tripes du début à la fin. Un rythme vif, des phrases courtes, parfois saccadées qui vous ballottent comme sur une mer houleuse avec des accalmies de brise tendre çà et là au gré d'une émotion. La sonorité de la narratologie est si vivante qu'elle invite parfois à danser.
‘'Je parlerai aux mouches, au vent qui colportera mes mots dans notre chaîne d'îles'' T1 p.11
La trame du récit dans un enchevêtrement entre l'analyse, les aventures, l'histoire nous plonge dans un futurisme si réaliste que le présent s'estompe. Pourtant, ça et là l'auteur n'a pas pu s'empêcher de bifurquer vers un retour abyssal.
Des descriptions méticuleuses rendent le récit très vivace. Des portraits comme autant de tableaux sombres, parfois même mélancoliques sinon tragiques s'intercalent avec des étalages de beauté faste et écarlate, souvent de paysages idylliques.
‘'Le soleil paresseux s'éclipsait et Krimaren achevait de s'égosiller'' T1 p. 41
‘'Ce lac glauque occupait le cratère. C'était beau, si beau de le voir changer de couleur. Gris-vert, jaune et émeraude sans éclat, nuage, gris, jaune et émeraude terne, jet de vapeur, gaz, gris jaune… T2 p. 330
Le narratif dense et passionnant vous emporte dans un tourbillon d'émois allant de la tendresse, de l'attachement, en passant par la colère à la révolte.
‘'Ses yeux étaient éteints. Ses mains calleuses. Ils fixaient souvent en silence le ciel, comme si l'ouate des nuages pouvait lui conférer une caresse.'' T2 p. 290
Un humour subtil caché sous un masque savant, docte, ironisant farouchement la ‘'maladie infantile'' ou sénile de la ‘'scienticité''. Des jeux de mots, des mots calembours, des mots dits, des mots éteints ressuscités, des mots futurs inventés, foisonnement intense d'un imaginaire à tout casser jusqu'à déstabiliser.
Le Tome 2 un petit bijou de poésie et de philosophie. On plonge dans un univers merveilleux où même le réalisme est poétique. Des problèmes d'éthiques, des réflexions philosophiques sur l'existence sont soulevés avec sérieux pourtant, sans dogmatisme.
Des hyperboles accentuent la poétique de la prose : ‘'Écoute le silence. Écoute comment il se lasse de laisser passer le vent serpentant entre les labyrinthes des cimes montagneuses'' T1 p. 26
‘'Il est plus facile de rendre les gens heureux, que de se rendre heureux.'' T2 p. 287
Une cadence tout en rythme : ‘'Se souvenir, ressusciter, faire resurgir, restructurer, restaurer, restituer. Que de mots envoyés en éclaireurs dans une jungle compacte et qui revenaient bredouilles.'' T2 p.280
L'enfance pas trop loin sur les sentiers du merveilleux.
Poussière d'étoile peut-être ! T3 p.445 dit Kder à l'injonction établie ‘'tu retourneras à la poussière.''
Le ton léger enrobe le déploiement idéologique en sous-bassement, dans un mécanisme littéraire spiralé si présent dans les trois Tomes. On constate que l'auteur, vogue non seulement sur un registre de gauche, mais surtout s'assure que l'analyse socio politique de classe soit toujours présente en filigrane, souvent de manière flagrante.
Dans le premier Tome, avec un accent apparemment badin, le système capitaliste est mis à nu, décortiqué dans son pourrissement jusqu'à la lie. Chaque strate est auscultée, ‘'effeuillée'' et examinée. Une critique en règle de la culture dominante se livre : la question migratoire, l'âgisme, l'apologie de la jeunesse éternelle, le repli identitaire, la marchandisation (de tout), la religion, l'agnosticisme, etc.
Dans les Tome 2 et 3, sans tomber dans un passéisme fade, les catégories sociales en présence sont décortiquées et explorées. Le culte technologique, technocratique y est dénoncé. Rien n'échappe au couperet chirurgical de la critique : langue, éducation, sexualité, organisation sociale, santé, intelligence artificielle, etc., voire l'alimentation passent au moulinet de l'œil acerbe de Kder.
Même dans l'élégie de la nature, la politique comme un leitmotiv, dans une atmosphère de kaléidoscope revient immanquablement.
‘'Le vent battait les lambeaux de leurs haillons lacérés par les gaz du volcan'' T2 p. 330
‘'Il fallait que je m'en imprègne comme d'une réserve, pour la leur cracher, comme une lave vengeresse.'' T3 p. 445
‘'La vie est faite de mort comme le va et vient des vagues''. Avec une touche qui rappelle les portraits des villes ouvrières d'Engels, nous est livré un voyage psychédélique dans le monde des bas-fonds, des pouilleux… Une description réaliste de la misère humaine empreinte de sensibilité et d'humanité. Un dessin minutieux de ces bidonvilles aux flancs des collines qui peuvent être en Ayiti, à Calcutta, à Conakry ou encore n'importe où au Grand Sud.
Un texte s'apparentant à un essai politique mais si romanesque et poétique que sa lecture émeut parfois jusqu'aux larmes.
‘'Quelle vision vive. Mon amour, Aurolia, ici, où ça ? Elle disparut comme elle était venue, laissant sa présence dans ma mémoire lâche. Peut-on appeler ça une mémoire, lorsque l'image d'Aurolia s'y évanouit, comme s'éteint la couleur chatoyante d'un poisson pêché dans la mer de corail. ‘' T2 p. 318
On souhaite continuer à suivre l'attendrissant Kder, on veut voir grandir Usis, on veut connaître l'avenir de sain, on veut redonner vie à Aurolia. Kder vient nous chercher au tréfonds de nos engagements et fait vibrer la fibre révolutionnaire en nous. Vivement le Tome 4 !
Poésie dure
Poésie tendre
Poésie philosophique
Toujours truffée d'idéologie
Cette trilogie passionnante, forgeuse de conscience, interpelle notre humanité et l'Amour, le vrai.
« Il faut que l'humanité réapprenne à aimer, car il n'y a de divin que dans l'humanité » T2 p. 337
Chantal Ismé
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Nouvelles dispositions canadiennes sur l’écoblanchiment : Énergir s’expose à des sanctions de plusieurs millions de dollars pour écoblanchiment

La coalition Sortons le gaz ! considère que plusieurs prétentions d'Énergir constituent de l'écoblanchiment au sens de la Loi sur la concurrence du Canada. La coalition déposera donc bientôt une plainte au Bureau de la concurrence afin que le Bureau enquête, prenne des mesures appropriées contre Énergir et que des dédommagements soient offerts à ses clients. Les sanctions prévues peuvent maintenant atteindre 10 millions $.
Énergir prétend sur son site Internet et dans ses publicités qu'elle peut alimenter les appareils de ses clients à 100 % en gaz naturel renouvelable (GNR). Ainsi, un message publicitaire (en date du 7 octobre 2024 et du 2 janvier 2025 dans l'édition électronique de La Presse) mentionne : « Énergir va encore plus loin et s'engage, depuis avril 2024, à ce que tout nouveau raccordement à son réseau soit alimenté par de l'énergie 100 % renouvelable ».
Or c'est impossible. Et voilà donc un cas patent d'écoblanchiment, car le gaz distribué à l'ensemble des clients transite par un seul et même système de pipelines et canalisations. Tous reçoivent donc le même gaz, composé actuellement à 98 % de gaz d'origine fossile et de seulement 2 % de GNR. À l'heure actuelle, il est donc opérationnellement impossible pour Énergir de distribuer ces deux types de gaz de façon distincte. En vertu des nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence, Énergir doit être en mesure d'étayer ses allégations.
Par ailleurs, Énergir centre l'essentiel de son marketing et de ses activités de relations publiques sur le GNR alors qu'elle distribue à 98 % de l'énergie fossile. Cela constitue également de l'écoblanchiment.
Plusieurs entreprises au Canada ont déjà réagi à la mise en place des nouvelles dispositions sur l'écoblanchiment en épurant leur site Internet, et en changeant leur message marketing. Énergir aurait dû faire de même.
« Énergir se comporte de manière téméraire et continue à diffuser des faussetés que même les autres distributeurs canadiens de gaz ont renoncé à mettre de l'avant. Elle trompe ses clients québécois et c'est inacceptable », selon Emmanuelle Rancourt, coordonnatrice de la coalition Sortons le gaz ! « Nous allons continuer de rassembler les preuves pour préparer la plainte formelle, en espérant que des mesures soient prises et que des dédommagements soient offerts à la clientèle », termine-t-elle.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les organisations de la société civile québécoise dénoncent tout recul climatique sous prétexte de la crise Trump

Les organisations environnementales, de santé, et du développement appellent le gouvernement du Québec à s'aligner sur son Comité consultatif sur les changements climatiques. Celui-ci lui demande instamment de « continuer de s'appuyer sur les faits scientifiques pour guider la prise de décision et l'élaboration des politiques publiques » au lieu de faire marche arrière quant à nos ambitions face aux changements climatiques.
Les déclarations du ministre de l'Environnement, Benoit Charette – selon lesquelles les contraintes environnementales pourraient être assouplies pour « ne pas pénaliser l'économie québécoise » – envoient un message préoccupant alors que la crise climatique frappe déjà et plus fréquemment nos communautés et notre économie.
Un recul des politiques environnementales serait tout à fait contraire à ce que la science nous réitère mais aussi aux souhaits des Québécois.e.s. En effet, un sondage Léger réalisé pour Équiterre en décembre dernier a montré que 83 % des Québécois.e.s veulent une action plus ambitieuse pour lutter contre les changements climatiques.
Dans un contexte d'incertitude politique à Ottawa, le leadership des provinces est plus que jamais nécessaire. Ce rôle crucial des États fédérés se manifeste déjà de l'autre côté de la frontière, où une alliance bipartisane d'États américains a réaffirmé lundi que l'action climatique se poursuivra, quelles que soient les décisions de la nouvelle administration. À travers le monde, plusieurs États signataires de l'Accord de Paris ont eux aussi réitéré leur ambition de respecter celui-ci. Il nous faut également au Québec des leaders qui continuent à aller de l'avant et qui osent agir avec ambition et vision.
Le gouvernement du Québec s'est toujours dit fier de son ambition en matière de lutte contre les changements climatiques, de ses initiatives telles que son système de plafonnement et d'échange de droits d'émission (SPEDE) et de son énergie propre. Les incertitudes politiques sont une occasion pour le Québec de jouer un rôle clé dans la transformation mondiale en cours :
– en maintenant et en rehaussant les cibles climatiques conformément aux données probantes et aux engagements internationaux de l'Accord de Paris ;
– en augmentant ses efforts en adaptation ; et
– en renforçant les partenariats avec des États fédérés, des villes et des organisations partageant des ambitions pour résoudre la crise climatique pour créer un front commun face aux crises climatiques et géopolitiques.
Citations
Leïla Cantave, Responsable pour le Québec, Réseau action climat Canada :
« Reculer sur les engagements environnementaux, c'est retarder encore davantage l'adaptation de notre économie aux défis du 21ᵉ siècle. Le Québec a ce qu'il faut – les capacités, le talent et l'innovation – pour se positionner comme un leader mondial de la transition énergétique. Ce qu'il nous manque, c'est la volonté et le courage de nos décideurs et décideuses. »
Andréanne Brazeau, analyste principale des politiques, Québec, Fondation David Suzuki :
« Le Québec est à l'heure des choix. Allons-nous reculer sur nos décisions courageuses et pragmatiques ou nous rallier du côté des États, des villes et des organisations les plus ambitieuses sur le continent ? Allons-nous gouverner sur la base de la science ou laisserons-nous la désinformation l'emporter ? Les chemins à prendre sont clairs pour assurer un avenir sécuritaire, abordable et prospère aux générations actuelles et futures. Notre cible climatique pour 2035 à venir et la prochaine mise à jour du Plan pour une économie verte 2030 seront deux jalons révélateurs de la voie que le gouvernement prendra. Choisissons le bon côté de l'Histoire. »
Patricia Clermont, organisatrice et porte-parole, Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME) :
« Le gouvernement québécois doit faire preuve de réalisme à la fois environnemental et économique, et il doit garder ses ambitions afin de veiller à la meilleure protection de la santé environnementale possible – et donc humaine -, qui n'est pas contraire à la santé économique du Québec. Au contraire : assurer la santé environnementale contribue à diminuer les coûts pour notre système de santé, et donc à améliorer la santé économique du Québec. Il n'y a absolument pas lieu d'opposer santé et environnement d'une part, et économie d'autre part. »
Anne-Céline Guyon, analyste climat-Énergie, Nature Québec :
« Le Québec a toutes les cartes en main pour faire de la transition écologique et sociale son meilleur atout dans le contexte géopolitique actuel. C'est une grande force qui nous assurera de traverser les multiples turbulences que nous allons avoir à traverser. Ayons le courage de faire ce qui doit être fait. C'est le meilleur moyen pour faire du Québec un endroit sûr et résilient pour le futur. »
Rébecca Pétrin, directrice générale, Eau Secours :
« Un assouplissement des contraintes environnementales engendrera une contamination et une surconsommation accrue de notre ressource en eau ainsi qu'une destruction accélérée de nos milieux humides. Le gouvernement du Québec doit continuer d'assumer pleinement son rôle de protecteur de cette ressource collective vitale pour le vivant, mais aussi essentielle pour l'économie. »
Aussi appuyé par :
David Roy, directeur général, Ateliers pour la biodiversité
Michèle Asselin, directrice générale, Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
Geneviève Paul, directrice générale, Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)
France Pomminville, Directrice générale, Réalité Climatique Canada
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Non au projet de loi 69 sur l’énergie !!

Des représentant.e.s de l'ACEF du Nord de Montréal, d'Attac-Québec, de GroupMobilisation, du Regroupement vigilance énergie Québec, du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et leurs allié.e.s ont organisé un (rassemblement le jeudi 16 janvier devant l'hôtel Bonaventure) à Montréal où se tenait le dîner de la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain. Au menu : conférence de la super-ministre Économie, Innovation et Énergie, Christine Fréchette.
Aujourd'hui, nous sommes devant la conférence de la super-ministre Fréchette qui défend le projet de loi 69 par lequel des droits liés à la production électrique sur le territoire du Québec vont être cédés à des compagnies privées.
Pourtant, lors des dernières élections, le gouvernement de la CAQ n'a jamais reçu le mandat de céder ou de privatiser partiellement ou totalement la production et la distribution de notre énergie électrique. Cette électricité, c'est l'héritage de René Lévesque qui a nationalisé via Hydro-Québec sa production et sa distribution. Nous sommes 9 millions d'actionnaires québécois de cette électricité, et elle doit demeurer notre propriété.
En agissant à l'encontre de ce consensus, le gouvernement Legault procède à la dépossession de notre bien commun national au profit d'intérêts privés. Vol. 6, No 2 www.groupmobilisation.com 23 Janvier 2025 Le Plan de la DUC GMob DUC (2 Dans le contexte d'une crise climatique planétaire aux effets dévastateurs, où l'avenir de nos enfants se joue maintenant, où il faut décarboner de toute urgence les énergies que nous utilisons dans une perspective de réduction, le gouvernement Legault, lui, met plutôt notre électricité au service du développement économique et des profits privés.
Les scientifiques nous avertissent (du danger d'extinction d'espèces animales et végétales https://www.ledevoir.com/documents/special/22-04-biodiversite/index.html?fbclid=IwAR15LnxtNkKmBZhBwYuJ3RGsjROuqG9BeSwTV6bhU8RjNsaYZVfonLpdiEo-) -et d'une grave crise mondiale de la biodiversité, mais le gouvernement Legault, lui, favorise l'exploitation abusive de territoires riches en biodiversité. Il utilise même le ministre de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques, Benoit Charrette, pour modifier les (règlements permettant la tenue d'un BAPE au profit de compagnies privées)-https://www.ledevoir.com/documents/special/22-04-biodiversite/index.html?fbclid=IwAR15LnxtNkKmBZhBwYuJ3RGsjROuqG9BeSwTV6bhU8RjNsaYZVfonLpdiEo . Il permet (que des normes environnementales visant la protection de la Santé ne soient pas respectées-https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-08-26/pollution/seuls-huit-etablissements-sont-autorises-a-depasser-les-normes.php ) pour mieux favoriser des corporations privées.
La ministre Fréchette et son gouvernement agissent comme facilitateurs pour les affaires. Ils copinent dans des dîners de Chambre de commerce pis des rencontres non déclarées de lobbyisme pour modifier des lois sur mesure pour leurs projets cachés. Ils vendent le vent pour tuer Hydro-Québec, ils privatisent l'électricité, ils privatisent l'environnement, ils privatisent la Santé ! Ils privatisent, ils dérèglementent, ils sous-traitent, ils méprisent tout avis contraire, pis ils demandent qu'on change d'attitude face à leur volonté de richesse plus grande qu'en Ontario.
Ils nous accusent d'être contre tout. On n'est pas contre tout, on est pour : pour ne laisser personne derrière, pour la solidarité, pour la biodiversité nécessaire, pour le vivant, pour l'avenir de nos enfants, on est pour, pour, pour !...
C'est eux qui sont contre : contre nos droits, contre notre santé, contre la biodiversité, contre le vivant, contre l'avenir, contre, contre, contre !...
Ils sont POUR une seule affaire : leurs profits immédiats ! Pis pour ça, ils accaparent notre bien commun, détruisent notre environnement et chapardent nos droits. Ça suffit ! L'électricité, qu'elle soit hydraulique, éolienne ou solaire nous appartient à nous, et on en a besoin pour décarboner parce que l'avenir du climat se joue maintenant.
Alors leur privatisation, c'est pas pour nous, on n'est pas fou !
Solidarité !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Canada : Les 10 provinces mettent fin à la détention de migrants dans des prisons

Les 10 provinces canadiennes se sont désormais engagées à mettre fin à leur contrat de détention migratoire avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ce qu'Amnistie internationale Canada et Human Rights Watch ont aujourd'hui qualifié de victoire majeure pour les droits des personnes migrantes et réfugiées. Terre-Neuve-et-Labrador, la dernière province, vient de confirmer qu'elle n'autorisera plus le gouvernement fédéral à détenir dans les prisons locales des personnes migrantes ou demandeuses d'asile.
Les deux organisations ont créé la campagne #Bienvenue au Canada en octobre 2021 pour exhorter les provinces à mettre fin à cette pratique. Le recours aux prisons provinciales pour la détention de personnes migrantes est incompatible avec les normes internationales en matière de droits humains, et dévastateur pour la santé mentale de ces personnes. Le gouvernement fédéral devrait emboiter le pas aux provinces et prendre d'importantes mesures pour mettre fin à la détention migratoire à travers le pays.
« La décision de Terre-Neuve-et-Labrador est une immense victoire en matière de droits humains, elle préserve la dignité et les droits des personnes qui viennent au Canada en quête de sécurité ou d'une vie meilleure », a déclaré Samer Muscati, directeur adjoint intérimaire de la division Droits des personnes handicapées à Human Rights Watch. « Comme les dix provinces ont résilié leur contrat de détention des personnes migrantes, le gouvernement fédéral devrait enfin garantir, par le biais d'une directive ou d'un amendement législatif, que l'ASFC cessera une fois pour toutes de recourir aux prisons pour les incarcérer. »
Au cours des cinq dernières années, l'ASFC a incarcéré des milliers de personnes pour des raisons d'immigration dans des dizaines de prisons provinciales à travers le pays, sur la base d'accords conclus avec les provinces. Les conditions de détention en prisons provinciales sont inhumaines, ces établissements ont une vocation intrinsèquement punitive. Le 12 mars 2024, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a transmis un avis officiel à l'agence frontalière indiquant qu'à compter du 31 mars 2025, ses prisons provinciales ne détiendraient plus des personnes uniquement en vertu de la législation sur l'immigration. À ce jour, les accords conclus dans cinq provinces ont expiré à la suite de périodes de préavis de résiliation, et les accords conclus dans les cinq autres provinces doivent expirer d'ici mars 2025. L'ASFC a cherché à prolonger ces accords dans certaines provinces.
Dans un rapport datant de 2021, Human Rights Watch et Amnistie internationale ont démontré que dans les centres de détention migratoires au Canada les personnes racisées, en particulier les hommes noirs, sont gardées dans des conditions plus restrictives et pour des périodes plus longues que les autres détenu·e·s. Les personnes handicapées sont également victimes de discrimination tout au long de la procédure de détention.
Ces personnes sont régulièrement menottées, enchainées et enfermées avec peu ou pas de contact avec le monde extérieur. Le Canada est l'un des rares pays de l'hémisphère nord à ne fixer aucune limite légale à la durée de leur détention. Des personnes peuvent ainsi être détenues pendant des mois, voire des années, sans aucune fin en vue.
Sara Maria Gomez Lopez a fait l'expérience directe de la détention migratoire en arrivant au Canada en tant que demandeuse d'asile en 2012. L'ASFC l'a incarcérée pendant trois mois en Colombie-Britannique. « Je me souviens de la profonde douleur que je ressentais en prison », a-t-elle déclaré. « Le Canada peut et doit cesser de causer de telles douleurs et laisser place à l'accueil bienveillant qui a contribué à guérir tant de personnes ayant trouvé refuge dans ce pays. Cette ouverture me donne l'espoir que d'autres n'auront pas à vivre la même douleur que moi. »
Depuis le début de la campagne #Bienvenue au Canada, des centaines de personnes militantes, avocates, professionnelles de la santé et des leaders religieux, aux côtés de personnes ayant personnellement vécu la détention migratoire, ainsi que des dizaines de grandes organisations de justice sociale, ont appelé les autorités provinciales et fédérales à mettre fin à l'utilisation des prisons provinciales pour la détention liée à l'immigration. Plus de 30 000 personnes à travers le Canada ont également participépris part à la campagne en écrivant directement aux autorités provinciales et fédérales.
En vertu de ces accords, l'ASFC a versé aux provinces des centaines de dollars par jour pour chaque migrant·e incarcéré·e dans une prison provinciale. Ainsi, selon l'agence frontalière, au cours de l'exercice qui s'est terminé en mars 2023, l'elle a défrayé 615,80 $ par jour pour chaque femme détenue dans une prison du Nouveau-Brunswick. Au cours de ce même exercice, elle a dépensé 82,7 millions de dollars pour la détention, soit plus qu'au cours des quatre années précédentes.
En vertu de la législation sur l'immigration, l'ASFC a toute la latitude pour décider du lieu de détention des personnes migrantes : aucune norme juridique ne guide ses décisions de détenir une personne dans une prison provinciale plutôt que dans un centre de surveillance de l'immigration. À l'expiration de ses contrats avec les provinces, elle n'aura plus accès à leurs prisons pour détenir des personnes migrantes. L'ASFC gère également trois centres de détention migratoire, semblables à des prisons de sécurité moyenne et fonctionnant comme telles, qui imposent d'importantes restrictions à la vie privée et à la liberté, des règles rigides et des routines quotidiennes, en plus de mesures punitives en cas de non-respect des règles et des ordres.
Il existe d'autres solutions viables à la détention à travers tout le pays. Au lieu de financer des centres de détention ou des pratiques punitives non privatives de liberté comme le suivi électronique, le gouvernement fédéral devrait investir dans des programmes communautaires respectueux des droits et gérés par des organisations locales à but non lucratif, indépendantes de l'agence frontalière.
« Nous félicitons les provinces pour leur décision de cesser d'emprisonner les demandeurs d'asile et les migrants uniquement pour des raisons d'immigration », a déclaré France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnistie internationale Canada francophone. « La pression sur le gouvernement fédéral est maintenant claire pour qu'il mette fin à ce système de violation des droits partout au pays. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Budget 2025 et violence conjugale : répondre à 100% des besoins, c’est une question de survie

Après deux années sans argent neuf dans le budget du Québec, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale presse le gouvernement d'investir pour permettre aux maisons de répondre à l'ensemble des demandes d'aide. Après avoir présenté son mémoire au cabinet du ministre des Finances, le Regroupement s'inquiète de voir le financement des services stagner en raison de la conjoncture économique.
« L'enveloppe octroyée aux maisons ne répond actuellement qu'à 75% des besoins des femmes et des enfants victimes de violence conjugale, et le manque à gagner se creuse à mesure que la demande d'aide et l'inflation augmentent. Aujourd'hui, nous avons chiffré ce manque à gagner à 57,7 millions de dollars pour l'ensemble des maisons.? » alerte Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.
Après deux budgets consécutifs sans aucune bonification pour les maisons, les impacts se font sentir pour les femmes et les enfants qui ont besoin d'une aide immédiate, que ce soit en hébergement ou en services externes. Taux d'occupation moyen de 98% en 2023-2024, apparition de listes d'attente pour recevoir des services de consultation et d'accompagnement hors hébergement, manque de personnel, etc.
Les efforts combinés du gouvernement et de tous les acteurs engagés dans la lutte contre la violence conjugale portent fruit ? : les femmes demandent de l'aide en grand nombre. À titre d'exemple, SOS violence conjugale fait état d'une augmentation de +109% en 5 ans pour la demande d'hébergement et les demandes pour des services externes ont doublé en 4 ans dans notre réseau. Il est temps que ce même gouvernement ajuste les capacités de service des maisons.
Plus de 400 cartes de femmes et d'enfants pour interpeller les ministres
Nos demandes répétées pour travailler avec le Ministre Carmant sur des solutions financières n'ont trouvé aucun écho depuis un an. Face à ce silence et à l'incapacité grandissante des maisons à répondre à l'ensemble des besoins, le Regroupement a recueilli plus de 160 lettres d'appui de partenaires aux quatre coins de la province qui soutiennent les maisons dans leurs revendications de financement.
Municipalités, écoles primaires et secondaires, milieux de travail, CEGEP, universités, tous soulignent le travail inestimable des maisons d'aide et d'hébergement, leur apport dans la communauté et la nécessité qu'elles disposent d'un financement adéquat.
En parallèle, le Regroupement a également reçu 420 cartes de voeux confectionnées dans les maisons par des femmes et des enfants hébergés, par des intervenantes et des membres de CA. Adressées aux ministres Lionel Carmant, Martine Biron et Éric Girard, ces cartes témoignent de l'importance qu'ont eu les maisons dans la trajectoire des femmes et des enfants, et des risques qu'il y a à sous-investir dans les services.
« Nous espérons que le gouvernement saura entendre l'urgence et exaucer les voeux de celles et ceux qui, après avoir bénéficié des services des maisons, ne souhaitent qu'une chose : que les maisons puissent répondre à 100% des demandes d'aide, sans délai » conclut Annick Brazeau.
Extraits des cartes de voeux
“Pour la nouvelle année, mon voeu le plus cher serait qu'aucune autre femme ne soit affectée par le manque de ressource, l'impuissance et la solitude que j'ai moi-même ressenti » – femme hébergée
“Les intervenantes m'ont tendu la main quand je croyais que tout était perdu. Grâce à leur aide, j'ai pu repartir à zéro et protéger mes enfants” – femme hébergée
Audrey, 7 ans, souhaite “ne plus avoir peur d'entendre des cris la nuit et de pouvoir faire des beaux dodos.”
Olivier, 15 ans, souhaite “ne plus avoir peur de perdre mes amis et de changer d'école par manque de place en hébergement dans ma région.”
“Pour la nouvelle année, mon voeu le plus cher serait de ne plus jamais être dans l'obligation de demander à une femme de “rappeler une autre fois” pour une place en hébergement” – Jessica, intervenante à la maison de Lina.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quand on est une multinationale qui ne paie pas...

Quand on est une multinationale qui ne paie pas d'impôt, ou à peine, il est plus aisé de s'acquitter de quelconque amende ou dommages et intérêts, des années plus tard, pour avoir contrevenu au Code du travail. Quand on ne paie pas d'impôt, ou à peine, il est aussi plus facile d'accepter de fermer des entrepôts fraîchement construits et d'enregistrer des pertes sèches cumulant des millions de dollars afin de tuer dans l'œuf un mouvement de syndicalisation.
Amazon ou les paradis fiscaux contre les travailleurs et les travailleuses
23 janvier 2025 | lettre de l 'IRIS
En 2023, l'IRIS publiait une étude faisant état de quelque 120 milliards de dollars de profit net transférés au Luxembourg par des entreprises canadiennes dans la dernière décennie. Cette étude s'étant concentrée sur des firmes canadiennes, leurs consœurs américaines et internationales n'avaient pas été recensées. Les frasques récentes d'Amazon au Québec sont l'occasion de s'y attarder, d'autant plus que le siège social européen de ce géant est basé, sans surprise, au Luxembourg.
Tout est légal, et c'est ça le problème
En 2003, l'État du Luxembourg entérinait auprès d'Amazon une stratégie d'évitement fiscal permettant à l'entreprise de garder à l'abri de l'impôt le trois quarts de ses profits déclarés au Luxembourg et issus de ses activités en sol européen. Le stratagème, connu sous le nom de « prix de transfert », est une chasse gardée de bien des multinationales, dont l'usage saigne à blanc depuis des décennies les trésors publics du monde entier. En l'espèce, les profits européens d'Amazon déclarés au Luxembourg étaient « défiscalisés » par le biais de redevances artificielles entre les filiales de la compagnie pour l'usage de sa propriété intellectuelle. En d'autres mots, une filiale luxembourgeoise d'Amazon, propriétaire des brevets de l'entreprise, chargeait à une autre filiale un tarif démesuré, le tout afin de gonfler les dépenses de l'entreprise et ainsi diminuer son revenu imposable là où elle devait normalement s'acquitter d'impôts.
En 2014 et suite à une enquête, la Commission européenne a estimé que cette seule stratégie avait permis à Amazon d'éviter de s'acquitter de 250 millions d'euros en impôt auprès du fisc luxembourgeois. Selon l'institution européenne, les contributions fiscales moindres d'Amazon représentaient un avantage indu sur ses concurrentes, qu'il convenait de rétablir. Cet effort de la part de la Commission européenne est pourtant resté vain, puisque tour à tour, le Luxembourg et Amazon ont interjeté appel devant la Cour européenne de justice, et sont parvenus à infirmer la décision initiale.
Fort de cette victoire, Amazon poursuit à ce jour ses stratagèmes fiscaux au Luxembourg, qui lui fournissent un avantage illégitime sur ses concurrents. Uniquement pour l'année 2023, elle a déclaré des profits de 946 millions $ CAD au Luxembourg, selon les états financiers de sa filiale Amazon Services Europe s. à r. l. En Amérique du Nord, Amazon peut compter sur ses filiales du Delaware, qui ont concouru à ce que le géant du commerce en ligne ne paie pas un sou d'impôt fédéral aux États-Unis en 2017 et en 2018, en dépit de ses profits mirobolants.
Un avantage sur ses concurrents… et ses travailleurs et travailleuses
La Commission européenne a jugé à juste titre que les manœuvres fiscales d'Amazon au Luxembourg représentaient un avantage indu sur ses concurrents, parmi lesquels on compte des petites et moyennes entreprises. D'un point de vue strictement libéral, les paradis fiscaux stimulent la concentration des marchés et la domination de grandes entreprises, à l'encontre des principes élémentaires de concurrence. Amazon contrevient d'ailleurs régulièrement à ces principes, ayant par exemple été condamné en 2021 à une amende de 1,3 milliard d'euros par l'autorité antitrust italienne.
Si l'on prolonge le raisonnement de la Commission européenne et qu'on l'applique au rapport entre Amazon et ses salarié·e·s, on parvient à des conclusions similaires : les impôts non payés par Amazon sont autant d'avantages pécuniaires dans la gestion de ses relations de travail qui lui donnent une marge de manœuvre supplémentaire pour affronter les aspirations syndicales de ses travailleurs et travailleuses, ou tout simplement pour mettre en place de coûteuses technologies de contrôle et de surveillance de sa main-d'œuvre. En somme, l'impôt évité est autant de capital économisé permettant à la multinationale milliardaire de mieux faire triompher un modèle d'affaires voyou.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Projet de loi n° 81, Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement : Le gouvernement refuse d’entendre les travailleurs et travailleuses

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) dénonce l'attitude du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, qui a choisi d'exclure le mouvement syndical des Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 81, Loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement, qui débuteront ce mardi 28 janvier. Pourtant, le ministre Benoit Charrette, sans gêne, n'hésite pas à dérouler le tapis rouge pour entendre en commission parlementaire les acteurs patronaux et commerciaux, en levant le nez sur les travailleurs et travailleuses qui sont pourtant des acteurs importants dans ce dossier.
« Il est inconcevable que la FTQ ne soit pas entendue à cette commission. Ce projet de loi propose de modifier diverses dispositions en matière d'environnement, comme les évaluations environnementales, notamment dans le secteur industriel et énergétique ; deux secteurs où la FTQ est fortement représentée. Le message est clair : le ministre a un parti pris en faveur du patronat », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.
Aussi, la FTQ s'inquiète vivement de cette tendance du gouvernement de la CAQ d'octroyer de plus en plus de pouvoirs à ses différents ministères, tout en réduisant la participation et le poids de la société civile.
« Le ministre cherche à se donner le droit d'accélérer des projets sans s'assurer que la main-d'œuvre soit disponible, et sans avoir les évaluations nécessaires pour garantir que notre environnement ne subira pas de dommages irréversibles. N'a-t-on pas appris de nos erreurs avec le fiasco Northvolt ? », d'enchaîner le secrétaire général.
« La FTQ reconnaît que certaines modifications proposées dans le projet de loi n° 81 pourraient être bénéfiques, comme la mise à jour concernant la protection de la biodiversité et le pouvoir accru des municipalités dans le domaine de la réglementation et de l'évaluation environnementale. Toutefois, à quoi serviront ces mesures si le ministre de l'Environnement a le pouvoir de contourner ses propres règles, comme dans le dossier Northvolt », poursuit le secrétaire général.
« Ce projet de loi aurait pu être positif, mais les démarches de développement industriel et énergétique de la CAQ manquent de vision et ne favorisent que les entreprises. Les ambitions économiques ne devraient pas passer avant la protection de notre environnement et les intérêts des travailleurs et travailleuses du Québec », conclut le secrétaire général, Denis Bolduc.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Hausse du prix des loyers : « La crise du logement est une préoccupation réelle »

La CSQ réagit vivement à la réaction de la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, quant à la hausse estimée du prix des loyers à 5,9 % pour 2025. « Il faut plus de logements, nous en sommes aussi, mais ça ne se fera pas en claquant des doigts d'ici les prochaines semaines ! Une hausse anticipée de 5,9 %, c'est largement au-dessus de l'inflation », fait valoir le président de la CSQ, Éric Gingras.
Tiré de Ma CSQ.
La CSQ rappelle que la hausse du salaire minimum pour 2024 était de seulement 3,28 % alors que l'inflation, pour la même période de référence, se situait pourtant à 4,5 %. « Et aujourd'hui, sous prétexte que c'est une décision sous la responsabilité du Tribunal administratif du logement (TAL), il laisse aller des hausses à 5,9 %. Voyons donc ! Et pour les hausses des tarifs d'hydroélectricité qu'il a pourtant fait geler à 3 %, aussi en prétextant vouloir les maintenir près de l'inflation ? À un moment donné, il faut que les arguments se tiennent ! Là, c'est assez clair que les salaires n'augmenteront pas au même rythme que les prix des loyers et que cette hausse accentue l'inflation du logement locatif », dit Éric Gingras.
La crise du logement affecte inévitablement les plus pauvres, pour qui l'impact négatif à prévoir est évident, puisque l'on sait qu'ils ont tendance à déménager plus. Mais la CSQ insiste sur le fait que la question déborde maintenant de ce cadre habituel et affecte différentes strates socioéconomiques de la population.
« Et c'est notamment là que le gouvernement fait fausse route et démontre toute son incompréhension des enjeux connexes qui en découlent. La question de l'abordabilité du logement est à ce point importante et centrale dans le quotidien de nos membres qu'elle s'est traduite en orientation lors de notre dernier congrès en faveur de la mise en œuvre de plans d'action gouvernementaux devant comprendre un réinvestissement public massif pour créer et rénover des logements sociaux et un renforcement des protections des droits des locataires, notamment par un meilleur contrôle des loyers et une protection accrue contre les évictions », ajoute Éric Gingras.
« Autrement dit, la réaction de la ministre hier démontre non seulement un manque de sensibilité, mais surtout le peu de place accordée aux enjeux sociaux par le gouvernement, lesquels sont exacerbés dans le sillage de la crise du logement, l'itinérance, l'insécurité alimentaire et la violence conjugale, notamment. Et ça, contrairement à ce que semble penser le gouvernement, ça préoccupe la population, dont nos membres. »
Un épisode du balado de la CSQ, Prendre les devants, est justement consacré aux enjeux entourant la question du logement.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soins à domicile : la FIQ soumet ses recommandations

Appelée à participer à une consultation du MSSS sur la Politique nationale sur les soins et les services de soutien à domicile (SAD) au Québec, la FIQ a déposé un mémoire comprenant 8 recommandations pour adapter les soins et services aux besoins des personnes aînées. Celles-ci misent d'abord et avant tout sur une approche qui favorise le maintien de l'autonomie et de la santé des personnes aînées plutôt qu'une approche orientée vers l'hospitalo-centrisme.
Dans un contexte où le vieillissement et l'accroissement de la population demeure un défi important pour le réseau public de la santé, il apparaît clair que l'expertise et la connaissance des enjeux que possèdent les professionnelles en soins qui offrent des SAD doivent être entendues et mises à contribution.
Aujourd'hui, les vice-présidentes Françoise Ramel et Jérôme Rousseau participent aux auditions pour présenter nos recommandations orientées vers les thèmes prioritaires identifiés dans la consultation.
Voici les 8 recommandations qui ont été formulées par la Fédération :
1- Redonner aux CLSC leur vocation d'origine en matière de gestion et de prestation des soins et du soutien à domicile.
2- Planifier de manière durable et paritaire la main-d'œuvre nécessaire en soins et en soutien à domicile, notamment en prévoyant la présence d'infirmières praticiennes spécialisées.
3- Déterminer l'élargissement des pratiques professionnelles sur la base des compétences nécessaires aux soins sécuritaires et de qualité.
4- Consacrer une proportion fixe du PIB québécois aux soins à domicile.
5- Simplifier et clarifier le financement des soins à domicile afin d'obtenir une reddition de compte transparente et d'en tirer des données probantes.
6- Exclure la contribution de l'usager-ère de la politique nationale sur les soins à domicile.
7- Offrir aux patient-e-s l'ensemble des soins professionnels requis par leur condition.
8- Réduire la place occupée par les entreprises privées à but lucratif dans la dispensation du soutien à domicile et utiliser les économies pour offrir ces services à travers le réseau de la santé.
Consulter le mémoire de la FIQ.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Loi 21 : La Cour suprême accepte d’entendre l’appel de la FAE

Prenant connaissance de l'annonce, ce matin, Mélanie Hubert, présidente, a déclaré que la FAE était « satisfaite » de la décision rendue par la Cour suprême. La FAE avait entamé cette démarche de contester des pans de la Loi 21 à l'hiver 2019. Plus précisément, la FAE conteste notamment deux éléments devant les tribunaux : l'opération de dénombrement orchestrée par le gouvernement Legault quelques mois avant l'adoption de cette loi, ainsi que la discrimination à l'embauche, la discrimination à l'emploi et le droit au travail.
Opération dénombrement
En novembre 2018, le ministère de l'Éducation de l'époque a fait parvenir aux directions d'établissements scolaires un sondage, lequel visait à obtenir des informations quant au port de « symboles religieux » par les employés ainsi que le nombre et la nature de demandes d'accommodements demandés pour les motifs religieux, linguistiques ou ethnoculturels. L'on cherchait à connaître le nombre exact d'enseignantes et d'enseignants portant des signes religieux. Les minorités religieuses, plus particulièrement les femmes musulmanes portant le voile, avaient ressenti un effet de stigmatisation à la suite de l'opération de dénombrement.
Discrimination à l'embauche, discrimination à l'emploi et droit au travail
Une portion de l'article 27 de la Loi 21, communément appelé « clause grand-père », vient restreindre, par son libellé, ce droit acquis de porter un signe religieux en précisant qu'il demeurera tant que l'enseignant exercera la même fonction au sein de la même commission scolaire. Ainsi, une personne enseignante qui souhaiterait accéder à de nouvelles fonctions (ex. poste de direction) ou irait travailler dans un autre centre de services scolaire perd ce droit. Or, du fait de sa mission, la FAE se doit de protéger tant le droit au travail que l'accès à ce dernier.
Pour des institutions laïques
Afin d'éviter toute confusion, amalgame ou désinformation, la FAE tient à rappeler qu'elle est en faveur de la laïcité de l'État et qu'elle dénonce et s'oppose à toutes les formes d'intégrisme ainsi que de prosélytisme.
Pour rappel, à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel rendu en février 2024, concernant la contestation de la Loi sur la laïcité de l'État (Loi 21), la FAE a décidé d'en appeler de ce jugement. Ainsi, elle avait alors déposé une requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada.
La FAE a non seulement la responsabilité de défendre les droits de ses membres, à plus forte raison leurs droits fondamentaux, elle a le devoir de le faire. Il faut se méfier de la distorsion qui est actuellement faite des chartes, canadienne et québécoise, et de la facilité avec laquelle les parlements suspendent nos droits fondamentaux en utilisant excessivement les clauses dérogatoires.
C'est quoi, les clauses dérogatoires ?
Les clauses dérogatoires (ou nonobstant) sont incluses dans l'une et l'autres des chartes des droits et libertés (art. 33 de la Charte canadienne et art.52 de la Charte québécoise) et permettent aux parlements, sous certaines conditions, de supplanter, de contourner ou de suspendre temporairement certains droits de l'une ou l'autre des chartes.
La FAE n'est pas contre l'utilisation des clauses dérogatoires. Elle souhaite néanmoins que leur utilisation soit balisée. Cette utilisation devrait être faite avec parcimonie et de manière exceptionnelle. Un parlement qui y recourt devrait pouvoir démontrer que son objectif est clair et urgent. Là est l'un des principaux écueils de la Loi 21.
Une situation qui dépasse le Québec... et la laïcité
Si, au départ, la FAE a entamé cette démarche pour, notamment, défendre le droit au travail de nos membres, la banalisation de l'utilisation de la clause dérogatoire par plusieurs parlements provinciaux nous donnent malheureusement raison d'être inquiets.
En effet, dans les dernières années au Canada, on a vu plusieurs cas de clauses dérogatoires utilisées sans avoir l'obligation de démontrer un objectif réel et urgent. Par exemple, le parlement ontarien a suspendu la liberté d'association en 2022, alors qu'en Saskatchewan, le parlement a invoqué la disposition de dérogation pour empêcher les enfants de moins de 16 ans de changer de prénom ou de pronom à l'école, sans le consentement de leurs parents.
Qui plus est, juste au sud de nos frontières, des états américains sont venus restreindre, voire dans certains cas interdire, le droit à l'avortement. Des personnes enseignantes risquent maintenant des mesures disciplinaires si elles affichent leur appartenance à la communauté LGBTQ2+, notamment en Floride, alors qu'on est aussi venu interdire, non seulement en Floride, mais aussi dans certains états, de parler des réalités LGBTQ2+ à l'école. Il est évident que le Québec ou le Canada ne sont pas à l'abri de tels reculs des droits fondamentaux. Il est primordial de demeurer vigilants.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les canadiens rejettent les menaces tarifaires de Trump : Nouveau sondage du CTC

Un nouveau sondage commandé par le Congrès du travail du Canada (CTC) révèle queles Canadiens sont gravement préoccupés par les risques économiques et politiques que fait courir le président américain Donald Trump. Un sondage mené par GQR Canada entre le 13 et le 20 janvier 2025 auprès de 1 500 personnes éligibles à voter révèle qu'une majorité de Canadiens croient que les menaces tarifaires de 25 % annoncées par le président Trump sur les produits canadiens auraient un effet dévastateur sur les emplois, l'économie et les relations entre le Canada et les États-Unis.
« Les menaces irresponsables de Donald Trump constituent une attaque directe contre les travailleuses et travailleurs des deux côtés de la frontière », estime Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les Canadiens sont à juste titre alarmés et s'attendent à un leadership solide de la part de leurs gouvernements afin de protéger leurs emplois et défendre nos industries contre ces politiques néfastes. »
Huit Canadiens sur dix croient que les tarifs américains sur les produits canadiens augmenteront le coût de la vie, et neuf Canadiens sur dix croient qu'ils auront un impact défavorable sur les relations canado-américaines.
En réponse à ces menaces :
– 90 % des Canadiens appuient un plan d'investissement pour renforcer notre économie, soutenir les industries canadiennes et créer de bons emplois.
– 77 % croient que le gouvernement fédéral devrait exercer des représailles en imposant des tarifs douaniers sur les importations en provenance des États-Unis, et 75 % veulent que le Canada bloque l'accès des États-Unis aux ressources canadiennes comme l'électricité, le pétrole et le bois.
– 80 % veulent que le gouvernement appuie ceux qui seraient touchés par des pertes d'emploi.
– Deux Canadiens sur trois rejettent l'idée d'une politique d'apaisement avec Trump.
« C'est un moment d'unité pour le Canada », déclare madame Bruske. « Les dirigeants politiques de tous les ordres de gouvernement et de tous les partis doivent être à l'écoute des Canadiens et comprendre que les gens s'attendent d'eux qu'ils restent unis pour défendre le Canada et les travailleuses et travailleurs canadiens. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Diversité comme Pilier d’Innovation

Montréal, le Lundi 27 janvier 2025 — Il y a des moments dans l'histoire où le silence n'est pas une option.
Aujourd'hui, face au retrait des programmes d'équité, de diversité et d'inclusion aux États-Unis, nous ne pouvons rester immobiles. Diversité artistique Montréal lance un appel à tous ceux qui croient en un avenir plus juste : la diversité est notre force, l'inclusion est notre chemin, et l'équité est notre défi commun.
À Montréal, nous savons que la richesse d'une société réside dans sa diversité. Cette ville, vibrante et cosmopolite, est une terre d'opportunités où près de 40 % de la population appartient à une minorité visible. Comme l'a si bien dit Martin Luther King, "L'injustice où qu'elle soit est une menace pour la justice partout dans le monde." Nous refusons de laisser l'élan du progrès s'éteindre. DAM s'engage à être un phare d'espoir, un lieu où chaque artiste, quelle que soit son origine, peut réaliser son potentiel.
Face à cette annonce internationale, nous appelons les artistes, les institutions et les partenaires culturels à s'unir pour redoubler d'efforts dans la défense des valeurs d'inclusion. DAM s'engage à renforcer ses programmes actuels de soutien aux artistes marginalisés, tout en développant de nouvelles initiatives pour créer des opportunités équitables pour tous.
Dans les mois à venir, nous lancerons une série d'ateliers et de résidences artistiques dédiés à la mise en valeur des talents issus de communautés diversifiées. Selon une étude de l'UNESCO, les industries culturelles et créatives représentent 3 % du PIB mondial et emploient près de 30 millions de personnes à travers le monde. En soutenant les artistes diversifiés, nous contribuons non seulement à l'équité, mais aussi à une économie culturelle florissante.
Alors que le monde fait face à des défis écologiques sans précédent, à une précarité croissante et à une concentration du pouvoir dans les mains de quelques-uns, il est impératif que nous choisissions l'unité et le partage. Nos réponses à ces crises doivent être collectives et inclusives. La diversité n'est pas seulement une richesse culturelle, c'est une solution indispensable pour imaginer un avenir durable et équitable. Ensemble, nous devons construire un monde où chaque individu peut prospérer, en s'appuyant sur des valeurs de solidarité, de collaboration et de respect mutuel.
Nous savons que des choix comme celui des États-Unis peuvent semer le doute, mais ils sont aussi une opportunité de prouver que nous pouvons faire mieux, ensemble. Montréal a l'occasion de se positionner comme un leader mondial en matière d'équité, diversité et inclusion. Nous invitons tous les acteurs de notre écosystème culturel à se joindre à nous pour amplifier les voix qui en ont le plus besoin.
Citations
"L'histoire nous observe, et nos actions d'aujourd'hui détermineront le monde que nous léguerons demain. Ensemble, faisons de Montréal un exemple d'inclusion, de justice et de créativité." — JIMMY PHILEMOND-MONTOUT, Directeur général de Diversité Artistique Montréal
"Quand d'autres ferment des portes, ouvrons davantage les nôtres. La diversité n'est pas seulement une valeur morale, c'est une source d'innovation et de prospérité pour toute notre société." — JIMMY PHILEMOND-MONTOUT
À propos de Diversité artistique Montréal
Diversité artistique Montréal est une organisation dédiée à la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans les arts et la culture. En collaborant avec des artistes, des institutions et des partenaires, nous nous engageons à bâtir un écosystème culturel qui reflète et valorise la richesse de notre société.
============================================================
** Facebook (http://www.facebook.com)
** Twitter (http://www.twitter.com/)
** Link (http://www.instagram.com/)
** Website (http://mailchimp.com)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La dérive autoritaire en Équateur

Le 8 décembre, quatre enfants d'origine africaine ont été arrêtés puis ont disparu à Guayaquil, le plus jeune n'ayant que 11 ans, alors qu'ils avaient quitté leur domicile pour jouer au football. Dans la vidéo qui circule sur Internet, on peut voir comment au moins 10 soldats les ont fait monter dans une camionnette et les ont maltraités. Quinze jours plus tard, leurs corps ont été retrouvés brûlés près d'une caserne militaire.
9 janvier 2025 | tiré d'Inprecor Raúl Zibechi
Les tribunaux ont déclaré que les garçons avaient été victimes d'une « disparition forcée » et ont tenu l'État équatorien pour responsable. Il n'y avait aucune preuve qu'ils avaient commis des crimes, contrairement à ce que les autorités avaient déclaré. Les forces armées se contredisent. Elles ont d'abord affirmé qu'ils avaient été libérés dans de parfaites conditions. Ensuite, elles ont placé en détention 16 officiers en uniforme faisant l'objet d'une enquête du bureau du procureur général, responsable des événements.
Une campagne contre les enfants a été déclenchée en haut lieu : « Le 24 décembre, sur les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp, des centaines de comptes, récemment créés et vraisemblablement faux, ont commencé une campagne de diffamation contre les mineurs, affirmant que leur disparition était nécessaire et qu'ils étaient liés à des groupes criminels » (« Infobae », 24/12/2024). Le gouvernement et les institutions publiques ont tenté de dissimuler les faits.
Le 31 décembre, le ministère public équatorien a confirmé que les quatre corps retrouvés correspondent au groupe d'enfants portés disparus le 8 décembre. Une vague d'indignation secoue le pays. L'Alliance des organisations pour les droits humains de l'Équateur a déclaré que cette affaire s'inscrivait « dans une pratique d'abus d'autorité et de force, de discrimination, de stigmatisation et de profilage racial » de la part des forces de sécurité de l'État.
La société équatorienne découvre qu'il s'agit d'une guerre contre ceux d'en bas, conséquence du racisme structurel et de la militarisation croissante du pays, un processus aussi récent qu'intense. L'état d'urgence est en vigueur en Équateur presque sans interruption depuis janvier, dans le cadre de la prétendue guerre contre le crime organisé, un argument avancé par le président Daniel Noboa, mais en réalité il s'agit de contenir les secteurs populaires.
Le collectif féministe et anti-prison Mujeres de Frente, qui travaille dans les prisons, affirme que l'Équateur est devenu « un État paramilitaire » dont l'épicentre se trouve dans les prisons. » Depuis 2015, l'État, par l'intermédiaire de la police, avec le soutien des grandes entreprises et de l'ambassade des États-Unis, a armé les prisonniers et les a “ organisés ” en groupes criminels pour faciliter le mode d'accumulation par dépossession au service des pouvoirs d'en haut. »
Ce à quoi nous devons répondre, c'est pourquoi un pays comme l'Équateur, qui était il y a encore cinq ans l'un des plus pacifiques et des plus stables du continent, a entamé cette dérive vers la militarisation et l'effondrement des institutions démocratiques. Je vois deux raisons principales : l'une géopolitique et l'autre intérieure, toutes deux liées entre elles.
L'Équateur est un acteur important de la géopolitique régionale. C'est le premier point décisif pour comprendre les raisons qui poussent les États-Unis, le Pentagone et le Commandement Sud à tisser des liens étroits avec le gouvernement Noboa. Un gouvernement rejeté par la population, qui n'est pas capable d'être gouverné par la légalité et la légitimité de ses actions. Ce gouvernement a obtenu la cession des îles Galápagos pour que les États-Unis y établissent une base militaire permanente, fournissant des installations pour le fonctionnement de la flotte et de la force aérienne du Commandement Sud. C'est la position géographique idéale pour répondre à la présence croissante de la Chine, qui a inauguré il y a quelques semaines le port de Chancay, dans le nord du Pérou, qui aspire à devenir un lien clé dans le commerce entre l'Asie et l'Amérique du Sud.
La deuxième question concerne la réaction des élites équatoriennes au soulèvement indigène et populaire de 2019. Cette action collective des peuples indigènes et des secteurs populaires a abouti à une victoire politique sur le gouvernement de Quito, un triomphe aux yeux de l'opinion publique, mais aussi à la défaite des forces de police, qui ont dû reculer face aux peuples organisés.
Pendant les treize jours du soulèvement, ils ont réussi à arrêter plus de 200 policiers, qui sont restés sous la garde des indigènes et de la population jusqu'à ce que leur libération soit négociée avec les organisations internationales de défense des droits humains. Il est clair qu'aucune classe dirigeante ne peut accepter une telle situation sans réagir violemment, comme l'ont fait plus tard les élites en créant un État paramilitaire lié au trafic de drogue.
Deux processus se combinent ici : la militarisation interne et l'alignement externe sur le Pentagone. La Maison Blanche a tout intérêt à avoir un gouvernement soumis en Amérique du Sud, tandis que les classes dirigeantes équatoriennes ont intérêt à la tutelle d'un allié capable de soutenir le militarisme interne tout en restant neutre face aux violations flagrantes des droits humains.
Enfin, la nouvelle réalité de la militarisation du pays pose un énorme défi aux forces sociales populaires, en particulier au mouvement indigène. Depuis son apparition publique dans les années 1980, la Conaie (Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur) à toujours évolué dans un cadre démocratique, ses droits d'organisation et de manifestation ont toujours été respectés, bien qu'elle ait parfois été durement réprimée. La douzaine de soulèvements indigènes qui ont eu lieu depuis 1990 se sont soldés par des victoires ou des échecs, mais la Conaie a généralement été reconnue par l'État comme un interlocuteur légitime.
Aujourd'hui, il devra agir dans de nouvelles conditions, sous la pression du militarisme et de la société pour la sécurité et l'ordre. Les gouvernements ne permettront pas de nouveaux soulèvements, comme ceux qui, par le passé, ont modifié l'équilibre des pouvoirs dans le pays. Les mouvements d'en bas ne seront pas interdits mais étroitement contrôlés, leurs dirigeants surveillés et soumis à un chantage à la collaboration avec le système. Ils devront se réinventer pour faire face aux nouveaux défis.
Publié dans naiz le 5 janvier 2024
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Trump, l’Europe et la vertu outragée : malaise dans le suprémacisme impérial

Trump annonce la couleur avec des déclarations de politique extérieure fracassantes : annexion du canal de Panama, colonisation pure et simple du Groenland et, pour le Canada, publication sur son réseau social d'une carte de l'Amérique du Nord intégralement recouverte de la bannière étoilée.
Hebdo L'Anticapitaliste - 737 (16/01/2025)
Par Thierry Labica
Comme inspiré par Netanyahou brandissant la carte d'un seul grand Israël devant l'assemblée générale de l'ONU, voici donc Trump, saison 2.
De vrais projets ?
Stratégie de l'imprévisibilité et de la menace généralisée ? Symptômes de sénescence d'un vieillard autoritaire se rêvant en maître d'empire ? On peut toujours spéculer sur les ressorts de telles provocations. Quelles que soient ses intentions ultimes en la matière, ce coup d'éclat fait entendre nombre de motifs familiers. En premier, l'agressivité viriliste, désormais marqueur privilégié de l'identité politique de la nouvelle extrême droite planétaire, de Trump à Duterte en passant par le bolsonarisme. Un autre motif est l'antiféminisme, celui déclaré de l'ex-président sud-coréen (Yoon Suk Yol, maintenant déchu) en passant par celui du mouvement Vox en Espagne et la version française de « l'anti-wokisme ». De ce point de vue, ces sorties sont pleinement en cohérence avec les signaux adressés par Musk en direction des dirigeants de l'extrême droite européenne.
On y reconnaît aussi un signe de la très nette tendance à la concentration du pouvoir présidentiel américain, en cours depuis une quarantaine d'années. La posture de Trump n'en est à présent que la manifestation la plus caricaturale.
Retour à la tradition
Un registre un peu plus ancien encore : l'argument de la « sécurité nationale », dont ne dépendraient rien moins que le bon ordre et la liberté du monde, fait écho mot pour mot à celui des dirigeants américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Soucieux de pérenniser le déploiement d'ampleur inédite de bases militaires à travers le monde, ceux-là faisaient déjà de la « sécurité » la clé de toutes leurs justifications : au nom de la « sécurité », le Pacifique, débarrassé de la puissance japonaise défaite, avait vocation à devenir « notre lac » ; certains, et pas des moindres, se « foutaient de l'appellation choisie, dès lors que nous avons un contrôle absolu, incontesté de nos besoins en bases militaires ».
Les indignés
Le « meilleur » de toute cette affaire est ailleurs. On le doit avant tout au spectacle offert par des « partenaires européens » en plein émoi, en pleine « incompréhension » face au mépris affiché par l'allié, l'ami, le protecteur, emblème universel de « nos valeurs occidentales ». On apprend que la France et l'Allemagne officielles se sont montrées « catégoriques » : « Les frontières ne doivent pas être déplacées par la force ». Pour Scholz (chancelier allemand), au côté du président du Conseil européen (A. Costa) : « Le principe de l'inviolabilité des frontières s'applique à tous les pays, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest ». « Ce principe ne peut et ne doit pas être ébranlé. » « Les États-Unis doivent appliquer les principes des Nation unies, tout le monde s'y tient et cela restera certainement ainsi. », selon un porte-parole du gouvernement allemand. Enfin, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, déclare que l'UE ne tolérerait pas une intervention militaire américaine : « Il n'est pas question que l'Union européenne laisse d'autres nations du monde, quelles qu'elles soient […], s'en prendre à ses frontières souveraines ». De son côté, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, a dénoncé « une forme d'impérialisme », carrément. Sens des valeurs, grands principes, ardente indignation : on tremble à la Maison Blanche, c'est sûr.
Sinistres menteurs
Il nous vient une petite question, en même temps qu'une nausée : s'agit-il bien là des mêmes dirigeants qui ont applaudi et activement contribué à plus d'une année de génocide israélien en Palestine, massivement armé par les États-unis de Biden-Harris, et ont laissé piétiner le droit international ? qui ont réprimé férocement toutes les solidarités en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne ? Et dénié tout principe de souveraineté au Liban abandonné à la folie meurtrière sioniste ? Et qui laissent filer la guerre à travers le Moyen-Orient, comme si plus de trente années de carnages et d'échec abyssal ne suffisaient pas ? Les mêmes se livrent à présent aux grimaces sordides de la vertu outragée sur fond du racisme colonial qu'ils gardent en partage. L'hypocrisie ne tue pas, et c'est bien là leur chance.
Thierry Labica
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Tech sur les chemins d’une contre-révolution

D'Elon Musk à Pierre-Edouard Stérin, en passant par Emmanuel Macron : que s'est-il donc passé en France comme aux États-Unis pour que la Tech s'apparente à une révolution conservatrice ? Pour analyser cette évolution, il faut suivre le chemin des différentes promesses du secteur, celles d'une société ouverte, fondées sur l'information, la désintermédiation, la dématérialisation et l'augmentation des richesses.
10 juillet 2024 | tiré d'AOC media
https://aoc.media/analyse/2024/07/09/la-tech-sur-les-chemins-dune-contre-revolution/ ?
loggedin=true#_ftn1
Sidération. C'était l'État dominant à San Francisco au soir de l'élection de Donald Trump le 8 novembre 2016. Le candidat Républicain s'était pendant des mois attiré les railleries des techies de la Bay area, pour la moitié nés dans un autre pays que les États-Unis, ayant l'habitude ne pas voter et se désintéressant le plus souvent de la vie politique locale, mais hautement diplômés et attachés à l'esprit scientifique.
Dans les mois précédents l'élection, les entrepreneurs et investisseurs mettaient quelques minutes de côté les actualités Tech au moment du déjeuner et dans les meetups de fin de journée pour se demander comment un tel personnage avait pu être investi. Des petits regroupements étaient organisées pour s'en moquer les soirs de débats présidentiels comme certains en avaient l'habitude pour leurs émissions de TV réalité préférées. Un même état de sidération s'est emparé de la French Tech aux soirs du résultat des élections européennes et au premier tour des législatives face à la montée électorale du Rassemblement national.
À Paris comme à San Francisco, la Tech se vit comme un secteur résolument progressiste. Les historiens et essayistes firent la part belle aux hippies, aux universitaires et aux hackers des années 1970-1980 dans le récit de ses origines[1]. Ce récit trouva une continuité dans le boom Internet des années 1990. Internet incarnait et réalisait la promesse libérale d'un monde sans guerre et sans crise économique[2]. En France, la thèse d'Henri Bourguinat triomphait : celle des 3D, désintermédiation, dérégulation et décloisonnement[3].
Bureaucraties et règlements étaient appelés à perdre du terrain au profit de l'information et de la libre entreprise. Aux États-Unis, Francis Fukuyama célébrait la fin de l'histoire et Al Gore invitait à s'engager sur les autoroutes de l'information. Grâce à Internet, le monde devait entrer dans une période de paix, de démocratie, marquée par un accroissement des connaissances et des richesses. La célébration du partage et de la contribution du Web 2.0 emboita le pas à cette promesse dans les années 2000. Les réseaux d'information devaient participer à l'avènement de sociétés ouvertes.
Contrairement à l'idée reçue d'une Tech tout entière libertarienne, cette vision explique l'affinité historique liant la Silicon Valley et le parti démocrate depuis les années 1990. Le secteur de la Tech a très majoritairement soutenu successivement les candidats Clinton en 1992 et 1996, Al Gore en 2000, John Kerry en 2004, Obama en 2008 et 2012, Clinton en 2016 et Biden en 2020. Les donations des salariés de grandes entreprises technologiques durant la campagne de 2012 l'illustrent : 91 % des donations des employés chez Apple au profit du candidat Obama, 97 % chez Google et 99 % chez Netflix[4].
Ce soutien n'est pas anodin alors que les big Tech ont détrôné l'industrie pétrolière comme premier financeur de la campagne présidentielle en 2016. En 2016, un seul diner de 20 convives organisé par la veuve de Steve Jobs avait permis à Hilary Clinton de repartir en campagne avec 20 millions de dollars. Eric Schmidt, ancien PD-G de Google, et Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, travaillent avec le parti Démocrate pour améliorer le ciblage électoral et la culture numérique de ses candidats depuis près de dix ans. L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche fut donc logiquement vécue comme une catastrophe dans le nord de la Californie.
À l'inverse, celle d'Emmanuel Macron en 2017 fut perçue comme un signe d'espoir. Le jeune candidat, déjà marqué par plusieurs voyages aux États-Unis, était venu présenter avec conviction sa vision aux entrepreneurs français de la région, à San Francisco, en janvier 2016 en tant que ministre de l'Économie. Deux ans plus tôt, en 2014, alors qu'il réfléchissait à la création d'une start-up offrant des services de formation, il y rencontra des fondateurs de start-ups aux cotés de Brigitte Macron et Xavier Niel[5]. Il repartit de la Silicon Valley fasciné par ce modèle organisé autour du travail, de la jeunesse et de l'innovation.
Cette fascination fut la pierre de touche d'un programme de politique notamment présenté lors de l'inauguration de la Station F en juin 2017. L'objectif était de transformer le pays en une terre d'entrepreneurs, en leur donnant les moyens de leurs ambitions. Il annonça en mars 2018 au Collège de France le déblocage d'1,5 milliard d'euros de crédits publics au profit de l'intelligence artificielle, comprenant 400 millions d'appels à projets et de défis d'innovation de rupture financé par le Fonds pour l'innovation et l'industrie de 10 milliards d'euros récemment mis en place.
À l'automne de la même année, la suppression de l'impôt sur la fortune (ISF) était inscrite dans la loi de finances de manière à favoriser l'investissement. Fin 2019, une mission était confiée au cabinet de conseil McKinsey au sein de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse (Cnav) pour planifier la réforme des retraites. L'une des hypothèses de travail était de glisser d'un système par répartition à un système par capitalisation, à l'image de la Californie, où les fonds de pension constituent l'un des principaux partenaires des capitaux-risqueurs. Au niveau Européen, le Président Macron pressa l'avancée de projets de grands investissements à l'image du supercalculateur Jules Verne devant voir le jour en 2025.
La Tech semble très éloignée des préoccupations de l'électorat à la différence des guerres, du pouvoir d'achat ou de l'immigration. Elle est pourtant aujourd'hui la première des industries[6]. Or, après avoir tenue une ligne progressiste, elle semble ces dernières années basculer vers le conservatisme. En mars 2024, Elon Musk s'est entretenu avec l'ancien Président à Palm Beach (Floride) au début du mois de mars, et ses relations avec Biden n'ont cessé de se tendre. Il multiplie depuis les déclarations contre « l'immigration illégale et non-contrôlé », le « virus woke » ou encore les « médias traditionnels » coupables de biaiser l'information. Au début du mois de juin dernier, David Sachs (cofondateur de PayPal) et Chamath Palihapitiya (dont Facebook a fait la fortune en tant que l'un des premiers employés) ont invité Donald Trump dans la Silicon Valley pour une levée de fonds au profit de ce dernier. L'invitation avait valeur d'événement dans ce bastion progressiste[7]. Les organisateurs l'ont justifié par le fait que le candidat soit pro-business, favorable aux cryptomonnaies et aux baisses d'impôts.
En France, Otium Capital qui constitue un poids lourd de la French Tech, contrôlé par Pierre-Edouard Stérin, milliardaire catholique et conservateur, est devenu un des soutiens économiques les plus actifs du Rassemblement national[8]. Comme pour d'autres secteurs, l'objectif consiste à associer défense de valeurs traditionnelles avec la préservation d'un cadre réglementaire propice aux affaires[9]. Que s'est-il donc passé en France et aux États-Unis pour que la Tech s'apparente à une révolution conservatrice ? Il est possible d'analyser cette évolution en suivant le chemin des différentes promesses de la Tech, soit celles d'une société ouverte, fondées sur l'information, la désintermédiation, la dématérialisation et l'augmentation des richesses.
Pour mesurer l'écart de la Tech avec la promesse d'une société ouverte, il est commode de se référer à Peter Thiel qui comptait parmi les premiers soutiens du candidat Trump au sein de la Silicon Valley en 2015. L'entrepreneur-investisseur prédisait la victoire du « Lone Warrior » quand aucune élite intellectuelle du pays ne l'envisageait avec sérieux. Thiel est connu dans la Silicon Valley pour sa proximité au « Dark Enlightment », un mouvement qui considère que liberté et démocratie ne peuvent marcher de concert, la première devant primer sur la dernière. Il a cofondé en 2004 la société Palantir, une entreprise éditrice de deux logiciels dédiés à l'appariement et la visualisation de données : Palantir Gotham et Palantir Foundry. En 2015, le site d'information TechCrunch révélait que la firme avait comme principaux clients la CIA, la NSA, l'Air force, West Point et les US Marines[10].
Cette proximité entre armée et nouvelles technologies n'est pas une nouveauté. La seconde guerre mondiale puis la guerre froide profitèrent grandement au développement de l'informatique et de l'intelligence artificielle dans les régions de Boston et de San Francisco. Dans les années 1980, la Silicon Valley comptaient plusieurs centres de contrôle d'armement et de satellites de défense. La révolution Internet a fait oublier ce trait d'union liant le complexe militaro-industriel. Il est apparu avec netteté après le déclenchement de la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient et l'ouverture de la crise taïwanaise.
Les cinq contrats militaires les plus importants attribués à Amazon, Microsoft et Alphabet entre 2019 et 2022 totalisaient près de 53 milliards de dollars[11]. Le projet Nimbus, un accord entre Google, Amazon et Israël datant de 2021 incluant des services de Cloud et d'intelligences artificielles (IA) prévoyaient des applications stratégiques. Les tensions entourant Taïwan entre les États-Unis et la Chine ont été également lues à travers le prisme de la guerre des semi-conducteurs[12].
Les grandes entreprises de la Tech restent pourtant sur le plan des services un gage de liberté et de sécurité, vers lequel se tournent encore aujourd'hui des développeurs ukrainiens, des opposants russes, chinois ou turcs. À partir d'une étude des mouvements sociaux du tournant des années 2010, Zeyneb Tufekçi a souligné que si Internet a permis de contourner efficacement la censure des médias aux États-Unis, en Égypte, en Turquie ou à Hong Kong, ce pouvoir de contrôle glissait des instances politiques vers les grandes plateformes. Ces dernières délimitent en effet le cadre communicationnel des rassemblements et restructurent le pouvoir des groupes militants autour des figures masculines du développeur et du data analyst[13].
Les développeurs du monde entier continuent d'envisager les services de la Silicon Valley comme un gage de liberté, notamment en raison de la prévalence des outils open source, souvent rapportés à une vision libertaire[14]. Mais depuis quelques années, des piliers du logiciel libre telles que GitHub (service d'hébergement et de gestion logiciel créé en 2008 et racheté 7,5 milliards de dollars en 2018 par Microsoft) et Red Hat (premier fournisseur mondial de logiciel libre, fondé en 1993 et racheté par IBM en 2018 pour 34 milliards de dollars) ont intégré le pôle propriétaire de la Tech.
Les salariés des grandes entreprises sont devenus les principaux contributeurs aux projets de logiciels libres, seul 15 % du code Linux continuant d'être produit par des bénévoles[15]. Microsoft, entreprise naguère haïe des hackers en raison de ses solutions fermées, voit son écosystème triompher à force de rachats et de partenariats (LinkedIn, OpenIA, Blizzard, Mistral AI, etc.). Ce renversement trouve son point d'origine à la fin des années 1990 quand l'entreprise fondée par Bill Gates acta que l'open source était l'inévitable chemin de la domination industrielle dans le secteur informatique.
Cette stratégie de l'écosystème hégémonique se retrouve aujourd'hui au cœur du déploiement des services de Meta, d'Apple, d'Amazon et d'Alphabet. L'accès aux « interfaces de programmation (API) premium » qui constituait l'un des cœurs du Web 2.0 se ferme ou se monnaye chèrement, de 1 500 à 5 000 dollars par an. Parallèlement, il en coûte entre 20 000 et 50 000 dollars de services de Cloud aux développeurs pour mettre sur pied une application Internet, mettant à mal la promesse de décloisonnement du web. Là où Internet devait faire triompher la désintermédiation, c'est le modèle d'entreprises capitalistes et leurs stratégies d'écosystème hégémoniques qui prédominent.
Le boom des IA renforce la domination des « Magnificent 7 » (les 7 mercenaires, surnom des anciens GAFAM rejoints par Tesla et Nvidia) dans un contexte où l'accès aux ressources s'avère plus cher et plus contraint. Le traitement de larges bases de données suppose en effet des GPU, des services de Cloud et le recrutement de « cerveaux » pour accompagner la supervision et la modélisation. Les grands modèles de fondations nécessitent pour cette raison des investissements conséquents : il en a couté plus de 79 millions de dollars à OpenIA pour entrainer Chat-GPT4 en 2023, plus de 191 millions de dollars à Alphabet pour Gemini-Ultra[16].
En détrônant les entreprises du pétrole, de l'électricité, de l'agro-alimentaire et de l'assurance, le secteur de la Tech a redéfini la question sociale.
Les coûts environnementaux de la Tech croissent d'autant, même si le secteur continue à s'accrocher à la promesse de dématérialisation. Amazon vise la neutralité carbone en 2040. Google déclarait l'avoir atteint en 2007. Microsoft ambitionne de capter plus de carbone qu'il n'en émet. Or, ces déclarations sont rendues possibles par l'achat massif de crédits carbone et les jeux de compensation via des projets eco-labelisés. Dans les faits, entre 2013 et 2020, la consommation d'énergie du secteur a augmenté de 50 %[17].
Dans son rapport annuel sur l'environnement publié en 2024, Google a concédé que l'émission de gaz à effets de serre de l'entreprise s'était accrue de 50 % sur les cinq dernières années[18]. Sam Alman alerte régulièrement sur la nécessité de développer massivement de nouvelles sources d'énergie pour couvrir des besoins exponentiels de consommation des IA. C'est 15 à 35 % de quantité d'eau supplémentaire que les big Tech ont utilisé chaque année depuis 2021. Aux États-Unis plusieurs voix se sont levées pour exiger l'encadrement de cette fuite en avant via notamment la proposition de loi « Artificial Intelligence Environmental Impacts Act ».
Mais ce type d'initiative participe à la crispation politique du secteur face à des cadres de régulation renforcés, aux États-Unis comme en Europe. Outre Atlantique, la multiplication des audiences au Sénat, les menaces de mise en application du Sherman Act (loi AntiTrust), les coups de semonce de la Security and Exchange Commission (autorité de surveillance des marchés) ou encore la pression exercée par le Federal Trade Commission Office of Technology (créé en 2023) agace et inquiète le secteur.
En Europe, le Règlement général sur la protection des données (2016), Digital Service Act (2022) et l'IA Act (2024) se traduisent dans les faits : 500 millions de dollars d'amende infligés à Google en 2021 faisant suite au 2,42 milliards exigés en 2017 pour violation des règles antitrust de l'Union européenne ; 1,2 milliard d'euros réclamés à Meta par la Data Protection Commission, l'autorité de contrôle irlandaise des données en juin 2023 ; 1,8 milliard d'euros d'amende pour Apple en mars 2024 pour abus de position dominante sur le marché de la distribution d'applications de diffusion de musique en continu.
Des enquêtes pour non-conformité contre Apple, Alphabet et Meta sont également en cours au titre du règlement sur les marchés numériques. Cette pression réglementaire pousse les grands noms de la Tech vers des positions défensives et droitières considérées comme plus favorables à leur industrie. Elle est d'ailleurs devenue depuis dix ans le principal lobby à Washington (90 millions investis en 2017 selon Fondapol) comme à Bruxelles (113 millions d'euros en lobbying en 2022 selon le LobbyControl et Corporate Europe Observatory).
Dans le même temps, le statut de l'information sur laquelle repose l'économie de la Tech a changé. Dans les années 1990, une information équivalait à un savoir et une connaissance. Or, l'actuelle révolution des IA se traduit par un appauvrissement de la qualité de l'information, sous diverses formes (hallucinations, deepfakes, erreurs, etc.). Les différentes mesures réalisées situent le taux d'erreur de Chat-GPT entre 30 et 45 % en fonction des pays, là où Wikipédia ne comptent en moyenne que 3,5 erreurs par page. Une récente étude de chercheurs de Google DeepMind concluait à la montée des fausses informations sur Internet, liées aux détournements d'images de personnes et la falsification de preuves[19]. Alors que 80 % de la désinformation à base d'image sur Internet est généré par des IA, la plupart de ces faux viserait à influencer l'opinion, à escroquer et à réaliser des profits[20].
Dans cet écosystème, la valeur des données est dissociée de leur qualité informationnelle : vraies ou fausses, opinions ou informations sourcées, photos authentiques ou truquées, chacune est susceptible de participer à la chaîne de valeur. Cette dynamique explique le changement de position de la Tech vis-à-vis du journalisme. Meta supprima Facebook News en 2023 sans égard pour les conséquences de cette décision sur l'économie des médias, la plateforme se réjouissant de disposer d'une large base d'entrainement.
Elon Musk déclarait au Cannes Lions de juin 2024 que chaque citoyen devait désormais faire entendre sa vérité, sans passer par le contrôle des journalistes. OpenIA a multiplié les accords avec des grands groupes de presse (l'agence Associated Press, News Corp, le groupe de presse allemand Axel Springer ou Le Monde) en déclarant en privé qu'il lui reviendra de choisir quelle information serait mise en valeur et exploitée par ses services.
Or, qu'ils s'agissent du journalisme ou d'autres secteurs, les entreprises de la Tech ont montré qu'elles étaient peu à même de donner suite aux mobilisations sociales qui les visaient. La fronde des chauffeurs Uber en Californie, les oppositions internes au contrats militaires passées par Microsoft et Alphabet, les tentatives régulières d'organisation syndicale dans les usines Tesla et les entrepôts d'Amazon, ou encore le Google Walkouts, quand près de la moitié des employés protestait contre les inégalités dont les femmes étaient victimes au sein de l'entreprise en 2018, furent résolu par la direction de ces entreprises d'une même façon : le licenciement des organisateurs et porte-voix de la mobilisation. Cette position trouve une forme de cohérence historique dès lors que l'on interroge le modèle social de la Tech.
En détrônant les entreprises du pétrole, de l'électricité, de l'agro-alimentaire et de l'assurance, le secteur de la Tech a redéfini la question sociale[21]. Au 19e siècle, la révolution de l'énergie et des transports s'était accompagnée de lois assurantielles visant à couvrir les risques et développer l'éducation dans les pays industriels. Dans la première moitié du 20e siècle, l'essor de l'automobile déboucha sur la mise en place du fordisme, un modèle social posant pour principe que les ouvriers travaillant durement à l'usine seraient payés en conséquence et pourraient accéder aux biens de consommation produits. Avec la Tech, la promesse héritée des années 1990 fut toute autre : de nouveaux acteurs (Amazon, Napster, Google, Facebook, etc.) libéraient l'information et donnaient à chacun et chacune les moyens de devenir entrepreneur.
La contrepartie du cadeau de la Silicon Valley fut la précarisation du droit et des conditions de travail. Le statut hyperprivilégié des employés des big Tech ont pris la direction inverse des travailleurs précaires des plateformes, non seulement dans les pays riches, mais aussi ceux des pays du Sud global mobilisés dans le cadre de contrats de crowd et d'outsourcing[22].
Les grandes entreprises de la Tech concentrent les richesses, travaillent à abaisser le niveau d'imposition, et n'ont de cesse d'optimiser fiscalement leurs opérations. Le tout sans proposer de système de redistribution au-delà de leurs bureaux, autre que le revenu minimum universel, une mesure qui trouve sa source chez les conseillers libéraux de Richard Nixon dans les années 1970[23]. Or, le secteur s'avère peu propice à employer. Il ne représente que 2 à 3 % de la population active en France comme aux États-Unis. Son modèle est pourtant devenu hégémonique.
En effet, les traitements algorithmiques, les services dématérialisés, les mesures de performance et les valeurs d'agilité, ont été hissés au rang de nouveaux standards professionnels au sein des grandes bureaucraties privées et publiques. Comme l'a montré la sociologue Clara Deville au sujet de l'accès au revenu de solidarité active (RSA) en zone rurale[24], les services de l'État ont été présentés au cours des années 2010 comme plus simples, plus efficaces et plus rapides. La mise en place d'outils numériques devait faciliter les démarches administratives.
Or, pour nombre de personnes, cette numérisation fut synonyme de fermetures des guichets et de difficultés accrues pour obtenir des rendez-vous. L'obtention du RSA, et l'accès de bien d'autres services, est devenue plus complexe pour les personnes reléguées géographiquement et socialement. La montée de l'extrême droite peut être ainsi lue comme l'envers d'une start-up Nation, pensée uniquement à partir des centres urbains et des catégories sociales privilégiées.
Ainsi donc, pour chaque promesse de la révolution Internet des années 1990 (société de l'information, désintermédiation, dématérialisation, enrichissement) correspond aujourd'hui une tendance inverse (désinformation, domination des big Tech, coûts environnementaux, croissance des inégalités). Ces évolutions expliquent son changement de cap politique, et interroge sur la direction que cette industrie prendra et fera prendre à l'avenir si elle continue d'ignorer sa portée sociale.
NDLR : Olivier Alexandre a récemment publié La Tech. Quand la Silicon Valley refait le monde aux éditions du Seuil
Olivier Alexandre
SOCIOLOGUE, CHERCHEUR AU CNRS
Notes
[1] Cf. Patrice Flichy, L'Imaginaire d'Internet, Paris, La Découverte, 2001Fred Turner, Aux sources de l'utopie numérique, Caen, C&F Editions, 2012 ; Benjamin Loveluck, Réseaux, libertés et contrôle. Une généalogie politique d'Internet, Paris, Armand Colin, 2015 ; Félix Treguer, L'utopie déchue, Paris, Fayard, 2019 ; Anne Bellon, L'État et la toile, Paris, La Dispute, 2023.
[2] Voir notamment Manuel Castells, L'Ère de l'information. La Société en réseaux, Paris, Fayard, 1998 et Yochai Benkler, The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom, New Haven (CO), Yale University Press, 2006.
[3] Henri Bourguinat, Michel Dupuy, Jérome Teïletche, Finance internationale, Paris, PUF, 1992.
[4] Nate Silver, « In Silicon Valley, Technology Talent Gap Threatens G.O.P. Campaigns », FiveThirtyEight, November 28th 2012.
[5] François Clémenceau, « Quand Emmanuel Macron découvrait l'Amérique à 29 ans », Journal du Dimanche, 22 avril 2018
[6] En 2023, le secteur information et technologie représente 4,5 % du PIB, 900 000 employés et 65 milliards d'euros en 2023. Aux États-Unis, le secteur représente près de 1.9 trilliards, soit 10 % du PIB (source : International Trade Administration).
[7] Voir Corine Lesnes, « En Californie, des milliardaires prennent parti pour Donald Trump », Le Monde, 18 juin 2024.
[8] En 2023, il a déployé près de 190 millions d'euros, là où la BPI a engagé au cours des dernières années 400 millions d'euros d'investissements et où Kima, le fonds de Xavier Niel, engage près de 20 millions d'euros par an.
[9] Théo Bourgeron, « Finance, énergies fossiles et Tech : ce patronat qui soutient l'extrême droite par intérêt », AOC, 5 juillet 2024.
[10] Matt Burns, « Leaked Palantir Doc Reveals Uses, Specific Functions And Key Clients », TechCrunch, January 11, 2015.
[11] Roberto J. Gonzalez, « How Big Tech and Silicon Valley are Transforming the Military-Industrial Complex », Watson Institute, April 17, 2024.
[12] Voir Chris Miller, La guerre des semi-conducteurs : Un conflit mondial pour une technologie, Paris, L'artilleur, 2024.
[13] Zyneb Tufekci, Twitter et les gaz lacrymogènes. Forces et fragilités de la contestation connectée, Caen, C&F Éditions, 2019.
[14] Voir notamment Gabriella Coleman, Gabriella Coleman, Coding Freedom : The Ethics and Aesthetics of Hacking, Princeton Princeton (NJ), University Press, 2013 et Sébastien Broca, Utopie du logiciel libre. Du bricolage informatique à la réinvention sociale, Neuvy-en-Champagne, Éd. Le passager clandestin, 2013.
[15] Laure Muselli, Fred Palier, Mathieu O'Neil, Stefano Zacchiroli, « Les employés des GAFAM, plus gros contributeurs du logiciel libre », Polytechnics Insights, 2021.
[16] Source : Stanford AI Index, May 2024.
[17] Voir notamment Mélodie Pitre, « Cloud carbon footprint : Do Amazon, Microsoft and Google have their head in the clouds ? », Carbone 4, 2 november 2022 et Nastasia Hadjadji, « L'insoutenable coût écologique du boom de l'IA », Reporterre, 4 juillet 2024.
[18] « Google environmental Report », 2024.
[19] Nahema Marshal and al., « Generative AI Misuse : A Taxonomy of Tactics and Insights from Real-World Data », Google DeepMind, July 6, 2024.
[20] Nahema Marshal and al., « Generative AI Misuse : A Taxonomy of Tactics and Insights from Real-World Data », Google DeepMind, July 6, 2024.
[20] Nicolas Dufour and al., « AMMEBA : A Large-Scale Survey and Dataset of Media-Based Misinformation In-The-Wild », May 21, 2024.
Sur la thématique des usages politiques de la désinformation, voir notamment Giuliano da Empoli, Les ingénieurs du chaos, Les États à la conquête de nos esprits, Paris, JC Lattès, 2019 ; David Colon, La guerre de l'information, Paris, Taillandier, 2023 ; David Chavalarias, « Minuit moins dix à l'horloge de Poutine. Jusque-là tout se passe comme prévu », 30 juin 2024.
[21] Pour une mise en perspective historique, voir notamment Jacques Donzelot, L'invention du social, Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Fayard, 1984 et Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.
[22] Voir notamment Antonio Casilli, En attendant les robots, Paris, Seuil, 2019 Sarah T. Roberts, Derrière les écrans. Les nettoyeurs du web à l'ombre des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, 2020, et Kate Crawford, Contre-Atlas de l'intelligence artificielle, Paris, Zuma, 2021.
[23] Anton Jager and Daniel Zamora Vargas, Welfare for Markets : A Global History of Basic Income, Chicago, University of Chicago Press, 2023.
[24] Clara Deville, L'État social à distance. Dématérialisation et accès aux droits des classes populaires rurales, Paris, Éditions du Croquant, 2023.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Il est temps de mettre fin au programme d’exploitation des travailleurs et des travailleuses étrangèr.e.s

The Maple, le 13 janvier 2015
https://www.readthemaple.com/its-time-to-end-the-exploitative-foreign-worker-program/?ref=maple-digest-news-newsletter
Les données publiées en ligne par le gouvernement du Canada montrent que le montant des amendes infligées aux employeur.e.s qui embauchent des travailleurs et travailleuses dans le cadre du Programme des travailleurs, travailleuses étranger.e.s temporaires (PTET) a augmenté de façon marquée en 2024.
Selon les données d'Immigration, Réfugié.e.s, et Citoyenneté Canada, le gouvernement du Canada a imposé 153 amendes aux entreprises qui emploient des travailleurs et travailleuses étranger.e.s temporaires au cours de la dernière année civile. Prises ensemble, ces sanctions pécuniaires ont totalisé $4,030,250, l'amende moyenne s'élevant à $26,341.
Il semble que cette tendance s'inscrit dans la continuité de celle observée ces dernières années, qui est celle de la hausse des amendes et des sanctions. Selon un reportage du Globe and Mail de mai 2024, 194 entreprises ont été pénalisées pour avoir enfreint les règles du PTET en 2023 et ont reçu des amendes totalisant $2,7 millions. Ainsi, bien que le nombre total d'amendes ait légèrement diminué en 2024, leur valeur monétaire a sensiblement augmenté.
De plus, la valeur moyenne des amendes augmente depuis plusieurs années. En 2023, l'amende moyenne était de $13,841, contre $11,606 en 2022, $9,761 en 2021 et $3,077 en 2020.
Les amendes peuvent varier considérablement en fonction de la nature et de l'ampleur des infractions et du dossier de conformité de l'entreprise. Par exemple, la plus petite pénalité infligée en 2024 était de $750, tandis que la plus élevée concernait une amende de $365,750 imposée en avril dernier à une entreprise de transformation de homards basée au Nouveau-Brunswick pour une série d'infractions, dont la plus grave incluait le fait de n'avoir pris des mesures contre des abus de toutes sortes. Dans ce cas, l'entreprise s'est également vu interdire l'embauche de travailleurs et de travailleuses par l'intermédiaire du PTET pendant deux ans.
Il semble que les interdictions imposées - dans presque tous les cas temporaires - aux employeur.e.s deviennent également plus nombreuses. En 2024 31 entreprises ont été temporairement exclues du PTET pour des périodes allant d'un à dix ans, tandis que dans un cas, une entreprise a été définitivement exclue. Cette entreprise, un vignoble en Colombie-Britannique, a également reçu une amende de $118,000 pour des infractions liées au fait de ne pas avoir empêché les abus sur le lieu de travail.
L'abus des travailleurs et des travailleuses étranger.e.s temporaires n'est pas bien sûr chose nouvelle. Mais le nombre croissant de ces travailleurs et travailleuses vulnérables employé.e.s au Canada a rendu le problème encore plus répandu.
Alors que les entreprises se plaignaient d'une pénurie généralisée de main-d'œuvre après la pandémie, le gouvernement fédéral a réagi en assouplissant les règles régissant le PTET et d'autres programmes facilitant l'accès aux travailleurs et travailleuses immigrant.e.s et migrant.e.s.
Après les changements apportés au PTET en 2022, la plupart des employeur.e.s pourraient embaucher jusqu'à 20 % de leurs travailleurs et travailleuses comme migrant.e.s temporaires, contre 10 % auparavant. De plus, les employeur.e.s de sept secteurs identifiés comme connaissant d'importantes pénuries de main-d'œuvre, notamment la fabrication de produits alimentaires, les services de restauration et d'hébergement et la construction, pourraient embaucher jusqu'à 30 % de leur main-d'œuvre grâce au PTET.
Alors que le marché du travail commençait à s'affaiblir, les employeur.e.s ont intensifié leurs efforts pour embaucher des migrant.e.s temporaires, notamment dans la restauration rapide et la construction, mais aussi dans le secteur de la santé. À mesure que les employeur.e.s ont eu un meilleur accès aux travailleurs et travailleuses migrant.e.s temporaires vulnérables, le gouvernement a détecté davantage de cas d'abus.
Les expériences négatives des travailleurs et travailleuses migrant.e.s employé.e.s dans l'agriculture ont retenu l'attention des médias. Mais les abus dans le cadre du PTET s'étendent bien au-delà de ce seul secteur, comme le montre clairement l'examen des données du gouvernement.
Le gouvernement fédéral ayant à la fois élargi l'éventail des secteurs pouvant accéder aux travailleurs et travailleuses étranger.e.s temporaires et assoupli les règles imposées aux employeur.e.s qui cherchent à recruter ces travailleurs et travailleuses, l'exploitation et les abus des migrant.e.s ont désormais lieu dans davantage de secteurs de l'économie.
Le gouvernement libéral a pourtant fait preuve de grandes inconséquence et incohérence en ce qui concerne les travailleurs et travailleuses migrant.e.s temporaires. Après avoir déjà élargi le recours au PTET et à d'autres programmes de migration en réponse aux pressions exercées par les entreprises, le gouvernement a brusquement changé de cap l'an dernier et a indiqué qu'il allait limiter le nombre de travailleurs et trvailleuses temporaires.
Сette réorientation politique s'inscrit en partie dans un effort global visant à réduire la migration et l'immigration au Canada, qui faisait souvent des nouveaux immigrants, nouvelles immigrantes, des étudiants étrangers, étudiantes étrangères et des travailleurs et travailleuses migrant.e.s des boucs émissaires pour des problèmes, tels que la hausse des coûts du logement et le manque de ressources dans les services de santé. Pourtant, les nouvelles restrictions sur la migration de main-d'œuvre temporaire étaient également une réponse à une inquiétude généralisée concernant l'exploitation et les abus des travailleurs et travailleuses migrant.e.s temporaires.
Tout au long de la seconde moitié de 2024, l'attention s'est renouvelée sur les abus généralisés des migrant.e.s travaillant au Canada dans le cadre du PTET et d'autres programmes. En particulier, un rapport accablant du rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, Tomoya Obokata, qui critiquait fortement le programme, a reçu une attention médiatique considérable.
Lorsque le gouvernement fédéral et les député.e.s conservateurs et conservatrices de l'opposition ont remis en question la caractérisation du PTET par le fonctionnaire de l'ONU comme « un terreau fertile pour les formes contemporaines d'esclavage », Obokata a maintenu ses commentaires, bien qu'il ait déclaré qu'il devait rassembler davantage de preuves avant de publier le rapport final.
Lorsque le rapport a été publié en juillet, sa principale recommandation – mettre fin au système de permis de travail fermés qui lie les travailleurs et travailleuses à des employeur.e.s particulier.e.s – a été largement ignorée.
Au lieu de cela, le débat s'est porté sur le nombre de travailleurs étrangers, travailleuses étrangères temporaires plutôt que sur la conception du programme et sur la manière dont il génère systématiquement des risques d'exploitation et d'abus.
Les permis de travail fermés laissent les travailleurs et travailleuses migrant.e.s temporaires entièrement dépendant.e.s des employeur.e.s pour le travail, le logement, l'accès aux soins de santé et de nombreux autres besoins. Une fois au Canada, ces travailleurs et travailleuses ne sont pas « libres » de changer d'emploi, mais sont plutôt lié.e.s à l'employeur.e qui les a embauché.e.s et a facilité leur entrée au pays. De plus, comme la perte d'emploi entraîne généralement l'expulsion, les travailleurs et travailleuses sont réticent.e.s à se plaindre des abus et des mauvais traitements. La structure même du programme, qui se concentre sur des permis fermés qui lient les travailleurs et travailleuses à des employeurs particuliers, employeures particulières, génère une vulnérabilité et un potentiel d'exploitation.
Dans ces circonstances, les inspections gouvernementales et l'application de la loi axée sur la dissuasion constituent la dernière ligne de défense, même si elles ne sont pas suffisantes.
Le fait que le gouvernement impose un plus grand nombre d'amendes d'une valeur monétaire plus substantielle est une mesure positive, bien qu'insuffisante. Comme le soulignent depuis longtemps les spécialistes de la conformité aux normes du travail, une dissuasion efficace nécessite des sanctions significatives. Pourtant, malgré les sanctions plus sévères mises en place ces dernières années, de nombreux cas de maltraitance des travailleurs et travailleuses restent probablement non détectés.
Les entreprises qui emploient des migrant.e.s dans le cadre de programmes de permis de travail fermés sont censées être inspectées pour s'assurer qu'elles respectent les règles du programme. Mais en réalité, les services d'inspection du gouvernement ne disposent tout simplement pas des ressources suffisantes pour détecter tous les cas de non-conformité et d'abus de la part des employeur.e.s.
De plus, les employeur.e.s sont souvent informés à l'avance des inspections et ont généralement la possibilité de corriger leurs actes répréhensibles afin de rester admissibles à participer au programme et à embaucher des migrant.e.s.
Même les employeur.e.s qui reçoivent des sanctions pécuniaires relativement importantes peuvent payer leurs amendes, s'engager à corriger les infractions passées et continuer à employer des migrant.e.s. Par exemple, une entreprise qui a été condamnée à une amende de 78,000 $ en mars de l'année dernière pour avoir enfreint les règles relatives au paiement (le gouvernement ne divulgue pas de détails précis sur les cas individuels) est désormais à nouveau autorisée à participer au PTET. En effet, 38 entreprises qui ont été sanctionnées par des amendes de différents montants en 2024 sont désormais autorisées à embaucher des travailleurs et travailleuses migrant.e.s.
En fin de compte, la seule façon de véritablement résoudre les problèmes au cœur du PTET est de supprimer le système de permis de travail fermé du programme. Lier les travailleurs et travailleuses à des employeur.e.s spécifiques est une forme de travail non libre qui génère l'exploitation, les mauvais traitements et les abus.
En outre, les travailleurs et les travailleuses en général ont intérêt à ce que ce système d'exploitation cesse. Permettre aux permis de travail fermés et au travail temporaire migrant de perdurer sous leur forme actuelle porte atteinte aux normes sociales de tous les travailleurs, toutes les travailleuses. Comme le dit si bien le vieux slogan syndical, une atteinte à l'un.e est une atteinte à tous et à toute.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
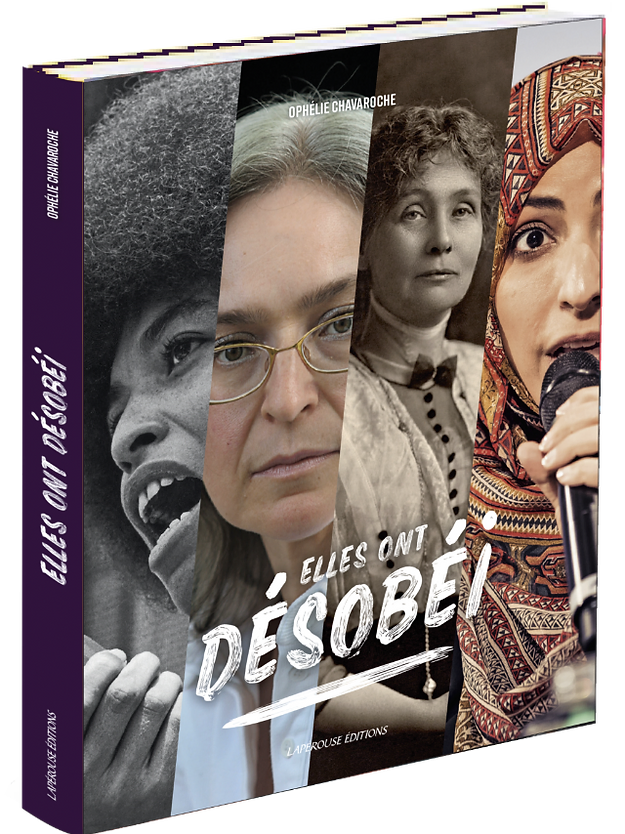
*« Elles ont choisi la voie de la révolte,...
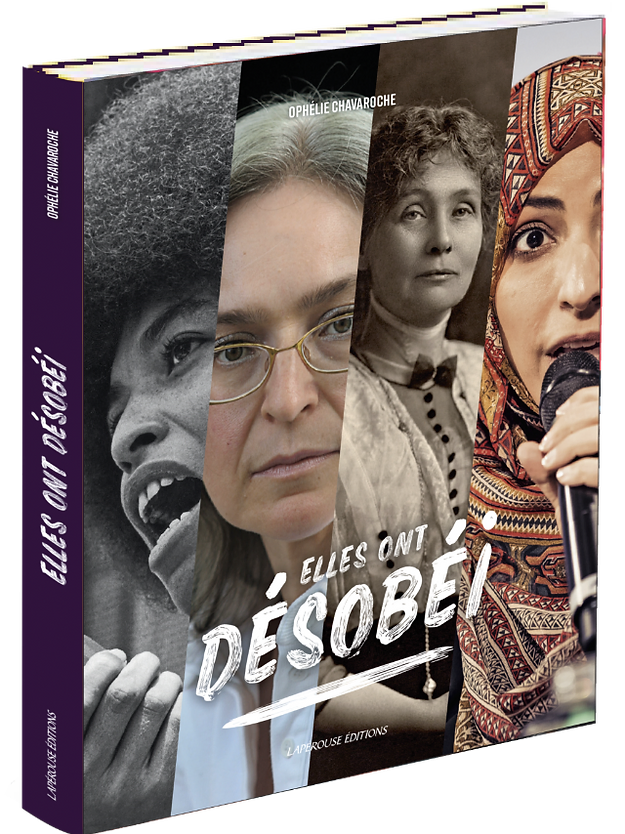
*« Elles ont choisi la voie de la révolte, parfois au péril de leur vie. Pourquoi et comment ? ».*
Je me permets de vous adresser quelques pages du livre « Elles ont désobéi », paru en décembre dernier aux éditions Lapérouse. *« Ce livre raconte l'histoire de femmes qui se sont illustrées par leur désobéissance à un ordre établi. Une histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui, avec plus de vigueur que jamais. »*
Contre l'oppression, contre l'injustice, pour la planète, pour exister en tant que femmes, pour le respect du corps des femmes, pour l'égalité des genres…
– Carola Rackete, sauveteuse illégale en méditerranée, au secours des migrants
– Angela Davis, féministe et grande figure des luttes contre les injustices raciales et sociales
– Alessandra Horap, de l'ethnie Mundukuru, contre les projets de déforestation et d'extraction minière qui empoisonnent l'Amazonie
– Sophie Scholl, militante allemande exhortant ses concitoyens à se lever contre Hitler et la barbarie nazie
– Anna Politkowskaïa, dénonçant inlassablement le régime de Vladimir Poutine et de ses méthodes criminelles
– Nawal el Saadawi, égyptienne, initiant la lutte contre la pratique de l'excision en Afrique
– Ranjana Kumari contre la coutume de la dot - pour que naître femme en Inde ne soit plus une malédiction
– Bobbi Gibb, première marathonienne - a contribué à balayer les préjugés sexistes dans le sport
– Malala Yousafzai, défiant les talibans avec son « Journal d'une écolière pakistanaise » témoignant du régime de terreur infligé aux femmes
– Leymah Gbowee, militante libérienne, qui par un combat pacifiste avec les femmes de son pays, a réussi à faire tomber un tyran et à mettre fin à quatorze ans de guerre civile
Et bien d'autres femmes célèbres ou moins connues … Gisèle Halimi, Greta Thunberg, Rosa Parks, Masha Amini, Marielle Franco … artistes, sportives, suffragettes, pirates, militantes MeToo, collectif Pussy Riot, guérilleras zapatistes, pionnières de l'écologie, … un hymne au courage, à la créativité et à l'engagement des femmes à travers le monde et au fil de l'Histoire. Une histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui, avec plus de vigueur que jamais.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Préface de l’ouvrage « Islam et Capitalisme » de Maxime Rodinson par Omar Benderra

Maxime Rodinson est l'auteur d'une double rupture idéologique et politique, d'une part avec l'orientalisme en tant que modalité spécifique aux cultures arabo-islamiques de l'anthropologie coloniale et d'autre part avec la théorie critique développée par les dogmes marxistes en vogue dans les années soixante et soixante-dix du siècle dernier. Islam et capitalisme est publié en 1966 dans un contexte mondial dominé par deux blocs politiques, celui de l'Ouest capitaliste dirigé par les États-Unis et celui de l'Est communiste piloté par l'URSS.
L'époque est aussi celle de l'émergence des pays du Tiers Monde dans le fil des guerres de libération et des indépendances des années 1950 et 1960. Les États arabes, pour la plupart récemment libérés de la férule coloniale française ou britannique, relevaient de cette catégorie intermédiaire et se situaient dans l'orbite de l'un ou l'autre des blocs géopolitiques concurrents. La rivalité planétaire entre les États-Unis et l'Union soviétique était propice à une confrontation intellectuelle riche et diversifiée entre théoriciens libéraux de différentes écoles et marxistes de courants parfois clairement antagoniques. Les débats sou- vent très vifs et les controverses soutenues ne se limitaient évidemment pas aux pays des deux blocs opposés et concernaient d'importantes catégories d'intellectuels, de chercheurs ou d'activistes du Tiers Monde.
Dogmatismes et principe de réalité
Cette période qui semble aujourd'hui fort lointaine a été marquée dans le monde arabe par des débats intenses et particulièrement animés entre économistes, sociologues et historiens autour des questions urgentes de l'édification des États postcoloniaux et du développement économique mais aussi de leurs histoires et de leurs formes d'organisation sociale. Dans ce florilège de publications concernant le monde arabe, y compris celles qui se paraient d'une caution académique, l'engagement politique l'emportait souvent sur la rigueur analytique. Les lignes de fractures entre ces diverses approches se caractérisaient par la primauté des convictions politiques et au respect discipliné de la ligne de leurs partis et relevaient pour l'essentiel d'une perspective occidentale, culturellement ethnocentrée, sur une civilisation étrangère.
C'est dans ce contexte d'affrontement idéologique intense, favorable aux réductions dogmatiques présentées comme vérités d'évidence, que Maxime Rodinson publie Islam et capitalisme, un livre-repère dont j'ai l'honneur de préfacer la réédition québécoise. En marxiste iconoclaste mais en universitaire rigoureux, Rodinson procède à un examen critique des thèses en présence et remet les pendules à l'heure du principe de réalité, par le développement d'un argumentaire systématiquement étayé. Sa démarche est fondée sur une indéniable rigueur scientifique, une connaissance encyclopédique des thèmes abordés et une réelle proximité avec les formations sociales appréhendées. Au-delà de l'économie et de la religion, ce que Maxime Rodinson éclaire précisément est un rapport occidental au monde musulman.
Le matérialisme historique dont se prévaut Maxime Rodinson est construit sur une démarche méthodique et largement inclusive, ne laissant pas de place à l'imprécision ni aux schématisations mécanistes, à la différence de nombre d'analystes se réclamant de l'héritage de Karl Marx, qui se risquaient à des considérations très incertaines, du « mode de production asiatique » aux « féodalités hydrauliques » en passant par les systèmes de relations interpersonnelles, pour décrire les sociétés et expliquer les retards socioéconomiques du monde arabo-musulman.
Le marxisme historiciste de Rodinson se démarque ainsi par sa volonté de comprendre le développement historique des sociétés musulmanes et de contextualiser les textes arabo- musulmans, ce qui le place en porte-à-faux avec les orientalistes, qui traitent le monde arabe comme une entité ontologiquement stable, mais aussi avec les staliniens, qui ont des modèles de développement très rigides.
Le colonialisme, matrice des régressions arabes
L'auteur est également en rupture avec les orientalistes qui tout en célébrant les avancées civilisationnelles observées dans leur lointain passé, attribuaient les stagnations et le recul des sociétés de cette région du monde à une religion obscurantiste. Pour nombre de ces observateurs, l'islam est la matrice de cultures archaïques, induisant des formes d'organisation figées et radicalement hostiles à toute évolution. Il ne faisait aucun doute pour beaucoup de ces experts ès islam que la religion portée par le Prophète Mohamed était l'obstacle fondamental à la modernisation économique et au progrès en général.
Pour Maxime Rodinson, ces interprétations fallacieuses masquent la réalité des effets de l'agression coloniale et de l'hégémonie impérialiste franco-britannique qui s'installe à la faveur de la dislocation de l'Empire Ottoman au cours du XIXe siècle et au début du XXe.
Pour l'historien et le sociologue, le retard des sociétés arabo-islamiques ne saurait être expliqué par de prétendus blocages culturels et une censure religieuse mais plutôt par les agressions multiformes et les occupations violentes dont elles ont été victimes. À mille lieues de cette reconnaissance de la responsabilité coloniale et dans une convergence apparemment paradoxale, les analyses du marxisme orthodoxe et davantage encore celles des orienta- listes ont pour commune caractéristique la formulation de représentations suprémacistes et essentialistes plus ou moins clairement exprimées dans une vision hiérarchique, assumée ou implicite, du monde.
Maxime Rodinson démontre que l'islam n'est en rien opposé au capitalisme (ou à une quelconque forme d'organisation économique a priori). Historiquement, les sociétés islamiques ont été largement façonnées par un capitalisme marchand pratiqué par le Prophète lui-même. Le commerce et la propriété privée n'ont jamais été, au contraire, remis en cause par l'islam. Ce sont bien les conditions sociopolitiques, somme de multiples facteurs, de la croissance démographique européenne à l'industrialisation de l'Angleterre en passant par les gigantesques pillages coloniaux inter alia, qui ont permis l'expansion dynamique du capitalisme occidental et qui, au contraire, ont joué en défaveur du développement économique du monde musulman, en détruisant les souverainetés des États qui le composaient et en cassant les dynamiques internes.
Ces conditions historiques ont permis l'invasion par vagues successives de vastes régions du monde par les puissances européennes, la destruction des sociétés locales, la dépossession et la clochardisation des populations autochtones. Ainsi, au bout de longues années de génocides et de spoliation de tous ordres, la narration élégiaque de la conquête de l'Algérie reprise notamment par une bonne partie de l'intelligentsia française a massivement scénarisé l'effroyable régression infligée aux sociétés indigènes, présentant leur immense misère comme un état naturel inhérent à une culture radicalement exotique, rétrograde, repliée et imperméable aux idées de progrès. L'apport « émancipateur » du colonialisme, issu de la « civilisation des Lumières » s'imposant de lui-même comme une nécessité, justifiant la « mission civilisatrice », fardeau que le colon blanc s'imposait très symboliquement, niant catégoriquement l'étendue de crimes imprescriptibles. Et c'est très exactement ce qui fut célébré en 1930 en grandes pompes républicaines et nationalistes lors du centenaire de la colonisation de l'Algérie.
Capitalisme, collectivisme ou économie socialiste de marché ?
La confrontation multiforme entre capitalisme et socialisme, extrêmement vive durant les années consécutives à la Seconde Guerre mondiale, s'est évaporée avec la disparition de l'Union soviétique en 1991 et l'échec avéré des diverses formes d'étatisation de l'économie. L'ensemble du monde arabe aujourd'hui est dirigé par des régimes de diverses natures mais unanimement libéraux et généralement peu efficaces. Mais de quel capitalisme s'agit-il ?
Si les économistes favorables à la collectivisation des moyens de production et au rôle de gestionnaire de l'État ne sont plus audibles, ceux qui prônent la dérégulation des marchés au nom du libéralisme n'ont pas gagné en crédibilité. De fait, le creusement vertigineux des inégalités par la concentration des richesses et la massification de la précarité dans les opulents pays industrialisés signe en effet les limites socialement et éthiquement destructrices du modèle. Au plan global, l'échec des politiques économiques libérales imposées par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale aux États défaillants illustre cruellement les limites d'une doxa antisociale imposée par les banques et les multinationales occidentales.
En contrepoint de ces échecs et crises à répétition, l'émergence extraordinairement rapide de la Chine au cours de ces vingt dernières années remet en cause les positionnements doctrinaires antérieurs. Pékin, en ouvrant son marché au secteur privé national et aux investissements étrangers, n'a pas abandonné pour autant ses instruments de souveraineté en termes de politique économique. La planification centrale ainsi que le contrôle strict des opérations bancaires et financières permettent au pouvoir central d'encadrer une dynamique de croissance soutenue sans précédent historique.
L'ordre du monde sous hégémonie occidentale est ainsi remis en cause par l'apparition d'un catalyseur global alternatif. Le capitalisme chinois sous la férule du Parti communiste explore un mode alternatif de commerce et de coopération avec le reste du monde sous des formes fort différentes de celles de l'Occident.
Pour autant, d'autres tentatives de maintenir autant que possible le rôle social de l'État tout en procédant à l'élimination des contraintes bureaucratiques au fonctionnement du marché ont bel et bien eu lieu. L'expérience brève et rapidement interrompue des Réformes en Algérie entre 1986 et 1991 était construite sur la nécessité du marché par l'ouverture à l'initia- tive privée tout en libérant la gestion des entreprises publiques des tutelles administratives. L'objectif des Réformateurs était de garantir le rôle de l'État en tant que régulateur dans le cadre institutionnel démocratique de l'État de droit. Mais très rapidement, les réformes, en éliminant les très opaques supervisions administratives, se sont heurtées aux intérêts du haut commandement de l'armée et de la police politique qui ont fini par casser définitivement cette dynamique en janvier 1992. La bourgeoisie militaire algérienne s'engagera quelques mois plus tard dans un contexte de violence inouïe dans la voie antisociale et antinationale de l'ajustement structurel sous tutelle du FMI.
L'impasse permanente du monde arabe
Les guerres et invasions occidentales, en Irak, en Syrie et en Libye expliquent en partie leurs impasses économiques mais l'image renvoyée par les économies des États arabes n'impressionne guère. De fait, si la manne des hydrocarbures venait brutalement à s'assécher, les opulents pays du Golfe persique s'effondreraient rapidement. Le libéralisme rentier des producteurs de pétrole, qui ne débouche jamais sur une économie industrielle, évolue, au mieux, vers un capitalisme d'intermédiation financière, uniquement susceptible d'abriter des hubs commerciaux et de services sans profondeur productive. L'illustration majeure de cette « modernisation » est celle des Émirats arabes unis, engagés dans un programme d'insertion active dans le marché global autour du commerce et des services adossés à une plateforme financière de recyclage de capitaux d'origine souvent non identifiable.
Le reste des économies du Machrek ou du Maghreb est en crise structurelle, à l'image de l'Égypte du maréchal Al-Sissi qui s'est très tôt, au milieu des années 1970, engagée dans une politique d'« Infitah », c'est-à-dire une politique d'ouverture des marchés et de privatisation. L'Égypte est plus que jamais dépendante des perfusions externes de ses bailleurs de fonds. Au bout d'un demi-siècle de politique libérale, l'économie égyptienne est sinistrée, écrasée par un endettement qui a massivement enrichi une classe compradore au détriment de l'immense majorité de la population qui survit dans des conditions épouvantables. À l'ouest du continuum arabo-musulman, le Royaume du Maroc, en dépit de législations très favorables, ne parvient pas à attirer les niveaux d'investissements qui lui permettraient de créer une base industrielle vitale et de répondre autant que possible à un écrasant chômage de masse. L'Algérie qui avait, au prix fort, construit les fondations d'une base industrielle substantielle l'a essentiellement bradée à vil prix en se soumettant aux diktats du FMI à la suite du coup d'État militaire du 11 janvier 1992. La non-gestion économique délibérée assumée par l'armée et la police politique a atteint des paroxysmes de gabegie et de corruption dans les années Bouteflika, privant le pays de ressources nécessaires à son développement, stérilisant durablement les capacités créatives et les compétences d'une jeunesse aujourd'hui sans perspectives.
L'échec économique des régimes arabes postindépendances
est d'autant plus cinglant que leurs pays disposaient pour certains de ressources et de moyens substantiels. Mais qu'il s'agisse de pays bénéficiant de ressources fossiles, pétrole et gaz, ou moins favorisés par la géologie, les performances économiques sont très en deçà des minima requis pour combler des retards considérables. Et c'est sous cet aspect que la démarche analytique de Maxime Rodinson, qui était conscient des limites de ces systèmes, s'avère encore pertinente. La caractéristique commune première des régimes arabes, quelle que soit leur forme ou nature, monarchie ou république, est leur caractère non démocratique et antipopulaire. Féodalités et dictatures militaires imposées par Londres ou Washington et soutenues par Paris, ces systèmes néocoloniaux de facto perpétuent la domination impérialiste et la misère de leurs peuples par l'inefficacité de leur gestion économique, leur corruption massive et le blocage de toute évolution. Ces autoritarismes qui écrasent leurs sociétés assurent l'insertion subalterne des économies arabes dans l'ordre mondial libéral et continuent de transférer les richesses vers l'Occident par les détournements et les malversations. Continuant en les renouvelant les modes de pillages instaurés par la domination coloniale directe. Ces systèmes de non-droit, derrière de vertueuses proclamations et la référence démagogique aux principes islamiques, empêchent le fonctionnement rationnel de leurs marchés internes, inter- disent le développement en organisant la captation privative des ressources publiques au profit de la caste au pouvoir et de ses protecteurs étrangers.
L'autoritarisme apatride contre le développement national
Maxime Rodinson, par sa lecture critique, déconstruit l'un des éléments constitutifs de la représentation occidentale du monde musulman en posant la question du rapport des superstructures culturelles et idéologiques à l'infrastructure économique. Et c'est bien à ce niveau que se situe encore le débat actuel dans un monde arabe qui depuis s'est profondément transformé. Dans les années 1960 et 1970, période de publication de son ouvrage, le choix d'un modèle de développement susceptible de permettre aux pays du Tiers Monde de rattraper leurs retards sur les pays industrialisés était au cœur des luttes politiques entre avocats du libre marché et partisans de la voie socialiste. Le socialisme, sous ses diverses déclinaisons, par administration directe de l'État ou par autogestion, était une hypothèse dont l'efficacité n'était pas encore remise en cause.
Dans le monde arabe, les pays qui avaient opté pour le socialisme, sous diverses significations, ont mis en avant les dimensions de justice sociale et de solidarité, nullement contradictoires avec le Coran et les textes de l'islam. De la même manière les autres pays arabes ayant opté pour le capitalisme justifiaient ce choix par la liberté de commerce dont le Prophète avait fait sa première profession. S'ils divergeaient en matière de choix économiques, ces systèmes politiques fort différents se retrouvaient tous dans l'autoritarisme : les uns et les autres n'ont pas réussi à construire des économies productives et viables. La religion musulmane n'a aucune part dans la faillite des gouvernances arabes, l'islam n'est en rien responsable des échecs de politique économique. Ce qui est clairement en cause est la dictature et la qualité désastreuse à tous égards de ses personnels cooptés dans les rangs d'un clientélisme de l'obéissance et de la soumission. À la différence de leurs homologues asiatiques dont le patriotisme ne peut être nié, les dictatures arabes sont des systèmes apatrides et prédateurs qui ne répondent à aucune règle, fondamentalement organisés autour de la corruption et de la fuite des capitaux, leur logique de fonctionnement est largement déconnectée des pays qu'ils dirigent.
Le tableau général qui s'impose à l'issue d'une analyse actualisée des économies du monde musulman laisse peu de place à l'incertitude s'agissant des gouvernances arabes héritières et continuatrices des tutelles coloniales. Il ressort que les régimes postindépendances ont, en traitant leurs peuples avec le même mépris, pour l'essentiel maintenu les conditions d'assujettissement installées par le colonialisme. Les habitants des États arabes aux indépendances circonscrites ne sont toujours pas des citoyens dans l'acception démocratique minimale du terme. L'impossibilité de mettre en place des structures politiques reconnues, légitimes et représentatives, a déterminé une situation permanente généralisée de non-droit. Les élites réelles sont marginalisées et éliminées des sphères de décision aboutissant de ce fait à une perte de confiance dans les représentants des pouvoirs et une démonétisation des institutions, à commencer par l'administration de la justice réduite à un service subalterne de l'exécutif. Aucune politique économique ne peut être valablement envisagée sans adhésion et confiance des acteurs sociaux à même de mobiliser les capacités de création de leurs sociétés.
Aujourd'hui comme hier, et en dépit de ce que prétendent les propagandistes de la guerre des civilisations, l'islam ne peut être incriminé dans l'échec socioéconomique du monde musulman. Les racines idéologiques des retards comme celles de tous les blocages sont à rechercher dans la réalité des structures sociales de pouvoir, dans l'identification des acteurs et de leurs alliances, internes ou externes et, in fine, dans la nature des enjeux économiques. Les peuples arabes, hier sous la botte coloniale, vivent aujourd'hui sous la férule de régimes soutenus par les ex-métropoles coloniales. L'une des illustrations les plus éloquentes de la soumission néocoloniale des États arabes est bien leur silence, ou même leur complicité pour certains, devant le génocide en cours à Gaza.
Maxime Rodinson a grandement contribué à situer les responsabilités des retards du monde arabo-islamique en écartant des théories mystifiantes et en imposant une démarche analytique à la fois savante, cohérente et limpide. La réédition d'Islam et capitalisme est plus que pertinente, elle est salutaire dans une période où les oligarchies atlantistes, par leurs médias, leurs maisons d'édition et leur ascendant sur les appareils d'État, accentuent un discours essentialiste et raciste visant à dresser les sociétés et les peuples les uns contre les autres. Il faut donc saluer le courage des universitaires, des chercheurs et des éditeurs qui reprennent et font connaitre les travaux d'un intellectuel qui incarnait l'éthique de l'engagement et l'esprit scientifique dans le respect de tous.
Omar Benderra – Algeria-Watch
Paris, 17 septembre 2024
* Omar Benderra est économiste et ancien président de banque publique. En exil en France depuis 1992, il est consultant indépendant, membre de l'association de défense des droits humains Algeria-Watch et a codirigé l'ouvrage collectif Hirak en Algérie. L'invention d'un soulèvement (La Fabrique, 2020).
Éditions de la rue Dorion
www.ruedorion.ca
1266, rue Dorion
Montréal, Qc
H2K 4A1

ChatGPT, une intelligence sans pensée, d’Hubert Krivine

Hubert Krivine, probablement pas le moins connu des lecteurs et lectrices de l'Anticapitaliste, sort un nouveau livre de vulgarisation et de débat scientifique sur ChatGPT.
Hebdo L'Anticapitaliste - 738 (23/01/2025)
Éditions Cassini, 2025, 192 pages, 12 euros.
Sur la forme, c'est assez court : une centaine de pages. Et un effort particulier a été fait sur l'accessibilité, avec des sections plus compliquées pouvant être omises et signalées par la mise en page, le renvoi en annexes de certains points et la construction générale qui n'hésite pas à reprendre des idées pour faciliter la compréhension générale. Tous les détails ne sont pas nécessairement évidents, mais si on ne s'y arrête pas, ça se lit très bien.
Vulgarisation scientifique
Sur le fond, commençons par dire que ce n'est pas à charge contre ChatGPT, ou plutôt le modèle de lecture et de génération de texte qu'il représente et encore moins sur l'IA en général, mais « [une tentative] d'en définir les limites, même à contre-courant ». Une des forces du livre est d'éviter de se concentrer sur les aspects spectaculaires des réussites ou échecs de ChatGPt, une autre est d'être écrit par quelqu'un qui n'est pas un spécialiste et qui, outre son expérience de scientifique, a déjà beaucoup produit en vulgarisation (ou médiation) et en réflexion sur les sciences. Il va ainsi surtout poser de bonnes questions qui aident à comprendre à quoi nous avons affaire et aux limites importantes de ce modèle d'IA, par-delà les réussites et l'emballement qu'il génère.
Partant d'un problème qui semble peut-être éloigné du quotidien — la conception de théorie scientifique — mais éclaire bien le problème principal de l'IA : celle-ci repose sur l'utilisation d'un grand nombre de données (big data) et donc la production des réponses par induction à partir de ces données. Ce qui peut être utile à la science, mais va à l'encontre d'une grande partie des avancées de la science. Le nombre de données est à la fois trop important — ce qui amène de nombreux problèmes — et trop faible pour la « compréhension » de l'environnement. D'où la question de l'intelligence et de la pensée.
Quelle utilisation pour l'IA ?
Évitant les affirmations péremptoires sur ces sujets et en posant de bonnes questions, le livre permet d'envisager ces concepts dans leur diversité en gardant pour fil directeur la question de leur utilisation, des trop nombreuses données que constituent notre environnement et la préoccupation de créer « du neuf à partir du vieux ». Intéressant au-delà des problèmes de l'IA. Ainsi il aborde, par la bande, la question de l'intelligence des animaux non humains, poursuit sur les problèmes économiques et écologiques que pose le nombre de données et de sa croissance, et termine avec la nécessité de ces modèles d'IA et l'horizon de leurs progressions.
Pour celleux qui peuvent craindre la difficulté de lecture, une nouvelle fois l'attention portée à l'accessibilité est grande et une conclusion prend le temps de récapituler et nous permet d'apprécier les questions soulevées.
Benjamin Mussat
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Notre résistance, entreprise depuis des années
22 janvier – Pierre Jasmin
https://www.artistespourlapaix.org/resistance-entreprise/
1- Ce salut hitlérien du 20 janvier, couplé à une grimace de défiance à l'ordre
établi, saluait la première mesure du président Trump qui fut de gracier l'immense majorité des complotistes du 6 janvier 2021 ayant envahi le Capitole pour tenter de renverser l'accession au pouvoir « démocratique » de Biden.
2- Les immigrants maltraités par Donald Trump dans tous ses discours de
campagne seront les cibles préférées du nouveau gouvernement américain.
3- Le pape appelle cela TURPITUDE et en fait la raison pour laquelle il n'a pas
accepté l'invitation de Macron à la réouverture de Notre-Dame-de-Paris, où il ne voulait pas être obligé de serrer la main à Donald Trump.
4- Une trêve fragilisée par Nétanyahou reconnu coupable, par le Tribunal
International de La Haye, de génocide contre la Palestine (aujourd'hui reconnue par 146 pays de l'ONU mais pas par le Canada !) permet néanmoins à quatre-vingt-dix Palestiniens et trois otages israéliens d'être libérés. Ils auraient dû être remis à l'UNRWA de l'ONU, ils sont heureusement saufs dans les mains du Croissant-Rouge.
5- Le froid de la météo nous fait oublier que selon les mots d'Antonio Guterres,
secrétaire général de l'ONU, notre planète est en feu en particulier à Los Angeles.
6- Le boycott des géants du numérique est entrepris avec le retrait de X (Elon
Musk) par le Collège des Médecins, les journaux encore à peu près respectables le Monde, The Guardian et Libération et les artistes Elton John et Barbra Streisand.
7- Le boycott d'Amazon antisyndical est bien entrepris au Québec,
malgré la bourde « jus d'orange » de mon oncle François Legault.
8- Méfiance accrue face aux opioïdes des pharmaceutiques.
9- PSPP fait de lui une Danielle Smith : « le Canada n'a pas été un bon voisin ».
10- Northvolt de M. Fitzgibbon fabriquera des batteries à 25% trop chères ?
11- Chrystia Freeland annulerait l'impôt sur les gains en capital, si elle devient
cheffe du parti conservateur 2.0, pardon, du parti libéral dont aucun candidat à la succession de Justin (ni lui-même) n'appelle à une solidarité avec le Mexique progressif de Claudia Sheinbaum (voir commentaire à notre dernier article (i).
12- L'ex-président de la Corée du Sud arrêté pour rébellion et abus de pouvoir ?
13- Le 23 décembre 2020, à la surprise générale, le président Trump, encore en
exercice, avait apposé son veto à un budget militaire en hausse « plaçant les intérêts de l'establishment de Washington au-dessus de ceux du peuple américain » et qui allait à l'encontre de ses « efforts pour ramener les troupes à la maison depuis l'Afghanistan, l'Allemagne et la Corée du Sud ». Quand réalisera-t-il sa promesse la plus spectaculaire et la plus urgente d'arrêter la guerre d'Ukraine ?
14- N'a-t-il fait que déplacer le génocide palestinien à Jénine en Cisjordanie ?
15- 217 policiers kényans arrivent en Haïti comme force de paix antigangs.
16- Le Nigéria rejoint le BRICS de la Chine et de la Russie. Le pays compterait
regagner son titre de 1ère économie d'Afrique en se soustrayant de l'influence du $, responsable de la baisse de ses recettes d'exportation, de l'augmentation du service de sa dette et de son inflation et d'une dépréciation de sa monnaie.
17- Cuba est à nouveau déclaré terroriste, comme le Venezuela.
18- La loi 21 sera débattue en Cour Suprême contre la majorité québécoise.
19- Trump congédie les fonctionnaires qui oeuvraient dignement pour la
diversité, l'équité et l'inclusion.
20- Les enseignants CPE veulent leur valeur être dignement rémunérée.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Ci-joint la lettre que nous avons fait parvenir...
Ci-joint la lettre que nous avons fait parvenir hier après-midi au premier
ministre du Québec.
VRIc suggère au premier ministre, François Legault, de profiter de la
relance des discussions pour le renouvellement du traité de libre-échange
entre le Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026 *pour adopter quatre
mesures pour le développement de l'économie circulaire dans le cycle du
carbone au Québec.
M François Legault,
Premier ministre
835 bd René-Lévesque E 3e étage,
Québec, QC G1A 1B4
Sujet : Option Québec pour le traité de libre-échange Canada-États-Unis 2026.
Monsieur,
Face à la position du président Trump d'établir une barrière tarifaire de 25 % sur les produits canadiens, comme vous le dites, il faut garder la tête froide et examiner toutes les options.
Le Québec doit profiter de la réouverture des négociations du traité de libre-échange États-Unis, Mexique, Canada, en 2026, pour développer l'économie circulaire dans le cycle du carbone. Dans ce contexte, une des options à privilégier est celle d'une économie compatible avec l'urgence climatique.
Ainsi, quatre mesures devraient être prises.
• La première serait de déterminer le cadre de la négociation en fixant la barrière tarifaire
canadienne à 30 % pour les produits américains qui entrent au Canada si elle est maintenue à 25 % pour nos produits qui entrent aux États-Unis, soit un différentiel de 5 % en notre faveur. Ce différentiel est accepté par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) lorsque les parties démontrent que l'entente est désavantageuse à l'égard de l'une des parties. Il s'agit du même différentiel qui existait avant les négociations de l'Accord de libre-échange de 1989.
• La deuxième serait de choisir les produits sur lesquels nos tarifs s'appliqueraient, comme les électroménagers (poêle, réfrigérateurs, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse). Ces appareils, fabriqués aux États-Unis, possèdent une trace carbone supérieure à ceux produits au Québec.
• La troisième serait d'abolir la TPS et la TVQ sur les mêmes produits usagés, l'idée est d'orienter le pouvoir d'achat des consommateurs vers des entreprises québécoises qui traitent et vendent des produits usagés. Ces derniers possèdent une trace carbone moindre que les produits neufs produits aux États-Unis.
• La quatrième serait de faire en sorte que les municipalités, les ministères et les organismes gouvernementaux achètent des produits usagés. À la fin des négociations de ce nouveau traité de libre-échange, il faut s'assurer que le différentiel des tarifs est de 5 % en faveur du Canada. Ce résultat équivaut à la taxe carbone à la frontière de l'Union
2 européenne. Ainsi, et particulièrement pour le Québec, nous serions assurés du décollage de l'économie circulaire dans le cycle du carbone, seule économie conciliable avec l'urgence climatique. Notre relation avec notre voisin est souvent comparée à celle d'un éléphant dans le même lit qu'une souris. Aujourd'hui, il y a un élément plus gros qui domine les bêtes : le réchauffement du climat.
Mahamadou Sissoko
Président
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Millionnaires dans la rue ! Millionnaires dans la rue !
Les différentes strates des classes dominantes, c'est-à-dire financières et économiques, ne sont plus tout à fait sur la même longueur d'ondes, si tant est qu'elles l'aient jamais été. Mais cette fois-ci, des divisions inédites apparaissent dans leurs rangs. Elles remettent en question le trumpisme et ce, dans un milieu (celui de la finance) reconnu pour sa grande discrétion.
En effet, rappelons que voici peu de temps, des millionnaires ont dénoncé publiquement le groupe des multimilliardaires qui entourent Donald Trump. En substance, ils redoutent que le régime Trump ne tourne le dos à un capitalisme "libéral et démocratique" au profit d'un modèle plus autoritaire, à la russe ou à la chinoise. Ils jettent donc un regard critique sur la "révolution conservatrice" qui s'amorce sous l'administration Trump.
Il peut être intéressant tout d'abord d'examiner succinctement les membres de l'entourage Trump. Les fortunes qu'ils possèdent donnent le tournis :
1- Elon Musk (pressenti pour diriger le Département de l'efficacité gouvernementale), propriétaire de Tesla : 434 milliards. Il joue un rôle de proche conseiller de Trump.
2- Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon : 239 milliards.
3- Mark Zuckerberg, qui possède Meta : 212 milliards.
4- Sundar Pichai (google) : 63 milliards. Le "p'tit dernier", le "pauvre" du groupe. Pourquoi ne pas organiser une collecte en sa faveur ?
Passons maintenant à un niveau inférieur des capitalistes, celui des simples millionnaires Deux tiers de ceux-ci provenant de 22 pays (y compris des États-Unis) jugent que l'influence des ullrariches présentent une menace pour la stabilité mondiale. Ils appréhendent que cette concentration de richesse n'entraîne un nationalisme identitaire et que le capitalisme extrême ne rompe avec l'État de droit et la libre concurrence. 70% des millionnaires et même certains milliardaires appuient même une augmentation des impôts pour les multimilliardaires, et ils s'affirment prêts à faire leur part dans cet effort fiscal.
On peut en conclure, même avec toutes les nuances que cette affirmation nécessite, que la classe dirigeante financière mondiale se fragmente et que des capitalistes s'alarment de l'extrême concentration de la richesse aux mains de quelques-uns, sans doute par crainte de troubles sociaux et de la fragilisation du système économique qui a permis leur réussite.
En effet, le capitalisme libre-échangiste et mondialisé s'essouffle, vu les ravages sociaux qu'il a déjà causés et les déceptions qu'il a provoquées au sein des populations.
Il y a quelque chose d'ironique dans cette division qui se fait jour au sein des grands capitalistes financiers. Une frange d'entre eux estiment que le système va trop loin en mettant en lumière l'indécente richesse de la strate la plus élevée et l'influence politique qu'elle a conquise avec Donald Trump. Elle veut sauver le système en limitant ses abus les plus criants.
Cette montée de l'esprit critique peut rassurer jusqu'à un certain point, mais elle ne garantit nullement, du moins à court terme, un recul du trumpisme. Le "national-capitalisme" s'implantera-t-il durablement ou ne s'agit-il que d'un phénomène passager ? Chose certaine, même s'il devait s'affaiblir au fil des ans, il aura disposé du temps nécessaire pour infliger beaucoup de dégâts tant aux États-Unis mêmes qu'au Canada et au Québec.
À lire les dénonciations de millionnaires du trumpisme, il faut croire que la forme de capitalisme extrême et renfermé qui est sa marque de commerce ne convient pas à tout le monde, et pas seulement aux travailleurs.
Dans les manifs de protestation qui se produiront, verra-t-on quelques-uns de ces richards défiler dans la rue, pancartes à la main ?
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Conférence exceptionnelle à Paris pour souligner l’histoire du mois des noirs
« Ensemble, célébrons la richesse et la diversité des cultures noires, rendons hommage à leur histoire et inspirons les générations futures à poursuivre le chemin vers une société plus juste et inclusive » a déclaré le diplomate Maguet Delva en prélude des activités visant à célébrer le mois de l'histoire des noirs.
À l'occasion de la célébration du mois de l'histoire des Noirs, une conférence historique et culturelle se tiendra à Paris le 8 février 2025, mettant à l'honneur un sujet d'une portée universelle : « La Révolution Haïtienne et les Origines de la Diplomatie Haïtienne ».
Cet événement s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à reconnaître et célébrer les contributions des peuples noirs à l'histoire mondiale. La Révolution haïtienne (1791-1804), pierre angulaire de la lutte contre l'esclavage et pour l'émancipation, sera au cœur des discussions. En s'appuyant sur des faits historiques, cette conférence mettra en lumière l'impact de cet événement révolutionnaire sur les mouvements d'indépendance, ainsi que sur la création des premières stratégies diplomatiques haïtiennes.
Selon Maguet Delva, diplomate, journaliste et écrivain, l'un des initiateurs de cet événement, ce sera un moment de réflexion et de partage. Cette activité réunira des experts en histoire et relations internationales, des historiens spécialisés dans la révolution haïtienne, des chercheurs en diplomatie et droits des peuples comme Bourhis Mariotti, Jocelyn belfort doctorant, Patrick Cauvin.
Ces intervenants-es analyseront comment Haïti, en tant que première république noire indépendante, a joué un rôle central dans la reconfiguration des relations internationales à l'époque.Cet événement, accessible au grand public, permettra également de mieux comprendre les contributions majeures de la diaspora noire et de réfléchir à l'héritage culturel et politique de cette période fondatrice.
Voulant justifier le choix d'un tel sujet, Maguet Delva, l'une des figures emblématiques de la diplomatie haïtienne en France, a souligné que la révolution haïtienne est exceptionnelle parce qu'elle est la seule révolution d'esclaves ayant mené à la création d'un État indépendant.
La Révolution d'esclaves en Haïti souligne t-il nous enseigne que la justice et la liberté ne se négocient pas, même dans un contexte hostile. La diplomatie haïtienne a montré qu'un petit État pouvait jouer un rôle moral et stratégique dans un monde dominé par des grandes puissances. Aujourd'hui encore, Haïti reste un rappel que les droits humains et la souveraineté nationale sont des combats universels.
Cet acte de grandeur marque un tournant dans l'histoire en affirmant que la liberté et l'égalité ne sont pas des principes réservés à un seul groupe, mais des droits universels. Elle a non seulement mis fin à l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue, mais elle a aussi défié les grandes puissances esclavagistes de l'époque, comme la France, l'Angleterre, et l'Espagne.
Le diplomate haïtien, fondateur du Regroupement des Archives Diplomatiques et des Documentations de la République d'Haïti en France (RADRH) a rappelé pour dire que la diplomatie haïtienne a commencé à prendre forme dès la proclamation de l'indépendance en 1804. Jean-Jacques Dessalines, le premier chef d'État haïtien, comprenait que la survie d'Haïti en tant que nation indépendante dépendait de sa reconnaissance par les autres puissances. Cependant, les grandes nations esclavagistes, comme les États-Unis et les pays européens, étaient hostiles à l'idée d'un État dirigé par d'anciens esclaves. Cela a forcé donc Haïti à développer une diplomatie pragmatique et résiliente pour protéger sa souveraineté et s'intégrer dans le concert des nations.
La diplomatie haïtienne a posé les bases d'une solidarité entre les peuples opprimés. En soutenant les luttes pour l'indépendance en Amérique latine et en servant de refuge pour les esclaves en fuite, Haïti a prouvé son rôle en tant que symbole d'émancipation. Cependant, la dette de 1825 imposée par la France en échange d'une reconnaissance officielle a lourdement pesé sur l'économie haïtienne et limité son influence diplomatique à long terme. Malgré ces défis, Haïti est resté un exemple de résilience et de courage sur la scène internationale.
Cet événement annuel de grande envergure se veut être une opportunité unique d'éduquer, d'unir et de sensibiliser autour de l'histoire, de la culture et des luttes pour l'égalité et la justice sociale.Proposant un programme diversifié conçu pour inspirer et engager les communautés, cette journée n'est pas seulement un moment pour regarder en arrière, mais aussi une invitation à agir pour un avenir plus inclusif.
À rappeler que le mois de l'histoire des Noirs (Black History Month) est célébré chaque année en février en France, aux États-Unis et au Canada, et en octobre dans certains pays comme le Royaume-Uni. Cette célébration met en lumière les contributions, les réalisations, les cultures et l'histoire des communautés noires à travers le monde, tout en rappelant les luttes pour l'égalité et la justice.
Cette journée offre une opportunité précieuse de rendre hommage aux contributions, à la résilience et aux luttes des communautés noires à travers le monde. Pourtant, il reste un défi crucial : sensibiliser toutes les communautés à l'importance de cette commémoration et engager un dialogue collectif autour de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion.
De Martin Luther King à Aimé Césaire, de Rosa Parks à Nelson Mandela, ces personnalités ont façonné l'histoire mondiale et inspiré des générations. Mais cette célébration ne se limite pas à l'évocation des grands noms : elle permet également de reconnaître les contributions quotidiennes des membres de ces communautés dans divers domaines, tels que l'art, la science, l'économie et le sport.
Il est important de souligner que l'histoire des communautés noires est indissociable de l'histoire universelle. En sensibilisant les communautés à cette célébration, on contribue à bâtir un monde où la diversité est non seulement acceptée, mais célébrée comme une richesse inestimable. Chacun de nous a un rôle à jouer pour que cet héritage ne soit pas oublié, mais transmis avec fierté et respect.
Smith PRINVIL
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











