Derniers articles

Le trompe-l’œil de la politique migratoire dans l’État espagnol

Depuis des années, la politique migratoire est au centre des grands débats de nos sociétés. Il est vrai qu'elle a toujours été là, mais cela ne peut masquer la certitude que nous sommes à une époque où le débat migratoire s'impose largement sur des positions réactionnaires formulées en termes d'identité et d'exclusion.
6 février 2025 | Hebdo L'Anticapitaliste - 740
https://lanticapitaliste.org/opinions/international/le-trompe-loeil-de-la-politique-migratoire-dans-letat-espagnol
En Espagne, le débat prend une configuration spécifique. Le rôle de l'État espagnol dans la distribution internationale du travail limite ses fonctions à des tâches productives secondaires, à faible valeur ajoutée, qui requièrent une énorme quantité de main-d'œuvre peu qualifiée.
Vague réactionnaire et reflux politique
Cela devrait conduire à une position consistant à faciliter l'arrivée de la main-d'œuvre, mais cela est en contradiction avec au moins deux autres éléments sous-jacents. D'une part, la vague réactionnaire a fait croître les positions politiques sur ces questions, en plaçant la migration comme un phénomène à craindre et en criminalisant les migrantEs dans le cadre de la politique d'exclusion et de sécurité. D'autre part, il y a une contradiction : les classes populaires autochtones peuvent bénéficier d'une certaine ascension de classe au fur et à mesure que des emplois moins valorisés sont confiés à des migrantEs, mais elles peuvent aussi, pour cette même raison, avoir des attentes et être déçues par leur accès au travail.
À cela s'ajoute la démobilisation qui, au-delà des mouvements sectoriels, affecte la politique dans son ensemble dans l'État espagnol. Après la quasi-liquidation du cycle de mobilisation et de nouvelles formes politiques entre 2010 et 2020, la situation actuelle est celle d'un reflux, avec de petits signes de mobilisation qui annoncent une possible réarticulation politique des mouvements populaires, mais qui restent très peu actifs et en position de faiblesse évidente face aux forces de l'État.
Large soutien populaire pour la régularisation
C'est, en gros, le scénario dans lequel s'inscrivent les derniers mouvements autour de la question migratoire. La proposition de régularisation massive rassemble plusieurs ONG et associations dans le but de mettre en avant la demande de légalisation de la situation de milliers de personnes qui vivent et travaillent dans l'État espagnol dans une situation de précarité absolue. La campagne pour la régularisation1 est simple et a un objectif clair : elle estime qu'il y a environ un demi-million de personnes sans papiers dans notre société et demande leur régularisation par le biais d'un mécanisme législatif tout aussi simple. Ce qui est peut-être le plus significatif, c'est qu'elle a été rédigée et soutenue par un large éventail d'organisations qui, grâce à une argumentation simple, ont obtenu un large soutien populaire — plus de 600 000 signatures — et l'accord de tous les groupes politiques, à l'exception du parti d'extrême droite VOX. Toutefois, ce soutien est encore faible, étant donné que le seul le vote qui a eu lieu doit permettre son traitement au Congrès, lequel pourrait modifier ou rejeter la proposition.
Dans leur argumentation, les organisations mettent l'accent sur la nécessité politique et sociale de reconnaître légalement la situation des centaines de milliers de sans-papierEs qui vivent de fait dans l'État espagnol. Insister sur ce point est une sagesse incontestable, tout comme rappeler les diverses régularisations qui ont eu lieu dans différents pays européens. De cette manière, la discussion est placée au bon endroit, en soulignant que les migrantEs font partie de notre société et que leur régularisation doit venir, à la fois en raison de la légitimité qu'ils ont en tant que tels et en raison des nécessités de l'État lui-même.
Toutefois, il convient de noter que la campagne, par son nom même, « essentielEs », souligne la nécessité de régulariser ces personnes qui, bien qu'en situation irrégulière, exercent des fonctions d'assistance, de nettoyage ou de soins de santé de base, qui sont fondamentales pour la viabilité de la communauté. Ce raisonnement rend visible le rôle des migrantEs dans notre monde, mais il a un côté pervers, car il soutient l'instrumentalisation d'un groupe qui, pour beaucoup, n'est acceptable que s'il vient travailler.
Une apparente position progressiste du gouvernement
Les prochaines étapes se situent au niveau des groupes parlementaires : le Bureau du Congrès doit fixer une date pour le débat afin de discuter et d'approuver, de modifier ou de rejeter le texte. Sur le papier, il semble que l'option la plus facile soit que les partis soutenant le gouvernement introduisent des modifications pour réduire le champ d'application, en exigeant une durée de séjour minimale pour bénéficier de la régularisation ou en introduisant d'autres types de conditions. Cependant, il pourrait aussi le laisser mourir ou même choisir de le soutenir en bloc tel quel s'il apparaît que les votes contre seront majoritaires. Ainsi le gouvernement et ses partenaires maintiennent apparemment une position progressiste tout en blâmant la droite pour son rejet. En tout état de cause, le gouvernement ne semble pas du tout intéressé par une régularisation qui créerait des problèmes avec de nombreux partenaires européens et donnerait des armes à l'extrême droite, et il n'a pas non plus les éléments pour la faire passer en raison de sa faiblesse parlementaire.
D'autre part, le gouvernement a déjà réagi en dehors du Parlement, en modifiant le décret sur les étrangerEs2, qui facilite l'accès à la régularisation par « arraigo », la formule la plus courante pour obtenir des papiers. Le gouvernement estime que quelque 300 000 personnes bénéficieront de cette mesure ainsi que des modifications contenues dans le décret. Ce faisant, il mise sur l'activité gouvernementale et laisse de côté l'option de la régularisation massive. Il va sans dire que, dans ce cas, le lien avec le travail n'est pas seulement discursif, mais exécutif : seulEs celleux qui ont un emploi ou la possibilité immédiate d'en obtenir un sont régulariséEs, ce qui consolide l'instrumentalisation des migrantEs.
Bien entendu, il incombe à la gauche politique de progresser dans un domaine où, jusqu'à présent, elle n'a guère apporté plus que quelques slogans. Le vide politique est énorme et nécessite un travail en profondeur pour aider à articuler une réponse sociale, main dans la main avec les migrantEs, pour apporter une proposition sérieuse autour de la migration en tant que question politique brûlante, mais aussi pour élaborer, au-delà, une politique antiraciste systématique, remettant en question les frontières et abordant le droit de tous d'aspirer à une vie digne et sans racisme.
Juanjo Álvarez, militant d'Anticapitalistas
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Serbie : Premières victoires des mobilisations étudiantes

C'est vers Novi Sad, dans le nord de la Serbie qu'ont convergé le dimanche 2 février des dizaines de milliers de manifestantEs – dont une partie ont parcouru 80 km en venant de la capitale Belgrade à pied ou en vélo.
Hebdo L'Anticapitaliste - 740 (06/02/2025)
Par Catherine Samary
Crédit Photo
DR
C'est dans cette ville que s'est produit il y a trois mois l'effondrement de l'auvent en béton de la gare, qui venait d'être rénovée, tuant quinze personnes. Ce drame a catalysé une colère rampante contre le régime synthétisée par le slogan : « La corruption tue » (1).
Un auvent qui s'effondre à Novi Sad
Inaugurée en 1964 dans l'ancienne Yougoslavie socialiste, la gare de Novi Sad n'avait guère été entretenue après la fin du régime et de la fédération, au tournant des années 1990. Le trafic s'était effondré. En 2022, la gare bénéficia d'un coup de neuf quand Novi Sad avait été nommée « capitale européenne de la culture ». Le président serbe Aleksandar Vučić était alors venu, avec son ami le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, pour inaugurer la nouvelle rame à grande vitesse reliant la ville à Belgrade. La rénovation de la gare s'est poursuivie en 2023 et 2024 et elle a officiellement rouvert le 5 juillet dernier. Moins de quatre mois plus tard, le 1er novembre, l'auvent s'effondrait tuant sur le coup 14 personnes, une autre décédant à l'hôpital.
Des étudiantEs révoltéEs
Les étudiantEs de Novi Sad ont alors occupé leur université, faisant tache d'huile dans tout le pays, pour réclamer la transparence sur les travaux effectués, l'inculpation et la démission des responsables. Quelque trois mois après le drame, le souffle du mouvement de révolte mené par les étudiantEs ne retombe pas. Au total près de 60 établissements de l'Enseignement supérieur sont bloqués, dont toutes les facultés de l'université de Novi Sad, de Belgrade, de Niš et Kragujevac. Certaines facultés privées ont aussi rejoint le mouvement, ainsi qu'un bon nombre d'associations citoyennes et une partie des agriculteurs, notamment le collectif qui s'oppose à l'extraction du lithium par Rio Tinto (2), mais aussi des personnalités du théâtre et du cinéma ou encore des sportifs. Fin janvier, les étudiantEs ont appelé à une grève générale et à des défilés convergeant vers Novi Sad pour le 1er février, pour l'anniversaire du drame.
Les médias à la botte du régime ont accusé les étudiantEs d'être « dirigés par la CIA » et par « les politiciens de l'opposition ». En vérité, les étudiantEs se défient des partis, largement décrédibilisés.
Le président souffle le chaud et le froid
L'actuel président Aleksandar Vučić, qui dirige le parti de droite (mal) nommé Parti progressiste serbe (SNS), tend à cumuler de multiples pouvoirs. Il fut chef du gouvernement de Serbie entre 2014 et 2017, puis élu plusieurs fois président du pays depuis 2017. Il joue sur tous les tableaux géopolitiques (vers l'UE, qui lui fait les yeux doux, et la Russie) en étendant son contrôle sur tous les médias pour faciliter ses réélections successives. Face au mouvement étudiant, il a alterné menaces et tentatives d'apaisement. Pour calmer le jeu, il a reconnu sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d'un rassemblement « d'opposition », « exceptionnellement grand ». Il s'est dit « toujours prêt » à entendre « ce qu'ils ont à dire, car la paix et la stabilité sont les plus importants ». Le pouvoir a même tenté de mettre les lycéenNEs en vacances anticipées…
Mais rien n'y a fait, d'autant que les incidents et attaques physiques contre les manifestantEs se sont multipliés. Aux demandes de vérité et de sanctions concernant la tragédie du 1er novembre, se sont alors ajoutées les exigences de poursuite contre ceux qui avaient attaqué les étudiantEs et la démission du Premier ministre Miloš Vučević (maire de Novi Sad entre 2012 et 2022).
Démission du Premier ministre et ancien maire de Novi Sad
Le 28 janvier le mouvement a remporté plusieurs victoires. Après un long entretien avec le Président, et alors que des milliers d'étudiantEs bloquaient un important nœud routier de Belgrade, Miloš Vučević annonçait qu'il démissionnait, afin « d'éviter de nouvelles complications et de ne pas augmenter davantage les tensions dans la société ». Treize étudiantEs et professeurEs arrêtéEs pendant des manifestations ont été graciéEs, de nombreux documents relatifs à la rénovation de la gare ont été publiés. Et le pouvoir a assuré « garantir des crédits favorables pour l'achat d'appartements par les jeunes », histoire de les calmer…
Mais ces victoires du mouvement n'ont fait que stimuler l'ampleur des mobilisations vers Novi Sad le 2 février. Les manifestantEs demandent notamment la publication de tous les documents – dont les contrats passés avec une entreprise chinoise. « Nous sommes tous sous un auvent », « Nous voulons la justice, pas des pots-de-vin », disaient les pancartes d'un mouvement qui marquera la vie politique du pays.
Catherine Samary
1. Lire Courrier des Balkans, notamment https://www.courrierdesb…
2. Cf. Courrier des Balkans https://www.courrierdesb…
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Pentagone et la Maison-Blanche ouvrent leurs portes aux médias “favorables”

Alors que la Maison-Blanche ouvre ses portes aux créateurs de contenu, le Pentagone réorganise l'accès des médias “traditionnels” à ses locaux. La presse américaine analyse les mutations des relations entre les médias et le pouvoir après l'investiture de Donald Trump.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Karolyne Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, le 28 janvier 2025. Lors de son premier point de presse, elle a annoncé l'ouverture de la salle de presse présidentielle aux "nouveaux médias". Photo Roberto Schmitd/AFP.
Au Pentagone, le siège du ministère de la Défense américain, situé à l'écart du centre de Washington, le Correspondents' Corridor est un espace stratégique où “les journalistes ont leurs quartiers. Ils y disposent en permanence d'un accès à Internet, ainsi que d'un téléviseur et d'une petite cabine radio” pour capter des informations en temps réel, interpeller un porte-parole au détour d'un couloir ou saisir une déclaration à la volée, expliquent Kevin Baron, ancien vice-président de la Pentagon Press Association, laquelle représente l'ensemble des journalistes chargés de couvrir le ministère, et Price Floyd, qui a occupé le poste de ministre adjoint à la Défense pour les affaires publiques, dans une tribune publiée dans The Washington Post.
“Il est vraiment important que des journalistes chevronnés puissent arpenter chaque jour les couloirs du Pentagone pour les besoins de leur profession, en ayant la permission d'entrer dans les bureaux pour y obtenir des réponses à leurs questions”, insistent les cosignataires.
Mais, pour quatre grands médias américains, ce privilège va prendre fin. Le quotidien The New York Times, la chaîne NBC News, le diffuseur public américain National Public Radio (NPR) et le site Politico devront plier bagage. À partir du 14 février, leurs bureaux dans le Correspondents' Corridor seront occupés respectivement par le tabloïd conservateur New York Post, la chaîne pro-Trump One America News Network, le média ultraconservateur Breitbart News Network et le site HuffPost. Cette décision, communiquée par un mémo interne sans notification préalable aux médias concernés, intervient dans le cadre d'une nouvelle politique de “rotation annuelle des médias”, rapporte CNN.
Des médias “nettement favorables à Trump”
“Tout ce qui va changer pour eux, c'est qu'ils vont devoir abandonner leur espace de travail en présentiel dans le bâtiment pour permettre à de nouveaux médias de devenir à leur tour des membres résidents du corps de presse du Pentagone”, relativise Jonathan Ullyot, un haut responsable de la communication du ministère, cité par The Washington Post dans un autre article. Les médias concernés pourront donc toujours assister aux briefings et prétendre à des voyages officiels.
Selon CNN, aucune justification n'a été fournie quant aux critères d'attribution. Seule explication avancée par Jonathan Ullyot : l'instauration d'une rotation annuelle pour “permettre à davantage de médias d'avoir accès à l'espace limité du Correspondents' Corridor”. Concrètement, chaque année, une organisation de presse par catégorie (radio, télévision, presse papier et en ligne) devra céder sa place à un autre média.
Trois des nouveaux résidents, orientés à droite, sont considérés par CNN comme “des médias d'assez petite envergure et nettement favorables à Trump”. Seul média progressiste, le HuffPost détonne dans la sélection. Actuellement, il n'a pas de correspondant attitré au Pentagone.
L'orientation politique des nouveaux venus n'est pas le seul élément pointé du doigt. Breitbart News Network est ainsi censé remplacer NPR en tant que média radio, mais, comme le souligne CNN, “le mot ‘radio' n'apparaît même pas sur la page d'accueil du site”. L'organisation ne dispose que d'un podcast diffusé sur SiriusXM, une radio satellite, loin du vaste réseau national de NPR.
Place aux influenceurs et aux podcasteurs
Et le Pentagone n'est pas le seul à réorganiser ses relations avec les médias. La Maison-Blanche a annoncé l'ouverture de la salle de presse présidentielle aux “nouveaux médias”. Le 28 janvier, la porte-parole, Karoline Leavitt, a ainsi invité influenceurs, blogueurs, podcasteurs et créateurs de contenu à demander une accréditation, à condition qu'ils “produisent du contenu informationnel bien fondé”. Résultat : “C'est le débarquement des anneaux lumineux et trépieds pour smartphones à la Maison-Blanche !” décrit Fortune, média économique américain.
En moins de vingt-quatre heures, plus de 7 400 demandes ont été enregistrées, révèle le New York Post. Une tendance qui reflète l'évolution du paysage médiatique. Selon une étude du Pew Research Center relayée par Fortune, 17 % des Américains s'informent désormais sur TikTok, contre seulement 3 % en 2020. “Notre équipe doit faire passer le message du président Trump en tous lieux et nous devons adapter la Maison-Blanche au nouveau paysage médiatique de 2025. C'est capital !” affirme Karoline Leavitt, citée par The New York Times.
Cependant, Steven Buckley, spécialiste des médias numériques, estime, sur le site The Conversation, que cette mise en avant des influenceurs pourrait accentuer la défiance envers le journalisme, déjà importante. Seuls 31 % des Américains accordent encore une réelle confiance aux médias grand public, selon un sondage Gallup cité notamment par
Newsweek. “Si les influenceurs des réseaux sociaux ont tant d'importance aux yeux du président, souligne Steven Buckley, ce n'est pas seulement en raison de leur attitude favorable à son égard, mais surtout en raison de leur grande influence sur l'opinion publique.”
Aruzhan Yeraliyeva

Bernie Sanders redonne l’envie d’avoir envie

Le sénateur démocrate endosse le rôle de chef de file de la résistance au rouleau-compresseur Trump. Puissant et à la hauteur du moment, il appelle à la lutte, à ne pas baisser les bras et surtout, redonne du courage.
Une vidéo dont la traduction et le sous-titrage ont été assurés par Baptiste Orliange
5 février 2025 | tiré de regards.fr
https://regards.fr/bernie-sanders-redonne-lenvie-davoir-envie/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Face aux attaques brutales de Trump, la riposte reste à construire

En deux semaines, Donald Trump a violé la Constitution et enfreint la loi pour mettre en œuvre des mesures qui menacent des millions d'emplois et les programmes de santé, d'éducation et de protection sociale des personnes âgées, des enfants et des pauvres.
Hebdo L'Anticapitaliste - 740 (06/02/2025)
Par Dan La Botz
Bloqué à plusieurs reprises par les tribunaux, Trump a donné au milliardaire Musk, à la tête du DOGE (Département de l'efficacité du gouvernement), le pouvoir de prendre le contrôle des systèmes informatiques du gouvernement. Le président agit avec le soutien unanime du Parti républicain. Les Démocrates tergiversent et ne parviennent pas à s'opposer à lui.
Un e-coup d'État ?
Les actions de Trump sont ahurissantes. Il a d'abord tenté d'imposer un gel des dépenses pour toutes les subventions et prêts gouvernementaux, ce qui aurait affecté 20 millions d'enfants pour les repas scolaires, 2 millions de personnes âgées pour les repas à domicile, 79 millions de bénéficiaires de Medicare, 93 millions de bénéficiaires de Medicaid et de l'assurance maladie pour les enfants… Deux juges fédéraux ont bloqué Trump. Mais Musk et son équipe ont pris le contrôle des systèmes informatiques du département du Trésor et pourraient bloquer les paiements. S'agit-il d'une sorte d'e-coup d'État ?
Trump a envoyé à plus de deux millions d'employéEs du gouvernement fédéral le courriel « Fork in the Road » (« face, à une bifurcation, il faut se décider ») — une copie des courriels envoyés par Musk en novembre 2022 aux employésE de Twitter/X — leur disant qu'ils peuvent démissionner maintenant et continuer à travailler à domicile pour recevoir leur salaire et leurs avantages jusqu'au 30 septembre 2025. S'ils choisissent de ne pas démissionner, ils doivent retourner au bureau, mais n'ont aucune garantie de conserver leur emploi. Il suffit de répondre à l'e-mail avec le mot « Démission ». Selon le nombre de démissions, un dépeuplement de plusieurs agences gouvernementales est possible.
Hausse des droits de douane
Trump a l'intention de lancer une guerre commerciale contre le Mexique, le Canada et la Chine, en imposant des droits de douane de 25 % sur les produits en provenance du Mexique et du Canada, et des droits de douane supplémentaires de 10 % sur la Chine. Il s'agit des trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Justin Trudeau et Claudia Sheinbaum ont déjà annoncé que leurs pays riposteraient. Compte tenu de l'intégration de la production industrielle nord-américaine, ces droits de douane pourraient, par exemple, entraîner la fermeture d'usines automobiles au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les droits de douane rendront plus coûteuse l'importation de bois d'œuvre pour la construction américaine.
Choc et sidération
Trump a commencé à rassembler et à expulser les immigrantEs sans papiers à l'aide d'avions militaires, quelques centaines seulement jusqu'à présent, mais il promet de les expulser tous. Il estime leur nombre à 20 millions alors que les experts en dénombrent 11 millions. De nombreux immigréEs craignent désormais d'aller au travail, à l'école, à l'hôpital, à l'église ou au temple.
Tout cela fait partie de l'objectif de Trump : réduire la taille, le pouvoir et le coût du gouvernement fédéral et surtout mettre fin à l'État-providence.
Trump a renvoyé 17 inspecteurs généraux dont le travail est de mettre un terme à la fraude, aux abus et à la corruption, de sorte qu'il n'y a guère d'opposition efficace au sein de la bureaucratie. Jusqu'à présent, l'opposition politique a utilisé les tribunaux pour tenter de bloquer Trump, avec un certain succès, mais les affaires judiciaires seront pour finir soumises à la Cour suprême conservatrice qui a eu tendance à soutenir Trump.
Les Démocrates n'ont pas réussi à parler d'une voix unifiée et claire, ni à ralentir l'assaut de Trump. Les Démocrates progressistes ont appelé le parti à réaffirmer sa prétention historique à représenter la classe ouvrière. Mais le parti vient d'élire comme président Ken Martin, qui est un apparatchik modéré.
L'attaque de Trump a été si rapide, si profonde et si intense qu'il n'y a pas encore de réponse massive de la base. Les syndicats, les organisations noires et latinos, les groupes de femmes, les groupes LGBT et la gauche discutent et planifient, mais n'ont pas encore de stratégie.
Dan La Botz, traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump, la répression anti-migratoire et les profits de la peur

Selon le philosophe Alberto Toscano, auteur notamment de Late Fascism (« Le fascisme tardif », qui paraîtra bientôt en français aux éditions de la Tempête), les plans d'expulsion massive de Trump s'inscrivent dans une histoire longue de guerre politique et juridique contre les migrant·es.
21 janvier 2025 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/profits-peur-trump-immigration-racisme/
***
« Ils n'ont encore rien vu. Attendez 2025. » C'est ce qu'a déclaré Tom Homan, le « tsar des frontières » récemment nommé par Donald Trump, lors de la conférence du National Conservatism en juillet dernier, où Tom Homan a annoncé que, si Trump revenait à la Maison-Blanche, il dirigerait « la plus grande force de déportation que ce pays ait jamais vue ».
Quelques mois plus tôt, Stephen Miller, le futur chef de cabinet adjoint de Trump et principal agitateur anti-migrants, avait exposé sa propre vision sombre de la « répression migratoire la plus spectaculaire » : faire appel à l'ensemble des pouvoirs fédéraux pour une campagne de déportation massive qui écraserait les avocats spécialisés dans les droits des immigrants et tous les efforts visant à protéger les travailleurs sans papiers de la surveillance, de l'incarcération et de l'expulsion.
Aujourd'hui, à moins de quelques jours de l'investiture de Trump, les menaces à l'encontre des responsables municipaux ou étatiques désireux d'offrir un « sanctuaire » sont devenues plus explicites, comme lorsque Tom Homan a récemment promis de poursuivre le maire de Chicago, Brandon Johnson, s'il continuait à « héberger et dissimuler » des demandeurs d'asile.
Les plans de déportation massive de Trump sont alarmants, mais ils sont aussi une récapitulation consciente (bien qu'accélérée) de la longue histoire de racisme d'État anti-migrants des États-Unis, ainsi que le produit d'un système très rentable de détention et de surveillance soutenu par les administrations successives des deux grands partis. La principale fonction de l'expulsion dans les économies capitalistes qui dépendent de la main-d'œuvre immigrée et sans papiers n'est pas d'expulser ces travailleurs, mais de les subordonner.
Qu'elles prennent ou non la forme « spectaculaire » recherchée par Miller, elles rapporteront des dividendes de multiples façons : elles permettront aux prisons privées et autres entreprises carcérales chargées de gérer la répression à venir de continuer à faire des bénéfices, tout en permettant à Trump de tirer un profit politique de l'affirmation selon laquelle les migrants sont les premiers coupables du « carnage américain ». Cette stratégie ne connaît aucune limite morale ou factuelle, comme l'a montré la réponse de MAGA aux récentes violences à la Nouvelle-Orléans et à Las Vegas – déclarant « Nous devons sécuriser cette frontière » alors même que les deux attaques ont été perpétrées par des citoyens étatsuniens nés aux USA et ayant un long passé militaire.
Pour contester la violente désignation des migrants comme boucs émissaires qui s'annonce, il faudra se mobiliser contre la prétention de l'administration Trump à être le champion du « travailleur américain »…
150 ans de guerre juridique contre les migrants
La rhétorique qui entoure la politique phare du mouvement MAGA ressemble à une compilation des plus grands succès de 150 ans de lutte contre les migrants via des lois nativistes. Les diatribes sinophobes de Trump contre le fentanyl chinois franchissant la frontière rappellent que les travailleurs chinois ont été la première cible des lois répressives et racistes sur l'immigration aux États-Unis, à commencer par la loi Page de 1875, ainsi que d'un mouvement ouvrier nativiste qui s'est battu pour que la main-d'œuvre reste blanche.
Mais ce n'est que le début. En 2015, Donald Trump a invoqué la tristement célèbre « opération Wetback » menée par Dwight Eisenhower en 1954 comme un possible modèle à suivre pour sa propre administration. Les mensonges que Trump et le vice-président élu JD Vance ont répandus cet automne sur les immigrés haïtiens de Springfield, dans l'Ohio, montrent à quel point le racisme anti-Noirs et anti-Latinos a joué un rôle crucial, depuis le « boatlift » des immigrés cubains et haïtiens de Mariel en 1980, dans la présentation de la migration comme une crise de la sécurité nationale.
La promesse du programme des Républicains pour 2024 de « déporter les gauchistes pro-Hamas » des campus universitaires nous rappelle à quel point les politiques anti-migrants ont souvent été liées à des paniques politiques concernant les subversifs étrangers, depuis la loi McCarran-Walter de 1952, qui classait les communistes et les anarchistes dans la catégorie des « étrangers expulsables, jusqu'à la Loi sur les Ennemis Étrangers de 1798 (Alien Ennemies Act 1798, utilisée pour justifier l'internement massif des Étatsuniens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale (et maintenant également citée par Trump et ses acolytes comme un moyen de contourner les obstacles juridiques à l'arrestation de millions d'immigrants sans papiers).
Aujourd'hui, le Congrès est sur le point d'adopter la loi Laken Riley, avec un soutien considérable des démocrates, qui élargit encore la détention obligatoire, y compris pour les immigrés en situation régulière, sous le prétexte d'une vague inexistante de « criminalité immigrée ».
Si l'idéologie xénophobe de MAGA n'a guère innové par rapport à ses prédécesseurs – se distinguant principalement par sa grossièreté sans fard – ses efforts pour transformer le racisme nativiste en une plateforme politique centrale trouvent également des précédents dans l'histoire récente de la loi sur l'immigration et de son application.
L'administration de Bill Clinton, et en particulier son soutien à des projets de loi tels que la Loi sur la Réforme de l'Immigration Illégale et la Responsabilité des Immigrés (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act), qui criminalisent l'immigration, ont marqué un tournant pour la « machine à expulser » des États-Unis. Comme l'a fait valoir Silky Shah, directrice exécutive de Detention Watch Network, le tournant punitif des années Clinton a facilité la fusion de l'application des lois sur l'immigration et du complexe industriel carcéral en un seul et même paysage carcéral.
C'est en 2014, sous la présidence de Barack Obama – surnommé le « déporteur en chef » bien avant l'entrée en fonction de Trump – que le même Tom Homan, alors haut responsable de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), a commencé à promouvoir l'idée de recourir à la « séparation des familles » pour décourager l'immigration. Bien que Obama ait hésité à mettre en œuvre cette idée, il a néanmoins honoré Homan en lui décernant le Presidential Rank Award l'année suivante. Comme le note Silky Shah, le travail de l'administration Obama pour relier le système de détention/déportation aux forces de l'ordre « s'est étendu et a mis en place une puissante machinerie » que Trump exploitera plus tard.
Profit privé, propagande publique
La privatisation a constitué une dimension importante de ces systèmes imbriqués. Sous le couvert de « réformes » bienveillantes, l'administration Obama a supervisé à la fois l'augmentation des poursuites fédérales pour des délits d'immigration tels que la réadmission illégale et le recours accru à des prisons privées et à des « alternatives à la détention » pour les migrants, y compris diverses formes de surveillance et d'« e-carceration ».L'industrie des prisons privées, qui a déjà vu ses actions dopées par la nouvelle de la victoire électorale de Trump, s'attend à une manne sous sa seconde administration.
Pour sa part, et jusqu'à ses derniers jours, l'administration Biden a prolongé des contrats lucratifs avec les sociétés qui gèrent les installations privées où sont entreposés la majorité des migrants sans papiers détenus – plus de des détenus de l'ICE se trouvaient dans des centres de détention privés en juillet 2023 – malgré des cas documentés de « négligence médicale, de décès évitables, d'utilisation punitive de l'isolement cellulaire, d'absence de procédure régulière et de traitement discriminatoire et raciste », comme l'a rapporté The Guardian. Même les centres de détention dont le bureau de l'Inspecteur Général du ministère de la Sécurité Intérieure (Department of Homeland Security) a explicitement demandé la fermeture restent ouverts.
Les groupes de défense des droits humains ont protesté contre les brutalités résultant de la dépendance de l'administration Biden à l'égard de l'industrie de la détention, qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui est dirigée par des sociétés telles que GEO Group (anciennement Wackenhut) et CoreCivic (anciennement Corrections Corporation of America). Entre-temps, comme l'a rapporté The Lever, des sociétés de capital-investissement ont réalisé des investissements considérables dans les centres de détention fédéraux pour immigrés, « ce qui signifie que des intérêts de Wall Street opaques, non tenus de rendre des comptes et qui font des profits sont prêts à gagner des centaines de millions de dollars en détenant et en surveillant les immigrés du pays ».
L'industrie pénitentiaire privée, qui a déjà vu ses actions dopées par la nouvelle de la victoire électorale de Trump, s'attend maintenant à une manne sous sa deuxième administration. Comme l'a déclaré le président exécutif de GEO Group lors d'une conférence téléphonique sur les résultats après l'élection : « Nous nous attendons à ce que la future administration Trump adopte une approche beaucoup plus agressive en ce qui concerne la sécurité des frontières ainsi que l'application de la loi à l'intérieur du pays, et qu'elle demande au Congrès des fonds supplémentaires pour atteindre ces objectifs. » Cette agressivité accrue à l'égard des migrants se traduit directement par une augmentation des revenus pour GEO et ses semblables.
Le profit à tirer de la punition racialisée des sans-papiers ne s'arrête pas à la détention et à l'expulsion, mais comprend également le contrôle et la surveillance électroniques des migrants. Le Programme de Surveillance Intensive de l'ICE (Intensive Supervision Appearance Program) comprend des chevillières, des « montres » de surveillance et des applications pour smartphone à reconnaissance faciale, qui font toutes l'objet, avec l'extraction de données, de contrats lucratifs avec le gouvernement.
Compte tenu d'un certain scepticisme quant à la capacité de l'administration Trump à mettre en œuvre tous ses plans draconiens – Evan Benz, avocat au Centre Amica pour les droits des immigrés, note qu' il n'y a « aucun moyen rentable ou pratique pour l'ICE de détenir et d'expulser légalement les plus de trois millions de migrants inscrits au registre des personnes non détenues, malgré ce dont Trump et ses sbires fascistes peuvent rêver pour l'année prochaine » – même un échec de la campagne de déportation massive s'avérerait toujours rentable pour les intérêts des prisons privées, tout en répandant la misère et la terreur parmi les migrants.
Une économie de la peur
Regarder la machine de détention et d'expulsion que Trump et son cabinet de bigots fortunés sont en train de mettre en marche, c'est contempler toute une économie politique de la peur et de la punition, générant des profits privés à partir du carburant de la propagande démagogique, tout en récoltant les bénéfices psychologiques du nativisme en remplissant les coffres des entreprises.
Pour les travailleurs immigrés, la peur a toujours été un facteur économique : elle les contraint à accepter des emplois moins bien rémunérés, entrave la syndicalisation et permet à des employeurs despotiques d'agir. Comme l'explique Nicholas De Genova, chercheur spécialiste en études migratoires (dont on pourra lire cet article sur Contretemps), la principale fonction de l'expulsion dans les économies capitalistes qui dépendent de la main-d'œuvre immigrée et sans papiers n'est pas d'expulser ces travailleurs, mais de les subordonner, en rendant leur main-d'œuvre bon marché et contrôlable du fait qu'ils sont expulsables.
Homan lui-même a demandé ‘l'extension des visas temporaires pour les travailleurs saisonniers aux travailleurs migrants travaillant toute l'année dans l'industrie laitière, qui dépend tellement des travailleurs sans-papiers que leur absence doublerait le prix du lait. Lorsqu'ils ne sont pas montrés du doigt comme des menaces pour la sécurité nationale, les travailleurs sans papiers sont réduits à des facteurs de production, moins importants que les animaux dont ils s'occupent et les marchandises qu'ils produisent.
Il est clair que la cible principale des plans de déportation massive de Trump n'est pas la « criminalité des migrants », mais cette vaste partie de la classe travailleuse étatsunienne composée de travailleurs sans papiers et de tous ceux et toutes celles qui tombent sous l'ombre redoutable de l'expulsabilité – notamment les étudiants activistes qui se mobilisent contre le génocide. La défense de la vie des migrants n'est donc pas seulement une priorité de tout mouvement pour la justice sociale, mais aussi une lutte politique et syndicale. Pour que cette lutte prenne de l'ampleur, il sera nécessaire de briser l'équation réactionnaire de la classe travailleuse avec la blancheur et la citoyenneté nationale, qui perdure depuis la fin du. XIXème siècle.
En 2018, des milliers de personnes se sont mobilisées contre le programme de séparation des familles de l'ICE – y compris des politiciens démocrates comme Kamala Harris, qui a ensuite adopté un message de « fermeté à l'égard de l'immigration ». Dans un développement prometteur, Liz Shuler, présidente de l'AFL-CIO, a déclaré récemment que la lutte contre les raids sur les lieux de travail et les déportations massives était une « priorité absolue » pour le mouvement ouvrier. Pour contrer l'attaque de Trump contre les migrants, il faudra que le mouvement, au centre duquel se trouvent les travailleurs migrants, aille au-delà des préoccupations humanitaires et s'attelle à la tâche ardue mais nécessaire de démanteler la machine à expulser.
*
ALBERTO TOSCANO enseigne à la School of Communications de l'Université Simon Fraser et codirige le Centre for Philosophy and Critical Theory de Goldsmiths, Université de Londres. Il a récemment publié Late Fascism : Race, Capitalism and the Politics of Crisis (Verso), Terms of Disorder : Keywords for an Interregnum (Seagull) et Fanaticism : On the Uses of an Idea (Verso, 2010 ; 2017, 2e éd.). Il a également traduit les travaux d'Antonio Negri, d'Alain Badiou, de Franco Fortini et de Furio Jesi.
Publié sur le site In These Times. Traduit de l'anglais pour Contretemps par Christian Dubucq.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

États-Unis : Défendons les immigré·es !

Le futur président Donald J. Trump a appelé au « plus grand programme de déportation de l'histoire américaine ». Il s'agit d'une crise sur plusieurs fronts pour des millions d'immigré·s et leurs familles, d'autant plus que Trump a élargi la catégorie des personnes « expulsables ». Il a même menacé de passer outre la Constitution américaine et de mettre fin à la citoyenneté de naissance, qui a été ajoutée à la Constitution après l'abolition de l'esclavage.
Tiré de Inprecor
28 janvier 2025
Par Dianne Feeley
El Gran Paro Americano (la grande grève américaine), Los Angeles, le 1er mai 2006, lorsque plus d'un million d'immigrant·es et leurs sympathisant·es ont protesté contre un projet de loi anti-immigrants au Congrès. De grandes manifestations ont eu lieu à Chicago, New York, Houston et dans de nombreuses autres villes. Le projet de loi n'a pas abouti. Photo par Jonathan McIntosh - Travail personnel, CC BY 2.5, Lien.
Trump diabolise les immigrant·es, affirmant qu'ils empoisonnent, volent, assassinent et prennent les ressources des citoyens. Si les immigrant·es ont quitté leur pays pour diverses raisons, les récits révèlent le désespoir de ceux qui fuient la guerre, la violence, la pauvreté et les catastrophes climatiques.
De nombreux·ses Américain·es pensent que les immigré·es sans papiers devraient être expulsé·es parce qu'ils se sont faufilés hors de la file d'attente pour demander l'asile. Mais il n'y a pas de file d'attente ordonnée ! Le système est cassé, délibérément.
D'autres peuvent être gêné·es par le fait que le pays se diversifie de plus en plus. En 1965, moins de 5 % de la population était née en dehors des États-Unis, contre 15 % aujourd'hui. En outre, près de 90 % des immigrant·es proviennent de pays non européens. Ce pays a eu des frontières ouvertes pendant la majeure partie de son histoire, mais lorsque des Chinois ont été recrutés pour construire le chemin de fer transcontinental, des lois d'exclusion ont été mises en place.
Revendiquant un mandat, l'administration Trump mettra en œuvre une politique anti-immigration sévère dès le premier jour. Bien que les nouveaux responsables n'aient pas fixé d'objectif quant au nombre de personnes qu'ils prévoient d'expulser au cours de la première année, Stephen Miller, le chef de cabinet adjoint de Trump chargé de la politique, parle avec fermeté de fermer la frontière et de procéder à des déportations massives. Cela ne peut se faire qu'en annulant les différentes catégories dans lesquelles la plupart des immigré·es sans papiers bénéficient d'une protection minimale.
Trump utilisera également le commerce comme monnaie d'échange. Sa menace d'imposer des droits de douane de 25 % sur les produits mexicains et canadiens est sa première tentative pour effrayer les autorités canadiennes et mexicaines et les forcer à patrouiller à leur frontière avec les États-Unis. Un mois avant l'investiture de Trump, le gouvernement canadien a proposé 1,3 milliard de dollars canadiens (913,05 millions de dollars) pour renforcer la sécurité à la frontière, afin de se prémunir contre l'augmentation des droits de douane proposée. (Alors qu'un million de personnes tentent de franchir la frontière sud chaque année, moins de 20 000 franchissent la frontière nord). Pourtant, M. Trump continue d'exacerber la rhétorique en demandant que le Canada devienne le 51e État.
Aujourd'hui, sur les plus de 40 millions de résidents qui ont immigré aux États-Unis, environ 11 millions sont sans papiers. Sur ces 11 millions, près de 90 % travaillent, ce qui représente près de 5 % de la main-d'œuvre totale. De nombreux employeurs et secteurs d'activité cherchent déjà des « solutions de contournement » pour leurs employés, mais il existe un risque évident de lier les immigrant·es à un employeur spécifique.
Et malgré tous les discours sur la fermeture des frontières, deux tiers des 11 millions sont arrivés avec un visa d'étudiant, de travail ou de touriste et ont dépassé la durée de leur séjour.
L'héritage Biden
Alors que Trump a dénoncé le bilan de Biden en matière d'expulsions, la réalité est que Biden a expulsé plus de personnes chaque année de sa présidence que Trump. Au cours du premier mandat de Trump, environ 1,2 million de personnes ont été rapatriées.
Au début de la pandémie de grippe aviaire, Trump a ressuscité le titre 42 pour des raisons de santé, mettant fin à toute possibilité d'asile. Cet ordre général a été en vigueur de mars 2020 à mai 2023, chevauchant les administrations Trump-Biden. En fait, sur les 4 677 540 rapatriés sous Biden, 2 754 120 étaient en réalité exclus en vertu du Titre 42. Néanmoins, c'est Obama qui détient le titre de « Déporteur en chef » pour avoir déporté près de trois millions de personnes au cours de son premier mandat et près de deux millions au cours de son second mandat, pour un total d'un peu moins de cinq millions au cours de ses huit années de mandat.
Alors que l'administration Obama s'est concentrée sur l'expulsion des immigrants qui avaient été condamnés pour un crime, Trump a élargi le champ d'action à tous les immigrants sans papiers. Actuellement, environ 40 000 immigrant·es sont en détention, dont près de 80 % sont hébergés dans des prisons privées (principalement au Texas, dans le Mississippi ou en Californie). Thomas Homan, nommé par Trump pour être en charge de la sécurité des frontières, explique que l'administration commencera par déporter les « criminels ». En réalité, selon des chiffres récents, pas plus de 20 à 33% des personnes déportées sont condamnées pour un quelconque crime.
Si, sur le papier, la politique américaine professe des valeurs humanitaires, la nécessité de réunir les familles et encourage l'emploi, le système d'immigration n'a pas été mis à jour pour faire face à la nouvelle réalité des réfugié·es. Voici un aperçu de certaines de ces réalités.
Environ 1,6 million de demandeur·ses d'asile attendent que leur dossier soit examiné. Le temps d'attente moyen est de 4,3 ans. En vertu du droit international, l'asile devrait être accordé à ceux qui craignent de subir un préjudice crédible de la part de l'État s'ils sont renvoyés dans leur pays, mais le gouvernement américain rejette la plupart des demandes d'asile. En 2020, par exemple, l'administration Trump n'en a approuvé que 15 000.
Trois à quatre millions d'autres immigrant·es sont également en attente d'une audience. Lorsque les services de l'immigration et des douanes (ICE) jugent que ces personnes sont en sécurité, ils les remettent à leur famille ou les obligent à s'inscrire à des programmes de surveillance. Développés par l'industrie pénitentiaire privée, ces programmes comprennent les SmartLINKS et les moniteurs de cheville et de poignet.
Au moins 700 000 citoyen·nes de 17 pays différents ayant connu des guerres ou des catastrophes environnementales ont obtenu un statut de protection temporaire (TPS). Ce statut, d'une durée de six à dix-huit mois, est souvent renouvelé. Les demandeurs bénéficiant du TPS reçoivent un permis de travail et sont protégés contre l'expulsion. Si le secrétaire à la sécurité intérieure décide de ne pas renouveler le TPS pour un pays donné, les personnes concernées retrouvent leur statut antérieur. Quatorze des 17 pays devaient faire l'objet d'un renouvellement en 2025, mais M. Biden a reporté la date limite à 2026. Trump a qualifié plusieurs de ces pays, dont Haïti, de « pays de merde ».
Environ 530 000 jeunes sans-papiers qui sont arrivé·es aux États-Unis lorsqu'ils ou elles étaient enfants ont bénéficié d'une protection temporaire dans le cadre du programme DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, Action différée pour les arrivées d'enfants). Cette politique a été mise en œuvre par l'administration Obama en juin 2012 après plusieurs sit-in et manifestations impressionnants de jeunes immigrés. Comme le TPS, elle fournit une autorisation de travail et protège les bénéficiaires de l'expulsion. Pourtant, les bénéficiaires du DACA n'ont pas de statut légal ni de voie d'accès à la citoyenneté. En fait, il y a jusqu'à trois millions de « Dreamers » qui n'ont pas déposé de demande alors que le DACA acceptait encore des candidats. Bien que ce programme soit populaire auprès d'une majorité d'Américains, il pourrait être supprimé par une décision de la Cour suprême ou par Trump.
Déjà 1,3 million de personnes ont reçu des mesures d'éloignement, mais leur pays n'a pas accepté leur retour. L'équipe de Trump s'efforce de trouver des pays tiers disposés à les accueillir.
Le plan de l'administration entrante ciblera probablement les hommes immigrés - de préférence célibataires - dans les villes où ils peuvent être arrêtés et expulsés : Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphie et Washington. L'objectif est de les expulser rapidement avant qu'ils ne puissent faire l'objet d'une action en justice. En 2013, l'ACLU a rapporté que 83 % des personnes expulsées n'avaient pas vu leur affaire entendue par un juge.
Mais même si l'administration Trump ne peut pas expulser toutes les personnes arrêtées, le gouvernement pourrait les retenir en développant rapidement le « soft housing » : Un ancien fonctionnaire a déclaré qu'ils pourraient préparer 25 grands magasins fermés avec des lits de camp, des Port-a-Potties et un approvisionnement alimentaire de base dans les 90 jours. Le gouvernement du Texas a déjà offert 70 terrains de football pour ce type d'hébergement.
Un autre problème auquel se heurte un plan d'expulsion gouvernemental est que les 4,6 millions d'immigrés sans papiers vivent dans des familles à « statut mixte ». Comme certains de leurs membres sont citoyens américains, ces familles ont plus de chances de contester l'expulsion. Une étude portant sur les communautés ayant subi des perquisitions massives sur leur lieu de travail a révélé un traumatisme important au sein de la communauté. Mais la réponse de Tom Homan à une question de CBS News sur la possibilité de procéder à des expulsions massives sans séparer les familles a été froide : « Les familles peuvent être expulsées ensemble ».
Le Conseil américain de l'immigration a estimé que « l'arrestation, la détention, le traitement et l'expulsion d'un million de personnes par an » coûterait 88 milliards de dollars par an. Le Conseil conclut également que les déportations massives réduiraient le PIB américain de 4,2 à 6,8 %, soit de 1,1 à 1,7 billion de dollars (en dollars de 2022) par an. (Le comité éditorial du New York Times a publié un long article soulignant que l'économie américaine a besoin de 1,6 million d'immigrant·es par an pour maintenir sa croissance économique. Il concentre ses suggestions sur un processus ordonné par lequel le monde fournirait aux États-Unis ses membres les plus jeunes et les plus résistants. Les rédacteurs du Times sont commencé l'article en appelant à un renforcement de la « sécurité » aux frontières).
D'après ce que nous savons des précédentes déportations massives dans les années 1930 et 1950, certains immigrant·es se sentiront si peu sûrs d'eux qu'ils s'expulseront d'eux-mêmes. Le Conseil américain de l'immigration estime que l'auto-déportation représente environ 20 % du total, mais je pense que le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé - plus proche de 75 %. Une grande partie de la rhétorique de Trump à l'encontre des immigrés pourrait viser à les effrayer pour qu'ils partent.
La menace
Voici quelques-uns des moyens utilisés par le projet 2025 pour mettre en place un plan de déportation :
• La mise en place d'une machine à expulser à l'échelle nationale : Le projet prévoit d'autoriser l'ICE à recourir à l'« expulsion accélérée » contre les immigré·es trouvé·es n'importe où dans le pays. Outre les descentes sur les lieux de travail, il permettrait des descentes dans les écoles, les hôpitaux et les institutions religieuses. L'administration tentera d'utiliser l'Alien Enemy Act de 1798 pour mener à bien son projet, une absurdité puisque les États-Unis ne sont en guerre avec aucun autre pays et qu'il n'y a donc pas d'« étrangers ennemis ». Trump a également laissé entendre qu'il pourrait déclarer une urgence nationale.
• Militarisation des frontières : Le projet 2025 prévoit « l'utilisation de personnel et de matériel militaires » pour empêcher les passages aux frontières. Cela signifie davantage de surveillance et de murs. (Pour 2025, l'ICE dispose d'un budget de 350 millions de dollars, soit 30 millions de plus que l'année précédente. Mais ce budget est insuffisant pour le projet de Trump).
• L'expansion des centres de « détention » des immigrant·es : Le projet prévoit de plus que doubler le nombre d'immigré·es détenu·es alors qu'ils/elles sont menacé·ees d'expulsion. Actuellement, environ 50 000 d'entre eux et elles sont emprisonné·es, la plupart dans des centres privés, d'autres dans des prisons.
• Élimination de programmes : tels que les Programmes de Statut de Protection Temporaire pour les personnes venant de pays où il y a une catastrophe naturelle ou un conflit armé. Établi par le Congrès en 1990, il légalise actuellement le statut de personnes originaires de 16 pays différents pour une période de temps spécifique et renouvelable.
Les groupes les plus importants sont les suivants : 350 000 Vénézuélien·nes, 200 000 Haïtien·nes et 175 000 Ukrainien·nes. Ces personnes ont un statut légal et peuvent travailler tant que le programme est renouvelé. Trump a tenté de se débarrasser du programme au cours de son premier mandat, mais il en a été empêché par une action en justice de l'ACLU. Il ne fait aucun doute qu'il essaiera à nouveau. Le programme DACA pourrait être une autre cible. D'autres programmes pourraient être renforcés, comme les visas H-B1 qui permettent l'entrée de travailleurs étrangers qualifiés, les visas H-B2 qui couvrent les travailleurs à bas salaire, en particulier les travailleurs agricoles et les travailleurs de l'industrie hôtelière (tels que ceux utilisés par les entreprises Trump), ou les visas de regroupement familial. Des factions des partisans MAGA de Trump se disputent le programme HB-1.
• Rendre obligatoires les programmes de vérification du travail : Le projet 2025 étendrait E-Verify, un système mal organisé destiné à prouver que les employés ont le droit de travailler aux États-Unis. Les secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'hôtellerie dépendent de la main-d'œuvre immigrée et cherchent déjà des exceptions pour pouvoir continuer à fonctionner.
• L'enchevêtrement des contrôles locaux et fédéraux : Le projet 2025 appelle à l'extension de la participation des polices locales et d'État à l'application des lois fédérales sur l'immigration. Ceux qui s'y refusent risquent de se voir refuser tout financement fédéral, y compris pour les écoles qui enregistrent et éduquent les enfants d'immigrés. Les villes, comtés et États « sanctuaires » qui coopèrent peu avec l'ICE seront sans aucun doute visés.
Que pouvons-nous faire ?
Il existe un certain nombre d'organisations et de syndicats dans tout le pays qui œuvrent depuis des années pour la justice envers les immigré·es. Les socialistes peuvent contribuer à la mise en place de campagnes de soutien à celles et ceux qui ont fui leur pays à cause de la guerre, de la violence - notamment sexuelle -, du manque de travail ou des ravages du changement climatique.
En particulier depuis que la communauté immigrée s'est mobilisée pour rejeter le projet de loi Sensenbrenner, entre 2006 et 2008, les syndicats soutiennent de plus en plus les droits des immigré·es. Les syndicats qui comptent un nombre important de travailleur·ses immigré·es sont notamment SEIU, HERE et UE, et ils ont aidé l'AFL-CIO à les soutenir également. Comme l'a fait remarquer Liz Shuler, présidente de l'AFL-CIO, « Un·e immigré·e ne s'interpose pas entre vous et un bon emploi, c'est un milliardaire qui le fait. C'est un milliardaire qui le fait ».
Les délégations syndicales au Congrès ont insisté sur le fait que la frontière est une distraction par rapport aux problèmes du lieu de travail. Elles soulignent que tous les travailleurs, quel que soit leur statut en matière d'immigration, devraient avoir accès à la pleine protection des lois sur le travail et l'emploi. C'est l'absence d'une telle protection qui crée une « économie souterraine », source d'exploitation et de conditions de travail dangereuses pour ceux qui n'ont pas de statut légal.
Voici quelques suggestions sur la manière dont nous pouvons protéger les personnes sans statut légal :
Les campagnes doivent indiquer clairement aux fonctionnaires que nous nous opposons à ce que les gouvernements locaux et nationaux collaborent avec les autorités fédérales pour mettre en œuvre leurs plans d'expulsion.
Nous devons soulever l'injustice du système d'immigration, qui est conçu pour « échouer », dans nos syndicats et nos organisations communautaires. Cela signifie des discussions individuelles, en soulevant la question de manière concrète lors de réunions et de conférences.
Début janvier, Labor Notes a organisé une réunion en ligne pour les syndicalistes, à laquelle ont participé plus de 200 personnes. Un article citait cinq façons d'aider les membres et incluait le guide du National Immigration Law Center à l'intention des employeurs pour prévenir la persécution des travailleurs, qui suggérait des demandes contractuelles concrètes que le syndicat pourrait proposer. Contrairement à la diabolisation des immigré·es par Trump, notre message de solidarité considère que nos voisins et nos collègues contribuent à construire une société plus forte et plus saine. Ils ont fui des conditions difficiles, souvent à cause des politiques de Washington.
Dans nos communautés, nous devons trouver des moyens de faire savoir aux sans-papiers que nous les soutenons.
Cela peut prendre la forme de « veilles communautaires », en s'assurant que leurs enfants sont protégés, et d'autres méthodes d'accompagnement.
Publié le 14 janvier 2025 par Solidarity
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Décoder la stratégie de communication de Trump II

À première vue, il semble difficile de s'y retrouver dans les déclarations tonitruantes et stupéfiantes de Donald Trump au sujet du Canada (en faire le 51e État des USA), de la bande de Gaza (vider le territoire de la population palestinienne), de l'imposition d'une barrière tarifaire pour les produits canadiens, mexicains, chinois, etc., de purge dans l'appareil gouvernemental, etc…
Par-delà le caractère intempestif du 45e et 47e président des USA et sans égard pour sa personnalité ou ses troubles pour lesquels nous ne disposons d'aucune compétence ou expertise pour les diagnostiquer, nous tenterons, dans les prochaines lignes, de cerner certains éléments de la stratégie de communication mise en place par son équipe présidentielle. Cette stratégie semble de plus en plus s'inspirer d'éléments qui correspondent à la stratégie « du choc », de « la sidération et de la stupeur » et de la « saturation ». Qu'est-ce à dire ?
La stratégie du choc
La stratégie du choc a été conceptualisée par la journaliste Naomi Klein dans l'ouvrage La stratégie du choc paru chez Actes Sud en 2007. Pour l'essentiel cette stratégie suppose une méthode bien précise qui consiste à « intervenir immédiatement pour imposer des changements rapides et irréversibles à la société éprouvée par le désastre ». Cette stratégie a été mise de l'avant par certains économistes néolibéraux qui préconisaient des thérapies de choc. Elle s'inspirait des cadres des services de renseignement et des militaires qui appliquaient des méthodes de torture par électrochocs afin de rendre les suspects amnésiques et parfaitement manipulables. « Les partisans de la stratégie du choc, affirme Naomi Klein, croient fermement que seule une fracture radicale – une inondation, une guerre, un attentat terroriste – peut produire le genre de vastes pages blanches dont ils rêvent. C'est pendant les moments de grande malléabilité – ceux où nous sommes psychologiquement sans amarres et physiquement déplacés – que ces artistes du réel retroussent leurs manches et entreprennent de refaire le monde. »
Refaire le monde, c'est ce que Donald Trump, Elon Musk et Steve Bannon semblent vouloir nous imposer en ce début de mandat qui doit durer quatre ans, et ce via une démarche qui ne nous donnera pas le temps de décoder clairement leurs orientations ou leurs intentions réelles et de permettre aux personnes affectées et concernées de se tourner vers les recours juridiques pour contrer les visées présidentielles autoritaires, liberticides, réactionnaires, et nous en passons !
La stratégie de la sidération et de la stupeur
Sidération. Ce mot signifie « subir l'action funeste des astres », ou encore « être frappé d'insolation », c'est-à-dire être totalement privé de tout moyen de réagir de manière autonome face à la puissance infinie des étoiles ou d'une puissance divine. Le rêve que semble partager Donald Trump et Elon Musk en matière sidéral consiste à vouloir à la fois atteindre et conquérir Mars — la planète rouge du dieu de la guerre — et de traiter les humains du point de vue de la puissance cosmique. Ajoutons que sous l'angle médical et psychologique, la notion de sidération suggère l'anéantissement de toute force de résistance face à un choc émotionnel.
On peut également utiliser pour qualifier la nouvelle stratégie de communication déployée par Trump II, le terme de stupeur, qui signifie l'engourdissement et la paralysie. Devant la masse considérable de décrets qu'il signe, nous nous retrouvons dans une situation où on ne peut faire face correctement à cet amas indigeste. Pire, nous devenons, sur le coup, quasiment incapables d'exercer notre esprit critique et, par conséquent, notre puissance d'agir risque de s'amoindrir.
La stratégie de la saturation
Depuis son retour au Bureau ovale de la Maison-Blanche, le nombre de décrets signés par Donald Trump atteint un nouveau sommet historique et porte sur une foule de sujets allant de l'immigration à la justice, de l'identité de genre à l'environnement, des coupes dans les programmes gouvernementaux à la réduction drastique pour ne pas dire draconienne dans la fonction publique, etc. N'oublions pas non plus les décrets qu'il a signés et qui ont pour effet de déclarer l'état d'urgence à la frontière du Mexique, la remise en question du droit d'asile, la fin du « droit du sol » et l'envoi de personnes migrantes sans-papiers à Guantanamo. Ajoutons, last but not least, le décret qui a pour effet d'accorder la grâce présidentielle aux personnes reconnues coupables pour leur participation à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Et comme dirait l'Autre : And more to come ! ou encore And many more to come ! Un mot, on le devine, s'impose : saturation.
Le pouvoir de l'information et de la communication
Dans une société des écrans comme la nôtre, il devient possible de proposer des idées, des images et des mises en scène, de façon à les décréter comme étant celles d'une réalité souhaitée. La signature des décrets dans le Bureau ovale devant les caméras n'est pas anodine et relève du symbolisme. Car c'est en ce lieu que l'avenir de la nation des USA se décide, en quelque sorte. Mais il s'agit aussi d'une mise en scène propre à une nouvelle télé-réalité. Derrière son bureau hautement symbolique, soi-disant du chef d'État le plus puissant de la planète, le président étasunien devient le producteur, le maître de jeu et la vedette de l'émission qui suscite le plus de « choc », le plus de rebondissements, le plus de réactions, et ce, partout dans le monde. Tous les projecteurs sont braqués sur lui, dans l'attente du prochain décret ou de la prochaine révélation choc.
En misant sur les écrans, le président étasunien occupe certes les devants de la scène, mais il expose son pouvoir, qui est aussi celui de sa signature au bas des décrets. D'ailleurs, celle-ci est souvent montrée ; preuve épique du geste posé pour le bien soi-disant de la population de son pays. Il devient héroïque, immortalisé par les images, puisqu'un Grand président l'est par ses gestes et ce qui est montré de lui. En même temps, son rôle de maître du jeu le place en situation où il prend constamment les devants, sans arrêt, toujours dans l'optique de pousser ses opposant.e.s, autant alliéEs qu'ennemiEs, sur la nécessité de réagir. Ces dernières et derniers deviennent les personnages secondaires ou encore les vilain.e.s qui abusent des bontés des USA, qui spolient leurs richesses, justifiant ainsi une action forte, soit celle d'une plume toute-puissante capable de renverser la situation. En ce sens, le président étasunien doit démontrer qu'il manie le « bâton » — soit un pouvoir donné par métonymie à la plume ; dans une réplique de la pièce The Conspiracy de Bulwer-Lytton disant que « la plume est plus forte que l'épée » — et le maintient en tout temps.
Il n'y a pas meilleure émission de superhéros que celle-ci, d'autant plus qu'elle prend scène dans la réalité.
Conclusion
En signant à une vitesse grand « V » cette avalanche d'actes administratifs unilatéraux Donald Trump inonde l'espace médiatique et tente d'empêcher les critiques de s'organiser en s'assurant que personne d'autre que lui et les membres de son équipe de stratèges — plus ou moins compétents —, ne contrôle le flot d'informations. Ce qu'il ne parvient pas, par ailleurs, à réaliser complètement. Au moment où nous écrivons ces lignes, certains de ces décrets font l'objet de dénonciations et de poursuites devant les tribunaux. Des jugements ont même été émis et ont pour effet de les suspendre d'application provisoirement.
Donald Trump ne se contente pas d'occuper, d'envahir et d'inonder l'espace médiatique. Il le submerge et le noie. En agissant ainsi il alimente le flot de controverses, ce qui a pour effet de détourner l'attention de la population en la bombardant d'une suite ininterrompue de déclarations ahurissantes. Cette stratégie de communication n'est pas sans risque pour le principal intéressé. Doit-on rappeler, comme l'observait à son époque Machiavel dans Le prince, que la citoyenne et le citoyen moyen ne raffolent pas d'agitation constante.
Parlant de citoyennes et de citoyens, la population totale des USA en 2023 est estimée à 334 900 000 habitantEs. Le nombre de personnes de 18 ans et plus s'élève à un peu plus de 260 millions. Sur ce dernier chiffre, en novembre dernier, il n'y a que 156 302 318 qui ont exercé leur droit de vote, alors que 49,8 % ont choisi Donald Trump et 48,32 % ont accordé leur vote à Kamala Harris. Les assises électorales de Donald Trump demeurent fragiles. Il n'a pas été plébiscité par l'électorat et encore moins par la population. Pour le moment, il adopte des comportements unilatéraux qui en font un tyran. En ce sens, il abuse abondamment de ses pouvoirs présidentiels. Il agit d'une manière opposée et contraire à ce qui est attendu de lui sur un plan légal ou constitutionnel.
Dans l'histoire du XXe siècle il y a des personnages politiques qui ont marqué leur époque et ils ont laissé une trace un peu plus longue que d'autres. Pensons ici à Roosevelt et à son New Deal. A contrario, il y a eu Margaret Thatcher et Ronald Reagan qui ont remis frontalement en question certaines assises du Welfare state et du keynésianisme. Qu'en sera-t-il de Trump II ? Ses décrets auront-ils pour effet d'inaugurer une nouvelle ère ou se permuteront-ils en mauvais souvenirs sous une prochaine administration ? Pour le moment, seules les personnes qui s'amusent au jeu des prédictions peuvent hasarder quelque chose sur le sujet. Pour notre part, nous laissons à d'autres la description « experte », c'est-à-dire la définition de la marche à suivre pour orienter les changements à mettre en place dans les présentes circonstances. Tout au plus pouvons-nous apporter un éclairage susceptible de rendre compte de ce qui se passe en vue de l'étape qui consiste à choisir son camp. Which side are you on ?
Guylain Bernier
Yvan Perrier
9 février 2025
10h50
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Houston, Dallas, Los Angeles … : des milliers de manifestants contre la politique xénophobe de Trump

Depuis le week-end dernier, de nombreuses manifestations traversent le pays pour témoigner de la colère contre les déportations et les violentes attaques du nouveau président contre les personnes immigrées.
5 février 2025 | tiré du site de Révolution permanente | Photos : Houston, Dallas, Los Angeles … : des milliers de manifestants contre la politique xénophobe de Trump
https://www.revolutionpermanente.fr/Houston-Dallas-Los-Angeles-des-milliers-de-manifestants-contre-la-politique-xenophobe-de-Trump
Depuis son retour au pouvoir, Trump a lancé une offensive sans précédent contre les immigrés : fin du droit du sol, état d'urgence à la frontière, chasse aux sans-papiers … Les premiers jours du mandat de Trump, qui a fixé un objectif de plus de 1000 arrestations par jour, ont été marqué par les raids violents de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) contre les sans-papiers. Entre le 23 janvier et le 3 février, ce sont plus de 8000 personnes qui ont été arrêté par l'ICE.
Depuis le week-end dernier, des manifestations de plusieurs milliers de personnes ont éclaté dans les villes les plus touchées par l'offensive raciste de Trump. Des lycéens ont quitté leurs lieux d'étude en signe de protestation et des commerçants issus de l'immigration ont fermé leur établissement.
A Los Angeles, plusieurs manifestations ont réuni des milliers de personnes pendant trois jours. Dimanche, avec une importante présence de la diaspora mexicaine, les manifestants ont envahi l'autoroute avant d'être violemment réprimés par la police.
Lundi, à Los Angeles toujours, des centaines de lycéens ont quitté leur cours pour protester contre les arrestations commises par l'ICE dans leur quartier lors des dernières semaines.

Le Texas, en raison de sa proximité avec la frontière mexicaine et de la présence de millions d'immigrés (en particulier venant d'Amérique latine) sur son territoire et de son gouverneur ultra-réactionnaire, est également l'un des épicentres de la lutte contre le projet xénophobe de Trump. Que ce soit à Dallas, à Houston ou dans la Rio Grande Valley, des milliers de personnes ont défilé dans les rues pour dénoncer les pratiques de l'ICE et notamment l'extension de leur juridiction aux écoles, aux hôpitaux et aux lieux de culte.

A Denver également, un meeting pour organiser la défense des droits des immigrés a réuni plus d'un millier de personnes, avec comme mot d'ordre la lutte contre « la terreur de l'ICE ».
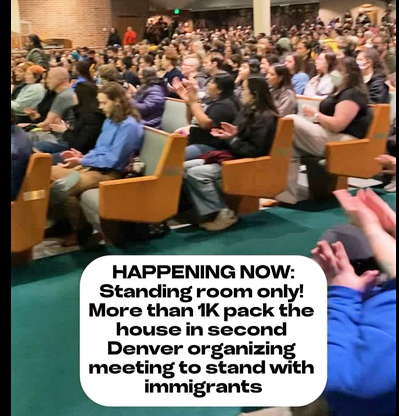
Atlanta, Chicago, Charlotte, San Jose, San Diego, New York, Boston et d'autres encore, nombreuses sont les villes qui ont vu les familles d'immigrés, les étudiants et les organisations communautaires prendre la rue pour dénoncer la politique raciste de Trump et manifester leur solidarité avec le sort des sans-papiers.
Alors que le Parti démocrate ne bronche pas devant ces offensives anti-immigration, ces mobilisations embryonnaires montrent que la population immigrée n'entend pas laisser passer aussi facilement les mesures xénophobes du nouveau président. Les témoignages de professeurs et de travailleurs de la santé qui ont annoncé qu'ils refuseraient de se plier aux ordres de la nouvelle administration sont un autre signe de la résistance que rencontre la politique de Trump auprès d'une partie de la population.
Face à une offensive historique contre les droits des immigrés, les manifestations du week-end dernier montrent la voie de ce qui pourrait être une résistance contre les politiques réactionnaires de Trump : une mobilisation d'ampleur organisée à la base, alliant tous les travailleurs qu'ils soient immigrés ou non, qui se dresse pour défendre non seulement les droits des sans-papiers, mais ceux des travailleurs dans leur ensemble.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
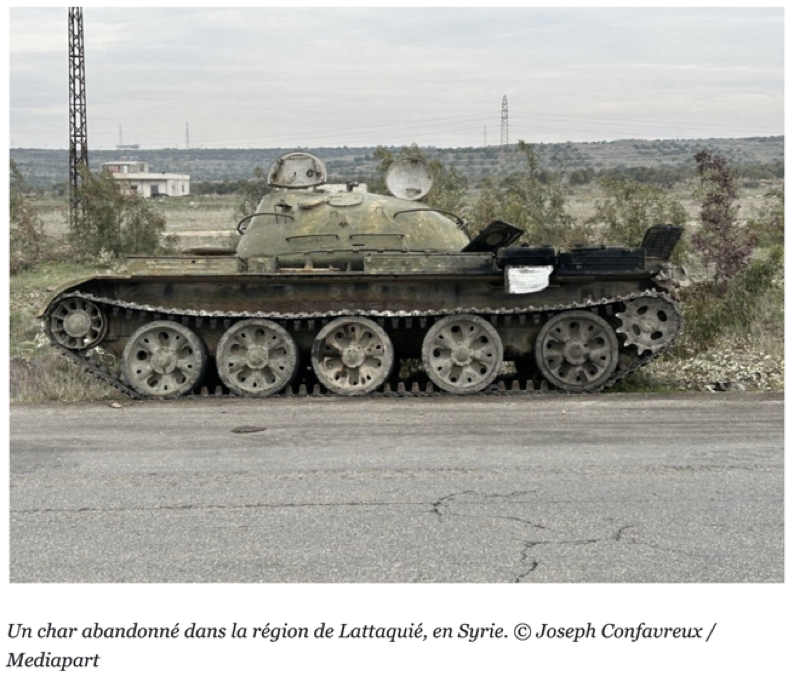
Religion, idéologie, doctrine politique : ce qui attend la nouvelle Syrie
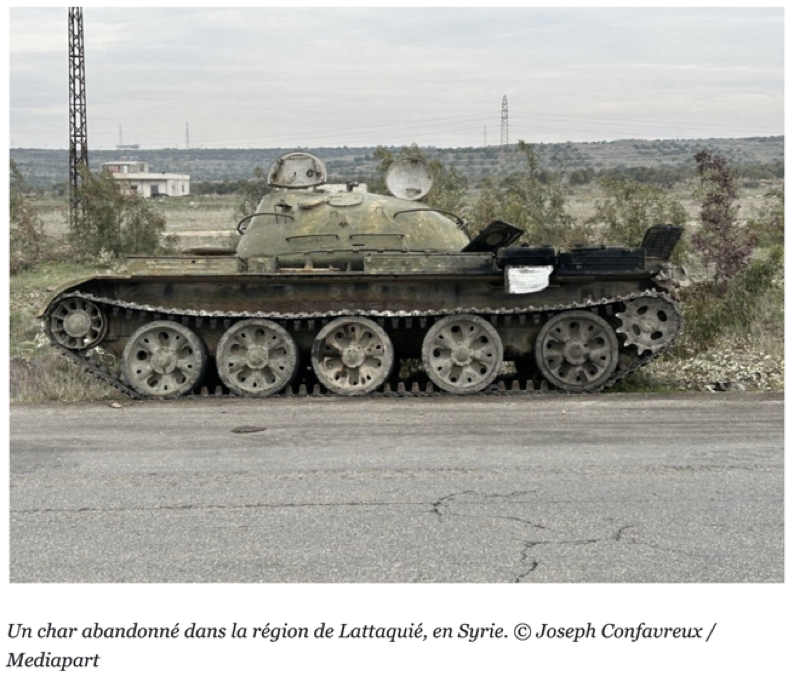
Que peut-on saisir des projets économiques et politiques du groupe Hayat Tahrir Al-Cham, qui s'est rendu maître de la Syrie, à partir de ce qu'il a expérimenté à Idlib et commencé de faire à Damas ? Entretien avec le chercheur Patrick Haenni.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Et si l'observation des centres commerciaux, ou malls, implantés ces dernières années à Idlib constituait l'un des meilleurs moyens pour comprendre ce que pourrait devenir la Syrie de demain ?
Dans un article passionnant publié juste avant l'offensive victorieuse du groupe Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) sur Damas, le chercheur Patrick Haenni montrait à quel point ces lieux cristallisaient les tensions, mais aussi les accommodements possibles entre les normes islamiques, le consumérisme et la mise en place d'un espace public que les différentes composantes religieuses, politiques et sociales de la région d'Idlib ne se représentent pas à l'identique.
Pourquoi certains cafés et restaurants tenus par des capitaux proches de HTC acceptaient le narguilé tandis que d'autres, moins liés à HTC, l'interdisaient ? Pourquoi une loi de régulation plus stricte du mélange entre les sexes dans ces lieux avait-elle pu être adoptée au moment précis où HTC envoyait des messages de « modération » à l'intention de la communauté internationale ? Comment faire cohabiter un impératif ascétique lié à une culture combattante et islamiste et les aspirations à la consommation, voire à l'hédonisme, des sociétés ?
Alors que le ministre des affaires étrangères du gouvernement dirigé par Hayat Tahrir Al-Cham se trouvait récemment au Forum économique de Davos en Suisse, pour annoncer un plan de privatisations et débattre, notamment, avec Tony Blair, et tandis que Ahmed al-Charaa prononçait, jeudi 30 janvier, son premier discours à la nation depuis la chute de Bachar al-Assad, que peut-on dire de la vision du monde, à la fois politique et économique, portée par HTC ?
Entretien avec Patrick Haenni, chercheur affilié à l'Institut universitaire européen de Florence. Il publiera, avec Jerome Drevon, en juin, un ouvrage intitulé Transformed by the people. HTS' road to power in Syria, une analyse fine des mutations idéologiques et politiques de ce mouvement, basée sur un travail de terrain de plus de cinq ans dans l'ancien fief du mouvement dans le nord-ouest de la Syrie.
Mediapart : HTC est-il représentatif de cet « islam de marché » à la fois conservateur sur le plan des mœurs et libéral sur le plan économique que vous analysiez il y a quelques années à propos des Frères musulmans égyptiens ?
Patrick Haenni : L'Islam de marché interrogeait l'espace des convergences entre mondialisation et islamisation, et montrait les affinités entre l'islam politique et le nouvel ordre libéral, voir néolibéral, en train de se mettre en place dans les années 1990-2000. Là, nous sommes dans une configuration radicalement différente. HTC est un produit de la guerre, et il en reflète l'évolution.
HTC est un groupe armé, un mouvement de combattants, qui, de combats en batailles, a perdu énormément de ses cadres initiaux, lesquels étaient souvent des urbains éduqués. HTC a donc vu sa base prendre l'ascenseur social vers le bas.
Une très grande partie de la première génération, éduquée et politisée comme l'est Ahmed al-Charaa, est morte dans les combats ou a disparu du fait des scissions de HTC, d'abord avec l'État islamique, puis avec Al-Qaïda.
En raison de cet élagage, à partir de 2019, le mouvement a dû recruter localement, dans la région d'Idlib. Il en a découlé une mue sociologique. Le mouvement se provincialise, et sa nouvelle base sociale est constituée par les petites classes moyennes pour les cadres et un socle très rural pour les combattants.
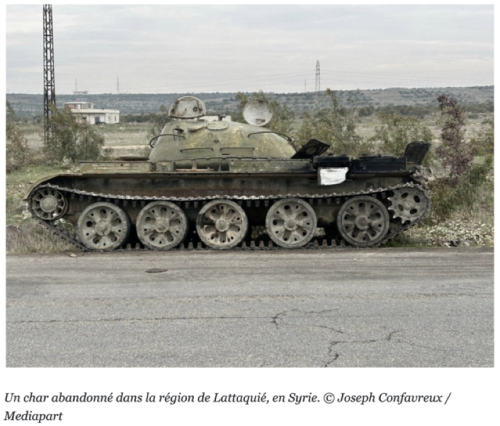
On est ainsi passé d'un mouvement en partie internationaliste, recrutant souvent au sein des classes moyennes, à un mouvement plus local et moins diplômé, implanté davantage en bas de l'échelle sociale. Ce qui a obligé HTC à simplifier les formations idéologiques données aux combattants et à largement les dépolitiser.
Par ailleurs, l'expérience de l'exercice du pouvoir qui se met en place à Idlib en 2017 sous le nom de « Gouvernement syrien du Salut » est le produit d'un mouvement militarisé limité en ressources humaines et financières qui n'a jamais fait de la gouvernance locale sa priorité, ni n'y voit le lieu de réalisation de ses idéaux politiques. Son seul horizon utopique a toujours été la prise de Damas, Fath al-Cham,en arabe, à l'instar de l'appellation de son mouvement.
Contrairement aux Kurdes qui ont créé une dynamique de fonctionnarisation de la société syrienne du nord-est en ayant réussi à mettre près de 220 000 personnes dans une administration censée d'ores et déjà incarner leur idéal militant et préparer la Syrie de demain, Charaa fait, lui, de la gouvernance locale par défaut, par manque de ressources humaines et financières mais aussi parce que ses intérêts sont ailleurs.
- On est bien sur un régime néolibéral, mais c'est une forme de néolibéralisme par défaut.
À Idlib, pas d'administration pléthorique, mais un secteur public dégraissé, un État minimal et une propension à la décharge du service public sur le secteur associatif, les ONG, internationales ou locales, ou les Nations unies : un tiers de la population à Idlib vit ainsi dans des camps et survit sous perfusion onusienne.
Cela vaut également pour des secteurs à haute teneur idéologique comme l'éducation, où les salaires étaient payés par des financements occidentaux, et les manuels, ainsi que les examens, repris du gouvernement intérimaire syrien de l'opposition basé en Turquie.
Quant à l'État syrien, depuis la prise de pouvoir, le dégraissage a également commencé avec le renvoi de près de 30 % des employés du secteur public redoublé de suppressions de subventions à certains biens de première nécessité, comme l'huile de chauffage, les transports publics, l'essence ou, de manière plus cruciale, le pain dont le prix a été multiplié par 10 à certains endroits.
On est bien sur un régime néolibéral, mais c'est une forme de néolibéralisme qui, là encore, fonctionne « par défaut », et non comme conséquence d'une motivation idéologique de contraction de l'intervention étatique.
Est-il possible de cerner « l'idéologie » de HTC, que ce soit sur le plan économique ou politique ?
HTC ne possède pas une idéologie structurée. Ce sont bien sûr des islamistes, qui se sont déradicalisés sans devenir modérés pour autant.
Leur déradicalisation est le produit non intentionnel de quatre dynamiques : leur rupture avec le djihad global ; leur rupture avec le salafisme comme projet de purification à marche forcée de la religiosité ; leur pari sur les majorités silencieuses pour mieux marginaliser les minorités radicales agissantes à l'intérieur ou à l'extérieur du mouvement ; et, en conséquence, la pratique tacite d'un « salafisme inversé » d'acceptation d'une certaine inertie du social qui permet à un islam populaire, soufi notamment, de se réaffirmer sur la scène sociale après en avoir été occulté pendant près d'une décennie.
Cette déradicalisation ne se fait pas au nom d'une idéologie : c'est le produit d'une trajectoire que HTC maîtrise seulement partiellement. Sans surprise, quand on demande aux leaders du mouvement de se définir, les réponses varient et demeurent évasives : ils parlent de mouvement révolutionnaire, d'islamisme, de djihadisme politique, de conservatisme sunnite…
Le compromis trouvé à Idlib entre les normes de l'islam et la société à laquelle elles s'appliquent peut-il se reproduire à Damas, dont la composition sociologique et la diversité religieuse sont très différentes d'une petite ville conservatrice et homogène du nord du pays ?
Le leader de HTC, Ahmed al-Charaa, est un politique davantage qu'un idéologue ayant une recette claire pour reformater la société selon ses convictions. À Idlib, il a trouvé une forme d'équilibre dans une société polarisée entre une austérité révolutionnaire et combattante et une volonté jugeant que la révolution et le combat devaient déboucher sur la réalisation d'une société nouvelle laissant la place à une vie sociale non contrainte par la rigueur souhaitée par les premiers.
Al-Charaa a donc fait des compromis entre une aile populiste islamiste, parfois salafiste, dure et austère, et une société, toujours musulmane et conservatrice, mais qui voulait revivre et respirer. À Idlib, le compromis était tenable parce que la marge d'écart entre ces deux tendances n'était pas drastique.
À Damas, en revanche, la polarisation est bien plus forte. On a, d'un côté, le renforcement de cette aile populiste islamiste et parfois salafiste qui réinvestit un champ religieux moins contrôlé à Damas qu'il ne l'était à Idlib. Là-bas, HTC avait la main sur les mosquées, les écoles, les instituts de charia. Les prédicateurs étaient sous contrôle, parfois directement, parfois indirectement, par exemple en intégrant, pour les contenir, les plus durs dans les institutions religieuses que ces derniers ne contrôlaient pas.
À Damas, et dans les autres grandes villes, les radicaux étrangers ou les groupes de prédication (dawa) paradent en pick-up, rappellent la norme islamique dans ses versions les plus conservatrices, s'installent dans un champ religieux peu contrôlé pour l'instant.
Et de manière plus profonde, on voit aussi s'affirmer une identité sunnite vindicative difficile à contenir et qui a sa part sombre de violence revancharde. Elle s'affirme sur la côte ou dans la région de Homs, notamment dans les espaces urbains brassés d'un point de vue confessionnel et travaillés par une mémoire de la guerre civile souvent marquée par la haine et le sang.
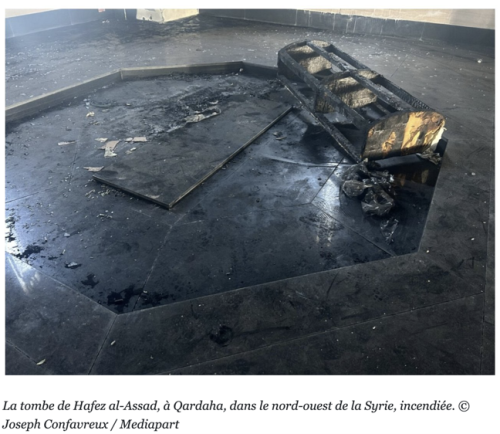
Mais, de l'autre, on voit aussi une affirmation de la société civile, des bourgeoisies urbaines avec des styles de vie radicalement différents et soucieux de les défendre. Eux aussi recourent à la rue. On le voit à travers les manifestations, petites mais continues, de femmes notamment, qui arborent des slogans ouvertement séculiers tels « la religion à Dieu et la nation à tous ». Bouillonne ainsi une société civile politisée voulant être dans le jeu et improvisant réunions et formations politiques dans les cafés d'activistes.
Or les nouveaux maîtres de Damas ne pourront faire sans ces élites urbaines qui détiennent l'économie et qui, in fine, sont les dépositaires de l'expérience de l'État. Depuis la prise de Damas, les rencontres avec ces dernières sont légion, même si on ne sait pas encore quel type de partage de pouvoirs elles sont susceptibles – ou non – d'engendrer. En clair, si des visions différentes de la norme religieuse ont, bien sûr, toujours (co)existé, les pressions contraires qui ont contraint Charaa à l'arbitrage à Idlib sont bien plus divergentes à Damas.
L'ancienne politique d'arbitrages pratiquée à Idlib tient, désormais, pour les nouveaux dirigeants, d'une pratique du grand écart idéologique toujours plus complexe.
La prise de Damas a principalement été vue sous deux angles : soit la victoire finale d'une révolution, soit le début de l'imposition d'une idéologie islamiste. Les tensions en cours se jouent-elles principalement autour de l'idéologie et du religieux ?
Pas uniquement. Ces dimensions sont réelles mais il en est une autre, non moins fondamentale, qui est la dimension de classe.
La prise de Damas est vue par beaucoup, dans la capitale, comme un débarquement sociologique de la province d'Idlib, le fief de HTC avant son Blitzkrieg [« guerre éclair » – ndlr] victorieux le mois passé. À l'image de ces révolutionnaires issus des campagnes d'Idlib qui, arrivant dans le quartier huppé d'Al-Malki à Damas, ont créé, dans une mosquée du quartier, le « conseil des notables d'Al-Malki ». Une initiative que la bourgeoisie locale regarde en grinçant des dents, étant entendu qu'il n'y a pas plus de « notables » à Al-Malki que dans le XVIe arrondissement de Paris…
- Contrairement à la vision des talibans de Kaboul, il n'y a pas, chez le militant moyen de HTC, cette idée de Damas comme ville pécheresse.
Alors qu'elle était l'incarnation de la marge, la province d'Idlib devient d'ores et déjà implicitement une marque de statut social. Les voitures porteuses de plaques d'Idlib se voient privilégiées par la police de la route, prompte à leur donner la priorité au nom d'une libération qui leur est créditée.
Surtout, et de manière bien plus profonde, la politique de nominations et de licenciements au sein de la fonction publique prend la pente d'un double appui sur une appartenance sunnite et, plus spécifiquement, parfois, des réseaux de solidarité tissés autour de l'expérience du pouvoir développée par HTC à Idlib ces dernières années.
D'une certaine manière, on retrouve dans cette affirmation révolutionnaire et sociale d'une province spécifique au sein de la capitale ce qu'avait déjà connu Damas avec la prise de pouvoir du Baas en 1963, qui fut également à la fois l'affirmation de la province et celle d'une région.
Le chercheur français Michel Seurat disait il y a très longtemps que « l'État au Machrek, c'est une assabiyya[groupe ou réseau de solidarité – ndlr] qui a réussi » ; la Syrie aujourd'hui lui donne clairement, une fois de plus, raison.
Mais cette forme de revanche des campagnes sur les villes n'est-elle pas une vengeance, comme ce fut le cas lorsque les talibans s'emparèrent de Kaboul en 1996 ou lorsque les Khmers rouges prirent Phnom Penh ?
Contrairement à la vision des talibans de Kaboul, il n'y a pas, chez le militant moyen de HTC, cette idée de Damas comme ville pécheresse. Le contact de la ruralité et de l'urbanité est pour l'instant ambivalent.
Il y a, d'une part, la réaction défensive des élites, les sorties en pick-up « d'entrepreneurs de morale » venant prêcher la bonne parole et qui sont souvent pesants pour le voisinage, mais, d'autre part, les selfies des jeunes femmes avec les combattants débarqués de la campagne ou la satisfaction d'élites totalement épuisées par la prédation suffocante exercée sur eux par l'ancien régime.
Il y a surtout, comme à Idlib, un ancrage du mouvement dans les petites classes moyennes, provinciales souvent, mais pas pour autant déconnectées du urban life style qui existe dans les grandes villes.
Et quand la pression morale dépasse un certain seuil, comme ce fut le cas avec la tentative d'islamiser les manuels d'enseignement à Damas, d'imposer une police des mœurs à Idlib ou de priver les femmes de participation à des discussions sur le futur de la justice à Alep, alors les autorités corrigent le tir par le haut et imposent un rétropédalage.

Ce rétropédalage peut aussi se faire de manière spontanée : le conseil des notables du quartier d'Al-Malki, comme dans les autres quartiers de la ville, est d'ores et déjà en état de mort clinique tout simplement car la greffe de la culture provinciale n'y a pas pris souche.
En définitive, en dépit des décalages cognitifs, on n'est donc ni dans un triomphe revanchard de la ruralité sur l'urbanité – Charaa a passé son adolescence dans le quartier plutôt cossu de Mezze –, ni dans l'imposition d'une islamisation par le haut, comme ce fut le cas avec les talibans.
- HTC n'a jamais fait son “coming out” identitaire. Le groupe n'a jamais accouché d'une charte ou d'un document fondateur explicitant la nouvelle doctrine ou son identité politique.
Mais cette affirmation provinciale est aussi très contextuelle. À Damas, le syndicat principal des avocats a été importé et substitué par le syndicat local d'Idlib. Dans les régions, la « ruralisation » du pouvoir peut être plus forte et se faire via des plans de dégraissage sur la base des appartenances confessionnelles.
Elle peut aussi prendre la forme d'une islamisation de l'État. Ainsi, à Deir ez-Zor, l'autorité de l'État central s'effectue en réalité par le truchement des anciens frères d'armes de Charaa, originaires de la petite ville de Sheheil, à l'est de l'Euphrate, longtemps bastion du Front Al-Nosra. Dès leur prise de pouvoir, plusieurs femmes fonctionnaires de la municipalité non voilées ont été licenciées. Mais là encore, on est davantage dans l'ordre de l'initiative locale que de l'application d'un programme idéologique dûment élaboré par le haut.
En réalité, depuis sept ans, le leadership tend à pondérer ses bases, voire à contraindre les plus velléitaires idéologiquement. Et on est toujours bien face à une déradicalisation par le haut, souvent imposée par le leadership du mouvement à des cadres intermédiaires revêches.
Quelle est alors l'identité des nouveaux maîtres de Damas ?
Agent réel de déradicalisation, HTC n'a pourtant jamais fait son « coming out » identitaire. Le groupe n'a jamais accouché d'une charte ou d'un document fondateur explicitant la nouvelle doctrine ou son identité politique.
Le mouvement a fait l'économie d'un aggiornamento théologique. Sa déradicalisation est le fruit de l'exercice du pouvoir, non d'une mutation idéologique assumée et argumentée.

Elle est à la fois profonde, ancrée dans la durée et difficilement réversible car cristallisée par des changements de force en profondeur dans le mouvement, à savoir la mise à l'écart de la ligne dure, même si bien sûr les radicaux sont loin d'avoir tous disparus.
Elle reste pourtant sans discours sur sa propre transformation. Révolution silencieuse pour les uns, dont je suis, ou conspiration du silence d'un nouveau pouvoir déjà passé maître dans l'art de la taqiyya et de la dissimulation, pour les sceptiques cherchant une oriental touch. Il est sans doute un peu tôt pour répondre de manière définitive.
Ce que nous pouvons en revanche d'ores et déjà affirmer, c'est que cette déradicalisation est unique dans le paysage djihadiste, et ce, à deux titres. D'une part, il ne s'agit pas d'une révolution doctrinale alors qu'habituellement les djihadistes commencent par l'idéologie, comme l'ont fait les djihadistes égyptiens ou libyens. D'autre part, c'est une déradicalisation qui s'effectue par un acteur en position de force alors que la déradicalisation des djihadistes est d'ordinaire le produit d'une phase de faiblesse, et de l'expérience carcérale.
La déradicalisation s'effectue ici en position de pouvoir. Plus que cela, elle est le produit de l'exercice du pouvoir et des contraintes qu'il véhicule.
- HTC s'est fait transformer par la société qu'il contrôle. Sa déradicalisation, c'est du salafisme à l'envers.
Lorsqu'on est contraint de faire alliance avec l'armée turque, armée de l'Otan émanant de l'expérience d'un État laïc, il faut répondre à ceux qui rejettent le principe de recherche d'appui sur des forces infidèles.
Lorsqu'il s'agit de réaffirmer l'autorité de la ligne de HTC face au discours des idéologues du djihad global, l'adoption de l'école de jurisprudence chaféite permet de produire de la légitimité locale et du contrôle religieux. Le chaféisme n'est ainsi pas le reflet d'un traditionalisme mais le produit d'une stratégie affirmée de différenciation.
Lorsqu'il s'agit de gérer un champ religieux très dense avec plus de 1 200 mosquées, de multiples instituts de charia issus pour la plupart de la tradition soufie, contrairement à l'État islamique prêt à imposer son dogme à tout prix, HTC « fait avec », c'est-à-dire réhabilite le bas clergé local et ses visions du monde.
Quand les nouvelles recrues sont du terroir, peu éduquées, plus attachées à la défense de leur village qu'à l'avènement d'un califat mondial et que, de surcroît, l'État islamique reste un concurrent, la formation idéologique des combattants est révisée à la baisse, à la fois simplifiée et déradicalisée : il faut faire rempart – au risque de défections vers l'État islamique – et rendre accessible.
De fil en aiguille, HTC a progressivement amorcé un cours « thermidorien » et renoncé à « purifier le dogme » et la société, c'est-à-dire renoncé à l'idéal salafiste de la tabula rasa et, toujours plus – et de manière largement empirique – compose avec « l'inertie du social », selon les termes de l'historien François Furet. HTC s'est fait transformer par la société qu'il contrôle. La déradicalisation de HTC, c'est du salafisme à l'envers.
De manière stratégique, HTC à Idlib s'est comporté de façon profondément transactionnelle, y compris sur les questions de normes religieuses, et n'a pas clarifié sa ligne idéologique. De ce point de vue, il y a bien une part de taqiyya, de dissimulation dans ce flou stratégique.
Mais qu'est-ce qui est dissimulé ? Une radicalité impénitente qui sortira du bois une fois le pouvoir pris ou, à l'inverse, un recentrage idéologique sur une ligne révolutionnaire, sunnite et conservatrice mais déradicalisée et qui ne dit pas encore son nom pour faciliter la greffe d'un modèle encore fragile dans un milieu qui le voit parfois encore avec scepticisme ?
Si tout est sans doute possible, je penche pour la seconde option. En effet, si HTC s'est montré fortement transactionnel, il devra l'être d'autant plus après sa victoire face aux pressions externes – l'incantation internationale vers l'inclusivité et la paranoïa non moins globale et locale vis-à-vis de l'islam politique.
Les nouveaux dirigeants ne pourront préserver le pouvoir sans préservation de l'État, ce qui suppose un pacte avec la communauté internationale et avec les élites urbaines, seules détentrices de l'expérience étatique, toutes deux impossibles à obtenir en cas de régime islamique dur.
L'actuelle structure des contraintes liées à l'exercice du pouvoir après le 8 décembre devrait caler la boussole idéologique du mouvement sur le cap des réajustements centristes qu'il tenait depuis la rupture avec Al-Qaïda en 2016.
La trajectoire de HTC peut-elle être un modèle de déradicalisation pour d'autres organisations de ce type ?
En définitive, le recentrage idéologique de HTC rappelle moins les anciennes expériences djihadistes que l'expérience des partis d'extrême droite qui ont connu un itinéraire parfois similaire de dégagement des extrêmes dans un contexte de position de force, de volonté de prise de pouvoir et sans grands efforts de conceptualisation doctrinale.
En réalité, l'expérience d'Idlib permet de jeter quelques lumières sur les affirmations centristes de ces partis. Tout d'abord, le recentrage idéologique n'est jamais purement instrumental. À Idlib comme ailleurs, lorsqu'un mouvement radical opère un recentrage idéologique, cela provoque des tensions internes majeures, des scissions, des départs et des purges. Ce processus ne mène pas nécessairement à une véritable modération, mais il élimine les éléments les plus radicaux.
- Le recentrage ne transforme pas seulement les extrêmes ; le centre lui-même est redéfini en absorbant des aspects idéologiques des marges radicales.
Ensuite, le recentrage ne transforme pas seulement les extrêmes ; le centre lui-même est redéfini en absorbant des aspects idéologiques des marges radicales. À Idlib, cela se traduit par une influence persistante de la culture salafiste. Un radicalisme conservateur se maintient, mais à l'extérieur du mouvement et sur le mode d'une contestation populiste de ce dernier.
Par ailleurs, le recentrage n'est jamais purement politique. HTC a dû composer avec les réalités socio-religieuses d'Idlib puis de Damas et accepter une certaine revanche de la société qui prend le chemin d'une retraditionnalisation, tout comme les partis d'extrême droite européens s'adaptent à la modernité sociologique – acceptation des valeurs libérales, recul sur les modèles familiaux traditionnels, etc. – et renoncent à la tabula rasa conservatrice.
Les recentrages idéologiques sont, ensuite, généralement durables. HTC, comme les partis européens d'extrême droite, a consolidé son recentrage en s'éloignant des éléments radicaux, rendant un retour aux années de terreur improbable.
Contrairement aux partis européens, HTC n'agit pas dans un cadre démocratique institutionnel. Son recentrage repose sur des calculs politiques : assurer la paix sociale en faisant un pari sur les majorités silencieuses, obtenir une acceptabilité internationale nécessaire pour recevoir de l'aide humanitaire, et incarner une alternative gagnante au régime syrien.
Les recentrages idéologiques ne fonctionnent pas nécessairement uniquement en régime électoral. À Idlib, le recentrage idéologique de HTC a coïncidé avec une réduction relative de l'autoritarisme qui, contrairement à l'Égypte de Sissi ou à la Syrie de Bachar al-Assad, fonctionne moins à la répression brute qu'à la suppression de toute option politique concurrente.
Le pouvoir reste verrouillé. HTC concède des espaces limités de liberté politique et sociale, tout en contrôlant les institutions clés. Le recentrage idéologique est mis au service d'une entreprise de raréfaction des alternatives politiques au nom du rejet des extrêmes (al-ghulû, dans la terminologie islamiste).
À Idlib comme ailleurs, les réajustements idéologiques de formations politiques anciennement radicales peuvent soutenir des formes finalement assez ordinaires d'« extrême centre », pour reprendre le concept de Pierre Serna. D'un côté bizarrerie dans le paysage djihadiste, la déradicalisation de HTC se situe bien, de l'autre, dans un air du temps, singulièrement illibéral et mondial.
Joseph Confavreux
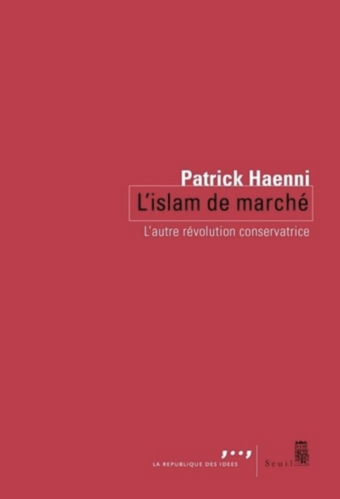

Myanmar 4 ans après le putsch : Peur, terreur, colère, résistance

Nyein Chan May est étudiante, cofondatrice et dirigeante de l'association German Solidarity Myanmar (GSM). Avant le coup d'État de février 2021, elle est venue en Allemagne pour étudier les sciences politiques. Elle a été cofondatrice du syndicat étudiant de l'université des langues étrangères de Yangon dans lequel elle a été active de 2012 à 2015. Féministe intersectionnelle, elle est également engagée dans la production de podcasts. Wolfgang Kremer s'est entretenu avec elle à propos de ce que peut apporter la solidarité internationale.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Wolfgang Kremer Chan, cela fait maintenant quatre ans que l'armée a effectué un coup d'État au Myanmar. Depuis ton exil, quel regard portes-tu sur la situation dans ton pays ?
Nyein Chan May - Peur, terreur, colère et résilience sont quatre mots qui permettent de décrire la situation. Les chiffres actuels font état de 19 847 morts dues à la violence politique et de plus de 28 000 personnes arrêtées pour des raisons politiques. 127 personnes ont été condamnées à mort. Malgré les succès militaires croissants des forces de résistance, le nombre d'attaques aériennes de la junte militaire contre des cibles civiles augmente.
Selon le Bureau des Nations-Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette situation horrible est le quotidien des habitant.e.s du Myanmar. Et c'est ce quotidien que je partage avec eux depuis l'Allemagne, car la totalité de mes ami.e.s et de ma famille est encore sur place. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'un regard lointain, mais c'est comme si je vivais moi-même ces atrocités.
Et pourtant, les gens au Myanmar résistent depuis quatre ans, et ce sans soutien notable et efficace de la communauté internationale. Cette résilience remarquable me donne de l'espoir et me motive.
Hormis quelques spécialistes et des activistes, les gens en Allemagne et en Europe associent le plus souvent le Myanmar à la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi et à son parti, la LND, ainsi qu'au génocide de la minorité musulmane des Rohingyas en 2017. Quel est le rôle actuel de l'ASSK et de la LND et existe-t-il un espoir pour les Rohingyas de voir les persécutions cesser ?
Le conflit au Myanmar remonte à l'époque coloniale. Il ne s'agit pas d'une simple lutte de pouvoir entre un parti politique, comme la LND, et la junte militaire. Il s'agit plutôt de la résistance d'une population multiethnique qui ne veut pas vivre sous un régime autoritaire.
Aung San Suu Kyi continue de jouir d'un grand respect auprès d'une grande partie de la population, surtout en raison de son image personnelle. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle ait une véritable influence sur l'ensemble de la résistance. Depuis le coup d'État, celle-ci est principalement conduite par la jeune génération, qui agit de plus en plus souvent de concert ou en accord ponctuel avec des groupes armés ethniques.
La situation des Rohingyas continue de se dégrader. Des informations nous parviennent selon lesquelles de jeunes hommes rohingyas sont enrôlés de force par l'armée et envoyés dans des affrontements où le risque de perdre la vie est élevé. Malheureusement, des informations font également état de violations des droits de l'homme commises par l'Arakan Army (AA), qui fait partie de l'alliance dite des trois Fraternités de groupes armés ethniques, qui a réalisé l'« opération 1027 » en octobre 2023 et a depuis pris le contrôle de nombreuses régions.
Environ 600 000 Rohingyas vivent au Myanmar dans des conditions que le HCR décrit comme « proches de l'apartheid ». Plus de 140 000 personnes sont enfermées dans des camps dans l'État de Rakhine. Les conditions de vie dans les centres de réfugiés, comme le camp de Cox's Bazar, sont également extrêmement précaires.
La réconciliation entre les communautés dans l'État Rakhine, des accords pour une coexistence pacifique ainsi que des poursuites judiciaires engagées contre les violations des droits de l'homme sont des conditions essentielles pour assurer un avenir sûr aux Rohingyas. Ces objectifs ne peuvent toutefois être atteints sans mettre fin à la domination des militaires, qui opprime et divise.
La situation humanitaire et économique au Myanmar est catastrophique. Quelles sont les tâches les plus urgentes pour une aide humanitaire efficace ?
Pour faire face à la crise humanitaire au Myanmar et contribuer à la résolution du conflit à long terme, la communauté internationale devrait adopter, en collaboration avec les acteurs régionaux, une stratégie qui combine l'aide transfrontalière et la coopération des organisations locales de la société civile. De telles approches se sont révélées efficaces pour améliorer les soins aux civils et renforcer les forces de résistance.
Étant donné que la junte bloque systématiquement l'aide humanitaire ou la détourne de son objectif, l'aide transfrontalière en provenance de pays voisins comme la Thaïlande, l'Inde et le Bangladesh devient de plus en plus importante. Ce type d'aide pourrait être dirigé de manière ciblée vers des régions particulièrement touchées comme Chin, Kachin et Rakhine, où les organisations ethniques sont actives et ont souvent un lien plus étroit avec la population.
Une telle aide transfrontalière devrait se déployer à plusieurs niveaux :
– Premièrement, en fournissant de la nourriture, des médicaments et des moyens éducatifs via des canaux fiables.
– Deuxièmement, en encourageant la mobilité dans les régions frontalières afin de pouvoir répondre rapidement à des situations d'urgence aiguë, comme les déplacements massifs de population suite à des attaques militaires.
– Troisièmement, en exerçant une pression internationale et en prenant des sanctions contre les États qui soutiennent la junte. Des accords avec les pays voisins devraient viser à mettre en place des corridors humanitaires transfrontaliers et à faciliter l'accès des ONG internationales aux zones frontalières.
Au début de l'année 2024, on espérait que la junte pourrait bientôt être renversée. Aujourd'hui, beaucoup craignent une sorte d'impasse militaire et un éclatement en territoires contrôlés par différentes forces. Un avenir fédéral pour le Myanmar est-il encore une option réaliste pour l'avenir ?
Le fédéralisme est un objectif commun à la plupart des forces de résistance, y compris aux groupes armés ethniques. Depuis l'indépendance en 1948, nous n'avons jamais eu l'occasion de réellement chercher à atteindre cet objectif de manière conséquente. La résistance en cours nous donne toutefois l'occasion de commencer à réfléchir au fédéralisme, de formuler des conceptions et de faire de ce rêve une réalité.
Le Myanmar est un pays qui a connu plus de sept décennies de conflits armés et une énorme diversité de protagonistes. Il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'une unité entre les différents groupes puisse être établie en l'espace de quatre ans. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne nous efforçons pas d'y parvenir. Nous essayons de renforcer et de soutenir le dialogue politique au sein des forces de résistance. La lutte contre la junte et les démarches pour établir une démocratie fédérale doivent se faire en parallèle.
Tu as cofondé l'association German Solidarity Myanmar ( GSM) et tu en es actuellement la secrétaire générale. Quels sont vos projets et prévisions actuels ?
GSM est une jeune organisation militante qui œuvre en faveur du mouvement démocratique du Myanmar en défendant ses positions, en effectuant un travail de relations publiques et en faisant de l'éducation politique. Nous revendiquons une attitude plus déterminée et une politique réactive vis-à-vis du Myanmar de la part de la République fédérale d'Allemagne et de l'Union européenne.
Nous avons récemment publié le document « Asile et intégration des réfugiés birmans en Allemagne ». Ce document décrit non seulement les défis auxquels sont confrontés les réfugié.e.s du Myanmar en Allemagne mais formule également des revendications concrètes et des recommandations d'action en ce qui concerne la politique d'asile.
Dans ce contexte, nous organiserons prochainement des rencontres en ligne avec la diaspora du Myanmar en Allemagne, où il sera possible de discuter ouvertement et en toute sécurité de sujets tels que l'asile, la réinstallation et la vie en Allemagne. En outre, nous prévoyons d'autres discussions avec le ministère des Affaires étrangères, les députés du Bundestag (même après les nouvelles élections) et les représentants de l'Union européenne.
Et bien sûr, à l'occasion de l'anniversaire du coup d'État (le 31 janvier), il y aura une manifestation bruyante et colorée devant l'ambassade à Berlin !
Les implications géostratégiques du conflit sont complexes et la résistance civile et armée dans le pays est politiquement très hétérogène. A ce sujet, vous, l'association GSM, fournissez des données de fond importantes dans le cadre de vos « updates » hebdomadaires.
Le Myanmar n'est pas seulement un pays de conflits et de catastrophes humanitaires, c'est aussi un « point de rencontre » géopolitique stratégique. Nous considérons la lutte pour la démocratie au Myanmar comme faisant partie d'une lutte globale contre le front des autocraties qui se soutiennent mutuellement, comme actuellement la Chine et la Russie qui soutiennent la junte.
Outre les « Updates », nous organisons régulièrement des briefings Indo-Pacific afin de placer le Myanmar dans le contexte plus large de la géopolitique de la région. Ces briefings ont lieu à la fois en ligne et en présentiel.
Et l'importance géostratégique du Myanmar fait toujours l'objet de discussions de plaidoyer et de réunions d'échange avec des acteurs allemands et européens.
Tu te considères comme une féministe intersectionnelle. Dans la situation actuelle et dans une société profondément patriarcale et militarisée, est-ce que toi et tes camarades avez une chance d'être entendus et d'exercer une influence ?
C'est précisément cela - être entendues et avoir de l'influence - qui constitue notre contribution féministe à la résistance. Si nous parlons d'une révolution qui doit changer l'ensemble du système oppressif, nous devons également soulever la question de la lutte contre le patriarcat. Cela signifie que les femmes du Myanmar ne luttent pas seulement contre la junte militaire, mais aussi contre le patriarcat dans la société et au sein de la résistance.
Mes compagnons de lutte et moi-même sommes souvent critiqués pour ces efforts - également par les forces de résistance et parfois même par les femmes, comme si nous affaiblissions la résistance. Non, c'est tout le contraire ! Nous évoquons haut et fort le problème des structures patriarcales, parce que nous voulons élever cette révolution à un niveau supérieur. Car une démocratie qui ne réfléchit pas de manière intersectionnelle à l'égalité des sexes ainsi qu'aux droits des femmes et des groupes marginalisés et qui ne les prend pas en compte est une démocratie aux carences inacceptables. Nous en sommes fermement convaincus.
GSM est une association à but non lucratif, reconnaissante pour tout don et toute collaboration active !
Compte pour les dons :
German Solidarity with Myanmar Democracy e.V., GLS Bank
IBAN : DE18 4306 0967 1277 0150 00
BIC : GENODEM1GLS
https://www.sozonline.de/2025/02/myanmar-3/
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro.
Interview publiée dans Sozialistische Zeitung (SOZ 2, Februar 2025 p. 19)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza. Avec Donald Trump, en avant toute vers le nettoyage ethnique

Le Proche-Orient a connu, au cours des dernières décennies, de nombreux plans, souvent américains, mais aussi onusiens, soviétiques, russes, arabes ou israéliens. Celui que le président Donald Trump a présenté lors de sa rencontre avec Benyamin Nétanyahou le 4 février a ceci de particulier qu'il ne prétend plus s'abriter, même partiellement, derrière la façade du droit international. Il le piétine de manière cynique en arguant d'un seul principe : la loi du plus fort. Les idées qu'il avance violent ce qui reste de légalité internationale, déjà largement mise à mal par les crimes contre l'humanité et le génocide à Gaza, qui se poursuivent en toute impunité avec le soutien des États-Unis et un large aval européen.
Tiré d'Orient XXI. Photo : L'image montre deux hommes assis dans un bureau opulent, probablement dans le Bureau Ovale. L'un porte un costume noir avec une cravate rouge, tandis que l'autre est habillé en costume bleu avec une cravate rouge. Ils semblent engagés dans une conversation, avec des expressions sérieuses. En arrière-plan, on voit une cheminée décorée et divers objets sur des étagères. L'ambiance est formelle et politique.
Washington, le 4 février 2025. Le président américain Donald Trump rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Andrew Caballero-Reynolds / AFP
L'histoire retiendra que le président étatsunien a été le premier chef d'État à recevoir le premier ministre israélien depuis l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre par la Cour pénale internationale pour crime de guerre à Gaza ; un accueil que le locataire de la Maison Blanche a qualifié d'« honneur ». Le trajet de Nétanyahou jusqu'à Washington a pourtant dû être prolongé pour ne pas traverser l'espace aérien de pays susceptibles, quant à eux, d'appliquer le droit international.
Donald Trump a d'abord affirmé sa volonté de faire de Gaza un territoire appartenant à long terme aux États-Unis (« long-term ownership ») : « Nous prendrons la bande de Gaza et nous ferons le travail ; nous nous approprierons ce territoire. » Depuis son accession à la présidence, il a revendiqué la prise de contrôle du canal de Panama et celui du Groenland, sans oublier sa proposition d'intégrer le Canada aux États-Unis. Tout cela au nom de la « défense de [leurs] intérêts » et au mépris des autres, sans exclure, pour cela, l'usage de la force. On comprend que Trump se réclame d'un de ses prédécesseurs, William McKinley (1843-1901), qui déclara la guerre à l'Espagne et, à l'issue de sa victoire, prit le contrôle de Porto Rico, de Guam et des Philippines, annexa Hawaï tandis que Cuba devenait un protectorat. Pire que Vladimir Poutine avec l'Ukraine, Trump ouvre ainsi la voie à la justification de tous les changements de frontières, de la conquête du Congo par le Rwanda à celle de Taïwan par la Chine.
Des projets liés à des intérêts personnels
Cette prise de contrôle d'un territoire situé à des milliers de kilomètres des États-Unis s'accompagne de la proposition de vider Gaza de sa population, de l'installer ailleurs, en Égypte ou en Jordanie qui n'en veulent pas. Gaza deviendrait, selon Trump, « la Côte d'Azur du Proche-Orient », dans la lignée des propositions de son gendre Jared Kushner, en mars 2024 (1). Celui-ci espère y investir et en retirer d'importants bénéfices — il est bon de rappeler que, pour Trump et son entourage, les projets sont souvent liés à des intérêts personnels sonnants et trébuchants.
Le président américain a inscrit ses déclarations dans le sillage des « accomplissements » de son premier mandat : la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et l'installation de l'ambassade américaine sur place, la légitimation de l'annexion illégale par Israël du plateau du Golan syrien, les accords d'Abraham et le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Il a également précisé que Gaza « ne devrait pas passer par un processus de reconstruction et d'occupation par la même population qui y vit une existence misérable ». Quelle commisération pour ses habitants.
De plan, Trump n'en a guère en réalité : « Cela pourrait être payé par de riches pays voisins. Il pourrait s'agir [pour le point de chute des Palestiniens] de nombreux sites ou d'un seul grand site », n'en déplaise aux rédactions qui n'ont rien trouvé de mieux que de discuter de la faisabilité de la chose au lieu de rappeler son illégalité et, subsidiairement, son immoralité.
La fenêtre d'Overton
Il existe un danger à discuter « objectivement » dans les médias de ce plan de transfert massif de la population — un objectif qu'Israël cherche à remplir depuis 1948 —, c'est de le rendre légitime ; on le fait ainsi entrer dans le cadre de la « fenêtre d'Overton » (2)
. Pour cela, il faut « exposer régulièrement l'opinion publique à des idées auparavant considérées comme extrêmes, en les rendant plus visibles dans les médias et les réseaux sociaux. Cette exposition répétée peut graduellement normaliser ces idées et les rendre moins choquantes, les faisant entrer progressivement dans la fenêtre acceptée. »
En discutant en toute objectivité du nettoyage ethnique, on le rend « discutable ». Le fait même que le chef d'État le plus puissant au monde puisse se permettre de tels propos en dit long de cette fenêtre ouverte par 15 mois de génocide à Gaza. On a beau faire de Donald Trump le symbole d'un homme capable de toutes les folies et de tous les excès, c'est bien le bilan macabre de son prédécesseur et la complicité de ses homologues occidentaux qui lui permet de dérouler un tel discours.
On ne discute pas de savoir si le transfert de population, un crime contre l'humanité selon l'article 7 du statut de Rome (3), est possible ; on ne demande pas non plus à ses lecteurs et lectrices s'ils « [croient] au projet de Trump de transformer Gaza en Riviera », comme l'a suggéré Le Figaro dans un sondage. Sur France Info, chaîne du service public, on ne juge pas utile de reprendre un invité qui qualifie la démarche de Donald Trump de « pragmatique ». Mieux, on le questionne sur la faisabilité de la chose : « Comment imaginer ce transfert dans d'autres pays ? Dans quel pays ? L'Égypte ? La Jordanie, pays qui aujourd'hui refuse cette idée ? » Rien ne résiste au professionnalisme journalistique, pas même la perspective d'un nettoyage ethnique au lendemain d'un génocide.
Quand Arte met en bandeau, le 31 janvier 2025, dans son émission « 28 Minutes », « Faudrait-il évacuer la bande de Gaza le temps de la reconstruction ? », la chaîne, particulièrement muette sur le génocide à Gaza, contribue à l'acceptabilité de l'inacceptable. Il aurait été plus honnête de titrer « un crime contre l'humanité est-il nécessaire pour reconstruire Gaza ? ». Car c'est bien la question qui est posée après les déclarations de Trump.
Notes
1.« “Nettoyer Gaza” qui a un bord de mer au “potentiel précieux” : tollé en ligne après des propos de Jared Kushner », L'Orient Le Jour, 20 mars 2024.
2. Expression utilisée « pour désigner le fait que les idées jugées acceptables par la population sont toutes à l'intérieur d'un périmètre précis. Une sorte de fenêtre, en quelque sorte. »
3. « Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. »
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Après le cessez-le-feu à Gaza, Israël dirige son feu sur la Cisjordanie

Bassam Assous était en train de dîner chez lui avec sa famille lorsque les coups de feu ont commencé. Il était environ 20 heures, le samedi 25 janvier, et des soldats israéliens étaient entrés à leur insu dans leur village de Muthalath Al-Shuhada, situé près de Jénine, en Cisjordanie occupée. Les fenêtres et les volets étaient fermés – "nous n'avions aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur jusqu'à ce que nous entendions des tirs tout près ", a déclaré Assous à +972 Magazine.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Assous et sa femme, Ghada, se sont rapidement éloignés des fenêtres, tandis que leurs deux filles, Shaimaa et Teema, se sont cachées dans une chambre avec la fille de Teema, Laila, âgée de 2 ans.
Soudain, Assous a entendu ses filles crier. « Je me suis précipité dans la chambre avec ma femme ; Shaimaa tenait fermement Laila, tandis que Teema criait à côté d'elles », a-t-il raconté. « J'ai pris Laila dans mes bras et mes mains se sont rapidement couvertes de sang. Le sang coulait de sa tête – elle avait été touchée par une balle.
Portant sa petite-fille en sang et inconsciente, Assous est sorti en courant dans la rue et s'est rendu compte qu'elle était remplie de soldats israéliens et de véhicules blindés. » Ma femme a crié : "Pourquoi as-tu tué cette fille ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?', poursuit-il. L'un des soldats, qui se tenait à une certaine distance, a répondu : ‘Désolé' ".
J'ai répliqué en criant : « Pourquoi l'avez-vous tuée ? », poursuit Assous. « Les soldats ont pointé leurs armes sur moi et m'ont dit de ne pas m'approcher. Ma femme a continué à crier et l'un des soldats lui a indiqué un endroit situé à 100 mètres et lui a dit : « Va là-bas et attends une ambulance ».
Lorsque l'ambulance est arrivée, Ghada est montée avec Laila. Shaimaa, qui avait été blessée par des éclats d'obus à la mâchoire et au flanc, et Teema, qui avait été blessée par des éclats d'obus à la main droite, avaient également besoin d'être soignées. » J'ai dit aux soldats que je voulais partir avec mes filles, mais ils m'ont dit : “Non, vous allez venir avec nous” », ajoute Assous.
« Les soldats m'ont emmené dans la maison de mon oncle, où ils avaient déjà arrêté quatre de ses fils, tandis que mon oncle et le reste de la famille étaient assis à proximité », a-t-il raconté. « Je n'avais aucune idée de ce qui se passait avec ma femme et mes filles – nous n'avions pas le droit d'utiliser nos téléphones ni même de parler. Lorsque j'ai insisté pour appeler, un soldat a menacé de me menotter. Je suis resté détenu ainsi jusqu'à 23 h 30 environ, heure à laquelle les soldats se sont retirés de la zone. Ils n'ont arrêté personne et n'ont rien confisqué.
« Après le départ des soldats, des voisins sont venus voir comment nous allions », poursuit M. Assous. « C'est là que j'ai su que Leila était décédée, parce qu'ils ont commencé à nous présenter leurs condoléances. J'étais sous le choc, mais j'ai vite compris que je devais me montrer fort pour ma fille Teema, qui s'est effondrée en larmes et ne parvenait pas à comprendre la perte de son enfant. Je l'ai emmenée dans un centre médical proche, où on lui a administré des sédatifs ».
Assous explique que Teema – qui est étudiante en master à l'université An-Najah de Naplouse, spécialisée dans l'ingénierie de l'environnement et de l'eau – a déjà perdu son mari, Mohammad Al-Khatib, il y a deux ans lors d'un accident de travail. » Elle avait du mal à surmonter le traumatisme de la perte de son mari, alors je l'ai fait venir avec sa fille pour qu'elle vive avec nous à la maison », explique-t-il. » Elle disait toujours : “Je veux juste élever ma fille et m'occuper d'elle”, mais aujourd'hui, elle me demande sans cesse :"Pourquoi ont-ils tué ma fille ? Qu'est-ce que cette petite enfant a fait pour mériter cela ?"
En réponse à la demande de +972, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré « regretter tout préjudice causé à des civils non impliqués » et a affirmé avoir reçu des renseignements sur des terroristes qui s'étaient barricadés à l'intérieur d'un bâtiment dans le village. Selon le porte-parole, les soldats ont averti « à plusieurs reprises » toutes les personnes se trouvant à l'intérieur de sortir avant d'ouvrir le feu. Assous a nié avoir entendu un tel avertissement.
Un état de terreur dans le camp de réfugiés de Jénine
Le meurtre de Laila n'a pas été commis isolément. Depuis le matin du 21 janvier, deux jours seulement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, l'armée israélienne est engagée dans une vaste campagne militaire dans le nord de la Cisjordanie. Selon l'armée, l'opération, baptisée « Mur de fer », est destinée à « préserver la liberté d'action des FDI » et à réprimer la résistance armée dans le territoire occupé. Elle fait suite à une campagne de sept semaines menée par l'Autorité palestinienne (AP) contre des groupes armés dans le camp de réfugiés de Jénine.
Les opérations de l'armée israélienne se concentrent également sur Jénine et ses environs, ainsi que sur Tulkarem. Jusqu'à présent, l'opération a tué 16 Palestiniens à Jénine et trois à Tulkarem, tout en détruisant massivement des infrastructures civiles dans les deux villes et en déplaçant de force des milliers de Palestiniens de leur domicile.
« Mardi dernier, vers 11 heures, une unité spéciale de l'armée d'occupation a pris d'assaut le camp », explique à +972 Ahmed Hawashin, chercheur au Centre palestinien pour les droits de l'homme (PCHR) et résident du camp de réfugiés de Jénine. « Les soldats – je soupçonne qu'il s'agissait d'une escouade de tireurs d'élite – se sont positionnés dans des bâtiments surplombant le camp et ont commencé à tirer sans discernement, tandis que des missiles étaient tirés depuis les airs. Les véhicules de l'AP, qui étaient présents dans le camp depuis 45 jours, ont commencé à se retirer.
« La peur s'est répandue parmi tous les citoyens lorsque la nouvelle de l'opération militaire à Jénine a circulé », poursuit Hawashin. » Ma famille s'est réfugiée à l'extérieur du camp et a essuyé des tirs bien qu'il s'agisse de civils. Je me suis réfugié chez un ami dans le quartier Joret A-Dahab du camp.
» D'autres véhicules militaires sont arrivés et ont assiégé le camp alors que les forces commençaient leurs incursions », raconte-t-il. « Pendant toute la nuit, les bruits de tirs et d'explosions n'ont pas cessé. À deux reprises, alors que j'étais assis avec un groupe de volontaires ambulanciers devant la maison de mon ami, un drone a lancé des grenades sur nous. L'un des jeunes hommes a été blessé par des éclats de grenade – nous étions terrifiés ».
Le lendemain matin, un drone israélien a diffusé un message de l'armée ordonnant à tous les résidents du camp d'évacuer. Des hordes de familles ont commencé à sortir, et Hawashin a décidé qu'il serait trop dangereux de rester sur place plus longtemps. « La situation sur le terrain et ce qui circulait dans les médias à propos de cette invasion nous ont effrayés – nous ne savions pas ce qu'ils allaient faire ».
Selon Hawashin, un groupe d'environ 100 personnes du quartier de Jorat A-Dahab s'est rassemblé pour partir ensemble – et a été accompagné par un drone militaire jusqu'à ce qu'il atteigne l'entrée ouest du camp. À ce moment-là, les soldats leur ont ordonné par haut-parleur de se diviser en groupes de cinq personnes et de se soumettre à une inspection. « Il y avait une caméra qui prenait des photos, et les soldats ont décidé qui arrêter en se basant sur les données de la caméra », a-t-il raconté. « Nous avons ensuite continué notre chemin dans la ville.
Dans la ville de Jénine elle-même, où les forces israéliennes ont assiégé les hôpitaux, « la vie est aussi paralysée. Des affrontements ont lieu [entre l'armée israélienne et les groupes de résistance palestiniens], et des véhicules militaires circulent dans les rues. Les magasins sont fermés et la plupart des citoyens ne sortent pas de chez eux, craignant pour leur vie ».
Les conditions dans le camp se détériorent rapidement. Les écoles sont fermées depuis le début de l'opération de l'Autorité palestinienne, début décembre, et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) est dans l'incapacité de fournir des services depuis plus d'un mois. L'électricité a également été complètement coupée dans le camp.
« Le camp est également devenu un danger pour la santé », a ajouté M. Hawashin. « Depuis le début de la campagne de l'Autorité palestinienne, les déchets n'ont pas été ramassés, laissant des tas d'ordures s'accumuler le long des rues. Les rues et les infrastructures d'approvisionnement en eau sont toujours détruites par les précédentes invasions israéliennes, si bien que les habitants comptent sur les réservoirs d'eau et les conteneurs installés sur les toits, mais nombre d'entre eux ont été endommagés par les tirs de la campagne de l'Autorité palestinienne et de l'opération israélienne actuelle, ce qui les rend inutilisables.
Je n'ai jamais été confronté à une attente aussi longue au poste de contrôle »
Parallèlement aux attaques contre le camp de réfugiés de Jénine et ses environs, l'armée israélienne a fermé les routes principales dans toute la Cisjordanie – par des postes de contrôle, des barrières en fer et des monticules de terre – en guise de punition collective, n'ouvrant certaines routes qu'à des heures précises de la journée. Ces fermetures obligent les habitants à attendre de longues heures dans les embouteillages, à emprunter des itinéraires alternatifs à travers les champs et les chemins de terre, ou à éviter complètement de se déplacer. Aux points de contrôle, les soldats ont eu recours à d'autres pratiques répressives, comme la confiscation arbitraire de clés de voiture pendant des heures.
Mohammad Hureini, étudiant en littérature anglaise à l'université de Birzeit, près de Ramallah, et militant de Youth of Sumud, devait passer un examen la semaine dernière, mais celui-ci a été reporté après le lancement par Israël de son opération militaire en Cisjordanie, qui a empêché de nombreux étudiants de se rendre à l'université.
Le lendemain, Hureini, qui était resté près de l'université, a décidé de rentrer en voiture dans son village d'A-Tuwani, dans les collines du sud de l'Hébron – un trajet qui, avant le 7 octobre, prenait habituellement environ deux heures. Cependant, après le début de la guerre à Gaza et l'élargissement des restrictions imposées par Israël aux déplacements des Palestiniens en Cisjordanie, Hureini mettait quatre ou cinq heures pour rentrer chez lui. Cette fois-ci, avec les fermetures supplémentaires, le voyage a duré 13 heures.
« Depuis Naplouse, je me suis rendu au point de contrôle d'Atara, au nord de Ramallah, mais il était fermé et des dizaines de voitures y étaient bloquées », explique-t-il. » J'ai fait demi-tour pour me rendre au point de contrôle de Jaba', au sud-ouest de Ramallah, mais à mesure que j'approchais, il y avait de gros embouteillages : les soldats avaient fermé le point de contrôle à pratiquement toute la circulation et fouillaient les véhicules l'un après l'autre ».
Pendant des heures, Hureini est resté assis dans les embouteillages alors que des centaines, voire des milliers de voitures faisaient la queue pour être inspectées. » On aurait dit qu'un véhicule passait toutes les demi-heures », raconte-t-il. « Au bout de trois heures, j'ai vu des gens abandonner leur véhicule et appeler des taxis pour qu'ils viennent les chercher de l'autre côté du poste de contrôle après avoir traversé à pied. Je n'avais jamais connu une attente aussi longue à ce poste de contrôle »
Environ six heures plus tard, c'est enfin au tour de Hureini de se soumettre à l'inspection. « Il y avait deux soldats au poste de contrôle », explique-t-il. « L'un d'eux m'a fait signe de m'arrêter, alors j'ai coupé le moteur. Les deux soldats étaient au téléphone, sans prêter attention à moi ni aux véhicules qui faisaient la queue derrière moi. Pendant que j'attendais, j'ai compris qu'ils faisaient cela pour humilier les gens, leur briser le moral et perturber nos vies, rien d'autre.
Dix minutes plus tard, le soldat m'a demandé ma carte d'identité et a commencé à fouiller le véhicule en me demandant : « D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Que faites-vous ? Au bout de cinq minutes, il m'a dit de continuer ».
Le calvaire de Hureini n'était pas terminé. « Après cela, j'ai emprunté la route de contournement – qui, bien sûr, n'a pas de points de contrôle parce que les colons l'utilisent – jusqu'à ce que j'atteigne le point de contrôle de Container, qui sépare les parties nord et sud de la Cisjordanie. Il y avait trois voies de circulation menant au poste de contrôle. Pour la première fois, j'ai vu ce qui ressemblait à des milliers de véhicules à l'arrêt. On m'a dit que les soldats avaient fermé le poste de contrôle sans donner de raison et qu'ils n'autorisaient personne à passer.
« J'ai attendu une demi-heure sans bouger, car d'autres voitures arrivaient derrière moi », poursuit-il. « L'un des conducteurs m'a parlé d'un chemin de terre qui pouvait être utilisé pour contourner le poste de contrôle. Il a commencé à conduire et je l'ai suivi. Des dizaines de véhicules nous ont bientôt rejoints. La route était dangereuse – elle était pleine de rochers et de trous. J'ai roulé prudemment pendant 45 minutes, craignant que ma voiture ne tombe en panne. Cette distance aurait pu être parcourue en cinq minutes s'il n'y avait pas eu de poste de contrôle ».
Et pourtant, ce n'est pas tout. « J'ai atteint Bethléem à 19h30 et j'ai trouvé la porte principale de la ville fermée. J'ai pris un autre itinéraire en passant par Beit Jala, où des soldats avaient installé un poste de contrôle et fouillaient les véhicules. Après avoir appris qu'il existait une autre route qui contournait le poste de contrôle, je l'ai suivie jusqu'à ce que j'atteigne à nouveau la route principale et j'ai continué à rouler jusqu'à mon village.
» Parti de l'université de Birzeit, près de Ramallah, à 8 heures du matin, je suis arrivé chez moi à 21 heures, épuisé et avec un mal de tête. Je n'avais rien mangé de la journée, j'ai donc dîné et je me suis couché. La situation depuis que l'armée israélienne a lancé sa nouvelle opération est devenue insupportable ».
En réponse à la demande de commentaire de +972 concernant les nouvelles fermetures de routes, l'armée israélienne nous a renvoyés à un briefing du porte-parole international de l'armée dans lequel il déclare : » Les points de contrôle sont un outil que nous utilisons dans la lutte contre le terrorisme, permettant la circulation des civils tout en fournissant une couche de contrôle pour empêcher les terroristes de s'échapper et de saper l'opération ».
‘L'occupation n'a besoin d'aucune excuse pour nous détruire‘
Pour comprendre cette nouvelle opération militaire d'Israël et les mesures de punition collective, les Palestiniens de Cisjordanie font un lien direct avec le cessez-le-feu à Gaza.
« Le gouvernement israélien n'a pas le moral après avoir quitté Gaza, malgré le fait qu'il ait commis un génocide, tué des dizaines de milliers de personnes et détruit la bande de Gaza », a déclaré à +972 Omar Assaf, un résident du camp de réfugiés de Deir Ammar, près de Ramallah, qui dirige une initiative visant à reconstruire le leadership populaire palestinien à travers la Palestine et la diaspora. « Pour compenser, il a lancé une campagne militaire ciblant le camp de réfugiés de Jénine et fermant le reste des villes et villages palestiniens à la recherche d'une image de victoire dans cette guerre.
« La Cisjordanie a toujours été un front majeur pour l'occupation, mais il y a toujours eu une résistance palestinienne contre ses ambitions », poursuit Assaf. « Ces dernières années, des groupes armés sont apparus dans le nord de la Cisjordanie pour s'opposer à l'occupation, aux attaques des colons et à l'expansion des colonies sur les terres palestiniennes. En réponse, les relations entre l'Autorité palestinienne et l'occupation ont évolué dans la lutte contre ces groupes, passant d'une coordination de la sécurité à une coopération pure et simple.
« L'Autorité palestinienne a réussi à mettre fin à l'activité de la Fosse aux lions à Naplouse en recrutant certains de ses combattants au sein des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne », a-t-il déclaré. « L'occupation [israélienne] a dû s'occuper des groupes armés dans le camp de réfugiés de Jénine [par la force], et jusqu'à présent, elle n'y est pas parvenue.
L'incursion de sept semaines de l'AP dans le camp, juste avant la dernière opération israélienne, était « une action sans précédent dans l'histoire de la cause palestinienne », affirme Assaf. Et si l'Autorité palestinienne a prétendu qu'elle réprimait la résistance armée afin de protéger le camp du devenir de la bande de Gaza, il considère qu'il s'agit là d'une « déclaration honteuse », ajoutant : » L'occupation n'a pas besoin d'excuses pour nous détruire, occuper nos terres et construire des colonies ; elle le fait parce que c'est son projet principal ».
L'AP, conclut Assaf, devrait faire l'une des deux choses suivantes : « Elle peut revenir au peuple palestinien, le soutenir contre les politiques d'occupation, unifier le front palestinien interne et mettre fin à la division. Ou bien, si elle ne peut pas le faire, elle doit organiser des élections pour permettre au peuple palestinien de choisir des dirigeants qui le représentent et le conduisent vers la réalisation de ses aspirations. Si l'AP poursuit son approche actuelle, elle augmentera les tensions au sein de la population et affaiblira le front interne face à l'occupation ».
Basel Adraa est un militant, journaliste et photographe du village d'a-Tuwani, dans les collines du sud d'Hébron.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : +972 Magazine

Les déplacements de civils et la présence prolongée de l’armée israélienne distinguent cette opération en Cisjordanie

Un mois après que les dirigeants des colons juifs ont appelé à une opération israélienne en Cisjordanie « comme à Gaza », le gouvernement a donné son accord. Les plans de démolition de maisons et les discussions sur une présence militaire à long terme signalent une escalade évidente.
Tiré d'Association France Palestine Solidarité. Article publié à l'origine dans Haaretz. Photo : L'armée israélienne continue son agression à Tulkarem pour le 11ème jour consécutif, le 6 février 2025 © Quds News Network.
La plupart des routes du camp de réfugiés de Tulkarm ont été détruites par l'armée israélienne - et ce n'est pas la première fois.
« Je pense que nous avons détruit cette route au moins quatre ou cinq fois l'année dernière », a déclaré lundi le chef de la brigade régionale d'Ephraim, le colonel N., lors d'une visite de la région pour les journalistes.
La nature répétitive de l'activité de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés de Tulkarm, comme dans d'autres camps de réfugiés en Cisjordanie au cours des deux dernières années, est évidente. L'entrée de forces importantes, la destruction de routes sur lesquelles des explosifs avaient été placés, les frappes aériennes et les arrestations, tout cela s'est déjà produit ici, à maintes reprises.
Et comme pour souligner cette circularité, le chef de la brigade qualifie même cette activité de « continuation de l'opération Bouclier défensif » - une opération qui a eu lieu il y a plus de 20 ans.
Les rues du camp sont désertes.
Contrairement à la position officielle, le commandant de la brigade admet que des résidents ont bien été expulsés du camp par l'armée israélienne, mais il affirme qu'ils n'ont été évacués que des zones où il y a des combats, tout en continuant leur vie quotidienne dans d'autres zones, là où c'est possible.
Selon les estimations de l'armée israélienne en date de lundi, quelque 2 000 résidents ont été évacués du camp, mais des sources palestiniennes font état d'un nombre beaucoup plus élevé. Le gouverneur de Tulkarm a déclaré lundi matin que près de 9 000 résidents avaient été expulsés.
Bien que l'incursion dans le camp ressemble aux précédentes, bien qu'elle soit plus importante, elle comprend certaines choses dont les militaires n'avaient jamais parlé auparavant. Aujourd'hui, elles font l'objet de discussions ou sont déjà mises en œuvre : la destruction de maisons dans les camps de réfugiés dans le but d'élargir leurs routes internes et une présence militaire continue et prolongée.
Dimanche, l'armée a démoli des maisons dans le camp de réfugiés de Jénine précisément dans ce but, diffusant même des vidéos montrant des structures explosées et des volutes de fumée. Selon le colonel N., dont le nom ne peut être publié en vertu d'une nouvelle politique de l'armée israélienne - bien qu'il apparaisse sur Wikipedia et Google - l'armée souhaite mener une opération similaire à Tulkarm également.
« Il y a des points hauts dans le camp où les hommes armés se rassemblent », explique le commandant de la brigade. « Nous souhaitons ouvrir des routes et démolir des maisons à cette fin, car elles sont actuellement inaccessibles aux véhicules blindés. »
Il ajoute qu'il souhaite détruire six maisons pour atteindre le cœur du camp et que sa demande a été transmise aux autorités juridiques pour approbation.
Même si l'armée a déjà détruit des bâtiments dans des camps de réfugiés par le passé, l'activité est différente cette fois-ci. Il s'agit d'une action calculée, approuvée par les dirigeants politiques. Alors que lors des opérations précédentes dans les camps de réfugiés, les bâtiments étaient « rasés » par les véhicules lourds de l'armée israélienne - même lorsque les routes étaient suffisamment larges pour permettre l'accès - cette fois-ci, selon les témoignages recueillis à Jénine, l'armée israélienne fait exploser les bâtiments.
La semaine dernière, le ministre de la défense, Israël Katz, a affirmé que l'armée resterait dans le camp de réfugiés de Jénine même après la fin de l'opération. Le commandant de l'opération Tulkarm ne semble pas en désaccord avec cette affirmation.
« Nous devons maintenir une action et une continuité, et même lorsque nous partons, maintenir les patrouilles et l'activité de l'infanterie », déclare-t-il. N. pense que l'armée devra maintenir une activité constante dans le camp au cours des prochains mois, ce qui nécessitera des centaines de soldats. « Au moins un bataillon, soit 200 à 300 soldats pour les patrouilles et les activités quotidiennes à l'intérieur du camp », a déclaré le chef de brigade, soulignant que sa position ne serait pas nécessairement acceptée.
Selon les données du ministère palestinien de la santé, 70 personnes ont été tuées par l'armée israélienne depuis le début de l'année, dont cinq à Tulkarm. L'armée a déclaré que, depuis le début de l'opération dans le camp de réfugiés, trois hommes armés ont été tués, plus de 50 suspects ont été arrêtés et quelque 45 engins explosifs ont été détruits - considérés par l'armée comme la principale menace pour les soldats sur le terrain.
Dans le cadre de l'opération, l'armée a également mis en place un point de contrôle à l'entrée de l'hôpital Thabet Thabet, les patients n'étant admis qu'après un contrôle de sécurité. Le chef de la brigade estime qu'il est impossible de classer la plupart des habitants du camp comme innocents et sans lien avec des activités militantes. « Dans chaque maison, on trouve des explosifs, des armes, des gilets pare-balles et des lance-pierres », explique-t-il, soulignant toutefois que l'armée ne peut pas arrêter toutes ces personnes.
Au début de l'opération de Tulkarm, l'armée a annoncé qu'elle avait tué le principal commandant du Hamas dans la ville, Ihab Abu Atiwi, lors d'une frappe aérienne - mais ce n'est qu'en octobre 2024 que l'armée israélienne a tué quelqu'un d'autre qui occupait le même poste lors d'une frappe aérienne à Tulkarm. Son prédécesseur avait été tué par l'armée en avril.
L'armée mène actuellement des opérations simultanées à Jénine, à Tulkarm et dans le village de Tammun, tous situés dans le nord de la Cisjordanie. Leur opération devrait s'étendre au camp de réfugiés de Nur Shams, également à Tulkarm. Il y a quelques semaines, afin de permettre une activité militaire dans plusieurs endroits à la fois, les brigades ont été redistribuées en Cisjordanie : La brigade Ephraïm a reçu Tulkarm ainsi que Qalqilyah, tandis que la brigade Menashe a reçu les régions de Tammun et Tubas ainsi que Jénine.
Tout au long de la tournée, le personnel militaire a répété le message selon lequel la décision d'une opération dans le nord de la Cisjordanie a été prise par crainte d'une répétition possible des événements du 7 octobre 2023. Si le traumatisme de l'armée face à cet échec est évident, il est difficile de ne pas remarquer les effets de la campagne permanente des colons appelant à une déclaration de guerre en Cisjordanie. Ces campagnes ont mis l'accent sur le risque d'un scénario similaire au massacre des communautés frontalières de Gaza, qui se déroulerait également dans les colonies et les villes centrales.
En décembre dernier, les chefs des conseils des colonies de Cisjordanie ont adressé une lettre au cabinet de sécurité israélien, exigeant un changement de stratégie en Cisjordanie. Ils ont insisté pour que la population palestinienne résidant dans les « zones associées au terrorisme, en particulier les camps de réfugiés » soit déplacée et ont demandé de « démanteler toutes les structures terroristes, comme nous l'avons fait à Gaza ». Chaque maison incriminée est détruite, chaque terroriste est éliminé ».
Un mois plus tard, alors que l'accord de cessez-le-feu à Gaza était en cours de signature, les objectifs de la guerre ont été actualisés au sein du cabinet et incluent désormais la Cisjordanie.
Cette décision est clairement ressentie sur le terrain : les importantes forces militaires présentes dans les camps de réfugiés, les annonces pompeuses d'une opération sans précédent, l'intensification des raids aériens, l'évacuation des résidents des camps de réfugiés et les points de contrôle qui ont poussé comme des champignons après la pluie, perturbant la vie des habitants. Tout cela porte la Cisjordanie à un point d'ébullition jamais atteint depuis le début de la guerre.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Israël. L’armée coloniale à l’heure du messianisme

Derrière les crimes contre l'humanité commis par l'armée israélienne à Gaza se profile l'influence grandissante des nationalistes fondamentalistes au sein de l'institution militaire, entre autres. Une ascension qui ne se dément pas depuis trente ans.
Tiré d'Orient XXI.
Général de brigade, Yehuda Vach commande la 252e division de l'armée israélienne. Entre décembre 2024 et janvier 2025, le journal israélien Haaretz lui a consacré deux enquêtes et un éditorial (1) révélant les actes commis sur ses ordres par ses soldats dans la zone de Gaza, incluant les villes de Beit Hanoun et de Jabaliya, ainsi que les camps de réfugiés palestiniens adjacents. L'ensemble s'apparente à une leçon sur le traitement réservé aux « animaux humains » que sont les Palestiniens. L'essentiel se passe le long d'une « ligne imaginaire » imposée par l'armée sur le corridor de Netzarim. Son tracé n'est nulle part indiqué. Aucun Palestinien n'en a été informé. Mais tout homme, femme, enfant qui la franchit doit être abattu sans sommation. Ordres du général Vach. « Il n'y a pas de civils. Chacun est un terroriste », a-t-il dit à ses hommes. La quasi-totalité des officiers et des soldats se soumettent à ses ordres – hormis quelques rares qui, écœurés et épouvantés, ont fini par vendre la mèche, bien après que cette tragédie a commencé, cinq mois plus tôt.
« Le petit Napoléon »
Le premier article évoque, entre autres, les corps des victimes abandonnés en pleine nature sur cette ligne. Des chiens errants affamés rôdent par paquets pour s'en repaître. Les soldats l'appellent « la ligne des cadavres ». Après que le porte-parole de l'armée a annoncé que « plus de 200 terroristes [ont été] abattus » dans cette zone, l'officier d'un des bataillons dira à Haaretz : « Parmi les victimes, seules dix étaient connues comme appartenant au Hamas ». Cette approche, indique le journaliste Yaniv Kubovich, « ne se limite pas à la division 252 ». Il cite un réserviste de la division 90 qui raconte avoir été témoin d'un événement qui l'a révulsé : non armés, un père et ses deux enfants traversent la « ligne interdite » inconnue. Ils sont abattus par une roquette tirée d'un hélicoptère de combat. « Ils ne pouvaient rien nous faire. On est dans le mal absolu », s'indigne-t-il. Les témoignages similaires abondent. Lorsque le commandant en second d'un bataillon conteste les tirs sur des Palestiniens brandissant un drapeau blanc, son supérieur rétorque : « Je ne sais pas ce qu'est un drapeau blanc. On tire pour tuer. »
Yehuda Vach est l'homme qui, dans sa zone d'activité, mène cette campagne où une armée surarmée assassine sans distinction des civils par milliers. Appelé par certains soldats « le petit Napoléon », il évoque devant ses adjoints, après la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas abattu le 16 octobre 2024, son regret de ne pas avoir vu le corps de ce dernier être démembré, pour le « désacraliser » aux yeux de ses partisans. « Ce n'était pas une blague, se souvient un officier. C'était une réunion d'évaluation formelle. » Fin décembre 2024, lorsqu'une autre mission lui est confiée, Vach déclare : « On n'a pas atteint notre but. » Ce but, avait-il dit à ses proches, était d'expulser les 250 000 Gazaouis encore vivants de la zone qu'il gérait.
Pour cela, rapporte la seconde enquête journalistique, Vach n'hésite pas à prendre des initiatives jamais débattues avec ses supérieurs. Ainsi constitue-t-il, dixit Haaretz, sa petite « armée privée » : une escouade secrète composée de soldats sous ses ordres, essentiellement des religieux messianiques, et de civils amenés à Gaza par son frère, Golan Vach. Le but de cette milice est de détruire tout ce qui ne l'a pas encore été dans la zone, sans en informer quiconque. Lorsque les faits sont révélés par Haaretz, le porte-parole de l'armée déclare que ces opérations sont « approuvées à tous les échelons. […] Les décisions du commandant de la division ont été professionnelles et réfléchies ». L'équipe de génie lourd réunie par les frères Vach « était une force militaire autorisée de réservistes formés » et « les allégations concernant l'entrée de civils et de véhicules civils sur le territoire de la bande de Gaza par le commandant de la 252e division ne sont pas vraies ». Bref, l'armée ment. Des faits qui auraient dû faire l'objet d'une enquête approfondie sont a posteriori validés. À ce jour, aucune sanction n'a été prise à l'encontre du général messianique.
Une tendance de plus en plus puissante
Quelle peut être l'explication de ce repli peu glorieux de l'état-major face à des comportements formellement contraires à ses normes officielles ? La réponse réside précisément dans l'identité politique du général Vach. Ce dernier adhère aux convictions de la frange coloniale messianique et fasciste qui, depuis trois décennies, pèse de plus en plus lourd dans l'armée israélienne. Lorsque la police militaire est intervenue dans le camp de détention Sde Teiman, en juillet 2024, afin d'y arrêter neuf geôliers soupçonnés de tortures graves à l'encontre de détenus palestiniens, des membres de la mouvance coloniale messianique qui avaient forcé l'entrée du camp s'y sont violemment opposés. Aucun d'eux n'a été poursuivi. Ainsi le général Vach se sent-il suffisamment protégé au niveau de l'état-major pour servir ses propres intérêts politiques en toute autonomie. Et le même état-major, de facto, capitule. Tel est aujourd'hui le poids de la tendance messianique en Israël, qui n'est pas majoritaire dans la société juive, mais qui impose chaque jour un peu plus son agenda politique.
Dans l'histoire d'Israël, l'armée n'a jamais été factieuse. Mais une mouvance factieuse, celle du colonialisme messianique, impose aujourd'hui son bon vouloir à l'armée. Comment l'expliquer ? Les enquêtes de Yaniv Kubovich montrent que le supérieur hiérarchique de Vach était hostile à ses actes, mais qu'il n'a rien fait, ou rien pu faire, pour l'en empêcher. Exactement comme, à Sde Teiman, des députés messianiques factieux se sont sentis plus forts que la justice. Dans les deux cas, on attend toujours les sanctions. Quoi d'anormal ? Depuis longtemps les colons messianiques se déchaînent en Cisjordanie en imposant leur volonté à des officiers qu'ils transforment en factotums au service de leurs méfaits à l'égard des Palestiniens.
Depuis trente ans, quand, le 25 février 1994, Baruch Goldstein, un colon kahaniste (membre de la fraction la plus raciste du pays), assassine 29 fidèles palestiniens au caveau des Patriarches à Hébron et en blesse 250 autres, puis que, l'année suivante, Yigal Amir, lui aussi influencé par des rabbins messianiques, assassine le Premier ministre travailliste Yitzhak Rabin, le champ d'action du camp messianique ne cesse de se renforcer. Pourtant, il a longtemps occupé une place secondaire dans le sionisme.
« L'âne du Messie »
Le premier qui a établi ce lien entre le sionisme et la fin des temps bibliques est le premier grand-rabbin de Palestine, Abraham Isaac Kook (1865-1935) qui énonce la fameuse idée que le sionisme, pourtant une idéologie nationaliste laïque au départ, constitue « l'âne du Messie ». On dirait aujourd'hui l'idiot utile. La Bible dit que le Messie viendra assis sur un âne. Pour Kook, en bâtissant un État juif en Terre sainte, le sionisme portait sans le savoir sur ses épaules l'arrivée du Messie. Kook fonde l'école talmudique Merkaz HaRav (le « centre rabbinique ») en 1924 pour promouvoir ses idées.
Longtemps, sa mouvance reste marginale au sein du sionisme, même parmi les religieux, où la mouvance politique dite Mizrahi était beaucoup moins nationaliste et belliqueuse que la fraction travailliste ou celle nommée « révisionniste », qui coalisait la droite et l'extrême droite. Mais la victoire « miraculeuse » de juin 1967 fournit le déclic. Elle suscite dans la population un vent de mysticisme alimenté par l'idée du « Grand Israël » (la Palestine historique). Incarné par Tsvi Yehuda HaCohen Kook (le fils du précédent), qui accentue fortement la vision suprémaciste juive de son père ; le messianisme va s'enraciner. Son école rabbinique devient le pilier du Goush Emounim (« Bloc de la foi »), moteur politique du messianisme juif. Ce mouvement politique fondamentaliste a depuis disparu, mais il a généré de très nombreux héritiers disséminés dans divers courants : les deux partis fascistes d'Itamar Ben Gvir et de Bezalel Smotrich, mais aussi au Likoud et dans les partis religieux orthodoxes. Ensemble, ils incarnent l'essor d'un ultranationalisme messianique devenu un acteur politique et surtout social de premier ordre, influant très au-delà du seul camp dit sioniste religieux.
Comment est-ce arrivé ? D'abord, ce camp a mieux surfé que les autres sur la logique de la colonisation. Et comme le font tous les fondamentalismes, ceux juifs israéliens ne retiennent que les parties les plus identitaires de leur lecture littérale et sélective des textes saints. Tout est écrit d'avance, et si l'on sait bien lire, Dieu sera de notre côté. Lors d'un récent séjour en Israël, un rabbin m'a expliqué que l'attaque du Hamas le 7 octobre était « un miracle divin ». Dieu nous montre la voie. L'heure est venue de respecter ses désirs : s'emparer de toute la « Terre d'Israël ». Dès lors, si cette terre « nous appartient » exclusivement, et que les Palestiniens sont une résurrection d'Amalek, l'ennemi éternel des Juifs, pourquoi tergiverser ? Ce discours paraît simpliste, mais si le conflit est inexorable et insoluble parce qu'existentiel, autant y mettre fin radicalement, et au plus tôt.
Ensuite, aucun gouvernement israélien, ni de droite ni de gauche, n'a su ni voulu brider l'ardeur des messianiques. Lorsqu'en 1994 est commis le massacre de Hébron, des conseillers du Premier ministre Yitzhak Rabin préconisent de profiter de l'aubaine pour évacuer les 80 colons messianiques barricadés au cœur de la ville. Vu les circonstances, qui oserait s'y opposer ? Rabin tergiverse et finit par renoncer. Depuis, la colonisation a plus que triplé, à Hébron et ailleurs. Et le poids des messianiques avec.
Enfin et surtout, les messianiques ont su mettre en place une logistique dont l'impact n'a cessé de grandir. Dans Au nom du Temple, Charles Enderlin (2) retrace la manière dont l'extrême droite coloniale messianique, en usant d'une stratégie très articulée mêlant guerre culturelle et capture de positions stratégiques dans des domaines clés de la société, est parvenue à occuper une place politique et à produire un impact sociétal, surtout dans la jeunesse, qu'on aurait eu du mal à imaginer cinquante ans plus tôt. Lorsque, au soir de la conquête de l'esplanade des Mosquées par Israël, en juin 1967, Shlomo Goren, grand-rabbin de l'armée, appelle à raser la mosquée Al-Aqsa pour reconstruire le Temple sur ses cendres, 99 % des Israéliens le prennent pour un fou dangereux. Aujourd'hui, de multiples organismes alimentent cette idée de la « reconstruction du Temple ». Leurs défenseurs siègent au gouvernement.
Hitler s'est juste trompé de cible
Le camp messianique n'a pas seulement proliféré dans le circuit éducatif religieux en Israël. Il touche désormais amplement le secteur public. Il jouit de médias nombreux, écrits, télévisés et radiophoniques. Il dispose de plus en plus de députés, et de soutiens financiers considérables. Enfin, il s'est emparé de positions très importantes dans l'armée. L'affaire commence en 1953, quand celle-ci accueille la première Yechivat Hesder (académie militaire religieuse). Le principe consiste à offrir aux jeunes portant la kippa un service militaire où l'apprentissage de l'usage des armes se mêle aux études bibliques. En 1967, il n'y en avait que trois. En 1990, treize. Aujourd'hui, on en compte près de quatre-vingt-dix. Le Merkaz HaRav et ses émules ont mis la main sur ces écoles, souvent installées dans des colonies en Cisjordanie.
L'éducation qu'on y reçoit est fondée sur le suprémacisme juif en particulier à l'encontre des Arabes et des musulmans. En 2000, un célèbre rabbin de cette mouvance, Yitzhak Guinzburg, explique en une du supplément hebdomadaire du quotidien Maariv que « l'Arabe a une âme animalière » (3). Vingt ans plus tard, le rabbin Giora Redel, un dirigeant de la Yechivat Hesder Bnei David, explique aux recrues que « l'idéologie de Hitler était à 100 % correcte, mais [qu']il visait la mauvaise cible » (4). Il entend par là qu'il aurait dû exterminer les musulmans, pas les juifs. Son compère de la même académie, Eliezer Kashtiel, déclare sur la chaîne 13 : « Je crois au racisme », ajoutant que « les Arabes ont un problème génétique » (5). Ces rabbins n'ont jamais subi la moindre sanction.
Dans les bataillons les plus « problématiques » de l'armée israélienne, ceux qui massacrent sans remords les civils, enfants, femmes et hommes, et qu'on voit ensuite s'en réjouir en chantant sur les réseaux sociaux israéliens, beaucoup sont issus des écoles militaro-messianiques de cet acabit. Aujourd'hui « 40 % des officiers d'infanterie qui sortent des écoles de formation des officiers sont issus de la communauté nationale religieuse », (6) alors que cette mouvance ne regroupe que treize députés au Parlement sur cent vingt. Avant chaque affrontement armé, nombre de ces officiers tiennent des discours où ils appellent les soldats à prier pour que le Dieu d'Israël leur permette d'annihiler leurs ennemis.
Un exemple parmi d'autres, le bataillon Netzah Yehuda (« Éternité de Juda ») est composé à 60 % d'anciens élèves de ces académies militaires messianiques. Ses soldats ont été régulièrement accusés de crimes perpétrés contre des Palestiniens. L'un d'entre eux a été incarcéré pour avoir usé de la gégène à leur encontre, quatre autres pour sévices sexuels sur un « suspect », d'autres pour avoir frappé à mort un Palestinien de 78 ans. Ils n'ont pas été poursuivis. Et devinez quoi ? Lorsqu'il était jeune, Yehuda Vach a suivi sa propre formation militaire à l'académie Bnei David, celle-là même où l'on enseigne que Hitler s'est juste trompé de cible. Quelques années plus tard, il a pu faire bénéficier de son apprentissage l'école d'entraînement des officiers de l'armée israélienne, lorsqu'il en a pris le commandement.
Notes
1- Yaniv Kubovich, « “No civilians. Everyone's a terrorist” : IDF soldiers expose arbitrary Killings and rampant lawlessness in Gaza's Netzarim corridor », 18 décembre 2024, « “Flatten” Gaza, halt aid : the Israeli division commander overseeing Gaza's brutal Netzarim corridor », 1er janvier 2025 ; « Editorial : Vach's private army : the growing gap between the IDF and rogue commanders », 2 janvier 2025. Les citations de ce paragraphe et des quatre suivants sont toutes tirées de ces trois articles.
2- Charles Enderlin, Au nom du Temple, Israël et l'arrivée au pouvoir des juifs messianiques, Le Seuil, Points, 2013. Édition augmentée en 2023.
3- Maariv, supplément du vendredi, 20 octobre 2000.
4- Amir Tibon : « Trump envoy Greenblatt condemns Israeli rabbis' remarks that endorsed racism, Hitler », Haaretz, 1er mai 2019.
5- Ibid.
6- Peter Beaumont et Quique Kierszenbaum, « National religious recruit challenge values of IDF once dominated by secular elite », The Guardian, 18 juillet 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le plan de Trump pour Gaza fait déjà des dégâts

La proposition de nettoyer Gaza des Palestiniens s'appuie sur un courant profond de la société israélienne, mettant en péril toute chance d'un avenir pacifique dans la région.
Tiré d'Agence médias Palestine.
En septembre 2020, vers la fin de son premier mandat présidentiel, Donald Trump a supervisé la signature des accords d'Abraham entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn sur la pelouse de la Maison Blanche. Ces accords, auxquels le Soudan et le Maroc allaient également adhérer dans les mois suivants, ont été proclamés « accords de paix », mais il aurait été plus juste de les qualifier d'« accords de mise à l'écart du peuple palestinien ». Leur objectif n'était pas de créer la paix – il n'y avait pas de guerre entre ces États à l'origine – mais plutôt d'établir une nouvelle réalité régionale dans laquelle la lutte de libération palestinienne serait marginalisée et, en définitive, oubliée.
Les quatre années et demie qui ont suivi ont été les plus sanglantes de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Un an et demi après la signature des accords, les forces israéliennes ont attaqué les prieurs du Ramadan à la mosquée Al-Aqsa et ont entrepris d'expulser des familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem, déclenchant un déluge de roquettes du Hamas depuis Gaza et une éruption de violence intercommunautaire entre Juifs (soutenus par les soldats et la police israéliens) et Palestiniens qui a embrasé l'ensemble du territoire situé entre la mer Méditerranée et le Jourdain, pour la première fois depuis 1948. 2022 et 2023 ont vu un nombre record de Palestiniens tués par des soldats et des colons israéliens, ainsi qu'un pic d'attaques contre des Israéliens. Puis vint le 7 octobre, preuve ultime qu'essayer de marginaliser la lutte palestinienne, c'est comme ignorer un séparateur d'autoroute : cela se termine par une collision fatale.
Que Trump le comprenne ou non, sa nouvelle approche consiste essentiellement à dire : si nous ne pouvons pas contourner les Palestiniens, expulsons-les. « J'ai entendu dire que Gaza ne leur a vraiment pas porté chance“, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en début de semaine, ajoutant qu'il serait donc préférable que l'ensemble de la population de la bande déménage vers un « bon et beau morceau de terre tout frais ».
L'un des premiers critères d'examen de l'idée est sa faisabilité. De ce point de vue, elle est manifestement vouée à l'échec. Les chances que plus de 2 millions de Palestiniens – dont la plupart sont des réfugiés ou des descendants de réfugiés de la Nakba de 1948 qui, depuis 75 ans, demeurent dans des camps de réfugiés à Gaza plutôt que de quitter leur patrie – acceptent aujourd'hui de la quitter sont proches de zéro.
La probabilité que des pays comme la Jordanie ou l'Égypte acceptent ne serait-ce qu'une fraction de cette population est tout aussi faible, car une telle décision pourrait déstabiliser leurs régimes. Et l'idée que les États-Unis, après avoir mis fin à des occupations longues, coûteuses et meurtrières en Irak et en Afghanistan, seraient maintenant prêts à « posséder » Gaza, à la gouverner et à la développer semble tout aussi farfelue.
Mais ce plan est pire que la somme de ses parties. Même sans avancer d'un pouce, il a déjà eu un impact profond sur le discours politique juif-israélien. En réalité, il serait peut-être plus judicieux de dire que la proposition de Trump puise dans un profond courant sous-jacent de la société juive-israélienne.

Aux côtés de M. Trump lors de la conférence de presse, M. Netanyahu a été le premier à saluer l'initiative du président. « C'est le genre de réflexion qui peut remodeler le Moyen-Orient et apporter la paix », a-t-il proclamé. Sans surprise, les leaders de la droite messianique israélienne se sont également empressés d'exprimer leur joie face à cette proposition, traitant la conférence de presse de M. Trump comme une révélation divine. Mais ils étaient loin d'être les seuls.
Benny Gantz, qui a quitté le gouvernement en raison de la direction de la guerre à Gaza, a qualifié le plan de transfert de M. Trump de « créatif, original et intéressant ». Yair Lapid, chef du parti centriste Yesh Atid, a qualifié la conférence de presse de « positive pour Israël ». Yair Golan, chef du parti démocrate sioniste de gauche, s'est contenté de commenter l'impraticabilité de l'idée. C'est comme si les politiciens de l'ensemble du spectre sioniste avaient simplement attendu le moment où le nettoyage ethnique recevrait le sceau d'approbation « Made in America » pour l'adopter.
Ce poison transfériste n'est pas près d'être éliminé de la circulation sanguine israélienne. Et les conséquences pourraient être catastrophiques pour l'ensemble de la région.
Pas d'incitation à la négociation
Même sans bottes américaines sur le terrain, le sentiment qu'Israël est tombé sur une occasion historique de vider la bande de Gaza de ses habitants palestiniens donnera un élan énorme aux demandes de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben Gvir, qui pressent Netanyahou de faire sauter le cessez-le-feu avant qu'il n'atteigne sa deuxième phase, de conquérir Gaza et de construire les colonies juives dans la bande de Gaza. Netanyahou, qui a semblé quelque peu embarrassé par la franchise de Trump, est lui-même favorable à l' idée de « réduire » la population de Gaza et pourrait bien céder à ces exigences, surtout s'il craint de perdre sa coalition.
Quant à l'armée israélienne, un haut fonctionnaire cité par le site d'information israélien Ynet a qualifié l'initiative de Trump d'« excellente idée ». Par ailleurs, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), l'organe de l'armée chargé de superviser les affaires humanitaires à Gaza et en Cisjordanie, a déjà commencé à élaborer des plans. Si, par exemple, l'Égypte refuse que le point de passage de Rafah soit utilisé pour faciliter le nettoyage ethnique de Gaza, l'armée peut ouvrir d'autres itinéraires « depuis la mer ou la terre et de là vers un aéroport pour transférer les Palestiniens vers les pays de destination ».
Même si le cessez-le-feu passe aux phases deux et trois, que les otages sont tous libérés, que l'armée se retire de Gaza et qu'un cessez-le-feu permanent est instauré, le plan de Trump ne disparaîtra pas de la politique israélo-juive. Quelle motivation aurait un gouvernement ou un parti à promouvoir un accord politique avec les Palestiniens si l'opinion publique juive considère leur expulsion comme une alternative viable ? Chaque accord, chaque cessez-le-feu pourrait être perçu comme une étape temporaire vers l'objectif ultime d'un transfert massif. Les possibilités d'une coopération politique juive-palestinienne efficace se réduiront considérablement.
Et pourquoi s'arrêter à Gaza ? Il n'y a aucune raison particulière pour que la proposition de Trump ne soit pas étendue aux Palestiniens de Cisjordanie – une région qu'il considère probablement aussi comme « très malchanceuse » pour eux – ou à Jérusalem-Est, ou même à Nazareth.

Dans la rue palestinienne, le plan de Trump ne fera que miner davantage toute notion de réconciliation avec Israël. Parfois avec enthousiasme, parfois à contrecœur, mais depuis les accords d'Oslo en 1993 (et même avant), les dirigeants politiques palestiniens ont affirmé la possibilité de vivre aux côtés d'un État né du déplacement massif et des ruines de leur propre peuple en 1948. Cela n'a certainement jamais été évident ; il y a eu de nombreux obstacles, beaucoup de double discours, et beaucoup d'opposition violente – notamment de la part du Hamas – mais cette approche est restée dominante pendant des décennies.
Une fois que le président américain propose le transfert comme solution au « problème palestinien » et que tout Israël – de la droite fasciste religieuse au centre libéral et même à la gauche sioniste – y adhère, le message adressé aux Palestiniens est clair : il n'y a aucune possibilité de compromis avec Israël et son protecteur américain, du moins sous sa forme actuelle, parce qu'ils sont déterminés à éliminer le peuple palestinien.
Cela ne signifie pas nécessairement que des masses de Palestiniens se lanceront immédiatement dans la lutte armée, bien qu'il s'agisse là d'un résultat potentiel. Mais il est certain qu'il sera impossible pour tout dirigeant palestinien qui tente de parvenir à un accord avec Israël de conserver le soutien de la population. La légitimité de l'Autorité palestinienne est déjà au plus bas ; en s'engageant à nouveau dans un processus politique avec Israël dans l'ombre du plan de Trump, elle ne fera que se détériorer davantage.
Une recette pour la guerre régionale totale
Et le danger ne s'arrête pas là. Trump, dans son ignorance totale du Moyen-Orient (tout au long de la conférence de presse, il a répété que « les Arabes et les Musulmans » bénéficieraient de la prospérité que son plan apporterait), a « régionalisé » la question palestinienne, considérant que sa résolution n'était pas l'affaire des Juifs et des Palestiniens vivant entre le fleuve et la mer, mais qu'il se déchargeait de cette responsabilité sur les États environnants. Non seulement il demande à l'Égypte, à la Jordanie, à l'Arabie saoudite et à d'autres pays d'accepter des centaines de milliers de Palestiniens sur leur territoire, mais il leur demande également de signer l'enterrement de la cause palestinienne.
Une telle demande constitue une menace directe pour les régimes du monde arabe. Le gouvernement jordanien craint qu'un afflux important de Palestiniens dans son royaume n'entraîne sa chute en perturbant le fragile équilibre démographique du pays, qui penche déjà fortement du côté palestinien. Mais même dans d'autres pays moins directement liés à la Palestine, la situation est tout aussi fragile. Il suffit de regarder les chaînes d'information saoudiennes le jour de l'annonce de Trump pour saisir le niveau de choc, de menace et de peur entourant cette décision.
Quinze ans avant que l'OLP ne fasse un compromis historique avec l'État d'Israël, l'Égypte avait conclu que non seulement elle pouvait accepter l'existence d'Israël dans la région, mais qu'elle pouvait aussi en tirer profit, et avait signé le traité de paix de 1979. La Jordanie lui a emboîté le pas et, il y a quatre ans et demi, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont adopté la même ligne de pensée. Même sans avoir officiellement normalisé ses relations avec Israël, l'Arabie saoudite, poids lourd de la région, semble être parvenue à une conclusion similaire.

Mais la démarche bulldozer de Trump, et l'adhésion spontanée d'Israël à cette démarche, pourraient indiquer aux régimes du Moyen-Orient – y compris ceux qualifiés de « modérés » (qui, en réalité, sont souvent plus autocratiques que les autres) – que le compromis est futile. Il suggère qu'Israël, grâce à sa puissance militaire et au soutien des États-Unis, pense pouvoir imposer à la région toutes les solutions qu'il souhaite, y compris le déplacement forcé de millions de personnes de leur patrie et le déni de leur droit à l'autodétermination, presque universellement reconnu.
Au cours de l'année et demie écoulée, Israël ne s'est pas contenté de commettre des massacres à Gaza et de détruire les infrastructures nécessaires à la vie humaine. Il a également occupé des parties du Liban et refuse de les quitter en violation de l'accord de cessez-le-feu ; il s'est emparé de certaines parties de la Syrie et n'a pas l'intention de les quitter de sitôt. Cette réalité ne fait que renforcer l'impression qu'Israël a décidé qu'il pouvait établir un nouvel ordre au Moyen-Orient par la force pure et simple, sans aucun accord ni aucune négociation.
La guerre de 1973 a été la dernière fois qu'Israël s'est battu contre les armées d'États souverains plutôt que contre des organisations militantes non étatiques, qui ont toujours été beaucoup plus faibles. Même si les manuels d'histoire israéliens affirment aujourd'hui qu'Israël n'a aucune responsabilité dans cette guerre, il ne fait aucun doute que l'Égypte et la Syrie l'ont déclenchée parce qu'elles avaient compris qu'il n'y avait aucune chance de récupérer pacifiquement les territoires qu'Israël avait occupés en 1967.
La voie qu'Israël suit aujourd'hui, sous l'influence de Trump, pourrait le conduire au même endroit, où ses voisins concluront qu'Israël ne comprend que la force. En effet, Middle East Eye a cité des sources à Amman déclarant que la Jordanie est prête à déclarer la guerre à Israël si Netanyahou tente de transférer de force des réfugiés palestiniens sur son territoire.
Cette situation n'est pas inévitable, bien sûr. Beaucoup de choses dépendent des caprices de Trump et de sa détermination à donner suite à ses déclarations face à l'opposition mondiale. La résistance doit venir non seulement des Palestiniens, mais aussi des Juifs d'Israël qui comprennent qu'ils n'ont pas d'avenir ici sans vivre sur un pied d'égalité avec les habitants de la terre. Elle pourrait également prendre la forme de nouvelles coalitions au Moyen-Orient et au-delà, qui refuseront d'accepter les diktats américains.
Ce qui est clair, c'est que les projets belliqueux de Trump, et la tentative pathétique d'Israël de surfer sur la vague, comportent le risque très réel d'être contrés par la force. Et ce serait désastreux pour tout le monde.
Meron Rapoport est rédacteur à Local Call.
Une version de cet article a d'abord été publiée en hébreu sur Local Call. Lire l'article ici.
Traduction depuis l'anglais : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : +972 Magazine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
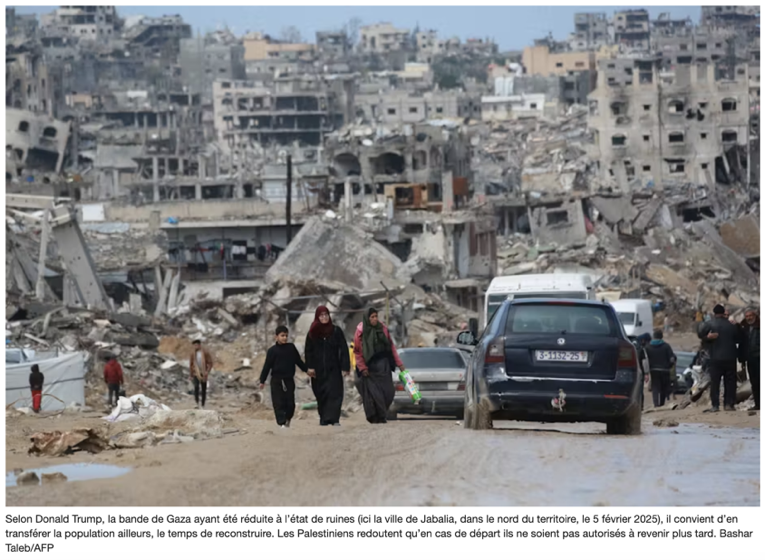
Moyen-Orient. « Transférer » les Palestiniens : quand Donald Trump réactive un vieux fantasme de l’extrême droite israélienne
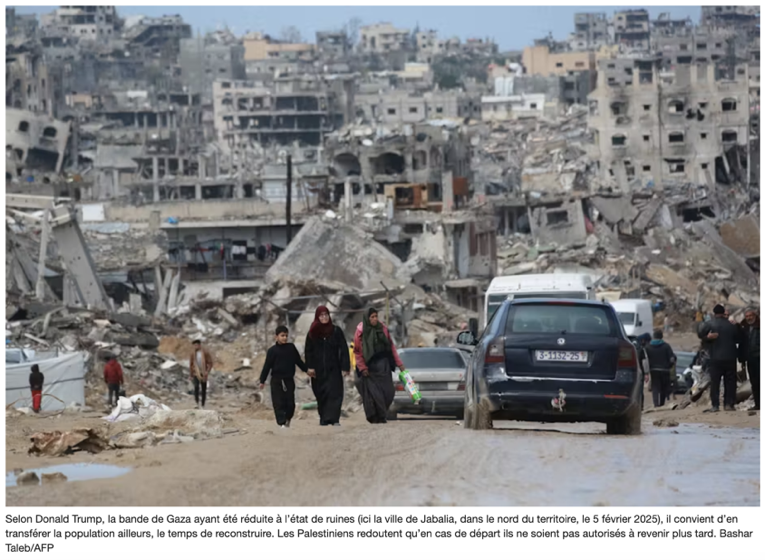
L'idée de Donald Trump n'est pas vraiment originale. Voilà des décennies que l'éventualité d'une expulsion massive des Palestiniens de Gaza, mais aussi de Cisjordanie, est caressée par certaines franges de la classe politique israélienne.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Le 25 janvier, Donald Trump exprimait son souhait de « nettoyer » la bande de Gaza, devenue d'après lui « un véritable chaos » :
- « Il s'agit littéralement d'un chantier de démolition. Presque tout est détruit et les gens meurent là-bas. Je préfère m'impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements dans un endroit différent où ils pourront vivre un jour en paix. »
Le président américain ajoutait s'être entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie pour le presser d'accepter sur son territoire des millions de Palestiniens, et comptait prendre attache avec le président égyptien Abd al-Fattah al-Sissi en vue de formuler la même demande.
Quelques jours plus tard, lors d'une visite du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou à Washington pour discuter de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, Trump réitérait ses propos en précisant que les États-Unis déploieraient des troupes pour faire de la petite enclave méditerranéenne leur « propriété » et « la Côte d'Azur du Moyen-Orient ».
Après ces déclarations choc, il importe de recontextualiser cette idée de « transfert » des Palestiniens, illégale du point de vue du droit international mais, en réalité, déjà ancienne dans la longue chronologie de ce conflit.
Entre sidération, indignation et acclamations
Les réponses à la proposition faite par la nouvelle administration américaine d'une évacuation des populations palestiniennes furent immédiates et, bien entendu, prévisibles.
Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est dit scandalisé et a rejeté avec virulence tout projet d'occupation, d'annexion et de déplacement, tandis qu'un communiqué du Hamas soutenait que « les habitants de Gaza ont enduré la mort et ne quitteront leur patrie sous aucun prétexte ». Quant au Djihad islamique, qui, rappelons-le, avait pris part aux tueries du 7 octobre 2023, il fustigeait dans les termes les plus forts « la déportation des Palestiniens hors de leur terre », ajoutant que ce projet relevait d'une négation pure et simple de l'identité palestinienne.
L'Égypte et la Jordanie, mais également ces « nations arabes » dont Trump avait suggéré qu'elles pourraient accueillir des millions de réfugiés palestiniens, s'opposaient tout autant à cette option, notamment l'Arabie saoudite, pour qui la seule issue possible et acceptable reste la solution à deux États.
Désemparée, la communauté internationale se retrouvait quant à elle dans un état de sidération face à ce virage pris par Washington, à savoir celui d'une neutralisation de la « question palestinienne » dans ce Moyen-Orient en pleine reconfiguration.
Et sans surprise, les représentants de l'extrême droite israélienne, favorables depuis le début de la guerre à une recolonisation de Gaza, se réjouissaient de cette annonce, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, chef du parti sioniste religieux Mafdal, la qualifiant d'« excellente idée ».
Transfert : les racines anciennes d'un concept
Quoique cet aspect soit peu mentionné, voire tabou devant le déchaînement de passions qui a entouré la relance et l'escalade meurtrière des hostilités entre Israéliens et Palestiniens, il faut aller chercher les origines de cette notion de « transfert » dans les premières années du nazisme et la réponse alors développée par certaines organisations sionistes.
Le 25 août 1933, sur fond de persécutions grandissantes, est en effet signé entre, d'une part, l'Allemagne nazie et, d'autre part, les autorités juives et sionistes déjà établies en Palestine, essentiellement commandées par l'Agence juive, l'accord dit « Haavara » (« transfert » en hébreu), qui prévoit la migration de 50 000 à 60 000 Juifs allemands vers la Palestine, alors sous mandat britannique. Cet accord est loin de faire l'unanimité et provoque de nombreuses résistances, au sein même du courant sioniste comme parmi la communauté juive élargie. Il n'en reste pas moins perçu par ses promoteurs comme l'unique recours face à un environnement de plus en plus hostile, en Allemagne comme ailleurs sur le continent européen.
L'idée d'un transfert des Juifs d'Europe vers la Palestine a très tôt mué en un concept inscrit au cœur même du « Nouveau Yichouv » (« peuplement » en hébreu), ce mouvement d'implantation d'un certain nombre de Juifs en Palestine entre la seconde moitié du XIXe siècle et 1948, qu'il convient de distinguer du « Vieux Yichouv », qui désignait la présence juive dans la Palestine alors encore sous domination ottomane, soit les anciennes communautés juives historiques. Au moment de la partition de 1947, on recense près de deux millions d'habitants, dont 630 000 Juifs et 1 340 000 Arabes, dont plus de la moitié vivant dans les frontières du futur État juif qui se proclamera bientôt indépendant.
Tout au long de la première moitié du XXe siècle, les nouveaux arrivants juifs entretiennent avec ces populations arabes établies en Palestine des relations fluctuantes – entre indifférence, coexistence précaire et sentiment de supériorité.
La « question arabe » ne cessera de constituer un obstacle aux yeux de ceux qui aspirent à la création d'une nation juive majoritaire – comme il a été souligné, jusqu'en 1947 les Palestiniens représentaient encore l'écrasante majorité des habitants et possédaient aussi la plupart des terres. L'idée d'un transfert de ces autochtones vers les États arabes alentour, que Theodor Herzl adoubait lui-même explicitement dans ses écrits, progresse ainsi dans les esprits, surtout celui du père fondateur de l'État d'Israël, David Ben Gourion.
Après le 7 Octobre, la réactualisation d'une idée
Les modalités pratiques d'un tel plan n'ont cependant jamais fait l'objet d'un consensus parmi les élites israéliennes et la rhétorique actuelle fait plutôt écho aux positions les plus dures qui avaient été adoptées avant 1948 par le Fonds national juif notamment, une organisation fondée à Bâle en 1901 dont la raison d'être était l'achat de terres en Palestine et la préparation des premiers « pionniers » juifs. Cet organisme considérait en effet que la réalisation du rêve d'un État juif devrait nécessairement passer par le contrôle le plus extensif possible du territoire.
À défaut d'un transfert complet et définitif des Palestiniens au cours de la Nakba (« catastrophe » en arabe, terme employé pour désigner l'exode de centaines de milliers de Palestiniens à la suite de la défaite des armées arabes face à Israël lors de la première guerre israélo-arabe de 1948), ce sont des transferts locaux et des déplacements internes qui ont eu lieu, conduisant une partie des Palestiniens à opter pour le ralliement à l'État hébreu dont ils sont depuis des citoyens (aujourd'hui, près de 20 % des citoyens d'Israël sont arabes).
Or, l'idée d'un transfert plus massif des populations arabes de Palestine, telle qu'envisagée dès les années 1930 par la frange extrême du mouvement sioniste, n'a jamais fondamentalement disparu, resurgissant à chaque nouvelle guerre qui opposa Israël à ses adversaires locaux et régionaux, puis en réaction aux actions terroristes palestiniennes.
C'est cette violence qui a fini par convaincre de larges pans de la société israélienne qu'aucune paix durable ne serait jamais possible avec les Arabes et que la fondation d'un État palestinien indépendant et souverain aux portes d'Israël serait bien plus une menace existentielle qu'un gage de sécurité. Tragiquement, les événements du 7 Octobre sont venus renforcer cette conviction et éclairent sans doute aussi pourquoi une grande partie des Israéliens considèrent avec bienveillance le plan proposé par Donald Trump pour Gaza.
Trump réalisera-t-il son projet pour Gaza ?
Toute la question consiste dès lors à savoir si le président américain fraîchement investi a réellement l'intention, et plus encore les moyens, de cette stratégie de la table rase dans un Proche-Orient où, in fine, l'insoluble question palestinienne n'en serait plus une.
Depuis les annonces faites par le nouvel occupant de la Maison Blanche, ses conseillers s'emploient comme ils le peuvent à éteindre l'incendie en modérant ses propos et en indiquant qu'il ne s'agirait que d'un transfert « temporaire » des Gazaouis, le temps de la reconstruction des villes dévastées au cours des quinze derniers mois de guerre. Depuis le Guatemala, le secrétaire d'État Marco Rubio est allé jusqu'à évoquer « une offre généreuse » destinée à reconstruire Gaza et à la débarrasser de ses gravats, mines et autres munitions non explosées pour en faire un espace de nouveau vivable.
Du côté des principaux intéressés, les Palestiniens, après une guerre inédite par sa violence et qui a totalement anéanti leur habitat suivant une logique d'authentique urbicide, il va sans dire que la perception est radicalement différente et que ces affirmations intempestives font davantage craindre le scénario d'une seconde Nakba dont ils risqueraient de ne jamais se remettre. Le pire leur semble d'autant plus crédible que la colonisation de la Cisjordanie s'est accélérée et intensifiée ces derniers mois, hypothéquant toute perspective à court ou moyen terme d'un État palestinien.
Myriam Benraad, Responsable du Département International Relations and Diplomacy, Schiller International University - Enseignante en relations internationales, Sciences Po
• The Conversation. Publié : 8 février 2025, 13:18 CET.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.
Myriam Benraad, Sciences Po" class="spip_out" rel="external">Myriam Benraad est politologue, docteure en science politique de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) et professeure en relations internationales, géopolitique et négociation. Elle dirige notamment le département International Relations and Diplomacy à l'Université internationale Schiller à Paris.
Ses travaux récents portent sur la problématique de la vengeance et des émotions dans leurs rapports à la violence politique et aux transformations internationales. Elle est l'auteure, entre autres publications, de L'Etat islamique est-il défait ? (CNRS Editions, 2023) ; L'Irak par-delà toutes les guerres. Idées reçues sur un Etat en transition (Paris, Cavalier Bleu, 2023) ; Terrorisme : les affres de la vengeance. Aux sources liminaires de la violence (Paris, Cavalier Bleu, 2021) ; Géopolitique de la colère. De la globalisation heureuse au grand courroux (Paris, Cavalier Bleu, 2020). Adresse électronique : myriam.benraad@schiller.edu
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Équateur menace d’aggraver les violations des droits de la personne dont sont victimes les nations et les communautés autochtones

Appel │ SIGNEZ et MARCHEZ pour un avenir juste et égalitaire

Depuis 25 ans, la Marche mondiale des femmes porte les centaines de milliers de voix de celles et ceux qui exigent, partout dans le monde, des changements réels et durables pour les femmes.
Cette année, avec le Collectif 8 mars nous nous unissons à la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes - CQMMF pour rappeler que nous sommes :
🔥ENCORE EN LUTTE pour mettre fin aux violences faites aux femmes.
🔥 ENCORE EN LUTTE contre la pauvreté vécue par les femmes.
🔥 ENCORE EN LUTTE pour la justice climatique féministe.
Signez la lettre de soutien aux orientations de la CQMMF et montrez que vous aussi, vous êtes ENCORE EN LUTTE !
Pour signer 👉 https://bit.ly/417D6MR
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Sous Ford, le chômage en Ontario au plus haut niveau en dix ans
Une formation unique au Québec : L’Écologie Intégrée pour une transition socio-écologique inspirante
Amazon est partout, la résistance l’est tout autant !
Échos de l’âme : un hommage à Jacques Roumain

Révolution québécoise, une revue « pour l’établissement d’un véritable socialisme »
Dans les années 1960, de nombreux mouvements contestataires émergent en Occident que l’on réunit sous l’appellation de Nouvelle gauche. Cette dernière désire renouveler l’analyse marxiste, tout en introduisant des pratiques militantes originales. Au Québec, plusieurs groupes s’inscrivent dans cette mouvance et cherchent une voie d’émancipation sociale, culturelle et économique. C’est le cas de l’équipe de Révolution québécoise qui joue un rôle central dans la discussion radicale avant que ses dirigeants ne rejoignent le Front de libération du Québec à l’automne 1965[1].
En juin 1960, le Parti libéral du Québec de Jean Lesage remporte les élections provinciales mettant fin à plus de quinze ans de règne de l’Union nationale. Le nouveau gouvernement introduit plusieurs mesures progressistes, notamment la restructuration de l’éducation, de la santé et des affaires sociales que l’État prend dorénavant en charge plutôt que l’Église catholique. Au niveau économique, les libéraux appuient la consolidation de la bourgeoisie francophone au Québec, tout en procédant à certaines nationalisations, dont celle de l’électricité en 1962. Pourtant, dès cette époque, plusieurs militant·es trouvent ces actions insuffisantes. Les plus radicaux soulignent que le progrès du Québec ne dépend pas du développement d’une bourgeoisie nationale, mais doit plutôt viser l’émancipation des masses laborieuses. Leurs réflexions tentent d’arrimer l’indépendance du Québec et la libération de son peuple, dont on trouve une première formulation dans la Revue socialiste (1959). Son directeur, Raoul Roy, affirme : « Seul l’établissement, par l’outil socialiste, d’une république souveraine, parce que seul le socialisme affranchit des chaînes capitalistes et de l’oppression nationale, émancipera le Québec du joug des colonialistes et de l’expansionnisme impérialiste du capital étranger. »[2]
Dans ce contexte, diverses organisations émergent, dont le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN, 1960-1968) et le Front de libération du Québec (FLQ, 1963-1972), ainsi que des revues comme Parti pris (1963-1968) et Révolution québécoise (1964-1965)[3]. Cette dernière est issue de la rencontre entre Pierre Vallières et Charles Gagnon, deux jeunes intellectuels déçus des publications existantes. À la différence de l’étapisme promu par Parti pris (indépendance d’abord, socialisme ensuite), la revue Révolution québécoise adopte une position plus fondamentalement marxiste, affirmant dans sa présentation liminaire : « La sécession en elle-même est une mesure à combattre, si elle n’est pas nécessitée par l’établissement au Québec d’une économie de type socialiste. »[4] Ceci dit, la revue défend l’indépendance si elle est réalisée par les prolétaires québécois dans l’optique de leur libération et de l’instauration d’un régime socialiste. La question de la lutte des classes est au cœur des huit parutions que connaît la revue jusqu’en avril 1965, ainsi que la volonté de lier la théorie et la pratique révolutionnaire.

« Abolir l’exploitation de l’homme par l’homme »
À l’été 1964, lorsque Pierre Vallières décide de lancer Révolution québécoise, il est déjà connu en tant que secrétaire général du Syndicat des journalistes de Montréal (affilié à la CSN), leader de la grève en cours à La Presse et ancien collaborateur de la revue Cité libre. Charles Gagnon, quant à lui, est chargé de cours de l’Université de Montréal et a déjà publié quelques textes. Grâce à leur stature et à un climat social favorable, la revue exerce un certain attrait, dont témoigne la présence de Pierre Vadeboncœur dans ses pages. La revue se distingue par son intransigeance qui lui donne sa saveur et fait son intérêt. Dans une époque marquée par un nationalisme québécois censé rassembler tous les groupes de la société, il n’est pas bienvenu de souligner que la bourgeoisie québécoise travaille pour son propre intérêt et qu’elle est pratiquement aussi nuisible aux classes laborieuses que la bourgeoisie anglo-canadienne. Vallières précise : « Les travailleurs ne doivent avoir aucun scrupule à exploiter à leur profit et au maximum les compétitions très vives qui existent entre les capitalistes canadian et les capitalistes québécois. […] Le Québec demeurera l’appendice pauvre d’un système qui couvre la moitié du monde et qui favorise l’exploitation du plus grand nombre possible de pays au profit des actionnaires américains et de leurs amis, tant que la bourgeoisie québécoise conservera l’initiative de l’affirmation nationale. »[5]
Afin de participer au développement d’un mouvement révolutionnaire au Québec, la revue prône un travail d’éducation en vue de développer une conscience de classe antagonique et la formation d’un parti socialiste québécois axé sur la lutte contre le capital. « La propagande et l’organisation sont les deux jambes de la révolution en marche. »[6] Pour se faire, l’équipe déploie un effort visible de documentation des luttes ouvrières en cours, par exemple la grève de Bellerive Veneer and Plywood (Mont-Laurier), les luttes dans le secteur du textile ou le conflit à La Presse. Charles Gagnon, impliqué dans le mouvement étudiant, critique son manque de vision. En termes de modèles, la revue sollicite l’exemple de Cuba où une révolution populaire a renversé la dictature pro-américaine et instauré un régime socialiste très dynamique. L’idée générale qui habite la revue est la suivante : se lier avec les travailleur·euses en documentant leurs luttes, utiliser celles-ci comme exemples pour faire comprendre le système d’exploitation et la nécessité de son dépassement, puis encourager l’organisation révolutionnaire en s’inspirant de modèles internationaux. En somme, il faut passer d’une révolution tranquille à une révolution active.



Du Mouvement de libération populaire à la lutte armée
En plus de ses réflexions, l’équipe de Révolution québécoise participe à l’organisation politique concrète. En mars 1965, elle intègre un comité de coordination des mouvements de gauche comprenant Parti pris, le Parti socialiste du Québec, la Ligue socialiste ouvrière et plusieurs autres. Durant le printemps et l’été, le projet d’alliance se cristallise et plus de 150 personnes adhèrent au Mouvement de libération populaire (MLP). Alors que Révolution québécoise cesse de paraître en avril 1965 en raison de difficultés financières, ses dirigeants s’impliquent dynamiquement dans la nouvelle organisation. Pierre Vallières indique : « C’est dans cette perspective d’action directe que l’équipe de Révolution québécoise se joint à celle de Parti pris, moins pour écrire dans la revue que pour agir à partir du mouvement suscité par elle. »[7] Malheureusement, la formation éprouve des difficultés de deux ordres : d’abord, elle peine à recruter au-delà de ses adhérent·es initiaux·ales, ensuite, elle n’arrive pas à choisir entre le travail de masse et l’action avant-gardiste. De fait, la plupart des militant·es du MLP sont attiré·es soit par les grandes organisations existantes, soit par la lutte armée. En mars 1966, une majorité de membres du MLP rejoignent le Parti socialiste du Québec, alors que Vallières et Gagnon ont déjà intégré le FLQ.
Charles Gagnon explique dans le texte Violence, clandestinité et révolution (juin 1966)[8] que la lutte armée est nécessaire afin de provoquer un durcissement du pouvoir qui révélera aux travailleurs sa véritable nature. Le prolétariat sera ainsi poussé à la révolte, dont le FLQ pourra prendre la direction afin de mener à terme le processus révolutionnaire et d’instaurer le socialisme. Malgré les attentats et la répression, cette stratégie échoue, ce dont conviennent Vallières et Gagnon à l’hiver 1971-1972, le premier choisissant d’appuyer le Parti québécois, le second de lancer l’organisation marxiste-léniniste EN LUTTE !. Ainsi, c’est Charles Gagnon qui renoue avec le projet initial de Révolution québécoise, faisant écho aux desseins d’un syndicaliste qu’il interviewait en février 1965 : « Lorsqu’on va se battre systématiquement pour les travailleurs, ils vont retrouver leur dignité et le sens de leurs responsabilités et à partir de là, nous pourrons construire une société nouvelle à la mesure des travailleurs, faite pour eux et dirigée par eux. »[9]

Par Alexis Lafleur-Paiement, membre du collectif Archives Révolutionnaires
Notes
[1] Cet article est initialement paru dans le numéro 101 de la revue À Bâbord !
[2] « Propositions programmatiques de la Revue socialiste », Revue socialiste, no 1 (printemps 1959), page 21.
[3] Tous les numéros de Révolution québécoise sont disponibles en version numérisée : https://archivesrevolutionnaires.com/documents-numerises/
[4] « Présentation », Révolution québécoise, no 1 (septembre 1964), page 5.
[5] VALLIÈRES, Pierre. « Le nationalisme québécois et la classe ouvrière », Révolution québécoise, no 1 (septembre 1964), pages 18-19.
[6] ROCHEFORT, Jean. « Socialisme et sécession », Révolution québécoise, no 1 (septembre 1964), page 39.
[7] VALLIÈRES, Pierre. « Pour l’union de la gauche », Parti pris, vol. 2, nos 10-11 (juin-juillet 1965), page 103.
[8] Disponible dans GAGNON, Charles. Écrits politiques, vol. 1, Montréal, Lux, 2006, pages 11-30.
[9] « Vers une conscience de classe », Révolution québécoise, no 6 (février 1965), page 17.
Les travailleurs et travailleuses en lock-out depuis novembre
Une organisation ouvrière occupe un entrepôt d’Intelcom à Montréal
Allemagne : entrevue avec Stefan Liebich, parlementaire de Die Linke pendant 25 ans, sur les élections du 23 février
Accueil de la petite enfance et précarité : une problématique persistante

Appuyons les licencié-es et boycottons Amazon !

Soyons nombreux dans les rues de Montréal le samedi 15 février en appui aux 4500 travailleurs et travailleuses licenciés par Amazon et ses sous-contractants. Le 22 janvier dernier Amazon, annonçait son intention de fermer ses sept centres de distribution au Québec en guise de représailles à la syndicalisation de son entrepôt de Laval.
Cette décision brutale est contraire à nos lois du travail et démontre tout le mépris qu'à cette multinationale et son grand patron Jeff Bezos, allié de Donald Trump, envers les travailleurs et travailleuses du Québec. Nous devons riposter énergiquement en boycottant les produits d'Amazon et en exigeant que tous les paliers de gouvernement et toutes les institutions publiques cessent de s'approvisionner auprès de cette multinationale.
L'intersyndicale de Québec solidaire invite tous les membres du parti à se joindre à ce grand mouvement de boycottage et à le populariser dans leurs communautés. C'est une lutte ouvrière et une résistance populaire à l'impérialisme trumpiste !
Suivez le mouvement de boycottage ICI, ON BOYCOTTE AMAZON
https://www.facebook.com/boycottamazon.ca
Les travailleurs et les activistes se rassemblent à la porte d’Amazon
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












