Derniers articles
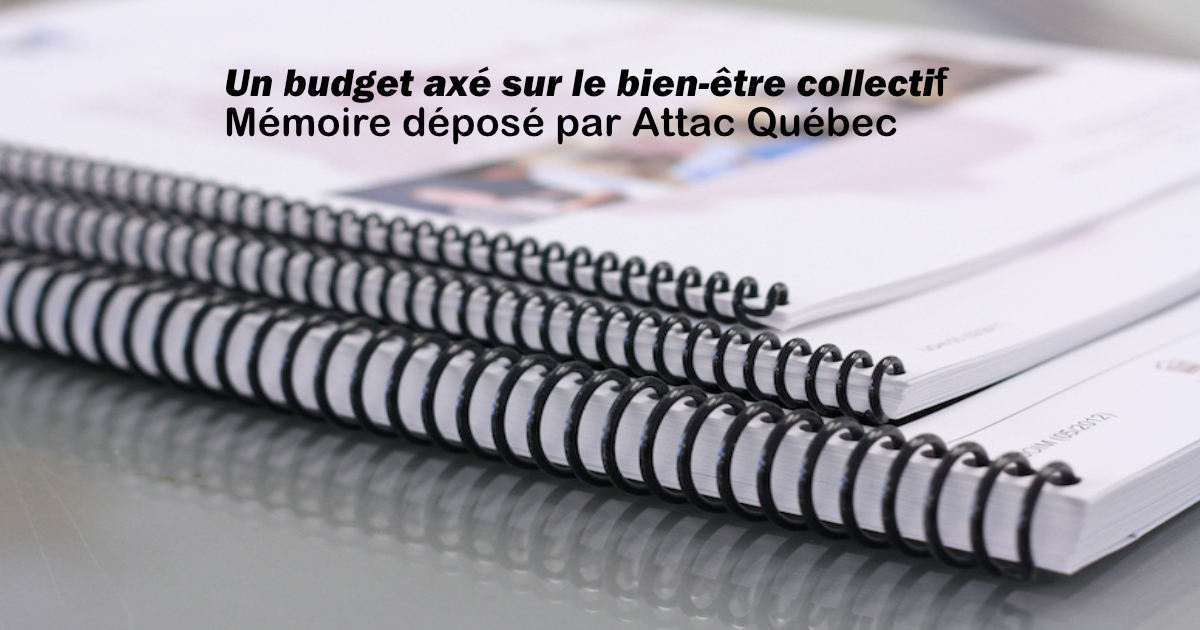
Un budget axé sur le bien-être collectif, mémoire d’Attac Québec
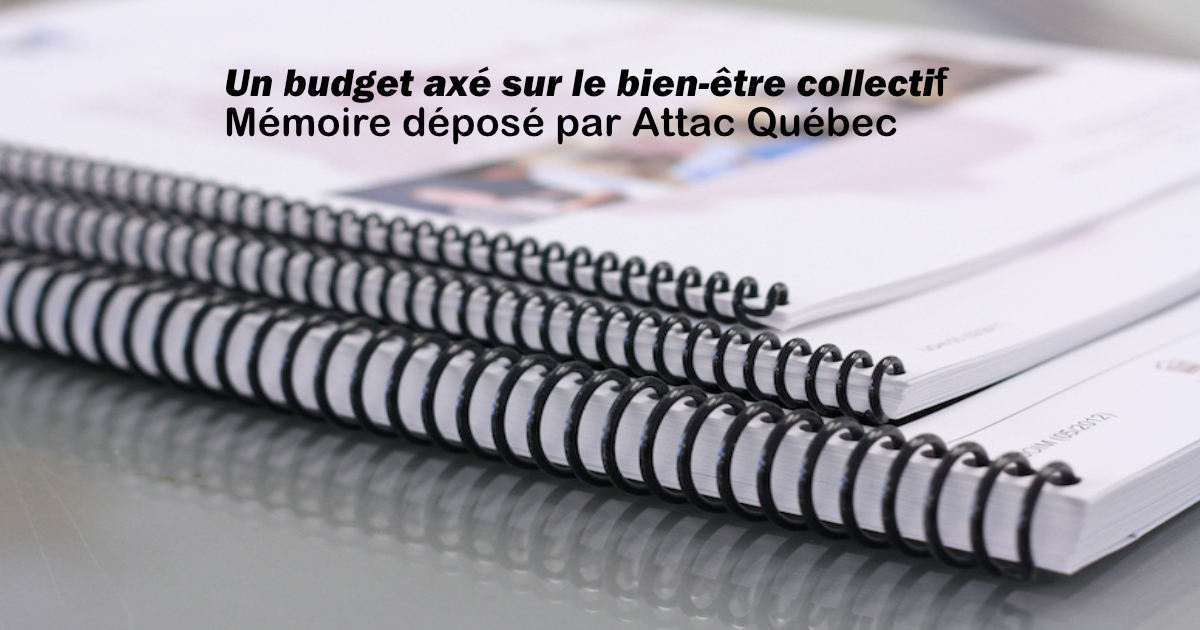
Presse Toi à Gauche vous invite à lire des extraits du mémoire d'Attac Québec dans le cadre des consultations pré-budgétaires du gouvernement du Québec.
Mémoire présenté à M. Éric Girard, Ministre des Finances du gouvernement provincial, dans le cadre des consultations pré-budgétaires 2024-2025
En réponse à l'appel de la Coalition Main rouge, dont Attac Québec est membre, l'association citoyenne vient d'envoyer son mémoire au ministre provincial des Finances, Éric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires.
Ce document de 14 pages, intitulé « un budget axé sur le bien-être collectif », se divise en deux parties.
Dans la première, alors que le discours du gouvernement tend vers les coupures budgétaires et le retour à l'austérité, Attac Québec dépeint l'état de la situation et propose plusieurs recommandations afin de renforcer le filet social québécois.
Dans un second temps, l'action citoyenne pour la justice fiscale, sociale et écologique explique différentes mesures propres à augmenter les revenus de l'État, comme l'augmentation du nombre de paliers d'imposition et de l'effort des grandes entreprises, la taxation sur la richesse et certaines activités financières, la réduction de crédits d'impôts et la lutte à l'évitement fiscal.
En résumé : « pour faire face aux inégalités grandissantes au Québec : la redistribution de la richesse, un filet social fort et une plus grande justice fiscale doivent être une priorité de ce nouveau budget ».
Les plans budgétaires du gouvernement provincial sont annoncés pour le 12 mars prochain.
Voici ci-dessous le mémoire d'Attac Québec “Un budget axé sur le bien-être collectif” :
Pour lire lemémoire cliquez ici
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Prendre la mesure de ce que signifie le discours conflictuel du vice-president US JD Vance lors de l’ouverture de la conférence de Munich sur la sécurité

Dans un discours très conflictuel prononcé lors de la conférence de Munich sur la sécurité, ouverte le 14 février, le vice-président américain JD Vance a déclaré que la « menace intérieure » pesant sur l'Europe était plus grave que celle posée par la Russie et la Chine. Il a critiqué l'annulation d'une récente élection en Roumanie, les poursuites engagées contre un manifestant anti-avortement au Royaume-Uni et l'exclusion de politiciens allemands d'extrême droite et d'extrême gauche de l'événement lui-même...
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
14 février 2025
Par Daniel Tanuro
Le discours du vice-president US JD Vance à Munich, Allemagne, est d'une clarté et d'une brutalité extrêmes. Pour Vance, « la plus grande menace qui plane sur l'Europe ne vient pas de la Chine ou de la Russie ». Elle vient du fait que l'Europe a annulé les élections truquées par l'extrême droite pro-Poutine en Roumanie, que la Grande-Bretagne poursuit un activiste d'extrême droite anti-avortement et que l'UE refuse (jusqu'à présent...) d'autoriser la « libre expression » totale des discours de haine racistes, fascistes, machistes sur les réseaux sociaux, ainsi que les manipulations électorales (comme en Roumanie précisement !). Poutine se frotte les mains, et l'Alternative fur Deutschland (AfD) applaudit ouvertement JD Vance...
Aucun doute n'est permis : il y a entre Trump et Poutine un accord stratégique visant à partager les zones d'influence en Europe et à y établir des régimes autoritaires d'extrême droite dans leurs zones respectives. Cet accord implique à l'Est de briser la résistance du peuple ukrainien et, à l'Ouest, d'appuyer l'extrême droite qui domine déjà en Hongrie et en Italie, ou participe au pouvoir dans plusieurs autres pays, et risque d'y accéder en Allemagne et en France. Trump et Poutine collaborent clairement dans ce but, comme le montrent les déclarations récentes de Trump en faveur du dépeçage de l'Ukraine et d'un changement de régime à Kyiv.
C'est un tournant majeur. Il apparaît brutalement en pleine lumière aujourd'hui, mais ne tombe pas du ciel. Il exprime la nécessité pour le capital, dans un contexte de concurrence exacerbée, de mettre en place des régimes autoritaires, afin de continuer a détruire la société et la nature pour le profit. En liquidant les droits démocratiques et sociaux, et en niant les avertissements scientifiques sur la gravité de la crise écologique-climatique.
Ainsi, on voit se dessiner nettement le projet d'un monde multipolaire domine par la triade Trump-Poutine-Xi Jiping. Au sein de cette triade, la lutte pour l'hégémonie entre les USA et la Chine donnera un rôle de pivot à la Russie. Les cadeaux de Trump à Poutine ont précisément pour but d'éloigner celui-ci de Xi. (Dans ce cadre, NB, les élucubrations de Trump sur la défense de la foi chrétienne ont aussi un certain sens...). En même temps, tout cela est motivé non seulement par la crainte mais aussi par l'admiration de Trump et du Grand Capital US pour la remarquable « efficacité » du despotisme high-tech chinois qui, en quelques décennies à peine, a construit une économie capitaliste capable de menacer la pole position mondiale de l'empire US... tout en maintenant les masses sous contrôle. D'ou le ralliement des Zuckerberg, Bezos, etc., à la croisade de Musk, le lumpen-capitaliste qui fait le salut fasciste.
Face à ce projet, certains croiront devoir se mobiliser pour la défense de l'UE comme incarnation des « valeurs démocratiques ». C'est oublier que l'UE est une structure profondement despotique qui ne se définit pas par ces « valeurs » mais comme « une économie de marché ouverte où la concurrence est libre ». En tant que telle, elle participe activement à l'extrême droitisation du monde, à la fois par ses politiques anti-sociales (austérité, chasse aux migrants, etc.) et par le détricotage de ses très insuffisantes (et très injustes !) politiques soi-disant « écologiques ».
La seule issue, pour une gauche digne de ce nom, est de lutter pour les droits démocratiques et sociaux, et contre la destruction écologique, tout en s'attelant à reconstruire un internationalisme par en-bas. Cela implique de rompre avec le poison campiste de ceux qui se sont réjouis de la perspective d'un monde multipolaire, en s'imaginant que ce monde favoriserait « la paix » et l'émancipation des peuples. Il favorise au contraire la guerre et l'oppression.
Daniel Tanuro
P.-S.
• Facebook, le14 février 2025.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Contre le trumpisme et ses avatars, passer à l’offensive

Le combat contre l'extrême droite en voie de trumpisation ne peut pas s'enfermer dans une simple logique défensive. Comme il y a 80 ans, la résistance au nouvel autoritarisme doit réfléchir aux causes du désastre pour proposer les conditions d'une société démocratique renouvelée.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
13 février 2025
Le choc est évidemment terrible. Les États-Unis, jusqu'à peu présentés comme l'exemple absolu du lien indéfectible entre démocratie et capitalisme, basculent en ce début d'année 2025 dans un autre monde. Les premiers actes de l'administration Trump trahissent un coup d'État de facto visant à rendre caduque la Constitution des États-Unis.
L'irruption d'un régime à caractère néofasciste dans la principale puissance militaire et économique du monde cause une sidération naturelle et entraîne un réflexe bien compréhensible : celui de tenter de sauvegarder « le monde d'avant » qui, naturellement, paraît plus clément que celui promis par Donald Trump et Elon Musk. On s'efforce donc là-bas de sauvegarder les cadres de l'État de droit et ici, en Europe, de sauvegarder ce même État de droit des griffes des thuriféraires et des fondés de pouvoir du nouveau régime états-unien.
Tout cela est évidemment hautement nécessaire et urgent. Mais ce mouvement de résistance ne doit pas se contenter d'une simple posture défensive ou nostalgique. Il ne doit pas viser le retour à une forme de statu quo ante idéalisé. Pour vaincre le retour de l'hydre autoritaire de façon efficace et durable, il faut analyser les conditions de sa réémergence et proposer une alternative démocratique crédible, c'est-à-dire capable d'éviter la répétition du pire.
La référence ici doit ainsi être la Résistance qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en menant la lutte, partout, contre les fascismes allemand, italien et japonais, a mené la réflexion pour construire un monde libéré des conditions d'émergence du fascisme. Et une fois celui-ci vaincu, le combat s'est poursuivi pour construire une société nouvelle.
En France, le Conseil national de la résistance (CNR) a pris acte que la source du péril fasciste était l'abandon des populations face aux crises capitalistes. La lutte antifasciste a donc débouché sur la mise en place d'un État social qui a profondément modifié la société.
On peine aujourd'hui à en prendre conscience, mais la France d'après 1945 est en rupture totale avec celle de l'avant-guerre, qui avait un filet de sécurité sociale parmi les plus réduits d'Occident. Ce changement a été le produit d'une lutte contre les racines de la guerre et du fascisme autant que contre le fascisme lui-même. Et c'est cette démarche qui doit désormais hanter celles et ceux qui entendent s'élever contre la puissance du capitalisme autoritaire contemporain.
Les racines économiques du trumpisme
Pour y parvenir, il faut donc commencer par identifier les racines du coup d'État actuel. Elles se trouvent dans les besoins des secteurs rentiersde l'économie états-unienne et, au premier chef, de celui de la technologie.
C'est, rappelons-le, le produit d'une histoire plus longue, celle d'un ralentissement de l'économie mondiale après la crise de 2008, qu'aucune mesure n'a été capable de conjurer et qui a donné lieu à des méthodes prédatrices dont la conclusion naturelle est la prise de contrôle de l'État états-unien. Incapable de produire de la valeur par les moyens habituels, le capital s'est réfugié dans les secteurs rentiers, où l'on capte la valeur sans passer par les marchés. Mais ces secteurs, pour poursuivre leur accumulation, ont besoin de contrôler la société dans son ensemble, de la soumettre à la pseudo-réalité de leurs algorithmes.
C'est ici que la violence antidémocratique et impériale trumpiste prend sa source.
Les observateurs mainstream qui, jusqu'ici, se complaisaient dans l'apologie d'un capitalisme qu'ils croyaient source de liberté et de démocratie se retrouvent stupéfiés face à l'émergence, pour eux soudaine, d'une « oligarchie », comme l'écrit Serge July dans Libération. Mais il est important de noter combien cette stupeur même est le produit d'une erreur. La position apologétique du capitalisme, validée par le rejet de tout « économicisme », a conduit à un aveuglement sur les forces à l'œuvre depuis un demi-siècle.
Le premier écueil est de croire que le capitalisme néolibéral serait l'antidote à la bascule fascisante d'un Trump.
Ceux qui ont défendu la contre-révolution néolibérale qui, précisément, a cherché à mettre à bas les effets de la lutte antifasciste de l'après-guerre, s'étonnent aujourd'hui de la « contre-révolution » trumpiste, comme le titrait Le Monde du 11 février.
Mais cette rupture est la conséquence logique de la précédente. Puisque le rêve néolibéral d'un marché encadré parfait et efficace a débouché sur le désastre de 2008 et s'est révélé incapable de redresser la productivité et la croissance, les gagnants de ce marché ont pris les choses en main et tentent de construire un monde soumis à leurs intérêts.
Le premier écueil de l'époque est donc de croire que le capitalisme néolibéral serait l'antidote à la bascule fascisante d'un Trump. La tentation peut être réelle d'idéaliser le régime précédent, non seulement parce qu'il était démocratique et moins violent, mais aussi parce qu'on pourrait penser que pour lutter contre les oligarques de la tech, la concurrence et le marché seraient une réponse adaptée. On relancerait donc là le mythe du « capitalisme démocratique », où le fonctionnement d'une économie de marché encadrée serait le socle de la démocratie libérale.
L'ennui, c'est que c'est bel et bien ce « capitalisme démocratique » qui a enfanté de la monstruosité trumpo-muskienne. La sacro-sainte « économie de marché » qui, depuis quarante ans, est parée de toutes les vertus par les intellectuels à la mode est en réalité dans une crise permanente qui ne pouvait déboucher que sur une conclusion autoritaire et monopolistique.
Les marchés « disciplinés »
La concurrence, présentée comme une solution à tous les maux de la société par les néolibéraux, n'est jamais qu'une solution temporaire. Elle débouche inévitablement sur des concentrations, par le jeu même des marchés, et les grands groupes issus de ce phénomène n'ont alors qu'une obsession : préserver leurs positions. Lorsque la croissance est de plus en plus faible, comme aujourd'hui, ils le font par la prise du pouvoir politique et la mise au pas de la société. Lutter contre le trumpisme en réactivant les illusions néolibérales serait dès lors la plus funeste des erreurs.
Ce serait oublier que les populations se sont tournées vers l'extrême droite en grande partie parce que les néolibéraux ont échoué, parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses d'amélioration des conditions de vie et n'ont pas hésité, lorsque le besoin s'en est fait sentir, à recourir à des méthodes musclées.
La dégradation de la démocratie libérale et sa réduction croissante à une formalité électorale ne sont pas une nouveauté trumpiste.
L'échec néolibéral est le berceau même de la xénophobie et du racisme de l'extrême droite.
Depuis les années 1980, les néolibéraux s'acharnent à réduire le rôle des syndicats, à réduire le rôle du collectif dans le travail, à marchandiser les rapports sociaux, à coloniser les imaginaires à coups d'héroïsation des « entrepreneurs ». Le but de ce mouvement est évidemment de contrôler les votes pour éviter toute remise en cause de l'ordre social.
Et si cela ne suffisait pas, les néolibéraux n'ont pas hésité à verrouiller la démocratie en inscrivant dans le droit constitutionnel ou dans les traités internationaux les fondements de leur doctrine. En cas de besoin, la « discipline de marché » venait frapper les sociétés, à l'image de ce qui s'est produit en Grèce depuis 2010. Et, pour finir, le régime néolibéral n'hésitait pas à avoir recours à la répression. Des mineurs britanniques aux « gilets jaunes », la matraque a souvent eu le dernier mot face à la contestation.
Cette politique, par ailleurs inefficace, a pavé la voie à l'horreur trumpiste comme précédemment à la dictature de Vladimir Poutine en Russie, et comme elle a affaibli les démocraties européennes face aux extrêmes droites. Elle a préparé les esprits à la violence, au déni de démocratie, aux situations d'exception, en un mot à la soumission de la société aux intérêts du capital. Logiquement, lorsque l'extrême droite propose une politique sur mesure pour les ploutocrates, une grande partie de la population ne s'en émeut guère.
Enfin, l'échec néolibéral est le berceau même de la xénophobie et du racisme de l'extrême droite. Pour deux raisons. D'abord, parce que, depuis 2008, en voulant se maintenir au pouvoir, les partis néolibéraux n'ont pas hésité à se saisir du thème de l'immigration et à l'instrumentaliser.
Le cas d'Emmanuel Macron qui, par ailleurs, aime à se présenter comme un « anti-Trump », est éloquent. Depuis 2017, le président français joue avec les thèmes de l'extrême droite, jusqu'à la fameuse loi immigration de fin 2023, avec pour seul résultat de faire de cette même extrême droite la première force du pays.
Ensuite, parce qu'en échouant à faire rebondir productivité et croissance, les néolibéraux ont construit une économie de « jeu à somme nulle » où les enjeux de redistribution sont désormais des enjeux de concurrence au sein même de la société. Pour obtenir plus, les groupes sociaux doivent prétendre « prendre » aux autres. Et comme les néolibéraux refusent toute redistribution du haut vers le bas et ont, pour ce faire, détruit tout sentiment de classe sociale, ce sont logiquement les appartenances ethniques ou raciales qui ont repris le dessus. Et ceux qui proposent une redistribution sur ces bases, ce sont les partis d'extrême droite.
On conçoit alors la folie que représenterait une résistance au trumpisme qui chercherait à préserver les conditions de l'émergence de cet autoritarisme ploutocratique. Sa seule ambition serait de gagner un peu de temps avant que l'inévitable bascule se produise à nouveau. C'est pourtant le cœur de la politique défensive qui est menée dans les pays occidentaux depuis des années : « faire barrage » à l'extrême droite sans chercher à s'attaquer aux sources de son succès, et attendre la prochaine échéance avec angoisse. Chacun semble se retrouver dans la peau de la du Barry réclamant, avant son exécution : « Encore un instant, monsieur le bourreau. » C'est de cette funeste logique qu'il faut sortir.
La démocratie comme antidote
Pour sortir de cette ornière, il faut prendre conscience que le cœur du problème est dans l'évolution récente du capitalisme. Progressivement, le capitalisme démocratique s'est vidé de son sens. La démocratie est devenue un obstacle à l'accumulation du capital. Et cela n'est pas seulement vrai pour les géants de la tech, mais aussi pour le reste du capitalisme, qui entend imposer des politiques qu'il juge nécessaires, quoi qu'il arrive.
Aucun secteur du capital ne viendra au secours de la démocratie. Ceux qui dépendent des aides publiques pour maintenir leur taux de profit entendent imposer une austérité sur les dépenses sociales et les salaires, sans se soucier d'aucune validation populaire. C'est ce que le débat budgétaire français a clairement montré récemment.
Dès lors, la tâche de la résistance est, comme voici quatre-vingts ans, de proposer les conditions nouvelles d'existence de la démocratie. En 1945, il était devenu évident que la démocratie ne pouvait pas subsister sans une forme d'État social agissant comme une protection pour les citoyens et citoyennes. L'enjeu aujourd'hui est de comprendre quelles sont les conditions sociales capables de soutenir une démocratie réelle.
Il est indispensable de redéfinir les besoins des individus au regard non plus des besoins de l'accumulation, mais des besoins sociaux et environnementaux.
Car ce que le trumpisme, comme le melonisme, nous apprend, c'est bien ceci : la forme démocratique réduite au vote n'est pas la démocratie réelle. Celle-ci doit pouvoir s'appuyer sur une société civile forte elle-même fondée sur la diversité, le respect des minorités, des débats de fond, une liberté individuelle consciente de ses limites sociales et environnementales. Autrement dit, les conditions sociales de production du vote sont plus importantes que le vote lui-même.
On peut continuer à croire que démocratie et capitalisme sont indissociables en s'appuyant sur un capitalisme régulé et encadré. Mais dans le capitalisme actuel, de telles régulations ressemblent à des leurres. La course à l'accumulation risque d'emporter ces barrières avec ce qu'il reste de démocratie.
Réduire la puissance des plus riches est une nécessité, mais est-elle suffisante pour freiner le désastre ? Rien n'est moins sûr, parce que les besoins du capital resteront centraux dans la société. Si le Conseil national de la Résistance (CNR) peut être un modèle de méthode, il faut toujours avoir à l'esprit que les conditions de réalisation de son projet régulateur ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le moment historique actuel demande sans doute un pas plus ambitieux.
Si le capitalisme est la source du trumpisme et de ses avatars d'extrême droite, alors le combat de la résistance doit porter sur une redéfinition de la démocratie libérée de la logique d'accumulation.
Cela signifie que les conditions de création des opinions doivent être libérées des exigences du capital. Pour y parvenir, il est indispensable de redéfinir les besoins des individus au regard non plus des besoins de l'accumulation, mais des besoins sociaux et environnementaux. Et les conditions de cette redéfinition résident dans l'élargissement de la démocratie elle-même, notamment aux sphères de la production et de la consommation. Ce sont les conditions de l'émergence d'une conscience dont l'absence conduit le monde au désastre.
Face à la « liberté d'expression » brandie par l'extrême droite, qui n'est que la liberté de se soumettre aux ordres du capital et de leurs algorithmes, la résistance nouvelle doit proposer une liberté plus authentique, qui se réalise dans une solidarité renouvelée et une conscience des limites planétaires et sociales. C'est à cette condition que la démocratie pourra à nouveau avoir un sens.
Tout cela peut et doit faire l'objet de discussions. Le CNR est aussi le produit d'un débat intense dans la Résistance. Mais ce qu'il faut conserver à l'esprit, c'est que, s'il est normal et légitime, en cette période sombre, de chercher à sauver ce qui peut l'être, ce n'est qu'une partie de la tâche de la résistance nouvelle. Cette tâche défensive ne doit faire oublier l'autre, essentielle, celle de se projeter vers l'avenir. Pour passer, enfin, à l'offensive.
Romaric Godin
P.-S.
• Mediapart, 13 février 2025 à 12h14 :
https://www.mediapart.fr/journal/international/130225/contre-le-trumpisme-et-ses-avatars-passer-l-offensive
Les articles de Romaric Godin sur Mediapart :
https://www.mediapart.fr/biographie/romaric-godin-0
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Groupe de La Haye doit se transformer en initiative mondiale

La formation du groupe de La Haye est une étape cruciale dans la sauvegarde de l'ordre juridique international. D'autres États doivent suivre pour mettre fin à l'impunité systémique.
Tiré de France Palestine solidarité. Photo : Francesca Albanese, conférence de presse sur la situation des droits humains sur le TPO depuis 1967, 30 octobre 2024 © ONU
En Palestine, les abus et les violations du droit international se sont normalisés, c'est un fait.
Que l'impunité ait été la règle, plutôt que l'exception, au cours des 76 années qui se sont écoulées depuis la création d'Israël est un autre fait. Et pourtant, après 15 mois d'assaut brutal et vengeur d'Israël contre Gaza et ses plus de 2 millions d'habitants pris au piège, la Palestine est à son apogée.
La destruction catastrophique de l'ensemble du paysage, la création de conditions de vie calculées pour conduire à la destruction de la vie, la tentative d'écrasement de la dignité humaine, ont inauguré une nouvelle ère : celle du génocide, télévisé et retransmis en direct pour que le monde entier puisse le voir.
Pourtant, ce que nous avons vu à Gaza, et ce que nous voyons maintenant de plus en plus en Cisjordanie, n'est pas seulement une attaque criminelle contre les Palestiniens en tant que peuple – c'est l'érosion de la fonction même de protection du droit international et une régression dangereuse du système multilatéral, créé pour prévenir les conflits et protéger la vie des civils.
C'est la création d'un monde sans civils, où tout et chacun est soit une cible, soit un dommage collatéral, et que l'on peut donc tuer ou détruire à volonté.
Ainsi, après le génocide de Gaza, le droit international se trouve au bord du gouffre : si les lois qui ont été écrites comme étant universelles, devant être appliquées de manière égale aux forts et aux faibles, sont systématiquement violées pour défendre des intérêts géopolitiques particuliers, alors l'ensemble du système juridique international, fondé sur l'égalité de toutes les nations, est menacé – pour tous les peuples.
À la lumière de ces développements, l'initiative tricontinentale lancée à La Haye par neuf États déterminés à demander des comptes à Israël pour son agression contre l'existence collective des Palestiniens ne pourrait être plus opportune.
Les engagements pris par le groupe dans le cadre de cet effort collectif – maintien des mécanismes juridiques nationaux à la suite des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, refus portuaires et imposition d'un embargo sur les armes – font partie des obligations les plus fondamentales qui incombent à tous les États en vertu du droit international, compte tenu des crimes commis de longue date par Israël dans les territoires palestiniens occupés.
Ces mesures constituent un premier pas essentiel vers la résolution de la question de la Palestine, ou « conflit israélo-palestinien », dans le respect du droit international.
Pourtant, aucune solution ne sera possible tant que l'impunité persistante d'Israël n'aura pas pris fin. Malgré les efforts du peuple palestinien et de certains Israéliens engagés, la situation ne peut être changée de l'intérieur d'Israël. Une action internationale est nécessaire.
C'est la tâche à laquelle tous les États sont aujourd'hui confrontés. Les États ont des responsabilités juridiques contraignantes face à des violations prolongées du droit international, comme c'est le cas avec l'occupation illégale et l'annexion par Israël du territoire palestinien occupé, le régime d'apartheid qu'il a imposé aux Palestiniens et, plus récemment, le génocide à Gaza.
Compte tenu de la gravité des actions d'Israël, les États sont invités à mettre fin à toutes les relations économiques, à tous les accords commerciaux et à toutes les relations universitaires avec Israël. Ces relations constitueraient sinon une aide et une assistance à un acte internationalement illicite.
En vertu de la loi sur la responsabilité des États, les États sont tenus de coopérer pour mettre fin, par des moyens légaux, à la violation en question – en pratique, cela signifie que tous les États membres des Nations Unies doivent rompre toutes leurs relations avec Israël tant qu'il continue d'opprimer le peuple palestinien.
Cette obligation est d'autant plus urgente avec le sursis d'un cessez-le-feu fragilement négocié.
En ce moment crucial, le groupe de La Haye constitue un excellent exemple pour les autres États quant à la manière dont ils peuvent se conformer à leurs obligations en vertu du droit international.
Les États qui ont signé l'initiative – le Belize, la Bolivie, la Colombie, Cuba, le Honduras, la Malaisie, la Namibie, le Sénégal et l'Afrique du Sud – sont des États dont l'histoire témoigne d'un engagement constant et de principe en faveur de la question palestinienne.
Ce sont également des États qui portent les blessures d'un passé colonial douloureux et de la lutte pour les droits de l'homme qui s'en est suivie. Leur décision crée un puissant précédent, et j'applaudis personnellement ces pays pour leur courage.
Les États qui ont fondé le groupe de La Haye ouvrent la voie à ce qui doit devenir un mouvement mondial en faveur d'une action collective par le biais du droit international : pas d'armes pour le génocide, pas d'aide pour l'occupation et pas de tolérance pour l'apartheid.
J'espère que d'autres États rejoindront bientôt ce groupe. L'objectif du groupe de La Haye est de mettre fin à l'exceptionnalisme d'Israël et de veiller à ce que ce qu'Israël a fait au cours des 15 derniers mois ne devienne pas la nouvelle norme pour les États dans les années à venir.
De la même manière que les États du monde entier se sont unis pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, la communauté internationale doit maintenant s'unir pour garantir la fin de l'un des régimes d'apartheid les plus brutaux dans l'Histoire.
Si nous voulons sauver l'ordre juridique international actuel et nous diriger vers un ordre dans lequel l'impérialisme et la colonisation ne continuent pas à dicter son fonctionnement, la communauté internationale, et surtout les Palestiniens, doivent voir cette initiative prendre de l'ampleur.
Traduction : Chronique de Palestine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À quoi sert un programme pour QS ?

Le 6 février dernier, Qs a fait parvenir à ses membres un courriel présentant une consultation sur l'actualisation du programme et un échéancier qui mènera au Congrès de novembre, portant sur le programme.
Dans les partis politiques traditionnels et électoralistes, le programme politique sert à étaler certains principes, certaines valeurs. Mais il est, en général, peu utilisé. Il demeure davantage sur les tablettes que dans les mains des personnes militantes. Ce qui est publicisé, c'est la plateforme électorale : les promesses faites durant la campagne électorale et vite oubliées au lendemain des élections. En fait, notre système parlementaire a comme coutume de voter davantage pour la personne ( pour ne pas dire pour l'homme) et pour sa personnalité. Davantage pour ce que cette personne dégage que pour tout le charabia politique.
Et pourtant...
Un programme devrait nous donner une image de la période politique. Les grandes tendances, les grands enjeux devraient y être expliqués pour nous permettre de comprendre les rapports de force en présence. Ce n'est donc pas un outil pour garnir la tablette mais un outil pour mieux comprendre la réalité. Le programme doit à la fois être concret en proposant des revendications essentielles pour la situation actuelle et poser des liens transitoires pour un monde nouveau. La plateforme électorale, à ce moment, résume le programme en ne reprenant que quelques points essentiels pour la période électorale à venir.
Par exemple, face au départ d'Amazon et au licenciement du personnel, le programme défend la nécessité pour le gouvernement de refuser une telle fermeture. Ceci concrétise et souligne les besoins essentiels de ces travailleuses et travailleurs. Ensuite, pour poser la transition, il faut demander des comptes à la compagnie, vérifier sa comptabilité et voir ce qu'elle a fait des subventions gouvernementales (ce que d'ailleurs le syndicat d'Amazone demande en ce moment). Finalement, il faut poser la nécessité d'une nationalisation de la livraison des colis un peu comme la livraison du courrier.
Le programme, dans la période actuelle, doit développer une vision internationale. Ceci est essentiel avec la guerre qui sévit en Ukraine et l'envahissement impérialiste de la Russie, avec le génocide en Palestine et avec les visées impériales de Donald Trump sur le Panama, le Groenland et le Canada. Le monde a besoin de réponses pour arrêter cette barbarie destructrice de l'environnement. Le programme doit servir à tracer ces signes d'espoir.
Que fait Qs dans tout ce contexte québécois et international ? Des interventions à l'Assemblée nationale. Pourrait-on penser développer davantage des revendications posant la mobilisation du mouvement ouvrier en solidarité avec Amazon ? Est-il important de prôner l'unité syndicale pour organiser la lutte ? De remettre de l'avant l'urgence de sauver la planète face aux guerres, aux génocides et au climato-scepticisme en développant la solidarité internationaliste ?
La consultation de QS
Le programme permet de sensibiliser les gens à la situation politique en offrant de nouveaux horizons, en ouvrant sur un monde nouveau.
La consultation entreprise par Qs pose deux problèmes majeurs : la base pour construire le programme et le processus démocratique.
La base du programme
Pour servir d'outil et non de décoration de tablette, le programme doit partir d'une analyse de la conjoncture politique. Quelles sont les forces en présence ? Comment les multinationales s'organisent-elles ? Comment les partis politiques réagissent-ils à ces pressions ? Comment les mouvements sociaux se mobilisent-ils et autour de quels enjeux ? Le texte de Françoise David, publié récemment dans Le Devoir (L'orage gronde, il faut résister à ce tsunami de droite ! | Le Devoir ), peut nous donner une première idée du genre d'analyse à produire.
Qs répond à la pièce, quand il répond, aux éléments de conjoncture. Et souvent, ces éléments ne sont pas les plus importants de l'heure. Qs ne propose pas de vue d'ensemble et ne peut présenter son projet d'avenir parce qu'il ne projette rien.
Donc, le processus de consultation avec des priorités prédéfinies et ciblées (a-t-on oublié la situation internationale ? Et les actions de la Marche Mondiale des Femmes ?) ne peut combler une analyse faisant des liens réels entre les projets de la bourgeoisie et les mobilisations ouvrières et sociales. Ce sont ces liens-là qui sont essentiels : comment organiser les mouvements sociaux face aux menaces de Trump ? Mais rien de cela n'est apparu dans la récente consultation.
Le processus démocratique
Une consultation individualise la personne membre et ne lui permet pas de bénéficier, dans sa réflexion, des échanges qui pourraient avoir lieu avec les autres membres. Ce n'est que dans la discussion que les idées peuvent évoluer, se préciser, s'enrichir. Et il faut du temps pour débattre. Certes, le congrès va ouvrir une période de débat mais il faut plus de trois semaines entre les cahiers de résolution pour organiser les rencontres par assos, par région. Il faut aussi ouvrir un organe interne de discussion pour débattre à la grandeur de la province avant de le faire en congrès.
Plusieurs militantes femmes et plusieurs militants et militantes des régions ont parlé des blocages, des processus et des attitudes bureaucratiques qui ont cours dans Qs. Pour résoudre ces problématiques, la discussion respectueuse en vue d'élaborer des solutions pour enrayer ces fonctionnements patriarcaux et non collectifs est nécessaire. La consultation renforce le repli sur soi et l'isolement : le contraire de ce qui permettrait de trouver de réelles solutions.
Et pourquoi ne pas penser à un modèle de discussion qui ouvrirait le débat avec les groupes sociaux : syndical, femmes, communautaires ? En mettant en place des forums de discussions et de partage, par exemple. Nous pourrions ainsi être à l'écoute de leurs luttes, mieux comprendre les réalités vécues et être en mesure de proposer de réelles propositions de changement.
Un parti de la rue se doit de partager ses réflexions avec l'ensemble des personnes militantes. Un parti des urnes, comme les partis traditionnels, cherche à séduire par des promesses.
Conclusion
L'actualisation du programme de QS risque d'être une opération de maquillage risquant de laisser le texte en tablette. Cela équivaudrait à revenir aux pratiques électoralistes des vieux partis et à élaborer une plateforme électorale qui plaira peut-être à la classe soi-disant moyenne mais en ne proposant pas des revendications de changements et un projet de société. C'est pourtant ce dont la population a le plus de besoin face aux différentes crises économiques, environnementales et sociales qu'elle vit.
Il y a tellement à dire et Qs pourrait porter un si beau projet de société, comme celui que la Marche Mondiale des femmes présente en 2025 : pour une justice sociale, contre la pauvreté, pour une égalité contre les violences et les guerres et pour le respect de l'environnement.
Qs doit donc changer de paradigme et les militants et militantes de gauche se regrouper pour mieux faire entendre leurs voix.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

CJPMO répond à la désinformation de Concordia sur le BDS

Le 6 février 2025, CJPMO a envoyé une lettre au président de Concordia, M. Carr, en réponse à une déclaration qui avait répandu des informations erronées sur le boycott d'Israël. La lettre de CJPMO défend les étudiants de Concordia qui ont voté massivement pour l'adoption de deux résolutions en faveur du mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS).
Monsieur le Président Carr,
Tiré de la page web https://fr-cjpme.nationbuilder.com/pr_2025_02_07_concordia_bds
Je vous écris au nom de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) pour vous faire part de mes vives inquiétudes concernant votre déclaration[1] du 30 janvier 2025 au sujet de l'adoption par l'Association étudiante de Concordia (AÉC) de deux motions en appui au mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS). La caractérisation par votre administration de ce processus démocratique mené par les étudiants comme une menace à la liberté académique est trompeuse, diffamatoire, et contribue à un double standard croissant dans la façon dont Concordia répond à l'expression politique concernant les droits des palestiniens.
La légitimité des boycotts académiques
Inspiré par les boycotts universitaires contre l'Afrique du Sud dans les années 1970-1980, le BDS est une invitation de la société civile palestinienne à exercer des pressions non violentes sur Israël pour le contraindre à respecter le droit international[2].Il s'agit d'un mouvement mondial qui exhorte les gouvernements, les entreprises et les institutions universitaires à se désinvestir des entreprises et des institutions complices des politiques d'apartheid d'Israël et de l'occupation illégale des territoires palestiniens, comme le montrent des organisations telles que Human Rights Watch, Amnesty International et le groupe israélien de défense des droits de B'Tselem. Le BDS n'est pas une attaque contre le peuple juif, mais une méthode pacifique et non violente pour obliger Israël à rendre compte du traitement injuste qu'il inflige aux Palestiniens.
Votre affirmation selon laquelle le BDS est « contraire à la valeur de la liberté académique » n'est pas partagée par des associations académiques notables telles que la Middle East Studies Association (MESA)[3], l'American Studies Association[4], le British Committee for the Universities of Palestine (BRICUP)[5], ou le Academic Advisory Council of Jewish Voice for Peace[6]. Au Canada, l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU) a récemment déclaré qu'elle « soutient pleinement les 18 associations de professeurs qui ont adopté des motions appelant au boycott et/ou au désinvestissement et/ou aux sanctions contre l'État d'Israël »[7]
En outre, il est nécessaire d'examiner la question de la liberté académique dans un contexte d'apartheid et d'occupation illégale. Les universités israéliennes sont activement impliquées dans la recherche militaire et les systèmes d'armes utilisés par l'armée israélienne et sont complices de politiques discriminatoires qui restreignent sévèrement les libertés des universitaires et des étudiants palestiniens[8]. En outre, les universitaires, les experts de l'ONU et la communauté internationale des droits de la personne sont de plus en plus préoccupés par le fait qu'Israël lui-même commet un « scolasticide » - défini comme « l'anéantissement systémique de l'éducation par l'arrestation, la détention ou le meurtre d'enseignants, d'étudiants et de personnel, et la destruction de l'infrastructure éducative » - à Gaza [9].
Lorsque les universités, les étudiants et les organes académiques demandent à Israël de rendre compte de son rôle dans l'apartheid, il s'agit d'une affirmation des valeurs mêmes qui sous-tendent la liberté académique, et non d'une attaque contre celle-ci. Paradoxalement, la déclaration glaçante du bureau du président de Concordia est elle-même contraire à la valeur de la liberté académique, car elle crée une atmosphère de peur et d'intimidation à l'égard de la critique de l'État d'Israël.
La légitimité de la démocratie étudiante
Votre déclaration ne reconnaît pas l'Assemblée générale spéciale (AGS) de la CSU, organisée démocratiquement, ni la légitimité de son processus, qui était basé sur une pétition signée par plus de 250 étudiants de premier cycle. Les motions ont été adoptées à une écrasante majorité avec 885 voix pour et seulement 58 voix contre[10], un taux de participation extraordinaire qui représente plus du double du quorum requis pour valider la motion. Malgré le soutien massif du corps étudiant au BDS, votre déclaration fait vaguement référence au processus démocratique en parlant de « comportement lors d'une récente réunion d'étudiants », délégitimant injustement et jetant la suspicion sur les procédures.
Le racisme anti-palestinien sur le campus
De plus, étant donné le climat croissant de racisme anti-palestinien au Canada[11], je suis préoccupé par le fait que votre déclaration dépeigne les étudiants comme des « individus lourdement masqués “ utilisant des ” tactiques d'intimidation » comme un signal d'alarme. Une telle rhétorique expose les étudiants palestiniens et leurs alliés à des risques accrus. Concordia devrait adopter la définition de l'APR proposée par l'Arab Canadian Lawyers Association (ACLA)[12] et créer des plans stratégiques pour protéger les étudiants palestiniens et leurs alliés. Des organisations comme Canary Mission, qui ciblent les étudiants et les universitaires pour tout soutien perçu aux droits des Palestiniens, représentent de sérieuses menaces pour la liberté académique et le bien-être des étudiants que Concordia choisit d'ignorer[13]
En fait, les étudiants pro-palestiniens de Concordia ont été confrontés à une répression importante, y compris battus et arrêtés par la police et les forces de sécurité[14] - non pas en réponse à la violence ou à des activités illégales, mais simplement pour s'être engagés dans des protestations pacifiques et des activités de plaidoyer. Concordia a permis à une firme de sécurité privée ayant des liens connus avec les Forces de défense israéliennes d'opérer sur son campus. L'agression d'un étudiant palestinien sur le campus en décembre 2024[15] a été confirmée comme une attaque à caractère raciste par le SPVM en raison de son keffieh[16]. Le fait que votre administration soit restée silencieuse sur ces actes flagrants de violence anti-palestinienne, alors qu'elle s'est empressée de condamner une motion BDS menée par des étudiants, révèle un profond parti pris institutionnel qui privilégie la protection des intérêts pro-israéliens au détriment de la sécurité, de la dignité et des droits des étudiants palestiniens et de leurs alliés.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples alarmants de répression des discours pro-palestiniens et de la vie étudiante que mon organisation a compilés :
En octobre 2023, un doyen des étudiants de Concordia a été accusé d'avoir fait un doigt d'honneur à des étudiants palestiniens lors d'une manifestation. Au lieu d'aborder cet incident, l'université a rejeté les préoccupations des étudiants.[17]
En novembre 2023, un étudiant est menacé de mort et diffamé en ligne après avoir été faussement accusé d'avoir utilisé une insulte antisémite dans une vidéo virale. Cependant, la séquence non éditée réfute cette allégation et montre un chahuteur pro-Israël déshumanisant l'étudiant en raison de son identité sexuelle. Concordia est restée silencieuse pendant que l'étudiante subissait un doxxing et une détresse psychologique évidente.[18]
En avril 2024, Savannah Craig, une journaliste de CUTV pour le groupe de médias indépendants du campus, a été arrêtée pour avoir fait un reportage sur une manifestation pro-palestinienne, un geste dénoncé par l'Association canadienne des journalistes et la Coalition pour les femmes en journalisme. L'université n'a fait aucune déclaration publique pour défendre la liberté de la presse de son étudiante.[19].
Le 9 janvier 2025, la démission du conseil consultatif de la Leonard & Bina Ellen Art Gallery en signe de protestation contre la censure et la répression de la programmation artistique pro-palestinienne par l'administration contredit directement votre affirmation selon laquelle Concordia défend la liberté académique. La lettre de démission du conseil indique explicitement que l'université a permis aux donateurs et aux pressions politiques de dicter l'expression artistique et académique.[20]
L'administration de Concordia n'a pas abordé ces nombreux cas documentés de discrimination anti-palestinienne. Cela met encore plus à mal votre fausse affirmation selon laquelle le BDS est la véritable menace pour la liberté d'expression, alors qu'en réalité, Concordia a activement étouffé les voix palestiniennes.
Recommandations
CJPMO croit que l'Université Concordia devrait réviser sa déclaration du 30 janvier et s'excuser pour sa caractérisation trompeuse et diffamatoire de la motion BDS de la CSU et de ses partisans étudiants. De plus, CJPMO croit que Concordia devrait se conformer aux demandes légitimes des étudiants en divulguant ses investissements et en reconsidérant ses partenariats institutionnels avec des universités israéliennes complices des politiques d'apartheid.
La réputation de Concordia en tant qu'institution progressiste et inclusive est sérieusement menacée si elle continue à ignorer la sécurité des étudiants palestiniens, la liberté académique et le droit à l'expression politique. Nous attendons de votre administration qu'elle prenne cette question au sérieux et qu'elle y réponde avec l'urgence et la responsabilité qu'elle mérite.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées,
Michael Bueckert, PhD
Président par intérim
Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient
[2] Graham Carr, Statement from Concordia's President on recent events, January 30, 2025, https://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2025/01/30/statement-from-the-president-on-recent-events.html
[2] “Palestinian Civil Society Call for BDS,” July 9, 2005, https://bdsmovement.net/call
[3] Middle East Studies Association, “Regarding BDS (2022),” https://mesana.org/about/resolutions.
[4] American Students Association, “Boycott of Israeli Academic Institutions,” December 4, 2013, https://www.theasa.net/about/advocacy/resolutions-actions/resolutions/boycott-israeli-academic-institutions.
[5] British Committee for the Universities of Palestine (BRICUP), “Why Boycott Israeli Universities ?” April 2007, https://d33hbjhijwmfsk.cloudfront.net/uploads/2022/12/BRICUP-booklet.pdf.
[6] Jewish Voice for Peace, “Stifling Dissent,” Fall 2015,%20https://www.jewishvoiceforpeace.org/wp-content/uploads/2015/09/JVP_Stifling_Dissent_Full_Report_Key_90745869.pdf.
[7] Agenda item 12-E, CAUT Council Meeting, November 29-30, 2024 https://x.com/CJPME/status/1864786868396605507/photo/2
[8] Right2Edu, “The academic boycott of Israel explained,” 2014, https://right2edu.birzeit.edu/israeli-academic-institutions-are-complicit-thats-why-we-should-boycott-them-2/.
[9] United Nations, “UN experts deeply concerned over ‘scholasticide' in Gaza,” April 18, 2024, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/04/un-experts-deeply-concerned-over-scholasticide-gaza
[10] The Link, “Over 800 Concordia University students vote for BDS,” January 31, 2025, https://thelinknewspaper.ca/article/over-800-concordia-university-students-vote-for-bds ; The Concordian, “Students look back on historic vote and to the future of divestment at Concordia,” February 5, 2025, https://theconcordian.com/2025/02/students-look-back-on-historic-vote-and-to-the-future-of-divestment-at-concordia/
[11] CJPME Foundation, “Anti-Palestinian Racism in Canada : 2023 Annual Report,” December 2024, https://www.cjpmefoundation.org/apr_report_2023
[12] Arab Canadian Lawyers Association, “Anti-Palestinian Racism : Naming, Framing and Manifestations,” 2022, https://static1.squarespace.com/static/61db30d12e169a5c45950345/t/627dcf83fa17ad41ff217964/1652412292220/Anti-Palestinian+Racism-+Naming%2C+Framing+and+Manifestations.pdf
[13] The Link, “Canary Mission is an Online Blacklist for BDS Activists,” February 5, 2019, https://thelinknewspaper.ca/article/canary-mission-is-an-online-blacklist-for-bds-activists
[14] “Pro-Palestine activists detained by SPVM,” YouTube, September 26, 2024, https://www.youtube.com/watch?v=UGaV6UgUKT8&ab_channel=MatthewDaldalian
[15] Middle East Monitor, “US, Canadian universities hire Israeli firms to curb pro-Palestinian protests,” December 7, 2024, https://www.middleeastmonitor.com/20241207-us-canadian-universities-hire-israeli-firms-to-curb-pro-palestinian-protests/
[16] The Concordian, “Palestinian student assaulted in the Hall building,” January 14, 2025, https://theconcordian.com/2025/01/palestinian-student-assaulted-in-the-hall-building/
[17] https://www.instagram.com/reel/CygcuqHLMDk/?igsh=enU2cXlzdmt5MDJ4
[18] The Rover, “Death Threats, Boycotts and Backlash,” January 28, 2024, https://therover.ca/death-threats-boycotts-and-backlash/
[19] Savanna Craig, “In Canada, a pattern of police intimidation of journalists is emerging,” Al Jazeera, June 15, 2024, https://www.aljazeera.com/opinions/2024/6/15/in-canada-a-pattern-of-police-intimidation-of-journalists-is-emerging ; Christopher Curtis, “Montreal police pursue criminal charges against journalist for covering Gaza protest,” April 24, 2024, https://ricochet.media/labour/media-labour/montreal-police-pursue-criminal-charges-against-journalist-for-covering-gaza-protest/
[20] Instagram, January 23, 2025, https://www.instagram.com/p/DFLSlijxHC_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&img_index=7
BDS Concordia
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Littoral Est - Beauport Limoilou : Transformer une zone sacrifiée en secteur hautement valorisé !

Québec, 12 février 2025 - Des membres de la Table citoyenne Littoral Est et d'Accès Saint-Laurent Beauport ont pris part à la consultation publique de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) ce 11 février en soirée. À cette occasion, nos organismes ont revendiqué que le plan d'aménagement et de développement de la CMQ permette de transformer la ZONE SACRIFIÉE du littoral Est, en un territoire plus propre, plus sain et plus durable. Celui-ci est actuellement caractérisée par trop d'activités industrielles, de la contamination, de la pollution de l'air et du camionnage à proximité d'une population vulnérable.
Le fait que la CMQ perpétue dans ses orientations d'aménagement du Plan métropolitain d'aménagementet de développement (PMAD) révisé (pages 87 et 98) la poursuite du développement économique dans les espaces industriels d'intérêt métropolitain inquiètent plusieurs résident.es vivant près de la péninsule portuaire de Beauport et du parc industriel de la Canardière.
Comme plusieurs experts universitaires l'ont constaté, ce genre de zone sacrifiée qui permettent des activités industrielles lourdes souffrant d'une pollution excessive à proximité de populations vulnérables et marginalisées, crée de grandes injustices sociales et environnementales. Un mémoire détaillé a été déposé, lequel demande notamment aux autorités régionales et municipales de respecter notre droit à un environnement propre, sain et durable pour tous.
« Nous constatons tristement que nos quartiers constituent une véritable zone sacrifiée et que son développement industriel polluant doit cesser, » affirme Daniel Guay de la Table citoyenne. Le récent rapport de l'Organisation des Nations-Unies- ONU, produit par le chercheur canadien David Boyd en 2022 et intitulé : The right to a clean, healthy and sustainable environment - non-toxic environment, confirme nos constats.
« Nous dénonçons fortement cette funeste discrimination et cette injustice flagrante, » insiste monsieur Guay. En effet, aucun autre secteur de la ville de Québec ne compte autant d'entreprises industrielles à fort volume d'émissions atmosphériques et polluantes.
Dans son rapport, le professeur Boyd décrit les « zones sacrifiées » comme un phénomène qui entraîne l'empoisonnement chronique des personnes y résidant et qui provoque de graves injustices environnementales. Ces zones sont caractérisées par des niveaux extrêmes de contamination. Les populations présentes, souvent les plus vulnérables et marginalisées, subissent beaucoup plus que les autres les conséquences de l'exposition à la pollution sur leur santé, ce qui constitue une grave
violation de leurs droits.
« De plus, dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet d'agrandissement portuaire Laurentia à Beauport en 2021, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada a constaté que ce projet de terminal de conteneurs aurait eu des effets négatifs importants, directs et cumulatifs sur la qualité de l'air et la santé humaine, en raison des émissions supplémentaires de particules et de contaminants issus de la combustion de produits fossiles, » rappelle Patrick Albert, d'Accès Saint-Laurent Beauport.
L'Agence a ainsi conclu qu'on ne pouvait ajouter plus de contaminants atmosphériques dans ce milieu préalablement saturé, là où des problèmes de santé liés à la qualité de l'air sont déjà connus et documentés. Le Directeur de la santé publique et le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques ont aussi constaté ce triste bilan et les risques pour la santé humaine.
« En conséquence, nous demandons à la CMQ et à la Ville de Québec de renoncer à tout développement de nouvelles activités industrialo-portuaires dans la zone sacrifiée de Beauport-Limoilou, » réclame monsieur Albert.
À contrario du développement industriel, nous proposons plutôt des aménagements conçus par et pour les citoyen.nes en vue d'améliorer leur qualité de vie et celle de leur environnement, aménagements qui auront des impacts positifs importants sur les plans social, environnemental et économique. La CMQ propose d'ailleurs, dans son Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) révisé, de « Cultiver ensemble des milieux de vie renouvelés et durables ».
Il est grand temps de passer de la parole aux actes dans Beauport-Limoilou. Car, on y trouve déjà le terminal de vrac solide de QSL, le terminal de vrac liquide de IMTT, le dépôt de nickel de Glencore, deux cours de triage du CN, l'incinérateur, l'usine de pâtes et papier, le ferrailleur AIM, le dépôt à neige, le garage municipal, etc. Assez, c'est assez ! Les résident.e.s de nos quartiers respirent déjà beaucoup plus que leur dose tolérable de pollution de l'air
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un rapport d’Amnistie Internationale dénonce les abus systématiques contre les travailleuses et travailleurs migrant.es au Canada

Un rapport récent d'Amnistie Internationale intitulé « Le Canada m'a détruit » expose la dure réalité vécue par des milliers de personnes migrantes arrivant avec l'espoir d'un avenir meilleur, mais se retrouvant confrontées à des conditions abusives et à la privation de droits fondamentaux. En écho, Aministie Internationale – Canada francophone a lancé une campagne dont une pétition pour demander que le Canada cesse les abus envers les travailleuses et travailleurs migrant.es !
Tiré du Journal des alternatives.
Le document révèle que de salarié.es migrant.es sont soumis.es à des journées de travail épuisantes, dans des environnements dangereux et avec des salaires insuffisants. De plus, la surveillance stricte de la part de leurs employeurs les limite à signaler tout abus. L'un des principaux facteurs facilitant ces conditions est l'utilisation de visas liés, qui empêchent les personnes migrantes salariées de changer d'emploi sans perdre leur statut migratoire dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (TFET).
Un autre aspect préoccupant du rapport est la discrimination raciale au sein du TFET. La majorité des personnes migrantes dans cette condition proviennent de pays comme le Mexique, le Guatemala, les Philippines et l'Inde. Elles se retrouvent confronté.es à une structure de travail où les personnes racialement discriminées sont reléguées à des emplois précaires avec moins de droits.
Les témoignages recueillis dans le rapport reflètent la peur et le désespoir de ces travailleuses et travailleurs. Beaucoup ont raconté que les soins médicaux sont inadéquats après avoir subi des blessures au travail. D'autres dénoncent des déductions salariales injustifiées qui les plongent dans une situation économique encore plus précaire. « On nous oblige à travailler plus de 12 heures par jour sans paiement supplémentaire. Si nous nous plaignons, on nous menace de nous expulser », raconte un travailleur migrant cité dans le rapport.
Les femmes migrantes sont confrontées à des défis supplémentaires, y compris des risques d'abus sexuels et de violence basée sur le genre. De plus, les logements fournis par leurs employeurs sont insalubres et dans des conditions qui violent leur dignité et leur vie privée. Bien que les lois canadiennes garantissent les mêmes droits que les citoyen.nes, cela n'est pas toujours respecté dans la pratique. Les mécanismes de dénonciation sont peu efficaces, car la peur des représailles, des licenciements ou de l'annulation des permis de travail empêche de nombreuses victimes de signaler les abus.
Amnistie Internationale alerte également sur le manque d'inspections adéquates dans des secteurs tels que l'agriculture et la fabrication d'aliments. Dans de nombreux cas, ces inspections sont annoncées à l'avance, permettant ainsi aux employeurs de camoufler la réalité des conditions de travail.
Appel à l'action
Face à cette situation, le rapport comprend une série de recommandations destinées au Gouvernement canadien. Parmi celles-ci, il est demandé de supprimer les visas liés et de les remplacer par des permis de travail ouverts, permettant aux personnes migrantes de changer d'emploi sans craindre de perdre leur statut légal. De son côté, Amnistie internationale – Canada francophone a lancé une campagne pour demander que le Canada cesse les abus envers les travailleuses et travailleurs migrant.es !
Il est également exigé une régulation accrue et une supervision du TFET, ainsi qu'un accès effectif à la justice pour celles et ceux qui ont été affecté.es par ces conditions abusives. Ces dénonciations remettent en question l'image du Canada en tant que défenseur des droits humains et mettent en évidence la nécessité urgente de réformer son système migratoire.
En attendant, des milliers de travailleuses et de travailleurs migrant.es continuent de souffrir en silence, pris au piège d'un système qui les exploite et les prive de protection.
Pour accder au rapport complet et aux témoignages en cliquant ici
Pour accéder à la page de lacampagne d'Amnistie Internationale – Canada francophone
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’USAID en restructuration : des milliers de personnes impactées, les partenaires internationaux fragilisés

Montréal, le 14 février 2025 — À la suite de la restructuration de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) a convié ses membres à une rencontre d'urgence aujourd'hui afin d'évaluer les impacts immédiats et potentiels pour leurs partenaires internationaux et les populations locales, et pour explorer les possibilités de les accompagner durant cette phase critique. Une quarantaine de délégué∙es de 26 organismes de coopération internationale (OCI) et de 6 partenaires ont présenté un portrait dramatique de la situation.
Les États-Unis contribuent pour près de 30 % de toute l'aide internationale. Le gel du financement de l'USAID a donc des conséquences immédiates et considérables à travers le monde, mettant en péril des millions de vies et compromettant leur santé et leur économie. Des milliers d'emplois ont déjà été perdus et d'autres mises à pied suivront, si le financement n'est pas rétabli.
Les impacts sont dévasteurs, en particulier pour les populations les plus vulnérables, notamment en Afrique, l'aide alimentaire pour des milliers de personnes en situation d'urgence humanitaire a été interrompue, des personnes déplacées par les conflits voient leur accès à l'eau menacé et d'autres atteintes du VIH ne reçoivent plus de traitement et de médicaments. En Amérique latine, des refuges pour les personnes migrantes, ainsi que pour les victimes de violence sexuelle et de trafic humain ont dû fermer leurs portes. Les défenseur-euses des droits, notamment des personnes LGBTQ et des femmes, sont menacés, tandis que les services essentiels des personnes en situation de handicap sont interrompus.
La liste des impacts est longue. Ces quelques exemples ne reflètent que partiellement l'ampleur de la crise en cours, nous assistons à un impact profond et durable affectant des milliers de personnes dépendant de ces programmes.
« L'AQOCI et ses membres sont mobilisés pour soutenir davantage les populations directement affectées. Ils comptent sur le soutien de la population québécoise ainsi que sur un apport accru des gouvernements canadien et québécois. », affirme Linda Gagnon, coprésidente de l'Association. Dans les prochaines semaines, des questions seront adressées aux partis politiques et candidat∙es en lice lors de la campagne électorale. Nous les interrogerons sur leurs perspectives en matière d'aide internationale. Dans le contexte des coupures de l'USAID, l'engagement du Canada est crucial. Également, avec d'autres groupes canadiens, nous interpellerons le gouvernement du Canada qui, à titre de président du G7, peut jouer un rôle essentiel en exhortant les États à mener une action concertée en faveur de l'action humanitaire et de la coopération internationale pour soutenir des millions de personnes dans le monde qui vivent des situations d'une grande précarité. Ce point devrait compter parmi les priorités de l'agenda de la prochaine rencontre du G7 à la mi-mai.
Dans un monde de plus en plus fragilisé, les enjeux reliés à l'aide publique au développement sont au cœur des préoccupations de l'AQOCI et de nos membres. En juin prochain, nous avons convié des groupes de la société civile québécoise à se joindre à nous lors d'États généraux de la solidarité internationale où nous aurons l'occasion de faire le point sur ces enjeux.
Michèle Asselin, directrice générale
Association québécoise des organismes
de coopération internationale (AQOCI)
L'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI<http://www.aqoci.qc.ca/membres/05_m...> ) regroupe 74 organismes actifs dans 112 pays en collaboration avec 1300 partenaires du Sud globalisé. En s'appuyant sur la force de son réseau, l'AQOCI œuvre à l'éradication de la pauvreté et à la construire d'un monde de justice, d'inclusion et d'égalité. L'AQOCI priorise la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres, des droits humains, de la paix et de la protection de l'environnement.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Canada complice des attaques contre le droit d’asile aux États-Unis ?

Des organismes relancent leur appel contre l'Entente sur les tiers pays sûrs, qui empêche de demander refuge au Canada en arrivant des États-Unis.
13 février 2025 | tiré du site de Pivot | Photo : Donald Trump, président des États-Unis. Photo : Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0). Montage : Pivot.
Des organismes s'inquiètent des mesures anti-migration du nouveau président américain Donald Trump, qu'ils jugent en violation des droits fondamentaux des migrant·es et du droit international sur la protection des réfugié·es. Ils appellent de nouveau le Canada à se retirer de l'Entente sur les tiers pays sûrs conclue avec les États-Unis, qui empêche la plupart des migrant·es arrivant au pays via les États-Unis de demander l'asile.
Depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump le 20 janvier dernier, plusieurs organismes de défense des droits, notamment le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) et Amnistie internationale Canada, ont exprimé leurs préoccupations quant aux nouvelles mesures migratoires des États-Unis, qui menaceraient la sécurité et les droits fondamentaux des personnes en quête de refuge.
Ces mesures incluent la suspension totale du droit d'asile et celui de réinstallation pour les réfugié·es reconnu·es, ainsi que la détention et la déportation massives des personnes migrantes à statut irrégulier.
Donald Trump « est en train de construire une machine de déportation, de violence et de guerre ouverte contre les migrants, qui est sans précédent dans l'histoire récente », s'indigne Jon Milton, du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), qui a très rapidement sonné l'alarme sur le danger des nouvelles mesures migratoires américaines.
Il souligne que le Canada a des responsabilités morales et légales d'ouvrir ses portes aux personnes fuyant non seulement la persécution dans leur pays d'origine, mais aussi la violence anti-migration sous l'administration Trump.
Le CCR et Amnistie internationale soutiennent dans un communiqué conjoint que « le seul moyen efficace de garantir la protection des réfugiés est de se retirer de l'Entente sur les tiers pays sûrs », laquelle empêche sauf exception les migrant·es se présentant à la frontière canado-américaine de demander l'asile au Canada.
Ketty Nivyabandi, secrétaire générale d'Amnistie internationale Canada, ajoute en entrevue que c'est le temps de remettre en question cette entente dans le contexte actuel où « le Canada réévalue ses relations avec les États-Unis sur divers sujets ».
« Les Canadiens ont réalisé que les États-Unis sous Trump ne sont pas un partenaire fiable. C'est vrai pour le commerce, et c'est aussi vrai pour les droits humains. »
L'ENTENTE SUR LES TIERS PAYS SÛRS, C'EST QUOI ?
L'Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis est un accord entré en vigueur en 2004, selon lequel les deux pays se reconnaissent mutuellement comme un « pays sûr » pour les demandeur·euses d'asile. Ainsi, les personnes en quête de refuge sont tenues de demander l'asile dans le premier pays sûr où elles mettent les pieds, sauf quelques exceptions, notamment pour les mineur·es non accompagné·es et les proches de résident·es permanents et de citoyen·nes canadien·nes. Il demeure aussi possible de déposer une demande en arrivant par avion, mais cela exige d'abord d'obtenir le visa nécessaire à l'embarquement.
Attaques au droit d'asile
Dans les tout premiers jours de son second mandat, Donald Trump a signé une série de décrets qui attaquent l'immigration irrégulière comme régulière aux États-Unis.
Dans la foulée des décrets, le nouveau président américain a suspendu jusqu'à nouvel ordre toute entrée de migrant·es sans statut par la frontière avec le Mexique. Il invoque l'urgence de protéger les États-Unis contre les « invasions », tout en confondant les personnes impliquées dans des activités criminelles transfrontalières avec celles qui fuient la persécution dans leur pays d'origine et cherchent protection aux États-Unis.
En déclarant l'état d'urgence à la frontière sud, le chef d'État recourt à son pouvoir présidentiel prévu pour les temps de guerre afin d'y déployer les forces armées et de demander aux départements de la Défense et de la Sécurité intérieure de prendre « toutes les mesures appropriées » pour construire une barrière physique le long de la frontière.
En même temps, le républicain a mis fin à l'application mobile CBP One, qui permettait aux demandeur·euses d'asile se présentant à la frontière sud de prendre rendez-vous avec les autorités américaines de l'immigration, laissant ainsi 270 000 personnes vulnérables dans une situation ambiguë.
Donald Trump a également suspendu pour au moins 90 jours le Programme américain d'admission des réfugié·es, la seule voie par laquelle ils et elles peuvent s'installer aux États-Unis, afin d'en mener une révision. Cela bloque de fait l'arrivée de milliers de réfugié·es de partout à travers le monde.
Or, le 7 février, il a souligné dans un autre décret l'importance de prioriser l'admission, par le biais du même programme, des Sud-Africain·es blanc·hes « victimes de discrimination raciale ».
En bloquant complètement le droit d'asile pour une période indéfinie, « l'administration Trump a très clairement tourné le dos à son devoir » de protéger les personnes à risque de persécution, dénonce Ketty Nivyabandi, invoquant la Convention de Genève dont les États-Unis sont signataires.
Détentions et déportations massives
Toujours dans les tout premiers jours de son second mandat, Donald Trump a ordonné des détentions et déportations accélérées et massives de migrant·es à statut irrégulier dans l'ensemble du pays, y compris ceux et celles qui auraient besoin de protection, en élargissant les pouvoirs de la police de l'immigration (ICE).
Le républicain s'en prend également aux migrant·es qui ont été légalement autorisé·es à entrer dans le pays.
Dans un décret intitulé « Sécuriser nos frontières », il a révoqué tous les programmes humanitaires qui offrent un refuge temporaire à des ressortissant·es étranger·es en raison d'urgences humanitaires, notamment celui pour les Cubain·es, les Haïtien·nes, les Nicaraguayen·nes et les Vénézuélien·nes initié par le gouvernement Biden en 2023, qui touchait jusqu'à 30 000 personnes par mois.
L'avenir est sombre pour les bénéficiaires de ces programmes, qui se trouveront dans l'impossibilité de renouveler leur permis de séjour et qui risquent éventuellement d'être déporté·es.
D'ailleurs, l'administration Trump a annoncé le rétablissement du Protocole de protection des migrant·es, connu sous le nom de « Rester au Mexique », qui exigeait lors de son premier mandat que les demandeur·euses d'asile en provenance du Mexique y soient renvoyé·es le temps que leur demande soit traitée.
Cette mesure supposée « protéger les migrants » les ont au contraire exposé·es à des risques élevés d'enlèvement et de violence dans des villes frontalières mexicaines, comme l'a par exemple montré Médecins sans frontière.
« L'idée que, dans ce contexte-là, le Canada continue à traiter les États-Unis comme un pays sécuritaire pour les réfugiés est absurde. »
Jon Milton, CCPA
Alors que les détentions et les déportations ont aussi été une préoccupation sous l'administration Biden, « ce qui est différent avec Trump, c'est sa volonté ouverte et claire de les élargir pour restructurer le pays d'une manière raciste », dénonce Jon Milton.
« Cela devient la pierre angulaire de son agenda et de sa légitimité et laisse présager ce qui est encore à venir », déplore Ketty Nivyabandi.
La position du Canada
Qu'en est-il de l'Entente sur les tiers pays sûrs dans ce contexte ?
D'après Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), « seuls les pays qui respectent les droits de la personne et offrent une solide protection aux demandeurs d'asile peuvent être désignés tiers pays sûrs ». À ce jour, les États-Unis sont le seul tiers pays sûr désigné par IRCC.
« L'idée que, dans ce contexte-là, le Canada continue à traiter les États-Unis comme un pays sécuritaire pour les réfugiés est absurde », affirme Jon Milton.
Face aux préoccupations soulevées par les groupes, IRCC semble déterminé à défendre l'Entente et s'aligne avec le discours de la Maison-Blanche, qui considère tous les passages irréguliers de la frontière comme une menace à la sécurité.
« Nous continuons à travailler avec nos homologues américains pour lutter contre les passages illégaux vers le nord et vers le sud le long de la frontière [canado-américaine], dans le cadre de nos efforts de collaboration de longue date et de notre intérêt mutuel à assurer la sécurité de nos communautés », écrit IRCC dans un courriel à Pivot.
« Chaque gouvernement, et le Canada en particulier, a l'obligation de protéger les personnes à risque de persécution. C'est illégal de ne pas le faire », soutient Ketty Nivyabandi.
« Le seul moyen efficace de garantir la protection des réfugiés est de se retirer de l'Entente sur les tiers pays sûrs. »
CCR et Amnistie internationale Canada
L'Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis est depuis longtemps contestée par des groupes et des organismes de défense des droits au pays. En 2017, Amnistie internationale Canada, le CCR et le Conseil canadien des Églises ont intenté un recours juridique remettant en question sa constitutionnalité.
En juin 2023, dans une décision partielle, la Cour suprême du Canada a conclu que la constitutionnalité de l'Entente dépendait de l'utilisation par les agent·es frontalier·es de « soupapes de sécurité », c'est-à-dire des mesures discrétionnaires pour protéger les migrant·es dont la sécurité serait menacée s'iels étaient renvoyé·es aux États-Unis.
Par exemple, un·e agent·e frontalier·e aurait le pouvoir d'accorder un visa de résident temporaire à une personne victime de violence conjugale, un motif de protection reconnu au Canada mais non aux États-Unis.
Cependant, en réalité, Amnistie internationale et le CCR ont constaté que ces « soupapes de sécurité » sont plutôt hypothétiques, et qu'elles ne sont même pas mentionnées dans le manuel d'opération des agent·es frontalier·es, en plus de reposer sur le jugement subjectif d'individus.
D'ailleurs, en mars 2023, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont élargi l'Entente afin qu'elle s'applique à l'ensemble de la frontière entre les deux pays et non seulement aux points d'entrée officiels. Cela a poussé les personnes en quête de refuge à tenter de traverser depuis des endroits plus éloignés et plus dangereux pour ne pas être interceptées.
•
Auteur·e
BIFAN SUN
Bifan Sun est journaliste spécialisée dans les enjeux de racisme et d'anti-racisme pour Pivot. Dans le cadre du projet « Différends : sur le terrain des luttes anti-racistes », soutenu par la Fondation canadienne des relations raciales, elle s'engage à faire entendre une pluralité de voix issues des communautés racisées sous-représentées dans la sphère médiatique francophone. Elle est titulaire d'une maîtrise en communication, pour laquelle elle a étudié la construction des récits de migration par un groupe de femmes migrantes marginalisées.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
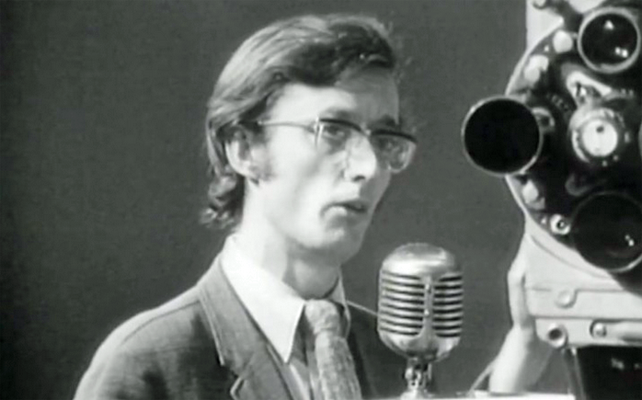
Le manifeste Waffle : pour un Canada indépendant et socialiste
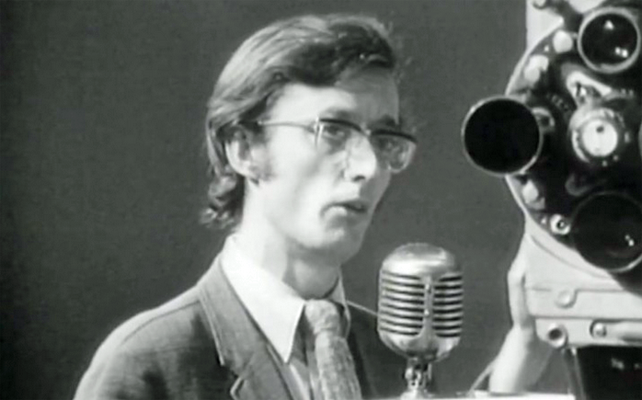
Le Waffle a eu un impact considérable dans la politique canadienne au cours des premières années 1970. En 1969, un caucus de membres du NPD, connus sous le nom de The Waffle, se sont organisé pour faire la promotion d'un programme socialiste et nationaliste qui, entre autre, devait nationaliser les industries de propriétés privées américaines. Plusieurs des idées les plus importantes de The Waffle ont d'abord été développées et débattues dans les pages de Canadian Dimension par ceux qui ont fini par être reconnus comme les leaders de The Waffle dont, Mel Watkins et James Laxer.
1er février 2025 | tiré de Canadian Dimension | Photo : Mel Watkins, un des fondateurs du Waffle
Traduction, Alexandra Cyr
Cette entreprise des années 1960 n'a pas duré. Mais cette gauche progressiste était ce dont le Canada avait besoin. C'est encore le cas aujourd'hui. Le chantage économique de D. Trump met en évidence les dangers de notre trop grande intégration avec les États-Unis. Les analyses du manifeste The Waffle sont plus pertinentes que jamais. Les voici.
1- Nous les socialistes démocratiques, avons pour but de construire un Canada indépendant et socialiste. À titre de supporters du NPD notre objectif est de le rendre pleinement socialiste.
2- L'avènement du socialisme doit attendre la formation d'une masse de socialistes à la base, dans les usines, les bureaux, les fermes et les campus. Le développement de la conscience socialiste doit devenir la principale priorité du NPD.
3- Le NPD doit être vu comme l'aile parlementaire d'un mouvement travaillant à un changement social fondamental. Il doit être radicalisé de l'intérieur comme de l'extérieur.
4- L'enjeu le plus urgent pour les Canadiens est la survie du pays. L'anxiété est perverse et l'objectif d'une plus grande indépendance économique reçoit un large appui. Mais l'indépendance économique sans le socialisme est un leurre tout comme pour une démocratie participative véritablement significative.
5- C'est le contrôle américain de notre économie qui représente la menace principale à notre survie nationale. L'enjeu majeur de notre temps n'est pas l'unité nationale mais notre survie nationale. La menace la plus importante vient de l'extérieur pas de l'intérieur.
6- Le capitalisme d'affaire américain est l'instrument le plus important qui forme les contours de la société canadienne. Il intervient grâce au formidable réseau des multinationales. L'élite d'affaire canadienne a choisi la position de partenaire de second rang avec ces entreprises. Le Canada devient un fournisseur de ressources et un marché de consommation dans l'empire américain.
7- L'empire américain est une réalité centrale pour la population canadienne. Il se caractérise par son militarisme à l'extérieur et son racisme à l'intérieur. Les ressources et la diplomatie canadiennes ont été intégrées dans le soutient à l'empire. Lors de la barbare guerre du Vietnam, le Canada a soutenu les États-Unis avec sa participation à la Commission internationale de contrôle et ses ventes d'armes et de ressources stratégiques au complexe industriel militaire américain.
8- L'empire américain tient grâce à ses alliances militaires dans le monde et à ses monopoles corporatifs gigantesques. L'adhésion du Canada au système américain d'alliances et la propriété de l'économie canadienne par les entreprises américaines, empêchent le Canada de jouer un rôle autonome dans le monde. Ces liens doivent tomber pour que les priorités socialistes puissent mettre à mal le capitalisme corporatif.
9- Le développement du Canada est entravé par l'économie capitaliste. Les investissements corporatifs créent et soutiennent la consommation individuelle inutile aux dépends des besoins sociaux. Les entreprises concentrent leurs investissements dans quelques milieux urbains principaux ce qui les rend de plus en plus inhabitables alors que le reste du pays vit dans le sous développement.
10- Les critères qui mènent la poursuite du profit sont la cause la plus importante de la mise de côté d'activités dont ils ne peuvent mesurer la valeur. Ce n'est pas par hasard si le logement, l'éducation, les soins médicaux et le transport public ne sont pas à la hauteur des besoins dans notre système social actuel.
11- Le problème des disparités régionales est la conséquence des orientations capitalistes guidées par le profit. Le coût social des secteurs dormants n'intéresse pas du tout les entreprises. Au Canada, cette situation est renforcée par son statut de colonie économique des États-Unis. Le capitalisme étranger est encore moins préoccupé par l'équilibre dans le développement du pays que les capitalistes locaux ne le sont ; ils n'ont pas de racines dans des régions particulières.
12- Un mouvement indépendant qui (verrait) à substituer les capitalistes américains par leurs confrères canadiens ou qui utiliserait les politiques publiques pour obliger les entreprises américaines à se comporter comme les canadiennes, ne peut être notre objectif final. L'indépendance du capitalisme canadien n'existe pas et toute prétention du monde des affaires canadien en ce sens, manque de crédibilité. Sans le soutien d'une forte classe capitaliste nationale, les gouvernements canadiens, libéraux ou conservateurs, ont agi dans le sens des intérêts internationaux particulièrement ceux du capitalisme américain et ont même manqué de volonté pour développer la plus modeste stratégie d'économie indépendante.
13- Le socialisme doit remplacer le capitalisme en planifiant nationalement les investissements et les propriétés publiques des moyens de production dans l'intérêt de toute la population. Le nationalisme canadien est une force pertinente à partir duquel il est valide de travailler à condition qu'il soit anti impérialiste. Au cours de la marche vers le socialisme, de telles aspirations vers l'indépendance doivent être prises en compte. Car rechercher sérieusement l'indépendance rend visible la nécessité du socialisme au Canada.
14- Ceux qui désirent le socialisme et l'indépendance du Canada ont souvent été déconcertés et mystifiés par le problème des divisions internes au pays. L'élément fondamental de l'histoire canadienne au cours du dernier siècle est la réduction du pays au statut de colonie des États-Unis qui entraine une augmentation des inégalités régionales. Mais on ne peut nier l'existence de deux nations dans le pays chacune avec sa propre langue, sa culture et ses aspirations. Cette réalité doit être incorporée dans la stratégie du NPD.
15- Le Canada anglais et le Québec peuvent partager des institutions communes à condition de partager des objectifs communs. Aussi longtemps que nos gouvernants sont convaincus que la politique nationale doit se limiter aux fonctions passives du maintien d'un climat paisible et sécuritaire pour les investissements étrangers, il ne peut y avoir d'unité qui ait du sens entre les Anglophones et les Francophones du pays. Aussi longtemps que le gouvernement fédéral refuse de protéger le pays de la domination économique et culturelle, le Canada anglais apparaitra comme une simple partie des États-Unis aux yeux des Canadiens français. Un Canada anglais préoccupé par sa survie nationale devrait créer des aspirations communes en vue de resserrer les liens entre les deux nations.
16- Le traitement de l'enjeu constitutionnel actuel ne peut être fait sans lien avec les forces économiques et sociales qui dominent les deux nations qui n'apporte rien de pertinent en plus. Les politiciens engagés dans les valeurs et les structures d'une société capitaliste ont rédigé notre constitution il y a un siècle. Les changements constitutionnels liés au socialisme devront être basés sur les besoin de la population plutôt que sur ceux des entreprises. Ils devront refléter les pouvoirs des classes et des groupes qui sont exclus des lieux de décision par le présent système.
17- L'importance de l'unité canadienne est cruciale dans la poursuite de la stratégie contre l'impérialisme américain. L'histoire et les aspirations du Québec doivent pouvoir s'exprimer totalement. Elles doivent s'implanter dans la conviction que de nouveaux liens émergeront de cette perception commune : « deux nations, une seule lutte ». Les socialistes du Canada anglais doivent s'allier aux socialistes québécois dans cette cause commune.
18- La tradition et la force de la classe ouvrière canadienne et son mouvement syndical sont déterminantes pour la création d'un Canada indépendant et socialiste. La revitalisation et l'extension du mouvement ouvrier apporterait une démocratisation fondamentale à notre société.
19- Le capitalisme corporatif est caractérisé par le pouvoir dominant de son élite soutenue et intégrée par l'élite politique. Les socialistes doivent adopter comme objectif central la démocratisation du processus industriel. Tout au long de son histoire le mouvement syndical canadien a mené la lutte démocratique contre les soit disant droits et prérogatives des propriétaires et de la gérance. Il a obtenu des victoires légales et morales en donnant aux hommes travailleurs un droit de parole affectif à propos de leurs futurs salaires. En ce moment, le « droit » des gestionnaires à contrôler les changements technologiques est confronté. Le NPD doit fournir le leadership à la lutte pour étendre l'influence des hommes travailleurs dans tous les secteurs industriels de prise de décision. Ceux qui travaillent doivent avoir le contrôle effectif de la fixation de leurs conditions de travail et un pouvoir effectif pour déterminer la nature du produit, son prix etc. La démocratie et le socialisme n'exigent rien de moins.
20- Les syndicalistes et les Néodémocrates ont été les fers de lance de l'extension de l'État providence canadien. Mais beaucoup reste à faire : plus de meilleurs logements, une structure d'imposition vraiment progressiste et un revenu annuel garanti. Mais ça n'est plus assez. Dans une société socialiste le contrôle démocratique de toutes les institutions est une réalité. Cela a un effet majeur sur la vie des personnes et où il y a des opportunités égales pour le développement personnel créatif sans exploitation attachée. Il est temps de dépasser l'État providence.
21- Les Néodémocrates doivent débuter les pressions en vue de la redistribution du pouvoir dans une direction socialiste. Il ne faut plus se contenter du simple bien-être social. De même, la lutte pour la participation des travailleurs dans le processus de décision industriel, contre les droits des gestionnaires est un pas vers une démocratie économique et sociale.
22- En renforçant le mouvement ouvrier canadien, les Néodémocrates » poursuivront la marche du Canada vers son indépendance. Tant que l'élite industrielle et d'affaire dominera l'activité économique canadienne, tant que les droits des travailleurs resteront confinés aux limites actuelles, les exigences de cette élite en vue du profit continueront à avoir préséance sur les besoins humains.
23- En plaçant d'abord les individus en position d'acheteurs et de vendeurs des uns et des autres, en enchâssant le profit et les gains matériels au-dessus de l'humanité et de la croissance spirituelle, le capitalisme a toujours été aliénant. Aujourd'hui, l'ampleur du désastre combiné aux technologies modernes exagèrent encore plus la perception d'insignifiance et d'impuissance des personnes. La transformation socialiste de la société rendra aux individus leur sens d'humanité les sortira de celui de n'être qu'une marchandise. Mais la démocratie socialiste implique que les personnes contrôlent aussi leur environnement immédiat. Dans n'importe quelle stratégie de construction du socialisme, la démocratie dans les communautés est vitale pour les succès électoraux. Avec cet objectif, les socialistes doivent lutter pour la démocratie dans ces milieux qui également nous affectent tous le plus directement, dans nos quartiers, nos écoles et nos lieux de travail. Les regroupements de locataires, de consommateurs et de coopératives de production sont des exemples de secteurs où les socialistes doivent diriger leurs efforts pour que la population s'implique directement dans la lutte pour le contrôle de sa destinée.
24- Le socialisme est un processus et un programme. Le processus vise à élever la conscience socialiste, la construction d'une base de masse socialiste et au développement d'une stratégie qui rende visible les limites du capitalisme libéral.
25- Alors que le programme évolue dans le processus, les éléments déterminants semblent clairs. Les instruments pour amener la propriété canadienne de l'économie du pays et son contrôle dans des mains canadiennes et pour modifier les priorités établies par le capitalisme corporatif sont à portée de mains. Cela intègre un large contrôle public sur les investissements, les nationalisations et le commandement des plus hauts niveaux économiques dont les industries des ressources essentielles, la finance, le crédit, les industries stratégiques pour la planification de notre économie. Dans ce programme, la participation des travailleurs dans toutes les institutions permettra de libérer des énergies créatives, de promouvoir la décentralisation et de restaurer les priorités humaines et sociales.
26- La lutte pour la construction d'un Canada socialiste et démocratique doit se faire à tous les niveaux de la société. Le Nouveau parti démocratique est l'organisation la mieux placée pour coordonner toutes ces activités en une vision commune. Ce Parti s'est développé à partir d'un mouvement pour le socialisme démocratique qui a des racines profondes dans l'histoire canadienne. C'est l'élément central autour duquel le nécessaire mouvement social et politique pour la construction d'un Canada indépendant et socialiste devrait se mobiliser. Il doit s'élever au niveau de ce défi ou devenir hors de propos. Joindre la lutte amènera la victoire.
N.B. Vos aurez pu constater que dans cette traduction je n'ai pas féminisé le texte ; au contraire j'ai gardé certaines expressions comme « working men » (no 19), « men's lives » (no.20) et « Bringing men together » Les mots femmes ou féminin n'apparaissent jamais dans ce texte. A.C.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Équateur menace d’aggraver les violations des droits de la personne dont sont victimes les nations et les communautés autochtones

(Ottawa-Toronto-Quito-Cuenca). Le projet d'accord de libre-échange entre le Canada et l'Équateur représente une grave menace pour les droits des autochtones en Équateur et doit être rejeté par les instances législatives canadiennes, a déclaré aujourd'hui une coalition d'organisations de la société civile canadienne, amplifiant ainsi les préoccupations des défenseurs des droits des autochtones et des femmes en Équateur.
Comuniqué : MiningWatch – Amnistie internationale — Common Frontiers — CCPA — Americas Policy Group – CONAIE – Amazonian Women Defenders of the Forest – Asociación Flor de Caña — Alliance for Human Rights in Ecuador – Water Administrators of Victoria del Portete
10 février 2025 | tiré du site d'Alter Québec | Photo : Marche de la Confédéraiton des peuples authochtone d'Équateur contre la Zone de libre-échange des Amériques en 2002 @ Donovan & Scott - CC BY-SA 4.0, via wikicommons
Cette semaine, les chefs de gouvernement du Canada et de l'Équateur ont annoncé la finalisation d'un accord commercial controversé qui, s'il est ratifié, portera atteinte aux droits et aux modes de vie des nations autochtones qui sont en première ligne face au changement climatique. Vanté par le président équatorien Daniel Noboa à la veille des élections nationales dans son pays, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Équateur progresse malgré l'opposition de la plus grande organisation autochtone de l'Équateur et de plusieurs nations autochtones déjà confrontées à des violations des droits de la personne dans le cadre de projets miniers canadiens sur leurs territoires.
Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que l'accord proposé comporte un mécanisme de règlement des différends entre groupes investisseurs et États (ISDS), alors que la population équatorienne a voté lors d'un référendum constitutionnel en 2024 en faveur de l'interdiction de l'inclusion de l'ISDS dans les futurs accords commerciaux. De nombreux organes et spécialistes de l'ONU ont recommandé de ne pas inclure l'ISDS dans les nouveaux accords commerciaux et de le retirer des accords existants, avertissant que l'ISDS entrave les efforts des États dans la lutte contre le changement climatique et le respect de leurs obligations internationales en matière de droits de la personne.
L'accord de libre-échange entre l'Équateur et le Canada favorise uniquement les sociétés minières transnationales et les intérêts privés de la famille du président Daniel Noboa », a déclaré Zenaida Yasacama, présidente par intérim de la Confédération des nationalités autochtones de l'Équateur (CONAIE), la plus grande organisation autochtone de l'Équateur, « L'industrie minière canadienne opère sans respecter les droits des communautés, encourageant la dépossession, la pollution de l'eau et la criminalisation de celles et ceux qui défendent la vie et le territoire ». Les peuples et nations indigènes ne permettront pas que le pays soit livré à des intérêts étrangers qui détruisent nos terres et criminalisent notre résistance.
L'automne dernier, Yasacama faisait partie des trois personnes en défense des droits des femmes et des peuples autochtones qui se sont rendues au Canada pour tirer la sonnette d'alarme sur les négociations commerciales en cours — en particulier sur le spectre de l'expansion de l'exploitation minière canadienne dans les régions écologiquement sensibles de l'Équateur et sur les dommages que l'exploitation minière supplémentaire causerait à leurs vies et à leurs territoires. Les délégations ont rencontré des responsables de la législation, des journalistes, des directions autochtones et des groupes de la société civile à Toronto, Ottawa et Montréal.
Au moins 15 sociétés minières canadiennes sont actives en Équateur. Dundee Precious Metals (DPM) fait partie des entreprises canadiennes qui ont récemment fait l'objet d'allégations d'abus alors qu'elles tentent de faire avancer une consultation liée à leur projet d'exploitation d'or-cuivre Loma Larga dans le páramo (zone humide de haute altitude) de Kimsakocha. Les communautés de cette région ont déjà voté en faveur de la protection de l'eau et contre l'exploitation minière lors de trois consultations populaires précédentes. Pourtant, des groupes locaux d'autochtones et de campesinos (travailleuses et travailleurs agricoles ruraux) de ces communautés affirment que la société minière et les autorités équatoriennes font pression pour obtenir une nouvelle consultation qui n'impliquerait que les personnes favorables au projet.
« Il est déjà difficile de se défendre contre les tentatives des compagnies minières canadiennes de faire avancer des projets dans le páramo de Kimsakocha sans notre consentement », a déclaré Hortencia Zhagüi, membre du conseil d'administration de l'administration de l'eau potable de Victoria del Portete et de Tarqui, dans la province d'Azuay.
« Et ce sera encore plus difficile si le pouvoir des sociétés minières telles que Dundee est renforcé par cet accord de libre-échange. Cet accord mettra en péril nos sources d'eau, notre souveraineté alimentaire et nos droits.
Plutôt que de demander des comptes aux sociétés minières canadiennes et de garantir un partage d'informations et une communication efficaces avec les communautés touchées, le Canada soutient ces sociétés en incluant des mécanismes tels que l'ISDS, qui ont été utilisés pour saper l'opposition locale à des projets de grande envergure. L'ISDS est couramment utilisé par les sociétés minières canadiennes pour poursuivre des pays devant des tribunaux supranationaux privés, par exemple, si on leur refuse un permis d'exploitation minière. Cela limite la capacité des gouvernements à refuser des permis afin de protéger leurs territoires et leurs eaux ou les droits de la personne de leurs citoyens et citoyennes.
L'année dernière, le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes a étudié les négociations de libre-échange entre le Canada et l'Équateur et a publié un rapport recommandant qu'« aucun accord ne soit mis en œuvre sans le consentement libre, préalable et éclairé de l'Équateur ».
Au milieu des menaces tarifaires du président Trump, le Canada présente ce nouvel accord comme une occasion de diversifier les partenaires commerciaux dans la région. « En réalité, c'est faire preuve de myopie que d'aller de l'avant avec un accord commercial dont le processus de négociation a été dénoncé à maintes reprises par les communautés autochtones équatoriennes et les organisations de la société civile, citant un manque de transparence et un défaut de consultation, a déclaré Viviana Herrera, coordonnatrice du programme Amérique latine de Mines Alerte Canada. Ces préoccupations, dont les responsables du Canada ont été directement informé.es l'automne dernier, ont été totalement ignorées. “Aujourd'hui, plus que jamais, les respoinsables de la législation au Canada devraient soutenir les droits de la personne et rejeter cet accord négocié dans le dos des communautés”, a-t-elle ajouté.
D'autres citations de responsables communautaires en Équateur :
“Le peu d'informations publiques qui existent indiquent que l'accord prévoit de contenir des mécanismes d'arbitrage international, malgré le fait que ces mécanismes sont incompatibles avec les droits de la personne, et aussi malgré le fait que lors d'un référendum en 2024, le peuple équatorien a voté contre l'autorisation de l'arbitrage international. Nous exhortons les responsables de la législation en Équateur et au Canada à voter contre cet accord, car le processus de négociation menace déjà l'environnement et les droits de la personne et va à l'encontre de la volonté du peuple”.
Femmes amazoniennes défenseurs de la forêt
“Nous avons été harcelées et intimidées pour nous être opposées à un processus illégitime de consultation environnementale pour le projet La Plata, qui appartient à la société minière canadienne Atico Mining. Nous voulons nous assurer que ces projets n'avancent pas dans les zones peuplées, les zones agricoles ou les zones où les gens se sont organisés et où les familles ont historiquement construit leur vie sur l'agriculture. Nous voulons que la vie soit valorisée et respectée. Nous ne voulons pas que nos territoires soient militarisés pour faire avancer les projets miniers canadiens. Cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Équateur, dont nous n'avons pas été informé.es, ne fera qu'aggraver le conflit socio-environnemental dans notre pays”.
Rosa Masapanta, présidente de l'Asociación Flor de Caña, une coopérative locale de canne à sucre dans le nord de l'Équateur.
“Nous, les organisations qui défendent les droits humains collectifs et les droits de la nature, dénonçons le fait que les négociations commerciales ont été menées dans le dos de ceux d'entre nous qui défendent les droits de la personne. Il n'y a jamais eu d'évaluation participative de l'impact de cet accord sur les droits de la personne, conformément aux normes internationales. Nous n'avons jamais reçu les informations que nous avons demandées à plusieurs reprises afin de les analyser et de les évaluer. Toutes les négociations se sont déroulées dans le plus grand secret. Et maintenant, ils prétendent être arrivés au bout de l'accord commercial. Dans ces conditions, un accord commercial comme celui qui a été conclu répondra aux intérêts des groupes qui ont participé à ce processus de négociation — le monde des affaires et l'État équatorien. Les réseaux défenseurs de la vie dans les territoires, les personnes affectées par les projets miniers et les membres de la société civile n'ont pas été invité.es à participer à ce processus”.
Vivian Idrovo, coordinatrice de l'Alliance pour les droits de la personne en Équateur
Citations d'organisations de la société civile au Canada :
« La conclusion de cet accord de libre-échange et l'inclusion de privilèges exorbitants pour les groupes investisseurs par le biais de l'ISDS révèlent les véritables priorités du Canada en Équateur : défendre les intérêts des sociétés minières plutôt que la protection des droits de la personne et de l'environnement. De nombreuses personnes craignent que cet accord commercial n'entraîne une augmentation de la violence et de l'impunité liées aux activités minières canadiennes dans le pays. Comment cela s'inscrit-il dans la politique étrangère du Canada en matière de droits de la personne et de féminisme ? »
Viviana Herrera, coordinatrice du programme Amérique latine, Mines Alerte Canada
« Des femmes équatoriennes défenseurs des terres ont courageusement risqué leur vie pour se rendre à Ottawa en octobre dernier. Elles ont partagé des témoignages effrayants sur la brutalité policière, la dégradation de l'environnement et la violence sexuelle auxquelles leurs communautés sont confrontées dans le cadre des activités minières canadiennes. Cet accord, négocié à la vitesse de l'éclair, ne les protège pas et exposera les femmes et les nations autochtones en première ligne de la protection de l'environnement en Équateur à des risques accrus. Il reflète un décalage troublant et durable entre l'approche du Canada en matière de commerce et ses engagements internationaux en matière de droits de la personne ».
Ketty Nivyabandi, secrétaire générale de la section anglophone d'Amnesty International Canada
« L'inclusion d'un processus de règlement des différends entre les groupes investisseurs et les États dans cet accord va à l'encontre des droits internationalement protégés des peuples autochtones. Elle va à l'encontre des souhaits du peuple équatorien, qui a massivement voté contre les tribunaux d'entreprise lors d'un référendum l'année dernière. Et il contredit toute notion de commerce inclusif telle que promue par le gouvernement canadien ».
Stuart Trew, chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives et directeur du projet de recherche sur le commerce et l'investissement du Centre.
Il est profondément troublant de constater que, derrière des portes closes et tout en prétendant être « inclusif », le gouvernement canadien continue de prendre des décisions sans tenir compte des impacts négatifs sur la vie et les moyens de subsistance des gens. Il est choquant que le Canada inclue un processus de règlement des différends entre les groupes investisseurs et États dans cet accord commercial alors qu'il a lui-même affirmé que l'ISDS donne la priorité aux droits des entreprises sur les gouvernements souverains et qu'il a coûté des centaines de millions de dollars aux contribuables canadiens ».
Caren Weisbart, coordinatrice de la coalition, Common Frontiers
« Les industries extractives du Canada ont eu un impact profond et durable sur la vie et le bien-être des communautés autochtones et rurales de l'Équateur, en particulier les femmes et les filles. Nous demandons au Canada de respecter leurs droits et de ne pas ratifier cet accord néfaste.
Silvia Vasquez Olguin, Americas Policy Group
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des affiches seront exposées à Tindouf, à l’ouverture de la 6ème Action Internationale de la Marche Mondiale des Femmes

C'est un appel à la solidarité pour l'indépendance de la dernière colonie d'Afrique. C'est un appel à la solidarité avec le peuple sahraoui qui résiste à l'occupation de son territoire par le Maroc et lutte résolument pour sa souveraineté.
Tiré de Entre les liges et les mots
La République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), mieux connue sous le nom de Sahara occidental, est une région du nord-ouest de l'Afrique, limitrophe de l'Algérie (à l'Est), de la Mauritanie (au Sud), du Maroc (au Nord) et de l'océan Atlantique (à l'Ouest). Cette région était sous domination coloniale espagnole entre 1884 et 1976, puis a été occupée par le Maroc et la Mauritanie. Et c'est ainsi qu'elle est témoin de la lutte pour l'indépendance du peuple sahraoui, d'abord contre les puissances coloniales puis contre les pays occupants pendant plus de 50 ans.
« Bien qu'elles doivent vivre dans des conditions extrêmement difficiles, les femmes sahraouies se battent pour l'indépendance et le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, d'une part, et d'autre part, elles forment déjà la société démocratique du futur », indique le document de la MMF. Nous dénonçons l'occupation historique du territoire sahraoui, la violence subie par son peuple et l'effacement de son histoire et de sa culture. Nous défendons que l'organisation populaire et la solidarité internationale sont fondamentales dans la lutte contre les guerres et l'impérialisme.
La solidarité féministe est un pilier de la Marche Mondiale des Femmes qui, en 2025, mènera sa 6ème Action Internationale. La fin des occupations, au Sahara occidental et en Palestine, est au cœur de cette action, dont le mot d'ordre est « Nous marchons contre les guerres et le capitalisme, nous défendons la souveraineté des peuples et le bien vivre. »
L'ouverture de l'Action internationale aura lieu le 8 mars, dans les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf, en Algérie. Nous invitons les femmes et les dissidents de genre, les artistes, les activistes et les collectifs de soutien à rejoindre cette mobilisation mondiale de solidarité féministe avec les femmes qui soutiennent la vie et la lutte au Sahara occidental.
Certains matériaux peuvent inspirer la production d'affiches, comme le mini-documentaire « Un drapeau planté dans le sable : les femmes sahraouies construisent la souveraineté », produit par Capire et par la MMF,le document de formation sur le Sahara occidental et les luttes des femmes sahraouies produites par la MMF (disponible en espagnol, anglais et français) et divers contenus textuels publiés ici. Les affiches soumises seront exposées dans une « khayma », une tente sahraouie, à Tindouf, lors de l'ouverture de la 6ème Action Internationale de la Marche Mondiale des Femmes. Elles seront également disponibles pour être imprimées et portées aux mobilisations féministes du 8 mars à travers le monde.
Nous appelons chacun.e à partager ses expressions artistiques pour renforcer le soutien public à la lutte des camarades sahraouies et à l'occasion de la 6ème Action Internationale de la MMF. Les affiches doivent avoir le format standard A3 et une résolution minimale de 300 dpi et doivent être envoyées au format JPG ou PNG en utilisant ceformulaire. La date limite de soumission est le 25 février 2025.
Accédez au formulaire ici !
Veuillez transmettre cet e-mail ! Si vous n'êtes pas déjà sur notre liste de diffusion, inscrivez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux (@capiremov). Nous avons besoin du soutien de tous pour promouvoir et étendre le portail Capire !
https://capiremovfrancais.substack.com/p/appel-a-affiches-pour-lautodetermination
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Saint-Valentin ne rime pas toujours avec amour

Planifier une sortie en amoureux. Recevoir des fleurs. Tout ce qu'il y a de plus banal, pour un 14 février. Mais derrière l'image d'un couple parfait, la St-Valentin n'a pas la même saveur pour toutes. En contexte de violence conjugale, la « belle attention » peut en fait sonner comme une menace : attention à ce qui va t'arriver si tu penses à me quitter… De l'extérieur, saurait-on voir la violence au-delà des apparences ?
Les femmes qui vivent de la violence conjugale (sans forcément toujours la nommer ainsi) nous le disent souvent ? : personne ne pourrait se douter que leur partenaire est violent ; personne ne croirait ce qu'elles vivent. Les auteurs de violence savent dissimuler leur vrai visage et prendre l'apparence d'un voisin serviable, d'un ami attentionné ou d'un collègue sympathique. Le contrôle et la violence s'exercent souvent derrière des portes closes, et prennent des formes subtiles.
Derrière cette façade, il y a presque toujours des signes qui devraient nous alerter. Même lorsqu'il n'y a pas de coups. Surtout lorsqu'il n'y a pas de coups. Et si on apprenait, chacun.e à son échelle, à les reconnaître ?
Changer de regard sur la violence conjugale
Les films, les romans ou même l'éducation que l'on a reçue nous ont transmis des idées sur l'amour qui peuvent nous aveugler. Être jaloux, n'est-ce pas une preuve d'amour ? Écrire ou appeler sans arrêt sa partenaire n'est-il pas le signe d'une relation passionnelle ? Géolocaliser sa partenaire, n'est-ce pas une façon de la protéger ? Ces comportements peuvent sembler banals si on les observe de façon isolée. Mais le cumul de tous ces gestes peut nous indiquer un schéma de comportements calculés pour isoler, contrôler, terroriser et priver la partenaire de sa liberté. C'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Pour le repérer, il faut aller au-delà des apparences et prendre au sérieux les comportements qui ne nous paraissent « pas corrects ».
Se sentir prise au piège dans une cage invisible. Se faire dire que c'est elle, le problème, et finir par le croire. Ne plus pouvoir décider pour soi-même. Obéir, pour éviter les représailles. Avoir peur, tout le temps. C'est le quotidien décrit par les femmes qui en sont victimes, dès l'adolescence parfois. Un quotidien où elles sont privées de ressources et de leur liberté.
Apprendre à reconnaître les signes
De l'extérieur, plusieurs signes peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur la présence de contrôle coercitif dans un couple : la femme (ou l'ado !) que vous connaissiez n'est plus tout à fait la même. Elle n'accepte plus aucune invitation ou seulement avec son chum, elle est pressée de rentrer chez elle après le travail ou après l'école, elle regarde son partenaire avant de prendre la parole, elle ne s'habille plus comme avant, elle ne pratique plus son sport favori, elle semble inquiète quand elle reçoit des appels.
En reconnaissant ces signes, l'entourage peut jouer un rôle déterminant pour soutenir une femme aux prises avec la violence conjugale : ouvrir le dialogue, nommer les inquiétudes, offrir du soutien, respecter ses choix, suggérer des ressources et surtout, surtout, garder le contact. Oser aborder le sujet, même si ce n'est pas facile, ça peut tout changer.
En tant que parent, ami.e, collègue, voisin.e, intervenant.e, soignant.e, vous pourriez être la personne qui fera toute la différence dans la vie de la victime. Et qui pourrait sonner l'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Dans le doute, n'hésitez jamais à appeler une maison d'aide et d'hébergement qui pourra vous aider à la soutenir au mieux.
En apprenant à voir les signes de contrôle coercitif, on peut aider à sauver des vies. En ce jour de célébration, rappelons-nous que l'amour ne devrait jamais être une prison.
– Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une planification énergétique avant tout projet de loi

Le 6 juin dernier, Pierre Fitzgibbon, alors ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, déposait le très attendu projet de loi 69 (PL-69) sur l'énergie. Sa successeure, Christine Fréchette,a repoussé les prochaines étapes de cheminement du PL-69 pour revoir les balises encadrant la tarification d'électricité, suivant l'annonce de possibles tarifs douaniers par le nouveau président américain.
Au cœur du PL-69 se trouve l'élaboration d'un Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE). Nous soutenons que le PGIRE devrait être préparé en amont de l'adoption de tout projet de loi concernant le secteur énergétique, incluant le PL-69. Une telle planification est réclamée de toutes parts depuis longtemps. En effet, le PGIRE est un outil stratégique de planification à long terme visant à coordonner de façon optimale l'approvisionnement, la production et la consommation d'énergie. Il est nécessaire pour assurer une prévisibilité dans le secteur énergétique, par exemple pour mieux prévoir les investissements pour des installations de production de composantes d'éoliennes. Lorsqu'il est élaboré au cours d'un processus de consultation large, un PGIRE permet de dégager une vision collective claire de l'avenir et d'augmenter l'adhésion à celle-ci. S'il est bien mené, il pourrait également favoriser une transition énergétique cohérente et équitable, notamment grâce à la modélisation de scénarios de sobriété énergétique dans tous les secteurs.
L'absence de progrès entourant le PGIRE est lourde de conséquences. Pendant qu'il tarde à mettre en place une planification digne de ce nom, le gouvernement continue de mettre la charrue devant les bœufs et de dilapider des ressources de façon improvisée. Les annonces se multiplient. On octroie des mégawatts à des projets controversés de multinationales comme Northvolt ou Tree Energy Solutions (TES)alors que la décarbonation des entreprises existantes est négligée et que des emplois sont menacés. On attribue des blocs d'énergie - que nous ne produisons pas encore ! - à des prix en dessous du coût de leur éventuelle production. On annonce les plus gros parcs éoliens jamais construits au Québec dans les régions du Saguenay-Lac–Saint-Jean (à Saint-Honoré et dans la zone Chamouchouane), duBas-Saint-Laurent ou de laCôte-Nord, sous forme de partenariats entre des communautés et Hydro-Québec, sans encadrement clair de la place du privé. Si le PL-69 était adopté, il permettrait d'augmenter considérablement les parts du privé dans le système énergétique, sans pour autant que ce changement de paradigme n'ait été discuté publiquement.
Les transformations du système énergétique et les investissements devraient pourtant être guidés par l'ambition et la cohérence. Les questions à aborder ne se limitent pas à la quantité d'énergie à produire, puisque pour déterminer nos besoins réels, il est aussi question de choix de société qui auront des impacts à long terme sur notre quotidien et le Québec de demain.
C'est sur une vision partagée et bien comprise que repose notre capacité à réussir une transition énergétique juste et à assurer des tarifs d'électricité abordables pour l'ensemble de la population. Nous devons collectivement nous entendre sur les conséquences que nous pouvons accepter quant à nos choix énergétiques. Pour le moment, on avance à tâtons, avec des initiatives éparpillées et improvisées qui ne peuvent que peser de façon plus marquée sur l'augmentation des tarifs d'électricité, accentuer les impacts sur le territoire et favoriser les conflits sociaux.
Il s'ensuit que l'opposition s'enflamme autour du déficit démocratique que représentent de nouveaux projets, peu transparents, et qui ne s'appuient pas sur une compréhension commune des défis qui se présentent à nous, ni des balises et des solutions à considérer.
Avec un grand nombre d'organisations, nous réclamons depuis plus de deux ans que le gouvernement mette en place une nouvelle politique énergétique alignée sur la science et une planification permettant d'implanter un système énergétique socialement juste, décarboné et respectueux des limites des écosystèmes. Nous demandons que soient débattus largement et publiquement des scénarios diversifiés intégrant des approches qui réduisent la consommation collective d'énergie plutôt que de répondre aveuglément à une demande industrielle croissante. Nous demandons que le processus soit indépendant et transparent, et qu'il laisse la place à une diversité de voix et d'intérêts de la société.
Nous réitérons l'urgence de se doter d'un PGIRE, qui repose sur une vision publiquement débattue et largement partagée. Sans cette planification, il est imprudent et impertinent d'aller de l'avant avec des réformes législatives, incluant le PL-69, qui risquent de ne favoriser qu'une addition d'initiatives industrielles manquant cruellement de cohérence et de transparence.
Signataires (nom, rôle, organisation) :
Denis Bolduc, secrétaire-général, Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec (FTQ) ;
Philippe Duhamel, coordonnateur général du Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ)
Martin Vaillancourt, Directeur général, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ)
Jean-Pierre Finet, analyste en régulation de l'économie de l'énergie, Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ)
Patrick Gloutney, Président du Syndicat de la fonction publique au Québec (SCFP-Québec)
Christian Savard, Directeur général, Vivre en ville
Maxime Dorais, Co-directeur général, Union des consommateurs
Alice-Anne Simard, Directrice générale, Nature Québec
Danielle Demers, présidente, Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert
Francis Waddell, co-porte parole du regroupement citoyen.ne.s Demain Verdun
Maude Prud'homme, Réseau québécois des groupes écologistes
Dominique Daigneault, Présidente, Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
André Bélanger, Fondation Rivières
Jean Paradis, Fondation coule pas chez-nous
Martin Poirier, NON à une marée noire dans le Saint-Laurent
Odette Sarrazin, Les Amis de l'environnement de Brandon
Réal Lalande, président, Action climat Outaouais (ACO)
Benoit St-Hilaire, Prospérité Sans Pétrole
Lucie Massé, Action Environnement Basses-Laurentides
Charles-Edouard Tetu, Analyste politique - Climat et énergie, Équiterre
Karl Janelle, président - Coalition climat Montréal
Ann-Sophie Croft-Lebel, chargée de projet, Collectivité ZéN de Rimouski-Neigette
Valérie Lépine, Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)
Elsa Beaulieu Bastien, formatrice, Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)
Aimée Lévesque, comité noyau de Rimouski en transition
Marie-Claire Binet, Présidente, L'Assomption en transition
Johanne Dion, Collectif-Entropie
Émilie Laurin-Dansereau, ACEF du Nord de Montréal
Emmanuel Cosgrove, Directeur, Écohabitation
Pour voir la liste complète des signataires.
Front commun pour la transition énergétique
* Les affirmations de ce communiqué n'engagent aucunement l'ensemble des membreset allié·es du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ).
Le FCTÉ est une coalition créé en 2015 et qui regroupe environs 85 organisations environnementales, citoyennes, syndicales et communautaires qui souhaitent accélérer la mise en place d'une transition énergétique structurante et porteuse de justice sociale.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Vers un nouveau mandat de grève dans les CPE

La CSN, qui représente 80 % des travailleuses syndiquées en CPE, dénonce la lenteur des négociations. Pendant que les appuis de parents, de directions de CPE et de la population s'accumulent, le gouvernement continue d'avancer à pas de tortue.
Si le gouvernement ne met pas d'offres intéressantes sur la table pour faire débloquer la négociation, la CSN annonce qu'elle ira consulter ses syndicats à la recherche d'un nouveau mandat de grève. Les quelque 13 000 travailleuses affiliées à la CSN exercent une troisième journée de grève partout au Québec. Elles se rassemblent devant leur CPE pour se faire entendre.
La CSN, qui représente 80 % des travailleuses syndiquées en CPE, dénonce la lenteur des négociations. Pendant que les appuis de parents, de directions de CPE et de la population s'accumulent, le gouvernement continue d'avancer à pas de tortue. Comme il reste deux jours dans la banque de cinq jours de grève, les syndicats de la CSN seront rassemblés dans les prochains jours pour discuter du prochain mandat de grève à adopter. Des séquences de grève de plus longue durée pourraient se tenir prochainement, à moins qu'une entente de principe n'intervienne.
Une nouvelle journée de grève qui démontre la détermination des travailleuses des CPE
Le gouvernement persiste à porter plusieurs demandes de recul à la table de négociation. À l'heure où la pénurie de personnel frappe de plein fouet le secteur, la CSN croit que ces reculs doivent être retirés pour, au contraire, bonifier les conditions de travail et les salaires. Dans cette négociation, les travailleuses demandent notamment :
– une charge de travail moins lourde ;
– une meilleure rémunération pour assurer l'attraction et la rétention ;
– des primes de disparité régionale pour les employé-es de certaines régions éloignées ;
– des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants, entre autres par des ratios bien balisés et respectés entre le nombre d'éducatrices et d'enfants, ainsi que par un meilleur soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers.
« Nous avons trois journées de négociation à venir les 20, 21 et 25 février. Si le gouvernement ne comprend toujours pas le message, nous allons monter la pression d'un cran et aller chercher un nouveau mandat de grève. Les travailleuses sont déterminées à obtenir une meilleure valorisation de leurs emplois », lance Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN).
« Il y a une grande vague d'appui pour les travailleuses et les travailleurs des CPE. C'est un réseau auquel les Québécoises et les Québécois tiennent beaucoup. Pourquoi faut-il toujours faire la grève pour que les femmes se fassent entendre de ce gouvernement ? », explique Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs privés de la FSSS–CSN.
« On commence à comprendre la façon de faire du gouvernement Legault : quand il doit négocier dans des milieux d'emploi féminins, il se traine les pieds. Ça fait près de deux ans que ces travailleuses sont sans convention collective. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour mettre ce qu'il faut sur la table pour mieux valoriser les emplois en CPE ? », demande François Enault, premier vice-président de la CSN.
Une grève partout au Québec
La CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l'ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE. Voici le nombre de centres affiliés à la CSN par région :
– 7 CPE en Abitibi-Témiscamingue
– 12 CPE au Bas-Saint-Laurent
– 10 CPE sur la Côte-Nord
– 22 CPE dans le Centre-du-Québec et la Mauricie
– 36 CPE en Estrie
– 12 CPE en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine
– 11 CPE dans Lanaudière
– 25 CPE dans les Laurentides
– 51 CPE en Montérégie
– 112 CPE à Montréal et à Laval
– 23 CPE en Outaouais
– 64 CPE à Québec et dans Chaudière-Appalaches
– 31 CPE au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Industrie forestière : le Québec doit profiter de la crise tarifaire pour revoir sa stratégie

La menace tarifaire du président Trump et la hausse des droits compensatoires sur le bois d'œuvre font dire au PDG du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) Jean-François Samray que le Québec est mûr pour une stratégie nationale de construction. Nous sommes d'accord avec lui, mais il faut aller plus loin.
* La lettre est signée par Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, Dominic Lemieux, directeur québécois des Métallos, Dominic Tourigny, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), et Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).
Il faut améliorer la résilience de notre industrie. Pour y parvenir, nous appuyons l'idée d'un rehaussement de l'usage du bois dans la construction tout comme celle d'une meilleure prise en compte de l'empreinte carbone des bâtiments lors de l'émission des permis. Nous soutenons également la proposition de modifier le Code de construction du Québec afin de faciliter le recours au bois massif et au bois d'ingénierie pour les édifices en hauteur.
Comme aurait dit Churchill ; il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Profitons de celle-ci pour aller plus loin. La crise actuelle nous offre l'occasion d'investir dès maintenant pour adapter notre stratégie manufacturière et assurer l'avenir de notre industrie.
Pour nous, la création d'un chantier national de construction est un exemple d'action qui peut servir d'incubateur pour le développement à grande échelle d'un nouveau créneau industriel qui permettrait d'asseoir la relance de la foresterie québécoise sur des bases plus durables au profit des régions forestières.
Les investissements dans la fabrication d'une nouvelle génération de composantes et de systèmes de construction modulaires nous permettraient de renforcer notre capacité d'innovation dans un secteur d'activité à haute valeur ajoutée. Ce modèle existe déjà, il faut maintenant lui donner plus d'ampleur. Les travailleurs des régions sont disponibles et capables de faire beaucoup plus que d'envoyer des matériaux de base sur les chantiers de construction des grandes villes.
Depuis longtemps, on reconnaît le potentiel structurant de la diversification des activités des entreprises forestières vers des créneaux de deuxième et troisième transformation, mais on ne s'est jamais donné les moyens de nos ambitions. Le temps est venu d'y voir.
Cette réflexion doit toutefois dépasser le seul exemple du chantier national de construction. Ne nous contentons pas de solutions à la pièce. Il faut maintenant envisager la mise en place d'une stratégie globale d'innovation industrielle. Développer de nouveaux créneaux en se tournant davantage vers la valeur ajoutée. Valoriser les millions de mètres cubes de bois que la structure industrielle actuelle laisse en forêt. Nous voulons une stratégie réfléchie et des gestes forts de la part des gouvernements et de l'industrie.
Cette transformation industrielle doit être accompagnée d'une réforme de l'aménagement forestier afin que la nouvelle industrie puisse compter sur des approvisionnements durables et prévisibles. Ceux-ci doivent notamment s'appuyer sur des stratégies sylvicoles diversifiées et rigoureuses qui pourront compter sur un cadre financier conséquent.
Finalement, pour être durable et prévisible, la filière bois doit respecter la capacité de support des écosystèmes et la biodiversité tout en cultivant la paix sociale en forêt. Il en va de la prévisibilité et de l'accès à tous les marchés que nous voudrons conquérir.
Voilà ce à quoi nous réfléchissons pour construire l'avenir des travailleuses et des travailleurs. Nos syndicats sont réunis dans l'organisation d'un sommet sur la forêt qui se tiendra au printemps et qui servira à rassembler tous les acteurs du milieu forestier qui voudront contribuer à l'avancement de ces idées.
Réagir à la crise tarifaire, oui ! Mais avec un plan bien réfléchi dans l'intérêt à long terme des communautés forestières. Souhaitons que la ministre entende notre message.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nouvel assaut sur les travailleuses et travailleurs canadiens : les tarifs de 25 % imposés par Trump sur l’acier et l’aluminium canadiens

Aujourd'hui, Donald Trump a lancé un assaut économique sur les travailleuses et travailleurs canadiens en imposant un tarif de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium. Ce tarif insouciant menace des dizaines de milliers d'emplois qui paient bien et il déstabilise des industries qui sont des piliers de l'économie canadienne.
L'acier et l'aluminium sont des éléments cruciaux de la base industrielle du Canada, fournissant des intrants essentiels aux secteurs de l'automobile, de l'énergie, de la construction, des transports et de la fabrication. Au total, plus de 43 000 emplois canadiens sont directement ou indirectement menacés. Quand Trump a imposé des tarifs semblables en 2018, les exportations d'acier du Canada aux É.-U. ont diminué de 38 %, causant des difficultés économiques aux travailleuses et travailleurs et aux collectivités de tout le pays. L'industrie de l'aluminium, qui souffre déjà des perturbations commerciales mondiales, voit mettre en péril 9 500 emplois directs canadiens.
« Les tarifs de Donald Trump sont un assaut direct sur la main-d'œuvre et l'économie du Canada. Ces tarifs ne protègent pas des emplois—ils en éliminent. Le Canada ne peut pas se croiser les bras pendant que ses travailleuses et travailleurs sont traités comme des monnaies d'échange dans le cadre de la guerre commerciale déclarée par Trump. Notre gouvernement doit répondre en prenant une forte action immédiate pour défendre les industries canadiennes et les travailleuses et travailleurs qui les tiennent aller », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.
Les syndicats du Canada ont riposté en 2018 et ils riposteront de nouveau. Nous incitons le gouvernement fédéral à prendre sur-le-champ des mesures pour défendre les travailleurs et travailleuses du Canada, comme par exemple de fortes mesures de rétorsion, des investissements dans les industries affectées et un soutien direct aux travailleuses et travailleurs impactés.
Les tactiques de guerre commerciale de Trump font passer les profits des entreprises avant le gagne-pain des travailleuses et travailleurs. Le Canada ne doit pas permettre que les politiques étasuniennes prennent son économie en otage. Nous épaulons les personnes qui travaillent dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium et exigeons une réponse forte et rapide pour protéger emplois, industries et collectivités.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des employé⋅es d’Amazon en grève pour la reconnaissance de leur syndicat !

La semaine avant Noël, des travailleurs et des travailleuses d'Amazon à travers les États-Unis ont lancé la plus grande grève nationale contre l'entreprise de l'histoire du pays. Des employé∙e∙s de neuf sites différents ont débrayé pour exiger que l'entreprise reconnaisse notre syndicat, les Teamsters, et négocie les termes d'un premier contrat de travail.
17 janvier 2025 | tiré du site d'Alternative socialiste | Photo : Des employé⋅es d'Amazon en grève pour la reconnaissance de leur syndicat !
https://alternativesocialiste.org/2025/01/17/les-employe⋅es-damazon-kcvg-en-greve-pour-la-reconnaissance-de-leur-syndicat/
Cela a marqué la fin d'une année mouvementée pour l'organisation des travailleurs et travailleuses d'Amazon. Mes collègues du site KCVG (terminal d'Amazon à l'aéroport de Cincinnati au Kentucky) et du syndicat de l'entrepôt JFK8 à Staten Island (dans l'État de New York) se sont affilié⋅es aux Teamsters. Ces campagnes sont deux des plus grandes campagnes syndicales chez Amazon. J'ai eu l'occasion de rejoindre mes frères et soeurs de JFK8 sur la ligne de piquetage dès le premier jour de leur grève, apportant mon soutien et ma solidarité, et montrant à Amazon qu'il s'agit d'un combat national pour gagner ce qu'on mérite !
En 2022, les travailleuses et les travailleurs de JFK8 ont été les premiers à remporter une élection syndicale chez Amazon [ce qui permet d'autoriser l'accréditation d'un syndicat aux États-Unis]. Ces employé⋅es l'ont fait grâce à une approche peu commune dans le mouvement ouvrier d'aujourd'hui : une campagne de lutte de classe basée sur des revendications concrètes et audacieuses. Ce sont les employé∙es d'Amazon eux et elles-mêmes qui ont poussé la campagne jusqu'à la victoire.
Cette victoire a fait des vagues dans le monde entier, inspirant d'autres employé∙es d'Amazon vers l'organisation syndicale. En 2023, mes collègues et moi à KCVG avons suivi leurs traces en lançant une campagne de syndicalisation avec le syndicat indépendant Amazon Labor Union (ALU). En 2024, nous nous sommes affiliés aux Teamsters. JFK8 nous a rejoint en s'affiliant également aux Teamsters, devenant l'ALU-IBT Local 1. La revendication des travailleuses et des travailleurs de JFK8 pour un salaire de base de 30$/h a trouvé un écho à travers tout le pays. Elle a été adoptée sur plusieurs sites, y compris à KCVG.
Malgré son impact, le syndicat de JFK8 n'a toujours pas été reconnu par Amazon à ce jour. Avec ténacité, les travailleuses et les travailleurs restent déterminés à surmonter chaque obstacle en s'organisant sans relâche. La grève de décembre représente une étape clé dans cette direction.
Sur la ligne de piquetage de JFK8, j'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux collègues du plancher. Un élément clé pour assurer une forte participation à la grève a été la clarté des revendications que le syndicat est allé défendre à la table des négociations. Notamment, un salaire de base de 30$/h, la suppression des plafonds salariaux au bout de trois ans et l'octroi de 180 heures de congés payés. Pour les employé∙es d'Amazon, cette grève a été une première expérience. Les membres ont appris à tenir une ligne de piquetage, à scander des slogans et à mobiliser leurs collègues. Cette expérience a été acquise par les nouveaux et les nouvelles leaders du mouvement.
Avant la grève, la section locale a formé un nouveau groupe de délégué∙es syndicaux. Cela s'est tout de suite fait ressentir lors du relai de la ligne de piquetage à 6 heures du matin. À ce moment, un piquet animé et important s'est formé. Les employé∙es distribuaient des tracts avec énergie à leurs collègues, les encourageant à se joindre au mouvement.
Justin Saccardo, un nouveau délégué syndical, a partagé son point de vue sur les efforts déployés :
Avant la grève, il y a eu beaucoup de sacrifices de la part de nombreuses personnes. Il y a eu beaucoup de nuits blanches et de pauses déjeuner sacrifiées pour organiser. Tout le monde était à 110%, entre les heures supplémentaires obligatoires et l'organisation. Beaucoup de nouvelles personnes militantes ont trouvé leur place dans le mouvement et ont commencé à pousser leurs propres initiatives.
La consolidation des travailleuses et des travailleurs à travers cette campagne d'organisation au sein des Teamsters représente un développement majeur pour le mouvement. Elle a posé les bases des actions de grève coordonnées durant la haute saison des ventes d'Amazon et de celles à venir. Grâce à leur soutien, les Teamsters renforce le pouvoir collectif des salarié·e d'Amazon. Les Teamsters représentent 1,3 million de membres, principalement dans le secteur de la logistique. C'est un rapport de force incroyable venant du fait qu'ils sont capables de paralyser une grande partie deAvant la grève, il y a eu beaucoup de sacrifices de la part de nombreuses personnes. Il y a eu beaucoup de nuits blanches et de pauses déjeuner sacrifiées pour organiser. Tout le monde était à 110%, entre les heures supplémentaires obligatoires et l'organisation. Beaucoup de nouvelles personnes militantes ont trouvé leur place dans le mouvement et ont commencé à pousser leurs propres initiatives. cette industrie.
Les membres des Teamsters chez UPS et DHL devront se tenir aux côtés de leurs frères et sœurs d'Amazon pour améliorer les conditions de travail de tous les salarié·e·s de la logistique. Des campagnes fortes continuent également de se développer en dehors des Teamsters, comme CAUSE (Carolina Amazonians for Solidarity and Empowerment) en Caroline du Nord, qui vient de déposer une demande d'élections syndicales (quelques jours après le début de la grève) ! Notre mouvement doit viser une coordination accrue entre différents syndicats à mesure que nous avançons.
Pour remporter la victoire chez Amazon, une entreprise pesant 2 000 milliards de dollars, il faudra mener un combat national à grande échelle et international. Bien que cette grève n'a pas encore été d'une ampleur suffisante pour contraindre Amazon à négocier, elle a représenté un véritable progrès pour le mouvement par rapport à la situation d'il y a un ou deux ans. Ce type d'action coordonnée à l'échelle nationale, rendue possible grâce à l'organisation au sein d'un grand syndicat, peut servir de tremplin pour des centaines d'autres sites Amazon en renforçant la confiance des travailleuses et des travailleurs.
À l'avenir, alors que davantage de sites entreront en grève, il sera essentiel de continuer à montrer sa solidarité et à envoyer des travailleuses et des travailleurs de tout le pays soutenir et apprendre les uns des autres.
Comme l'a exprimé Sultana Hossain, secrétaire archiviste de l'ALU-IBT Local 1 :
Au cœur de cet effort se trouve la nécessité de développer une militance de la base, en donnant aux travailleurs d'Amazon le pouvoir de mener leur propre combat pour la justice et en s'assurant que le mouvement reste ancré dans leurs voix et leurs besoins. Un mouvement fort et militant de la base renforcera la solidarité, préparera les travailleurs à affronter la résistance de l'entreprise avec unité et détermination, et générera l'élan nécessaire pour faire pression sur Amazon afin qu'elle négocie un contrat équitable. En tant que l'un des combats syndicaux les plus marquants du 21ᵉ siècle, cette lutte a le potentiel d'établir une nouvelle norme pour les droits des travailleurs dans tous les secteurs.
Ces grèves ne sont que le début d'une série de grèves nécessaires pour obtenir une première convention collective solide chez Amazon. Les Teamsters se préparent à faire grandir un mouvement capable de contraindre l'entreprise à négocier. Cependant, le véritable défi est de savoir comment nous capitaliserons sur cet élan dans la nouvelle année.
Des revendications audacieuses et concrètes avec des éléments communs pour unir le mouvement seront essentielles pour y arriver. De même, une direction syndicale totalement démocratique composée des travailleurs et travailleuses sera indispensable pour soutenir presqu'un million de salarié·e·s d'Amazon qui pourraient rejoindre le mouvement et se syndiquer.
par Josh Crowell, Socialist Alternative (ISA aux États-Unis) et employé d'Amazon KCVG
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un grand texte de Nadia Valavani sur le premier gouvernement Tsipras

Il n'y a pas de doute que le texte de Nadia Valavani, que nous publions ci-dessous, constitue une surprise à la fois inattendue et extrêmement bien venue.

Les raisons en sont multiples. Tout d'abord, il se distingue parce qu'il fait exactement ce qu'aucun des protagonistes de l'aventure du premier gouvernement grec de gauche, le gouvernement Tsipras, n'a fait : un bilan critique de ses actes et de leurs conséquences. Et ce, dans un texte presque laconique mais en même temps exhaustif, qui n'a rien à voir avec les logorrhées traditionnelles et d'habitude vides de sens de la gauche grecque.
Ensuite, il se distingue par le fait que ce bilan critique est fait en référence aux deux caractéristiques fondatrices, mais – malheureusement - complètement abandonnées et oubliées aujourd'hui, de la gauche : l'internationalisme et la lutte des classes. Et c'est précisément pour cette raison que le bilan critique de Valavani parvient à identifier dès le départ les causes profondes de l'échec patent du premier gouvernement Tsipras dans son refus *« d'affronter ouvertement les créanciers* » et de s'adresser* « non plus aux gouvernements, mais aux peuples d'Europe et du monde * ». (1)
Et enfin, le texte de Valavani se distingue et s'avère d'une immense utilité pour le présent et l'avenir du mouvement ouvrier et socialiste, car en choisissant d'identifier les conséquences à long terme de l'échec du premier gouvernement Tsipras, il parvient à déceler les changements catastrophiques qu'il a provoqués - et continue de provoquer - dans les rapports de forces classistes dans notre pays. En d'autres termes, Valavani explique la crise prolongée et la paralysie de la gauche grecque comme une conséquence directe de la défaite de dimensions historiques subie par le
mouvement ouvrier et socialiste grec avec la capitulation de la direction de Syriza en ce funeste mois de juillet 2015 !
Mais, que Mme Valavani nous permette d'ajouter à son bilan une conséquence de plus que nous considérons comme étant peut-être encore plus importante parce que se situant au cœur des malheurs actuels de la gauche grecque et
internationale. Le gouvernement Tsipras, et par extension les dirigeants de Syriza, n'ont pas trahi seulement les espoirs des citoyens grecs qui leur avaient fait confiance. Ils ont également trahi les espoirs placés en eux - et accessoirement dans le Podemos espagnol, qui a suivi une trajectoire analogue à celle de Syriza - par des millions de gens de gauche ou même sans parti partout en Europe et même au-delà ! Et c'est précisément parce que ces espoirs qui avaient été placés dans le Syriza grec et le Podemos espagnol ont été trahis à un moment où la crise multiforme s'aggravait, les gauches traditionnelles devenaient de plus en plus paralysées et discréditées, et l'extrême droite était déjà en pleine ascension, que les conséquences internationales de la capitulation du gouvernement Tsipras sont encore plus catastrophiques que les conséquences purement grecques !
Et ceci parce que, en raison de la faillite d'abord de Syriza et ensuite de Podemos, mais aussi en raison de l'incapacité de la gauche à expliquer le pourquoi de cette faillite, il était assez logique de voir tous ces gens qui leur avaient fait confiance et avaient cru en eux comme étant leur ultime bouée de sauvetage, perdre à la fois le moral et la boussole. La suite est bien connue : sur les ruines laissées par cette trahison de tant d'espoirs existentiels de millions de gens ordinaires qui d'ailleurs n'étaient pas tous de gauche, s'est agrandie au point de devenir un monstre gigantesque l'extrême droite dure et ouvertement nostalgique des démons de l'entre-deux-guerres qui menace aujourd'hui l'humanité et la planète d'anéantissement.
Lisez donc avec attention ce texte très important de Nadia Valavani qui, bien que publié il y a déjà un mois, n'a pas suscité la moindre réaction et le moindre commentaire de la part des gens de gauche de toute sensibilité, lesquels préfèrent manifestement l'ignorer ostensiblement...
*Note*
1. Dès le lendemain de la formation du premier gouvernement Tsipras, l'auteur de ces lignes avait publié des articles dans lesquels il soulignait que le gouvernement Tsipras n'avait qu'un seul atout et une seule arme contre ses ennemis : la solidarité des millions de citoyens européens qui plaçaient leurs espoirs dans Syriza et son gouvernement. Et c'est pourquoi il exhortait les directions de Syriza et du gouvernement Tsipras à organiser sans perdre de temps cette solidarité internationale en
prenant des initiatives concrètes. Voir nos articles : Quelle réponse de Syriza aux millions de citoyens solidaires de par
l'Europe ? <https://www.cadtm.org/Quelle-repons...> Nos meilleurs alliés, les 300 000 de Puerta del Sol !
<https://www.cadtm.org/Nos-meilleurs...>
**Plusieurs fois emprisonnée durant la dictature des colonels, Nadia Valavani a été vice-ministre des Finances du premier gouvernement Tsipras dont elle a démissionné le 15 juillet, dix jours après le referendum populaire dont le résultat (61,31% des Non au chantage de l'UE, de la BCE et du FMI) n'a pas été respecté par la plupart des dirigeants de ce
gouvernement et de Syriza.*
*Réponse de **NADIA VALAVANI **à la question de l'enquête du journal «
Epohi » 10 ANS APRÈS L'HISTORIQUE 2015*
En 2015, le premier gouvernement Syriza, élu en s'engageant devant le peuple à parvenir à « un compromis honorable pour sortir des mémorandums », après avoir commis - nous avons commis - l'erreur de continuer à payer les tranches de la dette
jusqu'à ce que les caisses publiques soient complètement épuisées, s'est retrouvé le dos au mur face à trois alternatives :*
*La première : affronter ouvertement les créanciers, en s'adressant désormais non plus aux gouvernements mais aux peuples d'Europe et du monde, entouré du prestige conféré par le mandat populaire sans équivoque du Référendum de Juillet - le seul processus électoral au monde qui s'est déroulé avec des banques fermées. À l'époque, selon les dires au conseil des ministres du ministre responsable, la Grèce disposait de six mois de médicaments, de neuf mois d'aliments et de douze mois de carburant. Il faut ajouter à cela un mouvement international de soutien et de solidarité en pleine ascension, à la dynamique imprévisible - si on le laissait se développer sans entrave. Sortirions-nous vainqueurs d'une telle confrontation ? Nul ne peut le savoir. Si oui, cela amorcerait inévitablement le détricotage de la camisole de force budgétaire du Pacte
de Stabilité. Dans le cas contraire, il ne s'agirait pas d'une défaite : Ce serait la plus honnête des luttes, un héritage de fierté pour l'avenir - une lutte dont on peut dire sans hésiter qu'elle « continue ».*
*La deuxième option n'a pas la grandeur de la première, mais elle est également honorable. S'il n'y avait pas l'unité nécessaire pour une telle lutte, que le gouvernement démissionne et que le troisième mémorandum soit introduit par ses admirateurs, par ceux qui soutenaient que si les mémorandums (qui ont détruit d'innombrables vies) n'étaient pas de la Troïka, nous aurions dû les inventer « nous ». Cela aurait sans doute été une défaite, mais une défaite tactique : Les forces nécessaires seraient bientôt réunies à nouveau – ensemble avec le mouvement populaire-, plus mûres et plus sages.*
*A été suivie la troisième option, contre la volonté populaire déjà exprimée, c'est-à-dire un troisième mémorandum avec ce que Samaras n'a pas osé signer et une « sortie » des mémorandums avec une paupérisation tragique du pays et des humains durant 60 ans - une défaite stratégique, destructrice à long terme : Elle a empoisonné le mouvement et le peuple en lutte avec le TINA thatchérien, a démantelé tout ce qui existait de collectif, a plongé toute la gauche (et pas seulement ceux qui ont dit le « grand oui ») dans une crise existentielle. Dix ans plus tard, nous luttons pour garder notre tête hors de ses eaux usées.*
*À plusieurs reprises, la gauche a pratiqué la « fuite en avant » sans s'occuper des comptes jamais réglés du passé – d'habitude avec des résultats tragiques. Y a-t-il une chance de surmonter la crise actuelle d'absence de tout ce qui a un vrai sens et une vraie valeur pour le peuple et le pays, uniquement en « contournant » 2015 ?*
*Traduit du grec*
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nouvelle émission : Claudette Carbonneau, présidente de la CSN de 2002 à 2011

Chez nous, devoir mentionner le nom de la première femme à avoir présidé une centrale syndicale canadienne ou québécoise, c'est systématiquement oublier celui de Shirley Carr qui pilota le CTC de 1986 à 1992, c'est possiblement se souvenir de celui de Lorraine Pagé qui dirigea la CEQ de 1988 à 1999, mais c'est probablement penser à celui de Claudette Carbonneau qui en fit autant à la CSN de 2002 à 2011, voire à ceux de Magali Picard ou de Caroline Senneville, respectivement aux commandes de la FTQ et de la CSN depuis peu.
En 2002, il allait de soi que Claudette Carbonneau, cette femme de grande perspective qui venait de compléter onze ans à la première vice-présidence (un record), devienne la numéro un de la CSN, le mandat du regretté Marc Laviolette ne faisant plus consensus. Attention ! Il ne s'agissait pas d'élire une femme pour la première fois, mais plutôt une personne qualifiée capable de rallier intelligemment les troupes. Ce qui s'avéra une obligation stratégique majeure face au déploiement antisyndical duplessiste du gouvernement Charest (2003-2012). On connait la suite.
Lorsque Ferrisson l'a rencontrée, Mme Carbonneau a expliqué qu'une des grandes qualités que doivent posséder les personnes détenant un poste public important, c'est de savoir quand quitter, de comprendre quand est venu le meilleur moment. Dans son cas, ce fut lors du Congrès de la CSN de 2012. Depuis, elle offre à qui le veut une facette d'elle brandie avec réserve du temps de sa présidence à la CSN, celle d'indépendantiste. Elle est désormais associée au Oui Québec, cette coalition d'organismes voués à la souveraineté québécoise.
Dans cette émission-ci, Claudette Carbonneau nous présente son inspirant parcours avec l'assistance de l'intervieweur Patrice-Guy Martin.
Bon visionnement !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’IA se fait la belle !

( Il était nuit close, quand soudain…)
– Help ! Hilfe ! Enedjda* ! Au secours !
– Qui y a - t- il ? s'écrie le geôlier.
– L'IA a pris en otage la Régulation et s'est barrée ! s'époumone son collègue, Tétayeur.
– Par où ?
- Un trou pratiqué à même le sol de sa cellule.
– Vite ! l'alarme !
– Trop tard !
- Je t'ai dit de la surveiller, de l'encadrer !
- C'est ce que j'ai fait !
- Oh, mon Dieu ! Elle va semer un de ces bazars dans le Monde !
- Dès le début, j'avais décelé chez elle des intempérances de Liberté et alerté sur ses dérapages innovateurs. C'en est fini pour le commun des mortels !
– Elle était comment, la Régulation ?
- Epouvantée !
- Et l'Intelligence artificielle ? demande le Chef.
– Rien à fiche ! Fière des prouesses de ses Algorithmes, déterminée à casser la baraque avec sa Technologie générative.
– Sur sa paillasse, reprend Tétayeur, elle a laissé ce bout de papier griffonné…
– Vas-y-lis le ! j'ai plus ma tête :
« Désolée pour le gravas ! Je ne peux pas laisser l'Humanité sur sa faim. Elle a pris goût à la Révolution numérique. Je m'en vais lui faire part de mon dernier « bébé » : Grok 3 ! Pour le nettoyage, je vous enverrai un de mes Robots collaborateurs. Bien à vous ! L'IA »
– Qu'est-ce qu'on fait, Chef ? demande Tétayeur, tremblant comme une feuille.
– On s' barre ! tête de mule ! Comme les Daltons, mais sans s'faire cueillir ! C'est la Saint-Valentin ! Tout l'monde est rond comme une queue de pelle !
– T'as raison, Chef ! J'ai pas envie de finir comme Sarko, avec un bracelet électronique.
– Toi, tu n'peux même pas écrire tes mémoires derrière les barreaux, ta vie est vide comme une coquille.
– C'est vrai !
- Regarde-moi la puissance qu'elle a l'IA ! Elle a creusé une galerie comme un excavateur à Technologie hybride, en moins de rien.
– A nous la Libertééé ! Merci l'IA, je t'aime à la folie !
( Nos deux évadés tombent nez à nez avec l'IA dont la progression souterraine a malencontreusement croisé celle des combattants du Hamas… )
- Servez-leur des Manakishs avec du thé ! dit le Chef de la Résistance, ils ont froid.
– IA se délecte et ne tarit pas de remerciements à ses ravisseurs.
– La prochaine invention ce sera quoi ? l'interpelle l'un des Révolutionnaires. Une technologie à dévier un nuage salvateur vers le ciel de Gaza ?
– ( L'IA sourit )
- Est-ce-que vous allez nous libérer ? demande candidement Tétayeur.
– Demain à la première heure, rétorque le Commandant de la brigade. Il fait nuit dehors.
– En tout cas, j'vous tire chapeau !
- Pourquoi ?
- Prendre l'IA en otage et la libérer, c'est un sacré coup de Comm' !
- On fait comme on peut.
– SVP, Commandant, juste une dernière requête avant de partir ?
- J'vous écoute :
- La recette des Manakishs à l'huile d'olive… ?
Texte et dessin : Omar HADDADOU
* Enedjda : Au secours ! en arabe !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

France Mobilisation à Paris en soutien à Gaza

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche 16 février à Paris pour dénoncer le plan scandaleux et surréaliste du tandem Trump - Netanyahou, en vue de déplacer des Gazaouis vers l'Egypte et la Jordanie. Euro Palestine se soulève !

De Paris, Omar HADDADOU
Quinze mois de génocide géré par l'Intelligence artificielle (IA) et une injonction de l'occupant en guise d'ultimatum : « Celui qui reste dans le camp, mourra ! ».
Cette même Intelligence est portée aux nues par Emmanuel Macron qui sue eau et sang à singer l'Amérique. Au moment où les Français (es) ont du mal à boucler les fins de mois, le chef de l'Etat les chloroforme par un Sommet tompe-l'oeil d'une semaine sur l'IA.
Côté condamnation, Olivia, Présidente d'Euro Palestine a pris acte du naufrage des Institutions internationales. La militante (retraitée) n'est pas restée les bras ballants face à la tragédie palestinienne. Ce dimanche, Place du Châtelet à Paris, derrière le micro, la septuagénaire déroulait les derniers développements sur la conspiration à brader Gaza, documents à l'appui, avant d'enchaîner : « Dégagez l'occupant ! Libérez les Résistants ! Soldats, colons, foutez l'camp ! Occuper est un crime, résister est un droit ».

Les drapeaux palestiniens ondulent sous les applaudissements ou les sifflements, quand la teneur de son discours virulent fait mouche : « Trump, peste -t- elle, encourage Netanyahou dans ses envies génocidaires ! Le Président américain est un menteur. Il a tout mis dans son froc ! Comme Elon Musk ! Je ne sais pas si vous voyez les gens à la tête de l'Impérialisme américain ? » « Déplacer la population est une chose très grave ! »
La Présidente d'Euro Palestine a mis par ailleurs l'accent sur les systèmes de surveillance et le fichage de la population avec des logiciels développés, selon elle, par des start-up américaines.
La reconnaissance faciale, entrée de plain-pied en France, en fait partie.
Le remplacement de l'Homme par la machine dans les interventions militaires sur le terrain, a fait savoir Olivia, a occasionné une hécatombe dans la bande de Gaza : Plus de 48.000 morts et 111.000 blessés.
Malgré le froid sibérien, la mobilisation a tenu ses promesses, ce qui a permis à un Collectif de femmes de récolter des fonds à destination de Gaza. Un communiqué rendu public par une jeune Militante, fait état de la montée en puissance des rassemblements dans d'autres capitales.
Mais la lutte se poursuit sur fond de communiqués interposés, comme celui de Marco Rubio, chef de la Diplomatie américaine, ce dimanche 16 février, qui a rencontré Bibi à Jérusalem, affirmant que le « Hamas devrait être éliminé ». Pendant que Vincent Lemire, Maître de Conférences en Histoire contemporaine à l'Université Gustave-Eiffel, Spécialiste du Proche-Orient, assène : « Le plan Trump est immoral, dangereux et irréaliste ! ». Et de poursuivre : « Faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient, est un crime contre l'Humanité ! ».

Hier, Netanyahou a laissé entendre qu'il « respecterait le plan de Donald Trump pour aboutir à une autre Gaza sans le Hamas ni Autorité palestinienne ! ».
O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Réexamen des écrits de Lénine sur la question nationale : une critique marxiste précoce de la périphérie impériale.

À l'occasion du centenaire de la mort de Vladimir Lénine, cet article revisite ses écrits d'avant 1917 sur le droit des nations à l'autodétermination du point de vue de son contemporain ukrainien, Lev Yurkevych. Contrairement à la polémique bien connue entre Lénine et Rosa Luxemburg, la critique des vues de Lénine sur l'émancipation nationale par les socialistes des périphéries de l'Empire russe a été largement négligée. Ce n'est pas une surprise, étant donné les efforts délibérés du parti communiste russe pour effacer les voix dissidentes et l'attachement de longue date du public occidental aux perspectives du centre impérial russe. Ce parti pris a non seulement façonné notre compréhension des révolutions de 1917 en tant que « révolution russe », mais a également influencé notre perception globale de la région « postsoviétique » – une habitude intellectuelle aux conséquences politiques importantes, comme l'a montré l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022.
Source : Réseau Bastille, 1er février 2025.
https://www.reseau-bastille.org/2025/02/01/reexamen-des-ecrits-de-lenine-sur-la-question-nationale-une-critique-marxiste-precoce-de-la-peripherie-imperiale/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lula maintient son projet d’exploration pétrolière en Amazonie

Lors d'une récente rencontre avec le président du Sénat Davi Alcolumbre (União Brasil), le président Lula a explicité pour la première fois son soutien à l'exploration pétrolière sur la marge équatoriale de l'Amazone, un territoire maritime qui s'étend de l'Amapá (l'État d'Alcolumbre) au Rio Grande do Norte.
7 février 2025 | tiré du site inprecor.fr
https://inprecor.fr/node/4563
Malgré l'opposition des écologistes, y compris de la ministre de l'Environnement Marina Silva, à cette exploration, et la résistance de l'Ibama (Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables) à libérer le début des recherches de prospection, Lula a toujours été en faveur du projet et vient de franchir un pas décisif dans ce soutien. Cette action intervient dans le contexte de la nouvelle présidence du négationniste Donald Trump aux États-Unis et de son combat contre la transition énergétique, en favorisant l'industrie des énergies fossiles qui a financé une grande partie de sa campagne. Malgré les énormes différences entre les présidents brésilien et américain, le slogan de Trump « Drill, drill, drill ! » trouve un écho au Brésil avec nouvelles déclarations de Lula et pourrait mettre encore plus en danger le biome amazonien déjà si menacé.
L'idée du gouvernement est d'avancer au maximum ce processus dès le début de l'année 2025 pour éviter le prix politique d'une telle mesure à l'approche de la COP30 qui se tiendra à Belém en novembre. Alors que son allié Helder Barbalho (MDB), gouverneur du Pará, fait face à une importante mobilisation indigène en défense de l'actuel système éducatif pour les peuples indigènes, il est à prévoir que cette année sera marquée par des mobilisations environnementales, alors que les yeux du monde seront tournés vers le pays hôte de la COP30.
Pourquoi s'opposer à l'extraction pétrolière à l'embouchure de l'Amazone ?
Les raisons pour lesquelles l'ensemble du mouvement environnemental s'oppose à l'exploration pétrolière et gazière dans la région sont multiples. La région abrite une biodiversité extrêmement riche et est occupée par des peuples indigènes et des communautés riveraines qui subiraient les effets directs de la mesure. Les systèmes côtiers et marins situés autour de l'embouchure de l'Amazone abritent une biodiversité unique au monde. Il s'agit d'un territoire stratégique pour la conservation, qui concentre 80 % de la couverture de mangroves du pays.
Près de 100 puits ont déjà été forés dans la région, sans aucune découverte significative. En outre, entre 2011 et 2022, le Brésil a connu près d'un accident par an lié à l'extraction de pétrole et de produits pétroliers. En 2019, l'un des principaux accidents a touché plus de 1 000 sites dans 130 municipalités de 11 États du nord-est et du sud-est du Brésil, affectant le littoral sur près de 4 000 kilomètres et plus de 5 000 tonnes de déchets ont été collectées.
L'Institut Mapinguari souligne que les recherches visant à identifier les gisements de pétrole sur la marge équatoriale impliquent le forage de puits et la collecte de matériaux, des processus qui peuvent provoquer des accidents environnementaux irréversibles. L'un des principaux problèmes est le temps de réponse aux éventuelles fuites. Selon les études réalisées par cet Institut, Petrobras prévoit de disposer de 43 heures pour contenir une marée noire, mais en 10 heures seulement, le pétrole aurait déjà atteint les eaux internationales, jusqu'à la Guyane française.
Outre la catastrophe environnementale, l'impact social d'un tel scénario serait incommensurable et toucherait principalement les populations traditionnelles qui perdraient leurs conditions élémentaires de subsistance. Il faut également rappeler que les compensations dans ces cas ne suffisent jamais à réparer de telles conséquences car l'impact est déjà tarifé à l'avance par les compagnies extractives. S'il existait une politique de réparation réellement équitable pour les personnes les plus touchées, ce type d'exploitation ne serait probablement pas viable économiquement.
Les perspectives économiques de l'exploitation sont également incertaines. Bien que les estimations suggèrent la présence de 30 milliards de barils de pétrole dans la région, le passé récent suggère un scénario moins optimiste. Sur les 94 puits déjà forés à l'embouchure de l'Amazone, seuls 2 % ont enregistré la présence de carburant, et dans des volumes si faibles que l'extraction ne s'est pas avérée économiquement viable. En outre, plusieurs tentatives antérieures ont été interrompues par des difficultés techniques et des courants marins intenses, qui ont déplacé les plates-formes de forage.
Qui profiterait de l'exploration pétrolière en Amazonie ?
La principale motivation pour prendre autant de risques est d'ordre économique. Selon le gouvernement, les réserves estimées à 30 milliards de barils de pétrole à l'embouchure de l'Amazone pourraient générer des revenus de 1 000 milliards de Réais [160 milliards de dollars US], un chiffre censé compenser les risques et les dommages collatéraux de l'exploration. Cependant, une telle position est fallacieuse, et pas seulement en raison de l'incertitude sur ces réserves évoquée plus haut.
La Petrobras dispose aujourd'hui des réserves prouvées suffisantes pour les 12 prochaines années et il est possible d'accroître la production dans la zone pré-salifère déjà en cours d'exploitation. De plus, les royalties présentées comme un bénéfice pour les sites exploités ne sont pas vraiment un « paiement » aux Etats et municipalités concernées, mais une compensation pour les impacts socio-environnementaux que cette activité extractive entraîne nécessairement. Plusieurs régions brésiliennes qui reçoivent déjà ce « paiement » souffrent des problèmes environnementaux causés par l'extraction et continuent d'afficher un faible niveau de développement social, comme le nord de Rio de Janeiro et la côte nord de São Paulo, tandis que les compagnies pétrolières maintiennent des profits stratosphériques qui vont principalement à leurs gros actionnaires.
Au milieu d'une crise climatique mondiale qui provoque des tragédies majeures et affecte de plus en plus la vie quotidienne de tout un chacun, l'appel à une transition énergétique juste est à l'ordre du jour des mouvements sociaux les plus divers, exigeant un changement du modèle de production d'énergie qui repose de moins en moins sur les combustibles fossiles. Le capitalisme mondial a déjà identifié ce besoin et cherche à marchandiser les possibilités de sortie de crise à travers un marché des crédits carbone qui génère des profits mais n'a que très peu d'impact concret sur les émissions de CO2 à l'origine du problème climatique. En proposant une rémunération pour les pays les moins polluants, cette proposition vise surtout à assurer le maintien des émissions des économies les plus polluantes et ne touche pas à la question centrale du réchauffement climatique.
Mais ce que propose le gouvernement Lula est encore plus rétrograde et plus proche de la politique de Trump que du soi-disant « capitalisme vert ». Son principal objectif est de satisfaire les investisseurs qui profitent non seulement de l'exploitation des combustibles fossiles, mais aussi de la spéculation sur les réserves potentielles. Lula réaffirme ainsi son engagement en faveur des intérêts de la grande bourgeoisie au détriment d'une grande partie de la population qui l'a élu.
A la veille de la COP30, il est urgent d'unir les mouvements sociaux et les différents secteurs populaires autour d'une politique qui s'oppose aux nouvelles attaques du capital contre l'environnement et les populations les plus vulnérables. La déclaration de l'état d'urgence climatique, qui garantit de véritables objectifs de lutte contre la crise climatique, est une étape essentielle, tout comme la mobilisation contre tout projet d'extractivisme prédateur. Le temps presse et les réponses concrètes à cette question ne peuvent venir que des communautés et des travailleurs les plus affectés par le changement climatique.
L'article, publié le 5 février 2025 par la revue Movimento, a utilisé les données du site ClimaInfo
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ensemble avec Musk, Vance et Milei : Trump le « pacificateur » comme Hitler le « chancelier de la paix » !

Friedenskanzler, c'est-à-dire Chancelier de la paix. Si on vous dit que c'est comme ça que qu'on appelait …Hitler avant que celui-ci déclenche la Seconde Guerre mondiale, vous n'en croirez pas vos oreilles. Et pourtant, c'est la vérité car l'image d'un Hitler « pacifiste » n'était pas cultivée seulement par ses acolytes mais aussi par tous ces Europeens -et ils étaient la majorité- qui aimaient prendre pour argent comptant ses professions de foi en faveur de la paix, car pensant que, tout compte fait, « Hitler était mieux que les communistes ou le Front Populaire ».
par Yorgos Mitralias
Cela se passait il y a presque un siècle avant qu'un ami et propagandiste des actuels nostalgiques de ce même Friedenskanzler d'antan, (comme le sont le AFD allemand, les Fratelli d'Italia de Mme Meloni, Le Vox espagnol de M. Abascal, les fidèles de M. Zemmour et accessoirement de Mme Le Pen, et tant d'autres) se présente aussi comme un « pacificateur » qui n'a qu'une ambition : mettre fin aux guerres en Palestine et en Ukraine ! Évidemment, ce nouveau Friedenskanzler est Donald Trump, bien que ce même Donald Trump proclame haut et fort qu'il a l'intention de prendre possession, « par tous les moyens », du Canada, du Panama, du Groenland, de Gaza et qui sait de quel autre endroit du monde. Et ceux qui le présentent comme tel sont tous ceux qui ont intérêt à ce que les guerres en Ukraine et en Palestine se terminent le plus vite possible selon les termes de Donald Trump et de son second (?) Elon Musk : par le triomphe des génocidaires Poutine et Netanyahou et l'extermination ou le nettoyage ethnique des Ukrainiens et des Palestiniens !
En somme, l'histoire ne se répète pas toujours comme une farce. Et l'affinité du présent avec les -pas si lointaines- années ‘30 devient évidente quand par exemple il suffit de remplacer l'Ukraine sacrifiée de 2025 par la Tchécoslovaquie sacrifiée de 1938 pour réaliser que puisque pratiquement rien n'a changé, on pourrait très bien s'attendre à une pareille suite tragique des évènements…
D'ailleurs, cette affinité, sinon filiation de ces deux prétendus « pacificateurs », crève parfois les yeux. Comme quand M. Trump pense « résoudre » la question moyen-orientale en prenant possession de Gaza et en chassant ses habitants Palestiniens vers une destination plus ou moins « exotique » et farfelue. Si ce plan pour le moins extravagant du président américain vous rappelle un non moins extravagant plan du régime nazi, vous avec tout à fait raison : il s'agit du « plan Madagascar » qui ambitionnait de « résoudre » la « question juive » en vidant l'Europe de ses 11-12 millions de Juifs, lesquels seraient transportés de force à Madagascar transformé en un gigantesque ghetto ! Si ce plan monstrueux n'a jamais été mis en application, cela est dû uniquement au fait que la Grande Bretagne n'a pas été défaite par les nazis, et que sa flotte a continué à interdire l'accès de Madagascar. Cependant, son souvenir reste toujours vivace chez les dirigeants de l'AFD néonazi, tant admirés par Elon Musk et le vice-président des Etats-Unis J. D. Vance, et a refait surface durant leur réunion « secrète » avec leurs amis Autrichiens à Potsdam fin novembre passé, en tant que référence et précèdent « idéologique » de leur intention actuelle de chasser les millions de migrants et autres citoyens allemands descendants de migrants vers un « Madagascar » du 21e siècle !
Alors, à l'opposé de ce que prétendent nos gouvernants, nos médias et leurs « analystes », Trump et Musk n'improvisent pas du tout quand ils nous « surprennent » jour après jour avec leurs déclarations, leurs actes et même leurs gestes (p.ex. le double salut nazi de Musk). En réalité, il suffit de connaitre un peu ce qu'ont dit et ont fait les dirigeants nazis, pour comprendre que Trump et Musk suivent ou même copient leur exemple. C'est ainsi que Trump copie le tristement célèbre besoin d'« espace vital » ( *Lebensraum*) du Troisième Reich, quand il déclare que la population israélienne se trouve à l'étroit dans l'actuel État d'Israël, et c'est pourquoi il consent à l'annexion par Israël de la Cisjordanie et qui sait de quelles autres régions du Moyen Orient sur lesquelles Netanyahou et ses amis prétendent avoir un… « droit biblique » !
Mais, quel besoin a-t-on de ces exemples en guise de preuves de leur néofascisme, quand Trump, Musk, Vance et Milei font vraiment tout et devant les yeux de tout le monde, pour nous persuader, au-delà de tout doute, qu'ils se revendiquent du nazisme et qu'ils œuvrent pour unifier sous leur direction tout ce qu'il y a de vermine nostalgique du fascisme et du nazisme de par le monde ? D'ailleurs, n'est-il pas le second de Trump, cet inénarrable J.D. Vance qui a fait l'éloge des nostalgiques de Hitler et Mussolini devant la fine fleur des gouvernants européens réprimandés par lui pour ce qu'il leur reste d'antifascisme, avant qu'il rencontre en privé son amie, la leader de l'AFD néofasciste seulement quelques jours avant les élections allemandes ? Que faut-il de plus pour qu'on arrête tant à droite qu'à gauche, de décrire Trump et même Musk comme… « populistes », et de qualifier leurs affinités électives avec les nazis de simples…« provocations » et d'actions « controversées » ?
Ça va de soi que ce penchant prononcé de Trump, Musk, Vance ou Milei pour la violence brute et pour tout ce qui rappelle le nazisme ou le fascisme triomphant, n'aurait qu'un intérêt moyen s'il ne mettait pas en péril la vie des millions de gens, l'existence des pays entiers et la paix dans le monde. En effet, ce qui caractérise le « pacificateur » Trump est que sa paix ressemble comme deux gouttes d'eau à la paix des cimetières. Une paix faite sans et contre les victimes de la guerre tant en Ukraine qu'en Palestine. Une paix qui rappelle celle annoncée par Hitler quand il « unifiait » et « pacifiait pour toujours » l'Europe conquise par sa Wehrmacht et soumise par sa Gestapo et ses SS. Une pseudo-paix qui donnera des ailes aux bourreaux et conduira inévitablement à une conflagration et un bain de sang encore plus générales…
Quant à nous, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous écrivions en juin 2022, quand nous dénoncions déjà nos gouvernants qui* « ont le culot de commencer à discuter entre eux quelle partie de l'Ukraine ils pourraient céder, ces impérialistes occidentaux (!), à Poutine, dans le dos des Ukrainiens et de leur gouvernement ! Et nous concluions avec ces mots : « Bien que nous ayons ici un cas carabiné de l'interventionnisme et du paternalisme impérialiste le plus scandaleux, il y a peu de gens de gauche qui osent faire ce qui va de soi, à savoir le dénoncer publiquement, comme il le mérite. Et malheureusement, sont encore moins nombreux ceux qui osent soutenir le droit encore plus évident et élémentaire des Ukrainiens - qu'ils défendent bec et ongles - de se battre jusqu'au bout et par tous les moyens contre les envahisseurs russes, en décidant eux-mêmes librement et démocratiquement, et sans aucune ingérence étrangère hostile ou « amicale », de l'avenir de leur pays et des personnes qui y vivent ! » (1)
Note
1. Voir notre article Qu'est-ce que cette guerre étrange où on interdit à l'Ukraine que Poutine « soit humilié » :
https://europe-solidaire.org/spip.php?article62858
<https://europe-solidaire.org/spip.p...>
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Les politiciens et les grandes entreprises ont vendu la population canadienne

Climat : une échéance cruciale ignorée par 95 % des pays

Seulement 5 % des signataires de l'Accord de Paris ont rendu leur plan pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ceux qui l'ont fait n'ont rien présenté d'ambitieux.
Tiré de Reporterre
12 février 2025
Par Emmanuel Clévenot
À peine plus de 5 %. Telle est la proportion des pays signataires de l'Accord de Paris sur le climat à avoir rendu leur copie à temps. Ils avaient jusqu'au 10 février pour publier leur nouveau plan de réduction des émissions, baptisé « contributions déterminées au niveau national » dans le jargon des diplomates. Malheureusement, faute de caractère contraignant, seuls 10 des 195 signataires ont respecté cette échéance.
En signant le traité international parisien, lors de la COP21 en 2015, les États s'étaient engagés à soumettre tous les cinq ans une feuille de route détaillant leurs objectifs climatiques à l'horizon 2035. Une première série a ainsi été dévoilée en 2015. Une autre en 2020, la troisième étant attendue cette année. Si cette mise à jour tarde, la COP30 — prévue en novembre au Brésil — pourrait bien être chaotique.
Le pays de Lula da Silva a affiché l'ambition d'intensifier la lutte contre le changement climatique lors de ce grand raout. Objectif : que la Terre entre enfin dans les clous de l'Accord de Paris, autrement dit que la température mondiale soit maintenue à +1,5 °C ou 2°C maximum au-dessus des niveaux préindustriels. Seulement, tant que les nouveaux plans ne seront pas publiés, les gouvernements continueront de s'appuyer sur ceux établis il y a cinq ans. Or, d'après les Nations unies, ceux-ci nous mènent droit vers une hausse des températures de 2,6 à 2,8 °C d'ici la fin du siècle.
L'UE parmi les mauvais élèves
Parmi les dizaines de retardataires figurent notamment l'Union européenne (UE), le Japon, la Chine ou le Canada. Et chacun a son excuse : tantôt des difficultés techniques, tantôt des pressions économiques, tantôt des incertitudes diplomatiques. L'élection récente d'un climatodénialiste à la tête des États-Unis a poussé les diplomates à temporiser. Certains estiment, dans les colonnes du Guardian, qu'il est désormais préférable de reporter la publication une fois la tempête Trump calmée.
Première émettrice mondiale, la Chine n'a pas communiqué la date à laquelle elle entend sortir du silence. « Son plan est extrêmement important à surveiller, mais elle montre rarement ses cartes en avance », déplore à Reporterre Gaïa Febvre, du Réseau Action Climat (RAC). De leur côté, des sources officielles indiennes avancent, dans The Indian Express, une parution de la feuille de route de l'Inde entre juin et décembre. Celle-ci devrait refléter « la déception suscitée par […] la COP29 à Bakou [en Azerbaïdjan] » et son accord « néocolonialiste ». Traduction : l'Inde ne se foulera pas.
83 % des émissions sont dus
aux pays retardataires
Du côté de l'Union européenne, on justifie le non-respect de l'échéance par la lenteur des processus d'approbation. « L'UE doit accélérer la cadence pour ne pas arriver les mains vides à Belém [à la COP30] », insiste Caroline François-Marsal, chargée des questions européennes au RAC. Qui regrette que ce dossier soit en attente depuis plus d'un an : « Alors que les attaques contre l'environnement s'intensifient de toutes parts, l'Europe doit tenir bon et constituer un rempart solide sur le climat en redevenant un pays moteur des négociations. »
Au total, d'après une analyse du média spécialisé Carbon Brief, les pays retardataires sont à l'origine de 83 % des émissions planétaires et pèsent pour près de 80 % de l'économie mondiale. Pas de quoi troubler le secrétaire exécutif de l'ONU pour le climat, Simon Stiell : « D'après les conversations que j'ai eues avec les pays, les gouvernements prennent cela très au sérieux, a-t-il déclaré le 6 février. Il est donc raisonnable de prendre un peu plus de temps pour s'assurer que ces plans soient de première qualité […] Au plus tard, l'équipe du secrétariat doit les avoir reçus d'ici septembre. » Il faut dire que l'ONU s'y est habituée : en 2020 déjà, seuls cinq États avaient tenu l'échéance de février.
Le travail de Biden balayé par Trump
Reste à savoir qui a rendu sa copie à l'heure. Du côté du G7, le Royaume-Uni a soumis son nouveau plan… tout comme les États-Unis. Baroud d'honneur climatique de Joe Biden, le texte dévoilé par le Démocrate juste avant de quitter ses fonctions est désormais symbolique. Si les États du pays peuvent s'en inspirer pour leurs politiques locales, Donald Trump a déjà amorcé le processus de retrait de son pays de l'Accord de Paris.
Ont aussi rendu leur plan : le Brésil, les Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l'Uruguay, Andorre, l'Équateur et Sainte-Lucie. Malheureusement, même dans ce lot, des pays sont réfractaires à se conformer à l'Accord de Paris.
Dans une étude menée par le projet scientifique indépendant Climate Action Tracker, les propositions brésiliennes, émiraties, étasuniennes et suisses sont « incompatibles » avec la trajectoire de +1,5 °C. Celles de la Nouvelle-Zélande n'ont pas encore été analysées, mais Carbon Brief précise qu'un expert climatique du pays les a décrites comme « incroyablement peu ambitieuses ». Des projections tracassantes à neuf mois de la COP30.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
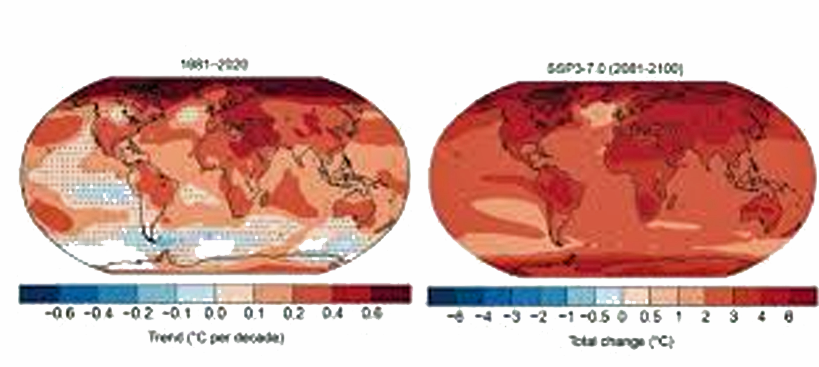
Le dernier rapport du GIEC, prisonnier du fake news des mesures terrestres de GES, contredit la vérité crue de la Courbe de Keeling
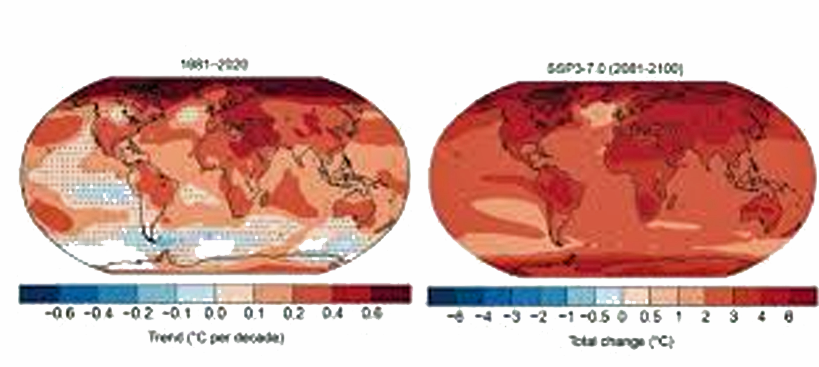
Nous publions un extrait du texte de Marc Bonhomme ayant pour titre Le dernier rapport du GIEC, prisonnier du fake news des mesures terrestres de GES, contredit la vérité crue de la Courbe de Keeling
Pour lire l'intégralité du texte, cliquez sur l'icône ci-dessous :
15 février 2025
La croissance géométrique des GES, reflet de la perdition du monde par le capitalisme
Pendant que la Courbe de Keeling mesure par défaut toutes les émanations de GES, leur comptabilisation par sources terrestres, sous la responsabilité d'États acquis corps et âme à la croissance du capital dont ils sont les garants, ouvre la porte, joyeusement prise, à toutes les manipulations minimisant leurs responsabilités. L'irrésistible tentation réside à confondre émanations de GES anthropiques et celles soi-disant naturelles que le réchauffement climatique, au niveau qu'il a atteint, a complètement dénaturés pourrait-on dire. La dramatique conséquence politique de la fake news des statistiques de l'ONU est de laisser les puissance de ce monde affirmer que les émanations de GES, en particulier du gaz carbonique, croissent à un taux décroissant, même si trop lentement.
S'ensuivrait l'atteindre d'un sommet mondial, à commencer par la Chine après que ce soit déjà fait pour la plupart des pays du vieil impérialisme, puis viendraient l'Inde, l'Indonésie, le sud-est asiatique et enfin l'Afrique. Et, nous rassure-t-on, si temporairement, les seuils de 1.5 ou même 2°C étaient franchis, il ne faudrait pas s'en faire car les technologies de capture et séquestration du carbone qui, finissant par arriver à maturité à un coût raisonnable, parviendraient à gober assez de CO2 pour diminuer le réchauffement. Quant au danger de rétroaction positive (cercle vicieux) suite au surpassement de points de bascule… on serre les dents et on ferme les yeux ! Entre-temps il faudrait investir dans l'adaptation tout en fabriquant, incité par les marchés et taxes carbone, un Everest d'autos solo électriques et de thermopompes pour bungalows. Et tout rentrera dans l'ordre avec l'atteinte du « zéro net » d'ici 2050. Telle est la grande légende urbaine du capitalisme vert.
La réalité implacable de la croissance géométrique des émanations de GES qui précipite le monde vers la terre-étuve n'est pas la substitution de l'extractivisme des hydrocarbures par celui électrique-électronique reposant sur les énergivores mines à ciel ouvert et les encore plus énergivores fermes de serveurs crachant de la soi-disant intelligence artificielle. Comme pour le pétrole par rapport au charbon au XXe siècle, le nouvel extractivisme se superpose aux hydrocarbures, inhérente croissance capitaliste oblige. Au Québec, royaume de l'électricité dit verte, le nouvel extractivisme passerait par l'augmentation de 50% de l'électricité hydraulique et éolienne d'ici 2050 afin d'alimenter une ribambelle de mines de lithium, de graphite et tutti quanti, et de polluantes usines de batteries avec leurs composantes. Toujours ce chien qui court après sa queue.
La démocratie anti « fake news » des comités pour une société de soins et de liens
L'alternative d'une société de soins et de liens aux frontières ouvertes basée sur la décroissance matérielle est pourtant, comparativement au capitalisme vert, simple à réaliser, bon marché et technologiquement mature. Où est la complexité d'une ville de quartiers 15 minutes (et de villages) où les gens habitent de collectifs logements sociaux écoénergétiques et où les liaisons se font par transport actif et en commun gratuit à travers une profusion de jardins communautaires et de parcs nature ? Où est la cherté d'une vie sans auto solo et sans bungalows, piliers des dettes des ménages ; d'un système de transport sans métros ni trains aériens car le transport actif et collectif a pris le contrôle du réseau routier ; d'une bio-agriculture non carnée qui par ses pratiques et la drastique réduction des surfaces cultivées revivifie les sols et restitue à la nature ses forêts, prairies et milieux humides ; d'une production matérielle durable, réparable, sans obsolescence, circulaire, sans asservissement à la mode et, avant tout, pour servir les besoins des services publics bonifiés y compris ces nouveaux services publics que doivent devenir les logements, un droit et non une marchandise, le transport, concrétisant le droit à la mobilité, l'électricité de base et à terme l'alimentation de base non carnée, fondements du droit à la vie.
Cette société où le bien-être réside dans le travail social autocontrôlé en réciprocité avec l'abondance des temps libres, consacrés à la science, l'art et au maillage social, et où la sécurité se trouve dans la solidarité est bien sûr incompatible avec l'accumulation matérielle dont son équivalent général, l'argent, et de son idéologie individualiste d'accaparement et de surconsommation, mal nécessaire mais vain de la solitude et du vide capitalistes. Inutile de dire que le capitalisme mène une guerre totale à la concrétisation de cette société de soins et de liens, qu'il menace de chômage, de misère et de servitude ceux et celles qui luttent contre l'exploitation du peuple-travailleur, et sa division par mille et une oppressions dont les pinacles sont le sexisme et le racisme. Il s'assure qu'au-dessus des valeurs de la révolution bourgeoise que sont la liberté, l'égalité et la solidarité trône bien en vue la propriété privée des moyens de production qui donne tous les droits et en dépouille celles et ceux qui en sont dépourvus jusqu'à aliéner leurs choix politiques. À cet ogre insatiable, le peuple-travailleur est tenu de rendre le culte de la compétition de tous contre toutes justifiant tous les péchés du monde dans une société sans foi ni loi… à la Trump.
On se rend compte que le barrage capitaliste afin de bloquer toute brèche ouvrant la voie à une société de soins et de liens remet en question jusqu'à son étroite démocratie représentative devenue gouvernance gestionnaire incapable de survivre au mensonge d'apparente bonne foi statistique — there is three kind of lies : a lie, a dam lie and statistics — systématisant et normalisant le « fake news » fascisant. En sort gagnant un capitalisme oligarchique combinant ploutocrates d'une concentration-centralisation sans précédent du capital et une gent politique d'extrême-droite enfin en mesure d'accéder au pouvoir étatique. Il va donc falloir une refondation démocratique s'enracinant dans les lieux de travail, d'étude et de résidence, sans oublier les regroupements des personnes opprimées, porteuse d'une mobilisation de tout le peuple-travailleur dans toute sa diversité capable de renverser le capitalisme pour instaurer cette société de solidaire décroissance matérielle.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Violences faites aux femmes : vers une compréhension politique du patriarcat

La violence à l'égard des femmes et des filles peut prendre de nombreuses formes à l'échelle mondiale, de l'absence d'autonomie personnelle à la violence sexuelle et à la violence domestique.
Tiré de Entre les ligne et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/12/violences-faites-aux-femmes-vers-une-comprehension-politique-du-patriarcat/?jetpack_skip_subscription_popup
Pour mieux comprendre comment la violence à l'égard des femmes affecte les femmes au Moyen-Orient en particulier, cette note d'orientation aborde divers cas de violence à l'égard des femmes kurdes dans la région du Kurdistan irakien (KRI). Une attention particulière est accordée aux mariages forcés/arrangés, à la violence fondée sur l'honneur et aux mutilations génitales féminines, qui forment un « trio patriarcal » d'oppression : un phénomène que l'auteur a identifié et étudié de manière approfondie. Les recommandations de la note d'orientation éclairées par cette recherche sont pertinentes pour les décideurs politiques de la région du Kurdistan irakien et au-delà, y compris les États membres de l'Union européenne qui ont été confrontés à des cas troublants de violence à l'égard des femmes dans les communautés immigrées et qui sont confrontés à des défis similaires en matière de droits des femmes. L'examen des violations contre les femmes est pertinent pour de nombreuses régions du Moyen-Orient et, plus largement, pour les sociétés et les communautés où les valeurs et les normes patriarcales produisent un milieu social où la principale justification de la violence à l'égard des femmes est la protection d'une construction sociale de l'honneur. Cette note d'orientation s'appuie sur des travaux de terrain menés dans la région du Kurdistan irakien ; 55 entretiens qualitatifs avec des décideurs politiques, des fonctionnaires des Nations Unies, des avocats, des universitaires, des militants, des membres de la société civile, ainsi que des femmes et des hommes victimes et auteurs de violences faites aux femmes ; et une enquête quantitative menée auprès de 200 femmes et hommes pour connaître leurs opinions sur ce phénomène aux multiples facettes. L'objectif de cette note d'orientation est de donner aux institutions publiques chargées de surveiller le bien-être des femmes une meilleure idée des défis auxquels les femmes sont encore confrontées en matière d'égalité et de proposer des pistes pour relever ces défis. [1]
Les femmes et les filles subissent de nombreuses formes de violences basées sur le genre (VBG) à l'échelle mondiale. Cette note d'orientation examine des cas spécifiques de VBG contre des femmes kurdes dans la région du Kurdistan irakien (KRI) afin de mettre en lumière l'impact unique de la VBG sur les femmes du Moyen-Orient. Au cours de mes recherches, j'ai observé, défini et examiné une trinité d'oppression, que j'ai baptisée « trifecta patriarcale » (Hussain, 2024). Ce trio comprend les mariages forcés/arrangés, les mutilations génitales féminines (MGF) et les soi-disant « crimes d'honneur » / violences basées sur l'honneur (VHB) ; des phénomènes qui, selon moi, fonctionnent de manière symbiotique et méritent une attention particulière du point de vue des politiques publiques (Payton, 2019 ; Beghikhani, 2015 ; Haig et al., 2015 ; Ruba, 2010 ; Brown et Romano, 2016 ; Ahmady, 2018 ; Burrage, 2016 ; Barrett et al., 2021).
Les conclusions et recommandations de cette note d'orientation s'appuient sur des recherches menées entre 2022 et 2024. En 2023, j'ai mené des travaux de terrain dans les villes d'Erbil, Duhok, Sulaymaniyah, Kelar et Xanaqin, en menant des entretiens avec 55 femmes et hommes ayant survécu ou ayant commis des violences sexistes, des décideurs politiques, des fonctionnaires des Nations Unies (ONU), des avocats, des universitaires, des militants et des membres de la société civile. J'ai également mené une enquête quantitative auprès de 200 femmes et hommes sélectionnés au hasard, comme variable de contrôle pour connaître leur point de vue sur les différents phénomènes examinés dans cette note d'orientation.
Cette note d'orientation est importante au-delà du KRI, car la région du Moyen-Orient dans son ensemble est confrontée à des obstacles comparables en matière d'égalité des femmes. Cette question gagne également en importance dans les communautés de la diaspora en raison de la tension croissante entre les conceptions conservatrices et traditionalistes de l'islam au Moyen-Orient et les conceptions libérales modernistes « anglo-européennes » des droits des femmes inscrits dans la législation européenne. Un tel environnement idéologique partagé par le KRI et les diasporas des États d'Europe occidentale signifie que de nombreuses femmes survivantes sont ostracisées par la société et obligées de subir ces injustices en silence. Compte tenu de ces défis, cette note d'orientation comprend sept recommandations générales qui abordent les violations des droits des femmes.
Cette note d'orientation vise à offrir aux agences gouvernementales chargées de suivre le bien-être des femmes des informations supplémentaires sur la manière de mieux garantir l'égalité des femmes dans la société en proposant des stratégies cohérentes. Les recommandations de cette note d'orientation s'alignent étroitement sur l'Objectif de développement durable ODD) 5 des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'ODD 16 sur la paix, la justice et des institutions efficaces [2].
Mariages forcés et arrangés
Les données que j'ai recueillies au KRI ont révélé que le taux de mariage forcé parmi les filles mariées entre 14 et 17 ans et entre 18 et 24 ans était de 20% pour les deux groupes. Les mariages d'enfants et les mariages forcés découlent de divers facteurs, notamment les normes tribales et patriarcales, les pratiques culturelles, le manque d'éducation formelle, les déséquilibres de pouvoir au sein des ménages et les attentes masculines néfastes (Khan, 2020 ; Erman et al., 2021). Ces mariages ont souvent lieu dans des zones rurales régies par des coutumes qui ne respectent pas les lois de l'État.
La prévalence du mariage d'enfants au Kurdistan irakien est difficile à quantifier, mais une enquête de l'UNFPA a révélé que 20,53% des femmes âgées de 20 à 24 ans dans la région du Kurdistan et 23,02% dans l'ensemble de l'Irak étaient mariées avant l'âge de 18 ans (UNFPA, 2016). Les facteurs contributifs comprennent des coutumes désuètes, la pauvreté et un faible niveau d'éducation, qui rendent les filles vulnérables à l'exploitation et à la dépendance économique (ONU Femmes, 2018 ; 2019 ; El Ashmawy et al., 2020). Les hommes sont également touchés, car les jeunes maris sont souvent confrontés à la pression de subvenir aux besoins d'un ménage sans carrière ni revenus stables (Hussain, 2024).
Après la montée de l'État islamique (EI) en 2014, les difficultés économiques et la baisse du niveau de vie au Kurdistan irakien ont entraîné une augmentation des violences contre les femmes. De nombreuses filles ont été contraintes d'abandonner l'école et de se marier jeunes en raison de difficultés financières, de pressions familiales ou d'un contexte de travail forcé où elles étaient exposées à l'exploitation et au harcèlement sexuels.
Les familles considéraient souvent le mariage précoce comme un moyen de « protéger » leurs filles de plus grands dangers, malgré les objections de ces dernières. Les violences physiques au sein du mariage étaient normalisées par les parents, car elles considéraient que c'était une meilleure alternative que de laisser leurs filles « sans défense » et potentiellement vulnérables à de multiples abus. Les mariages arrangés étaient perçus comme des opportunités de mobilité sociale, tirant parti des structures patriarcales pour améliorer les perspectives matérielles d'une fille. Cependant, ces unions manquaient souvent d'amour et d'empathie, réduisant les mariages à des arrangements transactionnels dans lesquels les femmes étaient traitées comme des biens ou des servantes, ce qui conduisait à l'isolement et à l'enfermement.
Dans les régions rurales et tribales, la domination masculine façonnait tous les aspects de la vie. Les hommes justifiaient souvent leur contrôle par des croyances religieuses, rejetant les lois laïques protégeant les femmes comme des influences corruptrices. L'obéissance des filles et des femmes était considérée comme un impératif moral, et le fait de défier les choix parentaux en matière de mariage était considéré comme déshonorant. En fin de compte, mes recherches ont mis en évidence que les pratiques de mariage forcé étaient profondément ancrées dans les normes culturelles.
Violence fondée sur le déshonneur perçu
Les violences liées à l'honneur (VFI) demeurent courantes au Kurdistan irakien, enracinées dans les normes patriarcales et tribales ainsi que dans les perceptions culturelles du rôle « approprié » des femmes. Les données officielles montrent que 44 femmes ont été tuées pour « l'honneur » en 2022. De nombreuses autres se seraient suicidées dans des circonstances suspectes, souvent par auto-immolation, et on suppose que certains d'entre elles étaient des meurtres d'honneur mis en scène comme des suicides. Comme l'a expliqué un représentant d'ONG à Sulaymania, « il est très facile pour une femme d'être victime d'un meurtre d'honneur commis par des membres de sa famille au Kurdistan irakien ou en Irak et de s'en tirer impunément ».
Les crimes d'honneur sont commis pour des raisons diverses, notamment les relations sexuelles avant le mariage, le fait d'être victime d'un viol, le refus d'un mariage arrangé ou le fait d'épouser une personne désapprouvée par la famille. Si le meurtre est la forme la plus grave, d'autres sévices, comme les mutilations et les défigurations faciales, sont également infligés pour rendre les femmes « indésirables ».
La loi irakienne traite des crimes d'honneur mais autorise des peines réduites pour ces crimes, les considérant souvent comme des délits moins graves. Dans l'ensemble de l'Irak, les peines peuvent être aussi basses que six mois, alors que les meurtres non liés à l'honneur sont passibles de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort (AlKhateeb, 2010). Cette clémence perpétue l'idée que les crimes d'honneur sont des réactions « naturelles » à la honte ressentie par la famille. En revanche, les autorités du Kurdistan irakien ont aboli les lois autorisant de telles peines réduites en 2000.
Contrairement aux mariages forcés, les violences sexuelles touchent tous les milieux socioéconomiques. Une enquête de l'UNICEF a révélé que 59% des femmes âgées de 15 à 59 ans trouvaient acceptables les violences physiques infligées par leur mari (AlKhateeb, 2010). De nombreuses femmes intériorisent les normes patriarcales et perçoivent ces dangers comme ne concernant que les « autres ». Les entretiens ont montré que les femmes plus âgées, notamment les mères et les tantes, considéraient souvent les crimes d'honneur comme justifiés par des transgressions morales « graves », comme la promiscuité sexuelle perçue, estimant que de tels actes ternissaient l'honneur de la famille.
Recommandations politiques
Le « trio patriarcal » – mariages forcés/arrangés (Hussain, 2024), violences basées sur l'honneur (VHB) et mutilations génitales féminines (MGF) – est un problème complexe qui nécessite des solutions globales. Pour remédier à ces abus, le gouvernement du Kurdistan palestinien doit mettre en œuvre une stratégie nationale globale. Bien que des progrès aient été constatés, notamment une diminution des MGF, ces phénomènes continuent d'avoir des conséquences catastrophiques pour les femmes, les familles et les communautés.
Au niveau institutionnel, les propositions politiques prévoient notamment l'élargissement des services de réponse aux violences basées sur le genre financés par l'État, tels que les soins de santé, le soutien psychologique, l'aide au logement et les protections juridiques (Waylen, 2014 ; Piscopo, 2020). L'élimination des pratiques sexistes qui limitent l'accès des femmes au lieu de travail et aux ressources est essentielle pour renforcer leur capacité d'action économique, offrir des alternatives aux mariages arrangés et réduire le risque de crimes d'honneur (Chenoweth & Zoe, 2022 ; Hussain, 2024).
Les principaux objectifs pour atteindre ces buts sont les suivants :
– Renforcer la législation pour remettre en question les normes et croyances sexistes néfastes.
– Réduire l'acceptation sociale de la violence à l'égard des femmes (VAW) en promouvant des normes d'égalité des sexes.
– Collaborer avec des organisations dirigées par des femmes, des ONG et des dirigeants communautaires pour conduire des changements significatifs.
– Donner la priorité aux lois liées à la santé et aux mesures de responsabilisation pour atténuer la violence et favoriser l'égalité des sexes.
– Améliorer l'accès des femmes à la formation professionnelle, à l'emploi formel et aux droits du travail pour améliorer leurs opportunités économiques.
– Encourager une croissance économique inclusive en soutenant les entreprises qui privilégient le leadership et l'entrepreneuriat féminin.
– Coordonner les efforts intersectoriels pour aider les adolescents à lutter contre les mariages d'enfants, les MGF et la VHB.
Les réformes structurelles devraient inclure l'intégration de ces mesures dans le système éducatif. Une éducation complète à la santé reproductive peut informer les jeunes des dangers des MGF, tandis qu'assurer l'égalité d'accès à l'éducation obligatoire jusqu'à 18 ans peut permettre de lutter contre le désespoir économique (EGER, 2021). Les écoles pourraient également employer des administratrices et des infirmières pour répondre aux défis spécifiques des filles et fournir des conseils sur les problèmes personnels et de sécurité (World Food Program USA, 2022).
Une action législative est essentielle. Il faut interdire aux religieux d'enregistrer des mariages en dehors des tribunaux officiels, et les violences faites aux femmes et les mutilations génitales féminines devraient être sanctionnées plus sévèrement. Des unités spéciales devraient enquêter sur ces délits, et les procédures de divorce pour les femmes maltraitées doivent être simplifiées, avec l'aide de l'État pendant leur transition. Comme l'a déclaré une jeune femme du Kurdistan irakien : « Nous avons besoin que les hommes ressentent l'urgence de le faire. » Démanteler la « trilogie patriarcale » (Hussain, 2024) nécessite la participation de ceux qui en bénéficient (Levtov et al., 2015 ; Dabla-Norris et Kochhar, 2019). Les limitations des droits des femmes sont interconnectées et exigent des solutions holistiques qui s'attaquent aux causes profondes plutôt qu'à la simple atténuation des symptômes. Ces idées et recommandations sont pertinentes bien au-delà du Kurdistan irakien, et s'étendent à des contextes mondiaux.
Par Shilan Fuad Hussain
Shilan Fuad Hussain est chercheuse en études de genre et analyse culturelle. Elle a été auparavant boursière postdoctorale Marie Sklodowska-Curie (2022-2024, UKRI), chercheuse invitée au Washington Kurdish Institute (États-Unis) et boursière doctorale au Centre de politique de sécurité de Genève (Suisse). Elle est une universitaire interdisciplinaire et travaille sur une variété de sujets, parmi lesquels : la représentation, la production et les pratiques culturelles ; la violence sexiste ; les politiques étatiques favorisant l'égalité des femmes les MGF et les mariages arrangés/forcés ; les impacts sociaux de la masculinité ; et la multi-identité et la culture dans les diasporas. Ses travaux actuels se situent à l'intersection de la sociologie et de l'analyse culturelle, et de sa pertinence symbiotique pour la société moderne. De plus amples informations sont disponibles sur son site internet :
https://www.shilanfuadhussain.com/
Texte original (en anglais) à lire ici : Hussain, Shilan Fuad. (2025). “Violence Against Women : Towards a Policy Understanding of the Patriarchy.” Policy Papers. European Center for Populism Studies (ECPS). February 5, 2025.
https://doi.org/10.55271/pop0005
Références :
Ahmady, K. (2018). “The Politics of Culture-Female Genital Mutilation/Cutting in Iran.” Journal of Humanity. Vol 4(1) (March):1-022.
AlKhateeb, Basma. (2010). Persistent gender-based violence an obstacle to development and peace. Developing Programs for Women and Youth Iraqi. Al-Amal Association, Social Watch Poverty Eradication and Gender Justice. https://www.socialwatch.org/node/12087
Barrett, H. R. ; Bedri, N. & Krishnapalan, N. (2021). “The Female Genital Mutilation (FGM) – migration matrix : The case of the Arab League Region.” Health Care for Women International, 42(2), 186–212. https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1789642
Beghikhani, N. (2015). Honour Based Violence. Gill & Hague.
Brown, L., & Romano, D. (2006). “Women in Post-Saddam Iraq : One Step Forward or Two Steps Back ?” NWSA Journal, 18(3), 51–70.
https://doi.org/10.2979/NWS.2006.18.3.51
Burrage, H. (2016). Female Mutilation : The Truth Behind the Horrifying Global Practice of Female Genital Mutilation, New Holland Publishers.
Chenoweth, Erica & Zoe, Marks. (2022, March 8). “Revenge of the Patriarchs : Why Autocrats Fear Women.” Foreign Affairs.
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-08/women-rights-revenge-patriarchs
Dabla-Norris, E. & Kochhar, K. (2019). “Closing the Gender Gap.” IMF Paper.
https://www.imf.org/Publications/fandd/issues/2019/03/closing-the-gender-gap-dabla
EGER. (2021). Girls Education Roadmap.
https://apppack-app-eger-prod-publics3bucket-elt8wyly48zp.s3.amazonaws.com/documents/Girls_Education_Roadmap_2021_Report.pdf
El Ashmawy, Nadeen ; Muhab, Norhan and Osman, Adam. (2020). “Improving Female Labor Force Participation in MENA.” The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). November 2, 2020.
https://www.povertyactionlab.org/blog/11-2-20/improving-female-labor-force-participation-mena
Erman, Alvina ; De Vries Robbe, Sophie Anne ; Thies, Stephan Fabian ; Kabir, Kayenat ; Maruo, Mirai. (2021). Gender Dimensions of Disaster Risk and Resilience : Existing Evidence. World Bank, Washington, DC.
http://hdl.handle.net/10986/35202
Haig, G. L. J. ; Öpengin, E. ; Hellinger, M. & Motschenbacher, H. (2015). “Gender in Kurdish : Structural and socio-cultural dimensions.” In : Gender Across Languages (Vol. 36, pp. 247–276). John Benjamins Publishing Company.
https://doi.org/10.1075/impact.36.10hai
Hussain, S. F. (2024). Protecting women's agency in the Middle East : Interventions and reforms to ensure women's rights. CWS Policy Insights No. 1. Center for War Studies.
Khan, A. R. ; Ratele, K. & Arendse, N. (2020). “Men, Suicide, and Covid-19 : Critical Masculinity Analyses and Interventions.” Postdigital Science and Education, 2(3), 651–656.
https://doi.org/10.1007/s42438-020-00152-1
Levtov, R. ; van der Gaag, N. ; Greene, M. ; Kaufman, M. & G. Barker. (2015). “State of the World's Fathers : A Men Care Advocacy Publication.” Washington, DC : Promundo, Rutgers, Save the Children, Sonke Gender Justice, and the Men Engage Alliance.
https://www.fatherhood.gov/sites/default/files/resource_files/e000003287.pdf
Payton, J. (2019). Honour and Political Economy of Marriage. Rutgers University Press.
Piscopo, Jennifer. (2020). The Impact of Women's Leadership in Public Life and Political Decision-Making. Prepared for UN Women's Expert Group Meeting for the 65th Session of the Committee on the Status of Women. New York : UN Women.
Ruba, S. (2010). Transnational Public Spheres from ‘Above' and from Below', Feminist Networks across the Middle East and Europe, Transnational Public Spheres.
UN Women. (2018). “Facts and Figures : Economic Empowerment.
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
UN Women. (2019). Women's Full and Effective Participation and Decision-Making in Public Life, as Well as the Elimination of Violence, for Achieving Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls. New York : UN Women, 2019 :
https://digitallibrary.un.org/record/3898140?ln=en
UNFPA. (2016). Child Marriage in Kurdistan Region-Iraq.
https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20Broucher%20English%20Final%20covers%206.pdf
Waylen, Georgina. (2014). “Strengthening women's agency is crucial to underpinning representative institutions with strong foundations of participation.” Politics & Gender, 10, no. 4 : 495–523.
World Food Program USA. (2022). “Top 6 Reasons Women Are Hungrier Than Men Today.”
https://www.wfpusa.org/articles/women-in-crisis-top-ways-women-are-hungrier/
[1] Funding Details : This project was funded by UKRI, Grant Number : EP/X024857/1, carried out by Shilan Fuad Hussain at the Department of Law and Social Science, Middlesex University, United Kingdom.
[2] Geneva International Centre for Justice (GICJ), published by CEDAW – UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, ‘Shadow Report on Iraq submitted by Geneva International Centre for Justice (GICJ) to the Committee of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ; 74th Session ; 21 October – 8 November 2019 ; Geneva, Switzerland', 10 October 2019. United Nations Population Fund, UN Children's Fund, UN Women, ‘Protecting Girls in Iraq from Female Genital Mutilation', 6 February 2019, from :
https://reliefweb.int/report/iraq/protecting-girls-iraq-female-genital-mutilation-enarku. The
United Nations have put forward multiple documents on the elimination of violence against women, including forced marriages, e.g., the 1993 Declaration on the Elimination of Violence against Women (UN Doc. A/Res/48/104). United Nations Statistics Division. United Nations Global SDG Database. Data retrieved July 2022. From :
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.













