Derniers articles

« Nous sommes en face du surgissement de l’inconcevable »

Internationalisme et démocr@tie n°9
Donald Trump est redevenu président ou plutôt il vient d'être investi 47e président des États-Unis d'Amérique. Trois mois ont suffi, les répliques de la secousse ne sont pas stabilisées, mais rien ne sera plus comme avant.
20 février 2025 | tiré du site entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/20/nous-sommes-en-face-du-surgissement-de-linconcevable/#more-90879
Et le monde a basculé…
Des signes avaient précédé l'événement. Mais, c'était davantage la faiblesse, les erreurs de la campagne démocrate qui étaient soulignés. L'arrivée de Trump était souvent minorée, voire moquée : « C'est un clown », « Ce sera comme la dernière fois »… L'attaque du Capitole par la horde de ses partisans était relativisée, voire oubliée [1].
Les débats lexicologiques ne sont pas sans intérêt pour la compréhension fine de l'époque. Nous publions deux textes de Gaspar Miklos Tamás sur l'apparition du post-fascisme en Hongrie [2]. La vague vient de loin…
« L'histoire ne repasse pas les plats », remarquait Hegel, au début du 19e siècle. La politique de Trump n'est pas identique à celle menée en Europe par Mussolini, Hitler ou le colonel de La Roque [3] ; l'oligarque de la tech, Elon Musk, n'est pas Henry Ford.
Pourtant ce n'est pas une comédie qui se déroule sous nos yeux malgré les gesticulations, les saluts et les grimaces des protagonistes [4].
Trump, depuis son investiture, déroule ce qu'il faut bien appeler une politique fasciste. Pour s'en convaincre, il suffit de récapituler quelques-uns des nombreux décrets qu'il a théâtralement signés.
* Amnistie des assaillants du Capitole en 2021… Milices armées.
* Aide aux entreprises amies, suppression des règlements et organismes anticorruption… Mafia.
* Expulsions des immigré·es, réaffectation de Guantanamo… Racisme.
* État d'urgence à la frontière avec le Mexique… Menaces contre les pays voisins.
* « Dégraissage de l'État », fermeture de services à la population… Libertarisme.
* Suspension de l'aide internationale (USAID) et nationales… Isolationnisme.
* Hausse des tarifs douaniers… Guerre commerciale.
* Organisation de l'espace d'influence (Canada, Panama, golfe du Mexique, Groenland)… Doctrine Monroe élargie.
* Attaques contre le droit international et ses instances : CPI et CIJ, protection du criminel Netanyahou… Impunité renforcée des criminels et destruction du droit et des droits.
* Suppression du « droit du sol »… Nativisme.
* Fin des programmes d'égalité, de diversité et d'inclusion… Remise en cause des acquis de la lutte pour les droits civiques.
* Retrait des organismes internationaux où ils siégeaient encore, en particulier, l'OMS… Laisser faire, conspirationniste, eugénisme.
* Attaques contre les femmes (droit à la contraception et à l'avortement) laissées au bon vouloir des États avec la bénédiction d'une Cour suprême à majorité réactionnaire, en attente de possibles nouveaux décrets… Masculinisme et destruction des droits.
* Restauration de « la réalité biologique naturelle ». Essentialisme.
* Exclusion des personnes « trans » de l'armée et du sport… Homophobie et sexisme.
La liste est longue et s'allonge [5]…
Un exemple troublant et lourd de sens : Trump a publié un décret sur l'architecture des établissements publics et s'est nommé président de la Fondation J. F. Kennedy Center of Performing Arts. À quand l'interdiction de l'art « dégénéré », c'est-à-dire celui qui ne reçoit pas l'agrément de ses amis, comme Bernard Arnaud, qui font et contrôlent le marché de l'art ?
Pour appliquer cette rafale de décrets, le président s'est entouré de collaborateurs issus du mouvement MAGA [6], créé sur la base du mot d'ordre initial de campagne, dans et hors du vieux Parti républicain.
Aujourd'hui, Trump dicte sa politique et les républicains approuvent ou se taisent [7]. D'autre part, ses collaborateurs n'ont pas suivi le cursus traditionnel qui menait à l'exercice du pouvoir ; ce sont des businessmen pour la plupart. La réussite en affaires, encore faut-il distinguer les investisseurs industriels et les aventuriers des échanges transactionnels [8], semble être le viatique pour gouverner. Le néolibéralisme dans son idéologie et par son soft power magnifiait depuis longtemps ces « héros » aux États-Unis, mais aussi en Europe. La vague vient de loin…
MAGA accoucha de MEGA (Make Europe Great Again) le 8 février 2025 à Madrid où se sont réunis les soutiens européens de Trump [9]. Une force politique réelle et dangereuse au pouvoir ou à ses portes dans beaucoup de pays mais aussi à Bruxelles.
Vendredi 14 février, le vice-président des États-Unis s'est adressé aux chefs d'États européens à Munich. Il a reproché à l'Europe son renoncement à « certaines valeurs fondamentales », comme le liberté d'expression. Pour lui, comme sur X, celle-ci doit être sans limite et laisser libre cours au complotisme et aux « vérités alternatives ». L'Europe a également, selon lui, renoncé à la démocratie. Il prend pour exemple le président roumain qui, sans campagne aucune, a été élu grâce à des malversations informatiques venues de l'étranger (Russie très certainement). C'était la démocratie selon Vance et jamais il n'aurait dû être obligé de démissionner.
Vance est en phase et soutient les MEGA dans leur lutte orwellienne contre « L'Europe des Lumières » et, contre l'avis de tous les dirigeants allemands, il a rencontré personnellement Alice Weidel, la responsable de l'AfD.
Au début du siècle, les études sur le « post-humanisme » s'attardait sur le côté dangereux mais folklorique des pionniers de la réalité augmentée, du dépassement du vivant, etc. Aujourd'hui, Musk, a rallié la Silicon Valley – une illustration du basculement de secteurs capitalistes vers des solutions très autoritaires et illibérales [10] – à la cause de Trump et ce qui, il y a peu, semblait encore un cauchemar de science-fiction, est devenu un marché juteux. Sous couvert de recherches médicales réelles, le champ des applications de l'augmentation machiniste du « potentiel humain » s'est extraordinairement étendu.
De même, se retrouvent au pouvoir des propriétaires de plateforme d'échanges de bitcoins, à commencer par Trump et Musk. Ce marché financier parallèle et obscur enrichit les riches d'autant plus qu'ils sont au pouvoir. La vague vient de loin…
Notre revue a un an
Née en réaction au 7 octobre en Israël-Palestine – crimes du Hamas et politique de Netanyahou – et à l'invasion poutinienne de l'Ukraine, soutien à la résistance du peuple ukrainien contre l'impérialisme russe, Adresses s'est intéressée à la transformation du monde en multipolarités impérialistes [11]. Les divers pôles, issus le plus souvent des BRICS, cumulaient des politiques autoritaires pour le moins. Mais il restait des aspects de la mondialisation capitaliste (adhésion de la Chine à l'OMC en 2001) qui faisait que les économies se trouvaient en concurrence certes mais incroyablement interpénétrées.
Restait encore, une domination évidente de la puissance étasunienne qui semblait maintenir un équilibre précaire et renvoyer un reflet de la démocratie dite occidentale.
C'était même l'unique grille de lecture de bien des analystes qui prônent un campisme primaire ou une hiérarchisation des combats au nom d'une conception étriquée de la colonialité [12].
L'élection de Trump vient de chambouler bien des analyses. Le basculement fasciste du gouvernement des États-Unis rentre en résonance avec les pratiques des autres pôles impérialistes.
Il ne s'agit pas simplement de recréer de nouvelles narrations mais d'ouvrir les yeux sur la profondeur du changement.
L'instauration d'un dialogue entre Trump et Poutine excluant de fait les dirigeants ukrainiens, la place des accords économiques (la volonté d'accaparement des terres rares) primant sur le droit international sont des exemples de ce qu'il convient d'appeler la « diplomatie transactionnelle ». La loi du plus fort, la primauté des intérêts financiers.
Cette nouvelle pratique s'applique à bien des aspects de la politique internationale. Tous les acteurs majeurs de la politique mondiale prennent langue avec Trump et se préparent à ce grand casino. Les règlements internationaux n'interfèrent plus avec la volonté du plus fort, la tentative d'organiser un développement « éthique » et concerté de l'« Intelligence artificielle » a échoué cruellement pour son organisateur lors du sommet de Paris des 10 et 11 février.
Ces rapports directs de subordinations et de transactions sont lourds de confrontations à venir. Le néolibéralisme mondialisé a vu les conflits se multiplier, le trumpisme, ses avatars et ses dérivés mènent aux guerres et aux affrontements contre les collectifs de travailleurs et travailleuses [13].
Certes la vague vient de loin mais aujourd'hui c'est une déferlante. Bien des interrogations se posent : quel sera le rôle de la Chine ? Quel sort réserve-t-on aux Gazaoui·es ? Que deviennent les résistant·es ukrainien·nes ? Dans cette nouvelle forme de domination du monde que deviennent les populations qui ne participent pas aux razzias, celles et ceux qui n'ont que leur force de travail ?
En conclusion que peut faire la « gauche d'émancipation » dans ce nouveau « casino » ?
Certes les analyses doivent sortir de la peinture à gros traits de la situation. Ce travail doit être poursuivi et approfondi rapidement. Il faut aussi apprendre des erreurs. La faiblesse de cette gauche, son inconséquence, sa rapidité à transformer les mobilisations émancipatrices en regroupements conformistes font partie du problème global.
Mais sans tarder, face à cette déferlante c'est bien d'un barrage uni contre le fascisme [14] pour la défense implacable de la démocratie, du droit des femmes à disposer de leur corps [15], du droit des peuples à l'autodétermination, de la solidarité internationale sans laisser quiconque dans l'ombre (Afghan·nes, Congolais·es, Géorgien·nes, Haïtien·nes, Soudanais·es, Iranien·nes, Kurdes, Ouïgour·es, Palestinien·nes, Rohingyas, Tutsi·es, Syrien·nes, Tamoul·es, Tibétain·nes, Ukrainien·nes, etc. – tous et toutes aussi dignes que les autres –, sans oublier les peuples-nations effacés de l'outremer français).
Sans tarder, ensemble, en respectant les choix de chacun·e, par-delà les divergences, nous pouvons populariser les résistances fragmentaires, ressouder des liens distendus, participer à revivifier toutes ces formes sociales et politiques qui se construisent par en bas, etc.
Faire front commun contre la déferlante fasciste. Il y a urgence !
Didier Epsztajn, Michel Lanson, Patrick Silberstein, 15 février 2025
Nous avons emprunté le titre de cet édito à Patrick Chamoiseau que nous remercions chaleureusement pour son autorisation.
Télécharger le n°9 : Adresses n°9
Notes
[1] Deux romans, à la fois dystopiques et uchroniques, auraient pu attirer notre attention sur la survenue possible de l'inconcevable. Impossible ici, de Sinclair Lewis date de 1935 et Complot contre l'Amérique de Philip Roth est paru en 2004.
[2] Voir Gaspar Miklos Tamás, « Naissance du post-fascisme dans la Hongrie de Orban », p.27 et « Sur le post-fascisme », p.36.
[3] Voir Didier Leschi, « Les Croix-de-feu et la tentation autoritaire à la française », Adresse n° 09/88, p.72 ; Patrick Le Tréhondat, Robi Morder et Patrick Silberstein, « Dernière station avant l'abattoir », Adresse n° 09/89, p. 84.
[4] Voir Bart Cammaerts, « Le salut nazi d'Elon Musk, George Orwell et cinq leçons », Adresse n° 09/89, p. 49.
[5] Voir Frieda Afary, « Fascism or not fascism », Adresse n° 09/82, p.18.
[6] Make America Great Again : Rendre l'Amérique à nouveau grande.
[7] Voir Sam Farber, « Comprendre la réélection de Trump », Adresse n° 09/87, p.63.
[8] Voir Samuel Farber, « Trump Lumpen Capitalist », Jacobin, octobre 2018.
[9] Voir Gilbert Achcar, « L'ère du néofascisme et ses particularités », Adresse n° 09/86, p. 61.
[10] Voir Taki Manolakos, « La fin du néolibéralisme préfigure la montée du fascisme », Adresse n° 07/63, p. 23.
[11] Voir Kavita Krishna, « Multipolarité une doctrine au service des autoritarismes », Adresses, n° 0, 23 janvier 2024.
[12] Voir Michel Cahen, « Violences en colonialité : “Angola 1961. Gaza-Israël 2023” », Adresses, n°4, 1er septembre 2024 ; « Intégrer l'ethnicité à la démocratie politique », à paraître dans Adresses, n°10.
[13] Voir Ilya Budraitskis, « Le poutinisme, c'est le fascisme », Adresse n° 09/85, p.52
[14] Voir, Carl Davidson et Bill Fletcher Jr., « Combattre l'abolition de la démocratie », Adresse n° 09/81, p. 9.
[15] Voir Un appel unitaire, « 8 Mars : grève féminist ! », Adresse n° 09/90, p. 100.
Toutes les introductions et les numéros à télécharger gratuitement sont disponibles sur une page dédiée :
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/adresses-internationalisme-et-democrtie/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ensemble contre Trump et contre l’extrême droite !

Plus d'une centaine de manifestant-es se sont réunis devant le Consulat général des États-Unis à Québec ce dimanche 23 février 2025 pour dénoncer les politiques fascistes, colonialistes, misogynes et racistes du président Trump. Presse-toi à gauche publie ci-dessous les différentes interventions qui, toutes, soulignaient les dangers des politiques du président Trump non seulement pour les personnes vivant aux États-Unis mais également pour les peuples du Québec, du Canada et du monde.
Les interventions
1. Vania Wright-Larin du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec-Chaudière-Appalaches (REPACQ 03-12) dénonce les politiques de Trump et d'Elon Musk, leurs volontés impérialistes et leurs menaces tarifaires. Il a également introduit les différents intervenant-es et a ponctué ses propos de slogans bien sentis repris par les participant-es à cette manifestation.
2. Interventions de Marie-Hélène Fortier et d'Émilia Castro de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes lors de la manifestation devant le Consulat américain à Québec le 23 février dernier contre les politiques régressives de Trump.
3. Intervention de Charlotte Veilleux de l'organisation DIVERGENRES en défense des droits des personnes LGBTQ+ et trans lors de la manifestation devant le Consulat américain à Québec le 23 février dernier contre les politiques régressives de Trump.
4. Intervention d'Hyungu Kang du Collectif de lutte et d'action contre le racisme qui vise à
combattre le racisme sous toutes ses formes et de défendre les droits des personnes racisées. Discours prononcé le 23 février 2025 à Québec dans le cadre d'un rassemblement de solidarité contre les politiques de Trump.
5. Intervention de Raphaël Laflamme du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants de Québec. Discours prononcé le 23 février 2025 à Québec dans le cadre d'un rassemblement de solidarité contre les politiques de Trump.
6. Mama Keita intervient au nom du Comité femmes immigrantes de Québec le 23 février 2025 dans le cadre d'un rassemblement de solidarité contre les politiques de Trump, rassemblement qui s'est tenu devant le Consulat américain de Québec.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Mujeres Libres : Individuality and Community | Martha Ackelsberg (USA, 1984)

Les syndicats et groupes communautaires dénoncent le PL 89

MONTRÉAL, QC : Le Comité d'Action en Solidarité avec la Construction du Québec (CASQ), qui est un regroupement de différentes organisations communautaires et ouvrières supportant les travailleurs et travailleuses de la construction, organisera un rassemblement devant le bureau du ministre du Travail, Jean Boulet, pour dénoncer la déposition du projet de loi 89.
Le 19 février, Jean Boulet, le ministre du Travail de la CAQ, a déposé le projet de loi 89 (PL89) qui attaquer le droit de grève des travailleurs du Québec. L'ensemble des syndicats de la province a dénoncé ce projet de loi qu'ils accusent de brimer le droit constitutionnel de libre association.
Le Comité d'Action en Solidarité avec la Construction du Québec (CASCQ)
Contact : Renaud Simard - Responsable à la coordination
Téléphone : 438-935-8257
Courriel : renousim@hotmail.fr
Avec ce projet de loi, Boulet se donne le droit de forcer le retour au travail dans des secteurs qui ne sont pas considérés comme essentiels. Éducation, secteur municipal, secteur privé rien n'est épargné par le ministre accusé à plusieurs reprises de favoriser les intérêts du patronat.
Au Québec, l'année 2025 est déjà ponctuée par plusieurs conflits de travail, notamment dans les CPE, le transport scolaire et l'hôtellerie. À ces secteurs risquent de s'ajouter dans les prochains mois la construction, le transport collectif et les cols bleus.
Si le PL89 est adopté, le ministre du Travail pourrait suspendre ces grèves et imposer des arbitrages exécutoires aux tables de négociation en question. Or, ce genre de mesure a pour effet de réduire considérablement le rapport de force des syndiqués.
Avec les conventions collectives dans l'industrie de la construction qui se terminent le 30 avril 2025, les négociations sont déjà en cours et les offres patronales proposent des reculs majeurs en matière de conditions de travail et de salaire et mèneront à l'appauvrissement des travailleurs et travailleuses dans l'industrie dans un contexte d'inflation épuisante. Si les deux
côtés des tables de négociations ne se rapprochent pas et la grève est inévitable, le PL89 met directement en question le rapport de force que les travailleurs de la construction et leurs syndicats ont pour mettre de la pression sur le patronat.
Pour ces raisons, le CASCQ dénonce fortement le PL89 et nous invitons les membres des médias à venir couvrir notre rassemblement, parler avec nos organisations affiliées sur comment le PL89 va les affectées, et de discuter avec les travailleurs et travailleuses de la construction de leurs conditions de travail.
Alliance Ouvrière
Centre des Travailleurs/Travailleuses Immigrants (CTI-IWC)
Syndicat des Locataires de Montréal (SLAM-MATU)
Ligue 33
Syndicat des Locataires de Gatineau/Hull
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
/
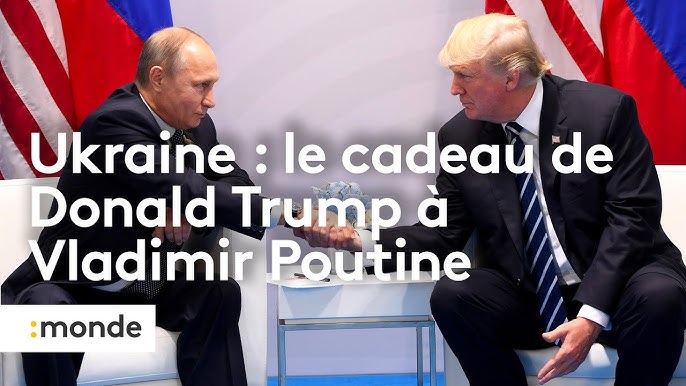
Paix entre néofascistes et guerre contre les peuples opprimés
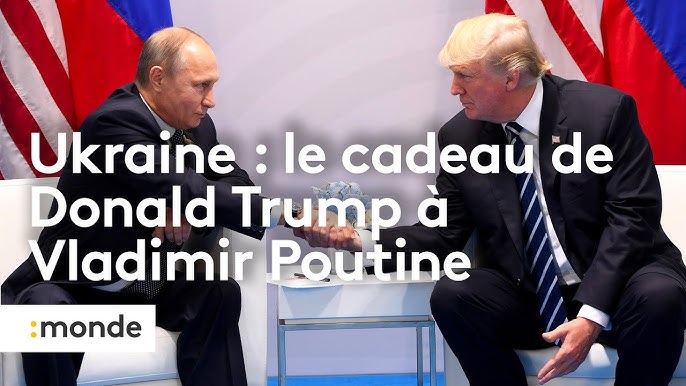
Que Washington et Moscou aient choisi le royaume saoudien comme lieu de réunion entre leurs délégations pour discuter des perspectives de la guerre qui se déroule en Ukraine depuis que les forces russes ont envahi ce pays il y a trois ans, est une illustration claire des profonds changements qui se produisent sous nos yeux dans les affaires internationales.
Tiré de Médiapart
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/190225/paix-entre-neofascistes-et-guerre-contre-les-peuples-opprimes
19 février 2025
Gilbert Achcar
Professeur, SOAS, Université de Londres
La manière même dont la réunion a été organisée est tout à fait cohérente avec le lieu : l'administration néofasciste de Donald Trump n'a pas cherché à promouvoir la paix entre les parties belligérantes dans le cadre du droit international et des Nations unies, comme la Chine n'a cessé d'y appeler depuis le début du conflit, mais cherche plutôt à conclure un accord direct avec le régime également néofasciste de Vladimir Poutine aux dépens du peuple ukrainien. Il est donc tout à fait naturel que les deux parties n'aient pas choisi une arène neutre et conforme au droit international, comme les Nations Unies, mais une arène conforme à leur nature, même si son régime despotique est de type traditionnel.
Ce qui rend la scène encore plus hideuse, c'est que les États-Unis sont un partenaire à part entière dans la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien à Gaza, qui se déplace actuellement en partie vers la Cisjordanie. L'administration Trump s'est même empressée d'annuler les mesures limitées que l'administration précédente avait prises pour parer au blâme, en particulier le gel de l'exportation de bombes d'une tonne qui ont grandement contribué à la destruction de la bande de Gaza et à l'extermination de sa population, ainsi qu'à la guerre d'élimination qu'Israël a menée contre le Hezbollah au Liban. Au contraire, comme prévu, excepté par ceux qui ont tenté d'échapper à l'amère réalité en projetant leurs désirs sur elle (voir « Deux mythes sur le cessez-le-feu à Gaza », 22 janvier 2025), la nouvelle administration a surpassé la précédente dans la surenchère sioniste avec l'appel de Trump à déporter sans retour les résidents de la bande de Gaza, c'est-à-dire à mettre en œuvre ce que le droit international appelle « nettoyage ethnique » – un crime contre l'humanité.
L'axe néofasciste sioniste-américain converge avec la Russie de Poutine dans la haine raciale des peuples opprimés. Moscou a excellé dans ce domaine, non seulement par son agression coloniale contre l'Ukraine, répudiant sa souveraineté nationale, mais aussi dans la région arabe, où elle a joué un rôle clé dans la destruction de la Syrie et l'extermination d'un grand nombre de ses habitants, tout en étant ouvertement complice de l'État sioniste en lui permettant de bombarder à volonté les sites iraniens en Syrie (dans le cadre de la rivalité entre les influences russes et iraniennes dans ce pays). Le ministre russe des affaires étrangères a même comparé la guerre de Moscou contre l'Ukraine à la guerre d'Israël contre Gaza, assimilant la description poutiniste des dirigeants ukrainiens comme nazis à la description sioniste du Hamas comme nazis. Notons également que la réaction de Moscou au projet criminel d'expulsion énoncé par Trump a été modérée, même par rapport à la condamnation explicite émise par certains des alliés traditionnels de Washington, comme la France.
Voici maintenant les Américains impliqués dans le meurtre de centaines de milliers de Gazaouis qui rencontrent les Russes impliqués dans le meurtre de centaines de milliers de Syriens, les deux parties partageant avec l'État sioniste un mépris commun pour les droits territoriaux des peuples. Ils se rencontrent sur le territoire d'un État arabe qui, s'il se préoccupait vraiment du sort des peuples syrien et palestinien, aurait dû être si hostile aux deux parties qu'il ne leur serait même pas venu à l'idée de lui demander d'accueillir leur réunion.
Ce à quoi nous assistons en réalité n'est rien de moins qu'une refonte de la carte politique du monde, passant de la confrontation de la Guerre froide entre un bloc occidental qui prétendait défendre les valeurs de la démocratie libérale (et les a constamment trahies) et un bloc de l'Est dans lequel prévalaient des régimes dictatoriaux – de cette confrontation à la dissolution du système occidental, après le système oriental, par suite de la crise mortelle qui a frappé la démocratie libérale et de la montée mondiale du néofascisme (voir « L'ère du néofascisme et ses particularités », 5 février 2025). L'ère de la Nouvelle Guerre froide, qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique et la dissolution de son bloc, a constitué la transition en combinant loi de la jungle et néolibéralisme effréné. Washington a joué le rôle principal dans la prédominance de ces deux caractéristiques sur le droit international et le développement fondé sur l'État social et la protection de l'environnement.
Nous assistons aujourd'hui à une convergence entre néofascistes aux dépens des peuples opprimés, car le nouveau fascisme, comme l'ancien, nie ouvertement le droit des peuples à l'autodétermination. Les gouvernements libéraux restants en Europe sont stupéfaits, après avoir compté pendant huit décennies sur la protection américaine du système occidental sans oser former un pôle mondial indépendant de Washington, non seulement militairement, mais principalement dans le domaine de la politique étrangère. Le résultat est que les peuples opprimés du monde ne sont plus en mesure de profiter de la divergence entre grandes puissances qui existait dans le passé, mais doivent maintenant mener leurs luttes de résistance et de libération dans des conditions plus difficiles que jamais. Le cas de la Palestine en est la preuve la plus évidente.
Traduit de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 18 février. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quelle stratégie pour combattre l’extrême-droite et l’austérité ?

Révolution écosocialiste organisait une conférence vendredi le 21 février concernant la montée de l'extrême droite. Voici le texte de l'allocution d'André Frappier. Quelle stratégie pour QS au-delà d'un électoralisme à courte vue ? Assumer les perspectives de gauche et de rupture avec le système tout en développant des alliances populaires pour combattre l'extrême droite et l'austérité.
1. Définir la nouvelle problématique. Les raisons qui ont conduit à la montée de l'extrême droite dans le monde et à Trump en particulier
Le faible taux de syndicalisation est un révélateur de la pauvreté, les combats pour des salaires et des conditions de travail décents étant plus difficiles, ainsi que de la fragmentation du tissu social et par conséquent de la conscience politique de classe.
En 2023, 10,5 % des hommes salariés étaient syndiqués, contre 9,5 % des femmes ce qui est un nouveau record à la baisse. Le taux d'adhésion des travailleurs du secteur privé est resté inchangé, à un niveau record de 6 %. Les employeurs ont exploité les faiblesses du droit du travail américain et les responsables politiques fédéraux et nationaux n'ont pas réussi à les en empêcher.
Comparativement il était de 39,1% au Québec en 2022, 26,5% en Ontario et 29,4 dans le reste du Canada.
2. On ne peut revenir en arrière
L'irruption d'un régime à caractère néofasciste dans la principale puissance militaire et économique du monde cause une sidération naturelle et entraîne un réflexe bien compréhensible : celui de tenter de sauvegarder « le monde d'avant. L'ennui, c'est que c'est bel et bien ce « capitalisme démocratique » qui a enfanté de la monstruosité. Aux États-Unis les populations se sont tournées vers l'extrême droite en grande partie parce que les néolibéraux ont échoué, parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses d'amélioration des conditions de vie.
Au Canada et au Québec
Mark Carney envisage la possibilité de réduire la taille des services publics. Selon l'AFPC Lorsque Pierre Poilievre dit qu'il veut “couper dans la bureaucratie”, le message est très clair. Un gouvernement sous Pierre Poilievre, ça voudrait dire des coupes dans les programmes dont ont besoin les familles, l'élimination d'emplois au gouvernement pour alléger les impôts de ses amis entrepreneurs, et la privatisation de services publics pour rediriger les fonds publics vers les poches des entrepreneurs privés.
Le Conseil du Patronat du Québec (CPQ) propose quant à lui de réduire l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 15 à 12%, voire 10 % au fédéral et de 11,5 à 10 % au provincial.
Le gouvernement de la CAQ se prépare déjà à ce régime d'austérité en voulant retirer à toutes fin pratiques le droit de grève. Le seul qui s'y oppose c'est Québec solidaire. Legault s'est rangé sans nuance aux demandes de Trump en matière d'immigration. Le ministre Bonnardel a affirmé se préparer à envoyer la Sûreté du Québec pour faire face à la vague migratoire qui sera provoquée par la volonté d'expulsion de Trump.
Quant au PQ, PSPP dans une publication sur X n'hésite pas à affirmer : « Les États-Unis ont des points légitimes sur la question du laxisme aux frontières. Il faut donc voir cette situation pour ce qu'elle est réellement : avant tout, un enjeu de gestion négligente des frontières du gouvernement fédéral. Nous demandons au gouvernement fédéral de travailler avec l'administration Trump pour régler les enjeux aux frontières.
Quant à QS le recentrage populiste ne l'a pas servi. Selon le dernier sondage, nous sommes passés en dessous du PCQ d'Éric Duhaime avec son populisme de droite. Il est plus que temps de revenir à des revendications qui ciblent les responsables de la déchéance économique et environnementale, les grandes entreprises, les multinationales et les dirigeants de la finance.
L'immigration devient la cible de tous les maux avec lequel carbure le nationalisme identitaire.
3- Nos perspectives, ne comptons que sur nos propres moyens
S'il est normal et légitime, en cette période sombre, de chercher à sauver ce qui peut l'être, on ne doit pas oublier l'autre, essentielle, celle de se projeter vers l'avenir. Pour passer, enfin, à l'offensive.
S'opposer à Trump par le seul biais de la réponse aux tarifs qu'il dit vouloir imposer, c'est refuser de voir l'ensemble de ses objectifs. Et cette situation va maintenant amplifier la crise environnementale qui menace la survie de la planète. Seule une coordination une riposte environnementale et une alternative internationale pourra changer le cours des choses.
Si nous n'offrons pas d'alternative à la classe ouvrière, elle suivra forcément les forces néolibérales qui, de capitulation en capitulation devant la droite, la désarmera et la laissera au final sans force de résistance face à la droite et l'extrême droite. C'est l'histoire du mouvement ouvrier.
Notre force repose sur la politisation, sur la mobilisation. Il faut s'adresser à la population et aux progressistes américains, construire la mobilisation avec eux. Le Canada pays est contrôlé au final par les multinationales, les minières, les papetières, les compagnies forestières, les pétrolières et les consortiums financiers. Aucun secteur du capital ne viendra au secours de la démocratie.
Notre défi n'est pas de sauver ce Canada, mais de lier les luttes sociales de la classe ouvrière du Reste du Canada dans une stratégie commune avec les luttes des mouvements sociaux au Québec et avec les nations autochtones. Nous sommes la seule force qui peut apporter une solution à la crise politique et environnementale. L'heure est maintenant pour nous de construire la mobilisation populaire, d'unir les forces de la gauche au niveau international afin de pouvoir poser une politique et un discours alternatif.
- Qui mettra en priorité une politique altermondialiste basée sur la planification écologique dans la lutte aux changements climatiques passant par une rupture avec le capitalisme fossile,
- L'égalité sociale et la défense des services sociaux dans une perspective d'égalité sociale ;
- Une lutte anti-patriarcale défendant l'égalité des hommes, des femmes et des personnes de la diversité sexuelle et de genre, une lutte antiraciste ;
- Une indépendance du Québec en alliance avec les classes ouvrières et populaires du ROC et les nations autochtones et faisant du Québec une terre d'accueil face aux migrations appelées à se développer à cause de la pauvreté engendrée par l'exploitation économique des industries du nord et de la crise climatique causée par ces derniers.
Conclusion
Le 30 septembre 1938, le Français Daladier, le Britannique Chamberlain et l'Italien Mussolini signaient avec Hitler les accords de Munich. En cédant une nouvelle fois à la menace, les Occidentaux confirmaient le dictateur allemand dans la conviction que tout lui est permis.
Rosa Luxembourg nous avait déjà averti de cette situation en 1915. "La société bourgeoise est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Déclaration du Comité Femmes Immigrantes contre la haine et les reculs sociaux : notre engagement pour une société juste et inclusive

Mama Keita intervient au nom du Comité femmes immigrantes de Québec le 23 février 2025 dans le cadre d'un rassemblement de solidarité contre les politiques de Trump, rassemblement qui s'est tenu devant le Consulat américain de Québec.
Bonjour à toutes et à tous : Ceci est une déclaration du Comité Femmes Immigrantes contre la haine et les reculs sociaux : notre engagement pour une société juste et inclusive. Nous, membres du Comité Femmes Immigrantes, dénonçons fermement les discours haineux, sexistes, transphobes, racistes, antiavortement et climatosceptiques tenus par Donald Trump. Ces propos, non seulement divisent, mais mettent en péril les droits durement acquis par les femmes, les communautés immigrantes et les groupes marginalisés à travers le monde.
Nos droits ne sont pas négociables
Les attaques contre le droit à l'avortement et l'autonomie des femmes sur leur propre corps sont un recul inacceptable. Nous affirmons haut et fort que toutes les femmes doivent avoir le droit de décider de leur avenir, sans ingérence politique ou idéologique.
Nous défendons une société inclusive
Les paroles racistes et transphobes de Trump encouragent un climat de peur et de discrimination. Nous croyons en une société où chacune et chacun a sa place, peu importe son origine, son genre ou son identité.
L'urgence climatique est réelle
Nier le changement climatique, c'est nier la réalité de millions de personnes, en particulier des populations les plus vulnérables. Nous exigeons des politiques responsables et durables, loin des discours négationnistes et destructeurs.
Nous appelons à la mobilisation
Nous refusons de rester silencieuses face à ces discours qui nous visent directement. Nous appelons toutes les femmes, les allié.e.s et les organisations engagées pour les droits humains à s'unir, se mobiliser et faire entendre nos voix contre ces idéologies rétrogrades.
Un monde meilleur est possible
Ensemble, nous continuerons à bâtir un monde où l'égalité, la justice et la solidarité sont au cœur de nos actions.
Nous ne reculerons pas. Nous avançons
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Manif contre Trump à Québec : Quels intérêts dirigent les États-Unis ?

Discours prononcé le 23 février 2025 à Québec dans le cadre d'un rassemblement de solidarité contre les politiques de Trump. Par Raphaël Laflamme, organisateur communautaire au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et militant du groupe Alliance Ouvrière.
Sur 23 ministres nommés au cabinet de Trump, on compte au moins 16 milliardaires. Seulement trois d'entre eux détiennent des fortunes personnelles de moins de 10 millions de dollars. Tous, sans exception, sont investis dans les formes les plus perverses du capital financier : des compagnies d'assurances au bitcoin en passant par les investissements boursiers dans les pétrolières et les compagnies d'armement.
Combinées, les fortunes personnelles du cabinet de Trump sont de plus de 460 milliards de dollars. En comparaison, la valeur du cabinet de Biden – qui était composée presque exclusivement de millionnaires venus du 1% – était de 118 millions de dollars. Le cabinet de Trump vaut presque 4000 fois plus que le cabinet de Biden, qui était déjà composé de millionnaires ! Avec Trump, on passe d'un gouvernement du 1% à gouvernement du 0,0001%.
Nous ne verserons pas de larmes pour Biden et ses associés. Leur héritage est celui d'un gouvernement de l'establishment, du 1% qui nous gouverne et nous exploite depuis des décennies. Leur gouvernance néo-libérale a posé les bases du virage à droite. Mais qu'est-ce que ce changement veut dire pour les travailleurs et travailleuses, pour le monde ordinaire ?
Nous le voyons déjà. Le 7 février, Elon Musk a annoncé que le Consumer Financial Protection Bureau allait être dissous. Cette agence protégeait les consommateurs, par exemple, des frais excédentaires chargés par les compagnies de crédits ou les banques. En janvier, juste avant l'inauguration de Trump, l'agence avait passée un règlement comme quoi les dettes contractées pour rembourser des frais médicaux ne seraient pas prises en compte dans le calcul de la cote de crédit pour obtenir une hypothèque. Cette mesure, et l'ensemble de la mission de ce bureau, sont caducs. Pour les survivants du cancer qui voulaient une maison, on oublie ça.
C'est bien connu que la commission « DOGE » de Musk a ordonné de nombreuses coupures de postes de fonctionnaires fédéraux. Hormis la protection du consommateur, dans quoi est-ce que Musk a coupé ? Entre autres dans la Food and Drug Administration, chargée de surveiller les opérations de compagnies comme Neuralink, possédée par Musk. Dans la Federal Aviation Administration, chargée de surveiller les opérations de compagnies comme SpaceX, possédée par Musk. Dans USAID, qui avait enquêté sur Starlink, la compagnie de Musk. Elon Musk est littéralement en train de couper dans les mécanismes de surveillance et de responsabilité de ses propres compagnies. Ce n'est plus une question de conflit d'intérêts ou de manigances : c'est un gouvernement qui agit ouvertement en défense de ses propres intérêts.
Ces exemples ne sont que la pointe de l'iceberg d'une série de mesures déjà prises, et qui seront prises, pour presser à fond le citron des classes populaires et renvoyer le maximum de richesse vers les banquiers, les magnats des compagnies d'assurances et les oligarques du capital financier.
Pour se donner une idée de ce qui s'en vient, on peut se fier aux nombreuses affirmations de Trump contre la classe ouvrière qu'il vomit régulièrement sur Truth Social et X : il aimerait délocaliser des usines pour payer des moins bons salaires, il trouve que les salaires des travailleurs aux États-Unis sont trop élevés, il propose de renvoyer les travailleurs dans le cas d'une grève, il s'oppose au paiement des heures supplémentaires, etc.
Pour les gens ordinaires, un gouvernement Trump, ça veut dire ne jamais savoir que son usine ne sera pas délocalisée. Ça veut dire que les acquis du passé, comme les fonds de retraites, sont toujours à un décret près d'être annulé. Ça veut dire plus de latitude pour les banques et les compagnies d'assurance pour frauder légalement. Ça veut dire des attaques décomplexées contre l'assurance emploi et les programmes sociaux. Ça veut dire une législation à l'extrême du néo-libéralisme, un code du travail qui sera reforgé dans l'intérêt des grandes corporations. C'est un retour aux conditions de travail des sweatshop de la première révolution industrielle.
Au cours des prochaines années, la fortune personnelle des membres du cabinet Trump va décupler. La valeur des corporations détenues par Elon Musk a déjà grimpée de 613 milliards. Cette valeur-là, ce n'est pas Musk qui l'a créée en travaillant. De l'argent, ça n'apparaît jamais de nul part. C'est de la valeur qui a été volée directement à la classe ouvrière. 613 milliards volés en un mois par une seule personne. Imaginez ce qui sera volé en quatre ans par l'ensemble des oligarques au pouvoir.
Nous devons clairement comprendre ce que le cabinet de Trump représente : les intérêts des éléments les plus réactionnaires de l'oligarchie financière. Ils sont en train de préparer la voie pour une dictature ouverte du capital financier, autrement dit, pour instaurer un régime fasciste aux États-Unis. Leur stratégie est de créer un front uni en ralliant une base d'appui parmi les petits entrepreneurs frustrés et dans les classes populaires blanches afin de les mobiliser contre les migrants, contre les minorités de genre, les minorités religieuses, etc. autour d'un programme axé sur les valeurs ultra-conservatrices. Mais au bout de la ligne, même les ouvriers blancs et les petits entrepreneurs y seront perdants : l'essence du programme de Trump, c'est l'enrichissement du 0,0001% au détriment de la vaste majorité, au détriment de tous les gens ordinaires des États-Unis, au détriment des peuples du monde et au détriment de la viabilité de la vie sur Terre.
Nous devons lutter pour éviter que la vague Trump arrive ici. L'agenda de Poilievre, ce n'est peut-être pas encore Trump, mais c'est certainement un pas dans sa direction. Contre la vague de droite, il faut promouvoir l'unité de classe. Il faut lutter avec nos camarades immigrants et immigrantes, avec nos camarades des minorités religieuses et de genre, pour défendre leurs droits et nos droits. Ensemble, il faut prendre l'offensive et diriger une lutte sociale d'envergure pour mettre un terme au système capitaliste qui génère l'inégalité, la guerre et le fascisme.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La colère tarifaire de Trump

Au cours du week-end, le président Donald Trump a annoncé une série d'augmentations tarifaires sur les importations américaines de marchandises en provenance des partenaires commerciaux les plus proches des États-Unis, le Canada et le Mexique. Il a proposé une augmentation de 25 % des tarifs douaniers (avec un taux inférieur pour les importations de pétrole en provenance du Canada). Il a ensuite annoncé une augmentation de 10 % des droits de douane sur toutes les importations chinoises. C'est ainsi que Trump a commencé sa nouvelle guerre commerciale.
7 février 2025 | tiré de Viento sur
https://vientosur.info/la-rabieta-arancelaria-de-trump/
Et pourtant, dès qu'il l'a commencé, il a pris du recul. Trump a annoncé qu'il reportait d'un mois les hausses de droits de douane avec le Canada et le Mexique parce que leurs gouvernements avaient accepté de faire quelque chose contre la contrebande de fentanyl aux États-Unis, qui, selon lui, tue 200 000 Américains chaque année. Ce chiffre est absurde, bien sûr, car moins de 100 000 Américains meurent chaque année d'overdoses de drogues de toutes sortes. À l'heure actuelle, la contrebande de fentanyl à la frontière canado-américaine est minuscule, surtout si on la compare aux opérations des cartels de la drogue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. De plus, comme le président mexicain Sheinbaum l'a fait remarquer à Trump, les cartels peuvent utiliser des méthodes violentes grâce au trafic d'armes effectué par les Américains aux États-Unis.
Les gouvernements du Canada et du Mexique se sont empressés de conclure un accord avec Trump, promettant des groupes de troupes aux frontières pour arrêter le trafic et plus de forces antidrogue conjointes avec les États-Unis, etc. Cela semble suffisant pour que Trump reporte sa mesure tarifaire, bien que les droits de douane sur la Chine soient maintenus (pas de médicaments là-bas ?). Des taxes seront également introduites dans le système douanier sur les importations de petits colis qui étaient auparavant exempts de droits de douane, ce qui affectera les achats en ligne de marchandises en provenance de l'étranger par les Américains.
Alors, que devrions-nous apprendre de cette crise de colère ? Les menaces d'augmentation des droits de douane sont-elles simplement utilisées pour intimider d'autres pays afin qu'ils fassent des concessions à Trump ? Ou y a-t-il une politique économique cohérente dans tout cela ?
Cette folie répond à une méthode. Sur le front extérieur, Trump a l'intention de rendre à l'Amérique sa grandeur en augmentant le coût de l'importation de biens étrangers pour les entreprises et les ménages américains, réduisant ainsi la demande et l'énorme déficit commercial que les États-Unis ont actuellement avec le reste du monde. Il veut le réduire et forcer les entreprises étrangères à investir et à opérer aux États-Unis au lieu d'y exporter.
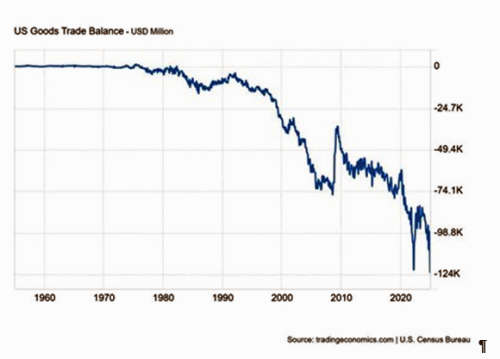
Il pense que cela augmentera les revenus et l'emploi des Américains. Et avec les revenus supplémentaires des droits de douane, le gouvernement aura suffisamment de fonds pour réduire autant que possible l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices des sociétés (en fait, Trump dit qu'il veut abolir complètement l'impôt sur le revenu). Si tel est le plan, les droits de douane finiront par être pleinement mis en œuvre et la Chine obtiendra probablement une augmentation encore plus importante.
Si Trump va de l'avant avec ses mesures tarifaires protectionnistes, quel sera l'impact sur le commerce et l'économie américains ? Les droits de douane actuellement prévus affecteraient 1,3 billion de dollars d'échanges commerciaux avec les États-Unis, et 43 % de toutes les importations américaines seraient touchées.

Les augmentations cumulatives des droits de douane depuis que Trump les a lancés pour la première fois au cours de son mandat de 2016 à 2020 atteindraient des niveaux jamais vus depuis 1969, juste avant les réductions tarifaires internationales du GATT et de l'OMC au cours des décennies de mondialisation à la fin du XXe siècle.

En effet, les droits de douane sont une taxe sur les biens importés, que le Trésor américain peut empocher. Un tarif de 25 % sur le Canada et le Mexique augmenterait les coûts pour les constructeurs automobiles américains. On s'attend à ce que ces tarifs augmentent jusqu'à 3 000 $ sur le prix de certaines des 16 millions de voitures vendues aux États-Unis chaque année. Les coûts des denrées alimentaires augmenteraient également, car le Mexique fournit plus de 60 % des produits frais aux États-Unis.
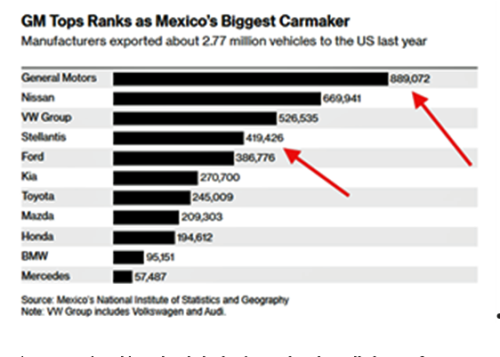
L'impact précis dépendra de la durée pendant laquelle les tarifs resteront en place et de la décision d'autres pays de prendre des mesures de rétorsion. La Chine a déjà annoncé une série de contre-mesures. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que le pays imposerait des contrôles à l'exportation sur le tungstène, le tellure, le ruthénium, le molybdène et les articles liés au ruthénium, des composants essentiels des produits technologiques. La Chine prévoit également une taxe de 15 % sur le gaz naturel liquéfié.
Aux États-Unis, si des augmentations tarifaires sont mises en œuvre, les prix intérieurs augmenteront et il y aura une pression à la hausse sur l'inflation. Il y a un facteur qui contrecarre cela. Si le dollar américain se renforce par rapport aux autres devises commerciales, le coût des importations en dollars sera plus faible, ce qui réduira l'impact des droits de douane sur les prix. Mais le taux d'inflation aux États-Unis augmentera très probablement. L'inflation recommence déjà à augmenter. Les augmentations tarifaires porteront le taux au-dessus de 3 % d'ici 2025.
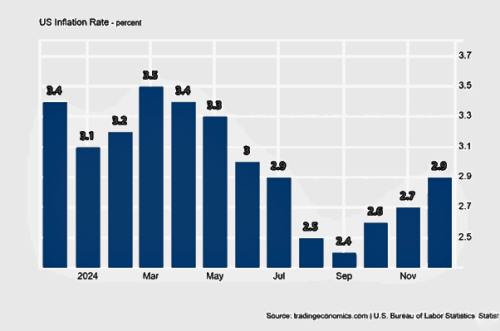
Un groupe de réflexion américain, le Tax Policy Center, estime que le revenu médian des ménages américains après impôts diminuera de 1 %, soit 930 dollars, d'ici 2026 si les tarifs sont pleinement mis en œuvre. En effet, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7 % et le PIB réel perdrait de 0,4 %. Le Peterson Institute for International Economics estime que les droits de douane entraîneront une contraction de l'économie américaine de 0,25 % l'année prochaine et de 0,1 % à long terme. « Les politiques qu'il poursuit présentent un risque inflationniste élevé », a déclaré Adam Posen, directeur du groupe de réflexion du Peterson Institute for International Economics. « Il semble que la promotion de l'industrie manufacturière et l'atteinte des partenaires commerciaux de l'Amérique soient des objectifs qui, pour Trump, ont plus de priorité que le pouvoir d'achat de la classe ouvrière. »
Trump affirme que les revenus supplémentaires provenant des tarifs seraient utilisés pour réduire les impôts et que l'ensemble des types de revenus serait censé aider les revenus des ménages. Mais les estimations des revenus supplémentaires provenant des droits de douane ne s'élèvent qu'à 150 milliards de dollars par an. Et les réductions d'impôt sur le revenu profiteront principalement aux personnes aux revenus les plus élevés, tandis que la hausse de l'inflation touchera les groupes à faible revenu.
Si l'impact des hausses tarifaires devait réduire la croissance économique, le soi-disant succès relatif de l'économie américaine par rapport à d'autres grandes économies serait en péril. La croissance du PIB réel aux États-Unis avait déjà ralenti à la fin de 2024 pour s'établir à un taux annualisé de 2,3 %. Des mesures tarifaires réduiraient ce taux de croissance cette année et l'année prochaine.
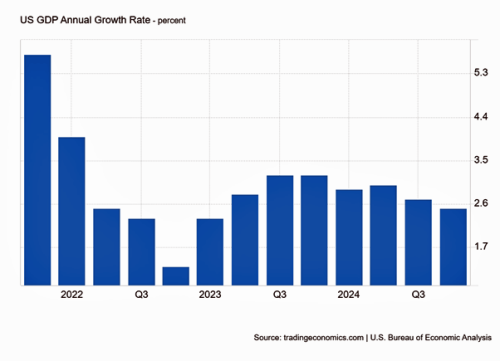
Ainsi, alors que Trump impose des droits de douane, l'inflation aux États-Unis augmente et la croissance de la production ralentit.
Les pays soumis aux augmentations tarifaires de Trump seront durement touchés. Le Peterson Institute calcule que « sous la deuxième administration Trump, le PIB des États-Unis serait inférieur d'environ 200 milliards de dollars à ce qu'il aurait été sans les droits de douane. Le Canada perdrait 100 milliards de dollars à cause d'une économie beaucoup plus petite et, à son apogée, les droits de douane réduiraient la taille de l'économie mexicaine de 2 % par rapport à ses prévisions de base. En fait, les économistes de JP Morgan estiment que ces mesures pourraient plonger le Canada (déjà faible) et le Mexique dans une récession à part entière.
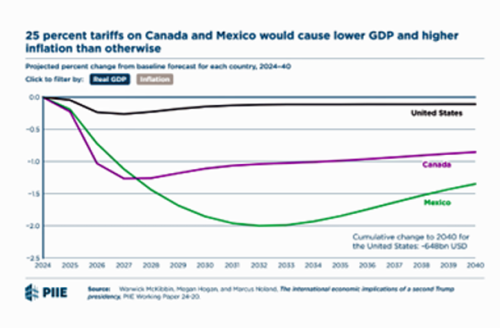
L'impact sur la Chine dépendra de l'ampleur des augmentations tarifaires. Pour l'instant, ce n'est que 10 %, mais Trump a déclaré que ce serait finalement 60 %. Si les États-Unis imposaient un tarif supplémentaire de 10 % à la Chine et que la Chine répondait en conséquence, le PIB américain serait réduit de 55 milliards de dollars au cours des quatre années de la deuxième administration Trump, et de 128 milliards de dollars en Chine. L'inflation devrait augmenter de 20 points de base aux États-Unis et, après une baisse initiale, de 30 points de base en Chine.
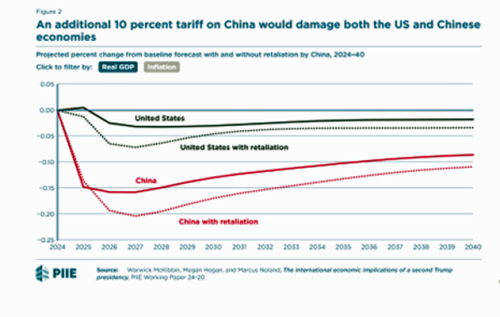
Ces estimations supposent que des mesures tarifaires seront appliquées. Jusqu'à présent, Trump a reporté son application pendant qu'il poursuit ses tactiques de négociation avec ses partenaires commerciaux. Mais n'oubliez pas qu'il prévoit également d'augmenter les droits de douane sur toutes les importations de l'UE, et cela n'est pas encore arrivé.
En général, l'augmentation des droits de douane et d'autres mesures protectionnistes seront affaiblies par les mesures de rétorsion et la croissance économique. La croissance du commerce mondial s'est quelque peu redressée en 2024 après s'être contractée en 2023. Les tarifs douaniers de Trump arrêteront cette reprise dans son élan.

Dans les années 1930, la tentative des États-Unis de protéger leur base industrielle avec les tarifs douaniers Smoot-Hawley n'a conduit qu'à une nouvelle contraction de la production qui a conduit à la Grande Dépression qui a englouti l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. Les grandes entreprises et leurs économistes ont condamné les mesures Smoot-Hawley et ont mené une campagne vigoureuse contre leur mise en œuvre. Henry Ford a tenté de convaincre le président Hoover d'opposer son veto à ces mesures, les qualifiant de « stupidité économique ». Des mots similaires viennent maintenant des grandes entreprises et de la finance ou du Wall Street Journal, qui a qualifié les tarifs douaniers de Trump de « guerre commerciale la plus stupide de l'histoire ».
La Grande Dépression des années 1930 n'a pas été causée par la guerre commerciale protectionniste provoquée par les États-Unis en 1930, mais les tarifs douaniers n'ont fait qu'ajouter de la force à la contraction mondiale, qui est devenue « chacun pour soi ». Entre 1929 et 1934, le commerce mondial a chuté d'environ 66 % alors que les pays du monde entier mettaient en œuvre des mesures de rétorsion commerciale.
Bien que Trump ait rompu avec les politiques néolibérales de mondialisation et de libre-échange pour « rendre sa grandeur à l'Amérique » aux dépens du reste du monde, il n'a pas abandonné les politiques néolibérales pour l'économie nationale. Les impôts des grandes entreprises et des riches seront réduits, mais il est également prévu de réduire la dette du gouvernement fédéral et de réduire les dépenses publiques (sauf pour l'armement, bien sûr). Cette année, le déficit budgétaire des États-Unis sera de près de 2 000 milliards de dollars, dont plus de la moitié sont des intérêts nets, soit à peu près la même quantité que les États-Unis dépensent pour leur armée. L'encours total de la dette publique s'élève aujourd'hui à 30,2 billions de dollars, soit 99 % du PIB. La dette américaine en pourcentage du PIB dépassera bientôt le pic de la Seconde Guerre mondiale. Le Congressional Budget Office estime que d'ici 2034, la dette du gouvernement américain dépassera 50 000 milliards de dollars, soit 122,4 % du PIB. Les États-Unis dépenseront 1,7 billion de dollars par an rien qu'en intérêts.
Trump a laissé Elon Musk prendre en charge les dépenses du gouvernement fédéral, fermer des ministères (peut-être le ministère de l'Éducation) et licencier des milliers d'employés publics pour réduire le gaspillage. Le problème pour Musk est que la plupart des déchets et des dépenses vont à la défense, mais il ne fait aucun doute qu'il continuera à réduire les services publics et même les programmes de droits comme Medicare.
Trump a l'intention de privatiser autant de gouvernement qu'il le peut. « Nous vous encourageons à trouver un emploi dans le secteur privé dès que vous le souhaitez », a déclaré le Bureau de la gestion du personnel de l'administration Trump. Selon Trump, le secteur public est improductif, mais pas le secteur financier, bien sûr. « La voie vers une plus grande prospérité américaine est d'encourager les gens à passer d'emplois à faible productivité dans le secteur public à des emplois à plus forte productivité dans le secteur privé. » Personne ne connaît ces excellents emplois. De plus, si le secteur privé cesse de croître à mesure que la guerre commerciale s'intensifie, ces emplois à plus forte productivité n'existeront jamais.
4/02/2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

De nouveaux comités de travailleurs syriens lancent des protestations coordonnées contre les licenciements massifs d’employés du gouvernement

Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes soutient les comités indépendants formés en Syrie
Des comités indépendants de travailleurs nouvellement formés en Syrie ont organisé des manifestations et des veillées dans tout le pays pour protester contre la décision du gouvernement intérimaire de licencier des milliers d'employés du secteur public, et en réponse à la flambée du coût de la vie qui plonge des millions de Syriens dans la pauvreté.
Des rassemblements ont eu lieu le 15 février à Damas, Alep, Soueïda, Lattaquié et Homs. Les manifestations font suite à une initiative lancée par l'Association des travailleurs pour le changement démocratique (WADC) appelant à la formation de comités démocratiques pacifiques de coordination du travail en réponse à l'aggravation de la crise économique, à l'érosion des droits des travailleurs et à l'impact dévastateur des politiques néolibérales sur la classe ouvrière. Le WADC appelle à la mobilisation massive des travailleurs, à l'auto-organisation démocratique et à une action unifiée pour résister aux licenciements, à la privatisation et à l'injustice économique.
Déclaration de l'Association des travailleurs pour le changement démocratique
L'Association des travailleurs pour le changement démocratique annonce la formation de comités de coordination syndicale indépendants, pacifiques et démocratiques dans toutes les provinces. Ces comités visent à unifier le mouvement syndical en cours et à venir, chaque province établissant son propre organe de coordination pour organiser des activités localement. Chaque comité comprendra des représentants de différents secteurs syndicaux du secteur public afin de s'assurer que les manifestations et les sit-in se déroulent collectivement à un moment et à un endroit unifiés dans toutes les provinces. Cet effort vise à consolider nos revendications légitimes, qui découlent des graves dommages infligés à nos emplois, à nos moyens de subsistance et à l'avenir de nos enfants en raison de décisions hâtives et injustes qui ne tiennent pas compte des intérêts du secteur public, de ses institutions, de son économie et de ses ressources humaines.
Nous sommes fiers du fait que, en tant que classe ouvrière, nous avons toujours été et continuons d'être la représentation la plus fidèle de l'unité nationale et de la souveraineté pour atteindre les objectifs suivants :
* Annuler toutes les décisions rendues par le gouvernement intérimaire concernant les licenciements, les licenciements, les suspensions, les résiliations de contrats, les congés forcés sans solde ou toute autre mesure injuste sous quelque prétexte que ce soit.
* Nous exigeons la formation de comités gouvernementaux spécialisés comprenant des représentants syndicaux pour examiner tous les dossiers d'emploi, identifier les cas de corruption et d'emplois fantômes, et renvoyer les violations devant la justice pour qu'elle rende des comptes équitablement.
* Accorder des contrats à durée indéterminée aux travailleurs annuels et saisonniers que l'ancien régime refusait de régulariser dans le cadre de son évasion de responsabilité.
* Restructurer le personnel et les ressources humaines pour s'assurer que les travailleurs ne sont pas licenciés arbitrairement tout en investissant dans les compétences et la formation continue pour améliorer l'efficacité.
* Augmenter les salaires de manière équitable pour s'aligner sur la norme minimale d'un moyen de subsistance digne.
* Veiller à ce que les retraités soient inclus dans toute augmentation de salaire et ne soient en aucun cas exclus.
* Inverser les politiques de privatisation et s'appuyer sur les capacités nationales pour relancer et réformer le secteur public en tant que pilier de l'économie nationale et de la sécurité sociale.
* Rouvrir toutes les entreprises du secteur public, en particulier les entreprises productives, et créer de nouvelles opportunités d'emploi dans divers secteurs tout en réintégrant les chômeurs.
* Les syndicats ouvriers appartiennent aux travailleurs, et eux seuls ont le droit de déterminer leur sort. Nous exigeons de nouvelles élections libres de toute ingérence ou contrôle extérieur.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes un groupe de travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que des militants syndicaux de diverses provinces syriennes. Depuis 2012, nous avons mis de l'avant notre programme de changement démocratique et nous nous sommes battus pour celui-ci malgré les sévères restrictions politiques et sécuritaires imposées par l'ancien régime. Nous avons défendu avec détermination les droits et les intérêts des travailleurs malgré toutes les tentatives de nous mettre à l'écart et de nous intimider.
Nos efforts ont gagné la confiance d'une grande partie des travailleurs des deux secteurs.
Structure organisationnelle des comités de coordination
Le comité général de coordination est basé à Damas et comprend les chefs des comités provinciaux de coordination. Chaque comité provincial comprend des représentants de la coordination des groupes syndicaux.
Par exemple :
Coordination Damas et Damas rurale : Formée à partir de l'ensemble des délégués des groupes syndicaux (électricité – santé – médias – banques – industries textiles, etc.) Coordination Homs – Coordination Daraa – Coordination Sweida – Coordination Hama – Coordination Quneitra – Coordination Alep -Coordination Tartous – Coordination Lattaquié, etc.
La structure finale de ces comités syndicaux sera annoncée une fois que tous les groupes syndicaux auront été constitués. Nous appelons tous les travailleurs à organiser leurs groupes, à choisir leurs représentants collectivement et à veiller à ce que les délégués soient qualifiés, dignes de confiance et connus pour leur intégrité, leur altruisme et leur forte conscience nationale et de classe.
Pour l'instant, la communication avec nous se limitera à Facebook Messenger via notre page (Democratic Workers' Change).
À partir du samedi 15 février 2025, nous lancerons des sit-in hebdomadaires organisés tous les samedis de 10h à 14h devant les bâtiments syndicaux de toutes les provinces. Cette mobilisation continue sera notre principale voie vers l'atteinte du plus haut niveau d'organisation et du plus grand mouvement de masse pacifique capable d'exercer son poids et de garantir ses droits légitimes. Notre objectif ultime est de devenir un partenaire actif dans la construction de la nouvelle Syrie à laquelle nous aspirons tous.
Slogans :
Le slogan principal : « Persistance, persévérance, jusqu'à ce que la décision soit renversée »
« Un, un, le peuple syrien est un »
« Un, un, les travailleurs syriens sont un »
« Les travailleurs syriens sont unis »
« Nous sommes des travailleurs de l'État, pas des travailleurs du régime »
« Un gouvernement intérimaire, pas des licenciements de travailleurs »
« Non aux licenciements arbitraires »
« Nous sommes avec la loi et contre la corruption »
« Les moyens de subsistance sont une ligne rouge »
« Nous ne sommes pas des fantômes »
« Nous sommes tous Syriens, et nous reconstruirons notre pays avec amour »
« Les retraités ont donné leur vie à ce pays – nous devons préserver leur dignité »
« Oui à la responsabilisation des fonctionnaires corrompus »
« Notre détermination est forte, nous voulons travailler »
« Oui à l'amélioration de l'efficacité au travail »
« Nous avons besoin d'une augmentation de salaire qui nous soutienne »
« Vous voulez une économie forte ? Vous pouvez compter sur nous »
« Désolé messieurs… Nos usines ne sont pas à vendre »
« Non à la privatisation, nous pouvons faire fonctionner et améliorer nos industries »
« Nos emplois sont notre dignité et le gagne-pain de nos enfants »
« Nous sommes fatigués de l'injustice et de la privation »
« Notre mouvement est national… Notre mouvement est pacifique… Nous changerons tout injuste »
« Nous exigeons la justice sociale »
« Nous ne voulons pas de mots, nous voulons des actions »
« Nous ne resterons pas à la maison, nous construirons une nouvelle nation »
Comité général de coordination pour le changement démocratique des travailleurs
MENA Solidarity Network
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump : Réagissons avant qu’il ne soit trop tard

*Unis mais désespérément seuls ! Unis dans leurs hécatombes, leurs bains de sang et leur solitude. Et unis aussi dans la même résistance acharnée pour la vie, la liberté et leur autodétermination nationale. Peuples palestinien et ukrainien martyrisés et unis…contre les mêmes bourreaux unis.
D'ailleurs, n'était-il pas l'un d'eux, qui nous avertissait, déjà le 28 décembre 2023, que « Les objectifs déclarés d'Israël dans son opération en cours contre les militants du Hamas à Gaza semblent presque identiques à ceux de Moscou dans sa campagne contre le gouvernement ukrainien” ? (1)*
Cette phrase d'il y a un an, aurait dû nous préparer pour affronter les malheurs actuels. D'autant plus que celui qui l'avait prononcé n'est pas n'importe qui. C'est *Serguei Lavrov*, bras droit et éternel ministre des Affaires étrangères de M. Poutine. Un M. Lavrov qui s'était même empressé de préciser que les objectifs de Netanyahou à Gaza « *semblent similaires à la "démilitarisation" et à la "dénazification", que Moscou poursuit en Ukraine depuis le lancement de son offensive en février 2022 » ! *En somme, mêmes génocides et mêmes génocidaires…
Malheureusement, personne n'a prêté la moindre attention à ces affirmations de M. Lavrov, bien qu'il les a faites au cours d'un grand interview accordé aux très officielles agences Tass et Novosty et bien que cet interviewfigurait longtemps en toute première page du site du ministère russe des Affaires Étrangères ! Comme on pouvait s'en attendre, le silence assourdissant qui les a toujours entourées était dû au fait que ceux qui soutiennent les crimes de M. Netanyahou à Gaza n'aiment pas être associés aux crimes de M. Poutine en Ukraine, et ceux qui soutiennent les crimes de M. Poutine en Ukraine n'aiment pas être associés aux crimes de M. Netanyahou à Gaza. En d'autres termes, une alliance pas tellement contre nature entre tous ceux qui avaient intérêt à passer sous silence des vérités qui ne pouvaient que mettre à nu leur hypocrisie…
Mais, force est d'admettre que quand nous écrivions qu'en affirmant *« que la Russie ne fait rien de plus en Ukraine qu'Israël à Gaza* », M. Lavrov *« s'adressait d'abord a l'establishment américain… essayant de lui faire comprendre que la Russie n'est pas un adversaire mais plutôt un ami, les deux ayant des intérêts communs »,* nous ne pouvions pas imaginer qu'un président des Etats-Unis traduirait en actes ces paroles de M. Lavrov seulement un an plus tard ! Et pourtant c'est exactement ce qu'est en train de faire actuellement M. Trump quand il soutient -avec un zèle qui fait froid dans le dos les guerres génocidaires contre les peuples ukrainien et palestinien des criminels qui s'appellent Netanyahou et Poutine…
Toutefois, l'actualité brûlante n'éclaire pas rétroactivement seulement ces déclarations tonitruantes de M. Lavrov. Elle éclaire aussi plusieurs autres dues à M.Poutine lui-même. Comme par exemple celle, ahurissante et « incompréhensible » quand il l'a faite en février 2024, que c'était la Pologne qui avait… contraint l'Allemagne de Hitler à l'attaquer, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale ! A première vue bizarre et « incompréhensible », cette affirmation de M. Poutine devient compréhensible quand on la lit dans son entièreté à la lumière de la plus brulante actualité des derniers jours : « *les Polonais n'avaient pas cédé le corridor de Dantzig à l'Allemagne, et ils sont allés trop loin, poussant Hitler à déclencher la Deuxième Guerre mondiale en les attaquant. Pourquoi est-ce contre la Pologne que la guerre a commencé, le 1er septembre 1939 ? La Pologne s'est révélée intransigeante, et Hitler n'a eu d'autre choix que de commencer à mettre en œuvre ses plans avec la Pologne » ! (2)*
En réalité, ce que M. Poutine voulait nous dire en réécrivant ainsi l'histoire de la Seconde guerre mondiale, c'est que l'Ukraine actuelle envahie par l'armée de M. Poutine ressemble comme deux gouttes d'eau à la Pologne de 1938 envahie par la Wehrmacht de M. Hitler. Et que ces deux pays sont responsables des agressions militaires qu'ils ont subies, car ils les ont provoquées en refusant de céder devant les prétentions territoriales et autres de leurs envahisseurs ! Alors, ce n'est pas un hasard que le maître du Kremlin a prononcé ces monstrueuses énormités au cours du grand interview qu'il a accordé à Tucker Carlson, étoile de la chaîne Fox news, très proche de M. Trump et donc, tout indiqué pour faire connaître ces affirmations de M. Poutine aux milieux d'extrême droite américains lesquels d'ailleurs… les partagent.
De nouveau, force est de constater que ce positionnement cynique de M. Poutine en faveur du droit du plus fort, a fait mouche auprès de l'extrême droite américaine. La preuve en est qu'une fois réinstallé à la Maison Blanche, M. Trump s'est empressé non seulement de reprendre tous les « arguments » du président russe en faveur de son invasion de l'Ukraine, mais aussi de profiter de la situation pour… participer activement au pillage et à la destruction de l'Ukraine aux côtés de son complice russe !
Alors, quelle est la nature de cette association de Trump avec Poutine ? S'agit-il d'une alliance occasionnelle ou bien d'affinités électives beaucoup plus solides ? De nouveau, c'est Poutine qui a donné le premier un début de réponse quand il s'est adressé longuement à ses compatriotes le jour de l'invasion de l'Ukraine par son armée. Et bien que systématiquement « oubliés » par ses amis et ennemis de droite comme de gauche, ses diatribes anticommunistes de ce jour fatidique ainsi que ses violentes attaques contre la Révolution d'Octobre 1917, les Bolcheviks et surtout, contre Lénine en personne,(3) éclairent au-delà de tout doute, tant ses références politiques et idéologiques que la nature de son alliance avec Trump.
En somme, *ce qui unit actuellement Poutine à Trump c'est la communauté de leurs références idéologiques, tout ce qui les rend réactionnaires, obscurantistes, ennemis jurés des faibles, des pauvres, des minorités, des socialistes, des féministes, des écologistes, des travailleurs, des syndicats ouvriers. C'est leur adoration de la violence brute, du virilisme et de l'autoritarisme le plus exacerbé, des milliardaires, des oligarques et des dictateurs, c'est leur haine viscérale de la démocratie.*
Alors, pas de doute, Trump, Poutine, Netanyahou, Musk, Milei et leurs amis de par le monde, ne représentent pas une version simplement plus dure du néolibéralisme, comme continuent de le prétendre certains irresponsables. Ils représentent un danger mortel pour nous tous, pour l'humanité, pour la démocratie et la planète. Un danger analogue à celui que représentait le fascisme et le nazisme il y a 80 ans. Ils représentent l'Internationale Brune de notre temps. Réagissons donc tous ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Car cette fois il n'y aura pas de seconde chance…
*Notes*
*1. **Sergueï Lavrov : "Israël poursuit des objectifs similaires à
ceux de la Russie » ! :*
https://www.pressegauche.org/Serguei-Lavrov-ministre-russe-des-affaires-etrangeres-Israel-poursuit-des
*2. **Pourquoi les partisans de Poutine le censurent
systématiquement ? :* https://inprecor.fr/node/3896
*3. **Poutine : « Lénine est l'auteur de l'Ukraine d'aujourd'hui » ou
comment tout ça est la faute à … Lénine et aux bolcheviks : *tps ://
lanticapitaliste.org/opinions/international/poutine-lenine-est-lauteur-de-lukraine-daujourdhui-ou-comment-tout-ca-est-la
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La mauvaise protection des travailleurs et des travailleuses fait obstacle à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne

Si l'Ukraine veut espérer adhérer à l'Union européenne, les droits du travail doivent être une priorité beaucoup plus importante. C'est également nécessaire pour renforcer la résilience de la société.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/15/la-mauvaise-protection-des-travailleurs-et-des-travailleuses-fait-obstacle-a-ladhesion-de-lukraine-a-lunion-europeenne-communique-de-sotsialnyi-rukh/
Le rapport d'étape 2024 de la Commission européenne sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE a fait l'effet d'une douche froide pour le gouvernement ukrainien. Parmi les nombreuses exigences auxquelles l'Ukraine doit répondre, le domaine du marché social et du travail ressort comme critique par rapport aux conditions d'adhésion à l'UE.
L'Ukraine obtient même la plus mauvaise note dans ce domaine parmi les dix pays candidats, juste derrière le Kosovo. Ce mauvais classement révèle également les années de négligence systématique dans le pays, antérieures à l'invasion russe et liées au démantèlement de la réglementation. Mais aussi à la marginalisation des syndicats par les gouvernements successifs.
En conséquence, la détérioration des conditions de vie des travailleurs et des travailleuses ukrainiennes est aujourd'hui devenue un obstacle direct aux perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
Le dialogue social : un idéal oublié
Au sein de l'Union européenne, le « dialogue social » – ou les négociations entre les partenaires sociaux – est désormais une institution bien établie et une image de la façon dont les désaccords peuvent être résolus par la démocratie, la négociation et la reconnaissance mutuelle entre les employeurs, les syndicats et les gouvernements.
En Ukraine, le principe du dialogue social a été marginalisé. Le Conseil social et économique tripartite national officiel (NTSEC) – qui était censé être le moteur des réformes coopératives du marché du travail – est inactif depuis 2021. Sans plateforme de dialogue social fonctionnelle, les syndicats sont amenés à réagir de manière défensive aux initiatives gouvernementales au lieu de façonner de manière proactive l'élaboration des politiques.
Au niveau local, l'ébranlement de la pratique des négociations antérieures est encore plus évident. Invoquant l'état d'urgence militaire qui a suivi l'invasion, les employeurs ont été autorisés à suspendre unilatéralement les conventions collectives. De grandes entreprises comme les chemins de fer nationaux ou le plus grand producteur d'acier du pays, ArcelorMittal, n'ont pas tardé à tirer parti de cette situation.
La nouvelle législation viole des normes européennes essentielles contenues dans la Charte sociale européenne, qui garantit le droit à la négociation collective et à des salaires équitables.
L'affaiblissement du mouvement syndical est important dans la conjoncture. Le nombre de membres a chuté, avec une perte estimée à 700 000 membres depuis 2022. Ce déclin reflète la destruction des emplois, les effets de la guerre et l'affaiblissement de la capacité des syndicats à défendre les droits des travailleurs et des travailleuses.
Sécurité au travail : qui protège les travailleurs et les travailleuses ?
La guerre elle-même a porté un coup majeur à la sécurité des travailleurs et des travailleuses, mais cela ne change rien au fait que la protection du travail dans le pays était déjà insuffisante. Le système en vigueur se concentre étroitement sur les mesures réactives, alors que dans l'Union européenne, par exemple, la prévention joue un rôle beaucoup plus important.
Le projet de nouvelle loi sur la sécurité au travail du gouvernement ukrainien (projet de loi n°10147) a été vivement critiqué pour son approche néolibérale. Il accorde aux employeurs beaucoup plus d'autonomie et de liberté, tout en supprimant des garanties pour les travailleurs, et les travailleuses, notamment en réduisant le financement des mesures de sécurité et de protection lors des travaux dangereux.
Malgré une certaine inspiration des directives européennes, le projet de loi ne respecte pas les normes minimales – notamment en ce qui concerne le travail intérimaire et l'accès aux données de sécurité à des fins de prévention.
Avec plus de 200 décès liés au travail dans l'industrie en 2023 – dont la moitié directement liée à la guerre – la nécessité d'une réforme globale est urgente. Pourtant, les propositions actuelles risquent d'affaiblir encore davantage la protection. Par rapport à la législation actuelle, elles laissent encore plus de questions à la discrétion de l'employeur. Il s'agit notamment de la contribution minimale à la santé et à la sécurité au travail, ainsi que de la fréquence à laquelle les employé·es doivent être informé·es sur les questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
Une inspection du travail en crise
La Commission européenne a identifié l'inefficacité de l'inspection du travail ukrainienne comme une lacune majeure. L'absence d'un cadre juridique clair empêche les inspecteurs et les inspectrices d'appliquer efficacement la législation du travail. La situation s'est aggravée sous l'état d'urgence, les inspections ayant été suspendues et le contrôle encore affaibli.
Suite aux pressions exercées par l'UE, certaines propositions ont été faites pour renforcer l'inspection du travail, mais encore de façon limitée. Tant que l'Ukraine ne suivra pas l'exemple d'autres pays candidats qui ont adopté des lois dédiées à l'inspection du travail, son système restera inadapté.
L'absence de mesures dissuasives contre les violations liées au travail signifie que les employeurs qui exploitent la loi continueront à le faire sans entrave. Cela compromet à la fois les droits du travail et les ambitions européennes de l'Ukraine.
Des réformes au profit des travailleurs, et des travailleurs, pas seulement de Bruxelles.
Remédier à ce type de faiblesses systémiques est loin d'être une simple formalité pour l'adhésion à l'UE. C'est une nécessité pour la stabilité et la résilience de l'Ukraine. Garantir une application rigoureuse du droit du travail, renforcer le dialogue social et améliorer l'environnement de travail sont des réformes qui profitent à l'ensemble de la société.
Les syndicats ukrainiens doivent profiter de cette occasion pour travailler avec des partenaires internationaux et affirmer leur rôle dans l'élaboration de l'avenir du marché du travail du pays. La guerre a montré que la solidarité et la justice ne sont pas seulement des idéaux à atteindre mais des outils concrets et essentiels à la survie nationale.
Le respect des droits du travail et des réformes solides renforceront non seulement les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne mais aussi sa cohésion sociale face à la poursuite de l'agression russe.
En donnant la priorité au bien-être de l'ensemble de la main-d'œuvre, l'Ukraine peut jeter les bases d'une véritable intégration européenne et montrer que les valeurs démocratiques, les droits des travailleurs et des travailleuses sont au cœur de sa future trajectoire .
Vitaly Dudin
Tribune de Vitaly Dudin, cofondateur de Sotsialnyi Rukh, pour Solidaritet, journal socialiste danois à l'occasion d'une rencontre avec l'Alliance Rouge-Vert danoise. Le syndicat ukrainien des infirmières « Sois comme Nina », invité par son homologue danois participe à cette rencontre.
https://solidaritet.dk/ringe-arbejderbeskyttelse-staar-i-vejen-for-ukrainsk-eu-medlemskab/
Traduction Deepl Pro relue ML
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
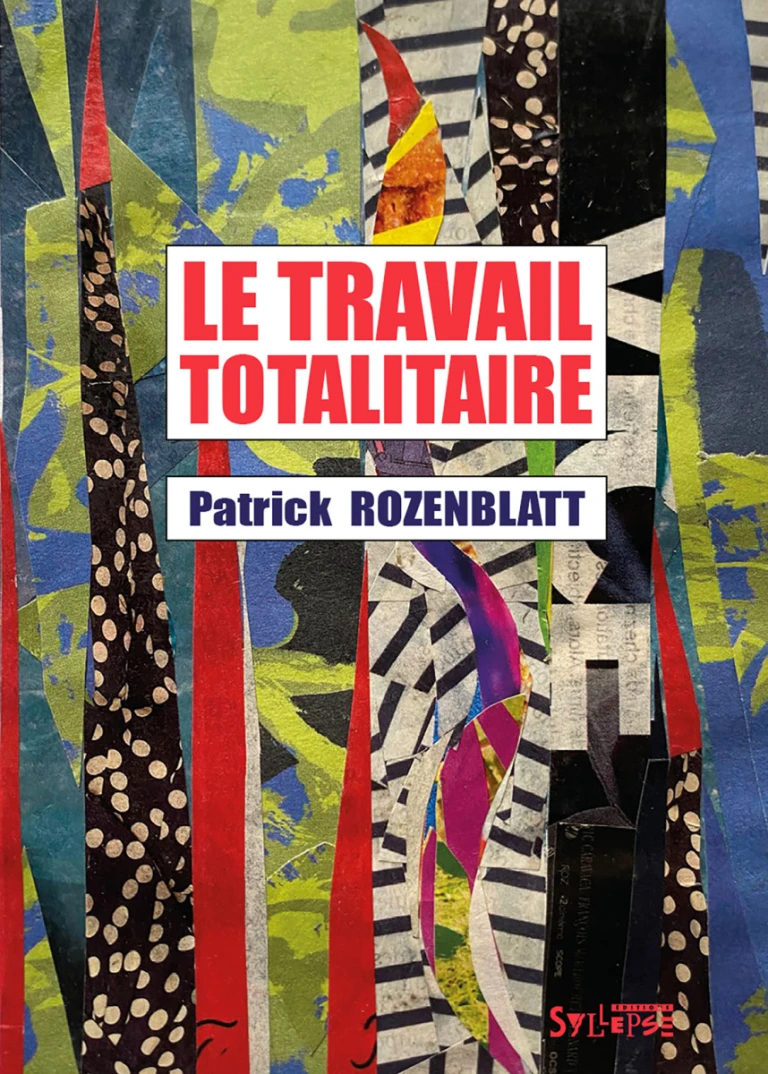
Au travail dès deux ans, les capitalistes à la fête !
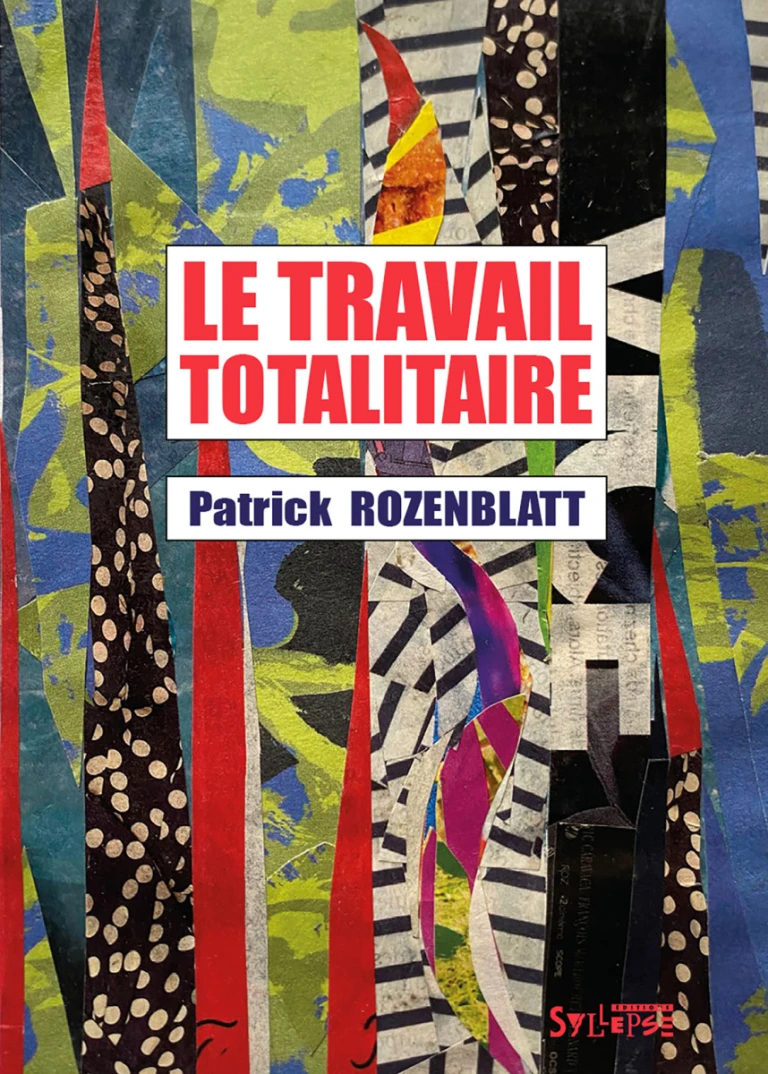
De Black Friday en Black Novembre, d'Halloween à Noël, les offres exceptionnelles de discount,à durée très limitée, explosent les yeux et les oreilles pour que nous concédions au culte des cadeaux.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/24/au-travail-des-deux-ans-les-capitalistes-a-la-fete/
Avec l'aimable autorisation des Editions Syllepse
Pour faire ses courses, le temps est incommensurable ! Trouver des idées de cadeaux neufs ou dorénavant recyclés, en fonction de l'état des porte-monnaies et des valeurs écologiques (345 euros en moyenne e 2023, selon Le Sofinscope-baromètre OpinionWay pour Sofinco), aspire une énergie démesurée jusqu'à la trêve des confiseurs, entre Noël et jour de l'An1 ! L'illusion peut ainsi exister qu'en suspendant l'activité de travail, pour une majorité de la population, cette trêve prolongerait laïquement les « trewa dei », trêve de Dieu par laquelle, au Moyen-Âge, « l'Église limitait les guerres privées en interdisant toute hostilité entre seigneurs du mercredi soir au lundi matin et à certaines époques de l'année (Avent, Noël, Carême, Pâques)2 ». Elle serait le symbole d'un temps arraché aux capitalistes, un temps libre pour échapper à l'emprise permanente du travail subordonné !
Trêve d'illusions, ce temps des fêtes est surtout un temps contraint où s'offrent les cadeaux, où l'on va aussi les échanger, dans un continuum commercial frénétique. L'idéologie capitaliste l'entretient par un flot publicitaire hypnotisant qui dépasse de près d'un tiers son volume du reste de l'année. Les enfants perçoivent précocement tout le paradoxe de l'expression « trêve des confiseurs », car c'est précisément le moment où ils ont plus de chance qu'à d'autres d'accéder aux produits marchands qu'ils soient cadeaux ou sucreries. Moment pour leur offrir les joies de l'insouciance ou moment pour les intégrer brutalement dans le monde impitoyable du travail à perpétuité ?
En relation directe avec cette interrogation, on ne peut qu'être admiratif ou horrifié par un des jeux mis sur le marché de Noël en novembre 2023. Dès deux ans, la marque Infini Fun invite les parents à offrir à leurs enfants, pour moins de 40 euros et payable en trois fois, un kit de télétravail3. La publicité le présente en des termes qui invalident toute ambiguïté :
Comme papa et maman : je passe des appels avec mon téléphone, je participe à des vidéoconférences avec mon ordi et mon casque […], cinq modes de jeu sur l'ordinateur : télétravail (imitation), découverte et trois modes quiz sur les lettres, les chiffres et les couleurs. […] Le téléphone offre dix-huit zones tactiles qui déclenchent de nombreux effets sonores et musiques. Il me rappelle automatiquement […]. Le casque (factice) me donne l'air encore plus professionnel4.
Vive le travail et dès les fêtes ! Les parents sont dans l'ensemble ravis, leurs commentaires peuvent mêmes être élogieux. Reviennent le plus des formules comme « Super imitation », « Super ludique » qui disent l'essentiel d'une adhésion à socialiser les enfants aux idéaux de la logique compétence dès leur sortie du berceau5. Quelle progression car, après recherche, ce genre de dressage aux bons comportements, qui ont notamment pris leur essor durant le confinement imposé lors de la pandémie du Covid 19, s'adressaient plutôt aux enfants sachant déjà lire et écrire. À l'époque le site MoneyVox proposait plusieurs supports ludiques et pédagogiques afin « d'apprendre aux enfants à gérer leur argent de poche et initier vos adolescents à l'économie et la finance ». Il recommandait par exemple pour les petits de 6 à 10 ans une application sur mobile et tablette, de l'association Crésus qui vient en aide aux personnes en difficulté, dont l'objectif principal est de « montrer à l'enfant que l'argent n'est pas illimité, qu'il se gagne et se dépense ». Le but du jeu est d'organiser avec un budget limité la plus belle fête d'anniversaire « du choix du lieu en passant par la préparation du gâteau ». Pour y parvenir, l'enfant doit mobiliser « des compétences de lecture, de calcul mental simple, de stratégie et de planification ». En prime, le jeu sensibilise « à l'alimentation saine, à l'entraide, à la solidarité ». Quel beau programme !
C'est une société qui se croit civilisée car elle peut afficher des lois qui, littéralement, laissent à penser qu'à travers un long processus, et sans plus de conflictualité, elle a établi un monde permettant la coexistence harmonieuse et humaniste d'un temps pour travailler et d'un temps libre pour le bien-être de toute sa population, des plus jeunes aux plus âgé·es. Pour s'en assurer, il suffit d'aller voir sur le site du gouvernement de la République et de lire, y compris entre les lignes pour les non-dits, ce qu'il présente, à partir de la loi du 22 mars 1841, sur l'interdiction du travail des enfants. Car au commencement, cette présentation le reconnaît, il y a eu un capitalisme, sans morale ni limites, exploitant dans le cadre d'un « nouvel esclavage6 » toutes les forces vives tout en les épuisant prématurément :
En France comme en Angleterre, vers 1840-1850, les enfants de moins de 14 ans représentent 15 à 20 % de la main-d'œuvre des manufactures et des usines. Le travail des enfants n'est pourtant pas en soi une nouveauté, il est usuel dans l'agriculture comme dans l'artisanat. Mais avec les nouvelles conditions de travail engendrées par l'industrie textile mécanisée, il s'apparente à un nouvel esclavage7.
Le travail détruit à petit feu et détruit tout court, à tel point que :
Médecins, hygiénistes, philanthropes, réformateurs sociaux et industriels progressistes soulignent les effets mortifères pour les enfants de journées de 14 heures passées sous les métiers textiles : déformations physiques, rachitisme, tuberculose… La mortalité est également élevée : à Mulhouse, entre 1812 et 1827, parallèlement à la croissance de l'industrie, la durée de vie moyenne diminue de quatre ans et la moitié des enfants n'atteignent pas l'âge de 10 ans8.
L'humanité a pourtant bien du mal à imposer un droit de vivre puisqu'il faudra, accessoirement, ce que le site gouvernemental oublie de mentionner, une révolution en 1840, et les Communes des années 1870, pour voir promulguer les lois de 1841 et de 1874 qui interdisent respectivement l'embauche avant 8 ans, puis avant 12 ans. Malgré cet effacement de la mobilisation des esclaves concerné·es, histoire de ne pas dire que l'action ouvrière et syndicale n'a servi à rien, la note expose a contrario crûment le peu d'impact de la législation concernant la mise au travail car : « Rareté des inspections, amendes insuffisantes, puissance des intérêts économiques en jeu, accord tacite des parents les plus pauvres9. »
Au final, à l'horizon de la Première Guerre mondiale, la réduction de ce fléau du travail des enfants sera peu résorbé dans l'industrie, et donc loin d'être effective ailleurs, que par « les progrès techniques et la nécessité de former les ouvriers, couplés aux nouvelles lois scolaires10 ».
On retrouve ici le recours à une logique déterministe du progrès technique, comme seule autorité acceptable pour juguler un esprit du capitalisme totalement insensible à l'irrationalité protectrice de droits humains universels.
En conséquence, si la mise au travail des enfants a reculé, si le temps de scolarisation s'est allongé, si l'idée d'un temps libre légal s'est glissée dans les représentations liées à la vie de l'enfance à la retraite, c'est fondamentalement parce que les configurations productives dans lesquelles sont incorporées en permanence des innovations technologiques modèlent des formes de division sociale du travail qui s'en accommodent.
Dès lors, si certains ont cru à un cheminement de l'histoire permettant d'établir, plus ou moins avec des luttes, une réduction régulière du temps de travail et une augmentation tout autant régulière du temps libre et choisi, peut-être ont-ils omis cette capacité de l'univers capitalistique et des penseurs à son service, à transformer des représentations mythiques et à bouleverser les croyances sur le sens des progrès acquis ?
Si l'on observe ce qui se passe aux États-Unis, quelques signes corroborent le bien-fondé d'une telle interrogation. Dans un article paru en juillet 2023, Steve Fraser analyse le retour en force du travail des enfants soutenu par la révision de législations protectrices :
Au cours des deux dernières années, quatorze États ont présenté ou adopté des lois annulant les réglementations qui régissaient le temps de travail des enfants, réduisant les restrictions sur les travaux dangereux et légalisant les salaires minimums pour les jeunes à partir de 14 ans. Prenez une grande respiration et réfléchissez à ce point : le nombre d'enfants au travail aux États-Unis a augmenté de 37% entre 2015 et 202211.
Sommes-nous très loin de suivre la même voie ? Le site officiel de l'administration française invite plutôt à le penser, ne serait-ce que lorsqu'il énonce les possibilités offertes légalement pour qu'un enfant ou un adolescent puisse travailler avant 14 ans « dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, du mannequinat ou encore dans une entreprise ou une association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo12 ». La dernière catégorie d'activités ajoutée en 2020 devrait mettre particulièrement « la puce à l'oreille », elle a d'ailleurs depuis été étendue aux enfants « youtubeurs » ! Elle signale que depuis l'incorporation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans les process de production, depuis les années 1990 et surtout depuis la diffusion massive des smartphones et des tablettes dans les années 2010, les vieilles catégories de représentations de l'exploitation du travail des enfants, notamment celles du travail industriel mutent vers d'autres lieux.
Nos catégories de penser et d'agir pour leur protection sont-elles encore pertinentes et que nous disent-elles aussi plus généralement sur les mutations profondes de l'exploitation du travail ? Ne voit-on pas les capacités enfantines, dès le plus jeune âge à se saisir des objets connectés et à converser avec les logiciels ? Pourquoi, dès lors, ne pas repenser la totalité des temps de la vie, raccourcir l'enfance comme le temps de retraite, et puisqu'ils passent par l'usage des mêmes objets connectés et que leurs pratiques s'entremêlent, arrêter de distinguer, pour toutes et tous, temps de travail et temps libre ? L'intransigeance du gouvernement sur l'augmentation de l'âge légal du départ à la retraite n'est-elle pas directement liée à cette représentation ?
Indéniablement, cet air du temps souffle au quotidien une petite musique qui porte des messages ayant vocation à orienter et à contraindre nos pensées et nos actes. Il s'insinue, via de multiples supports construits pour encadrer notre conscience du monde. Certains d'entre eux passent par des supports que nous choisissons comme la radio, la télévision, les journaux ou encore les réseaux numériques. D'autres sont plutôt imposés au travail, dans les transports jusque dans la rue où la publicité s'invite pour nous influencer. L'imbrication des deux se fait désormais via les mises en scènes et l'hypervalorisation de la parole des expert·es et des influenceur·euses qui vendent des « one best way » pour penser le monde, y vivre, voire y mourir. Faiseurs d'opinions, ils tentent d'imposer de bons comportements, n'induisent nulle mise en débat collectif mais appellent tout au contraire au mieux à commenter, au pire à déclarer qu'on les aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie !
Le phénomène n'est pas vraiment récent, Paul Lazarsfeld, sociologue américain, montrait dès 1940 comment les « leaders d'opinion » influencent les représentations politiques. Injonctions à croire, prêts à penser, produits à acheter, comportements à adopter, tenues à afficher, loisirs à ne pas manquer, lieux touristiques à voir absolument, cette liste non exhaustive se renouvelle quotidiennement faite d'imprécations culpabilisantes qui nous interpellent et segmentent nos réponses de la tête aux pieds. Le niveau de pollution atteint et l'emprise avilissante produite sur la capacité humaine à produire une pensée d'ensemble sont aussi insidieux que la diffusion des particules fines dans l'air respiré. Se rendre compte de cette aliénation béate et mortifère dans laquelle une culture mosaïque13 fait glisser l'humanité, se mettre en état de résister à toutes les pauvres féeries marchandes, se mettre en situation a contrario de produire, modestement mais avec ambition, une pensée démocratique, écologique et sociale, cela demande que chacun·e dispose, pour résister, d'un important temps libre de non-travail, arme incontournable mais qui fait cruellement défaut quand on examine avec précision ce qu'il en est au-delà des images d'Épinal.
Loin des discours idéologiques sur la fin du travail ou sur la société du temps libre et choisi, la thèse de ce livre et son ambition sont donc de rendre compte du processus en cours d'asservissement de la vie quotidienne et du temps libre aux rapports de production, de distribution et de consommation que cherche à imposer, au 21e siècle, la logique de mise en valeur du capital. Ce processus progresse, en France, sous l'étendard de la « Refondation sociale » soulevé par le CNPF-Medef dès le tournant du siècle. Depuis, il ne cesse de se légitimer, avec l'appui inconditionnel des forces et institutions d'État toutes mobilisées pour en asseoir l'hégémonie.
L'envahissement de nos vies par la logique d'une mise au travail forcé, aux seules conditions du Capital, s'est peu à peu instillé à travers la production de mythes et la propagation de croyances qui ont été patiemment inventées, puis médiatisées, afin de contraindre nos consciences et nos imaginations. Malgré luttes et résistances, elles se sont progressivement imposées comme autant d'avatars visant à édulcorer, afin de la faire accepter, la violence des rapports sociaux subordonnés.
Des mythes pour contraindre imaginations et consciences et faire consentir à l'esclavage moderne
Mythe de la compétence productrice d'une valorisation rationnelle du travail et de l'obtention d'un salaire décent ; mythe de la négociation, dite « entre partenaires sociaux », comme support à l'écriture des bases d'une société policée ; mythe d'un temps libre permettant d'en jouir ; mythe d'un habitat à soi assurant de vivre en toute intimité une vie sentimentale à l'abri des intrusions ; mythe d'un monde-village facile d'accès pour y passer des vacances.
Chacun de ces mythes, qui selon les moments, occupe plus ou moins le devant de la scène sociale et politique, participe à resserrer l'étau, en masquant l'exploitation et l'assujettissement de la force de travail dans les rapports sociaux de production, de distribution et de consommation. L'objectif commun de la propagation de ces mythes consiste à vendre le mirage d'un capitalisme émancipateur et pourvoyeur de bien-être. Le seul régime de production capable, comme l'ont écrit en 2000 les idéologues patronaux de la « Refondation sociale », d'être le gouvernement, non démocratique, d'une société moderne. La seule à leur convenance !
Ces mythes, dont certains trouvent leurs origines dans les trente dernières années du 20e siècle, contribuent à entretenir, en masquant les rugosités désastreuses de la réalité quotidienne de millions de travailleur·euses pauvres et de pauvres tout court, la réussite miraculeuse du capitalisme comme seul régime heureux de production, de distribution et de consommation.
En combinant prodigieusement les progrès de la science et de la technique, les beautés d'une éducation comportementale épanouie et les plaisirs de l'engagement humain dans le travail en mission, devenu le quasi seul vecteur admis, comme dans une religion, de la construction d'une identité socialement acceptable et légitime, ses laudateurs, grassement payés pour ce faire, ressassent comme des prédicateurs que l'ensemble de la population, si elle accepte de se discipliner, pourra en récolter les offrandes et en propager le ruissellement.
Côté scène, l'étalement de chiffres et une propagande médiatique à flux continu ne cessent d'en affirmer les bienfaits souriants, alors que côté cour, les exploiteurs du travail, sous toutes les formes possibles d'atomisation, font exploser sans vergogne, l'une après l'autre, les quelques représentations et droits restants : protection de la mise au travail (précarité contractuelle, ubérisation et travail gratuit, pauvreté), surveillance du temps de travail et du temps de repos (horaires flexibles, repos atomisés, retraite repoussée), séparation entre vie professionnelle et vie privée (télétravail, travail chez soi, travail anywhere).
Dans cette longue marche mortifère, la grande force du capitalisme et de ses servants, avec la complicité des institutions d'État, est de conserver un cadre de justification et d'échanges en apparence policé. Les concepts d'emploi, de rémunération, de temps de travail et de temps libre, de retraite, d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, voire de concertation et de négociation, continuent à s'entendre alors qu'ils sont de plus en plus obsolètes et creux au regard des mutations déjà pleinement accomplies des formes d'exploitation du travail. Ils parviennent ainsi à circonvenir une pensée politique d'opposition et les revendications syndicales dans une seule logique de riposte corrective dans laquelle les logiques d'émancipation se dissolvent, voire tendent à s'éteindre, comme celle d'un droit fondamental, indispensable et inaliénable à l'oisiveté. Comme l'écrivait Bertrand Russel en conclusion de son remarquable essai :
Dans un monde où personne n'est contraint de travailler plus de quatre heures par jour […], les hommes et les femmes ordinaires, deviendront plus enclins à la bienveillance qu'à la persécution et à la suspicion. Le goût pour la guerre disparaîtra, en partie pour la raison susdite, mais aussi parce que celle-ci exigera de tous un travail long et acharné. La bonté est, de toutes les qualités morales, celle dont le monde a le plus besoin, or la bonté est le produit de l'aisance et de la sécurité, non d'une vie de galériens. Les méthodes de production modernes nous ont donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans l'aisance et la sécurité. Nous avons choisi, à la place, le surmenage pour les uns et la misère pour les autres : en cela, nous nous sommes montrés bien bêtes, mais il n'y a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise indéfiniment
14.
Faute de déconstruire les concepts de l'esclavage moderne, il devient impossible de concevoir et de proposer, à ceux et celles qui ne vivent que de leur travail, une vision unifiante et alternative en imaginant des représentations et revendications pour sortir de ces cadres et formes d'exploitation idéologiques et matérielles.
À l'ère de l'automation, de l'informatisation, de la numérisation généralisée et mondialisée, alors même que la mise au travail forcé et le plus souvent gratuite, tend à s'étendre à l'ensemble de la vie quotidienne15, est-il encore sensé de batailler, dans les formes d'un dialogue social bien limité, en ne critiquant que la partie visible de l'exploitation capitalistique du travail humain ?
En effet, comme dans une liste à la Pérec ou à la Prévert, on peut schématiquement pointer quelques cruelles réalités de cette implacable « refondation ».
* Un emploi sous des formes mitées qui ne couvre et ne couvrira bientôt qu'une partie marginale du travail productif et social, tout autant que la menace du travail forcé ira en s'accroissant, voire la mutation engagée du RSA (Revenu de solidarité active).
* Une rémunération qui s'éloigne de l'illusion contractuelle, liant salaire direct et indirect (cotisations) à des objectifs constants et durables, qui encourage avant tout la productivité jusqu'à l'usure du salarié·e et/ou du faux indépendant, et encense la démultiplication des primes individualisées, tel un retour au plaisir bourgeois, et religieux, de donner selon son bon vouloir un « pourboire ».
* Un temps de travail qui ne borne plus à l'antique pointeuse, ni même aux badgeuses individualisées, mais qui se propage du matin au soir, bien au-delà des seul·es télétravailleur·euses dans leur domicile « googlisé ». Il s'immisce, pour toutes et tous, dans les transports et en tous lieux où la connexion est possible selon le slogan managérial miraculeux « Anytime, Anywhere, Any device16 ». Un temps de travail amplifié démesurément sans que personne ne le mesure encore quantitativement comme un temps assujetti à l'organisation du travail que maîtrisent seuls les employeurs,
* Une mise au travail gratuite, via les outils de numérisation (NTIC), qui s'est imposée et s'enracine de manière ludique avec l'apprentissage précoce des enfants puis des étudiant·es, bien avant toute forme d'emploi salarial. Elle s'étend, notamment au domicile mais plus généralement dans nos déplacements nomades, à toutes les catégories de populations, contredisant d'une part l'approche distinguant les concepts de travail productif et reproductif (femmes, enfants et retraités) et en rendant absurde la distinction réifiante d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle.
On a donc une tendance générale à l'augmentation de l'activité sous des formes salariales, reconnues ou travesties, dont seule une partie est considérée et prise en compte sous l'aspect monétaire. Elle se double d'une imprécation à un engagement accru et d'une mobilisation quotidienne épuisante à répondre aux attentes des donneurs d'ordre que l'on soit en emploi, en chômage ou catégorisé encore comme inactif. Ce beau programme s'accompagne d'une petite musique dansante qui vous enjoint de travailler agilement toujours plus, au quotidien et le plus tard possible, puisqu'il est gravé dans le marbre des chiffres, comme une tendance lourde et irréfutable, affirmant que nous devrions vivre plus vieux ! En attendant, l'imperium n'a de cesse d'exceptionnaliser le quotidien du droit du travail. Un projet de décret prévoit, par exemple, de permettre à titre temporaire, et sans compensations, de recourir à la dérogation au repos hebdomadaire pendant le déroulement des Jeux olympiques de Paris-2024 où « le marathon ce ne sera pas uniquement pour les athlètes17 ».
L'ensemble de ces éléments factuels matérialise une représentation de la société où vous devez être conforme (look et relook) et où le temps et l'espace à soi se rétrécit, comme dans L'écume des jours de Boris Vian. C'est très justement ce que le capital ne cesse d'organiser afin de vous contraindre à ne pouvoir vous refuser à ses avances douteuses, qu'elles touchent aux modes de produire, de distribuer ou de consommer. Il vous faut donner, donner et donner encore plus et comme l'affirme, en juillet 2020, Élisabeth Borne, alors première ministre, le patronat ne doit surtout pas, en retour, être assujetti à vous le rendre ni par de nouveaux droits ni par l'impôt. Il est seulement invité à vous aider, à vous donner ou à vous redistribuer, selon son bon vouloir, tel jour une prime, le lendemain une ristourne sur le prix de tel ou tel bien et le surlendemain peut-être une augmentation de salaire. Et n'oubliez surtout pas d'apprendre à lui dire merci !
En quelques mots, tout est dit pour ceux qui gardaient quelques illusions : notre démocratie capitaliste bourgeoise ne tolère et ne concède qu'une égalité formelle dans les urnes et la refuse totalement dans les rapports de travail, ou devrions-nous dire plus précisément dans la mise en œuvre des formes d'exploitation du travail. Fin totale des illusions racornies sur « la citoyenneté dans l'entreprise » promulguée dans le préambule des lois Auroux (1983), mais révérence et enthousiasme devant « l 'entreprise citoyenne », dont la jouissance est destinée aux seuls propriétaires du capital.
Le retour aux rapports fondamentaux de l'exploitation comme aux beaux temps du 19e siècle est ainsi pleinement acté : le travail appartient à celui qui le conçoit et le paie, et celui qui l'accomplit lui doit tout et se doit de lui concéder toute l'énergie et le temps qu'on lui réclame dans le quotidien, comme tout au long de sa vie. Le retour à ces fondamentaux renvoie à l'expression de l'enjeu essentiel, si ce n'est unique pour celui qui ne vit pas du capital : être humain à part entière ou être chose manipulable selon les besoins, c'est-à-dire être un esclave moderne. Pierre Naville dans le dernier chapitre de De l'aliénation à la jouissance (1954) exposait précisément le processus à l'œuvre :
L'esclave moderne ne l'est pas juridiquement, la loi l'a fait libre, mais sans propriété : donc contraint de travailler pour autrui, esclave du système. D'où ce conflit : il ne doit pas seulement subir sa condition mais l'accepter. Le système veut son « aveu » et pour l'obtenir, il brise en l'homme ce quelque chose qui se rebelle, et qui tient à sa personne. Seul le temps de travail y parvient, pourvu qu'il soit assez long et bien contrôlé. Le travail est une contrainte ; si cette contrainte est assez persévérante, si l'homme ne peut y échapper assez longtemps, il finit par s'y identifier dans la narcose (sommeil artificiel) et la détresse18.
Un affrontement essentiel et permanent sur le sens de la vie
On est ici au cœur de l'affrontement essentiel qui traverse tant les regards et controverses théoriques que les interrogations contradictoires que tout un chacun rencontre quand il lui reste un peu de temps pour s'interroger sur ce qu'il vit dans son quotidien. Dans cette quête de sens, Jean-Marie Vincent explicite théoriquement que « le rapport de travail est un rapport de rapports sociaux multiples qui marquent fortement de leur empreinte ceux qui travaillent19 ». De plus, il souligne, en s'appuyant sur l'apport de Gerhart Brandt, que le travail n'est pas seulement soumission au commandement du Capital mais plus fondamentalement soumission à des processus abstraits de socialisation (soumission au travail abstrait, à la technologie, aux formes de l'échange marchand)20. L'ensemble de cette combinatoire enferme « les salarié·es assujetti·es à la production de valeurs et de profits par toute une machinerie sociale qui n'est pas faite seulement de dispositifs d'oppression et de contrôle mais aussi de dispositifs d'exploitation et d'appropriation de l'agir ».
Il est ainsi subordonné même dans le temps du non-travail, ce temps défini comme celui devant nous permettre d'inventer et de vivre des rapports s'émancipant, peu à peu, de la domination des logiques capitalistiques de marchandisation de la vie, matérielle et sentimentale, pour nous préparer à nous en évader pleinement dans un processus permanent où le travail perdrait sa place hégémonique dans la vie quotidienne. C'est pourquoi nous partageons toujours son invitation à partir d'une critique du « mouvement ouvrier qui a poussé le plus loin la sacralisation du travail sous la forme paradoxale d'une mythologie laïque ».
Cette approche critique prolonge celle de Pierre Naville quand il propose que le processus de réduction du temps d'assujettissement au travail s'attaque à la transformation des contenus et des relations qui existent entre travail et non-travail pour produire dialectiquement leur conjointe métamorphose. Les rapports de travail peuvent alors se transformer en faisant reculer le plus rapidement possible les processus de domination, d'exploitation et de précarisation généralisée qui empêchent de penser ensemble les finalités de la production des biens et des services et leurs sens dans et pour la société. De même que les rapports de non-travail, dans toutes les relations de société et de proximité où ils se nouent, peuvent permettre de cultiver des rapports égalitaires de genre et rendre plus écologique nos vies quotidiennes.
Cette approche totalement contradictoire à celle de la « Refondation sociale » conçue par le Capital et ses servants permet de dépasser de fausses oppositions et de situer la totalité des implications de ce moment actuel de la lutte de classes qui couvre la période de 1968 à nos jours. Elle s'inaugure dans la lutte des Lip, conflit autogestionnaire et analyseur de l'héritage de Mai 68 pour les luttes d'émancipation, et notamment celle pour le contrôle de la production et celle pour la réduction massive du temps de travail qui s'affiche alors autour d'un radical « Travailler moins pour vivre mieux ». Cette lutte des Lip, bientôt rejointe par plusieurs dizaines d'autres, ébauche des pratiques et donne à voir d'autres formes possibles de rapports productifs et sociaux qui déchaînera et mobilisera contre elles, dans une totale unité, les forces archaïques et modernistes du capital et de l'État.
Elle effraie alors d'autant plus qu'elle démontre en pratique que les damné·es de la terre ont l'imagination et les capacités d'élaborer et de mettre en œuvre une société qui s'émanciperait de leur joug. Elle effraie car elle s'acoquine avec l'orientation tracée par Paul Lafargue dès sa Réfutation du droit au travail de 1848, plus connue sous la dénomination provocatrice du Droit à la paresse21. Dans ce texte il s'interroge sur ce que peut valoir une vie dominée par l'emprise d'un travail dont le temps dicte le moindre moment de votre monde quotidien ? Sa réponse est sans appel : cette vie aliénée ne vaut rien et la pauvreté des familles enchaînées au salariat témoigne alors en France de ce constat. D'où son plaidoyer pour les inciter à ne pas accepter l'accaparement de leur temps de vie par le temps de travail en expliquant pourquoi et comment il est possible de réduire massivement le temps soumis à travailler pour un patron.
Le « Lip c'est fini, fini » vociféré à la radio et à la télévision, le 1er août 1973, par le premier ministre Pierre Mesmer, inaugure la mobilisation massive des forces patronales pour briser, concrètement et idéologiquement, l'acuité des idéaux de Mai 68 dans les rapports sociaux de production et dans la vie quotidienne. Il faudra au patronat et à l'État plus d'une bonne vingtaine d'années pour y parvenir dans une longue marche affirmée théoriquement avant l'aube de ce siècle. Et depuis, ils ne cessent de vouloir maintenir à toutes forces idéologiques et répressives, auxquelles participent les successions de mises en état d'urgence, l'emprise qu'ils ont tissée. Sur le temps formel de travail, ils seront pourtant obligés d'accepter des concessions jusqu'aux trente-cinq heures, mais ils en produiront le contournement en atomisant l'ensemble du salariat pour mieux contrôler son temps individuel et collectif de mise au travail et mieux accaparer le temps libre de non-travail à des fins productives. Par la saisie des compétences acquises hors-emploi dans le temps quotidien, par une mise au travail hors-emploi pour de multiples activités de service, par l'encadrement des loisirs et des modes de plaisir dans un temps urgent de consommation marchande, par le démantèlement dans l'habitat des temporalités intimes métamorphosées en temps de travail assujetti, s'est constitué et consolidé un vaste processus de résistance du capital visant à annihiler l'accès au temps libre de non-travail.
Si même les gains de temps formels ouvrent sur une vie quotidienne où les rapports au travail vous enserrent de plus en plus dans des formes d'esclavage moderne et où s'entretiennent des rapports sociaux androcentrés, comment peut-on entrevoir les voies d'une émancipation ? En campant sur le seul objectif indispensable d'une réduction quotidienne pour toutes et tous du temps de travail sans l'inclure dans une vision plus vaste des processus d'assujettissement au travail capitalistique, est-il encore possible de penser et lutter pour une transformation émancipatrice ?
Un livre pour contribuer à penser, à lutter et à débattre pour concevoir un temps de la vie quotidienne émancipée du temps de travail
Pour contribuer à la compréhension du tissage des configurations temporelles dans lesquelles nous sommes contraints de vivre et de penser, l'objet théorique de la qualification du temps quotidien et de sa légitimation doit être mis en discussion au plus près des pratiques que nous exerçons ou côtoyons d'ordinaire. Trois logiques temporelles s'entremêlent si l'on cherche à analyser les significations de ce temps journalier. Ces logiques que nous ayons conscience ou non de leur impact sur nos façons d'agir sont liées à des symboliques, parfois très anciennes, permettant de faire société. Elles pèsent dans leur combinatoire sur nos capacités à comprendre la société de travail dans lequel nous vivons ou survivons, et ce faisant, sur nos capacités à penser et à produire de possibles alternatives menant vers une société de liberté et de bien-être.
Ces trois logiques temporelles sont celles du sacré, du synchrone et de l'asynchrone.
La logique du sacré
Elle en réfère aux dogmes religieux et profanes. Elle encadre et rythme les moments marquants de la vie (naissance, baptême, mariage, enterrement, anniversaire, etc.) mais aussi des temps plus ou moins liés au retour des saisons ou à la commémoration de références sociales communes (par des processions, des fêtes, des célébrations politiques, associatives ou militaires, des manifestations, etc.). Elle se matérialise aussi dans le calendrier qui encadre le déroulement du temps et décline, au long de l'année, des mois et de la semaine, les jours chômés censés permettre de nous reposer mais aussi de nous rassembler afin d'être a minimaensemble.
Elle mène encore au quotidien, via le son des horloges puis le silence des montres individuelles, les délimitations du temps à consacrer aux activités contradictoires ou complémentaires de la prière, de la méditation, de l'étude, du travail, de la rêverie ou encore de la déambulation et du repos. Dans les religions monothéistes, le temps de la prière quotidienne dicte ainsi la segmentation du temps quotidien. Par exemple, en France, au 19e mais encore au 20e siècle il n'est pas rare d'observer des arrêts de la production consacrés à dire obligatoirement des prières, à genoux, particulièrement dans les ateliers de femmes. La logique du sacré participe à imposer des normes communes et à poser des interdits censés contraindre les diktats matérialistes du fonctionnement des marchés. Par exemple, dans les conflits autour du temps de travail entendre dire que « le dimanche c'est sacré », n'implique pas une adhésion à une religion mais exprime le refus de la disparition d'un temps commun pour vivre ensemble autour d'autres activités que le travail rémunéré dans un temps contraint.
La logique du synchrone
Elle affiche les coordinations incontournables requises dans l'organisation commune d'une société. Elle permet d'articuler dans l'organisation de la vie quotidienne ce qui relève de temps sacrés tout en introduisant les injonctions spécifiques venant d'organisations singulières dans la société de travail. Autrement dit, la logique du synchrone se propose de coordonner l'ensemble des temps spécifiques de l'activité quotidienne et de les mettre en rythme. Elle organise, initialement, la vie quotidienne à partir des temps transcendants construits sur le sacré puis y intègre toutes les représentations d'organisations immanentes des liens. Cela inclut diverses formes comme les us et habitudes ou les rituels autour par exemple de la mise au travail, de la sortie du travail, les temps de pauses et de repas, etc. Cela touche également par exemple aux horaires d'ouverture des institutions publiques tout autant qu'à la possibilité de concrétiser des liens sociaux d'intimité permettant de se retrouver dans un temps à soi qui peut être partagé. C'est sur la base d'une telle logique que le mouvement ouvrier s'est rallié profondément au projet revendicatif des huit heures de travail, huit heures de repos, huit heures de loisir comme la représentation idéale d'une vie quotidienne émancipée.
La logique de l'asynchrone
Elle a pour vocation à légitimer, en les délimitant et en les encadrant, les logiques temporelles qui perturbent les mises en commun issues originellement de la combinaison des temps sacré et synchrone. Par exemple, elle justifie au nom d'un intérêt général que lors du jour de repos commun plusieurs activités professionnelles soient autorisées, sans possible refus de s'y soustraire. Le travail s'invite alors pour certains dans un « temps familial sacré ». Le travail posté, le travail d'astreinte sont des figures marquantes, avec l'organisation permanente des services de la sécurité publique (police, gendarmerie et sapeurs-pompiers) de la légitimité d'une telle logique au nom du bien public ou de l'intérêt général. C'est ensuite au nom d'une urgence, banalisée par différents modèles d'organisation de la production et de la distribution, que cette logique initialement supplétive va tendre à asseoir son emprise dans l'espace de la consommation des biens et des services jusqu'à se promouvoir comme logique hégémonique dans l'expansion de la mondialisation des affaires. La logique de l'asynchrone devient alors motrice dans toute une série d'adaptations et de réorganisations des activités et des temporalités. Elle ridiculise les rythmes « ancestraux » du travail et du repos, altère les représentations cristallisées du temps et embrouille la qualification qui peut être donnée au temps de travail comme au temps de repos, de loisir ou d'oisiveté. De logique dominée, elle devient logique dominante généralisant l'urgence dans l'organisation de la vie quotidienne afin de nous faire consentir à la prorogation de l'esclavage moderne.
Ces trois logiques accompagneront notre réflexion, tout au long des cinq chapitres de ce livre, pour analyser les tensions, les conflits et la dialectique de leurs résolutions au regard des combats menés pour s'émanciper des rapports d'exploitation.
Le premier situe le conflit structurel sur le temps d'assujettissement à la logique d'exploitation et interroge le sens des réponses tronquées du mouvement ouvrier et syndical au regard de la transformation des rapports sociaux, notamment de genre.
Le second explore, face aux luttes pour « Vivre et travailler autrement », les angoisses et les premières ripostes patronales qui débouchent sur l'invention de l'aménagement flexible du temps de travail.
Le troisième analyse l'aggiornamento de l'esclavage moderne que fonde la théorisation de la « Refondation sociale » conceptualisée et propagée par le Medef.
Le quatrième examine la concrétisation de ses effets sur l'aliénation de la vie quotidienne ces vingt dernières années jusque dans ses ajustements post-Covid.
Le cinquième présente trois modèles actuels aux sources de la perpétuation de l'oppression par le travail et les met en discussion proposant d'orienter, réflexions, débats et luttes vers une critique radicale de la vie quotidienne.
Patrick Rozenblatt : Le travail totalitaire
Editions Syllepse, Paris 2025, 184 pages, 20 euros
https://www.syllepse.net/le-travail-totalitaire-_r_22_i_1101.html
1. Cette expression trouve son origine dans la décision prise en 1874 par les députés français de suspendre, durant ce laps de temps, leurs affrontements parlementaires sur l'élaboration de la constitution afin de laisser place libre au commerce.
2. Site de la BNF.
3. « Après la dînette, le “Kit du télétravail” pour enfants à partir de 2 ans ! », Contre Attaque, 13 novembre 2023.
4. Présentation sur le site de la FNAC.
5. Seul un papa s'inquiète de l'aspect addictif et une maman émet une critique sur les couleurs associant encore le rose aux femmes et le bleu aux hommes !
6. Première loi en France limitant le travail des enfants, gouvernement.fr.
7. Ibid.
8. Ibid. On peut ajouter que ce processus amenait à rejeter plus tard hors de la conscription obligatoire une partie importante des jeunes hommes, ce qui affaiblissait l'armée française.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Steve Fraser, « Le retour du travail des enfants », source TomDispach, traduit par les lecteurs du site Les-Crises.
12. Il existe un contrôle théorique de l'inspection du travail et une autorisation préalable. « À partir de quel âge peut-on travailler ? », Service-Public.fr.
13. Abraham M. Moles, Sociodynamique de la culture, Paris/La Haye, Mouton, 1967.
14. Bertrand Russel, Éloge de l'oisiveté, 1932, http://www.esprit68.org/.
15. Patrick Rozenblatt, Razzia sur le travail : critique de l'invalorisation du travail au 21e siècle, Paris, Syllepse, 2017.
16. Tout le temps, partout, avec n'importe quel support.
17. Le Canard enchaîné.
18. Pierre Naville, Le nouveau Léviathan, t.1, De l'aliénation à la jouissance, Paris, Anthropos, 1970.
19. Jean-Marie Vincent, « La légende du travail », dans Pierre Cours-Salies (coord.), La liberté du travail, Paris, Syllepse, 1995.
20. Gerhart Brandt, Arbeit, Technick und gesellschaftliche Entwicklung, Francfort, Suhrkamp, 1990.
21. Paul Lafargue, Réfutation du droit au travail de 1848, texte publié en 1880 et plus connu sous la dénomination provocatrice du Droit à la paresse.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Amazonie accueillera la COP30 en 2025

Dix ans après l'accord de Paris et deux escales dans des pays pétroliers, la trentième Conférence des parties sur le climat (COP30), qui se déroule cette année aux portes de la forêt amazonienne brésilienne, sera sûrement marquée du sceau des peuples autochtones.
15 février 2025 | tiré d'Alter-Québec
https://alter.quebec/lamazonie-accueillera-la-cop30-en-2025/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=20-fevrier-2025--numero-commemoratif-du-30e-anniversaire-dAlternatives
Dès sa dernière élection en 2022, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva avait lancé un appel pour recevoir la COP30 en Amazonie. C'est donc à Belém, capitale de l'État du Pará, dans le nord du Brésil, que se tiendra la conférence organisée par l'Organisation des Nations unies, du 10 au 21 novembre prochain.
Alors que la ministre de l'Environnement, Marina Silva, l'appelle la « COP des COP », le Brésil accueillera la prochaine Conférence des Parties (COP) sur le climat avec des contradictions certaines. Aujourd'hui, le pays reste un grand producteur de pétrole, même si Lula a réaffirmé l'importance de protéger l'Amazonie pour la sécurité climatique dans le monde. Malgré l'engagement de son gouvernement à éradiquer la déforestation du pays, il a aussi fait avancer son projet d'adhésion à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
Avec le retour à la Maison-Blanche d'un climatosceptique, la COP30 aura lieu dans un contexte géopolitique hostile, car sans l'engagement des États-Unis, il sera difficile de conclure des accords fermes pour le climat.
Une COP tournée vers l'Amazonie
Le règne du dernier président Bolsonaro a été marqué par l'explosion de la déforestation en Amazonie. Lula, quant à lui, a promis de renverser la vapeur et de tenir son engagement de zéro déforestation. Il y a deux ans, après l'annonce d'une COP aux portes de la forêt amazonienne, les populations autochtones de la région ont commencé à se mobiliser. Il faut donc s'attendre à ce que les luttes portées par ces peuples occupent le cœur de la conférence de l'ONU.
Une mobilisation internationale se prépare. Des réseaux d'Europe, d'Afrique et des Amériques se sont donné rendez-vous, en novembre prochain, pour un sommet des peuples, en parallèle de la COP30, auquel participeront sûrement plusieurs délégations du Québec. À suivre.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Témoignage – Qu’en est il de la deuxième phase de l’accord à Gaza ?

Dans un développement récent, Israël a conditionné le passage à la deuxième phase de l'accord à des exigences que le Hamas considère comme inacceptables, notamment le désarmement de la résistance et l'éloignement du Hamas de la bande de Gaza. Le mouvement a affirmé que ces demandes relèvent de la « guerre psychologique absurde », insistant sur le fait que la résistance ne quittera pas Gaza et que son désarmement est hors de question. Il a également souligné que toute disposition concernant l'avenir de la bande de Gaza doit être décidée uniquement par un consensus palestinien, sans ingérence extérieure.
Tiré d'Union juive française pour la paix.
Par ailleurs, des responsables du gouvernement de Benjamín Netanyahou ont déclaré qu'il existe de profondes divergences entre les deux parties et que parvenir à la deuxième phase de l'accord semble quasiment impossible. Ces responsables ont précisé qu'Israël ne fera aucune concession sur ses demandes et que la seule option envisageable est la prolongation de la première phase (A) de l'accord, en intégrant davantage d'otages israéliens dans la liste humanitaire.
Dans le même contexte, une délégation israélienne de négociation est partie aujourd'hui pour Le Caire afin de discuter des détails de la première phase du cessez-le-feu. Un responsable israélien a révélé que les négociations porteront sur l'introduction de maisons mobiles dans la bande de Gaza, précisant que l'occupation est prête à faire entrer 300 unités résidentielles à ce stade. Toutefois, ce nombre reste largement insuffisant pour répondre aux besoins d'un seul camp de réfugiés, parmi les nombreux camps dispersés à travers le territoire, où des centaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge après la destruction de leurs maisons.
Situation humanitaire catastrophique : Gaza sous le poids de la guerre, du froid et de la faim
La souffrance des habitants de Gaza se poursuit dans un contexte de crise humanitaire catastrophique. Avec les destructions massives des infrastructures et l'effondrement des services essentiels, la vie devient de plus en plus difficile pour des centaines de milliers de citoyens.
Dans ce cadre, de grandes quantités de carburant ont été acheminées vers la centrale électrique située au centre de la bande de Gaza, permettant à la compagnie d'électricité de commencer la réparation de certaines lignes qui n'ont pas été complètement détruites. Cependant, l'ampleur des dégâts sur le réseau électrique est immense, rendant le rétablissement de l'électricité dans les foyers un travail de longue haleine qui pourrait prendre des années.
Simultanément, une puissante dépression météorologique a frappé Gaza dans la nuit d'hier, aggravant davantage les souffrances des habitants, en particulier ceux qui vivent dans des camps de déplacés et des tentes de fortune. Les fortes pluies et vents violents ont inondé ces abris précaires, transformant le sol en marécage de boue, rendant la vie insupportable, aggravée par le froid glacial et l'absence totale de moyens de chauffage.

Face à cette catastrophe, la colère des citoyens est montée d'un cran, notamment parmi ceux qui sont retournés dans leurs quartiers dévastés du nord et du sud de la bande de Gaza. Ils n'ont trouvé que des ruines, confrontés à une réalité encore plus cruelle : aucun abri, pas d'eau potable, et des rues toujours bloquées par les décombres qui rendent les déplacements extrêmement pénibles.
Avec l'accumulation des crises, la détresse des habitants ne cesse de croître. Les fortes pluies et le froid mordant ont contribué à une dégradation rapide des conditions sanitaires, provoquant la propagation de maladies dans un environnement privé des besoins les plus élémentaires pour la survie.
Extraction des corps sous les décombres après des mois de bombardements
La tragédie humanitaire ne cesse de s'aggraver avec la découverte continuelle de corps sous les ruines depuis plusieurs mois, conséquence des bombardements israéliens qui ont détruit les équipements de la défense civile dédiés au déblaiement des gravats.
Les familles endeuillées vivent toujours sous le choc, plongées dans une souffrance incommensurable, entourées de scènes de désolation et de destruction. Beaucoup subissent de graves traumatismes psychologiques, incapables de retrouver et d'inhumer dignement leurs proches laissés sous les décombres de leurs maisons détruites.

Après d'intenses efforts diplomatiques, l'entrée de deux bulldozers égyptiens spécialisés dans l'évacuation des débris et l'aménagement des routes a finalement été autorisée. Ces engins entameront leurs opérations dans le nord de la bande de Gaza, visant à dégager les ruines et récupérer les corps encore ensevelis sous les bâtiments détruits.
Cette avancée, bien que tardive, constitue un soulagement partiel pour les habitants qui espèrent enfin offrir à leurs proches un enterrement digne. Cependant, les besoins en équipements restent énormes, alors que les souffrances des familles continuent de croître jour après jour.
Poursuite des violations israéliennes et obstruction à l'entrée de l'aide humanitaire
Malgré l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne a continué de violer ses propres engagements à plusieurs reprises cette semaine, entraînant la mort de plusieurs civils et les blessures d'autres dans différentes zones de la bande de Gaza. Ces violations répétées suscitent des inquiétudes croissantes quant à un possible effondrement de l'accord, d'autant plus qu'Israël maintient une position rigide, poursuivant ses attaques ciblées sur certaines zones.
Par ailleurs, Israël continue d'entraver l'évacuation des patients et des blessés nécessitant des soins médicaux à l'étranger. Les autorités israéliennes ont reporté le départ de dizaines de malades et de leurs accompagnateurs, ce qui a aggravé leur état de santé et mis leur vie en danger.

Cette obstruction ne se limite pas aux patients : le passage de Kerem Shalom a également été soumis à des restrictions strictes sur l'acheminement de l'aide humanitaire. Israël n'a permis l'entrée que de 180 camions sur les 600 convenus, soit à peine 30 % du volume attendu au cours des deux derniers jours, selon le bureau des médias gouvernemental de Gaza. Cette réduction drastique des approvisionnements a exacerbé la crise alimentaire et la pénurie des biens essentiels, rendant la situation encore plus insoutenable pour les habitants de la bande de Gaza.
Le bilan de l'agression israélienne s'alourdit alors que le blocus et les crimes se poursuivent : depuis le 7 octobre 2023, 48 271 morts et 111 693 blessés, faisant de cette attaque l'une des plus meurtrières contre des civils dans l'histoire contemporaine. Ces chiffres accablants illustrent l'ampleur de la tragédie que vivent les Palestiniens de Gaza, confrontés à une guerre d'extermination systématique dont le but est d'anéantir toute forme de vie dans le territoire assiégé.
Israël a transformé la bande de Gaza en la plus grande prison à ciel ouvert au monde, soumettant ses habitants à un blocus implacable depuis 18 ans. Cette situation a engendré une détérioration sans précédent des conditions humanitaires, plongeant près de deux millions de déplacés – sur une population totale de 2,4 millions d'habitants – dans des conditions catastrophiques, avec un manque délibéré de nourriture, d'eau et de médicaments. Malgré les appels internationaux incessants, Israël continue de pratiquer une politique de famine et de privation à l'égard des civils, perpétuant ainsi des crimes d'une ampleur inouïe contre une population sans défense.
Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter d'aboutir à un accord global qui soulagerait les souffrances des habitants de Gaza, l'intransigeance d'Israël bloque toute avancée significative. Entre bombardements, siège et déplacements forcés, Gaza demeure une plaie ouverte au cœur du monde, où ses habitants endurent une guerre impitoyable sous le regard passif de la communauté internationale.
Abu Amir, le 20 février 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mondialement, le 1% s’appuyant sur le 10% et soudoyant le 40% est responsable de la crise climatique. Reste à renverser le sablier.

Comme le montre le tableau suivant, les ultra-riches et les riches sont quasi exclusivement responsables des émanations de GES au-delà de la viabilité pour ne pas dépasser le 1.5°C de réchauffement de la terre. Pour le dire comme le Secrétaire général des Nations unies en 2020 : « Au cours des 25 dernières années, les 10 % les plus riches de la population mondiale ont été responsables de plus de la moitié des émissions de carbone. L'injustice et l'inégalité de rang à cette échelle sont un cancer. Si nous n'agissons pas maintenant, ce siècle pourrait être le dernier.

Dans les derniers trente ans (voir la dernière colonne du tableau ci-bas), les 50% les plus pauvres n'ont été responsables que de 16% des nouvelles émanations de GES alors que les 10% les plus riches l'ont été pour 45% :
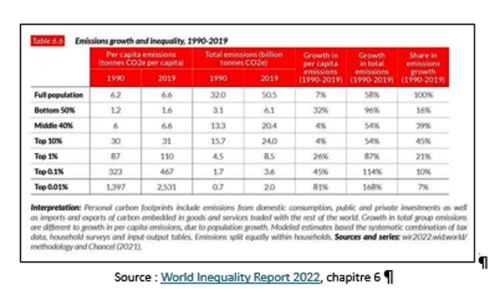
Fait crucial à noter, le surgissement des pays émergents depuis 1990, en particulier de la Chine, combiné à la généralisation de l'austérité dans les pays du vieil impérialisme, fait qu'alors qu'en 1990 près des deux tiers des inégalités carbone étaient dus aux inégalités entre pays, ce sont celles à l'intérieur des pays qui expliquent la même proportion en 2019 :
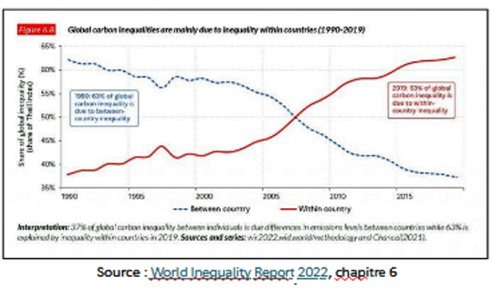
Ces données reposent sur l'empreinte carbone, donc sur la consommation y compris la part de chaque individu pour les émanations de GES non seulement à partir directement du ménage privé mais aussi des dépenses par les gouvernements et des investissements privés en fonction du revenu du ménage et non de leur contrôle de la production. Si on se basait sur ce contrôle, la concentration de la responsabilité des émanations de GES est quasi invraisemblable : « Plus de 70 % de ces émissions historiques [1854 à 2022] de CO2 peuvent être attribuées à seulement 78 entreprises et États producteurs. »
Derrière les froides statistiques se cachent les banques de la « dirty dozen »
Si on prend seulement en compte le passé récent depuis 2016 soit depuis les Accords de Paris, « [l]e Top 10 est principalement dominé par les entités étatiques chinoises et russes. La production chinoise de charbon arrive ainsi largement en tête, représentant un quart des émissions mondiales sur la période. Viennent ensuite la société pétrolière publique Saudi Aramco (5% des émissions mondiales), le géant russe de l'énergie Gazprom (3,3%) et le producteur public indien de charbon Coal India (3%). Les majors occidentales sont quant à elles présentes dans le Top 20 : Exxon arrive 11e avec 1,4% des émissions, suivi de Shell, BP, Chevron ou encore TotalEnergies, qui se place 18e avec 1% des émissions mondiales. »
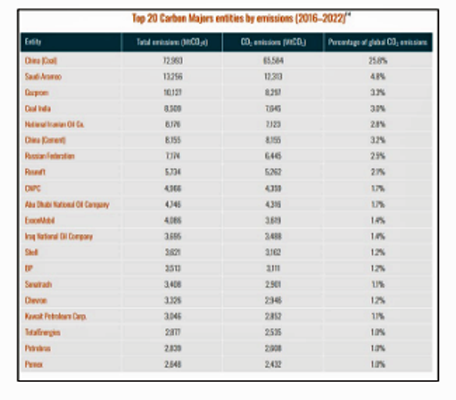
Ce serait cependant une grave erreur que de tout mettre sur le dos de la Chine et de la Russie. Derrière les grands émetteurs de GES sont embusquées les grandes institutions financières dont deux canadiennes qui font partie de la « dirty dozen ».

Quant à leur engagement climatique, prétextant la peur du trumpisme, elles fuient la pourtant futile Net-Zero Banking Alliance(NZBA) des Nations unies faisant partie de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)… initié par le banquier (et futur Premier ministre du Canada ?) Mark Carney.
Ensuite, il faut creuser pour établir la responsabilité finale. Par exemple, on sait qu'une bonne part de la production manufacturière chinoise est destinée aux pays du vieil impérialisme. Ce n'est pas pour rien, n'en déplaise à Trump, que la balance commerciale des ÉU est fortement déficitaire. Quand on y pense, l'important déficit commercial des ÉU, qui dure depuis 1975, soit depuis 50 ans, n'est pas autre chose qu'une ponction sans rémunération sur les ressources du monde et, à revers, une exportation de GES non compensée. Derrière les rideaux, le sorcier d'Oz transforme ses dollars hégémoniques en pouvoir d'achat miraculeux bien appuyé sur une puissance économique et militaire… de plus en plus toussoteuse. Le comportement aberrant trumpien cache la conscience claire de l'irrémédiable déclin de (l'ex-)gendarme du monde prétendant équilibrer ses comptes et se repliant sur la forteresse nord-américaine.
L'énergivore American Way of Life de l'endettement, de l'isolement et de l'anxiété
Plus généralement, l'American Way of Life de la consommation de masse repose sur les piliers du complexe auto-bungalow imposé aux travailleurs-consommateurs et travailleuses-consommatrices par les choix productifs du grand capital et allègrement financé par les banques. D'où la contradiction entre fin du mois et fin du monde que confrontent les ménages populaires. L'American Way of Life, à la source de l'orgie de GES, soutenu par la Finance et la propagande capitaliste, appelée publicité, justifié par la « demande solvable » keynésienne, entretient des besoins insatiables jamais comblés huilant la machine à profits.
L'American Way of Life plonge la masse populaire dans l'insatisfaction permanente et l'anxiété de l'endettement restreignant sa liberté de riposter collectivement. Isolé dans son bungalow et dans son auto, l'humain de la modernité est condamné au malheur du stress permanent et de son corolaire de maladies chroniques et mentales. C'aurait été si simple, au début du XXe siècle, pour une société démocratique de choisir le logement collectif au lieu du bungalow et le transport collectif au lieu de l'auto solo, le tout dans une ville donnant la priorité aux piétons et à la verdure au sein d'une campagne assurant l'essentiel de l'approvisionnement végétarien sans ruiner les sols, sans dévaster les forêts et sans polluer les eaux. Il n'est pas trop tard pour bien faire.
Une esquisse de stratégie écosocialiste qui se heurte à la division entre le Nord et le Sud
De cette analyse sommaire on peut voir en filigrane l'esquisse de la stratégie pro-climat : mobiliser le 50% tout en ralliant le 40% pour écraser le 1% tout en neutralisant le 9%. Globalement, il y a une double difficulté. Le 50% le plus pauvre constitue la grande majorité de la population des pays du Sud lesquels pays sont cependant peu émetteurs de GES mais aussi peu influents au niveau mondial. Le 40% du milieu, mondialement parlant, qui s'accroche désespérément à l'American Way of Life forme la majorité de la population des pays du vieil impérialisme lesquels pays sont d'importants émetteurs de GES et influencent fortement la direction de la politique mondiale. En plus, les émissions de GES ont beau être sourcées nationalement et sectoriellement, leurs conséquences sont immédiatement mondiales.
Se pose, dès le départ, la nécessité d'une lutte mondiale mais qui ne peut que s'amorcer dans la nation qui reste le lieu central de la politique malgré l'éclatement économique des États à l'ère impérialisme. Pendant que dans le Sud se multiplient les luttes dont l'origine ou le fondement est souvent écologique mais sans aboutir, au Nord elles ne décollent pas sauf parfois en grande mobilisation sans lendemain ou en coups d'éclat médiatiques mais très minoritaires. Toutefois, les pays émergents, surtout la Chine mais aussi certains autres pays des BRICS + se caractérisent par une majoritaire masse appauvrie et une influence mondiale ou tout au moins régionale significative. Là sont peut-être les maillons faibles où jaillira l'étincelle qui mettra le feu à toute la plaine.
L'intensification de la crise climatique unifie le monde et s'articule avec la crise sociale
Est certesdémobilisante la désinformation climatique qui prétend à l'atteinte proche d'un sommet mondial d'émanations de GES laissant voir une descente rapide grâce à un renouvellement de la consommation de masse électrifié à coups d'autos solo électriques et d'une orgie d'énergie renouvelable ouvrant une nouvelle ère extractiviste tout aussi énergivore. Mais cette fake news est contredite par la réalité crue de la croissance à taux croissant de GES, mesurés directement dans l'atmosphère, qui fait de l'adaptation, mal pourtant nécessaire, un ridicule chien qui court après sa queue. L'incontournable réalité des catastrophes et des super-canicules climatiques allant croissant exponentiellement et qui n'épargne plus le Nord ramène implacablement sur le terrain des vaches. Elle y ramène d'autant plus que ces événements sur fond de tendance lourde s'articulent de plus en plus avec la crise sociale de la vie chère, du logement, des infrastructures détruites et des austérisés services publics débordés.
Il ne saurait être long que ces soulèvements massifs et prolongés qui ont en vain galvanisé le monde méditerranéen dans les années 2010 resurgissent dans l'un ou l'autre pays émergent. Elle pourrait même surgir dans les pays du vieil impérialisme où ces « classes moyennes » du 40%, s'appauvrissant et se précarisant davantage, en viennent à devenir une majorité acculée au pied du mur. La bourgeoisie mondiale a parfaitement compris le danger existentiel qui la confronte en répondant par la montée de l'extrême-droite déviant la colère populaire sur ces « classes moyennes » du Sud, instruites et sans emploi, qui montent en masse vers le Nord. À la gauche de sortir de ses confortables gonds centristes et électoralistes mobilisant pour une société solidaire de soins et de liens coupant radicalement avec la croissance matérielle des extractivismes ancien et nouveau.
Marc Bonhomme, 23 février 2025
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Allemagne : Un sociologue commente le score de l’AfD - « Le succès de Die Linke montre ce qui peut être fait »

Selon le sociologue Axel Salheiser, l'AfD pourrait encore gagner du terrain à l'avenir dans les Länder de l'Est. Pour s'y opposer, il faudrait que les partis affirment leur identité propre. Interview réalisé par Anne Fromm.
24 février 2025, Anne Fromm Axel Salheiser
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article73739
Axel Salheiser : Je m'y attendais. Mais ce qui me choque, c'est qu'elle a fortement progressé par rapport aux dernières élections régionales. D'une part, elle profite du climat qui règne dans toute l'Allemagne. D'autre part, les sondages post-électoraux montrent que les thèmes qui ont fait pencher la balance en Allemagne de l'Est étaient différents de ceux de l'Allemagne de l'Ouest. Des sujets tels que l'environnement et le climat n'ont pratiquement pas joué de rôle à l'Est. Ici, le thème principal était l'immigration, utilisée comme bouc émissaire. L'idée que les migrant.e.s sont systématiquement favorisé.e.s est bien reçue ici, car de nombreux Allemands de l'Est se considèrent comme des citoyens de seconde zone.
Pourquoi ? La situation des gens à l'Est n'est pas si mauvaise.
Salheiser : C'est vrai, mais les responsables politiques des partis démocratiques hésitent à aborder le sujet, car personne ne veut offenser ses électeurs. Et il est également difficile de dire aux gens : « La situation n'est peut-être pas aussi bonne que vous l'espériez. Mais elle pourrait être bien pire. »
Ce qui est vrai, c'est que les succès de la politique des 35 dernières années sont beaucoup trop peu évoqués. Au lieu de cela, les Allemands de l'Est dépeignent leur avenir de manière sombre : restructurations, les jeunes qui partent, les régions qui se vident. Nous savons que là où l'attitude face à l'avenir est particulièrement négative, le mécontentement à l'égard de la démocratie est particulièrement grand.
Mais d'autres régions d'Allemagne sont également confrontées à de grandes incertitudes quant à leur avenir. Pourquoi l'Est est-il si réceptif aux discours de l'extrême droite ?
Salheiser : Nous étudions depuis de nombreuses années les opinions des personnes qui vivent en Thuringe. Le facteur le plus important qui explique pourquoi les gens votent pour l'AfD, ce sont les opinions nationalistes et xénophobes. Autrement dit, les personnes qui ont des opinions racistes sont les plus susceptibles de voter pour l'AfD. Cela peut sembler banal, mais c'est tout de même pertinent. Toutes les personnes qui ne sont pas satisfaites de la démocratie ne votent pas pour l'AfD. Mais toutes celles qui votent AfD se disent insatisfaites de la démocratie. L'AfD absorbe le mécontentement politique comme une éponge.
L'AfD a obtenu près de 40 % des voix en Thuringe et en Saxe. Qu'est-ce que cela signifie ?
Salheiser : Cette situation entraîne un grand déficit de représentation. Si près d'un Thuringien sur deux a voté pour l'AfD, on est en droit de se demander pourquoi cette force politique est tenue à l'écart du pouvoir. Les partis démocratiques ne peuvent pas suffisamment expliquer cela. Au contraire : la CDU défend une politique migratoire très proche de celle que souhaite l'AfD. Comment peut-elle alors expliquer de manière convaincante pourquoi elle ne travaille pas avec l'AfD ?
Les partis démocratiques ont essayé beaucoup de choses : ils pointent du doigt l'extrême droite, ils essaient de la contrer sur le fond. Mais cela ne semble pas porter ses fruits. Comment faire mieux ?
Salheiser : Le succès du parti Die Linke montre, à petite échelle, comment il est possible de faire autrement : ne pas s'acharner sur l'AfD, mais au contraire affiner son propre profil. C'est une erreur de corréler la question sociale à l'origine des gens. Il faut arrêter de mettre en avant l'immigration en tant que problème pour nos systèmes sociaux. Cela conduit à ce que la migration soit considérée dans son ensemble comme un phénomène à bannir. Les partis démocratiques doivent parvenir à faire taire ce discours. Il ne profite qu'à l'AfD.
La force de l'AfD n'est pas un phénomène purement allemand, et encore moins un phénomène purement est-allemand. Les populistes de droite triomphent dans le monde entier. L'Allemagne est-elle en train de se rallier à l'esprit général du temps ?
Salheiser : Oui, mais la comparaison avec les populistes de droite en Italie, aux Pays-Bas et en France est boiteuse. Je ne veux pas banaliser les partis de droite là-bas. Mais l'AfD est beaucoup plus virulente. Elle n'est pas seulement d'extrême droite. Elle est une extrême droite qui veut changer radicalemen le système.
Peut-on s'attendre à ce que l'AfD cesse de croître ?
Salheiser : Non, il n'en est pas question, surtout dans l'Est. Nous observons une évolution linéaire depuis les dernières élections. Si nous prolongeons cette ligne, l'AfD obtiendra la majorité absolue lors des prochaines élections régionales en Allemagne de l'Est. C'est une perspective catastrophique. Nous pouvons déjà voir les dommages causés à la culture démocratique au niveau régional.
L'AfD étend ses structures et renforce ses organisations extraparlementaires grâce à sa présence dans les différentes assemblées. Cela conduit à davantage de violence et de polarisation. Dans les zones rurales, cela affecte en premier lieu les réfugié.e.s, les homosexuel.le.s, les personnes de gauche et non-blanches dans les zones rurales.
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevorde avec l'aide de DeepLpro.
Source - TAZ, 24 février 2024 :
https://taz.de/Soziologe-ueber-AfD-Erfolg/!6068511/
• Axel Salheiser. est sociologue et directeur scientifique de l'Institut pour la démocratie et la société civile (IDZ) d'Iéna. Il effectue des recherches sur l'extrémisme de droite et l'hostilité envers certains groupes de personnes.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre de soutien mondial à la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences, Reem Alsalem

Cette lettre a été envoyée le 2025-02-21 et contient les signatures de plus de 500 organisations et 5 000 individu·es.
Cette lettre a été initiée par la Plate-forme d'action internationale des femmes (WoPAI) et le Lobby suédois des femmes, en collaboration avec le Réseau européen des femmes migrantes.
Les signataires de cette lettre souhaitent exprimer leur profonde gratitude pour le travail excellent et novateur réalisé par Mme Reem Alsalem, dans le cadre de son mandat actuel de rapporteuse spéciale sur la violence à l'égard des femmes et des filles.
Il est extrêmement important que le poste de rapporteur spécial sur une question aussi cruciale que la violence masculine à l'encontre des femmes et des filles soit occupé par quelqu'une de méritante et de courageuse, jouissant de la plus haute autorité et des normes d'intégrité les plus élevées.
Les organisations de femmes du monde entier suivent le travail de Mme Alsalem, et nous sommes profondément préoccupées par les campagnes de diffamation et les attaques infondées contre elle et son travail, qui se sont récemment intensifiées en raison de l'engagement inébranlable de Mme Alsalem en faveur des droits humains des femmes et de ses présentations indépendantes et objectives sur toutes les formes de violence à l'encontre des femmes et des filles. Ces campagnes et ces attaques ne sont que la preuve que Mme Alsalem a exposé la dure vérité des systèmes qui normalisent et justifient la violence à l'égard des femmes.
Par cette lettre, nous souhaitons exprimer notre soutien au travail extrêmement important de Reem Alsalem. Nous appelons à une action globale de soutien à Mme Reem Alsalem en joignant nos forces aux siennes et en soutenant son mandat et son travail indépendant, en partageant ses rapports et sa couverture des questions critiques et ses recommandations pour mettre fin à l'endémie croissante de la violence à l'égard des femmes.
Lire la lettre
Signez la pétition ICI
https://www.womensplatformforaction.org/global-support-letter/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte des femmes internationales pour une Syrie démocratique fondée sur la liberté des femmes

Lettre ouverte de femmes internationales pour une Syrie démocratique basée sur la liberté des femmes
à l'attention de
António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies,
Sima Sami Bahous, directrice exécutive d'ONU Femmes,
Roberta Metsola, présidente du Parlement européen,
António Luís Santos da Costa, président du Conseil européen,
Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe,
Tiré de Entre les lignes et les mots
Depuis la chute du régime Assad en Syrie le décembre 2024, des discussions sont en cours sur l'avenir de la Syrie, et avec cela, les nouvelles opportunités pour une reconstruction démocratique de la société syrienne.
Il est essentiel que la société elle-même façonne et fasse avancer cette reconstruction. Il est également essentiel que les femmes syriennes participent à l'élaboration de ce processus en co-construisant la politique et toutes les sphères de la vie d'une manière autodéterminée.
La Syrie est en état de guerre civile depuis plus de dix ans, un processus qui a débuté par un soulèvement contre le régime oppressif baasiste. Au cours des 13 années qui ont suivi, la société a été confrontée à plusieurs reprises aux crimes les plus atroces contre l'humanité perpétrés par divers groupes terroristes tels que le soi-disant État islamique ou aux attaques d'invasion menées par l'État turc en violation du droit international.
Dans le nord et l'est de la Syrie, la population kurde construit depuis 2012 une société autonome fondée sur la libération des femmes, l'écologie et la démocratie de proximité. Les femmes ont joué un rôle très important dans ce processus. Dans ce modèle social, les femmes prennent des responsabilités et sont représentées dans tous les domaines de la vie sociale et politique. Elles se sont organisées pour se défendre et défendre la vie de tous. Les unités de défense des femmes du YPJ, aux côtés des YPG et des FDS, ont combattu l'État islamique et libéré de nombreuses villes de son règne. Le modèle social du confédéralisme démocratique dans le nord et l'est de la Syrie a créé une coexistence multiethnique et multireligieuse qui peut servir de modèle pour la réorganisation dans toute la Syrie.
Les femmes syriennes se sont unies et organisées pour lutter contre les attaques dont elles font l'objet et contre la société dans son ensemble. Elles sont déterminées à œuvrer en faveur du processus de paix, d'une société démocratique, de la vérité et de la justice. C'est pourquoi, le 22 décembre 2024, le Conseil des femmes syriennes a présenté une déclaration visant à remodeler la Syrie. Dans cette déclaration, l'association, composée de femmes de différentes origines ethniques, religieuses et culturelles, appelle à la participation décisive des femmes et de toutes les composantes de la société syrienne aux processus politiques.
Nous soutenons les 13 objectifs et demandes développés par le Conseil des femmes syriennes pour construire une nouvelle Syrie démocratique basée sur la participation des femmes (lien). En outre, la reconnaissance et la participation de l'Administration autonome démocratique dans le nord et l'est de la Syrie (DAANES) au processus actuel sont également essentielles pour un avenir démocratique en Syrie.
Nous appelons la communauté internationale et tous les acteurs politiques à reconnaître officiellement la DAANES, à soutenir directement les organisations civiles sur place et à établir une coopération à long terme. Nous appelons à un soutien et à des alliances politiques avec les organisations de femmes démocratiques et la société civile dans toute la Syrie, plutôt qu'à une coopération avec les groupes djihadistes dont l'idéologie et la pratique sont basées sur l'humiliation et l'oppression violente des femmes.
Nous demandons également l'arrêt immédiat des livraisons d'armes et des concessions politiques à la Turquie. Les relations diplomatiques avec les forces démocratiques en Syrie doivent être renforcées afin d'arrêter les attaques violentes de la Turquie, de mettre fin à la guerre et de permettre la construction d'une Syrie démocratique.
Il est temps de renforcer les forces démocratiques du Moyen-Orient, comme DAANES, et de soutenir les femmes qui luttent pour la liberté, la paix et la démocratie en Syrie !
Voir les signatures sur le site Women Defend Rojava
https://womendefendrojava.net/en/2025/01/28/international-womens-open-letter-for-a-democratic-syria-based-on-womens-freedom/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Les sportives qui portent le voile ont le droit de jouer, comme les autres ! »

Dans une tribune collective, des personnalités publiques et des présidents d'associations dénoncent la proposition de loi qui voudrait interdire le port de tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Ces 18 et 19 février, à l'occasion d'une séance plénière au Sénat, sera débattue une proposition de loi visant à renforcer le principe de laïcité dans les compétitions sportives en interdisant le port de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Celle-ci aurait pour effet d'interdire l'accès aux compétitions à de nombreuses femmes et filles en France. L'Anestaps (organisation représentative des jeunes dans le champ du sport et de l'animation), Amnesty International France et Basket Pour Toutes alertent sur les dangers de cette proposition de loi qui est contraire au droit international et aux valeurs de libertés, d'inclusion et d'égalité que prône le sport.
Cette proposition de loi prétend faire respecter le principe de laïcité, mais porte en réalité une atteinte grave à la liberté de conscience. Elle porte aussi atteinte aux droits de participer à la vie culturelle, de disposer de son corps et de ne pas être discriminée, pourtant garantis par les conventions internationales ratifiées par la France.
Selon l'Observatoire de la laïcité, « la laïcité garantit la liberté de conscience, la liberté de religion et de culte, de laquelle découle la liberté vis-à-vis de la religion, et celle de manifester des convictions, quelles qu'elles soient – religieuses ou non –, mais toujours dans les limites de l'ordre public ». L'Observatoire rappelle d'ailleurs que l'interdiction du port de signes religieux ne s'applique pas aux usagers des services publics. C'est aussi le sens de la décision du Conseil d'Etat statuant dans le contentieux opposant les Hijabeuses à la Fédération française de football (FFF) [dans laquelle, tout en autorisant la FFF à édicter ses propres règles, il estime que les joueuses sont bien des usagères d'un service public et qu'elles ne sont donc pas soumises au devoir de « neutralité », NDLR].
Le sport est, par essence, un espace où chacune et chacun peut se dépasser, apprendre et s'épanouir. Il transcende les barrières sociales, culturelles et religieuses et porte des valeurs universelles de respect, d'égalité et de diversité. Pourtant, choisir d'interdire le port du couvre-chef sportif revient à priver des milliers de femmes qui portent le voile de cet épanouissement personnel et collectif.
De plus, cette interdiction ne prend pas en compte les réalités des terrains. En effet, elle constituerait un frein pour des femmes et des filles dont la pratique sportive est déjà bien inférieure à celle des hommes. Elle serait la source d'isolement social, de sédentarité, de mal-être psychologique et d'humiliation supplémentaire, pour les sportives exclues ou obligées d'enlever publiquement leur voile. Elle porterait atteinte à la pérennité des clubs dont l'activité bénévole repose en partie sur l'implication de femmes qui portent le voile. Enfin, elle restreindrait les opportunités de voir des talents français s'épanouir sereinement. En n'entravant pas la pratique du sport, nous favorisons sa féminisation, un objectif que la France s'est fixé, notamment à travers l'organisation des premiers Jeux olympiques et paralympiques paritaires en 2024.
Les institutions internationales comme le Comité international olympique, la Fifa ou encore les Nations unies ont démontré qu'il est possible de concilier liberté religieuse et pratique sportive. Leur décision d'autoriser le port du couvre-chef sportif dans les compétitions prouve qu'une réglementation inclusive peut coexister avec des standards élevés de sécurité et d'équité. La proposition de loi aggraverait une exception française remarquée lors des Jeux olympiques et paralympiques, où la France était le seul pays à interdire le port du voile à ses athlètes.
Nous appelons les sénatrices et sénateurs à rejeter cette proposition discriminante et à travailler collectivement à des solutions qui garantissent l'accès au sport pour toutes et tous, sans distinction. Ensemble, faisons du sport un monde inclusif et émancipateur, fidèle à ses valeurs universelles.
Premiers signataires :
Nathalie Tehio, présidente de la LDH (Ligue des droits de l'Homme) ; Anne Savinel-Barras, présidente Amnesty International France ; Hélène Bâ, présidente de Basket Pour Toutes ; Lily Rogier, présidente de l'Anestaps ; Béatrice Barbusse, sociologue ; Jean-Louis Bianco, président de Vigie de la laïcité, ancien ministre, ancien président de l'Observatoire de la laïcité ; Aurélie Bresson, fondatrice des éditions Les Sportives ; Kayode Damala, président des Etudiants musulmans de France (EMF) ; Yohann Diniz, ancien athlète de haut niveau
Lire la liste complète des signataires
Lire la tribune sur l'obs
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Réintégrer les savoirs scientifiques dans la société : un enjeu démocratique

L’altruisme obligatoire, handicap rédhibitoire des femmes

La féministe Adrienne Rich a parlé de « compulsory heterosexuality » (hétérosexualité obligatoire) comme un obstacle quasi-insurmontable à l'affranchissement des femmes. Encore plus handicapante pour elles est l'idéologie de l'abnégation féminine, qui leur impose de s'investir dans une identité altérocentrée –le fait de se définir relativement aux autres, comme dispensatrice de services et de soin, (continuation sociale de la fonction maternelle) – idéologie qui est en soi désindivisualisante et autodestructrice.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Le problème est que cette socialisation à l'altruisme place les femmes dans une situation lose-lose : si elles se conforment à cet impératif de vivre pour les autres et à n'exister que relativement à leurs besoins et à leur bien-être, la seule forme de réalisation qui leur est ouverte est de se consacrer aux tâches de care qui leur sont dévolues normativement par la société, ce qui les exclut de toute forme d'activité créatrice et de toute possibilité d'accès au pouvoir.
Si elles décident de s'investir dans leur propre réalisation, d'être artistes, chercheuses, politiciennes, etc. elles sont stigmatisées pour avoir refusé leur vocation altruiste « naturelle » et leurs productions sont qualifiées de secondaires ou ignorées. Si elles sont politiciennes, elles sont rejetées par l'opinion comme trop peu féminines, trop dures, trop égoïstes, trop bossy, et ne sont pas élues.
Il y a quelques années, « une expérience a été conduite à la Columbia Business School, pour évaluer comment les étudiant/es percevaient le leadership selon le sexe. Les chercheurs ont présenté à la moitié des étudiant/es le CV d'une auto-entrepreneuse, Heidi Rozen, une investisseuse en capital risque ayant connu une brillante réussite basée sur sa personnalité entreprenante et son large réseau de contacts professionnels et personnels. A l'autre moitié, ils ont présenté le même CV, mais avec un prénom différent, masculin : Howard.
Les étudiant/es éprouvaient du respect pour les succès de Heidi et d'Howard, mais au niveau de l'appréciation de leur personnalité, il y avait une différence. Iels trouvaient Howard sympathique mais pas Heidi, qui était vue comme égoïste, et infréquentable comme collègue. Les hommes peuvent accéder au sommet sans choquer ou déplaire aux autres parce que leur succès leur appartient. Des femmes par contre, on attend que leurs efforts bénéficient à la collectivité – elles doivent s'occuper des autres autour d'elles au lieu de travailler pour leur propre succès. Par conséquent, quand les femmes réussissent à accéder à des positions de leadership, elles sont perçues comme présentant un déficit en matière de nurturance et de qualités collectivement utiles, comme l'étude Heidi/Howard l'a mis en évidence. » (Gemma Hartley)
C'est ce qui explique qu'il n'y ait que 20% de femmes au Congrès aux Etats-Unis, et si peu de femmes chefs d'Etat dans le monde.
Parce qu'en gros, si les femmes manifestent ces qualités maternelles/altruistes qu'on exige d'elles, on les voit comme manquant d'autorité et d'agressivité, et incapables d'exercer un leadership compétent et énergique dans un monde régi par les rapports de force.
Si elles se montrent volontaires, déterminées, peu émotionnelles et « masculines », on les accuse d'être ambitieuses, égoïstes et « control freaks » (maniaques du contrôle), et on les trouve personnellement antipathiques. L'affirmation égocentrée de soi, fondement de toute expression créatrice, est interdite aux femmes.
You cant' win…
Francine Sporenda
https://sporenda.wordpress.com/2025/02/07/laltruisme-obligatoire-handicap-redhibitoire-des-femmes/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Afrique : La RDC démunie face à l’agression du Rwanda

La capitale du Nord-Kivu, Goma, est tombée. Les troupes conjointes de la milice M23 et du Rwanda ont vaincu le dispositif déployé en urgence pour défendre la ville. Il était composé du bataillon spécial de la Monusco (Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en république démocratique du Congo), et des troupes de l'Afrique du Sud déployées dans le cadre de la Sadec, la structure régionale de l'Afrique australe.
Tiré d'Afrique en lutte.
Incertitude sur la politique rwandaise
L'avancée du M23 et des troupes rwandaises dans l'est du pays qui compte le Nord et le Sud-Kivu ainsi que l'Ituri semble inéluctable. Le président congolais Félix Tshisekedi a fait appel à une société de mercenaires roumains censée faire la différence grâce à l'utilisation de drones. C'était compter sans l'efficacité de la défense anti-aérienne et du brouillage GPS de l'armée rwandaise rendant ces armes inopérantes.
Dans les territoires conquis, les miliciens du M23 ont mis en place une nouvelle économie permettant l'exploitation du coltan et de l'or dont la production est acheminée au Rwanda. Les pertes pour le Nord-Kivu sont estimées à 7 millions de dollars par mois. Au-delà de l'aspect économique, les objectifs du Rwanda restent flous. En effet, si l'ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs, Vincent Karega, a déclaré que les miliciens du M23 « vont continuer dans le Sud-Kivu, parce que Goma ne peut pas être une fin en soi » il a été démenti aussitôt par le ministère des Affaires étrangères de Kigali. Cependant, James Kabarebe, important dirigeant du pays des Mille Collines, revendique les deux régions comme historiquement rwandaises.
Dans le même temps, Corneille Nangaa le dirigeant de l'Alliance du fleuve Congo (AFC), qui se veut l'aile politique du M23, affirme : « Notre objectif n'est ni Goma ni Bukavu mais Kinshasa, la source de tous les problèmes ». L'AFC déploie beaucoup d'effort pour tenter de fédérer les différentes milices armées qui pullulent dans la région. Au vu de la situation, il n'est pas exclu que certains wazalendo (les patriotes en kiswahili) qui se battaient aux côtés des forces armées congolaises ne changent de camp.
En tout état de cause, quel que soit l'objectif du Rwanda, transformer la région Est de la RDC en une sorte de dominion ou renverser le pouvoir au profit d'un gouvernement associé, voire subordonné à Kigali, le défi pour le Rwanda est l'administration de ces vastes territoires.
La RDC isolée
C'est évidement un coup dur pour Tshisekedi qui avait fait de la défense de la souveraineté son principal argument électoral lors des dernières élections présidentielles. Il appelle à l'unité nationale, exhorte la jeunesse à s'enrôler dans l'armée. Il annonce une contre-offensive qui risque de ne pas dépasser le stade de la rhétorique vu l'état de délabrement de l'armée congolaise d'autant que peu de pays de la région souhaitent s'investir militairement.
Au niveau diplomatique, ce n'est guère mieux. Certes la plupart des pays ont condamné la prise de Goma mais dans des termes généraux s'en assortir ces déclarations de quelconques mesures dissuasives. Les pays occidentaux n'ont guère envie de se fâcher avec le président rwandais Paul Kagamé qui reste un fidèle soutien du camp occidental en protégeant les infrastructures des majors pétrolières, dont TotalEnergies, au Mozambique. De plus son libéralisme autoritaire n'est évidemment pas pour déplaire à Trump et consorts.
Les voix de la « négociation » semblent aussi être dans l'impasse. Tshisekedi a décliné l'invitation du Kenyan William Ruto pour une réunion avec Kagamé. Il a préféré se rendre en Angola où le président João Lourenço a mené un travail de médiation entre les deux pays. Lourenço a dénoncé la prise de Goma par les RwandaisEs au risque de saper sa neutralité auprès de Kigali.
Dans cette guerre, ce sont les populations civiles qui paient le plus lourd tribut de l'agression du Rwanda en RDC notamment les femmes et jeunes filles victimes de viols et d'agressions sexuelles dont le nombre a explosé.
Paul Martial
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Égypte du président Sissi prisonnière de crises inextricables

Un sommet arabe se réunira le 4 mars au Caire pour proposer un plan sur l'avenir de Gaza, après la proposition du président Donald Trump de déporter sa population. Jamais la situation du président Abdel Fattah Al-Sissi, coincé entre son alliance avec Israël, une situation régionale instable, ses réformes économiques antisociales, son autoritarisme sans limite et son armée qui a étendu sa mainmise sur les richesses du pays, n'a été aussi précaire. Sur cette situation, Robert Springborg, spécialiste de l'Égypte, répond aux questions d'Orient XXI.
Tiré d'Orient XXI. Traduit de l'anglais par Philippe Agret.
Sylvain Cypel. — Donald Trump a demandé au président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi d'accueillir un nombre massif de Palestiniens de Gaza. La presse américaine a récemment fait écho à une possible pression de Trump sur lui à propos du grand barrage de la Renaissance sur le Nil, en Éthiopie, qui menace de réduire l'accès de l'Égypte à l'eau. Pensez-vous que le président égyptien puisse finalement céder à la pression américaine quant à l'avenir des Palestiniens ?
Robert Springborg — D'après des images satellites prises dans le Sinaï, on sait que, plusieurs mois après le début de la guerre de Gaza, l'Égypte préparait un grand « camp » pour recevoir les Palestiniens expulsés, a priori à la suite de pressions de l'administration Biden. Après que ces photos ont été publiées, le développement du projet a été stoppé. Ce qui laisse penser qu'il y a eu des pressions sur le président Sissi pour qu'il renonce à ce plan, des pressions exercées sans doute par la seule force qui possède de l'influence en Égypte, à savoir l'armée.
L'administration Trump a désormais fait monter les enchères en offrant son soutien à l'Égypte, y compris — mais probablement pas seulement — en ce qui concerne le conflit sur le barrage avec l'Éthiopie. Mais en même temps, l'indignation ressentie en Égypte, comme dans presque tout le reste du monde, devant la destruction de Gaza a rendu beaucoup plus difficile tout compromis de la part du président Sissi, comme l'a montré la plus grande tolérance du régime à l'encontre des manifestations contre les actions israéliennes.
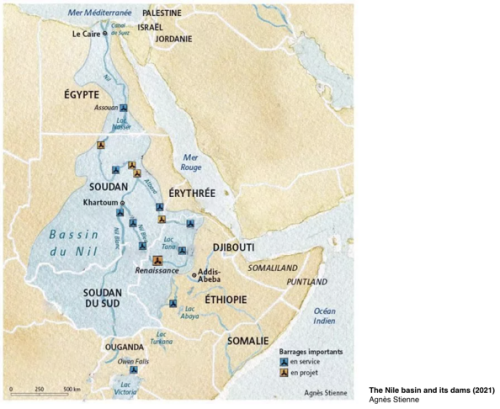
Les dilemmes de la guerre contre Gaza
Cela dit, on peut imaginer un scénario dans lequel le déplacement/transfert d'au moins une partie des Palestiniens de Gaza en Égypte pourrait devenir un élément d'un accord plus large qui mettrait fin à l'engagement actuel d'Israël à Gaza. Dans ce cas, Sissi obtiendrait le soutien américain contre l'Éthiopie et une poursuite de l'assistance étrangère de Washington, ce qui amènerait l'armée égyptienne à considérer un tel accord plus favorablement. Et s'il s'accompagnait d'un retour de l'Autorité palestinienne dans un rôle à Gaza, et d'un soutien arabe et international à la reconstruction du territoire ainsi que d'une garantie de sécurité, cela réduirait encore les réticences du Caire à accueillir des Gazaouis. Et cela offrirait au premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou une possibilité de revendiquer une « victoire » grâce à l'expulsion de Palestiniens.
En résumé, la situation est fluide, mais il est possible d'imaginer certaines conditions qui conduiraient l'Égypte à céder aux pressions américano-israéliennes.
Divisions entre nantis et laissés pour compte
S. C.— Quel est l'état réel de la société égyptienne plus de dix ans après l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah Al-Sissi ?
R. S.— Les politiques du régime ont divisé la société égyptienne entre nantis et laissés pour compte. Ce fossé prend plusieurs formes. Premièrement, les salaires n'ont pas suivi le rythme de l'inflation, et donc les familles dépendant d'un travail rémunéré ont vu leurs revenus réels substantiellement réduits. Deuxièmement, l'inflation a davantage frappé les produits de première nécessité, en particulier les denrées alimentaires, que les autres biens et services. Troisièmement, les services publics, en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation, se sont dégradés, forçant les usagers à se tourner vers le secteur privé. Quatrièmement, le niveau d'emploi dans la fonction publique par rapport à l'emploi global a décliné, touchant ainsi les femmes et la petite classe moyenne qui, traditionnellement, dépendaient davantage des emplois dans le secteur public.
À l'autre extrémité de l'échelle sociale, ceux ayant accès au capital, soit grâce à des emplois dans le secteur privé ou à la propriété d'entreprises, soit grâce à des transferts de fonds ou à diverses formes de corruption, ont vu leurs revenus grimper en flèche, et ils se sont alors livrés à des acquisitions ostentatoires, notamment dans l'immobilier et les services haut de gamme. C'est ainsi que, tandis que ceux d'en haut s'enrichissaient, la situation de ceux d'en bas déclinait, creusant l'écart des revenus et le fossé social qui étaient déjà importants. En effet, selon l'indice de Gini (1) des inégalités, tel que rapporté par l'économiste Thomas Piketty, parmi les pays à revenu moyen et moyen inférieur, l'Égypte est la plus inégalitaire. Cette profonde inégalité a fortement exacerbé les tensions socio-politiques, dont la pléthore de grèves dans les grandes entreprises n'est qu'un des indicateurs.
Une économie contrôlée par les militaires
S. C.— Le soutien du Fonds monétaire international (FMI) et de l'Europe en faveur de l'Égypte se poursuit. La présidente de la Commission européenne, Ursula Van der Leyden, a récemment chanté les louanges de réformes qui sont virtuellement inexistantes (2). Comment l'expliquez-vous ?
R. S.— Le FMI, l'Union européenne et presque tous ses États membres ont renoncé à encourager les réformes en Égypte, qu'elles soient politiques ou même économiques, comme le prouvent leurs aides financières massives offertes au printemps 2024. Le moteur de ce soutien résulte de la peur, de la crainte d'un effondrement du régime dictatorial, qui poserait une multitude de défis, sous la forme de migrations transméditerranéennes, de terrorisme, d'antagonisme avec Israël, et de liens avec des forces déstabilisatrices dans des pays frontaliers comme la Libye et le Soudan, ou autres…
L'Égypte étant « un trop gros morceau » pour la laisser échouer dans l'esprit de ces décideurs, ces derniers font systématiquement abstraction des violations des droits humains par le président égyptien, de son autoritarisme toujours plus étouffant, de son mépris effronté des réformes conclues avec le FMI et d'autres donateurs, de ses accointances avec Vladimir Poutine et les Chinois, etc. Que les opinions occidentales n'aient pas protesté plus vigoureusement contre ce soutien à courte vue et, finalement contre-productif, au plus terrible dictateur de l'histoire moderne de l'Égypte est un acte d'accusation de la démocratie occidentale elle-même.
Aucune réforme en perspective
S. C.— Quelle direction prend l'économie égyptienne ? D'un côté, le régime prône une orientation néo-libérale. De l'autre, la mainmise de l'armée sur l'économie nationale semble toujours plus forte. N'y a-t-il pas là une contradiction ?
R. S.— Oui, c'est contradictoire et cela conduit à une économie très similaire à celle de la Russie de Poutine. Il y a deux « gagnants » : d'abord l'armée et les officiers des services de sécurité, ainsi que d'autres, liés administrativement à l'État dans l'État ; puis les oligarques qui dirigent des secteurs de l'économie qui sont en cheville avec les premiers. Pratiquement tous les autres acteurs économiques sont des « perdants ». Et comme votre question le suggère, cette division s'intensifie au fur et à mesure que le contrôle direct et indirect des militaires sur l'économie — et les petits arrangements avec leurs oligarques favoris — devient de plus en plus étroit. Il n'y a aucune chance pour la moindre réforme fondamentale de cette économie qui restera dominée par l'État dans l'État aussi longtemps que le président Sissi et l'armée restent au pouvoir. La promotion d'une économie libérale dans laquelle s'engagerait le régime est une opération de relations publiques entièrement destinée à des audiences occidentales et n'a strictement aucun rapport avec l'organisation et la gestion actuelles de l'économie.
S. C.— Le fait que l'armée égyptienne étende son contrôle de l'économie n'est-il pas dangereux pour l'armée elle-même ? Lors d'une conférence à Florence (Italie) en janvier 2025, vous avez parlé de sa lente évolution vers un conglomérat de « milices ». À quoi faisiez-vous référence ?
R. S.— D'abord sous Anouar El-Sadate, puis davantage sous Hosni Moubarak et encore plus sous le président Sissi, l'armée a changé sa priorité. De conduire la guerre, elle est passée à celle de générer du profit. Par conséquent, ses capacités de combattre ont stagné en dépit du fait qu'elle est l'une des forces armées du Sud qui dépensent le plus pour ses achats d'armes, qu'elle est la plus grande armée en Afrique et l'une des plus grandes au monde. Elle consacre des ressources inadéquates à l'entraînement, à la réparation et l'entretien du matériel, à sa logistique, à l'intégration des forces et de l'organisation et de la gestion militaires. La pléthore d'équipements qu'elle a acquise auprès de nombreux fournisseurs différents nécessiterait d'ailleurs des militaires bien mieux formés pour les intégrer dans leurs différents corps. L'Égypte ne les a pas, donc l'efficacité de son armée de l'air, de ses blindés et même de son infanterie de base ne s'est pas développée parallèlement à ses dépenses et ses achats. Le corps des officiers se préoccupe de faire de l'argent, pas de se préparer à faire la guerre.
Des milices pour consolider le pouvoir
Quant au phénomène des « milices », je faisais référence à l'organisation des Fils du Sinaï (Abnaa Sina) dirigée par Ibrahim Al-Argani et créée à l'origine par l'armée afin de servir d'unités auxiliaires lors de la campagne de contre-terrorisme dans le nord du Sinaï. Al-Sissi a ensuite orchestré l'extension de son rôle à la fois géographiquement jusqu'à l'Égypte « continentale », et fonctionnellement, au sein des systèmes économique et politique. Par exemple, il lui a permis de devenir l'intermédiaire entre le ministère (égyptien) de l'Intérieur et le Hamas pour la délivrance de visas pour les Gazaouis en échange de paiements dépassant souvent 5 000 dollars (4 820 euros).
Fin 2024 — début 2025, Sissi a également favorisé l'émergence d'un nouveau parti politique, le Front national, dans lequel Al-Argani a d'abord obtenu la place de dirigeant, jusqu'à ce que des objections se fassent apparemment jour au sein des militaires qui ont commencé à le percevoir comme une menace à leurs intérêts. Il a été provisoirement écarté puis réinstallé, mais dans un rôle quelque peu ambigu. Selon des sources informées, Al-Sissi voudrait qu'Al-Argani, sa milice et son parti politique servent à la fois de bras répressif de la présidence et de contrepoids à l'armée. Jamais auparavant dans l'histoire moderne de l'Égypte, une milice de cette nature avait été autorisée par l'État. Qu'une telle milice ait été créée laisse deviner la décrépitude de l'État-nation.
S. C.— Le soutien officiel de l'Égypte en faveur de l'armée soudanaise dans la guerre civile, qui dure depuis bientôt deux ans, pèse-t-il sur son économie ?
R. S.— C'est un fardeau, mais également un bénéfice pour l'économie. D'abord, directement, car l'Égypte a facilité la contrebande d'or du nord et de l'ouest du Soudan, dont tirent profit les Égyptiens impliqués dans ce trafic au cœur duquel on trouve probablement les militaires et les services de sécurité. Ensuite indirectement, parce que la présence de réfugiés soudanais en Égypte est une source de revenus pour le gouvernement, sous la forme d'aide financière fournie par les donateurs, qu'il s'agisse du FMI, de l'UE, des États-Unis ou de nombreux pays européens. Ces réfugiés sont traités incroyablement durement par le régime égyptien et une grande partie de la population. Tout bien pesé, Le Caire a probablement tiré profit de la guerre civile soudanaise.
La dépendance à l'égard d'Israël
S. C.— Comment l'armée égyptienne gère-t-elle ses relations étroites avec Israël (notamment sur la sécurité dans le Sinaï) tout en préservant sa mission fondamentale de garante de l'indépendance ? N'y a-t-il pas de risques pour elle après ce qui s'est passé à Gaza ?
R. S.— L'armée et les services de sécurité des deux pays collaborent étroitement, ainsi que le démontre leur capacité à gérer une multitude de crises sécuritaires, que ce soit des meurtres de soldats des deux côtés de la frontière, des violations de clauses des traités ou des tensions plus graves résultant de la guerre israélienne contre Gaza. L'une des raisons pour lesquelles les relations ont résisté est que l'armée israélienne a joué un rôle clé dans la répression de l'insurrection qui a éclaté au Sinaï dans le sillage de la révolution égyptienne de 2011. Une autre raison, encore plus importante, est que l'influence de Tel-Aviv à Washington est cruciale pour que Le Caire y conserve sa position privilégiée, malgré la récente condamnation du sénateur Bob Menendez pour avoir accepté des pots-de-vin du plus proche conseiller du président Sissi afin de faciliter la livraison d'aide étrangère (par les États-Unis) à l'Égypte (3).
Mais la collaboration avec Israël est impopulaire en Égypte, Sissi la cache donc, comme il le fait pour toutes les « mauvaises nouvelles », qu'elles soient de nature sécuritaire, politique ou économique. Et comme toutes les sources indépendantes d'information publique ont été supprimées dans le pays, les Égyptiens n'ont pas vraiment les moyens de savoir à quel point leur pays, leur armée et leur président sont devenus dépendants d'Israël. La dépendance vis-à-vis des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite est davantage connue dans le public, mais elle n'est pas aussi problématique pour Sissi parce qu'il s'agit de pays arabes. Toutefois, même concernant cette dépendance, il y a un énorme rejet de l'opinion, ce qui montre combien des informations sur les relations sécuritaires entre Israël et l'Égypte pourraient s'avérer politiquement explosives.
Notes
1- NDLR. L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte du niveau d'inégalité pour une variable et sur une population donnée. Il varie entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité extrême). Les inégalités mesurées peuvent porter sur des variables de revenus, de salaires, de niveau de vie, etc.
2- Le 17 mars 2024, lors du forum UE—Égypte sur l'investissement, Ursula von der Leyen et Le Caire ont signé un « partenariat stratégique » pour 7,4 milliards d'euros dans le domaine de l'énergie et mais surtout dans le renforcement des frontières.
3- En juillet 2024, l'élu du New Jersey est reconnu coupable de corruption, de trafic d'influence et d'avoir agi comme agent de l'étranger en faveur de l'Égypte et du Qatar. Il démissionne de son poste de sénateur le 20 août 2024. En janvier 2025, il est condamné à une peine de 11 ans de prison pour corruption.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Intelligence Artificielle façon Musk, une arme de destruction massive

Notre chroniqueur et ami Xavier Houzel est effrayé par les perspectives ouvertes par un Elon Musk, bras droit de Trump, qui tire « son pouvoir et son aura » de l'Intelligence Artificielle, « la sienne, bien entendu ».
Tiré de MondAfrique.
Elon Musk se présente aux États-Unis tel Protée, sachant tout du passé et du présent et doté du pouvoir de prophétie et de la faculté de se métamorphoser : il nous propose tout à coup , avec Grock 3, l'IA soi-disant « la plus intelligente sur terre[i] » ! Comme il tire son aura et qu'il détient son pouvoir de l'IA, des innovations et des ruptures correspondantes, il commence par faire table rase du passé en tentant de remplacer en bloc une nuée de fonctionnaires américains par l'IA – la sienne, bien entendu. Il fait à cette occasion la chasse au renseignement, qu'il s'agisse du FBI ou de la CIA, ou du Fisc et de la sécurité sociale, car il lui faut les données de leur clientèle pour s'en approprier aussitôt les clés, pour les référencer et les faire mouliner avec ses propres algorithmes, qu'il s'agisse des électeurs ou des contribuables, c'est-à-dire de tous les citoyens, et cela sans autorisation de personne ni la moindre protection de la vie privée des gens. Ce qui est ahurissant !
Après l'Amérique du Nord, pourquoi ne pas s'attaquer au reste de l'Humanité, avec la force de frappe des USA ? Sans limites aucunes. Le vice-président Vance reproche dès aujourd'hui à l'Union Européenne de brider ladite IA pour en contrôler les dérives éventuelles ! Il préfigure alors ce que sera le « monde d'après ». Mais nous sommes à la fois loin de l'ère du Sud Global et de son heure et de l'invention d'un nouvel ordre mondial, éventuellement favorable au groupe des BRICS, tel que le conçoit un universitaire comme Bertrand Badie.
L'IA va trop vite
Nous sommes aussi tout près d'un effondrement civilisationnel de l'ancien monde, parce que l'IA va trop vite ! La course se fait sur une corde raide. Une nouvelle forme de colonisation par la conformité des messages et par l'uniformité induite de la pensée risque de balayer toute volonté de rupture avant que les colonisés n'aient eu le temps de s'en prémunir. Nombre de métiers disparaîtront, d'autres les compenseront, comme jadis et depuis l'invention de la roue, là n'est pas la question ! Les philosophes et les théologiens se penchent sur le problème. Les flux migratoires, par exemple, devront être régulés pour éviter la « submersion » des civilisations par le nombre, et puis les naissances et puis la démographie….mais ce n'est pas l'IA qui y pourvoira ! La « démocratie » fonctionnera par algorithmes intercalés. Cela donne le vertige : monsieur Vance semble vouloir le nier, en créant un tohu-bohu jamais atteint auparavant quand il morigène la vieille Europe à ce propos. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, à terme, ce sera le retour à l'ordre primordial, à la révision des échelles de valeurs et des rapports de forces. C'est dangereux.
Deuxième chuchotement d'Elon Musk, bruissant comme un méchant acouphène dans les oreilles présidentielles : l'armement et la monnaie (le sacro-saint Dollar), qui faisaient la puissance de l'Amérique, risquent d'être trappés d'obsolescence ! Le char de combat et l'avion de chasse « à coups de millions » n'auront plus besoin d'équipages ; ils seront impuissants devant les attaques de plus petits que soi « au prix d'une poignée de Dollars » ; seulement. Le drone est devenu intelligent ! Et même très intelligent (beaucoup plus malin que ne peut l'être un char, trop compliqué).
L'esprit de conquête
Le même Protée poursuit cependant en murmurant à l‘oreille du président que le réchauffement climatique va libérer des glaces – sous la double influence de l'homme et des cycles naturels tels que l'oscillation Nord-Atlantique – la plus grande partie des eaux et des continents inclus dans le Cercle polaire Arctique. Or ce rivage invisible borde des pays aussi variés que l'Alaska, le Canada, le Groenland, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie (notamment la Sibérie). Les satellites de Starlink (près de 7.000 unités) disent que les icebergs y fondent à toute allure mais surtout qu'il existe, au-delà de cette ligne de démarcation, un No man's land immensément riche encore à conquérir.
Nonobstant un traité datant de 1920 – celui de Svalbard, instauré pour réglementer l'inlandsis arctique[ii] – les Américains aimeraient bien bouter hors de l'Arctique les Russes et les Européens. En réalité, ce sont les Chinois que l'Amérique redoute le plus en Arctique, sachant que le « premier arrivé » pourrait y contrôler les eaux (la pêche), le sol (l'agriculture et les forêts), le sous-sol (les terres rares et les hydrocarbures) et les accès (la route du Nord sera bientôt ouverte aux tankers toute l'année). Les Chinois ont l'inconvénient d'être trop nombreux, ce qui se transforme en avantage quand il s'agit de peupler des pays vierges ! La région arctique a d'autre part un caractère stratégique évident depuis la guerre froide, les missiles balistiques de la Russie pouvant facilement passer par le pôle Nord vers le continent américain !
Ces considérations sont de nature à faire resurgir l'esprit de conquête qui anima jadis les ancêtres d'Elon Musk et de Donald Trump ! Aussi le tandem formé par le Sud-Africain et le pionnier yankee ne résiste-t-il pas à la tentation de mettre la main sur le trésor du Cercle Arctique Polaire. La population autochtone du Grand Nord Canadien, du Groenland ou de la Sibérie orientale qu'on nomme « les Esquimaux » est beaucoup moins nombreuse que les tribus « Indiennes » de la conquête de l'Ouest ou que les peuplades bantouphones de la Colonie du Cap.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis réclament sans vergogne aussi bien le Canada que le Groenland et c'est pourquoi ils se retirent sine die – sans aucune explication valable – de traités tels que l'Accord de Paris de 2015, adopté dans le cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi que de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de la même manière que, le 8 mai 2018, le président américain d'alors, le même Donald Trump, avait annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne, en accompagnant sa décision brutale de sanctions économiques accablantes contre l'Iran ! L'Europe s'était alors couchée, la France la première… anticipant ainsi sur son retour à la case zéro de l'ordre primordial (en vigueur lors du dernier refroidissement global, ou de la dernière glaciation terminée il y a 12.000 ans), quand le dominant primait obligatoirement sur le dominé – avant l'existence de « nations », avant les « valeurs », avant Homère, avant Tocqueville ! Et voilà enfin pourquoi, Donald Trump et son équipe se précipitent chez MBS (qui a les sous, dont la Russie pourrait avoir besoin pour se remettre de la guerre et développer la Sibérie) pour y rencontrer le président Poutine. L'affaire de l'Ukraine sera une bonne affaire pour les trois : l'un sera remboursé en terres rares et l'autre en territoires. Trump veut à tout prix éloigner la Russie de la Chine et MBS, gardien au nom de son père des Deux Mosquées, veut être dans la cour des grands, sachant que les Russes sont ancrés aussi solidement à Mourmansk qu'ils entendent le rester aussi durablement à Vladivostok.
Pour le reste, les Russes et les Perses se méfient l'un de l'autre depuis toujours. Poutine est relativement isolé. Les Chinois ne sont pas invités. Quant aux Européens, ils sont anéantis.
Les jeux de rôle de la diplomatie
Avec la fin du libre arbitre de l'homme (battu par plus intelligent que lui, mais pas obligatoirement par le plus fort), avec la fin de la diversité démocratique (tout le monde obéissant à la même intelligence supérieure), avec l'altération du principe de puissance (jusqu'alors caractérisé par la force), avec la dévalorisation de la notion de frontière (celles des traités, de celui de Berlin ou celui de Svalbard et d'une kyrielle d'autres lignes de partage négociées), avec la démonétisation des organisations internationales et de leurs chartes en déshérence, la communauté des nations risque de s'effondrer sous elle-même. Les traits des civilisations hier vivantes iront en s'estompant, à cause de l'IA, qui, entre temps, sera une « super IA » assistée d'ordinateurs quantiques « réagissant uniformément » et en temps réel. Justement, c'est imparable !
L'Histoire récente et la géographie sont certes encore prégnante de la colonisation des Phéniciens à Carthage, de celle de Rome sur le pourtour méditerranéen, des Chinois dans le Sud-Est Asiatique et jusqu'en Sibérie, des Ottomans, de la France ou de la Grande-Bretagne et du reflux – pour ne pas dire de la décadence – de leurs empires. On admet que sans le désastre de Diên Biên Phu et surtout sans la pantalonnade infligée à la France à 60 kms du Caire devant les menaces soviétiques et les semonces américaines du 7 novembre 1956 – lorsque « l'Opération Mousquetaire » tourna à l'avantage diplomatique pour Nasser – la Guerre d'Algérie n'aurait jamais eu lieu.
Oui, Nasser, le plus faible, a battu le plus fort, ce jour-là (la Grande-Bretagne, l'État Hébreu et la France, coalisés). Mais c'est épiloguer à revers et nous n'en sommes plus là ! Merci à Moscou et à Washington. La France, l'Angleterre, l'Allemagne sont aujourd'hui dans un même état de décrépitude sans qu'il n'y ait là de rapport avec la « décolonisation ». Avec la mondialisation, la téléphonie et internet, tout le monde colonise dorénavant tout le monde de multiples façons. Et j'ajoute, pour parler du faible qui bat le plus costaud, que l'Afghanistan a battu à plate couture successivement l'Union Soviétique et les États-Unis d'Amérique. Les colonisés d'hier sont les colonisateurs de demain, démarche à laquelle ils s'adonnent le plus souvent sans expérience ni mesure, directement ou par intermédiaire : les USA en sont l'exemple le meilleur. Au mieux, ils font des enfants « à la mitrailleuse » et ils investissent l'ancienne métropole.
La Diplomatie devrait enfin pouvoir jouer. Mais alors sans IA et hors la vue de toute caméra.
Notes
[ii] Ce dernier autorise ses signataires (le Canada, le Danemark, les États-Unis, l'Islande, la Norvège, la Russie, la Finlande, la Suède, la Chine et d'autres) à exploiter la zone arctique (pêche, chasse, tourisme, recherches scientifiques, industrie…). Exception faite à la Chine, pourtant signataire, n'ayant accès à aucun de ces droits.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Esclavage, colonisation : l’Union africaine demande réparation

Au 38ᵉ sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis-Abeba, les 15 et 16 février, l'un des sujets centraux a été la demande panafricaine de réparations liées à la traite transatlantique des esclaves et à la colonisation. Une résolution a été adoptée à cet effet.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Ouverture de la 38e session ordinaire de la Commission de l'Union africaine (CUA), à Addis-Abeba, en Ethiopie, le 15 février 2025. Photo Tiksa Negeri/Reuters.
Le 15 février, l'Union africaine (UA) a adopté une résolution, présentée par le Ghana et appuyée par l'Algérie. Cette résolution, intitulée “Justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations”, a été retenue comme thème de l'année 2025 pour l'Afrique. Selon Africa Inside, “cette initiative marque une avancée majeure dans la construction d'un front africain uni pour porter ces revendications sur la scène internationale”. C'est même la première fois dans son histoire que l'UA place les réparations au premier plan, analyse de son côté The Guardian.
“Esclavage, pillage : combien doivent Londres, Rome, Bruxelles, Paris… à l'Afrique ?” La question est abruptement posée par le titre ivoirien L'Infodrome, qui reproduit une carte de l'Afrique figurant les sommes que doivent verser la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Portugal et le Royaume-Uni aux pays africains à titre de réparations.
Cette initiative a d'ailleurs été présentée comme un “moment historique” par Monique Nsanzabaganwa, vice-présidente sortante de la Commission de l'Union africaine, puisqu'elle devrait permettre “de rendre à l'Afrique ses droits légitimes et renforcer ses revendications légitimes”. Une analyse que partage Africa Inside, qui estime :
“En plaçant la question des réparations et de la justice coloniale au cœur du débat international, cette résolution de l'Union africaine pourrait marquer un tournant dans les relations entre l'Afrique et l'Occident. Elle ouvre la voie à une reconfiguration géopolitique.”
En amont de ce 38e sommet de l'UA, rapporte Business Insider Africa, le Conseil économique, social et culturel de l'UA (Ecosocc) avait organisé un présommet de la société civile pour faire avancer ce dossier des réparations et des dommages liés aux effets durables de l'esclavage et de la colonisation. Du XVe au XIXe siècle, au moins 12,5 millions d'Africains ont été kidnappés, transportés de force par des marchands, principalement européens, et vendus comme esclaves.
Justice réparatrice
En 2023, rappelle Business Insider Africa, l'Union africaine avait déjà adopté une résolution visant à obtenir une justice réparatrice pour l'esclavage transatlantique et la colonisation, relançant le débat sur sa mise en œuvre. L'organisation panafricaine avait notamment souligné la nécessité de la restitution des terres autochtones confisquées et la restitution des objets culturels saisis pendant la période coloniale.
La même année, l'UA s'était associée à la Communauté caribéenne (Caricom) pour exiger des réparations. À l'époque, le Guardian notait que ce partenariat entre l'Union africaine, composée de 55 membres, et la Caricom, composée de 20 pays, visait à intensifier la pression sur les anciens pays esclavagistes pour qu'ils s'engagent dans le mouvement des réparations.
La Caricom avait également élaboré son propre plan de réparation en dix points, qui prévoyait notamment une justice réparatrice, des excuses officielles complètes, l'annulation de la dette et l'investissement des anciennes puissances coloniales dans les systèmes de santé et d'éducation des pays lésés.
L'Afrique exige des comptes
Cependant, le succès de ces efforts dépendra de la capacité des pays de l'UA à surmonter la résistance des anciennes puissances coloniales. Car, comme le souligne Business Insider Africa, de nombreux dirigeants occidentaux s'opposent au versement de réparations.
Si Donald Trump estimait déjà en 2019 qu'il “ne voyait pas cela se produire”, Emmanuel Macron a plaidé, lui, pour une “réconciliation des mémoires”, tandis que le populiste britannique Nigel Farage voit dans ces négociations sur les réparations un signe de faiblesse.
En outre, la question n'est pas exempte d'arrière-pensées politiques. Ce projet de résolution a ainsi été porté par l'Algérie, qui a joué un rôle de premier plan dans la volonté de l'Union africaine de faire reconnaître sur la scène mondiale ce dossier de la réparation de la colonisation. Or cette résolution intervient dans un contexte d'une détérioration des relations entre l'Algérie et la France, notamment sur la question de la mémoire coloniale.
De même, l'expulsion des troupes françaises de plusieurs pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest s'est accompagnée d'une critique mémorielle de l'ancienne colonisation française, tandis que la Russie et la Chine ont amplifié et utilisé la question de la responsabilité coloniale pour contester l'influence européenne en Afrique, analyse le Guardian.
Mais peut-être est-ce justement “le bon moment pour que l'Afrique exige des comptes et pour que les démocraties européennes proposent enfin une réponse significative”, souligne le titre britannique, qui estime qu'“alors que le monde est aux prises avec des dynamiques de pouvoir changeantes, l'appel de l'Afrique à la justice est plus urgent que jamais”.
Courrier international
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
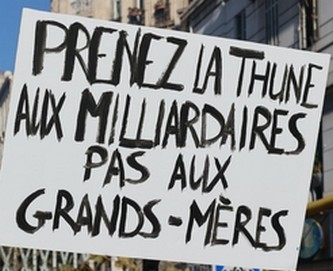
L’équipe éditoriale de La Presse+ : Des choix pas anodins
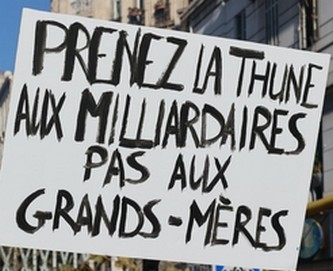
Soyons clairs, les faits ne sont pas en cause ici. Les viaducs s'écroulent, la chaussée s'ouvre comme la mer Rouge du temps de Moïse et les aqueducs éruptent tels le Vésuve. Il y a aussi de la moisissure dans les murs des écoles et plus de gens dont le quotidien se résume à deux choix : passer leurs nuits dans les édicules de la STM ou crever de froid. Le récent dossier de La Presse, « Le Québec à l'heure des choix » (ainsi que l'éditorial qui l'accompagne), rapporte certaines vérités quant à l'état de la situation.1
Henry Diaz, économiste
Là où on risque la dispute, c'est aux moments où les textes tirent des conclusions douteuses, proposent des fausses dichotomies et où ils plantent sournoisement les semences de l'apologie du capitalisme, de la privatisation des besoins de base et du démantèlement généralisé de l'État. Car en effet, quelques vérités n'équivalent pas automatiquement à l'ensemble de la réalité.
Par exemple, c'est curieux qu'en nous proposant l'idée que l'État dépense trop et n'en génère pas assez, l'éditorialiste en chef de La Presse nous parle des CPE, du personnel spécialisé dans les écoles, des rentes de retraite et de la cohésion sociale.2 En d'autres mots, on dépenserait trop pour les enfants, les personnes âgées et les immigrants non blancs et non catholiques, entre autres. Pas un mot sur l'inégalité des revenus qui se creuse au Québec depuis quarante ans ni sur le traitement fiscal des mieux nantis, qui ne contribuent pas leur juste part :
• L'écart entre le 1 % des Québécois les plus riches et la moitié la plus pauvre s'est creusé de 52 % entre 1982 et 2019 ; 3
• La part de revenus du 0,1 % des plus riches au Québec a augmenté de 141,7 % entre 1982 et 2019 ; 4
• En 2020, le taux marginal d'imposition provincial du 0,1 % (revenus nets d'au moins 595 600$) était le même que celui de ceux et celles ayant des revenus de 108,390$.5,6
Ce n'est pas anodin non plus que cette critique juge que l'augmentation de 5,5 points de pourcentage (par rapport au PIB) sur 20 ans de toutes les dépenses de l'État serait « considérable »,7 notamment en raison de tous ces programmes pour les plus vulnérables. Cependant, on passe sous silence l'augmentation salariale de 30 % que les députés se sont octroyés en 2023 alors que l'économie du Québec a cru de 0,6 % la même année.8
On évite aussi de mentionner que la valeur du parc immobilier des ministres du gouvernement Legault s'élevait à 45 millions $ en 2023,9 mais on n'hésite pas à nous dire que le Québec n'a pas assez de richesse pour inclure de nouveaux éléments dans la mission de base de l'État (ça vous dit quelque chose, la crise du logement ? On se souviendra que le gouvernement Legault a longtemps refusé de reconnaitre l'existence de l'enjeu).10
En santé, on donne la parole à Gaétan Barrette pour nous convaincre que les problèmes financiers du réseau de la santé sont le résultat des syndicats et des familles qui ne prennent pas soin des aînés.11 Pas un mot sur la masse salariale des médecins spécialistes (autour de 5 milliards $ annuellement).12 Silence aussi par rapport au fait que c'est l'ancien ministre lui-même, dans son rôle de président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui a fait bondir le salaire des médecins spécialistes (gain de 77 % entre 2006 et 2015).13 À l'époque, Radio-Canada écrivait : « il n'existe aucune profession au Québec rémunérée à même les fonds publics qui a connu un tel bond. » 14
Encore moins anodin, l'éditorial de La Presse veut nous vendre la Suède comme un idéal à atteindre, pays où la social-démocratie irait mieux grâce à la cohésion sociale qui a permis de sabrer dans les rentes de retraite, entre autres.15 La « solution » au Québec passerait donc par l'homogénéisation de la société et les coupures dans les programmes. Cependant, pas un mot sur le fait qu'en Suède le salaire moyen d'un PDG est 60 fois le salaire moyen d'un travailleur, ratio qui atteint 226 au Québec. 16,17 Pourtant, on ne trouve pas la chronique ou article de La Presse demandant une réduction de cet écart au Québec pour s'aligner avec la Suède. Curieux.
En long et en large, ce grand dossier de La Presse nous dit que l'État dépense trop et choisit de cibler comme cause les groupes les plus vulnérables, tout en taisant toute problématique liée aux plus nantis et à la répartition équitable du pouvoir économique et de la richesse. C'est un point de vue qui ouvre la porte à des dérives comme celle qui se déroule présentement aux États-Unis, où un milliardaire a maintenant la main mise sur des décisions de l'État, dont potentiellement celles concernant les contrats et subventions qui pourraient être accordés à sa propre compagnie, le tout au nom de l'efficacité et de la productivité.
Il est facile de demander des sacrifices aux plus démunis, aux enfants et aux aînés, d'autant plus que ce sont des groupes typiquement sans pouvoir et sans tribune. C'est curieux que Mmes Gramond et Fournier n'en demandent pas autant aux plus riches ni aux pouvoirs économiques et politiques dont La Presse semble se faire le porte-parole.
C'est comme si on s'identifiait plus aux multimillionnaires et milliardaires qui aimeraient tout privatiser pour ornementer leurs fortunes. On devrait plutôt se battre pour notre vrai groupe d'appartenance, car, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire, nous sommes tous plus proches de devoir dormir à l'entrée des stations de la STM que de s'acheter un yacht ou une île privée (deux gestes extrêmement problématiques, mais c'est sujet pour un autre moment).
Notes
1. État-providence : le Québec à l'heure des choix
2. Le Québec à l'heure des choix
3.Les inégalités de revenus ont plus augmenté qu'il n'y paraît au Québec
4. Ibid.
5.Ibid.
7.Le Québec à l'heure des choix
8.Statistiques Canada. Tableau 36-10-0222-01 (calculs de l'auteur).
9.Un gouvernement de propriétaires – Institut de recherche et d'informations socioéconomiques
10.Legault refuse de parler de crise du logement : « ça a des impacts »
11.État-providence : le Québec à l'heure des choix
12. Les médecins spécialistes réclament une hausse de rémunération « équitable »
13. Le fossé de la rémunération se creuse entre médecins et infirmières
14.L'effet Barrette : 42 % de plus pour les médecins spécialistes
15.Le Québec à l'heure des choix
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
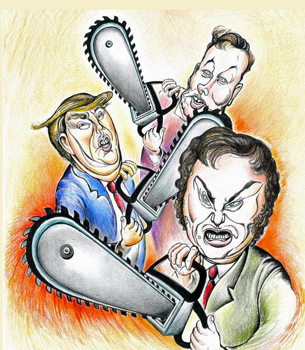
Trump le « pacificateur » comme Hitler le « chancelier de la paix » !
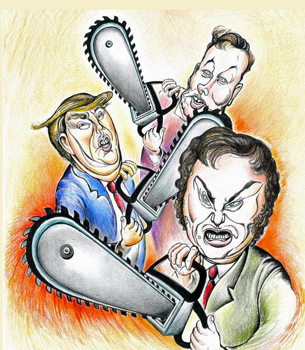
Friedenskanzler, c'est-à-dire Chancelier de la paix. Si on vous dit que c'est comme ça que qu'on appelait … Hitler avant que celui-ci déclenche la Seconde Guerre mondiale, vous n'en croirez pas vos oreilles. Et pourtant, c'est la vérité car l'image d'un Hitler « pacifiste » n'était pas cultivée seulement par ses acolytes mais aussi par tous ces Européens – et ils étaient la majorité – qui aimaient prendre pour argent comptant ses professions de foi en faveur de la paix, car pensant que, tout compte fait, « Hitler était mieux que les communistes ou le Front Populaire ».
17 février 2025 | tiré du site entre les lignes entre les mots | Illustration : Ensemble avec Musk, Vance et Milei - dssin de Sonia Mitralias
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/17/trump-le-pacificateur-comme-hitler-le-chancelier-de-la-paix/#more-90801
Cela se passait il y a presque un siècle avant qu'un ami et propagandiste des actuels nostalgiques de ce même Friedenskanzler d'antan, (comme le sont le AFD allemand, les Fratelli d'Italia de Mme Meloni, Le Vox espagnol de M. Abascal, les fidèles de M. Zemmour et accessoirement de Mme Le Pen, et tant d'autres) se présente aussi comme un « pacificateur » qui n'a qu'une ambition : mettre fin aux guerres en Palestine et en Ukraine ! Évidemment, ce nouveau Friedenskanzler est Donald Trump, bien que ce même Donald Trump proclame haut et fort qu'il a l'intention de prendre possession, « par tous les moyens », du Canada, du Panama, du Groenland, de Gaza et qui sait de quel autre endroit du monde. Et ceux qui le présentent comme tel sont tous ceux qui ont intérêt à ce que les guerres en Ukraine et en Palestine se terminent le plus vite possible selon les termes de Donald Trump et de son second (?) Elon Musk : par le triomphe des génocidaires Poutine et Netanyahou et l'extermination ou le nettoyage ethnique des Ukrainiens et des Palestiniens !
En somme, l'histoire ne se répète pas toujours comme une farce. Et l'affinité du présent avec les – pas si lointaines – années ‘30 devient évidente quand par exemple il suffit de remplacer l'Ukraine sacrifiée de 2025 par la Tchécoslovaquie sacrifiée de 1938 pour réaliser que puisque pratiquement rien n'a changé, on pourrait très bien s'attendre à une pareille suite tragique des évènements…
D'ailleurs, cette affinité, sinon filiation de ces deux prétendus « pacificateurs », crève parfois les yeux. Comme quand M. Trump pense « résoudre » la question moyen-orientale en prenant possession de Gaza et en chassant ses habitants Palestiniens vers une destination plus ou moins « exotique » et farfelue. Si ce plan pour le moins extravagant du président américain vous rappelle un non moins extravagant plan du régime nazi, vous avec tout à fait raison : il s'agit du « plan Madagascar » qui ambitionnait de « résoudre » la « question juive » en vidant l'Europe de ses 11-12 millions de Juifs, lesquels seraient transportés de force à Madagascar transformé en un gigantesque ghetto ! Si ce plan monstrueux n'a jamais été mis en application, cela est dû uniquement au fait que la Grande Bretagne n'a pas été défaite par les nazis, et que sa flotte a continué à interdire l'accès de Madagascar. Cependant, son souvenir reste toujours vivace chez les dirigeants de l'AFD néonazi, tant admirés par Elon Musk et le vice-président des Etats-Unis J.D. Vance, et a refait surface durant leur réunion « secrète » avec leurs amis Autrichiens à Potsdam fin novembre passé, en tant que référence et précèdent « idéologique » de leur intention actuelle de chasser les millions de migrants et autres citoyens allemands descendants de migrants vers un « Madagascar » du 21e siècle !
Alors, à l'opposé de ce que prétendent nos gouvernants, nos médias et leurs « analystes », Trump et Musk n'improvisent pas du tout quand ils nous « surprennent » jour après jour avec leurs déclarations, leurs actes et même leurs gestes (p.ex. le double salut nazi de Musk). En réalité, il suffit de connaitre un peu ce qu'ont dit et ont fait les dirigeants nazis, pour comprendre que Trump et Musk suivent ou même copient leur exemple. C'est ainsi que Trump copie le tristement célèbre besoin d'« espace vital » (Lebensraum) du Troisième Reich, quand il déclare que la population israélienne se trouve à l'étroit dans l'actuel État d'Israël, et c'est pourquoi il consent à l'annexion par Israël de la Cisjordanie et qui sait de quelles autres régions du Moyen Orient sur lesquelles Netanyahou et ses amis prétendent avoir un… « droit biblique » !
Mais, quel besoin a-t-on de ces exemples en guise de preuves de leur néofascisme, quand Trump, Musk, Vance et Milei font vraiment tout et devant les yeux de tout le monde, pour nous persuader, au-delà de tout doute, qu'ils se revendiquent du nazisme et qu'ils œuvrent pour unifier sous leur direction tout ce qu'il y a de vermine nostalgique du fascisme et du nazisme de par le monde ? D'ailleurs, n'est-il pas le second de Trump, cet inénarrable J.D. Vance qui a fait l'éloge des nostalgiques de Hitler et Mussolini devant la fine fleur des gouvernants européens réprimandés par lui pour ce qu'il leur reste d'antifascisme, avant qu'il rencontre en privé son amie, la leader de l'AFD néofasciste seulement quelques jours avant les élections allemandes ? Que faut-il de plus pour qu'on arrête tant à droite qu'à gauche, de décrire Trump et même Musk comme… « populistes », et de qualifier leurs affinités électives avec les nazis de simples… « provocations » et d'actions « controversées » ?
Ça va de soi que ce penchant prononcé de Trump, Musk, Vance ou Milei pour la violence brute et pour tout ce qui rappelle le nazisme ou le fascisme triomphant, n'aurait qu'un intérêt moyen s'il ne mettait pas en péril la vie des millions de gens, l'existence des pays entiers et la paix dans le monde. En effet, ce qui caractérise le « pacificateur » Trump est que sa paix ressemble comme deux gouttes d'eau à la paix des cimetières. Une paix faite sans et contre les victimes de la guerre tant en Ukraine qu'en Palestine. Une paix qui rappelle celle annoncée par Hitler quand il « unifiait » et « pacifiait pour toujours » l'Europe conquise par sa Wehrmacht et soumise par sa Gestapo et ses SS. Une pseudo-paix qui donnera des ailes aux bourreaux et conduira inévitablement à une conflagration et un bain de sang encore plus générales…
Quant à nous, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous écrivions en juin 2022, quand nous dénoncions déjà nos gouvernants qui « ont le culot de commencer à discuter entre eux quelle partie de l'Ukraine ils pourraient céder, ces impérialistes occidentaux (!), à Poutine, dans le dos des Ukrainiens et de leur gouvernement ! » Et nous concluions avec ces mots : « Bien que nous ayons ici un cas carabiné de l'interventionnisme et du paternalisme impérialiste le plus scandaleux, il y a peu de gens de gauche qui osent faire ce qui va de soi, à savoir le dénoncer publiquement, comme il le mérite. Et malheureusement, sont encore moins nombreux ceux qui osent soutenir le droit encore plus évident et élémentaire des Ukrainiens – qu'ils défendent bec et ongles – de se battre jusqu'au bout et par tous les moyens contre les envahisseurs russes, en décidant eux-mêmes librement et démocratiquement, et sans aucune ingérence étrangère hostile ou « amicale », de l'avenir de leur pays et des personnes qui y vivent ! » [1]
Yorgos Mitralias
Note
1] Voir notre article Qu'est-ce que cette guerre étrange où on interdit à l'Ukraine que Poutine « soit humilié » :
https://europe-solidaire.org/spip.php?article62858
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

G7, G8 ou G6 sans les États-Unis ?

L'orientation idéologique que prend actuellement le gouvernement américain l'éloigne des autres membres du G7, qui auraient en juin une occasion de l'expulser, une idée qui avait déjà surgi en 2018 lors d'une précédente guerre commerciale démarrée par ce pays.
En janvier, le Canada a assumé la présidence du G7 dont le sommet se tiendra du 15 au 17 juin à Kananaskis en Alberta. Depuis 50 ans, l'organisme qui comprend le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Union européenne, le Japon, les États-Unis et le Canada coordonne les réponses des démocraties libérales face aux défis qu'elles rencontrent. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a qualifié le G7 en 2022 de « comité directeur du monde libre » et le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, affirme actuellement qu'il est le groupe des grandes démocraties les plus avancées.
La Russie en a été membre pendant un certain temps, soit de 1997 jusqu'en 2014, date à laquelle elle en a été expulsée pour avoir envahi l'Ukraine. Or, le président Trump a récemment soutenu que la Russie aurait dû conserver son adhésion et plaidé pour sa réintégration, qualifiant son exclusion d'erreur.
Les États-Unis dans l'internationale réactionnaire
S'il est prévu cette année d'y discuter les enjeux mondiaux, la présence au sein de ce groupe d'un pays ayant changé d'allégeance politique pourrait forcer ses membres à prendre une décision difficile en ce qui concerne le nombre de ses participants. L'arrivée du nouveau gouvernement Trump le 20 janvier avec l'agenda MAGA (Make America great again) amène son pays sur la voie de ce qui a récemment été qualifié d'internationale réactionnaire. En exemple de cela, le 14 février, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, le vice-président américain, J. D. Vance, a prononcé un discours qui a mis à mal la relation transatlantique des États-Unis. Selon lui, la véritable menace pour l'Europe ne proviendrait pas d'acteurs extérieurs, mais de l'attitude des gouvernements européens qui ne sont pas à l'écoute des préoccupations de leurs électeurs les plus radicaux. « En Grande-Bretagne et à travers l'Europe, la liberté d'expression, je le crains, est en retrait », a-t-il affirmé, soutenant plusieurs partis nationalistes de droite, telle l'Alternative für Deutschland (AfD), acceptant des néonazis dans ses rangs.
L'éviction du président Zelensky et des Européens des pourparlers de paix sur l'Ukraine a été un autre coup porté à cette relation transatlantique, ce qui a eu comme conséquence la création d'un « conseil de crise » formé de représentants français, britanniques, italiens, polonais et espagnol. Donald Trump met en place un nouvel ordre mondial en négociant seul avec Vladimir Poutine. Le président américain commence aussi une guerre économique internationale. Entre autres choses, l'acier et l'aluminium européen et du Canada pourraient prochainement être taxés à la hauteur de 25 % par les États-Unis, diverses nouvelles taxes visant aussi le Mexique et la Chine.
Réintégrer la Russie ou expulser les États-Unis ?
Jean-Noël Barrot considère comme « inimaginable » que la Russie réintègre aujourd'hui le G7, puisqu'elle en agresse des membres et se comporte de moins en moins comme une démocratie. La ministre des Affaires étrangères du pays hôte de la rencontre en juin, Mélanie Joly, a aussi déclaré que le Canada s'opposait fermement à cette réintégration.
L'idée d'exclure les États-Unis du G7 avait été présentée une première fois lors de la réunion de 2018 qui avait eu lieu à Charlevoix au Québec. Une semaine avant cette rencontre, Trump avait aussi imposé des droits de douane aux métaux provenant de l'Union européenne, du Mexique et du Canada. Les ministres des finances des pays visés avaient alors annoncé que leur coopération et collaboration avait été mise en danger en raison d'actions d'un pays membre. Le président de la France, Emmanuel Macron, avait alors fait le commentaire que le G7 ne serait pas très dérangé de redevenir G6, suggérant que le groupe pourrait être mieux sans les États-Unis, qui avaient d'ailleurs décidé de ne pas signer le communiqué final de la rencontre. Trump avait alors aussi dit qu'il voulait que la Russie revienne dans le G7.
Lors de la rencontre du G7 qui s'est tenu en Europe en 2024, les pays membres avaient réitéré leur attachement aux « principes démocratiques et aux sociétés libres, aux droits de la personne universels, au progrès social et au respect du multilatéralisme et de la primauté du droit ». Ils affirmaient avoir la volonté de renforcer les règles et les normes internationales pour le bien de tous. Or, les actions du gouvernement de Donald Trump montrent qu'il ne respecte pas cet ordre international.
Il y a quelques semaines, au sommet de Paris sur l'IA, le vice-président J.D. Vance s'en est pris aux lois européennes sur l'IA et les marchés numériques (DMA) qui doivent prévenir les abus des réseaux et les dérives dans l'intelligence artificielle parce qu'elles touchaient les Gafam. De plus, les déclarations du président américain qui veut vider Gaza de ses habitants et celles affirmant qu'il est prêt à utiliser la force militaire pour s'accaparer du Groenland, du Panamá et faire du Canada le 51e État américain en utilisant des contraintes économiques, montrent que Donald Trump est déterminé à mettre en place un nouvel ordre mondial basé sur l'injustice et la négation des droits des faibles. La mise en pratique cette année des propos de 2018 d'Emmanuel Macron empêcherait le président américain de détruire le G7 de l'intérieur et protégerait la crédibilité de l'organisme.
Michel Gourd
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

PAJU exige la démission de la ministre Pascale Déry

Un article du Devoir révèle que la ministre québécoise Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, a mené une enquête sur les cégeps Dawson et Vanier de Montréal sous l'influence de groupes pro-israéliens, CJA et CIJA(Centre consultatif des relations juives et israéliennes). Selon l'article, le site Internet de CJA affirme avoir influencé Mme Déry, avec l'aide de CIJA, pour lancer l'enquête. L'article du Devoir cite le site Internet de CJA : « Nous sommes heureux de cette décision et nous continuerons de collaborer directement [“to engage directly”] avec la ministre et les établissements au cours du processus », avait aussi écrit le CIJA sur sa page Facebook, dans une publication en anglais.
23 février 2025 | Tiré du site du PAJU
L'article du Devoir précise encore : Membre de la communauté sépharade, la ministre Déry a siégé au conseil d'administration du CIJA de 2016 à 2022. Le 4 février, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) lui a transmis une lettre dans laquelle elle dénonce l'« instrumentalisation politique du processus d'enquête administrative » que ferait la ministre aux collèges Dawson et Vanier, de même que l'« apparence de conflit d'intérêts » dans laquelle elle se place en raison de son implication passée au CIJA.
Ingérence dans le choix du cours académique
En mêlée de presse mardi le 18 février 2025, Mme Déry n'a pas répondu aux questions portant sur ce possible conflit d'intérêts. Elle a reconnu avoir exprimé des réticences à propos du cours de français intitulé « Appartenances palestiniennes » offert au collège Dawson.
Mme Déry a dit : « Je suis effectivement intervenue sur le contenu du cours pour une simple et bonne raison, c'est que le contexte était vraiment explosif, a-t-elle justifié. Ce que j'ai demandé, c'est : pour éviter de jeter de l'huile sur le feu, est-ce que dans ce cours de français, […] on aurait pu éviter de parler d'enjeux plus sensibles et plus clivants ? » Elle a souligné que « certains étudiants » avaient « des malaises » avec le contenu du cours.
Toujours selon l'article du Devoir, « Dans une récente enquête de La Presse, 10 enseignants ont dit avoir vu dans ce geste une ingérence de la part de la ministre. Des sources ont fait état au Devoir d'inquiétudes semblables ». La FNEEQ-CSN a réagi aux aveux de Pascale Déry. Le syndicat s'est dit « profondément indigné par l'admission de la ministre, elle-même signataire de la convention collective des profs de cégeps, où elle s'est engagée à respecter la liberté académique ».
« Ce principe fondamental est même reconnu par l'UNESCO, qui rappelle que l'État ne doit jamais s'ingérer de la sorte. Cette bévue de la ministre indique qu'il est temps de renforcer et d'étendre la Loi sur la liberté académique [dans le milieu universitaire] au réseau collégial, comme le réclamait la Fédération dès 2021 », a fait savoir le président du regroupement syndical, Benoît Lacoursière, cité dans l'article du Devoir.
Gouvernement québécois pro-Israël
Pascale Déry a démontré sans l'ombre d'un doute qu'elle s'est ingérée dans l'administration du Collège Dawson et du Cégep Vanier au nom de deux organisations pro-israéliennes, dont l'une qu'elle a représentée en tant que membre du conseil d'administration de 2016 à 2022. Elle est de plus un parfait exemple de la tendance pro-israélienne et anti-palestinienne du gouvernement caquiste québécois actuel de François Legault. Nous rappelons au public que c'est le gouvernement Legault qui a ouvert un bureau commercial à Tel-Aviv en pleine connaissance de la nature apartheid de l'État d'Israël et du génocide à Gaza à partir d'octobre 2023. Récemment, le coprésident de PAJU, Bruce Katz, a envoyé à la ministre des Affaires internationales du Québec, Martine Biron, une lettre ouverte demandant à savoir si le bureau du gouvernement Legault à Tel-Aviv est ouvert. Mme Biron n'a pas répondu.
La démission exigée
Dans ces circonstances, il incombe à Mme Déry de démissionner de son poste de ministre. Mme Déry a clairement outrepassé son mandat et se trouve clairement en situation de conflit d'intérêts ayant des ramifications politiques. Elle se positionne comme ministre en fonction de valeurs communautaristes. Qu''elle soit juive sépharade n'est pas la question : toute personne a un héritage, une culture. Mais qu''elle se serve de son poste de ministre pour promouvoir des valeurs sionistes, des valeurs Israël First, c'est tout le gouvernement Legault qui est en cause.
Si Mme Déry refuse de démissionner, il incombe au gouvernement Legault de la démettre de ses fonctions. Sinon, le gouvernement Legault se rendrait complice du conflit d'intérêts de Pascale Déry et de son ingérence politique dans l'administration des cégeps du Québec. Elle a bafoué le principe de la liberté académique et doit pour cette raison démissionner ou être démise de ses fonctions par le premier ministre du Québec.
– 30-
Contact : info@paju.org
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











