Derniers articles

Des activistes occupent le Parlement canadien pour protester contre la guerre de Gaza et l’armement d’Israël

« Le Canada doit cesser d'armer Israël et mettre en œuvre un embargo immédiat sur les armes. » À Ottawa, plus de 100 militants juifs ont entamé un sit-in à l'intérieur d'un édifice parlementaire canadien mardi pour exiger que le Canada cesse d'armer Israël. Rachel Small, membre de la Coalition des Juifs disent non au génocide et membre du sit-in, affirme que les affirmations du gouvernement canadien selon lesquelles il cesse les livraisons d'armes à Israël occultent le fait que des armes canadiennes sont toujours transportées via les États-Unis. "Nous sommes ici pour nous assurer qu'ils ... coupent le flux », explique Small. De telles protestations « sont ce que nous devrions voir davantage », ajoute le journaliste israélien et ancien objecteur de conscience Haggai Matar.
Tiré de Democracy Now
Invités Rachel Small
membre de la Coalition des Juifs disent non au génocide et principal organisateur canadien de World Beyond War.
Haggée Matar
Journaliste et militant israélien, directeur exécutif du magazine +972 et objecteur de conscience qui a refusé de servir dans l'armée israélienne.
Crédit image : Les Juifs disent non à la Coalition contre le génocide
Transcription
Il s'agit d'une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme finale.
AMY GOODMAN : Aggée, vous avez demandé si les gens en font assez. Je veux entrer dans cette conversation avec cette nouvelle de dernière minute. Au Canada, environ 150 militants juifs et alliés viennent de lancer une manifestation devant le Parlement canadien à Ottawa pour exiger que le Canada cesse d'armer Israël.
Nous sommes maintenant rejoints par Rachel Small, membre du groupe Juifs disent non à la Coalition pour le génocide.
Rachel, pouvez-vous décrire où vous en êtes, ce que vous faites et ce que vous demandez ?
RACHEL SMALL : Merci. Nous sommes dans un édifice de la Colline du Parlement. À l'heure actuelle, nous avons complètement pris le contrôle du hall d'entrée de cet édifice, où se trouvent des centaines de bureaux de parlementaires.
Notre exigence est claire : le Canada doit cesser d'armer Israël et mettre en place un embargo immédiat sur les armes. Nous savons que chaque avion de chasse F-35, chaque hélicoptère Boeing Apache qui largue des bombes sur le Liban et Gaza en ce moment est rempli de centaines de composants canadiens. Nous sommes ici en tant que Juifs pour dire que cette violence ne peut pas continuer en notre nom. Et nous sommes ici en tant que gens de conscience pour dire que le strict minimum que le Canada doit faire en ce moment est d'arrêter d'armer un génocide.
JUAN GONZÁLEZ : Haggai Matar, quelle est votre réponse à ce genre d'actions qui se produisent à l'étranger ? Cela a-t-il un impact sur le public israélien ?
HAGGAI MATAR : Tout d'abord, je tiens à féliciter les militants qui sont sur le terrain à Ottawa. C'est incroyable. C'est exactement le genre de protestation que les gens devraient entreprendre au Canada, certainement aux États-Unis, qui sont le plus grand fournisseur d'armes, de financement et de soutien diplomatique à Israël. Donc, oui, c'est ce que nous devrions voir de plus en plus.
Je crains qu'en Israël, encore une fois, ces manifestations soient généralement considérées comme antisémites ou, dans le cas des Juifs qui protestent, comme des Juifs qui se haïssent eux-mêmes ou des gens déséquilibrés. C'est ainsi qu'il est perçu. C'est notre travail en tant qu'Israéliens juifs sur le terrain, en parlant en hébreu, en parlant aux gens de nos communautés, d'essayer de les aider à comprendre que ce n'est pas le monde qui est devenu fou, c'est nous.
AMY GOODMAN : Il est intéressant de noter que le premier ministre Justin Trudeau vient de rencontrer le président élu Trump à Mar-a-Lago, en Floride. Rachel Small, nous regardons le groupe de personnes. L'une d'elles, je crois, dit « Juifs pour une Palestine libre ». Quelle a été la position de Trudeau ? Et qu'est-ce qui va vous arriver ce matin ?
RACHEL SMALL : Au cours des 13 derniers mois, nous avons assisté à une vague de résistance sans précédent au Canada, à des milliers de personnes partout au pays, non seulement à adresser des pétitions à leurs députés, non seulement à manifester, à les rencontrer, mais aussi à imposer des barrages dans les usines d'armement, à faire tout ce que nous pouvons pour que le Canada cesse d'armer Israël.
Et cette pression a amené le gouvernement canadien à adopter une position que nous n'aurions pas cru possible il y a un an ou deux. Ils se sont engagés à cesser d'armer Israël. En fait, le ministre des Affaires étrangères a récemment dit que les armes canadiennes n'allaient pas être utilisées à Gaza.
Malheureusement, ce n'est pas vrai. Malheureusement, nous savons qu'ils ne se sont pas attaqués à tous les permis et qu'ils ont continué d'envoyer des armes aux États-Unis sans même avoir besoin d'un permis. Ceux-ci sont utilisés dans tous les F-35 utilisés par Israël. Il s'agit de l'arme de guerre principale d'Israël.
Nous avons donc poussé le gouvernement canadien dans un coin où il sait quelle est la bonne position. Ils savent qu'ils doivent arrêter d'armer Israël. Et nous sommes là pour nous assurer qu'ils le font. La vaste coalition Embargo Now s'est réunie dans tout le pays et a en fait obtenu l'appui officiel de 45 parlementaires à l'appel en faveur d'un embargo sur les armes. Nous avons simplement besoin que le gouvernement intervienne et prenne des mesures pour couper le flux de toutes les armes à destination et en provenance d'Israël. C'est le strict minimum qu'ils doivent faire.
AMY GOODMAN : C'est Rachel Small, membre de la Coalition des Juifs disent non au génocide. Si vous avez un peu de mal à la comprendre, elle est à l'intérieur du Parlement canadien à Ottawa. Il y a des dizaines de personnes derrière elle, l'organisatrice canadienne principale de World — avec le groupe World Beyond War. Et dans le studio avec nous à New York, bien que généralement à Tel Aviv, se trouve Haggai Matar, journaliste israélien, activiste, directeur exécutif du magazine +972, lui-même objecteur de conscience. Juan ?
JUAN GONZÁLEZ : Oui, Haggai, il ne nous reste qu'une minute environ, mais je voulais vous interroger sur la décision du président élu Trump de choisir l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Mike Huckabee, comme prochain ambassadeur des États-Unis en Israël. Huckabee n'est pas seulement un sioniste chrétien américain de premier plan qui a ouvertement plaidé pour l'annexion de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël, il a déclaré en 2008 qu'il n'y a vraiment rien de tel qu'un Palestinien. Qu'attendez-vous de ce genre d'ambassadeur de la nouvelle administration Trump ?
HAGGAI MATAR : Donc, évidemment, les nominations et les politiques de Trump sont terrifiantes pour nous et devraient l'être aussi pour tous ceux qui se soucient des droits des Palestiniens. Je tiens également à souligner, cependant, que les politiques de Trump ont une contradiction inhérente. En tant qu'isolationniste, Trump ne veut pas s'impliquer dans trop de guerres. En tant que personne qui veut rompre des accords avec l'Arabie saoudite et les États arabes du Golfe, il voudra peut-être s'assurer qu'ils ne dérivent pas dans le champ d'influence Iran-Chine. Et ces deux politiques, être pro-annexion et pro-colonies et pro-Israël et être pro-guerre et vouloir signer des accords, elles se heurtent. Et je pense que c'est notre rôle à gauche de mettre un coin là-dedans et d'essayer de faire en sorte qu'il devienne de plus en plus évident comment ces politiques entrent en conflit les unes avec les autres.
AMY GOODMAN : Haggai Matar, je tiens à vous remercier infiniment d'être avec nous, journaliste israélienne, militante, directrice exécutive du magazine +972, ancienne objectrice de conscience, a refusé de servir dans l'armée israélienne.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Pourquoi chercher des liens économiques avec une dictature américaine ?

Difficile de croire que le gouvernement fédéral fait des plans pour raffermir ses liens avec les États-Unis au moment où D. Trump redevient Président. Il a dit qu'il serait le dictateur d'un jour. Il risque fort de l'être plus longtemps.
Gordon Laxer, Canadian Dimensions, 27 novembre 2024
Traduction, Alexandra Cyr
Le Canada ne renforce pas ses liens économiques avec la Chine, la Russie ou la Corée du nord. Devrions-nous le faire avec un Trump à la tête des États-Unis s'il se comporte comme un dictateur ?
Son second mandat sera sans doute différent du premier. Il comprend beaucoup mieux les vulnérabilités du système. Il nomme des hommes et des femmes « soumis.es » et déclare qu'il s'en prendra à ses adversaires. La Cour suprême lui a garanti l'immunité. John Kelly, son ancien chef de cabinet a dit que la définition du terme « fasciste » peut lui être appliquée.
Même si les garde-fous américains disparaissent, le Canada tente de réveiller l'esprit de la vielle « équipe Canada » pour dire à D. Trump et son équipe ainsi qu'aux gouverneurs.es républicains.es, que la prospérité américaine dépend des liens économiques avec le Canada. Le problème est que commercer avec nous a bien moins d'impact pour eux que pour nous. La campagne électorale de D. Trump a été largement basée sur le slogan « America-first » pas sur Amérique du nord d'abord. Pourquoi le Président désigné Trump se préoccuperait-il des dommages chez-nous ? Laissons l'esprit « Team Canada » au hockey et au soccer.
Nous avons longtemps présumé que les États-Unis nous protégeraient des pressions des autocrates étrangers. Ça ne tient plus. Dans le passé, l'évaluation des dangers que présentent les dictatures était incroyablement naïve. Après avoir rencontré A. Hitler à Berlin en 1937, le Premier ministre Mackenzie King déclarait que c'était un homme de paix et un ami du Canada. Cette naïveté ne s'est effacée qu'après l'invasion de la Pologne (par l'armée allemande). Le Canada a alors déclaré la guerre à l'Allemagne.
Est-ce que l'évaluation actuelle du danger que représente un puissant autocrate au sud de la frontière est tout aussi naïve ? Pourquoi donnerions-nous à un dictateur les moyens économiques de nous pousser à mettre fin à notre démocratie ? Ne serait-il pas plus approprié de desserrer nos liens économiques avec notre voisin, de plus compter sur nous-mêmes et de développer des liens plus étroits avec d'autres démocraties ?
Quand le commerce avec votre principal client tourne au vinaigre, vous êtes dans de mauvais draps. Bien sûr qu'il faut continuer à commercer avec les États-Unis, ce sont nos principaux partenaires mais éloignons-nous de l'hyper dépendance. Chacune de ces dépendances implique un échange de puissance. Le monde des affaires reconnait le danger de devenir dépendant d'un seul client. Le prix à payer devient trop élevé si votre bien-être tient à ce seul lien commercial. Il gagne trop de pouvoir sur vous et minimise votre habileté à bâtir votre propre avenir. Mieux vaut réduire ces risques en diversifiant sa base d'affaire. Cet adage s'applique aussi aux pays.
Adhérer à l'ALÉNA a été une erreur stratégique pour le Canada. À l'époque cela pouvait sembler avantageux mais c'était mettre tous ses œufs dans le seul panier américain. Nous avons naïvement pris pour acquis que les États-Unis demeureraient une démocratie protectrice. Et nous voilà devant la question de savoir si la démocratie peut survivre et se développer ici si les États-Unis deviennent une véritable dictature.
Les droits de douane que D. Trump veut imposer vont créer un mur contre nos exportations aux États-Unis. Nous allons être obligés de nous distancier du marché américain et chercher à commercer avec d'autres pays. Cela va aussi encourager les entreprises canadiennes à vendre plus à la population d'ici. C'est une bonne chose. Vendre à l'étranger n'est pas intrinsèquement mieux que de vendre au pays.
Après le Brexit, le Royaume uni a cherché à approfondir ses liens en dehors de l'Union européenne. Réanimons nos liens dans le Commonwealth, avec le Royaume uni, l'Australie et la Nouvelle Zélande avec qui nous avons déjà des liens culturels et affectifs. Nous devrions aussi nous rapprocher des pays démocratiques européens et de l'Amérique latine. Notre partenaire dans l'ALÉNA, le Mexique est un choix qui tombe sous le sens. Sa nouvelle Présidente, Mme Claudia Scheinbaum est à la tête d'un gouvernement progressiste qui est en train de rétablir son contrôle sur son économie. C'est un modèle pour le Canada.
La pandémie nous a appris qu'il était risqué de ne compter que sur une seule chaine mondiale d'approvisionnement. Ces structures sont fragiles et peuvent être perturbées par des changements politiques. C'est ce que provoque l'élection de D. Trump. Il est temps de rééquilibrer la place du Canada dans le monde. Si nous avons perdu un ami fiable ne pouvons-nous pas en gagner d'autres ? Allons-nous prendre en charge notre propre économie pour pouvoir maintenir la démocratie dans notre pays ?
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

VJI condamne la répression policière contre le mouvement de solidarité avec la Palestine

Partout au Canada et dans le monde, nous assistons à une augmentation marquée de la répression violente du mouvement de solidarité avec la Palestine. Voix juives indépendantes (VJI) condamne la criminalisation croissante de l'activisme de solidarité avec la cause palestinienne et l'utilisation d'une force excessive par la police pour intimider et harceler les militant.e.s.
Tiré du site web
2 décembre 2024 IJV Canada
Le 15 octobre 2024, le gouvernement canadien a inscrit le groupe Samidoun, également connu sous le nom de Réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens, sur la liste des « entités terroristes » en vertu du code pénal, en réponse à des mois de pression exercée par des groupes de pression pro-israéliens, quelques député.e.s libéraux.ales et l'opposition conservatrice. Le 14 novembre 2024,une équipe d'intervention d'urgencede la police de Vancouver a effectué une descente au domicile de Charlotte Kates, coordinatrice internationale de cette organisation, en utilisant des grenades flash et des véhicules blindés dans un quartier résidentiel. Ces dernières actions des autorités canadiennes constituent une violation flagrante de plusieurs droits fondamentaux garantis par la Charte. Indépendamment des divergences que l'on peut avoir avec Kates et Samidoun, cette répression vise clairement à intimider l'ensemble du mouvement de solidarité avec la Palestine en le menaçant de criminalisation.
Nous constatons de plus en plus souvent que cette dérive autoritaire est liée aux efforts déployés au niveau local pour soutenir la cause palestinienne. En novembre 2023, des manifestant.e.s qui avaient pulvérisé de la peinture rouge lavable sur la devanture d'un magasin de livres Indigo se sont réveillés lorsque la police a fait une descente violente chez eux, jetant leurs effets personnels et faisant tomber les portes de leurs gonds. En septembre 2024, la police de Toronto a fait sortir des militant.e.s juif.ve.s d'une manifestation eta bousculé et agressé un groupe de manifestant.e.s pacifiques à l'extérieur. La même semaine,la police de Calgary a fait un usage excessif de la force contre un groupe de manifestant.e.s pacifiques lors d'un rassemblement hebdomadaire contre le génocide en cours à Gaza. À Montréal, les forces de police ont utilisé du gaz lacrymogène et ont fait un usage excessif de la force contre des manifestant.e.s, fracturant le bras d'un manifestant.e et en blessant quatre autres, qui ont dû être transportés d'urgence à l'hôpital. Le 25 novembre,la police d'Ottawa a violemment arrêté des manifestant.e.s pacifiques lors d'un rassemblement hebdomadaire de solidarité avec Gaza. Ces événements témoignent d'un recours inacceptable à la violence de la part des services de police à l'encontre des Québécois.e.s et des Canadien.ne.s qui réclament justice et paix.
Cette répression continue ne vise pas à protéger la sécurité nationale ou la sécurité publique, mais à faire taire la dissidence, à intimider les militant.e.s et à étouffer les conversations critiques et nécessaires sur la complicité du Canada dans le génocide et l'apartheid israéliens.
Le processus de désignation d'une organisation comme entité terroriste a été largement critiqué par les groupes de défense des libertés civiles etdes droits de la personne en raison de son caractère discrétionnaire qui permet aux autorités d'ajouter un groupe à la liste, du manque de transparence et du déni des garanties procédurales de base prévues par la loi, ainsi que des graves conséquences auxquelles s'exposent les groupes ajoutés à la liste à tort ou par erreur. Dans ces conditions, le public ne devrait pas être prêt à accepter la désignation du gouvernement comme un fait, ou comme une mesure qui rendra nécessairement le public plus sûr.
La récente publication du manuel canadien sur la définitionde travail de l'antisémitisme de l'IHRA menace de légitimer encore davantage ce type de violence policière excessive et de répression gouvernementale. Ce manuel est conçu pour informer les services de police, les juges, les lieux de travail, les universités et d'autres institutions canadiennes sur la manière de mettre en œuvre la définition de travail de l'antisémitisme de l'IHRA, qui confond dangereusementla critique d'Israël et l'antisémitisme. S'il est suivi, ce manuel pourrait être utilisé pour justifier des descentes de police de plus en plus militarisées, comme celles dont nous avons été témoins à Toronto et à Vancouver, en partant du principe que dénoncer le génocide israélien ou qualifier le sionisme de projet colonial est considéré comme un crime haineux.
Les attaques du Canada contre les militant.e.s s'inscrivent dans une tendance internationale croissante qui menace gravement les libertés civiles fondamentales. Aux États-Unis, desrésolutions de la Chambre des représentants ont récemment été adoptées, qui donnent au gouvernement les moyens de réduire au silence et de réprimer l'activisme en faveur de la Palestine. La situation aux États-Unis risque d'empirer si Trump poursuit une initiative connue sous le nom de Projet Esther, qui utilise les accusations d'antisémitisme pour tenter de saper et finalement de criminaliser l'activisme de solidarité pro-palestinien. Au Royaume-Uni, le domicile d'un journaliste a été perquisitionné et ses biens confisqués. La chambre basse du parlement allemand a adopté un projet de loi sur l'adoption de l'IHRA, alors que les critiques se poursuivent sur la répression violente et la censure des activités de défense de la Palestine par le gouvernement.
En qualifiant le mouvement de solidarité avec la Palestine d'antisémite ou de terroriste, les gouvernements occidentaux criminalisent de fait l'impératif moral de dénoncer l'injustice. Alors que VJI et d'autres membres de la société civile du monde entier exigent un embargo total sur les armes, des sanctions contre les responsables israéliens, la fin de la complicité internationale dans les crimes de guerre d'Israël et le respect par leurs gouvernements du droit international et de ses tribunaux, les gouvernements occidentaux ont choisi d'intensifier la répression de la dissidence.
Il ne s'agit pas seulement de défendre les droits des Palestinien.ne.s, il s'agit de défendre les libertés fondamentales qui nous protègent tous. Si nous permettons à l'État de supprimer ces droits au nom de la protection d'Israël, nous sommes tous.tes en danger. La lutte pour la libération des Palestinien.ne.s est indissociable de la lutte pour la justice sur l'île de la Tortue. Il est impératif que nous soyons solidaires des militant.e.s de la solidarité avec la Palestine et que nous résistons à la criminalisation de la dissidence par le gouvernement, sinon nous subirons tous les conséquences de vivre dans une société où la répression politique est la norme et où les gouvernements – quelle que soit leur couleur politique – déterminent quel discours politique est acceptable et lequel doit être réduit au silence.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Une coalition demande la démission du ministre de l’Immigration Marc Miller et une enquête publique sur la répression policière

4 décembre 2024, Montréal - Une coalition de groupes locaux de solidarité avec la Palestine demande que des mesures soient prises pour contrer la répression policière croissante et les fausses accusations portées contre les manifestants pro-palestiniens.
La Coalition Police Pas Palestine (PPP) a été formée en réponse à la révélation que des membres du personnel du ministre fédéral de l'Immigration Marc Miller ont fait de fausses
accusations à la police, menant à des accusations criminelles contre des manifestant.e.s pacifiques.
La Coalition organise une conférence de presse au Palais de Justice de Montréal (10 rue St Antoine) le jeudi 5 décembre à 11h00 afin de présenter
ses trois revendications :
1. la démission immédiate du ministre de l'Immigration Marc Miller ;
2. la nomination d'un nouveau ministre de l'Immigration qui appliquera aux Palestinien.ne.s la même politique que le gouvernement canadien applique actuellement aux Ukrainiens ; et
3. la nomination d'une commission publique indépendante chargée d'enquêter sur la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine par la police de Montréal.
Depuis le mois de mars, les manifestant.e.s ont organisé des sit-in pacifiques devant le bureau de Marc Miller. Ces sit-in ont été lancés par Samar Alkhdour, une résidente palestinienne de Montréal qui a perdu sa fille Jana à Gaza à cause de l'inaction d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Elle a commencé les sit-in pour contester les retards dans le traitement des demandes et demandeuses d'asile des Palestinien.ne.s, y compris celle de sa sœur.
En septembre, des membres du personnel du bureau de M. Miller ont fourni de fausses informations à la police contre Mme Alkhdour et deux autres manifestant.e.s. Le personnel de M. Miller a prétendu que les manifestant.e.s avaient encerclé la voiture de M. Miller, crié des obscénités et tapé sur la voiture, l'endommageant ainsi. La police a alors arrêté trois manifestant.e.s qui ont passé une nuit en prison.
Les accusations ont finalement été retirées le 29 novembre, la vidéo prouvant qu'elles étaient totalement fausses. M. Miller ne s'est pas manifesté pour rectifier les faits et a ainsi permis qu'une erreur judiciaire se poursuive pendant près de trois mois. « Un ministre fédéral a permis que des manifestant.e.s soient inculpé.e.s et jeté.e.s en prison alors qu'il savait personnellement qu'ils étaient innocent.e.s », déclare Barbara Bedont, avocate de la Coalition. « Cela ne devrait jamais se produire dans une société démocratique. »
Les fausses accusations dans cette affaire s'inscrivent dans le contexte plus large de l'incapacité du ministre de l'immigration à assumer les responsabilités du Canada à l'égard des réfugiés du génocide à Gaza. « Depuis plus d'un an, nous demandons à M. Miller de permettre aux réfugié.e.s palestinien.e.s de venir au Canada, mais il refuse de bouger », déclare Samar Alkhdour. « Nous avons besoin d'un ministre de l'immigration qui offre le même soutien aux Palestinien.ne.s qu'aux Ukrainien.ne.s, dont près d'un million ont été autorisés à venir au Canada depuis le début de l'invasion russe. »
Le groupe demande également la création d'une commission indépendante chargée d'examiner la répression policière croissante du mouvement de solidarité avec la Palestine. L'affaire qui a été rejetée le 29 novembre 2024 n'est qu'un cas parmi des dizaines d'autres où des manifestant.e.s pro-palestiniens sont faussement accusés de crimes alors que les actes de harcèlement et d'intimidation à l'encontre des manifestant.e.s pro-palestiniens sont ignorés, voire encouragés.
« Il y a une abondance de preuves que le SPVM surveille excessivement le mouvement pro-palestinien », déclare le professeur Ted Rutland de l'Université Concordia. « Nous demandons à la Ville de Montréal de mettre sur pied une commission publique indépendante qui aura la confiance de la communauté pour examiner ces violations systémiques.
Parmi les questions qui seront examinées par la Commission indépendante, il y a celle de savoir si les agent.e.s du SPVM ont été responsables ou complices des actes de vandalisme commis lors des manifestations anti-OTAN au Palais de Congrès le 22 novembre dernier. Lors de la conférence de presse, la Coalition présentera des preuves vidéo d'actes de vandalisme et de violence non provoquée commis par des agents du SPVM lors de manifestations pro-palestiniennes, ainsi que de représentations erronées de la loi.
Pour visionner les preuves vidéo, veuillez consulter le site nopp.ca.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les 49 fois où les États-Unis ont utilisé leur pouvoir de veto contre des résolutions de l’ONU concernant Israël

Rien que pour cette dernière année, Washington a mis son veto à quatre résolutions du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu à Gaza.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Les États-Unis ont mis mercredi dernier leur veto face à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Cette décision marque la 49e utilisation des États-Unis de leur pouvoir de veto à l'encontre de projets de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies concernant Israël.
Le projet de résolution a été présenté par les dix membres élus du Conseil de sécurité et tous les membres, à l'exception des États-Unis, ont voté en sa faveur.
Ce veto marque plus d'un an de soutien diplomatique des États-Unis à Israël dans sa guerre contre Gaza, qui s'est poursuivie le mois dernier par l'invasion du Liban par Israël.
Toutefois, ce soutien diplomatique de Washington à Israël n'est pas nouveau et se poursuit sur une base bipartisane depuis des décennies.
Outre l'aide militaire d'un montant d'environ 3 milliards de dollars qu'ils lui accordent chaque année, les États-Unis sont également le principal allié d'Israël au sein des institutions internationales et ont souvent utilisé leur pouvoir de veto au Conseil de sécurité pour bloquer les mesures diplomatiques visant Israël en raison de leur traitement des Palestiniens.
Premier veto
Selon la Jewish Virtual Library, les États-Unis ont déjà utilisé leur pouvoir de veto 48 fois contre des projets de résolution du Conseil de sécurité concernant Israël depuis qu'ils ont commencé à l'utiliser en 1970.
La première, la résolution S/10784, exprimait une profonde inquiétude « face à la détérioration de la situation au Moyen-Orient » et visait l'agression israélienne à la frontière libanaise.
Rédigée par la Guinée, l'ancien pays de la Yougoslavie et la Somalie, les États-Unis ont été les seuls à s'opposer à la résolution. Le Panama s'est abstenu.
Plusieurs résolutions similaires ont également fait l'objet d'un veto américain au cours des années suivantes. En 1975, année où la guerre civile a éclaté au Liban, la résolution S/11898 demandait à « Israël de renoncer immédiatement à toute attaque militaire contre le Liban ». Là encore, les États-Unis ont été les seuls à voter contre.
En 1982, année qui a vu certaines des plus féroces attaques israéliennes contre le Liban, l'Espagne a présenté un projet de résolution exigeant qu'Israël « retire toutes ses forces militaires immédiatement et sans condition jusqu'aux frontières internationalement reconnues du Liban » dans un délai de six heures. Les États-Unis y ont posé leur veto.
Les États-Unis se sont opposés à des résolutions similaires en 1985, 1986 et 1988. La guerre civile libanaise a pris fin en 1990, mais Israël ne s'est pas retiré du sud du pays avant l'an 2000.
Jerusalem
La question du statut définitif de Jérusalem, dont les accords d'Oslo stipulaient qu'elle ne serait discutée qu'à la fin d'un éventuel accord de paix entre Israël et la Palestine, est depuis longtemps la cible du veto américain à l'ONU.
Le projet de résolution S/12022, présenté en 1976, appelait Israël à protéger les « Lieux saints qui sont sous son occupation ».
La résolution se déclare « profondément préoccupée par les mesures prises par les autorités israéliennes qui ont conduit à la grave situation actuelle, y compris les mesures visant à modifier le caractère physique, culturel, démographique et religieux des territoires occupés ».
Les États-Unis ont été le seul pays à voter contre le projet de texte.
En 1982, le Maroc, l'Iran, la Jordanie et l'Ouganda ont présenté un projet de résolution après qu'un soldat israélien ait tiré sur des croyants, tuant au moins deux d'entre eux, dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.
Ce projet demandait à « la puissance occupante (Israël) d'observer et d'appliquer scrupuleusement les termes de la quatrième Convention de Genève et les principes du droit international concernant l'occupation militaire, et de s'abstenir de toute entrave à l'accomplissement des fonctions établies du Conseil supérieur islamique à Jérusalem ».
Se référant au complexe de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem, le texte qualifie le site de « l'un des lieux les plus saints de l'humanité ».
Le texte a également décrit le « statut unique de Jérusalem et, en particulier, la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse des lieux saints de la ville ».
Un autre projet de texte appelant Israël à respecter les lieux saints musulmans a fait l'objet d'un veto américain en 1986.
Palestine
En 1976, les États-Unis se sont opposés à une résolution appelant Israël à se retirer de tous les territoires palestiniens – dans ce cas, le Royaume-Uni, la Suède et l'Italie se sont abstenus.
Le projet de texte présenté par la Tunisie en 1980 soulignait les « droits inaliénables du peuple palestinien ». Les États-Unis ont voté contre et le Royaume-Uni, la France, la Norvège et le Portugal se sont abstenus.
Les résolutions condamnant les colonies israéliennes (considérées comme illégales selon le droit international), n'ont été bloquées en 1983, 1997 et 2011 qu'uniquement par les États-Unis.
En 2004 et 2006, les États-Unis ont refusé d'appeler Israël à mettre fin aux guerres contre Gaza, qui ont tué des centaines de personnes.
Le dernier combat d'Obama
Fin 2016, après l'élection de Donald Trump mais avant qu'il ne prenne ses fonctions, l'administration américaine de l'ancien président Barack Obama s'est abstenue lors d'un vote sur les colonies israéliennes.
C'était la première fois en quarante ans qu'une résolution de l'ONU condamnant Israël était adoptée.
Les États-Unis avaient pourtant utilisé leur pouvoir de veto contre un vote similaire en 2011, et c'était la seule fois que l'administration Obama avait exercé ce pourvoir lors de sa présidence.
Évoquant l'absence de progrès visible dans le processus de paix, l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Samantha Power, a déclaré : « On ne peut pas à la fois défendre l'expansion des colonies israéliennes et défendre une solution viable à deux États qui mettrait fin au conflit. Un choix s'impose entre les colonies et la séparation ».
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que cette décision était « honteuse » de la part des États-Unis.
Trump attaque l'ONU
La précédente administration Trump a inauguré une nouvelle ère de diplomatie pro-israélienne à l'ONU.
En juin 2018, les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, l'accusant d'avoir un « parti pris chronique » contre Israël.
L'administration Trump a également posé son veto à plusieurs résolutions de l'ONU concernant Israël.
Le 19 décembre 2017, les États-Unis se sont opposés à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui rejetait la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.
Plusieurs mois plus tard, en juin 2018, les États-Unis ont posé leur veto face à une mesure rédigée par le Koweït qui condamnait l'usage de la force par Israël envers les Palestiniens. Les forces israéliennes avaient tué des dizaines de manifestants non violents à Gaza lors des manifestations de la Marche du retour.
Comme dans de nombreux autres cas, les États-Unis ont été les seuls à s'opposer à la résolution.
La guerre d'Israël contre Gaza
Le 7 octobre 2023, le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens de Gaza ont lancé une attaque surprise contre le sud d'Israël, tuant environ 1,140 personnes et en prenant 240 autres en otage.
Israël a répondu en guerre totale et a lancé une violente offensive de bombardements aériens, suivie d'une invasion terrestre de Gaza. À ce jour, les forces israéliennes ont tué plus de 44,000 Palestiniens, selon le bilan officiel communiqué par le ministère palestinien de la santé.
Toutefois, d'autres estimations prudentes estiment que le nombre de morts est beaucoup plus élevé. Une étude publiée dans la revue Lancet estime que le nombre de morts pourrait dépasser les 186,000 personnes.
Depuis le début de la guerre, les membres du Conseil de sécurité ont tenté d'introduire des résolutions appelant à un cessez-le-feu et à la fin des combats à Gaza.
Cependant, ces efforts ont été bloqués à de nombreuses reprises par les États-Unis. Depuis le début de la guerre, Washington a bloqué quatre résolutions différentes appelant au cessez-le-feu.
En outre, les États-Unis ont bloqué une résolution visant à reconnaître la Palestine comme membre à part entière des Nations unies.
De nombreux dirigeants mondiaux ont dénoncé les efforts déployés par les États-Unis pour bloquer un appel au cessez-le-feu au sein de l'administration internationale, et les alliés occidentaux de Washington ont également exprimé leur regret face à la non-adoption de ces mesures.
Source : The Middle East Eye
Traduction : SP pour l'Agence Média Palestine
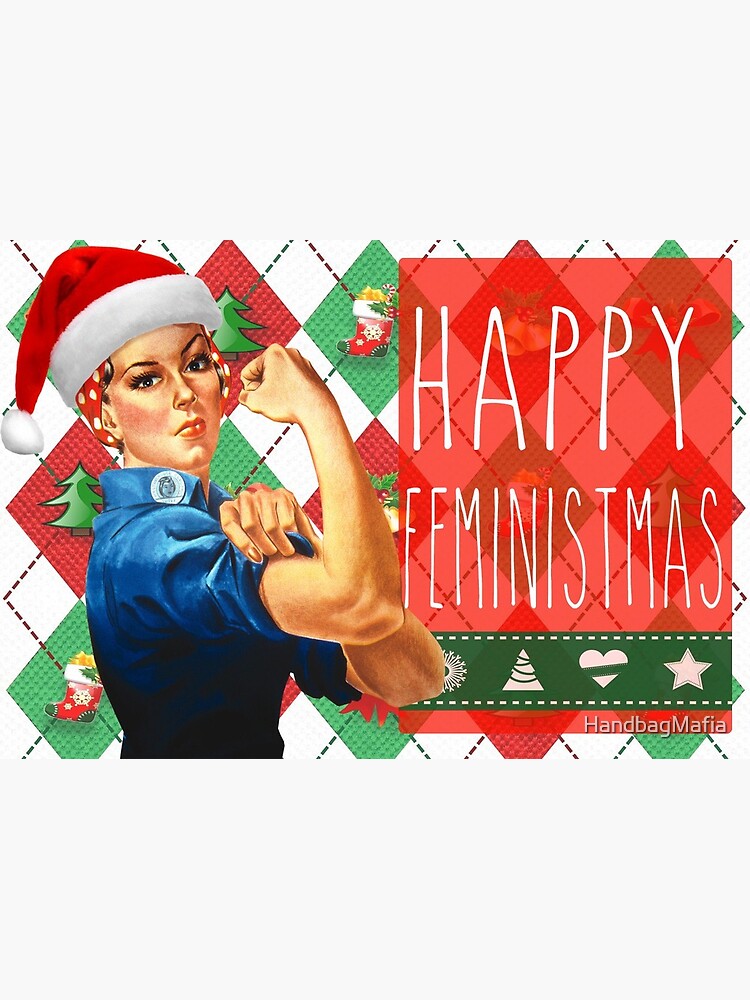
Le 7 novembre, 2 jours après les élections américaines
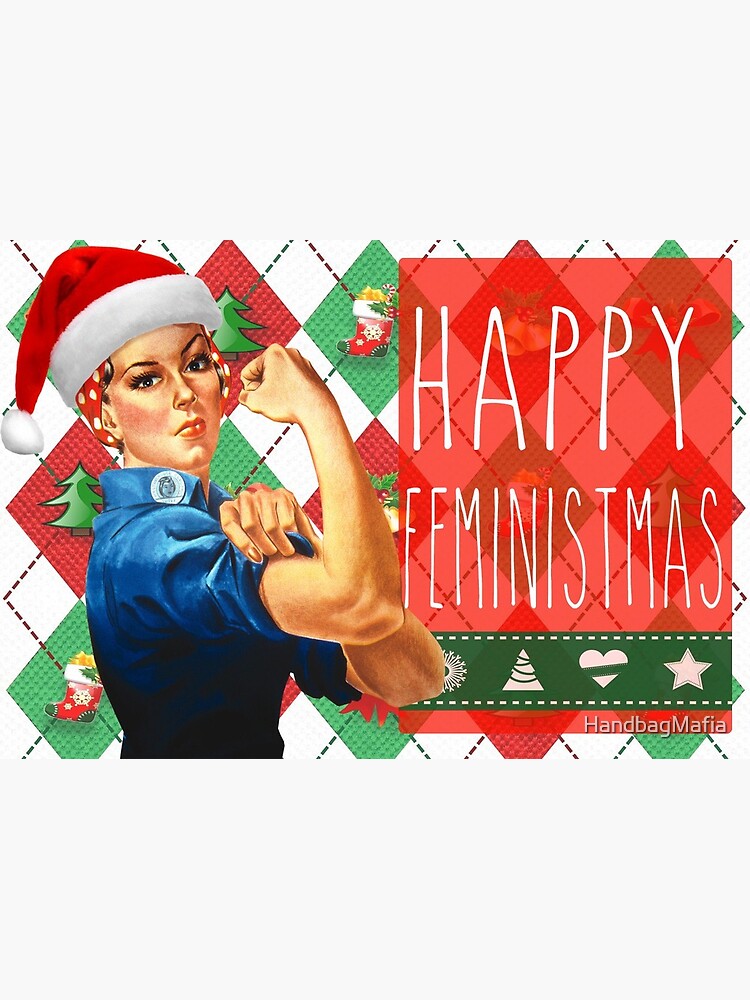
Ce texte a été lu lors du Noël festif et solidaire organisé le 1 décembre par le comité des femmes de Québec Solidaire Capitale nationale.
Le texte que je vous lis ici, je l'écris le 7 novembre, 2 jours après les élections américaines. C'est une claque dans face, un coup de massue, un cauchemar.
Comme vous toutes, je me suis réveillée le 6 novembre avec la peur au ventre. Découragée et tellement en colère aussi. Une des premières publications que j'ai vu ce matin-là sur les réseaux sociaux, c'était la publication de Léa Clermont Dion. Elle partageait les tweets que « l'influenceur » masculiniste ultra toxique Andrew Tate avait publié. En gros, il se félicitait que le patriarcat ait gagné.
Parce que le patriarcat avait déjà perdu ? Je dois avoir manqué ce mémo-là.
Ensuite il disait qu'il était temps de s'attaquer maintenant au vrai problème, puisque l'avortement est « réglé » pour lui. La prochaine étape pour Andrw Tate, c'est s'attaquer au droit de vote des femmes. Ce serait, selon lui, une aberration que nous ayons le droit de voter.
Ça vous fait peur ? Moi aussi ! J'avais envie de vomir. Puis en continuant de regarder sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur ce texte de Marie-Ève Cotton, une autrice et psychiatre. J'avais envie de vous lire son texte :
Les femmes blanches ont voté pour Trump.
Je répète, les femmes blanches ont voté pour Trump.
Au lieu de remettre en question les valeurs patriarcales, dont il est l'égérie, elles s'y sont soumises avec l'idée qu'au moins, avec cette direction raciste et pro-riches, elles seraient considérées davantage que les femmes noires, latines, musulmanes... que les pauvres, les membres de la communauté LGBTQ+, etc.
Sous les oppresseurs, les opprimés jouent du coude pour ne pas finir derniers dans la pyramide, au lieu de s'unir pour redéfinir le pouvoir.
C'est aussi la victoire de l'insatiabilité humaine. L'illusion d'enrichissement, sous Trump, l'espoir de s'acheter plus de bébelles, d'avoir droit à son séjour annuel dans un tout-inclus, sont plus importants pour le citoyen moyen que les droits fondamentaux d'autres humains qui ne font pas partie de son cercle personnel. L'être humain est fondamentalement égocentrique.
C'est aussi un suicide sur le plan environnemental. Le choix du déni, jusqu'à la fin. Le confort des adultes avant l'avenir des enfants. C'est à ce dernier sujet que ce sera irréversible.
Son texte m'a complètement bouleversé et pour moi, il est criant de vérité.
Sous les oppresseurs, les opprimés jouent du coude pour ne pas finir derniers dans la pyramide, au lieu de s'unir pour redéfinir le pouvoir.
J'ai continué ma lecture des réseaux sociaux. Je suis ensuite tombé sur ce texte en anglais. Je vous en fait la traduction : « les hommes américains on échanger les droits des femmes de leurs pays contre le fait de pouvoir payer moins cher leur gaz ». Aussi j'ai trouvé ce texte, qui disait que « les hommes de la génération Z, en qui nous avions placé tellement d'espoir ces dernières années qu'il participerait avec nous au changement, nous ont trahi. Finalement ils ont fait comme tous leur prédécesseur et ont voté de la même façon. »
Et puis je suis finalement tombé sur une publication de Martine Delvaux.
Pleurer.
S'organiser.
Résister.
Ce fut la publication qui a eu le plus grand écho pour moi. Le hasard veut que le soir du 6 novembre nous ayons eu une rencontre entre militant de QS. J'étais un peu nerveuse, parce que je me disais que ça ne serait pas une soirée très joyeuse. Mais vous savez quoi ? Ça m'a fait un bien fou. Parce qu'on avait un endroit où ce réunir entre nous et discuter de comment on se sentait. Et ça m'a vraiment fait réfléchir.
Des moments comme nous avons au Noël Solidaire et féministe sont nécessaire et essentiel, plus que jamais. Nous ne devons pas baisser les bras. Nos droits et nos acquis n'ont jamais été autant menacé. On ne se mentira pas, dans un an c'est possible que ce soit Poilièvre qui rentre au Canada. C'est très inquiétant.
Je vais vous citer Blanche Paradis une militante féministe et membre du comité des femmes que j'admire profondément. Elle m'a dit ce soir du 6 novembre après que je lui ai cité la publication d'Andrew Tate ou il parle de nous enlever le droit le vote :
« Ils sont mieux de se lever de bonne heure s'ils pensent nous enlever nos droits. Ils vont nous trouver sur leur passage. On va se battre. Les prochaines années seront difficiles. Mais, notre job à nous, ça va être de garder le fort. »
Notre job à nous ça va être de garder le fort.
Moi c'est parole là, ils m'ont marqué. On ne se mentira pas, ce n'est pas nécessairement dans les prochaines années qu'on va faire le plus d'acquis. On est dans un solide backlash. Mais on doit s'accrocher, on doit se battre pour ne pas perdre les acquis que nous avons actuellement. Notre travail et notre implication n'ont jamais été aussi nécessaire.
C'est le temps de se mobiliser. D'avoir un mouvement féministe très fort dans la ville de Québec. C'est le temps de s'impliquer au sein d'organisation politique féministe intersectionnel provinciale (je parle de Qs ici pas de la CAQ hein) et municipale (shout out à transition Québec). Et, en attendant de devenir un pays, de s'impliquer au sein des organisations politiques féministes fédérales. Nos implications sont nécessaires, qu'elles soient en temps, et, uniquement si vous avez les moyens, en argent aussi.
Bâtissons des liens entre nous. Créons des amitiés. Des liens intergénérationnels. Des liens de sororités. Impliquons-nous dans les luttes de la communauté LGBTQIA2S+ et les luttes antiracistes. Créons des safe space. Réunissions-nous. Allons aux activités féministes de notre région. Parlons de nos lectures féministes intersectionnelles entre nous. Abonnons-nous aux pages féministes et partageons leurs contenus. Participons aux manifestations. Parlons plus fort. Dénonçons les discours haineux. NE DEMEURONS PAS SILENCIEUSE. Et surtout surtout surtout, prenons soin de nous, parce qu'il ne faut pas s'épuiser non plus si on veut pouvoir combattre.
Nous devons être uni et forte pour tenir le fort. Le temps que la tempête passe.
Pleurer.
S'organiser.
Résister.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

On a grandi dans un monde où on nous disait que le féminisme est dépassé

Voici le discours que Mélanie Pelletier, responsable du comité des femmes du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches (CSN) a prononcé à la manifestation du 6 décembre contre les violences faites aux femmes dans la Capitale nationale.
Bonjour tout le monde,
On a grandi dans un monde où on nous disait que le féminisme est dépassé, où les filles peuvent faire ce qu'elles veulent, devenir ce qu'elles veulent, un monde où l'égalité est atteinte.
Et puis, il y a 35 ans, bang !, la haine, le backlash, le retour de la violence en pleine face. Polytechnique. Quatorze femmes tuées parce que femmes. Quatorze femmes assassinées parce qu'un homme avait décidé qu'elles ne deviendraient pas ce qu'elles voulaient.
Périodiquement la réalité nous rattrape. Les nouvelles nous rattrapent. Que ce soit l'augmentation de la violence « conjugale » chez les jeunes, la montée du masculinisme et maintenant des « mâles alpha », l'exploitation sexuelle des adolescentes et des jeunes adultes. Et, depuis quelques années, l'explosion des féminicides.
Des femmes tuées parce que femmes. Dans l'intimité la plupart du temps. Par leur partenaire ou leur ex. Rien d'extraordinaire. Pas de monstre. Pas de fou. Pas d'attentat. La banalité du mal. « Je vous jure, j'ai rien vu aller, c'était des voisins tranquilles, un petit couple sans histoire avec des beaux enfants ». La prise de pouvoir et de contrôle qui se rend jusqu'à sa conclusion logique et extrême : le meurtre.
Face à l'horreur, face à la récurrence de l'horreur, c'est facile de geler. De se sentir impuissantes. La prochaine victime est encore en vie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la garder en vie ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête ?
Déjà, s'autoriser à en faire une analyse politique et en tirer des conclusions. Toutes les histoires sont particulières, tous les féminicides sont singuliers. Certes. Mais ce sont tous des cas de violence conjugale. Il y a toujours des signes avant-coureurs, après coup on se rend toujours compte qu'on aurait pu voir venir. Qu'on aurait dû voir venir.
La base ce serait de s'assurer qu'il y ait un filet de sécurité en place et que le filet soit assez solide pour que toutes les femmes qui veulent quitter une situation de violence conjugale aient les moyens de le faire.
Historiquement, tous les progrès des femmes sont directement liés à l'éducation et à l'autonomie financière. C'est pas une garantie mais c'est clair que réduire les inégalités, accroitre l'autonomie financière des femmes, ça augmente les options disponibles, ça élargi le champ des possibles et ça mine les dynamiques d'isolement et de prise de contrôle et de pouvoir. Alors, oui, il faut continuer le combat pour l'égalité.
Confrontés aux dénonciations et aux revendications féministes face aux agressions sexuelles, face à la violence conjugale, face aux féminicides certains disent : « Pas tous les hommes ». Ok, d'accord, je veux bien, mais on va se le dire, peut être pas tous les hommes mais tous des hommes quand même.
Qu'est-ce que nos alliés masculins peuvent faire ? Le but ce n'est pas de culpabiliser tous les gars mais que peuvent-ils faire face au sexisme et à la misogynie systémique ? Déjà dénoncer, casser la maison des hommes, casser la solidarité masculine. Refuser de rester silencieux, refuser de regarder ailleurs quand il y a des jokes de vieux mononcles. Éduquer et s'éduquer sur le sexisme, le patriarcat, la masculinité toxique. Briser le cercle de reproduction sociale. Intervenir au quotidien face aux situations qui n'ont pas d'allure. Se positionner en allié. Soutenir les luttes féministes aussi, participer aux luttes pour l'égalité et la justice sociale.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
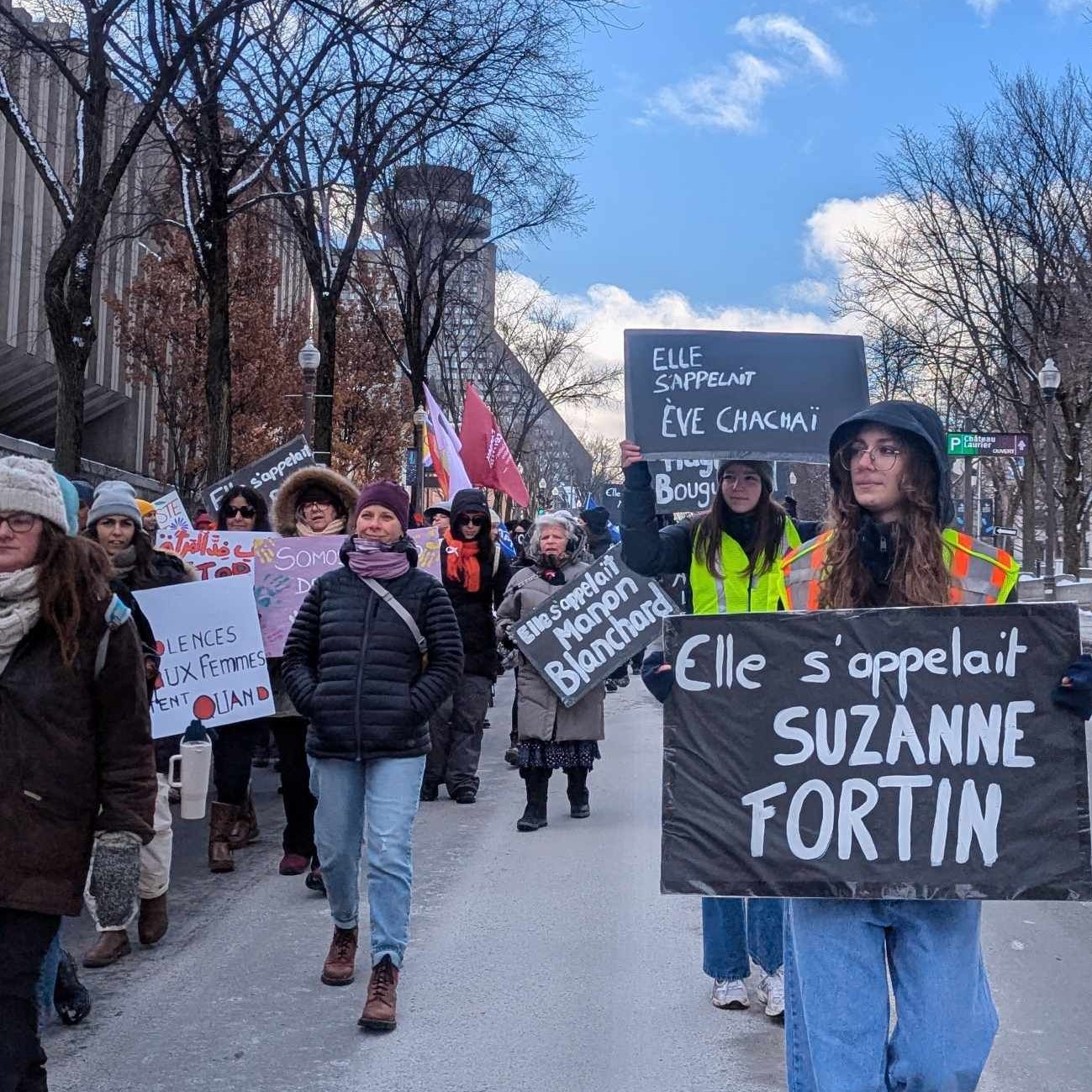
Journée de commémoration et d’actions contre les violences faites aux femmes
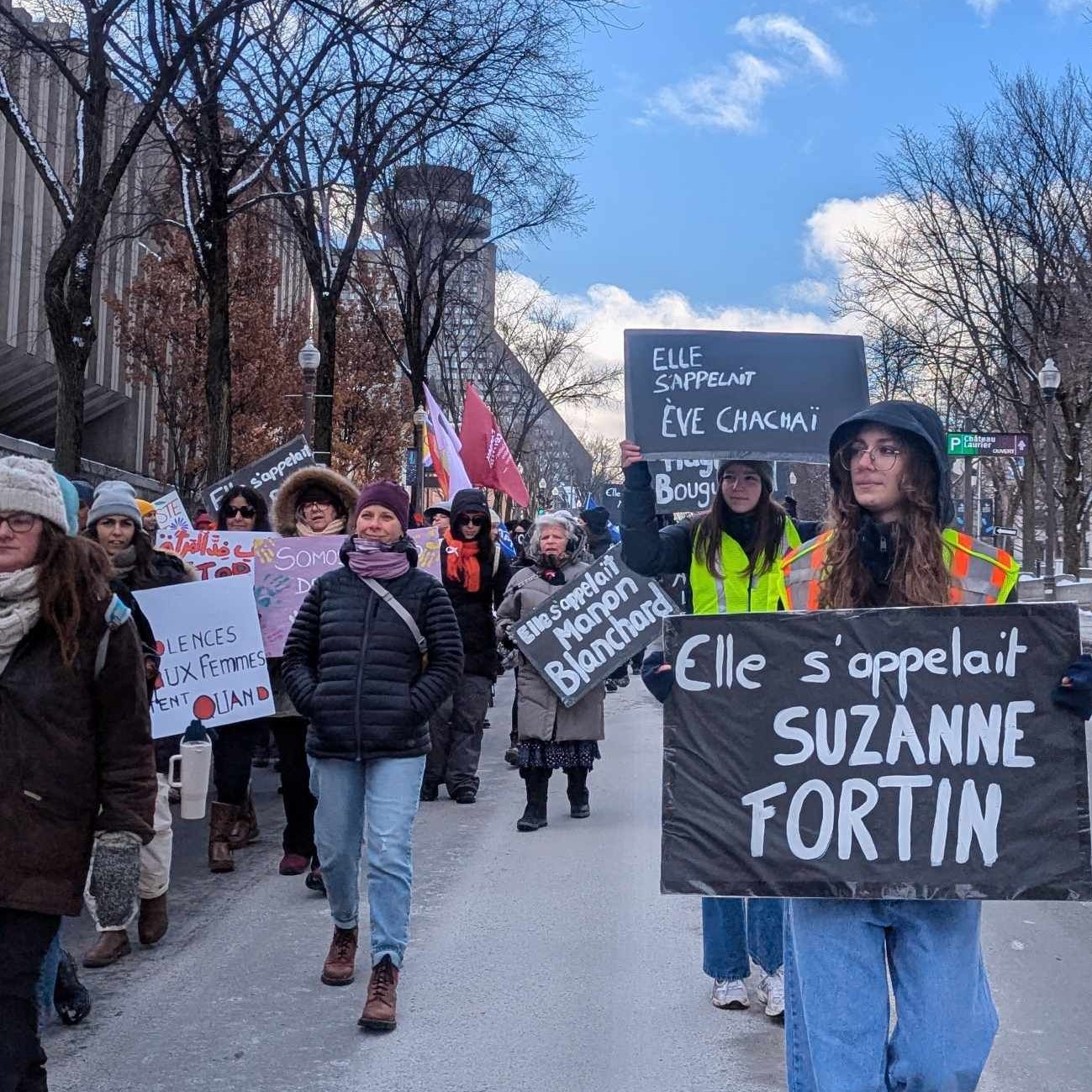
Presse toi à gauche publie le communiqué de presse émis suite à la manif du 6 décembre à Québec. Suit un texte lu durant la manif exposant la situation des femmes handicapées.
Québec, le 6 décembre 2024- Aujourd'hui, le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) a organisé une marche et un rassemblement devant l'Assemblée nationale dans le cadre de la Journée de commémoration et d'actions contre les violences faites aux femmes.
Soulignant les 35 ans de la tuerie de Polytechnique et la recrudescence du phénomène des violences envers les femmes, le RGF a interpellé le gouvernement pour adopter un plan d'action urgent pour contrer les féminicides et mettre fin au phénomène des violences.

Force est de constater que les violences n'ont pas diminué durant la dernière année totalisant à ce jour 25 féminicides en 2024, alors que nous étions à 10 à la même date l'an dernier. "La violence à l'encontre des femmes, en particulier celles issues de groupes marginalisés, tels que les femmes en situation de handicap ou les femmes autochtones, est un fléau omniprésent qui se nourrit de multiples formes d'oppression, incluant le racisme, le sexisme, la xénophobie et la violence structurelle. Cette violence ne se contente pas de violer les droits fondamentaux des femmes, elle constitue également un obstacle majeur à la pleine réalisation de l'égalité, de la justice sociale et de l'inclusion, empêchant ainsi l'épanouissement d'une société véritablement égalitaire pour toutes les femmes." souligne Julie Montreuil, co-directrice du Carrefour familial des personnes handicapées.
Violence conjugale et crise du logement
La situation actuelle de la crise du logement donne du fil à retordre aux femmes qui essaient de sortir d'une situation de violence. La complexité à se trouver un logement social ou abordable et le manque de places en maison d'hébergement peut décourager et mettre plus à risque des femmes qui vivent des violences. « Même si le gouvernement connaît les solutions : créer de nouvelles places en maisons d'hébergement et en maison de deuxième étape, offrir du logement social, il tarde à les mettre en œuvre sous prétexte de rigueur budgétaire ! Combien vaut la sécurité des femmes aux yeux du gouvernement ? » interroge Nancy Beauseigle, co-coordonnatrice au RGF-CN.
De la violence genrée
Malgré toutes les luttes menées depuis des décennies au Québec, les violences et les féminicides continuent, démontrant que les racines du patriarcat sont encore bien ancrées dans notre société et trouvent de multiples façons d'encourager et perpétuer des rapports de pouvoir et de domination sur les femmes. La montée des discours de droite et d'extrême droite, la popularité d'influenceurs masculinistes auprès de jeunes hommes est très inquiétante pour le présent et l'avenir.
Pour combattre le fléau des violences envers les femmes, le gouvernement doit prendre ses responsabilités de façon urgente afin de mieux protéger les victimes et combattre toutes les formes de violences envers les femmes. C'est aussi par la prévention et la sensibilisation que nous arriverons à changer ce système !

Le RGF-CN regroupe des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale et travaille à la défense des droits et des intérêts de toutes les femmes, à l'égalité des femmes entre elles et à l'amélioration des conditions de vie.
*****************
Violence faite aux femmes : Un combat urgent et collectif
Les féminicides, ces tragédies qui frappent de manière brutale et absurde, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Cette année, 25 féminicides sont comptabilisés au Québec, mais le drame est bien plus vaste et profond. Selon un rapport de l'ONU, une femme meurt toutes les 10 minutes dans le monde, tuée par son conjoint. Ce chiffre est insupportable, mais il ne représente que le début du cauchemar.
Il est grand temps de parler de ce qui se cache sous l'eau, des multiples formes de violence que subissent les femmes dans leur quotidien. Au Canada, ce sont 200 000 commotions cérébrales liées à la violence conjugale qui sont recensées chaque année. Et ce n'est pas tout : les traumatismes, les handicaps physiques et les problèmes de santé mentale, les séquelles invisibles laissées par des années de violence, pèsent lourdement sur les victimes et, par extension, sur toute la société. Cette violence a un coût humain inestimable, mais aussi un coût financier colossale, qui touche la société dans son ensemble : frais de la sécurité publique, frais judiciaires, les frais de santé, les frais d'incarcération, les frais de réadaptation, tous les programmes de soutien aux victimes…
Il est crucial, et urgent, que les hommes prennent conscience de l'ampleur de leur violence. Car ce ne sont pas seulement les femmes qui en paient le prix. C'est l'ensemble de notre société qui en assume les conséquences. La violence ne se manifeste pas par hasard. Elle est nourrie et cultivée par un système qui lui permet de prospérer. C'est pourquoi les mesures pour y mettre fin doivent être multiples, globales et résolues. Mais au lieu de voir des progrès, nous perdons du terrain.
Les statistiques nous le montrent : l'âge des victimes de féminicides augmente, et de plus en plus de femmes âgées, souvent considérées comme "moins concernées", sont touchées. Une tendance lourde s'installe, et ces femmes, souvent plus vulnérables, payent un prix encore plus élevé.
Les femmes en situation de handicap, les femmes autochtones, les aînées et les femmes issues de l'immigration sont les plus laissées pour compte. Quand l'État accorde des fonds pour des maisons d'hébergement et des organismes de soutien, c'est un pas dans la bonne direction. Mais lorsque des programmes essentiels sont suspendus ou supprimés, comme le Programme d'adaptation du domicile ou les formations de francisation, ce sont ces mêmes femmes qui se retrouvent encore et toujours vulnérabilisées, isolées, impuissantes. La stigmatisation sociale et le rejet de certaines catégories de femmes, comme les immigrantes, rendent encore plus difficile le départ d'un environnement violent. Trouver un logement, s'intégrer, sortir de l'emprise d'un conjoint violent deviennent des luttes quasi impossibles.
Le logement, c'est un autre enjeu majeur. Les personnes handicapées, par exemple, subissent depuis des décennies la pénurie de logements accessibles et adaptés. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais aujourd'hui, dans la crise actuelle, il atteint des sommets. Et pourtant, des solutions simples existent. Le problème n'est pas un manque de solutions, mais un manque de volonté politique et d'engagement. Les femmes victimes de violence, en particulier celles qui sont handicapées ou vulnérables, n'ont souvent pas d'alternatives viables. Elles sont piégées, condamnées à rester là où elles se trouvent, avec leurs blessures et leur souffrance.
Il ne suffit pas de demander un plan pour contrer la violence au Québec. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un engagement à préserver et à renforcer notre filet social. Chaque jour qui passe, nous assistons à son effritement, à sa disparition progressive. Le phénomène de discrimination systémique est une réalité qui touche de plein fouet les femmes, et particulièrement celles en situation de handicap, qui vivent un double poids : celui de la violence et celui de l'exclusion sociale.
Si nous voulons vraiment que la violence cesse, que les féminicides s'arrêtent et que les femmes arrêtent de mourir des mains de leur conjoint, il est impératif que nous prenions toutes les mesures nécessaires, en renforçant les programmes sociaux au lieu de les sabrer. Chaque femme a droit à la sécurité, à l'épanouissement et à la dignité. L'heure est grave, et il est urgent de réagir. Nous ne pouvons plus attendre.
Julie Montreuil
Directrice services cliniques
Carrefour familial des personnes handicapées,
Responsable du Volet violence conjugale, sexuelle et structurelle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Pour la paix, pour Gaza, pour notre humanité

On doit se réapproprier notre force collective. En tant que citoyens et citoyennes, nous avons la responsabilité d'agir et de s'engager pour mettre fin aux guerres et à ce génocide. On ne peut laisser le monde entre les mains des forces destructrices de la guerre.
Martine Eloy et Suzanne-G. Chartrand, Collectif échec à la guerre
Chaque année, le Collectif Échec à la guerre profite du Jour du Souvenir pour rappeler que les guerres ne font pas que des victimes parmi les militaires. Elles tuent en plus grand nombre des civils - hommes, femmes et enfants – et détruisent la vie de ceux et celles qui y survivent. Lorsqu'on parle de guerre, on parle de morts, mais la destruction s'étend bien au-delà. Le coquelicot blanc est le symbole d'un mouvement lancé par des femmes britanniques en 1933 après la Grande guerre qui a fait 20 millions de morts. Pourquoi nos leaders politiques refusent-ils de le porter, alors qu'un génocide se déroule au vu et au su de tous et toutes ?
Guerres, génocide et destruction de l'environnement
Cette année, la campagne annuelle du coquelicot blanc s'est déroulée sous le thème Pour la paix, pour Gaza, pour notre humanité. Selon Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, plus de 42 000 personnes sont mortes et 96 000 personnes ont été blessées en date du 1er octobre et ces chiffres sont sous-estimés compte tenu du nombre de personnes enfouies sous les décombres. En mai, on estimait à 10 000 le nombre de personnes sous les décombres, dont 4 000 enfants.
Environ 22 500 Palestinien-ne-s sont blessés à vie. Mais en plus des morts, il y a les personnes déplacées très loin, dans des conditions parfois atroces. L'offensive d'Israël au Liban a entrainé le déplacement de 1,4 million de personnes depuis la fin du mois de septembre. À Gaza, des personnes sont emportées par une famine délibérément provoquée et utilisée comme arme de guerre. Sans compter les personnes qui meurent par faute d'accès à des médicaments ou à une intervention médicale urgente.
Et, c'est sans parler des dommages sévères et parfois irréversibles à l'environnement, dont la pollution des sources d'eau potable et des sols agricoles par des produits toxiques et des débris militaires. Selon la juriste F. Albanese, près de 40 millions de tonnes de débris, dont des munitions non explosées et des restes humains, contaminent actuellement l'écosystème.
À noter que les guerres, les entraînements militaires et le fonctionnement des armées qui sont d'importantes sources de production de gaz à effet de serre (GES), ne sont pas comptabilisée dans les seuils de GES. Et n'oublions pas qu'il y a d'autres guerres, qui perdurent depuis des années, notamment en Ukraine, au Yémen, au Ghana, au Soudan et au Myanmar. Le cout humain, matériel et environnemental des guerres est énorme.
Des centaines de résolutions de l'ONU violées
Alors, comment se fait-il que les pays occidentaux n'aient pas pris de positions fermes pour arrêter le génocide en cours ? Des centaines de résolutions de l'ONU ont été violées par Israël, sans que les pays membres des Nations Unies n'interviennent pour les faire respecter. Y aurait-il par hasard des intérêts cachés en jeu ?
La réaction des États occidentaux au génocide et aux multiples crimes contre l'humanité se limite actuellement à des regrets prononcés du bout des lèvres… Ils n'adoptent pratiquement aucune mesure sérieuse et maintiennent leur relations économiques, politiques et stratégiques avec Israël… Ils se présentent comme des États de droit, mais continuent d'envoyer du matériel militaire et des milliards à un pays qui procède à un génocide. En effet, nous assistons à la délégitimation des Nations Unies et du droit international.
Combien de fois, tiraillée par un mélange d'indignation, de colère et de peine, avons-nous fermé la radio, la télé, nos écrans ? Se peut-il qu'à force d'être exposés à de telles atrocités, la violence finisse par s'installer comme la normalité et l'indignation fasse place au sentiment d'impuissance ?
Francesca Albanese critique le gouvernement du Canada, non seulement pour son silence, mais pour sa complicité avec le génocide en cours en Palestine. Le Canada a le devoir « légal » de respecter le droit international et le devoir moral de reconnaitre le « génocide colonial » du peuple palestinien, nous rappelle-t-elle. Toutefois, malgré les promesses de la ministre Joly, le Canada réitère sa fidélité envers son « ami » et continue d'exporter du matériel militaire à destination d'Israël.
Dans le contexte actuel de la guerre génocidaire en Palestine, on ne peut, on ne doit garder le silence. On a la responsabilité d'agir. Nous devons exiger que le Canada rompe ses relations économiques avec Israël et qu'il arrête l'exportation d'armes. En somme, nous devons exiger que le Canada respecte le droit international. Un point c'est tout !
On doit se réapproprier notre force collective. En tant que citoyens et citoyennes, nous avons la responsabilité d'agir et de s'engager pour mettre fin aux guerres et à ce génocide. On ne peut laisser le monde entre les mains des forces destructrices de la guerre.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
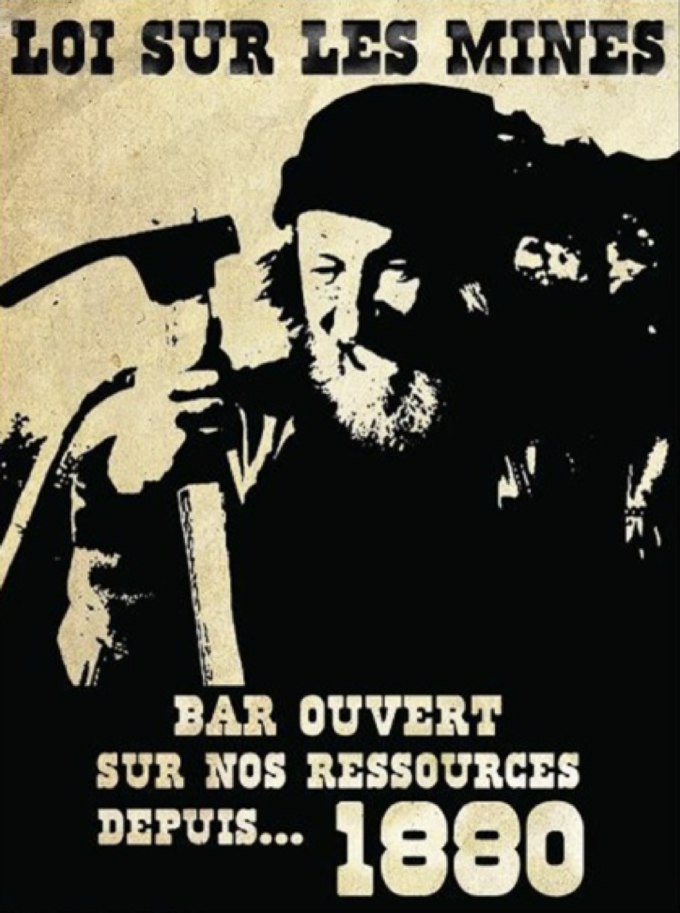
Adoption du projet de loi sur les mines : Trop peu d’avancées, les principales demandes de la population ont été balayées
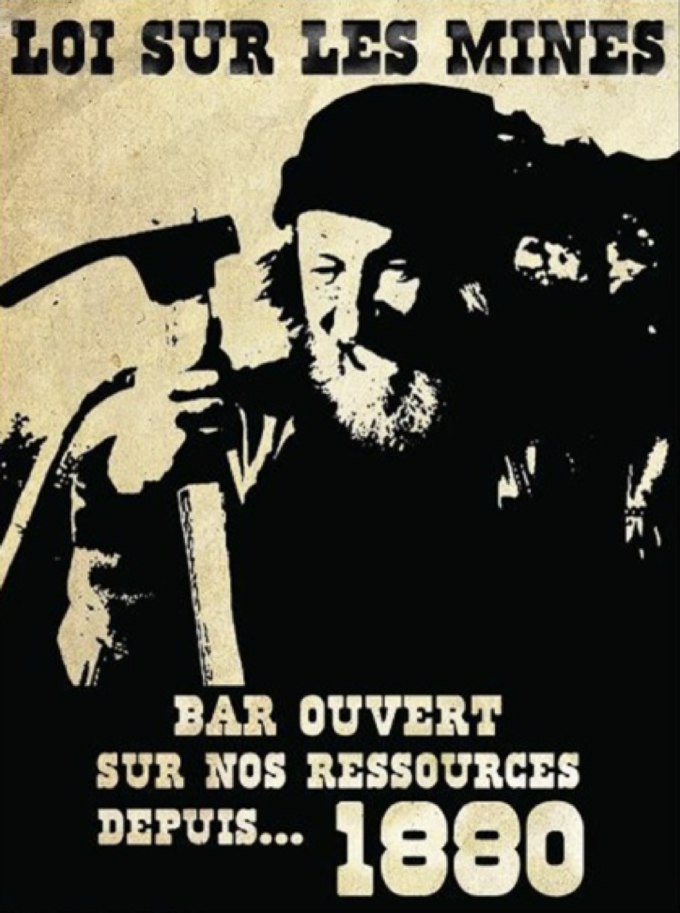
Alors que l'Assemblée nationale s'apprête à voter sur l'adoption du Projet de loi modifiant la Loi sur les mines et d'autres dispositions (PL63), la Coalition Québec meilleure mine intervient pour souligner que cette réforme, en dépit de certaines avancées notables, ne répond pas aux attentes de la société civile. Des pans entiers du chantier de révision des lois minières ont carrément été écartés dès le dépôt du projet de loi sans jamais y être inclus par la suite et d'autres ont souffert de plusieurs amendements qui, au final, limitent la capacité du Québec à intervenir pour réduire les tensions occasionnées par la multiplication des projets miniers à travers la province. La Coalition QMM déplore l'approche du gouvernement de faire fi d'un important jugement récent de la Cour supérieure qui a souligné de graves lacunes dans le régime minier du Québec en matière de respect des peuples autochtones.
Notre travail tout au long des consultations nationales de 2023 et des travaux parlementaires depuis mai 2024 nous mène à conclure que l'exclusion des questions relatives à la fin de la préséance des droits miniers et de l'autorégulation de l'industrie, à la protection de l'eau et au retrait efficace des claims miniers nocifs, notamment, a été sciemment décidée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et son équipe. Les attentes étaient à la hauteur des problèmes : immenses. Le résultat est à la hauteur du gouvernement actuel en matière environnementale : faible.
En attendant une équipe gouvernementale qui aura le courage d'imposer des normes minières dignes des enjeux de notre époque, l'industrie minière continuera hélas de prospérer sur la vaste majorité du territoire québécois au détriment de l'environnement, des droits des peuples autochtones et des communautés locales et de la sobriété minérale.
Priorités écartées
Le projet de loi sur les mines ne répond pas à la grande majorité des conclusions du rapport des consultations du Ministère des Ressources naturelles et des Forêts publié en octobre 2023.
Comme nous l'avons souligné dans notre mémoire présenté en commission parlementaire cet automne, le projet de loi initialement déposé en mai dernier répondait à moins de 10% des recommandations de la Coalition QMM. Sachant que trop peu d'occasions de réformer le régime minier se présentent, nous avons néanmoins adopté la position d'être favorable à l'étude du projet de loi, à condition qu'y soient ajoutées nos six priorités.
Nous avons donc soumis aux partis représentés à l'Assemblée nationale le mois dernier des dizaines de propositions d'amendements pour corriger le tir. Or, le rapport de la Commission parlementaire indique que la plupart des amendements proposés par les partis d'opposition ont été balayés par l'équipe de la ministre et que peu de gains substantiels ont été réalisés pour l'environnement et les droits des populations directement touchées par les minières.
Au final, les priorités de la Coalition QMM sont absentes du projet de loi sur le point d'être adopté aujourd'hui. Les revoici :
1- Consentement des populations avant l'émission des droits miniers
2- La fin de la préséance des droits miniers sur la protection de l'eau, de l'environnement, des aires à protéger et des populations
3- Un mécanisme efficace de retrait des claims miniers incompatibles avec les autres usages du territoire
4- Une obligation légale de restaurer les mines abandonnées d'ici 10 ans
5- La fin de l'autorégulation du secteur minier
6- L'obligation de retourner les déchets miniers dans les fosses et autres excavations
Aucune réponse appropriée au jugement de la Cour supérieure au sujet des droits des Autochtones
L'étude détaillée du PL63 a été marquée par le jugement de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire menée par la Première Nation Mitchikanibikok Inik, rendu le 18 octobre. La Cour a conclu que le gouvernement du Québec porte atteinte aux droits constitutionnels et inhérents de la Première Nation en ne la consultant pas avant d'émettre des claims miniers aux compagnies d'exploration minière. Nous avons formellement demandé à la ministre de prendre acte de cette décision des tribunaux et d'amender son projet de loi en conséquence. Ce qui n'a pas été fait, en dépit des nombreuses tentatives en ce sens de la part de l'opposition.
Quelques avancées ou mesures intéressantes notables
La ministre a concentré son attention sur la soustraction des terres privées à l'activité minière, ce que nous interprétons comme une avancée là où les mesures s'appliqueront – ce qui n'est ni partout ni maintenant. Nous réitérons cependant que cette approche n'aura qu'un effet limité sur les préoccupations, tensions et conflits générés par l'industrie minière avec les populations locales puisque 92% du territoire de la province se trouve en terres publiques, là où se concentrent l'essentiel des activités minières.
Nous soulignons également l'assujettissement de tous les nouveaux projets d'exploitation minière à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement menant au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), mais déplorons que cette mesure ne s'applique pas à tous les projets d'agrandissement des mines en opération, malgré nos demandes répétées en ce sens. Les mesures pour exiger la réparation des « préjudices » à l'environnement ont aussi retenu notre attention, même si leurs définition et application restent à évaluer concrètement.
La suite
Pour l'heure et désormais, il importe de garder en tête que cette révision de la Loi sur les mines ne répond pas aux attentes de la société civile et que le gros du travail reste entier pour que le Québec ait meilleure mine.
Citations
« Il y a trop peu dans la version finale du projet de loi sur les mines pour qu'il soit qualifié de gain. Oui, il faut saluer que l'industrie recule en terres privées, mais les conflits sont largement provoqués par l'industrie sur les territoires des peuples autochtones en terres publiques. Aujourd'hui, l'environnement et particulièrement l'eau douce sont les grands oubliés de cet exercice de révision bureaucratique », Rodrigue Turgeon, avocat, co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine et coresponsable de MiningWatch Canada.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
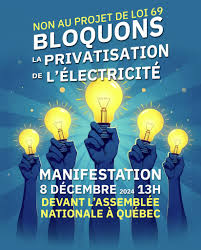
Manifestation sur le PL69
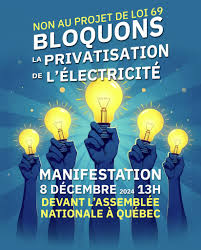
Suite à la manif du 8 décembre contre le projet de loi P69, Presse toi à gauche publie deux txte : un du Front commun pour la transition énergétique et un autre de Germain Dallaire.
De Front commun pour la transition énergétique
Rassemblement à Montréal
PL-69 : BLOQUONS LA PRIVATISATION DE L'ÉLECTRICITÉ !
TIOHTIÁ:KE, MONTRÉAL, le 9 décembre 2024 – Hier, devant les bureaux d'Hydro-Québec, des organisations communautaires, environnementales et syndicales et des groupes citoyens ont dénoncé les dérives du projet de loi no 69 (PL-69) assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques au Québec et demandent un vrai débat public sur l'énergie.
Les inquiétudes sont nombreuses. Avec le PL-69, la CAQ attaque un service indispensable. « Si on permet au privé de produire de l'électricité, on transforme un service public essentiel en industrie soumise aux fluctuations du marché. L'électricité coûtera plus cher à produire, l'impact sur les factures sera majeur », signale Pierre-Guy Sylvestre, économiste au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).
Au Québec, un ménage sur sept n'arrive pas à payer sa facture d'électricité ou y parvient au détriment d'autres besoins de base. Le coût élevé de l'énergie est d'ailleurs une des causes principales de la précarité énergétique. « Si le PL-69 est adopté tel quel, cette situation inacceptable va s'aggraver », dénonce Émilie Laurin-Dansereau de l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal.
De plus, le projet de loi ne contient aucune mesure claire pour assurer la décarbonation. « Le PL-69 favorise plutôt le développement industriel et fait reposer le coût des nouvelles infrastructures énergétiques nécessaires à ce développement sur les tarifs d'électricité, ce qui constitue une injustice à la fois sociale et environnementale », appuie Mélanie Busby du Front commun pour la transition énergétique.
« Dans le contexte où les crises climatiques s'accumulent et nous mettent en danger, notre électricité publique, on ne doit surtout pas s'en priver ! » ajoute Jacques Benoit de GroupMobilisation.
« De plus, ce projet de loi trahit l'héritage des années 60 où la nationalisation de l'électricité a permis de faire de cette ressource un bien commun et non la propriété et l'usage de quelques-uns ! » ajoute Bruno Detuncq du groupe Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville.
« Il est très attrayant pour les entreprises privées de reprendre cette belle poule aux œufs d'or qu'est la production de l'électricité », déclare Claude Vaillancourt, président d'Attac Québec (Action citoyenne pour la justice fiscale, sociale et écologique). « Le cas documenté de la compagnie Brookfield démontre la possibilité d'acquérir des infrastructures publiques de production d'électricité tout en étant la championne canadienne de l'évitement fiscal. Le gouvernement du Québec voudrait-il être le complice d'une pareille entourloupette : prendre le bien public et cacher les profits qui en résulteront dans les paradis fiscaux ? ».
Cette mobilisation de l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal, GroupMobilisation (Gmob), Attac Québec, le Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ), Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC) ainsi que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) s'inscrit dans un appel à l'action plus large pour revoir en profondeur le PL-69. Dimanche après-midi, sept régions du Québec (Montréal, Bécancour, Shawinigan, Saint-Hyacinthe, Québec, Chicoutimi, Coaticook) étaient en action pour presser le gouvernement à faire passer les besoins de la population avant les intérêts des grandes entreprises.
* Le Front commun pour la transition énergétique soutient ses membres et allié·es qui ont organisé le rassemblement. Les affirmations de ce communiqué n'engagent cependant pas l'ensemble des membres du Front commun pour la transition énergétique.
***********
Manifs contre le PL 69 La mobilisation est partie !
Germain Dallaire
Dimanche le 8 décembre se tenaient simultanément dans sept villes du Québec des manifestations pour bloquer le projet de loi 69 qui ouvre toute grande la porte à une accélération de la privatisation de la production d'électricité.
Globalement, malgré une température aux allures de tempête à certains endroits, l'ensemble de ces manifestations a regroupé 3 à 400 personnes. Les milieux syndicaux, politiques, écologistes et communautaires étaient présents. Des représentants du SCFP étaient présents partout, des militant(e)s de Climat Québec ainsi qu'une multitude de groupes environnementaux, citoyens et groupes communautaires tels que l'ACEF du Nord, ATTAC-Québec, Mouvement Onésime Tremblay, Association des retraités syndiqués de Rio Tinto, conseil régional de la FTQ Sag-lac, Toujours Maitres chez nous, PCENY, Regroupement Citoyens Éolien Monnoir, CCCPEM, CMVE, REVEQ, Vent d'élus. Au Saguenay, la CSN était présente. À St-Hyacinthe, QS y était. J'en oublie sûrement et m'en excuse à l'avance.
Cela a donné lieu à une grande diversité d'interventions. À Shawinigan, prenant prétexte de la prise de position de Legault à l'effet d'interdire de prier dans les lieux publics, les manifestant(e)s ont psalmodié des psaumes contre la privatisation de l'électricité. À Montréal, une chorale d'une dizaine de personnes ont entonné des chansons anti-privatisation tout près du buste de René Lévesque. Au Saguenay lac St-jean, un micro libre a permis à des gens de manifester leur opposition. À Coaticook, une trentaine de personnes ont déambulé dans un parc en scandant des slogans.
La couverture de presse a été variable. Au Saguenay, Radio-Canada a rapporté l'évènement, à Montréal CTV était présent, à St-Hyacinthe c'était Tout-tv, à Shawinigan et Bécancour La Tribune a fait un bon reportage mais le meilleur est venu de Radio Canada à Québec. La cheffe de Climat Québec Martine Ouellet y a bien expliqué en quoi le PL 69 favorisait la privatisation, le dirigeant du SCFP Patrick Goultney est intervenu ainsi que le député péquiste Pascal Paradis qui a appelé au retrait du projet de loi.
Sans aucun doute, le principal acquis de ces manifestations est la grande variété des groupes qui se sont activement impliqués autant dans l'organisation que le déroulement des manifs. Cela permet d'être optimiste pour une reprise des actions après le temps des fêtes. C'est un premier coup de semonce mais sûrement pas le dernier.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Vers une nouvelle zone industrielle à Québec ?

De vastes milieux naturels, situés au sud de l'aéroport, sont menacés par un développement industriel à Québec. Si une telle décision était prise, elle nuirait à notre résilience face à la crise climatique et contribuerait à la détérioration de notre environnement.
Si des promesses sont faites de conserver un pourcentage appréciable des milieux naturels du secteur, il n'en reste pas moins qu'une bonne proportion de ces milieux, avec les êtres qui y vivent, seront détruits de manière irrémédiable. La ville considère en effet qu'il existerait des milieux naturels « d'intérêt », les seuls dignes d'être conservés, ce qui justifie le mythe de la conciliation des usages.
Ajoutons à cela que les routes traversant les 3 cours d'eau et la construction d'immeubles, appauvriront peu à peu les espaces naturels résiduels puisque tous ces milieux sont interconnectés. Et les quelques arbres plantés, dont certains mourront d'ailleurs prématurément, ne seront pas en mesure d'exercer immédiatement les mêmes fonctions que les arbres matures : filtration et rafraîchissement de l'air, régulation des inondations, espaces de vie pour de nombreuses espèces.
Des surfaces humides, qui s'étendent de Jean-Gauvin jusqu'à la route de l'aéroport, captent le carbone, retiennent les eaux de dévaler la pente en direction de W.-Hamel et préviennent les inondations. Des solutions techniques sont souvent présentées pour remplacer certains de ces services écosystémiques que nous rend la nature. Ces ouvrages, construits à grands frais, ne ressusciteront pas ces milieux de vie uniques en ville.
Nous estimons que le peu de milieux naturels, situés dans le périmètre urbain de la ville, justifie leur préservation intégrale. En effet, les boisés de 0,5 hectare ou plus sont présents sur seulement 14 % de la surface de ce périmètre alors que les milieux humides, boisés ou non, en représentent un peu plus de 2%.
Par ailleurs, la pollution de l'air cause 300 décès prématurés par an à Québec, selon Santé Canada, et c'est sans compter l'aggravation des maladies respiratoires, cardiaques ou vasculaires. Dans le secteur sud de l'aéroport, il arrive aussi que la pollution dépasse les normes acceptables pour les humains. L'augmentation du camionnage et un air devenu plus toxique du seul fait de l'augmentation de la température générée par la création d'îlots de chaleur ajouteront également à la pollution. En été, la température peut atteindre 12°C de plus sur des surfaces asphaltées en comparaison aux surfaces végétalisées. Précisons que la station du ministère de l'Environnement, située à l'école Primevères, n'est pas en mesure d'enregistrer la plupart des polluants générés par l'aéroport et par le trafic sur les grandes voies de circulation qui encerclent le secteur résidentiel. Si elle les enregistrait, on assisterait probablement à d'autres dépassements de normes.
En outre, si le sud de l'aéroport est développé, d'anciennes terres agricoles, dont la fertilité a été élaborée par des siècles de labeur de la nature, perdront cette capacité de nourrir à nouveau le Québec. Elles pourraient pourtant contribuer à notre sécurité alimentaire, mise à mal par les changements climatiques, qui entraîneront plus d'incendies et d'inondations ayant comme conséquence de couper des voies de circulation pour acheminer la nourriture en direction de notre ville.
Puisque la ville a converti un terrain de soccer naturel en terrain synthétique au coût de 5,3 millions de dollars, elle aurait certainement eu les moyens d'acquérir un terrain d'un km2, de l'éventuelle zone industrielle, acheté par un promoteur deux ans auparavant à coût similaire. Cela amène à nous interroger sur les « besoins » à prioriser : les intérêts à court terme de différents investisseurs ou un environnement sain pour tous les enfants ?
Le maintien de la nature peut pourtant nous assurer un équilibre écologique, même en ville, et il est justement nécessaire de la préserver, en ville, pour garantir un équilibre écologique global. Que préférons-nous pour contrôler les populations de rongeurs : laisser les grands oiseaux faire leur travail parce que nous aurons protégé leur habitat ou appliquer des poisons de manière généralisée ?
Les immeubles vides et les vastes stationnements inutilisés forment déjà de tristes cicatrices dans nos paysages de plus en plus bétonnés et privés d'arbres matures. Que souhaitons-nous collectivement pour nos enfants : encore plus de béton ou une véritable cohabitation avec la nature ?
Anne-Frédérique Gosselin et Cédric Kessler, pour les Amis du boisé de l'aéroport
Christine Penner, Mère au front pour Pascal et David
Isabelle Goarin, Mère au front pour mon enfant (étudiant en technique du milieu naturel)
Josée Roy, Mère au front pour Émilie
Marie-Hélène Joannette-Cartier, Mère au front pour Céleste
Hélène Landry, Mère au front pour le vivant et les enfants
Joances Beaudet, Mère au front pour Pierre-Olivier
Catherine Berthod, Mère au front pour Aurore, Loic et Clément.
Marie-Hélène Felt, Mère au front pour Jeanne et Élie
Mathieu Benoit, Père au front pour Frédérique et Raphaëlle
Nathalie Goulet, Mère au front pour Gaspard, Gustave, Joséphine, Mathias et Leonie
ainsi que pour mes deux petits fils : Grégoire et Théodore
Elsa Moreau, Mère au front pour Ophélie et Héloïse
Marie-Eve Brassard, Mère au front pour Agathe et Lily
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Cassons les ailes de QSL !

Le maire Marchand nous accuse de vouloir « casser les ailes » du projet de terminal de conteneurs de QSL au port de Québec. Il a bien raison, ce projet doit être ARRÊTÉ avant qu'il ne prenne son envol et qu'il soit trop tard !
Le maire de Québec prétend qu'il n'a pas assez d'informations pour s'opposer au projet. Or, tel que révélé par Radio-Canada, ces informations existent et ont été transmises au gouvernement du Canada, mais QSL refuse de les dévoiler publiquement.
Tout indique que le projet de QSL sera dévastateur pour la qualité de l'air et pour la santé humaine. On ne peut pas souhaiter réduire la pollution de l'air et être en faveur d'un terminal de conteneurs à la Baie de Beauport, c'est l'un ou l'autre, il faut choisir son camp.
Appel à l'action : envoi massif de courriels
Pour faire pression sur le Maire et son équipe, nous vous invitons à écrire dès maintenant à Bruno Marchand, ainsi qu'à Marie-Josée Asselin, responsable de l'environnement au comité exécutif.
Montrons-leur que nous sommes nombreux et nombreuses à être en désaccord !
Cassons les ailes de QSL !
******
M. Marchand, j'ai de grandes inquiétudes quant aux impacts désastreux qu'occasionnerait un terminal de conteneurs à la Baie de Beauport.
Nous avons toutes les informations nécessaires pour se rendre à l'évidence que le projet de l'entreprise QSL qui prévoit transfrontalier 250 000 conteneurs par année aurait pour conséquence de faire transiter à travers les quartiers limitrophes au port de Québec plusieurs centaines de camions de plus par jour. Or, la Direction de la santé publique a déclaré que l'air de Limoilou-Basse-ville était déjà saturé en contaminants atmosphériques, que les risques pour la santé des personnes vulnérables étaient élevés et qu'il fallait réduire cette pollution, pas en ajouter.
Au nom de l'amélioration de la qualité de l'air et de la préservation de la santé de la population, je vous demande de retirer immédiatement votre appui au projet de terminal de conteneurs à la Baie de Beauport, avant qu'il ne prenne son envol et qu'il ne soit trop tard.
Sincèrement,
Table citoyenne Littoral Est
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le grand retour de l’austérité

La CAQ a accédé au pouvoir en 2018 en misant sur les ratés de l'austérité imposée par le PLQ de Philippe Couillard. On peut comprendre que le gouvernement tente aujourd'hui par tous les moyens de nier les lourdes conséquences de ses choix politiques…
Tiré de Le point syndical. Illustration : Alain Pilon
« Il faut s'en tenir aux dépenses vraiment nécessaires » en procédant à des « analyses chirurgicales ». « Il n'y a aucune commande de réduction budgétaire », juste des « gestionnaires qui se sont aperçus qu'ils étaient en dépassement de budget. » Tel est le discours tenu tout l'été par les ministres de la CAQ, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, en tête.
Le dernier budget, déposé il y a six mois à peine, prévoyait tout un chapitre sur « l'optimisation de l'action de l'État et l'examen des dépenses gouvernementales » assorti de prévisions couvrant à peine l'augmentation des besoins. Déjà, la CSN notait que ce budget mettrait à mal les services publics, le gouvernement ayant choisi de se priver de plus de 2 milliards $ l'année précédente en offrant des baisses d'impôt qui ont surtout profité aux mieux nantis.
Or, loin des tapis feutrés de l'Assemblée nationale et des salles de presse, les conséquences de l'austérité frappent déjà. Depuis la fin de l'été, on découvre chaque jour une nouvelle coupe ou une nouvelle politique de restrictions dans nos services publics.
Le 24 octobre, Sonia LeBel a annoncé un gel de recrutement dans les ministères et dans plusieurs sociétés d'État, dont les services correctionnels et les organismes gouvernementaux. Dans les réseaux publics de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, cette politique vise le personnel administratif.
Dans les écoles primaires et secondaires, 400 millions $ ont été retranchés cette année du budget d'entretien, et ce, dans un contexte où de nombreux établissements nécessitent des travaux importants. Les programmes de francisation ont aussi subi le couperet gouvernemental, certains centres n'acceptant plus d'inscriptions cet automne.
Dans les cégeps, nombre de projets de rénovation et d'agrandissement ont été mis en suspens. La situation est si alarmante que les présidentes et les présidents des conseils d'administration des cégeps ont publié une lettre ouverte conjointe le 19 novembre pour exprimer leur inquiétude sur la mission même des cégeps, qui est en péril.
En novembre, la nouvelle PDG de Santé Québec tenait une tournée médiatique pour expliquer la toute première mission que lui a confiée le gouvernement : couper plus de 1,5 milliard $ cette année !
En Abitibi-Témiscamingue, le chat était sorti du sac en septembre lors du conseil d'administration du CISSS. La réunion aurait dû se dérouler à huis clos, mais des journalistes ont pu y assister par erreur. Les coupes à venir ont été évoquées ainsi que la possible révision des services dans la région. Le déficit atteindrait 110 millions $. Officiellement, les gestionnaires se veulent rassurants : les soins et les services à la population seront préservés…
Le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec–CSN, Félix-Antoine Lafleur, en doute. « La population active de la région, c'est environ 100 000 personnes. Ça fait 1000 $ par personne de déficit. Comment croire qu'il n'y aura pas d'impact ? »
Parmi les pistes de solution proposées par le syndicat, notons la fin du recours aux agences privées de placement de personnel. Le CISSS a payé 145 millions $ à ces agences l'an dernier, soit 27 % de plus que l'année précédente. C'est plus que le déficit au complet !
Recruter, dans le public
Les syndiqué-es du réseau public demandent d'ailleurs depuis longtemps que cesse l'utilisation de ces agences privées pour investir plutôt dans le réseau public. Et ce n'est pas qu'une question de bonne gestion financière : ça concerne aussi la qualité des soins et des services à la population. À cet effet, les employé-es des CHSLD, en nombre insuffisant et déjà essoufflés, constatent que la qualité de vie des résidentes et des résidents se dégrade. Les employé-es d'agence peuvent être compétents, néanmoins, ils sont dépêchés pour de très courtes périodes dans les établissements. L'époque où le personnel des CHSLD pouvait créer de vrais liens humains avec les bénéficiaires est décidément révolue.
4000 en moins
Pour réduire son déficit, le CISSS a retranché 4000 heures de soins par mois au CHSLD Pie-XII, à Rouyn-Noranda. C'est intenable pour les employé-es, qui peinent à assurer aux aîné-es dans ces milieux de vie les soins dont ils ont besoin. Le 17 octobre, après avoir proposé d'autres solutions aux gestionnaires, le syndicat local affilié à la CSN, la Fédération de la santé et des services sociaux–CSN et le conseil central ont dénoncé cette mauvaise décision et ont alerté la population de la région sur les répercussions de l'austérité caquiste.
Des coupes partout
Cette nouvelle période d'austérité se confirme à une vitesse folle en santé et dans les services sociaux. Au CHUM, 26 postes de préposé-es aux bénéficiaires et 7 postes d'agentes administratives ont été supprimés. D'autres coupes et des postes non remplacés ont aussi été dévoilés dans les médias depuis, notamment au CISSS de Laval et au CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. On doit s'attendre à ce que pas mal tous les établissements procèdent éventuellement à de telles annonces, qui découlent directement des choix politiques de la CAQ.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
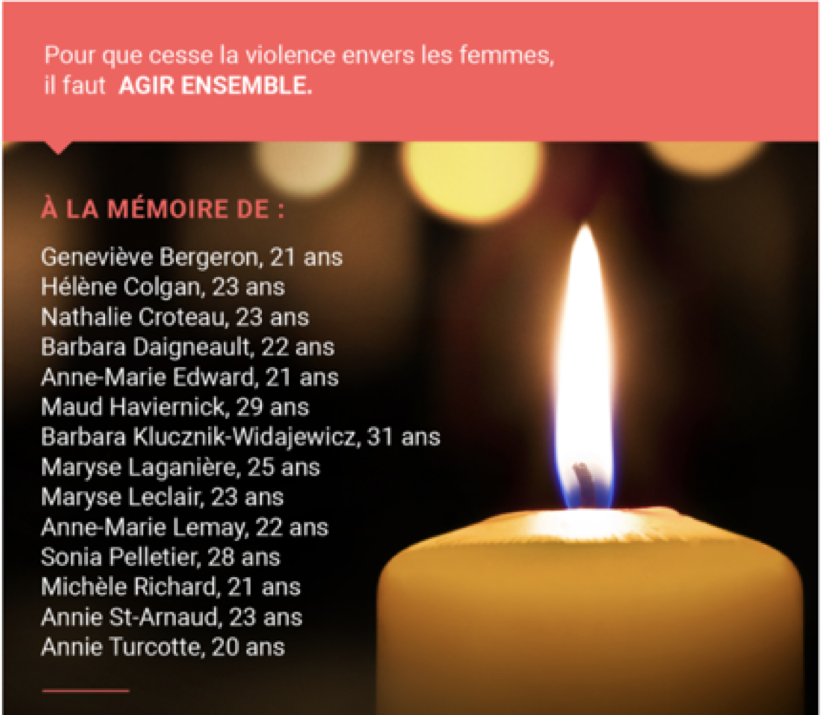
6 décembre 1989 : 35 ans après la tragédie, le combat doit continuer
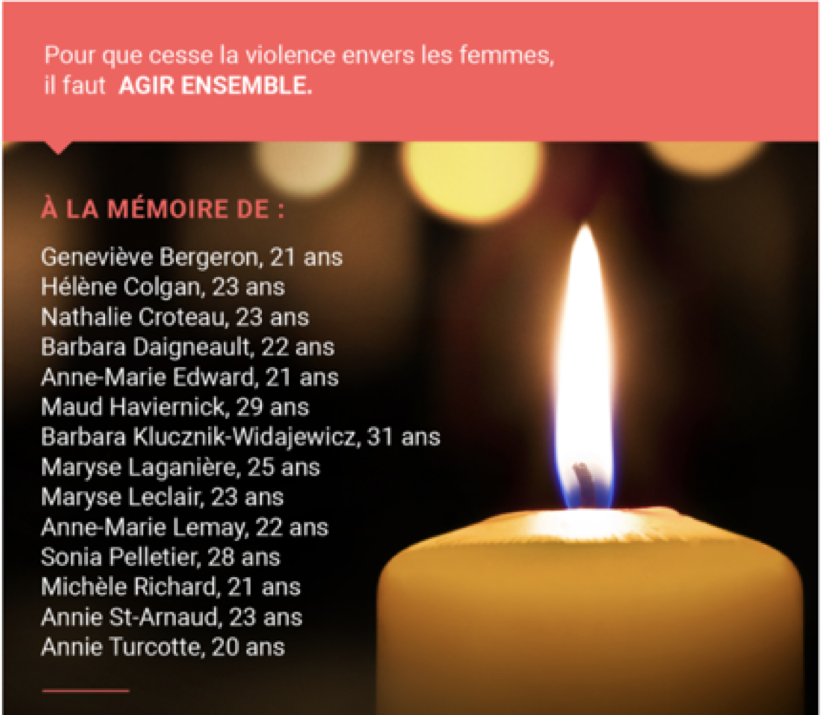
Il y a 35 ans, le 6 décembre 1989, le Québec était marqué à jamais par un acte de violence misogyne : la tuerie de l'École Polytechnique de Montréal. Cet événement, au-delà de l'horreur qu'il a suscitée, a aussi mis en lumière un problème profond : les violences faites aux femmes, simplement parce qu'elles sont des femmes.
Tiré de Ma CSQ.
« En 2024, cette tragédie demeure un rappel brutal de l'importance de lutter contre le sexisme et les violences genrées qui persistent encore aujourd'hui. Commémorer le 6 décembre est essentiel pour honorer la mémoire des 14 victimes et réaffirmer notre engagement collectif à bâtir une société plus juste et égalitaire », souligne la vice-présidente de la CSQ, Nadine Bédard-St-Pierre.
Ne jamais oublier
Il aura fallu 30 ans, soit en 2019, pour que l'on reconnaisse enfin cet attentat comme antiféministe. « Cette attaque ciblait les femmes parce qu'elles étaient des femmes, c'est important de le reconnaître et de ne jamais l'oublier », ajoute Nadine Bédard-St-Pierre. Bien que 35 ans se soient écoulés, les violences faites aux femmes, sous des formes diverses, continuent d'être présentes : féminicides, harcèlement, agressions, inégalités économiques, cyberviolence. Chaque année, des milliers de femmes au Québec et dans le monde en sont victimes.
« Pour la CSQ, cette journée est l'occasion de réitérer son engagement envers l'équité et la lutte contre toutes les formes de violence », souligne la vice-présidente.
Un combat toujours nécessaire
Malgré des progrès, il reste encore tant à faire : les statistiques montrent que les femmes continuent de faire face à des obstacles au cours de leur vie, qu'il s'agisse de violences physiques ou psychologiques, d'inégalités, de représentations stéréotypées, etc. « Cette journée du 6 décembre nous rappelle aussi que chaque action compte : éduquer, sensibiliser, légiférer et, surtout, écouter les femmes », conclut Nadine Bédard-St-Pierre.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Francisation : l’aveuglement fait place à l’improvisation

Après des mois de représentations auprès des élus et de mobilisations aux quatre coins du Québec, nous recevons l'annonce du retour de 10 millions de dollars aux centres de services scolaires qui offrent des services de francisation de qualité avec une grande déception. Non seulement s'agit-il d'une somme économisée par l'abandon de l'allocation octroyée aux étudiants qui suivaient des cours de francisation à temps partiel, mais elle n'est même pas pérenne.
Ce que le gouvernement appelle aujourd'hui un investissement n'est rien d'autre qu'une aide d'urgence pour stopper l'hémorragie dans certains milieux.
- Bien sûr que la FAE est heureuse pour les 5000 nouveaux élèves qui seront francisés grâce à cette somme, mais qu'en est-il de toutes les autres personnes qui sont laissées pour compte ?
- - Annie-Christine Tardif, vice-présidente à la vie professionnelle à la FAE
Concrètement, ces 10 millions représentent des miettes comparativement aux besoins du réseau. Cette annonce génère, encore une fois, de l'incertitude et provoque de l'instabilité. Qu'arrivera-t-il après le 31 mars ? Les 5 000 élèves supplémentaires devront-ils attendre de nouveau avant d'être accueillis dans le réseau du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) ? Pendant ce temps, la situation continuera de se détériorer dans les CSS qui n'auront pas leur part du gâteau. Comment ces sommes seront-elles réparties et comment ce montant a-t-il été déterminé ? En aucune façon, cette somme ne traduit une volonté politique de sauver les services de francisation dans les centres de services scolaires.
Nous dénonçons également le fait que le ministre Jean-François Roberge n'ait pas rencontré les personnes concernées pour discuter de la situation et trouver des solutions viables et concrètes. Le ministre Roberge a finalement réalisé que le réseau MIFI n'était pas en mesure d'accueillir les élèves dont les cours ont pris fin de façon abrupte dans les centres d'éducation des adultes, mais il improvise une solution bancale plutôt que de continuer à miser sur un réseau scolaire solide, établi et mature.
« Des centaines d'enseignantes et enseignants ont perdu leurs emplois au cours des dernières semaines. Le ministre Roberge pense-t-il vraiment que ces personnes ont attendu patiemment dans leur salon qu'il se réveille pour se trouver un autre emploi ? S'il souhaite qu'elles poursuivent leur enseignement auprès des personnes immigrantes, il faudrait leur démontrer que leur apport est important et leur assurer une stabilité. On le dénonce dans la rue depuis des semaines : le gouvernement Legault est en train de démanteler un service de qualité, mais aussi un tissu social qui permettait d'intégrer les personnes issues de l'immigration dans la société québécoise », s'insurge Madame Tardif.
Par ailleurs, la FAE s'attendait minimalement à ce que les investissements supplémentaires, puisés à même les économies réalisées par la coupe de l'allocation de participation des élèves à temps partiel (entre 65 et 67 M$), soient à la hauteur de la proportion des élèves francisés dans le réseau scolaire par rapport à ceux inscrits dans le réseau du MIFI. De même, cette annonce ne répond pas aux autres demandes de la FAE, à savoir le déplafonnement du nombre d'élèves équivalent temps plein, que le ministère avait limité à 8 789, et à la fin de l'interdiction d'utiliser d'autres enveloppes budgétaires dans les centres de services pour continuer d'assurer des services en francisation.
Le ministre Roberge ne cesse de répéter que son ministère travaille activement pour trouver de nouveaux partenaires afin que des classes ouvrent rapidement. Pendant ce temps, les centres d'éducation des adultes ont le personnel, les locaux et l'expertise pour répondre aux besoins ; il n'a donc pas à chercher bien loin. Que se cache-t-il derrière cet entêtement à vouloir démanteler les services de francisation dans les CSS ?
Pour en savoir plus, consultez notre page sur le sujet.
La vidéo "Stop au démantèlement de la francisation"
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les principes et les statuts de l’Alliance ouvrière

Nous publions les principes et les statuts de l'Alliance ouvrière discutés à son congrès de 2024 (PTAG)
Nos principes
1. Démocratie et liberté
Malgré l'éloge constant de la classe politique et des grands médias pour les institutions « démocratiques » de notre pays (parlement, chambre des communes, etc.), nous savons qu'il ne s'agit que de façades qui n'ont rien à voir avec la démocratie réelle. Quel pouvoir détient vraiment le travailleur moyen sur les grandes décisions politiques qui affectent sa vie ? Nous sommes limités à voter une fois aux quatre ans pour mandater l'une ou l'autre des grandes-gueules carriéristes qui, sitôt advenue au pouvoir, abandonne toutes ses belles promesses électorales et se range docilement derrière les intérêts des corporations et des grandes banques – les véritables dirigeants de ce pays.
Alliance Ouvrière défend la perspective d'un système véritablement démocratique. Un système où les gens ordinaires ne voteraient pas seulement pour un représentant aux quatre ans, mais détiendraient un réel pouvoir sur les décisions qui les affectent : de la vie quotidienne à la shop et dans les quartiers jusqu'aux décisions de planification économique et de politique étrangère. D'ici là, nous continuons à défendre le peu de démocratie possible dans le système actuel. Nous réclamons la transparence des gouvernements, institutions et corporations ainsi que le droit du peuple d'être informé correctement. Nous défendons la liberté de former des associations et organisations indépendantes, la liberté d'expression, de contestation et de manifestation.
2. Égalité et unité
Nous défendons l'égalité pour tous les travailleurs et travailleuses au-delà des nationalités ou des spécificités démographiques. Nous cherchons à nous unir sur la base de la classe sociale au-delà des divisions nationales, culturelles, de sexe, etc. qui la traverse. Nous rejetons les politiques qui visent à « diviser pour mieux régner » incarnées par les guerres culturelles, inventant des critères de divisions toujours plus saugrenus les uns que les autres pour briser notre unité. Nous nous opposons aux idéologies rétrogrades (racisme, sexisme, etc.) au sein de la classe et défendons le droit à tous et toutes de participer à la lutte sans discrimination.
Nous luttons pour la perspective d'un monde réellement égalitaire, libéré des inégalités socioéconomiques, des divisions nationales et des guerres impérialistes. La véritable liberté ne sera possible que lorsque les travailleurs et travailleuses prendront en main la direction de la société indépendamment des monopoles, des banques, des corporations et autres institutions parasitaires qui perpétuent les inégalités et empêchent la majorité de l'humanité de mener une vie digne.
3. Classe contre classe
Nous avons un parti pris pour les travailleurs et travailleuses et nous défendons leur droit de lutter pour améliorer leur conditions de travail et de vie. Nous reconnaissons que l'appareil légal n'est qu'un compromis historique et qu'il est moralement juste d'agir au-delà du code du travail lorsque nécessaire. Nous rejetons la collaboration de classe et l'inféodation du mouvement ouvrier à des partis électoraux vendus à l'ordre établi. Nous croyons en la nécessité d'avoir nos propres organisations, indépendantes des structures imposées par l'État.
Nous défendons la centralité ouvrière – le principe stratégique selon lequel la classe ouvrière doit jouer le rôle déterminant dans le mouvement pour dépasser le capitalisme. Un changement social fondamental ne peut venir que par l'organisation solide des travailleurs et travailleuses pour la défense des intérêts de la classe.
Nos objectifs
Les classes populaires ont la volonté de lutter contre les injustices. Que ce soit les luttes menées par les centrales syndicales dans les sphères économiques et politiques, les envolés de mécontentement généralisées tel le mouvement des convois de la liberté ou les luttes menées par les diasporas migrantes contre l'agression impérialistes sur leur nation, nous voyons que l'ordre de choses actuel provoque la colère du peuple.
Cependant, les mouvements populaires feront toujours face à des limites si nous n'arrivons pas à innover dans nos méthodes. D'un côté, on échoue de s'inscrire dans la continuité d'un projet politique plus large. On manifeste un jour pour la Palestine, le lendemain contre la corruption, l'autre jour pour la négo syndicale. On court d'une lutte à l'autre sans faire d'avancées – sans construire une structure qui permettrait de pérenniser notre force de frappe. Bref, on se contente de mobiliser sans organiser. Sans canaliser les luttes dans des organisations, capables de relancer de nouvelles vagues de luttes, de se consolider et grossir pour répéter jusqu'à la victoire, on tombe dans le mouvementisme. On saute d'un mouvement à l'autre sans être capable de les lier par la pratique et de renforcer le pouvoir de la classe sur le long terme.
De l'autre côté, même si les luttes mènent parfois à des organisations et servent des projets politiques plus larges, elles échouent de le faire pour notre propre classe, et sont plutôt récupérées par des forces de classe réactionnaires. Nous pouvons penser au mouvement des convois de la liberté, qui bien que comportant une participation de la classe ouvrière, s'est ultimement fait canaliser dans la faction conservatrice de la classe dirigeante (Poilèvre et cie). Nous pouvons penser également aux grèves étudiantes de 2012, qui au final auront surtout profilées au projet social-démocrate de la petitebourgeoisie et au parti politique Québec Solidaire. Dans tous les cas, la classe ouvrière, bien que partie intégrante de ces mouvements, n'a pas su apprendre à les diriger selon ses propres intérêts.
C'est pourquoi notre objectif principal est de constituer la classe ouvrière en force politique indépendante. [1] Agir en force politique indépendante, cela veut dire d'abord se concevoir comme classe (avoir une conscience de classe), comprendre le nous comme la classe ouvrière plutôt que la nation, l'appartenance à l'un ou l'autre des côtés de la guerre culturelle, ou d'autres divisions secondaires. Cela veut dire ensuite de se doter des outils qui nous permettent d'agir indépendamment et collectivement en tant que classe, de puissantes organisations capables de rivaliser avec le patronat et l'État. De son côté, le grand patronat, qui détient le contrôle de l'économie, est bien organisé pour faire valoir ses intérêts et est en mesure de tirer les ficelles de la politique en sa faveur. Si nous voulons être capable de lui faire face, nous avons besoin de : A. organiser solidement la classe ouvrière ainsi que B. Éduquer et mobiliser politiquement la classe ouvrière.
A. Organiser solidement la classe ouvrière
Cela veut avant tout dire construire les organisations de défense de base de la classe ouvrière, les syndicats. Malheureusement, des décennies d'absence de syndicalisme de classe ont effrité la capacité des syndicats à assumer ce rôle fondamental. Ceux-ci ayant été incapable de s'adapter à une réalité changeante du monde du travail, le taux de syndicalisation est bas (29%) et tend à diminuer. Parmi les syndicats qui existent, plusieurs sont des organisations peu démocratiques, avec une implication minimale ou inexistante des membres. Si implication il y a, c'est généralement au sens de mobilisation (manifestations, piquets de grève) et rarement au sens d'organisation. Parfois, même la démocratie formelle (assemblées, élections, etc.) est limitée, en particulier dans certains syndicats internationaux. [2].
Les syndicats ont accepté l'appareil légal comme étant légitime, plutôt que de le comprendre comme un simple compromis historique. Bien qu'il soit juste de reconnaître que les gains du mouvement ouvrier passé tel que la reconnaissance légale des syndicats, le droits de grève, etc. sont des acquis précieux qui été arrachés à la bourgeoisie par la lutte, il faut également reconnaître que ces gains sont conditionnels au rapport de force exercé par la classe.
Malheureusement, au sein du mouvement syndical actuel, on se fourvoie trop souvent en s'appuyant principalement sur ces acquis légaux plutôt que sur la construction d'un réel rapport de force. Même les syndicats plus militants et ancrés dans leur base sont coincés dans cette mentalité de paix industrielle, où tout militantisme se doit de respecter les règles du jeu de la bourgeoisie. Ce problème est exacerbé par le fort poids joué par les employés permanents au sein des syndicats, trop souvent des personnes issues d'études universitaires poursuivant des ambitions carriéristes, formés à une mentalité de « ressources humaines ». L'État, lui, ne se limite pourtant pas à respecter les règles de son propre jeu et peut écraser même les luttes syndicales légales via des lois de retour au travail ou d'autres stratagèmes bureaucratiques. Même s'il est prouvé que l'État agit de manière inconstitutionnelle, la judiciarisation des luttes donne toujours le bénéfice du doute à la partie patronale. Après des délais de plusieurs années avant un règlement en cours, les membres sont démobilisés et le mal est fait.
Ce dont nous avons besoin, ce sont de syndicats qui sont réellement capables d'accomplir leur rôle, des syndicat de lutte de classe. D'abord, cela veut dire des syndicats combatifs, prenant partie fermement pour obtenir le plus de gains possibles pour leur membres, n'ayant pas peur de mener des grèves, des actions dérangeantes et des campagnes politiques à la défense de la classe, et ce en permanence et non seulement lors des périodes de négociation de la convention. Ensuite, cela veut dire des syndicats démocratiques dans lesquels les membres sont réellement organisés au sein de la structure syndicale, sont impliqués dans les discussions stratégiques, et où la volonté de la base est réellement ce qui dirige l'action syndicale. Finalement, cela veut dire des syndicats militants, se basant sur les intérêts absolus de la classe ouvrière dans son ensemble plutôt que sur l'intérêt étroit de leurs propres membres, et capables de mener des actions qui dépassent ce qui est permis par l'État.
B. Éduquer et mobiliser politiquement la classe ouvrière
Le syndicat est l'organisation de défense de base de la classe ouvrière, un outil essentiel sans lequel il serait impossible de rivaliser avec la classe dirigeante. Cependant, les syndicats possèdent en soi des limites qu'ils ne pourront dépasser s'ils sont laissés à eux-mêmes. Il ne suffit que de regarder l'état du mouvement syndical actuel qui a été laissé à lui-même depuis les vagues de militantisme politique des années 70 et 80. Le syndicalisme ne mène, spontanément, qu'à la conscience syndicale. Si nous voulons avoir une conscience de classe, alors nous devons également avoir une organisation de classe, qui ne se limite pas à défendre les intérêts « sur la job », mais aussi les intérêts des travailleurs et travailleuses dans l'ensemble de la société. Ceci ne viendra pas d'un développement spontané du mouvement syndical, mais d'une impulsion de l'extérieur.
Tout en reconnaissant le rôle essentiel des syndicats, nous devons lutter contre le syndicalisme étroit et aller au-delà de la conscience syndicale. Ceci implique d'éduquer la classe ouvrière pour qu'elle soit en mesure de comprendre ses propres intérêts et former son opinion indépendamment des grands médias. Comment, par exemple, former des militants capables de tenir tête aux permanents syndicaux de carrières, confiants et connaisseurs, habitués de diriger les structures syndicales ? Comment faire pour que les travailleurs et travailleuses saisissent la nature des réformes néolibérales et voient au-delà des mensonges des politiciens ? Comment faire pour que les syndicats situent leurs luttes dans un horizon internationaliste, en solidarité avec les peuples ailleurs dans le monde qui sont opprimés par l'impérialisme Canadien ? Cela implique un vaste effort d'éducation politique pour apprendre à déceler nos propres intérêts de classe, comprendre notre histoire, et développer nos capacités.
Dans cette optique, il n'existe pas de meilleur école que la lutte. C'est en menant la lutte politique que la classe ouvrière apprendra en pratique qui sont ses amis et ses ennemis. Il faut viser à mobiliser la classe ouvrière dans des campagnes politiques dépassant le cadre étroit des conditions de travail. Il faut apprendre à lutter contre les fermetures de shop, contre les réformes néo-libérales, contre les permis de travail fermés, contre la spéculation immobilière, bref, lutter contre la classe dirigeante dans l'ensemble des sphères de la vie sociale, et ultimement pour le renversement complet de l'ordre établi.
Notre stratégie
Si l'on veut se constituer en force politique indépendante, alors il faut apprendre à lutter avec nos propres moyens, à faire de la lutte politique ouvrière. Cela veut dire non seulement se préoccuper des autres sphères de la vie sociale au-delà des luttes économiques, mais surtout, de se réapproprier nos propres méthodes de lutte.
Ce qui fait que la classe ouvrière possède un réelle poids et lui donne un rôle historique, c'est son contrôle sur la production. Dans notre société, les moyens de production sont détenus par une minorité qui encaisse les profits, mais le processus de fabrication des marchandises est divisé parmi des millions de travailleurs et travailleuses. La minorité qui possède s'enrichit sur le dos de la majorité qui travaille. La classe ouvrière, consciente d'elle-même, peut utiliser son contrôle sur la production – faire la grève – non seulement pour des gains au travail, mais pour défendre ses intérêts dans l'ensemble de la société. C'est là que se situe le potentiel d'un réel rapport de force : dans notre capacité à faire des grèves politiques.
Le rôle de l'État est, en premier lieu, de préserver la domination économique de la classe dominante, ce qui implique en grande partie de réprimer le droit de grève. Historiquement, faire la grève, même pour des raisons économiques, était carrément illégal, et l'État réprimait sévèrement le syndicalisme. C'est éventuellement devenu intenable : face au dynamisme et à la combativité du mouvement ouvrier, valait mieux ouvrir la valve de l'autocuiseur que de contenir la pression jusqu'à ce que ça explose. L'État a opté pour encadrer le syndicalisme afin de s'assurer qu'il ne nuise pas trop au bon fonctionnement de la société et surtout, qu'il n'en vienne pas à menacer l'existence même du capitalisme. On en arrive aujourd'hui avec un ensemble de loi – le code du travail – issu d'un pacte de paix sociale entre le patronat et les syndicats.
Les syndicats ont, malheureusement, plié l'échine et se sont soumis à ces lois pacifiantes et démobilisatrices. Souvent, ils font même confiance à l'État et font la promotion de politiques qui renforcent le rôle de l'État dans la société (social-démocratie) . Ils ignorent ce qui est principal, le rapport de force entre les classes, pour se concentrer sur du lobbying parlementaire. Quand ils n'arrivent pas à obtenir leur objectif de cette façon, ils se replient et se contentent de se dire qu'ils ont fait « tout en leur possible. »
La récupération de l'outil de la grève politique pour rétablir le rapport de force de la classe ouvrière est nécessaire. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de crier des mots d'ordres radicaux de l'extérieur du mouvement syndical comme des clients insatisfaits – appeler à la grève politique n'amènera pas à la grève politique. Nous ne pouvons pas non plus nous contenter de rester isolés dans des microsorganisations avec un membership dans les deux chiffres et aucune influence dans la société. Pour améliorer le mouvement syndical, il faut être dans le mouvement syndical. Pour avoir des meilleurs syndicalistes, il faut être les meilleurs syndicalistes. Il est facile de critiquer lorsqu'on est à l'extérieur du mouvement, mais lorsqu'on est confronté à ses réalités, à ses problèmes concrets, ce n'est pas si simple. La réalité est qu'un bon nombre de syndicalistes sont des personnes bien intentionnées, réellement dévouées pour la classe, qu'il ne faut pas aliéner avec une posture ultra-radicale. Ils font simplement face aux mêmes limites que nous.
Ce que l'on propose, c'est un processus à long terme, un travail qui nécessitera des années. Pour cela, nous ne pouvons pas nous contenter de nous éparpiller dans les différents syndicats sans coordination ni stratégie commune. Notre objectif (constituer la classe ouvrière en force politique indépendante), concrètement, veut dire qu'Alliance Ouvrière vise à agir comme centre politique pour organiser le déploiement des militants pour la grève politique dans le mouvement ouvrier. Voici comment nous proposons d'y arriver :
1. S'organiser sur la base de caucus ou comité par industrie pour planifier l'expansion et la consolidation du syndicalisme de lutte de classe. Les caucus peuvent servir à augmenter la densité syndicale par industrie en formant de nouveau syndicats, à réformer les syndicats existants pour en faire des syndicats combatifs, démocratiques et militants ainsi que de promouvoir l'unité et la coordination intersyndicale.
2. Mener des campagnes politiques combatives contre les attaques de l'État sur la classe ouvrière (réformes du code du travail, privatisations, etc.). Ce faisant, encourager les syndicats à lutter politiquement et à adopter des tactiques militantes plutôt que de se limiter au lobbying et aux campagnes de communication.
3. Constituer un centre d'éducation et d'information sur les questions d'organisation en milieu de travail, sur les questions politiques (grèves politiques, rôle politique et social du syndicalisme, histoire ouvrière) et sur les luttes ouvrières en cours. Collectiviser les expériences et approfondir notre compréhension de la lutte politique ouvrière.
En menant cette approche en trois fronts, nous pourrons apprendre à organiser et diriger la classe ouvrière au sein des organisations de défense de base (syndicat), à mener de lutter politiques d'envergure et à approfondir notre compréhension du mouvement syndical. En combinant ces trois fronts, nous pourrons éventuellement mener des grèves politiques pour le pouvoir ouvrier.
Nos statuts
1. Mission
Alliance Ouvrière vise à constituer la classe ouvrière en force politique indépendante. Nous organisons et mobilisons la classe ouvrière dans les milieux de travail et les autres sphères de la vie sociale afin de récupérer l'outil de la grève politique.
2. Membres
Toute personne ayant participé à au moins une assemblée générale, et étant en accord les principes, les objectifs et la stratégie d'Alliance Ouvrière peut devenir membre.
Les membres ont le devoir de contribuer au travail de base d'Alliance Ouvrière, soit l'organisation de la classe ouvrière dans les milieux de travail, et de respecter les principes généraux d'Alliance Ouvrière.
Les membres ont le droit de voter et se faire élire, de participer aux rencontres de leur organisation de base et aux congrès, ainsi que de partager leur point de vue lors des rencontres.
3. Cotisations
La cotisation pour les membres d'Alliance Ouvrière est de 10$ par mois, qui est remise et administrée par l'exécutif de chaque chapitre régional.
Le chapitre régional doit remettre 20% de son budget au comité de coordination.
4. Instances de base
Les instances de base d'Alliance Ouvrière sont le caucus industriel et le chapitre régional. Les instances de base sont des organisations avec leur propre structure démocratique, définie en concordance avec les principes, les objectifs, la stratégie et les statuts d'Alliance Ouvrière.
Toute région ou industrie avec au minimum trois membres d'Alliance Ouvrière peut former une instance de base et nommer un délégué au comité de coordination.
4.1 Le caucus industriel
Le caucus industriel est la principale instance d'Alliance Ouvrière, et vise à coordonner la stratégie des militants dans chaque industrie pour arriver à l'objectif de la grève politique. Il est formé de membres d'Alliance Ouvrière dans une industrie spécifique.
Le caucus tient une assemblée générale au minimum aux six mois. Le caucus se divise en comités basés sur des tâches ou des milieux de travail spécifiques selon les besoins.
Le caucus élit un comité exécutif chargé d'organiser les rencontres, de coordonner les activités entre les rencontres et de coordonner les actions des différents comités.
4.2 Le chapitre régional
Le chapitre régional est l'instance chargée de coordonner les différents caucus industriels d'Alliance Ouvrière dans une ville ou région, de mener des campagnes politiques et d'organiser des activités d'éducation. Il est formé de membres d'Alliance Ouvrière dans une ville ou région.
Le chapitre tient une assemblée générale au minimum aux trois mois. Le chapitre peut se diviser en sous-comités selon les besoins.
Le chapitre élit un comité exécutif chargé d'organiser les rencontres, de coordonner les activités entre les rencontres et de coordonner les actions des différents comités.
5. Comité de coordination
Le comité de coordination est l'instance chargée d'organiser les congrès, d'approuver la création des instances de base, et d'assurer la communication et la coordination entre les différentes instances d'Alliance Ouvrière.
Politiquement, le comité de coordination doit mettre de l'avant des campagnes politiques nationales, mettre en commun les ressources des instances, et promouvoir l'unité d'action.
Le comité de coordination d'Alliance Ouvrière est composé d'un représentant de chaque chapitre régional élu lors du congrès. Si un chapitre régional est formé entre deux congrès, le chapitre régional élit un représentant au comité de coordination lors d'une de ses assemblées générales.
6. Congrès
Le congrès est l'instance dirigeante d'Alliance Ouvrière. Le comité de coordination élu au congrès précédent est responsable d'organiser le congrès suivant.
Toutes les instances de base d'Alliance Ouvrière ont le droit d'amener des propositions aux congrès. Tous les membres d'Alliance Ouvrière ont le droit de participer au congrès ainsi que de débattre, proposer des amendements, et voter les propositions amenées par les instances.
Le congrès doit se tenir au minimum aux deux ans.
[1] Lorsqu'on utilise le mot politique ici, c'est au sens large - l'organisation de la vie sociale - et non au sens des institutions politiques (partis, parlements, municipalités, etc.). On parle de mener des luttes politiques, et non de faire du lobbyisme ou de la politique partisane.
[2] Les syndicats internationaux se distingues des syndicats "Canadiens" ou Québécois par le fit que les directions centrales sont situées aux États-Unis, et parfois possèdent un droit de veto sur les décsions prises en assemblées syndicales locales
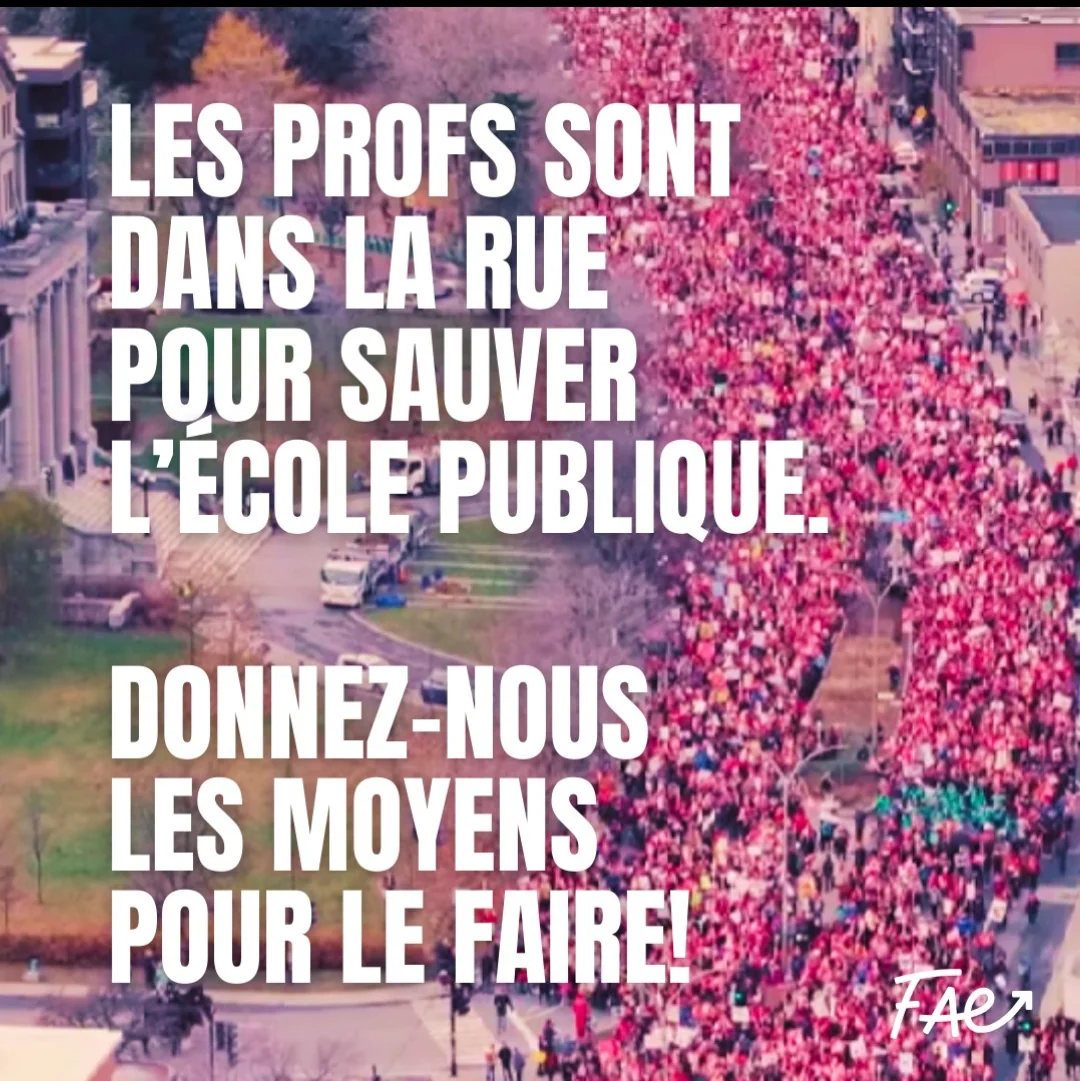
Une chronologie de la grève illimitée de la FAE de 2023
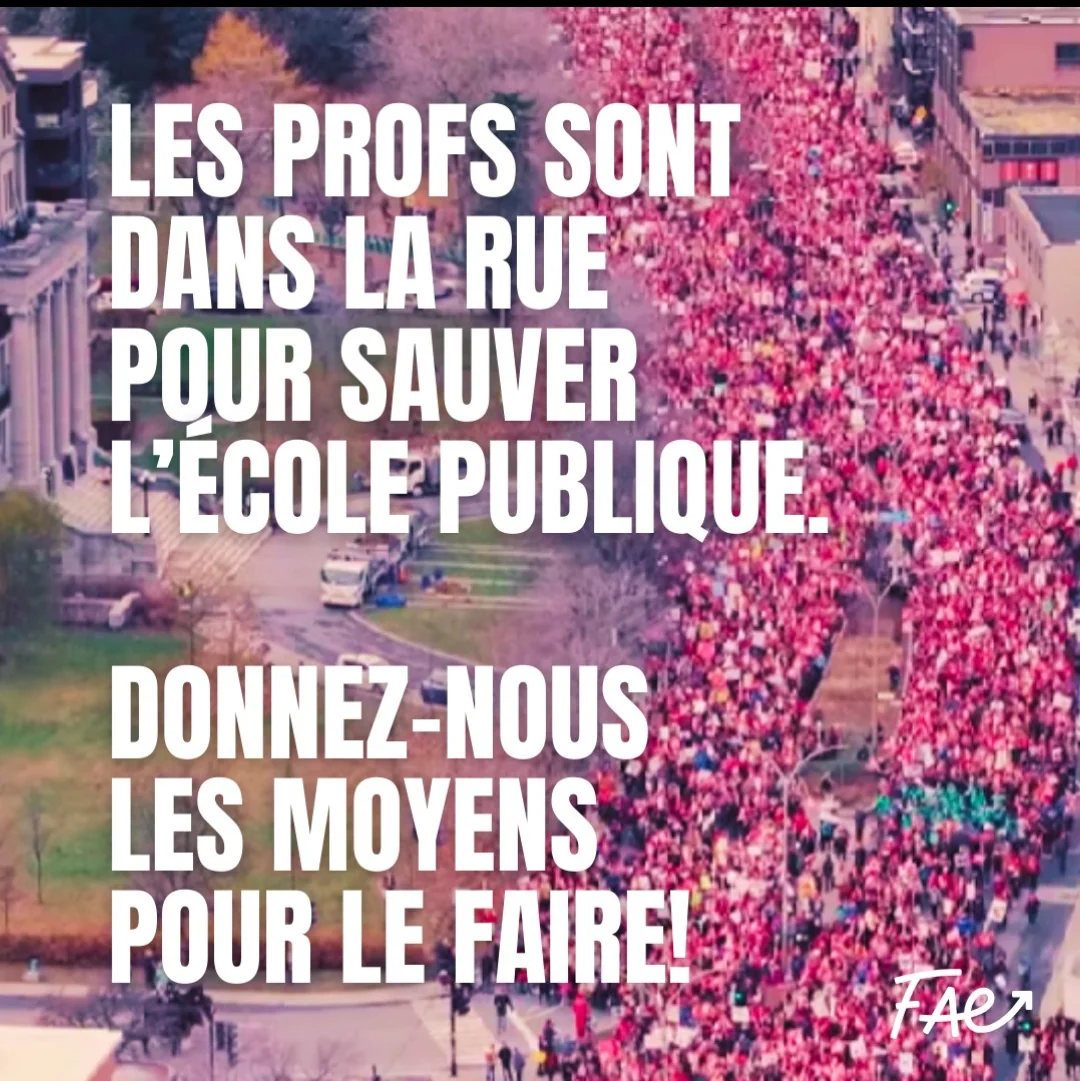
Nous publions ici la seconde partie de la chronique du GIREPS consacrée à la grève des 65 500 enseignantes (du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes) syndiquées à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) qui a été déclenchée le 23 novembre 2023 avec un mandat de grève illimitée et qui a pris fin après cinq semaines.
Cette seconde partie présente une chronologie des évènements qui ont marqué cette mobilisation historique (Partie 2). Elle fait suite à une première partie centrée sur le contexte de cette grève, la dynamique syndicale dans laquelle elle s'inscrit ainsi que sur les revendications (Partie 1). Une dernière partie proposera quelques pistes de réflexion (Partie 3).
L'ensemble a été exclusivement rédigé à partir des articles de presse, communiqués syndicaux, chroniques, synthèses ou commentaires repérés sur les pages Facebook (de la FAE, des syndicats membres de la FAE et du Front commun) qui ont été publiés, et ce jusqu'à trois mois après la signature de l'entente mettant fin à la grève.
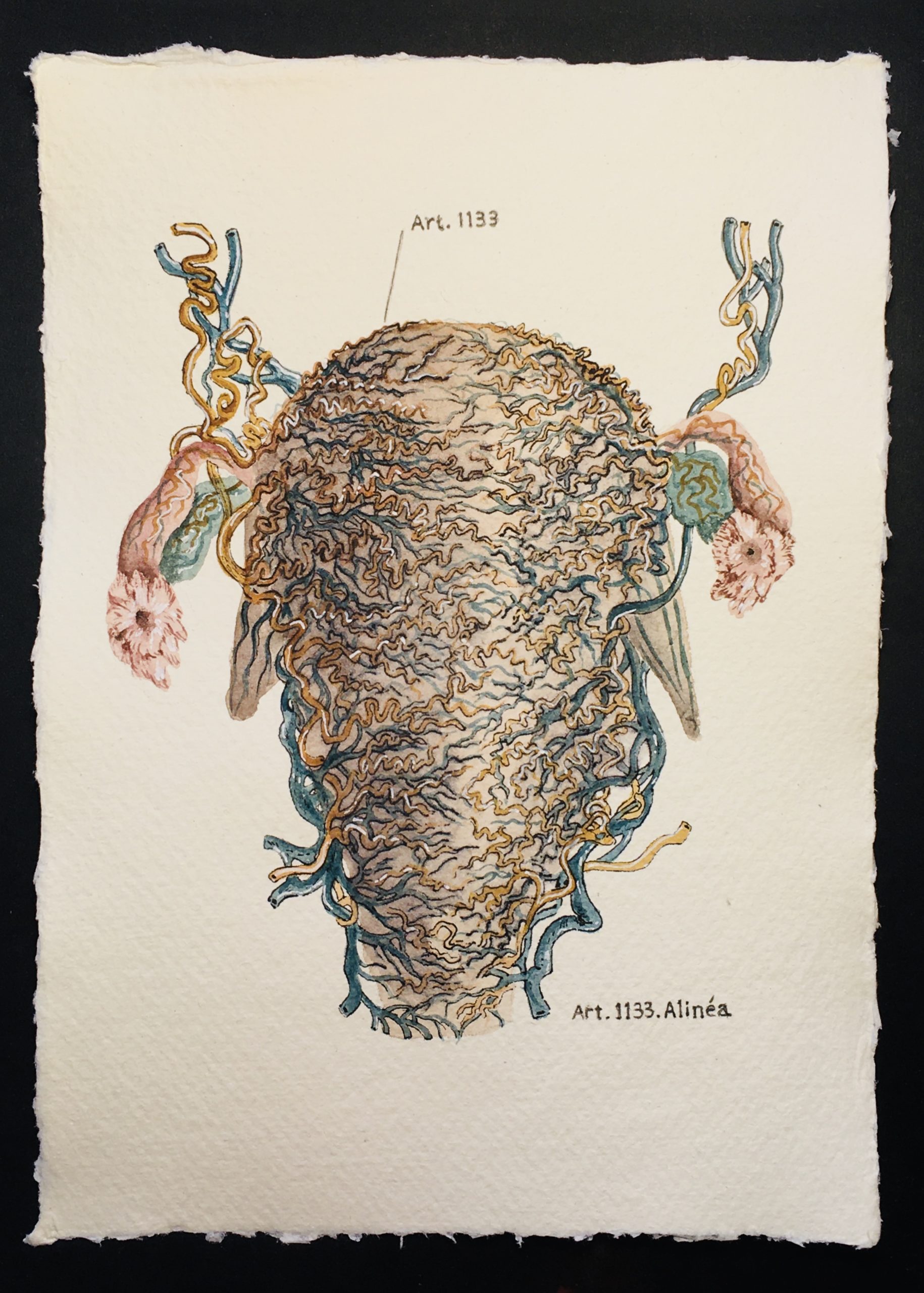
Dévitalisation — Anatomie d’une violence silencieuse
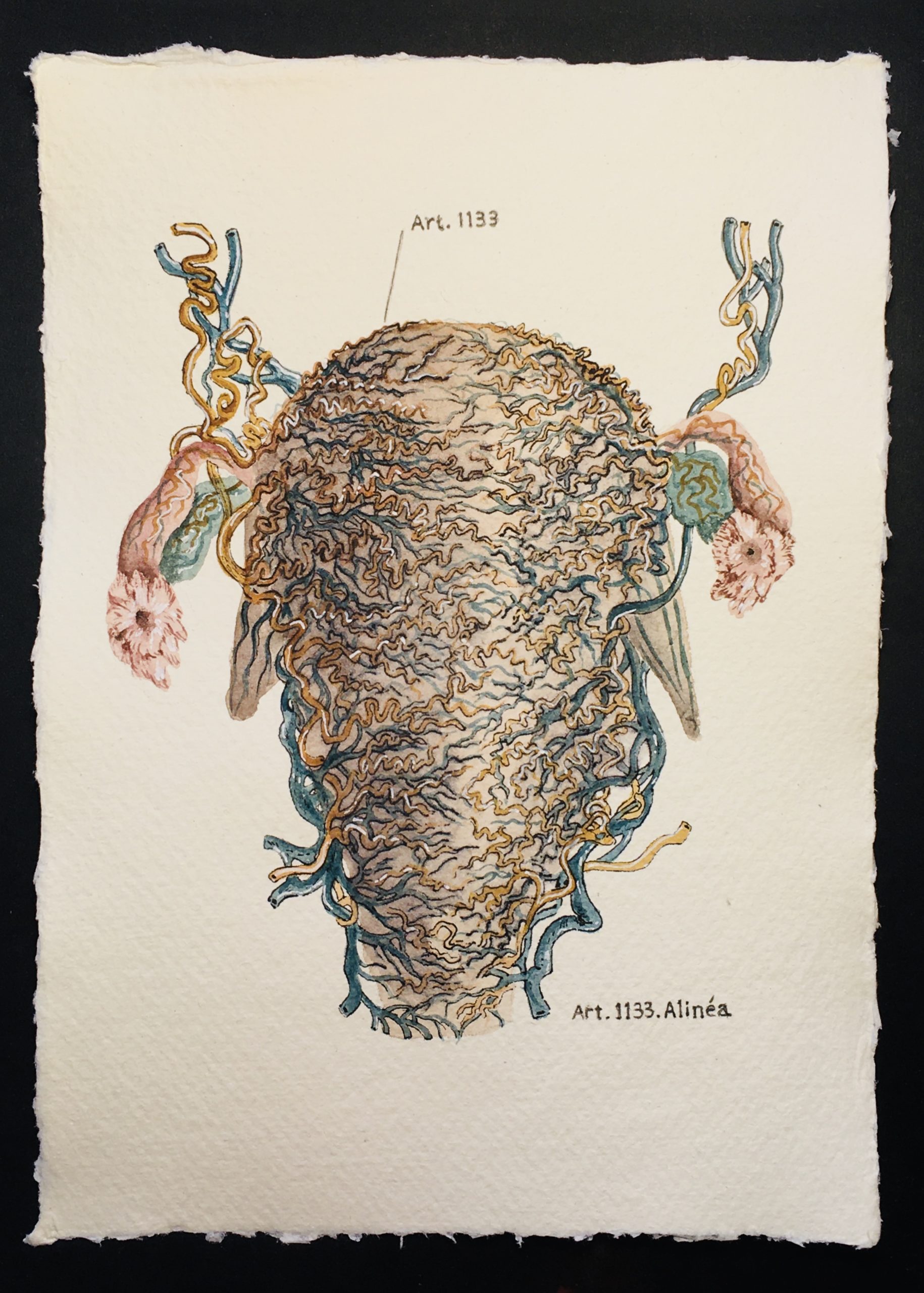
À travers une série de dessins représentant l'anatomie de l'utérus, l'artiste iranienne Nikoo Nateghian, qui vit et travaille à Bruxelles, nous plonge dans les méandres des lois oppressives iraniennes. Chaque détail anatomique renvoie à un article de loi, soulignant ainsi la manière dont le système juridique peut être utilisé pour opprimer et contrôler les femmes en Iran. Ce projet, intitulé « Dévitalisation », explore ainsi la violence insidieuse qui touche les femmes iraniennes émanant des systèmes législatifs qui violent leurs droits fondamentaux.
Tiré de Agir par la culture
Nikoo Nateghian
La représentation anatomique de l'utérus que l'artiste confronte à ces textes agit comme un moyen de neutralisation et de désensibilisation de la perception de cet organe féminin puissant et sacré. Les articles de loi, avec leur langage juridique impérieux, interviennent pour perturber cette contemplation paisible. Ils déconstruisent la connaissance acquise par l'observation des planches anatomiques, révélant ainsi la manière dont ces lois contribuent à la dévitalisation des femmes en Iran, en les réduisant à de simples cas à traiter par le système judiciaire.
Art. 1133 (amendé le 10/11/2002). Un homme peut demander le divorce en respectant les conditions prévues par la loi.
Art. 1133 (amendé conditions énoncées aux articles 1119, 1129 et 1130 de cette loi). Les situations permettant à la femme de demander le divorce comprennent la disparition de l'époux pendant quatre ans, le refus de l'époux de fournir une pension alimentaire, le non-respect de l'époux des autres droits obligatoires, le mauvais traitement de l'époux au point où la vie devient insupportable, les maladies sexuellement transmissibles graves de l'époux qui mettent l'épouse en danger.
Art. 1180. Un enfant mineur est placé sous l'autorité parentale de son père et de son grand-père paternel. L'enfant non émancipé ou mentalement handicapé est placé sous l'autorité parentale de son père et de son grand-père paternel si l'incapacité ou le handicap existaient déjà durant la minorité.
Art. 1181. Chacun des pères et des grands-pères a autorité parentale sur ses enfants.
Art. 1233. Une femme ne peut pas accepter une tutelle sans le consentement de son mari.
Art. 1114. L'épouse doit résider dans le domicile désigné par son époux, à moins que le choix du domicile ne lui ait été confié.
Art. 1117. L'époux peut interdire à son épouse de pratiquer une profession ou un métier qui contrevient aux intérêts de la famille, à ses propres valeurs ou aux valeurs de sa femme.
Art. 367. Dans l'article 366 de cette loi, si les ayants droit des deux parties plaignantes demandent la peine de Qisâs et que les montants du prix du sang pour les deux victimes ne sont pas les mêmes, et si le prix du sang pour les auteurs est supérieur à celui des victimes, par exemple si les deux meurtriers sont des hommes et l'une des deux victimes est une femme, le demaneur de la peine de Qisas du côté de la femme doit payer la moitié du montant complet du prix du sang. Dans ce cas, en raison de l'incertitude quant à l'identité du meurtrier de la femme, l'excédent du prix du sang mentionné est réparti également entre les meurtriers.
Art. 301. L'indemnité pour les hommes et les femmes est égale, mais lorsque le montant de l'indemnité est inférieur au tiers complet, l'indemnité pour la femme est la moitié de celle de l'homme. (Cette règle s'applique à l'indemnité pour les coups et blessures n'ayant pas entraîné la mort).
Art. 351. Le « walî damm » (tuteur du sang) est le même que les héritiers de la victime, à l'exception du conjoint qui n'a pas le droit de demander la peine de qisâs.
Art. 630. Si un homme surprend sa femme en train d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme et a connaissance de son consentement à l'adultère, il peut les tuer sur-le-champ, et s'il s'agit d'un rapport sexuel forcé pour sa femme, il peut seulement tuer l'homme. La punition pour les coups et blessures est la même que pour le meurtre dans ce cas.
Art. 258. Lorsqu'un homme commet un meurtre sur une femme, le walî (tuteur) de la victime doit payer la moitié du diyeh complète avant de recourir à la peine de représailles et si les héritiers de la victime acceptent, le meurtrier peut négocier un arrangement pour le montant total du prix du sang, soit moins, soit plus que cela.
Art. 382. Lorsqu'une femme musulmane est délibérément tuée, le droit de représailles est établi. Mais si le meurtrier est un homme musulman, le walî (tuteur) de la victime doit payer la moitié du diyeh complet avant de recourir à la peine de représailles. Si le meurtrier est un homme non musulman, aucune compensation n'est exigée avant d'appliquer la peine de représailles. Dans le cas de la peine de représailles pour le meurtre d'une femme non musulmane par un homme non musulman, le paiement de la différence du diyeh entre eux est requis.
Art. 209. Si un homme musulman tue intentionnellement une femme musulmane, il est condamné à la peine de mort. Cependant, le parent de la femme doit payer la moitié du prix du sang à l'auteur d'assassinat avant l'exécution. (Il est à noter que ce titre de « parent » est généralement appliqué au tuteur légal de la femme mineure.)
Art. 963. Si les époux ne sont pas des ressortissants du même pays, leurs relations personnelles et patrimoniales sont régies par les lois de l'État du pays dont l'époux est le ressortissant.
Art. 964. Les relations entre les parents et les enfants sont régies par les lois de l'État du pays dont le père est le ressortissant.
Art. 1105. Dans les relations entre époux, la direction de la famille incombe à l'époux.
Art. 1108. Si l'épouse refuse sans motif légitime de remplir ses devoirs conjugaux, elle ne sera pas en droit de recevoir de pension alimentaire.
Art. 1043 (amendé le 05/11/1991). Le mariage d'une fille vierge, même si elle a atteint l'âge de la puberté, est soumis à l'autorisation de son père ou de son grand-père paternel. Si le père ou le grand-père paternel refuse injustement de donner son autorisation, celle-ci est nulle pour autant que la fille obtienne l'autorisation du tribunal civil spécial. Le tribunal exigera que l'époux ait été présenté en bonne et due forme, que les conditions du mariage soient respectées et que la dot soit convenue entre les parties. Le mariage devra ensuite être enregistré au bureau d'enregistrement du mariage.
Art. 1158. Un enfant né pendant le mariage a pour père l'époux de sa mère, pour autant que la cohabitation ait préexisté dans un délai de 6 à 10 mois précédant la naissance de l'enfant.
Art. 1167. Un enfant né hors mariage n'est pas rattaché
au père adultérin.
Art. 220. Le père ou le grand-père qui tue son propre enfant n'est pas soumis à la peine de mort, mais il doit payer une indemnité au walî (tuteur) de l'enfant et subir une punition.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
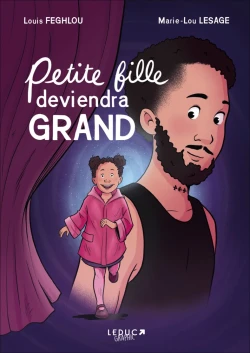
Transition de genre : une BD pour mieux comprendre
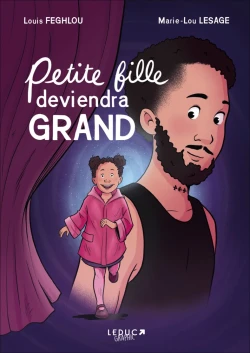
Parue en septembre 2024, la bande dessinée/Petite fille deviendra grand,/illustrée par Marie-Lou Lesage/,/est l'occasion pour lui, devenu auteur, de partager désormais avec un plus large public son histoire, et d'apporter sans détour, mais avec délicatesse, des réponses justes et éclairantes à des questions qu'il est parfois difficile de se poser, et de poser.
Tiré de Le Café pédagogique, Paris, 27 novembre 2024
Par Claire Berest
*Depuis 2020, Louis Feghlou, étudiant en médecine, raconte au quotidien, à travers son compte @loulouparfois sur Instagram et Tiktok, son parcours de vie d'homme transgenre et en particulier les différentes étapes qui jalonnent sa transition, entamée à l'âge de 18 ans.
Petite fille deviendra grand, Louis Feghlou et Marie-Lou Lesage. Editions Leduc – Collection Leduc Graphic <https://www.editionsleduc.com/produ...> /./
**
*Autobiographie d'un parcours*
Dans la première partie de l'album, l'auteur, né Alia, raconte ses origines, sa famille, son éducation, et la sensation diffuse, très tôt, d'être en décalage avec les codes féminins. Le coming out lesbien qui arrive à l'adolescence, apporte, un temps, une réponse. Mais n'empêche pas« la sensation de vide », de perdurer, et avec elle l'impression de ne pas s'être« vraiment trouvée »…
Jusqu'à ce qu'un reportage documentaire mette enfin les mots « dysphorie de genre » et « transidentité » sur ce qui était là, mais sans pouvoir, ou savoir, se dire. C'est alors un intense et renversant moment de bascule, placé exactement au centre du livre, évoqué dans une sorte de tourbillon graphique bouleversant. Un avant, et un après. La seconde partie de l'album est consacrée aux différentes étapes de la transition sociale, puis de la transition physique de réassignation, qui vont prendre plusieurs années, et confronter l'auteur, et son entourage, à de nombreuses interrogations et discussions.
Le récit prend donc son temps, et le rythme de narration fait ici particulièrement sens. Il rappelle en effet combien un parcours de transition vient de loin, et combien il se construit, étape après étape. On est bien loin des représentations qu'en font parfois certain·es, qui veulent y voir une lubie adolescente et un effet de mode. L'auteur ne cache d'ailleurs rien des difficultés rencontrées, des échecs et des rejets, de ce parcours vécu « comme un train en marche »au cours duquel, parmi ses proches,« des personnes descendraient à certains arrêts et ne remonteraient jamais ». Mais il raconte aussi les réussites, la libération et le bonheur de ne plus être, enfin,« incomplet »…
*Un album nécessaire*
Depuis 2021, une circulaire de l'Éducation nationale encadre l'accueil des élèves transgenres, ou en interrogation sur leur identité de genre, afin de les protéger de toute discrimination expliquant que : La transidentité est un fait qui concerne l'institution scolaire. Celle-ci est en effet confrontée, à l'instar de leur famille, à des situations d'enfants – parfois dès l'école primaire – ou d'adolescents qui se questionnent sur leur identité de genre ». Le texte a ses limites, mais il aussi le mérite d'exister, et de rappeler qu'il est de la responsabilité de tous et de toutes, au sein de l'Ecole, de se mobiliser « pour créer des environnements scolaires qui garantissent à ces élèves le droit à l'intégrité, au bien-être, à la santé et à la sécurité. »
Pour autant, une circulaire ne peut mettre fin à elle seule aux menaces et agissements discriminatoires. Comme le rappelait le sociologue Arnaud Alessandrin, dans un entretien donné auCafé pédagogiqueen octobre 2023,« plus de 80% des jeunes trans ou non binaires disent avoir vécu une scolarité dégradée ou très dégradée du fait des violences transphobes ou d'une peur qu'elles s'abattent sur eux ». A leur façon les « manuels scolaires parfois très stigmatisants »ou encore les « cours d'éducation à la sexualité (…) qui oublient littéralement l'existence de ces mineurs », participent de cette violence, et témoignent de l'écart important entre les préconisations officielles et ce qui se joue concrètement sur le terrain.
Pour combattre cette violence, et faire de l'Ecole un véritable lieu d'accueil, il faut s'attaquer aux idées reçues qui font le terreau de la transphobie, mais aussi permettre aux élèves trans de ne plus se sentir invisibilisé·es et empêché·es d'exister. Le très bel album/Petite fille devient grand/, particulièrement adapté par son langage, à la fois pudique et sans tabou, à un lectorat adolescent, peut, à coup sûr, contribuer efficacement à l'un et à l'autre…
Claire Berest, 27 novembre 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Stanley Ryerson : militant révolutionnaire et historien

L'automne 2024 est l'occasion du lancement d'une nouvelle collection de livres chez M Éditeur, une petite maison d'édition installée au Québec et dont le catalogue se compose principalement d'ouvrages progressistes. La collection se présente ainsi : « La série Recherches matérialistes publie des ouvrages critiques en sciences sociales dans une perspective marxiste. Elle vise à rendre accessibles divers travaux, passés et présents, concernant l'histoire, l'économie et la pensée politique, pour outiller les militant·es contemporain·es. La série désire en particulier valoriser la recherche québécoise ou portant sur le Québec. »
4 décembre 2024 | tiré de contretemps.eu
Le premier ouvrage publié est une réédition de Capitalisme et confédération (Stanley Ryerson, 1972). Dans ce livre, l'auteur présente une synthèse de la construction du Canada en intégrant les éléments économiques, sociaux et politiques, avec un intérêt particulier pour la lutte des classes. Ce livre est constitutif de l'historiographe marxiste canadienne et recèle une valeur programmatique pour la collection, dont l'objectif est d'encourager une réflexion marxiste afin d'alimenter la lutte d'émancipation du prolétariat. Contretemps vous présente ici la nouvelle préface à l'ouvrage, rédigée par Nathan Brullemans et Alexis Lafleur-Paiement.
Stanley Bréhaut Ryerson (1911-1998) demeure à ce jour le plus important intellectuel marxiste canadien, tant pour son rôle dirigeant au sein du Parti communiste du Canada (PCC) que pour ses contributions théoriques et historiques. Sa vie durant, il choisit de mettre son talent intellectuel au service du peuple, se privant longtemps d'une carrière prestigieuse à laquelle le destinait son milieu d'origine. C'est ainsi que, dans les années 1930, il rejoint le Parti communiste, entraînant rapidement son licenciement du collège Sir George William's (Montréal).
Dès lors, il se consacre au travail militant comme journaliste, éducateur populaire et organisateur. Durant trente ans, il produit une riche documentation destinée aux ouvrières et aux ouvriers. Lorsqu'il quitte le Parti en 1971, il poursuit sa mission au sein de la jeune Université du Québec à Montréal (UQAM). Sa proximité avec le mouvement indépendantiste lui attire la sympathie de la gauche québécoise. Malgré ses ruptures et ses soubresauts, la trajectoire de Ryerson suit le fil d'un marxisme vivant, porté vers la théorie, mais aussi profondément enraciné dans la pratique.
Alors que Ryerson incarnait jadis l'éminente figure de l'intellectuel du Parti, sa vie et son œuvre sont moins connues des jeunes générations, ce qui s'explique notamment par le ressac des grandes causes politiques qui furent les siennes, à savoir le marxisme et l'autodétermination du Québec. D'abord, le marxisme est entré en crise depuis les grandes défaites qu'a subies le mouvement ouvrier à partir des années 1970[1], puis de l'effondrement du Bloc de l'Est en 1991. Les restructurations néolibérales, la flexibilisation du travail et le saccage des syndicats rendent maintenant difficile une politique ouvrière radicale[2].
Ensuite, les échecs référendaires de 1980 et de 1995 ont affaibli le mouvement indépendantiste québécois qui s'est replié dans une posture identitaire[3]. Ce climat délétère complique la diffusion des idées marxistes, avec des conséquences pour la transmission de la pensée de Ryerson. Les études à son sujet se font rares et ses ouvrages demeurent difficiles d'accès. De fait, pratiquement aucun de ses livres n'a été traduit en français, alors que Capitalisme et confédération n'a pas été réédité depuis 1978.
Pourtant, nous sommes convaincus que l'œuvre de Ryerson, ainsi que sa méthode liant la recherche théorique et l'engagement politique, méritent notre attention. C'est pourquoi nous proposons, dans cette introduction, de présenter brièvement le parcours de Stanley Ryerson et les lignes de force qui traversent son œuvre, sensible aux trajectoires nationales et coloniales. Partant, le lecteur pourra mieux apprécier le riche contenu du livre Capitalisme et confédération, sa plus importante contribution à l'historiographie canadienne et à l'étude des trajectoires coloniales / nationales.
Une vie intellectuelle et militante[4]
Stanley Bréhaut Ryerson est né le 12 mars 1911 dans une famille de la bourgeoisie intellectuelle torontoise. Son père est le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Toronto et lui-même fréquente la meilleure école de la ville, le Upper Canada College (1919-1929). Il s'inscrit ensuite en langues modernes à l'Université de Toronto, tout en étant précepteur pour les enfants de certains des plus importants notables de la province.
À l'été 1931, il s'installe à Paris pour sa troisième année d'études universitaires. Il y rencontre de jeunes marxistes et évolue du libéralisme progressiste de son adolescence vers le communisme. Dès son retour au Canada (printemps 1932), il s'implique dans la Ligue des jeunes communistes (aile jeunesse du Parti communiste du Canada), puis devient rédacteur en chef du journal The Young Worker. En 1933-1934, le jeune Ryerson retourne à Paris pour ses études de deuxième cycle, toujours en langues modernes. L'époque est bouillante de contradictions sociales qui affermissent ses convictions. Il précise :
Ces deux séjours à Paris sont déterminants pour [moi]. C'est l'époque de la crise, de la montée des fascismes, et du Front populaire, et aussi celle où le marxisme et le communisme exercent une fascination certaine sur les intellectuels. C'est l'heure des choix ! [Je] considère que le communisme est alors la seule voie susceptible de résoudre les problèmes sociaux et la crise des valeurs engendrées par le capitalisme.[5]
En août 1934, il s'installe à Montréal afin d'enseigner au collège Sir George William's. L'expérience est de courte durée puisque Ryerson devient membre du Parti communiste du Canada, fait qui, lorsqu'il est connu en 1937, entraîne son licenciement. Alors que le PCC est en pleine ascension, il éprouve des difficultés à recruter des intellectuels, un vide qui permet à Ryerson d'occuper un rôle unique au sein de l'organisation[6].
À partir de 1935, les choses s'accélèrent pour le jeune Stanley qui cumule les postes au sein du Parti. Il est nommé directeur du programme d'éducation du PCC, puis devient membre du comité central. L'organisation considère alors que les Canadiens français sont les « masses les plus exploitées du Canada » et cherche conséquemment à développer sa présence au Québec[7].
Ryerson apparaît comme la personne désignée pour s'occuper de cette tâche en sa qualité d'intellectuel bilingue. Il est élu secrétaire du Parti pour le Québec et rédacteur en chef adjoint du journal de l'aile provinciale, Clarté. À partir de 1937, Ryerson travaille à temps plein pour le Parti et devient un de ses principaux dirigeants, ce qui lui vaut d'être arrêté, et de voir ses livres confisqués puis brûlés par la police. En 1939, il passe à la clandestinité, peu de temps avant que le PCC soit déclaré illégal[8].
En septembre 1942, les dirigeants communistes clandestins (dont Ryerson) décident de se livrer aux autorités et sont brièvement incarcérés, avant de lancer une organisation paravent pour le Parti communiste, appelée Parti ouvrier progressiste. Ryerson, de retour à Toronto, continue de s'occuper de l'éducation et prend la tête de la nouvelle revue théorique National Affairs Monthly en 1944. Cette période agitée ne l'empêche pas de publier une quinzaine de livres et de brochures entre 1937 et 1949.
En 1951 et après, Ryerson voyage régulièrement en URSS en tant que représentant du Parti et intègre la rédaction de la revue du Kominform, Pour une paix durable et une démocratie populaire. Il participe au XXe Congrès du Parti communiste d'Union soviétique (1956) en tant que membre de la délégation du Canada et rencontre Nikita Khrouchtchev. En 1960, Ryerson prend la direction du Centre d'études marxistes (Toronto) et dirige l'édition canadienne de la World Marxist Review.
Durant cette décennie, il joue non seulement un rôle dirigeant dans le Parti communiste du Canada, mais obtient aussi une renommée dans le mouvement communiste mondial en tant que directeur de la revue Marxist Quarterly. Cette période faste est marquée par la publication de deux ouvrages historiques majeurs : The Founding of Canada (1960) et Unequal Union (1968), traduit en français sous le nom Capitalisme et confédération (1972).
Les années suivantes se révèlent plus compliquées pour Ryerson, qui démissionne de son poste au comité central en 1969 en raison de désaccords avec les autres dirigeants concernant l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie (1968), la question de l'autodétermination du Québec et la démocratie socialiste. En 1970, Ryerson se réinstalle à Montréal où il est embauché comme professeur à l'UQAM. Ses divergences avec le PCC persistant, il décide de le quitter en 1971.
L'engagement marxiste continue d'animer les travaux de Ryerson, mais c'est surtout dans le domaine académique qu'il brille dans les années 1970 et 1980, alors que la cause de l'indépendance du Québec devient son principal combat à la même époque. Il poursuit son implication dans le Comité international des sciences historiques, tout en publiant de nombreux articles. Il obtient un doctorat de l'Université Laval (1987) en témoignage de son œuvre, pour lequel il doit seulement écrire un texte d'une cinquantaine de pages décrivant sa vie et sa vision de l'histoire[9]. Ryerson prend sa retraite en 1991 et obtient l'éméritat du département d'histoire de l'UQAM l'année suivante. Il décède le 25 avril 1998.
Cette vie profondément marquée par l'action politique et intellectuellement riche a laissé des traces durables. Ryerson a rédigé un grand nombre de textes : plus de 500 selon la recension non exhaustive de Robert Comeau et de Robert Tremblay[10]. De cette masse ressortent une vingtaine de livres et de brochures, dont les deux ouvrages fondamentaux parus en 1960 et en 1968. Sans prétendre épuiser le sujet, nous pouvons donner quelques indications au lecteur afin qu'il s'oriente dans cette œuvre colossale, tout en soulignant ses traits fondamentaux.
« L'histoire du peuple », une œuvre à vocation politique
L'œuvre de Ryerson, bien que globalement cohérente dans sa méthode et ses sujets, semble formée de blocs successifs.
Il y a d'abord les réflexions historiques dans un dessein d'éducation et d'agitation politique (vers 1935-1949), suivi d'une deuxième période marquée par l'approfondissement théorique et les questions internationales (vers 1950-1960), elle-même suivie par la séquence des « grandes études marxistes » sur l'histoire du Canada (1960-1972) et, enfin, d'un quatrième moment plus académique, marqué du sceau de l'indépendantisme (après 1972).
Cette division schématique ne saurait gommer les récurrences dans son œuvre, au premier rang desquelles l'approche marxiste, la connexion entre théorie et pratique, et la centralité de l'histoire canadienne. C'est d'ailleurs sur ces éléments de continuité que nous voulons insister, avec une attention particulière à la méthode de Ryerson et à ses ouvrages des années 1960.
La vision de l'histoire de Stanley Ryerson est restée étonnamment constante durant ses quelques soixante années de travail. La cohérence de sa démarche trouve son origine dans le programme initié par le Parti dans les années 1930 sous la direction de Margaret Fairley et de Ryerson. Ce projet, appelé « l'histoire du peuple », cherche à présenter une chronique du Canada et des luttes populaires canadiennes aux travailleurs, de manière accessible et didactique. Les grandes études marxistes publiées par Ryerson dans les années 1960 forment l'apogée de ce programme au long cours[11], avec trois axes principaux.
D'abord, l'histoire est considérée comme un outil nécessaire afin de comprendre les structures sociales du présent, dans le sillon du matérialisme historique. Ensuite, l'histoire possède une valeur heuristique pour éduquer les classes laborieuses et élever leur niveau de conscience, permettant aussi de les intéresser aux luttes politiques. Enfin, l'histoire peut servir d'appui aux luttes politiques concrètes, puisqu'elle permet de comprendre leurs ressorts, mais aussi parce qu'elle offre un bassin comprenant la totalité des expériences accumulées par la classe ouvrière dans son combat pour son émancipation.
De fait, l'histoire joue un rôle essentiel dans le processus révolutionnaire, qui n'est pas sans rappeler « l'historicisme réaliste » d'Antonio Gramsci (1891-1937)[12]. Dans un article de 1947, Ryerson explique :
« Notre étude théorique portera fruit dans la mesure où elle fusionnera avec les tâches pratiques de la lutte. […] Nous traitons de la vraie histoire de notre pays afin d'armer et d'inspirer le camp du peuple dans son combat contre le fascisme en Amérique, et pour aider à faire avancer la lutte pour un Canada socialiste ! »[13]
Malgré son éloignement du marxisme révolutionnaire, Ryerson conserve le même cadre épistémologique quarante ans plus tard, lorsqu'il explique en 1987 : « Au plan social, l'histoire répond à des besoins précis : besoins de savoir leur genèse pour comprendre les problèmes actuels, besoin pour les groupes sociaux de prendre conscience de leurs racines et de leur identité pour devenir des agents efficaces. »[14]
De plus, l'œuvre de Ryerson a une propension multidisciplinaire qui associe l'histoire, l'économie, les sciences politiques et les études culturelles. Ces différents domaines sont pour lui autant de moyens de connaître les réalités passées et présentes, et des outils pour agir concrètement en vue de transformer la société. Cette ouverture est perceptible dans son approche à la fois globale et située, puisque « c'est dans un contexte international que se constitue le national »[15].
Conséquemment, Ryerson n'a de cesse d'entretenir le dialogue avec ses camarades étrangers, surtout par l'entremise du Comité international des sciences historiques. La focalisation sur le contexte canadien s'avère une manière de comprendre les dynamiques internationales, sous forme d'étude de cas, quoique jamais réductible totalement. Le chercheur militant doit pratiquer sans cesse des allers-retours dans ses analyses entre son domaine et les grands facteurs qui structurent le monde (capitalisme, impérialisme). Après, l'étude d'un contexte donné demeure nécessaire pour vérifier les principes généraux, mais aussi pour lutter efficacement dans ledit contexte.
Une autre manière de synthétiser l'approche de Ryerson est d'affirmer avec Jean-Paul Bernard que sa méthode « se caractérise par la valorisation, sans exclusive, de la totalisation, de la conceptualisation, et de la primauté du présent dans le rapport présent / passé »[16]. C'est dans cette perspective qu'il étudie l'histoire de la transition du féodalisme au capitalisme (vers 1775-1840), le développement de la classe ouvrière canadienne et les luttes politiques du XIXe siècle.
À partir de ses recherches, Ryerson croit que nous sommes en mesure de comprendre les structures politiques, sociales et économiques qui fondent le Canada, et de mieux les combattre. Pour lui, le développement du capitalisme canadien s'inscrit dans une transition internationale, mais implique une spécificité, soit l'assujettissement des Canadiens français, politiquement et économiquement, ainsi que la relégation aux marges des peuples autochtones. Son œuvre accorde un intérêt marqué aux rapports entre les différentes nations qui forment le Canada, où le droit à l'autodétermination des peuples joue un rôle central.
Alors que le PCC s'est longtemps crispé sur la question nationale québécoise, les études pionnières de Ryerson sur le républicanisme dans les deux Canadas l'entraînent vers une position d'ouverture. De sa fondation jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale (1921-1939), le Parti refuse de reconnaître que les Canadiens français forment une nation distincte, évacuant ipso facto la question de l'autodétermination nationale[17].
Ryerson joue alors un rôle important dans la reconnaissance du Québec comme nation minoritaire, notamment grâce à son ouvrage French Canada (1943), où il met de l'avant les traditions démocratiques et anti-impérialistes du Québec. Jusque dans les années 1960, le PCC et Ryerson adhèrent néanmoins aux thèses de Lénine sur la question nationale, à savoir que toute nation a un droit conditionnel à l'autodétermination, dans une logique de subordination aux luttes du prolétariat[18]. L'historien abandonne cette position après sa rupture avec le Parti.
Dans le sillage de la commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme au Canada, Ryerson qualifie le Québec de « nation dominée » et réexamine le potentiel révolutionnaire du mouvement national québécois. La conjoncture politique, marquée par les événements d'Octobre 1970 et du Front commun intersyndical de 1972, prouve à ses yeux la jonction entre la lutte de libération nationale et la lutte des classes[19].
Pourtant, Ryerson n'est pas un souverainiste jusqu'au-boutiste : il défend la reconnaissance des Franco-Québécois comme nation et leur droit réel à l'autodétermination qui lui semble irréalisable dans le Canada tel qu'il existe. Une fédération socialiste demeure la solution qu'il privilégie en théorie, mais l'indépendance est préférable dans le contexte bloqué de l'époque Trudeau. Cette position s'harmonise avec l'air du temps : « Il paraît assez évident que, tout au long des années 70, les positions de l'auteur correspondent au plus près au sentiment politique dominant au sein des mouvements sociaux du Québec, au point d'en constituer l'expression intellectuelle la mieux articulée. »[20]
En somme, l'historien révolutionnaire désire comprendre l'origine des structures d'exploitation qui s'imposent aux sociétés contemporaines, saisir les potentialités de la classe ouvrière – agent révolutionnaire par excellence – et découvrir comment instaurer les conditions sociopolitiques d'égalité pour les nations, dont le Québec. Son œuvre, « essentiellement marquée par le matérialisme historique »[21], concourt à l'objectif d'un monde libéré du capitalisme et de l'impérialisme.
Retour à Capitalisme et confédération
En 1996, l'historien David Frank écrivait au sujet de Stanley Ryerson : « Le renouveau de l'histoire du Canada dans les dernières décennies a accumulé à son endroit une dette qui est loin d'être toujours reconnue. »[22] Si cette mésestime persiste, un problème plus grave affecte aujourd'hui l'œuvre de Ryerson : son manque de lecteurs. Cet écueil est d'autant pénible que les ouvrages de Ryerson recèlent une valeur historique, épistémologique, didactique et heuristique importante pour approcher l'histoire du Canada. Plus de cinquante ans après sa publication, l'heure est venue d'un retour à Capitalisme et confédération.
L'ouvrage paraît aux éditions Parti pris en 1972, en tant que « version refondue, corrigée et augmentée » du livre Unequal Union sorti en anglais en 1968[23]. Le titre francophone est sans doute plus conforme à l'esprit du projet de Ryerson qui veut éclairer en chassé-croisé les structures économiques et politiques, c'est-à-dire la concomitance des processus d'accumulation dans la colonie et la formation d'un appareil d'État bourgeois moderne, hostile aux nations minoritaires et aux souverainetés autochtones.
La question centrale de Capitalisme et confédération est la suivante : « Quel rapport y aurait-il entre l'institution du travail salarié et la Confédération canadienne ? En d'autres termes : entre l'industrie capitaliste et la question nationale ? »[24] Les deux axes qui expliquent l'histoire du Canada seraient, d'un côté, les classes sociales et la transition vers le capitalisme, et de l'autre, la consolidation des appareils d'État et les principes démocratiques nationaux. La proposition de Ryerson consiste à restituer la formation de ces catégories à travers la combinaison de la lutte des classes et du contexte colonial / national.
Le livre s'inscrit dans le renouveau de l'historiographie marxiste canadienne des années 1970[25]. Néanmoins, contrairement à la tradition économiciste issue de la IIe Internationale, Ryerson ne considère pas les phénomènes étatiques et nationaux comme de simples reflets superstructurels de la base économique[26]. Il se distancie du structuralisme althussérien qui préconise une subordination de l'histoire à la philosophie marxiste (à travers les concepts de classes, de surdétermination, d'appareils idéologiques d'État, d'instances et de modes de production). Son œuvre s'inscrit plutôt dans l'historicisme d'Edward P. Thompson, qui demeure attaché à une méthode inductive et à la recherche empirique[27].
De fait, Ryerson accorde une primauté aux événements, à l'agentivité humaine et à l'imprévisibilité de la lutte des classes. Comme il le dit, son projet est celui d'une « histoire socio-économique, politique et philosophique qui tienne pleinement compte des réalités sociales, nationales, humaines »[28]. Il s'en dégage une méthode d'interprétation historique flexible qui, sans mobiliser un appareil conceptuel abstrait, intègre les notions marxistes avec agilité et une certaine simplicité[29].
Ainsi, l'ouvrage renvoie dos à dos les lectures économicistes et nationalistes de l'histoire canadienne, qui recoupent approximativement les vues des Écoles historiques de Québec et de Montréal[30]. La première vision, incarnée par Fernand Ouellet, prétend que la Conquête anglaise de 1760 n'entraîne pas une coupure radicale avec l'économie de la Nouvelle-France. L'accent est mis sur la continuité des structures coloniales, mercantiles et seigneuriales ainsi que sur la prolongation du commerce des fourrures, quoiqu'en soulignant le dynamisme économique impulsé par les marchands anglais[31].
De manière semblable, l'historien Harrold Innis contribue à l'histoire économique du Canada en insistant sur les aspects techniques et géographiques. Ryerson estime que la thèse de Ouellet se focalise unilatéralement sur la conjoncture économique et néglige les questions nationales et politiques, notamment les révolutions atlantiques et l'arrivée massive des loyalistes qui entraîne un développement inégal des institutions politiques[32]. Dans le cas d'Innis, notre auteur considère que son « matérialisme » ressemble plutôt à une métaphysique, car il fait l'histoire de l'extraction des ressources naturelles en déconnexion des rapports sociaux qui médiatisent la nature, évacuant du coup la référence aux classes sociales[33].
À l'extrême opposé, la thèse du « nationalisme traditionnel » portée par Lionel Groulx apparaît aussi inacceptable, car elle comprend la nation comme une « mystique réactionnaire » et « empêche de situer le fait national dans le contexte universel de l'évolution des formations socio-économiques »[34].
Pour Ryerson, l'empire colonial relève d'un espace mondial où se joue un conflit entre de nombreuses classes et fractions de classes : marchands anglais, petits-bourgeois républicains, capitaines d'industrie émergente, seigneurs, clercs, paysannerie… sans oublier la classe ouvrière naissante. Le recoupement des positions de classes et des intérêts nationaux permet de dépasser l'explication simpliste de l'école nationaliste[35].
Capitalisme et confédération présente la formation de l'État canadien dans le contexte d'une transition inégale de l'économie d'Ancien Régime vers le mode de production capitaliste. Dans le sillage de Maurice Dobb, Ryerson rappelle la distinction analytique entre le capital marchand et le capital industriel[36]. Les marchés précapitalistes sont compatibles avec le commerce métropolitain, alors que le passage au capitalisme commande la transformation de la terre en capital, la dépossession des producteurs directs et, à terme, l'irruption d'une révolution industrielle.
La théorie de Ryerson repose sur l'idée que l'essor de la petite industrie caractérise la transition capitaliste autour de 1830. Cette dynamique s'exprime selon lui à travers trois secteurs : 1) le commerce du bois et les chantiers maritimes, 2) les usines et les ateliers, et 3) l'expansion de la petite entreprise de biens de consommation. Dans les deux premiers cas, les capitalistes sont canadiens-anglais (avec des prolétaires francophones), alors que le troisième secteur est dominé par « l'embryon d'une bourgeoisie industrielle francophone »[37]. Mais cette transition est bloquée par les forces coloniales, économiques comme politiques.
L'inertie coloniale est aggravée par la crise qui sévit dans les campagnes, résultat de la distribution inégale des terres, du renforcement des charges féodales après la Conquête et des mauvaises récoltes. Cette crise agraire plus ou moins permanente (avec une intensité particulière dans les années 1830) pousse des milliers d'habitants – c'est-à-dire des paysans canadiens français – à migrer vers les États-Unis, sans avoir été préalablement transformés en prolétaires salariés, en raison de l'absence de travail industriel suffisant en ville. Il faut attendre l'étouffement des insurrections de 1837-1838 pour lancer la révolution industrielle canadienne et construire des institutions bourgeoises modernes[38].
Toujours est-il que Ryerson discerne l'apparition d'un conflit de classe qui oppose les petits capitalistes industriels aux élites aristocratiques, marchandes et cléricales. En s'appuyant sur le mécontentement généralisé des habitants face au régime seigneurial, les conditions sont mûres pour la révolution. C'est à partir de ces antagonismes que Ryerson pose le diagnostic d'une révolution bourgeoise avortée. Plus précisément, il décrit les insurrections de 1837-1838 comme une « révolte paysanne dirigée par la petite-bourgeoise » ou encore – d'une manière aussi stimulante que paradoxale – comme une « révolution bourgeoise sans bourgeoisie »[39].
De plus, les insurrections se manifestent à un moment où le pouvoir des capitalistes canadiens apparaît encore bigarré. Certains des insurgés sont attachés au régime seigneurial, comme Louis-Joseph Papineau. Il n'en demeure pas moins que les révolutions au Canada adoptent l'esprit démocratique bourgeois de l'époque, tout en s'incarnant de manière originale suivant leur situation géopolitique et économique[40].
Ryerson considère aussi l'expérience révolutionnaire canadienne comme une itération des révolutions atlantiques, au sens de l'historien Jacques Godechot[41]. Il rappelle l'influence politique des révolutions américaine et française, ainsi que leur impact sur la formation intellectuelle des leaders canadiens. L'historien note des filiations directes, comme pour l'exilé polonais Von Schultz qui avait combattu le despotisme du tsar en Pologne en 1831, avant de s'engager dans la révolution du Haut-Canada[42].
Le nationalisme des Patriotes est loin d'exprimer un sentiment ethnique étroit, comme le pense lord Durham qui réfléchit les rébellions en termes de conflit de « races ». Il est plus juste de parler d'un « patriotisme démocratique » se préoccupant de la condition des Canadiens français. C'est un fils de loyalistes, Robert Nelson, qui proclame le 28 février 1838 la République du Bas-Canada. Sans oublier, de manière plus fondamentale, que l'action révolutionnaire de 1837-1838 a lieu dans les deux Canadas, où les colons d'origine britannique se soulèvent aussi[43].
L'auteur conçoit les insurrections du Haut et du Bas-Canada comme des sœurs. Leurs origines sont similaires : c'est l'oppression du pouvoir impérial, et la domination des marchands et des propriétaires terriens. Dans le Haut-Canada, c'est le despotisme du « family compact » sur les petits colons qui mène à une lutte armée de libération nationale. Le leader William Lyon Mackenzie déclare sa solidarité avec l'insurrection du Bas-Canada, bien que les liens militaires soient trop faibles pour mener à la réussite de la révolte.
Ces républicains sont aussi en faveur de l'abolition de l'esclavage, alors que la déclaration d'indépendance de Nelson affirme que les Autochtones possèdent les mêmes droits que tous les autres citoyens. Dans le Bas-Canada, les récriminations contre le despotisme du gouverneur, l'arbitraire des autorités, les blocages sociaux et économiques, ainsi que l'infériorisation des francophones, se mêlent dans un mouvement révolutionnaire, nationaliste et républicain, avec une direction démocratique.
Il est clair pour Ryerson que le triomphe de la contre-révolution n'efface pas l'apport décisif des rébellions aux transformations politiques et économiques de la colonie. C'est après l'Acte d'Union de 1840 que le gouvernement responsable est établi grâce à la pression de Lafontaine, offrant les bases de l'état bourgeois établi en 1867.
Mais ces éléments politiques seraient insuffisants pour comprendre pleinement le développement du Canada : ce qu'il fallait pour unir le pays, c'est un réseau de communication efficace, un chemin de fer. À partir de 1850, il se développe un capitalisme de connivence entre les hommes d'État canadiens et les grandes compagnies de chemin de fer, particulièrement la Grand Trunk Railway. Le train devient l'instrument du colonialisme et permet de lancer les bases d'une accumulation capitaliste élargie, principalement au service des intérêts anglais[44].
L'ouvrage prend au sérieux la question du colonialisme et ses effets corrosifs sur les sociétés autochtones, soulignant « l'exploitation effrénée des populations indigènes », marquée par la violence de l'accumulation primitive[45]. Pour Ryerson, cela relève d'un « régime de colonialisme infiniment plus opprimant et impitoyable que celui qui fut par la suite imposé aux colonies blanches par leur métropole »[46].
En plus d'un siphonnage de l'économie traditionnelle, il faut ajouter les stratégies d'accaparement des terres stimulées par l'expansion territoriale d'un Canada voulant imposer son hégémonie a mari usque ad mare. C'est à partir de ces transformations qu'il faut comprendre les soulèvements des Métis de 1869 et de 1885 que Ryerson considère comme « le seul exemple d'une intervention réelle des masses dans la question de la Confédération »[47].
On peut dire que Ryerson conçoit la domination et l'exploitation des Premières Nations par l'Empire britannique en deux temps, qui répondent à la logique de transition du colonialisme classique vers l'impérialisme. Le premier moment est l'exploitation mercantile coloniale du travail autochtone à travers le commerce des fourrures, au profit des marchands anglais (jusqu'en 1840 environ)[48]. La seconde phase, caractérisée par la domination capitaliste, implique un double mouvement de prolétarisation et d'encasernement des peuples autochtones.
En somme, dans Capitalisme et confédération, Ryerson offre une remarquable leçon d'histoire intégrée, avec une focale sur les classes populaires et les peuples minoritaires. Il atteint son objectif d'écrire une histoire à même d'éclairer la conscience collective, et de nous aider à lutter contre des systèmes d'exploitation profondément enracinés, mais jamais irrévocables.
***
Depuis l'œuvre pionnière de Ryerson, de nombreuses avancées ont été faites sur le terrain de l'histoire sociale au Québec, alors que le marxisme s'est considérablement renouvelé dans sa méthode historique[49]. Pareillement, divers travaux stimulants ont vu le jour depuis les années 1990 concernant les rébellions de 1837-1838 et la transition vers le capitalisme au Canada. Les contributions les plus importantes associent les insurrections patriotes aux révolutions atlantiques et éclairent leur contenu républicain, des idées qui trouvent leur origine dans l'œuvre de Stanley Ryerson[50].
À la jonction du marxisme et de l'histoire, la discussion sur la transition au Canada a fait des progrès considérables. Plusieurs hypothèses ont été formulées quant à la nature des modes de production dans la vallée du Saint-Laurent et aux causes des changements sociaux afférents[51]. À la lumière de ces travaux, Capitalisme et confédération apparaît comme une œuvre séminale, pleine d'intuitions qui n'ont pas fini de produire leurs fruits et, surtout, porteuse d'une méthode dialectique dont la maîtrise n'a guère d'équivalent. Ainsi, le projet de Stanley Ryerson d'une sociologie historique de la formation étatique, coloniale et nationale, liée à une théorie de la transition vers le capitalisme, continue de susciter l'intérêt[52].
Maintenant, laissons place à l'œuvre de Stanley Bréhaut Ryerson. Que la lectrice ou le lecteur y trouve une histoire riche et vivante, présentée suivant une méthode marxiste dont il ne faut jamais oublier le potentiel heuristique et révolutionnaire.
Nathan Brullemans et Alexis Lafleur-Paiement[53]
Montréal, le 15 juin 2024.
Notes
[1] Sur la crise du marxisme, voir MOREAU, François et Richard POULIN. « Montée et déclin du marxisme au Québec » dans Critiques socialistes, no 1 (automne 1986), pages 101-146.
[2] À ce sujet, voir notamment CAMFIELD, David. La crise du syndicalisme au Canada et au Québec, Montréal, M Éditeur, 2014, et ROBERT, Martin et Martin PETITCLERC. Grève et paix. Une histoire des lois spéciales au Québec, Montréal, Lux, 2018.
[3] PIOTTE, Jean-Marc et Jean-Pierre COUTURE. Les nouveaux visages du nationalisme conservateur au Québec, Montréal, Québec Amérique, 2012.
[4] La meilleure source biographique demeure COMEAU, Robert et Robert TREMBLAY (dir.). Stanley Bréhaut Ryerson, un intellectuel de combat, Hull, Vents d'Ouest, 1996.
[5] RYERSON, Stanley B. Connaître l'histoire, comprendre la société : un rapport en voie de mutation ?, thèse de doctorat, Université Laval, 1987, page 44.
[6] KEALEY, Gregory. « Stanley Bréhaut Ryerson : intellectuel révolutionnaire canadien » dans COMEAU, Robert et Bernard DIONNE (dir.). Le droit de se taire. Histoire des communistes au Québec, Montréal, VLB, 1989, page 200.
[7] BISAILLON, Joël. Stanley Bréhaut Ryerson (1911-1998) et l'analyse de sa pensée sur la question nationale au Québec, mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 2008, page 53.
[8] Le PCC est interdit à trois reprises : en 1921, 1932 et 1940.
[9] RYERSON. Connaître l'histoire, comprendre la société, 1987.
[10] COMEAU et TREMBLAY. Stanley Bréhaut Ryerson, 1996, pages 381-411.
[11] KEALEY, Gregory. « Stanley Bréhaut Ryerson : historien marxiste » dans COMEAU et DIONNE. Le droit de se taire, 1989, page 250.
[12] DOUET, Yohann. L'histoire et la question de la modernité chez Antonio Gramsci, Paris, Garnier, 2022.
[13] RYERSON, Stanley B. « Marxism and the Writing of Canadian History » dans National Affairs Monthly, vol. 4-2 (1947), page 51. Nous traduisons.
[14] RYERSON. Connaître l'histoire, comprendre la société, 1987, page 45.
[15] RYERSON, Stanley B. « À propos de Les syndicats nationaux… de Jacques Rouillard » dans Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 35-3 (1981), page 400.
[16] Dans COMEAU et TREMBLAY. Stanley Bréhaut Ryerson, 1996, page 98.
[17] BISAILLON. Stanley Bréhaut Ryerson, 2008, page 28.
[18] BISAILLON. Stanley Bréhaut Ryerson, 2008, page 93.
[19] BISAILLON. Stanley Bréhaut Ryerson, 2008, page 182.
[20] Sur l'enjeu des liens entre le Canada et le Québec, voir l'excellent DENIS, Serge. « Stanley B. Ryerson et le Québec contemporain, 1965-1993 » dans COMEAU et TREMBLAY. Stanley Bréhaut Ryerson, 1996, pages 157-208 (page 196 pour la citation).
[21] MASSÉ, Georges. « Démarche historienne et apport d'un marxiste québécois à l'historiographie ouvrière » dans COMEAU et TREMBLAY. Stanley Bréhaut Ryerson, 1996, page 307.
[22] FRANK, David. « L'influence de Stanley B. Ryerson auprès de la nouvelle gauche anglo-canadienne » dans COMEAU et TREMBLAY. Stanley Bréhaut Ryerson, 1996, page 359.
[23] Le livre connaît deux éditions en français, d'abord sous le titre Le capitalisme et la confédération (1972) puis sous le titre Capitalisme et confédération (1978) qui présentent le même texte.
[24] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 13.
[25] Par exemple : BOURQUE, Gilles. Classes sociales et question nationale au Québec, 1760-1840, Montréal, Parti pris, 1970 ; BOURQUE, Gilles et Anne LEGARÉ. Le Québec. La question nationale, Paris, Maspero, 1979 ; NIOSI, Jorge. La bourgeoisie canadienne. La formation et le développement d'une classe dominante, Montréal, Boréal, 1980 ; GAGNON, Charles. Feu sur l'Amérique, Montréal, Lux, 2006.
[26] RYERSON, Stanley, B. « Prise de conscience : nationalité et tensions sociétales. Notes pour un témoignage » dans Cahiers de recherche sociologique, no 20 (1993), page 16.
[27] THOMPSON, Edward P. The Making of the English Working Class, New York, Penguin, 1966.
[28] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 15.
[29] FECTEAU, Jean-Marie. « Classes, démocratie, nation. La transition au capitalisme chez Stanley B. Ryerson » dans COMEAU et TREMBLAY. Stanley Bréhaut Ryerson, 1996, page 238.
[30] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 24.
[31] OUELLET, Fernand. Histoire économique et sociale du Québec (1760-1850), Montréal, Fides, 1966.
[32] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, pages 25-26.
[33] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 514, et KEALEY. « Stanley Bréhaut Ryerson : historien marxiste », 1989, page 248.
[34] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 24.
[35] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 504.
[36] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 515.
[37] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972,page 47.
[38] KEALEY. « Stanley Bréhaut Ryerson : historien marxiste », 1989, page 254.
[39] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 113.
[40] KEALEY. « Stanley Bréhaut Ryerson : historien marxiste », 1989, page 252.
[41] COVO, Manuel et al. « Les révolutions atlantiques. Une vague démocratique » dans BANTIGNY, Ludivine (dir.). Une histoire globale des révolutions, Paris, La Découverte, 2023, pages 223-263.
[42] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972,page 178.
[43] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 82. Voir aussi MAUDUIT, Julien. La guerre d'indépendance des Canadas, Montréal, McGill's University Press, 2022.
[44] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 317.
[45] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 20. Au sujet des peuples autochtones et du processus colonial canadien, on consultera aussi les six premiers chapitres de RYERSON, Stanley. The Founding of Canada, Toronto, Progress Books, 1960.
[46] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 20.
[47] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 460.
[48] RYERSON. Le capitalisme et la confédération, 1972, page 515.
[49] Pour un exemple concernant la transition, voir BRENNER, Robert et al. The Brenner Debate : Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
[50] Voir notamment GREER, Allan. Habitants et patriotes : la Rébellion de 1837 dans les campagnes du Bas-Canada, Montréal, Boréal, 1997 ; LAMONDE, Yvan. Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896, Montréal, Fides, 2000 ; BELLAVANCE, Marcel. « La rébellion de 1837 et les modèles théoriques de l'émergence de la nation et du nationalisme » dans Revue d'histoire de l'Amérique française, no 53-3 (2000), pages 367-400 ; HARVEY, Louis-Georges. Le printemps de l'Amérique française, Montréal, Boréal, 2005 ; DUCHARME, Michel. Le concept de liberté au Canada à l'époque des révolutions atlantiques, Montréal, McGill's University Press, 2010.
[51] BERNIER, Gérald et Daniel SALÉE. Entre l'ordre et la liberté. Colonialisme, pouvoir et transition vers le capitalisme dans le Québec du XIXe siècle, Montréal, Boréal, 1995 ; GREER, Allan. Habitants, marchands et seigneurs. La société rurale du Bas-Richelieu, Montréal, Septentrion, 2000 ; GRENIER, Benoît. « Pouvoir et contre-pouvoir dans le monde rural laurentien aux XVIIIe et XIXe siècles » dans Bulletin d'histoire politique, no 18-1 (2009), pages 143-163 ; GREER, Allan. Property and Dispossession : Natives, Empires, and Land in Early Modern North America, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 ; SANFILIPPO, Matteo. Le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent. Un problème historiographique, Ottawa, Presses universitaires d'Ottawa, 2022.
[52] DUFOUR, Frédérick Guillaume. « Lamonde, la Brève histoire des idées au Québec et les défis d'une sociologie historique des processus de formation étatique, nationales et coloniales au Québec et au Canada » dans Bulletin d'histoire politique, no 29-1 (2020), pages 195-211.
[53] Les auteurs codirigent la série Recherches matérialistes chez M Éditeur et sont membres du collectif Archives Révolutionnaires (https://archivesrevolutionnaires.com/).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
La guerre, Yes Sir !
Il s'agit là du titre d'un roman publié par Roch Carrier en 1970 ; c'est une fable à la fois réaliste et surréaliste dont l'action se situe dans le Québec rural au début des des années 1940.
Dernièrement, le président Donald Trump a évoqué lors d'une rencontre à Mar-a-Lago en présence de Justin Trudeau la possibilité que le Canada devienne le cinquante-et-unième État américain dont le premier ministre serait nommé gouverneur. Tout ça si Ottawa s'avérait incapable de faire face aux tarifs douaniers de 25% que Trump menace d'imposer si Ottawa ne resserre pas la sécurité aux frontières. Tous eux n'ont évidemment pas pris au sérieux cette farce. Il semble que Trump, comme bon nombre de ses compatriotes considère les Canadiens comme des Américains du nord, vu l'étroite imbrication de leurs économies respectives. Comme on sait, les liens commerciaux sont intenses entre les deux pays. Il faut y ajouter la proximité culturelle, surtout entre le Canada anglais et son grand voisin du sud. Le Canada est donc un satellite des États-Unis, même s'il bénéficie d'une certaine autonomie vis-à-vis de son puissant voisin, surtout en politique étrangère. Vu le rapport de forces entre les deux pays, peut-il en être autrement ? L'alliance militaire canado-américaine cimente encore davantage les liens entre les deux États.
Mais peut-on pour autant en déduire que l'hypothétique annexion du Canada par Washington irait de soi et que l'opération si elle se produisait, se ferait sans douleur ? certainement pas.
Tout d'abord, aucun indice ne permet de penser que l'ensemble des Américains serait intéressé à "gober" le Canada, une ingestion qui se révélerait vite indigeste. L'intégration, même relative, des deux économies et les liens commerciaux entre les deux États satisfont la plupart des citoyens et citoyennes de la république du sud.
Une annexion ne pourrait que déstabiliser leurs économies respectives, ce qui compromettrait la stabilité politique nord-américaine. Le Mexique est beaucoup plus faible que le Canada mais pour autant Trump n'a jamais évoqué la possibilité de son annexion. Les institutions canadiennes viennent tout droit du parlementarisme britannique, celles des États-Unis sont républicaines. Le type de société et l'échelle des valeurs diffèrent donc beaucoup entre l'un et l'autre pays.
Il faut ensuite relever que le nationalisme "canadian" poserait un problème épineux à Washington en cas d'annexion. La Maison-Blanche se heurterait à une résistance farouche de la part d'une bonne partie de la population. Il en résulterait un conflit majeur et indésirable pour le gouvernement américain. Après tout, le déploiement des investissements américains au Canada rapporte déjà beaucoup aux firmes américaines (et donc indirectement à l'État par le biais des taxes et impôts). Alors, pourquoi risquer de tout bousiller ? Ottawa dispose d'une influence internationale importante et une tentative d'annexion plomberait encore davantage la crédibilité américaine dans le monde déjà très amochée.
Si l'annexion se produisait, comment disposer de cet immense territoire ? Trump en plaisantant, a affirmé à Mar-a-Lago qu'on pourrait diviser le Canada en deux États, l'un libéral et l'autre conservateur, mais dans la réalité il faudrait le diviser en plusieurs États et donc, tenir compte de ses particularités régionales (en particulier de celle du Québec), ce qui représenterait tout un casse-tête pour les dirigeants américains. L'équilibre des forces partisanes au Congrès s'en trouverait bouleversé.
Pour terminer, la question du Québec se poserait. Le Québec a plutôt mauvaise réputation aux "States" vu ses velléités souverainistes et son rôle de trouble-fête au sein de la fédération canadienne. On peut douter que la classe politique américaine et que la plupart de ses électeurs soient intéressés à se charger de ce "fardeau".
Toutes ces considérations constituent de la politique-fiction j'en conviens, mais elle peuvent nous donner une idée des possibilités d'action et de leurs limites chez les deux voisins nord-américains et par ricochet sur les nôtres, ici au Québec.
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Extrême droite sur Internet : la montée des influenceur·ses nationalistes

Si Internet favorise l'extrême droite, c'est aussi parce que ses stratégies de communication s'y sont adaptées, notamment en utilisant les techniques issues du marketing. La communication policée du RN lui donne un vernis de respectabilité, tout en favorisant tout un écosystème d'influenceurs et de groupes plus radicaux où les discours racistes se libèrent. Analyse.
Tiré du blogue de l'auteur.
Cet article est le deuxième volet d'une recherche sur Internet et l'extrême droite. Vous pouvez lire le premier article ici.
Avant même l'apparition des médias alternatifs et des réseaux sociaux, Internet a permis à des groupes traditionnellement peu ou pas mis en avant par les médias « mainstream » de s'exprimer publiquement. Pour Dominique Cardon, nous vivions à la fin du XXème siècle dans une « sphère publique restreinte » (1).
Dans cet espace, les médias (journaux, télévision, radio) avaient une fonction de « gatekeepers » (« gardiens de porte ») ; en sélectionnant les prises de parole publiques, le système médiatique décidait quels discours avaient une visibilité et une légitimité, et les hiérarchisait. Le fait d'être repris dans les médias légitime un discours ou une personnalité auprès du grand public. Il permet en tout cas de se faire connaître, d'avoir une existence dans le débat. L'internet permet de contourner ces gatekeepers, et ainsi de donner la parole à des groupes qui n'ont traditionnellement pas voie de cité dans les médias, d'ouvrir la porte aux « quidams » (2). En France, ce sont les groupes d'extrême droite qui ont été les pionniers de ce type d'expression directe, contournant le système médiatique. Le Front National a été le premier parti politique français à créer un site internet en 1996, et un compte Facebook en 2006 (3).
Cette présence n'est pas surprenante, elle est dans la continuité des stratégies historiques du parti et de ce courant. Avant de créer le Front National en 1972, Jean-Marie Le Pen s'associe à Léon Gaultier, ancien officier SS, pour créer en 1963 la SERP (Société d'Études et de Relations Publiques) avec laquelle il diffusera sous le manteau des enregistrements défendant l'OAS – Organisation Armée Secrète, qui avait tenté un coup d'état pour conserver l'Algérie française (4). Cette société d'édition se spécialisera dans les chants militaires, incluant des chants de la Wehrmacht et des Waffen SS. Elle a été condamnée en 1968 pour « apologie de crimes de guerre » après la diffusion de chants du IIIe Reich (5). L'image sulfureuse de ces hommes leur interdisant l'accès aux médias, c'est donc « par les marges » qu'ils arrivent à la médiatisation (6). L'adresse de la SERP deviendra d'ailleurs l'adresse officielle du premier siège du FN.
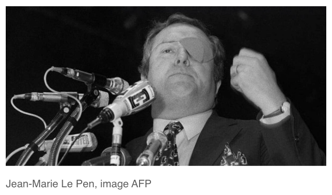
Le FN est devenu RN, et la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen va désormais jusqu'à refuser la filiation à l'extrême droite (7), et tenter d'effacer les traces de l'antisémitisme qui l'a créé et continue de le nourrir (8). Maintenant que le RN a « blanchi » son image et se veut un parti « républicain », cette stratégie de « communication par les marges » est utilisée par les nouveaux groupuscules d'extrême droite, tels que le Bloc Identitaire en France (dissous en 2021) ou CasaPound en Italie (9).
Ces groupuscules, plus radicaux que les partis institutionnalisés, n'ont pas accès par défaut à l'agenda médiatique, et doivent donc, pour se faire entendre, utiliser des moyens détournés. Internet leur offre la possibilité de diffuser eux-mêmes leurs contenus, et d'accéder ainsi à une visibilité : « Une vidéo qui « fait le buzz » a toutes les chances d'être reprise par les journalistes se sentant autorisés à commenter l'activité des réseaux sociaux » (10). Ces groupes organisent donc des actions spectaculaires (occupation de mosquées, irruption dans un fast-food avec des masques de cochon, organisation d'« apéros saucisson-pinard »...), inspirées des actions des mouvements écologistes type Greenpeace. Ce côté sensationnel, associé à des messages politiques simplifiés, et la diffusion importante de ces actions sur l'internet, leur permet de rentrer dans l'agenda médiatique. Ces actions de « second degré » ne visent pas les personnes présentes physiquement à ces manifestations, mais les les sympathisant·es sur les réseaux sociaux, et surtout les journalistes.
D'ailleurs, les groupes ne s'y trompent pas dans la formation de leurs militant·es. Celle-ci « ne consiste pas dans l'apprentissage approfondi des théories politiques. […] Devenir un militant de ces organisations consiste à apprendre à communiquer dans des formes [adaptées aux] supports médiatiques qui hybrident davantage l'information et le divertissement, tels que la presse gratuite, les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu ou la presse locale » (11).
L'internet devient donc un échelon intermédiaire, entre une communication limitée de groupe radical et les médias mainstream. Exister sur Internet permet de toucher beaucoup plus de personnes qu'avec des enregistrements sonores de plaidoirie, mais aussi, grâce aux reprises des médias, de toucher petit à petit le grand public, et se faire une place dans le débat politique national. C'est ainsi que le discours de l'extrême droite se répand et se banalise. Ces groupuscules, bien que non affiliés au RN, communiquent sur YouTube, sur des blogs, sur les réseaux sociaux, et diffusent les thématiques de l'extrême droite.
L'intérêt pour le RN est que ces vidéastes parviennent à « politiser » un public jeune qui serait naturellement tenté par l'abstention. […] « Plus le RN cherche à se respectabiliser, plus il est obligé d'adopter un langage très institutionnel, très policé, et plus il risque de se couper de son électorat contestataire, explique Julien Boyadjian (12). Mais c'est d'autant plus intéressant pour eux de déléguer à d'autres ce travail de politisation moins lisse, moins formaté. » (13)
Les groupuscules radicaux utilisent donc Internet pour faire émerger leurs problématiques dans l'espace public. Qu'on en parle en bien ou en mal ne change rien, on en parle, ces thèmes font l'actualité. C'est ce qu'on appelle l'astroturfing (14) : quand un groupe restreint impose ses problématiques en faisant croire qu'elles concernent un groupe plus grand. Une fois ce discours infusé dans la société, les forces en présence (partis politiques, associations de la société civile...) sont obligées de s'adapter à cet agenda médiatique, et de réagir aux thématiques imposées par l'extrême droite (immigration, sécurité, islam...), laissant de côté les leurs (écologie, inégalités sociales, éducation...).
En France, cette stratégie a payé, et le rôle des militant·es des groupuscules identitaires est de plus en plus prégnant au RN, influençant la ligne du parti et ses votes à l'Assemblée nationale. De nombreux membres du Bloc Identitaire ou de Génération Identitaire ont rejoint les rangs du FN, comme Philippe Vardin et Damien Rieu (désormais avec Zemmour) ou encore Grégoire de Fournas (député RN, ancien membre du BI, qui avait été suspendu quinze jours pour avoir crié « Qu'il retourne en Afrique ! » au député La France insoumise (LFI) Carlos Martens Bilongo (15)).
« « Il y a eu une imprégnation générale des idées et du style identitaires », explique un ancien cadre du BI. En 2021, Jordan Bardella reprenait à son compte la théorie complotiste du « Grand Remplacement », très relayée dans les milieux identitaires » (16). Le « Grand Remplacement » est une théorie développée par le polémiste d'extrême droite Renaud Camus. Elle « fait référence à un supposé processus de substitution des Européens ou des Français "de souche" par des immigrés extra-européens, venus principalement d'Afrique » (17).
Les influenceur·ses d'extrême droite : rendre l'idéologie « cool »
Les règles de diffusion d'un contenu sur l'internet ne sont pas les mêmes que dans les médias traditionnels, et l'extrême droite s'est adaptée à ces nouveaux canaux. Leurs idéologues ne diffusent plus sous le manteau des cassettes de chants de guerre de la Wehrmacht, mais reprennent les codes de la publicité et de la « culture LOL » (18) d'internet pour toucher un public plus large. Le cas de YouTube et des influenceur·euses d'extrême droite qui y officient est particulièrement représentatif de cette dynamique.
Les médias mainstream étant de plus en plus critiqués pour leur manque d'objectivité, le public se tourne vers des sources d'information alternatives. Une tendance qui s'est renforcée depuis la pandémie de COVID-19 et les confinements généralisés. L'extrême droite s'y est adapté en présentant ses médias comme « alternatifs » ou « citoyens », en opposition à un système médiatique présenté comme manipulatoire. Nous avons analysé dans un autre article comment la publicité a diffusé ses techniques manipulatoires dans tout l'espace public (médias, prises de parole politiques...), les érigeant en norme de discours, et créant ainsi un doute permanent dans la parole publique qui se paie aujourd'hui par cette défiance généralisée envers les médias et les politiques (19).
Une étude de 2018 du Pew Research Center a trouvé que 73% des adultes états-uniens visitaient YouTube, allant jusqu'à 94% pour les 18-24 ans. En 2017, YouTube était uniquement derrière Facebook comme réseau social le plus populaire pour s'informer. En parallèle, la confiance dans les médias mainstream est en déclin constant, avec seulement 32% des Américains affirmant avoir confiance dans les médias, selon une étude de 2016 du Gallup Poll. (20)
Une étude récente sur les jeunes consommateurs d'informations a découvert qu'ils avaient plus confiance dans les contenus « générés par les utilisateurs » que par les médias traditionnels. (21)
C'est une aubaine pour l'extrême droite, qui a développé le concept de « réinformation » (22), capitalisant sur le doute légitime des citoyen·nes pour mieux imposer sa vision du monde. Le fait de se faire passer pour des médias « alternatifs », créés par et pour des « citoyens désintéressés », permet ainsi de contourner la méfiance par défaut envers les contenus politiques identifiés comme venant d'un parti ou d'un « camp politique ». Une fois créée cette forme de confiance, les internautes sont plus perméables aux idées diffusées. Ainsi le site Novopress créé en 2005, se présente comme une « arme de réinformation », qui entend défendre une information « alternative et sans tabous » afin de lutter contre « le monde de la pensée et de l'information uniques » (23).
Car même si nous sommes conscient·es que les informations que nous recevons ne sont pas toujours vraies, il reste très difficile de distinguer le vrai du faux : aux États-Unis, 84 % des adultes interrogés se sentaient confiants (39 % très confiants et 45 % plutôt confiants) dans leur capacité à reconnaître de fausses informations (24). En France, 73% des Français·es ne jugent pas fiables les informations reçues via les réseaux sociaux numériques. Mais lorsqu'une étude de 2017 (25) teste cette capacité à distinguer le vrai du faux, la rumeur selon laquelle « des maires de villes de province font venir des personnes étrangères de Seine-Saint-Denis dans leur ville en échange de subventions » est jugée comme une affirmation fausse par seulement 31 % des répondants (certainement fausse à 9 % et probablement fausse à 22 %) » (26).
YouTube a pris une place de premier choix dans la création de médias alternatifs, et l'extrême droite s'en est emparée, notamment avec des réseaux d'influenceurs, présentant une idéologie ultra-conservatrice tout en reprenant les codes « cool » de la culture Internet. Un exemple est ce que Rebecca Davis appelle le RIA (Réseau d'Influence Alternative). Dans son rapport « Broadcasting alt-right on YouTube » (27), elle décrit un réseau de YouTubeurs états-uniens d'extrême droite (approximativement 65 sur 80 chaînes) qui récupèrent cette méfiance pour diffuser leur idéologie.
On peut parler de réseau dans le sens où ceux-ci partagent les mêmes sujets de prédilection – la menace « woke » et féministe, la peur des étranger·es, le « racisme scientifique », la détestation des « élites » et des SJW (« Social Justice Warriors » ou « Guerriers de la justice sociale »)... – se citent les uns les autres et apparaissent dans les vidéos des autres chaînes du réseau. La variété des sujets abordés ainsi que la production importante de contenus exprime le projet de ne pas être uniquement des sources d'information alternatives, mais bien de remplacer les médias mainstream (28).
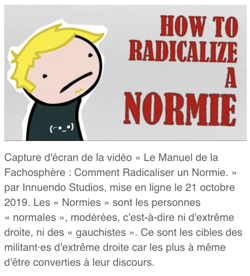
Ces chaînes adoptent une charte graphique et un ton de parole « légers », drôles, reprenant les codes des influenceur·ses commerciaux·les (29). Cela leur permet de toucher un public très divers, de masquer la radicalité des opinions qu'ils défendent, et d'invisibiliser la souffrance des personnes désignées comme ennemies ou inférieures (personnes LGBT, non-blanches, femmes, « wokistes »...).
Parce qu'elles brassent des sujets divers (féminisme, racisme, corruption...), ces vidéos sont autant de portes d'entrée dans l'univers de la « droite alternative » (30). Une fois happé par ce ton léger, il devient très facile de virer vers des vidéos de plus en plus radicales, par le jeu des collaborations, c'est-à-dire d'invitations sur les vidéos les uns des autres pour des débats ou des partages d'expériences. Cela crée des passerelles depuis des chaînes mainstream et plus modérées, vers d'autres chaînes beaucoup plus radicales qui prônent ouvertement la suprématie blanche et l'action violente. Ces YouTubeurs se citent entre eux, créant ainsi une illusion de sourçage des informations. Une information peut être recoupée par plusieurs chaînes du réseau et donc donner l'impression d'être vérifiée, alors que toutes citent la même source. Tout cela crée les conditions d'une radicalisation de ces internautes.
Elles arrivent aussi à être les vidéos les plus mises en avant par YouTube sur n'importe quel sujet, en utilisant les failles dans les algorithmes. Les techniques de SEO (Search Engine Optimization) sont utilisées depuis de nombreuses années par les grandes entreprises et les publicitaires pour mettre leurs publications en avant dans les moteurs de recherche. L'idée est de connaître les règles qu'utilisent les algorithmes pour classer les contenus, et formater sa page ou son post pour qu'il corresponde à ces règles (format de vidéo, mots-clés dans le titre, images de présentation, etc.) et se retrouve mis en avant. Les influenceurs d'extrême droite reprennent ces techniques à leur profit, ce qui fait que jusqu'à la purge de 2020 des contenus d'extrême droite par YouTube, quand on tapait le mot-clé GamerGate (31), l'algorithme mettait systématiquement en avant des vidéos de harceleurs comme Mia Yiannopoulos ou Carl Benjamin, plutôt que des victimes de ces harceleurs.
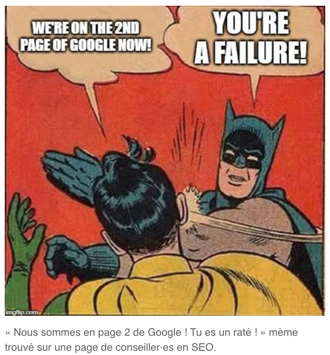
Les algorithmes des GAFAM mettent en avant les contenus qui créent le plus d'engagement chez les internautes, c'est-à-dire surtout des commentaires (positifs ou négatifs). L'onglet « recommandé pour vous » de YouTube renvoie donc le plus souvent à des vidéos clivantes, guidant les internautes dans un voyage vers de plus en plus de radicalité :
En 2016, une publication interne à Facebook montrait que « 64% des entrées dans des groupes extrémistes sont dus à nos outils de recommandation », spécifiquement via les fonctionnalités Suggestions pour vous et Découvrir (32).
En 2017, l'algorithme [de YouTube] recommandait environ 10 fois plus de contenus affirmant que la Terre est plate que de vidéos fondées sur la vérité scientifique. Pourquoi ? Parce que ce type de contenus fait réagir les utilisateurs, les fidélise et permet de diffuser davantage de publicité, donc de générer plus d'argent. (33)
Le résultat de cette stratégie est que le 4 janvier 2018, la vidéo la plus vue en direct sur YouTube est un débat animé par les youtubeurs d'extrême droite Andy Warski et Jean-François Gariépy, autour du « racisme scientifique » – qu'ils appellent « race realism ». Les invités sont Richard Spencer, suprémaciste blanc qui a popularisé le terme d'alt-right, et Carl Benjamin, libertarien présenté comme plus modéré que son adversaire. Les débats tournent autour de la notion de race, des qualités inhérentes à la « whiteness » (« blanchité »), et les commentaires sont largement favorables à Richard Spencer : « Je n'ai jamais vraiment écouté parler Spencer avant, mais on voit tout de suite qu'il est d'un niveau bien plus élevé », commente Nashmau (34), un utilisateur. Ces vidéos ont néanmoins été supprimées en même temps que plusieurs chaînes d'extrême droite le 29 juin 2020 (35). Mais celle-ci avait engrangé 450,000 vues et été mise en avant par YouTube en tant que #1 trend.
En France aussi, il existe un réseau de youtubeurs d'extrême droite avec les mêmes pratiques. Des chaînes comme celle de Papacito, Valek, Bruno le Salé, Raptor dissident ou Lapin du futur, font des millions de vues (une vidéo sur le racisme anti-Blancs de Valek est en 2023 à 1,7 millions de vues (36)). Tout en reprenant les codes du stand-up et en faisant des placements de produits pour des compléments alimentaires ou des applications bancaires, ils distillent une idéologie raciste à destination des jeunes (37).
Cette idéologie n'est pas neutre. Les appels au meurtre et à la violence sont monnaie courante dans ces vidéos, ce qui mène d'ailleurs régulièrement à des condamnations ou à des suspensions de compte. Cette banalisation de la violence a des effets réels, et pousse certains internautes à aller jusqu'à commettre des actes terroristes. Le YouTubeur Papacito a été condamné pour une vidéo montrant l'exécution d'un électeur de LFI (38).

La culture du LOL, entre blagues sexistes et mèmes racistes
Sur les forums comme dans les vidéos YouTube, c'est beaucoup par l'humour que l'extrême droite fait passer ses idées. En effet, la culture du LOL normalise les blagues sexistes. Celles-ci sont beaucoup mieux acceptées que les blagues racistes et se propagent plus facilement. Mais sur les forums, tout se mélange, c'est d'ailleurs le principe même de l'humour Internet. Sous couvert d'ironie, de troll (39) et de « shitposting » (40), les internautes mélangent blagues sexistes et racistes, créant ainsi, selon l'expression de Mathilde Saliou, une « intersectionnalité des haines » (41).
Le forum « Blabla 18-25 » de jeuxvidéos.com a été très actif dans plusieurs campagnes de cyberharcèlement à caractère sexiste depuis 2013 (42) et est en parallèle devenu un soutien quasi-officiel à Henry de Lesquen, ancien président de Radio Courtoisie, figure de l'extrême droite et de la « remigration ». Celui-ci reprend les codes de la rhétorique catholique contre-révolutionnaire, ce qui semble de prime abord assez loin de l'esprit d'un forum nommé « Blabla du 18-25 ». Mais ses formules surannées (il a traité un journaliste juif de « menteur pharisien ») et ses attaques racistes particulièrement violentes (il utilise le terme « Congoïde » pour désigner les personnes noires) en font une sorte de « troll » IRL (In Real Life).
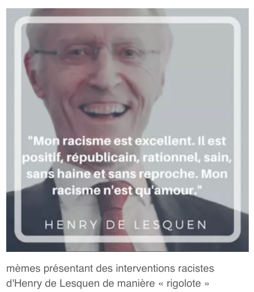
Les internautes se sont emparés de son image décalée, en créant et diffusant de manière massive des mèmes et des gifs à son effigie. « Cynique, décomplexée et collant à l'actualité, cette communication, qui s'adresse aux jeunes internautes en reprenant leurs codes visuels et leurs références culturelles, est taillée pour une viralité qui va bien au-delà des cercles habituels de l'extrême droite » (43).

Cette communication opportune pour le personnage a été depuis copiée par des équipes plus officielles, comme celle d'Eric Zemmour, qui a repris ces codes à son profit lors de sa campagne de 2022. « Cette cool connexion s'avère une arme d'autant plus redoutable qu'il n'est nul besoin de partager ces idées pour en rire, et que même ceux qui s'en offusquent participent […] à leur viralité » (44). Ces figures de l'extrême droite sont transformées en « icônes pop », les rendant quasiment sympathiques et surtout omniprésentes sur la Toile, particulièrement dans les discussions sur les jeux vidéo. C'est une stratégie habile dans la mesure où en France, en 2018, 3 internautes sur 4 étaient des gamers, soit 32,3 millions de personnes (45).

Le recrutement des militant·es par l'internet
Selon le journaliste Paul Conge, auteur d'une étude sur l'extrême droite, les jeux vidéos sont « un vecteur identitaire très fort pour des jeunes gens qui ont entre 14 et 18 ans, qui n'ont pas forcément une culture politique au départ – mais qui en acquièrent une grâce à ça » (46). Le journaliste s'est fait passer pour un adolescent dans le but de rencontrer des recruteur·ses de groupes d'extrême droite. Ceux-ci vont sur des jeux multijoueurs en réseau comme Fortnite ou des forums, et « trollent » des joueur·ses ou des groupes. Le but est de faire déraper la discussion, et selon les réactions, d'inviter les joueur·ses intéressé·es dans des forums plus confidentiels, où se discutent ouvertement les thèses racistes et les moyens de résister au « Grand Remplacement ». Le même mécanisme est d'ailleurs utilisé par des représentant·es du RN dans les conventions de tuning : iels s'insèrent, distillent leurs discours, et réussissent à amener leurs idées dans des domaines qui n'ont au départ rien à voir avec la politique.

Le phénomène dit du « troll » est particulièrement adapté aux stratégies de l'extrême droite. Un troll est un internaute qui « cherche délibérément à engendrer des polémiques, par exemple en abordant un sujet controversé ou en s'en prenant aux autres participants » (47). Il y a de nombreux types de trolls, qui vont du « grammar nazi » (« nazi de la grammaire ») débusquant et moquant la moindre faute d'orthographe jusqu'aux trolls politiques organisés par des personnalités, des entreprises ou des gouvernements pour discréditer des adversaires ou perturber les débats à l'intérieur d'une nation ennemie. Le troll est un produit typique de l'économie de l'attention (voir l'autre partie de cet article).
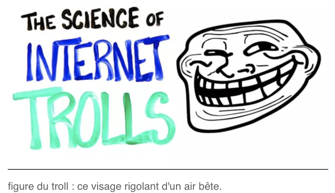
L'irruption de trolls d'extrême droite dans des parties de jeux vidéo ou des conversations en ligne est une arme redoutable. Même si le troll est évacué par les participant·es, la multiplication des attaques crée un climat de tension permanente, et impose les sujets de l'extrême droite dans les conversations. Plus leurs thématiques sont discutées, plus elles seront présentes dans les tendances, et donc mises en avant par les algorithmes. Se présenter sous la forme de l'humour, même violent, permet au discours en question de se rappeler en permanence aux membres du groupe par des blagues, des mèmes, des images, des références.
L'ironie est utilisée comme une arme. Toute critique est impossible, car elle se fait opposer la sentence : « tu dois être vraiment stupide pour penser que je pense ce que je dis. Tu vois bien que c'est ironique. » « Mais en même temps, leurs contenus [sont] odieux, et [abaissent] chaque fois le curseur de l'acceptable » (48). Un ou plusieurs internautes peuvent alors être intéressés par les propos du troll et se mettre en contact avec lui, en dehors du groupe initial.
C'est un phénomène très sérieux dont même l'OTAN s'inquiète, dans un rapport de 2021, comme d'une arme pouvant être utilisée par des États pour interférer dans la politique intérieure d'autres États. La Russie est reconnue avoir utilisée des « usines à trolls » diffusant de fausses informations et encourageant les rumeurs complotistes. Ceci afin de favoriser l'extrême droite européenne, plus favorable a priori à son régime et propice à déstabiliser les États de l'intérieur (49). De nombreux internautes pro-Trump ont aussi utilisé les trolls pour promouvoir leurs candidats, allant jusqu'à s'auto-nommer « Trump's Troll Army » (« l'armée de trolls de Trump »). Joe Biden a lui aussi utilisé des « usines à troll » pour promouvoir sa campagne (50). Brenton Tarrant, terroriste responsable de la tuerie de Christchurch, écrivait avant son attaque que « les mèmes ont fait plus pour le mouvement ethnonationaliste que n'importe quel manifeste » (51).
Conclusion
Les discours de l'extrême droite se sont adaptés aux codes de l'internet pour asseoir sa domination. Gardant son côté sulfureux historique, tout en reprenant l'humour léger de la publicité et le cynisme des forums Internet, elle a réussi à faire de l'internet un porte-voix pour ses idées excluantes. La médiatisation par les marges des groupuscules les plus violents a permis aux groupes plus institutionnels et policés comme le RN de se hisser aux postes d'élu·es, tout en se démarquant de cette image de milices qui lui collait à la peau. Comme une division du travail idéologique, on voit les représentant·es de partis d'extrême droite afficher une image de respectabilité et d'ouverture, en encourageant en douce les groupes les plus radicaux à saturer la toile de discours racistes et d'appels au meurtre.
Ce jeu entre partis « officiels » et groupuscules radicaux permet à l'extrême droite de déplacer la fenêtre d'Overton. Cette métaphore a été imaginée par le sociologue du même nom pour désigner les opinions considérées comme acceptables par l'opinion publique, et donc susceptibles d'être introduites dans la législation (52). Toute opinion exprimée dans l'espace public qui se trouverait en dehors de cette fenêtre métaphorique serait par défaut discréditée comme insensée ou trop extrême. Par exemple, la prohibition de l'alcool aux États-Unis a duré pendant 13 ans (de 1920 à 1933). Elle était donc acceptable politiquement à ce moment précis de l'Histoire, à cet endroit du monde. En 2024, un·e politicien·ne qui proposerait l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool serait sûr·e de ruiner son image et sa carrière. Elle n'est plus dans la fenêtre d'Overton.
De même, la théorie du « grand remplacement » est longtemps restée confinée à d'obscurs groupuscules ou des terroristes (Brenton Tarrant a intitulé son manifeste « Le grand remplacement » avant de tuer 50 personnes à la sortie d'une église néo-zélandaise). Elle est désormais reprise dans de nombreux médias (notamment la chaîne CNews, possédée par Vincent Bolloré) et par de nombreux responsables politiques d'extrême droite ; d'abord cantonnée à Éric Zemmour et ses soutiens, elle est passée au Rassemblement National et même maintenant au groupe politique « centre-droit » Renaissance.
L'agenda médiatique actuel est déplacé vers les problématiques de l'extrême droite, qui saturent petit à petit le débat politique. Les discours racistes des marges se retrouvent au cœur des gouvernements et de leurs politiques, que les élu·es soient ou non affilié·es à des partis d'extrême droite. En France, la loi sur l'immigration, proposée par Renaissance, pourtant désigné par le ministère de l'Intérieur comme « centre-droite » a été votée par 100% des parlementaires du RN tandis que 22% des parlementaires de Renaissance s'abstenaient ou votaient contre. Une première dans ce mandat (53). Marine Le Pen a d'ailleurs qualifié ce vote de « victoire idéologique » (54).
Notes
1- Jurgen HABERMAS, L'espace public. Archélogie de la publciité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Payot, 1993
2- Dominique CARDON, La démocratie Internet, éditions du Seuil et La République des idées, 2010
3- Achraf BEN BRAHIM, Pourquoi l'extrême-droite domine la toile. Le grand remplacement numérique, Éditions de l'aube et fondation Jean Jaurès, 2023, p. 13
4- Jonathan THOMAS, La propagande par le disque. Jean-Marie Le Pen, éditeur phonographique, Paris, EHESS, in Achraf BEN BRAHIM, op. cit.
5- Valérie IGOUNET, « Plongée dans les sonorités nationalistes », France TV Infos, 20 juin 2016, à consulter ici : https://blog.francetvinfo.fr/derriere-le-front/2016/06/20/plongee-dans-les-sonorites-nationalistes.html
6- Achraf BEN BRAHIM, op. cit., p. 12
7- Youmni KEZZOUF, « Pour le Conseil d'État, le RN est bien d'extrême-droite », Mediapart, 21 septembre 2023 https://www.mediapart.fr/journal/politique/210923/pour-le-conseil-d-etat-le-rn-est-bien-d-extreme-droite
8- Youmni KEZZOUF et Marine TURCHI, « Israël-Hamas, le RN tente de faire oublier son passé antisémite », Mediapart, 11 octobre 2023
9- Pietro Castelli GATTINARA, Caterina FROIO, « Quand les identitaires font la une. Stratégies de mobilisation et visibilité médiatique du bloc identitaire », Revue française de science politique, 2018/1 (Vol. 68), p. 103 https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2018-1-page-103.htm
10- Caterina FROIO, Samuel BOURON, « Entrer en politique par la bande médiatique ? Construction et circulation des cadrages médiatiques du Bloc identitaire et de Casapound Italia », Questions de communication, 2018/1 (n° 33), p. 221 https://shs.cairn.info/revue-questions-de-communication-2018-1-page-209?lang=fr
11- Caterina FROIO, Samuel BOURON, op. cit., p. 218
12- maître de conférences à Sciences-Po Lille et spécialiste de la politisation en ligne.
13- Lucie DELAPORTE, « Les Youtubeurs de la haine : un fascisme débonnaire », Mediapart, 14 mars 2021 https://www.mediapart.fr/journal/france/140321/les-youtubeurs-de-la-haine-un-neofascisme-debonnaire
14- David CHAVALARIAS, op. cit.
15- Valérie HACOT, « Les identitaires, nouveau vivier du FN », Le Parisien, 24 juillet 2018, https://www.leparisien.fr/politique/les-identitaires-nouveau-vivier-du-fn-11-05-2018-7711248.php?ts=1701272182641
16- Ellen SALVI, « Le passé identitaire du député RN Grégoire de Fournas est aussi un passif judiciaire », Mediapart, 18 décembre 2023 https://www.mediapart.fr/journal/france/181223/le-passe-identitaire-du-depute-rn-gregoire-de-fournas-est-aussi-un-passif-judiciaire?at_medium=custom7&at_campaign=1046
17- Alice GALOPIN, Thibault LE MENEC, « L'article à lire pour comprendre pourquoi le "grand remplacement" est une idée raciste et complotiste », France Info, 13 mars 2022 https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/l-article-a-lire-pour-comprendre-pourquoi-le-grand-remplacement-est-une-idee-raciste-et-complotiste_4965228.html
18- Laughing Out Loud, ou « Mort de Rire » en français. Voir Monique DAGNAUD, « De la BOF génération à la LOL génération », Slate, 13 septembre 2010, à consulter ici ; https://www.slate.fr/story/27079/bof-generation-lol-generation
20- Rebecca DAVIS, Alternative Influence, Broadcasting the reactionnary right on YouTube, Data & Society, 2018, p. 5, traduction personnelle https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/09/DS_Alternative_Influence.pdf
21- Ibid., p. 16, traduction personnelle
22- Jen SCHRADIE, L'illusion de la démocratie numérique. Internet est-il de droite ?, éditions quanto, 2022. Voir aussi son interview sur France Inter : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-code-a-change/pourquoi-internet-favorise-la-droite-2707050
23- Elsa GIMENEZ, Olivier VOIROL,"Les agitateurs de la toile. L'internet des droites extrêmes. Présentation du numéro", Réseaux, 2017/2, n. 202-203, p. 9-37 https://shs.cairn.info/revue-reseaux-2017-2-page-9?lang=fr
24- PEW RESEARCH CENTER (2016), Many Americans Believe Fake News Is Sowing Confusion, http://www.journalism.org/2016/12/15/many-americans-believe-fake-news-is-sowing-confusion/ , cité par Franck REBILLARD, « La rumeur du PizzaGate durant la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Les appuis documentaires du numérique et de l'Internet à l'agitation politique », Réseaux, 2017/2 (n° 202-203), Éditions La Découverte, p. 278-279 https://shs.cairn.info/revue-reseaux-2017-2-page-273?lang=fr
25- KANTAR, Baromètre de la confiance des Français dans les médias, cité par Franck REBILLARD, op. cit.
26- Franck REBILLARD, op. cit.
27- Rebecca DAVIS, op. cit., p. 16, traduction personnelle
28- « By creating an alternative media system on YouTube, influencers in the AIN express a wish not only to provide an additional, alternative option for young audiences, but also to replace their consumption of mainstream news entirely. » Rebecca DAVIS, op. cit., p. 15
29- « personnes qui modèlent l'opinion publique et promeuvent des biens et services à travers la « calibration consciente » de leur personnalité en ligne » définition de Rebecca DAVIS, op. cit., p. 6, traduction personnelle
30- Ou alt-right, terme dont la paternité est revendiquée par Richard Spencer, militant d'extrême droite états-unien. Il désigne une nouvelle forme d'extrême droite, plus moderne, tournée contre le féminisme, le « gauchisme », et pour un suprémacisme blanc.
31- Le GamerGate est une campagne de cyberharcèlement envers Zoë Quinn, une programmeuse de jeux vidéos, lancée par son ex-petit ami Eron Gjoni, jaloux de la sortie du jeu Depression Quest de Zoë. Elle prend de l'ampleur sur les forums tels que Reddit, 4Chan, 8Chan et Twitter, ou le « 18-25 » de jeuxvideo.com en France, utilisant les algorithmes pour inonder le web de leur rancœur et leurs menaces de mort. cf. Mathilde SALIOU, Technoféminisme, Comment le numérique aggrave les inégalités, Éditions Grasset & Fasquelle, 2023, pp. 35-50
32- Mathilde SALIOU, op. cit., p. 59
33- Mathilde SALIOU, op. cit., p. 57
34- « I've never really listened to Spencer speak before, but it is immediately apparent that he's on a whole different level. » traduction personnelle
35- « YouTube supprime des chaînes racistes, dont celle du polémiste Dieudonné », RTS, 30 juin 2020 https://www.rts.ch/info/monde/11438734-youtube-supprime-des-chaines-racistes-dont-celle-du-polemiste-dieudonne.html
36- Valek, « ANTIRACISME », YouTube, 24 septembre 2019 consultable ici : https://www.youtube.com/watch?v=tHt_L9mz85o&t=485s
37- Lucie DELAPORTE, op. cit.
38- « Une enquête ouverte contre Papacito, le youtubeur d'extrême droite, pour provocation au meurtre », Le Monde, 9 juin 2021 https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/09/une-enquete-ouverte-contre-le-youtubeur-d-extreme-droite-papacito-pour-provocation-au-meurtre_6083462_3224.html
39- « perturber quelque chose parce que c'est amusant » : Lucie RONFAUT, « Des ados ont trollé Trump, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle », Libération, 27 juin 2020. https://www.liberation.fr/planete/2020/06/27/des-ados-ont-trolle-trump-et-ce-n-est-pas-forcement-une-bonne-nouvelle_1792456/ La pratique du trolling prend souvent la forme de remarques hors de propos au milieu d'une conversation, dans le but de la faire dégénérer.
40- Le shitposting (« poster de la merde ») est une variante du troll (ou trolling) qui consiste à littéralement poster de la merde, c'est-à-dire avancer des positions absurdes et contraires au bon sens, dans le but de faire déraper une conversation.
41- Mathilde SALIOU, op. cit.
42- Dont on peut retrouver une liste non-exhaustive de 2013 à 2017 dans cet article : Jules DARMANIN, « La misogynie du forum 18-25 de jeuxvidéo.com est connue depuis des années », BuzzFeed, 3 novembre 2017 https://www.buzzfeed.com/fr/julesdarmanin/jeuxvideocom-des-annees-de-harcelement-misogyne-et-de
43- Achraf BEN BRAHIM, op. cit., p. 53
44- Ibid., p. 57
45- Selon une étude de Médiamétrie. Cité par Mathilde SALIOU, op. cit., p. 39
46- Christophe CECIL-GARNIER, Paul CONGE, « Soirées tuning, cours de drague et jeux vidéo : les nouvelles méthodes de recrutements de l'extrême droite », StreetPress, 4 septembre 2020 https://www.streetpress.com/sujet/1599222757-soirees-tuning-cours-drague-jeux-video-nouvelles-methodes-recrutement-extreme-droite-fn-rn
47- Rapport de l'OTAN, « DEEP ADL - Infographie : Les usines à trolls (Médias - (Dés)information - Sécurité », 3 janvier 2021 https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_175693.htm
48- WU MING 1, Q comme Qomplot. Comment les fantasmes de complot défendent le système, Lux Éditeur, 2022, p. 119
49- Sylvain TRONCHET, « Les "influenceurs du Kremlin", ces Français qui ont choisi de relayer la propagande russe depuis Moscou », France Info, 18 décembre 2023 https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/reportage-les-influenceurs-du-kremlin-ces-francais-qui-ont-choisi-de-relayer-la-propagande-russe-depuis-moscou_6251514.html
50- Siddhartya ROY, « Joe Biden, Kamala Harris Got a Big Social Media Boost from Indian Troll Farms », Newsweek, 2 novembre 2020 https://www.newsweek.com/joe-biden-kamala-harris-got-big-social-media-boost-indian-troll-farms-1544047
51- « Memes have done more for the ethnonationalist movement than any manifesto », in David R. KIRKPATRICK, « Massacre suspect traveled the world but lived on the internet », New York Telegraph, 15 mars 2019. https://www.nytimes.com/2019/03/15/world/asia/new-zealand-shooting-brenton-tarrant.html
52- « Policies that are widely accepted throughout society as legitimate policy options », MacKinac Center for Public Policy, dont Joseph P. Overton a été vice-président https://www.mackinac.org/OvertonWindow
53- Pauline GRAULLE et Ilyes RAMDANI, « Loi immigration : à l'Assemblée nationale, la victoire au goût de débâcle du camp présidentiel », Mediapart, 20 décembre 2023 https://www.mediapart.fr/journal/politique/201223/loi-immigration-l-assemblee-nationale-la-victoire-au-gout-de-debacle-du-camp-presidentiel?at_medium=custom7&at_campaign=1046
54- « Projet de loi immigration : le RN votera pour le texte issu de la CMP, annonce Marine Le Pen, qui salue une "victoire idéologique" », Franceinfo avec AFP, 19 décembre 2023 https://www.francetvinfo.fr/societe/immigration/loi-immigration-le-rn-votera-pour-annonce-marine-le-pen-qui-revendique-une-victoire-ideologique_6254361.html
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Frente Amplio remporte les élections en Uruguay

Yamandú Orsi, candidat du parti de centre-gauche Frente Amplio (Front large), a battu son rival du Parti national lors du second tour de l'élection présidentielle en Uruguay, qui s'est tenu fin novembre. Le premier tour avait eu lieu le 24 octobre, simultanément avec les élections législatives et deux référendums.
6 décembre 2024 | tiré d'Inprecor.org | Photo : Comício da Frente Ampla - © Comício da Frente Ampla
https://inprecor.fr/node/4473
Le Frente Amplio large (FA) gouvernera à nouveau le pays suite à sa victoire au second tour des élections qui se sont tenues ce dimanche 24 novembre. Le candidat de la coalition Frente Amplio, le professeur d'histoire Yamandú Orsi, a battu le candidat du Parti national (conservateur) Álvaro Delgado de près de 4 %, ce qui permettra à la formation de centre-gauche d'accéder à nouveau à la présidence du pays.
Orsi était le candidat soutenu par l'ancien président José Mujica et avait remporté les primaires du FA face à Carolina Cosse, qui était, elle, soutenue par les groupes de gauche du Frente Amplio. Battue aux primaires, Carolina Cosse a finalement participé en tant que candidate à la vice-présidence. L'extrême droite représentée par le parti Cabildo Abierto du général de réserve Manini Ríos, qui avait obtenu de bons résultats lors des dernières élections, a cette fois-ci subi une défaite importante et est passée de trois sénateurs et neuf députés en 2019 à seulement deux députés aujourd'hui.
Simultanément au premier tour des élections présidentielles était organisé un plébiscite qui visait à inscrire le thème de la Sécurité sociale dans la constitution comme un droit humain fondamental. Bien qu'il ait près de 40 % des suffrages, le changement n'a pas atteint le niveau nécessaire pour être approuvé. Dans une interview exclusive à la Revista Movimento1 accordée entre les deux tours des élections, la sénatrice suppléante Cecilia Vercellino (PVP/FA) expliquait :
Le plébiscite sur la Sécurité sociale proposait d'incorporer dans la Constitution de la République trois mesures de protection, qui s'opposaient à la loi votée par le gouvernement actuel, et qui allaient beaucoup plus loin : lier les pensions les plus basses au salaire minimum national. En d'autres termes, faire qu'aucun retraité ne gagne moins que le salaire minimum national (ce gouvernement a gelé les pensions, elles n'ont pas augmenté durant tout son mandat) ; rétablir à 60 ans l'âge minimum à partir duquel on peut, si on le souhaite, prendre sa retraite (ce gouvernement a porté l'âge minimum à 65 ans) ; et surtout, principale proposition progressiste, a généré toute la controverse : l'élimination du profit dans la gestion de la Sécurité sociale, ce qui signifie la fin des AFAP (Gestionnaires privés des fonds de retraite par capitalisation en Uruguay). Il ne reste que 12 pays dans le monde avec ce modèle d'AFAPs et l'Uruguay est l'un d'entre eux.
Le FA était divisé sur cette question. Dès le départ, ses dirigeants ont clairement indiqué qu'ils ne soutiendraient aucune proposition de plébiscite, avec ou sans AFAP. Ils ne voulaient ni n'acceptaient de s'engager dans une autre lutte, qu'ils considéraient comme perdue, et qui pouvait, selon eux, détourner l'attention et les forces destinées à la reconquête du gouvernement. Des secteurs comme celui auquel j'appartiens (le PVP, Parti pour la Victoire du Peuple) n'étaient pas et ne sont pas d'accord avec ce point de vue d'une partie de la FA et, avec le Parti socialiste et le Parti communiste (eux aussi partie prenante du FA), nous avons soutenu l'initiative du PIT-CNT (la confédération syndicale uruguayenne) dès le début, bien sûr avec des nuances et des débats, mais nous l'avons fait sans hésitation parce que, si nous devions perdre et si nous avions tort, nous préférerions le faire en soutenant et en appuyant la classe ouvrière organisée.
Le nouveau gouvernement du FA, qui n'aura pas la majorité absolue au parlement à deux sièges près, a déjà annoncé la nécessité de lutter contre la pauvreté en réformant le système de protection sociale pour combattre l'actuelle situation de pauvreté qui affecte environ 20 % des enfants de moins de six ans et de créer un système unique contre le crime organisé.
Publié le 25 novembre 2024 par la revue Movimento, traduit par Luc Mineto
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
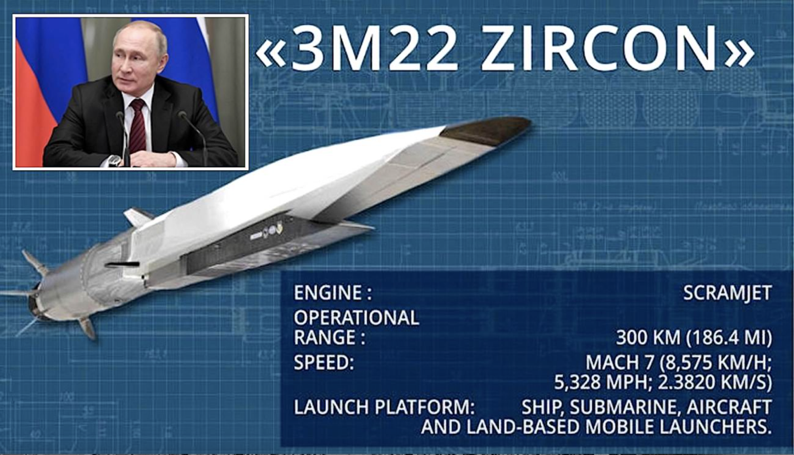
Russie - Ce que cachent les missiles hypersoniques
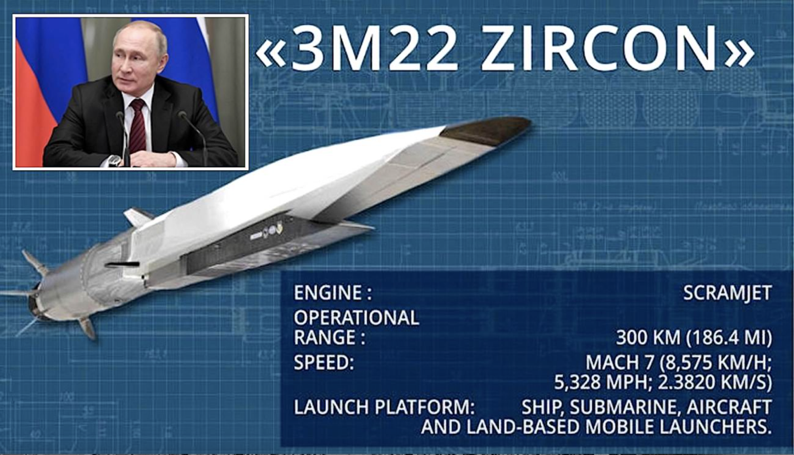
Le jeudi 21 novembre Poutine « dévoilait » une nouvelle arme de son arsenal en ordonnant le lancement du missile hypersonique, « Oreshnik » (noisetier), de portée intermédiaire. Un « test » réussi ou une démonstration d'impasse de son « opération militaire spéciale » ?
Hebdo L'Anticapitaliste - 731 (28/11/2024)
Par Catherine Samary
Les États-Unis avaient été informés, 30 minutes avant, du lancement de ce missile sans ogive nucléaire mais capable d'en transporter. Il n'a guère fait de dégâts, frappant une ancienne usine de Dnipro. Il s'agissait pour Poutine d'une opération théâtrale à plusieurs dimensions envers divers publics : faire peur, en Ukraine et auprès des opinions publiques de pays la soutenant ; en poussant d'un cran la rhétorique nucléaire dans ses menaces à destination de l'Occident, en amendant un oukaze pour signifier que toute aide apportée à l'Ukraine signalerait le pays concerné comme « cobelligérant » et susceptible de représailles nucléaires.
Parallèlement, il s'agissait pour Poutine de se montrer rassurant en direction de la population russe, quant aux capacités de défense du pays. Le dirigeant russe s'est réjoui de la réussite d'un « test » — permettant de lancer la production d'autres missiles de ce type. Sauf que son coût serait selon les experts, de 100 à 200 fois supérieur à celui des missiles quotidiennement envoyés sur l'Ukraine (et massivement interceptés). Par ailleurs, l'Ukraine a déjà été confrontée à l'envoi de missiles hypersoniques russes précédemment qualifiés par Poutine d'invincibles. Ce fut le cas en mai 2023, lorsque Kiev s'est servi d'un système antimissile américain Patriot pour détruire un missile Kh-47M2 Kinjal (lancé sur l'Ukraine depuis un MiG-31 russe) et qui, selon Poutine comme il l'a redit pour son « Oreshnik », ne pouvait être intercepté…
Les difficultés du régime poutinien
Mais surtout, Poutine a accompagné sa présentation de l'opération « Oreshnik » d'une mesure significative à destination de ses soldats : l'annulation de leurs dettes — ce qui s'ajoute à plusieurs mesures budgétaires déjà prises pour trouver des volontaires — et aider leur famille lorsqu'ils meurent au front, ce qui est la règle.
Début novembre, selon des services de sécurité étatsuniens, la Russie aurait formé des soldats nord-coréens qui pourraient aller sur le front. Cela marquerait à la fois un tournant de la guerre et un aveu. Jusqu'alors il n'y a eu aucun recours à des troupes étrangères pour se battre aux côtés de Kiev ou de Moscou — mais ce recours soulignerait encore la difficulté de recrutement de soldats — ce qui est également vrai en Ukraine, avec un autre contexte. Poutine s'est tourné vers les populations les plus pauvres du fin fond de la fédération de Russie et a offert des salaires bien supérieurs à ce qu'offre l'industrie, produisant aussi des pénuries de main-d'œuvre de ce côté. L'économie de guerre russe tourne à plein régime et distribue des salaires — mais elle ne permet pas de « vivre » ni de produire ce dont la population a besoin. Et l'inflation risque d'aggraver les tensions.
Globalement, « l'opération militaire » lancée par Poutine en février 2022 était supposée obtenir une chute du gouvernement Zelensky et une soumission de l'Ukraine au « monde russe » en quelques jours. Depuis près de trois ans, les UkrainienNEs résistent toujours (ce qui a surpris Biden et autres forces de l'OTAN) en réclamant les moyens de repousser l'envahisseur (1).
L'Ukraine se bat, en légitime défense
Dans l'attente de négociations qui seraient catalysées par Trump après son investiture, les deux parties cherchent à consolider leur position. Selon la presse étatsunienne, le président Biden a autorisé Kiev à effectuer sous sa supervision des attaques sur le territoire russe avec des missiles d'une portée de 300 km capables d'atteindre la région de Koursk (2) où seraient les forces nord-coréennes. Il s'agirait de dissuader celles-ci d'intervenir et de cibler des sites militaires d'où partent les attaques répétées sur les infrastructures et populations de l'Ukraine depuis des mois — faisant des milliers de morts et centaines de milliers de blesséEs.
Cette guerre a transformé le régime russe dans un sens fascisant – tuant ses opposantEs, les emprisonnant ou les forçant à s'exiler (3), (4). Elle a aussi creusé des haines « anti-russes » même dans les régions russophones de l'Ukraine. Sans que cesse l'aveuglement d'une partie des gauches dans le monde dont le seul ennemi impérial possible était l'Otan — et qui, pour certains, voient en Poutine une alternative progressiste à l'Occident.
L'ère Trump ouvre de grandes incertitudes. Notre rôle est d'aider la résistance populaire en Ukraine (5) — armée et non armée, et indépendante des gouvernants — et les opposantEs russes à la guerre en construisant les alternatives internationalistes (6).
Catherine Samary
1. https://lanticapitaliste…
2. https://lanticapitaliste…
3. https://inprecor.fr/node…
4. https://links.org.au/aut…
5. https://inprecor.fr/node…
6. https://lanticapitaliste…
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Martinique : Halte à la répression ! Libérez Petitot ! Non à la criminalisation de la contestation sociale !

Certes, donner des injonctions de fermeture des mairies aux élu-e-s de la population n'est pas très conventionnel. Certes, leur crier de façon assez lapidaire « NOU KÉ ATAKÉ ZOT », c'est prêter le flanc aux polémiques qui jouent sur les ambiguïtés.
30 novembre 2024 | • Inprecor. 3 décembre 2024 | Photo : Rodrigue Petitot, Le R, arrive au tribunal de Fort-de-France, le 15 novembre 2024. • ©Kelly Babo
https://inprecor.fr/node/4466
Mais, à qui fera-t-on croire que Préfet et Procureure de la République, qui scrutent à la loupe toute déclaration du RPPRAC ignoreraient que les attaques en question concernent le terrain électoral dans lequel cette organisation a déclaré publiquement vouloir se lancer ?
À qui fera-t-on croire que l'appel à la répression exprimé par un grand nombre d'élu-e-s (territoriaux ou municipaux), est autre chose qu'une couverture pour la propre impuissance dans laquelle les plonge le système colonial ?
Le prétexte à la répression contre Petitot ne trompe que les naïfs. Le harcèlement judiciaire actuel n'est que la mise en exécution du plan sinistre de Retaillau, dont tout le monde sait que les jours comme ministre, sont comptés jusqu'au renversement du gouvernement illégitime, rétrograde, et liberticide du sieur Barnier.
Le GRS réclame la libération immédiate de Petitot et de tous les contestataires victimes de la criminalisation du mouvement social. Une honte pour la prétendue « patrie des droits de l'Homme » !
Le mouvement ouvrier et démocratique se doit de s'opposer fermement à la répression qui, en dernière instance, s'attaquera à tout ce qui bouge, si on laisse faire ! La mobilisation contre la vie chère, pour une vie digne, pour l'emploi, la santé, l'École, et pour notre liberté, est un seul et même combat.
Fort-de-France le 30 novembre 2024
Groupe Révolution Socialiste
P.-S.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Dialogue Binet-Tanuro : le défi écologique passé au crible

C'est une initiative de la CGT de Loire Atlantique (44) réalisée en mai 2024 : un dialogue entre Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT et Daniel Tanuro, ingénieur agronome et auteur d'ouvrages sur le défi écologique avec notamment son dernier livre : « Ecologie, luttes sociales et révolution » (La Dispute). Un débat qui aborde (presque) toutes les questions : les limites de la planète, la contradiction entre le « social » et « l'environnemental« , la sécurité sociale professionnelle et environnementale, la décroissance mondiale de la production énergétique (sans pénaliser les pays pauvres), le sens du mot « production« , du « travail » et de l'industrie, et aussi les sources de luttes et d'espoir. Un échange très fécond. Plus bas, noter aussi un autre dialogue entre le même Daniel Tanuro et Sébastien Menesplier (secrétaire confédéral chargé de l'environnement) dans le cadre de « journées de l'écosyndicalisme » à Nantes en avril 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Déclaration de la confédération syndicale de Géorgie contre la répression.

L'Union des syndicats professionnels de Géorgie déclare qu'il n'y a pas d'alternative à l'intégration européenne, c'est la volonté inébranlable du peuple géorgien inscrite dans la Constitution géorgienne. Les autorités et chaque membre de la société ont l'obligation et la nécessité vitale de concentrer leurs efforts sur une intégration rapide dans l'Union européenne.
4 décembre 2024 |tiré d'Arguments pour la lutte sociale
Jusqu'à présent, chaque progrès du pays dans des directions différentes est lié au processus d'intégration européenne, et chaque défi qui inquiète la population de notre pays ne peut être résolu qu'en introduisant des normes européennes, avec une large participation du public. C'est pourquoi nous pensons que la décision du gouvernement de refuser d'ouvrir les négociations jusqu'en 2028, ainsi que le nom du candidat à la présidentielle qu'il a désigné, auraient dû être connus du public avant les élections.
Nous considérons que seule l'intégration européenne permettra d'assurer le bien-être de la société, la sécurité sociale, un emploi décent et, en général, une protection et un respect inébranlables des droits humains.
Nous condamnons catégoriquement l'excès évident de force de la part des forces de l'ordre, qui s'est manifesté par la violation des droits des représentants des médias et des participants aux manifestations, y compris par la violence physique. Nous pensons que chaque auteur et toutes les personnes responsables doivent être identifiés et tenus responsables immédiatement.
Il est également nécessaire de prévenir les actes de violence et de vandalisme contre les forces de l'ordre de la part des personnes impliquées dans la manifestation.
L'Union des syndicats professionnels de Géorgie est prête à fournir une assistance juridique à toutes les personnes dont les droits du travail seront violés en raison de l'exercice de la liberté d'expression ou d'autres droits légaux.
Syndicat professionnel des travailleurs des transports et de la route de Géorgie
Syndicat des métallurgistes, des industries minières et chimiques
Syndicat ferroviaire
Union des syndicats professionnels d'Abkhazie
Syndicat Professionnel des Travailleurs du Métro
Syndicat Professionnel des Énergéticiens
Union professionnelle des travailleurs de la connectivité
Syndicat Professionnel des Travailleurs Médicaux, Pharmacie et Protection Social
Union professionnelle des marins
Syndicat Professionnel des Bâtisseurs et Travailleurs Forestiers
Syndicat professionnel des travailleurs du secteur des services, des services publics et des banques
Syndicat professionnel des travailleurs de l'industrie pétrolière et gazière
Union professionnelle des fonctionnaires
Union professionnelle de l'art, des médias, des institutions culturelles et éducatives, des travailleurs du sport et du tourisme.
Syndicat libre des enseignants et des scientifiques de Géorgie (SPMTP)
Le 2 décembre 2024.
Source : RESU
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Une interview de Yuriy Samoilov, dirigeant du syndicat indépendant des mineurs ulrainiens

Yuriy Samoilov est un dirigeant du Syndicat indépendant des mineurs d'Ukraine (NPGU-KVPU) à Kryvyi Rih et un militant de l'organisation ukrainienne de gauche Sotsialnyi Rukh (Mouvement social). Dans cet entretien avec Federico Fuentes pour LINKS International Journal of Socialist Renewal, réalisé avec l'aide de Serhii Shlyapnikov, Samoilov donne une perspective syndicale et de gauche sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il explique comment les syndicats font face au double défi de l'occupation étrangère et des attaques contre les droits des travailleurs, ainsi qu'à la nécessité d'une solidarité internationale avec les travailleurs ukrainiens.
Federico Fuentes
3 décembre 2024 | Links - Traduction Patrick Le Tréhondat
Quels ont été les effets sur le moral de la population des attaques incessantes de la Russie contre les infrastructures énergétiques ?
L'été [juin-août] a été marqué par de nombreuses attaques contre les infrastructures énergétiques. Tout le monde fait des réserves de générateurs et de batteries. Le chauffage n'a pas encore été allumé dans les grands bâtiments, mais il a neigé hier [13 novembre], de sorte que les gens sont déjà gelés et craignent l'hiver à venir, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des enfants. À Kryvyi Rih, les attaques russes se concentrent désormais sur les zones résidentielles et les hôtels. Quatre hôtels ont été détruits, ainsi que plusieurs bâtiments résidentiels. Des civils, des familles entières, ont été tués. Il y a quelques jours, une frappe a eu lieu près de notre bureau syndical. Un grand bâtiment de cinq étages a été détruit. Plusieurs personnes sont mortes, dont une mère et ses trois jeunes enfants, dont le plus jeune n'avait que sept mois. Le père n'a survécu que parce qu'il était au travail. Les enfants doivent étudier dans les sous-sols ou en ligne. Tout le monde craint de nouvelles attaques. En ce qui concerne les installations énergétiques, les Russes ont bombardé tout ce qu'ils pouvaient. Les seules cibles restantes sont les centrales nucléaires, mais les frapper représenterait une situation tout à fait différente. Si une centrale nucléaire était bombardée, les radiations se propageraient également à l'Ouest. Si un missile touchait la centrale nucléaire de Rivne, toute la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque seraient touchées par les radiations. Il est possible qu'ils commencent à bombarder certaines sous-stations de distribution à proximité des centrales nucléaires ; nous y sommes habitués parce qu'ils l'ont fait l'année dernière.
Comment le gouvernement et les syndicats ont-ils réagi aux attaques contre les habitations ?
Le gouvernement verse des indemnités aux personnes qui perdent leur logement. Lorsque les maisons peuvent être réparées, les autorités locales procèdent aux restaurations. D'après ce que je vois, cela se fait assez rapidement. En ce qui concerne les syndicats, lorsque la maison d'un membre est détruite, nous fournissons un logement temporaire.
Les syndicats, en particulier les sections locales telles que les mineurs de Kryvyi Rih, ont joué un rôle important dans la résistance ukrainienne. Comment les syndicats ont-ils contribué à la défense de la souveraineté de l'Ukraine ?
La moitié des membres du NPGU ont rejoint le front dès le début de la guerre. Ils se sont engagés dans la défense territoriale ou ont été incorporés dans l'armée. Aujourd'hui, environ 70 % de ceux qui étaient syndiqués au début de la guerre combattent. Les syndicats soutiennent fortement ceux qui se battent parce qu'ils restent syndiqués. Mais le nombre de syndiqués a diminué à cause de la guerre. Nous couvrons les travailleurs des grandes entreprises, où il est plus facile de recruter des militaires. Aujourd'hui, il existe des exemptions qui empêchent les travailleurs d'être enrôlés dans l'armée. Mais en général, tout le monde se sent poussé à aller se battre. Les centres de formation de la défense territoriale sont très durs et fonctionnent sur le mode de la provocation. Les recruteurs pénètrent dans des entreprises comme ArcelorMittal, mais les syndicats s'y opposent.
Comment la guerre a-t-elle affecté le travail normal des syndicats ? Les syndicats ont-ils dû mettre de côté leurs propres revendications et actions, telles que des grèves pour maintenir les salaires, afin de ne pas être perçus comme sapant l'effort de guerre ?
Actuellement, à l'usine de minerai de fer de Kryvyi Rih, nous sommes impliqués dans un conflit du travail. Malgré la guerre, nous demandons une augmentation de salaire de 20 %. Nous négocions dans le cadre légal dont nous disposons. Avant la guerre, les grèves et les manifestations étaient reconnues comme légales par les tribunaux. Aujourd'hui, nous continuons à faire valoir nos revendications sans recourir aux manifestations ou aux grèves. Nous sommes en effet limités dans les actions que nous pouvons entreprendre pour protéger nos droits.
Comment les syndicats ont-ils réagi aux mesures prises par le parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, pour restreindre les droits des travailleurs ?
La classe ouvrière et les syndicats n'ont pas de parti à la Verkhovna Rada qui représente leurs intérêts. Le seul député issu d'un syndicat est Mykhailo Volynets, qui appartient à la Confédération des syndicats libres d'Ukraine (KVPU) et est membre de la faction parlementaire Batkivshchyna (Patrie). Surfant sur la vague d'espoir que représentait Volodymyr Zelensky en 2019, plusieurs partis sans véritable idéologie sont entrés à la Verkhovna Rada. Les syndicats ne savent pas comment travailler avec ces partis. Ils n'ont pas non plus trouvé les moyens d'amender la législation au parlement à cause de la guerre. En revanche, les syndicats ont déjà fait échouer les tentatives d'adoption d'un nouveau Code du travail. En Ukraine, le Code du travail adopté à l'époque de l'Union soviétique est toujours en vigueur [contrairement à la Russie, où il a été aboli au début de la présidence de Vladimir Poutine en 2001]. Et malgré toutes les lois de décommunisation, ils n'ont pas encore réussi à « décommuniser » le Code du travail. C'est grâce au travail des syndicats et à l'intervention des organisations syndicales internationales.
Des rapports occidentaux font état d'une lassitude croissante à l'égard de la guerre en Ukraine. Que pensent les Ukrainiens des spéculations sur ce qui serait très probablement un accord de paix injuste ?
Plus que la fatigue, qui est déjà passée, nous avons maintenant l'apathie. L'apathie, c'est pire. La plupart des gens n'attendent plus rien. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une répétition de 1943 [lorsque la moitié de l'Ukraine était sous l'occupation nazie et que les perspectives de victoire semblaient incertaines]. J'ai l'impression que le soutien occidental à l'Ukraine va disparaître et que nous serons laissés seuls face à l'impérialisme russe.
Nombreux sont ceux qui partagent vos craintes quant à une baisse du soutien occidental ?
Nous nous trouvons dans une situation similaire à celle de la Tchécoslovaquie en 1938 - ceux qui connaissent l'histoire comprendront ce que je veux dire. Les dirigeants européens et américains considèrent la situation de la même manière qu'à l'époque, lorsque l'Europe cherchait des moyens d'apaiser Hitler. Comme beaucoup d'autres pays, l'Ukraine n'est pas considérée comme faisant partie du monde « civilisé ». En ce sens, il n'y a pas de distinction entre nous et les nations d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique et l'Occident nous traite tous de la même manière.
Les pays occidentaux ont utilisé l'aide militaire à l'Ukraine comme prétexte pour réduire les dépenses sociales dans leur pays. Que diriez-vous aux gouvernements qui cherchent à utiliser la juste guerre d'autodéfense de l'Ukraine pour mener des attaques régressives contre leurs propres travailleurs et syndicats ?
En Ukraine, les droits sociaux des travailleurs et des syndicats sont également réduits. Plusieurs lois ont été adoptées qui réduisent considérablement les droits des travailleurs et du personnel militaire. Les pensions ont été réduites : avant la guerre, il était rare que les pensions soient réduites, mais aujourd'hui, ce sont les retraités qui sont visés. Même les personnes handicapées sont visées, avec un projet de loi en cours de discussion qui les privera du droit de réclamer des dommages et intérêts à leur employeur en cas de blessure ou de perte de capacité de travail. Cette mesure s'appliquera également au personnel militaire. Les gouvernements des autres pays observent la situation et cherchent à suivre la même voie. Ils cherchent n'importe quelle excuse pour réduire les prestations sociales des travailleurs. Nous ne devrions pas écouter de telles excuses.
Comment les syndicats ont-ils réagi au « plan de victoire » récemment annoncé par Zelensky ?
Un plan ne se limite pas à cinq mots sur une page. Un plan nécessite un ensemble complet d'actions à mettre en œuvre dans tout le pays. Ce n'est pas le cas. Par exemple, nous ne disposons pas d'une véritable mobilisation militaire. Il est vrai que nous attendons le soutien de l'Occident mais, à l'intérieur, nous sommes mal organisés. L'Ukraine dispose d'un énorme potentiel militaro-industriel, notamment en termes de personnes compétentes capables de développer des armes modernes. Mais aujourd'hui encore, les entreprises minières et métallurgiques ne reçoivent pas de commandes de minerai de fer ou de métal de l'intérieur du pays. De nombreuses entreprises industrielles ukrainiennes pourraient fonctionner, mais ne le font pas pour l'instant.
Comment les syndicats [internationaux] peuvent-ils aider au mieux leurs homologues ukrainiens ?
Bien qu'ils disent que je ne devrais pas aborder ce sujet, il est important de souligner que les syndicats internationaux ont seulement suspendu l'adhésion des syndicats russes qui soutiennent l'agression militaire contre l'Ukraine. La seule confédération à avoir exclu son syndicat russe affilié pour son soutien à la guerre est l'UITA [Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes]. Aucune autre structure syndicale n'a expulsé de syndicats russes soutenant l'agression militaire. Depuis 2014, les biens des syndicats de Crimée et des territoires occupés ont été remis à des syndicats jaunes basés en Russie. Ces mêmes syndicats sont profondément ancrés dans les syndicats européens et mondiaux. Je ne connais pas toute la situation, mais j'aimerais savoir comment les syndicats mondiaux et européens peuvent accepter de l'argent d'un agresseur aux mains pleines de sang. Une partie des cotisations perçues par ces syndicats provient de régions d'Ukraine ensanglantées. Je pourrais dire la même chose des Nations unies. Récemment, [le secrétaire général de l'ONU António] Guterres s'est rendu à un sommet des BRICS à Kazan, où une photo a été prise de lui serrant la main de Poutine, la tête baissée. Où avons-nous vu une telle photo auparavant ? Lorsque le dernier président de la première République tchèque a serré la main d'Hitler. La même posture. La même photo. Le moins que l'on puisse attendre des organisations internationales est qu'elles ne se salissent pas les mains avec le sang de l'impérialisme russe.
J'ai entendu dire qu'il y avait également un mécontentement à l'égard de la Croix-Rouge.
Je pense qu'il serait bon que les syndicats protestent devant les sièges de la Croix-Rouge dans différents pays, car la politique actuelle de la Croix-Rouge facilite manifestement l'agression. La Croix-Rouge vient inspecter les camps et les prisons où sont détenus les prisonniers de guerre russes en Ukraine. Pourtant, il n'y a pas eu un seul rapport sur la condition des prisonniers de guerre ukrainiens dans les prisons russes, bien que de nombreux Ukrainiens soient morts dans les prisons russes, comme le documente le bureau du procureur ukrainien, et que beaucoup d'autres aient été tués en se rendant sur le champ de bataille.
Pensez-vous que les syndicats internationaux et les organisations de gauche n'apportent pas d'aide à l'heure actuelle ?
Il est important de dire qu'une aide est apportée. Par exemple, notre ville a été privée d'eau potable. Cela a créé une situation que je n'ai vue nulle part ailleurs, où les magasins ne vendent que de l'eau potable. À Kryvyi Rih, ces magasins sont nombreux et vendent de l'eau propre à 2,50 dollars le litre. En réaction, des syndicats d'Europe et du monde entier, ainsi que des groupes de gauche, ont collecté des fonds pour acheter des filtres afin que nous puissions distribuer de l'eau gratuitement à certaines parties de la population. Mais de nombreux groupes de gauche continuent à défendre des positions pro-russes. Ils pensent qu'il n'y a qu'un seul impérialisme, l'impérialisme américain, et affirment que l'impérialisme russe n'existe pas. Or, il existe de nombreux impérialismes. Les groupes de gauche indépendants et les syndicats peuvent nous aider en parlant au monde de la gauche indépendante en Ukraine et du fait qu'il y a des Ukrainiens de gauche qui se battent sur le front et qui organisent les travailleurs. C'est important car beaucoup considèrent que les politiques de gauche sont liées à l'impérialisme russe. Au contraire, nous devons construire un internationalisme au sein du mouvement syndical qui cherche à unir tous les travailleurs du monde - en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Ukraine.
2 décembre 2024
Publié par Links
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Extrême droite sur Internet : la montée des influenceur·ses nationalistes

Si Internet favorise l'extrême droite, c'est aussi parce que ses stratégies de communication s'y sont adaptées, notamment en utilisant les techniques issues du marketing. La communication policée du RN lui donne un vernis de respectabilité, tout en favorisant tout un écosystème d'influenceurs et de groupes plus radicaux où les discours racistes se libèrent. Analyse.
3 décembre 2024 | Billet de blog
https://blogs.mediapart.fr/tanguy-delaire/blog/031224/extreme-droite-sur-internet-la-montee-des-influenceur-ses-nationalistes
Pour lire l'ensemble de l'article cliquez sur ce lien
Conclusion
Les discours de l'extrême droite se sont adaptés aux codes de l'internet pour asseoir sa domination. Gardant son côté sulfureux historique, tout en reprenant l'humour léger de la publicité et le cynisme des forums Internet, elle a réussi à faire de l'internet un porte-voix pour ses idées excluantes. La médiatisation par les marges des groupuscules les plus violents a permis aux groupes plus institutionnels et policés comme le RN de se hisser aux postes d'élu·es, tout en se démarquant de cette image de milices qui lui collait à la peau. Comme une division du travail idéologique, on voit les représentant·es de partis d'extrême droite afficher une image de respectabilité et d'ouverture, en encourageant en douce les groupes les plus radicaux à saturer la toile de discours racistes et d'appels au meurtre.
Ce jeu entre partis « officiels » et groupuscules radicaux permet à l'extrême droite de déplacer la fenêtre d'Overton. Cette métaphore a été imaginée par le sociologue du même nom pour désigner les opinions considérées comme acceptables par l'opinion publique, et donc susceptibles d'être introduites dans la législation [1]. Toute opinion exprimée dans l'espace public qui se trouverait en dehors de cette fenêtre métaphorique serait par défaut discréditée comme insensée ou trop extrême. Par exemple, la prohibition de l'alcool aux États-Unis a duré pendant 13 ans (de 1920 à 1933). Elle était donc acceptable politiquement à ce moment précis de l'Histoire, à cet endroit du monde. En 2024, un·e politicien·ne qui proposerait l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool serait sûr·e de ruiner son image et sa carrière. Elle n'est plus dans la fenêtre d'Overton.
De même, la théorie du « grand remplacement » est longtemps restée confinée à d'obscurs groupuscules ou des terroristes (Brenton Tarrant a intitulé son manifeste « Le grand remplacement » avant de tuer 50 personnes à la sortie d'une église néo-zélandaise). Elle est désormais reprise dans de nombreux médias (notamment la chaîne CNews, possédée par Vincent Bolloré) et par de nombreux responsables politiques d'extrême droite ; d'abord cantonnée à Éric Zemmour et ses soutiens, elle est passée au Rassemblement National et même maintenant au groupe politique « centre-droit » Renaissance.
L'agenda médiatique actuel est déplacé vers les problématiques de l'extrême droite, qui saturent petit à petit le débat politique. Les discours racistes des marges se retrouvent au cœur des gouvernements et de leurs politiques, que les élu·es soient ou non affilié·es à des partis d'extrême droite. En France, la loi sur l'immigration, proposée par Renaissance, pourtant désigné par le ministère de l'Intérieur comme « centre-droite » a été votée par 100% des parlementaires du RN tandis que 22% des parlementaires de Renaissance s'abstenaient ou votaient contre. Une première dans ce mandat [2]. Marine Le Pen a d'ailleurs qualifié ce vote de « victoire idéologique » [3].
[1] « Policies that are widely accepted throughout society as legitimate policy options », MacKinac Center for Public Policy, dont Joseph P. Overton a été vice-président https://www.mackinac.org/OvertonWindow
[2] Pauline GRAULLE et Ilyes RAMDANI, « Loi immigration : à l'Assemblée nationale, la victoire au goût de débâcle du camp présidentiel », Mediapart, 20 décembre 2023 https://www.mediapart.fr/journal/politique/201223/loi-immigration-l-assemblee-nationale-la-victoire-au-gout-de-debacle-du-camp-presidentiel?at_medium=custom7&at_campaign=1046
[3] 54 « Projet de loi immigration : le RN votera pour le texte issu de la CMP, annonce Marine Le Pen, qui salue une "victoire idéologique" », Franceinfo avec AFP, 19 décembre 2023 https://www.francetvinfo.fr/societe/immigration/loi-immigration-le-rn-votera-pour-annonce-marine-le-pen-qui-revendique-une-victoire-ideologique_6254361.html
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.






















