Derniers articles

Manifestation contre la modification de rezonage à Dalhousie favorisant l’implantation d’une mine de pouzzolane

Nouvelle (Québec), le 11 décembre 2024. – Le groupe citoyen Non Merci, PozzolanDalhousie ! lance une invitation à la population de la Baie-des-Chaleurs à venir manifester le 16 décembre 2024 contre le projet de mine à ciel ouvert de pouzzolane lors de la réunion publique du conseil municipal de Baie-des-Hérons. Selon les informations connues actuellement, la rencontre aura lieu à 19 h (heure locale du Nouveau-Brunswick), à l'hôtel de ville, au 111, rue Hall, à Baie-des-Hérons.
Cette rencontre du conseil municipal de Baie-des-Hérons est cruciale. La dérogation au règlement de zonage permettant l'implantation de la mine passera en troisième et dernière lecture. En cas d'adoption, ce règlement ouvrira la porte à l'implantation de la mine en plein cœur de la municipalité,avec tous ses effets catastrophiques attendus des deux côtés de la baie des Chaleurs.
Le groupe Non Merci, Pozzolan Dalhousie ! insiste sur la pertinence et la nécessité de la présence du plus grand nombre de personnes pour exprimer leur désaccord envers le projet de mine, le processus en place pour favoriser ce dernier, la sourde oreille apparente de certain(e)s élu(e)s et plusieurs manquements au processus démocratique déjà dénoncés par le groupe (réduction de la capacité de la salle, suppression des périodes de questions, tentative manquée de diffusion en continu, etc.).
Pour faciliter la participation des citoyen(ne)s, le groupe Non Merci, Pouzzolane Dalhousie ! organise un transport gratuit en autobus, qui partira de l'église de Nouvelle et se rendra à l'hôtel de ville de Baie-des-Hérons.
À propos du groupe citoyen
Nous sommes un groupe de citoyen(ne)s gaspésien(ne)s uni(e)s contre le projet EcoRock (anciennement Pozzolan Dalhousie). Notre objectif est de regrouper la population francophone de la baie des Chaleurs, incluant la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick. Nous appuyons les efforts de la communauté de Baie-des-Hérons, qui a déjà mis en œuvre plusieurs actions sous le nom No Thx Pozzolan v2.0 - Save Dalhousie Mountain.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Make it great again Noël féministe

Ce texte a été lu lors du Noël festif et solidaire organisé le 1 décembre par le comité des femmes de Québec Solidaire Capitale nationale.
2024-12-01
Élisabeth Germain
Je ne sais pas très bien ce qui m'arrive. C'est peut-être la vieillesse du corps qui s'est imposée à moi depuis un an et qui me ralentit. Ou une fragilité nouvelle qui me rend plus vulnérable aux fragilités autour de moi. En tout cas me voilà moins combative, moins prompte à monter sur mes grands chevaux, comme on dit.
C'est aussi, je crois, mes recherches écoféministes qui me font devenir tellement plus consciente de nos interdépendances et aspirer à ce que nous prenions soin de la vie, forte et fragile comme elle est.
J'ai envie de me tourner vers la paix plutôt que vers la lutte. Ou, en tout cas, de lutter pour rendre la paix possible. Vous voyez, je suis un peu mêlée. Et puis c'est un lieu commun, je le sais, parler de paix à Noël.
Mais c'est l'hiver, le début de l'hiver, et je ne peux qu'angoisser en pensant à toutes les Ukrainienꞏnes qui vont encore endurer le froid, la noirceur et l'impuissance, pour un troisième hiver d'affilée.
Parce qu'un empire a décidé de les conquérir. Parce qu'un orgueil mâle aspire à régner. Make Russia great again.
C'est le début de l'hiver et les Palestinienꞏnes continuent à être délogées, bousculées, bombardées, affamées. À mourir longuement.
Parce qu'un orgueil mâle, là aussi, poursuit impitoyablement sa vengeance et son appropriation. Make Israël great again.
Et c'est le début d'un hiver de quatre ans chez nos voisins du sud. J'angoisse là aussi, en pensant à toutes les femmes sur lesquelles le contrôle mâle, politique et religieux, va s'étendre de plus en plus.
Your body, my choice. Make America great again.
C'est aussi le début d'un hiver écologique où les puissants détruisent la vie pour construire leurs empires de pétrole, de satellites et d'artifices, Viagra, faux seins et intelligence artificielle.
Autrefois, hier encore, on pouvait ne pas savoir, on pouvait être des analphabètes de l'écologie, malgré les découvertes scientifiques depuis 1856 où Eunice Newton Foote, la première, découvrait l'effet de serre. Malgré les avertissements inquiets et bienveillants de Rachel Carson, les alarmes fracassantes de Françoise D'Eaubonne, les appels de Margaret Mead, les arguments des Australiennes Ariel Salleh et Val Plumwood, de l'Indienne Vandana Shiva, de l'Allemande Maria Mies, malgré les enseignements vécus de nos sœurs autochtones et africaines, de nos Mères au front québécoises et de toutes celles qui n'ont pas publié mais qui ont agi, alerté leurs milieux saccagés par l'expansion industrielle, affirmé la nécessité de l'attention, du soin, des relations, de la bonté.
Aujourd'hui… aujourd'hui c'est la planète elle-même qui nous fait savoir que ça ne va pas. Ces conquêtes, ces destructions d'êtres vivants, ces creusages de mines, ces gaz toxiques, engendrent déserts et déluges, défaites et désespoirs.
Les puissants, tous néo-capitalistes et autoritaires sous leurs étiquettes de gauche ou de droite, ces Make it great again veulent contrôler la planète, la vie, nos vies, notre sexualité.
Ils ne pourront pas empêcher cette vie de jaillir de nos corps, de notre sang, de nos accouchements, de nos désirs, de nos soins pour les vivantꞏes qui nous entourent. Car ensemble nous prenons soin, malgré tout.
Nous résistons. Est-ce que nous prenons une conscience nouvelle de notre force et de nos connexions ? Est-ce qu'un courage nouveau remplit nos veines pour résister aux nouvelles colonisations, aux nouvelles destructions de la vie et de la terre ?
Dites-moi, dites-moi que nous ne laisserons pas le champ libre à ces nouveaux tsars redoutables autant que méprisables :
Vladimir 1er, le faux curé,
Xi 1er, le rouleau compresseur,
Donald 1er, le pelotteur,
Benyamin 1er, le corrompu ,
Elon 1er, le fou des machines,
et tous leurs petits soldats malades de grandeur et de puissance phallique.
Noël, une fête presque aussi ancienne que notre hémisphère nord, célèbre le retour de la lumière, alors que nous sommes au creux de la noirceur : fin décembre, les jours commencent à allonger. Quand on se sent comme à la fin de tout, il y a… un léger basculement, presque imperceptible, mais porteur de tous les possibles.
Alors mon Noël féministe, je vous le partage. C'est le travail incessant, les cris d'amour et les révoltes de nos sœurs autour du monde. C'est la puissance des femmes quand elles s'allient pour la vie. C'est l'espoir que les humains mâles finissent par nous rejoindre dans la tâche essentielle : prendre soin de la vie, de toutes les vies, partout. Mon Noël féministe, c'est le rêve de renverser les puissances obscures et c'est la joie forte de partager ce rêve avec vous, en ce moment.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Un recours comme dernier recours face à l’inaction de Québec

Plus de sept ans après son adoption dans la Loi sur la qualité de l'environnement, le registre public d'information environnementale se fait toujours attendre. Forts de plus de 80 organisations et individus issus des milieux environnemental, syndical, juridique, de défense des droits, universitaire, journalistique et citoyen, nous prenons une fois de plus la parole pour défendre le droit à l'information comme pilier de la démocratie aux côtés du Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE), qui a déposé mardi une action visant à obtenir le registre public d'information environnementale.
Un droit fondamental souvent négligé
Cela fait des années que nous sommes nombreux à dénoncer le manque de transparence et les délais exaspérants, autant d'obstacles à la participation citoyenne et au respect du droit à l'information.
L'absence du registre public d'information environnementale illustre tristement cette « tendance au secret », pour citer l'ancienne juge en chef du Canada Beverley McLachlin. Il est grand temps de renverser cette tendance, au bénéfice de la population.
L'information environnementale, clé de voûte pour le respect des droits
L'environnement est au cœur de nos vies : il influence notre santé, notre sécurité et notre bien-être collectif présent et futur. Sans un accès rapide à des informations précises sur les impacts environnementaux des projets, comment la population peut-elle prendre part au débat public et agir ?
Le registre public d'information environnementale permettrait à chaque citoyen de comprendre les projets qui touchent son milieu de vie, de remettre en question les choix faits et de contribuer de manière éclairée aux affaires d'intérêt public et, lorsque nécessaire, à la prise de décision.
Les dénis du droit à l'information entraînent des conséquences sur l'exercice d'autres droits. Les tribunaux ont rappelé récemment que, « bien souvent, le seul écoulement du temps équivaut à un déni d'accès » . Aujourd'hui, nous, acteurs de tous les milieux, portons haut et fort la demande d'une plus grande transparence en matière d'information, notamment environnementale. C'est notre affaire à toutes et à tous.
Une demande collective pour la transparence
Il est regrettable qu'il faille en arriver à une action en justice pour assurer que le gouvernement respecte une décision législative si essentielle, adoptée démocratiquement par l'Assemblée nationale. L'action du CQDE vise à corriger cette opacité, à mettre fin à une longue attente et à rappeler que l'accès efficace à l'information n'est pas un privilège, mais un droit.
Nous appelons donc le gouvernement du Québec à prioriser la mise en œuvre de ce registre et à honorer son obligation envers la population.
Parce qu'en environnement comme en démocratie, le droit de savoir est la première étape vers l'action.
Signataires
Geneviève Paul, directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement ; Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec ; Denis Bolduc, secrétaire général, Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) ; Colleen Thorpe, directrice générale, Équiterre ; Nathalie Prud'homme, présidente, Ordre des urbanistes du Québec ; Béatrice Alain, directrice générale, Chantier de l'économie sociale ; Henri Jacob, président, Action boréale ; Christian Daigle, président-général, Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ; Malorie Flon, directrice générale, Institut du Nouveau Monde (INM) ; Sylvain Gaudreault, député de Jonquière à l'Assemblée nationale de 2007 à 2022 ; Louis-Gilles Francœur, journaliste affecté à la couverture environnementale de 1981 à 2012 au Devoir et vice-président du BAPE de 2012 à 2017 ; Cédric Bourgeois, cofondateur et associé, Transfert Environnement et Société ; Laure Waridel, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, chroniqueuse au Journal de Montréal et co-instigatrice de Mères au front ; Jean Baril, docteur en droit et auteur d'une thèse de doctorat, Droit d'accès à l'information environnementale : pierre d'assise du développement durable, récompensée par l'Assemblée nationale en 2012 ; Michel Bélanger, avocat émérite et cofondateur du CQDE ; Mario Denis, avocat légiste retraité (conseiller juridique et rédacteur de lois au ministère de l'Environnement du Québec de 1993 à 2010) ; Anne-Julie Asselin, avocate, Trudel, Johnston & Lespérance ; Geneviève Brisson, directrice scientifique, Centre de recherche en développement territorial (CRDT), et professeure en développement territorial, UQAR ; Alexandre Petitclerc, président, Ligue des droits et libertés ; Rodrigue Turgeon, avocat, coresponsable du programme national de MiningWatch Canada et co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine ; Sébastien Brodeur-Girard, professeur, École d'études autochtones, UQAT ; Lise Parent, professeure en sciences de l'environnement, Université TELUQ ; Martin Gallié, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM ; Rébecca Pétrin, directrice générale, Eau Secours ; Louis Simard, professeur, École d'études politiques, Université d'Ottawa ; Karel Ménard, directeur général, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets ; Jean-François Girard, avocat, DHC Avocats et membre honoraire du CQDE ; Bonnie Campbell, professeure émérite, Département de science politique, UQAM ; Stéphanie Roy, avocate et professeure adjointe, Faculté de droit, Université de Sherbrooke ; Paul Casavant, président, TerraVie – fonds foncier communautaire ; Antoine Corriveau-Dussault, chercheur et codirecteur de l'axe Éthique environnementale et animale, Centre de recherche en éthique ; Sébastien Jodoin, vice-doyen à la recherche, professeur agrégé et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les droits humains, la santé et l'environnement, Faculté de droit, Université McGill ; Isabelle Miron, professeure, Département d'études littéraires, UQAM ; Spencer C. Nault, administrateur, Association des juristes progressistes (AJP) ; Lucie Sauvé, professeure émérite, Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement (Centr'ERE – UQAM) ; Collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec ; Alain Branchaud, directeur général, SNAP Québec ; Joyce Renaud, vice-présidente, Mobilisation climat Trois-Rivières ; André Bélanger, directeur général, Fondation Rivières ; Louis Marchildon, professeur émérite (physique), UQTR ; Alexandre Lillo, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM ; David Roy, directeur général, Ateliers pour la biodiversité ; Olivier Barsalou, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM ; Paule Halley, avocate, professeure et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, Faculté de droit, Université Laval ; Hugo Tremblay, avocat, professeur, Faculté de droit, Université de Montréal ; Priscilla Gareau, biologiste, directrice générale, Ambioterra ; Laurence Brière, professeure au Département de didactique, directrice du Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement (Centr'ERE), UQAM ; Bruce Broomhall, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM ; André Bélisle, président, Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPQ) ; Thibault Rehn, coordinateur, Vigilance OGM ; Touwendé Roland Ouédraogo, chargé de cours, UdeM et UQAM ; Élisabeth Patterson, avocate, Dionne Schulze ; Geneviève Tremblay-Racette, coordonnatrice, Table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais (TROVEPO) ; Myriam Thériault, codirectrice, Mères au front ; Sophie-Laurence H. Lauzon, codirectrice générale, Réseau des femmes en environnement ; Emmanuel Rondia, directeur général, Conseil régional de l'environnement de Montréal ; Sylvain Lafrenière, coordonnateur, Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) ; Cédric G.-Ducharme, avocat, ex-président CQDE ; Jean-Philippe Waaub, professeur retraité, Département de géographie de l'UQAM et membre de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM ; Pascal Bergeron, porte-parole, Environnement Vert Plus ; Christophe Reutenauer, professeur, Département de mathématiques, UQAM ; Bernard Saulnier, ingénieur, Collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec ; Jacinthe Villeneuve, porte-parole du Comité Action citoyenne – projet Northvolt (C.A.C.) ; Sebastian Weissenberger, Département science et technologie, Université TELUQ ; Anne-Josée Laquerre, directrice générale et co-initiatrice, Québec Net Positif ; Elodie Morandini, directrice générale, Conseil régional de l'environnement de Laval ; Gilles Côté, chargé d'enseignement, Université de Sherbrooke ; Sabaa Khan, directrice générale, Fondation David Suzuki (Québec) ; Sylvain Paquin, directeur général, Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie ; Christopher Campbell-Duruflé, professeur adjoint, Lincoln Alexander School of Law, Toronto Metropolitan University ; Pascale Pinette, présidente, Comité de citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement maskoutain (CCCPEM) ; Jacques Tétreault, président Arbres.eco et ancien coordonnateur général du RVHQ ; Jean-Marc Fontan, professeur titulaire, Département de sociologie, UQAM ; Valérie Vedrines, présidente et fondatrice, Masse critique ; Christiane Bernier, porte-parole de Les enjeux de l'insecticide Bti sur la biodiversité ; Jacques Benoit, GMob (Group Mobilisation) ; Suzann Méthot, ex-présidente du Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social (COMEX), consultante ; Mitchell Marin, ex-président du Conseil régional de l'environnement de la Mauricie ; Marc Lépine, fondateur du Groupe Citoyen EAUTAGE ; André Beauchamp, président du BAPE de 1983 à 1987 ; Michel Lafleur, biologiste membre du comité des Vieilles Forges, Trois-Rivières ; Sarah Bourdages, présidente du conseil d'administration du Comité de solidarité/Trois-Rivières (CS3R) ; Marianne Bargiel, pour le Collectif Trois-Rivières pour la biodiversité ; Dominique Leydet, professeure, Département de philosophie, UQAM ; Sarah-Katherine Lutz, directrice générale d'ENvironnement JEUnesse ; Alice-Anne Simard, directrice générale, Nature Québec.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Journée des droits de la personne 2024 : Les syndicats du Canada ripostent à la montée de la haine

Les syndicats du Canada marquent la Journée internationale des droits de la personne en incitant les Canadiennes et Canadiens à s'unir pour contester la montée de la haine que répand une extrême droite enhardie.
Depuis la création de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, le Canada a réalisé d'importants progrès en matière de droits de la personne. Le droit à un salaire équitable, le droit à la sécurité au travail et le droit de ne pas faire l'objet de harcèlement et de discrimination sont des droits de toute personne, quels que soient son origine, son identité ou son statut. Bien qu'il y ait encore du pain sur la planche pour ce qui est de garantir à tous ces droits et d'autres droits de la personne, ces droits sont censés permettre à tous de vivre en sécurité, dans le respect et dans la dignité au Canada.
« Cette journée rappelle aux syndicats du Canada leur responsabilité de défendre les valeurs sur lesquelles repose la Déclaration—l'égalité, la liberté et l'équité. Ces valeurs sont au cœur de l'identité de notre mouvement. Mais il ne suffit pas d'appuyer ou même de promouvoir ces valeurs et principes : nous devons combattre activement la normalisation croissante de la haine, du racisme et de la xénophobie et riposter aux atteintes portées aux droits de la personne au Canada », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.
Dans l'ensemble du pays, nous continuons à assister à une très inquiétante flambée du discours et du harcèlement haineux. Les forces réactionnaires d'extrême droite, enhardies par un climat de polarisation accrue et alimentées par des politiciennes et politiciens qui sèment la peur, tentent de réduire les droits de la personne durement acquis. Leurs tactiques sont clivantes : elles opposent les travailleuses et travailleurs et les voisines et voisins entre eux en désignant des boucs-émissaires, jouant sur les stéréotypes et alimentant les feux du racisme, de la xénophobie et de la discrimination pour miner la solidarité qui est le fondement même de notre force collective. Le mouvement syndical doit continuer à tenir ferme contre ces forces et maintenir son engagement et son action pour faire régner la sécurité et le respect dans nos lieux de travail, nos syndicats et nos collectivités.
« Aujourd'hui, nous incitons tous les travailleurs et travailleuses—qu'ils soient syndiqués ou non—à s'unir pour se prononcer contre la haine, le racisme et la discrimination. Notre mouvement et notre pays ont lutté longtemps et avec acharnement en faveur de ces droits, et nous ne ferons pas marche arrière maintenant. Chaque étape de progrès a été gagnée grâce à la détermination, au militantisme et à la solidarité. Nous avons fait trop de chemin pour laisser d'autres nous faire reculer, et nous ne faisons pas qu'éviter un recul—nous allons de l'avant, ensemble, parce que la lutte pour ls droits de la personne est loin d'être terminée », a dit Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC.
Joignez-vous à nous :
Impliquez-vous dans notre campagne Travaillons ensemble et luttez pour l'accès de tous les travailleurs et travailleuses à l'équité.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les hauts et les bas de la session parlementaire

Le rythme de la session parlementaire est passé de très actif au ralenti, avec des semaines de travaux intensifs qui ont été plutôt… inactives. Retour sur cet automne qui a connu ses hauts et ses bas.
Tiré de Ma CSQ.
Petit retour en arrière : rappelons-nous que la rentrée parlementaire de l'automne a d'abord été marquée par les départs du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, et du député de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Youri Chassin, qui siège désormais comme indépendant.
Puis, le gouvernement a fait de l'énergie sa priorité, avec le projet de loi no 69 (PL69) et le projet Northvolt, en plus de mettre de l'avant le dossier de l'immigration, surtout en dénonçant publiquement ses divergences avec le gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Le cas de l'école Bedford, où des enseignantes et enseignants ont fait régner un climat malsain, a aussi réanimé le dossier de la laïcité.
Des projets de loi surveillés de près
Au cours de l'automne, la CSQ a participé à plusieurs commissions parlementaires. Elle a notamment défendu son point de vue sur l'avenir énergétique en lien avec le PL69. Pour la Centrale, il était clair que ce projet de loi devait être retiré puisqu'il ouvrait la porte à la privatisation d'Hydro-Québec. Après avoir défendu bec et ongles son texte de loi, et à la suite de la victoire de Donald Trump lors des élections américaines, la nouvelle ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, a mis le pied sur le frein et a suspendu, pour le moment, l'étude détaillée du PL69.
La Centrale s'est également prononcée au sujet du projet de loi no 74 (PL74) sur l'encadrement relatif aux étudiants étrangers. L'approche préconisée, qui confère d'importants pouvoirs à des ministres, risque d'ouvrir la voie à de l'arbitraire et à des dérives partisanes, craint la CSQ. Dans son mémoire, la Centrale rappelle à quel point la contribution des étudiants étrangers est essentielle à notre société et comment leur présence en région est un facteur d'enrichissement pour les milieux culturels et communautaires.
Par l'entremise du Collectif pour un Québec sans pauvreté, la CSQ a également réagi sur la réforme du régime d'assistance sociale. Elle a notamment dénoncé le fait que la réforme ne prévoit aucune augmentation des prestations et ne permet pas aux personnes qui en bénéficient de vivre dans la dignité.
D'un point de vue plus positif, la Centrale a salué le plan pour améliorer l'accès à l'avortement. Elle évalue présentement la possibilité de rendre les moyens de contraception gratuits au Québec. Alors que des discussions ont toujours lieu avec Ottawa à ce sujet, Québec solidaire a mobilisé des milliers de personnes derrière cet enjeu en déposant une pétition.
Parlant de pétition, ce moyen de pression a fait jaser les parlementaires cet automne. Comme le rapportait le journal Le Soleil, même s'il a la possibilité d'étudier certaines pétitions en commission parlementaire, le gouvernement de la CAQ a choisi de n'étudier aucune des 612 pétitions déposées à l'Assemblée nationale.
La CSQ a également vu d'un bon œil l'adoption de la Loi visant à contrer le partage sans consentement d'images intimes et à améliorer la protection et le soutien en matière civile des personnes victimes de violence, présentée par le ministre de la Justice.
Consultations : des enjeux importants abordés
En plus des projets de loi, plusieurs consultations ont eu lieu au cours des derniers mois. Mentionnons d'abord la consultation transpartisane sur l'utilisation des écrans. La CSQ a affirmé, dans son mémoire, qu'il fallait retrouver un cadre plus équilibré puisqu'il s'agit d'une responsabilité collective entre l'école, la maison et la société. De plus, la Centrale a rappelé qu'une grande réflexion en éducation est incontournable, et les écrans doivent en faire partie.
La ministre de la Famille et ministre responsable de la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation, Suzanne Roy, a également mené une consultation en vue du prochain Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation. La Centrale en a appelé à un plan d'action inclusif et adapté pour les personnes vulnérables, en contexte scolaire, pour les élèves et étudiants en milieu autochtone et dans les milieux de travail. Celui-ci devra évidemment être accompagné de ressources en nombre suffisant pour donner des résultats probants.
Parallèlement, le ministre du Travail, Jean Boulet, a lancé une consultation sur la transformation des milieux de travail par le numérique à laquelle la CSQ participera.
Finalement, la semaine dernière, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a annoncé qu'il n'y aurait finalement pas de fusions d'accréditations syndicales dans le cadre des fusions d'établissements et de l'implantation de Santé Québec. Sonia LeBel a également annoncé l'intention du gouvernement de présenter, l'année prochaine, un projet de loi visant à « moderniser » le régime de négociation collective du secteur public, aussi connu sous l'appellation de « la Loi 37 ». Plusieurs questions demeurent sans réponse, mais la Centrale fera les représentations nécessaires pour faire connaître son avis sur cette réforme.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’intervention du gouvernement bafoue les droits des travailleuses et travailleurs

Comme vous le savez peut-être déjà, le ministre du Travail, Steve MacKinnon, a décidé d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 107 du Code canadien du travail pour demander au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) d'établir si le STTP et Postes Canada sont en mesure de négocier un projet de convention collective dans un très proche avenir. Si le CCRI juge que les parties ne peuvent pas y parvenir, il ordonnera le retour au travail des travailleuses et travailleurs des postes. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette attaque contre le droit de grève et le droit à la négociation collective libre et équitable, des droits pourtant garantis par la Constitution.
Cette ordonnance du ministre s'inscrit dans une tendance profondément troublante. En effet, des gouvernements fédéraux successifs ont adopté des lois de retour au travail ou, dans le cas présent, exercé leurs pouvoirs arbitraires pour permettre aux employeurs de ne pas avoir à négocier de bonne foi. Quel employeur accepterait de négocier quoi que ce soit s'il sait que le gouvernement interviendra en sa faveur ? Une fois de plus, le gouvernement a choisi le capital au détriment des travailleuses et travailleurs en nous privant de la possibilité de négocier une bonne convention collective.
Ce que nous savons
La situation évolue rapidement, et nous n'avons pas encore reçu l'ordonnance. Ce que nous savons, c'est que les travailleuses et travailleurs des postes pourraient être contraints de reprendre le travail sans nouvelles conventions collectives négociées.
Lorsque nous aurons reçu l'ordonnance, nous la passerons en revue et examinerons toutes les options possibles pour aller de l'avant.
Nous avons appris qu'une audience du Conseil canadien des relations industrielles se tiendra prochainement, possiblement dès la fin de semaine.
Notre position
Nous sommes dans la rue depuis près d'un mois. Postes Canada est demeurée muette pendant cinq jours après avoir reçu notre dernière offre. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé d'agir maintenant ?
Nous allons continuer de nous battre avec acharnement pour obtenir de bonnes conventions collectives négociées à l'intention de nos 55 000 membres. Nous allons continuer de nous battre pour obtenir des salaires équitables, des conditions de travail sûres et le droit de prendre notre retraite dans la dignité. Depuis des années, nous faisons pression sur Postes Canada pour qu'elle diversifie sa gamme de services afin de générer davantage de revenus.
Nous devons rester forts face à cet abus de pouvoir. Restez à l'affût des renseignements additionnels que nous communiquerons dans les prochains jours.
C'est loin d'être terminé.
Solidarité,
Jan Simpson
Présidente nationale
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
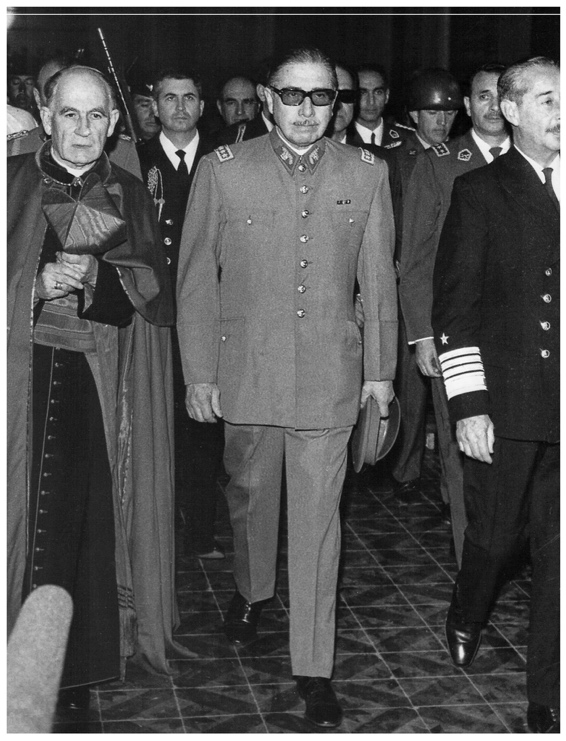
Souvenirs du Chili mais d’une actualité brûlante
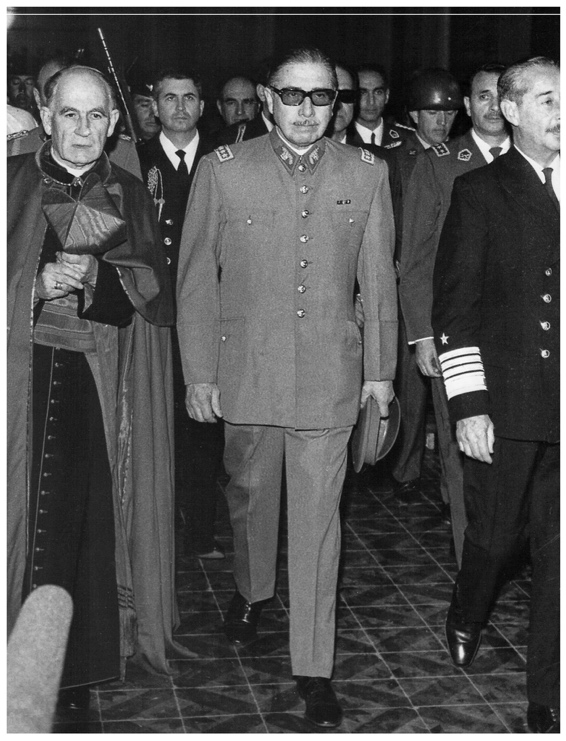
Un prêtre délateur me montre le message que les évêques chiliens font parvenir à Noël 1973 aux évêques du monde entier à la suite du coup d'état du 11 septembre
L'image qu'on se fait dans le monde de la junte militaire est faux... celle-ci n'est ni putschiste ni fasciste... elle est professionnelle et représente la réserve morale de l'âme chilienne... elle a libéré le Chili d'un gouvernement qui occasionnait appauvrissement brutal et permettait l'ingérence étrangère et surtout la marxisation du peuple... l'Église, comme le bon Samaritain, vient au secours des blessés (Note de l'auteur : torturés, familles de disparus, détenus en camps de concentration, etc.) sans partir à la recherche du responsable de leurs blessures...
Ovide Bastien, auteur de Chili : coup divin, Éditions du Jour 1974
Cyril William Smith, prêtre des Missions Scarboro, 24 novembre 1938 - 1 mai 1989
Le 10 décembre dernier je comparais la politique économique néolibérale promue par le président argentin Javier Milei lors du forum de l'extrême droite le 4 décembre à celle mise en pratique par le dictateur chilien Augusto Pinochet, grand pionnier du néolibéralisme. Je soulignais aussi le rôle clé joué par le délateur Bob Thompson à la suite du coup d'état chilien du 11 septembre 1973. Cet employé de l'Agence canadienne de développement international (ACDI, devenu depuis 2013 Affaires mondiales Canada) était tellement indigné de voir le caractère carrément fasciste des télégrammes confidentiels que faisait parvenir à Ottawa l'ambassadeur canadien au Chili Andrew Ross à la suite du coup d'état qui renversait Salvador Allende, qu'il les rendait publics.
Les délateurs Edward Snowden, Chelsea Manning et Julian Assange ont payé un immense prix personnel pour avoir agi selon leur conscience et dénoncé les écœuranteries perpétrées par les États les plus puissants. Thompson a également payé de sa peau pour avoir dénoncé Ross. Non seulement fut il congédié de l'ACDI mais on le barra aussi de tout futur emploi au sein du gouvernement fédéral.
Aujourd'hui, je rends hommage à un autre grand militant de la justice sociale et des droits humains qui, comme Thompson, a eu le courage de dénoncer des personnes complices du coup d'état chilien. Le document qu'il me remettait il y a 50 ans demeure encore fort pertinent aujourd'hui, surtout dans le contexte de la montée internationale de l'extrême droite, une montée qui est souvent, comme nous le savons, étroitement liée à la religion.
***********
Le prêtre Bill Smith me donne le message de Noël strictement confidentiel que les évêques chiliens envoient à tous les évêques du monde entier en décembre 1973
C'est mi-août 1974 et je suis sur le point de remettre à Éditions du Jour mon manuscrit Chili : le coup divin dénonçant la complicité de l'Église catholique dans le coup d'état chilien du 11 septembre 1973. Quelqu'un cogne à ma porte.
« J'ai appris que tu étais sur le point de publier, et j'ai pensé qu'il serait important que tu prennes conscience de ceci, » me dit Bill Smith en me remettant un document. « Svp ne dis à personne qui te l'a donné, car c'est une affaire qui est censée être strictement confidentielle. »
Le document que me remet ce prêtre, que je rencontrais pour la première fois quelques mois plus tôt à Santiago, est une longue analyse sur la situation au Chili qu'envoyait, à Noël 1973, la Conférence épiscopale chilienne à tous les évêques du monde entier.
Bill, comme tout le monde appelle ce curé, œuvre alors à l'Office des missions d'Amérique latine de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Il est responsable de tous leurs projets dans les Caraïbes et en Amérique latine.
Au début de 1989, Bill accepte une nouvelle responsabilité, celle d'agent de liaison entre la CSN et le mouvement syndical au Brésil et au Chili. Le jour avant le départ de Bill, Yves Laneville, ex-oblat qui fut prêtre ouvrier au Chili durant le gouvernement Allende et grand ami de Michel Chartrand, m'invite à partager un repas avec Bill dans un restaurant montréalais afin de lui dire au revoir.
Je n'oublierai jamais avec quelle passion mordante Bill, durant notre conversation, dénonce l'inégalité scandaleuse de revenus et de richesse dans le monde, comment on traite les immigrants, et l'indifférence générale qui existe face aux masses de marginalisés qu'on exploite comme main d'œuvre bon marché.
« J'espère qu'en vieillissant, je ne deviendrai jamais indifférent et passif devant tout cela. J'espère mourir une personne révoltée, » nous dit-il, avec grande émotion, durant notre souper.
Le vœu de Bill fut exaucé.
Le lendemain, à peine quelques heures après son arrivée à son nouveau poste à Sao Paulo, Brésil, il décède subitement d'une crise cardiaque.
Extraits du message de Noël 1973 des évêques chiliens à tous les autres évêques du monde
Le Comité permanent de l'Épiscopat a jugé qu'il était nécessaire de poser ce geste, étant donné que la presse internationale — y compris un très grand nombre d'organes catholiques — a tellement déformé les évènements du Chili, menant ainsi le public lecteur à une interprétation des évènements absolument fausse, qu'il fallait en quelque sorte offrir des éléments de jugement pondérés.
Tel est l'objectif de ces pages, affirme dans sa présentation le Secrétaire général de la Conférence épiscopale du Chili, l'évêque Carlos Oviedo Cavada.
Cardinal Raúl Silva Henriquez sort de l'église avec Augusto Pinochet, le 18 septembre 1973, après avoir offert à la junte militaire, lors d'une cérémonie télédiffusée, toute la « désintéressée collaboration de l'Église catholique »
Les Forces armées et les Carabiniers du Chili ne sont en aucune façon ni « putschistes », ni « fascistes », (...) leur constante tradition en est une de professionnalisme (...) ils sont au-delà des contingences politiques du pays. Le geste qu'ils ont posé le 11 septembre fut comme la réponse à une exigence nationale et, en tant qu'institutions armées, une conséquence de l'obligation qu'ils ont de garantir l'ordre au Chili.
Qu'est-ce qui prit fin au Chili le 11 septembre 1973 ? Pour plusieurs, pour les adhérents anonymes de l'Unité populaire, ce fut la fin de grands espoirs fondés sur un lien affectif avec les forces de la gauche, forces dans lesquelles, historiquement, de vastes secteurs du peuple placèrent leurs aspirations. Nous disons un lien affectif, car les réformes, les conquêtes en faveur du peuple ne s'étaient certainement pas réalisées. Les « 40 mesures » du programme électoral de l'Unité populaire, dans lesquelles étaient exprimés ces objectifs les plus immédiats en faveur des classes populaires, n'ont pas dépassé le stade de simple programme. Il n'y en a sûrement pas cinq qui sont devenues des réalisations concrètes. Plus tard, l'opposition rappelait régulièrement ces mesures pour ridiculiser le gouvernement de l'Unité populaire.
Pour la grande majorité des Chiliens, le 11 septembre 1973 représenta la fin d'un cauchemar, d'un état de décomposition du pays, de l'installation de la démagogie, de l'ingérence de politiciens étrangers (qu'on se rappelle la lettre de Fidel Castro, au président Allende, le 22 juillet 1973), de la violence sous toutes ses formes, de l'appauvrissement brutal de la nation et par-dessus tout, de la marxisation dans laquelle le Chili se trouvait entraîné. Tout cela se terminait par un acte des Forces armées et des Carabiniers du Chili lesquels représentent une véritable réserve morale de l'âme nationale. Pour cette majorité, le 11 septembre fut une véritable libération.
La connaissance du « Plan Z » a été le premier facteur de la prolongation de l'état de guerre interne dans le pays. Des secteurs de la gauche et de la presse internationale, adeptes du marxisme, ont tenté de nier l'existence de ce plan, qui était un auto-coup d'État de l'Unité populaire. Mais une documentation abondante a été trouvée et publiée. (…)
Certes, l'Église aimerait faire beaucoup plus en faveur de tous ceux qui souffrent, en imitant le bon samaritain qui s'occupa uniquement d'aimer le blessé sur la route et qui ne partit pas à la recherche de ceux qui l'avaient maltraité. Mais ces actions de l'Église en faveur des anciens militants de l'Unité populaire se sont méritées des critiques et des réserves dans la communauté catholique elle-même. La haine, la violence, le sectarisme qui s'étaient déclenchés durant l'Unité populaire furent si profonds – ‘l'âme du Chili est blessée', affirma un jour le cardinal — que ceux qui sous l'Unité populaire furent renvoyés de leurs emplois ou persécutés, ou qui eurent à souffrir sous ce régime, n'arrivent pas à comprendre que l'Église s'engage dans ces œuvres de miséricorde envers les anciens militants de l'Unité populaire. Cela a occasionné beaucoup d'incompréhensions parmi les catholiques eux-mêmes.
Dans le cas des Universités catholiques, le gouvernement a adopté une attitude distincte, en respectant leur dépendance du Saint Siège et de la Conférence épiscopale du Chili. Pour illustrer la compréhension à laquelle il est possible d'arriver, le cardinal nomma comme recteur de l'Université catholique du Chili, le recteur délégué par le gouvernement. (...)
Au cours des années précédentes, surtout pendant l'Unité Populaire, les jeunes ont joué un rôle de premier plan dans un contexte fondamentalement politique. Aujourd'hui, alors que les activités politiques sont en pause, ces jeunes sont confrontés à un vide d'action et de motivation. C'est une grande opportunité pour l'Église de former les jeunes, de les préparer pour l'avenir. Cette urgence est un défi pressant pour l'Église, c'est comme l'heure de Dieu pour ces jeunes.
Commentaires au sujet de l'analyse des évêques chiliens
Il est frappant de noter que les évêques chiliens non seulement ne qualifient pas de putschistes et fascistes les militaires et policiers chiliens qui ont brutalement renversé le gouvernement de Salvador Allende, mais qu'ils vont même jusqu'à affirmer qu'ils ne représentent rien de moins que « la réserve morale de l'âme chilienne ».
Des militaires qui, comme on le sait, finiront par torturer au moins 27 000 individus et en tuer au moins 3 000, et qui avaient déjà pratiqué beaucoup de torture, exécuté sommairement, mis sur pied des camps de concentration, fait disparaître toute presse libre, et exercé une répression tellement impitoyable que de de milliers de Chiliens et Chiliennes cherchaient par tous les moyens possibles de fuir à l'étranger...
Les évêques estiment que le bilan positif du gouvernement de l'Unité populaire est fort mince, qu'il se résume au lien affectif profond que de vastes secteurs de la population ont avec lui. « Les réformes et les conquêtes en faveur du peuple », disent-ils, « ne se sont pas réalisés ».
Quant au bilan négatif de l'Unité populaire, il est énorme, et se résume en un mot « cauchemar », poursuivent les évêques : « état de décomposition du pays, installation de la démagogie, ingérence de politiciens étrangers (qu'on se rappelle la lettre de Fidel Castro, au président Allende, le 22 juillet 1973), violence sous toutes ses formes, appauvrissement brutal de la nation, et, par-dessus tout, marxisation du pays ».
Il est intéressant de noter que les évêques, tout en soulignant avec justesse l'intervention politique étrangère du dirigeant d'un petit pays - celui de Fidel Castro - ne mentionnent pas une seule fois dans leur document de 59 pages l'intervention politique étrangère pourtant la plus spectaculaire - celle des États-Unis. Une telle omission est d'autant plus étonnante que, grâce à la fuite en 1972 des documents secrets de l'International Telephone and Telegraph (ITT) par le journaliste d'enquête Jack Anderson, cette intervention américaine était connue à travers le monde entier.
Ces documents, qui ont longtemps circulé au Chili, montrent que la CIA collaborait avec l'ITT et certains militaires chiliens pour renverser Salvador Allende, et cela aussi tôt qu'au moment de sa victoire électorale en 1970. Cependant, ils montrent aussi que la CIA, consciente que la grande popularité post-électorale de l'Unité populaire pourrait empêcher la réussite du coup d'État, avait suggéré aux militaires chiliens de reporter ce coup. Mieux vaut, soulignait la CIA, bien préparer le terrain afin de garantir la réussite du coup.
Tout d'abord, suggérait la CIA, il faut s'acharner à dénigrer le plus possible l'image d'Allende, tant au Chili qu'à l'étranger. Comment ? En produisant des reportages le noircissant, d'une part dans les médias chiliens, et, d'autre part, dans les médias à l'étranger. Nous allons vous aider dans cette campagne médiatique, dit la CIA, à travers nos contacts dans les médias internationaux, et de plus, nous allons verser de l'argent au grand journal conservateur du Chili, El Mercurio, ainsi qu'à d'autres médias d'opposition, pour les aider à dénigrer Allende.
Ensuite, poursuit la CIA, nous devons mettre le plus de bâtons possibles dans les roues de l'économie chilienne. La déstabiliser carrément. Comment ? Nous, Etats-Unis, avons beaucoup de pouvoir auprès des institutions financières internationales. Nous allons utiliser ce pouvoir pour imposer un blocus financier du Chili dans toutes ces institutions.
Enfin, conclut la CIA selon ce que révèlent les documents secrets de l'ITT, il faut faire un dernier pas pour assurer le succès d'un coup d'état. L'image d'Allende étant fortement noirci, et l'économie étant déstabilisée par le blocus financier, il faut maintenant s'acharner à créer un climat de chaos, de désordre et d'insécurité. Comment ? Par des actions de sabotage, telles que le dynamitage de ponts, de pylônes électriques. Ou encore, mettre le feu à des stations d'essence, etc.
Une fois le terrain bien préparé, une fois que le peuple aura gouté assez longtemps à dégradation économique, pénurie, appauvrissement, violences et insécurités de toutes sortes, les militaires chiliens pourront intervenir pour renverser l'Unité populaire. Et ils seront alors accueillis comme des sauveurs et des héros libérateurs par de vastes secteurs de la population. Ils seront perçus comme ceux qui rétablissent ordre et sécurité, ceux qui mettent fin au cauchemar !
Pour comprendre la méticulosité scientifique et à long terme de la planification américaine contre l'Unité Populaire sous Salvador Allende, rien de mieux que de visionner l'impressionnant documentaire de 139 minutes,La Spírale, produit par Armand Mattelart en 1976.
La stratégie préconisée par la CIA dans les documents secrets de l'ITT, notamment accorder de l'aide financière américaine aux médias chiliens afin de noircir Allende et l'Unité populaire, n'est pas restée lettre morte. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le rapport COVERT ACTION IN CHILE 1963-1973 produit par la Commission sénatoriale américaine. Ce rapport affirme que le « Groupe des 40 » a donné 700 000 dollars américains au journal El Mercurio le 9 septembre 1971 et 965 000 dollars le 11 avril 1972. De plus, explique ce rapport, le Groupe des 40, qui travaillait sous l'autorité de Henry Kissinger, ne se limitait pas à accorder des sous aux médias chiliens. Il produisait parfois lui-même du contenu dans ceux-ci. Il exerçait, affirme le rapport, une influence substantielle sur le contenu même du Mercurio, « allant jusqu'à y placer des éditoriaux inspirés par la CIA, et ceci, à certains moments, presque quotidiennement ».
Ce que les évêques chiliens semblent ignorer encore trois mois après le coup d'état, Salvador Allende en était parfaitement conscient, et ce, depuis fort longtemps. Lors du discours historique qu'il prononçait une fois déclenchée l'intervention militaire le 11 septembre, un discours que j'écoutais en direct à la radio depuis mon appartement à Santiago et qui serait son dernier discours avant de trouver la mort, Allende affirmait :
« Le capital étranger, l'impérialisme, unis à la droite, ont créé le climat nécessaire pour que les forces armées rompent avec leur tradition ».
Dans leur document, les évêques chiliens, pour aider leurs confrères évêques à travers le monde à comprendre que la junte militaire chilienne n'a rien à voir avec le putschisme et le fascisme, se réfèrent à ce qu'ils appellent le « Plan Z ». Selon ce plan, que le journaliste Julio Arroyo Kuhn rendait public le 18 septembre 1973 dans le quotidien El Mercurio, le gouvernement Allende aurait planifié l'assassinat, le 19 septembre 1973 et jour de fête nationale des forces armées, de différents chefs des forces armées qui s'opposaient à l'Unité populaire. Allende, selon le plan Z, aurait invités des chefs militaires à déjeuner avec lui au Palais présidentiel La Moneda, où ils seraient abattus par des serveurs. Vingt-quatre heures seulement après l'assassinat, Allende annoncerait la création de la « République démocratique populaire du Chili ».
Ce fameux « Plan Z » était, de toute évidence, une création, avec l'aide de la CIA, de la junte militaire en vue de justifier auprès de la population le coup d'état qu'elle venait de faire une semaine plus tôt, et toute la répression barbare qui l'accompagnait. Une création qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, à cette autre invention de l'administration Bush en 2003 - Saddam Hussein possède une immense quantité d'armes de destruction massive et représente une grande menace pour le monde entier – qui servait de prétexte pour justifier l'invasion de l'Iraq.
D'une part, la Commission sénatoriale américaine, à laquelle nous venons de référer plus haut, affirme que les Etats-Unis non seulement accordaient des sous au quotidien El Mercurio, mais influençaient souvent, ou produisaient directement, le contenu de certains de ses articles. D'autre part, grâce à la déclassification des dossiers de la CIA, on sait, parce que cette dernière le reconnaît tel quel, que le Plan Z n'était rien d'autre qu'une guerre psychologique menée par les forces armées chiliennes pour justifier le coup et la persécution de l'Unité populaire.
Le Plan Z n'a pas seulement servi de prétexte pour justifier le coup d'état. Comme de nombreux militaires et policiers chiliens ont cru cette invention, des prisonniers ont été battus et torturés dans des centaines de casernes et de postes de police, dans le but de leur arracher des aveux au sujet du plan diabolique Z.
L'hypocrisie, ou plutôt la complicité profonde de l'Église catholique chilienne dans le coup d'état est criante. L'Église, affirment les évêques chiliens dans leur document de Noël 1973, imite le bon samaritain qui aime les gens qui souffrent et vient à leur aide, sans cependant « partir à la recherche » de ceux qui occasionnent leurs souffrances. Comment, et pourquoi, partir à la recherche de ceux qui, selon l'Église, représentent la réserve morale du peuple, ceux qui le libère du chaos socialiste ? Contentons-nous d'aider, en bon samaritain, les gens que les libérateurs torturent, les familles des papas assassines ou portés disparus, les gens qu'on enferme comme du bétail dans des camps de concentration !
Pour éliminer tout ce qui est progressiste, la junte brûlait dans la rue des tonnes de livre à tendance socialiste. Elle prenait aussi le contrôle de ce qui s'enseigne, notamment en nommant un militaire à la direction de toutes les universités. Dans le cas des universités catholiques, affirment les évêques dans leur document, la junte est cependant gracieuse et respecte l'autorité et l'indépendance de l'Église. Pour la remercier, et « illustrer la compréhension à laquelle il est possible d'arriver », poursuivent les évêques, le cardinal Henriquez décide de nommer à la direction de l'Université catholique du Chili, pourtant une institution pontificale, le militaire « délégué » par la junte. Autre hypocrisie consommée : l'Église nomme à la direction de l'université le militaire qu'a choisi la junte pour ce poste !
Un dernier point on ne peut plus troublant. Les militaires ont banni tous les partis progressistes, fermé le parlement, mis en pause l'activité des partis politiques de droite, écrasé toute pensée progressiste, voire même toute possibilité de penser. Or les évêques chiliens, au lieu de dénoncer une telle situation, perçoivent cela comme une bonne affaire pour les jeunes. Cela représente ce qu'ils appellent « une grande opportunité pour l'Église », ou « l'heure de Dieu pour les jeunes » ! Comme « les activités politiques sont en pause » et que les jeunes, qui représentaient sous l'Unité populaire le fer de lance de l'action politique, « sont confrontés à un vide d'action et de motivation », profitons-en pour « former les jeunes, les préparer pour l'avenir », affirment les évêques ! Leurs cerveaux étant, grâce à une répression barbare et massive, vides de pensées socialistes nocives, à nous de les remplir du bien, à restaurer chez eux l'identité judéo-chrétienne, cette « âme du Chili ». C'est cette dernière, que les militaires, qui se disent de bons catholiques et représentent « la réserve morale du peuple », ont restauré par leur intervention du 11septembre !
*************
Lettre à ma famille le 15 décembre 1973
Je vivais à Santiago, dans un pays où de vastes secteurs de la population étaient soumis à répression brutale, peur, angoisse, et méfiance, alors que d'autres secteurs, provenant d'une partie de la classe moyenne mais surtout de l'élite économique, célébraient leur victoire.
Comme tant d'autres personnes, ma conjointe Wynanne et moi avions déchiqueté en mille morceaux nos livres et revues progressistes, plaçant tout cela dans des sacs de poubelles, et transportant avec grande discrétion ces sacs dans la rue, de peur que des voisins pro-junte comprennent ce que nous faisions et nous dénoncent.
Certaines des lettres que nous recevions étaient déjà ouvertes, donc nous nous sentions espionnés.
Le gros de notre énergie était consacré à deux choses : faire connaître au monde extérieur les atrocités que nous témoignions dans ce Chili de censure totale ; et aider le plus possible Chiliens et Chiliennes traqués par les militaires à se réfugier dans une ambassade afin d'échapper à emprisonnement, torture, et, possiblement, assassinat.
La lettre que, rempli d'émotion, de révolte et d'ironie, j'écrivais à ma famille le 15 décembre 1973 était donc codée. Il fallait dire des choses, mais le faire en sachant que celles-ci seraient peut-être lues par des militaires.
Les « fraises » représentent les personnes traquées que nous aidions à se réfugier dans une ambassade.
Le « Père Noël qui se promène en traineau » représente la junte militaire, qui est consciente que plusieurs personnes sur leurs listes noires arrivent à échapper à la répression en entrant dans une ambassade et qui prennent des mesures pour mettre fin à cela.
La « pétition contre la pollution » représente une pétition, initiée par nos contacts au Québec, demandant au gouvernement canadien d'ouvrir ses portes aux réfugiés chiliens et de dénoncer le caractère brutal et répressif de la dictature chilienne. En affirmant que la pollution est si grave ici qu'elle cause des décès, je me réfère, bien sûr, aux tueries perpétrées par la junte. En affirmant que « la pollution affecte de plus en plus de pays en Amérique latine ces dernières années », je laisse entendre que les dictatures se multiplient en Amérique latine.
Lorsque je me réfère aux mensonges que répand la presse internationale, je reprends le discours de la droite, un discours qu'on entend dans les secteurs nantis de Santiago, et qu'on voit régulièrement dans la presse censurée du Chili. Selon ce discours, le sang, la torture, les exécutions sommaires, les camps de concentration, etc. ne seraient que de la propagande répandue par les communistes à travers le monde afin de noircir l'image de la junte militaire.
Comme ma famille me connaît, elle sait fort bien que j'ironise, et que je pense exactement le contraire.
Je doute que les évêques chiliens, s'ils avaient pu lire ma lettre, penseraient que j'ironisais. Car l'objectif du document qu'ils faisaient parvenir à leurs confrères évêques dans le monde était précisément de corriger la fausse image négative qu'on se fait de la junte à l'étranger, parfois même dans des milieux catholiques.
« Des milliers de travailleurs font librement don d'une partie de leur salaire, » j'écris dans ma lettre à ma famille. Ici encore une fois, je prends une position fort différente de celle des évêques. Dans leur document, il y a une partie, que je n'ai pas reproduite ci-haut, où les évêques, pour illustrer l'enthousiasme de la population par rapport au coup d'état, affirme que de nombreuses personnes accourent pour donner argent, bagues d'or, etc. à la junte militaire afin de l'aider à rebâtir le pays. En précisément dans ma lettre que le don « que font librement » les travailleurs « est simplement déduit de leur chèque », je souligne l'aspect obligatoire et non libre de ce don supposément libre ! Ce qu'affirment les évêques est vrai, mais ce qu'ils omettent de dire est également vrai. Cette dernière omission, comme le fait de ne pas mentionner dans leur document le bannissement de la plus grosse centrale syndicale du Chili, la CUT, illustrent le parti pris de l'Église pour la junte militaire.
Lorsque j'affirme que « plusieurs milliers de familles sont sans emploi à Santiago », je n'utilise aucun code. C'est exactement la situation qui se vit, et celle-ci est dramatique. En ajoutant que ce problème va bientôt disparaître, car « elles ne perçoivent plus aucun revenu », j'ironise de façon on ne peut plus mordante, en laissant entendre que les familles vont tout simplement mourir de faim.
Tous ces codes étant expliqués, voici ce que j'écrivais à ma famille de Windsor, Ontario le 15 décembre 1973. Le moins qu'on puisse dire, ma lettre présente une image fort différente du Chili que celle peinte par le document que les évêques chiliens, exactement au même moment, faisaient parvenir à leurs confrères évêques du monde entier.
Chère maman, cher papa et chère famille,
Wynanne et moi sommes tous les deux un peu épuisés par notre constante cueillette de fraises. Même s'il fait très froid au Canada, il fait très chaud ici. Croyez-le ou non, le Père Noël est habillé pour l'hiver et se promène sur un traîneau par une température d'environ 90 degrés Fahrenheit ! Et il aime aussi les fraises, alors il n'aime pas l'idée qu'on les lui enlève.
La mère de Wynanne nous envoie des nouvelles au moins deux fois par semaine. Merci beaucoup d'avoir signé la pétition contre la pollution de l'air. C'est certainement un des pires maux dans le monde présentement, et il semble que cette pollution affecte de plus en plus de pays en Amérique latine ces dernières années. Hier encore, quelqu'un m'a dit que la pollution de l'air était si grave ici qu'elle causait des décès.
Si vous avez suivi la presse internationale ces dernières semaines, vous avez pu constater que les journalistes continuent de répandre toutes sortes de mensonges sur le Chili. Ils affirment que plus de 15 000 personnes ont été exécutées au Chili depuis le 11 septembre. Ils affirment que les tueries se poursuivent. Un article a même affirmé qu'il y avait et qu'il y a encore des cas quotidiens de torture.
Quand on voit à quel point les gens semblent prendre plaisir à publier toutes ces rumeurs sensationnelles, on se demande où va ce monde... Ici, tout est calme. Bien sûr, nous sommes toujours en situation de guerre, - une situation qui devrait durer plusieurs mois - et nous avons un couvre-feu toutes les nuits de 23h à 5h30. Un coup de feu occasionnel ici et là, mais c'est tout. Les gens travaillent. Beaucoup font don de leurs bagues en or à la junte militaire en signe de reconnaissance. Les rues sont très propres. Il n'y a plus de grèves folles. Des milliers de travailleurs font librement don d'une partie de leur salaire... ce dernier don est simplement déduit de leur chèque ! La grande majorité de ces travailleurs gagnent aujourd'hui en un mois ce qu'un travailleur moyen au Canada gagne en une demi-journée environ - mais c'est normal ici : le Chili est un pays sous-développé.
Les journaux, les stations de radio et de télévision ne tarissent pas d'éloges sur la junte militaire. Avant le coup d'État, il était incroyable de voir les ordures que l'on pouvait trouver dans les médias ! Aujourd'hui, les nouvelles sont courtes, joyeuses et objectives. On a envie de revivre ! Les médias nous informent que la Russie persécute toujours ses intellectuels. Quand on pense que sans l'armée chilienne et les Etats-Unis, le Chili serait peut-être encore en train de se diriger vers le socialisme !
Il y a encore plusieurs milliers de familles sans emploi à Santiago. Mais ce problème devrait être réglé sous peu : elles ne perçoivent plus aucun revenu...
Demain, Wynanne et moi allons escalader une belle montagne, située en plein cœur de Santiago. Cela devrait nous faire oublier les fraises ! Alors que vous célébrez Noël le 25...
Try to remember.... (Ma lettre fut rédigée en anglais, car les conjoints et conjointes de mes frères et sœurs sont anglophones, et ne me comprendraient pas si j'écrivais en français)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mandela, « le Rouge » effacé ?

La mémoire collective a ses ciseaux affûtés, et dans le cas de Nelson Mandela, le marxisme a été discrètement jeté dans la corbeille. La figure reconnue du « père » de la nation arc-en-ciel, chuchotant la réconciliation et prônant la paix, cache une histoire plus radicale, profondément ancrée dans les luttes anticolonialistes et la pensée révolutionnaire.
7 décembre 2024 | Billet de blog | Photo : Le président sud-africain Nelson Mandela danse lors du congrès annuel du Parti communiste sud-africain, le 7 avril 1995. © Juda Ngwenya
https://blogs.mediapart.fr/basilegiraud/blog/071224/mandela-le-rouge-efface
L'ANC : La lutte oubliée
Le Congrès national africain (ANC), auquel Mandela adhère en 1943, n'a pas toujours été ce temple de la démocratie libérale qu'on imagine aujourd'hui. Dans les années 1950 et 1960, il s'agit d'un mouvement influencé par des idéologies marxistes et des alliances stratégiques avec des partis communistes.
La Charte de la liberté (1955), document fondateur du mouvement, prône une redistribution des terres et la nationalisation des mines, un discours ouvertement socialiste.
Mandela lui-même reconnaît avoir été séduit par les idées marxistes. Dans son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, il confesse : "Le communisme promettait un paradis terrestre pour les pauvres et les opprimés." À ses débuts dans l'ANC, Mandela fréquentait les cercles communistes sud-africains, où Blancs et Noirs débattaient d'égal à égal.
Une révolution en soi dans un pays ravagé par l'apartheid.
C'est avec la création de l'aile militaire de l'ANC, Umkhonto we Sizwe (La Lance de la Nation), en 1961, que Mandela passe de la théorie à l'action, inspirée par les tactiques révolutionnaires communistes.
Mais une telle guerre exigeait des alliés puissants. C'est dans le bloc communiste que Mandela trouva un soutien crucial. L'Union soviétique joue alors un rôle clé en fournissant une aide militaire et logistique à l'ANC. Dès 1962, les premiers combattants de MK sont envoyés à Moscou pour suivre une formation militaire et idéologique.
Joe Modise, futur commandant de MK, a décrit ces entraînements comme une initiation à la tactique militaire et à la guerre révolutionnaire, mais aussi à une vision marxiste de la société. Selon des archives soviétiques, le Kremlin a consacré près de 100 millions de dollars entre 1963 et 1988 à soutenir l'ANC et son allié idéologique, le Parti communiste sud-africain (SACP).
La Chine, de son côté, offre également une assistance militaire dès les années 1960. Bien que les tensions sino-soviétiques aient limité une coopération tripartite, Pékin forma des cadres de l'ANC et fournit des armes légères aux premiers combattants de Mandela. Cuba, en revanche, incarne l'engagement le plus visible du bloc communiste en Afrique. Sous Fidel Castro, La Havane devient un point d'appui stratégique pour les mouvements anti-impérialistes africains, y compris l'ANC.
Lors de la célèbre bataille de Cuito Cuanavale en Angola (1987-1988), des troupes cubaines affrontent directement l'armée sud-africaine, affaiblissant ainsi la domination régionale de Pretoria. Mandela, libéré deux ans plus tard, qualifiera cette bataille de "tournant décisif dans la lutte contre l'apartheid".
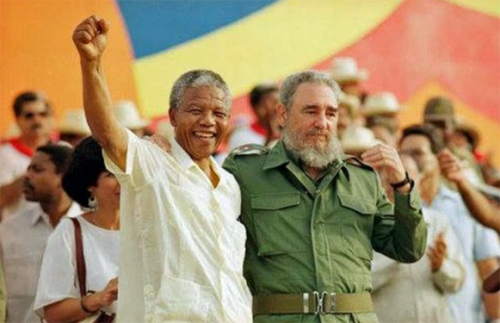
Nelson Mandela rend visite à Fidel Castro. La Havane, 1991
Mandela et le Parti communiste sud-africain
Pendant des années, Mandela a nié son appartenance officielle au Parti communiste sud-africain (SACP). Pourtant, en 2012, des documents historiques révélèrent que Mandela siégeait bel et bien au comité central du SACP dans les années 1960.
Ces révélations sont venues contredire la version officielle soigneusement polie : Mandela, le libéral dévoué à la démocratie, était également un révolutionnaire qui voyait dans le communisme un outil pour l'émancipation des opprimés.
Mais il n'y avait pas de contradiction dans cette appartenance, explique Ronnie Kasrils, ancien ministre et membre du SACP : "Mandela voyait dans le marxisme une méthode pour analyser les structures d'oppression économique et sociale."
Le discours de Mandela lors de son procès de Rivonia en 1964 témoigne d'ailleurs d'une analyse marxiste de la société sud-africaine : "L'apartheid et le capitalisme sont les deux faces d'une même pièce.". Un constat qui, dans une autre vie, aurait pu lui valoir une statue à Moscou plutôt qu'à Washington.
Une mémoire aseptisée
Pourquoi, alors, cette facette de Mandela a-t-elle été effacée de l'hagiographie du "nouvel ordre mondiale" ? La réponse réside dans les besoins narratifs des puissances occidentales.
À sa libération en 1990, Nelson Mandela devient une icône mondiale, une figure consensuelle nécessaire pour incarner la transition pacifique. Les États-Unis et le Royaume-Uni, qui l'avaient classé comme terroriste jusque dans les années 1980, participent à la réhabilitation d'un Mandela "acceptable".
Dans ce cadre, ses liens avec le communisme deviennent gênants. Le "Mandela rouge" disparaît sous une avalanche de photos où il serre les mains des présidents américains et britanniques.
La réconciliation, mantra de la Rainbow Nation, était un récit plus commercialisable qu'une révolution prolétarienne.
Aujourd'hui, les discussions sur Mandela omettent souvent ses critiques du capitalisme. La Commission Vérité et Réconciliation, certes essentielle, a échoué à redistribuer les richesses économiques aux Noirs sud-africains, laissant un pays où les inégalités restent criantes. Mandela lui-même le regrettait : "Nous avons vaincu l'apartheid politique, mais pas l'apartheid économique."
Si Mandela est désormais une icône mondiale, c'est au prix d'une simplification de son message.
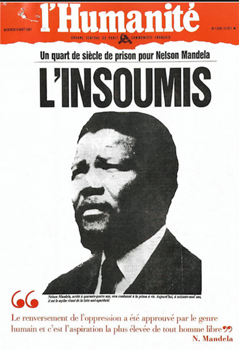
L'Humanité, 1987. © L'Humanité
Loin de la figure lisse qui orne les manuels scolaires, il était un stratège pragmatique, capable de s'allier aux communistes tout en tendant la main à ses ennemis.
Alors que des statues, avenues, places se dressent en son hommage dans les villes du “monde libre”, il reste à savoir si l'histoire rendra justice à l'homme complexe et révolutionnaire qu'il fut.
Car, pour citer Mandela lui-même : "Être libre, ce n'est pas seulement briser ses chaînes, mais vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres." Une maxime qui, sans le marxisme, perd peut-être de sa profondeur.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Guérilla des Farc » de Pierre Carles : l’avenir a une histoire

Dix ans durant, le cinéaste s'est rendu régulièrement en Colombie. Il offre un contre-récit de l'histoire de la rébellion et interroge l'avenir du mouvement qui a abandonné la lutte armée.
Tiré de l'Humanité
https://www.humanite.fr/culture-et-savoir/cinema/guerilla-des-farc-de-pierre-carles-lavenir-a-une-histoire
Publié le 11 décembre 2024
Michaël Mélinard
On a connu Pierre Carles pourfendeur des médias dominants, poil à gratter d'un système, aux méthodes parfois contestées. Avec « Guérilla des Farc, l'avenir a une histoire », il s'essaie à un journal documentaire, intime et engagé. Intime d'abord, car il s'adresse en voix off à son beau-père, Duni Kuzmanich, un cinéaste colombien disparu en 2008. Ce dernier a été le premier à réaliser un film sur la guérilla sans la dénigrer. Engagé aussi, car il recueille la parole de membres de Farc entre 2012 et 2022 tout en rendant hommage à deux cinéastes militants français, Bruno Muel et Jean-Pierre Sergent, venus tourner dans les années 1960 un documentaire surces guérilleros et guérilleras communistes.
Envisager une poursuite pacifique de la lutte
Sa forme hybride alterne des entretiens avec les Farc, dont celui avec la Française Natalie Mistral, et des extraits de « Canaguaro », l'œuvre de Kuzmanich relatant l'assassinat en 1948 de Jorge Eliecer Gaitan, un homme politique de gauche favori à l'élection présidentielle de l'année suivante, ainsi que la rébellion qui a suivi. S'y ajoutent également des images des négociations pour un processus de paix. Car en 2015 et 2016 se profile un accord avec le gouvernement colombien, entérinant le désarmement et le retour à la vie civile des rebelles.
C'est à la fois la possibilité de regarder vers l'avenir et d'envisager une poursuite pacifique de la lutte pour davantage de justice sociale. C'est aussi l'occasion de dresser un bilan sur leur combat. Là, le cinéaste redevient le critique des médias dominants en transposant sa grille d'analyse à la Colombie. La question de la représentation des Farc et de l'accusation de narcoterrorisme reprise en boucle pendant des décennies par les médias a en partie noyé leur message et terni la légitimité de leur lutte. Pierre Carles tente de remettre les pendules à l'heure. À la sienne en tout cas. En proposant un contre-discours qui fait des Farc des combattants contre l'oligarchie et la prédation des richesses.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Vingt Dieux » de Louise Courvoisier

Divine surprise du dernier Festival de Cannes, « Vingt Dieux », au titre malicieux, suscite d'entrée de jeu l'étonnement et l'admiration. Pour son premier long métrage, Sélection ‘Une Certain Regard' et Prix de la Jeunesse, Cannes 2024 entre autres récompenses, Louise Courvoisier nous offre un épatant ‘western agricole', tourné en Scope et aux couleurs, lumineuses et estivales, du Jura, sa terre natale.
Par Samra Bonvoisin, Le Café pédagogique, Paris, 11 décembre 2024
Pour visionner la bande-annonce.
Avec son coscénariste Théo Abadie ( et camarade de promotion de la Cinéfabrique de Lyon comme d'autres collaborateurs du film ) la jeune femme, déjà lauréate de la Cinéfondation cannoise en 2018 après son court-métrage, imagine le roman d'apprentissage, à la fois rugueux, fougueux et burlesque, de Totone, 18 ans, glandeur et fanfaron, vivant à la ferme paternelle avec sa petite sœur.
Un drôle de zigue, partageant son temps, avec deux potes branquignoles, entre bals alcoolisés, nuits d'ivresse et réveils ahuris aux côtés d'une fille séduite et mal étreinte.
Jusqu'à la mort de son père dans un accident de voiture. Une fois l'exploitation agricole et les vaches vendues, comment assurer l'avenir de sa petite sœur et gagner sa vie, alors qu'il croit n'avoir rien appris et se sent si démuni ?
Vingt Dieux, pour reprendre le juron favori de sa bande de pieds nickelés, loin de nous plonger dans le désespoir, Louise Courvoisier nous embarque alors dans l'aventure initiatique, mouvementée, bondissante et libertaire, d'un garçon du Jura saisi par une énergie désordonnée et tenace. Une histoire singulière, ancrée dans un territoire rural, rarement célébré ainsi à l'écran, où savoir-faire, savoir-être et désir d'aimer se conjuguent, au rythme changeant de compositions chorales entraînantes. Impossible de résister à l'épopée jurassienne et au charme déroutant de Totone (Clément Favereau, formidable).
*Un cowboy inattendu au pays des vaches laitières et du comté*
Nous voici plongés au cœur d'une fête de village dans le sillage d'un garçon aux cheveux roux, filmé de dos (peau blanche, épaules robustes, cou costaud) ; la caméra le suit à vive allure car le sujet fend la foule pour s'arrêter devant un petit groupe. Pressé par ses supporters improvisés et leurs cris répétés.Debout sur unetable, il se montre tout nu, sans paraître gêné, levant les bras en l'air en signe de triomphe, esquissant même quelques pas cadencés suscités par des incitations bruyantes (‘La danse du Limousin !, ‘La danse du limousin' !). Voici Tony (surnommé Totone), visiblement habitué à faire le malin pour amuser la galerie, ses potes en débrouille et embrouilles Jean-Yves (Mathieu Bernard, très bien) et Francis (Dimitri Baudry, aussi crédible) en particulier.
A la maison, il en mène moins large et semble se la couler douce, tandis que le père conduit l'exploitation agricole et que la petite sœur (Luna Garret, délicieusement vraie) va à l'école. À Totone et ses potes, les bals où l'on boit de la bière jusqu'à plus soif et emballe des filles pour une nuit sans trop savoir quoi faire en tant que mecs en cas de panne du sexe. Une expérience embarrassante pour Totone et minimisée par la partenaire d'un soir prête à excuser ce machisme inconséquent !
La mort du père fait cependant basculer l'existence de notre garçon insouciant. Il lui faut maintenant, et vite, assurer sa subsistance, protéger sa petite sœur et trouver un toit.
Ouvrier agricole, louant sa force de travail auprès des fermiers du coin, il se distingue par sa gaucherie, ses retards et son manque de pratique.
Qu'à cela ne tienne. Pourquoi ne pas se spécialiser dans la fabrication du comté et gagner ainsi, en deux tours de main, les 30.000 € destinés au vainqueur du concours agricole dans ce domaine ?
*Artisanat et transmission, sexe et amour : des chemins rocambolesques*
Pas si simple de remporter un concours dont on ignore les règles et les exigences préalables. Mais Totone s'accroche, se renseigne auprès des autorités, approche surtout une des grandes spécialistes en la matière, laquelle accepte de lui transmettre ingrédients nécessaires, pratiques particulières (notamment pour la fabrication ‘au chaudron'). Et nous saisissons, émus, l'importance de cette formation par une ‘ancienne' auprès d'un jeune renouant ainsi avec une tradition paternelle (que la relation père-fils figurée au début du récit ne laisse pas imaginer).Ce serait faire injure aux spectateurs que de révéler le dénouement de cette ambitieuse entreprise.
En tout cas, Totone n'ayant pas de domaine agricole ni de lait nécessaire à la fabrication du comté à sa disposition, met à contribution ses deux potes pour en ‘trouver' du bon sans débourser un euro…
Fort opportunément (le hasard est parfois grand artiste), il rencontre Marie-Lise (Maïwen Barthelemy, époustouflante interprète), une femmefranche, directe et solide, dirigeant seule une exploitation laitière d'envergure. Ou, entre venue au monde d'un petit veau et naissance de l'amour, comment une jeune femme qui sait ce qu'elle veut et un garçon qui ne le sait pas encore réunissent leurs efforts et leurs désirs pour aider à l'accomplissement des deux événements en même temps, la nuit, dans une étable au milieu du foin.
A ce titre, balayant les clichés et autres niaiseries sur la vie à la campagne, la cinéaste confère aux femmes un rôle majeur dans le parcours initiatique d'un garçon devenu curieux de tout, englué dans l'ignorance par paresse et habitude. A la fromagère âgée, la transmission de savoir-faire artisanaux, à la dirigeante d'exploitation laitière, la transmission des caresses et des gestes de tendresseaptes à susciter le plaisir féminin avec (ou sans) pénétration du sexe masculin. Autant dire que notre Totone n'en finit pas d'être surpris.
*Invention d'un western rural d'un nouveau genre, libre et galvanisant*
Au-delà des trahisons, coups fourrés et autres bastons entre bandes (les branquignoles associés à Totone ont pour ennemis jurés les propres frères de Marie-Lise), des rebondissements qui alimentent joyeusement l'épopée jurassienne, la fiction frappe par le traitement des paysages, leurs couleurs chaudes sous la lumière d'été, en plans larges le plus souvent, en magnifie la beauté particulière. Et, comme si nous retrouvions l'univers singulier des premiers films tels que « L'Enfance nue » ou « Passe ton bac d'abord » de Maurice Pialat (dans l'après-coup des auteurs de la Nouvelle Vague), l'irruption de corps différents, des grains de voix et des accents autres, un phrasé tranché et un langage parfois cru et direct nous touchent profondément. Un surgissement d'une vérité des êtres, de leurs origines géographiques et sociales, loin du formatage citadin commun à de nombreux personnages du cinéma, français d'aujourd'hui, notamment.
Libre dans le choix de son sujet comme dans l'élaboration d'un casting minutieux (des acteurs non-professionnels, tous cultivateurs, tous confondants de justesse), Louise Courvoisier a constitué un collectif de techniciens, amis connus à l'école de cinéma ou membres de sa famille, ses parents Linda et Charlie Courvoisier au premier chef. Anciens musiciens, convertis à l'exploitation céréalière dans le Jura, ce sont eux qui ont conçu les compositions musicales emballantes accompagnées de chants qu'on croirait sorties des chevauchées de cow-boys traversant Monument Valley à la poursuite des Indiens dans les westerns hollywoodiens. Des morceaux de musique version rodéos drôlement en phase avec les virées en mobylette des Pieds Nickelés jurassiens ou les concours de tonneaux entre voitures cabossées lancées à toute berzingue.
Quelles que soient les influences et les figures tutélaires (Jean-François Stévenin et la poésie vagabonde et nomade des héros décalés de « Passe montagne », tournage jurassien dans un registre différent, par exemple), la jeune réalisatrice prend la liberté d'emprunter des chemins de traverse sans s'interdire aucune voie. Avec des exigences manifestes : respecter les êtres et les paysages qu'elle filme en pulvérisant stéréotypes et images convenues.
Le western jurassien et ses longs plans-séquences à la mesure des grands espaces cadrés comme des territoires à conquérir entrent en résonance avec le parcours tragi-comiquedu héros de « Vingt Dieux ».Aussi Louise Courvoisier n'oublie pas de jouer sur la dimension burlesque, de capter les corps en déséquilibre, leurs chutes soudaines.
Elle figure aussi en se rapprochant des visages les élans du cœur et les flux de tendresse, signes d'une mutation profonde chez un êtreen devenir, longtemps dans l'ignorance qu'il était de lui-même.
Devant un spectacle de carambolages automobiles, Totone, de la main, fait signe à sa petite sœur de rejoindre le coin où paradent les vainqueurs. A l'écran, elle accède pour la première fois peut-être, au gros plan et en devenant plus active, grandit en un plan.
Le garçon, pour sa part, suit un temps des yeux l'envol de cette dernière. « Ving Dieux » nous offre encore une promesse et son héros, songeur, nous regarde.
Samra Bonvoisin, Le Café pédagogique, 11 décembre 2024
« Vingt Dieux », film de Louise Courvoisier. Sortie le 11 décembre 2024 ( en France )
Prix de la Jeunesse, sélection « Un Certain Regard », Cannes ; Valois de Diamant & Valois des étudiants, Festival international du film francophone, Angoulême ; Prix Jean Vigo 2024.
*Entrevue* avec la réalisatrice sur TV5 : https://www.youtube.com/watch?v=-lp2P_Eo_S8
*Une suggestion de André Cloutier, Montréal, 11 décembre 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le prix Nobel de littérature décerné à la Sud-Coréenne Han Kang

Le jury de Stockholm a récompensé l'écrivaine Han Kang capable d'entremêler la candeur de ses héroïnes et la cruauté brute de l'histoire.
Par Axel Nodinot, L'Humanité, France, le mercredi 11 décembre 2024
Suggestion de lecture d'André Cloutier
La lauréate du prix Nobel de littérature était mélancolique. Elle revenait sur son parcours devant une assemblée qui acclamait la première <https:/www.humanite.fr/culture-et-...>'>Sud-Coréenne à être ainsi célébrée, la 18e femme seulement en 117 éditions. Pas dépaysée par le froid suédois, la Séoulite a cependant échappé à la neige.
Omniprésents dans ses ouvrages, les flocons recouvrent tout. Le bruit, pour laisser place à la contemplation ou à l'angoisse ; les souvenirs, enfouis au plus profond des personnages ; les cadavres, ceux des dictatures militaires sud-coréennes.
« Inévitablement, le travail de lecture et d'écriture de littérature s'oppose à tout ce qui détruit la vie », a-t-elle déclaré en recevant son prix, ce mercredi 11 décembre à Stockholm. Au fil de son œuvre, Han Kang a pourtant réussi à déterrer, délicatement et avec poésie, des atrocités qu'aucune formule ne saurait égayer. S'entremêlent alors la candeur de ses héroïnes et la cruauté brute de l'histoire : sous la neige, les ruines brûlées, la terre gelée, et les ossements révèlent autant d'histoires dramatiques.
« Pendant ma vingtaine, j'écrivais ces lignes sur la première page de chaque nouveau journal intime : Le présent peut-il aider le passé ? Les vivants peuvent-ils sauver les morts ? », se rappelait-elle à Stockholm. L'écrivaine continue de chercher ses réponses, en se plaçant de front, face à la société et l'histoire sud-coréennes, toutes deux très dures.
Comme dans « La Végétarienne », Booker Prize en 2016, « Celui qui revient », où elle évoque les étudiants assassinés de Gwangju, sa ville natale, et « Impossibles Adieux », qui se déroule sur l'île de Jeju, où 30 000 personnes accusées d'être communistes furent massacrées par l'armée et le commandement américain.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Cherche sourire désespérément

( Coup de sifflet…)
– Sourd (e) comme un pot !
- Qui ? moi ?
- Oui, vous !
- Mes excuses, M. l'Agent.
- Vous connaissez le verbe verbaliser ?
- Bien sûr que j'connais. Il a comme épouse l'Absolution.
- Non, M. le Gouailleur ! Il a divorcé.
- Ah, bon ?
- Sa moitié s'appelle Fermeté.
- Il doit en baver, le mec ?
- Puisque vous avez le sens de la mise en boite, je vais vous faire un joli cadeau.
– C'est vrai ? - Une amende de fin d'année.
- Ca..mé..ra.. ca..chée ?
- Elle a gagné un procès et s'est émancipée.
- Comme quoi… Tout l'monde réclame un air de Liberté.
- Contravention de 3ème classe, ça vous parle ?
- J'en ai entendu parler.
- Eh bien, vous allez vous y familiariser.
- Il parait que ça fait très mal pour ceux qui vérifient deux fois leurs tickets de caisse ?
- Tout va être dématérialiser. Ils (elles) ne verront que dalle.
- C'est bien de noyer le Peuple par petites touches et des majorations « intersticées ».
- 68 euros ! C'est le montant de l'infraction, bien affichée.
- Quelle infraction ? Je viens d'arriver du bled pour une visite familiale. L'huile d'olive (Zit Azemmour) et couscous roulé à la main, peuvent en témoigner.
- Visite ou pas visite…
( La négociation est vouée à l'échec )
- J'peux savoir pour quel motif une telle « prune » ?
– On vous a flashé en train de rigoler, Monsieur !
- Et alors ?
- Alors, N.D.P (Nouvelles Dispositions Particulières) :
Article 1 : – Rire en Hexagone est passible d'une amende ! Article 2 : - S'esclaffer, d'un emprisonnement !
- Je rêve ou quoi ?
- Il ne fait pas encore nuit. Vous êtes en France Monsieur. La Législation évolue !
– Elle doit s'emm… derrière son bureau ?
- Qu'est-ce que vous dites ?
- J'ai dit, ça sent un peu la me'… à cause de la décharge sauvage juste devant nous.
- On ne rigole plus ! Regardez autour de vous toutes ces tronches tirées comme la membrane d'un Bendir* dont vous connaissez si bien l'usage ! Vous enfreignez la morosité ambiante parisienne.
- Attendez…
- Je n'attends rien. Vous troublez l'ordre du renfrognement et de la maussaderie faciale des Français (es).
- Monsieur l'Agent ! il y aurait les J.O des Gueules massacrantes, la France s'offrirait l'or, les doigts dans le nez.
- Vous connaissez zonzon ?
- Chez nous on l'appelle Bouhadma*. Je vous assure qu'on y rigole. Pour vous dire que nous sommes un peuple qui se boyaute de sa propre déveine, même derrière les barreaux. Et ça, ça vous turlupine !
- Donnez-moi votre pièce d'identité !
- Monsieur l'Agent, je suis Méditerranéen. Rire fait partie de mon ADN. Si l'affliction vous sied à merveille, de grâce ! ne m'ôtez pas mon deuxième Soleil !
- Vous êtes têtu (e) comme une bourrique, vous ! On vous a aligné (e), parce qu'il est formellement interdit de se fendre la pêche. Point barre !
( Le visiteur se tient la tête à deux mains et balbutie)
- Surréaliste.
- Ici c'est l'Autorité ! Pas le mouvement Dada* !
– « Adada sur mon poney, quand il trotte, il fait oplé, opla, au galop, au galop… ! Aaah, vous venez de pouffer de rire M. l'Agent ! Contravention de 4ème classe,135 euros ! Ça vous parle ? »
(L'Agent n'en peut plus et s'avoue vaincu)
– Reprenez votre Pièce d'Identité et éclipsez-vous ! Vous êtes irrécupérable !
- Avec tout le respect que je vous dois, M. l'Agent, moi je dis le début, et vous la fin : « One two, tree, viva… ? »
– Partez, j'vous dis !
( Le jeune Nationaliste s'éloigne et lui crie ) :
– L'Algérieeee !
Texte et dessin : Omar HADDADOU 2024
Bendir* : Instrument de percussion. Bouhadmama* : La taule, prison (Substantif dérivé du verbe arabe « yahdem », il enfonce, engouffre ) Mouvement Dada* : Courant intellectuel, littéraire et artistique du XXe siècle.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Journée mondiale de lutte contre le Sida
Lors de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, célébrée le 1er décembre 2024 à l'hôtel Montana, les revendications des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ont occupé une place centrale. Le Comité national de plaidoyer des populations clés en Haïti (CNPPCH) incluant d'autres concernés ont mis l'accent sur des appels urgents, brandissant des pancartes aux messages percutants tels que « Nou bezwen sekirite », « Batay kont VIH/Sida pap kanpe », « Fok wout yo debloke », et « Nou bezwen èd pou PVVIH ki viktim vyolans ».

Edouard Dieufait, président de la FEDHAP+ (fédération Haïtienne des associations de PVVIH), a rappelé que le VIH ne se réduit pas à une problématique de santé publique, mais est avant tout une question de droits humains. Il a insisté sur la nécessité de politiques publiques inclusives, rappelant aux décideurs politiques l'urgence d'adopter des mesures favorisant l'inclusion sociale et la pleine participation des PVVIH à la vie de la société. Il a remis un document de plaidoyer au MSPP, demandant au gouvernement de prendre en compte ces revendications dans ses priorités.

Pour sa part, Jhonny Lafleur, président du CNPPCH (Comité national de plaidoyer des populations clés en Haïti), a affirmé que les PVVIH, au-delà de leur statut sérologique, sont des citoyens à part entière, avec les mêmes droits et dignité que tous. Il a lancé un appel à l'unité et à l'engagement de tous les secteurs de la société, soulignant que la lutte contre le VIH est une cause commune qui nécessite la mobilisation de tous pour garantir un avenir sans discrimination ni stigmatisation.
Ces revendications ont exprimé la nécessité impérieuse de garantir la sécurité des PVVIH, de poursuivre la lutte contre le VIH, et de répondre aux besoins d'assistance pour les victimes de violences. Les manifestants ont exigé une action immédiate pour lever les obstacles qui entravent l'accès à des soins de santé, à un emploi et à des conditions de vie dignes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Ce que nous apprend l’échec de Google à Toronto. Compte-rendu de lecture

En 2016 Google voulait inventer sa Google City à Toronto. Moins de quatre ans plus tard, l'affaire était réglée, Sidewalk sa filiale d'innovations urbaines, abandonnait Toronto à son sort et disparaissait même deux ans plus tard comme compagnie. Compte-rendu de lecture de Josh O'Kane, Sideways : the city Google couldn't buy. Penguin, Random House of Canada, 2024.
Tiré du blogue de l'auteur.
Une météorite avait traversé le ciel des smart cities. Au début, en 2016, Google voulait inventer Google City à Toronto. Moins de quatre ans plus tard, l'affaire était réglée, Sidewalk sa filiale d'innovations urbaines, abandonnait Toronto à son sort et disparaissait même deux ans plus tard comme compagnie.
Pourtant, tout le monde avait fantasmé sur la nouvelle disruption dont Google était à nouveau capable. Et aujourd'hui, Josh O'Kane nous en raconte l'histoire par le menu, celui du journaliste local qu'il est, particulièrement impliqué et tenace dans la recherche des informations lorsque la transparence s'évanouit dans les brumes du lac Ontario.
A vrai dire, nous ne saurons pas grand-chose des détails techniques des prodigieuses innovations annoncées dans le fameux Yellow Book de Sidewalks Labs et dans la réponse à l'appel d'offres, ce n'est pas le centre d'intérêt de O'Kane.
C'est dommage, mais étant donné que la « Google City » n'a pas été mise en œuvre du tout, on peut comprendre que les questions techniques réduites aux dessins et aux promesses donnent peu de prises aux analyses. On trouvera un plus grand intérêt pour ces « solutions » techniques chez Tierney (2019), dans une lignée critique assez classique inspirée de Foucault, Lefebvre ou encore Bratton (The Stack) mais finalement assez sommaire. De même, dans ce livre Sideways, manque une discussion détaillée du modèle économique de Google fondé sur la donnée et sa monétisation, même si la question des données est traitée tout au long du récit et que les questions budgétaires deviendront de plus en plus critiques dans le projet.
On l'aura compris, ce travail de journaliste n'est pas aligné avec les standards des travaux académiques : on y perd mais on y gagne aussi la finesse des descriptions de situations, des personnages et un sens détaillé des enjeux politiques. Et c'est là sans doute ce qui manque souvent : une véritable étude de cas centrée sur le terrain, ses acteurs et leurs logiques, analogue à ce qu'on peut trouver chez Laugaa, Pinson et Smith (2024) dans le cas de Bristol, qui est un contre-exemple remarquable des smart cities centralisées.
Car l'enjeu politique est précisément ce qui reste délibérément négligé par les prophètes de la smart city et tous les libertariens qui accompagnent toutes les innovations urbaines (de AirBnB à Uber). Toute l'histoire qui nous est racontée est en fait ce choc des cultures entre datascientists disrupteurs de la plus grande plateforme numérique au monde et urbanistes d'une agence de développement locale dépendant de plusieurs strates politiques, la ville, la province et l'Etat fédéral.
À la fin de l'ouvrage, l'auteur cite Siri Agrell, un assistant du maire de Toronto, John Tory : « Les gens pensent (à la suite de cet échec) que le gouvernement n'est pas prêt à traiter avec la technologie. Alors que je pense que c'est exactement l'inverse : le secteur de la tech n'a aucune idée de la façon d'affronter les vrais défis des villes ».
Mais adoptons succinctement la démarche chronologique de l'auteur. Deux histoires et enjeux d'acteurs éloignés vont se rencontrer.
Le choc des cultures : aménageur versus disrupteur
L'agence d'aménagement Waterfront Toronto doit urbaniser le secteur du port de Toronto nommé Quayside, une zone plus directement urbaine de 5 hectares situé le long du lac et proche d'une autre très grande zone à aménager dans le futur : Port Lands et l'ile de Villiers.
La ville de Toronto est très attractive notamment pour les entreprises du numérique et sa population croit rapidement (3M d'habitants en 2016), le prix du m2 se rapproche de ceux de New York City et de San Francisco. Mais à part l'équipement de toute la zone en haut débit, rien n'est vraiment prévu, une vision manque lorsqu'un nouveau CEO, Will Fleissig, est nommé début 2016.
Avec ses adjoints, ils prennent contact directement avec Sidewalk dont ils ont entendu parler, le 27 juin 2016. Ils sont en effet à la recherche d'idées mais aussi de soutiens financiers et commencent à travailler à un appel d'offres (RFP, Request for Proposals) qui sera publié finalement le17 Mars 2017, après des mois de contacts et de réunions avec plusieurs candidats, dont Sidewalk Labs.
Sidewalk Labs de son côté est une spin-off de Google, qui rassemble toutes les idées urbaines que les ingénieurs de Google avaient lancées au sein du projet Javelin (dont des voitures volantes, des villes flottantes, un dôme, des véhicules autonomes). Ce projet initie le mouvement de réorganisation de Google en plusieurs sociétés sous l'ombrelle de Alphabet, créé en 2015, qui permet de propulser des projets indépendamment du métier de base de Google qu'est le moteur de recherche et la publicité.
Larry Page, l'un des deux fondateurs de Google avec Serguei Brin, est très investi dans ces projets qu'ils laissent explorer et prospérer dans un esprit très utopique et sans souci de rentabilité immédiate. Sidewalk Labs va être prise en main par Daniel Doctoroff, personnage central de l'histoire, en raison de sa personnalité (forte et parfois abusivement colérique admet-on) et de sa trajectoire : en tant qu'investisseurs immobilier, il a été au cœur de la candidature de NYC pour les Jeux Olympiques de 2012, il fut l'adjoint au maire Bloomberg avant de travailler dans son entreprise en 2007 (il connait donc très bien les enjeux financiers et les données).
Sa philosophie, résume l'auteur, consiste à maximiser la ville pour les actionnaires, ce qu'il fera par excellence en recyclant le projet perdant d'un stade pour les Jeux en projet immobilier d'envergure connu comme les Hudson Heights à NYC. En tant que directeur de Sidewalk Labs, il lance des groupes de travail avec tous les experts de la ville et du numérique (dont Richard Florida). Sidewalk lance son logiciel de gestion de parkings « Flow » et met en compétition les villes qui veulent le tester (Colombus, Ohio, gagne).
L'entreprise crée aussi à New York City « LinkNYC », des kiosques wifi répartis dans la ville. Tous ces services sont guidés par un principe : récupérer un maximum de données et les revendre, dans la logique du « digital surplus » de Soshan Zuboff, et comme le font toutes les plateformes du secteur.
Cette vision est publiée en Février 2016 sous la forme d'un Yellow Book de 437 pages, où la ville devient en fait une plateforme numérique qui comble le fossé ville/tech. Le dôme est le principe technique suprême qui encapsule toute la ville, un peu à la mode d'EPCOT de Disney avant qu'il ne soit réduit à un parc à thème en 1982. Le dôme est physique et régule tout le climat, ce qu'on retrouve dans quantité d'œuvres de science-fiction et chez Richard Buckminster Fuller.
Mais chez Sidewalk Labs, il devient aussi réglementaire et politique : toutes les règles extérieures sont suspendues et seule l'autorité propriétaire du dôme et du système d'information a le pouvoir de décider les règles qui lui conviennent notamment en matière de données personnelles. Page voulait une ville à partir de zéro et notamment une ville modulaire, toute en éléments recombinables, Doctoroff avait l'expérience des procédures et de la profitabilité.
Leurs visions se combinent dans un Yellow Book qui redéfinit toute la ville comme « fief » dit O'Kane, totalement confié au secteur privé, habillé de soucis de « privacy by Design » avec l'aval de Anne Cavoukian, experte du domaine. Les caméras et les capteurs sont partout pour tracer les comportements qui seront qualifiés alors de « urban data » pour montrer que ce ne sont pas des données personnelles mais seulement des traces publiquement accessibles dans l'espace urbain, ce qui justifie leur exploitation intensive qui permettra les calculs de l'IA pour optimiser les services.
Cette catégorie juridique de « urban data » posera de sérieux problèmes plus tard. Pour le reste, les innovations qui n'en sont pas abondent, comme les vide-ordures ( !!), les écoles maternelles ( !!), la plantation d'arbres comme système technique, etc.. Cette naïveté des promoteurs de smart cities qui pensent réinventer la roue est très fréquente, il suffit de refuser la terminologie branchée qu'ils adoptent pour se rendre compte de la supercherie.
Négociations biaisées et ambitions territoriales cachées
Revenons aux côtés de Waterfront Toronto. L'appel d'offres que l'agence publie le 17 mars 2017 s'avérera trop imprécis sur plusieurs points qui vont entrainer des malentendus, si l'on est clément, ou des opportunités de manœuvre si l'on est plus cynique, pour les répondants. Des pans entiers de questions clés ne sont pas traités en matière de données principalement : la collecte des données dans les limites légales existantes, le partage des données récoltées avec les services urbains ou sous forme de trust en open data, la propriété intellectuelle et les revenus des brevets qui seront déposés à partir de l'expérience.
L'extension de la zone à urbaniser est évoquée mais sans aucune garantie puisque de toutes façons Waterfront n'a pas de mandat pour le faire. Mais l'appel d'offres accueille volontiers les idées sur cette zone étendue. Evidemment, les répondants mais surtout Sidewalk vont utiliser cette possibilité pour montrer que leurs solutions techniques (comme un train monorail suspendu) n'ont de sens que sur une zone qui dépasse de loin Quayside et plus tard qu'elles sont impératives pour la rentabilité de leur projet.
Trois répondants se présentent. La réponse de Sidewalk est en fait totalement inspirée de son Yellow Book avec cependant des adaptations puisque le dôme étant irréalisable, ils proposent des auvents rétractables, les immeubles seront à ossature bois (pour des raisons d'innovation responsable écologiquement), toutes choses qui demanderaient par exemple une modification du code de la construction au niveau de la province de l'Ontario. Ou encore des pavés amovibles chauffants qui permettent d'accéder en permanence aux réseaux, ce qui est totalement infaisable avec le climat de Toronto, et qui donne une impression de posture hors-sol comme c'est souvent le cas avec ces firmes du numérique qui n'ont aucune expérience réelle de la gestion urbaine.
Pour l'anecdote, Sidewalk s'aperçut même que dans toutes ses maquettes de ville conçues en laboratoire, jamais les églises n'apparaissaient, dans des pays où pourtant elles prolifèrent et alors qu'elles sont des lieux de vie sociale incontournables, certes équipées de plus en plus de techniques numériques de diffusion médiatique.
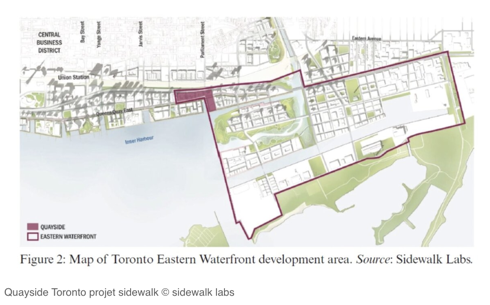
Cependant, Sidewalk est sélectionnée en Septembre 2017…. pour continuer les discussions avant de signer un accord définitif ! Le gouvernement fédéral soutient le projet en Octobre, mais l'auteur, journaliste, parviendra à montrer qu'en fait Justin Trudeau a eu une conversation téléphonique (cachée) au moins avec Eric Schmidt, le CEO de Google avant la décision et que toute l'annonce a été précipitée en fonction des agendas des uns et des autres pour réaliser une cérémonie très médiatique.
On peut penser que ce genre de détails n'aide guère à la compréhension du processus mais en fait, de telles opacités contribuent à miner les prétentions à la transparence et cela montre à quel point l'enjeu de réputation est essentiel dans la compétition financière désormais entre les Etats et les villes autour de ces labels technologiques.
Cela contribuera d'ailleurs à alimenter les soupçons des activistes qui sont évidemment des parties prenantes importantes de tout projet urbain, d'autant plus lorsque Google apparait derrière toute l'opération avec sa puissance et ses méthodes. Un blog de Bianca Wylie « Torontoist » sera très actif ainsi que l'Open Data Institute de Toronto et le Civic Tech de Toronto. Les consultations sont déjà agitées mais leur alarmisme n'est pas partagé par l'agence Waterfront qui considère qu'ils n'ont rien signé et qu'il faut leur donner le temps de tout ajuster.
Quand les temps médiatiques changent à propos des données : Cambridge Analytica, Zuboff, …
Mais l'année 2018 va changer la donne. Une fois encore des facteurs extérieurs majeurs changent les perceptions : le scandale Cambridge Analytica éclate en Mars 2018, le RGPD est mis en œuvre en Europe, les données sur NHS britannique sont collectées par Google, ce qui entraine une attention citoyenne et médiatique considérable sous forme de suspicion généralisée sur la question de la collecte et du traitement des données.
A tel point que le terme « smart cities » va se déprécier très vite, et que plus personne ne veut l'utiliser à Toronto, Waterfront parlant plutôt de « intelligent communities », on appréciera la nuance. Un effort de compréhension interculturelle sera même nécessaire tant la brutalité orientée business de Sidewalk sous influence de Doctoroff, l'ancien de Bloomberg, et leur culture du secret se heurtent à la tradition de relations civilisées de Waterfront : des conférences sur la culture canadienne et sa résistance à l'hégémonie US seront ainsi organisées à l'été 2018 pour le personnel de Sidewalk.
On peut dire que les critiques qui pointent la posture coloniale de ces grandes firmes apparaissent pertinentes au regard de ces efforts considérables pour ajuster les comportements.
L'accord est signé le 31 Juillet 2018 alors que les questions sur les données deviennent de plus en plus discutées dans le public. Sidewalk pense ainsi prendre les devants en créant un « civic data trust » indépendant, récupérant les données anonymisées et permettant à d'autres acteurs citoyens, administratifs ou privés d'exploiter les données récoltées.
Mais la définition des « urban data », comme indiqué déjà, continue à poser des problèmes. Toute utilisation des données doit en fait entrer dans le cadre légal existant au Canada qu'on appelle PIPEDA, agrégeant deux textes, Personal Data Protection et Electronic Document Act, qui datent tous les deux de 20 ans. Ces textes de loi relèvent du ministère de l'innovation alors que l'agence Waterfront relève, elle, en dernier ressort, du département fédéral des infrastructures.
Les pouvoirs publics canadiens à leurs échelles différentes tentent en fait d'éviter de devoir réécrire les lois car la procédure serait très longue, et préfèrent trouver une solution contractuelle ad hoc, ce qui évidemment ouvre la porte à toutes les critiques. Le commissaire à la privacy de l'Ontario prône ainsi ce qu'il appelle la « data minimization ».
A partir de 2019, année de la sortie du livre de Soshana Zuboff (The Age of Surveillance Capitalism), qui eut un écho puissant, les campagnes des activistes se sont multipliées, sous le hashtag #Block-Sidewalk notamment puis avec une plainte du CCLA en Avril 2019, tout cela pendant l'attente du plan masse qui n'était toujours pas fourni, et donc dans une situation d'information très imparfaite. Notons aussi que d'autres acteurs s'invitèrent dans la discussion, comme quoi la liste des parties prenantes n'est jamais vraiment closes dans ces projets : les syndicats du bâtiment notamment intervinrent pour soutenir le projet de Sidewalk alors que les Missisangas, nation indigène, exigèrent de participer à tout le processus car leurs idées et leurs intérêts n'avaient pas été pris en compte.
La prétention à créer un fief hors de tout contrôle, malgré les compromis
En juillet 2019, sort le plan masse (MIDP : Master Innovation Development Plan), document de 1524 pages intitulé « Toronto Tomorrow ». Il apparait qu'il est tout aussi énorme et ambitieux qu'au début sans avoir pris en compte la plupart des remarques faites par les diverses parties prenantes tout au long du processus. Sidewalk se pose comme le nouveau régulateur de toute cette zone, ignorant toutes les règles qu'il faudrait revoir à des échelles beaucoup plus larges, pour l'autoriser à construire des immeubles élevés à ossature bois, pour le système de transport léger sur rail ou encore pour piloter directement des feux de circulation adaptatifs.
Blayne Haggart, professeur associé en Science Politique à Brock University (Ontario) crée un blog pour étudier un à un les articles de l'énorme MIDP : un travail qui peut encore servir de référence pour conduire un examen critique de tout dossier de smart city ou de développement urbain.
Waterfront publie une réponse de 100 pages en Septembre signalant toutes les failles du plan masse et demande une réécriture pour le 31 Octobre 2019. Les deux points clés demeurent la gestion des données et des brevets et l'extension impossible vers Port Land puisqu'il faudrait de toutes façons un nouvel appel d'offres, ce que Sidewalk savait très bien en publiant son plan.
Et chose plutôt inattendue, Sidewalk répond en acceptant à peu près toutes les demandes de l'agence : la firme accepte de concourir pour les extensions éventuelles, elle abandonne sa référence à ce concept juridique fake que sont les « urban data », elle respectera les lois de chaque entité, elle partagera les revenus des brevets, etc. Il semble donc que tout rentre dans l'ordre et que Sidewalk ait appris l'art du compromis alors que toute la culture de ces disrupteurs leur imposent de tout faire pour éliminer le droit existant et faire plier les partenaires/ bureaucrates qui bloquent les innovations.
Waterfront accepte donc les 160 propositions de révision de Sidewalk à l'exception de seize d'entre elles, telles que le chauffage prélevant la chaleur des eaux usées à 4km du site ou encore les « ultrasmall efficient units » d'habitation qui sont en fait certes optimisées du point de vue énergétique mais inhabitables d'un point de vue…. humain !!
Le coup de grâce du Covid
Certes, Brin et Page ont quitté la direction de Alphabet en Décembre 2019, ce qui constitue un tournant historique pour la firme, autorisant moins de projections futuristes hasardeuses comme les aimait Brin, mais cela ne saurait remettre en cause le projet. Et pourtant, tout va s'écrouler en quelques mois, car fin Février 2020, Toronto, comme tout le reste de l'Amérique du Nord, est touché par la pandémie du Covid-19.
La conséquence qui affecte alors le plus directement le projet tient à l'effondrement du marché de l'immobilier de bureau. En effet, les confinements sous diverses modalités encouragent le télétravail et la fuite des zones denses. Waterfront devient plus exigeant sur le paiement par Alphabet du montant annoncé pour l'achat du lot et cela sans abattement. Sidewalk est sous pression de la part d'Alphabet pour revenir dans les règles d'un équilibre budgétaire et donc réduire ses coûts. Or, pour le faire sur un espace aussi restreint, il lui faudrait éliminer plusieurs des innovations qui faisaient pourtant l'intérêt de l'opération.
Sidewalk en tire la conclusion très rapidement que ce projet n'est plus intéressant, non viable économiquement et annonce qu'il stoppe sa participation le 6 mai 2020. Quatre ans de tractations diverses et de controverses sont ainsi annulés en trois mois à l'occasion du Covid, sans pouvoir établir si c'est une cause réelle ou une opportunité saisie pour mettre fin à un projet mal parti.
Les suites sont aussi radicales : Sidewalk Labs quitte Toronto puis quitte même le marché en tant qu'entreprise spécifique même si certaines innovations sont réintégrées dans Google même, reflétant ainsi une nouvelle stratégie d'Alphabet, indépendamment du Covid. Sidewalk dans ses derniers mois s'est d'ailleurs redéfini comme un incubateur de start-ups, de brevets et d'idées (dont les immeubles à ossature bois et le système de gestion de parking) et non plus comme l'aménageur urbain qu'il a tenté d'être à Toronto.
C'est avant tout son incapacité intrinsèque à forger des alliances hors du domaine de la tech qui apparait ainsi, et donc une forme d'inculture politique et urbanistique qui exige du temps long, du débat contradictoire et des partenariats et non des diktats à effet immédiat avec contrôle total.
De leur côté, Waterfront a dû relancer un appel d'offres pour un aménageur et non plus pour un « innovateur-sponsor » comme était perçu Sidewalk Labs. Mais la loi canadienne sur la vie privée a été changée dans les 6 mois qui ont suivi la fin de l'expérience de QuaySide : elle est proche du RGPD et étend ses obligations au secteur privé.
Cependant, il fallut deux ans pour sa mise en œuvre effective, car le temps administratif et politique ne relève pas des coups de force ou des passages à l'acte mais de l'acte d'institution durable et responsable, après examen contradictoire et minutieux. Bref, la culture libertarienne a échoué à abattre ou contourner l'Etat de droit mais cela n'empêche pas des promoteurs de tenter de le faire comme Jeff Bezos avec le nouveau siège d'Amazon (HQ2) à Cristal City (Virginie) près de Washington DC, en abandonnant cependant dès 2019 la localisation à NYC envisagée en raison de la controverse suscitée (effet de gentrification, avantages fiscaux exigés notamment). Elon Musk fait de même au Texas en achetant un village (Boca Chica) près de son site de lancement de Space X près de Brownsville et la gentrification de la ville apparait très vite.
Smart cities sans intelligence collective : un comble !
L'histoire racontée par Josh O'Kane explore encore d'autres biographies d'acteurs, car c'est son angle préféré. Cependant, pour l'analyse des dimensions politiques et des négociations internes entre les parties prenantes, son récit est remarquablement riche car il remet au premier plan ce que les belles histoires des technophiles et des libertariens veulent passer sous silence.
Ces innovations urbaines ne sont pas « techniques », elles sont encastrées dans des rapports sociaux, dans des environnements précis, dans des cadres juridiques, dans des cultures et des visions politiques qui entrent en conflit, elles sont « urbaines » au sens plein du terme. Le déni de ces dimensions ou leur instrumentalisation supposée par les techniques du numérique, du calcul et des modélisations conduit ces projets dans le mur et on ne peut pas s'en plaindre.
On peut cependant regretter que dans ces projets aux financements énormes de « smart cities », l'ingrédient le plus difficile à trouver soit « l'intelligence collective ».
Notes
Laugaa, M., Pinson, G. et Smith, A. (2024) . Les strates de la smart city L'institutionnalisation disjointe des politiques urbaines du numérique à Bristol. Réseaux, N° 243(1), 103-142.
Tierney, T. F. ‘Toronto's Smart City : Everyday Life or Google Life ?' Architecture_MPS, 2019, 15(1) : 1, pp. 1–21.
Un billet d'Irénée Régnault qui date de 2019 et qui soulevait déjà tous les problèmes du projet QuaySide : https://maisouvaleweb.fr/toronto-quayside-cite-etat-numerique-etre-democratique/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une extrême droite du désastre ? Entretien avec Richard Seymour

Le monde d'aujourd'hui regorge de catastrophes réelles. Mais de la préparation militaire aux fantasmes de déportation massive, l'extrême droite et la droite extrémisée promettent à leurs partisans de meilleures catastrophes : celles où ils seront aux commandes. Entretien avec Richard Seymour, qui vient de publier Disaster Nationalism, aux éditions Verso.
Tiré du site de la revue Contretemps
10 décembre 2024
Par Richard Seymour
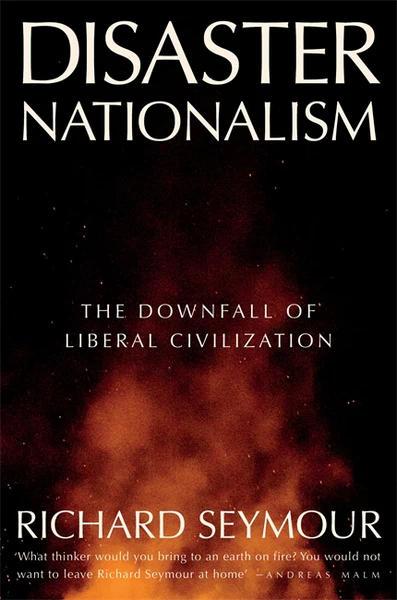
Lorsque Carlos Mazón a pris le pouvoir à la tête d'un gouvernement de droite à Valence l'année dernière, il semblait que la crise climatique n'avait rien d'inquiétant. Il avait formé une coalition entre son parti conservateur, le Partido Popular, et le parti d'extrême droite, Vox, et pour sceller l'accord, il avait accepté de supprimer l'Unité d'Intervention d'Urgence de Valence. Le mois dernier, Valence a été dévastée par des inondations qui ont fait plus de 200 morts, les alertes n'ayant pas été diffusées et les patrons ont refusé de laisser les travailleurs rentrer chez eux pour se mettre à l'abri. Alors que la crise battait son plein, Carlos Mazón profitait d'un long déjeuner.
Malgré ces responsabilités politiques, l'extrême droite a tenté de tirer profit de la catastrophe. Elle reproche au Premier ministre Pedro Sánchez et à son gouvernement de gauche d'avoir détruit des barrages datant de l'époque franquiste qui auraient permis d'arrêter les crues soudaines. En réalité, comme le rapporte El Diario, la grande majorité des barrages supprimés étaient de petits déversoirs de moins de deux mètres de haut, et tous étaient des « infrastructures inutiles ». Les barrages franquistes n'auraient pas sauvé les habitants de Valence. Mais pour les partisans de la droite, qui nient l'existence d'une véritable catastrophe et en inventent de fausses, cette hallucination est essentielle pour comprendre la destruction de l'Espagne.
Cette tendance de la pensée de droite est le sujet du nouveau livre de Richard Seymour, Disaster Nationalism. Dans cet ouvrage, Seymour utilise les outils de la psychanalyse et du marxisme pour examiner ce qui se passe avec l'extrême droite mondiale. Olly Haynes l'a interviewé pour Jacobin à propos de son nouvel ouvrage.
*
OLLY HAYNES Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le nationalisme du désastre et pourquoi – comme vous le dites – ce n'est « pas encore le fascisme ou un pas-encore-fascisme » ?
RICHARD SEYMOUR J'ai remarqué il y a quelques années que la nouvelle extrême droite était obsédée par des scénarios fantastiques de mal imaginaire et extrême. Les camps de la mort de la FEMA, (Federal Emergency Management Agency, l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence étatsunienne) la « théorie du grand remplacement », la « grande réinitialisation », les villes 15 minutes, les antennes 5G qui sont des balises de contrôle de l'esprit, et les micropuces installées dans les gens par les vaccins.
En Inde, il existe une théorie appelée « Romeo jihad », selon laquelle les hommes musulmans séduisent les jeunes filles hindoues et les convertissent à l'islam, menant ainsi une sorte de guerre démographique. Ou encore les fantasmes de QAnon selon lesquels des pédophiles satanistes et communistes dirigent le monde. Ils sont réellement captivés et obsédés par des scénarios hallucinatoires de désastre extrême.
Comment cela se fait-il ? Les catastrophes réelles ne manquent pas : incendies, inondations, guerres, récessions et pandémies. Pourtant, ils entretiennent souvent des relations négationnistes avec ces catastrophes. Beaucoup disent que COVID-19 n'était qu'une excuse pour le IVe Reich, ou que le changement climatique est une excuse pour un régime libéral totalitaire, une nouvelle forme de communisme, etc. Les gens de droite sont vraiment captivés et obsédés par les scénarios hallucinatoires de catastrophes extrêmes.
Je prends souvent l'exemple des incendies de forêt en Oregon. Les incendies ont ravagé les plaines et les forêts et ont brûlé à 800 degrés Celsius. Ils constituaient une véritable menace pour la vie des gens. Mais beaucoup de gens ont refusé de partir parce qu'ils ont entendu dire que c'était en fait les Antifas qui mettaient le feu et que cela faisait partie d'une conspiration séditieuse visant à éliminer les chrétiens conservateurs blancs. Alors, plutôt que de fuir pour sauver leur vie, ils ont mis en place des points de contrôle armés et ont pointé leurs fusils sur les gens, affirmant qu'ils étaient à la recherche d'Antifas.
Pourquoi ce fantasme d'apocalypse de masse ? Parce qu'il transforme le désastre d'une manière qui est en fait assez vivifiante. La plupart du temps, lorsque les gens subissent des catastrophes, ils sont déprimés et se retirent un peu de la vie et de la sphère publique. Mais l'extrême droite offre une autre issue. Elle dit que « ces démons dans votre tête avec lesquels vous vous êtes battus, ils sont réels et vous pouvez les tuer ». Le problème n'est pas difficile, abstrait ou systémique, il s'agit simplement de mauvaises personnes, et nous allons les attraper ». Il s'agit de toutes les émotions difficiles auxquelles les gens sont confrontés face aux chocs économiques et au changement climatique, et de leur donner un exutoire qui leur semble valide et valorisant.
C'est ce que j'appelle le nationalisme du désastre. Il n'est pas encore fasciste car, bien qu'il organise les désirs et les émotions des gens dans une direction très réactionnaire, ils n'essaient pas de renverser la démocratie parlementaire, ils n'essaient pas d'écraser et d'extirper tous les droits de l'homme et les droits civils – pour l'instant. Ils manquent également de maturité organisationnelle et idéologique. Nous sommes dans une phase d'accumulation de la force fasciste.
Si l'on remonte à l'entre-deux-guerres, ce processus d'accumulation avait déjà eu lieu, il y avait déjà eu des pogroms massifs, il y avait déjà eu de grands mouvements d'extrême droite avant le fascisme. Nous nous trouvons donc à un stade précoce du fascisme inchoatif que je vois se développer ici.
OLLY HAYNES À la fin de The Anatomy of Fascism, publié en 2005, Robert Paxton nous avertit que la politique israélienne pourrait sombrer dans le fascisme. Quelle est la place d'Israël dans votre conception d'un fascisme qui n'en est pas encore un ?
RICHARD SEYMOUR Lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, je ne m'attendais pas à parler beaucoup d'Israël. Je pensais qu'il s'intégrerait comme un élément mineur dans un patchwork mondial centré sur des États beaucoup plus importants. En fin de compte, j'ai dû écrire un tout nouveau chapitre en raison du génocide à Gaza.
Il est clair depuis un certain temps que le sionisme est toujours un génocide naissant parce que son désir ultime est que les Palestiniens n'existent pas. Et il y a toujours eu des éléments de fascisme hébreu depuis les années 1920. Je dirais que leur dynamique coloniale est tout à fait particulière. On ne voit pas cela aux États-Unis : il est évident que le colonialisme de peuplement est une réalité historique avec des répercussions permanentes, mais ce n'est pas une réalité vivante et actuelle. Le colonialisme de peuplement structure l'organisation de l'État, il structure la vie quotidienne, vous ne pouvez pas exister en Israël sans être conscient des Palestiniens et de leur désir récalcitrant et exaspérant d'exister.
Mais il y a d'autres aspects qui sont tout à fait similaires aux schémas observés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Inde, au Brésil, etc. Il s'agit du déclin du système d'après-guerre, dans leur cas un accord corporatiste entre la main-d'œuvre juive, le capital juif et l'État, obtenu grâce à la purification ethnique de 1948. Ce système s'est effondré dans les années 1970 et, comme partout ailleurs, il est devenu néolibéral. Les syndicats israéliens ont décliné. Ils ont tenté de s'adapter par le biais de la politique de la troisième voie, et leur dernière chance a probablement été le processus d'Oslo. Aujourd'hui, ils existent à peine.
Il y a eu ces tendances à l'augmentation du pessimisme et de l'inégalité des classes, et la vieille utopie nationaliste du monde de l'après-guerre a disparu. La classe capitaliste est cosmopolite et étroitement intégrée à Washington, ce n'est pas l'utopie nationaliste juive qu'ils essayaient de construire. C'est pourquoi certains membres du mouvement sioniste tentent de reconstituer cette patrie juive, une sauvegarde juive si l'on peut dire. La droite a dit : « Non, nous avons dépassé cela maintenant. Nous sommes dans une situation où nous devons régler la question avec les Palestiniens une fois pour toutes ». Pour eux, cela signifie expulser les Palestiniens et coloniser résolument chaque parcelle de terre qui, selon eux, appartient au Grand Israël.
Cela nous amène-t-il au fascisme ? Pas tant qu'il y a des systèmes constitutionnels, libéraux-démocratiques. C'est une démocratie d'exclusion, et ce n'est pas inhabituel à cet égard ; l'Amérique jusqu'aux années 1970 était une démocratie d'exclusion, et je dirais même qu'elle l'est encore aujourd'hui, mais à un degré différent. Israël a une culture de plus en plus raciste, autoritaire et génocidaire et il est plus proche d'un coup d'État fasciste que n'importe où ailleurs. Je pense que le génocide et le processus de radicalisation de la base vont conduire à un coup d'État kahanisteou d'extrême droite.
Si vous voulez voir où le fascisme est assez avancé, je dirais que c'est là, mais aussi en Inde. Il faut entendre les alarmes : « Nous sommes au bord d'un génocide », car le BJP [Bharatiya Janata Party], un mouvement autoritaire de droite lié au fascisme historique, a colonisé l'État et supprimé les droits civils. Il s'agit d'un phénomène mondial dans lequel Israël joue un rôle unique et distinctif. Israël est très proche d'un régime fasciste millénariste. À moyen terme, c'est une possibilité réelle et dangereuse, étant donné qu'il s'agit d'un État nucléaire.
OLLY HAYNES Vous écrivez qu' « il serait stupide d'ignorer les fantasmes catastrophistes de la droite. Ils sont souvent en phase avec des réalités que l'optimisme libéral préfère ne pas reconnaître ». De quelles réalités s'agit-il ?
RICHARD SEYMOUR Ils mettent parfois le doigt sur des éléments importants de la réalité. Les théories complotistes à propos des villes de 15 minutes, par exemple, sont hallucinantes et délirantes parce qu'on croit qu'elles annoncent une sorte de dictature communiste anti-voiture. Mais au fond, il s'agit d'une véritable menace pour l'automobilité, le mode de vie suburbain et les avantages relatifs de la possession d'une voiture.
Si vous construisez des villes en fonction de la commodité et de la présence de pistes cyclables partout, en vous débarrassant autant que possible de la pollution et en supprimant les places de parking, c'est un problème si vous êtes quelqu'un qui aime se déplacer partout en voiture. C'est particulièrement problématique si l'on commence à mettre en place des barrières de circulation pour vous empêcher d'emprunter certaines routes.
Si vous êtes directement et personnellement concerné, vous pouvez avoir l'impression que la vie va changer radicalement au cours des prochaines décennies. Et ils n'ont pas tout à fait tort : le changement climatique nécessitera de vastes changements structurels. Les libéraux veulent nier la gravité de ce qui se prépare et de ce que les gens vivent déjà. Je pense que la réponse de la gauche devrait être de dire : « Oui, vous avez raison, nous allons tout transformer, mais ce sera bien mieux pour vous. Voici comment ».
L'exemple qui me vient toujours à l'esprit est celui de Barack Obama en 2016. Il s'est moqué de Donald Trump qui faisait du catastrophisme dans sa campagne, et il a dit avec son ironie : « Le lendemain, les gens ont ouvert leurs fenêtres, les oiseaux chantaient, le soleil brillait. » Le pathos qu'il essayait d'invoquer était que les gens étaient en fait plutôt heureux, que tout allait bien. Puis, lors des élections, il a eu sa réponse : Trump a gagné. Pour beaucoup de gens, les choses ne vont pas bien.
Trump a prononcé son discours d'investiture avec le discours écrit par Steve Bannon, parlant du « carnage américain », ce qui, à mon avis, est une sorte de poésie réactionnaire, car le carnage n'est pas une description inexacte de la destruction de l'Amérique industrielle. Ils ont mis le doigt sur un problème réel, mais leur réponse a été de blâmer la Chine, l'Asie de l'Est. La plupart des emplois perdus l'ont été à la suite d'une lutte des classes par le haut – réduction des effectifs, démantèlement des syndicats. Il y a eu un élément d'externalisation, mais ce sont les entreprises, les patrons, qui sont à blâmer, pas les travailleurs et les travailleuses d'Asie de l'Est.
Vous voyez donc qu'ils peuvent identifier certaines formes de désastre. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est les intégrer dans une analyse globale cohérente et solide. Tout ce qu'ils proposent, en réalité, ce sont des symptômes conçus pour ne rien résoudre, mais qui vous permettent d'aller massacrer des musulmans en Inde, des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, de tuer des partisans du Parti des Travailleurs au Brésil, de tirer, de poignarder ou d'utiliser des voitures pour écraser des manifestants de Black Lives Matter aux USA, ou d'organiser des émeutes racistes en Grande-Bretagne où ils ont essayé de brûler des demandeurs d'asile dans leurs hôtels. C'est ce que la droite propose comme alternative au désastre ; de meilleurs désastres, des désastres dans lesquels vous vous sentez en contrôle.
OLLY HAYNES Vous avez mentionné les meurtres de musulmans en Inde. Pourriez-vous expliquer ce qu'était le pogrom de Gujarat et pourquoi vous le considérez comme le point de départ de la vague actuelle de nationalisme du désastre ?
RICHARD SEYMOUR Je dirais que c'est le canari dans la mine de charbon. De toute évidence, c'est loin d'être le seul pogrom significatif en Inde. Il existe une sorte de machine à pogroms : Paul Brass en parle avec élégance. Pour l'essentiel, un incendie s'est déclaré dans un train, tuant un certain nombre de pèlerins hindous. Il s'agissait de membres du VHP, une organisation d'extrême droite, et le mouvement Hindutva [nationaliste hindou] a supposé que des musulmans avaient provoqué l'incendie à l'aide de bombes à essence.
Il y a peu de preuves de cela : des enquêtes impartiales ont conclu que l'incendie était un accident. Mais ils ont décidé qu'il y avait eu un génocide contre les hindous et, dans les jours qui ont suivi, ils ont incité la population à prendre les armes et à traquer, tuer et torturer les musulmans. C'est ce qu'ils ont fait, directement organiséspar des membres du BJP, incités par des dirigeants du BJP, avec la complicité et la participation de la police et d'hommes d'affaires qui ont payé des individus pour qu'ils participent à l'opération.
Il s'agissait d'une explosion collective de violence publique coordonnée, d'une permissivité assortie d'un certain degré de contrôle de la part des autorités. Le résultat a été que le vote du BJP a augmenté de 5 % alors qu'on s'attendait à ce qu'il perde cet État après avoir terriblement mal géré un vrai désastre : un tremblement de terre qui avait eu lieu l'année précédente.
Vous voyez donc le schéma : il y a une vraie catastrophe qui affecte les gens, le gouvernement la gère terriblement, puis il propose une fausse version de la catastrophe et il incite les gens à tuer quelqu'un et c'est très excitant. Les choses qu'ils fontsont horribles. Ils assassinent des bébés devant leur mère, ils enfoncent des pointes entre les jambes des femmes, ils coupent les gens en deux avec des épées.
Il est évident que cette situation s'est accumulée depuis un certain temps, et alors, dans les mois qui ont suivi, Narendra Modi a organisé des rassemblements de fierté hindoue et a dit aux gens que si nous pouvions restaurer la fierté de notre peuple hindou, tous les « Alis, Malis et Jamalis » ne pourraient pas nous faire de mal – il voulait évidemment parler de la population musulmane qui venait juste de subir un pogrom. Le fait que ces propos n'aient pas jeté le discrédit sur le BJP, mais qu'ils aient au contraire électrisé sa base et fait de Modi un sex-symbol pour la première fois, en dit long sur ce type de politique.
Nous l'avons vu à maintes reprises. Sans toutes les manifestations armées, rassemblements anti-confinement et sans les violences contre les manifestants de BLM, vous n'auriez pas vu l'insurrection bâclée du 6 janvier. Même chose au Brésil : Jair Bolsonaro avait 20 points de retard, il a presque gagné en 2022 et a obtenu plus de voix qu'en 2018. Comment a-t-il fait ? Un été de violence chaotique au cours duquel il a déclaré que les militants de gauche devaient être mitraillés, et ses partisans ont brandi leurs armes face aux partisans du Parti des Travailleurs, les ont agressés ou les ont assassinés. Je ne dis pas que le pogrom du Gujarat a précipité ces autres événements, mais il s'agissait d'un exemple précoce de ce qui se passait, et dès que Modi a été élu en 2014, il a montré que le capitalisme libéral tolérerait cela.
OLLY HAYNES La plupart des violences génocidaires commises depuis les années 1990 l'ont été à l'encontre de musulmans de diverses ethnies, et bien qu'il y ait beaucoup de racisme à l'encontre de différents groupes dans la politique occidentale, les attaques les plus véhémentes semblent être réservées aux musulmans.
Tommy Robinson, par exemple, se vante que les Noirs sont les bienvenus à ses rassemblements. Quel rôle joue la figure abstraite du « musulman » dans le discours nationaliste catastrophique et a-t-elle remplacé le « juif » en tant que figure de la haine d'extrême droite ?
RICHARD SEYMOUR Je ne pense pas que l'on trouve cela au Brésil ou aux Philippines. Mais c'est le cas dans toute une constellation d'États, de l'Inde à Israël, en passant par les États-Unis et la plupart des pays d'Europe occidentale, et même d'Europe de l'Est. En termes sémiotiques, ce n'est pas exactement la même chose que la figure du « Juif », parce qu'à l'heure actuelle, le discours de l'extrême droite ne donne pas l'impression que les musulmans, en plus d'être une sorte de masse misérable de la Terre, contrôlent tout.
Il y a eu des tentatives pour développer une sorte de théorie de la conspiration comme celle de Bat Ye'or sur l‘Eurabia, par exemple. Mais la plupart du temps, il ne s'agit pas de la croyance que les musulmans sont secrètement aux commandes et dirigent le système financier, mais plutôt qu'ils constituent une masse subversive, violente, anormale et inférieure qu'il faut soumettre à la violence et aux frontières pour la garder sous contrôle.
Je dirais que cela trouve son origine dans le tournant des années 1980 vers l'absolutisme ethnique, la coalition entre les partisans du Likoud en Israël et les fondamentalistes chrétiens aux USA, vers une sorte de politique identitaire absolutiste où tout le monde doit entrer dans une case particulière – il y a une sorte d'effondrement de la solidarité antiraciste unificatrice que nous avons vue à l'époque de la guerre froide, en Grande-Bretagne, prenant la forme de la noirceur politique. Tout cela s'est effondré, puis il y a eu l'affaire Rushdie et les musulmans ont été catégorisés comme un problème spécifique.
Il est important que cela soit ancré dans l'expérience quotidienne de la vie capitaliste. En Grande-Bretagne, par exemple, les personnes qui militaient dans le même syndicat dans les villes du Nord ou sur les docks, une fois que ces industries ont été fermées et que les syndicats ont été démantelés, se sont souvent dirigées vers des secteurs marginalisées de l'économie et ont découvert que leur logement était toujours ségrégué, que le système scolaire était effectivement ségrégué, que les mairies pratiquaient des politiques de ségrégation et que le maintien de l'ordre était ségrégationniste dans ce sens, c'est-à-dire très raciste.
Ajoutez à cela l'austérité et vous obtenez une misère publique, personne n'a rien, et vous blâmez toujours les gens en bas de l'échelle : « Ils ont tout, je n'ai rien ». C'est à ce moment-là que l'on commence à voir des émeutes dans les villes du Nord et que la guerre contre le terrorisme catalyse tout cela.
Il s'agit donc d'un phénomène mondial dans lequel la civilisation libérale s'est définie contre les « mauvais musulmans ». Au départ, il y avait l'idée que le problème n'était pas tous les musulmans, mais seulement ce que nous appelons le fascisme islamique : George W. Bush l'a souligné. Mais la manière dont cette idée a été comprise par la population et la manière dont elle a été politisée l'ont étendue à tous les musulmans. Le musulman est donc une figure centrale, mais je pense que nous devons le considérer comme faisant partie d'une chaîne d'équivalence avec le « prédateur transgenre des toilettes », le « marxiste culturel » et le migrant.
Aux Philippines, la principale catégorie est celle des toxicomanes : ce sont les personnes qui ont été assassinées. Cela peut prendre différents accents, mais je suis d'accord pour dire que globalement, et particulièrement pour l'Occident, « le musulman » coordonne tous ces autres problèmes.
OLLY HAYNES L'un des chapitres les plus intéressants porte sur le rôle du sexe dans le discours nationaliste sur les catastrophes. Vous avez également écrit un chapitre sur le génocide à Gaza, bien qu'il mette un peu moins l'accent sur la psychanalyse que vous utilisez dans d'autres chapitres.
Les questions d'exploitation et d'agression sexuelles sont revenues tout au long du génocide à Gaza, entre les soldats israéliens affichant des vidéos sur TikTok avec des sous-vêtements de femmes palestiniennes ou les émeutes pour la défense de soldats accusés d'avoir violé des détenus en prison. Pourriez-vous développer votre analyse du rôle du sexe dans l'imaginaire nationaliste du désastre ?
RICHARD SEYMOUR Je dirais qu'en termes d'économie libidinale de cette nouvelle extrême droite, leur prémisse sous-jacente semble être que quelqu'un est toujours violé et que le problème est que les « communistes » (parmi lesquels ils incluent Kamala Harris, etc.) veulent que les mauvaises personnes soient violées. Le mouvement incel (les « célibataires involontaires »), les défenseurs des droits des hommes, etc. tentent souvent de justifier le viol.
Il y a une sorte de contradiction dans cette économie libidinale entre des interdictions sévères renouvelées – plus de mariage gay, plus de transgenre, retour des femmes dans les cuisines, fétichisme de l'épouse traditionnelle (trad wife) – d'une part, et d'autre part, une liberté prédatrice totale pour les hommes, donc une permissivité sélective. Il n'est pas surprenant de voir cela dans les zones de guerre. Les guerres donnent généralement lieu à de nombreux viols : la victimisation de l'ennemi passe notamment par la brutalisation des femmes.
J'ai récemment effectué des recherches sur les auteurs de crimes, en particulier en ce qui concerne le génocide à Gaza, et l'une des choses qui revient est ce dont parle Klaus Theweleit, c'est-à-dire l'idée de la femme dangereuse. En termes modernes, il s'agit de la combattante de la justice sociale (social justice warrior), hurlante et rousse, etc., mais à l'époque où il écrivait, le mouvement des Corps Francs Allemagne, les Freikorps des années 1920, la femme dangereuse était une communiste qui avait un pistolet sous la jupe. C'est une personne que l'on veut approcher suffisamment pour la tuer. Cette proximité dangereuse est passionnante parce que vous vous approchez du danger, puis vous le surmontez et vous prenez ce que vous voulez, de la pire façon possible.
J'imagine qu'une grande partie de la politique masculine de droite aujourd'hui est une tentative de surmonter un sentiment d'inefficacité, d'impuissance, de paralysie, etc. Et franchement, lorsqu'ils parlent de viol, ils sous-entendent qu'ils sont vraiment excités et qu'ils désirent beaucoup. Mais les faits suggèrent que les jeunes hommes, les jeunes en général, ne sont pas aussi intéressés par le sexe que les générations précédentes. Ils ne sont pas aussi intéressés par le sexe, ils ne sont pas aussi intéressés par le romantisme, il n'y a rien de très sexy dans la vie contemporaine.
L'une des choses ici est qu'ils blâment les femmes pour le fait qu'elles n'ont pas de désir, et ils disent : « Nous sommes involontairement célibataires. » Ils disent que si les femmes les draguaient, ils seraient prêts à faire l'amour tout le temps. J'en doute. Ils sont aussi troublés, contrariés et foutus que tout le monde, voire plus. Mais je pense qu'ils essaient de regonfler leur désir en le transformant en une démonstration de pouvoir, d'efficacité, de puissance. Il y a beaucoup de cela, et je pense qu'il y aura des spécificités à Gaza, parce que toute cette affaire de soldats israéliens se filmant dans la lingerie volée de femmes palestiniennes, c'est évidemment parodique, c'est génocidaire, mais il y a quelque chose à ce sujet qui implique une identification inconsciente avec la victime.
OLLY HAYNES J'ai trouvé qu'il manquait au livre une analyse du rôle des centristes libéraux dans cette situation. Je pense notamment à Kamala Harris qui a fait campagne avec les Cheney, avant de perdre face à Donald Trump. C'est là, en arrière-plan, mais je me demandais si vous pouviez expliquer comment vous voyez les libéraux s'intégrer dans ce tableau ?
RICHARD SEYMOUR Il y a deux angles à cette question. Les centristes libéraux en tant qu'individus et en tant que groupe et leur relation symbiotique avec l'extrême droite. Le second est celui sur lequel je me concentre dans le livre, sur les échecs de la civilisation libérale. La barbarie qui lui est inhérente se manifeste dans l'impérialisme et la guerre, dans son racisme, dans son sadisme frontalier, dans le travail et l'exploitation, mais aussi dans les hiérarchies de classe et les misères qu'elles engendrent. La question est donc de savoir comment nous parvenons à des situations spécifiques dans lesquelles des personnes comme Obama, Hillary Clinton, et maintenant Kamala Harris et Joe Biden contribuent à l'accession au pouvoir de cette nouvelle formation.
Je dirais que le philosophe Tad DeLay pose une question intéressante dans son récent livre, The Future of Denial, sur la politique climatique : « Que veut le libéral ? » C'est une bonne question, car les libéraux ne cessent de proclamer leur affinité avec les valeurs égalitaires et libertariennes. Ils affirment soutenir la lutte contre le changement climatique, mais s'opposent également à tout moyen efficace d'y parvenir.
Je pense de plus en plus qu'en fin de compte, les libéraux ne veulent pas du libéralisme. Il est évident qu'il faut faire certaines distinctions parce qu'il y a des libéraux qui sont véritablement engagés philosophiquement et politiquement dans les valeurs libérales, qui se battront pour elles et qui iront à gauche s'il le faut. Mais il y a aussi les centristes purs et durs dont la politique s'organise principalement autour d'une phobie de la gauche.
Je parle ici d'un anticommunisme hallucinant, principalement connecté avec la droite, mais les libéraux ont une vision tout aussi irréaliste de la gauche et de sa menace supposée. Ce serait bien si la gauche était plus forte et si nous étions sur le point de provoquer une révolution communiste, mais ce n'est pas le cas.
Lorsque Bernie Sanders s'est présenté, je me souviens de la panique des libéraux américains. Un animateur craignait qu'une fois que les socialistes auraient pris le pouvoir, les gens seraient mis au pied du mur et abattus. Pensez aussi à la façon dont le centre dur (centre-gauche et centre-droit) a encouragé les théories du complot comme en Grande-Bretagne, l'opération « Cheval de Troie » : l'idée que les musulmans prenaient le contrôle des écoles de Birmingham. Cette théorie complotiste ne venait pas de l'extrême droite, mais du gouvernement.
Le rapport est le suivant : l'extrême droite reprend les prédicats déjà établis par le centre libéral, les radicalise et les rend plus cohérents en interne. Il y a quelques années, au début de la période où le New Labour était au pouvoir, il a commencé à mettre en place une véritable répression à l'encontre des demandeurs d'asile. Ils mettaient régulièrement en scène des images d'actualité où un ministre se trouvait à Douvres à la recherche de demandeurs d'asile dans les camionnettes des gens et d'autres choses de ce genre. Pendant ce temps, le British National Party (BNP) prenait de l'ampleur et déclarait dans des interviews : « Nous aimons ce qu'ils font, ils nous légitiment ». Ils ont pris des préoccupations qui étaient au bas de l'échelle des préoccupations des gens en 1997 et les ont poussées au sommet, ce qui a donné une légitimité au BNP.
Pour leurs propres raisons, ils ont tendance à amplifier les courants réactionnaires qui circulaient déjà. Puis, lorsque l'extrême droite se développe sur cette base, ils ont tendance à affirmer que « c'est une bonne raison pour nous d'aller plus loin dans cette direction, car cela montre que si nous ne nous attaquons pas à ce problème, l'extrême droite va se développer encore plus ». Il s'agit d'une machine à résonance, qui rebondit en quelque sorte l'une sur l'autre. L'un des problèmes que pose le choix entre un démocrate centriste et un républicain d'extrême droite est que ce choix repose sur l'exclusion de la gauche. Structurellement, les deux se nourrissent de cette exclusion, mais à long terme, c'est l'extrême droite qui en bénéficie.
OLLY HAYNES Vers la fin du livre, vous suggérez que les appels à la rationalité et à l'intérêt personnel des gens ne fonctionnent pas toujours, et que la politique du « pain et du beurre », bien que nécessaire, n'est peut-être pas suffisante : pour mobiliser les gens politiquement, il faut susciter leurs passions. Avez-vous une idée de ce à quoi doivent ressembler ces « roses » qui doivent être offertes à côté du « pain » ?
RICHARD SEYMOUR J'aurais dû utiliser cette métaphore dans le livre : « du pain et des roses » est une bonne façon de le dire. Je pense qu'il existe une aspiration légitime et innée à la transcendance qui est immanente à la vie en tant que telle. En d'autres termes, être en vie, c'est s'efforcer d'atteindre une situation toujours différente. La vie est un processus téléologique dans lequel nous nous efforçons d'atteindre un certain niveau de développement. Mais aussi, l'aspiration à la connaissance, l'aspiration à l'autre – c'est l'instinct social, l'aspiration, dans le langage de Platon, au bien, au vrai et au beau. Je pense que cet instinct est présent chez tout le monde et chez tous les êtres vivants.
Je dirais que l'on peut le voir lorsque nous avons ces ruptures de gauche, comme la campagne de Sanders. C'est très bien de parler de pain et de beurre. Il y a de bonnes choses dont les gens ont besoin, comme les soins de santé et un salaire minimum plus élevé, la lutte contre l'exploitation des employeurs, mais aussi, au-delà, la lutte contre le sadisme frontalier, en disant aux gens qu'ils veulent vivre dans une société décente.
Toute personne dotée d'un instinct décent a été attirée par cette campagne, électrisée par elle, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit « votez pour moi et vous aurez plus de biens matériels », il a dit « votez pour moi et vous aurez une révolution politique ». Et ne vous contentez pas de voter pour moi, participez à un mouvement politique avec moi, prenez le pouvoir, renversez tous les éléments décrépits et sadiques de notre société et approfondissez la démocratie. Il a parlé d'un voyage improbable ensemble, pour refaire et transformer le pays.
Les gens ont vraiment envie de travailler ensemble pour atteindre quelque chose de plus élevé. L'une des pathologies de la vie moderne est que les gens se sentent frustrés, paralysés, inefficaces. Son mode d'expression caractéristique était « si nous restons unis » – et quand il disait cela, la foule entrait en éruption. Ce n'est qu'un exemple de rupture de gauche. Jean-Luc Mélenchon a son propre style, Jeremy Corbyn a un style très différent, mais l'idée de base est toujours la même : l'ethos social, l'effort commun.
Karl Marx et Friedrich Engels ont parlé de cette dialectique où l'on adhère à un syndicat au départ pour obtenir des salaires plus élevés, une journée de travail plus courte, des choses dont on a fondamentalement besoin, mais où l'on développe ensuite d'autres besoins, plus riches. Très souvent, les travailleurs se mettent en grève pour défendre leur syndicat, même s'ils perdent des journées de salaire et que leurs conditions matérielles objectives se détériorent quelque peu. Ils ont besoin les uns des autres, ils ont besoin de leur syndicat. Cela peut aller plus loin ; cela peut être politisé de manière beaucoup plus profonde. Le besoin le plus radical est le besoin d'universalité, au sens marxiste du terme.
Lorsque les gens descendent dans la rue pour lutter contre le changement climatique, ils pensent à un monde de plénitude, pas nécessairement un monde où ils ont tous les gadgets et les produits dont ils ont besoin, mais un monde où tout le monde et toutes les espèces ont une chance de prospérer et de s'épanouir. Je dirais que c'est normal. La question est de savoir comment ce communisme instinctif de base, comme le disait David Graeber (1961-2020), est contrecarré, écrasé et détourné. Comment ce besoin impeccablement respectable est-il négligé et pathologisé, de sorte que les gens n'osent même pas y penser, et encore moins l'exprimer ? De sorte que les gens adoptent une sorte de posture cynique.
Je pense que les roses dont nous avons besoin sont celles qui proviennent de notre unité : J'ai mentionné les termes platoniciens « le bon, le vrai et le beau ». Pensez à la culture et à ce travail que nous faisons ensemble, pensez à la recherche de la vérité dans les sciences et à ce travail que nous faisons ensemble. Nos efforts pour élever les normes morales en essayant de mettre fin à la violence, au viol et au racisme sont des capacités intrinsèques que nous possédons tous. Il est évident que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous pouvons vivre des existences privatives où nous sommes égoïstes, haineux et rancuniers. Mais ce n'est pas tout. Si c'était le cas, nous pourrions tout aussi bien abandonner.
*
Entretien publié dans Jacobin. Traduit de l'anglais pour Contretemps par Christian Dubucq.
Richard Seymour est journaliste, chercheur indépendant et militant révolutionnaire. Il tient le blog anglophone leninology.co.uk, est coéditeur de la revue Salvageet notamment l'auteur de Corbyn : The Strange Rebirth of Radical Politics, The Liberal Defense of Murder, American Insurgents.
Olly Haynes est un journaliste basé au Royaume-Uni, qui couvre la politique, l'environnement et la culture.
Illustration : Wikimedia Commons.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
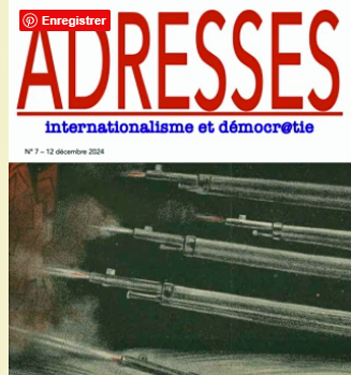
Avis de tempête
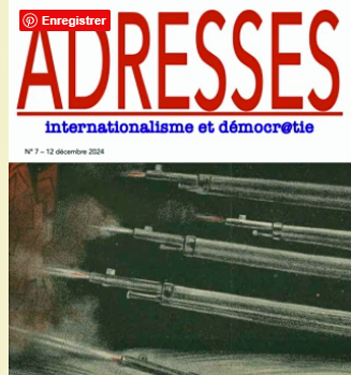
Nul n'osait le prévoir, Trump est élu président des États-Unis. Les Républicains MAGA (Make America Great Again) sont majoritaires au Sénat et à la Chambre des représentants, sans oublier la Cour suprême.
Il ne s'agit pas d'un simple événement électoral mais d'un bouleversement qui a déjà des impacts dans le monde entier, comme pour la majorité des populations civiles.
Nous proposons quelques éclairages sur l'élection étasunienne et sur les possibilités de résistance. Les élections américaines ne sont pas, hélas, exceptionnelles dans ce monde en profondes mutations [1].
Télécharger le n° 7 d'Adresses : internationalisme et démocr@tie :
Adresses n°7
Beaucoup encore refusent de voir Vladimir Poutine et l'armée russe bombarder les équipements énergétiques et sociaux vitaux pour la population ukrainienne. Et multiplier les crimes de guerre. Un nouveau pas a été franchi avec l'utilisation de missiles balistiques, possibles vecteurs d'ogives nucléaires. La guerre contre les populations ukrainiennes est aussi une guerre contre les populations de la fédération de Russie [2].
Le temps du néolibéralisme semble passé
Une nouvelle conjoncture apparaît, où des gouvernements, sous des formes plus ou moins autoritaires, vont amplifier les politiques de privatisations, d'expropriations, d'inégalités et de contrôle social.
Comment appréhender et nommer ces nouvelles formes politiques ? Certain·es parlent de fascisme [3], d'autres de postfascisme, comme par exemple, Gaspar Miklos Tamas, à propos du régime de Viktor Orbán [4].
Si nous voulons encore espérer que ce triste conte d'hiver puisse se transformer par nos actions collectives en souriant conte de printemps, il nous faut analyser, au niveau mondial comme au niveau local, les similitudes et les particularités, les effets sociaux et les contradictions de ces régimes.
Nous devons aussi faire connaître les actions propres de groupes humains [5], les dialogues entre Palestiniens et Israéliens, les mobilisations – aussi fragmentaires soient-elles – qui rompent les inerties favorisées par l'individualisme et la guerre de toustes contre toustes.
Certains bouleversements au 20e siècle ont suscité des enthousiasmes. Bien des espérances se sont effondrées dans des dictatures et des crimes de masse, que certain·es ont cependant continué à nommer « socialisme », « communisme [6] », d'autres, souvent les mêmes, ne peuvent pas dépasser l'anti-impérialisme des imbéciles [7].
Il ne s'agit pas de refaire ou d'effacer l'histoire, mais bien de rendre visibles les fils tissés entre refus, résistance et espérance. Nous pouvons nous appuyer sur des déjà-existants, des biens communs, des solidarités locales ou plus larges.
Contre le roi marché, Samuel Farber nous propose de discuter aujourd'hui de Cuba [8] et Meron Rapoport nous propose des conversations inégales entre un Palestinien et un Israélien [9].
Il importe aussi de développer les analyses qui nous permettent de comprendre les évolutions politiques et leurs résonances de régions en régions. Voir l'article de Joy Asasira : « Les femmes africaines victimes de Trump [10] ».
Une preuve évidente de cette profonde transformation au-delà des crimes, des pogroms, des génocides c'est bien le fait que certains gouvernements ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale (CPI) et s'affranchissent d'instances qui limitent leurs actions potentiellement criminelles. Cela en dit long sur la victoire actuelle de la logique « souverainiste » sur les droits communs des êtres humains. Aucun gouvernement ne devrait pouvoir se dérober et refuser les actions de la CPI ou de la Cour internationale de justice (CIJ). De plus, il ne sauraient y avoir d'immunité ni d'impunité pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité.
Quelles que soient les limites actuelles du droit international et de ses instances. Monique Chemillier-Gendrau souligne que « le monde d'aujourd'hui, devenu un village par la puissance des communications et du commerce, ne dispose pourtant pas d'un droit commun à l'application effective [11] ».
Penser le droit commun, comme émancipateur, est un point d'appui nécessaire pour appréhender le chaos du monde qui voient de nombreux pays sortir de leurs « démocraties » et rompre avec leurs valeurs fondatrices. Ce mouvement de bascule ne fait hélas que s'amorcer.
Bonne lecture.
Au moment du bouclage…
Le régime criminel de Bachar al Assad est tombé
Au souffle de l'élection de Trump se mêlent les effets tragiques du 7 octobre. L'équilibre instable du Moyen Orient est bouleversé par la destruction de Gaza menée par Israël, le ciblage du Hezbollah. L'Iran, sans ses alliés (Hamas, Hezbollah) se retrouve en position de faiblesse. La Russie toujours plus acharnée dans sa guerre contre l'Ukraine voit ses opérations de déstabilisation se retourner contre elle. La Géorgie est proche d'un nouveau Maïdan et la population roumaine n'accepte pas le trucage des élections.
L'instabilité est renforcée dans la région alors que les puissances du processus d'Astana (Russie, Iran, Turquie) tentent d'éviter une perte d'influence pour les deux premiers et surtout l'irruption directe des populations suppliciées.
Les gouvernements de la Russie et de l'Iran ont subi un revers durable, celui de la Turquie semble renforcé. Cela se répercutera inévitablement sur les autres conflits, sur l'équilibre des BRICS et sur les rapports internationaux à l'investiture de Trump. Et celui au pouvoir à Pékin devra sortir de son silence.
Il est maintenant nécessaire et possible de revenir aux aspirations initiales de la révolution syrienne, à savoir la démocratie, la justice sociale et l'égalité, tout en respectant le droit à l'autodétermination des Kurdes et de toutes les minorités.
Notes
1. Bill Fletcher Jr., « Comment se défendre dans la nouvelle période Trump », p.7 ; Frieda Afary, « Donner du sens à la victoire de Trump et à la résistance », p. 11.
2. Ilya Budraitskis, « Poutine mène une guerre culturelle contre le peuple russe », p.28.
3. Taki Manolakos, « La fin du néolibéralisme préfigure la montée du fascisme », p. 15.
4. Gaspar Miklos Tamas, « Naissance du postfascisme dans la Hongrie de Orban », p. 19.
5. Oleksandr Kyselov, « Ukraine : la force vient de l'intérieur », p. 44.
6. Ilya Budraitskis, « L'impérialisme politique russe et la nécessité d'une alternative de gauche mondiale », p. 31.
7. Voir les précédents numéros d'Adresses.
8. Sam Farber, « Cuba : “libre” marché ou planification démocratique ? », p. 47.
9. Meron Rapoport, « Conversations inégales », p. 53.
10. Joy Asasira, « Les femmes africaines victimes de Trump », p. 59.
11. Monique Chemillier-Gendreau, « L'échec du droit international à devenir universel et ses raisons », p. 39.
Didier Epsztajn, Michel Lanson, Patrick Silberstein
Télécharger le n° 7 d'Adresses : internationalisme et démocr@tie :
Adresses n°7
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’inquiétante étrangeté du monde – sur Le Double : Voyage dans le Monde miroir de Naomi Klein

Avec un livre en abyme, Naomi Klein entraîne le lecteur dans un voyage vertigineux à la poursuite du Double, le sien, une certaine Naomi Wolf avec laquelle on la confond souvent, égérie du féminisme dans les années 1990 passée au complotisme anti-vax et d'Al Gore à Steve Bannon, mais aussi le Double comme paradigme de notre temps en proie à l'inquiétante étrangeté de notre monde, avec ses miroirs, ses moi artificiels, ses réalités fabriquées.
16 décembre 2024 | tiré d'AOC media
https://aoc.media/critique/2024/12/15/linquietante-etrangete-du-monde-sur-le-double-voyage-dans-le-monde-miroir-de-naomi-klein/
J'ai lu deux fois Le Double de Naomi Klein. Normal me direz-vous avec un titre pareil, mais si je l'ai lu deux fois, ce n'est pas seulement à cause de son titre mais en raison de sa richesse et des multiples étapes de ce voyage dans ce que Klein appelle « le monde miroir ».
Je l'ai lu une première fois au pas de course, enjambant les obstacles, pour tenter de saisir l'unité de ce livre kaléidoscopique qui embrasse des sujets aussi différents que l'univers marchand des logos, la crise climatique, l'épidémie du Covid, la question du double chez Freud ou Philip Roth, l'ère politique des bouffons à la Donald Trump ou Javier Milei, le suprématisme blanc, la généalogie américaine du nazisme, le conflit israélo palestinien, mais aussi des questions plus personnelles comme le rapport à son double, une autre Naomi (Wolf) avec laquelle on la confond souvent, une ex féministe qui a viré complotiste à la faveur du Covid, devenue proche collaboratrice de Steve Bannon le maitre à penser de l'alt right, ou encore la campagne électorale au Canada de son mari candidat à la députation à laquelle elle participe tract en main dans les escaliers d'immeubles, et jusqu'au sujet plus délicat pour elle de l'autisme de son fils qualifié de « neurodivergent » par les médecins, une condition qui est selon elle un symptôme contemporain du rejet de l'Autre, du différent, du Double.
Je l'ai relu une deuxième fois, plus lentement, en étant attentif aux jointures de son texte, aux associations d'idées qui guident son raisonnement, plus narratif que déductif, parcourant une à une les surfaces réfléchissantes de ce « monde miroir », ces plans découpés qui donnent à ce livre sa profondeur de champ et son sujet véritable : la décomposition spectrale de notre folie collective. Entre les anti-vaccins, les influenceurs du bien-être et les démagogues de l'extrême droite, le livre déploie un arc narratif qui évoque davantage la fragmentation cubiste de l'objet que la polyphonie musicale à laquelle on serait tenté de le rapprocher. Sa lecture nécessite cette attention multidimensionnelle dont parlait Paul Klee, une vision mobile et disjonctive qui saisit les ruptures, les déplacements.
La pulvérisation du moi
Car il y a plus de deux livres dans Le Double, c'est un récit hydre à plusieurs têtes chercheuses comme le serpent de la mythologie, une fiction poulpe (sans aucun jeu de mots) qui plonge ses nombreux bras dans les ruines de notre monde néolibéral, fouillant ses décombres et brisant les cloisons qui nous empêchent d'en saisir l'unité.
Son véritable sujet c'est « l'évitement du monde » dont elle enregistre les modalités en trois parties. « La représentation, le cloisonnement et la projection sont les différents pas de danse de l'évitement. » Évitement du moi dont la fuite dans les artefacts numériques serait la forme archétypale. « Mes étudiants ont grandi en ayant conscience d'avoir un double extériorisé – un double numérique, une identité idéalisée, distincte de leur moi “réel” (le cloisonnement), qui leur sert à incarner le personnage qu'on attend d'eux (la représentation) s'ils veulent réussir. Dans le même temps, ils doivent projeter sur d'autres personnes (la projection) chacune des parties indésirables et dangereuses d'eux-mêmes : l'ignorant, le problématique, le déplorable, le “non-moi” qui délimitent les frontières du “moi”. Cette triade – le cloisonnement, la représentation et la projection – est en train de devenir une forme universelle de dédoublement, générant un personnage qui n'est pas exactement ce que nous sommes, mais que les autres perçoivent comme tel. »
De double en double et de miroir en miroir Naomi Klein poursuit l'image fuyante, diffractée, de nos moi en miettes. « Le moi comme marque parfaite, le moi comme avatar numérique, le moi comme mine de données, le moi comme corps idéalisé, le moi comme projection raciste et antisémite, l'enfant comme miroir du moi, le moi comme éternelle victime. Tous ces doubles ont un point commun, ils sont autant de façons de ne pas voir. Ne pas se voir clairement soi-même (parce que nous sommes trop occupés à afficher une version idéalisée de nous-mêmes), ne pas voir clairement les autres (parce que nous sommes trop occupés à projeter sur eux ce que nous ne supportons pas chez nous), et ne pas voir clairement le monde et les liens qui unissent les hommes (parce que nous nous sommes cloisonnés et volontairement aveuglés). Je pense que cela explique, plus que toute autre chose, l'inquiétante étrangeté de notre temps, avec tous ses miroirs, ses moi artificiels, ses réalités fabriquées. »
Naomi Klein ne s'exclut pas de ce processus de dissociation. Son moi fait partie du tableau, elle l'observe et l'interroge, le critique sans complaisance comme lorsqu'elle se moque de sa propre transformation en « logo » après le succès mondial de son best-seller « No Logo ». « Il y avait beaucoup d'hypocrisie dans cette mise en scène. (…) être la fille No Logo – le visage d'un mouvement anti-capitaliste émergent – et nier tout intérêt à me construire une image de marque. Être la seule, en somme, à faire proprement des affaires. N'est-ce pas finalement ce que nous sommes si nombreux à convoiter lorsque nous entrons dans cette arène, tout au moins quand nous tâchons d'y survivre ? Nous créons des personnages en ligne – des doubles de notre “vrai” moi – qui cultivent savamment la juste dose de sincérité et de dégout du monde ; nous manipulons l'ironie et le détachement qui ne sont pas trop promotionnels, mais font néanmoins le job ; nous flirtons avec les médias sociaux pour gonfler nos chiffres… »
Le carnaval est partout. Les méthodes et les concepts de la science politique ne suffisent plus à rendre compte des mutations que subissent les démocraties
Tout au long de son « voyage dans le monde miroir » elle ne se perd jamais de vue, incluant, en bonne einsteinienne, son propre reflet, celui de l'observatrice dans le champ observé. À chaque étape de son enquête dans l'univers ensorcelé des doubles, elle n'oublie jamais de mesurer l'ampleur des transformations en cours à l'aune de ses expériences personnelles, refusant de se positionner en surplomb de la dystopie numérique dans laquelle nous évoluons et qui nous transforme dans notre quête éperdue de la notoriété en nos doubles dévorants.
« La notoriété est la monnaie sans valeur de l'ère de la connexion permanente, à la fois un substitut à l'argent liquide et un moyen de s'en procurer. Elle se calcule sans tenir compte de ce que vous faites, mais en fonction de la masse de “vous” qui pénètre le monde. La notoriété s'obtient en jouant les victimes, mais aussi en victimisant les autres. C'est une chose que la gauche et la droite comprennent parfaitement. Quelle que soit l'influence qu'elle exerce, la notoriété est une donnée stable qui travaille exclusivement pour son propre compte et dans une seule optique : faire du volume. »
L'inquiétante étrangeté du bouffon
Dans ce monde envoûté, la vie politique apparaît non plus comme la scène de la délibération collective, le règne du logos et de la raison mais comme un théâtre hofmannien de l'étrange, soumis à ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté. Schelling le premier en avait donné une définition citée par Freud : « On qualifie de unheimlich (l'inquiétante étrangeté) tout ce qui devrait rester dans le secret, dans le dissimulé et qui est sorti au grand jour ». Les éléments de cette inquiétante étrangeté, Freud les empruntait en partie à Hoffmann le maître de l'étrange : la croyance en l'animisme, la magie et l'enchantement, la figure du double, la toute-puissance des pensées, le retour du refoulé, la relation avec les morts, les spectres, les fantômes.
Tout ceci se trouve dans ce livre dont Noemi Klein relate le surgissement dans les soubresauts de l'hypercrise actuelle, géostratégique, écologique, sanitaire, numérique… La vie politique n'est plus régie par la dissimulation mais par la simulation, non plus par le secret et le calcul raisonné, mais par l'épiphanie du fake et la parodie. Triomphe de la téléréalité sur le théâtre politique. La politique comme magie grotesque. Le mélange des genres devient la règle, confondant les registres du sérieux et du divertissement. Le carnaval est partout. Les méthodes et les concepts de la science politique ne suffisent plus à rendre compte des mutations que subissent les démocraties : simulation, dévoration, cannibalisation, parodie, carnavalisation, envoûtement. Le demos est sorti de son lit ; il déborde dans un champ bien plus large que celui de la sociologie et de la science politique, le domaine du bizarre, de l'inquiétant, celui des phénomènes paranormaux, le royaume de l'étrange.
C'est l'un des passages les plus fascinants du livre, lorsque Naomi Klein met ses pas dans ceux de Philip Roth, celui d' Opération Shylock et exhume le « pipikisme » cher à Roth pour analyser « cette force anti tragique qui dédramatise les choses – qui transforme tout en farce, qui banalise et superficialise tout ». Dans Opération Shylock publié en 1998, Roth rebaptisait son double grotesque et encombrant, Pipik, un sobriquet donné dans sa jeunesse « aux enfants un peu simplets, maladroits et inadaptés qui jouaient les intéressants ».
Depuis 2016, les pipik ont envahi le monde, ils sont sur Twitter ou Tiktok, inspirent les tweets des internautes comme les décrets des gouvernements, ils ont conquis le pouvoir et répandent depuis le Covid le pipikisme comme une « épidémie au carré ». « Quand la figure du bouffon devient centrale dans la vie publique, ce ne sont pas seulement les stupidités proférées par ses représentants qui posent un problème, c'est aussi leur capacité à rendre stupide tout ce qu'ils touchent, y compris – et surtout – les mots dont nous avons besoin pour les décrire et expliquer ce qu'ils font. Malheureusement, ces “doubl'idiots” pipikent si bien nos expressions et nos concepts qu'ils vont bientôt finir par nous laisser sans voix. Une fois pipikée, une idée peut-elle redevenir sérieuse ? »
Le pipikisme, forme actualisée du fascisme
C'est contre cette « pipikisation » des esprits que le livre de Naomi Klein déploie ses arguments les plus convaincants. Car on aurait tort de prendre à la légère le virus du grotesque qui s'est emparé des esprits. En désarmant la critique et la pensée, ce virus n'est pas seulement porteur d'insignifiance, il permet le retour du refoulé contenu dans le projet racialiste et colonialiste européen.
Dans deux chapitres clés qui apparaissent à la fin du livre : « Le nazi dans le miroir » et « L'ébranlable ethnicité », elle va au cœur politique de la thématique du double explorée tout au long du livre. Le pipikisme est la forme actualisée du fascisme. C'est « un archaïsme techniquement équipé » selon les mots de Guy Debord dans La Société du Spectacle, un fascisme augmenté par la puissance des algorithmes des Gafam et de l'intelligence artificielle qui codent et répandent son idéologie mortifère. « Si le fascisme, écrivait Debord, se porte à la défense des principaux points de l'idéologie bourgeoise devenue conservatrice (la famille, la propriété, l'ordre moral, la nation) en réunissant la petite bourgeoisie et les chômeurs affolés par la crise, il se donne pour ce qu'il est : une résurrection violente du mythe, qui exige la participation à une communauté définie par des pseudo-valeurs archaïques : la race, le sang, le chef. »
À ce devenir fasciste de l'Occident Naomi Klein apporte un éclairage historiographique et anthropologique qui permet de comprendre l'unité et la cohérence du projet racialiste et colonisateur qui resurgit sous nos yeux dans ces formes trumpistes. S'appuyant sur différentes sources (Joseph Conrad, James Q. Whitman, l'écrivain suédois Sven Lindqvist, Raoul Peck, Aimé Césaire, Frantz Fanon, W.E.B. Du Bois, ou encore Nehru, Premier ministre de l'Inde (1947-1964)) Klein retrace la généalogie de ces idéologies exclusivistes et des pratiques d'extermination qui ont inspirées le nazisme et qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui dans les théories du Grand Remplacement.
« Tous, dans les années 1930, 1940 et 1950, affirme-t-elle dans un entretien récent, écrivaient sur le fascisme européen, qu'ils considéraient comme le double du colonialisme et de l'impérialisme européens… un retour, au cœur de l'Europe, de la science raciale, des technologies, des mécanismes d'enfermement et d'anéantissement, utilises autrefois contre les peuples noirs. C'est l'idée du boomerang conceptualisé par Hannah Arendt : le fascisme serait le retour de la colonisation en Europe… Je ne dirais pas que c'est une réplique directe du nazisme mais plutôt une nouvelle itération du colonialisme de peuplement. » Un nazisme d'inspiration donc plutôt que d'imitation.
Cette histoire sinueuse ne commence pas dans les Amériques, mais en Europe, dans les siècles qui ont précédé l'Inquisition espagnole, les bûchers et les expulsions sanglantes de juifs et des musulmans. Elle se poursuit dans le génocide des Amérindiens avant de revenir en Europe pendant l'Holocauste. Naomi Klein cite Aimé Césaire qui accusait dans son Discours sur le colonialisme les Européens de tolérer « le nazisme avant qu'il ne leur soit infligé » « Ils ont fermé les yeux, l'ont légitimé, car jusqu'alors, il n'avait été appliqué qu'aux personnes non européennes. » Le crime d'Hitler envers les Alliés, pensait Césaire, était d'avoir fait aux Juifs et aux Slaves ce qui « jusqu'alors était réservé exclusivement » aux colonisés non blancs en pays étrangers ».
L'analyse de Césaire qui n'a rien perdu de sa pertinence rejoignait les réflexions de Klein, sur le nazisme comme le Double maléfique de l'esprit européen. Selon Césaire « Hitler n'était pas seulement l'ennemi des États-Unis et du Royaume-Uni – il était leur ombre, leur jumeau, leur sosie tordu : « Oui, cela vaudrait la peine d'étudier cliniquement, en détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler au bourgeois très distingué, très humaniste, très chrétien du XXe siècle que sans qu'il s'en rende compte, il a un Hitler en lui, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon. »
Le complexe de Gatsby
À l'appui de cette hypothèse, on peut citer un témoignage que ne cite pas Naomi Klein dans son livre, celui de Scott Fitzgerald, célèbre et pourtant invisibilisé par les images fastueuses avec lesquelles le cinéma a emballé son roman Gatsby le magnifique, publié en 1925. Tout fait symptôme dans ce roman qui précédait la crise de 1929. L'argent roi. Les fortunes vite faites. Les amours à « l'éclat de pur argent ». La plainte des saxophones dans la nuit. Un bolide jaune pâle. Le champagne qui coule à flots au cours des fêtes que donne Gatsby où s'étourdissent les riches New-Yorkais.
Au début du roman, le milliardaire Tom Buchanan, un des voisins de Gatsby explose au cours d'un diner où sont réunis tous les personnages du roman. « La civilisation court à sa ruine ! rugit-il avec une angoisse non feinte. Je suis d'un affreux pessimisme par rapport à ce qui se passe. As-tu lu The Rise of Colored Empires, d'un certain Goddard ? C'est un livre excellent. Tout le monde devrait l'avoir lu. L'idée, c'est que la race blanche doit être sur ses gardes, sinon elle finira par être engloutie. Une thèse scientifique, fondée sur des preuves irréfutables. […] Nous sommes la race dominante. Notre devoir est d'interdire aux autres races de prendre le pouvoir […]. Tout ce qui fait la civilisation, c'est nous qui l'avons inventé. Les sciences, disons, les arts, et le reste. Tu comprends ? »
Les arguments de Tom Buchanan , rappelle Sarah Churchwell, dans un article de The New York Review of Books, « American immigration : A century of racism », empruntaient à deux best-sellers de l'après-Première Guerre mondiale : The Passing of the Great Race, de Madison Grant (1916), et The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy, de Lothrop Stoddard (1920).
Sarah Churchwell constate à quel point ces idées s'étaient généralisées , en grande partie grâce à la fausse légitimité fournie par les institutions culturelles, notamment les éditeurs, les magazines populaires et les professeurs d'université. Fitzgerald avait découvert ces « idées rassies » alors qu'il était étudiant à Princeton, où il lui arriva d'aller écouter une conférence sur l'eugénisme. Grant et Stoddard ne faisaient que rhabiller d'anciennes idées « eugénistes » avec les habits neufs du biologisme, mais la voix qui les animait a trouvé un écho puissant dans le monde en ruine des années 1920. Elle s'est même dramatiquement concrétisée dans l'Immigration Act de 1924, qui assignait des quotas d'immigration aux divers pays d'Europe (et du monde) et a eu pour conséquence de réduire l'immigration de plus de 90 %.
Le soutien populaire à cette loi a été énorme. Celle-ci est restée en vigueur pendant quarante ans, jusqu'à son annulation par Lyndon B. Johnson en 1965. Le sénateur Jeff Sessions, qui fut le procureur général des États Unis dans l'administration Trump de 2017 à 2018, affirmait en 2015 que la loi de 1924 avait réussi à ralentir « considérablement » l'immigration.
Le livre de Madison Grant fut traduit en allemand, et l'idée d'hygiène raciale allemande s'inspirait de ses théories. Son influence sur l'idéologie nazie ne saurait être niée. Dans The Nazi Connection (1994), Stefan Kühl a bien montré que les nazis tiraient leurs idées eugénistes des théories américaines, tout comme ils utilisaient les lois américaines sur la race pour légitimer les lois de Nuremberg de 1935. Hitler aurait même adressé une lettre à Madison Grant pour le féliciter. Il lui avouait que son livre, The Passing of the Great Race, était devenue sa « bible » ! Une bible que les avocats des Nazis citèrent au procès de Nuremberg pour prouver que les États-Unis s'étaient livrés aux mêmes crimes que ceux pour lesquels ils étaient poursuivis.
Naomi Klein, Le Double : Voyage dans le Monde miroir, Actes Sud, septembre 2024.
Christian Salmon
Écrivain, Ex-chercheur au CRAL (CNRS-EHESS)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
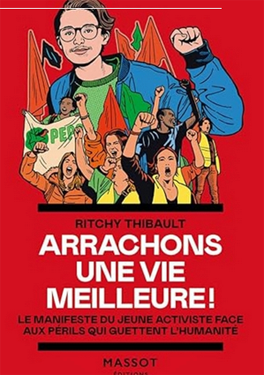
« Il y a une vraie lutte des classes au sein de l’écologie »
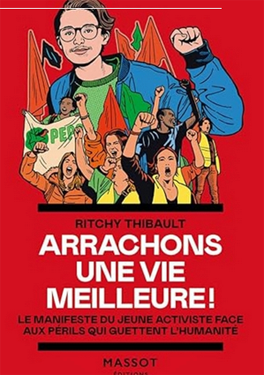
12 décembre 2024 | tiré de l'Hebdo L'Anticapitaliste - 733
https://lanticapitaliste.org/opinions/politique/il-y-une-vraie-lutte-des-classes-au-sein-de-lecologie
À l'occasion de la sortie de son livre « Arrachons une vie meilleure » aux éditions Massot, l'Anticapitaliste a rencontré Ritchy Thibault.
Tu es porte-parole d'un collectif politique qui s'appelle PEPS (Pour une écologie populaire et sociale). Tu as 20 ans. Comment expliques-tu ton parcours militant ?
Je n'étais pas du tout destiné à l'action politique. J'appartiens à ces populations que l'État, que les dominants assignent à l'apolitisme, parce que ma mère est gitane, mon père est manouche. Je me suis retrouvé sur un rond-point avec les Gilets jaunes à l'âge de 14 ans, à Pineuilh, à côté de Sainte-Foy-la-Grande, la ville d'origine d'Élisée Reclus, que j'ai découvert après m'être engagé, lui qui fut un des précurseurs de l'écologie. Dès que je sortais du collège, je marchais jusqu'au rond-point, et j'ai passé mes soirées à me politiser au bord des feux sur le rond-point de Pineuilh, en Gironde. C'est comme ça que je me suis mis à lire, à comprendre que finalement il fallait acquérir des outils pour combattre l'injustice. Puis, je me suis mis à faire 5 500 km à pied en stop une fois mon bac passé, sans thune, où j'ai été sur les routes. Je suis allé voir des expériences individuelles, collectives, et je me suis dit que finalement, il y a tout un « déjà-là », il y a une perspective révolutionnaire.
Comment tu passes de cette politisation des Gilets jaunes — très axée sur la question sociale souvent opposée aux questions écologiques à l'époque — à une conscience écologique ?
Les Gilets jaunes ne me destinaient pas à l'écologie, parce que comme je l'ai lu depuis, les dominants ont désubstantifié l'écologie chez les classes populaires. Ils ont diabolisé cette notion. La manière dont ils parlent de l'écologie fait que la perception de l'écologie chez les classes populaires, c'est une punition : quelque chose qui nous prend des sous. Le mouvement des Gilets jaunes commence avec le refus de la taxe carbone, qui est une grosse escroquerie. Sous prétexte d'écologie, vous venez nous taper à nous, qui avons une petite bagnole pour aller au boulot, qui faisons 40 km aller-retour par jour et pendant ce temps-là, vous laissez ceux qui ont des jets privés circuler partout dans le monde. C'est ce qu'ont dit les Gilets jaunes. C'est vraiment l'injustice totale.
Arrivé à Paris, je me mets à fréquenter les camarades du collectif politique, dont je suis le porte-parole, parce que j'ai pris conscience que l'écologie, c'est vraiment la notion d'avenir dans notre champ politique. Je suis convaincu que tout va se passer autour de l'écologie au vu de la situation. Il y a une vraie lutte des classes au sein de l'écologie. Il y a l'écologie bourgeoise, mais il y a aussi une écologie radicale, une écologie décoloniale. On le voit notamment avec le discours de Jill Stein, lors de la présidentielle aux États-Unis. Il y a d'un côté les écologistes européens bourgeois qui veulent lui donner des leçons et elle, qui les rappelle à l'ordre, en disant que la vraie écologie, c'est celle qui se positionne du côté des peuples opprimés, notamment du peuple palestinien. Chez PEPS, on défend la notion d'écologie de libération. On dit que l'écologie, elle libère des oppressions.
Je me suis dit que ça me concernait directement en tant que jeune racisé. Les voyageurs en France — ceux qu'on appelle les gens du voyage — ils sont parqués à côté des sites les plus polluants et les plus pollués de ce pays. C'est ce qu'on appelle le racisme environnemental. À Rouen, en 2019, il y a l'incendie de Lubrizol. Le premier lieu de vie à côté de ce site classé Seveso, c'est un terrain dit d'accueil — qui n'a rien d'accueillant — de voyageurs. Les gens, pendant qu'on évacue tout le monde autour, sont parqués là-bas. On leur dit : « Vous pouvez sortir, mais pas avec les caravanes ». Or les caravanes, ce sont le logement des gens, leur habitat. En quelque sorte, on les parque et on les séquestre en train d'inhaler des fumées profondément toxiques. L'écologie, c'est notre affaire à nous, les dominéEs et les exploitéEs de ce monde.
Dans les motifs d'indignation, tu parles beaucoup aussi, évidemment, du racisme ? De l'antitsiganisme ?
C'est une de mes batailles principales. Ma grand-mère et sa génération ont vécu un internement et un génocide toujours pas reconnu plus de 80 ans après. L'antitsiganisme, c'est le racisme subi par toutes les populations qui sont perçues comme Tsiganes. Alors, Tsigane, c'est un exonyme, un terme de la littérature scientifique que j'évite d'utiliser, mais il s'avère que le terme « antitsiganisme » désigne le racisme subi par tous ceux qui sont désignés comme tels, à savoir les Roms, les Yéniches, les Sintis, les Manouches, les Gitans et les voyageurs. Ce sont les 6 collectifs principaux.
Il y a le racisme environnemental. L'espérance de vie des voyageurs est de plusieurs années inférieure au reste de la population. Il y a la discrimination à l'école. Il y a les crimes policiers. Moi, je l'ai vécu dans ma famille, avec Daniel, qui s'est fait tuer par des gendarmes quand j'avais une dizaine d'années. Il y a eu Angelo Garand, et sa sœur qui mène un combat salutaire pour la justice, et d'autres… Les voyageurs sont les plus victimes de crimes policiers.
Il y a des convergences à faire, avec toutes celles et ceux qui subissent le racisme, en tant que phénomène systémique et structurel. Je me suis rapproché du champ de l'antiracisme politique. Avec Amal Bentounsi, on passe beaucoup de temps dans des combats communs. Il y a une nécessité impérative que les personnes qui subissent le racisme d'État en France s'unissent, ne laissent personne de côté pour déconstruire la pyramide raciale.
Tu me disais que tu travailles avec Ersilia Soudais, qui est députée, que vous préparez ensemble un projet sur cette question ?
Tout à fait. Je tiens à remercier Ersilia Soudais qui est la première parlementaire qui s'engage pleinement sur la lutte contre l'antitsiganisme. En janvier, Ersilia va déposer une proposition de résolution pour la reconnaissance du Samudaripen — « la mort de tout » en romanès —, donc du génocide des Roms, des Sintis, des Gitans, des Manouches et des voyageurs. Notre objectif ? Que la France, 80 ans après, reconnaisse sa culpabilité, qui est immense dans ce génocide et les persécutions entre 1939 et 1946. Elle ouvrirait la voie, notamment à des indemnisations et des réparations des spoliations très graves. L'État a volé tous les outils de travail de nos ancêtres, via la Caisse des dépôts et des consignations. Cela a assigné des gens à la misère.
Comment tu vois la situation avec l'autoritarisme qui se développe ?
Il y a des dérives autoritaires graves. Il y a des populations en France, comme les voyageurs, qui n'ont jamais connu l'État de droit. On a laissé faire une expérimentation de la coercition étatique vis-à-vis de certaines populations, vis-à-vis des quartiers populaires, vis-à-vis des populations racisées, des voyageurs, et des musulmanEs aussi. […]
On a atteint un degré de répression pendant les Gilets jaunes, que les gens sous-estiment. On a laissé passer la normalisation de l'état d'urgence après les attaques terroristes de 2015, et les mesures d'exception sont devenues la norme et la banalité. Les dominants font de la répression, car ils veulent silencier la parole de l'opposition, et notamment de la jeunesse. Et donc, il y a une fascisation qui est grave. Ils préparent, ils donnent clé en main à l'extrême droite.
Hannah Arendt disait que choisir le moindre mal, c'est toujours choisir le mal. Macron n'est pas du tout un rempart. Parce que si la formation politique de Bardella, le Rassemblement national, était arrivée en tête aux élections législatives, il aurait pris un plaisir fou à gouverner avec lui.
Qu'est-ce qu'agir dans ce monde qui se durcit, qui se radicalise de plus en plus vers l'écofascisme ?
Il faut cesser d'opposer de manière antagonique nos formes de luttes. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est ni le parti d'avant-garde révolutionnaire qui va sauver les masses avec un discours pseudo-éclairant. Ce n'est pas non plus la social-démocratie. Ça ne marche pas. On pense qu'il y a une troisième voie. C'est la révolution rampante. C'est un peu le lierre et les ronces qui poussent à travers les différents socles, le socle de la pyramide sociale, et qui la font effondrer. Qui poussent dans le bitume des bourses du CAC40 et qui font s'effondrer les bâtiments. Je pense qu'il y a trois fronts de lutte : un front interne, les institutions pour faire entendre une voix dissonante ; un front externe, pour être capable de s'opposer frontalement au système avec des grèves, des blocages, des manifs sauvages, des piquets de grève ; et un front parallèle, construire dès maintenant une alternative. C'est la stratégie du pouvoir populaire. Il faut que le système s'effondre de nos alternatives, qu'on construise des pouvoirs populaires encore plus forts que le pouvoir étatique et centralisé.
Propos recueillis par Olivier Besancenot
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
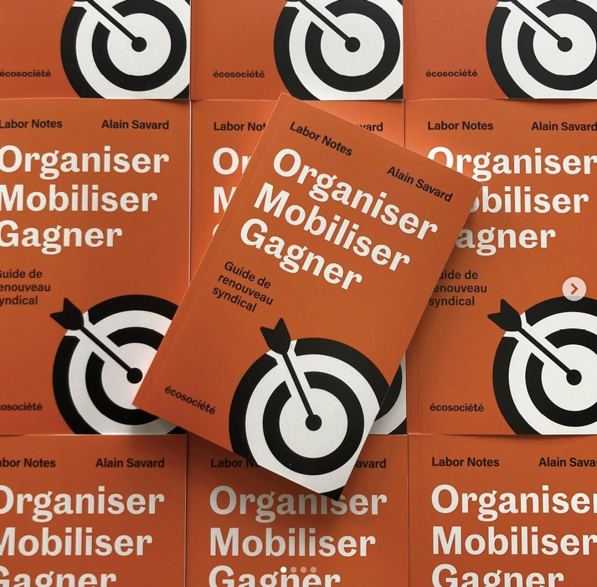
Tout le monde apporte son grain de sel (ou de sable !)
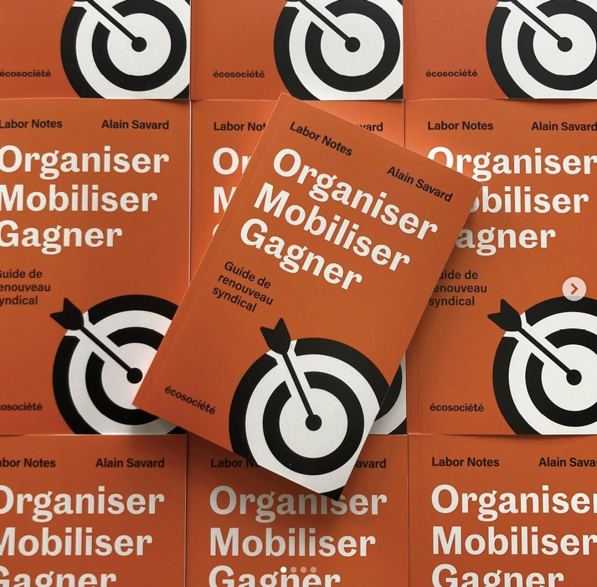
Plonger dans le livre Organiser, mobiliser, gagner : guide de renouveau syndical, c'est revenir à la base de l'implication syndicale. C'est prendre un pas de recul sur son action pour mieux comprendre son importance, qu'on milite depuis peu ou qu'on soit une personne d'expérience dans son syndicat.
Tiré du Point syndical.
Plonger dans le livre Organiser, mobiliser, gagner : guide de renouveau syndical, c'est revenir à la base de l'implication syndicale. C'est prendre un pas de recul sur son action pour mieux comprendre son importance, qu'on milite depuis peu ou qu'on soit une personne d'expérience dans son syndicat.
L'ouvrage est une adaptation québécoise du guide Secrets of a Successful Organizer de Labor Notes par le conseiller syndical de la CSN, Alain Savard. Son but est d'offrir une démarche « pour planifier des actions collectives qui fonctionnent ».
Certaines des 8 leçons ou des 47 « secrets » relèvent du gros bon sens. Et c'est vrai. Pour attirer plus de personnes aux assemblées, il faut interpeler les membres sur les enjeux qui les concernent. Logique. Mais pour savoir quels sont ces enjeux, il faut leur poser des questions et surtout, les écouter plus que leur parler.
À cette fin, prendre le temps de tenir des rencontres avec chacune et chacun des membres pour connaître leurs préoccupations est primordial. Il faut aussi chercher à les impliquer le plus possible en leur demandant de poser des actions simples et ciblées, comme porter un chandail d'une couleur précise ou encore signer une pétition. L'objectif n'est pas d'atteindre 100 % de participation le premier jour des moyens de pression, mais d'inclure progressivement les gens selon leur niveau de militantisme.
Le guide est rempli d'exemples de syndicats américains, canadiens et québécois qui ont mobilisé leurs membres sur des enjeux de premier et de deuxième front. Ces illustrations permettent de voir comment il est possible pour un syndicat de se positionner comme acteur de changement, de réaliser des gains en dehors des périodes de négociation et d'augmenter la mobilisation.
Le guide recourt à la cible d'un jeu de fléchettes pour représenter la constellation des membres en cinq paliers : le noyau, les militantes et militants, les sympathisantes et sympathisants, les désengagé-es et les hostiles. Le but est d'amener peu à peu chaque personne vers le centre pour solidifier le noyau et la relève.
Le guide n'a pas la prétention de nous permettre à tout coup de gagner nos luttes. Au contraire, l'auteur le mentionne clairement : « Vous perdrez plus souvent que vous gagnerez », mais chaque échec vient avec un apprentissage pour la suite.
Pour consulter l'ouvrage, c'est ici !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
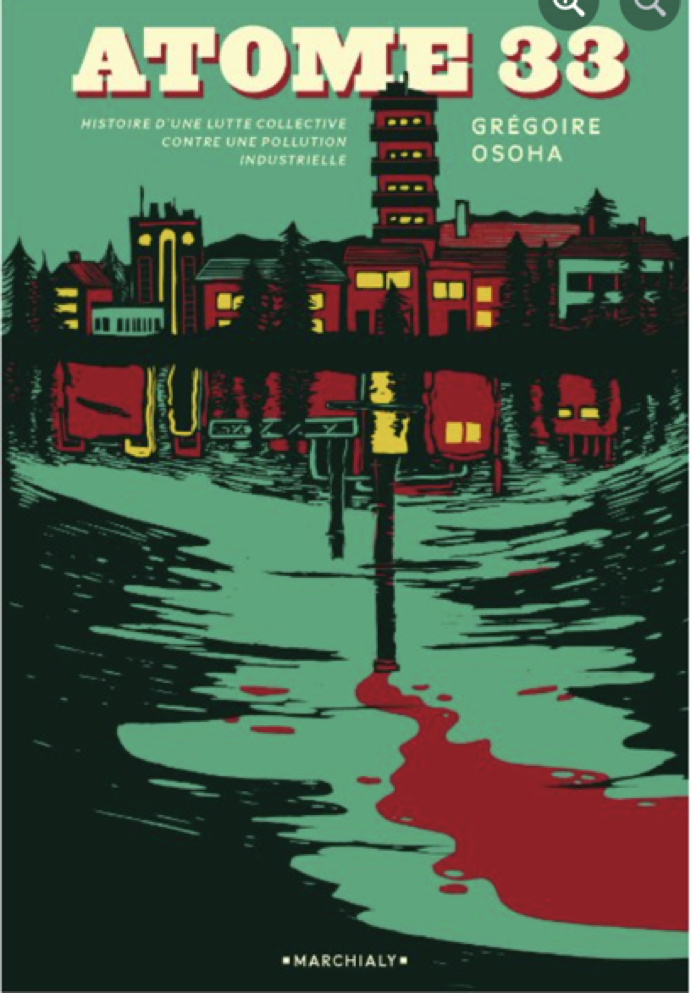
Atome 33 : Histoire d’une lutte collective contre une pollution industrielle
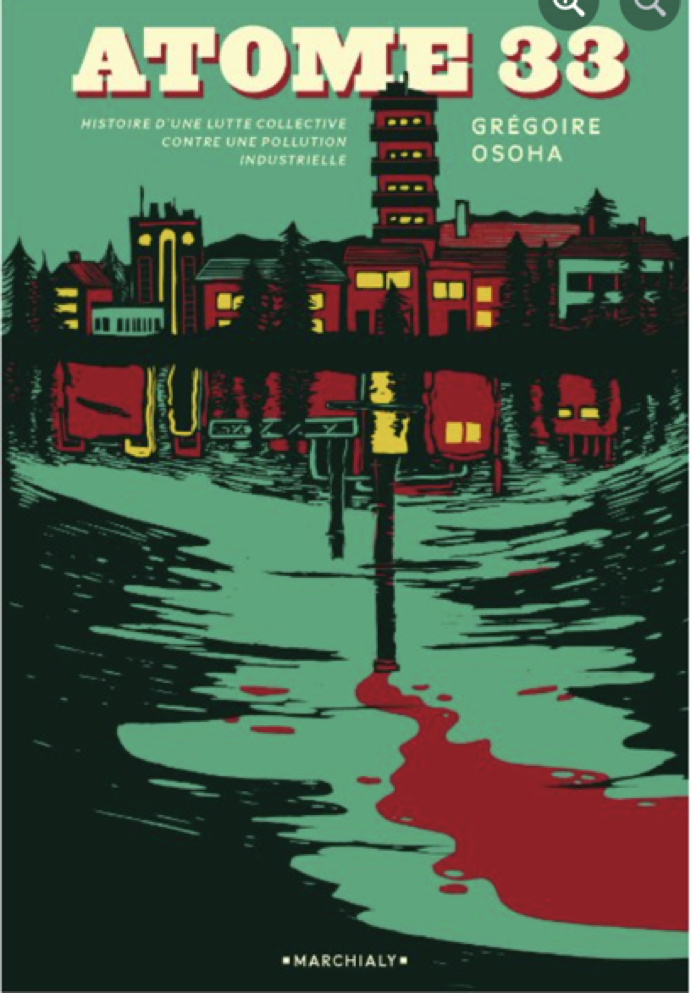
Rouyn-Noranda est une ville prospère de l'ouest du Québec construite autour de la fonderie de cuivre Horne. Lorsque ses habitants apprennent en 2019 que leurs enfants présentent un taux d'arsenic bien supérieur à la moyenne, ils se tournent vers la fonderie pour lui demander de réduire sa pollution invisible. Ce qu'ils ne mesurent pas alors, c'est l'immense influence de l'entreprise face à eux, qui n'est autre que le géant mondial des matières premières : Glencore.
Grégoire Osoha a suivi l'action collective de ces citoyens déterminés et retrace l'histoire de la fonderie et de la multinationale. Il tente ainsi de comprendre pourquoi il est si difficile d'obtenir gain de cause quand bien même la santé est impactée et pointe les dérives d'un système qui semble prêt à tout au nom du profit.
Lire un extrait.
Grégoire Osoha a travaillé plusieurs années pour Amnesty International France, il est aujourd'hui journaliste indépendant, réalisateur de documentaires et de podcasts. Atome 33 est son deuxième livre chez Marchialy après Voyage au Liberland.
À paraître le 25 février en Europe et au Canada un peu plus tard aux Éditions Marchialy.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Macron trahit la gauche et les écolos sur la question sahraouie

La reconnaissance par Macron de la marocanité du Sahara occidentale cachait des visées vite débusquées par des spécialistes. Ouvrir le territoire sahraoui aux intérêts des Groupes français afin d'y exploiter ses gisements miniers et maritimes. Une manif ce samedi 14 janvier pour dénoncer le coup du Khanjar du Président !

De Paris, Omar HADDADOU
Indignées, Alger et la Gauche française montent au créneau, contre Macron ! De la dernière colonie en Afrique, s'élèvent les voix de la Révolution pour l'Autodétermination de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD). Epuisées par le voyage jusqu'à Paris, les Militantes sahraouies et leurs enfants, avaient conservé ce sourire rayonnant, malgré le froid, conférant à leur beauté naturelle toute la puissance enchanteresse.
A celles et ceux qui prenaient part à la mobilisation, Place de la République, ce samedi 14 janvier, elles distribuaient des dattes et des bouteilles d'eau sous un florilège de chants patriotiques en arabe, les drapeaux nationaux en agitation continue : « Saluez Révolutionnaires, saluez ! Tous (es) les Révolutionnaires ! Ô peuple révolutionnaire, nous sommes Révolutionnaires et la terre libre, est aux Sahraouis (es) ! ».

Puis la voix d'un représentant de l'Association de la Communauté sahraouie en France de retentir : « Une seule solution, arrêtez l'occupation ! ».
Mais le coup porté par le chef de l'Etat français en s'arrogeant la latitude de fouler du pied les droits du peuple sahraoui et les résolutions de l'ONU, a mis le feu aux poudres à une vraie crise diplomatique entre Paris et Alger, sur fond de levée de boucliers de la Gauche et des Ecologistes français.
Rappelons ce fait marquant de la missive adressée le 30 Juillet au roi du Maroc. Emmanuel Macron affirmait, avec aplomb, que « le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ».
La déclaration de Fabien Roussel (PCF) en dit long sur les ambitions prédatrices et hégémonique d'Emmanuel Macron : « Il ouvre une crise diplomatique grave pour poursuivre le pillage de l'Afrique, dont les grandes richesses naturelles du Sahara Occidental ».

Une mise à nu étayée par la cheffe des Ecologistes, Marine Tondelier qui parle de « trahison de la position historique de la France ».
RECONNAISSANCE DE LA MAROCANITE DU SAHARA CONTRE INVESTISSEMENTS (ILLEGAUX) DANS LES TERRITOIRES OCCUPES !
Une résurrection néocolonialiste opéré par un Macron qui voit son statut de chef de l'Etat s'effriter lamentablement et ses gouvernements assignés à la queue leu leu pour remettre leur démission. La Gauche a de la matière observable sous les auspices de l'ingénu Bayrou, potentielle victime de la prochaine « secousse tellurique gouvernementale ». L'irréversibilité de la disgrâce du Président, est ponctuée par la supercherie et l'illusion cocasses de « France Afrique ».
Empoignant son bâton de pèlerin, Macron part à la conquête de zones d'influence et la promotion du protectionnisme des intérêts des entreprises françaises sur les territoires occupés du Sahara occidental.
Un espace dont le sous-sol suscite des convoitises par sa richesse considérable en minerais. De quoi éperonner les velléités hégémoniques d'Emmanuel Macron : On y relève d'importants gisements, tels que le fer, nickel, tungstène, titane, manganèse pierres précieuses, uranium, vanadium, et les très prisés : galène et bismuth pour leur importance stratégique dans l'industrie aéronautique et spatiale.
A noter aussi des filaments de grenats, rubis, saphir, topaze, béryl et tourmaline. Les tréfonds abriteraient également du pétrole à Al Ayoun et au sud-ouest. En reconnaissant la marocanité du Sahara occidental, Macron espère décrocher le Jackpot !
La mobilisation de ce samedi appelait avec force au respect des décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) et du Droit international. Elle exprimait son indignation face à l'attitude du gouvernement français qui encourage les entreprises à violer le Droit européen en investissant dans les territoires occupés du Sahara occidental. Le Président français s'est hasardé avec suffisance dans une ingérence délétère. Il cultive l'utopie que tout se décide à Paris !
Le réveil du Sahel lui a prouvé un changement de la donne.
En témoigne, le rejet catégorique par l'Indépendantistes sahraouis, le 17 octobre 2024, du projet de « partition » du Sahara occidental, soumis au Conseil de sécurité.
Le positionnement de la France témoigne - t-il de l'esprit vindicatif d'Emmanuel Macron envers Alger qui voit ses engagements diplomatiques et sa souveraineté bafoués en vertu d'un phantasme colonial atavique ? La crise diplomatique est plus que jamais consommée !
O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’Organisation Fief ; pose des pierres importantes...

L'organisation des femmes indépendantes, éduquées et féministes (FIEF) a organisée le samedi 14 décembre 2024, la première édition du Forum sur l'Inclusion et l'Autonomisation des Femmes à l'Hôtel Kinam, Pétion-Ville.
Plusieurs personnalités « toutes de sexes féminins », étaient présentes pour intervenir à cette activité : Sinedie S.Dupuy, Christine Stephenson et sans oublier la présence de Melodie BenJamin.
D'après les propos de la Présidente de FIEF madame Yvenie Chouloute : ” être féministe ne signifie pas être en désaccord avec le genre masculin, ni un mouvement qui vise à dénigrer les hommes ". Les deux autres intervenantes ; Mme Christine et Mme Dupuy, se rangent à cet avis en y ajoutant que « le féminisme est plutôt un combat qui tend à accélérer l'égalité, le leadership et les possibilités pour les femmes et les filles. »
L'objectif de ce forum était ; d'encourager la participation active des femmes dans les secteurs-clés de l'économie, de les inciter à être plus présentes dans les sphères publiques et privées. Tout un programme a été mis en place pour favoriser la réussite de cette journée : (panels de discussion avec des expertes, des leaders d'opinion et des femmes inspirantes, projection, Ateliers interactifs, Séances de photos individuelles, réseautage, etc.)
En termes d'affluence, pour la première réalisation de cet événement qui prône l'inclusion et l'autonomisation des femmes, on peut sans hésiter parler de grande réussite, d'après la présidente, son attente est comblée et déjà, elle commence à penser à la prochaine édition qui devrait se tenir en 2025.
Crédit Photos : Youbens Cupidon et Caleb François
Rédaction : Francois Alfred Dieudonné Junior en collaboration avec Smith PRINVIL
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Pour conjurer l’oubli de la Kanaky

Six mois après les révoltes en Nouvelle-Calédonie, Mediapart est parti à la rencontre des indépendantistes kanak, en tribu, dans les quartiers populaires de Nouméa, mais aussi dans la « brousse », au nord de la capitale. Avec pour objectif de donner la parole à celles et ceux qui en sont d'ordinaire privés.
Tiré du blogue de l'autrice.
« La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime, un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face. » La colonisation fait aussi partie de ce présent français sur lequel Emmanuel Macron refuse aujourd'hui de poser des mots aussi forts que ceux qu'il avait prononcés durant sa première campagne présidentielle au sujet de l'Algérie. Un présent que subissent au quotidien des dizaines de milliers de Kanak dans un archipel perdu au milieu de l'océan Pacifique, à 17 000 kilomètres de la métropole.
Lorsque les révoltes ont éclaté en Nouvelle-Calédonie au mois de mai, Mediapart a continué de documenter cette crise au cœur de ses engagements éditoriaux depuis sa création. Par le biais d'enquêtes, d'analyses, d'entretiens, mais aussi de reportages réalisés sur place par notre correspondant, le journaliste Gilles Caprais. Six mois plus tard, une fois le calme revenu et l'effervescence médiatique retombée, un impératif s'est imposé : il fallait retourner dans l'archipel, donner à voir et à entendre celles et ceux pour qui rien n'est réglé.
Pendant deux semaines, du 9 au 24 novembre, nous sommes donc partis à la rencontre des indépendantistes kanak, en tribu, dans les quartiers populaires de Nouméa, mais aussi dans la « brousse », au nord de la capitale. Sur notre route, nous avons aussi croisé celle de militant·es loyalistes et d'habitant·es issu·es de toutes les communautés qui composent la mosaïque calédonienne. Autant de personnes qui ont pris le temps, beaucoup de temps, pour se confier sur leurs histoires, leurs inquiétudes et leurs aspirations.

Ce reportage a aussi été l'occasion de mesurer physiquement les effets de la répression qui s'est abattue sur l'archipel au cours des derniers mois. La présence massive des gendarmes, sur les routes, dans les hôtels et dans les bars des quartiers chics de Nouméa ; le vrombissement régulier de leurs drones planant au-dessus de nos têtes ; ce sentiment diffus d'être observés dans chacun de nos mouvements. Mais aussi la dureté d'une capitale scindée en deux, où personne ne marche dans le centre-ville et où les destins se croisent rarement.
Aller en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, c'est aussi se départir de nos réflexes occidentaux pour découvrir un rapport au monde et aux mots différent du nôtre. Les mères y sont appelées « mamans » et les Européens qualifiés de « Blancs », sans que cela revête une quelconque connotation paternaliste ou raciste. La coutume, qui régit la société kanak et place l'humain au cœur de ses préoccupations, imprègne chaque échange. Il n'y a pas de petites phrases, de fausses confidences ou d'écume politique, telles qu'on peut en connaître en métropole. La parole y est aussi directe que précieuse. Et le temps n'a plus besoin de montre.
Durant notre reportage, nous avons aussi pu constater que beaucoup de peurs traversent aujourd'hui l'archipel. Et qu'il en est une qui ronge par-dessus tout les esprits : la peur de l'oubli. L'oubli de celles et ceux qui vivent loin et ne savent rien de ce qui se trame dans ce bout du bout du monde. L'oubli du passé que certain·es voudraient balayer. L'oubli de la culture kanak, de ses langues, et de son lien indéfectible à la terre. L'oubli du monde de l'invisible et de la parole des « vieux ». L'oubli du respect et de l'humilité que chacun·e leur doit.
Six mois après les révoltes qui ont embrasé la Nouvelle-Calédonie, Mediapart est donc revenu dans les lieux de la mobilisation dans l'espoir de conjurer cet oubli. Et vous propose le récit, en six épisodes, d'une indépendance déniée.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
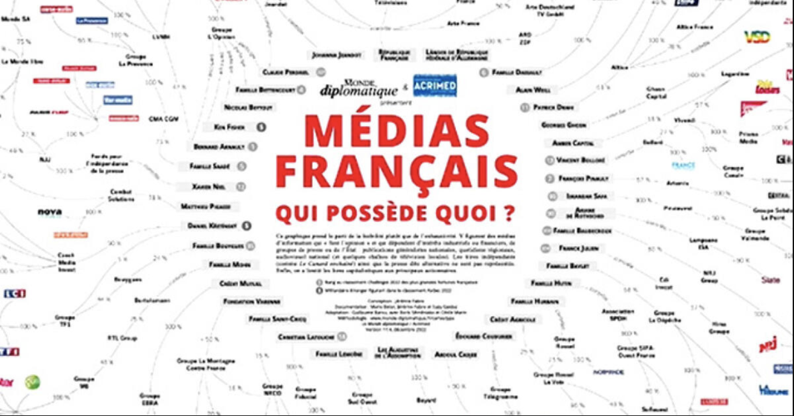
Comment les médias indépendants peuvent exister et porter d’autres voix ?
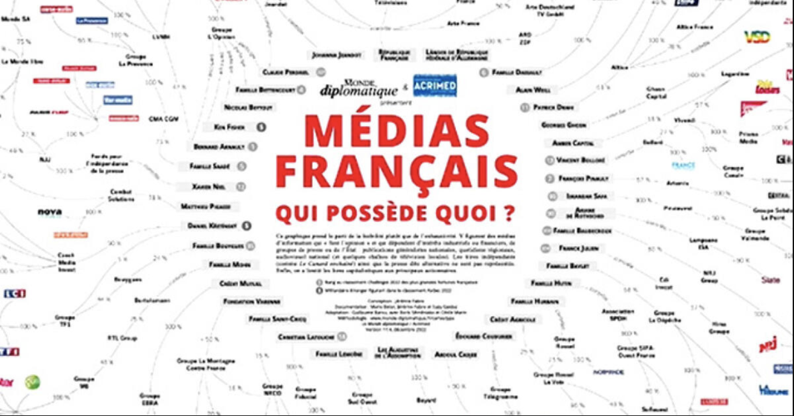
Face à CNews et BFMTV, comment les médias indépendants peuvent exister et porter d'autres voix ? StreetPress se pose la question dans ce podcast vidéo avec Valentine Oberti de Mediapart, Paloma Moritz de Blast et Seumboy d'Histoires Crépues.
Tiré du blogue de l'auteur.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Ligue des travailleuses domestiques reçoit le Prix Orfinger-Karlin de la Ligue des droits humains

Ce dimanche 8 décembre, la Ligue des droits humains a décerné le Prix Régine Orfinger-Karlin à la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC. Cette association rassemble des femmes sans-papiers de toutes origines qui travaillent comme aide soignantes, nounous, aide-ménagères, etc., en région bruxelloise et qui bataillent pour une reconnaissance de leur travail, invisible mais essentiel. Avec ce Prix, la Ligue des droits humains veut souligner la ténacité et le courage de la Ligue des travailleuses domestiques, ainsi que la force et la créativité de leurs actions.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Depuis 2018, la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC, accompagnée par le CIEP MOC Bruxelles, soulève des montagnes pour faire reconnaître leurs droits. Ces femmes, sans-papiers, originaires d'Amérique latine, d'Asie (Philippines), ou encore d'Afrique, travaillent comme domestiques chez des particulier·ères, souvent dans des familles aisées. Elles nettoient les maisons, gardent les enfants ou prennent soin des personnes âgées. On estime que ces femmes sont entre 70 et 80 000 en Belgique.
Visibiliser les travailleuses invisibles
Ces travailleuses de l'ombre ont décidé de revendiquer haut et fort des droits : elles demandent un accès légal au marché du travail afin de mettre fin à la précarité de leur situation et de pouvoir cotiser à la sécurité sociale, ainsi qu'un accès aux formations d'Actiris pour les métiers en pénurie. Par ailleurs, les travailleuses domestiques exigent une protection juridique qui leur permette de porter plainte en toute sécurité et dignité contre les employeurs abusifs.
Ténacité et créativité
En remettant le prix Régine Orfinger-Karlin à la Ligue des travailleuses domestiques, la LDH souhaite mettre un coup de projecteur sur une cause méconnue et saluer la détermination et la créativité de cette association. Les travailleuses domestiques portent leurs revendications partout où elles le peuvent :en juin 2022, la Ligue des travailleuses a créé son propre Parlement sur la place du Luxembourg pour dénoncer l'exploitation et les violences auxquelles elles font face au quotidien et interpeller les ministres compétents. Le 25 novembre 2022, les travailleuses ont déposé une motion devant le Parlement bruxellois. Lors de la journée internationale du travail domestique en juin 2023, elles ont monté un procès fictif devant le Palais de justice de Bruxelles qui s'est soldé par la condamnation du gouvernement bruxellois pour son manque de courage politique. Dans la foulée, elles ont déposé plainte au Parlement européen pour signaler le non-respect de plusieurs directives européennes par la Région. En juin 2024, les travailleuses en grève ont créé leur gouvernement idéal et ont défilé lors d'un “gala” pour mettre en valeur leurs efforts. La force, la ténacité et la créativité de leur combat forcent l'admiration.
Bamko et le Collectif les 100 diplômées
Deux autres associations ou collectifs étaient nommés pour cette édition 2024 du Prix Régine Orfinger-Karlin, du nom de cette résistante et avocate des droits humains qui a marqué l'Histoire de la LDH : le Collectif les 100 diplômées qui bataille sans relâche pour l'accès à l'enseignement et au monde travail pour les femmes qui portent le foulard ainsi que Bamko, centre de réflexion féministe qui enrichit le débat autour de la lutte contre le racisme ou encore la décolonisation de l'espace public.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Lithium en Argentine : comment penser une transition juste et féministe dans le gouvernement Milei

L'article de Terra Nativa - Amis de la Terre Argentine [Tiera Nativa - Amigas de la Tierra] aborde le contexte politique du pays et ses impacts sur la nature.
Tiré de Capire
04/10/2024 | Tierra Nativa – Amigas de la Tierra Argentina
Marí Fer
Le scénario politique, économique, social et environnemental en Argentine est marqué par des reculs permanents lorsque l'on parle de droits. L'extrême droite progresse simultanément et rapidement sur plusieurs fronts, affaiblissant notre démocratie et notre tissu social. Dans les premiers mois du gouvernement Milei, nous avons vu comment les impacts des politiques néolibérales touchent directement la vie des gens, en particulier dans les secteurs populaires, où l'État continue d'être absent et en recul constant. Le président cherche à imposer les règles du marché à toutes les relations sociales, ayant comme principal outil la destruction des structures de l'État. La réforme institutionnelle est telle que le Ministère de la déréglementation et de la transformation de l'Étata été créé, un organisme dont l'objectif est de « réduire les dépenses publiques ».
En même temps, quelques jours après l'investiture du gouvernement, le ministère de la Sécurité a créé le soi-disant Protocole pour le maintien de l'ordre public, un mécanisme de criminalisation des manifestations et des organisations sociales. Le protocole criminalise les blocages de rues et de routes, ce qui signifie que toute personne participant à une manifestation peut être considérée comme un criminel. Il convient de noter que le protocole n'est pas clair sur l'utilisation des forces de sécurité nationales et ne leur interdit pas expressément d'utiliser des armes à feu.
Ce contexte a conduit à l'institutionnalisation d'une série de mesures que le gouvernement met en œuvre depuis son arrivée au pouvoir : des milliers de licenciements dans l'État ; la réduction des ministères nationaux (dont le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et le Ministère de la Femme, du Genre et de la Diversité) ; une dévaluation brutale de la monnaie nationale ; le retrait des subventions pour les transports et les services de base, avec de fortes augmentations des tarifs ; suppression du financement des universités publiques et du système scientifique national ; fermeture des médias publics ; fermeture des organismes nationaux axés sur la préservation des droits humains, des droits de la communauté LGBTQI+ et des peuples autochtones ; interdiction d'utiliser des concepts tels que « changement climatique », « agroécologie », « genre » et « biodiversité » dans les espaces liés à l'État ; suspension de la livraison de nourriture aux cuisines communautaires ; fin de la distribution de médicaments gratuits pour les patients atteints de cancer et de maladies chroniques ; coupes dans le budget du système de santé publique ; entre autres.
Cette combinaison d'actions affecte directement l'économie familiale, augmentant les taux de pauvreté et d'indigence. L'une des dernières actions du gouvernement a été d'opposer son veto à une loi qui proposait d'augmenter le montant minimum de la retraite pour plus de 8 millions de retraités, qui sont actuellement en dessous du seuil de pauvreté.
Ce revers s'est produit à travers le projet de loi « Bases et points de départ pour la liberté des Argentins », qui a été approuvé par le Congrès national malgré des mobilisations populaires massives contre lui. Alors que le projet de loi était débattu au Parlement, les forces de sécurité nationales ont brutalement réprimé les manifestations. Selon le Centre d'études juridiques et sociales (CELS), la répression a laissé 665 personnes avec différents types de blessures dans la seule ville de Buenos Aires. 47 travailleurs des médias ont été blessés et 80 personnes ont été arrêtées arbitrairement lors de manifestations dans les villes de Córdoba, Rosario et Buenos Aires. Le dernier d'entre eux a été libéré après trois mois dans une prison de haute sécurité pour « terrorisme » et « tentative de coup d'État ».
Au sein de cette énorme loi de réforme de l'État se trouve le grand Programme d'incitation à l'investissement (RIGI). Avec cette nouvelle structure, il cherche à stimuler les investissements dans les mines, le pétrole, le gaz et l'agriculture pendant 30 ans grâce à des politiques fiscales et douanières qui ne profitent qu'aux capitaux étrangers. RIGI cherche à consolider un modèle de spécialisation productive dans lequel l'Argentine est un simple exportateur de matières premières, dans un processus dirigé par des entreprises transnationales et sans aucune articulation avec la structure productive nationale. En vertu de ce régime, les sociétés transnationales doivent fournir 40 % de l'investissement initial au cours des deux prochaines années. À partir de la troisième année, ils pourront utiliser totalement gratuitement les dollars générés par les exportations, ce qui réduira à l'avenir la disponibilité de devises étrangères dans le pays. De plus, ils pourront bénéficier d'avantages fiscaux pendant trente ans.
Carte de la colonisation contemporaine : le lithium en Argentine sous contrôle transnational
Le lithium est un bien naturel commun qui joue un rôle stratégique dans la transition énergétique et est crucial dans le différend géopolitique. Pour aborder cette question de manière globale, en plus du RIGI, il est essentiel d'analyser la performance internationale de Milei, qui est pleinement alignée sur les intérêts des États-Unis. Depuis son entrée en fonction en tant que président, Milei a effectué 12 voyages à l'étranger,passant 47 jours à l'extérieur du pays, les États-Unis étant la destination la plus fréquente. Ses liens avec Elon Musk, qui est également à l'origine du lithium argentin pour sa société Tesla, sont bien connus. Lors de l'un de ses nombreux voyages aux États-Unis, Milei a rencontré l'homme d'affaires, concluant des accords pour éliminer « les obstacles bureaucratiques et promouvoir le marché libre ». Une autre de ses destinations était l'Espagne, où il a présenté son livre Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica [Capitalisme, socialisme et piège néoclassique] et il a assisté à un événement pour le parti d'extrême droite Vox.
L'Argentine est le pays qui possède les deuxièmes plus grandes réserves de lithium au monde et forme, avec le Chili et la Bolivie, ce que l'on appelle le « triangle du lithium ». Alors que ce minéral est considéré comme une ressource stratégique dans des pays comme le Chili, la Bolivie et le Mexique, en Argentine les lois continuent de répondre aux intérêts des grandes entreprises. La perte de souveraineté nationale sur nos actifs stratégiques ouvre la voie à un pillage illimité par les sociétés transnationales. Ainsi, un modèle économique dépendant et extractif se perpétue qui génère de la pauvreté dans les régions où la richesse est extraite.
Le lithium a commencé à être exploité dans les années 1980. Cependant, son exploitation s'est intensifiée au cours des première et deuxième décennies des années 2000. Les exportations de lithium ont augmenté rapidement depuis lors. En Argentine, la production de lithium a augmenté de 72,2 % entre 2015 et 2020, selon les données du Secrétariat des mines de 2021.
Chez Tierra Nativa, nous avons fait une carte des projets de lithium en opération dans le pays. Elle montre l'extranéité qui caractérise le contrôle de cette production. Cette cartographie géoréférencée révèle la concentration de projets de lithium sous le contrôle de sociétés transnationales du Nord, ce qui en fait un outil fondamental pour comprendre les nouvelles formes de colonialisme économique et environnemental à l'œuvre dans notre région. En même temps, cela nous permet de réfléchir à des stratégies pour une transition énergétique juste.
Élaboré par : Giuliana Alderete
Pour une transition juste, féministe et populaire
Actuellement, l'ère des ressources non renouvelables telles que le pétrole et le gaz naturel touche à sa fin, et cela n'est pas seulement dû à la finitude de ces ressources, mais aussi aux vastes preuves scientifiques sur la grande pollution qu'elles génèrent, contribuant à l'accélération du changement climatique. Cette question est à l'ordre du jour du Nord, du Sud, des organisations multilatérales, des États et, surtout, des grandes entreprises.
Notre système énergétique est un système colonial dominé par les grandes transnationales, avec concentration de la propriété, privatisation des entreprises publiques, augmentation de la consommation et plus grande participation du pouvoir des entreprises à la politique énergétique des États. L'Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que l'Afrique et une grande partie de l'Asie, se caractérisent par l'exploitation des territoires et des zones sacrifiées. Les peuples autochtones, les Noirs et les communautés paysannes sont en première ligne contre les projets extractifs à grande échelle dans notre Sud.
La précarité énergétique est une réalité dans nos pays et creuse les inégalités. La marchandisation de l'énergie et les tarifs élevés empêchent les familles pauvres d'avoir un accès garanti à ce service. L'utilisation du bois de chauffage et du charbon de bois pour cuisiner augmente encore plus en temps de crise et affecte particulièrement la vie quotidienne et la santé des femmes, qui sont responsables des tâches de soin et de reproduction de la vie.
Le secteur de l'énergie est l'un des principaux responsables des conflits environnementaux et des violations des droits des peuples et des territoires. La politique énergétique est profondément liée à la géopolitique, aux politiques de développement et aux intérêts du capital transnational dans les secteurs de l'agro-industrie, des combustibles fossiles et des mines. Le contrôle des réserves et la contestation des sociétés transnationales pour l'exploitation de ces réserves font partie des motivations des coups d'État et des interventions dans les processus politiques des pays d'Amérique latine. Cela était évident lors du coup d'État en Bolivie en 2019, avec l'arrivée de la société d'Elon Musk au Brésil sous le gouvernement Bolsonaro et sa récente arrivée en Argentine sous le gouvernement Milei.
Le différend sur cette « transition » affecte nos démocraties. Par conséquent, cela affecte également la vie juste et souveraine de nos peuples. Il est nécessaire et urgent de réfléchir à la manière dont nous allons nous organiser pour que cette transition se fasse dans une perspective féministe et populaire. C'est-à-dire un processus qui construit, en même temps, des stratégies contre les différents systèmes d'oppression de genre et de classe et contre le racisme, le colonialisme, le fascisme et l'impérialisme.
En ce sens, Tierra Nativa défend la souveraineté économique et politique des États, la nationalisation des actifs stratégiques, la construction populaire des politiques publiques et de la planification de l'État, et le renforcement des liens régionaux en tant que stratégie fondamentale. Notre intention est que ce débat serve de contribution pour continuer à réfléchir à de nouveaux horizons.
Édition par Bianca Pessoa
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
Langue originale : espagnol
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
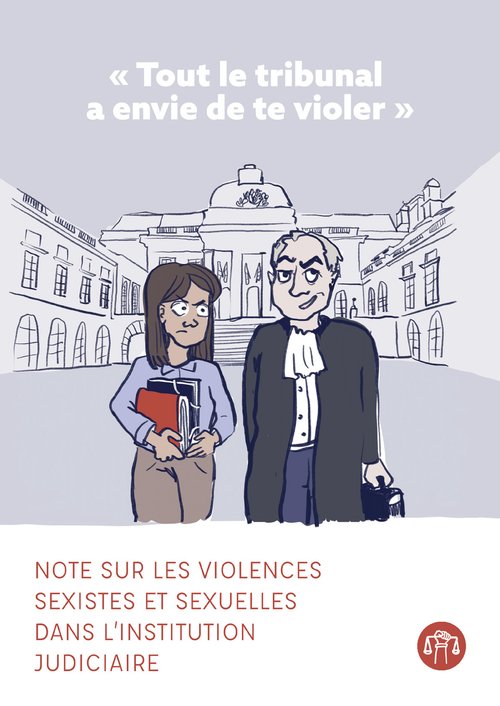
« Tout le tribunal a envie de te violer »
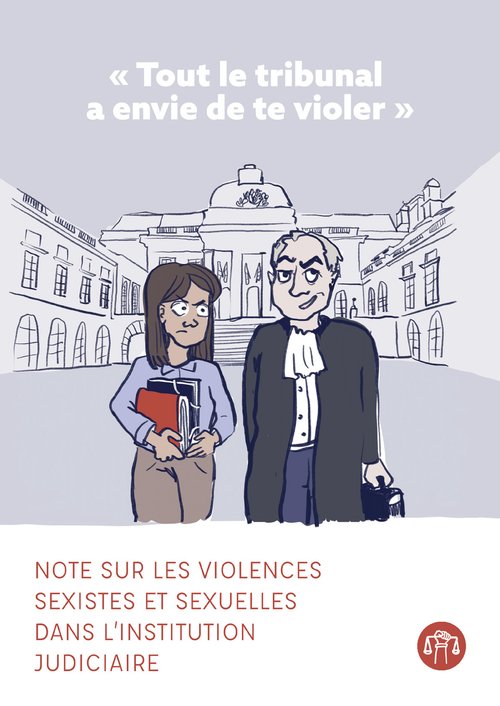
Alors que la société française prend, année après année depuis le début de #Metoo, la mesure du caractère structurel des violences sexistes et sexuelles, les attentes fortes de justice suscitées par cette prise de conscience se heurtent encore à des formes d'inertie ou de résistances de l'institution judiciaire et de ses membres.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Dans ce contexte, le Syndicat de la magistrature a décidé d'évaluer l'ampleur de ces comportements au sein même de l'institution judiciaire et questionner les rapports de genre. Il s'agissait d'interroger la capacité de l'institution judiciaire à jouer son rôle dans le traitement, la sanction et la réparation de ce type de faits.
Le Syndicat de la magistrature a ainsi adressé à l'ensemble des magistrat·es un questionnaire, sous la forme d'une enquête dite de victimation. Il leur a été demandé s'ils·elles avaient déjà été victimes ou témoins de VSS au sens large au sein de l'institution judiciaire. Une série de questions leur a été posée sur la nature des faits, l'éventuel rapport hiérarchique avec l'auteur, les conséquences des faits, la manière dont a été traité leur signalement en interne, etc.
Les 525 réponses complètes obtenues (qui s'ajoutent aux 447 formulaires partiellement ou totalement remplis mais non validés, soit 972 au total) permettent d'esquisser l'ambiance sexiste, homophobe et transphobe dans la magistrature.
La note publiée ce 5 écembre 2024 (ci-dessous), intitulée « Tout le tribunal a envie de te violer – note sur les violences sexistes et sexuelles dans l'institution judiciaire », analyse les réponses au questionnaire envoyé, dresse un état des lieux de la question et propose des pistes d'amélioration.
Ce premier travail a vocation à ouvrir de nouveaux débats et à initier des changements pour les personnels de justice mais aussi – et surtout – pour les justiciables, qui attendent légitimement une réponse à la hauteur des enjeux à l'œuvre pour notre société.
Télécharger la « Note sur les violences sexistes et sexuelles au sein de l'institution judiciaire »
***
Introduction
Alors que la société française prend, année après année depuis le début de #Metoo, la mesure du caractère structurel des violences sexistes et sexuelles, les attentes fortes suscitées par cette prise de conscience vis-à-vis de la Justice se heurtent encore à des formes d'inertie ou de résistances auprès de certain·es magistrat·es. C'est dans ce contexte que des débats ont émergé, au sein du Syndicat de la magistrature, sur la nécessité d'évaluer l'ampleur de ces comportements au sein même de l'institution judiciaire. Après tout, pourquoi les tribunaux, les cours d'appel, l'École nationale de la magistrature, les services de l'administration centrale, échapperaient-ils à ce phénomène ? Les hommes et les femmes de justice sont, comme leurs concitoyen·es, aux prises avec les structures patriarcales de notre société. Si certains faits très graves font l'objet de poursuites pénales ou sont sanctionnés disciplinairement, des gestes ou des propos problématiques, s'apparentant parfois à des délits, sont évoqués au détour de conversations de couloir ou de cantine, ici et là, sans pour autant susciter de réaction institutionnelle. Alors que les auditeur·rices de justice – magistrat·es en formation – ont courageusement commencé à aborder cette question et que le principe d'un projet d'étude sur le sujet au sein du ministère de la Justice a été récemment adopté, aucune enquête approfondie n'a pour l'heure été menée.
S'interroger sur les violences sexistes et sexuelles qui seraient commises entre les professionnel·les de la justice, ce n'est donc pas seulement questionner les rapports de genre en son sein, c'est aussi et d'abord interroger la capacité des membres de l'institution judiciaire à jouer leur rôle dans le traitement, la sanction et la réparation de ce type de faits. Autrement dit, comment un procureur qui tente d'embrasser une auditrice de justice dans un couloir du tribunal orientera-t-il les enquêtes qu'il supervise dans ces matières ?
Il est rapidement apparu que la seule manière d'objectiver les violences sexistes et sexuelles dans la magistrature était d'interroger les magistrates et magistrats sur ce dont ils et elles avaient été victimes et/ou témoins. Un groupe de travail interne au syndicat a été constitué, notamment afin d'établir un questionnaire qui a ensuite été adressé à l'ensemble des juges et parquetier·ères de France ; sur environ 9 000 magistrat·es et auditeur·ices de justice, 525 y ont répondu, taux de réponse qui permet d'obtenir un premier aperçu de la situation, d'autant plus qu'au sein de la justice comme ailleurs, témoigner de ces faits, y compris de manière anonyme, est loin d'être une évidence.
Notre enquête conduit à un premier constat : l'institution est bien confrontée aux violences sexistes et sexuelles, très majoritairement sous la forme de propos ou de faits de harcèlement, mais également sous la forme d'agressions sexuelles et de viols. Les réponses mettent en évidence que ces violences sont le fait d'un double rapport de domination de genre et de hiérarchie, au sein d'une institution pyramidale. Les répondant·es se sont tous·tes dit·es en attente de réaction de la part d'une institution qui, à l'évidence, ne parvient pas à prévenir et traiter correctement ces situations. Ce premier travail d'état des lieux, d'analyse et de propositions a vocation à ouvrir de nouveaux débats et changements pour les personnels de justice mais aussi (et surtout), pour les justiciables qui attendent légitimement une réponse à la hauteur des enjeux à l'œuvre pour notre société.
https://www.syndicat-magistrature.fr/toutes-nos-publications/nos-guides-et-livrets/note-vss-2024/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Lettre ouverte aux négociateurs de l’Arizona : "Pas de traversée du désert pour les droits des femmes !"

À l'heure où l'avenir de notre État fédéral se joue entre vos mains, au gré de vos négociations, coups de force, de poker ou de théâtre, nous tenons à vous faire part de notre sérieuse inquiétude quant au sort réservé aux droits des femmes.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Messieurs,
Nous, associations luttant quotidiennement pour une société plus égalitaire et plus juste, avons pris connaissance des déclarations de politique régionale et communautaire, en Wallonie comme en Flandre, et constatons amèrement qu'elles nous donnent plus de craintes pour l'avenir que de garanties pour nos droits. Au nord comme au sud du pays, les lunettes de genre semblent absentes sur des questions aussi cruciales que le logement ou l'emploi, et les chapitres « égalité » apparaissent bien maigres. L'accueil de la petite enfance, enjeu central pour l'accès des mères au marché du travail, se voit contaminé par des logiques marchandes et l'introduction, voire le renforcement, de priorités données aux parents qui travaillent porte atteinte au principe d'égalité entre les enfants.
« Ce qui filtre (ou ne filtre pas) des négociations est loin de nous rassurer »
À partir du moment où les mêmes partis – les vôtres – sont à la manœuvre dans les régions et au fédéral, comment ne pas redouter des politiques similaires pour votre futur gouvernement ? Ce qui filtre (ou ne filtre pas) des négociations de l'Arizona est par ailleurs loin de nous rassurer. Les réformes socioéconomiques sur la table risquent une fois de plus de toucher davantage les femmes, puisqu'elles sont statistiquement déjà plus pauvres que les hommes. La lutte contre les violences, ou pour l'égalité entre les femmes et les hommes ? Des non-sujets, semble-t-il. Sauf quand il s'agit de revenir en arrière, en proposant de supprimer les quotas de genre dans les CA des entreprises ? En Arizona, les droits des femmes pèsent peu face aux intérêts économiques…
Messieurs, l'avenir du pays, une fois encore, semble se décider « entre hommes ». Bien sûr, vous ne manquerez pas d'objecter : « Nul besoin d'être une femme pour mener des politiques d'émancipation pour tous et toutes ». Alors prouvez-nous que les enjeux d'égalité et que les droits des femmes, enjeux vitaux – car oui, il s'agit parfois de vie ou de mort ! – sont au cœur de vos préoccupations et de vos politiques. Montrez-nous que nos craintes ne se justifient pas et que la lutte contre les discriminations et les violences fondées sur le genre vous concerne au premier chef.
Laissez-nous tout d'abord vous rappeler qu'adopter des lunettes de genre pour chaque politique porte un nom : le gender mainstreaminget son corollaire, le gender budgeting. En l'occurrence, c'est une loi, donc une obligation à laquelle vous devrez vous conformer : celle d'évaluer en amont l'impact qu'aurait une mesure sur les femmes et sur les hommes et de rectifier le tir si cet impact devait se révéler différent en fonction du genre, donc discriminant. Cette application rigoureuse de la loi gender mainstreaming est un préalable et sous-tend dix mesures que nous estimons indispensables pour les droits des femmes et que nous vous conseillons fortement d'inscrire dans votre déclaration de politique générale (dix mesures qui ne sont pas listées ici par ordre de priorité) :
1.Créer un ministère des Droits des femmes et de l'Égalité de genre, de plein exercice, doté de moyens suffisants et maintenir la Conférence Interministérielle Droits des femmescomme outil de coordination des politiques d'égalité menées par les différentes entités fédérées, selon les principes de fonctionnement tels que définis sous la précédente législature.
2.Élaborer un nouveau plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre (PAN) assorti d'un budget conséquent, avec pour boussole laConvention d'Istanbul, en partant de l'évaluation du PAN 2021-2025 et avec une implication directe et structurelle de la société civile. Nous veillerons aussi à la mise en œuvre effective de la loi « Stop Féminicide ».
3.Améliorer la loi sur l'avortement selon les recommandations du rapport du groupe d'expert∙es multidisciplinaires, remis au Parlement en avril 2023, dont l'allongement du délai jusqu'à 18 semaines post-conception, la fin des sanctions pénales pour les femmes et les médecins et la suppression du délai de réflexion.
4.Supprimer le statut de cohabitant·e et permettre à tous, et surtout à toutes, la constitution de droits sociaux propres, personnels et assurantiels, dans une logique de sécurité sociale forte et égalitaire sans sabrer dans d'autres mécanismes comme les allocations de chômage. Nous nous opposons fermement à toute mesure visant à limiter les allocations de chômage au-delà de deux années !
5.Garantir une pension minimum digne et égalitaire, réellement accessible aux femmes, ce qui implique de supprimer la condition de vingt années de travail effectif (et certainement pas d'augmenter le nombre d'années !), de tenir compte de toutes les périodes assimilées, qu'elles soient prises pour des raisons de soin (crédit-temps pour s'occuper des enfants, par exemple) ou liées à une inactivité involontaire (incapacité/invalidité de travail), et de revaloriser les années travaillées à temps partiel. Alors que l'écart de pension entre femmes et hommes est déjà de 26%, nous nous inquiétons fortement d'une réforme qui viendrait encore appauvrir de nombreuses pensionnées.
6.Transformer le SECAL (service des créances alimentaires) en un fonds universel et automatique des créances alimentaires tel que préconisé par l'étude de faisabilité confiée par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes à la KU Leuven et l'Université d'Anvers etpubliée en octobre 2024.
7.Prendre en compte les spécificités genrées des parcours migratoires féminins, dont les violences que fuient les femmes, celles qu'elles rencontrent dans leur parcours etdans le pays d'accueil, dans le cadre d'une politique migratoire respectueuse de l'État de droit, de la Convention de Genève, de la Convention d'Istanbul et des droits humains fondamentaux.
8.Élaborer un plan d'action national contre le racisme, selon l'engagement pris par la Belgique à la Conférence de Durban de 2001, avec une réelle approche intersectionnelle et décoloniale qui reconnaît les formes de racisme qui affectent spécifiquement les femmes.
9.Revaloriser les métiers du soin, majoritairement féminins, dont on a vu le caractère essentiel durant la crise sanitaire, ce qui passe par une revalorisation salariale, de meilleures conditions de travail, une reconnaissance de la pénibilité de ces métiers et des maladies professionnelles qui y sont associées. Nous nous opposons fermement à toute coupe dans le secteur de la santé et du non-marchand ainsi qu'à tout ce qui mène à des emplois de plus en plus précaires qui rendent malades et ne permettent plus de vivre dignement (comme par exemple, l'élargissement des flexi-jobs à ces secteurs).
10.Garantir et renforcer les congés thématiques en les rendant plus accessibles, mieux rémunérés et mieux partagés. Pour que la conciliation entre nos vies professionnelle et familiale cesse de reposer sur les épaules des mères, et de les appauvrir !
Messieurs, il est grand temps de tenir compte de la moitié de la population belge dans vos négociations. Les droits des femmes et l'égalité de genre ne sont ni une matière résiduelle, ni une variable d'ajustement budgétaire ou un objet de marchandage politique. L'objectif de l'égalité demande de l'ambition, de la volonté politique et des moyens. Ne rien faire, c'est déjà reculer. Nous ne tolérerons aucun recul sur nos droits !
Signataires :
Carte blanche coordonnée par Vie Féminine et le Vrouwenraad
Awsa-Be (Arab women's solidarity association – Belgium)
BruZelle asbl
Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales (CPVCF)
Collectif contre les violences familiales et l'exclusion (CVFE)
Collectif des femmes
Des Mères Veilleuses
Elles pour Elles asbl
La Fédération des services maternels et infantiles (FSMI)
La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial
Femmes CSC
Fem&Law
Furia
GACEHPA (Groupe d'action des Centres extrahospitaliers pratiquant l'avortement)
Garance
Jump, Solutions for equity at work
La Voix des Femmes
Le Monde selon les femmes
Mode d'Emploi asbl
Sofélia
Solidarité Femmes La Louvière
Soralia
Synergie Wallonie pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Université des Femmes
Vie Féminine
Vrouwenraad (et ses membres)
Mis en ligne le 27 novembre 2024
https://www.axellemag.be/lettre-ouverte-feministes-negociateurs-arizona/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les Etats-Unis de Donald Trump : quels possibles contours sur le plan international ?

Le retour de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis ne peut rivaliser avec le choc de son accession en 2016. Toutefois, il oblige à opérer un véritable changement de perspective historique. En 2020, la victoire de Joe Biden a été considérée par les adversaires nationaux et internationaux de Trump comme une libération d'une crise de démence. Or, en 2024, c'est le mandat unique de Biden qui ressemble à une interruption de l'ère Trump provoquée par le Covid. En matière de politique étrangère, Trump a toujours suscité la confusion. Fut-il, lors de son premier mandat, une menace pour l'ordre mondial dirigé par les Etats-Unis ou une sorte de révélateur du véritable visage de cet ordre mondial ? Et qu'aurait fait exactement Trump si ses toquades n'avaient pas été si souvent contrecarrées par la bureaucratie de la sécurité nationale [politique de la défense nationale et des relations extérieures] et par sa propre incompétence ?
3 décembre 2024 | tiré du site alencontre.org
https://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/les-etats-unis-de-donald-trump-quels-possibles-contours-sur-le-plan-international.html
Ecrire sur Trump, c'est souvent sombrer dans la psychopathologie, ce qui est très bien dans la mesure où cela va de soi. Trump à Mar-a-Lago serait peut-être plus facile à supporter s'il ressemblait davantage à Tibère à Capri [allusion à l'empereur romain lors de son séjour de perverti à Capri au début de notre ère]. Mais loin d'être un libertin débauché, Trump est un abstinent forcené qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'au pouvoir et à la célébrité. Cette prédilection pour le pouvoir conduit à évoquer le fascisme et l'Europe des années 1930, ou un despotisme oriental transposé. Il a toujours été facile d'essayer de voir Trump comme faisant partie d'un ensemble international de dirigeants autocratiques (Modi, Erdogan, Orbán, Duterte), chacun d'entre eux étant, en fait, davantage défini par des conditions nationales spécifiques que par une quelconque tendance générale.
En réalité, Trump est une figure extrême de l'Americana [ce qui a trait à l'histoire, la géographie, le folklore et la culture des Etats-Unis]. Il fait appel à une forme typiquement états-unienne de nationalisme mercantile assorti d'une certaine dose d'escroquerie. Ses contemporains analogues les plus proches – et ils ne sont pas si proches – se trouvent au Brésil et en Argentine. Mais il a toujours eu plus en commun avec ses adversaires états-uniens qu'ils ne veulent bien l'admettre.
***
Que signifiera un second mandat de Trump pour le monde au-delà des Etats-Unis ? Il est difficile de faire des prévisions étant donné la nature fantasque de Trump et les récentes transformations du système politique des Etats-Unis. Ni les Républicains ni les Démocrates ne sont vraiment des partis politiques au sens du XXe siècle : ils ressemblent davantage à des regroupements mouvants d'entrepreneurs performants. La monnaie de la cour de Mar-a-Lago – avec ses comparses, ses sbires, ses acolytes, ses clans et ses lumpen milliardaires –, c'est la loyauté. La future directrice de cabinet de Trump, Susie Wiles, qui a dirigé sa campagne électorale et qui est à la tête de la faction de la « mafia de Floride » [comme la qualifie aussi The Economist du 26 octobre 2024], aura son mot à dire sur les personnes qui obtiendront l'oreille de Trump. Mais la pensée de ce dernier est une concoction instable. Trump est un guerrier passionné du deal qui se laisse parfois aller à une rhétorique anti-guerre. Son discours anti-empire peut être aussi peu sincère que la « politique étrangère pour la classe moyenne » de Jake Sullivan [telle que présentée en février 2021], le conseiller installé par Biden en matière de sécurité nationale. Tous deux font un clin d'œil à des sentiments qu'ils ne peuvent pas assumer. Après tout, une position anti-guerre impliquerait moins de pouvoir, ou moins d'utilisation du pouvoir. Or, s'il est favorable à quelque chose, Trump l'est pour le maximum de pouvoir.
Comme Biden avant lui, Trump donne le ton à la cour plus qu'il ne gère les affaires pratiques du gouvernement. Dans ces conditions, les nominations au sein du cabinet prennent une importance accrue. Certaines de ses nominations sont assez conventionnelles. Son choix pour le poste de conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, est un soldat de Floride qui n'aurait pas été dépaysé dans l'équipe de George W. Bush [2001-2009]. Mike Waltz a passé une grande partie de ces dernières années à s'insurger contre le retrait des forces américaines d'Afghanistan [décidé par Trump en février 2020 avec un délai de 14 mois et mis en œuvre par Biden], qui, selon lui, allait conduire à un « Al-Qaida 3.0 ». En ce qui concerne la Russie et la guerre en Ukraine, il s'est insurgé non pas contre le coût financier pour les Etats-Unis, mais contre la stratégie « trop peu, trop tard » de Biden.
Pour le poste de secrétaire d'Etat, Trump a nommé Marco Rubio [sénateur de Floride depuis 2011], un autre membre de la faction néoconservatrice orthodoxe qui a un jour coécrit un article avec John McCain [sénateur de 1987 à 2018 de l'Arizona, qui a succédé à Barry Goldwater] dans le Wall Street Journal, affirmant que le renversement de Kadhafi conduirait à « une Libye démocratique et pro-américaine ». Marco Rubio [d'une famille d'immigrés cubains] est obsédé par des projets visant à déstabiliser Cuba, le Venezuela et l'Iran. En 2022 encore, il critiquait les louanges « malheureuses » de Trump à l'égard des services de renseignement de Poutine. Un dossier interne de sélection des Républicains (très certainement obtenu et divulgué par des pirates iraniens) note que « Rubio semble s'être généralement présenté comme un néoconservateur et un interventionniste ».
Si Trump a nommé à des postes importants des membres de second rang de l'establishment, c'est en partie parce que beaucoup de professionnels les plus compétents avaient migré vers les démocrates. Kamala Harris a été soutenue par la plupart des membres de l'équipe de sécurité nationale de George W. Bush, notamment Michael Hayden [militaire, directeur de la CIA de 2006 à 2009, directeur de la National Security Agency-NSA de 1999 à 2005], James Clapper [directeur du renseignement national de 2010 à 2017], Robert Blackwill [diplomate, membre du think tank important Council of Foreign Relations] et Richard Haass [assistant de George H. Bush et président du Council of Foreign Relations de 2003 à 2023] – un véritable « who's who » de l'establishment de la politique étrangère.
Cela a conduit les républicains à faire un peu de ménage dans leurs rangs. Pour le poste de directeur de la CIA, Trump a choisi John Ratcliffe [élu de l'Illinois 2015-2020], son dernier directeur du renseignement national [de mai 2020 à janvier 2021] au cours de son premier mandat. Il a été sélectionné pour sa loyauté politique plutôt que pour toute autre qualité. Pete Hegseth offre la perspective d'un secrétaire à la Défense qui croit que les guerres d'Israël sont un accomplissement de la prophétie biblique et que les soldats états-uniens ne devraient pas être punis pour avoir commis des « soi-disant crimes de guerre ». Hegseth est un représentant du contingent de Fox News qui a la bouche écumante. Il nous rappelle également que nombre de ces personnes ont peu de chances de durer, si tant est qu'elles parviennent à être confirmées dans leurs fonctions [par le Sénat]. Le choix de Tulsi Gabbard [membre de la Chambre des représentants de 2013 à 2021] comme directrice du renseignement national irrite les commentateurs centristes et les politiciens européens en raison de ses opinions trop peu critiques à l'égard de la Russie de Poutine. Elle est également un prétexte pour que des démocrates prétendent que le retour de Trump est le résultat d'une ruse russe plutôt qu'un événement pour lequel l'establishment démocrate pourrait avoir une part de responsabilité. Dans l'ensemble, les nominations de Trump ne démontrent aucune désapprobation de l'establishment de la sécurité nationale. La logique des choix semble suivre une loyauté de tribu plus qu'autre chose.
***
Les républicains MAGA (Make America Great Again) aiment à se considérer comme différents des traditionnels fonctionnaires de Washington chargés de la sécurité nationale. Mais le sont-ils ? En juillet, Eliot Cohen, passionné de la guerre en Irak et cofondateur du Project for the New American Century [think tank néoconservateur créé entre autres par Dick Cheney, Robert Kagan, David Kristol, etc.], a décrit le programme politique de Trump comme étant « du réchauffé, et du réchauffé pas spécialement inquiétant d'ailleurs ». Selon Robert O'Brien, ancien conseiller de Trump en matière de sécurité nationale [de septembre 2019 à janvier 2021], il n'y a jamais eu de doctrine Trump, puisque ce dernier adhère « à ses propres instincts et aux principes états-uniens traditionnels qui sont plus profonds que les orthodoxies mondialistes de ces dernières décennies ». S'il y a eu un thème unificateur, Robert O'Brien insiste sur le fait qu'il a pris la forme d'une « réaction aux carences de l'internationalisme néolibéral ». Robert O'Brien, qui n'a pas reçu d'offre d'emploi dans la nouvelle administration, est à l'origine de la description de la philosophie de Trump comme étant « la paix par la force ». Il aime à dire que cette expression provient d'une citation un peu plus longue, qu'il attribue à tort à l'empereur Hadrien : « la paix par la force – ou, à défaut, la paix par la menace ». Cette phrase est en fait tirée d'un commentaire d'un historien moderne. Et comme beaucoup de choses chez Trump, « la paix par la force » est un héritage d'un ancien président des Etats-Unis : Ronald Reagan [janvier 1981-janvier 1989].
La politique étrangère de Trump présente des caractéristiques particulières, mais ce ne sont pas des aberrations. Les républicains MAGA sont prêts à peser de tout leur poids sur l'Amérique latine. Comme les démocrates, les alliés de Trump pensent que les Etats-Unis sont au cœur d'une deuxième guerre froide avec la Chine. La principale exception à la continuité entre Trump et Biden pourrait être l'Ukraine. Certaines personnalités proches de Trump, mais pas toutes, ont critiqué le soutien des Etats-Unis à l'Ukraine, principalement en raison de son coût élevé. La question de savoir si Trump mettra fin à ce soutien est probablement la plus importante sur le plan stratégique. Sous Joe Biden et Jake Sullivan, les Etats-Unis ont traité la guerre en Ukraine comme une possibilité d'affaiblir la Russie, et se sont peu souciés du fait que le prix pour cela soit payé en morts ukrainiens. Trump a affirmé qu'il mettrait fin à la guerre « avant même d'arriver dans le bureau ovale ». Mais la forme qu'il envisage pour cet objectif, si tant est qu'il l'ait imaginée, n'est pas claire. Il est probable qu'il aborde l'OTAN de la même manière qu'en 2018, avec de l'esbroufe et des menaces, mais sans conclusion. Les menaces risquent d'être un outil diplomatique très utilisé, quelle que soit leur efficacité.
***
En ce qui concerne le Moyen-Orient, un membre de l'équipe de transition a déclaré que Trump était « déterminé à rétablir une stratégie de pression maximale pour mettre l'Iran en faillite dès que possible », même s'il convient de préciser que Biden n'a jamais tenté d'améliorer les relations avec l'Iran. Trump, comme Biden, est partisan d'Israël en tant qu'atout ou même expression de la puissance des Etats-Unis dans le monde. Les atrocités de la terre brûlée à Gaza sont le meilleur témoignage des conséquences horribles du consensus politique américain sur Israël. Pour une grande partie du monde, la destruction de Gaza sera le souvenir le plus marquant de la présidence de Joe Biden. Mais sous Trump, cela n'aurait pas été différent. Le problème, lorsqu'on présente Trump comme le signe avant-coureur de la fin d'un ordre international « éclairé », c'est qu'il pousse à se s'interroger sur ce qu'est réellement cet ordre. Au Liban, on dénombre 3500 morts [1], qui s'ajoutent aux dizaines de milliers de morts à Gaza. Les Etats-Unis ont soutenu Israël, qui avait sommé les forces de maintien de la paix de l'ONU (FINUL) de quitter le Liban et avait même attaqué leurs bases. Après l'élection présidentielle, le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer [Likoud, ex-ambassadeur aux Etats-Unis de 2013 à 2021], a rendu visite à Antony Blinken, secrétaire d'Etat de Biden, à Washington, et à Trump à Mar-a-Lago afin de discuter des opérations israéliennes au Liban. Le 15 novembre, le président du parlement libanais, Nabih Berry, a confirmé que des responsables à Beyrouth étudiaient un dit plan de cessez-le-feu proposé par les Etats-Unis. Le même jour, une frappe aérienne israélienne sur Tayouné, dans la banlieue sud de Beyrouth, a détruit un immeuble résidentiel de 11 étages. Au Liban, comme à Gaza, les Etats-Unis se sont posés en médiateurs distants tout en soutenant en pratique une agression brutale.
***
Les héritiers néoconservateurs de Reagan, qui dirigent de nombreuses d'institutions, critiquent parfois la politique étrangère de Trump, non pas parce qu'il s'agit d'un désengagement du monde, mais parce qu'il s'agit d'un abandon de l'idéologie justificatrice de la puissance états-unienne. Lorsque vous renoncez à la profession trompeuse du respect des normes, des règles et de l'ordre international, vous renoncez également au jeu lui-même. La question de savoir si les Etats-Unis se sont jamais réellement soumis à des règles, quelles qu'elles soient, est abordée au mieux comme une question académique. La réalité à Gaza et au Liban est plus facilement ignorée que défendue. A cet égard, Trump est attaqué pour avoir rétabli la norme historique des Etats-Unis. Comme le dit Hal Brands – Henry Kissinger Distinguished Professor of Global Affairs à l'université Johns Hopkins [et intervenant à l'American Enterprise Institute] : sous Trump les Etats-Unis agissent « de la même manière étroitement intéressée et fréquemment exploiteuse que de nombreuses grandes puissances tout au long de l'histoire ». Trump n'est pas un isolationniste, pour autant que ce terme ait un sens utile, et ne propose pas de se retirer comme puissance mondiale. Au contraire, écrit Hal Brands, sur certaines questions, son administration « pourrait être plus agressive qu'auparavant ».
***
Plus que tout autre homme politique états-unien, Trump a été associé au recentrage de l'attention impériale états-unienne en direction de la Chine. Mais dire que sa deuxième administration sera pleine de faucons visant la Chine ne rend pas compte de l'ampleur de la transformation qui s'est opérée à Washington depuis 2016. En ce qui concerne la Chine, l'administration Biden a repris tous les éléments du discours de Trump et en a ajouté quelques-uns. En juin 2024, le Council on Foreign Relations a organisé sa China Strategy Initiative pour discuter de l'avenir des relations entre les Etats-Unis et la Chine. La plupart des responsables de la politique étrangère qui s'intéressent à la Chine étaient présents. Dans son allocution d'ouverture, Kurt Campbell, haut responsable de la politique en direction de la Chine dans les administrations Obama et Biden, a souligné que « les caractéristiques essentielles de la stratégie états-unienne dans l'Indo-Pacifique font l'objet d'un accord largement bipartisan ». La preuve de l'efficacité de cette stratégie, a-t-il ajouté, est que la Chine et la Russie « considèrent nos partenariats transcontinentaux avec une inquiétude croissante ». Il est probable que Trump aborde la Chine de la même manière que Jake Sullivan, mais plus encore, de la mauvaise manière, mais plus rapidement.
S'il y a une question de politique étrangère sur laquelle Trump a été cohérent, c'est bien celle des droits de douane face aux exportations de la Chine et du protectionnisme en général. Cela fait très longtemps qu'il fait des déclarations, mal fondées, sur le déficit commercial des Etats-Unis. Son projet prévoit des droits de douane de 60% sur les importations chinoises et de 10 à 20% sur toutes les autres [y compris 25% pour le Mexique et le Canada, membres de l'Alena, au lieu de zéro sur la plupart des importations]. Les Etats-Unis sont une économie à dimension continentale et sont beaucoup moins orientés vers le commerce international que des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Chine. Ils peuvent envisager des mesures drastiques que d'autres ne peuvent pas prendre. Mais les droits de douane imposés à un seul Etat sont souvent difficiles à appliquer, car les chaînes d'approvisionnement transnationales peuvent être modifiées pour les contourner. Des économistes compétents et agressifs tels que Robert Blackwill, qui a servi sous George W. Bush et rédigé une étude importante sur la « géoéconomie », ont pour la plupart soutenu Kamala Harris et ne sont pas actuellement disponibles pour aider Trump. Peut-être que certains reviendront du froid lorsque les courtisans loyalistes auront inévitablement tout gâché. Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce pendant le premier mandat de Trump, pourrait bien reprendre son rôle [le Financial Times annonçait le 8 novembre qu'il avait été approché par Trump].
Le projet de tarifs douaniers à hauteur de 60% est la dernière manifestation d'une stratégie états-unienne plus générale à l'égard de la Chine que les démocrates ont qualifiée de puissance concurrente du XXIe siècle. En Chine, on considère qu'il s'agit d'un endiguement (containment). Les idéologues de l'orbite de Trump sont généralement plus combatifs sur cette question que ceux qui sont plus proches des démocrates. Pourtant, dans l'esprit du consensus bipartisan de Kurt Campbell [en charge pour l'Asie de l'Est et le Pacifique sous Obama de juin 2009 à février 2013, une fonction prolongée sous Biden], ils ne sont pas fondamentalement en désaccord. Trump n'a pas encore choisi son équipe chinoise, mais son intention d'étendre la guerre froide économique est dangereuse. Robert O'Brien estime qu'un second mandat de Trump entraînera davantage de mesures de containment, y compris « une attention présidentielle accrue aux dissidents et aux forces politiques susceptibles de défier les adversaires des Etats-Unis ». Cela n'augurerait rien de bon pour l'avenir des relations sino-américaines, qui sont déjà médiocres. Au cours des années Biden, selon le rapport annuel du renseignement national sur l'évaluation des menaces, la Chine a commencé à réorienter son dispositif nucléaire vers une compétition stratégique avec les Etats-Unis, en partie parce qu'elle s'inquiétait de l'augmentation de la « probabilité d'une première frappe états-unienne ». La Chine ne possède pas encore de forces nucléaires capables d'égaler celles des Etats-Unis, mais cette situation pourrait ne pas durer. La gestion de ce problème est rendue encore plus délicate par le caractère instable de Trump.
***
En Europe, le retour de Trump a été accueilli avec le même sentiment de panique perplexe que sa victoire en 2016. Le 6 novembre, Le Monde titrait « La fin d'un monde américain ». La Frankfurter Allgemeine Zeitung a titré « Trumps Rache », soit « La revanche de Trump ». Les rumeurs d'un plan pour la guerre en Ukraine qui impliquerait de geler la ligne de front en échange de l'abandon par l'Ukraine de son adhésion à l'OTAN pour au moins vingt ans – édulcoré par une garantie compensatoire que les armes états-uniennes continueraient d'affluer – ne sont pas bien accueillies. Pourtant, personne ne croit que Trump démantèlera réellement la position militaire états-unienne en Europe. Elle a récemment été renforcée par une nouvelle base de défense antimissile en Pologne dont le personnel est composé de membres de la Marine des Etats-Unis. Il ne fait aucun doute que la Commission européenne s'efforce de trouver des moyens de protéger les économies européennes des répercussions des droits de douane voulus par Trump. Mais la réaction pavlovienne a été de profiter de l'occasion pour plaider en faveur d'une augmentation des dépenses militaires, ce qui ne contribue guère à l'investissement productif dont l'Union européenne a besoin.
***
Un second mandat de Trump est clairement une catastrophe pour le peu d'efforts internationaux existants afin de coordonner la lutte contre le changement climatique. Sous Biden, les Etats-Unis ont pris la diplomatie climatique presque au sérieux. Dans la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act, août 2022), les Etats-Unis ont adopté une législation sur le climat qui allait au-delà de celle de tous les gouvernements précédents. Il est facile d'exagérer ces réalisations, qui sont tellement insuffisantes qu'elles relèvent de la négligence. Mais la position de Trump – « drill, baby, drill » – est certainement différente. Il y a fort à parier qu'il publiera une série de décrets démantelant les mesures limitées de transition énergétique actuellement en place aux Etats-Unis. En mai 2024, Wood Mackenzie, l'une des principales sociétés de recherche et de conseil du secteur de l'énergie, a publié un document indiquant que sa réélection « éloignerait encore davantage les Etats-Unis d'une trajectoire d'émissions nettes zéro ». L'équipe états-unienne à la COP29 (le deuxième sommet climatique successif organisé dans un grand Etat d'hydrocarbures – l'Azerbaïdjan) est apparue découragée.
***
En Grande-Bretagne, on pourrait s'attendre à ce que le retour imminent de Trump provoque une remise en question de la portée des liens entre le pays et les Etats-Unis. Les tarifs douaniers sont évidemment préjudiciables aux intérêts commerciaux britanniques. Le 11 novembre, le président de la Commission des affaires et du commerce de la Chambre des communes, Liam Byrne (Labour), les a qualifiés de « scénario catastrophe ». La solution proposée par Liam Byrne était que la Grande-Bretagne négocie avec Trump une exemption des droits de douane en proposant de se rapprocher encore plus de la position états-unienne sur la Chine. Une réaction plus intéressante est venue de Martin Wolf dans le Financial Times. Il est d'accord avec Byrne pour dire que le gouvernement britannique devrait essayer de « persuader la nouvelle administration qu'en tant qu'allié proche et pays avec un déficit commercial structurel il devrait en être exempté ». L'offre proposée par Martin Wolf à Trump est une nouvelle augmentation des dépenses militaires. Cela pourrait ne pas fonctionner, mais « Trump apprécierait sûrement cette attitude soumise ».
Martin Wolf reconnaît que le retour de Trump implique des problèmes plus graves pour la Grande-Bretagne. Depuis la Seconde Guerre mondiale, affirme-t-il, le Royaume-Uni a cru que « les Etats-Unis resteraient le grand défenseur de la démocratie libérale et du multilatéralisme coopératif. Aujourd'hui, tout cela est plus qu'incertain. » Où était ce pilier de la démocratie au cours de la folie meurtrière internationale ininterrompue qui constitue le bilan des Etats-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale ? Si les millions de morts au Vietnam, en Corée et en Irak n'ont pas remis en question l'alignement stratégique de la Grande-Bretagne sur les Etats-Unis, pourquoi la seconde élection de Donald Trump le ferait-elle ? Gaza est-elle la preuve du multilatéralisme coopératif que Martin Wolf a à l'esprit ? En fin de compte, cela n'a pas d'importance, car pour lui, « il n'y a pas de substitut à cette alliance de sécurité avec les Etats-Unis ». Aujourd'hui encore, même après Gaza, la réalité d'un monde façonné par la puissance états-unienne, souvent démocrate, se heurte à un tel déni. Le gouvernement britannique a refusé de mettre fin à l'utilisation des bases britanniques à Chypre pour soutenir les attaques israéliennes contre Gaza, ou de mettre fin à la vente de pièces détachées de F-35 à Israël. Selon le secrétaire à la Défense, John Healey, cela « saperait la confiance des Etats-Unis dans le Royaume-Uni ».
***
Le style potentat de Trump modifiera l'ambiance des sommets du G7 et du G20, où la façade de coopération respectueuse a survécu à la destruction de l'enclave de Gaza. La réaction à sa victoire rappelle la raison pour laquelle les diables et les démons étaient nommés d'après des divinités étrangères dans l'Antiquité : votre diable est le dieu de votre voisin. Trump est un démon commode. Mais sa victoire n'amènera pas beaucoup de pays à reconsidérer leurs relations avec les Etats-Unis. Les différences tactiques mises à part, les centres traditionnels des préoccupations états-uniennes resteront l'Europe de l'Est, l'Asie de l'Est et le Moyen-Orient. Le thème sous-jacent de la politique étrangère des Etats-Unis reste le consensus des dites élites. Dans son utilisation des mécanismes de l'empire états-unien et de l'idéologie de sa primauté perpétuelle, Trump partage beaucoup avec ses prédécesseurs. Puissance maximale, pression maximale – sans illusions rassurantes. (Article publié dans la London Review of Books, vol. 46, n° 23, décembre 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Par Tom Stevenson est membre de la rédaction de la London Review of Books et auteur de Someone Else's Empire : British Illusions and American Hegemony, Verso Books, 2023.
[1] Un cessez-le-feu instable – déjà marqué par des bombardements israéliens – d'une durée de 60 jours est en cours depuis le 28 novembre. Déjà, selon L'Orient-Le Jour du 29 novembre, « des bombardements israéliens avaient ciblé les localités de Markaba, Taloussé et de Bani Hayan, dans le caza (district) de Marjeyoun, tandis que des bulldozers de l'armée israélienne ont pénétré dans d'autres villages frontaliers, également ciblés par des tirs d'artillerie israéliens ». Le 3 décembre, L'Orient-Le Jour titre : « Israël menace de ne plus “faire de différence entre le Hezbollah et l'Etat libanais” si la guerre reprend », ce qui traduit le projet politico-militaire israélien pour ce qui est de la « reconfiguration » du Liban. (Réd. A l'Encontre)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Guerres, militarisation et résistances

Édito en accès libre de Monde en guerre. Militarisation, brutalisation et résistances, le dernier volume de la collection Alternatives Sud.
Frédéric Thomas est chargé d'étude au CETRI - Centre tricontinental. Le Centre tricontinental est un centre d'étude, de publication et de formation sur le développement, les rapports Nord-Sud, les enjeux de la mondialisation et les mouvements sociaux en Afrique, Asie et Amérique latine.
10 décembre 2024 |Billet de blog du CETRI | Photo : Isan (Flickr) - Militarización México. © Isan (Flickr) - Militarización México.
À l'heure où les conflits armés revêtent de plus en plus une forme hybride et les États recourent à la stratégie de la militarisation, il convient de repenser les violences et la sécurité. À rebours d'une lecture qui essentialise les conflits, il faut nommer les dynamiques, les causes et les responsables, redonner la primauté au politique sur le militaire et enrayer la normalisation de la violence.
S'il n'y a pas, pour l'instant, de guerre mondiale, nous faisons bien face à un monde en guerre. L'Ukraine et Gaza (et bientôt tout le Proche-Orient ?) en portent le plus violent et dévastateur témoignage. Mais les deux conflits sont, dans le même temps, le marqueur du regard biaisé porté sur la dynamique des affrontements armés et du double discours du Nord. L'ONU, s'appuyant sur les données et les critères de l'Uppsala Conflict Data Program – UCDP, définit la guerre comme un conflit armé étatique faisant annuellement au moins un millier de morts au cours de batailles. En fonction de ces critères, neuf guerres étaient en cours en 2023.
L'UCDP distingue par ailleurs deux autres catégories de conflits : les conflits « non étatiques » et la « violence unilatérale ». Les premiers résultent de l'affrontement entre des groupes armés organisés, tandis que la seconde renvoie à l'utilisation de la force armée par un État ou un groupe armé formalisé à l'encontre de la population civile. À l'instar des conflits interétatiques, leur nombre suit une courbe ascendante depuis une dizaine d'années – en particulier les violences non étatiques, qui explosent –, mais ils sont nettement moins meurtriers : ils représentent ensemble un peu moins d'un quart de toutes les victimes de conflits sur la dernière décennie. Entre 2019 et 2023, le Mexique a concentré à lui seul près des deux-tiers des personnes tuées au cours de conflits non étatiques, tandis que 20% des mort·es de la violence unilatérale ont succombé dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).
Le monde n'avait plus connu autant de conflits depuis la Seconde guerre mondiale. Certes, le nombre de victimes est bien inférieur à celui de la période 1946-1999. De la fin de la Guerre froide à 2020, il est resté relativement bas ; à l'exception notable cependant du génocide au Rwanda en 1994 et de la guerre en Syrie, surtout en 2013-2014. Cette tendance générale recouvre néanmoins des moments et des foyers particulièrement meurtriers : ainsi, la RDC, en 1996, et l'affrontement entre l'Éthiopie et l'Érythrée (1998-2000), en 1999, concentrent respectivement près de 40 et de 50% des personnes tuées au cours de ces deux années. Mais, la guerre civile qui a éclaté en Éthiopie en 2021 a fait près de 300000 morts en deux ans, soit plus de la moitié de toutes les victimes de conflits armés sur cette période. C'est finalement moins la recrudescence des conflits qui doit nous préoccuper que leur transformation, imparfaitement appréhendée par les définitions « classiques » de la guerre.
Tendances actuelles
On ne s'attardera pas ici sur l'emploi dans les guerres actuelles de nouvelles technologies – armes autonomes, cyberattaques, etc. –, dont le drone est à la fois l'outil le plus connu et le plus massivement employé, notamment dans la guerre russo-ukrainienne où des spécialistes estiment qu'en 2023, l'Ukraine a perdu 10000 drones par mois (IEP, 2024). Ces quelques pages entendent plutôt se centrer sur les tendances récentes des dynamiques conflictuelles en matière de géopolitique, d'acteurs, d'enjeux et de stratégies, dans une perspective Nord-Sud.
Il convient tout d'abord de remarquer que la criminalité fait bien plus de victimes que les conflits armés. Ainsi, le nombre annuel d'homicides en 2019-2021 tournait autour de 440000, soit trois fois plus que les personnes tuées lors de conflits au cours de ces trois années. Mais la distinction entre organisation criminelle et groupe armé tend à se brouiller (voir plus loin). Par ailleurs, le principal champ de bataille, le lieu le plus violent pour les filles et les femmes continue d'être le domicile et la famille : en 2017, 58% des homicides de femmes avaient été commis par un conjoint ou un parent (ONU, 2020).
Opérations de maintien de la paix : entre frustration et transformation
Il existe une double concentration, géographique et meurtrière, des conflits violents. La plupart des guerres se concentrent en Afrique et au Moyen-Orient, tandis que la moitié des personnes tuées étaient éthiopiennes en 2021 et 2022 ; palestiniennes et ukrainiennes en 2023. Autre caractéristique, ces violences ont des racines historiques profondes, qui plongent souvent dans la période coloniale, dessinant de la sorte une conflictualité à longue portée sous la forme de conflits dormants ou de basse intensité, voire de « guerres sans fin », explosant à la faveur d'un événement particulier.
En outre, nombre de ces conflits sont internationalisés, au sens où l'une des parties ou les deux reçoivent le soutien de troupes d'un État extérieur, impliquant souvent, directement ou indirectement, l'une ou l'autre puissance régionale, voire mondiale, en fonction d'enjeux stratégiques. Ainsi en est-il de la situation en Lybie, au Soudan et dans la Corne de l'Afrique ; ces deux dernières régions faisant d'ailleurs l'objet d'articles de cet Alternatives Sud. À cet interventionnisme, il faut ajouter le trafic d'armes, dont les États-Unis sont – et de loin – le principal protagoniste, alimentant les conflits (Thomas, 2024a). Or, cette connexion nationale-internationale et la multiplication des acteurs s'affrontant sur le terrain rendent d'autant plus difficile la recherche d'une résolution pacifique.
Enfin, la majorité des conflits violents actuels ne relève pas (ou pas seulement) d'un affrontement entre États. Ils impliquent des acteurs non étatiques tels que des organisations terroristes (y compris transnationales), des sociétés ou entreprises militaires et de sécurité privées (EMSP), des milices, des organisations criminelles et des groupes armés hybrides ou aux frontières poreuses avec la criminalité. D'où une fragmentation des réseaux et des acteurs, ainsi que des attaques qui ciblent le plus souvent les civils. D'où, également, au niveau de la recherche académique, une difficulté à appréhender la dynamique actuelle des conflits armés avec les outils d'analyse du vingtième siècle.
La globalisation néolibérale, la stratégie sécuritaire américaine, l'émergence d'un monde multipolaire avec la montée en puissance de la Chine et de pouvoirs régionaux, l'intensification des flux financiers et d'armes, ainsi que l'extension de la criminalité organisée comptent parmi les principaux phénomènes dont les effets travaillent la configuration des souverainetés étatiques et, corrélativement, la nature des conflits, toutes deux marquées par des formes de privatisation.
La « guerre contre la terreur » déclarée par la Maison blanche à la suite des attentats du 11 septembre 2001 constitue un jalon important de cette transformation. Par son caractère global et la plasticité de ses cibles et objectifs, elle consacre une stratégie offensive qui légitime la militarisation de la politique. De plus, elle catalyse une double érosion de la souveraineté étatique ; en amont, en qualifiant certains États de « voyou », appartenant à un « axe du mal » et, en aval, en normalisant le recours massif aux EMSP, ces entreprises qui vendent sur la scène internationale des services sécuritaires et militaires. Ainsi, l'occupation de l'Afghanistan et de l'Irak s'est accompagnée d'un usage massif d'EMSP (Bilmes, 2021), au point de constituer la première force de travail dans les deux pays.
Wagner, l'EMSP la plus connue et la plus dénoncée en Occident, participe en réalité d'une économie mondialisée où les principales entreprises sont américaines, et dont le marché en 2020 était évalué à quelque 224 milliards de dollars (Transparency International, 2022). L'action de ces entreprises pose pas mal de problèmes, notamment en termes de droit et d'éthique, car elles ne rendent de comptes à personne et jouissent d'une quasi-impunité. Se pose également, dans un contexte de grande opacité, la question de leur indépendance réelle par rapport aux politiques des États où elles sont implantées et leur potentielle utilisation dans des guerres par procuration. Dans cet ouvrage, Tek Raj Koirala questionne les dynamiques du secteur de la sécurité et sa division du travail, qui redouble largement les rapports Nord-Sud, à partir du cas d'ex-soldats népalais impliqués dans les EMSP en Afghanistan.
De façon plus générale, c'est la notion wébérienne de l'État comme détenteur du monopole de la violence légitime qui doit être interrogée. L'érosion étatique et la privatisation du pouvoir public sont souvent, partiellement au moins, des stratégies mises en place par les États eux-mêmes. Les rapports que ces derniers entretiennent avec les EMSP ne sont donc pas univoques, relevant davantage et tout à la fois de la compétition et de la collaboration que d'une subordination directe ou, au contraire, d'une indépendance totale.
Outre les États et les entreprises militaires, les guerres actuelles impliquent souvent d'autres catégories d'acteurs armés, ce qui complique le scénario conflictuel. La Colombie est un cas emblématique. L'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) devait mettre fin au plus long conflit armé du continent latino-américain. Force est de reconnaître, huit ans plus tard, qu'on est loin du compte. Entre 2016 et 2024, 1559 leaders sociaux·ales ont été assassiné·es. Une centaine de massacres ont eu lieu au cours de ces trois dernières années, faisant près de 1000 victimes, et la Colombie est le pays le plus dangereux au monde pour les défenseurs et défenseuses de la terre et de l'environnement (Indepaz, 2024 ; Global Witness, 2024).
Si la guerre n'a pas disparu, elle s'est néanmoins transformée, rendant d'autant plus ardue la politique de « paix totale » du gouvernement de gauche de Gustavo Petro. Ainsi, le conflit armé s'est mué en « un scénario extrêmement hybride au sein duquel les frontières entre la politique et la criminalité sont toujours plus diffuses » et où les acteurs armés transitent de l'une à l'autre (Llorente, 2023). Cette hybridation varie en fonction des territoires – de leurs richesses en ressources naturelles, de la culture ou non de coca et de leur importance stratégique – et des organisations, mais elle est occultée par la rhétorique politique que ces dernières utilisent afin d'avoir accès aux négociations avec l'État colombien et d'en tirer parti. Cependant, le dénominateur commun de tous ces groupes est leur immersion dans une économie illicite et l'affrontement pour le contrôle d'un territoire afin d'accaparer tout type de rentes.
Politique et militarisation
Les dépenses militaires mondiales n'ont cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie. Les États-Unis, qui représentent plus du tiers de ces dépenses – soit trois fois plus que la Chine, en deuxième position –, sont aussi, et de loin, le principal exportateur d'armes, concentrant, entre 2019 et 2023, 42% des exportations mondiales (Spiri, 2024). L'Inde, l'Arabie saoudite et le Qatar sont, de leur côté, les principaux importateurs, totalisant ensemble, pour la même période, plus d'un quart des importations mondiales. Loin d'être seulement la conséquence d'un contexte marqué par la (menace de) guerre, les dépenses militaires et la circulation d'armes participent d'une logique de militarisation.
« La guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens », selon la formule canonique de Clausewitz. À l'heure actuelle, les interactions entre la politique et la guerre se sont intensifiées au point de constituer une forme politico-militaire. Sa manifestation peut-être la plus évidente réside dans la vague de coups d'États qui a secoué l'Afrique (Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée et Gabon) depuis 2020. Ces irruptions violentes de militaires au sommet du pouvoir côtoient cependant, d'Alger à Bangkok, en passant par San Salvador, des modes de collaboration plus occultes ou paradoxaux entre gouvernements et forces armées.
En Amérique latine, selon Hoecker (lire son article dans cet Alternatives Sud), ce phénomène traduit « l'émergence du militarisme civil ». Ce retour des forces armées au-devant de la scène, sur un continent qui a connu la longue nuit des dictatures militaires, soulève nombre de questions et d'inquiétudes. Il ne s'agit pas pour autant d'un retour au passé, mais bien d'une reconfiguration. Ce sont en effet les partis politiques au pouvoir qui se tournent vers les forces armées, non sans opportunisme bien souvent, afin de les faire participer à la lutte contre l'insécurité. Ce faisant, ces dernières acquièrent un rôle de police particulièrement étendu, allant du contrôle des frontières à la répression de manifestations, en passant par la lutte contre la criminalité.
Les guerres aux gangs et au narcotrafic, encouragées par Washington, sont les vecteurs privilégiés de cette militarisation. En Amérique latine surtout, mais également en Asie. Marc Batac analyse ainsi dans cet Alternatives Sud la confluence d'intérêts entre acteurs internationaux et locaux, ainsi que les interactions entre le gouvernement et les forces armées, dans la mise en place d'une stratégie antiterroriste aux Philippines. À quelques encablures de là, en Indonésie, l'actuel président et ancien ministre de la défense Prabowo Subianto est accusé de crimes de guerre sous le régime de Suharto (fin des années 1990), notamment de torture et de disparition d'activistes (Muhtadi, 2022).
Cette sorte de passage de témoin du politique aux militaires renforce l'impopularité des premiers et le crédit accordé aux seconds. Il s'inscrit par ailleurs dans une dynamique spécifique. La popularité des militaires dans le Sud doit aussi se lire au revers du désenchantement démocratique, du clientélisme et de la corruption de la classe politique, des inégalités et de l'incapacité des gouvernements successifs à assurer l'accès aux services sociaux (emploi, éducation, santé, etc.) qui consacrent et concrétisent, en quelque sorte, la démocratie. Les baromètres d'opinion en Afrique et en Amérique latine montrent cette désaffection démocratique (Jeune Afrique, 2024 ; Latino Barometro repris par Hoecker dans cet ouvrage). En contrepoint, les forces armées sont investies de valeurs – probité, professionnalisme, sérieux, etc. –, d'une efficacité dans la lutte contre l'insécurité et d'une soumission à l'intérêt général, qui font justement défaut à la classe politique aux yeux d'une grande partie de la population, et particulièrement de la jeunesse.
La confiance envers l'institution militaire et les valeurs qui lui sont attribuées sont bien entendu largement idéologiques, basées sur des croyances et non sur l'épreuve des faits. Ainsi, l'emploi des forces armées dans la guerre contre le narcotrafic, dans les cas emblématiques de la Colombie et du Mexique, a été un échec. De même, la lutte contre les terroristes islamistes au Sahel, qui constitue l'une des principales justifications données par les putschistes aux coups d'État menés au Mali, au Burkina Faso et au Niger, n'engrange guère de résultat jusqu'à présent. Quant à la prétendue incorruptibilité des forces armées, l'histoire et l'actualité de nombreux pays, du Mexique au Népal en passant par le Pakistan et la RDC, montrent plutôt une institution militaire gangrénée par les affaires, le clientélisme et le népotisme.
Le succès de la lutte contre les bandes armées au Salvador constitue-t-il un contre-exemple ? L'article que nous publions dans cet ouvrage invite plutôt à questionner ce « succès » devenu « modèle », qui relèvent tous deux d'une stratégie de communication, au centre du processus de militarisation, et qui emprunte, au Salvador et ailleurs, principalement une triple voie : celle de l'information, celle du droit et celle du visuel (Thomas, 2024b). En effet, dans un contexte où l'information est plus que jamais un enjeu de pouvoir, le président salvadorien Bukele n'a de cesse de mettre en scène sur les réseaux sociaux sa réussite et de chercher à court-circuiter ou censurer tout contre-récit critique.
La dimension la plus visuelle de la militarisation est celle du « Kaki washing » : soit l'utilisation des forces armées comme stratégie de communication politique, afin de projeter sur le gouvernement l'image associée aux vertus et valeurs que les militaires inspirent et qui manquent aux politiques (Verdes-Montenegro, 2021). Enfin, la militarisation emprunte également une voie juridique, consistant à multiplier et à accroître les peines d'incarcération – et à leur donner une grande publicité – à des fins électorales et populistes. Le Salvador est ainsi devenu le pays avec le plus haut taux d'emprisonnement au monde. Cette politisation du droit pénal peut-être qualifiée de « populisme punitif » (López et Avila, 2022).
Les appels des gouvernements aux militaires afin de capter une part de leur popularité et (re)gagner une certaine légitimité ne sont cependant pas seulement des calculs opportunistes d'une classe politique en mal de crédibilité. Ils témoignent aussi du fait que les problèmes politiques sont de plus en plus identifiés et traités comme des questions sécuritaires. Ce processus, qualifié de « sécuritisation » (ENAAT, Rosa Luxembourg Stiftung, 2021), revient à donner la priorité au militaire sur la politique dans l'analyse et dans l'action, en occultant les enjeux sociaux sous le paradigme (socialement construit) de l'insécurité. Or, si cette dynamique correspond à la vague mondiale des droites illibérales et réactionnaires, elle ne s'y réduit pas, comme en témoigne notamment le cas mexicain où un président de centre gauche a fait un recours abondant aux forces armées (Coste, 2024).
Ordre, État et instrumentalisation
Le regard néocolonial tend, d'un côté, à accorder une sorte de « droit à la guerre » à certains États (du Nord) et à entériner leurs prétentions à mener des actions « chirurgicales », « morales », bref « civilisées », et, de l'autre, à décréter implicitement ou explicitement des régions et des peuples violents par nature, condamnés par-là à une violence chaotique sans issue. À l'encontre d'une telle vision, Terefe et Tesfaye montrent dans leur contribution à cet Alternatives Sud l'imbrication de facteurs sociohistoriques complexes – les mouvements sécessionnistes, les attaques terroristes, les ressources naturelles, les pouvoirs prédateurs, les interventions armées internationales – qui explique pourquoi la Corne de l'Afrique est en butte à une série de conflits violents depuis des décennies.
Ils mettent de plus en avant l'instrumentalisation des tensions et de l'instabilité de la région par les puissances mondiales et régionales (Égypte, Arabie saoudite, Iran, Turquie, États du Golfe), afin de faire prévaloir leurs propres intérêts. Engagés dans une « course aux bases militaires », ces États tendent à reproduire des rapports de domination hérités du colonialisme, en renforçant des régimes autoritaires clients, vecteurs de conflits civils armés, au détriment des aspirations populaires.
C'est à une autre sorte d'instrumentalisation que s'intéresse Naing Lin dans son article sur le conflit armé en cours dans la région de l'Arakan, au Myanmar : celle des tensions ethniques. La mobilisation par la junte militaire des groupes rohingyas vise ainsi à affaiblir et à diviser la résistance armée, tout en fomentant des exactions racistes. Alors qu'il s'agit ici d'entraîner un pourrissement du conflit et de miner l'avenir, Azadeh Moaveni analyse brillamment, à partir du conflit israélo-palestinien, un autre cas de figure : l'instrumentalisation des violences sexuelles pour justifier la poursuite de la guerre.
La militarisation est imprégnée de la rhétorique machiste et viriliste des « hommes forts », de la mano dura, inscrite dans une scénographie dont les femmes sont absentes. Celles-ci sont cependant au centre de la guerre, dont elles sont devenues à la fois le trophée, la cible et l'un des enjeux principaux. Le viol est conçu comme arme de guerre, mais aussi, plus cruellement encore, comme une manière de faire la guerre. Les travaux de Rita Segato (2021) sur les féminicides et les guerres contre les femmes éclairent l'attitude de gangs armés au Mexique et en Haïti, empreints d'une « masculinité prédatrice », luttant pour conquérir des territoires. Des conquêtes qui passent par l'appropriation violente du corps des femmes.
Stimulante est par ailleurs la thèse de Segato, selon laquelle les féminicides ne sont pas la conséquence de l'impunité, mais fonctionnent plutôt comme producteurs et reproducteurs de l'impunité. Elle met de la sorte en lumière la connivence entre l'État et les acteurs criminels, obligeant à repenser les processus de négociation et de sortie de conflit. Le risque est grand, en effet, de sacrifier la justice, et plus encore la réparation, au nom de la realpolitik, en enfermant les sociétés dans un cercle vicieux de violences et d'impunité.
Les différents articles de cet Alternatives Sud invitent dès lors à penser la militarisation au croisement d'un entrelac d'acteurs et de rapports sociaux qui traversent la sphère étatique sans s'y réduire. Les militaires viennent moins combler un vide de l'État que manifester sa présence sous une forme spécifique : celle de la coercition étatique. Entre deux modalités de l'action publique – la force armée ou les services sociaux –, le choix a été fait. La militarisation représente dès lors moins un recul du gouvernement face à l'armée qu'une révision de la division des pouvoirs et une reconfiguration de la puissance publique.
Dans une situation de crise, perçue ou présentée comme hors de contrôle, l'armée est appelée à intervenir (ou intervient directement) pour, justement, reprendre le contrôle et remettre de l'ordre. De même, une situation où la souveraineté nationale – dont les militaires seraient les garants – est mise à mal par une menace (parfois imaginaire), toujours qualifiée d'« extérieure » à la société et à la nation – attaques impérialistes, groupes terroristes, organisations subversives, gangs, narcotrafiquants –, facilite l'entrée des forces armées sur la scène politique.
Mais l'ordre est autant un fantasme qu'un dispositif de pouvoir. Il permet d'opérer un quadrillage de l'espace public, d'intensifier le contrôle social et de recourir à des mesures extraordinaires, tout en limitant les contre-pouvoirs. Le désordre justifie la militarisation qui, en retour, définit l'ordre, ce qu'il est, ce qu'il doit être. Et les moyens pour y parvenir. L'attribution de fonctions de police à l'armée se double ainsi d'une militarisation de la police (au Sud comme au Nord ?), tandis que l'état d'exception ou d'urgence tend à se poursuivre, se reproduire et s'autolégitimer, comme en témoigne le cas salvadorien.
Résistance
Évoquant l'Allemagne au cours et après la Première guerre mondiale, George Mosse a mis en avant le concept de « brutalisation » pour rendre compte de la banalisation et de l'intériorisation de la violence, ainsi que de la façon dont celle-ci a servi de catalyseur à une résurgence nationaliste et totalitaire. Le concept, qui ne fait pas consensus parmi les historien·nes, peut-il être utile à l'analyse des sociétés du Sud confrontées à de longues vagues de violences ? La militarisation serait-elle une forme renouvelée de réveil nationaliste et le recours aux forces armées le signe d'une « brutalisation » acceptée, institutionnalisée ? La mise en spectacle de la violence tend, en tous cas, à la normaliser.
La guerre n'est ni une fatalité ni un accident qui surviendrait dans un ciel serein. Elle est le plus souvent un moyen pour des acteurs de prendre ou de conserver le pouvoir, d'accaparer des ressources et de réprimer les mouvements sociaux. La dépolitisation et l'essentialisation des conflits armés occultent les causes et les responsabilités, ainsi que les résistances à ces guerres. Et elles hypothèquent ou compliquent davantage la sortie de crise.
Il est illusoire de croire qu'une solution militaire puisse être apportée à des problèmes qui ont, presque toujours, des racines socioéconomiques, historiques et politiques. Mais, tout aussi illusoire est l'idée qu'un accord entre les parties en conflit suffise à lui seul à ouvrir une voie pacifique. Par exemple, la violence qui déchire aujourd'hui le Soudan est une guerre contre la population, menée par deux groupes non représentatifs et sans projet national si ce n'est celui d'accaparer les ressources et les pouvoirs et d'exploiter les Soudanais et Soudanaises. Une lecture biaisée des conflits entraîne des mécanismes boiteux pour les prévenir et les résoudre.
Rim Mugahed décrit dans cet Alternatives Sud les attentes contradictoires et irréalistes auxquelles sont confrontées les militantes yéménites, ainsi que les dynamiques nationales et internationales croisées qui ont abouti à leur exclusion de la table de négociation, malgré la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies (votée en 2000) qui reconnaît le rôle central des femmes et impose aux différentes parties d'un conflit de soutenir leur participation aux négociations et à la reconstruction post-conflit. Malheureusement, au Yémen comme ailleurs, le modèle libéral de la paix, qui reste dominant, tend à réduire les négociations à un accord entre les élites locales qui s'affrontent, méconnaissant la violence structurelle dont elles font preuve et leur assurant l'impunité. Sans compter que, dans bien des cas, elles n'ont pas intérêt à ce que le conflit cesse (Mansour, Eaton et Khatib, 2023).
Lutter contre la guerre, c'est d'abord nommer les dynamiques, les causes et les responsables, arracher la violence à sa naturalisation et la militarisation à son récit fonctionnel. Démontrer et dénoncer les dépenses et profits considérables du complexe militaro-industriel mondial dont le Pentagone est l'un des principaux centres. Remettre la question de l'égalité et des pouvoirs au centre du questionnement et penser toute sortie de crise avec et à partir des organisations sociales en général, et des organisations de femmes en particulier, qui sont en première ligne. Sous la stratégie de la militarisation, les cibles – trafiquants de drogue, gangs, guérillas, etc. – tendent à devenir perméables et permutables, au point, très vite, d'englober les mouvements sociaux, les ONG de droits humains, les journalistes, etc., soit tous ceux et toutes celles qui, par leurs critiques et leurs actions, refusent de s'aligner sur la logique guerrière du pouvoir.
Celles et ceux, naïfs·ves ou complaisant·es, qui ne voient là que des « écarts » ou des « excès » qu'ils et elles s'empressent de justifier, se condamnent à ne rien comprendre et à céder à la discipline autoritaire et à la tolérance envers la violence de l'État que le populisme punitif prépare et entretient. Il nous faut, tout au contraire, repolitiser la question de la sécurité, du conflit et de la paix, dégager l'action d'une perspective uniquement étatique, afin de se donner les moyens politiques de ne pas continuer la guerre, mais bien de l'arrêter.
Bibliographie
Bilmes L. (2021), « Where did the tn spent on Afghanistan and Iraq go ? Here's where », The Guardian, 11 septembre, https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/sep/11/us-afghanistan-iraq-defense-spending.
Coste J. (2024), « Militarización : la herencia maldita de López Obrador », Presente, 15 avril, https://revistapresente.com/presente/militarizacion-la-herencia-maldita-de-lopez-obrador/.
ENAAT, Rosa Luxembourg Stiftung (2021), Une Union militarisée. Comprendre et affronter la militarisation de l'Union européenne, https://rosalux.eu/en/2021/import-1981/.
Global Witness (2024), Voces silenciadas, https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/.
IEP (2024), Global Peace Index 2024, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/06/GPI-2024-web.pdf.
Indepaz (2024), Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, https://indepaz.org.co/category/observatorio-de-conflictos-y-posacuerdos/.
Jeune Afrique (2024), « Trois jeunes Africains sur cinq veulent émigrer : le sondage qui devrait inquiéter les présidents africains », Jeune Afrique, 14 septembre 2024, https://www.jeuneafrique.com/1609053/politique/trois-jeunes-africains-sur-cinq-veulent-emigrer-le-sondage-qui-devrait-inquieter-les-presidents-africains/.
Llorente (2023), Ley de Orden Público. Intervención en audiencia ante la Corte Constitucional, 22 août, https://storage.ideaspaz.org/documents/fip_intervencionmvll_final01.pdf.
López C. et Avila R. (2022), « Populismo punitivo : manifestación política vs. Derecho penal. La cadena perpetua en Colombia », Revista de Derecho, juillet-décembre, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972022000200218.
Mansour R., Eaton T. et Khatib L. (2023), Rethinking political settlements in the Middle East and North Africa. How trading accountability for stability benefits elites and fails populations, Chatam House, https://www.chathamhouse.org/2023/09/rethinking-political-settlements-middle-east-and-north-africa/05-addressing-structural.
Muhtadi B. (2022), The indonesian military enjoys strong public trust and support. Reasons and Implications, Trends in Southeast Asia, ISEAS Publishing, https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/11/TRS19_22.pdf.
ONU (2020), Conflit et violence : une ère nouvelle, https://www.un.org/fr/un75/new-era-conflict-and-violence.
Segato R. (2021), L'écriture sur le corps des femmes assassinées de Ciudad Juarez, Paris, Payot.
SPIRI (2024), Spiri fact sheet. Trends in international arms transfers, 2023, https://www.sipri.org/publications/2024/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2023.
Thomas F. (2024a), « Géopolitique du commerce des armes », CETRI.
Thomas F. (2024b), « Le stade Bukele du spectacle », CETRI.
Transparency International (2022), Hidden costs : US private military and security companies and the risks of corruption and conflict, https://ti-defence.org/wp-content/uploads/2022/08/Hidden_Costs_US_Private_Military_and_Security_Companies_PMSCs_v9-web_141022.pdf.
Verdes-Montenegro F. (2021), Del golpe de estado al golpe visual en América latina ? Remilitarización, khakiwashing y la vuelta de los militares a escena, https://www.fundacioncarolina.es/francisco-verdes-montenegro-investigador-de-fundacion-carolina-escribe-sobre-remilitarizacion-y-khakiwashing-en-la-region-latinoamericana/.
Wolf S. (2024), « El Salvador's State of Exception : A Piece in Nayib Bukele's Political Project », Lasa Forum, 54, 4, https://forum.lasaweb.org/files/vol54-issue4/dossier-5.pdf.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.













