Derniers articles

Élections : La position des partis fédéraux sur 39 enjeux environnementaux dévoilée

Les résultats d'un questionnaire mené auprès des partis fédéraux concernant leurs engagements environnementaux ont été dévoilés aujourd'hui. Les questions posées portaient sur des enjeux cruciaux tels que les changements climatiques, la biodiversité, l'eau, la mobilité durable, l'agriculture et l'alimentation, les ressources naturelles et bien d'autres.
Tous les partis y ont répondu, à l'exception du Parti conservateur du Canada. Le Parti libéral du Canada a quant à lui partiellement participé à l'exercice, en envoyant plutôt une lettre sans répondre aux questions de manière spécifique. Le Nouveau Parti démocratique, le Parti Vert et le Bloc Québécois ont répondu à toutes les questions.
Cet exercice non partisan s'inscrit dans une démarche menée par Vire au vert, une coalition d'une vingtaine d'organisations de la société civile québécoise, et a pour objectif de fournir à l'électorat les informations nécessaires pour faire un choix éclairé.
Le questionnaire a été envoyé aux cinq principaux partis politiques en février 2025. Plusieurs relances ont été faites auprès de tous les partis depuis cette première approche.
L'environnement demeure une priorité
« Malgré une campagne électorale dominée par la situation avec les États-Unis, nous savons que l'action climatique et la protection de la nature demeurent des priorités pour une large proportion de la population », expliquent les organisations membres de Vire au Vert.
Un récent sondage commandé par la Fondation David Suzuki confirme en effet que l'environnement demeure une priorité pour la population québécoise et canadienne, alors que près de 4 personnes sur 5 (79 %) au Québec et plus de 2 personnes sur 3 (69 %) estiment que le prochain gouvernement fédéral doit prioriser l'action climatique et la protection de la nature.
Des organisations environnementales canadiennes publient également aujourd'hui les réponses des partis à 10 autres questions portant sur l'environnement.
« C'est alarmant de constater que les enjeux environnementaux sont relégués au second plan dans le discours politique alors qu'ils sont indissociables des questions sociales et économiques : on pense au coût de la vie ou à la santé, par exemple. Nous espérons que notre démarche encouragera la population à se rendre aux urnes et à faire entendre sa voix en appuyant les partis prêts à faire ce qu'il faut pour créer un avenir durable et équitable », ajoutent les membres de Vire au vert.
Partenaires de Vire au vert pour les élections fédérales 2025
Accès transports viables, Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME), Centre d'écologie urbaine, Coalition Québec meilleure mine, Eau Secours, ENvironnement JEUnesse, Équiterre, Fondation David Suzuki, Fondation Rivières, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Front étudiant d'action climatique (FÉDAC), Mères au front, Nature Québec, Piétons Québec, Réalité climatique Canada, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, Réseau des femmes en environnement, Trajectoire Québec, Vélo Québec, Vigilance OGM, Vivre en Ville.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’assurance

La politique de l'autruche qui plonge sa tête dans le sable peut sembler être un analgésique temporaire à l'écoanxiété. Mais quoi qu'en disent le Président Trump, de nombreux conservateurs et tous les climato-négationnistes de la droite radicale, ignorer les changements climatiques ne les fera pas disparaître ! Plus les grands de ce monde attendent pour faire face à cette réalité, plus le réveil sera brutal pour tous ![1]
En 2024-2025, la liste des désastres climatiques est longue. Pensons aux incendies de Jasper en Alberta et dans la ville de Los Angeles, et aux ouragans Milton et Helene. Ici, dans la région de Montréal, on se souvient que le 9 août dernier, nous avons été accablés lorsque les pluies diluviennes de Debbie ont inondé nos rues et que l'eau s'est introduite dans nos sous-sols. Mais c'est de la « p'tite bière » si on compare ça aux inondations en Australie, où une superficie grande comme le Texas a été recouverte d'eau durant l'automne austral ! [2]
Le coût de ces désastres est énorme tant sur le plan humain que financier. Selon le Bureau des assurances du Canada, l'ouragan Debbie a coûté 2,5 milliards de dollars ; donc, cette tempête « se classe maintenant comme l'événement climatique le plus coûteux de l'histoire du Québec, surpassant même la tempête de verglas de 1998. »[3] Quant aux ouragans Helene et Milton qui ont frappé le sud des États-Unis, Bloomberg croit que le coût financier pourrait dépasser 50 milliards de dollars, américains bien évidemment.[4]
Même avant les désastres évoqués plus haut, dès le 6 mai 2024, dans l'introduction de son allocution, le sénateur Sheldon Whitehouse, alors président du comité sénatorial du budget des États-Unis, déclarait : « Le risque climatique rend les propriétés non assurables. Sans assurance, il est impossible d'avoir une hypothèque. Sans hypothèques, la valeur du marché immobilier s'effondre. L'effondrement du marché immobilier démolit l'économie. » Et plus loin, il s'interroge sur les effets de l'effondrement du marché de l'assurance dû aux coûts de ces désastres ou tout simplement du prix exorbitant des primes d'assurance. Il donne un exemple éloquent : en Floride, le propriétaire d'une maison paie en moyenne une prime annuelle de 6 000 dollars. D'autres doivent se contenter d'une assurance de dernier recours appuyée par l'État (Citizens Property Insurance) qui offre une couverture inadéquate avec des primes hors prix. Mais en cas de désastre majeur, ces assurances de dernier recours seront incapables de payer ne serait-ce qu'une infime partie des coûts réels ; l'État et les citoyens écoperont de cette mésaventure.[5]
La situation est tellement grave que des compagnies comme Farmers, Allstate, USAA et State Farm refusent tout nouveau client dans des États comme la Californie. Et après les feux de cette année, « sept des douze compagnies les plus importantes ont imposé des restrictions très sévères aux propriétaires ou dans certains cas presque décuplé le coût des primes. »[6]
Contrairement aux climato-négationnistes, les actuaires ont les données pour connaître véritablement la situation. Le but de l'assurance, c'est de gérer les risques. Mais les changements climatiques rendent cette gestion quasi-impossible. Il faut renforcer nos infrastructures pour les rendre capables de résister aux colères de Dame Nature. C'est pourquoi la lettre que des maires ont adressée aux cinq partis politiques arrive à point. Selon eux, pour répondre aux menaces tarifaires de Trump, la diversification de nos marchés ne passe pas par la construction de pipelines et de structures qui avantageraient les « énergies conventionnelles ». Ce genre de réponse aggraverait une situation climatique déjà alarmante. Au contraire, il faut favoriser notre économie en aidant nos municipalités à faire face aux dérèglements de notre climat.[7]
En cette période perturbée, nous avons besoin d'être rassurés. Mettre nos infrastructures à l'heure des catastrophes climatiques comme stratégie pour faire face aux tarifs trumpiens est une excellente prime d'assurance. En cette période électorale, espérons que les candidats de tous les partis politiques prêteront l'oreille à la suggestion constructive et pleine de bon sens de Mme Valérie Plante et des autres édiles municipaux.
Gérard Montpetit
La Présentation, Qc
le 17 avril 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Chaque mot compte, chaque vote aussi

Aujourd'hui, j'étais entre deux mondes. D'un côté, Ruba Ghazal et Jean-Luc Mélenchon lors d'un événement politique de Québec solidaire ; de l'autre, les chefs des principaux partis fédéraux lors du débat francophone.
Écouter Mélenchon m'a apporté du réconfort. Il a défendu la langue non pas comme une imposition, mais comme une cause commune. Il a revendiqué le contact direct avec la classe ouvrière et a porté un message de gauche sans l'édulcorer à l'approche des urnes. Sa manière de communiquer — entre le théâtre et la philosophie, entre l'émotion et la radicalité — était tout simplement puissante.
De l'autre côté, j'ai ressenti le vertige de l'époque vers laquelle le Canada semble se diriger. Une droite qui érige la peur, l'immigration et l'islamophobie en piliers de son discours. Une droite qui oublie — ou feint d'oublier — que ceux qui s'expriment sont eux aussi des immigrants, des colons sur une terre qui ne leur appartient pas. Le Bloc Québécois et le Parti conservateur sont les partis de la terreur, de l'égoïsme, de l'intimidation politique. Ils rivalisent pour voir qui punira le plus durement les plus vulnérables — et ils s'en vantent sans la moindre gêne, ignorant que leurs paroles atteignent aussi ceux qui, bien que privés du droit de vote, se sentent directement visés.
Ce sont nos Trump locaux. De petits autoritaires aux accents fascisants qu'il ne faut pas laisser respirer. Chaque vote pour eux est un vote contre l'humanité, contre la solidarité — non seulement envers les Palestiniens ou les minorités, mais envers nous tous. Car ils ne s'arrêteront pas là : ils finiront par nous criminaliser un par un, selon leur convenance.
Et non, le Hamas n'est pas une organisation terroriste, tout comme ne l'étaient pas le Congrès national africain de Nelson Mandela ni le Sinn Féin de Gerry Adams. Employer ce genre de terminologie est malhonnête envers le public, car cela revient à ignorer la différence fondamentale entre un État occupant comme Israël et un mouvement de résistance luttant pour libérer ses territoires occupés. L'omission délibérée de la voix palestinienne dans les médias est un affront de plus : on nie aux peuples arabes le droit d'être entendus selon leurs propres termes, devant une audience mondiale.
Jean-Luc Mélenchon a été habile en exposant le caractère politique des accusations d'antisémitisme portées contre lui — une tentative de museler les voix dissidentes. Et Jagmeet Singh a eu raison d'introduire, en plein débat, le mot que beaucoup évitent : génocide. Nommer les choses, c'est essentiel. Car face à une narration fasciste, on ne peut pas répondre à moitié, ni depuis le cadre défini par la droite. Il faut la confronter de front.
Nos vies en dépendent.
Manuel Tapial
Membre du Conseil d'Administration de Palestine Vivra
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« 𝟐𝟓 % 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦 : 𝐮𝐧 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 »

Attac Québec et la coalition Échec aux paradis fiscaux ont transmis cette semaine aux représentant.e.s des principaux partis politiques fédéraux une déclaration intitulée « 25% minimum : un engagement politique pour une imposition juste des multinationales »
Tiré de l'Info lettre D'Attac Québec
Les dernières semaines de campagne ont démontré que la défense de l'intégrité du régime fiscal canadien et le financement adéquat de notre modèle social constituent des priorités pour les électrices et électeurs canadien.ne.s ✅
Nous demandons à nos politicien.ne.s d'appuyer la déclaration afin de démontrer leur volonté de lutter contre l'évitement fiscal en œuvrant pour une imposition minimum des profits des multinationales à 25 % effectifs. La déclaration et les logos des partis qui l'appuient seront révélés publiquement dans les derniers jours de la campagne électorale.
DÉCLARATION : « 25% minimum : un engagement politique pour une imposition juste des multinationales »
L'actualité des dernières semaines démontre que la question de l'imposition juste des multinationales est un sujet qui inquiète les électrices et électeurs canadien.ne.s.
Pendant qu'un mouvement de résistance face à l'action des géants complices de la politique du
président Trump se lève à travers le pays, les Canadiennes et Canadiens s'interrogent sur les
conséquences de l'impunité des multinationales en matière fiscale sur la pérennité du
modèle social canadien.
La société civile alerte depuis de nombreuses années le gouvernement canadien quant aux
pratiques d'évitement fiscal à grande échelle des sociétés multinationales. Au cours des dernières
décennies, les experts ont observé à travers les pays développés une baisse importante de la
contribution des multinationales aux trésors publics. Au Canada, la situation a atteint un état
critique, alors que le taux effectif moyen d'imposition des multinationales canadiennes
opérant au pays a atteint le seuil historiquement bas des 9,4 %, soit plus de 17 % en deçà du
taux statutaire fédéral-provincial moyen (26,6%).
L'imprévisibilité de la situation économique actuelle met au jour la fragilité du filet social dont nous
avons hérité. Le gouvernement canadien dispose de marges de manœuvre budgétaires réduites,
qui laissent douter de sa capacité à continuer de soutenir notre modèle social face à la tempête
qui s'annonce. Un nouvel élan de solidarité est nécessaire, qui passe par une contribution plus
adéquate des contribuables corporatifs au pot commun.
Nous demandons à votre parti politique de lutter contre l'évitement fiscal et le recours aux
paradis fiscaux, en vue d'une imposition plus juste des profits des multinationales œuvrant
au pays, qui fixerait leur taux effectif de contribution à un minimum de 25 %.
Si votre parti appuie cette position de principe, nous vous demandons de nous le signifier
officiellement avant le 24 avril afin de démontrer votre volonté d'appliquer une fiscalité plus
juste, et ce dans le but de renforcer les services publics pour toustes. La déclaration et les logos
des partis qui l'appuient seront révélés publiquement dans les derniers jours de la campagne
électorale fédérale.
Votre logo :
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Élections fédérales 2025 - Beauport Limoilou : Enfin, les candidats parlent d’environnement

Québec, 18 avril 2025 - Les membres de la Table citoyenne Littoral Est et d'Accès Saint-Laurent Beauport ont pu obtenir des engagements de la part des candidats aux élections fédérales de Beauport-Limoilou.
Nos organismes souhaitent susciter l'engagement des partis politiques pour opérationnaliser la reconnaissance du droit à un environnement sain, propre et durable pour les citoyens des quartiers littoraux. Ce nouveau droit a récemment été intégré à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) pour assurer un avenir plus sain et plus juste.
Suite à des rencontres avec les candidat-e-s et des échanges de courriel, nous résumons ainsi leurs engagements dans l'ordre de réception de leur envoi.
Les candidat-e-s du Bloc Québécois de la Capitale-Nationale ont dévoilé, le 7 avril dernier, leurs
propositions pour la région.
Ainsi, elles et ils s'engagent à :
– Soutenir la création d'un centre d'expertise et d'innovation technique sur la qualité de l'air en tirant avantage de l'expertise et des connaissances techniques de nos nombreuses institutions
postsecondaires.
– Exiger la restauration environnementale des installations du Port de Québec, notamment la protection des battures de Beauport et demeurer très vigilants quant à l'acceptabilité sociale des divers projets du Port de Québec, afin d'améliorer la qualité de l'air et de vie des résident-e-s des quartiers centraux.
« La gestion du Port de Québec doit prendre un virage obligatoire vers l'acceptabilité sociale et la transparence en matière de transport des matières dangereuses. Il en va de la santé et de la sécurité des citoyen-ne-s », souligne la candidate de Beauport-Limoilou, Julie Vignola.
– Pour favoriser la construction de logements sociaux, ce parti souhaite exiger que les règles de la
SCHL correspondent aux besoins de la région.
Le 12 avril, Dalila Elhak, candidate du Parti Vert du Canada, nous indique qu'elle est résidente de
Limoilou depuis treize ans et a été témoin en 2013 de l'épisode de la poussière rouge. Cet événement marquant a profondément renforcé son engagement en tant que citoyenne pour la santé de notre environnement et le bien-être de notre communauté.
« C'est pourquoi je tiens à vous exprimer tout mon appui dans vos revendications, que ce soit, pour mettre fin à tout éventuel projet de terminal de conteneurs, pour accorder un statut légal de protection aux battures de Beauport, pour assurer un accès direct à ces battures pour la population et pour faire du logement social une véritable priorité nationale. Ces enjeux sont cruciaux pour garantir une qualité de vie digne et un avenir durable à notre quartier, à notre ville et à notre société dans son ensemble », conclut Dalila Elhak.
Ce 14 avril, Steeve Lavoie, candidat du Parti libéral du Canada, nous écrit que du point de vue du
développement, un gouvernement libéral exigera toujours que notre développement économique se fasse dans une perspective de développement durable en respectant notre environnement.
« Nous encourageons l'accès et la protection des zones naturelles, notamment nos berges et nos
battures. Nous nous engageons à évaluer chaque projet afin de nous assurer du respect des normes environnementales. L'acceptabilité sociale est également une condition nécessaire à l'aval d'un gouvernement libéral pour tout projet d'envergure », a résumé Steeve Lavoie.
« La crise du logement que nous traversons actuellement est une priorité pour nous. C'est pourquoi le gouvernement libéral investit déjà en logement social et abordable et s'est engagé à augmenter la cadence afin d'offrir des logements au plus grand nombre de Canadiens possibles et enfin, nous donner les moyens de résorber la crise. Nous souhaitons assurer le respect et le bien-être des gens de Limoilou et de Beauport. »
Le 14 avril, les candidats du Nouveau Parti démocratique (NPD), Raymond Côté, dans
Beauport-Limoilou et Tommy Bureau, dans Québec-Centre, nous ont communiqué leurs
engagements.
« Tout projet de développement dans ce secteur devrait être fait en mettant en priorité la sécurité et la santé des personnes. Toutes et tous devraient y trouver un milieu de vie sain et pouvoir accéder facilement à ces environnements naturels uniques que sont le fleuve Saint-Laurent et la Baie de Beauport » soutient Tommy Bureau, candidat dans Québec-Centre.
« La manutention d'énormes quantités de vrac solide à proximité des habitations est un problème
connu de longue date pour les citoyens de Beauport-Limoilou. Ajouter le fardeau supplémentaire de la circulation d'un grand nombre de conteneurs dans le milieu de vie de milliers de personnes est inacceptable », déclare Raymond Côté, candidat dans Beauport-Limoilou.
« Nous supportons l'objectif de 20 % [de logements sociaux] de votre demande. Par ailleurs, un
gouvernement fédéral néo-démocrate souhaite une plus grande collaboration des autres paliers de
gouvernement pour construire. Nous souhaitons au moins 100 000 logements sociaux financés par le fédéral d'ici 2035 », concluent les deux candidats.
Une rencontre a eu lieu le jeudi 17 avril avec Hugo Langlois, candidat du Parti conservateur du
Canada dans Beauport-Limoilou. Pour monsieur Langlois, la Baie de Beauport est un lieu rassembleur qui devrait être au cœur du développement du quartier d'Estimauville.
« Mon père avait développé le site avec les gens de voile à l'époque. Le 400è anniversaire de la ville de Québec a permis, grâce aux investissements du gouvernement fédéral, un réaménagement qui permet aux citoyens de profiter de ce splendide secteur. Je m'engage à travailler à protéger ce site et même à bonifier le secteur pour permettre à plus de citoyens d'en profiter. Le fleuve est une richesse pour Beauport Limoilou », exhorte monsieur Langlois.
Nous rappelons que dans Beauport-Limoilou, les sources d'émissions atmosphériques et de pollution sont nombreuses : autoroutes, terminaux portuaires, papetière, cours de triage, incinérateur, deux projets industrialo-portuaires sur la table à dessin, etc. Un virage à 180 degrés s'impose pour embellir, assainir et verdir nos milieux de vie.
Le défi est énorme. Notre santé est sacrifiée et nos droits bafoués. C'est pourquoi, nous demandions le 3 avril dernier aux candidats et à leur parti de :
● reconnaître que le Littoral Est est une zone sacrifiée ;
● s'opposer à un éventuel projet de terminal de conteneurs promu par l'entreprise QSL au Port
de Québec et à tout autre projet émetteur de pollution atmosphérique ;
● d'accorder un statut légal de protection aux battures de Beauport ;
● d'assurer un accès direct, sécuritaire et convivial à la baie de Beauport via l'avenue
D'Estimauville ;
● se doter d'un objectif chiffré de bonification de l'enveloppe budgétaire destinée au logement
social dans le secteur afin d'atteindre 20% du marché locatif dans un proche avenir. - 30 -
Pour information :
Daniel Guay, Accès Saint-Laurent Beauport :
Azélie Roclay, Table citoyenne Littoral Est :
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des emplois et des logements, pas de tarifs ni d’armement !

Alternative socialiste appuie officiellement la toute première candidature de Simon-Pierre Lauzon aux élections fédérales dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Voici un aperçu de sa réponse socialiste aux crises que nous traversons.
14 avril 2025 | tiré d'Alternative socialiste
Pour des revenus qui compensent l'inflation,
INDEXER TOUS LES SALAIRES ET PRESTATIONS AU COÛT DE LA VIE !
Tous les partis fédéraux s'engagent dans la guerre commerciale contre Donald Trump et la Chine. L'escalade des tarifs douaniers entre pays fait plonger l'économie mondiale vers la récession. Mais même dans un tel scénario, les plus grandes compagnies réussiront à garantir leurs profits. Pour les gens ordinaires, ça signifie des hausses de prix pour l'épicerie, l'essence et le loyer. Les patrons gèleront ou couperont les salaires, alors que les gouvernements coupent déjà dans les services publics.
Pour loger tout le monde, décemment et à bon prix,
CONSTRUIRE DES CENTAINES DE MILLIERS DE LOGEMENTS PUBLICS ÉCONERGÉTIQUES !
Les partis fédéraux veulent continuer d'offrir des millions de dollars aux propriétaires et aux promoteurs immobiliers privés. Les partis espèrent voir ceux-ci construire des logements abordables. En réalité, les promoteurs s'en mettent plein les poches en construisant des condos de luxe, et les propriétaires évincent les gens pour hausser les loyers. La hausse des tarifs douaniers sur le bois d'œuvre rend urgente la résolution de la crise du logement, que l'on pourrait aborder grâce à un programme massif de construction et de rénovation de logements publics de haute qualité et à loyer réellement abordable.
Pour créer des milliers d'emplois écologiques et de qualité.
NATIONALISER LE SECTEUR DES TRANSPORTS URBAINS ET INTERURBAINS !
Les partis fédéraux proposent de continuer et même d'accélérer l'exploitation des combustibles fossiles au Canada. Nous ne pouvons pas compter sur leurs promesses pour éviter les catastrophes climatiques, la pollution et les problèmes de santé publique.
La guerre tarifaire affecte le prix des automobiles et de l'essence. C'est le moment d'offrir des systèmes de transport en commun modernes, accessibles et gratuits à toute la population canadienne. Cela passe par le redéploiement d'un réseau ferroviaire moderne et nationalisé.
Pour financer des services publics gratuits, accessibles et de qualité,
QUITTER L'OTAN ET ARRÊTER LES INVESTISSEMENTS DANS LA DÉFENSE ET L'ARMEMENT !
TAXER LES ULTRA-RICHES ET LES GRANDES COMPAGNIES !
ABOLIR LES PARADIS FISCAUX ET NATIONALISER LA FINANCE !
Les partis fédéraux ne peuvent pas nous sortir de la stagnation et de la récession économique, car ils ne s'attaquent pas aux profits et à la propriété des grandes compagnies privées. Leur tactique principale consiste à investir dans l'armement et à organiser des guerres où la classe ouvrière est envoyée se battre contre ses propres intérêts.
Il est nécessaire de rompre avec le modèle capitaliste pour financer les ambitions sociales, écologiques et démocratiques de la classe ouvrière. Cela passe par une forte taxation des grandes entreprises et du luxe, et l'abolition des paradis fiscaux. Au-delà de la taxation, il est essentiel de nationaliser les secteurs clés de l'économie – comme l'énergie, le logement et les télécommunications – afin que leur gestion démocratique repose entre les mains des travailleurs et des travailleuses et soit orientée vers les besoins réels de la population.
Pour la libération nationale de la Palestine et de l'Ukraine,
AIDER À RECONSTRUIRE UNE FORCE POLITIQUE OUVRIÈRE ET SYNDICALE DANS LES PAYS VICTIMES DES GUERRES IMPÉRIALISTES !
Pour les puissances impérialistes, la guerre directe ou interposée permet d'accéder à de nouveaux marchés en détruisant ses concurrents. La classe ouvrière canadienne n'a aucun intérêt à mener indirectement la politique impérialiste des États-Unis en Ukraine ou à Gaza. Exigeons l'arrêt immédiat de la production militaire canadienne destinée au marché mondial !
Pour une classe ouvrière unie et sans frontières,
DÉFENDONS LES DROITS DE TOUT LE MONDE !
Les travailleuses et les travailleurs migrants font partie intégrante de la classe ouvrière canadienne. Il faut garantir à toute personne les mêmes droits sociaux, politiques, économiques et syndicaux, peu importe son statut migratoire. Il faut rompre avec le système de l'immigration temporaire, qui institutionnalise une précarité extrême.
Pour le respect de la diversité sexuelle,
GARANTIR L'ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE !
Les personnes LGBTQIA+ sont surreprésentées parmi les populations précaires, sans-abri, et exclues des services de santé, d'éducation ou d'emploi stables. Le capitalisme repose sur une norme familiale hétéronormative, utile au maintien et à la reproduction de la force de travail, ainsi que sur des rapports sociaux qui exploitent, divisent et hiérarchisent les identités.
Au-delà de la simple inclusion, lutter contre les oppressions spécifiques signifie notamment garantir un accès universel et gratuit aux services publics, en particulier aux services de santé adaptés aux réalités queer et trans.
Pour réaliser ce programme,
CONSTRUIRE UN PARTI POLITIQUE SOCIALISTE PAN-CANADIEN BASÉ SUR LES LUTTES SYNDICALES ET SOCIALES !
Les changements sociaux radicaux ne se réalisent pas en « convainquant » les élites ou suite à un « vote stratégique ». Seules l'organisation et l'action politique conscientes de larges couches de la population peuvent transformer la société en faveur de nos intérêts comme travailleuses et travailleurs. Tous les pans de la classe ouvrière en lutte partagent les mêmes intérêts globaux. Les grands mouvements de lutte spécifiques ou économiques ont le potentiel de s'unir pour former une structure de combat politique indépendante : un parti ouvrier socialiste.
Pour en savoir plus, vous impliquer ou faire un don : campagnesimonpierrelauzon@gmail.com
par Alternative socialiste
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
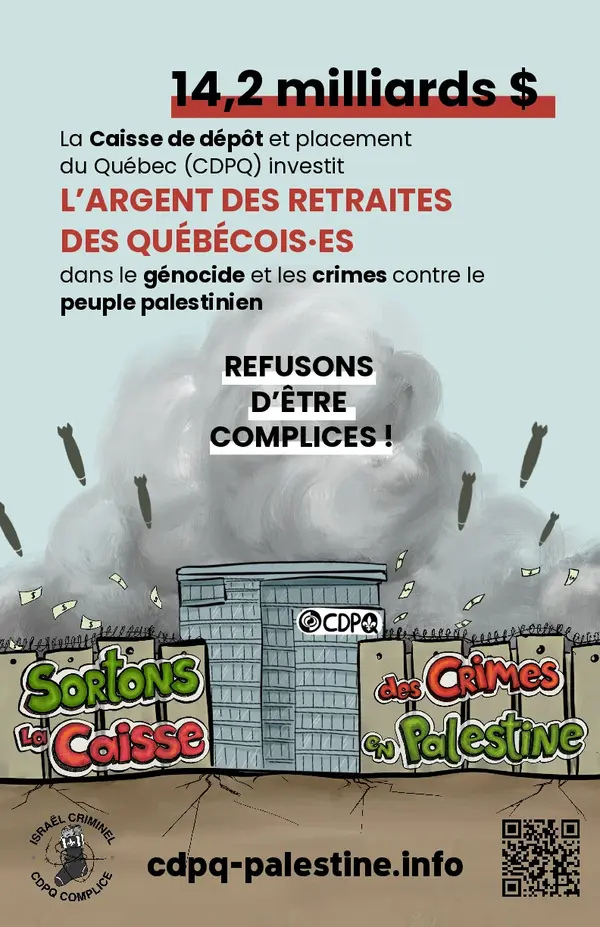
Campagne pour sortir la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) d’investissements dans des entreprises et activités néfastes pour les Palestiniens
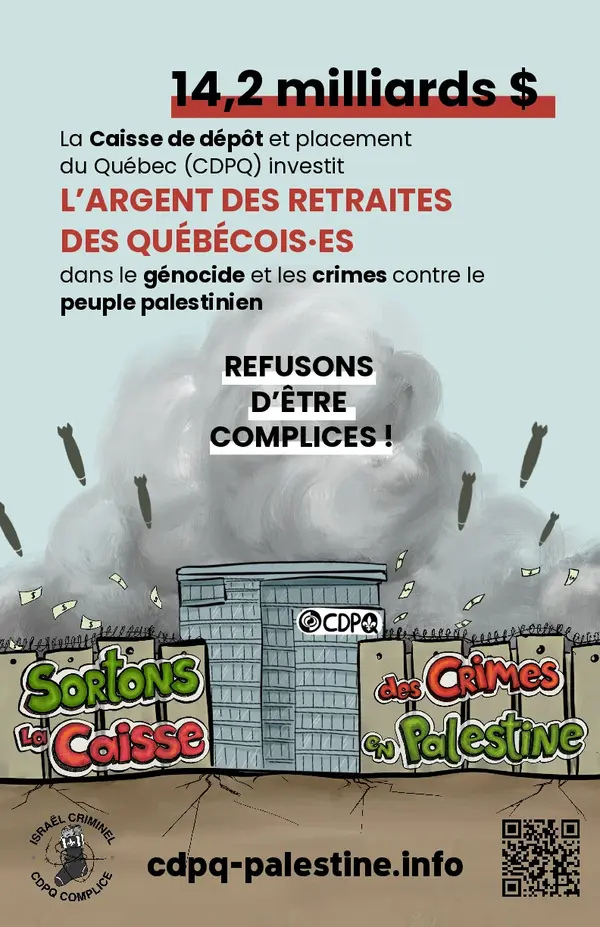
Cette campagne panquébécoise porte deux revendications concernant la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Chers amis et amies, sympatisant.e.s de la cause palestinienne,
Je communique à nouveau avec vous pour vous inviter à participer à une campagne lancée récemment par la Coalition du Québec Urgence Palestine concernant des investissements par le « bas de laine des Québécois et Québécoises » (Caisse de dépôt et de placement du Québec) dans des entreprises menant des projets portant atteinte aux droits des Palestiniens et considérés comme illégaux ou criminels aux yeux du droit international.
Vous êtes sûrement au courant des bombardements et exactions innommables menées par l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie, des agressions appuyées, dans ce dernier cas, par des colons illégalement installés dans ce territoire palestinien. Les reportages sur la situation encore aggravée à Gaza se font étonnamment plus rares. Celui du téléjournal du soir de Radio-Canada, lundi dernier, avec le témoignage d'une jeune médecin parlant du pire qu'elle ait connu à travers le monde m'a laissé très désemparé et sans mot pour qualifier l'inhumanité en cours là-bas. Pour l'ONU, la population, privée de tout ravitaillement depuis un mois et demi, affamée, ne comptant plus les morts, les blessés et les malades, constamment déplacée et pilonnée sans répit, y vit sa pire période depuis le début des attaques en octobre 2023. Nétanyahou et Trump avaient promis « l'enfer » à Gaza si le Hamas ne se pliait pas à toutes leurs exigences arbitraires, lesquelles contrevenaient d'ailleurs aux conditions convenues : ils ont tenu parole, Gaza est devenu un véritable abattoir humain !
Sur le coup et à court terme, vous pouvez vous sentir comme moi quelque peu impuissants face à la politique menée par l'actuel gouvernement d'Israël, imposée par son aile d'extrême-droite religieuse et condition de l'appui indispensable de celle-ci à la coalition au pouvoir. En effet, comme il était prévisible, Netanyahou a tout fait pour faire dérailler l'accord conclu en janvier dernier pour un cessez-le- feu en trois phases dont la seconde prévoyait le retrait de l'armée israélienne. Rien de surprenant, donc, car son intention ultime, appuyé en cela par D. Trump, avait toujours été de chasser définitivement tous les Palestiniens de Gaza, et éventuellement de faire de même pour ceux de Cisjordanie.
Faisant un pas de côté, la Coalition du Québec Urgence Palestine a entrepris récemment de lancer une campagne (« Sortons la Caisse des crimes en Palestine ») visant directement la participation d'une institution québécoise de premier plan à une telle situation, la CDPQ. S'il apparaît difficile pour nous d'aider directement les Palestiniens, au moins pouvons-nous faire obstacle à l'oppression exercée en notre nom contre ce peuple par les investissements d'une institution publique d'ici qui n'a jamais reçu un tel mandat de notre part alors qu'elle utilise notre argent à un tel usage. Rappelons ici que parmi les 48 composantes de ce « portefeuille » québécois, le 2e plus grand fonds de pension du Canada (432 milliards $), on compte l'argent du Régime des rentes du Québec, du RREGOP, de la SAAQ, de la Commission de la construction du Québec, de diverses caisses de retraites ou d'assurance, etc.
Cette campagne panquébécoise porte deux revendications concernant la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) :
1. le désinvestissement des 14,2 milliards $ de la CDPQ dans 87 entreprises ayant des activités liées à la colonisation et à l'occupation militaire par Israël des territoires palestiniens (Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza), voire au génocide commis par Israël à Gaza.
À titre d'exemples des entreprises en cause, la CDPQ avait investi, au 31 décembre 2023 :
4,2 milliards $ dans WSP Global, une firme d'ingénierie dont le siège social est à Montréal, qui supervise l'expansion du train léger de Jérusalem vers les colonies illégales de Jérusalem-Est (la CDPQ en est le plus important actionnaire) ;
1,2 milliards $ dans Alstom, qui participe à la construction de la ligne ferroviaire A1 Jérusalem-Tel-Aviv, sur des terres palestiniennes expropriées en violation du droit international ;
62,2 millions $ dans Lockheed Martin, dont les avions de chasse ont servi à tuer des dizaines de milliers de personnes à Gaza et à détruire toutes les infrastructures civiles de ce territoire.
Refusons de nous faire complices et exigeons que la CDPQ retire ce type d'investissements néfastes pour le peuple palestinien !
2. La mise en place d'un processus de contrôle transparent pour garantir qu'aucune entreprise dans laquelle la CDPQ investit ne soit associée à des violations des droits humains et du droit international.
Parmi plusieurs actions possibles de la Campagne, des lettres peuvent être envoyées aux administrateurs de la Caisse afin que soit mis fin à ses investissements impliqués dans des entreprises et projets fautifs. L'action des lettres va actuellement bon train, car 5 345 de celles-ci ont déjà été envoyées sur l'objectif de 6 400. Aidez-nous à dépasser celui-ci. Dans tout l'éventail international des formes de solidarité possibles avec les Palestiniens, c'est nous, comme Québécois et Québécoises, qui sommes les mieux placés pour intervenir auprès de la CDPQ comme acteur important de l'oppression israélienne.
Pour plus d'infoformations :https://cdpq-palestine.info/agir/index.fr.html
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

PL69 - Des citoyen·ne·s inquiet.e.s de voir leur facture d’Hydro explosée inondent de courriels la ministre de l’Énergie

Montréal, le 15 avril 2025 – Aujourd'hui, alors que le Projet de loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques au Québec (PL69) est toujours à l'étude, des centaines de citoyen.ne.s de partout au Québec ont écrit de manière concertée à la ministre de l'Économie, l'innovation et de l'Énergie pour lui demander d'abandonner le PL69.
Cette action coordonnée par l'ACEF du Nord de Montréal a été organisée par plusieurs associations de défense des droits des consommateurs de partout au Québec.
Avec cette action, les citoyen.ne.s ont voulu dénoncer le PL69 qui risque d'aggraver la précarité énergétique, un problème déjà vécu par 1 ménage québécois sur 7. « De Montréal au Lac-Saint-Jean en passant par les Laurentides, l'Estrie, les Bois-Francs et l'Outaouais, ces citoyen.ne.s demandent à la Ministre de tenir un débat public sur l'avenir de l'énergie avant d'adopter sa loi afin de s'assurer que les questions de justice sociale ne sont pas oubliées » résume Émilie Laurin-Dansereau, organisatrice communautaire à l'ACEF du Nord de Montréal.
S'il n'est pas modifié de façon importante, le projet de loi 69 entraînera des hausses de tarifs considérables. Rappelons que chaque année, Hydro-Québec conclut des centaines de milliers d'ententes de paiement avec sa clientèle résidentielle. Une hausse de tarifs ne fera qu'étrangler davantage les ménages qui étouffent déjà sous le poids de leurs obligations financières. -30-
Source :
ACEF du Nord de Montréal
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Nous ne sommes pas venus ici pour devenir des esclaves ! »

Suite aux révélations paru dans Le Devoir le 09[1] et 10[2] avril 2025 concernant l'abus vécu par des travailleuses et travailleurs migrant.e.s avec l'Agence de recrutement et de placement des employés Iris Inc., le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) et 6 groupes signataires du Bas-Saint-Laurent tiennent à montrer notre solidarité et à dénoncer ces violences.
L'Agence Iris, basée à Châteauguay puis à Ville LaSalle, a procédé à l'obtention des permis de travail fermés, liés à des postes au sein de l'agence qui n'existent pas en réalité. L'Agence Iris a ensuite affecté ces travailleuses et travailleurs à différentes entreprises-clientes, dont la résidence Reine Antier à Rivière-du-Loup. L'affectation des travailleuses et travailleurs à des lieux différents de ceux inscrits dans leur permis de travail contrevient bien entendu au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. M. Dieudonné Nidufasha, directeur de l'Agence Iris, a pourtant dit aux travailleuses et travailleurs qu'il avait l'autorisation de le faire par le gouvernement.
De plus, M. Nidufasha doit plusieurs dizaines de milliers de dollars en salaires impayés. Plusieurs plaintes à ce sujet ont été déposées à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), il y a plus d'un an. Cette agence demeure toutefois en opération et titulaire de deux permis valides de la CNESST, à titre d'agence de recrutement de travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et d'agence de placement de personnel.
Plusieurs plaintes ont également été envoyées à Service Canada, en charge du respect du Programme des travailleurs étrangers temporaires, il y a plus d'un an. Aucun suivi n'a été fait de leur part et aucune enquête ne semble avoir été entamée à l'encontre de l'Agence Iris par Service Canada.
Ces abus ont mis ces travailleuses et travailleurs dans une situation d'extrême précarité financière. Ces travailleuses et travailleurs se battent encore pour obtenir les salaires impayés, leurs feuilles de paie et leur relevé d'impôts, nécessaires pour leurs démarches d'immigration.
« Cette situation est totalement inacceptable ! » tonne Florian Freuchet du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) du Bas-Saint-Laurent. « Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Cette situation illustre parfaitement les problématiques liées aux agences de placement et de recrutement qui contournent les normes du travail et c'est monnaie courante ! La CNESST doit se doter de leviers supplémentaires pour sanctionner les agences de placement et de recrutement frauduleuses. C'est d'ailleurs elle qui émet les permis d'exploitation des agences de recrutement et de placement », poursuit-il.
« On voit encore que les institutions provinciales et fédérales se montrent inefficaces à protéger les travailleuses et travailleurs migrant.e.s face aux abus de ces intermédiaires privés qui profitent de leur vulnérabilité. Je ne connais PERSONNE qui soit à l'aise avec ce type d'esclavagisme moderne. Il y a urgence d'agir contre ces délits crapuleux. J'ai mal à mon Québec, j'ai honte du Canada. », mentionne quant à lui Sylvain Lirette, président du Conseil Régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
À la lumière de ce scandale, le CTTI et ses alliés réitèrent leurs revendications encore une fois pour que le gouvernement fédéral abolisse le permis de travail fermé qui expose continuellement les travailleuses et travailleurs migrants à ces situations d'exploitation. En outre, notons que de plus en plus de personnes migrantes perdent leur statut migratoire à la suite de telles situations abusives, ce qui nous réaffirme l'urgence de régulariser les personnes sans statut qui ne sont que des victimes du système d'immigration lui-même.
Notes
[1] https://www.ledevoir.com/societe/865483/enquete-travailleurs-etrangers-donnes-location
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les États généraux québécois de la solidarité internationale, un moment charnière pour l’AQOCI

Entrevue réalisée par Rana Bouazer, correspondante, en décembre 2024 avec Éric Normand Thibeault, coordonnateur des États généraux de la solidarité internationale initiée par l'Association québécoise des organismes de solidarité internationale (AQOCI)
16 avril 2025 | tiré du journal des Alternatives
Les États généraux québécois de la solidarité internationale, relancés par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), offrent un espace unique de dialogue et de réflexion sur les enjeux mondiaux actuels. Dans une entrevue exclusive, Éric Normand Thibeault, coordonnateur des États généraux québécois de la solidarité internationale, partage les motivations concernant cette initiative et ses objectifs visant à la solidarité internationale. Découvrez les dessous de cette démarche ambitieuse et les moyens pour les citoyen.nes de s'impliquer activement.
JdA-PA : En quoi consistent les États généraux de la solidarité internationale et qu'est-ce qui a amené l'AQOCI à relancer ce processus ?
Eric Normand Thibeault : L'AQOCI regroupe 73 organismes membres et collabore avec plus de 1 300 partenaires dans le Sud, intervenant dans 112 pays à travers le monde. En 2006, lAQOCI avait organisé les États généraux de la solidarité internationale, un espace de dialogue réunissant divers acteurs de la société civile, du secteur éducatif et du développement. Après presque 18 ans, l'AQOCI a choisi de relancer ce processus en raison des évolutions des enjeux mondiaux.L'objectif est de discuter des défis et des opportunités de la solidarité internationale et de formuler des propositions concrètes pour construire un monde plus juste. Contrairement à un congrès ou un colloque, les États généraux sont une véritable plateforme de dialogue et de reflexion collective , qui rassemble des acteurs des mouvement sociaux , du milieu syndical, du secteur éducatif, des chercheurs, des ONG et des partenaires du Sud.
JdA-PA : Comment se déploient les États généraux ?
ENT : Depuis leur lancement le 13 juin 2024 , les États généraux se déroulent sous forme de dialogues régionaux avec les partenaires de l'AQOCI, qui mènent des projets de solidarité internationale. Ces dialogues ont lieu tout au long de l'année et couvrent plusieurs régions du monde : l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. La prochaine rencontre est prévue pour le 11 décembre 2024. L'objectif est de recueillir des contributions de terrain sur des questions directrices afin de mieux orienter les actions de solidarité internationale.
JdA-PA : Quelles sont les thématiques abordées cette année, et pourquoi le thème de la démocratie et de la participation citoyenne a-t-il été choisi ?
ENT : Cette année, les États généraux abordent des thématiques cruciales telles que la démocratie et la participation citoyenne, un sujet particulièrement pertinent dans le contexte actuel. « Ce thème a été choisi pour répondre à une nécessité de renforcer la participation citoyenne active dans les décisions politiques, afin de garantir des sociétés plus inclusives et solidaires », explique le porte-parole de l'AQOCI. Ces discussions visent à identifier des solutions concrètes pour engager les citoyennes et les citoyens dans la transformation des sociétés.
JdA-PA : Où et quand se déroulent les États généraux ,et comment les gens peuvent-ils y participer ?
ENT : Les États génbéraux se dérouleront tout au long de l'année, avec plusieurs événements régionaux, et se clôtureront par un grand rassemblement du 4 au 6 juin 2025. Les personnes issues de ces réseaux et partenaires des membres l'AOQCI peuvent contribuer en consultant le site de l'AQOCI et soumettre des contributions écrites. Les participations pour rejoindre les dialogues régionaux sont sur invitation. Ces contributions permettent de faire entendre leurs préoccupations
JdA-PA : Pourquoi le thème de la démocratie et de la participation citoyenne a-t-il été choisi cette année pour les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) et quel est le lien avec les États généraux ?
ENT : Chaque année, l'AQOCI choisit un thème central qui guide les activités des JQSI.Cette année, le choix s'est porté sur la démocratie et la participation citoyenne, un sujet qui contribue à la mobilisation d'un large spectre d'acteurs pour les États généraux. Il constitue tout autant un défi particulièrement pertinent dans le contexte mondial actuel. »Ce thème s'inscrit dans une volonté de renforcer la participation active des citoyens pour des sociétés plus inclusives et solidaires », explique le représentant de l'AQOCI.
« Ce thème s'inscrit dans une volonté de renforcer la participation active des citoyens pour des sociétés plus inclusives et solidaires », explique le représentant de l'AQOCI. Ce thème, qui sert de boussole pour les actions de plaidoyer et de communication de l'organisation. Le thème de cette année se décline sous diverses formes pour rejoindre le grand public, par l'intermédiaire des projections de films ou des publications. En 2023-2024, l'AQOCI et ses membres ont choisi la souveraineté alimentaire comme thématique pour les campagnes d'éducation à la citoyenneté mondiale.Après les États généraux, un autre thème sera choisi par les membres de l'AQOCI lors de l'assemblée générale, prévue en juin 2025, où environ 150 participants y réfléchiront ensemble.
JdA-PA : Quelles sont les opportunités d'engagement pour les citoyens qui souhaitent s'impliquer davantage dans la solidarité internationale, notamment pendant les périodes creuses entre les JQSI, comme entre décembre et février ?
ENT : L'AQOCI offrent à ses membres et à ses alliés différentes formes d'opportunités d'engagement tout au long de l'année, même en dehors des événements clés comme les JQSI. Les citoyen.nes peuvent organiser des événements individuels tels que des webinaires, tenir des blogs, ou s'impliquer au sein d'associations. Certaines personnes choisissent également de manifester leur soutien sur la place publique ou de participer à des activités artistiques pour mobiliser et sensibiliser le grand public aux enjeux entourant la solidarité internationale.
Par ailleurs, il existe des opportunités de solidarité internationale sur une base volontaire ou bénévole, soit à l'étranger, soit au Québec, en accueillant des réfugié.es, en soutenant les nouveaux arrivants personnes nouvelles arrivantes, ou en participant à diverses initiatives ou projets communautaires.
Nombreux programmes de volontariat sont offerts et accessible à tous les âges, permettant aux citoyen.nes de vivre une expérience de solidarité, notamment avec des organisations telles que Médecins, OXFAM Québec, le Centre de solidarité du Saguenay Lac Saint-Jean ou Ingénieurs Sans Frontières. Ces expériences de volontariat peuvent aussi avoir lieu au sein du réseau francophone, avec des jeunes québécois qui s'engagent en Europe ou ailleurs. Ces initiatives offrent des possibilités d'engagement et d'apprentissage pour celles et ceux qui souhaitent mobiliser leur expertise dans un contexte international.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Avec des bâtons et des pierres, on viendra vous aider ! » - Le Québec, l’Ukraine et l’Internationalisme de Mélenchon

Le 16 avril 2025, Québec solidaire (QS) a reçu Jean-Luc Mélenchon, le chef du parti La France Insoumise (LFI) dans le cadre d'une conférence intitulée « Battre les droites ». Le leader insoumis a en effet décidé de faire une pause à Montréal. Pas trop longtemps cependant, le temps « de prendre sa respiration » et « de plonger aux États-Unis » présenter son dernier livre où « toute une partie de la population reste dans l'ignorance sans ça » (1'48). Il y a donc une urgence internationale.
Mais pour l'ancien sénateur socialiste, il était hors de question de ne pas s'arrêter au Québec pour lequel il a une « affection irraisonnée », qu'il attribue au « tempérament anti-américain » et à la résistance aux « gringos » des Québécois·es. Une halte s'imposait alors pour apporter « un soutien effectif et affectif au Canada et à nos cousins québécois exposés aux menaces d'annexion par leur voisin les USA » (Radio Canada).
Après des entretiens dans les médias locaux et une conférence à l'Université McGill, où il est ovationné, plusieurs centaines de personnes sont donc venues l'écouter le 16 avril, en compagnie de la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal.
Et pour résumer son message, si on veut "Battre les droites", il faut réfléchir avant de voter, "ne pas oublier ses convictions dans l'isoloir" et surtout ne pas voter pour les socio-démocrates comme, Kamala Harris "qui n'est pas de gauche" ; au contraire, la candidate démocrate est un "moindre mal qui reste quand même du mal" (1'23, McGill)... C'est donc une stratégie simpliste, strictement électoraliste, qui concrètement et explicitement fait aveuglement la politique du pire que nous suggère de suivre M. Mélenchon afin de battre les droites. Et de nouveau, celui qui n'a jamais réussi à s'imposer face à l'extrême droite lors des élections présidentielles françaises, a eu droit à une standing ovation, de la part de nombreux militant·es de Québec solidaire cette fois-ci.
Il est cependant loin d'être établi que la gauche étasunienne et les victimes du néofascisme de Trump (aux États-Unis, en Afrique, au Groenland et même en Palestine, où ça pouvait pourtant difficilement être pire) comprennent et souscrivent à une telle stratégie électoraliste ; c'est du moins ce que semblent attester les millions de personnes descendues dans la rue dans toutes les villes étasuniennes au mois d'avril, en s'organisant à la base (Federal Unionist Network, Hands Off, FiftyFiftyOneMovement), sans même avoir lu le livre de M. Mélenchhon, sans attendre les prochaines élections comme il le suggère, sans attendre les appels des leaders politiques, sans attendre les appels des centrales syndicales nationales encore largement silencieuses et invisibles.
Il est également très peu probable que M. Mélenchon et ses conseils stratégiques pour battre les droites, reçoivent le même accueil enthousiaste de la part de la gauche en Ukraine, dont 20% du territoire n'est pourtant pas seulement "menacé" mais officiellement annexé par la Russie. En trois heures de conférence à Montréal sur la situation internationale et sur la manière de "Battre les droites", le leader insoumis n'a pas estimé nécessaire d'adresser ne serait-ce qu'une seule critique au régime néofasciste de Poutine. Au contraire, il a trouvé du temps et estimé nécessaire de prendre sa défense en soulignant qu' "on" accusait à tort la Russie d'avoir fait sauter le gazoduc Northstream. Certes, "on" ne sait pas qui a saboté ce gazoduc. Mais à l'écouter, les ukrainien·nes pourraient facilement penser que pour M. Mélenchon, V. Poutine n'est pas le représentant d'une droite à battre également. En tout cas, dans son plan pour "Battre les droites", la lutte contre le néofascisme russe n'est clairement pas sa priorité.
De fait, ce même M. Mélenchon qui condamne aujourd'hui les menaces d'annexion de D. Trump, se réjouissait de l'invasion de la Crimée par Poutine en 2014 ("La Crimée est perdue pour l'OTAN. Tant mieux"). Et, en février 2022, soit quelques jours à peine avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par l'armée Russe, il déclarait avec son aplomb légendaire que la Russie était un partenaire « fiable » et que l'agresseur était « l'OTAN sans aucun doute ! ».
Depuis, au-delà de l'enfumage médiatique, lui et son parti s'opposent méthodiquement à toute solidarité armée avec l'Ukraine, parfois au nom de la paix et des négociations, parfois au nom du non-alignement, parfois au nom des coûts du chauffage des français et parfois, sans honte, au nom des ukrainien·nes eux-mêmes. Et tant pis pour les camarades ukrainien·nes, socialistes, féministes, LGBTQIA+, syndicalistes qui ne cessent quant à eux et elles de réclamer des armes pour se défendre, pour résister à l'envahisseur et se protéger des missiles et des drones qui pleuvent chaque jour sur les villes ukrainiennes. Peu importe ce que pensent et revendiquent les premiers concerné·nes, la paix internationale selon M. Mélenchon est à ce prix.
Curieusement ou de manière "irraisonnée" pour reprendre son terme, M. Mélenchon affirme que pour "nous", il est cependant prêt à renoncer à tous ses principes, à abandonner le non-alignement, le pacifisme, les négociations et à se battre à nos côtés, les armes à la main. Et cette fois-ci sans peur de menacer la paix internationale, sans crainte des risques d'escalade qui découlent logiquement d'une confrontation avec une puissance nucléaire et sans même s'inquiéter des risques d'explosion des coûts du chauffage pour les ménages français...
Pourquoi ? Parce qu'il ne tolère pas que Trump nous « parle comme ça » ; lui qui, toute honte bue, affirme désormais contribuer à « résister » à l'invasion Russe en Ukraine :
« Nous nous sommes en train de résister à l'invasion de l'Ukraine par les Russes, c'est pas pour supporter l'invasion du Canada par les États-Unis d'Amérique. Hum… Donc prenez le, si vous voulez, [comme] un message de solidarité et d'affection avec vous. Voilà, avec des bâtons et des pierres, on viendra vous aider ! » (3'48)
Au-delà de ce nouveau statut autoproclamé de résistant à l'invasion Russe, de ces fanfaronneries et du paternalisme qui ne manquent pas d'agacer, comment expliquer cette solidarité internationale à géométrie variable ? Comment expliquer un tel soutien pour le Québec, avant même que quiconque lui demande quoique ce soit, et cette méprisable et irresponsable indifférence pour les revendications et les appels à l'aide militaire, répétés et continus quant à eux, de la part de la gauche ukrainienne, des féministes, des mouvements LGBTQIA+ etc. ? Comment expliquer qu'il soit prêt à prendre des bâtons et des pierres pour défendre le Québec contre Trump mais qu'il refuse de lever le petit doigt contre Poutine ?
À l'entendre s'exprimer au Québec, on ne peut faire que des hypothèses : un racisme anti-ukrainien ? La conviction que seul l'impérialisme et le néofascisme trumpien sont réels et dangereux ? Une forme « d'anti-américanisme » primaire, qui homogénéise la population étatsunienne et qui expliquerait pourquoi il se garde bien d'évoquer ici les cinq à six millions de manifestant·es qui sont descendu·es dans les rues étatsuniennes ces derniers jours ? Une confusion irraisonnée ?
Dans tous les cas, l'absence de solidarité armée avec la gauche ukrainienne constitue un renoncement au fondement du socialisme, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'internationalisme. Et ce renoncement mine très concrètement la nécessaire et urgente construction de solidarités entre les forces progressistes pour « battre les droites », pour lutter contre l'axe Trump/Poutine et plus largement pour affronter cette Internationale néofasciste qui, quant à elle, a rarement semblé aussi puissante et unie, que ce soit pour massacrer les ukrainien·nes, les palestinien·nes ou quiconque s'oppose à leur projet d'accaparement et de partage du monde.
Martin Gallié
20 avril 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

FORTES : Une murale pour célébrer l’histoire des femmes

Le centre-ville de Sherbrooke accueillera bientôt une nouvelle œuvre d'art public célébrant l'histoire et la contribution des femmes. Intitulée FORTES, cette murale, réalisée par l'artiste locale Adèle Blais, viendra enrichir le circuit des murales de la ville. L'initiative, soutenue par la Ville de Sherbrooke, vise à mettre en lumière des figures féminines marquantes et à renforcer le dynamisme culturel du centre-ville.
Tiré du Journal Entrée Libre
Date : 7 avril 2025
Sylvain Bérubé
Une œuvre engagée et symbolique
La murale sera installée sur le mur nord de la ruelle Whiting, en face de l'hôtel de ville et du carré Strathcona. Elle présentera une composition artistique unique, où des cadres de styles et formats variés mettront en valeur des portraits de femmes ayant marqué l'histoire. Par cette approche, Adèle Blais souhaite rendre hommage aux contributions féminines souvent méconnues et souligner leur rôle dans l'évolution de la société.
« La murale FORTES n'est pas simplement une œuvre d'art, c'est un hommage vibrant à la force et à la résilience des femmes qui ont façonné notre monde », a déclaré la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin. Elle souligne également l'importance de ce projet pour l'art public et la valorisation du patrimoine collectif.
Une expérience immersive grâce à la réalité augmentée
En plus de la fresque murale, le projet comprendra une dimension technologique novatrice. Grâce à l'application « Adèle Blais – Peindre l'histoire », les visiteurs pourront vivre une expérience immersive en réalité augmentée. Cette initiative leur permettra d'explorer en détail chaque élément de la murale et d'écouter l'histoire des femmes représentées. Cette intégration numérique vise à rendre l'œuvre encore plus accessible et interactive.
Adèle Blais s'est entourée de l'expertise de Serge Malenfant, spécialiste des murales, afin d'assurer la conception et l'installation de l'œuvre. L'ensemble du projet bénéficie du soutien du Service du développement économique de la Ville de Sherbrooke.
Un investissement pour la culture et l'inclusivité
Le budget total alloué à la réalisation de cette murale et à son intégration numérique s'élève à 167 367 $. Cette somme provient d'un budget résiduel initialement destiné à un projet de murale qui n'a pas vu le jour après la dissolution de l'organisme M.U.R.I.R.S. en 2019.
Pour Raïs Kibonge, conseiller municipal du district du Lac-des-Nations, ce projet représente bien plus qu'une simple fresque artistique : « Avec FORTES, nous donnons vie à des récits qui méritent d'être entendus et vus. En intégrant l'art public dans l'espace urbain, nous créons un lieu vivant, accessible et attractif, tout en renforçant le sentiment d'appartenance de la communauté. »
Prochaines étapes
La création de la murale débutera en avril 2025 et s'étendra jusqu'en septembre. L'installation aura lieu en septembre 2025, suivie d'une inauguration officielle à la fin du mois.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Violences sexuelles et augmentation des loyers – Deux injustices sociales à combattre

Nous l'observons régulièrement dans l'actualité : l'augmentation du cout de la vie et des loyers exacerbe les inégalités présentes au sein de notre société. Les premières victimes de cette réalité ? Les femmes.
Tiré du Journal Entrée Libre
Consciente de cet enjeu, l'équipe du CALACS Agression Estrie tient à dénoncer les violences sexuelles subies par les femmes, alors que des milliers de locataires et de familles s'apprêtent à signer ou à renouveler leur bail pour l'année à venir. Il est essentiel de mettre en lumière cette problématique et de reconnaitre le lien étroit entre la crise du logement et les violences sexuelles dont les femmes sont victimes.
Les femmes en situation de précarité, particulièrement celles qui se trouvent à l'intersection de multiples oppressions, sont les plus touchées. L'augmentation du cout des loyers limite drastiquement leur capacité à quitter un environnement violent, faute de pouvoir accéder à un logement sécuritaire et abordable. De plus, les ressources d'hébergement destinées aux victimes de violence sont souvent saturées. Alors, où peuvent aller ces femmes confrontées à des violences sexuelles perpétrées par leur propriétaire ? Où peuvent se réfugier celles qui, en désespoir de cause, doivent échanger des services sexuels contre un toit ? Trop souvent, elles n'ont d'autre choix que de demeurer dans ces situations, ce qui amplifie leur sentiment de peur, d'insécurité, de culpabilité et de honte.
Il est impératif de considérer ce lien entre logement et violences dans l'élaboration de solutions concrètes. La pénurie de logements en Estrie a un impact majeur sur la sécurité physique, émotionnelle et sexuelle des femmes. Il est plus que temps que le gouvernement intervienne afin de garantir un accès accru aux logements sociaux, en particulier pour celles qui doivent fuir un contexte de violence. Ignorer cette problématique reviendrait à fermer les yeux sur la sécurité et la dignité des femmes.
À propos de Calacs Agression Estrie
Depuis plus de 40 ans, le CALACS Agression Estrie vient en aide aux femmes et aux adolescentes (12 ans et plus) ayant été victimes d'agression à caractère sexuel ainsi qu'à leurs proches. L'organisme communautaire autonome offre des services d'aide directe, de prévention et de sensibilisation aussi bien qu'il réalise des luttes et des actions politiques.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

De mal en pis : le nouveau contexte politique et les défis de la gauche canadienne

Cette brochure vise à encourager un débat de principe entre la gauche et la classe ouvrière afin de promouvoir un mouvement socialiste viable au Canada. Le débat démocratique est encouragé au sein et au-delà du Projet socialiste.
le 13 avril 2025 | Socialist Project | Traduction David Mandel
https://socialistproject.ca/2025/04/from-bad-to-worse/
La crise de légitimation et l'État autoritaire
La conjoncture politique actuelle se caractérise par le sentiment croissant, au Canada et partout dans le monde, que les politiques néolibérales ont échoué et que le capitalisme lui-même ne fonctionne pas. Ce sentiment est alimenté par l'affaiblissement, le démantèlement, voire la destruction, de ce qui conférait au système capitaliste une apparence de « légitimité » et d'« équité » aux yeux de la classe des travailleurs et travailleuses : salaires qui montaient, logements abordables, amélioration des soins de santé, et protection de l'environnement. Il s'agit d'une crise de légitimité croissante.
Si l'origine la plus immédiate de cette impasse est la « grande crise financière » de 2008-2010, elle est plus profondément enracinée dans la structure de l'État néolibéral, qui connaît un approfondissement de ses caractéristiques autoritaires dans la plupart des pays, en particulier avec l'arrivée au pouvoir de la seconde administration de Donald Trump aux États-Unis en janvier 2025.
La transformation des États capitalistes en un régime politique plus discipliné et axé sur le marché s'est opérée lorsque les États ont sacrifié l'augmentation des impôts sur les riches, qui avait soutenu les politiques et programmes sociaux, aux besoins du capital en matière de profits accrus, face à la longue crise des années 1970.
Les fonctions d'accumulation de l'État – les divers soutiens politiques à la rentabilité et à la réussite économique de la classe capitaliste – ont pris le pas sur la fourniture de services sociaux pour répondre aux besoins humains en matière de santé, de vieillissement, d'éducation, de culture, etc. Pour mener à bien ce programme, à partir des années 1980, le pouvoir de l'État a été largement centralisé au sein des banques centrales, des ministères des Finances et des services de police et pénitentiaires, tous largement à l'abri des pressions populaires et de la responsabilité démocratique.
Le rôle des partis politiques, des élections et des autres institutions étatiques associées à la légitimation du système est devenu de plus en plus limité et circonscrit, parallèlement à la restriction persistante des droits syndicaux. Pourtant, dans un contexte de précarité croissante du marché du travail et de stagnation des salaires jusque dans les années 1990, la contestation ouvrière a été largement contenue. Cet État néolibéral – fait de privatisations, de déréglementation, de libre-échange et de renforcement des contrôles policiers – a conduit de nombreux militants, nombreuses militantes et acteurs et actrices socialistes à parler d'une défaite de la politique ouvrière et d'un « vidage » de la démocratie libérale.
Les effets de la crise financière de 2008
C'est en 2008 que cette évolution a dégénéré en une véritable crise de légitimité politique, souvent qualifiée de « crise financière mondiale ». La crise financière s'est d'abord concentrée sur les institutions du système étatique les plus directement associées à l'intégration idéologique, dont la fonction est de convaincre la population de la légitimité et de la justice du système capitaliste – les partis politiques, les médias grand public et les établissements d'enseignement.
Elle a également pris la forme d'une crise de l'impérialisme, se répercutant du centre impérial américain sur l'ensemble du système impérial, y compris le Canada, et puis se répercutant sur le cœur même de l'empire américain. Le Canada, allié le plus fiable de l'empire, a dû faire face à bon nombre des mêmes contradictions que les États-Unis dans la gestion des conséquences économiques, sociales et idéologiques.
La crise financière a ainsi révélé l'interdépendance de formations sociales distinctes qui se sont formées au cours de la mondialisation menée par les États-Unis. Pendant plusieurs années, l'instabilité financière, la récession, le chômage et les renflouements ont touché des formations sociales particulières, à des rythmes distincts, définis par la position de chaque État national au sein du système impérial, son équilibre des forces et sa composition de classe. Chaque État a connu ses propres manifestations, ses tensions latentes et ses symptômes morbides : l'apparition de Trump et du mouvement MAGA aux États-Unis, la résurgence de mouvements fascistes majeurs en Allemagne, en Italie, en France et dans d'autres régions d'Europe, et des émeutes racistes explosives en Grande-Bretagne.
Au Canada, on a assisté à l'émergence d'une extrême droite populiste au sein du Parti conservateur national, à des scissions politiques en partis d'extrême droite dans plusieurs provinces, et à l'émergence du Parti populaire du Canada.
La crise a été aggravée par l'inquiétude populaire face à un effondrement écologique imminent, avec des incendies de forêt, des inondations et des tempêtes record frappant l'Amérique du Nord avec une régularité effrayante.
L'incapacité flagrante des États capitalistes à prendre des mesures significatives pour faire face à la catastrophe grandissante a éviscéré le mythe du « progressisme » libéral et de l'« incrémentalisme politique », selon lequel la situation s'améliorerait progressivement. Les illusions qui ont longtemps été essentielles à la légitimation du système capitaliste, comme la notion d'un « avenir meilleur », et même l'idée même de « l'avenir » sur laquelle ces idéologies s'appuient, ont brutalement disparu, surtout aux yeux des jeunes.
Pendant ce temps, la poursuite de l'austérité et des privatisations a accru l'exposition de la classe ouvrière au marché, réduisant les protections restantes contre ses ravages, tout en élargissant, ou en consolidant, sa centralité et son pouvoir dans l'allocation des ressources. Une nouvelle génération, arrivée à maturité au Canada depuis la crise de 2008, est aujourd'hui confrontée à un ordre politique et économique qui semble totalement incapable d'offrir une vie enrichissante et sûre, ce qui se traduit par des défis majeurs en matière de logement, de maintien des revenus et de sécurité d'emploi.
Ce régime d'« autoritarisme marchand » s'est consolidé grâce au durcissement des coalitions centristes, rendant le terrain électoral extrêmement défavorable à l'intervention des forces socialistes ou populaires. Outre une gouvernance hautement coercitive à l'intérieur du pays, ces forces se sont tournées vers un militarisme croissant à l'étranger, notamment par une confrontation croissante entre grandes puissances et le développement de nouveaux systèmes d'armes puissants, tels que des missiles hypersoniques équipés d'une nouvelle génération de bombes nucléaires.
La montée de ce militarisme est manifeste dans la guerre en Ukraine, soutenue par les États-Unis et l'OTAN (actuellement réévaluée par l'administration Trump à partir de 2025), et dans la guerre génocidaire israélo-américaine à Gaza.
Donald Trump et la montée de la droite
La nouvelle administration Trump a lancé une combinaison agressive d'attaques autoritaires contre des institutions étatiques clés et les communautés immigrées, recourant à des décrets présidentiels pour contourner le contrôle législatif. Cette concentration du pouvoir exécutif s'accompagne d'un nouveau discours impérialiste agressif, avec des menaces parfois illogiques contre d'autres États et territoires, notamment le Groenland, le Panama, la Chine et le Canada.
On ignore combien de temps il faudra pour que ces changements soient institutionnalisés et quelle sera leur ampleur pour instaurer un nouvel autoritarisme. Jusqu'à présent, peu d'opposition s'organise aux États-Unis. Des éléments de la classe capitaliste encore attachés au projet de mondialisation mené par les États-Unis sont mal à l'aise avec les initiatives de Trump (à l'exception de la promesse de baisses d'impôts), mais restent silencieux. Le Parti démocrate est désorienté après l'échec du programme Biden et l'aliénation populaire résultant de leur soutien aux guerres en Ukraine et à Gaza. Et la gauche et le mouvement ouvrier américains sont encore en proie à des difficultés organisationnelles, remarquablement silencieux face aux menaces contre les travailleurs et travailleuses du Canada et du Mexique.
Le durcissement de la politique et de l'État a initialement réussi en Amérique du Nord à contrer la menace mondiale croissante de l'extrême droite. Ce mouvement est notamment porté par des petits entrepreneur.e.s de plus en plus radicalisé.e.s (la petite-bourgeoisie), longtemps mis.es à l'étroit par la mondialisation, ainsi que par des pans de la classe ouvrière en colère et politiquement confus.
Malgré leurs importantes contradictions et les limites programmatiques et stratégiques majeures de la droite populiste et radicale, ces forces sociales ont été les principales bénéficiaires de la crise de légitimité. Elles ont démontré leur capacité à occuper, à des degrés divers, les espaces idéologiques évacués par les forces politiques sociales-démocrates et libérales en Europe et en Amérique du Nord.
Le réalignement néolibéral en cours des partis sociaux-démocrates en difficulté, par exemple, a continué à refléter et à alimenter la décomposition de la classe ouvrière, sous-tendue par les forces économiques centrifuges de la dispersion et de la précarité, l'augmentation forcée de la responsabilité individuelle sur le marché du travail, et l'intensification des processus de travail.
Ce processus a persisté après les défaites politiques de Bernie Sanders (faisant le pont entre le Parti démocrate et les Democratic Socialists of America aux États-Unis, de Jeremy Corbyn au sein du Parti travailliste britannique - comme auparavant avec Tony Benn), et les impasses des nouveaux partis de gauche en Grèce, en Espagne, en Allemagne et ailleurs en Europe.
Ces défaites ont ouvert la voie à une mainmise renouvelée des centristes libéraux, soutenus par les grandes entreprises, sur les partis de centre-gauche, sans grand succès électoral à l'appui. Le NPD a adopté une approche similaire aux niveaux provincial et fédéral au Canada.
Les jeunes du Canada, des États-Unis et d'Europe n'ont pas été épargné.e.s par l'adoption de solutions économiques de marché et de droite, en raison de leur manque de confiance en leur avenir économique et social, ce qui s'est traduit par un soutien électoral croissant aux partis conservateurs, comme le Parti conservateur du Canada de Pierre Polièvre et le Parti républicain de Trump.
Pourtant, la contestation, comme par le passé – notamment à l'époque du mouvement altermondialiste, d'Idle No More, et des soulèvements de Black Lives Matter – a attiré de nouvelles vagues de jeunes. Cette fois, c'est la multiplication des campements et des manifestations contre les attaques génocidaires israéliennes à Gaza, qui a attiré de nouvelles vagues de jeunes vers la pensée anti-impérialiste, les actions BDS et les politiques progressistes. La syndicalisation dans le secteur de la logistique et autour d'Amazon, ainsi que d'autres campagnes autour de l'économie des petits boulots, ont également suscité l'émergence d'une nouvelle cohorte de militant.e.s syndicaux et syndicales.
Les partis sociaux-démocrates comme le NPD ont depuis longtemps renoncé à toute remise en cause du capitalisme et n'ont guère avancé que de modestes réformes du régime néolibéral dans leur quête incessante d'un « capitalisme à visage humain ». Il est clair que l'adhésion à ces partis n'a pas donné naissance à une politique anticapitaliste ni permis l'émergence d'une nouvelle gauche politique.
Le contexte actuel, caractérisé par une gauche radicale faible, des classes ouvrières fragmentées et un mouvement syndical politiquement prudent, a conduit de nombreux et nombreuses membres de la gauche, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, à ne voir d'autre solution que de s'allier aux partis politiques traditionnels comme « partenaires juniors » au sein de nouveaux « fronts populaires », seule voie pour combattre la menace immédiate de la montée de la droite dure. Au Canada, cela se traduit par diverses alliances électorales entre le NPD, les Verts et les Libéraux (avec une variante propre au Québec), soutenues par un large éventail d'organisations de la gauche sociale cherchant à bloquer toute nouvelle érosion des acquis sociaux.
Il faut s'attaquer à la menace croissante de la droite. Mais cela ne doit pas se faire au prix de la dissolution d'une politique socialiste dans des coalitions dont les stratégies politiques et économiques – néolibéralisme et guerres mondiales en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie – ont été si directement responsables de la montée des forces d'extrême droite.
Dans ce contexte, il est plus important que jamais que la gauche socialiste mette tout en œuvre pour accroître sa propre visibilité, créer une présence organisationnelle et promouvoir, aussi vigoureusement que possible, une vision politique alternative.
Cela est nécessaire non seulement pour préserver les acquis démocratiques du passé, mais aussi pour répondre aux exigences croissantes d'un avenir proche « terrifiant » vers lequel Trump, l'OTAN et le changement climatique nous poussent sans relâche.
Si les « solutions » fondées sur le marché à la crise écologique proposées par le centre néolibéral sont insuffisantes, nous devons insister explicitement sur le fait que seule la remise en cause fondamentale du capitalisme et une profonde réorganisation de l'économie sur la base d'une démocratie radicale et la mise en œuvre d'un régime de planification démocratique ont une chance de conduire à un avenir durable. Ce n'est pas parce que cela presse que les compromis centristes ou les postures d'extrême gauche deviennent soudainement efficaces.
L'ouverture pour les socialistes
À l'heure actuelle, face à la menace des tarifs douaniers de Trump et à leurs répercussions socioéconomiques, une ouverture politique s'offre aux socialistes. La nécessité de rééquilibrer la relation du Canada avec l'empire américain – voire, pour certain.e.s, de s'en désengager – devient un sujet populaire parmi les travailleurs et travailleuses de tous horizons. Ils et elles expriment des inquiétudes quant au niveau d'intégration avec les États-Unis et aux coûts des politiques sociales et économiques de Trump, notamment les demandes d'augmentation radicale des dépenses militaires et de militarisation de l'Arctique et de la frontière canado-américaine.
Défier Trump signifie différentes choses pour différentes sections de la classe capitaliste canadienne : une majorité souhaite le statu quo ; d'autres réclament une intégration plus poussée ; et une petite minorité souhaite une politique industrielle davantage centrée sur le national, fondée sur une compétitivité et un capitalisme accrus, mais qui, à bien des égards, demeure conciliante avec l'empire américain et liée à la dépendance aux exportations.
Cette dernière position comprend des propositions visant à construire des pipelines de combustibles fossiles est-ouest, à abaisser les barrières commerciales interprovinciales, à rechercher activement de nouveaux marchés d'exportation, à poursuivre une gouvernance et des politiques économiques plus néolibérales et à répondre aux demandes de dépenses militaires accrues avec une intégration opérationnelle militaire plus poussée avec les États-Unis et l'OTAN dans l'Arctique, en Europe et en Asie de l'Est.
Les socialistes ont l'occasion de plaider en faveur d'un désengagement de l'empire américain en construisant une économie coopérative, socialement gérée et planifiée démocratiquement, organisée pour répondre aux besoins humains. Une telle économie serait davantage axée sur le développement interne, avec des prestations sociales en matière de logement, d'éducation, de transports publics et de soins de santé pour les travailleurs et travailleuses, et une évolution résolue vers la durabilité écologique et une réduction radicale des émissions de carbone.
Cela nécessiterait une rupture avec la mobilité des capitaux, le contrôle de la finance et du crédit, un nouveau régime fiscal, l'arrêt de l'austérité, l'abandon de la dépendance aux énergies fossiles et la rupture avec la voie néolibérale plus autoritaire dans laquelle Trump engage les États-Unis et que Polièvre, Doug Ford et le parti Conservateur entendent suivre.
La gauche socialiste que nous devons construire doit être anti-impérialiste. Il ne s'agit pas de semer l'illusion que le capitalisme est « à bout de souffle » ou que l'empire américain est sur le point de disparaître en tant que puissance mondiale dominante.
Nous devons reconnaître avec lucidité l'ampleur du défi. Si l'empire américain s'est fragmenté, si l'État américain ne jouit plus d'un « moment unipolaire » et si sa primauté dans l'ordre mondial s'est érodée, il n'en demeure pas moins la puissance économique, militaire et diplomatique dominante. De même, la mondialisation capitaliste et la mobilité des capitaux sont toujours bien présentes, les entreprises continuent d'engranger des profits, et les bouleversements environnementaux et sociaux ne remettent pas en question le recours aux prix et aux solutions de marché pour tenter de les résoudre.
Le capitalisme ne s'effondrera pas de lui-même ; il doit être transformé par l'action politique de la classe ouvrière. Cela doit inclure la lutte contre le colonialisme, souvent étroitement lié au capitalisme extractif des énergies fossiles. Cela commence par une déclaration de solidarité avec les défenseur.eue.s des terres autochtones, comme engagement prioritaire en faveur du droit des peuples colonisés à vivre dans la dignité et l'autodétermination.
On observe aujourd'hui une polarisation des options. La politique de compromis de classe, qui a défini la politique sociale-démocrate du XXe siècle au sortir des guerres mondiales et de l'émergence d'une syndicalisation de masse, n'est plus d'actualité. Même remporter des réformes modérées aujourd'hui exige une confrontation directe avec le capital et le capitalisme, ce qui, à son tour, exige de construire la base sociale profonde nécessaire à son efficacité.
De tels efforts doivent dépasser l'électoralisme qui considère le vote pour des politicien.ne.s individuel.le.s comme un raccourci. Et cela ne se résume pas à reconstruire et à élargir les syndicats conservateurs, dont les horizons politiques limités ont si directement contribué à notre situation actuelle.
Les efforts politiques de la gauche pour se développer en marge du mouvement syndical ne peuvent se faire que de manière à nous rendre dépendants et à nous abstenir de remettre en question l'orientation politique du syndicat.
Les mobilisations et résistances isolées – comme les grèves réussies dans le secteur automobile et ailleurs – ont été importantes. Mais elles n'ont pas permis de percée durable qui mettrait fin à l'inertie plus générale du cynisme et du fatalisme de la classe ouvrière. Le mouvement ouvrier au Canada doit encore être transformé.
Le Projet Socialiste : Vers l'Avenir
Tout cela nécessite un parti socialiste capable de s'engager dans la formation de la classe ouvrière par la pratique politique, en reliant les luttes disparates et en transformant les syndicats en instruments de lutte des classes. C'est le contexte auquel la gauche est confrontée au Canada et ailleurs.
À partir de cette constatation politique, le Projet Socialiste se penche non seulement sur le passé et le présent, mais aussi, comme tous les socialistes, sur l'avenir. De toute évidence, le présent n'est pas celui de grand succès de la classe ouvrière et des socialistes : les ravages du capitalisme néolibéral, l'impérialisme brutal de Trump, la défaite et la faiblesse des mouvements ouvriers, en particulier du mouvement syndical organisé, et la montée du populisme de droite et du conservatisme social, face à l'incapacité du centrisme libéral et de la social-démocratie à affronter le capitalisme. Cela sans parler des terribles pertes en vies humaines dans les guerres comme celles de Gaza, d'Ukraine et d'ailleurs, ou de la tragédie de la vie sans eau potable, au milieu de l'abondance, dans les communautés autochtones.
Il existe néanmoins des possibilités et de l'espoir : la classe ouvrière, bien que vaincue politiquement, continue de riposter, quoique sous des formes manquant de cohérence, de pouvoir organisationnel, et de cohésion, ainsi que d'une culture et d'une idéologie politiques propre à la classe ouvrière.
Mais une grande partie du virage vers le cynisme, la pensée et le vote de droite reflète le renforcement des pires composantes du capitalisme – chômage, inégalités, dégradation climatique, fracture sociale et réactions négatives – qui accompagnent inévitablement un leadership politique et social qui accepte et renforce quotidiennement le mythe selon lequel il n'existe pas d'alternative au capitalisme. Les travailleurs et travailleuses réagissent à ceux et celles qui proposent de fausses solutions, comme les Trump et les Poilièvre de ce monde.
Mais l'insécurité, la colère et la frustration qui poussent de nombreux travailleurs et nombreuses travailleuses vers la droite peuvent servir de fondement à une alternative à la gauche. Les socialistes occupent une place centrale dans les efforts visant à construire une compréhension et une identification de classe au sein et à travers la classe ouvrière, au Canada et dans d'autres pays. Nous avons la responsabilité et le potentiel de travailler au sein des institutions, des communautés et des syndicats clés de la classe ouvrière afin de former une nouvelle génération de dirigeant.e.s issu.e.s de la classe ouvrière et de bâtir une alternative.
Ils peuvent puiser une forte motivation des immenses manifestations contre le génocide de Gaza ; da la colère et le ressentiment grandissants des travailleurs et travailleuses en quête de logement, de soins de santé, d'emplois décents, de nourriture et de loisirs abordables ; et dans la prise de conscience croissante de la nécessité de créer un Canada – solidaire des autres – où les travailleurs et les travailleuses sont capables de prendre des décisions économiques et politiques clés, face à l'intimidation de l'empire américain, aux compromis et au besoin impérieux de faires de profits sur le dos de la classe ouvrière.
Cela nécessite la construction d'un parti politique socialiste, fondé sur les actions, les idées et l'organisation de la classe ouvrière.
La classe ouvrière est vaste. Elle est la source du travail qui rend possible tous les aspects de notre vie sociale et économique. Mais nous sommes divisé.e.s par secteurs, par niveaux du marché du travail, par statut social et identités : cols bleus/cols blancs, immigrant.e.s/natifs et natives, migrant.e.s, travailleurs et travailleuses précaires, hommes/femmes, transgenres, LGBT, public/privé, propriétaires/locataires et sans-abri.
Rassembler ces segments de la classe ouvrière et bâtir un mouvement politique et une identité commune est la mission d'un parti authentiquement socialiste.
Résumer et appliquer les leçons tirées de l'expérience et des luttes passées est un rôle clé pour les socialistes et une perspective passionnante pour construire et remettre en question et finalement renverser le système social existant.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Canada : Les 10 provinces mettent fin à la détention de migrants dans des prisons

Les 10 provinces canadiennes se sont désormais engagées à mettre fin à leur contrat de détention migratoire avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ce qu'Amnistie internationale Canada et Human Rights Watch ont aujourd'hui qualifié de victoire majeure pour les droits des personnes migrantes et réfugiées. Terre-Neuve-et-Labrador, la dernière province, vient de confirmer qu'elle n'autorisera plus le gouvernement fédéral à détenir dans les prisons locales des personnes migrantes ou demandeuses d'asile.
Les deux organisations ont créé la campagne #Bienvenue au Canada en octobre 2021 pour exhorter les provinces à mettre fin à cette pratique. Le recours aux prisons provinciales pour la détention de personnes migrantes est incompatible avec les normes internationales en matière de droits humains, et dévastateur pour la santé mentale de ces personnes. Le gouvernement fédéral devrait emboiter le pas aux provinces et prendre d'importantes mesures pour mettre fin à la détention migratoire à travers le pays.
« La décision de Terre-Neuve-et-Labrador est une immense victoire en matière de droits humains, elle préserve la dignité et les droits des personnes qui viennent au Canada en quête de sécurité ou d'une vie meilleure », a déclaré Samer Muscati, directeur adjoint intérimaire de la division Droits des personnes handicapées à Human Rights Watch. « Comme les dix provinces ont résilié leur contrat de détention des personnes migrantes, le gouvernement fédéral devrait enfin garantir, par le biais d'une directive ou d'un amendement législatif, que l'ASFC cessera une fois pour toutes de recourir aux prisons pour les incarcérer. »
Au cours des cinq dernières années, l'ASFC a incarcéré des milliers de personnes pour des raisons d'immigration dans des dizaines de prisons provinciales à travers le pays, sur la base d'accords conclus avec les provinces. Les conditions de détention en prisons provinciales sont inhumaines, ces établissements ont une vocation intrinsèquement punitive. Le 12 mars 2024, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a transmis un avis officiel à l'agence frontalière indiquant qu'à compter du 31 mars 2025, ses prisons provinciales ne détiendraient plus des personnes uniquement en vertu de la législation sur l'immigration. À ce jour, les accords conclus dans cinq provinces ont expiré à la suite de périodes de préavis de résiliation, et les accords conclus dans les cinq autres provinces doivent expirer d'ici mars 2025. L'ASFC a cherché à prolonger ces accords dans certaines provinces.
Dans un rapport datant de 2021, Human Rights Watch et Amnistie internationale ont démontré que dans les centres de détention migratoires au Canada les personnes racisées, en particulier les hommes noirs, sont gardées dans des conditions plus restrictives et pour des périodes plus longues que les autres détenu·e·s. Les personnes handicapées sont également victimes de discrimination tout au long de la procédure de détention.
Ces personnes sont régulièrement menottées, enchainées et enfermées avec peu ou pas de contact avec le monde extérieur. Le Canada est l'un des rares pays de l'hémisphère nord à ne fixer aucune limite légale à la durée de leur détention. Des personnes peuvent ainsi être détenues pendant des mois, voire des années, sans aucune fin en vue.
Sara Maria Gomez Lopez a fait l'expérience directe de la détention migratoire en arrivant au Canada en tant que demandeuse d'asile en 2012. L'ASFC l'a incarcérée pendant trois mois en Colombie-Britannique. « Je me souviens de la profonde douleur que je ressentais en prison », a-t-elle déclaré. « Le Canada peut et doit cesser de causer de telles douleurs et laisser place à l'accueil bienveillant qui a contribué à guérir tant de personnes ayant trouvé refuge dans ce pays. Cette ouverture me donne l'espoir que d'autres n'auront pas à vivre la même douleur que moi. »
Depuis le début de la campagne #Bienvenue au Canada, des centaines de personnes militantes, avocates, professionnelles de la santé et des leaders religieux, aux côtés de personnes ayant personnellement vécu la détention migratoire, ainsi que des dizaines de grandes organisations de justice sociale, ont appelé les autorités provinciales et fédérales à mettre fin à l'utilisation des prisons provinciales pour la détention liée à l'immigration. Plus de 30 000 personnes à travers le Canada ont également participépris part à la campagne en écrivant directement aux autorités provinciales et fédérales.
En vertu de ces accords, l'ASFC a versé aux provinces des centaines de dollars par jour pour chaque migrant·e incarcéré·e dans une prison provinciale. Ainsi, selon l'agence frontalière, au cours de l'exercice qui s'est terminé en mars 2023, l'elle a défrayé 615,80 $ par jour pour chaque femme détenue dans une prison du Nouveau-Brunswick. Au cours de ce même exercice, elle a dépensé 82,7 millions de dollars pour la détention, soit plus qu'au cours des quatre années précédentes.
En vertu de la législation sur l'immigration, l'ASFC a toute la latitude pour décider du lieu de détention des personnes migrantes : aucune norme juridique ne guide ses décisions de détenir une personne dans une prison provinciale plutôt que dans un centre de surveillance de l'immigration. À l'expiration de ses contrats avec les provinces, elle n'aura plus accès à leurs prisons pour détenir des personnes migrantes. L'ASFC gère également trois centres de détention migratoire, semblables à des prisons de sécurité moyenne et fonctionnant comme telles, qui imposent d'importantes restrictions à la vie privée et à la liberté, des règles rigides et des routines quotidiennes, en plus de mesures punitives en cas de non-respect des règles et des ordres.
Il existe d'autres solutions viables à la détention à travers tout le pays. Au lieu de financer des centres de détention ou des pratiques punitives non privatives de liberté comme le suivi électronique, le gouvernement fédéral devrait investir dans des programmes communautaires respectueux des droits et gérés par des organisations locales à but non lucratif, indépendantes de l'agence frontalière.
« Nous félicitons les provinces pour leur décision de cesser d'emprisonner les demandeurs d'asile et les migrants uniquement pour des raisons d'immigration », a déclaré France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnistie internationale Canada francophone. « La pression sur le gouvernement fédéral est maintenant claire pour qu'il mette fin à ce système de violation des droits partout au pays. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

RCA : les survivantes de violences sexuelles affectées par la réduction des financements

Les fonds des États-Unis qui soutenaient des programmes permettant de sauver des vies dans le camp de réfugiés de Korsi à Birao en République centrafricaine (RCA) et dans d'autres camps frontaliers ont récemment été supprimés, déplore l'agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive (UNFPA).
Tiré de Entre les lignes et lesm ots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/07/rca-les-survivantes-de-violences-sexuelles-affectees-par-la-reduction-des-financements/?jetpack_skip_subscription_popup
Cela veut dire que de nombreux services destinés à près de 70 000 femmes et jeunes filles ne pourront plus fonctionner.
« La vie est dangereuse pour les femmes dans ce camp », raconte Mariam Zakaria, 32 ans, qui a récemment fui la violence brutale et le conflit au Soudan et est retournée en République centrafricaine, son pays d'origine. « Si vous voulez travailler, quelqu'un risque de ne pas vous embaucher s'il ne peut pas profiter de vous. Et si une femme n'accepte pas, ses enfants n'auront rien à manger ».
Le camp de réfugiés de Korsi à Birao, dans le nord de la République centrafricaine, abrite environ 18 000 réfugiés et rapatriés. Nombre d'entre eux ont échappé au viol, à la coercition et aux abus traumatisants, leur voyage ayant été long et semé d'embûches. Mais à leur arrivée, ils découvrent souvent qu'ils ne sont pas non plus en sécurité.
« Je dois sortir pour chercher du travail. Je suis veuve et j'ai sept enfants – parfois, ils restent sans nourriture pendant deux jours », affirme Mme Zakaria dans un entretien avec l'UNFPA.
La crise au Soudan a poussé plus de 3 millions de personnes à fuir au-delà des frontières, dont des dizaines de milliers ont trouvé refuge en République centrafricaine. Cependant, des décennies de conflit, d'insécurité, de violence et de manque de services essentiels ont également provoqué le déplacement d'un cinquième de la population de la République centrafricaine, selon les estimations des Nations Unies.
La violence sexuelle, la traite des êtres humains et les mariages forcés augmenteraient également de façon alarmante en République centrafricaine, en particulier dans les camps de déplacés et les zones contrôlées par les groupes armés. La grande majorité des personnes victimes d'abus sont des femmes et des filles. Près d'un quart sont des enfants et des adolescents.
« Nous recevons beaucoup de cas de viols de mineurs, surtout pendant la saison sèche », a déclaré Léonce Issouf Dessoula, gestionnaire de cas dans un espace sûr soutenu par l'UNFPA dans le village de Boko Landja, aux abords de la capitale Bangui. « Les adultes sont également violées – les femmes vont dans la forêt pour chercher du bois et des aliments, et elles se font agresser ».
Même la maison peut être un danger
Cet espace sûr est l'un des 14 que l'UNFPA soutient actuellement dans les camps de déplacés et les communautés d'accueil de la République centrafricaine, qui offrent un refuge ainsi qu'une orientation médicale, psychologique et juridique aux survivantes et aux filles exposées au risque de mariage forcé. Mais ce ne sont pas que les étrangers qui représentent une menace pour les femmes et les filles, explique Mme Dessoula.
« Les agressions physiques au sein des mariages sont courantes, de même que les violences psychologiques. De nombreuses femmes sont confrontées à des abus financiers, lorsque leurs maris prennent l'argent qu'elles gagnent en vendant des marchandises et les laissent sans ressources ni opportunités ».
Selon des rapports de 2024, moins d'un tiers des survivantes de violences sexuelles ont reçu des soins psychologiques ou médicaux dans la période critique des 72 premières heures, et elles sont encore moins nombreuses à avoir bénéficié d'une assistance juridique ou d'une aide à la subsistance.
« Bien que moins fréquents, les mariages forcés existent également, en particulier pour les jeunes filles âgées de 16 à 18 ans, et sont souvent arrangés par leurs parents », explique Mme Dessoula.
Une deuxième chance
À Mboko Landja, près de la capitale Bangui, Naomi Dakaka, 22 ans, était l'une de ces jeunes filles.
« J'ai arrêté d'étudier à l'âge de sept ans car nous ne pouvions pas nous le permettre et nous n'avions aucune aide pour payer l'école. J'ai 12 frères et sœurs, mais notre père est irresponsable », a-t-elle raconté à l'UNFPA.
« J'avais 13 ans lorsqu'on m'a forcée à me marier. J'ai eu mon enfant en janvier 2020, il aura bientôt cinq ans. Son père m'a également abandonnée et je vis actuellement avec mes sœurs aînées ».
Les deux parents de Mme Dakaka sont décédés depuis, la laissant sans autre source d'aide – jusqu'à ce qu'elle entende parler d'un espace sûr de l'UNFPA à proximité, offrant un moyen alternatif de gagner sa vie pour aider à briser le cycle de la violence.
« Je rêve de devenir couturière pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants et les préparer à l'âge adulte », dit-elle. « Je veux partir d'ici avec des compétences utiles. Avant, je n'étais pas éduquée, mais grâce à cet espace, tout s'est transformé ».
Gel des fonds essentiels
Les fonds des États-Unis qui permettaient de sauver des vies et qui soutenaient des programmes dans le camp de réfugiés de Korsi à Birao – et dans d'autres camps situés près des frontières avec le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo et le Soudan – ont récemment été supprimés.
« Si le financement devait cesser, l'impact serait dévastateur », a averti la ministre de la promotion de l'égalité des sexes, Dr Marthe Augustine Kirimat, peu avant l'annonce de ces suppressions. « Cela affecterait le bien-être [des survivantes], ainsi que celui de leur communauté et de l'État ».
D'ores et déjà, des milliers de personnes ne bénéficient plus d'une assistance vitale – notamment en matière d'accouchement sans risque et de prise en charge clinique des viols – car deux dispensaires soutenus par l'UNFPA ont été contraints de fermer leurs portes, faute de financement.
En 2025, l'UNFPA a besoin de 16,5 millions de dollars pour ses programmes en République centrafricaine, en particulier pour les communautés les plus mal desservies.
Pour Albertine Yantijba, 55 ans, l'espace sécurisé de Mboko Landja est essentiel : « Tant qu'il reste actif, nos femmes peuvent vivre en toute tranquillité. Depuis le début du projet, davantage de femmes se sentent en sécurité, peuvent s'affirmer et mener une vie normale. Nous vous demandons de continuer à nous soutenir ».
https://news.un.org/fr/story/2025/03/1154276
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Défense du droit des travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s à participer à la prévention des maladies et des accidents du travail

Les travailleurs et les travailleuses non syndiqué.e.s sont près des deux tiers des travailleurs et travailleuses du Québec ; 82 % dans le secteur privé. Les statistiques montrent que les travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s sont deux fois plus susceptibles d'être blessé.e.s au travail que les travailleurs et travailleuses syndiqué.e.s. Les données sur les maladies professionnelles vont dans le même sens. Cette différence s'explique par le fait que les syndicats sensibilisent leurs membres et leur permettent de participer à la prévention.
La situation actuelle
Mais au Québec, les travailleurs et les travailleuses non syndiqué.e.s n'ont en pratique (contrairement à la lettre de la loi) aucun droit de participer à la prévention des maladies et des accidents du travail.
En pratique, les travailleurs et les travailleuses non syndiqué.e.s ne peuvent exercer même un droit de prévention aussi fondamental que le refus d'effectuer un travail dangereux. Même lorsqu'ils et elles connaissent ce droit – ce qui est plutôt rare chez les travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s – leur crainte de représailles les dissuade de l'utiliser. Selon les donnée de la CNÉEST, seulement 10% des refus sont exercés par des travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s.
Selon la règlement, les travailleurs et travailleuses des établissements de 20 employé.e.s et plus doivent se réunir en assemblée pour élire leurs représentant.e.s à un comité paritaire de santé et de sécurité, ainsi que leur représentant.e de santé-sécurité.
Interrogée sur la manière dont la CNÉEST veillera à ce que les employeur.e.s facilitent l'assemblée des travailleurs et travailleuses, comme le prescrit le règlement, la présidente de la CNÉEST a informé le CTTI, dans une lettre datée du 18 mai 2022, que « La LSST établit notamment les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations. Dans cet esprit, la CNÉESST encourage les employeurs à faciliter cette désignation, quant au lieu et au temps nécessaire, et nous comptons sur leur collaboration habituelle. »
Cette réponse est le comble du cynisme (ou pire). En fait, le CNÉEST n'informe même pas les employeur.e.s de leur responsabilité légale de faciliter une assemblée électorale. Et elle ne recueille pas non plus de statistiques sur l'application du règlement.
Dans les rares lieux de travail non syndiqués où existent des comités paritaires, les candidat.e.s des travailleurs et travailleuses à l'élection sont présélectionné.e.s par la direction et l'élection se déroule sans assemblée ni discussion, comme l'exige la réglementation, mais par iPhone et code QR ou autre moyen similaire. Les « représentant.e.s » des travailleurs et travailleuses ainsi « élu.e.s » ne disposent pas de temps libre pour préparer leur propre ordre du jour des réunions des comités paritaires. Ces réunions sont dominées par la direction.
Et les inspecteur.e.s de la CNÉEST, interpellé.e.s par les travailleurs et travailleuses concernant l'absence de véritables représentants en matière de prévention, acceptent ces pratiques, sans même prendre la peine de s'entretenir avec les travailleurs et travailleuses ayant porté plainte.
Après des demandes répétées depuis plusieurs mois par quatre organisations de défense des travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s (CTTI, RATTMAC, CIAFT, UTTAM), le ministre du Travail a finalement signé un décret autorisant la CNÉEST à financer la formation des travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s à la prévention. (Les syndicats bénéficient de ce financement depuis des décennies.)
Mais des questions demeurent :
– Qui est-ce que ces organisations formeront et à quoi servira cette formation, alors que les travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s n'ont pas de véritables représentant.e.s en santé et sécurité ?
– Que feront les travailleurs et travailleuses que nous formons à la prévention à leur retour au travail, puisqu'en pratique, ils et elles n'ont aucun droit de participer à la prévention ?
Cette situation appelle une campagne politique pour contraindre la CNÉEST à défendre activement et sérieusement les droits à la prévention des travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s. Cela seul donnerait un sens à la formation des travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s à la prévention.
L'organisation d'une telle campagne devrait être notre revendication commune aux syndicats lors du sommet.
Et dans le cadre de cette campagne visant à faire respecter le droit des travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s à participer à la prévention, les représentant.e.s du mouvement syndical siégeant au conseil d'administration du CNÉEST et dans ses différents sous-comités doivent exiger :
—que la CNÉEST mandate ses inspecteur.e.s pour faire activement respecter le droit des travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s à la prévention
—que la CNÉEST informe systématiquement les employeur.e.s de leur obligation légale de garantir une participation effective des travailleurs et travailleuses à la prévention
-que les inspecteur.e.s de la CNÉEST veillent à l'application du droit des travailleurs et travailleuses non syndiqués à participer à la prévention
– la création d'un bureau indépendant, financé par les fonds de la CNÉSST, qui offrirait des services de représentation en prévention pour aider les non-syndiqué.e.s à s'organiser pour mettre en œuvre les mécanismes de prévention et pour les représenter en cas de sanction.
Encore sur l'importance de la participation des travailleurs et travailleuses à la prévention des accidents et des maladies professionnelles
De nombreuses études menées dans le monde entier ont démontré le rôle de la participation des travailleurs et travailleuses à la prévention dans la réduction significative de l'incidence des accidents et des maladies professionnelles.
Mais au-delà des bénéfices directs pour la santé, la participation des travailleurs et travailleuses à la prévention cultive leur sens de la dignité humaine : ils et elles ne sont plus des « esclaves salarié.e.s », mais des citoyen.ne.s à part entier — cela même au travail. L'histoire montre le rôle important que joue le sens de la dignité humaine dans les luttes populaires importantes.
La participation à la prévention cultive chez les travailleurs et travailleuses une attitude active envers leurs conditions de travail. Elle cultive la conscience qu'ils et elles peuvent les influencer. Or, les conditions de travail ont continué de se dégrader, cela malgré les progrès rapides de la mécanisation, de l'informatisation et la croissance concomitante de la productivité du travail.
Au CTTI, nous parlons d'organiser les travailleurs et travailleuses. Mais l'essentiel de notre action consiste à agir pour eux et elles et à traiter leurs dossiers individuels et collectifs. Faire respecter le droit des travailleurs et travailleuses non syndiqué.e.s à participer à la prévention constituerait une étape importante vers une véritable organisation de ces travailleurs et travailleuses. Cela donnerait un véritable sens à leur formation en prévention.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Conamuri : le féminisme paysan populaire contre le patriarcat et la révolution verte

Malgré une baisse de 17% de sa population rurale au cours de la dernière décennie, le Paraguay reste l'un des pays les plus ruraux d'Amérique du Sud.
Tiré de Entre les lignes et lesm ots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/04/larticulation-des-femmes-decvc-envoie-une-lettre-ouverte-a-hansen-sur-la-position-des-femmes-dans-la-vision-pour-lagriculture-et-lalimentation-autre-texte/?jetpack_skip_subscription_popup
Les femmes représentent cinquante-sept pour cent de cette population. Avec l'exode croissant des hommes vers les villes ou à l'étranger, les femmes sont devenues les principales gardiennes de leurs territoires. Mais elles subissent de plein fouet la violence du capital liée à l'agrobusiness, ainsi que les effets en cascade des crises économiques, alimentaires et écologiques. La discrimination structurelle et le patriarcat ne font qu'aggraver leur vulnérabilité.
C'est dans ce contexte de lutte qu'est née Conamuri. Cette organisation de femmes paysannes et autochtones a passé les 25 dernières années à faire entendre les voix des femmes rurales confrontées aux impacts quotidiens de l'agrobusiness. Qu'elles portent sur les discriminations, les pénuries d'eau, la détérioration de la santé ou la perte des semences locales, ces luttes ne sont plus confinées à la sphère privée. Grâce à Conamuri, elles sont désormais au cœur de l'agenda politique.
La participation des femmes aux tâches rurales a bondi de 76% entre 2008 et 2022, mais la majorité d'entre elles restent sans terres ou n'ont accès qu'à de petites parcelles. Ce n'est qu'en 2002, avec l'introduction du Statut agraire (loi), que des efforts ont été faits pour promouvoir l'accès des femmes à la terre, au crédit et à l'assistance technique. Aujourd'hui, 46% des producteurs et productrices en zone rurale exploitent moins de 5 hectares et dépendent fortement de l'agriculture pour 70% de leurs revenus. Les subventions de l'État, les envois de fonds et l'aide familiale constituent le reste, tandis que les pensions et les locations de terres représentent à peine 3%.Plus de 84 % des femmes rurales ne bénéficient d'aucune forme d'assurance maladie.
Conamuri est aujourd'hui un réseau de plus d'un millier de femmes issues de presque tous les départements du Paraguay. Elles gèrent une école d'agroécologie, des potagers communautaires, des marchés locaux et produisent leur propre yerba mate biologique. Plus important encore, elles ont développé une approche politique et pédagogique unique : le féminisme paysan autochtone et populaire.
Un héritage de résistance
Conamuri a été l'une des premières organisations à dénoncer la mort de Silvino Talavera, un garçon de 11 ans décédé en 2003, à la suite de fumigations chimiques dans la région d'Itapúa. À l'époque, les femmes étaient traitées de « folles » ou accusées de ne pas comprendre les réalités agricoles. Même leurs camarades les accusaient de diviser le mouvement paysan. Mais elles ont tenu bon, bloquant les tracteurs et protestant contre les fumigations. La mort de Silvino a déclenché des mobilisations nationales et internationales contre les pesticides et les cultures transgéniques.
Après les pesticides, Conamuri a élargi son champ d'action pour contester l'ensemble du modèle violent de l'agrobusiness : de l'accaparement des terres à l'exploitation de l'eau, en passant par les impacts sur le travail urbain, le logement et les systèmes alimentaires. « De janvier à mars, nous subissons une véritable « guerre chimique » avec des fumigations aériennes qui empoisonnent des communautés entières », explique Alicia Amarilla, leader historique de Conamuri. « Des centaines de personnes se retrouvent à l'hôpital, des enfants meurent, mais la cause n'est jamais attribuée à la pollution agrochimique. »
« Aujourd'hui, nous dit Alicia, nos luttes sont reconnues et respectées. La campagne massive contre le blé HB4, baptisée « Du pain sans poison », témoigne de 25 ans de dialogue avec une société qui ne tolère plus d'être empoisonnée. »
Jusqu'en 2012, le Paraguay ne cultivait qu'une seule plante transgénique : le soja RoundUp Ready de Monsanto, autorisé en 2004 mais cultivé illégalement depuis les années 2000. Après le coup d'État parlementaire de 2012 contre le président Fernando Lugo, le processus d'autorisation des cultures transgéniques a été simplifié, sacrifiant ainsi la souveraineté au profit des multinationales de l'agrobusiness. Aujourd'hui, 61 cultures transgéniques ont été autorisées, dont 25 variétés de maïs, 10 de soja, 8 de coton et 1 de blé (HB4), toutes résistantes à un ou plusieurs produits agrochimiques.
En 2023, le volume des importations de produits agrochimiques au Paraguay était plus de deux fois supérieur aux niveaux de 2015, glyphosate en tête de liste. Bayer-Monsanto, Syngenta et Basfdominent le marché mondial des semences et des produits agrochimiques, et leur influence se fait profondément sentir au Paraguay.
Aujourd'hui,95% des terres du Paraguay sont consacrées à l'agrobusiness,soit 5,5 millions d'hectares, dont 3,5 millions pour le soja transgénique. « La ʺsojificationʺ du Paraguay a dévasté nos forêts », explique Rosa Toledo, une autre leader Conamuri de San Pedro. Depuis 1985, 142 000 km² de la forêt du Gran Chaco ont été convertis en terres cultivées ou en pâturages, faisant du Paraguay le troisième exportateur mondial de soja.
Le coût humain de l'agrobusiness
En 2013, plus de 13 communautés se sont unies pour faire face à l'invasion de près de 10 000 hectares de forêts vierges dans le département de San Pedro, surnommées le « poumon de San Pedro ». Les paysan·nes sans-terre ont occupé une partie de la zone pour dénoncer l'accaparement des terres et la déforestation opérés par Inpasa, une entreprise qui installait alors une usine d'éthanol de maïs et des monocultures d'eucalyptus et de soja.
« Les impacts sont dévastateurs », explique Rosa. « Les fumigations près des écoles rendent l'air irrespirable. Les attaques d'insectes, auparavant inconnues, sont désormais fréquentes. Nous avons établi un partenariat avec une faculté de médecine pour étudier les communautés entourées par les cultures de soja. Dans l'une d'elles, nous avons trouvé dix enfants atteints de leucémie, de nombreux cas de cancer, des problèmes oculaires et cutanés, ainsi que des allergies. Dans une autre communauté sans soja, il n'y avait pratiquement aucun problème de santé. Les produits agrochimiques tuent les gens à petit feu. »
Aujourd'hui, le Paraguay a signé des accords avec le Fonds vert pour le climat en vue d'obtenir des paiements conditionnés à la réduction des émissions. Le projet Paraguay +Verde, censé promouvoir la gestion durable des forêts, facilite en réalité l'expansion des monocultures d'eucalyptus sur les territoires paysans et autochtones. Entre 2015 et 2022, les plantations d'eucalyptus ont augmenté de 90%. Bien qu'il soit principalement cultivé pour la production de pâte à papier, l'eucalyptus est également utilisé pour produire du charbon de bois destiné au séchage de produits agricoles en grains comme le maïs et le soja, ce qui permet de commercialiser ces produits sous un label « vert ». Des communautés comme celle de Qom considèrent les plantations d'eucalyptus comme un cheval de Troie pour l'accaparement des terres. Ces arbres épuisent les ressources en eau, appauvrissent les sols et transforment les terres fertiles en déserts.
En conséquence, un grand nombre d'habitant·es sont contraint·es de louer leurs terres, non plus pour un an, comme dans le cas des cultures céréalières, mais pour des périodes de 10 à 20 ans. Sous l'effet combiné du besoin urgent de revenus et de l'absence de titres fonciers officiels, beaucoup finissent par perdre définitivement leurs terres. Conamuri parle de « pack expulsion » – soit le démantèlement systématique des communautés rurales.
Féminisme paysan populaire : une pratique quotidienne
« Dans la communauté Santory de Caaguazú, 300 familles résistent à l'avancée du soja sur près de 3 000 hectares, protégeant ainsi une zone humide vitale », explique Perla Alvarez, une leader Conamuri originaire de Caaguazú. « Nous avons créé une école d'agroécologie, Semilla Róga, où nous échangeons des semences et des connaissances. Chaque mois, nous organisons des ateliers sur la législation environnementale, la production de semences et les techniques agroécologiques. »
« Mais les défis sont immenses », poursuit Perla. « Avec l'avancée de l'eucalyptus et du soja transgénique, la pénurie d'eau est devenue critique. Les puits se sont asséchés et les coupures d'eau sont fréquentes. La communauté a réactivé sa résistance, en proposant une ordonnance municipale pour déclarer notre territoire exempt de produits agrochimiques et nous reconnaître officiellement comme communauté agroécologique. »
Pour Conamuri, le féminisme paysan populaire n'est pas qu'une théorie, c'est une pratique quotidienne. « Il donne une dimension politique à nos tâches quotidiennes : préserver les semences, entretenir des potagers diversifiés, pratiquer la médecine traditionnelle et nous protéger contre les violences », explique Perla. « Même la cuisine, souvent perçue comme un lieu d'oppression, est pour nous un espace de pouvoir. C'est là que nous transmettons nos savoirs, partageons nos recettes et organisons la résistance. »
Conamuri dirige également l'école Juliana pour les femmes autochtones, qui propose des formations sur les droits des peuples autochtones, la médecine naturelle et la prévention des violences. « Nous avons mis en place un « réseau de confiance » à l'échelle du territoire pour nous protéger mutuellement et dénoncer les violences », explique Perla. « Lorsqu'une camarade est victime de violences, nous nous rendons régulièrement à son domicile jusqu'à ce que la situation s'améliore. L'État n'offre ni refuge ni soutien, alors nous comptons les unes sur les autres. »
Grâce à des initiatives telles que l'École des femmes et des Jeunes défenseur·es de la souveraineté alimentaire, Conamuri internationalise sa lutte. « Nous construisons un dialogue continental sur les luttes anti-patriarcales », explique Perla. « Notre défi consiste à partager le travail du soin avec nos partenaires, notre famille et notre communauté, afin que les femmes puissent participer pleinement à la vie politique. Mais le simple fait de se réunir en tant que sujets politiques est disruptif. En cultivant du manioc ou en organisant des révoltes, nous semons la vie et la résistance. ».
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les travailleurs et travailleuses non syndiqué.es n’ont pas dans les faits le droit de participer à la prévention

Les travailleur.ses non syndiqué.es - presque 2/3 des travailleur.ses (82 % du privé) - sont 2 fois plus susceptibles d'être blessé.es au travail que les syndiqué.es. Les données sur les maladies professionnelles vont dans le même sens. Cette différence s'explique par le fait que les syndicats sensibilisent leurs membres et leur permettent de participer à la prévention.
Au Québec, les travailleur.ses non syndiqué.es n'ont pas en pratique - malgré la lettre de la loi - droit de participer à la prévention. Même un droit aussi fondamental que le refus d'effectuer un travail dangereux leur est pratiquement exclu par crainte de représailles. (Des statistiques d'Ontario indiquent que seulement 10% des refus sont exercés par des non syndiqué.es, qui y sont très largement majoritaires. Pour le Québec, la CNÉEST n'a pas ces statistiques.)
Selon le règlement, les travailleur.ses des établissements de 20 employé.es ou plus doivent se réunir en assemblée pour élire des représentant.es à un comité paritaire de santé et de sécurité, ainsi qu'un.e représentant.e en santé-sécurité.
Interrogée par le CTTI comment la CNÉEST veille à la réalisation de ce droit, sa présidente d'alors a répondu : « La CNÉESST encourage les employeurs à faciliter cette désignation, quant au lieu et au temps nécessaire, et nous comptons sur leur collaboration habituelle. » Le comble du cynisme !
Dans les faits, la CNÉEST n'informe même pas les employeur.es de leur responsabilité légale de faciliter une assemblée électorale. Et elle ne recueille pas non plus de statistiques sur l'application du règlement.
Dans les rares établissements non syndiqués où existent des comités paritaires, les candidat.es à l'élection sont présélectionné.es par la direction et l'élection se déroule sans assemblée ni discussion, mais par code QR, ou moyen similaire. Les réunions du comité conjoints sont dominées par la direction.
Et les inspecteur.es interpellé.es par les travailleur.ses sur l'absence de véritables représentant.es acceptent ces pratiques, sans même prendre la peine de parler avec les travailleur.es ayant porté plainte.
Grâce aux pressions exercées pendant plus que deux ans par quatre organisations qui défendent les non- syndiqué.es (CTTI, RATTMAC, CIAFT, UTTAM), le ministre a autorisé à la CNÉEST à financer la formation des travailleur.ses non syndiqué.es à la prévention (financement dont profitent les syndicats depuis des décennies.)
Mais des questions importantes demeurent :
– Qui est-ce que ces organisations vont former et dans quel but, alors que les travailleur.ses non syndiqué.es n'ont pas de véritables représentant.es en santé et sécurité ?
– Que feront les travailleur.ses ainsi formé.es à leur retour au travail, puisqu'ils et elles n'ont pas en pratique de droit de participer à la prévention ?
Nous croyons que cette situation appelle une campagne politique pour contraindre la CNÉEST - où siège aussi des représentant.es des centrales syndicales – à soutenir activement les droits des travailleur.ses non syndiqué.es.
Nous exigeons :
– que la CNÉEST informe systématiquement les employeur.es de leur obligation légale d'assurer une participation effective des travailleur.ses à la prévention, et notamment de faciliter à l'organisation et à la tenue d'une assemblée d'élection en bonne et due forme pendant les heures du travail
– que les inspecteur.es de la CNÉEST veillent à l'application du droit des travailleur.ses non syndiqué.es à participer à la prévention
– que le gouvernement crée un bureau indépendant, financé par les fonds de la CNÉSST, qui offrirait des services de représentation en prévention pour aider les non-syndiqué.es à s'organiser pour mettre en œuvre les mécanismes de prévention et pour les représenter en cas de sanction.
Le centre des travailleur.ses immigrant.es
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La CAQ : un Boulet contre les travailleuses et les travailleurs

Les centrales syndicales du Québec – la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) –, en collaboration avec l'Union des travailleurs et travailleuses accidenté(e)s de Montréal (UTTAM) et leurs alliés, ont émis la déclaration commune suivante à la suite de la manifestation tenue ce midi, sur le parvis de l'Assemblée nationale.
« Au plus grand bonheur de tous les patrons québécois, le ministre du Travail Jean Boulet et le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont déposé l'infâme projet de loi 89 (PL-89), qui vise clairement à casser le droit de grève de tous les salarié-es syndiqués du Québec.
« En commission parlementaire, des experts neutres et réputés ont unanimement mis en garde le ministre contre les dangers que représentent son projet de loi pour l'équilibre des relations de travail et pour le maintien de la paix industrielle. Aucun de ces experts indépendants n'a d'ailleurs trouvé de mérites au PL-89. Pourtant, que ce soit devant l'unanimité des experts ou devant les répétés appels au dialogue lancés par le monde syndical, le ministre Boulet et la CAQ persistent et signent. Leur refus d'entendre les critiques et de rencontrer les centrales syndicales dans ce dossier est incompréhensible et troublant : le mouvement syndical ne peut pas participer seul au dialogue social.
« Alors que les associations patronales applaudissent le PL-89, le mouvement syndical demande unanimement son retrait. Cette seule donnée devrait suffire à faire la démonstration au ministre que son projet de loi est déséquilibré et met en péril le délicat équilibre des relations du travail au Québec.
« Puisque la manifestation a été tenue en marge du Sommet SST 2025, ajoutons que, malgré une adoption unanime de la version finale du Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement en septembre 2024 par le conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le gouvernement refuse toujours d'entériner ce règlement afin qu'il entre en vigueur. Ce faisant, il refuse de reconnaître la réussite d'un dialogue social entre les syndicats et les associations patronales, et prive tous les milieux de travail d'un règlement essentiel pour bien protéger celles et ceux qui enrichissent le Québec.
« Pour nous, il n'y a pas mille et une solutions : le ministre Boulet et la CAQ doivent changer de cap. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Michel Chartrand, cet homme de parole, est mort il y a 15 ans.

Il reste encore beaucoup à dire sur la vie, les idéaux et les combats de Michel Chartrand (1916-2010).
Suzanne-G. Chartrand, didacticienne du français, et Marie-Christine Paret, linguiste
Aujourd'hui, nous choisissons d'attirer votre attention sur une de ses qualités laissée dans l'ombre. À titre de spécialistes de la langue, nous partageons avec vous notre admiration pour son incroyable maitrise de la communication orale en nous éloignant des clichés sur l'homme qui crie, sacre et engueule ses opposants.
Son grand ami Pierre Vadeboncoeur, homme calme et posé s'il en est, disait de lui : « Michel Chartrand a passé sa vie à dénoncer la comédie humaine. Il a toujours vécu en marge de la société officielle, en marge de la classe dominante et en état de contradiction avec elle. Il appartient à une filiation d'hommes, fort peu nombreux, ceux qui tentent toute leur vie de poursuivre une expérience de véracité1. »
Toute sa vie, il a échangé avec des jeunes, des ouvriers, des femmes au foyer, des détenus, des professionnels, des agriculteurs, des intellectuels et, toujours, il a su adapter son langage à ses interlocuteurs, ce qui est une habileté très rare. Et toujours aussi, son français était impeccable : une syntaxe parfaite, un vocabulaire très riche, des jeux de mots inventifs, de nombreuses figures de style et un sens exceptionnel de la prosodie qui captivait son auditoire. Peu d'hommes publics ont manifesté cette aisance à communiquer à différents auditoires leurs convictions et leurs combats pour tenter de les mobiliser. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter, par exemple, les deux émissions Souverains anonymes faites avec des détenus de la prison de Bordeaux à Montréal 2.
Mais il y a plus. Son discours n'avait rien du slogan ou de la langue de bois. Ses propos étaient toujours étayés par des faits attestés, tirés de statistiques, d'articles de loi, de rapports d'organismes internationaux ou nationaux, d'informations médiatiques incontestables. Il était doté d'une une mémoire phénoménale, et cela même à plus de 80 ans. Il pouvait parler du chômage, de la syndicalisation, du travail des femmes, de l'évitement fiscal, de lois, des maladies du travail, du financement inacceptable des compagnies avec les fonds publics, du démantèlement des services publics, des difficultés vécues par des jeunes et des vieux, mais toujours en s'appuyant sur des faits incontestables. C'était un homme informé, cultivé, mais, avant tout, un homme droit et, conséquemment, indigné !
Son discours était le contraire de ceux de la propagande, des fausses vérités, de la manipulation de l'auditoire ; ses qualités nous seraient fort utiles en ces temps de démagogie galopante. Car la santé de la démocratie est tributaire de la qualité de l'information dont disposent les citoyens et citoyennes afin de prendre des décisions éclairées.
Michel Chartrand aura été, comme l'a si magnifiquement écrit Claude Gauthier : « Debout, debout, jusqu'au bout, libre et fou. »
Notes
1.https://www.youtube.com/watch?v=LsGRt59S6ZU
2.https://www.google.com/search?q=michel+chartrand&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:1fa0a229,vid:JQ1WSNJl18I,st:0
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Éloge d’Aimé Césaire

Paris. Jeudi, 17 avril 2025. La Rhumerie. Boulevard Saint-Germain. Hommage à Aimé Césaire, organisé par la poétesse Suzanne Dracius et l'éditeur Jean-Benoît Desnel, avec la participation des comédiens Amadou Gaye et Greg Germain.
La part d'Aimé Césaire est toujours prégnante. Il prend en charge, dès ses premiers écrits, la part refoulée des noirs caraïbéens à l'époque des luttes anticoloniales, au moment où la conscience aigüe de l'esclavagisme suscite des traumatismes mortifères. L'écriture est taillée dans la pierre, éruptive, volcanique, irrévocable. Le rythme est percussif, impulsif, collusif. Se transgresse les conventions du langage. S'ouvre la sémantique sur l'imprévisible, l'imprédictible, l'insoupçonnable. L'écriture césairienne se savoure en poésie belle comme l'oxygène naissant » (André Breton ».
Suzanne Dracius lit un extrait du poème d'Aimé Césaire Le Verbe maronner. À René Depestre, poète Haïtien. Le texte d'origine, intitulé Réponse à René Depestre. Éléments d'un art poétique, est publié dans la revue Présence Africaine dans le numéro d'avril-juillet 1955, dont Aimé Césaire est cofondateur.
« Fous-t-en Depestre fous-t-en laisse dire Aragon
Quittez Aragon bouler
La faiblesse de Depestre, dirais-je l'erreur, est d'avoir une vue a priori du problème
Mais où est Depestre ?
Quel est cet éblouissement, quelle est cette contemplation extatique devant l'héritage prosodique français ? »
Paroles agissantes. Les échauffourées rhétoriques galvanisent les luttes anticoloniales. Maronner, c'est pratiquer la spécificité nègre dans tous les domaines. Cette singularité passe par la poésie, qui installe l'intellectuel au cœur du monde et de lui-même. L'engagement politique n'altère pas la réflexion philosophique, l'invention littéraire, la subversion poétique. Le contraire d'un militantisme suiveur. Louis Aragon, particulièrement, attire les foudres d'Aimé Césaire. L'auteur de La Diane française, éditions Pierre Seghers, 1944, qualifie l'alexandrin de grand tracteur, de terrible maître du tambour. Il préconise le retour au sonnet. Il amalgame le mouvement révolutionnaire avec la Pléiade. Cf. Journal d'une poésie nationale, 1954. Aimé Césaire refuse l'instrumentalisation de la poésie à quelque fin que ce soit. Il récuse « le champ culturel structuré par la dégradation symbolique ». Il s'investit dans la décolonisation des formes et des contenus, la désaliénation de l'intellect, du percept, de l'affect. Il conseille à René Depestre un voyage « sans rimes, toute une saison, loin des mares ». Il l'exhorte à la rébellion prosodique, à la révolte contre les diktats de l'actualité parisienne. « Crois-m'en comme jadis bats-nous le bon tam-tam » (Aimé Césaire). La négritude est incessamment clamée comme indémontable matrice. « Ma négritude n'est pas une taie d'eau morte ruée contre la clameur du jour » (Cahier d'un retour au pays natal). Rejet des enrôlements, des enrégimentements, des encadrements. Impératif préalable, se dégager, de la bourbe, de la fange, de la bouillasse. Reprendre, en toute chose, l'initiative. Ainsi, Aimé Césaire s'institue comme le sémaphore de la métissité, de la créolité, de l'hybridité, de la forêt natale, du chant profond du jamais refermé.
Aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, Aimé Césaire est célèbre. Son Discours sur le colonialisme, éditions Réclame, 1950, est un tournant historique, dans la lutte des damnés de la terre et dans la littérature. L'impérialisme occidental se dénonce comme mécanique de déculturation. L'argumentaire est marxiste. Le style est explosif. Le combat est intrinsèquement culturel. Dès 1945, le poète est maire de Fort-de-France, jusqu'en 2001, et député de la Martinique, jusqu'en 1993. Il est membre du parti communiste dont il démissionne en 1956. Lettre à Maurice Thorez : « Ce n'est ni le marxisme, ni le communisme que je renie. Je dis qu'il n'y a pas de variante africaine, ou malgache, ou antillaise du communisme, parce que le communisme français trouve plus commode de nous imposer la sienne. L'anticolonialisme même des communistes français porte les stigmates de ce colonialisme qu'il combat ».
En Mai 68, j'applique, avec Omar Blondin Diop, ce même constat au gauchisme. Nous sommes alors, tous les deux, les exceptions africaines qui confirment la règle. « Tiraillé entre son appartenance au parti communiste et ses amitiés surréalistes, entre la liberté de création et le caporalisme partidaire, entre les cultures nègres et les assimilations européennes, Aimé Césaire n'a jamais réussi à concilier ses aspirations fondamentales » (David Alliot, Le Communisme est à l'ordre du jour. Aimé Césaire et le PCF, de l'engagement à la rupture, 1935 - 1956, éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2013). Le poète détracte l'assimilationnisme des communistes, leur chauvinisme, leur suprémacisme.
Je dis mon poème Les Mots nus, dédié à Aimé Césaire, lutinerie post-mortem en alexandrins.
Les Mots Nus
Que peuvent les mots nus quand sonnent les clairons
Quand s'éclipse la lune au rythme des alarmes
Quand s'endeuillent les clowns et les joyeux lurons
Quand s'abreuve l'amour aux collecteurs de larmes
Que peuvent les mots nus quand s'embrasent les tours
Quand voltigent les corps comme fétus de paille
Quand s'invite la bourse au festin des vautours
Quand s'unit la canaille aux funestes ripailles
Que peuvent les mots nus quand rodent les vampires
Quand traînent dans la boue les âmes sans ressort
Quand s'écroule d'un coup l'invulnérable empire
Quand s'arment les enfants pour conjurer le sort
Que peuvent les mots nus quand s'extirpent les lombes
Quand germe la guerre dans les mares d'or noir
Quand tombe au petit jour la dernière colombe
Quand spéculent sur l'art les affreux tamanoirs
Que peuvent les mots nus quand meurent les sirènes
Quand flambent les cités pour un bout d'oriflamme
Quand s'écrit la gloire dans le sang des arènes
Quand s'enfuient les serpents des ziggourats en flammes
Que peuvent les mots nus quand pleuvent les missiles
Quand s'ébattent les chiens dans les maisons sans porte
Quand crache la terre ses ténébreux fossiles
Que peuvent les mots nus que vent de sable emporte
(Mustapha Saha, Le Calligraphe des sables, éditions Orion, 2021).
J'ai fréquenté Aimé Césaire pendant trente ans, de 1968 jusqu'à quelques mois avant sa mort en 2008. Il abhorrait la métrique classique. Je le taquinais avec mes octosyllabes, mes décasyllabes, mes alexandrins. Il faisait semblant d'être agacé. Un jour, il me dit : « Bordélise un peu ta poésie, elle sera plus vivante. Moi, je n'écris pas dans la mélodie. J'écris dans la discordance, dans la dissonance, dans la dissidence ».
La dernière fois que je vois Aimé Césaire, il a un verre de lunettes cassé. Je lui propose de contacter un opticien. Il me dit : « Pas la peine. Je n'en ai plus besoin ». J'esquisse au crayon son portrait. J'en tire plus tard une peinture sur toile. Cette image s'impose dans mon esprit chaque que je pense à lui.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Aimé Césaire et Suzanne Dracius.
Suzanne Dracius et Mustapha Saha.
Mustapha Saha : hommage à Aimé Césaire.
Portrait d'Aimé Césaire par Mustapha Saha.
Peinture sur toile.

No Other Land, retour sur une polémique

Le documentaire No Other Land sorti en 2024 et réalisé par un collectif israélo-palestinien de quatre militants, montre le quotidien de l'occupation et de la colonisation de la Cisjordanie. Il a pourtant fait l'objet d'une polémique parmi les militant·es pro-palestinien·nes, sur laquelle revient Emmanuel Dror afin d'expliciter certains débats liés à la campagne de boycott culturel menée par les organisations palestiniennes et le rapport que les spectateurs occidentaux peuvent entretenir avec un tel film.
Le film
No Other Land est un film israélo-palestinien dans sa réalisation et dans sa promotion. Il est réalisé par les Palestiniens Basel Adra et Hamdan Ballal, par l'israélien Yuval Abraham, et par l'israélienne Rachel Szor. Il dénonce avec vigueur et conviction le sort fait aux Palestinien·nes de Masafer Yatta et aux alentours, l'oppression de l'armée israélienne et des colons, les destructions de maisons, le harcèlement, le nettoyage ethnique, et le quotidien d'une occupation militaire brutale. A ce titre, c'est un film extrêmement pédagogique pour un public qui ne connaîtrait pas la situation dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967.
Le dispositif du film, où le journaliste indépendant israélien Yuval vient voir le militant palestinien Basel, et documente sa lutte qu'il soutient, est l'un des points forts de ce film car, en quelque sorte, cet israélien, c'est « nous ». « Nous » le public occidental qui s'identifie plus facilement au journaliste indépendant qui mène une enquête qu'au jeune Palestinien dont la vie est rythmée par une occupation coloniale violente. Ce sont donc « nous » qui sommes invités à rendre visite à cette famille palestinienne qui nous ouvre ses portes et que nous accompagnons sur le « champ de bataille » de Masafer Yatta.
Il est rare de voir de telles co-réalisations israélo-palestiniennes, l'idée séduit le grand public, et le film a bénéficié d'une très bonne distribution, d'excellentes critiques et, couronnement final, d'un Oscar pour le meilleur documentaire en 2025, un an après sa sortie. Rien de tel pour irriter l'armée israélienne qui, le 24 mars, arrête Hamdan Ballal dans une ambulance, alors qu'il vient d'être blessé dans une énième attaque de colons, à Soussiya, près de Masafer Yatta. Sous la pression, il sera libéré le lendemain, après avoir passé la nuit dans une prison militaire.
La réaction du PACBI (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel)
Pendant un an, le PACBI (l'organe palestinien qui coordonne les campagnes de boycott culturel et universitaire des institutions israéliennes) ne s'est pas exprimé sur ce film, mais il a fini par le faire, après avoir été interpellé, et suite à de multiples débats. Le PACBI a donc écrit deux articles extrêmement subtils, dont il est dommage que nous n'ayons pas de traduction en français[1], en particulier pour éclairer la polémique que ces articles ont déclenchée.
Que dit le PACBI ? Il exprime clairement que ce film est essentiel pour contrer la déshumanisation raciste des Palestinien·nes en Occident, et pour sensibiliser le public à la lutte contre l'occupation militaire, le nettoyage ethnique, et le système d'oppression coloniale israélien auquel les Palestinien·nes sont soumis·es et résistent. Il dit qu'il a conscience des effets bénéfiques que ce film présente, qu'il les prend en compte, et qu'un boycott de ce film auprès du grand public occidental serait contre-productif.
Il précise néanmoins que ce film ne respecte pas parfaitement les lignes directrices du PACBI, et qu'il pourrait donc tomber sous le coup d'une campagne de boycott. Pour celles et ceux que ça intéresse, il est important de se pencher sur les arguments de la campagne de boycott culturel[2], dans ses grands principes, et en lien avec ce film en particulier.
Les 6 arguments du PACBI
1/ Malgré les dénégations des uns et des autres, le PACBI réitère et démontre dans son deuxième article que No Other Land n'est pas complètement exempt de normalisation, et de risque de normalisation. Il remet en contexte ce qu'est la normalisation, et l'importance cruciale de s'y attaquer, en particulier auprès des pays arabes de la région, dans un monde dominé par Trump et ses accords d'Abraham.
Ce sujet de la normalisation est à la fois crucial et complexe, et il est bien détaillé dans plusieurs articles du PACBI qui ont été traduits en français[3]. La normalisation s'appuie sur le rejet du traitement d'Israël et les tentatives de représenter Israël comme s'il s'agissait d'un État « normal » de la région, avec lequel les relations peuvent se faire comme si de rien n'était, et non d'un État colonisateur et d'apartheid.
Au delà des accords économiques et politiques entre États, la normalisation est aussi une forme de « colonisation de l'esprit », où l'on en vient à penser que la réalité de l'oppresseur est la seule réalité « normale ». La promotion d'une co-existence sans disparition de l'oppression coloniale participe à la normalisation, d'où le concept d'une collaboration de co-résistance. Pour les Palestinien·nes, toute situation où un individu arabe et un individu israélien collaborent ou participent à un événement ou un projet commun, et qui ne serait pas basé sur un tel cadre, servirait à normaliser la situation.
Il va sans dire que cette mise en garde ne s'adresse pas aux co-réalisateurs palestiniens, ni même à la communauté palestinienne de Masafer Yatta : il est évident que de leur point de vue, toute aide est bénéfique, et qu'ils ne vont pas refuser une main qui se tend, ni la possibilité de relayer cette lutte sur les plus grandes scènes du monde. Jamais les appels de la campagne BDS ne concernent les Palestinien·nes eux-mêmes et elles-mêmes, qui sont pris dans un réseau colonial et se battent pour leur propre survie avant tout. Ces mises en garde concernent les militant.es du monde entier qui ont le luxe de pouvoir apporter ou non leur soutien à un film, de mener des batailles politiques et de répondre à l'appel du PACBI, dans sa complexité et sa subtilité.
2/ Un film qui se veut anticolonial refuse toute collaboration avec une association liée de près ou de loin à la colonisation israélienne. Or, l'équipe du film de No Other Land a violé cette règle au moins une fois en collaborant avec l'organisation Close-Up, contre laquelle 500 cinéastes s'étaient exprimés en 2019, justement parce qu'elle participe à la normalisation de l'apartheid israélien[4].
3/ Une équipe israélienne de cinéastes qui se veut anticoloniale s'exprime dans des termes attendus par les colonisés, en particulier en faisant mention de l'origine de la situation coloniale en Palestine, c'est à dire la Nakba de 1948 (l'expulsion de 800.000 Palestinien·nes de leurs terres), et en nommant l'État d'Israël comme le responsable de cette « grande catastrophe ». Ceci n'est pas un détail dans le cas d'un film centré sur l'occupation de Masafer Yatta qui date de 1967, comme nous le verrons plus loin.
Certes, l'équipe du film a fini par faire une telle déclaration, mais seulement après la publication du premier article du PACBI. Cela démontre que le reproche du PACBI était fondé, qu'il a été entendu, et par conséquent l'utilité des articles produits par le PACBI, qui font avancer les alliés dans leurs réflexions et positionnements.
Le réalisateur israélien principal du film, Yuval Abraham, lorsqu'il reçoit des prix pour No Other Land, semble adapter son discours à son public. Il a tenu des propos très peu courageux lors de la cérémonie des Oscars où il a, selon le PACBI, « repris le narratif sioniste sur Gaza », ce qui a offensé beaucoup de Palestinien·nes.
4/ Un point qui peut paraître anecdotique aux cinéphiles français, mais qui souligne la sensibilité d'un tel sujet pour le PACBI :
- « il est important de reconnaître que les Palestinien·nes n'ont pas besoin de validation, de légitimation ou de permission de la part des Israélien·nes pour raconter leur histoire, leur présent, leurs expériences, leurs rêves et leur résistance, y compris artistique, contre le système colonial d'oppression qui les prive de leur liberté et de leurs droits inaliénables. »
Bien sûr, cette sensibilité n'est pas suffisante pour appeler au boycott de No Other Land, mais elle explique un certain ressenti sur lequel il est intéressant de se pencher. Voir les Occidentaux adouber un film qui dit ce que les Palestinien·nes disent depuis des décennies, parce qu'il serait co-réalisé, donc validé par un Israélien, est difficile à avaler. Cela participe de l'invisibilisation des narratifs palestiniens.
Dans le cinéma israélien, il existe une tradition qui consiste à pleurer sur des massacres commis par des Israéliens, en mettant plus en avant les regrets des Israéliens que leurs responsabilités (voir par exemple Valse Avec Bachir, Tantura…), et une tradition occidentale à aduler ces films, et ces Israéliens. De manière générale, ce même « nous » qui s'identifie davantage au réalisateur israélien de No Other Land, tend à prendre plus au sérieux les voix israéliennes que les voix palestiniennes. A terme, cela reproduit une hiérarchie raciale, avec une identification aux narratifs des colons plutôt qu'à ceux des colonisés[5].
5/ Il existe un autre élément qui peut être difficile à comprendre dans un contexte français. La lutte pour la libération du peuple palestinien ne se fait pas qu'à Masafer Yatta. La lutte contre l'occupation de la Cisjordanie en général, et de Masafer Yatta en particulier, est une campagne qui est menée, entre autres, en Israël par des « sionistes de gauche ». Ces Israéliens ne remettent pas nécessairement en cause le contexte plus large qui l'accompagne : la colonisation de toute la Palestine historique depuis 1948, l'interdiction faite aux réfugiés de retourner chez eux, l'apartheid, le blocus criminel de Gaza, le génocide, etc.
Les sionistes de gauche soutiennent les luttes palestiniennes à la seule condition que leurs propres privilèges de colons demeurent préservés, et il existe donc une forte méfiance à l'égard d'œuvres qui adoptent une telle position. Elles peuvent sembler progressistes depuis la France, mais elles comportent un véritable obstacle sur le chemin de la libération et du respect du droit international, incluant l'ensemble des droits inaliénables du peuple palestinien.
Alors qu'une telle situation est peu connue, et donc mal comprise en France, nos camarades palestinien·nes nous demandent de leur faire confiance quant à leur connaissance du contexte, et de ne pas tenter de leur donner des leçons, de pointer leurs supposées erreurs, ou d'exiger leur rétractation. Le PACBI condamne explicitement cette attitude de la part de certains de ceux qui se prétendent ses alliés :
- « Nous notons ici que même les partenaires et alliés de longue date en Occident ne sont pas à l'abri du privilège racial d'être blancs ou proches de la blancheur, ce qui peut les empêcher de voir d'autres contextes ou même les amener à adopter un rôle de chien de garde, quelles que soient leurs intentions… »
6/ Enfin, un dernier aspect a été ignoré dans l'argumentaire pourtant passionnant du PACBI : s'il réitère que, pour le grand public, ce film est une très bonne introduction à l'occupation en Cisjordanie, il signale néanmoins que les militant.es « n'ont pas besoin de ce film en particulier pour les convaincre de 76 ans de colonialisme brutal, et qu'il existe de nombreux autres films palestiniens, arabes, internationaux, ou réalisés par des Israélien.nes antisionistes qui servent bien la cause palestinienne sans être entachés par une quelconque normalisation. »
On se retrouve alors dans une situation que les militant.es de la campagne BDS (boycott, désinvestissement et sanctions contre l'apartheid israélien) connaissent bien, et qu'on appelle « la zone grise », qui demande ni boycott, ni promotion. Dans cette situation, on n'appelle donc pas à boycotter No Other Land, mais puisqu'il bénéficie déjà d'une promotion et d'une distribution de première classe, et l'on peut s'en réjouir, alors il n'a pas besoin en plus de la promotion et des maigres ressources des festivals de films palestiniens ou des cercles de solidarité militants, qui pourraient à la place privilégier des films réalisés à 100% par des Palestinien·nes, ou qui pour le moins ne participent en aucune manière à la normalisation.
En conclusion
No Other Land est un excellent film, très utile pour la défense des droits du peuple palestinien. Cela n'empêche pas d'une part d'entendre les critiques que certain.es Palestinien.nes peuvent émettre, en particulier vis à vis de l'équipe israélienne du film. Cela n'empêche pas, d'autre part de constater que ce film bénéficie déjà d'une promotion « grand public », ce qui pose la question de la nécessité de le promouvoir encore, aux dépends de films plus petits et au moins aussi méritant.
Rappelons par ailleurs que la campagne BDS est une campagne anticoloniale à différents égards. D'abord parce qu'elle lutte contre la colonisation, mais aussi parce que c'est une campagne dont les termes ne sont pas décidés en Occident, et qui répond à un appel palestinien, dans ses objectifs, dans ses méthodes et dans sa rhétorique. Elle implique de la part de militants français de parfois faire des efforts pour comprendre les directives et les raisonnements palestiniens, y compris sur le sujet de la normalisation parfois mal compris, dans un dialogue souvent riche et fructueux.
A minima, on peut ouvrir le débat à partir des lignes du PACBI en interrogeant nos propres limites et nos contradictions, en faisant preuve d'humilité et en écoutant les Palestinien.nes auprès de qui on se bat, dans une co-résistance respectueuse et entière. Cet épisode participe de cet effort qui nous est demandé, ainsi qu'un appel à plus de vigilance contre certains de nos réflexes encore trop conditionnés par un contexte occidental.
Notes
[1] PACBI's Position on No Other Land, 5 mars 2025 ; PACBI's engagement with constructive critiques of our position on No Other Land, 10 mars 2025.
[2] Emmanuel Dror, « Boycott ? Oui ! Culturel ? Aussi ! », Contretemps, 14 janvier 2011 ; voir les directives PACBI pour le boycott culturel international d'Israël, 16 juillet 2014
[3] L'exception israélienne : normalisation de l'anormal, 31 octobre 2011 ; « Explication des directives anti-normalisation du mouvement BDS », 14 novembre 2022.
[4] PACBI Welcomes Statement by More Than 500 Filmmakers Against « Close Up » Initiative Normalizing Israeli Apartheid, 27 août 2019.
[5] Houda Asal, « Il est temps de parler de racisme anti-palestinien en France », Contretemps, 16 septembre 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Trump n’est pas fou, il a un projet - Conférence à l’université McGill à Montréal de Jean-luc Mélenchon
16 avril 2025
Jean-Luc Mélenchon est intervenu à l'occasion d'une conférence à l'université McGill pour présenter son livre "Faites mieux !", le 15 avril 2025.
Jean-Luc Mélenchon dénonce le développement d'un nouvel obscurantisme, où l'autorité politique ou religieuse s'immisce dans les universités en dictant thèmes et recherches. Il rappelle qu'en France, une ministre a cherché à "pourchasser l'islamo-gauchisme", pendant qu'aux États-Unis, Donald Trump menaçait Harvard pour son indépendance intellectuelle.
Il poursuit en soulignant l'absurdité d'un monde où, chaque année, 3 000 enfants dorment dans la rue en France tandis que les grandes surfaces préfèrent détruire les denrées invendues, illustrant l'incapacité de nos sociétés à changer. Il affirme que la révolution citoyenne doit remettre le peuple aux commandes.
Il célèbre aussi l'héritage féministe, citant La Cité des dames de Christine de Pisan comme la première intuition historique de l'émancipation des aptitudes biologiques. Il affirme que le féminisme, en rompant avec l'idée que la biologie dicte la vie sociale, fonde ainsi l'humanisme. Il souligne la contraception et l'IVG ont ouvert des libertés sans précédent.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon critique les reculs imposés par Trump sur l'écologie, les droits des femmes et des personnes transgenres, dénonçant leur caractère cruel et rétrograde. Il fustige également les droits de douane instaurés par Trump, révélateurs d'une crise profonde du capitalisme américain. Prédisant la domination économique futur de la Chine, il avertit que les États-Unis n'ont pas d'autres ne recourt qu'à l'économie de guerre. Terminant sur Gaza, il réaffirme son refus de détourner le regard devant l'horreur, revendiquant, dans l'engagement de la gauche radicale, une exigence de dignité absolue.
Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Ruba Ghazal à Montréal
Les interventions de Ruba Ghazal et de Jean-Luc Mélenchon ont eu lieu à l'occasion d'un meeting de Québec Solidaire à Montréal, le 16 avril 2025.
SOMMAIRE :
00:00 : Introduction de Roxane Milot
05:08 : Discours de Ruba Ghazal
26:00 : Discours de Jean-Luc Mélenchon
01:04:52 : Echange entre Jean-Luc Mélenchon et Ruba Ghazal

Trump persiste sur l’automobile

Après la pause ou le revirement annoncé par Trump, l'automobile demeure la seule industrie manufacturière dont les taxes à l'importation aux États-Unis en provenance de tous les autres pays du monde passent de 2 % à 25 %. La mesure est entrée en vigueur le 3 avril pour les voitures automobiles, et le sera d'ici au 3 mai pour les principales pièces.
Tiré de Inprecor
15 avril 2025
Par Jean-Claude Vessillier
La moitié des 16 millions d'automobiles vendues aux États-Unis est importée, ce chiffre s'élevant à 60 % pour les pièces. Mexique et Canada sont les premiers touchés car les firmes nord-américaines ont intégré à leur espace de production ces deux pays limitrophes. C'est sur un autre continent ce qui se passe avec Renault en Roumanie, Turquie et Maroc. Le déficit commercial des États- Unis pour ce secteur s'explique largement par cette politique dont les firmes nord-américaines sont le seules responsables.
Une autre cause du déficit est que les voitures américaines produites aux États-Unis sont tout simplement invendables dans la plupart des autres pays du monde, à commencer par l'Europe. Qui veut acheter ces mastodontes SUV au poids de plusieurs de tonnes et à une consommation supérieure à 10 litres d'essence aux 100 km ?
Dès les premiers jours qui ont suivi les annonces de Trump, les firmes automobiles ont réagi. Stellantis, propriétaire de Chrysler, a annoncé l'arrêt temporaire de la production dans l'usine de Windsor dans l'Ontario au Canada. Un autre de ses usines a été mise à l'arrêt à Toluca au Mexique. Toyota a suspendu les heures supplémentaires dans une usine au Mexique. Cette hâte interpelle. Même si les politiques de « juste à temps » entraînent une réactivité de plus en plus rapide, les firmes automobiles ont sur-signifié l'impact ces mesures en en faisant supporter les premières conséquences aux salariés.
Ces mesures annoncées pour les États-Unis ont des conséquences pour toute l'industrie automobile mondialisée. L'Europe occidentale connaît déjà un excédent de capacité de production comme en témoignent les fermetures d'usines annoncées en Allemagne par Volkswagen, la sous-utilisation des usines Fiat en Italie, et la casse des équipementiers en France. Les voitures vendues ou produites en moins dans un pays ne sont pas compensés ailleurs, et cela dans un contexte où la production mondiale a juste rattrapé son niveau de 93,5 millions de voitures d'avant Covid.
Cette pénurie de débouchés est la conséquence des limites qui pèsent sur l'usage de l'automobile dues au fait que c'est l'un des principaux facteurs du dérèglement climatique. Elle exacerbe la concurrence entre firmes et pays-continents. C'est pourquoi l'emploi ne peut pas être sauvé par les mesures de Trump laissant intact le pouvoir de nuisance des firmes actuellement dominantes. Ses promesses de réindustrialisation sont à moyen terme du vent.
Pourtant, Shawn Fein, le président de l'UAW le syndicat américain qui avait organisé la grande grève de l'automobile en octobre 2023 a, sur le site du syndicat, « félicité l'administration Trump d'avoir pris ces mesures. Ces droits de douane sont un grand pas dans la bonne direction pour les travailleurs de l'automobile et la population ouvrière à travers le pays ». Ce soutien, même ponctuel, aux mesures de Trump vaut alerte.
Il nous faut aujourd'hui, face à la concurrence exacerbée, mettre au premier plan une solidarité ouvrière effective. Beaucoup sont en France et en Europe indignés par la politique de Trump et ses barrières douanières. Qu'ils réfléchissent à la manière dont les travailleurs du Maroc ou de Roumanie accueilleraient une politique protectionniste d'un gouvernement français visant à fermer des usines mises en place par des firmes françaises. Les relocalisations ici sont toujours des délocalisations ailleurs.
Trump fait manifestement une « fixation » sur l'industrie automobile. C'est autant dû à la part de cette industrie dans le déficit comptable du commerce extérieur des États-Unis qu'au rôle politique de cette industrie pourtant déclinante. Raison supplémentaire pour combattre ici et partout les choix de Trump.
Publié le 14 avril 2025 par NPA Auto Critique
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Woke », « wokisme » : un inventaire éditorial pour identifier les auteurs de ce concept

« Woke », « wokisme » : on sait que ces mots servent à disqualifier les mouvements d'émancipation et de défense des droits sociaux. Mais qui utilise ces mots et dans quelle mesure ? Par quels auteurs ces mots ont envahi le champ médiatique et littéraire ?
Billet de blogue de Paco Tizon 16 avril 2025
Qui utilise le concept « woke » ou de « wokisme » dans la production littéraire, et dans quelle mesure ? Qu'est-ce que ça permet de comprendre sur la réalité de ce concept ?
Pour le savoir précisément j'ai inventorié tous les livres qui mentionnent ces mots, parus de mars 2023 à avril 2025. (Merci Electre, qui est la base de données qui référence tous les livres commercialisés.)
Sur 47 livres :
– 40 dénoncent le "wokisme", un supposé mouvement "woke" et des gens appelés "wokistes".
– 7 étudient l'instrumentalisation de ces mots, mais sans constater l'existence d'une idéologie woke ni d'un mouvement wokiste.
– AUCUN AUTEUR ne se revendique woke.
Ce qu'on peut conclure : le concept de wokisme est un fantasme d'idéologues réactionnaires, qui sert à disqualifier les mouvements de défense des droits. Le concept a ceci de pratique qu'il permet de qualifier les mouvements écologistes, les luttes anticapitalistes, antiracistes, féministes, contre les LGBTQIphobie, mais aussi les champs d'études sur toutes les formes d'oppressions - de classe, raciale, sexuelle, de genre, validiste, spéciste, industrielle.
À mesure que la société est perméable aux discours réactionnaire set oppressifs, et que les discours d'extrême-droite infusent dans le champ médiatique, le concept de "Woke" s'élargit : il intègre désormais certains secteurs d'activité : enseignement, champ social, syndicalisme, journalisme indépendant, etc.
"Woke" est un mot-valise. Une très grosse valise.
Le détail de ces titres est ici.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Palestine et le silence stratégique des progressistes

Je vis avec le sentiment étrange que le présent devient de plus en plus complexe et que, à tout moment, l'ordre établi pourrait s'effondrer. Le divertissement et les obligations imposées maintiennent les masses déconnectées de la réalité. Une réalité dure, dans laquelle des personnes sont surveillées, arrêtées, expulsées et même « disparues » simplement à cause de leurs convictions politiques, de leurs prises de parole publiques ou de leur simple humanité.
Pendant ce temps, les médias s'expriment avec des termes si vagues et abstraits que la majorité de la population ne peut les comprendre—ignorant la nouvelle forme d'esclavage qui s'installe, où des entreprises comme Tesla, Amazon et META dictent aux gouvernements comment légiférer pour élargir leurs marchés et leurs profits, au prix du démantèlement de siècles d'acquis sociaux durement gagnés.
Dans cette prétendue « société d'abondance », des millions de personnes peinent à survivre, tentant d'assurer un avenir pour lequel elles ne sont pas préparées. Non pas par manque de volonté ou d'effort, mais parce que leur sort est entre les mains de décideurs qui choisissent de gouverner pour les élites plutôt que pour la majorité. Dans un monde où la richesse est concentrée entre quelques mains, la misère se partage entre des millions.
Je regarde avec une certaine incrédulité la tournée de Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez à travers les États-Unis dans leur lutte contre l'oligarchie. J'ai envie de croire qu'ils sont entourés d'une équipe intelligente, qui leur indique les sujets les plus susceptibles de rassembler des personnes aux origines diverses. Mais je suis cette tournée avec scepticisme, car elle évite consciemment des sujets comme la Palestine. Même si la fenêtre d'Overton s'est suffisamment déplacée dans leur société pour permettre un débat ouvert, ils refusent toujours de faire de la défense des droits humains des Palestiniens un thème central de leur campagne. Comme s'il n'y avait pas de lien direct entre les impôts payés par les Américains et le transfert massif d'armement vers Israël, utilisé pour commettre des crimes horribles.
Parfois, les discours en disent plus par ce qu'ils taisent que par ce qu'ils énoncent. C'est pourquoi il est compréhensible que, à l'extrême gauche du Parti démocrate, d'innombrables initiatives citoyennes émergent—des initiatives qui, tout en étant sympathiques à Sanders et AOC, ne voteraient jamais pour eux.
Samedi dernier, lors de la marche nationale pour la Palestine à Ottawa, un intervenant a rappelé à la foule que tous les partis politiques, sans exception, savent ce qui se passe en Palestine—et ne font rien. Et c'est vrai. Au-delà de quelques déclarations signées, il est rare de les voir dans la rue ou de placer le génocide à Gaza au cœur de leur discours. Ils évitent la controverse, et ce faisant, ils se coupent aussi du sentiment des communautés. Et pire encore : par leur silence, ils ignorent également les Premières Nations des États-Unis et du Canada, qui subissent encore aujourd'hui un génocide silencieux.
Manuel Tapial
Membre du Conseil d'Administration de Palestine Vivra
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Parution le 15 avril 2025 au Québec Illustrations

Parution le 15 avril 2025 au Québec
Illustrations de Patrice Charbonneau-Brunelle · Postface de Josianne Poirier
« J'ai mis la radio, pis j'ai ouvert le resto. Y'a un vieux monsieur qui vient tous les matins prendre son café. Il attendait déjà sur le bord de la porte, comme un pas de vie, mais gentil quand même. Il m'a demandé si j'avais reçu le journal. Fak là, j'ai enlevé l'élastique autour des journaux.
Pis j'ai vu Julie. Julie sur toutes les couvertures du Journal de Montréal. Habillée dans sa toge de finissant. La même toge dégueuse que moi j'ai portée parce qu'il y en avait rien qu'une à l'école pour tout le monde. J'ai donné le journal au monsieur. Pis je me suis assise par terre, derrière le comptoir. À la radio, ils ont commencé à parler de Julie. Un cauchemar. Pis après ils ont passé All Star de Smash Mouth. Un esti de cauchemar. »
À la veille de l'an 2000, sur la Rive-Nord de Montréal, sept élèves de cinquième secondaire sont bouleversé·es par la disparition de leur amie, Julie Surprenant. Écrite par la comédienne, scénariste et réalisatrice Sarianne Cormier, cette pièce est un exercice pour sortir Julie de l'oubli, une ode à celleux qui restent et aux amitiés de l'adolescence, une étreinte qui apaise.
Illustration : Patrice Charbonneau-Brunelle
Autrement dit, en plus de transformer l'aménagement urbain, ce sont toutes les dimensions de la vie sociale qu'il faut réformer. Pour que la ville soit plus sécuritaire et que le sentiment de sécurité augmente de façon proportionnelle, il faudrait parvenir à éliminer les discriminations et les inégalités fondées non seulement sur le genre, mais aussi sur la race et la classe.
Il y a quelque chose qui tient de la pensée magique dans l'idée que la lumière a le pouvoir de pacifier le monde.
Depuis des années SARIANNE CORMIER se démarque autant devant que derrière la caméra. En plus de sa carrière de comédienne, elle est réalisatrice et scénariste de plusieurs courts métrages. Son premier long métrage Au revoir Pluton sortira en 2025.
Au théâtre, elle est l'autrice des pièces Mythologie (2021) et Julie (2024).
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Les droits humains armés : Guérillas, dictatures et démocratie en Argentine. »*

Par David Copello, Presses universitaires de Rennes, mars 2025
Des guérilleros défenseurs des droits humains ? L'idée peut paraître déroutante. C'est pourtant un élément central, quoique mal connu, de l'histoire des gauches latino-américaines, et en particulier argentines. Après les grandes mobilisations révolutionnaires des années 1960 et 1970, une répression féroce s'abat sur les contestataires, dans un contexte de dictature, avant de laisser place à une transition démocratique dans les années 1980. L'ouvrage montre comment cet environnement changeant a affecté les mouvements révolutionnaires argentins dans leurs discours et leurs pratiques, et comment ils ont cherché à préserver, dans leur lutte pour les droits humains et la démocratie, les idées et objectifs qu'ils associaient au départ à la révolution. Ces efforts inaugurés pendant les années 1970, dans le bruit des bottes et des balles, irriguent le discours politique kirchnériste et antinéolibéral jusqu'à nos jours. Le livre aborde ainsi la genèse et les ramifications contemporaines d'un rapport à la démocratie qui se construit sur un rapport aux armes. En se fondant sur une enquête originale et des archives inédites, il offre alors au public des clefs de lecture originales pour saisir les enjeux stratégiques de la gauche ( latino-américaine ) au XXIe siècle.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











