Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le Canada doit s’attaquer au racisme et à la discrimination systémiques sur le marché du travail

À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le 21 mars, les syndicats canadiens demandent au gouvernement fédéral de prendre des mesures immédiates et concrètes pour lutter contre le racisme au sein de la population active. La première mesure à prendre consiste à actualiser la Loi sur l'équité en matière d'emploi en mettant en œuvre les réformes recommandées par le Groupe de travail sur l'examen de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
La Loi sur l'équité en matière d'emploi est un outil essentiel dans nos efforts pour lutter contre le racisme en milieu de travail et remédier aux inégalités dont sont victimes les travailleuses et travailleurs noirs, autochtones et racialisés. Adoptée pour promouvoir l'égalité et éliminer les obstacles discriminatoires à l'emploi dans les lieux de travail régis par le gouvernement fédéral, la Loi fournit un cadre permettant aux employeurs de s'attaquer de manière proactive aux inégalités systémiques et d'assurer une représentation équitable de tous les groupes, y compris les peuples autochtones, les personnes ayant une incapacité, les femmes et les personnes racialisées – des groupes désignés en vertu de la Loi actuelle.
Si la Loi sur l'équité en matière d'emploi jette les bases du progrès, il reste encore beaucoup à faire pour réaliser pleinement son potentiel, qui peut être atteint par son actualisation. Le rapport du Groupe de travail sur l'examen de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, publié récemment à l'issue de consultations avec de nombreuses parties prenantes, dont les syndicats canadiens, contient un certain nombre de recommandations visant à renforcer et à améliorer l'efficacité de la Loi, y compris des mesures destinées à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques dans les pratiques d'embauche, de promotion et de maintien dans l'emploi.
« Nous sommes fermement déterminés à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques sur le marché du travail, afin d'assurer un avenir où chaque personne sera traitée avec dignité, respect et égalité, a déclaré Larry Rousseau, vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada. Les recommandations formulées par le Groupe de travail offrent une occasion importante d'éradiquer les iniquités profondément ancrées et de prévenir les iniquités futures, ce qui est absolument essentiel pour s'attaquer au racisme systémique et s'assurer que les travailleuses et travailleurs noirs, autochtones et racialisés ne sont plus laissés pour compte. C'est ainsi que nous construirons une société exempte de discrimination, de racisme et de préjugés. »
Les recommandations du Groupe de travail comprennent l'investissement dans des initiatives ciblées pour soutenir le recrutement, la formation et l'avancement des groupes sous-représentés dans la main-d'œuvre, ainsi que la mise en place de mécanismes d'application robustes pour tenir les employeurs responsables du respect de la Loi.
La lutte contre le racisme et la discrimination sur le marché du travail est essentielle pour garantir l'équité pour tous les travailleurs et travailleuses. Les écarts de revenus en fonction de la race persistent, car les travailleuses et travailleurs autochtones, noirs et racialisés continuent d'être confrontés à des obstacles aux possibilités d'emploi, à des pratiques d'embauche discriminatoires, à des salaires inégaux et à des possibilités d'avancement limitées. Si l'on ne s'attaque pas à ces inégalités, on ne fera qu'exacerber les problèmes rencontrés par ces travailleuses et travailleurs et on perpétuera leur exclusion d'une participation pleine et équitable au marché du travail.
Les syndicats canadiens ont également un rôle à jouer en prenant des mesures proactives pour faire progresser l'équité en matière d'emploi au sein de leurs propres organisations. Il s'agit notamment de supprimer les obstacles à l'égalité des chances et à un traitement équitable, d'inscrire l'équité en matière d'emploi à l'ordre du jour des négociations et de veiller à ce que les personnes les plus concernées fassent partie des comités de négociation. D'autres mesures consistent à sensibiliser les membres à l'importance de l'équité en matière d'emploi, à former le personnel et les dirigeantes et dirigeants à cette question et à mettre en place des mécanismes de responsabilisation pour suivre les progrès de l'équité en matière d'emploi au sein de leur organisation. Enfin, il est essentiel que les syndicats défendent les politiques et les initiatives en faveur de l'équité en matière d'emploi, notamment en renforçant la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
Le rapport complet du Groupe de travail sur l'examen de la Loi sur l'équité en matière d'emploi est disponible ici (en anglais seulement).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Northvolt : exigeons un BAPE et de la transparence

La giga-usine de batteries de la compagnie Northvolt est en voie de s'implanter en Montérégie sans qu'il n'y ait d'évaluation environnementale par le Bureau d'audience publique sur l'environnement (BAPE). Comment se peut-il que le plus grand projet industriel privé de l'histoire du Québec ne soit pas évalué de manière indépendante ? Parce que, attention : scandale… le gouvernement Legault, qui est juge et parti car il injecte des milliards de dollars dans le projet, a délibérément aidé Northvolt à éviter un examen du BAPE ! C'est un grave déni de démocratie environnementale, un manque flagrant de respect pour l'environnement et la population et une manière de fonctionner digne des années 60.
Tiré du site de Greenpeace Canada.
On ne peut accepter ce grave précédent sans réagir. Si le plus grand projet industriel privé de l'histoire du Québec n'est pas assez “gros” pour qu'il y ait un BAPE, quel projet le sera ?
Exigeons de la transparence et une évaluation environnementale indépendante
👉 Envoyez un courriel à Benoit Charette
Le gouvernement Legault a déjà permis que Northvolt coupe près de 9000 arbres et remblaie 61 des 92 milieux humides présents sur son site, soit environ 60 000 mètres carrés de milieux humides détruits. Au total, ce sont plus de 950 000 m2 de milieux naturels qui seront détruits. Mais tout n'est pas joué, la compagnie a aussi demandé une autorisation pour la construction de l'usine et devra en demander une pour l'exploitation de l'usine.
Plusieurs groupes environnementaux et groupes citoyens ont demandé la tenue d'une évaluation environnementale indépendante depuis l'annonce de l'implantation de l'usine de Northvolt en octobre 2023. Au total, plus de 180 groupes environnementaux, de syndicats, de médecins, de groupes citoyens et d'universitaires ont demandé un BAPE au gouvernement. Une évaluation environnementale indépendante et des audiences publiques sont essentielles pour protéger les citoyens et l'environnement. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de déclencher une telle évaluation.
L'implantation de cette usine aura de nombreux impacts sur la biodiversité du secteur qui abrite plusieurs espèces menacées. Elle aura aussi des impacts sur la qualité de l'air et de l'eau et potentiellement sur la santé de la population. Et elle aura des impacts sur tout le filet social – augmentation de trafic, défi pour le logement et les infrastructures de santé et scolaire pour faire face à l'augmentation du nombre de travailleur.euses, etc.
Demandez au ministre Charrette de déclencher une évaluation environnementale par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur l'ensemble de ce grand projet pour bien en saisir tous les enjeux. La transition écologique ne peut sans évaluation indépendante et sans audience publique !
Voici aussi ci-dessous quelques autres moyens d'agir :
👉 Envoyez un courriel à Benoit Charrette
✉️ Pour envoyer un courriel à Benoit Charette, ministre de l'Environnement, et mettre PierreFitzgibbon, ministre de l'Économie, utilisez le texte ci-dessous que vous pouvez copiez-collez.⬇️
Destinataires : ministre@environnement.gouv.qc.ca ; ministre@economie.gouv.qc.ca ;
Exemple de titre de courriel : Un BAPE pour Northvolt
Exemple de texte de courriel pour vous inspirer (vous pouvez copier-coller) :
Monsieur Charrette,
Plusieurs personnes sont préoccupées par la façon dont le projet Northvolt se développe, soit sans audience du Bureau d'audience publique sur l'environnement (BAPE) sur l'ensemble du projet. Je vous demande qu'un processus d'évaluation environnementale indépendante et des audiences publiques soient mis sur pied pour bien tenir compte des enjeux sanitaires, environnementaux et sociaux de grands projets. Je demande un BAPE pour Northvolt.
Cette giga-usine de batterie est « le plus gros projet industriel privé de toute l'histoire du Québec ». Comment se fait-il qu'un tel projet puisse se faire sans BAPE ? Nous savons que l'implantation d'une marina de 100 places, nécessite la tenue d'un BAPE et Northvolt, le plus grand projet industriel au Québec, y échappe ! C'est inacceptable !
Comme vous savez, ce projet évolue rapidement par l'obtention de permis par étape. Vous pouvez utiliser votre pouvoir discrétionnaire pour déclencher un BAPE à chacune des étapes. En aurez-vous le courage ?
Plusieurs aspects de ce projet sont préoccupants :
– les dommages causés présentement à la biodiversité sur le site
– la destruction des milieux humides – parmi les derniers de la Montérégie
– l'impact du déplacement de terres contaminées sur le site et le risque que les contaminants se retrouvent dans le Richelieu
– l'impact des contaminants qui seront rejetés dans l'air et dans l'eau pour la santé humaine
– l'impact de l'afflux de 3000 travailleurs sur les services de santé et dans les écoles
– l'augmentation de circulation aux environs du site
– la grande consommation d'hydroélectricité de cette usine et les lacunes créées pour d'autres projets
– le dézonage des terres agricoles pour soutenir la croissance démographique
– l'impact sur le territoire québécois en lien avec l'extraction des matières premières
– l'inconnu sur les impacts concrets que l'usine aura sur notre carboneutralité
– etc.
Par-dessus tout, le manque de transparence de votre gouvernement me préoccupe grandement. À chaque jour de nouvelles informations sont divulguées. Et à chaque jour des doutes se créent à cause de ce manque de transparence.
Vous avez le pouvoir discrétionnaire et mandater le BAPE. C'est ce que je vous demande, tout comme les plus de 180 groupes environnementaux, de syndicats, de médecins, de groupes citoyens et d'universitaires qui l'ont déjà fait.
Je vous demande, M.Charette, de déclencher un BAPE sur l'ensemble de ce grand projet pour bien en saisir les enjeux et bonifier ce projet s'il va de l'avant. La transition écologique ne peut plus se faire sur le dos de la Nature !
Insérer votre signature
***
👉 Autres moyens d'agir :
✏️ Signez la pétition du Comité d'action citoyenne sur le projet Northvolt qui demande au ministre de la tenue d'une enquête du BAPE.
✏️ Signez la pétition demandant au le ministre de l'Environnement fédéral d'initier des audiences publiques et entreprendre une évaluation environnementale approfondie pour le projet Northvolt.
***
👉 Quelques liens pour en savoir davantage sur Northvolt :
Dossier de presse (très complet) du COMITÉ ACTION CITOYENNE PROJET NORTHVOLT, mise à jour le 19 mars 2024
– Dès l'annonce du projet nous avons revendiqué un BAPE
– 180 groupes environnementaux, de syndicats, de médecins, de groupes citoyens et d'universitaires exigent un BAPE : lettre et article
– Un récent sondage nous a appris que 68% des gens sont d'accord à ce que le projet de Northvolt soit soumis à un BAPE (seulement 24% sont en désaccord) alors que la majorité des Québécois(es) rejettent l'approche du gouvernement qui a modifié la réglementation, ce qui a eu pour effet de soustraire le projet de Northvolt à la tenue d'un BAPE obligatoire.
– Des groupes environnementaux et des groupes citoyens locaux dénoncent les méthodes nuisibles du gouvernement du Québec en matière de développement industriel
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Manif-Action Bloquons Assomption - Mobilisation 6600 Parc-nature MHM

Montréal, 23 mars 2024** – Plus de 350 personnes ont bravé le froid pour manifester avecle mouvement citoyen Mobilisation 6600 Parc-nature MHM aujourd'hui en opposition auprojet de prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'autoroute Souligny dansMercier-Hochelaga-Maisonneuve.
**Après une marche dans le quartier, les manifestant.e.s ont bloqué symboliquement le boulevard de l'Assomption afin d'affirmer leur détermination à empêcher la réalisation du projet de prolongement mené par la Ville de Montréal et le Ministère des transports et de la mobilité durable du Québec.
« Le prolongement de ces routes vise à faciliter le transport de marchandises par camionet à servir ainsi les intérêts privés du Port de Montréal et de Ray-Mont Logistiques », a affirmé Anaïs Houde, co-porte-parole de Mobilisation 6600. « La Ville nous dit que cesroutes permettront d'apaiser la circulation. Il est pourtant prouvé scientifiquement que lacréation de nouvelles routes provoque le phénomène de « trafic induit ». La populationest très inquiète des impacts sur la santé et la qualité de vie du passage prévu de 22 000véhicules de plus par jour à proximité des résidences. Que ce soit clair : il n'y a aucune acceptabilité sociale au projet de prolongement Assomption-Souligny, et nous sommes déterminé.e.s à le bloquer », a-t-elle poursuivi.
Bien qu'un tiers du Boisé Steinberg ait été protégé par la Ville de Montréal à l'automne2022, le prolongement Assomption-Souligny menace directement la section la plus à l'estdu Boisé. « C'est inacceptable, même absurde, dans le contexte du réchauffementclimatique, que nos gouvernements dépensent pour construire une route de plus en pleine ville » a commenté Cassandre Charbonneau-Jobin, co-porte-parole de la mobilisation.
De plus, le prolongement de l'autoroute Souligny impliquerait la construction d'unéchangeur à 3 niveaux passant par-dessus les rails de chemin de fer du CN et de RayMont Logistiques. « Le projet de plateforme intermodale de Ray-Mont Logistiques nous pollue la vie : en plus du bruit, de la pollution atmosphérique et visuelle et de la vermine qu'il attire, il implique de réhabiliter une gare de triage à moins de 50 mètres d'habitations,de détruire des milieux naturels fréquentés par les habitant.e.s et de construire ces routes anachroniques. L'aménagement de notre quartier doit-il être décidé par une entreprise privée ? » demande Anaïs Houde.
La ville présentera son projet d'aménagement pour le secteur le 26 mars prochain, à 19h,au Cégep de Maisonneuve. « Nous serons là pour exprimer notre vision axée sur le droità un environnement sain, l'accès à la nature et l'innovation en matière de décontamination naturelle des sols et d'autonomie alimentaire. Une vision à mettre en contraste avec la bétonnisation qu'implique une route et l'expansion des activités industrielles lourdes qui en résultent. Aux projets de béton, nous opposons la protection du vivant » a affirméCassandre Charbonneau-Jobin.
La manifestation, festive et familiale, était organisée en collaboration avec le Conseil Central du Montréal Métropolitain – CSN, avec la participation de Rage climatique, lecirque Hors piste, le musicien SOV, la chorégraphe Karine Cloutier, Mères au front et l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste (ORA).
À propos de Mobilisation 6600 Parc-Nature MHMMobilisation 6600 Parc-Nature MHM est un mouvement citoyen qui lutte depuis 2016 pour la préservation des espaces verts, de la santé et de la qualité de vie de la population de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il revendique la création d'un Parc nature dans le quadrilatère Viau-Dickson-Hochelaga-Notre-Dame et s'oppose à l'installation de RayMont Logistiques.
Source : Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aéroport de Saint-Hubert (YHU) : Un de perdu, dix de retrouvés !

Longueuil, 22 mars 2024. - La décision de Transport Canada d'interdire à partir d'avril 24 les vols de nuit du Boeing 737-200 de Chrono Aviation à l'aéroport de Saint-Hubert constitue, selon la Coalition Halte-Air Saint-Hubert, la preuve indiscutable que le pouvoir politique a bien une emprise réelle sur le développement de cet aéroport, contrairement à ce
qu'ont laissé entendre plusieurs élu.e.s municipaux, provinciaux et fédéraux depuis plus d'un an.
En réaction à la mairesse Catherine Fournier qui, hier sur les ondes de Radio-Canada,saluait le courage dont le ministre [Pablo Rodriguez]avait fait preuve, la Coalition s'interroge : à quel courage fait référence la mairesse ? Est-ce celui d'interdire d'un trait de plume au Boeing 737-200 de réveiller des milliers de résidentes et résidents à 2h30 du matin ? Il a fallu des années pour obtenir cette décision pourtant pleine de bon sens, demandée par de
nombreuses associations de riverains et les mairies du secteur. Une décision d'interdiction bien tardive qui se justifie amplement par les conséquences sanitaires que provoque une telle pollution sonore.
La Coalition rappelle que Boeing 737-200 de Chrono est un avion totalement obsolète, ultra-polluant et ultra-bruyant, dont le décollage s'entend à plus de 10 kms à la ronde, et qu'il est interdit depuis des années dans de nombreux aéroports américains et européens pour cause de pollution sonore excessive. Arrivant en fin de vie, ces coucous volants sont condamnés à brève échéance aux dires mêmes de leur propriétaire Chrono Aviation.
Selon la Coalition, en mettant l'accent sur l'interdiction de vol d'un seul avion, la mairesse C. Fournier tente de camoufler la réalité du développement du Terminal Porter qu'elle défend depuis maintenant plus d'un an. 4 millions de passagers à terme, 11 000 par jour par rapport à 11 000 par année actuellement, ce qui représentera une centaine de vols chaque jour, 6 à 8 chaque heure, effectués par 5 compagnies aériennes, comme l'a assuré Michael Deluce, qui dirige Porter Airlines.
La Coalition fait également remarquer que si les élu.e.s municipaux de l'Agglomération voulaient vraiment avoir du courage, ils et elles demanderaient que les travaux de construction à l'aéroport de Saint-Hubert soient stoppés immédiatement, et que le projet de développement de l'aéroport soit déposé entièrement avec toutes les études d'impacts économiques, sanitaires, environnementaux et climatiques, afin d'être évalué publiquement sur tous ces aspects, comme on pouvait le lire dans les conclusions du rapport Trudel en
octobre 2022, ainsi que dans le rapport de l'Office de Participation publique de Longueuil
(OPPL) du 1er novembre suivant.
Pour la Coalition, en ne respectant pas les conclusions de ces deux rapports de consultation, la mairesse et tout son conseil trahissent la confiance de la population. La mairesse et tout son conseil ne peuvent en aucune façon clamer qu'il y a acceptabilité sociale du projet.
Pour information : coalition.halteair@gmail.com
https://www.facebook.com/coalitionhalteairSH
https://www.instagram.com/coalitionhalteairsh/
https://twitter.com/Coalition_YH
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Zone d’intérêt » entre la Palestine, la Syrie et la condition humaine

« Zone d'intérêt » est un film glaçant par son réalisme, et par son extraordinaire capacité à incarner le sens de la « déshumanisation » et ce qu'elle peut engendrer en termes d'atrocités. Glazer a déclaré que la compréhension de son film ne se réduit pas seulement au traitement du passé ou des atrocités historiques, mais s'inscrit aussi dans le contexte de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui.
Tiré du blogue de l'auteur.
Le film Zone d'intérêt du réalisateur britannique Jonathan Glazer, lauréat de l'Oscar de cette année, a suscité une vive controverse parmi les écrivains et les professionnels de la culture et du cinéma en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Non en raison de son contenu, de sa cinématographie ou de la construction de ses personnages, mais à cause des propos tenus par son réalisateur dans son discours à la cérémonie des Oscars.
Glazer a déclaré que la compréhension de son film ne se réduit pas seulement au traitement du passé ou des atrocités historiques, mais s'inscrit aussi dans le contexte de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Il a exprimé son rejet de l'instrumentalisation de l' « Holocauste » pour justifier les guerres en cours, la déshumanisation et la perpétration de crimes.
En réponse à son discours, plus d'un millier de personnalités du cinéma s'identifiant comme juives ont rejeté l'analogie qu'il aurait – selon elles - faite entre l'Holocauste et la guerre en Palestine depuis le 7 octobre 2023.
Par ailleurs, des intellectuels et des organisations juives progressistes ont défendu Glazer, estimant que le refus de confronter le passé au présent et la confiscation de la mémoire de l'« Holocauste » ne sont rien d'autre que des tentatives de dissimulation des crimes et de la « guerre génocidaire » menée par Israël contre les Palestiniens.
Naomi Klein, journaliste et universitaire féministe canadienne, a écrit un article percutant dans The Guardian dans lequel elle évoque l'habituation des gens à vivre près du génocide dont ils savent qu'il est en train de se produire. Comme le montre le film, seul un mur les sépare de son horreur. Elle interpelle sur le fait qu'aujourd'hui, nous soyons à quelques murs de Gaza, où des actes de génocide se produisent depuis près de six mois, sans que personne n'intervienne pour les faire cesser.
Entre la banalité du mal et l'amour des roses
L'histoire de Zone d'intérêt décrit les détails quotidiens de la vie de la famille d'un officier nazi allemand qui dirigeait le camp d'Auschwitz, où, sur ses ordres, les nazis ont brûlé des milliers de prisonniers juifs, après les avoir réduits à l'esclavage, torturés et pillé leurs biens.
Elle renvoie d'emblée à l'idée de « la banalité du mal », ou sa normalité telle qu'évoquée par Hanna Arendt dans son livre sur Eichmann.
La famille vit dans une maison située à quelques mètres des usines de la mort, d'où s'élève parfois une fumée indiquant que l'incinération des cadavres est en cours. Ils dorment, se réveillent, font des fêtes aux buffets garnis, s'offrent des vêtements et cadeaux (ainsi que des biens volés), tandis que leurs enfants jouent dans une piscine au milieu des bruits, des cris, des coups et des tirs d'exécution provenant du camp voisin.
Le père - l'officier - semble doux et affectueux avec sa femme et ses enfants, en particulier ses filles, auxquelles il lit des histoires pour les border après une longue journée de travail routinier. Des journées à recevoir des instructions, à les exécuter avec diligence, à discuter avec ses supérieurs et ses subordonnés de l'« efficacité » des performances et de l'importance d'augmenter les chiffres (c'est-à-dire le nombre de personnes tuées), et de la meilleure stratégie d'organisation de la « solution finale » par l'usage des fours et leur refroidissement afin de les vider des cendres et les remplir de nouveau de cadavres dans un temps optimal.
Nous le voyons ensuite furieux, donner des ordres pour sanctionner les soldats allemands et les membres de la SS qui cueillent sans ménagement des fleurs dans les jardins, alors qu'ils sont sensés les entretenir pour embellir le camp [de la mort] et ses alentours.
Dans le même temps, nous apercevons l'épouse cultiver avec sérénité son jardin au pied du mur qui sépare leur maison d'Auschwitz, s'émerveiller de ses belles couleurs et initier son bébé à toucher et à sentir le parfum des fleurs.
Ainsi va la vie d'une famille allemande installée dans la Pologne occupée, vivant à côté du lieu de « travail » du père.
Son œuvre n'est rien d'autre que le « mal absolu », à savoir l'extermination de « l'autre », transformé en numéro ou en objet ou en matière dépourvue de tout attribut ou relation humaine. Les choses atteignent le paroxysme de la « banalité du mal » au moment où l'officier-père est sur le point de vomir, pour des raisons que le réalisateur nous laisse deviner, puis la caméra bascule soudainement dans l'instant présent.
On voit ce qu'est devenu Auschwitz aujourd'hui, l'on aperçoit des employées balayer des salles qui ont été témoins de massacres quotidiens il y a des décennies, et d'autres lustrer ce qui reste des fours crématoires, ou essuyer la vitre transparente qui sépare les visiteurs des milliers de chaussures appartenant à ceux qui sont morts dans l'une des tragédies les plus atroces de l'histoire contemporaine.
Les murs de Palmyre et le champ de bataille de Gaza
Mais la « banalité du mal », ou la complicité avec le mal pour ensuite en faire un sanctuaire ou un musée qui risque d'être coupé du monde contemporain et des crimes en cours, est ce contre quoi le brillant réalisateur Glazer s'élève.
Il a surtout insisté sur l'effet miroir entre l'horreur décrite dans son film et la guerre de Gaza d'aujourd'hui. Une guerre avec laquelle non seulement nous coexistons, mais qui conduit certains à évoquer le passé pour rendre acceptable l'extermination de l'humanité d'autrui.
Ce film, dans lequel le réalisateur a réussi à restituer l'intensité de la violence sans la moindre scène « sanglante », nous rappelle ce qu'écrivait Franz Fanon à propos d'un officier français chargé de torturer les prisonniers algériens pendant la guerre de libération, et de son quotidien bureaucratique dans les prisons, avant de rentrer chez lui pour retrouver normalement sa famille. Il sera plus tard hanté par des cauchemars.
On peut aussi imaginer comment les années ont passé et continuent de s'écouler dans la « Syrie d'Assad », où la vie se poursuit non loin des murs des prisons de Palmyre depuis les années 1980 ou de Saidnaya aujourd'hui-même. Ces usines de la mort où des dizaines de milliers de Syriens sont tués ou continuent d'y mourir sous la torture, transforment des êtres en chiffres ou en images insoutenables que l'on regarde parfois avec effroi sur Facebook, avant de poursuivre notre vie quotidienne et vaquer à nos occupations malgré l'horreur et la conscience des événements récurrents.
Bien sûr, nous pouvons comparer la roseraie du film, méticuleusement entretenue à côté du lieu de torture et d'extermination des prisonniers, avec tous nos jardins, ou les jardins des villes et villages où nous vivons, géographiquement proches du champ de bataille de Gaza, ou visuellement en contact avec ses événements, que nous suivons depuis des mois directement à travers les médias et les réseaux sociaux. Nous les suivons avec stupéfaction, colère, avec un excès de haine pour les auteurs et pour le monde qui leur permet de continuer. Nous les suivons avec tristesse et chagrin, tandis que notre impuissance nous demande d'essayer de d'oublier le matin ou le soir l'horreur, afin de pouvoir respirer et continuer à accomplir nos tâches quotidiennes.
En ce sens, on peut dire que Zone d'intérêt est un film qui échappe au cadrage, à la classification exclusive, à la géographie et au temps. Il s'agit sans aucun doute de l'Holocauste et d'Auschwitz, mais aussi, et dans la même mesure, des relations humaines quotidiennes et routinières qui se déroulent parallèlement au meurtre de masse et dans son ombre, de la trahison, du trouble, de l'ambition, de l'exploitation, de l'accoutumance au « mal » et de l'adaptation à ses scènes, comme s'il s'agissait d'un décor ou d'un bruit de fond toujours présent, dérangeant jusqu'à l'insomnie et pour autant domestiqué.
Zone d'intérêt est un film glaçant par son réalisme, par la froideur de ses personnages (à l'exception de la belle-mère de l'officier) et par son extraordinaire capacité à incarner le sens de la « déshumanisation » et ce qu'elle peut engendrer en termes d'atrocités et de cadavres brûlés.
Puis, une « jeune polonaise inconnue » s'invite et s'infiltre de nuit dans les événements du film. Le réalisateur la présente en « négatif », circulant secrètement et courageusement à bicyclette entre les champs autour d'Auschwitz, où les prisonniers sont contraints de travailler durement pendant la journée avant d'être tués. Elle y disperse des fruits et un brin de vie parmi les roses et les arbres, pour leur signifier que des gens ne consentent pas à les abandonner à leurs bourreaux sans rien faire et aux spectateurs silencieux qui assistent à la combustion de leurs os. Elle essaie de leur dire qu'à sa façon, elle refuse de les exclure de l'humanité commune.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis : Les Oscars et la politique

Environ 19,5 millions de téléspectateurs ont regardé la 96e cérémonie des Oscars, dimanche 10 mars, pour connaître les lauréats des meilleurs films, des meilleurs acteurs, etc. Ce fut un véritable spectacle et un événement très politique.
Hebdo L'Anticapitaliste - 700 (21/03/2024)
Par Dan La Botz
Crédit Photo
Wikimedia commons / MichaelEArth
Les nominés pour les meilleurs films étaient eux-mêmes, dans de nombreux cas, particulièrement politiques. De manière très différente, Barbie et Poor Things étaient tous deux des films féministes, le premier ridiculisant et renforçant de manière contradictoire les stéréotypes féminins et le second – une combinaison merveilleusement étrange de Frankenstein et de Pygmalion (My Fair Lady) – dépeignant la lutte pour le droit des femmes à l'indépendance par rapport au contrôle des hommes et défendant leur droit à cette indépendance.
Oppenheimer nous a amenés une fois de plus à nous concentrer sur la menace de la bombe atomique avec laquelle nous vivons depuis plus de trois quarts de siècle. Maestro, le film sur Leonard Bernstein, traite de la difficulté – même pour les riches et les célèbres – d'être homosexuel au milieu du 20e siècle (tout comme Rustin, le film sur Bayard Rustin, le militant des droits civiques, qui n'a pas été nominé pour le meilleur film). Et American Fiction, qui explore le racisme dans la littérature et la vie d'un point de vue noir. Enfin, Killers of the Flower Moon dépeint les meurtres commis par des colons blancs pour acquérir frauduleusement des terres indiennes riches en pétrole en Oklahoma dans les années 1920.
Des luttes des acteurs et scénaristes d'Hollywood à l'Ukraine
Venons-en à la cérémonie des Oscars elle-même. Lors de l'ouverture de la cérémonie, Jimmy Kimmel, l'animateur de l'émission Jimmy Kimmel Live, qui présentait les Oscars pour la quatrième fois, a utilisé les dernières minutes de son monologue comique d'introduction pour parler de la grève des acteurs et des scénaristes, qui a duré 148 jours, et des problèmes qu'elle soulève. Il a déclaré : « Au fond, Hollywood est une ville de syndicats ».
Dans la section « in memoriam » des Oscars, l'Académie a rendu hommage au leader de l'opposition russe Alexeï Navalny, dont le portrait a été dressé dans le film Navalny (2022), qui a remporté l'Oscar du meilleur documentaire en 2023. Le meilleur documentaire de cette année a été Vingt jours à Marioupol, le récit de l'attaque russe sur cette ville ukrainienne. En acceptant son Oscar, Mstyslav Tchernov, le réalisateur, a déclaré : « Je serai probablement le premier réalisateur sur cette scène à dire : “J'aurais aimé ne jamais faire ce film” ». Il a poursuivi en disant qu'il souhaitait que la Russie n'ait jamais attaqué l'Ukraine et occupé ses villes, et il a appelé le gouvernement russe à libérer ses prisonniers militaires et civils.
Déshumanisation d'hier et d'aujourd'hui
Le réalisateur britannique Jonathan Glazer, dont le film en langue allemande La Zone d'intérêt a remporté le prix du meilleur long métrage international, un film sur un commandant nazi et sa femme vivant dans une « zone d'intérêt » confortable du camp de concentration d'Auschwitz où plus d'un million de Juifs sont morts, a profité de son temps de parole pour parler de la Palestine : « Notre film montre le pire de la déshumanisation. Nous sommes ici comme des hommes qui refusent que leur judéité et le souvenir de l'Holocauste soient détournés par une occupation qui a conduit tant de gens à s'affronter. Que ce soient les victimes du 7 octobre en Israël ou l'attaque en cours sur Gaza, tous sont des victimes de cette déshumanisation - comment résister ? » Il a dédié son film à la jeune fille qui figure dans son film et qui a résisté.
Un grand nombre de participants à la cérémonie portaient des pin's avec la phrase « Artists for Ceasefire » (artistes pour un cessez-le-feu).
Hollywood, connu pour ses personnalités progressistes, produit de nombreux films politiques de qualité et certainEs Américains ont apparemment un appétit pour de telles vues critiques de notre pays. Même s'il est également vrai qu'Hollywood produit et que les Américains consomment beaucoup de cinéma de merde. Voilà, c'est tout. Je vais au cinéma.
Dan La Botz, traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Je marche sur les cadavres avec aisance

– Appelez-moi Puissance !
– Moi qui marche sur les cadavres avec aisance.
– Boursouflez mon P !
– Le galbe bien prononcé.
– Soyez généreux !
– Au nom des malheureux.
– Je marche sur les cadavres avec aisance.
– Des femmes et des enfants réduits en semence.
– Je m'abreuve du sang.
– Du peuple innocent.
– Je déroule l'horreur.
– La famine et les maelstroms funestes sur la Patrie en pleurs.
– Esgourdez la crépitation.
– De ma résolue progression !
– Oui ! Je marche sur les cadavres avec aisance.
– L'Injustice comme cocarde en évidence.
– Je suis la force étayée.
– Par l'ami dominant respecté.
– L'Institution obstrue ses oreilles.
– Quand l'atrocité se veut réelle.
– Elle a pour consolation.
– La condamnation.
– Je marche sur les cadavres avec aisance.
– Quand l'âme prie avec déférence.
– Rien ne sera comme avant !
– Le néant vous attend !
( Essoufflée, les mains entachées à torrents de sang, la Puissance s'écrie avec démence )
– Montrez-vous ! Où êtes-vous ? J'ai envie de marcher sur des cadavres avec aisance !
– Livrez-moi obus, chars et drones de haute surveillance !
– J'en ferai des cadeaux aux vieillards et la petite enfance.
– Montrez-vous, j'vous dis ! Je suis la Suprématie auréolée de Démocratie.
– ( … )
– Ne cherchez-pas Puissance ! Je suis nulle part et partout.
– Qui êtes- vous ?
– Je suis la Résistance, la Justice du Peuple, adoubée de la Volonté céleste qui aura raison de vous !
Texte et dessin : Omar HADDADOU Mars 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Il faut sauver guignol du Champs de Mars

Après les bouquinistes des quais de Seine, préservés in extremis du désastre par une résistance opiniâtre et des indignations internationales, c'est au tour des activités culturelles, ludiques, séculaires, d'être sommés de disparaître corps et biens par le lobbying olympique. Toute la vie parisienne est priée de céder la place à la surveillance algorithmique.
Julien Sommer, trente-huit, ans anime le guignol du Champ-de-Mars. Il exerce cette activité depuis l'adolescence aux côtés de Luigi Tirelli, marionnettiste pendant soixante ans, disparu en 2018 à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Il doit impérativement fermer son castelet. Son contrat est autoritairement rompu. Sans aucune indemnisation. En tant que gérant de théâtre, il ne peut même pas prétendre au chômage. La tyrannie municipale sévit tous azimuts. Les balançoires, les voitures à pédales, les manèges sont soumis au nettoyage par le vide. Place aux boutiques commercialisant des gadgets olympiques.
Le théâtre du Champ-de-Mars, dédié aux marionnettes gaine, est construit en 1902 dans le style Second Empire. Guignol, créé au début du dix-neuvième siècle par Laurent Mourguet (1769-1844), ouvrier dans une fabrique de soie, un canut, parle lyonnais. Sa truculence retient l'attention. Il porte une jaquette couleur marron et un chapeau de cuir plat. Ses cheveux son coupés en catogan. La natte est réunie sur la nuque par un nœud. Il défend les petites gens. Il dénonce les injustices. Il est accompagné de son épouse Madelon, vêtue tantôt en robe camisole de lainage fleuri, tantôt en tablier avec un fichu blanc sur les épaules. Elle est surnommée Mère-la-grogne. Gnafron, joyeux buveur de Beaujolais est le contradicteur complice. Une vingtaine des pièces de Laurent Mourguet sont recueillies et publiées en 1865 sous le titre de Théâtre lyonnais de Guignol par un magistrat, Jean-Baptiste Onofrio (1814-1892). Ces compositions d'origine s'intitulent Les Couverts volés, le pot de confiture, Les Frères Coq, Le Portrait de l'Oncle, Le Duel, Le Marchand de veaux, Le Dentiste, Le Marchand de picarlats, Les Valets à la porte, Le Déménagement, Le Testament, Le Marchands d'aiguilles, Les Voleurs volés, Tu chanteras, tu ne chanteras pas, L'Enrôlement, La Racine merveilleuse, Le Château mystérieux, Les Conscrits de 1809, Ma Porte d'allée, Les Souterrains du vieux château. Théâtre lyonnais de Guignol, recueil Onofrio, réédition récente Jeanne Laffitte, 1999.
Chaque spectacle de Guignol auquel j'assiste depuis l'enfance est une cure de désintoxication, une purification des pollutions mentales. Le castelet est une boîte magique. Les personnages surgissent et disparaissent par enchantement. Ils sortent du vide. Ils rentrent dans le vide. Ils s'engloutissent dans les entrailles de la terre, insaisissables, insondables, irrécupérables. Ils ne laissent que leur empreinte indocile, transgressive, subversive. Toutes les espiègleries, les bouffonneries, les pitreries, les diableries, les démoneries sont permises au nez et à la barbe des ploutocrates. Guignol a beau être persécuté, censuré, prohibé sous différents régimes, il est immortel. Le Second Empire tente en vain de l'ensevelir. Des plumes alertes, Victor Vuillerme-Dunand (1810-1876), Joanny Durafour (1853-1938), Gaston Baty (1885-1952), Albert Chanay (1874-1942), Pierre Neichthauser (1873-1953), Ernest Neichthauser (1876-1969) le ressuscitent, l'éternisent.
Paris. Vendredi, 8 mars 2024. Un titre saute à mes yeux chez un bouquiniste, Guignol philosophe de F. Vérax, publié à Lons-le-Saunier par l'imprimerie Julien Payet & Co en 1877. Un opus conservateur de trente pages. Je le lis d'une traite. Dialogue entre Guignol et son ami Gnafron. Le procédé contestataire est récupère par la bourgeoisie. Les manipulations de la presse sont toujours d'actualité. Plus un journal est argutieux, licencieux, scandaleux, plus il fait de bonnes affaires. « A peine arrive un fait tant soit peu scabreux, aussitôt le journal de la localité donne un coup de tam-tam. A ce signal, tous les journaux proclament cet acte avec de grosses caisses. Et le fait brodé, commenté, exagéré fait le tour du pays. Il est difficile de ne pas se laisser attraper par les artifices d'une certaine presse. Elle sait si bien jeter de la poudre aux yeux. Elle sait si bien flatter les mauvais instincts qui germent dans les esprits. Le plus grand nombre des lecteurs ne retirent que le bénéfice du corbeau. Impossible de réformer l'opinion publique, égarée, obscurcie par tant de nuages, de mensonges, de sophismes qui s'élèvent de cet abîme qu'on appelle la presse ». Que dire des réseaux sociaux où les fake news façonnent effrontément les jugements ?
Beaucoup de bouquinistes proposent, avant tout, des reproductions de la Tour Eiffel, en affiches, en magnettes, en casquettes, en porte-clefs, en tasses de café. Les amoureux des livres se font rares ; Les boutiques de souvenirs made in China supplantent les enseignes historiques. La Tour Eiffel, ultime survivance de la mythologie parisienne, s'enferme dans une clôture de verre. Militaires de l'opération Sentinelle et vigiles armés aux portiques. Files d'attente interminables. Fouilles des sacs et des corps. Dans La Vie Errante, 1890, Guy Maupassant ouvre déjà son premier chapitre sur ce constat amer : « Je quitte Paris, et même la France, parce que la Tour Eiffel m'ennuie trop. Non seulement on la voit de partout, mais on la trouve partout, faite de toutes les matières, exposée dans toutes les vitrines, cauchemar inévitable. Peu importe la Tour Eiffel. Elle n'est que le phare d'une kermesse internationale. La puissante émotion de l'art est éteinte. S'éveillent des esprits d'un tout autre ordre, inventeurs de machines de toute sorte, des appareils surprenants, des combinaisons stupéfiantes de substances. Les conceptions idéales, les sciences pures, désintéressées, sont désormais interdites. L'imagination paraît de plus en plus excitable par l'envie de spéculation. Le génie d'un Isaac Newton capable d'un bond de la pensée d'aller de la chute d'une pomme à la grande loi régissant le monde, semble né d'un germe plus divin que l'inspiration pragmatique du fabricant américain de sonnettes, de porte-voix, de projecteurs ».
A Tour Eiffel claquemurée, encagée, cadenassée. La crise se banalise, se commercialise, se rentabilise. Les innombrables entreprises de sécurité laminent le service public. La pensée n'est plus un recours pour sortir de l'impasse.
La technocratie verrouille les issues. Les références se dévalorisent. Les repères se volatilisent. La municipalité gère les risques, l'improbable possible, l'invraisemblable admissible, l'absurde. Les décisions s'oxymorisent. La crise covidaire enracine définitivement la peur dans les cerveaux La peur de disparaître sans préavis. Peur de l'inconnaissable, de l'indéterminable, de l'indéchiffrable. Le viralisme ne laisse aucune alternative, aucune perspective. Les survivants se perçoivent comme des miraculés. La peur se met cyniquement, sournoisement en scène, s'orchestre politiquement. Les crédulités désespèrent. Les charlatanismes prospèrent. Les citadins fantomatiques, masqués, étourdis, hallucinés tâtonnent dans le brouillard. La mort, occultée de mille manières, met chacun devant son miroir. Le Champ-de-Mars, phagocyté par le Grand Palais Éphémère, n'est plus une promenade. Les artistes, les poètes, les philosophes, les lecteurs, les rêveurs le désertent. Les monuments inamovibles s'investissent pêle-mêle de commémoratisme, de festivisme, de donquichottisme. Tout et son contraire.
Le Champ-de-Mars n'est plus ce qu'il était. Jusqu'au dix-huitième siècle, le terrain est consacré aux cultures maraichères, avant de devenir un champ de manœuvre dépendant de l'Ecole militaire. Pendant la Révolution française, le parc rebaptisé Champ-de-la-Fédération puis Champ-de-la-Réunion, attire les fêtes populaires. Le massacre du 17 juillet 1991, ordonné par le Maire de Paris Jean Sylvain Bailly, lui-même guillotiné deux ans plus tard, assombrit l'histoire de la plaine paisible. Le 8 juin 1794, 20 prairial an II, Jacques-Louis David célèbre la fête de l'Être suprême. Il plante l'arbre de la liberté, symbole du consensus révolutionnaire. Maximilien de Robespierre préside la cérémonie. La première fête de l'Olympiade de la Révolution s'organise le 22 septembre 1796, avec des courses à pied, des luttes, des compétitions de chevaux, de chars. Le site accueille plusieurs expositions universelles en 1867, 1878, 1889, 1900, 1937. Le jeudi 8 avril 1971, l'artiste peintre marocain meurt, à l'âge de quarante-et-un-ans, dans l'anonymat total, sur un banc du Champ-de-Mars. Il laisse plusieurs dessins prémonitoires représentant une Tour Eiffel renversée. Peut-on encore parler de vie parisienne ?. La cancel culture s'officialise. L'ostracisation se généralise. La mémoire se lessive à coup de marketing ravageur.
Mustapha Saha
Sociologue
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Marx, le communisme et la décroissance
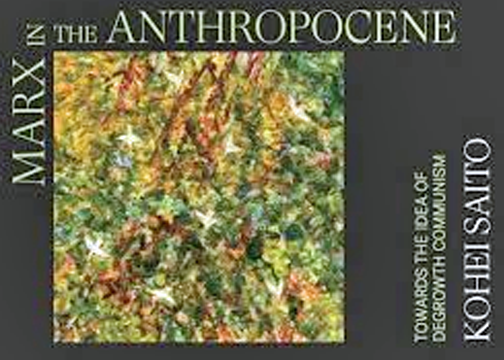
Kohei Saito remet le couvert
Dans « Marx's ecosocialism. An unfinished critique of the political economy », le marxologue japonais montrait comment le Marx de la maturité, conscientisé à l'impasse écologique capitaliste par les travaux de Liebig et de Frass, avait rompu avec le productivisme [1]. Son nouvel ouvrage, « Marx in the Anthropocene. Towards the Idea of Degrowth communism », prolonge la réflexion. [2] Ce livre est remarquable et utile en particulier sur quatre points : la nature de classe, foncièrement destructive, des forces productives capitalistes ; la supériorité sociale et écologique des sociétés (dites) « primitives », sans classes ; le débat sur nature et culture avec Bruno Latour et Jason Moore, notamment ; la grosse erreur, enfin, des « accélérationnistes » qui se réclament de Marx pour nier l'impérieuse nécessité d'une décroissance. Ces quatre points sont d'une importance politique majeure aujourd'hui, non seulement pour les marxistes soucieux d'être à la hauteur du défi écosocial lancé par la crise systémique du capitalisme, mais aussi pour les activistes écologiques. Le livre a les mêmes qualités que le précédent : il est érudit, bien construit, subtil et éclairant dans la présentation de l'évolution intellectuelle de Marx après 1868. Il a malheureusement aussi le même défaut : il présente pour acquis ce qui n'est qu'hypothèse. Une fois encore, Saito force le trait à vouloir trouver chez Marx la parfaite anticipation théorique des combats d'aujourd'hui. [3]
Au commencement était la « faille métabolique"
La première partie de « Marx in the Anthropocene » approfondit l'exploration du concept marxien de « faille métabolique » (« hiatus métabolique » dans la version française du Capital). [4] Saito se place ici dans le sillage de John B. Foster et de Paul Burkett, qui ont montré l'immense importance de cette notion. [5] Saito enrichit le propos en mettant en évidence trois manifestations du phénomène - perturbation des processus naturels, faille spatiale, hiatus entre les temporalités de la nature et du capital - auxquelles correspondent trois stratégies capitalistes d'évitement - les pseudo-solutions technologiques, la délocalisation des catastrophes dans les pays dominés, et le report de leurs conséquences sur les générations futures (p.29 et sq.).
Le chapitre 1 se penche plus particulièrement sur la contribution au débat du marxiste hongrois István Mészáros, que Saito estime décisive dans la réappropriation du concept de métabolisme à la fin du 20e siècle. Le chapitre 2 est focalisé sur la responsabilité d'Engels qui, en éditant les Livres II et III du Capital, aurait diffusé une définition du « hiatus métabolique » tronquée, sensiblement différente de celle de Marx. Pour Saito, ce glissement, loin d'être fortuit, traduirait une divergence entre la vision écologique d'Engels - limitée à la crainte des « revanches de la nature » - et celle de Marx - centrée sur la nécessaire « gestion rationnelle du métabolisme » par la réduction du temps de travail. Le chapitre 3, tout en rappelant les ambiguïtés de György Lukács, rend hommage à sa vision du développement historique du métabolisme humain-nature à la fois comme continuité et comme rupture. Pour Saito, cette dialectique, inspirée de Hegel (« identité entre l'identité et la non-identité ») est indispensable pour se différencier à la fois du dualisme cartésien - qui exagère la discontinuité entre nature et société - et du constructivisme social - qui exagère la continuité (l'identité) entre ces deux pôles et ne peut, du coup, « révéler le caractère unique de la manière capitaliste d'organiser le métabolisme humain avec l'environnement » (p. 91).
Dualisme, constructivisme et dialectique
La deuxième partie de l'ouvrage jette un regard très (trop ?) critique sur d'autres écologies d'inspiration marxiste. Saito se démarque de David Harvey dont il épingle la « réaction négative surprenante face au tournant écologique dans le marxisme ». De fait, « Marx in the Anthropocene » rapporte quelques citations « surprenantes » du géographe étasunien : Harvey semble convaincu de « la capacité du capital à transformer toute limite naturelle en barrière surmontable » ; il confesse que « l'invocation des limites et de la rareté écologique (…) (le) rend aussi nerveux politiquement que soupçonneux théoriquement » ; « les politiques socialistes basées sur l'idée qu'une catastrophe environnementale est imminente » seraient pour lui « un signe de faiblesse ». Géographe comme Harvey, Neil Smith « montrerait la même hésitation face à l'environnementalisme », qu'il qualifie de « apocalypsisme ». Smith est connu pour sa théorie de « la production sociale de nature ». Saito la récuse en estimant qu'elle incite à nier l'existence de la nature comme entité autonome, indépendante des humains : c'est ce qu'il déduit de l'affirmation de Smith que « la nature n'est rien si elle n'est pas sociale » (p. 111). D'une manière générale, Saito traque les conceptions constructivistes en posant que « la nature est une présupposition objective de la production ». Il ne fait aucun doute que cette vision était aussi celle de Marx. Le fait incontestable que l'humanité fait partie de la nature ne signifie ni que tout ce qu'elle fait serait dicté par sa « nature », ni que tout ce que la nature fait serait construit par « la société ».
Destruction écologique : les « actants » ou le profit ?
Dans le cadre de cette polémique, l'auteur consacre quelques pages très fortes à Jason Moore. Il admet que la notion de Capitalocène « marque une avancée par rapport au concept de ‘production sociale de nature' », car elle met l'accent sur les interactions humanité/environnement. Il reproche cependant à Moore d'épouser que les humains et les non-humains seraient des « actants » travaillant en réseau à produire un ensemble intriqué - « hybride » comme dit Bruno Latour. C'est un point important. En effet, Moore estime que distinguer une « faille métabolique » au sein de l'ensemble-réseau est un contresens, le produit d'une vision dualiste. Or, la notion de « métabolisme » désigne la manière dont les organes différents d'un même organisme contribuent spécifiquement au fonctionnement du tout. Elle est donc aux antipodes du dualisme (comme du monisme d'ailleurs) et on en revient à la formule de Hegel : il y a « identité de l'identité et de la non-identité ». « Marx in the Anthropocene » s'attaque aussi aux thèses de Moore par un autre biais - celui du travail. Pour Moore, en effet, le capitalisme est mû par l'obsession de la « Cheap Nature » (nature bon marché) qui englobe selon lui la force de travail, l'énergie, les biens alimentaires et les matières premières. Moore se réclame de Marx, mais il est clair que sa « Cheap nature » escamote le rôle exclusif du travail abstrait dans la création de (sur)valeur, ainsi que le rôle clé de la course à la survaleur dans la destruction écologique. Or, la valeur n'est pas un « actant hybride » parmi d'autres. Comme dit Saito, elle est « purement sociale » et c'est par son truchement que le capitalisme « domine les processus métaboliques de la nature » (pp. 121-122).
Il est clair en effet que c'est bien la course au profit qui creuse la faille métabolique, notamment en exigeant toujours plus d'énergie, de force de travail, de produits agricoles et de matières premières « bon marché ». De toutes les ressources naturelles que le capital transforme en marchandises, la force de travail « anthropique » est évidemment la seule capable de créer un indice aussi purement « anthropique » que la valeur abstraite. Comme le dit Saito : c'est « précisément parce que la nature existe indépendamment de et préalablement à toutes les catégories sociales, et continue à maintenir sa non-identité avec la logique de la valeur, (que) la maximisation du profit produit une série de disharmonies au sein du métabolisme naturel ». Par conséquent, la « faille n'est pas une métaphore, comme Moore le prétend. La faille existe bel et bien entre le métabolisme social des marchandises ainsi que de la monnaie, et le métabolisme universel de la nature » (ibid). « Ce n'est pas par dualisme cartésien que Marx a décrit d'une manière dualiste la faille entre le métabolisme social et le métabolisme naturel - de même que la faille entre le travail productif et le travail improductif. Il l'a fait consciemment, parce que les relations uniquement sociales du capitalisme exercent un pouvoir extranaturel (alien power) dans la réalité ; une analyse critique de cette puissance sociale requiert inévitablement de séparer le social et le naturel en tant que domaines d'investigation indépendants et d'analyser ensuite leur emboîtement. » (p. 123) Imparable. Il ne fait aucun doute, encore une fois, que cette vision de « l'emboîtement » du social dans l'environnemental était celle de Marx.
Accélérationnisme vs. anti-productivisme
Le chapitre 5 polémique avec une autre variété de marxistes : les « accélérationnistes de gauche ». Selon ces auteurs, les défis écologiques ne peuvent être relevés qu'en démultipliant le développement technologique, l'automation, etc. Cette stratégie, pour eux, est conforme au projet marxien : il faut abattre les entraves capitalistes à la croissance des forces productives pour possibiliser une société de l'abondance. Cette partie de l'ouvrage est particulièrement intéressante car elle éclaire la rupture avec le productivisme et le prométhéisme des années de jeunesse. La rupture n'est probablement pas aussi nette que Saito le prétend [6] , mais il y a incontestablement un tournant. Dans Le Manifeste communiste, Marx et Engels expliquent que le prolétariat doit « prendre le pouvoir pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, centraliser tous les moyens de production aux mains de l'Etat et augmenter au plus vite la quantité des forces productives ». [7] Il est frappant que la perspective de ce texte est résolument étatiste et que les forces productives y sont considérées comme neutres socialement ; elles forment un ensemble de choses qui doit changer de mains (être « arraché petit à petit à la bourgeoisie ») pour grandir quantitativement.
Les accélérationistes sont-ils pour autant fondés à se réclamer de Marx ? Non, car Marx a abandonné la conception exposée dans le Manifeste. Kohei Saito attire l'attention sur le fait que son oeuvre majeure, Le Capital, ne traite plus des « forces productives » en général (anhistoriques), mais de forces productives historiquement déterminées - les forces productives capitalistes. Le long chapitre XV du Livre 1 (« Machinisme et grande industrie ») décortique les effets destructeurs de ces forces, à la fois sur le plan social et sur le plan environnemental. On pourrait ajouter ceci : il n'est pas fortuit que ce soit précisément ce chapitre qui s'achève sur la phrase suivante, digne d'un manifeste écosocialiste moderne : « La production capitaliste ne développe la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur ». [8] Il n'est plus question ici de neutralité des technologies. Le capital n'est plus saisi comme une chose mais comme un rapport social d'exploitation et de destruction, qui doit être détruit (« négation de la négation »). Notons que Marx, après la Commune de Paris, précisera que rompre avec le productivisme nécessite aussi de rompre avec l'étatisme.
Il est étonnant que Kohei Saito ne rappelle pas la phrase du Manifeste citée ci-dessus, où le prolétariat est exhorté à prendre le pouvoir pour « augmenter au plus vite la quantité des forces productives ». Cela aurait donné plus de relief encore à sa mise en évidence du changement ultérieur. Mais peu importe : le fait est que le tournant est réel et débouche au Livre III du Capital sur une magnifique perspective de révolution en permanence, résolument anti-productiviste et anti-technocratique : « La seule liberté possible est que l'homme social, les producteurs associés règlent rationnellement leur métabolisme avec la nature et qu'ils accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force, dans les conditions les plus dignes de la nature humaine. La condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail. » [9] L'évolution est nette. Le paradigme de l'émancipation humaine a changé : il ne consiste plus en la croissance des forces productives mais en la gestion rationnelle des échanges avec la nature et entre les humains.
Subsomption formelle et subsomption réelle du travail
Les pages les plus riches de « Marx in the Anhropocene », à mon avis, sont celles où Saito montre que le nouveau paradigme marxien de l'émancipation résulte d'un ample effort de critique des formes successives que le capital a imposées au travail. Bien qu'elle fasse partie des travaux préparatoires au Capital, cette critique ne sera publiée que plus tard (« Manuscrits économiques de 1861-1863 »). Sa clé de voûte est l'importante notion de subsomption du travail au capital. Insistons-y en passant : la subsomption est plus que de la soumission : subsumer implique intégrer ce qui est soumis à ce qui soumet. Le capital subsume le salariat puisqu'il intègre la force de travail comme capital variable. Mais, pour Marx, il y a subsomption et subsomption : le passage de la manufacture au machinisme et à la grande industrie implique le passage de la « subsomption formelle » à la « subsomption réelle ». La première signifie simplement que le capital prend le contrôle du procès de travail qui existait auparavant, sans apporter de changement ni à son organisation ni à son caractère technologique. La seconde s'installe à partir du moment où le capital révolutionne complètement et sans arrêt le procès de production - non seulement sur le plan technologique mais aussi sur le plan de la coopération - c'est-à-dire des relations productives entre travailleurs.euses et entre travailleurs.euses et capitalistes. Se crée ainsi un mode de production spécifique, sans précédent, entièrement adapté aux impératifs de l'accumulation du capital. Un mode dans lequel, contrairement au précédent, « le commandement par le capitaliste devient indispensable à la réalisation du procès de travail lui-même » (p. 148).
Saito n'est pas le premier à pointer le caractère de classe des technologies. Daniel Bensaïd soulignait la nécessité que « les forces productives elles-mêmes soient soumises à un examen critique ». [10] Michaël Löwy défend qu'il ne suffit pas de détruire l'appareil d'Etat bourgeois - l'appareil productif capitaliste aussi doit être démantelé. [11] Cependant, on saura gré à Saito de coller au plus près du texte de Marx pour résumer les implications en cascade de la subsomption réelle du travail : celle-ci « augmente considérablement la dépendance des travailleurs vis-à-vis du capital » ; « les conditions objectives pour que les travailleurs réalisent leurs capacités leur apparaissent de plus en plus comme une puissance étrangère, indépendante » ; « du fait que le capital en tant que travail objectivé - moyens de production - emploie du travail vivant, la relation du sujet et de l'objet est inversée dans le processus de travail » ; « le travail étant incarné dans le capital, le rôle du travailleur est réduit à celui de simple porteur de la chose réifiée -les moyens de préserver et de valoriser le capital à côté des machines - tandis que la chose réifiée acquiert l'apparence de la subjectivité, puissance étrangère qui contrôle le comportement et la volonté de la personne » ; « l'augmentation des forces productives étant possible seulement à l'initiative du capital et sous sa responsabilité, les nouvelles forces productives du travail social n'apparaissent pas comme les forces productives des travailleurs eux-mêmes mais comme les forces productives du capital » ; « le travail vivant devient (ainsi) un pouvoir du capital, tout développement des forces productives du travail est un développement des forces productives du capital ». Deux conclusions non productivistes et non technocratiques s'imposent alors avec force : 1°) « le développement des forces productives sous le capitalisme ne fait qu'augmenter le pouvoir extérieur du capital en dépouillant les travailleurs de leurs compétences subjectives, de leur savoir et de leur vision, il n'ouvre donc pas automatiquement la possibilité d'un avenir radieux » ; 2°) le concept marxien de forces productives est plus large que celui de forces productives capitalistes - il inclut des capacités humaines telles que les compétences, l'autonomie, la liberté et l'indépendance et est donc à la fois quantitatif et qualitatif » (p. 149-150).
Quel matérialisme historique ? Quelle abondance ?
Ces développements amènent Kohei Saito à réinterroger le matérialisme historique. On sait que la Préface à la critique de l'économie politique contient le seul résumé que Marx ait fait de sa théorie. On y lit ceci : « A un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une période de révolution sociale ». [12] Il semble clair que Marx ne pouvait plus adhérer littéralement à cette formulation - et encore moins à celle du Manifeste sur l'augmentation quantitative des forces productives - dès lors que son analyse l'amenait à conclure que le développement des dites forces renforce l'emprise du capital et mutile l'agentivité de celleux qu'il exploite. Comme le dit Saito : « On ne peut plus assumer qu'une révolution socialiste pourrait simplement remplacer les relations de production par d'autres une fois atteint un certain niveau de forces productives. Puisque les forces productives du capital engendrées par la subsomption réelle sont matérialisées et cristallisées dans le mode capitaliste de production, elles disparaissent en même temps que le mode de production ». Transférer la propriété du capital à l'Etat ne changerait pas le problème : les forces productives restant inchangées, 1°) les tâches de conception devraient être assurées par une « classe bureaucratique », 2°) la destruction écologique continuerait. L'auteur en conclut que « la subsumption réelle pose un problème difficile de ‘gestion socialiste libre'. La vision traditionnelle du matérialisme historique, synthétisée dans la Préface, n'indique aucune piste de solution » et « Marx n'a pas été à même d'apporter une réponse définitive à ces questions, même dans Le Capital, de sorte que nous devons aller au-delà » (pp. 157-158).
« Aller au-delà » est ce qui est proposé dans la troisième partie de son ouvrage, et c'est elle qui soulève le plus de polémiques. La question de départ est simple : si l'émancipation ne passe pas par la libre croissance des forces productives, donc par ce que Daniel Bensaid appelait le « joker de l'abondance » [13] par où pourrait-elle passer ? Par « la réduction d'échelle et le ralentissement de la production », répond Saito (p. 166). Pour l'auteur, en substance, l'abondance doit s'entendre non comme pléthore de biens matériels privés - sur le modèle à la fois consumériste et excluant de l'accumulation de marchandises accessibles uniquement à la seule demande solvable - mais comme profusion de richesses sociales et naturelles communes. Sans cela, « l'option restante devient le contrôle bureaucratique de la production sociale, qui a causé l'échec de la voie soviétique » (p. 166).
Décroissance, économie stationnaire et transition
« Marx in the Anthropocene » entend donc plaider pour un « communisme de la décroissance », profondément égalitaire, axé sur la satisfaction des besoins réels. Selon Saito, ce communisme était celui des communautés dites « archaïques », dont certains traits ont subsisté longtemps sous des formes plus ou moins dégradées dans des systèmes agraires basés sur la propriété collective de la terre, en Russie notamment. Pour le Marx de la maturité, il s'agit de beaucoup plus que des survivances d'un passé révolu : ces communautés indiquent qu'après avoir « exproprié les expropriateurs », la société, pour abolir toute domination, devra progresser vers une forme plus élevée de la communauté « archaïque ». J'adhère pleinement à cette perspective, mais avec un bémol : Saito force gravement le trait en prétendant que « 14 années d'étude sérieuse des sciences naturelles et des sociétés précapitalistes » auraient amené Marx en 1881 à avancer « son idée du communisme décroissant » (p. 242) Cette affirmation est excessive. Prise littéralement, elle ne repose sur aucun document connu. Du coup, pour qu'elle ait malgré tout une once de plausibilité (et encore : à condition de la formuler comme une hypothèse, pas comme une certitude !) Saito est obligé de recourir à une succession d'amalgames : faire comme si la critique radicale de l'accumulation capitaliste par Marx était la même chose que l'économie stationnaire, comme si les communautés « archaïques » étaient stationnaires, et comme si l'économie stationnaire était la même chose que la décroissance. Cela fait beaucoup de « si », néglige des différences essentielles… et ne nous fait pas avancer dans le débat sur les enjeux de la décroissance au sens où elle se discute aujourd'hui entre anticapitalistes, c'est-à-dire au sens littéral de la réduction de la production imposée objectivement par la contrainte climatique. Voyons cela de plus près.
Laissons le PIB de côté et considérons uniquement la production matérielle : une société post-capitaliste dans un pays très pauvre romprait avec la croissance capitaliste mais devrait accroître la production pendant une certaine période pour répondre à l'énorme masse de besoins réels insatisfaits ; une économie stationnaire utiliserait chaque année la même quantité de ressources naturelles pour produire la même quantité de valeurs d'usage avec les mêmes forces productives ; quant à une économie décroissante, elle réduirait les prélèvements et la production. En mettant un signe d'égalité entre ces formes, Kohei Saito entretient une confusion regrettable. « Il devrait maintenant être clair, écrit-il, que le socialisme promeut une transition sociale vers une économie de décroissance » (p.242). C'est fort mal formulé, car la décroissance n'est pas un projet de société, juste une contrainte qui pèse sur la transition. Une « économie de décroissance », en tant que telle, cela ne veut rien dire. Certaines productions doivent croître et d'autres décroître au sein d‘une enveloppe globale décroissante. Pour coller au diagnostic scientifique sur le basculement climatique, il faut dire à peu près ceci : planifier démocratiquement une décroissance juste est le seul moyen de transiter rationnellement vers l'écosocialisme. En effet, étant donné qu'un nouveau système énergétique 100% renouvelables doit forcément être construit avec l'énergie du système actuel (qui est fossile à 80%, donc source de CO2), il n'y a en gros que deux stratégies possibles pour supprimer les émissions : soit on réduit radicalement la consommation finale d'énergie (ce qui implique de produire et transporter globalement moins) en prenant des mesures anticapitalistes fortes (contre les 10%, et surtout le 1% le plus riche) ; soit on mise sur la compensation carbone et sur le déploiement massif à l'avenir d'hypothétiques technologies de capture-séquestration du carbone, de capture-utilisation ou de géoingénierie, c'est-à-dire sur des solutions d'apprentis-sorciers entraînant encore plus de dépossessions, d'inégalités sociales et de destructions écologiques. Nous proposons l'expression « décroissance juste » comme axe stratégique des marxistes antiproductivistes d'aujourd'hui. Faire de la décroissance un synonyme de l'économie stationnaire n'est pas une option car cela équivaut à baisser le volume de l'alarme incendie.
La commune rurale russe, la révolution et l'écologie
La perspective d'une décroissance juste doit beaucoup à l'énorme travail pionnier de Marx, mais il n'y a pas de sens à affirmer qu'il en est le concepteur, car Marx n'a jamais plaidé explicitement pour une diminution nette de la production. Pour en faire le père du « communisme décroissant », Saito se base quasi exclusivement sur un texte célèbre et d'une importance exceptionnelle : la lettre à Vera Zasoulitch. [14] En 1881, la populiste russe avait demandé à Marx, par courrier, son avis sur la possibilité, en Russie, de s'appuyer sur la commune paysanne pour construire le socialisme directement - sans passer par le capitalisme. La traduction russe du Capital avait déclenché un débat sur cette question parmi les opposants au tsarisme. Marx rédigea trois brouillons de réponse. Ils attestent sa rupture profonde avec la vision linéaire du développement historique, donc aussi avec l'idée que les pays capitalistes les plus avancés seraient les plus proches du socialisme. A ce sujet, la dernière phrase est claire comme de l'eau de roche : « Si la révolution se fait en temps opportun, si elle concentre toutes ses forces pour assurer l'essor libre de la commune rurale, celle-ci se développera bientôt comme un élément régénérateur de la société russe et comme élément de supériorité sur les pays asservis par le régime capitaliste ».
Pour Saito, ce texte signifie que la dégradation capitaliste de l'environnement avait conduit Marx, après 1868, à « abandonner son schéma de matérialisme historique antérieur. Ce ne fut pas une tâche aisée pour lui, dit-il. Sa vision du monde était en crise. En ce sens, (ses) recherches intensives au cours de ses dernières années (sur les sciences naturelles et les sociétés précapitalistes, D.T.) étaient une tentative désespérée de reconsidérer et de reformuler sa conception matérialiste de l'histoire à partir d'une perspective entièrement nouvelle, découlant d'une conception radicalement nouvelle de la société alternative » (p. 173). « Quatorze années de recherches » avaient amené Marx « à conclure que la soutenabilité et l'égalité basées sur une économie stationnaire sont la source de la capacité (power) de résistance au capitalisme ». Il aurait donc saisi « l'opportunité de formuler une nouvelle forme de régulation rationnelle du métabolisme humain avec la nature en Europe occidentale et aux Etats-Unis » : « l'économie stationnaire et circulaire sans croissance économique, qu'il avait rejetée auparavant comme stabilité régressive des sociétés primitives sans histoire » (pp. 206-207).
Que penser de cette reconstruction du cheminement de la pensée marxienne à la sauce écolo ? Le narratif a beaucoup pour plaire dans certains milieux, c'est évident. Mais pourquoi Marx a-t-il attendu 1881 pour s'exprimer sur ce point clé ? Pourquoi l'a-t-il fait seulement à la faveur d'une lettre ? Pourquoi cette lettre a-t-elle demandé trois brouillons successifs ? Si vraiment Marx avait commencé à « réviser son schéma théorique en 1860 par suite de la dégradation écologique » (p.204), et si vraiment le concept de faille métabolique avait servi de « médiation » dans ses efforts de rupture avec l'eurocentrisme et le productivisme (p. 200), comment expliquer que la supériorité écologique de la commune rurale ne soit pas évoquée une seule fois dans la réponse à Zasoulitch ? Last but not least : si on peut ne pas exclure que la dernière phrase de cette réponse projette la vision d'une économie post-capitaliste stationnaire pour l'Europe occidentale et les Etats-Unis, ce n'est pas le cas pour la Russie ; Marx insiste fortement sur le fait que c'est seulement en bénéficiant du niveau de développement des pays capitalistes développés que le socialisme en Russie pourra « assurer le libre essor de la commune rurale ». Au final, l'intervention de Marx dans le débat russe semble découler bien plus de son admiration pour la supériorité des rapports sociaux dans les sociétés « archaïques » [15] et de son engagement militant pour l'internationalisation de la révolution que de la centralité de la crise écologique et de l'idée du « communisme décroissant ».
« Offrir quelque chose de positif »
L'affirmation catégorique que Marx aurait inventé ce « communisme décroissant » pour réparer la « faille métabolique » est à ce point excessive qu'on se demande pourquoi Kohei Saito la formule en conclusion d'un ouvrage qui comporte tant d'excellentes choses. La réponse est donnée dans les premières pages du chapitre 6. Face à l'urgence écologique, l'auteur pose la nécessité d'une réponse anticapitaliste, juge que les interprétations productivistes du marxisme sont « intenables », constate que le matérialisme historique est « impopulaire aujourd'hui » parmi les environnementalistes, et estime que c'est dommage (a pity) car ceux-ci ont « un intérêt commun à critiquer l'insatiable désir d'accumulation du capital, même si c'est à partir de points de vue différents » (p. 172). Pour Saito, les travaux qui montrent que Marx s'est détourné des conceptions linéaires du progrès historique, ou s'est intéressé à l'écologie, « ne suffisent pas à démontrer pourquoi des non-marxistes, aujourd'hui, doivent encore prêter attention à l'intérêt de Marx pour l'écologie. Il faut « prendre en compte à la fois les problèmes de l'eurocentrisme et du productivisme pour qu'une interprétation complètement nouvelle du Marx de la maturité devienne convaincante » (p. 199). « Les chercheurs doivent offrir ici quelque chose de positif », « élaborer sur sa vision positive de la société post-capitaliste » (p. 173). Est-ce donc pour donner de façon convaincante cette interprétation « complètement nouvelle » que Saito décrit un Marx fondant successivement et à quelques années de distance « l'écosocialisme » puis le « communisme de la décroissance » ? Il me semble plus proche de la vérité, et par conséquent plus convaincant, de considérer que Marx n'était ni écosocialiste ni décroissant au sens contemporain de ces termes. , Cela n'enlève rien au fait que sa critique pénétrante du productivisme capitaliste et son concept de « hiatus métabolique » sont décisifs pour saisir l'urgente nécessité actuelle d'une « décroissance juste ».
Vouloir à toute force faire entrer la décroissance dans la pensée de Marx est anachronique. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. Certes, on ne peut pas défendre la décroissance juste et maintenir en parallèle la version productiviste quantitativiste du matérialisme historique. Par contre, la décroissance juste s'intègre sans difficulté à un matérialisme historique qui considère les forces productives dans leurs dimensions quantitatives et qualitatives. Quoiqu'il en soit, nous n'avons pas besoin de la caution de Marx, ni pour admettre la nécessité d'une décroissance juste, ni plus généralement pour élargir et approfondir sa « critique inachevée de l'économie politique ».
Le problème de l'apologie
On peut se demander l'utilité d'une critique des exagérations de Saito. On peut dire : l'essentiel est que « (ce) livre fournit une alimentation utile aux socialistes et aux activistes environnementaux, indépendamment des avis (ou de l'intérêt même d'avoir un avis) sur la question de savoir si Marx était vraiment un communiste décroissant ou pas » [16]. C'est l'essentiel, en effet, et il faut le répéter : « Marx in the Anthropocene » est un ouvrage excellent, notamment parce que ses développement sur les quatre points mentionnés en introduction de cet article sont d'une actualité et d'une importance majeure. Pour autant, le débat sur ce que Marx a dit ou pas n'est pas à sous-estimer car il porte sur la méthodologie à pratiquer dans l'élaboration des outils intellectuels nécessaires à la lutte écosocialiste. Or, cette question-là concerne aussi les activistes non-marxistes.
La méthode de Kohei Saito présente un défaut : elle est apologétique. Ce trait était déjà perceptible dans « Marx's ecosocialism » : alors que le sous-titre de l'ouvrage pointait la « critique inachevée de l'économie politique », l'auteur consacrait paradoxalement tout un chapitre à faire comme si Marx, après Le Capital, avait développé un projet écosocialiste complet. « Marx in the Anthropocene » suit le même chemin, mais de façon encore plus nette. Pris ensemble, les deux ouvrages donnent l'impression que Marx, dans les années 70, aurait fini par considérer la perturbation du métabolisme humanité-nature comme la contradiction centrale du capitalisme, qu'il en aurait d'abord déduit un projet de croissance écosocialiste des forces productives, puis qu'il aurait abandonné celui-ci vers 1880-81 pour tracer une nouvelle voie : le « communisme décroissant ». J'ai tenté de montré que ce narratif est fort contestable.
Un des problèmes de l'apologie est de surestimer fortement l'importance des textes. Par exemple, Saito donne une importance disproportionnée à la modification par Engels du passage du Capital, Livre III, où Marx parle de la « faille métabolique ». La domination des interprétations productivistes du matérialisme historique au cours du 20e siècle ne s'explique pas avant tout par cette modification : elle découle principalement du réformisme des grandes organisations et de la subsomption du prolétariat au capital. Lutter contre cette situation, articuler les résistances sociales pour mettre l'idéologie du progrès en crise au sein même du monde du travail est aujourd'hui la tâche stratégique majeure des écosocialistes. Les réponses sont à chercher dans les luttes et dans l'analyse des luttes beaucoup plus que dans les Notebooks de Marx.
Plus fondamentalement, l'apologie tend à flirter avec le dogmatisme. « Marx l'a dit » devient trop facilement le mantra qui empêche de voir et de penser en marxistes au sujet de ce que Marx n'a pas dit. Car il n'a évidemment pas tout dit. S'il est une leçon méthodologique à tirer de son oeuvre monumentale, c'est que la critique est fertile et que le dogme est stérile. La capacité de l'écosocialisme de relever les défis formidables de la catastrophe écologiques capitaliste dépendra non seulement de sa fidélité mais aussi de sa créativité et de sa capacité à rompre, y compris avec ses propres idées antérieures comme Marx le fit quand c'était nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de polir soigneusement l'écologie de Marx mais aussi et surtout de la développer et de la radicaliser.`
Daniel Tanuro
Le 10 mars 2024
(à paraître dans « Actuel Marx »)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] Marx's ecosocialism. An unfinished critique of the political economy. Trad. Française « La nature contre le capital. L'écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital », Syllepse, 2021
[2] Marx in the Anthropocene. Towards the Idea of Degrowth Communism. Cambridge University Press, 2022.
[3] Voir mon article « Marx était-il écosocialiste ? Une réponse à Kohei Saito »,gaucheanticapitaliste.org
[4] Karl Marx, Le Capital, Livre III, Moscou, éditions du Progrès, 1984, Chapitre 47, p. 848
[5] Lire en particulier Paul Burkett, Marx and Nature. A Red and Green Perspective. Palgrave Macmillan, 1999. John Bellamy Foster, Marx's Ecology. Materialism and Nature, Monthly Review Press, 2000
[6] On lit déjà dans L'Idéologie allemande (1845-46) : « il arrive un stade dans le développement où naissent des forces productives et des moyens de circulation [...] qui ne sont plus des forces productives mais des forces destructrices (le machinisme et l'argent) ». Karl Marx et Friedrich Engels, L'Idéologie allemande, Éditions sociales, 1971, p. 68.
[7] Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du Parti communiste, in Oeuvres choisies, ed. De Moscou, tome 1, p.130.
[8] Le Capital, Livre I, Garnier-Flammarion, 1969, p. 363.
[9] Le Capital, Livre III, ed. De Moscou, chapitre 48, p. 855.
[10] Daniel Bensaïd, Introduction critique à ‘l'Introduction au marxisme' d'Ernest Mandel, 2e édition, ed. Formation Lesoil, en ligne sur contretemps.eu
[11] Michael Löwy, Ecosocialisme. L'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste, Mille et une nuits, 2011, p. 39
[12] Marx-Engels, Oeuvres choisies, Tome 1, p.525.
[13] D. Bensaïd, op. cit
[14] Marx et Engels, Oeuvres choisies, op. cit. tome 3, p. 156.
[15] Une opinion partagée par Engels : cf. notamment son admiration pour les Zoulous face aux Anglais, dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat.
[16] Diana O'Dwyer, « Was Marx a Degrowth Communist », https://rupture.ie

Au cœur de l’envoûtement capitaliste : comprendre les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies ont eu quinze ans. Depuis ce 31 octobre 2008 où le mystérieux Satoshi Nakamoto publie le white paper fondateur du Bitcoin (Nakamoto 2008), elles se sont démultipliées. Elles reposent sur une technologie appelée la blockchain, qui est essentiellement un « vaste registre numérique permettant d'enregistrer l'intégralité des transactions[1] pour en conserver l'historique et la traçabilité » (p.9).
Tiré du site de la revue Contretemps.
La nouveauté tient aux modalités de tenue de ce livre de compte : plutôt que de recourir aux « serveurs privés d'une banque commerciale » (p.9), centralisant les informations et garantissant l'intégrité du registre, « ce livre de compte […] est public, c'est-à-dire téléchargeable par tous et accessible en permanence » (p.9). Par ailleurs — et surtout — l'inscription de nouvelles transactions au registre se fait également de façon décentralisée, par le biais d'un mécanisme de consensus dont la version la plus connue est la « preuve de travail » du Bitcoin, renommée par les crypto-critiques « preuve de gaspillage » en raison de son coût écologique (p.92).
Leurs défenseurs présentent la blockchain, comme une promesse de liberté par la décentralisation. Il s'agirait de protéger les individus du Big Government et de la Big Finance, dont la collusion a éclaté aux yeux de tous lorsque le premier a renfloué sans condition ou presque la seconde lors de la crise de 2008, tout en en présentant la facture aux peuples. Leurs détracteurs, à l'inverse, soulignent combien il y a loin entre les idéaux des crypto-enthousiastes et la réalité d'une industrie — a minima — extrêmement concentrée, parasitique et dangereuse pour l'environnement.
Son titre ne laisse pas de place à l'équivoque : No crypto de Nastasia Hadjadji se range dans ce second groupe. En tout au plus cent quatre-vingt pages, il offre un tour d'horizon sans concession de ces formes monétaires plus si nouvelles que cela, qui fascinent (ou ont fasciné) également à gauche (Alizart 2019).
Pour rappeler quelques ordres de grandeurs, on comptabilise – selon les différentes estimations – entre 7000[2] et un peu plus de 20 000 crypto-monnaies[3]. La plupart sont des poussières à côté du Bitcoin, dont la capitalisation, c'est-à-dire le prix actuel multiplié par la quantité de bitcoins créés est de 500 milliards de dollars, soit la moitié de la capitalisation de l'ensemble des 7 000 crypto-monnaies dénombrées par la plateforme Coinmarketcap. Ainsi, les crypto-monnaies véritablement pertinentes sont tout au plus une quarantaine à se partager un marché de 1 000 milliards de dollars, qui, lui-même, est microscopique comparé aux produits dérivés, représentant actuellement 618 000 milliards de dollars[4], soit plus de six fois le PIB mondial[5].
Le point de départ du livre, cette fascination — positive ou négative — qu'elles inspirent, est donc sans commune mesure avec leur poids quantitatif au sein de la finance contemporaine. Il est tentant d'expliquer cet écart par la nature de l'objet : la monnaie est en effet une institution fondatrice de l'ordre marchand, qui engage le pouvoir et la souveraineté et dont la configuration précise est un enjeu de luttes sociales[6]. Les marxistes veulent dépasser la configuration actuelle du système monétaire, les réactionnaires souvent revenir à une « vraie » monnaie, idéalisant un passé mythique où la prévalence de l'étalon-or protégeait l'institution monétaire de toute manipulation[7].
C'est que changer la société, c'est (notamment) changer la monnaie et, de ce point de vue, il n'est pas fortuit que les monnaies sociales, autre type d'alternatives monétaires populaires parmi les partisans de l'économie sociale et solidaire, ont connu la même forte croissance au même moment que les crypto-monnaies. La crise de 2008 a en effet secoué le capitalisme jusque dans ses fondations et ouvert une période propice à toute sorte de remise en cause de l'état des choses (monétaire) existant[8].
Mais toutes les contestations ne se valent pas. Pour l'autrice, la « démocratisation des crypto-monnaies pose des questions éthiques, économiques, écologiques et politiques cruciales » (p.12). C'est à exposer méthodiquement « le péril de nature à la fois économique, écologique et politique » (p.13) qu'elle consacre les six chapitres de son livre, dont elle tire les matériaux d'une vaste enquête journalistique, alimentée par les analyses de la communauté crypto-critique, constituée notamment d'universitaires (Oliver Jutel, Tonantzin Carmona), de journalistes (Ben McKenzie, Jacob Silverman, Amy Castor), d'ingénieurs informatiques (David Gerard, Stephen Diehl, Molly White). On peut noter une relative absence de la recherche en sciences sociales utilisant des méthodes ethnographiques, dont la mobilisation aurait peut-être permis de rééquilibrer la discussion et de nuancer les conclusions. Après avoir passé en revue ces chapitres, trois pistes de discussion sont suggérées.
Du culte à sa politique
Le premier chapitre revient sur la plus fameuse des crypto-monnaies, le Bitcoin. Au sujet de son créateur, Satoshi Nakamoto[9], elle note comment son effacement volontaire en 2010 sanctionne la création de ce qui s'apparente à un véritable culte. Les maximalistes du Bitcoin sont fondamentalement « critiques de l'action des banques centrales » (p.16), présentées comme la source de tous les maux contemporains, de l'inflation à l'accroissement des inégalités. Si l'on peut retrouver également une « critique de l'action des marchés financiers » (p.16), elle se détache sur cet arrière-plan idéologique essentiellement libertarien. Ainsi, la décentralisation et la transparence, étendards des crypto-enthousiastes, sont connotées. Plutôt qu'à l'autogestion de la société, elles « s'articule[nt] à la croyance dans la fonction autorégulatrice du marché » (p.19). Le culte s'organise notamment dans les dédales d'internet, des réseaux sociaux, des forums, où reviennent les mêmes expressions : HODL, pour manifester sa ferme décision de ne pas vendre, de conserver les bitcoins le plus longtemps possible ; DYOR (« Do Your Own Research »), façon élitiste de renvoyer les sceptiques à leur manque de connaissance ; ou encore le rassembleur WAGMI (« We Are Going to Make It »), à travers lequel les maximalistes du bitcoin communient leur commun désir de richesse.
Après la description du culte, les membres de l'Église : les « opportunistes », ces poids lourds de la finance, qui s'avouent eux-mêmes plus « mercenaires » qu'idéologues, attirés par les promesses fabuleuses de gain ; les « défricheurs », souvent des hommes de catégories supérieures qui étaient là au début, ces crypto bros, qu'on retrouve aussi activement en train de faire la promotion de leur passion (et leur richesse) dans LREM ; les « idéologues », qui se considèrent les héritiers de l'école autrichienne, continuateurs de Friedrich von Hayek et d'Ayn Rand ; les « idéalistes », représentant la contrepartie (pour ne pas dire caution) de gauche des précédents, pour lesquels un Bitcoin du peuple est possible, qui permettrait d'éviter que le sauvetage sans condition des banques en 2008 puis le chantage odieux de la Troïka au peuple grec quelques années plus tard ne se reproduisent ; les « révoltés », ces « néoinvestisseurs en crypto » qu'anime le FOMO (« Fear Of Missing Out »), soit la crainte de laisser à d'autres ces fortunes gagnées en une nuit, qui leur permettraient de s'affranchir de leur condition ; les « mystiques », enfin, artisans d'un curieux syncrétisme à l'image de Maren Altman qui a « créée de toutes pièces une activité consistant à délivrer des prédictions astrales relatives au cours des cryptos sur la plateforme TikTok où elle est suivie par 14 millions d'abonnés » (p.35).
Le chapitre 2 est consacré aux origines idéologiques des cryptos. L'autrice retrace une généalogie précise, qui voit les Cypherpunks, héritiers de la contre-culture étatsunienne, se rapprocher progressivement, à partir de la fin des années 1980, des milieux politiques libertariens. Sur la liste mail pirate des Cypherpunk, créée en 1992, se côtoient Julien Assange, plus tard rendu célèbre par les Wikileaks, et Marc Andreessen, fondateur du fonds Andreessen Horowitz (a16z)[10], « grand argentier de la crypto-industrie » (p.48). Leur point commun initial : leur opposition à Big Brother et la nécessité de la protection de la vie privée (cypher signifie coder, chiffrer). Mais ce qu'il pouvait y avoir d'émancipateur dans la contre-culture étatsunienne disparait au contact des croisés libertariens contre la tyrannie des États et de leurs acolytes, les banques centrales : le cyberlibertarianisme naît de cette rencontre asymétrique.
Quelques grands tournants se dessinent. Le discours du cypherpunk Hammil en 1987, au cours d'un grand raout libertarien, la Future Freedom Conference. Le Reform Act de 1996, projet de loi sur les télécommunications porté par Bill Clinton, qui les électrise : « l'internet doit rester ingouvernable » (p.47). Les attentats du 11 septembre et le Patriot Act, qui inquiète le milieu cypherpunk, dont les innovations technologique sont désormais dans la ligne de mire des autorités, qui voient d'un mauvais œil ces premières tentatives de créer des systèmes de paiement autonomes et anonymes, depuis l'« e-cash » de David Lee Chaum en 1990 au « Bit Gold » de Nick Szabo entre 1998 et 2005 en passant par la « b-money » de Wei Dai. L'échec des « monnaies numériques convertibles en or », l'« e-gold », l'« e-bullion » ou « 1mdc » (p.54) à la fin des années 2000, moment où l'on peut dire que l'« utopie cyberlibertarienne a fait long feu », notamment en raison du caractère contradictoire du projet de créer une institution monétaire sans institution et des conceptions a- voire anti-démocratiques qui ont cours dans ce milieu, le condamnant à demeurer marginal (Narayanan 2013a ; 2013b).
Mais surtout, l'acte fondateur : la crise financière de 2008, le bail-out généralisé des responsables de la crise par les États, la crise subséquente des États férocement attaqués par ceux qu'ils avaient sauvés, et les réactions des populations qui refusent de payer la facture. 2013 est l'ouverture d'une nouvelle ère. Le bitcoin, véritable locomotive des cryptos, prend de la valeur, passant de 1 000 en 2013 à 20 000 dollars en 2017. Les cryptos se multiplient et, avec elles, les hacks et les fraudes aussi. Déjà présents au cours de la préhistoire des cryptos, de même que la méfiance suspicieuse des autorités vis-à-vis de systèmes de paiement qui leur échappent et qu'ils sont prompts à accuser de favoriser le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme international, comme le montre bien l'autrice, hacks et fraudes prennent une toute autre ampleur. Les principaux acteurs des cryptos se rapprochent de l'élite financière pour négocier leur soutien à ce qui, sur les marchés financiers, se qualifie de manipulation des cours. « D'un projet alternatif et anti système, les cryptos sont devenus une industrie à part entière qui brasse des milliards de dollars […] L'équation de la décennie à venir s'écrit désormais en ces termes : Big Finance + Big Crypto = <3 » (p.62). Les représentants de la nouvelle crypto-oligarchie vantent leurs bonnes relations avec leurs ennemis théoriquement jurés, politiciens et fonctionnaires des banques centrales, dont ils espèrent une reconnaissance symbolique aux effets économiques conséquents. Le crony capitalism, ce « capitalisme de connivence » honni par les libertariens, est reconduit par ses propres critiques, que leur nouvelle fortune a rendu soudainement pragmatiques.
Le chapitre 3 retrace les turpitudes de ces nouveaux « barons voleurs » que sont ces crypto-oligarques. Mark Karpelès, patron de Mt. Gox, qui détourne les fonds de ses clients ; Ruja Ignatova, la « missing crypto queen » qui arnaque des milliers de petits porteurs en leur faisant miroiter la rentabilité fabuleuse de son OneCoin ; le français Vincent Roppiot, à la tête de RR Crypto, dans le collimateur des autorités. Ces dérives individuelles qui échappent aux régulations trop faibles trouvent leur pendant dans l'absence d'assurance collective permettant de limiter le risque systémique. Ainsi, 2022 est l'année des faillites en cascade, du stablecoin algorithmique UST/LUNA à la Silicon Valley Bank en passant par l'exchange FTX, dont la chute laisse son concurrent, Binance, en situation de quasi-monopole. C'est un vice de fabrication : parce que les cryptos se veulent systèmes monétaires sans institution, « la solidité de la structure ne repose que sur le bon vouloir des acteurs du marchés, certains acceptant de soutenir les entreprises en difficultés de manière à éviter ls conséquences d'une contagion délétère » (p.75). Signe de la fusion entre la Big Finance et la Big Crypto, la chute de ces dominos crypto entraine le rachat en urgence du Crédit Suisse par UBS. Apparues en prétendant protéger les individus du risque systémique qui avait contraint les États à venir au secours des responsables de la crise de 2008, les cryptos finissent par alimenter ce même risque.
Le modèle économique des crypto est d'ailleurs proche des Ponzinomics de la spéculation financière, qui seraient également « le programme par défaut de l'industrie des cryptos » (p.87), où, pour s'enrichir, « il faut trouer le ‘prochain idiot' qui vous achètera vos tokens à un prix plus élevé que celui que vous avez payé » (p.87). L'autrice fait ici référence à la Greater Fool Theory de l'informaticien et crypto-critique David Gerard. Si l'enrichissement en crypto est sans doute de nature essentiellement spéculative, il n'est pas possible de suivre Gerard et l'autrice dans leur opposition entre crypto, d'une part, et actions et obligations d'une entreprise et monnaies de cours légal, de l'autre. Les crypto seraient en effet de la pure « valeur d'échange associée à la croyance des investisseurs », tandis qu'actions, obligations et monnaies officielles auraient une « valeur économique intrinsèque », liées respectivement « aux richesses produites par une entreprise, à son patrimoine et à son capital » et à la « richesse produite par un pays, une zone économique ainsi que sa capacité d'influence » (p.87).
Cette opposition entre une vraie et une fausse valeur n'a pas de sens du point de vue de la théorie marxiste du capital fictif : les titres financiers qui s'échangent sur les marchés secondaires ne sont pas moins fictif et spéculatif que les cryptos. S'il faut faire une différence entre crypto-finance et finance traditionnelle, ce n'est pas celle que fait l'autrice, qui conclut en soulignant simplement à la « nécessité du durcissement de l'encadrement de l'industrie des cryptoactifs » (p. 90) : les cryptos ont aussi permis un accès simplifié aux plus-values financières, là où celles-ci, dans la finance traditionnelle, même avec la diminution du poids des banques et le renforcement corrélatif des investisseurs institutionnels, reste largement réservées à une élite financière. Bien sûr, ce mouvement est contradictoire, puisqu'il renforce la financiarisation de la vie quotidienne. Mais, à l'image des travaux de Sanchez et Luzzi (2023) sur la diffusion des crypto-monnaies dans le corps social argentin, les usages populaires des crypto-monnaies sont aussi synonymes de renforcement de l'autonomie de l'individu face aux régulations étatiques qui n'impliquent pas mécaniquement plus d'égalité, de liberté ou de justice.
Le chapitre 4 passe en revue les conséquences écologiques des cryptos, montrant comment les besoins de l'industrie rentrent déjà fortement en contradiction avec les besoins sociaux des populations. L'argument est à la fois social, économique et écologique. Dans l'État du Texas, les habitants paient le coût quatre fois des entreprises cryptos qui s'y installent : une première fois par les exonérations d'impôts dont ces dernières bénéficient ; une seconde fois par la hausse du prix de l'électricité que nécessitent les ASICS, ces super-ordinateurs devenus indispensables pour « miner » des cryptos ; une troisième fois par les dédommagements que verse l'État aux entreprises en échange de l'interruption de leur activité en cas de fortes chaleurs, par exemple, qui entraîne une tension importante sur le réseau électrique ; une quatrième fois, enfin, sous forme de coupures actuelles ou potentielles de courant parce que ces entreprises n'interrompent pas nécessairement leurs activités dans ce cas.
Le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies utilisent en effet un mécanisme de consensus appelé « preuve de travail » qui sécurise les transactions en imposant, pour leur validation de façon décentralisée, la résolution d'un problème cryptographique dont la difficulté augmente avec la quantité de bitcoins déjà en circulation : plus l'on se rapproche de la limite des 21 millions maximum de bitcoins minables, plus l'écosystème Bitcoin tend logiquement à se concentrer pour faire face à des investissements en équipements informatiques toujours plus lourds. 5 entreprises contrôlent ainsi 85 % de la puissance de calcul du réseau, loin des promesses de décentralisation égalitaire des débuts. L'absurdité des fermes de minage est patente, leur coût écologique et social flagrant et les quelques tentatives de donner une utilité propre à l'activité de minage n'ont pas prospéré[11]. Il existe bien d'autres mécanismes de consensus, guère en odeur de sainteté auprès des maximalistes du Bitcoin, comme la « preuve d'enjeu » (avec ou sans smart contract, à rebours de ce qu'écrit l'autrice) : un participant aux échanges a d'autant plus de chance d'être sélectionné pour « valider » le bloc des dernières transactions à date qu'il a d'enjeu, c'est-à-dire qu'il possède des token de la crypto-monnaie à preuve d'enjeu en question. La seconde crypto après le Bitcoin, l'Ethereum, a réduit sa consommation d'énergie de près de 100 % (De Vries 2023) après être passé à cet autre mécanisme de consensus.
Cette réduction impressionnante aurait pu amener l'autrice à admettre une zone de pertinence des cryptos à condition qu'elles opèrent cette transition, dénommée The Merge. Mais elle reste sans conséquence pour son son propos, qui conclut en soulignant que « cette industrie non productive et prédatrice ajoute une couche supplémentaire de consommation énergétique à la charge déjà trop importante de notre consommation mondiale » (p.103) et en rappelant cet effet-rebond identifié par les économistes : tout verdissement des équipements ne permet pas de réduire mécaniquement la consommation d'énergie, mais amène surtout à installer plus d'équipements, conformément à la logique du capital.
C'est que la facture des cryptos ne se mesure pas qu'en tonnes équivalent. Elle a des effets politiques inquiétants. D'abord sous la forme d'un crypto-colonialisme favorisant le développement de formes d'inclusion prédatrice (Carmona 2022), objet du chapitre 5. Le Salvador est devenu, sous la houlette de son président entrepreneur de 38 ans Nayib Bukele, le premier pays à faire du bitcoin une de ses monnaies officielles. Le bilan est salé : un système virtuellement inutilisé, de toute façon inefficace et propice à la fraude ; 425 millions de dollar réglés par un Etat déjà exsangue au bénéfice d'un assemblage hétéroclite de conseillers et prestataires en crypto ; et un dispositif idéal pour convertir en toute légalité des sommes en cryptos en dollars étatsuniens tout en vidant au passage les réserves de change limitées de la banque centrale du pays. La RDC, les Îles Fidji ou Porto Rico sont quelques autres de ces « cryptopies ». Les populations y protestent contre ces crypto-colons, pas dupes des promesses de « décolonisation de la monnaie » visant à libérer les pauvres de l'hégémonie du dollar (p.130).
Même lorsque les projets en crypto présentent le visage plus aimable d'innocents projets humanitaires, comme dans les îles du Vanuatu, ils restent « inefficaces bien que coûteux [et] sont en réalité des produits d'appel destinés à nourrir le marketing de la crypto-industrie en la présentant comme un outil d'émancipation pour les populations vulnérables » (p.130)[12]. Une forme de technosolutionnisme (Morozov 2013) est inhérente aux cryptos, dont les partisans vantent les vertus décentralisatrices comme s'il s'agissait d'une vertu en soi. Or, les sciences sociales ont bien montré que la technologie n'est pas neutre et que ses effets dépendent largement des caractéristiques de ses acteurs. A l'image du micro-crédit (Guérin 2015), avec lequel elles peuvent du reste d'articuler sous la forme de micro-crédit en crypto, les cryptos ont un caractère prédateur marqué qui provient des dynamiques à la Ponzi sur lesquelles reposent leur valeur. Ainsi, on vend le « bitcoin comme un outil d'égalisation permettant d'aplanir les inégalités en vertu de sa nature ‘décentralisée' et ‘ouverte' [tout en omettant] sciemment que la régulation des cryptoactifs est trop faible pour protéger efficacement les particuliers et que ce marché dérégulé possède une généalogie réactionnaire qui le situe aux antipodes de la préservation des intérêts des minorités » (p.134).
C'est aux effets présents de cette généalogique que l'autrice consacre son dernier chapitre. L'intérêt de représentants — hommes politiques ou entrepreneurs — d'extrême-droite comme Zemmour, Bannon ou Thiel pour les cryptos s'explique par le caractère fondamentalement réactionnaire de la matrice intellectuelle des cryptos. Comme le remarque à juste titre l'autrice, l'hypothèse implicite d'une des défenses courantes de la blockchain, à savoir qu'elle permet de faire société sans nécessité de confiance, est précisément une vision pessimiste des sociétés humaines, dans lesquelles la défiance serait généralisée et indépassable. Diabolisation des banques centrales et postulat d'une origine intégralement monétaire de l'inflation sont deux autres piliers intellectuelles des cryptos qui les positionnent à droite, voire à l'extrême-droite de l'échiquier politique. Dans ce contexte, la liberté et la décentralisation présentées comme des vertus indiscutables des cryptos ont un contenu tout à fait coloré : la liberté « fait ainsi écho à la capacité à se dérober de à toute forme de supervision de la part d'instances gouvernementales ou supraétatiques » tandis que la « ‘décentralisation'' promue par les promoteurs des cryptoactifs est une expression codée pour un monde où les marchés dérégulés orchestrent la vie collective » (p.152).
Rien à voir avec l'autonomie qui s'expérimente par exemple dans les Zones à Défendre (p.153) : les cryptos radicalisent cette « idéologie californienne » (Barbrook et Cameron 1995), « mariage entre la loi du marché et la pensée hippie » dont les épigones sont nombreux dans la Silicon Valley, et la radicalisent clairement sur la droite. L'autrice conclut sur une tonalité pessimiste en soulignant que l'hiver crypto qui fait suite à la vague de faillites en 2022 est susceptible d'alimenter une « colère qui ne manquera pas de naître des scandales et des pertes financières qui en découlent », colère peu susceptible de susciter « un agir politique ‘de gauche' tourné vers la remise en question des hiérarchies sociales et politiques » (p.144).
Ce livre conclut sur une interrogation. Peut-on penser une « appropriation non capitaliste et non libertarienne de technologies forgées en dehors du berceau de la gauche radicale » (p.161) ? Il n'y répond pas, esquissant seulement une réponse en soulignant que la question de la résistance à la surveillance et la censure est un enjeu crucial pour la politique de l'émancipation. C'est, selon l'autrice, qu'il n'y a pas, en l'état, de véritable réflexion de gauche sur ce qu'il faudrait repenser dans les blockchain pour en supprimer la trace des origines. Sans rapport direct avec cette question pourtant essentielle, le livre conclut sur les enjeux écologiques, dont l'urgence – indéniable – exclut par principe la blockchain des futurs possibles, puisqu'il s'agit de « ralentir, désinvestir et réaffecter » plutôt que d'« innover, accélérer ou spéculer » (p.166). Ce dernier mouvement interroge, dans la mesure où l'autrice avait souligné l'existence de blockchains à très faible consommation d'énergie, dès lors que les mécanismes de consensus ne sont pas des preuves de travail.
Au total, cet ouvrage offre un panorama intéressant des crypto-monnaies. Mais sa conclusion, générale, pose plus de questions qu'elle n'offre de réponses. On a parfois le sentiment d'une fatalité de l'origine qui surdétermine la nature des crypto-monnaies. Or, les usages sont autrement plus divers que ne le suggère le livre. Une façon de commencer à apporter des éléments de réponses à l'interrogation, cruciale, sur des usages « non capitalistes et non libertarienne » pourrait être de repartir non pas des travaux de la seule communauté crypto-critique, très présente dans ce livre, mais de ceux des chercheurs et chercheuses en sciences sociales qui s'attachent à décrire la diversité et la complexité d'un objet qu'on ne saurait réduire à une matrice indépassable. Ainsi, comment penser la possibilité, aux côtés des crypto-monnaies « libertariennes », de crypto-monnaies sociales (Tichit, Lafourcade, et Mazenod. 2017), à l'image de la MonedaPAR étudiée par Raphaël Porcherot (2023) ? Comment comprendre la coexistence de maximalistes du Bitcoin et d'individus désireux de préserver la valeur de leurs avoirs monétaires dans un pays où l'inflation est structurelle comme l'Argentine ? L'autrice a sans doute raison de souligner le manque de réflexion sur de potentiels usages non capitalistes des crypto-monnaies ; néanmoins et a minima, des usages non libertariens existent bel et bien déjà et sont absents du livre, qui s'attache plutôt à montrer les errances des maximalistes des cryptos.
Ainsi, la fin de non-recevoir opposée aux crypto peut être à notre sens triplement nuancés. D'abord, parce que, comme nous l'avons rappelé, la valeur des cryptos n'est pas d'une autre nature que le reste des « valeurs » d'une économie capitaliste, au sens où toutes sont tout autant fictives et fétichistes. Ensuite, parce qu'il existe bien des usages monétaires des cryptos, de sorte que les réduire à un simple actif financier hautement risqué revient à reprendre sans distance critique le discours des autorités monétaires, qui n'ont aucun intérêt à voir reconnaître la qualité de monnaie à des instruments sur lesquels elles n'ont pas de contrôle. Enfin, parce qu'au-delà de ces usages monétaires potentiellement non libertariens, des usages non monétaires de la blockchain, sont possibles. Notre thèse, que nous n'avons pas la place de développer mais que nous développons dans un autre article en cours d'écriture, est que c'est notamment de ces usages non monétaires de la blockchain qu'il faut repartir pour avancer en direction d'une « appropriation non capitaliste et non libertarienne » de cette technologie. Les technologies ne sont pas neutres, mais elles ne sont pas non plus figées.
*
Illustration : Wikimedia Commons.
Références
Alary, Pierre, Jérôme Blanc, Ludovic Desmedt, and Bruno Théret (eds.) 2016, Théories françaises de la monnaie : une anthologie, Presses Universitaires de France.
Alizart, Mark 2019, Cryptocommunisme, Presses Universitaires de France.
Barbrook, Richard and Andy Cameron 1995, The Californian Ideology, Mute.
Blanc, Jérôme 2018, Les monnaies alternatives, Paris : La Découverte.
Carmona, Tonantzin 2022, ‘Debunking the narratives about cryptocurrency and financial inclusion', Brookings Metro.
Commandré, Ysé, Catherine Macombe, and Sophie Mignon 2021, ‘Implications for Agricultural Producers of Using Blockchain for Food Transparency, Study of 4 Food Chains by Cumulative Approach', Sustainability 13, 17 : 1–22.
De Vries, Alex 2023, ‘Cryptocurrencies on the road to sustainability : Ethereum paving the way for Bitcoin', Patterns 4, 1 : 1–5.
Dumas, Jean-Guillaume, Pascal Lafourcade, Ariane Tichit, and Sébastien Varrette 2022, Les blockchains en 50 questions : Comprendre le fonctionnement de cette technologie, Dunod.
Guérin, Isabelle 2015, La microfinance et ses dérives : émanciper, discipliner ou exploiter, Paris : Demopolis.
Nakamoto, Satoshi 2008, ‘Bitcoin : A peer-to-peer electronic cash system', Decentralized business review.
Narayanan, Arvind 2013, ‘What happened to the crypto dream ?, part 2', IEEE Security & Privacy 11, 3 : 68–71.
2013, ‘What happened to the crypto dream ?, part 1', IEEE security & privacy 11, 2 : 75–76.
Orzi, Ricardo, Raphaël Porcherot, and Sebastián Valdecantos 2021, ‘Cryptocurrencies for Social Change : The Experience of MonedaPAR in Argentina', International Journal of Community Currency Research 25, 1 : 16–33.
Porcherot, Raphaël 2023, ‘Une monnaie alternative peut-elle être une alternative à la monnaie ?', Saclay : Université Paris-Saclay.
Sánchez, María Soledad and Mariana Luzzi 2023, ‘The expansion of cryptocurrencies among young Argentines. Finding a way through finance in contemporary Argentina'.
Tichit, Ariane, Pascal Lafourcade, and Vincent Mazenod 2017, ‘Les monnaies virtuelles décentralisées sont-elles des dispositifs d'avenir ?', Interventions économiques 59.
Notes
[1] En fait, non seulement les transactions mais l'ensemble des opérations qui ont lieu dans le système, y compris les opérations « structurelles » telle que les modifications du nombre d'opérations nécessaires pour constituer un bloc. Des usages non monétaires des blockchains sont aussi possibles, par exemple dans certaines filières alimentaires où cette technologie est censée permettre une meilleure traçabilité dans l'intérêt supposé des consommateurs mais tend surtout à concentrer et renforcer le pouvoir entre les mains de certains agents déjà puissants : la transparence « ne permet pas systématiquement de prévenir ou de réduire le pouvoir mais peut l'exacerber » (Commandré, Macombe, et Mignon 2021).
[2] https://coinmarketcap.com
[3] https://www.schwab.com/learn/story/cryptocurrencies-what-are-they
[4] https://www.bis.org/statistics/about_derivatives_stats.htm
[5] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
[6] On peut se rapporter à Alary et al. (2016), recueil de texte autour des institutionnalismes monétaires, ou à un livre collectif des Economistes Atterrés et al. (2018).
[7] Ainsi, les Gold Bugs, frange de l'extrême-droite étatsunienne, et l'Etat islamique ont ceci en commun qu'ils prônent tous le retour à une « vraie » monnaie au sens d'une monnaie métallique : ici un retour à la convertibilité du dollar en or ; là la frappe de dinars en or faisant explicitement référence au temps des califes du passé.
[8] On en compte aujourd'hui environ 2 000 dans le monde (Blanc, 2021). Des hybridations entre ces deux formes de contestations monétaires sont possibles. Par exemple : https://theconversation.com/les-cryptomonnaies-sociales-ou-la-convergence-des-contestations-monetaires-109278.
[9] De 2008 à 2010, nous dit l'autrice, « il a ‘miné' 22 000 blocs, ce qui représente à l'époque un peu plus de 50 milliards d'euros » (p.15). La formulation laisse la place à l'équivoque puisqu'on ne sait pas si l'autrice fait référence à la valeur des transactions enregistrées dans ces 22 000 blocs ou à la valeur des bitcoins que Nakamoto a reçu en rémunération de son activité de « minage », qui désigne en fait le travail algorithmique de vérification des nouvelles transactions et de leur rajout à la chaîne de bloc.
[10] a16z est nommé ainsi car il y a seize lettres entre le A et le Z de Andreessen Horowitz.
[11] Ainsi des cryptos qui confèrent une utilité supplémentaire au « minage », au-delà de la seule vérification des transactions : par exemple Primecoin « qui remplace la preuve de travail de Bitcoin par le calcul des chaînes de Cunningham sur les nombres premiers [permettant de faire] avancer la recherche en mathématiques » ; « Gridcoin, Curecoin ou encore Foldingcoin [proposant] de mettre les calculs de validation des transactions au service de la science ou de la médecine, en participant à l'analyse du fonctionnement des protéines par exemple dans le cas de Curecoin » (Tichit, Lafourcade, et Mazenod 2017). Primecoin, Gridcoin et Curecoin s'échangent pour quelques centimes sur Coinmarketcap, le marché pour Foldingcoin a quant à lui cessé d'exister tout à fait.
[12] Ce type de dynamique se retrouve également dans un cas d'hybridation entre crypto-monnaie et monnaie sociale, la MonedaPAR. Si les usagers de la MonedaPAR sont à l'abri des fraudes et arnaques par construction, puisque la blockchain n'y est utilisée que comme « système d'exploitation » sans qu'il n'existe de marché spéculatif pour la MonedaPAR, reste que les techniciens en charge de la conception et du maintien de l'infrastructure crypto de cette alternative monétaire la présentent explicitement comme un produit d'appel. Leurs intérêts sont temporairement alignés sur ceux des usagers de la MonedaPAR : si le projet fonctionne, ce dernier leur garantira une publicité efficace pour leurs solutions de système monétaire configurable et destiné à tout type d'acteurs. Par ailleurs, à plus court terme, cela leur permet d'améliorer leur positionnement au sein de la blockchain Bitshares : la MonedaPAR augmente leurs chances d'être choisis par l'algorithme pour valider des blocs de transactions et de bénéficier ainsi de crypto-revenus additionnels (Porcherot 2023 ; Orzi, Porcherot, et Valdecantos 2021).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












