Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Israël, fait colonial. Maxime Rodinson met KO Bernard-Henri Lévy

Dans son dernier ouvrage Solitude d'Israël comme dans les interventions médiatiques qui s'en sont suivies, BHL conteste la qualification d'Israël de « fait colonial », opérée en juin 1967 par l'orientaliste Maxime Rodinson dans un texte au titre éponyme. Les arguments farfelus et fallacieux que le philosophe mobilise à cet effet ne sont jamais contestés par ses interviewers. Mise au point.
Tiré d'OrientXXI
17 mai 2024
Par Alain Gresh
Le dernier opus de Bernard-Henri Lévy mérite-t-il ces quelques lignes et le temps gaspillé à sa lecture ? Les interviews complaisantes que l'auteur multiplie lui permettent de dérouler, la plupart du temps sans contradicteur – l'ignorance de ses interviewers est souvent abyssale -, sa routinière défense d'Israël, de ses crimes de guerre, de son armée ô combien morale. Tout en déplorant la solitude d'un État qui dispose — excusez du peu — d'un soutien robuste des États-Unis et de la plupart des pays occidentaux, dont la conscience est à peine ébréchée par les quelque 35 000 morts, en majorité civils, dénombrés à Gaza. Rien de bien nouveau dans le monde selon BHL.
Nous aurions donc pu dédaigner ce pamphlet, triste ramassis des éléments de langage du discours politique et médiatique dominant, qui se drape dans les habits de la dissidence. Pourtant, l'ouvrage vaut pour un seul point : il fait remonter à la surface un texte oublié de l'orientaliste Maxime Rodinson, paru dans la revue de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Les Temps modernes à la veille de la guerre de juin 1967, et intitulé « Israël, fait colonial ? ». BHL en cite la conclusion :
Je crois avoir démontré, dans les lignes qui précèdent, que la formation de l'État d'Israël sur la terre palestinienne est l'aboutissement d'un processus qui s'insère parfaitement dans le grand mouvement d'expansion européo-américain des XIXe et XXe siècles pour peupler ou dominer les autres terres.
Une phrase qui ne peut que susciter l'indignation de ce « Jean-Paul Sartre dévalué » que moquait Renaud dans sa chanson « L'Entarté ».
« De vieilles passions communistes au cœur d'Israël »
Les migrants sionistes n'étaient-ils pas animés par des idéaux de la révolution d'Octobre ? Ne brandissaient-ils pas le drapeau rouge ? N'entonnaient-ils pas des chants spartakistes ? Ne se réclamaient-ils pas pour certains du marxisme-léninisme ? Dans une lettre à son ministre des affaires étrangères datée du 29 novembre 1924, le consul de France à Jérusalem notait :
Dans les colonies coopératives tout est indivis, le sol, les instruments de travail, les bénéfices, le plus souvent les repas se prennent en commun, tous les enfants sont rassemblés dans une nursery où l'une des femmes s'occupe d'eux. Ce système a, sous le rapport de la culture, des inconvénients graves qu'il est superflu de signaler, mais les chefs sionistes s'y résignent parce qu'il satisfait cette espèce de curiosité, d'inquiétude des formules sociales nouvelles qui tourmente l'âme de la plupart de leurs recrues. (…) Le sionisme, ne vivant que d'un appel aux forces morales, aux traditions nationales, doit utiliser tout ce qu'il fermente de vieilles passions communistes au cœur d'Israël.
Les dirigeants sionistes surent, comme l'a démontré l'historien israélien Zeev Sternhell (1), manipuler ces « vieilles passions communistes » pour créer des kibboutz très militarisés – « une main sur la charrue, l'autre sur le glaive » – dont l'objectif réel était le maillage du territoire palestinien, premier pas vers sa conquête.
Marx écrivait qu'on ne juge pas un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même. On ne peut évaluer non plus un mouvement sur l'idée qu'il se fait de lui-même. Il ne s'agit pas de nier la sincérité de cette « passion communiste » qui animait (certains) émigrants juifs, mais d'analyser leur pratique politique réelle, nombre de massacres et de crimes se sont fait au nom du Bien et de « la civilisation ». Rodinson a bien mis en lumière le point aveugle de ces colons :
La suprématie européenne avait implanté, jusque dans la conscience des plus défavorisés de ceux qui y participaient [à l'émigration en Palestine], l'idée que, en dehors de l'Europe, tout territoire était susceptible d'être occupé par un élément européen. Le cas de l'utopie sioniste n'était pas, de ce point de vue, différent de celui des utopies socialistes du type de l'Icarie de Cabet (2). Il s'agit de trouver un territoire vide, vide non pas forcément par l'absence réelle d'habitants, mais une sorte de vide culturel. En dehors des frontières de la civilisation (…), on pouvait librement insérer, au milieu de populations plus ou moins arriérées et non contre elles, des « colonies » européennes qui ne pouvaient être, pour employer anachroniquement un terme récent, que des pôles de développement.
Ce sentiment de supériorité n'était pas propre au seul mouvement sioniste, on le retrouve dans le mouvement ouvrier à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle. Ainsi, les communards en Algérie qui se réclamaient de la Commune de Paris de 1871, saluaient la répression de l'insurrection en Kabylie, qui embrasait alors le pays (3). Les fédérations algériennes de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) votèrent massivement l'adhésion à l'Internationale communiste au congrès de Tours en 1920, tout en dénonçant le nationalisme indigène « rétrograde » et en prônant l'assimilation. Tous ces socialistes chantaient pourtant « L'Internationale », se réclamaient de « la dictature du prolétariat », appelaient au soulèvement des « damnés de la Terre » réduits aux seuls ouvriers européens. Il fallut la création de l'Internationale communiste pour que s'impose, non sans obstacles, le mot d'ordre « prolétaires de tous les pays et peuples opprimés unissez-vous », et pour rompre en paroles et parfois en actes avec les vieilles tendances coloniales de la social-démocratie.
L'Ancien Testament comme titre de propriété
Pour contester le caractère colonial de l'entreprise sioniste, BHL rabâche plusieurs thèses auxquelles le long texte de Rodinson dans Les Temps Modernes avait répondu par avance, mais qu'il ne s'est pas donné la peine de relire, ne serait-ce que pour les contester.
« Il y a toujours eu des Juifs sur la terre de ce qu'est aujourd'hui l'État d'Israël », écrit-il, depuis des milliers d'années, avant et après la destruction du Temple en l'an 70. Certes, ils n'étaient pas constitués en nation, concède BHL, mais « les autochtones arabes ne l'étaient pas davantage ». Ils n'acquirent ce statut, selon lui, que dans les années 1940, en même temps que les Juifs, ce qui permet, par un tour de passe-passe, d'apposer un signe d'égalité entre les aspirations des Palestiniens et celles des Juifs en Palestine. Cette logique amènerait à prétendre que les peuples autochtones amérindiens ou africains, qui n'étaient pas des communautés nationales, n'ont donc pas subi le colonialisme.
Et quelle est la légitimité d'une revendication juive sur la Palestine ? Rappelons que Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique, avait envisagé une installation des juifs en Argentine ou au Congo. BHL invoque la Bible désignée comme le « Malet et Isaac des sionistes », pour justifier cette prétention. Rappelons que Malet et Isaac est la collection de manuels d'histoire conçue par la République au début du XXe siècle, et qui a inventé plusieurs thèmes de la mythologie nationale, dont « nos ancêtres les Gaulois ». S'il relève plus de l'idéologie que de l'Histoire, il a quand même quelques rapports avec cette dernière, ce qui n'est pas le cas de la Bible, même s'il reste un texte majeur pour l'humanité. Et qui peut considérer, sauf quelques illuminés, l'Ancien Testament comme un titre de propriété ?
Évoquant les droits historiques des juifs sur la Palestine, Maxime Rodinson ironise : « Je ne ferai pas à mes lecteurs l'affront de les croire séduits par cet argument », ou alors — c'est nous qui complétons — on ouvrirait les portes à une guerre de mille ans, notamment en Europe, avec les revendications « historiques » de la Russie sur l'Ukraine, de la Serbie sur le Kosovo, voire de la France sur la partie francophone de la Belgique.
Dans sa préface à un livre que j'avais écrit sur l'histoire de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Rodinson avait illustré l'absurdité d'une revendication reposant sur les mythes développés par les mouvements nationalistes :
Qu'on cherche à s'imaginer les Tsiganes – peuple persécuté depuis des siècles et exterminé en masse par les hitlériens – réclamer un État dans le département des Bouches-du-Rhône où se situe un sanctuaire qu'ils révèrent, celui des Saintes-Maries-de-la-Mer, réaliser leur projet grâce à l'appui des États-Unis et de l'Union soviétique, après s'être constitué une base territoriale en achetant systématiquement des terres, après avoir vaincu militairement les forces françaises s'efforçant de résister. Qu'on pense à la réaction des habitants placés dans une position subordonnée, forcés d'apprendre le tsigane pour avoir une place dans l'État tsigane, poussés autrement à aller s'établir ailleurs (la France est grande, il y a 95 autres départements diraient les apologistes de l'État tsigane) (4).
Le rôle central de Londres
« Il y a un point, un au moins, sur lequel tous s'accordent, argumente ensuite BHL, la colonisation, c'est le vol. Or il n'y eut ni vol ni dol. Les terres acquises par les migrants non moins que par les autochtones juifs ne furent, sauf exception, pas ravies mais achetées. (…) Il n'est pas vrai que les terres constitutives du futur Israël aient été prises par la force ou au mépris de la loi. » Là encore, BHL n'a pas lu Rodinson qui explique comment en Afrique noire comme en Tunisie, l'acquisition des terres par les colons s'opéra le plus souvent légalement. À la veille du plan de partage de la Palestine voté par l'Assemblée générale de l'ONU le 29 novembre 1947, le pourcentage des terres cultivables de Palestine possédées par des Juifs ne représentait que 9 % à 12 % des terres cultivables ; il fallut la création de l'État d'Israël, « le vol et dol » des terres des réfugiés palestiniens, la « judaïsation » des propriétés des Palestiniens citoyens d'Israël pour bouleverser le cadastre. Résultat : à la veille de la guerre de 1967, 72 % des terres aux mains de Juifs israéliens avaient appartenu à des Palestiniens avant 1947 (5).
Ultime pierre du raisonnement de notre philosophe, « qui dit colonialisme dit métropole coloniale. Or la réalité c'est que la métropole, c'est-à-dire, en la circonstance, la Grande-Bretagne, s'opposa de toutes ses forces, ici comme ailleurs, à la dislocation de son empire. … [La naissance d'Israël] est un moment de l'histoire, non des empires, mais de leur dissolution ; et le sionisme n'est pas un impérialisme, mais un anti-impérialisme. » Ce raccourci qui trouverait sa place dans un Mallet et Isaac israélien occulte le rôle central de Londres. À partir de 1922, date du début de leur mandat sur la Palestine, les Britanniques ont encouragé non seulement une émigration massive juive, mais ont aidé le Yichouv — la communauté juive en Palestine — à se constituer en corps séparé, avec ses institutions politiques, sa vie économique reposant sur « le travail juif » et la séparation d'avec les Arabes, et bientôt ses milices armées par les Britanniques. Le Royaume-Uni ne le fit pas par « amour des juifs », nombre de défenseurs du projet sioniste, Lord Balfour en tête, étaient antisémites, mais parce que Londres voyait ces colons européens comme « un poste avancé de la civilisation » et un point d'appui pour la défense de ses intérêts dans la région.
Cette approche se modifia durant la Seconde guerre mondiale, quand le Royaume-Uni dut prendre en compte les demandes de ses commensaux arabes sur lesquels il régnait (Égypte, Transjordanie, Irak). L'utilisation du terrorisme par les groupes sionistes contre des intérêts et des soldats britanniques – qui soulevèrent une véritable indignation dans l'opinion publique du royaume - et la volonté du sionisme de s'appuyer sur les États-Unis élargirent le fossé entre les alliés d'hier. Peut-on parler pour autant d'une guerre de libération sioniste contre l'empire ? Il faudrait alors considérer comme un soulèvement anticolonial la révolte des pieds-noirs d'Algérie contre Paris en 1960-1962, et l'Organisation armée secrète (OAS) comme un mouvement anti-impérialiste. Ou saluer la sécession des Blancs de Rhodésie en 1965 de la tutelle britannique comme un coup porté à l'empire de Sa Majesté. L'engagement d'Israël contre tous les mouvements d'émancipation des peuples du tiers-monde, du Vietnam aux colonies portugaises en passant par l'Amérique latine, a confirmé l'inscription durable de ce pays dans « le camp impérialiste ». Comme l'illustre l'alliance stratégique tissée avec l'Afrique du Sud de l'apartheidà partir de 1948, que poursuivirent tous les gouvernements israéliens de « gauche » comme de droite, allant jusqu'à aider Pretoria dans son programme nucléaire militaire.
On ne conseillera pas à BHL de relire Maxime Rodinson dont le texte dense — même s'il est parfois un peu daté - fait voler en éclat ses piètres démonstrations. En revanche, les lecteurs y trouveront de quoi nourrir leur réflexion à un moment où le caractère colonial du projet sioniste apparaît dans toute son horreur à Gaza.
Notes
1. Zeev Sternhell, Aux origines d'Israël. Entre nationalisme et socialisme, Fayard, 1998.
2. Étienne Cabet, théoricien politique français (1788-1856), voulait construire une cité idéale ; il tenta une expérience au Texas.
3. Alain Ruscio, « Commune(s), communards, question coloniale », Cahiers d'histoire, n° 153, 2022.
4. Préface à Alain Gresh, OLP, histoire et stratégies. Vers l'État palestinien, Spag-Papyrus, 1983.
5. Lire John Ruedy, « Land Aliénation » dans The Transformation of Palestine, sous la direction d'Ibrahim Abu-Lughod, Northwestern University Press, Evanston, 1971.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La France, tu l’aimes mais tu la quittes. Comment l’islamophobie travaille la société française

Dans un livre paru récemment au Seuil, Olivier Esteves, Alice Picard et Julien Talpin présentent les résultats d'une enquête sociologique vaste et inédite sur l'exil de Français·es de culture ou de confession musulmane, en réponse aux multiples discriminations et à la stigmatisation quasi-permanente, dans l'espace public, de l'islam et des musulman·es. S'inscrivant dans un champ de recherche en développement, les auteurs·rices nous invitent ainsi, à travers cet ouvrage, à prendre enfin toute la mesure des effets concrets de l'islamophobie sur la vie de millions de personnes vivant en France. Nous vous proposons d'en lire l'introduction.
23 mai 2024 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/islamophobie-discriminations-exil-musulmans-france/
Introduction
Quand vous entrez dans l'amphi, il y a un silence de mort. Alors que quand c'est les autres, on les applaudit, parce que c'est un peu le bazar en médecine en fait, il y a comme un système de bizutage, mais nous, on n'entre pas dans ce délire‑là. On en est même exclues d'office. Voilà… alors qu'on s'en fiche, qu'on soit intégrées ou pas, on s'en fiche. Mais, je sais pas, c'est comme un non‑dit, c'est : “bon elle, elle est voilée, elle ne fait pas partie de notre monde”.
Appelons cette femme Ilham[1]. Installée à Salford près de Manchester au moment où elle nous accorde un entretien en 2021, elle se souvient avec émotion de son passage en faculté de médecine, où elle était la seule à porter un hijab[2]. L'exclusion dont elle témoigne est à la fois liée à ses origines, à sa religion visible dans l'espace public, mais aussi à sa classe sociale. Elle confie en effet qu'en bifurquant ensuite vers des études de sage‑femme, elle a côtoyé un milieu plus hétéro‑ gène, moins marqué par un entre‑soi blanc et bourgeois, et que sa religion est « mieux passée » auprès des étudiantes de sa nouvelle promo.
Elle se souvient tout de même d'un événement traumatique dans son cursus de sage‑femme, lorsqu'un professeur d'anatomie avait exigé qu'elle retire son foulard avant un examen. Elle avait beau avoir soulevé son voile un instant pour montrer qu'elle ne portait pas d'écouteurs dans le but de tricher, le professeur n'avait rien voulu savoir. Ilham a essayé de se défendre, car la demande de l'enseignant n'était pas légale. Mais rien n'y a fait.
Ilham est née et a grandi dans un quartier populaire d'Orléans. Ses parents sont marocains, son père a été ouvrier agricole, puis a travaillé dans le BTP et sa mère s'est occupée de ses sept enfants. Ses études supérieures ont validé sa trajectoire sociale ascendante, mais le port du foulard a donné lieu pour elle à de multiples discriminations, et a fait de son parcours en médecine un épisode douloureux. Elle a décidé de le porter peu après la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l'école.
Les controverses précédant la loi et la législation elle‑même ont cristallisé la volonté d'Ilham d'affirmer son islam publiquement, tout en respectant les règles du dévoile‑ ment à l'entrée du lycée : « Le fait d'avoir mis la lumière sur le voile, ça m'a fait réfléchir, oui. J'étais adolescente, j'avais deux amies qui le portaient déjà, et j'ai décidé de le porter. » Avant d'ajouter :
« Le symbole de devoir retirer ce voile avant l'école reste gravé dans ma mémoire parce que, j'utilise des termes un peu forts mais, au début, de devoir retirer son voile devant l'école, c'était un crève‑cœur, on avait l'impression de se trahir. Et de voir les autres nous regarder, ce n'était pas de la curiosité malsaine, les autres se demandaient juste, « mais qu'est‑ce qu'elles font ? C'est trop bizarre ! » »
Son diplôme de sage‑femme en poche, elle postule dans des hôpitaux à Orléans, à Montargis, travaille quelques mois mais les entretiens, souvent, se passent mal. La suspicion qui entoure le port du voile est forte. Un chef de service lui demande d'emblée : « j'espère que vous ne portez pas le voile ! », alors qu'elle garde les cheveux découverts sur le lieu de travail. Dans ce climat délétère, elle essaie de s'ins‑ taller en statut libéral, mais malgré ses efforts n'y parvient pas. Elle « tombe au RSA », est proche de la dépression. Elle rencontre alors son futur mari, un biologiste marocain, qui part faire une thèse de doctorat en Espagne, et qu'elle suit. Installée à Saragosse, elle a l'impression de revivre, son hijab ne posant plus de problème. Elle se dit abasourdie par le contraste entre les deux pays :
« Moi, en Espagne, je me sentais revivre, je l'ai dit à mon mari, “c'est fou ici, on est à la porte de la France. Il n'y a qu'une chaîne de montagnes qui nous sépare, mais c'est une autre mentalité”. »
Comme d'autres, elle sait qu'un autre pays européen, l'Angleterre, est connu pour être, pour « des gens comme nous », un « autre monde ». Elle finit par partir avec son mari à Salford, près de Manchester.
Deux années après son installation, elle raconte :
« Dès qu'on est arrivés, on s'est sentis à l'aise ici, moi je n'étais jamais allée en Angleterre, jamais. Tout ce qu'on m'avait dit sur le pays s'est confirmé ; en tant que musulmans on se sent comme des poissons dans l'eau, clairement. Le fait musulman n'est juste pas un problème ici » (E129)[3].
Elle est en cours de validation de son équivalence de diplôme de sage‑femme, et donne des cours de français, comme son mari donne des cours de biologie. Elle se dit heureuse que ses deux enfants grandissent dans une atmosphère trilingue, avec le français, grâce à elle, l'arabe, grâce à son mari, et l'anglais. Elle sait aussi que ses enfants ne connaîtront pas toutes les vexations qu'elle a subies.
Redouane habite pour sa part à Dubaï depuis 2016. Il se qualifie assez naturellement d'« expatrié ». De fait, il ne partage pas le vécu traumatique d'Ilham. Français d'origine marocaine, il est arrivé en France à l'âge de deux ans. Son père, mécanicien, est décédé quand il était enfant. Sa mère, préparatrice en pharmacie, a alors dû assurer l'éducation des quatre enfants :
« Elle a toujours suivi nos études dès le plus jeune âge ; elle nous a appris qu'il fallait bosser, travailler dur. »
Comme lui, ses frères et sœurs partagent une trajectoire sociale ascendante, grâce à de longues études. Redouane en est pleinement conscient, d'où son profond sentiment de gratitude :
« En France, on a pu grandir, on a pu vivre en sécurité, on a pu manger à notre faim, on a pu étudier, tous étudier sans jamais avoir eu besoin de payer quoi que ce soit. Tout ça, ce sont des choses qu'on n'aurait jamais pu avoir dans notre pays d'origine. »
Redouane a pu intégrer une classe préparatoire scientifique, puis une école d'ingénieur, où il est parvenu à s'imposer dans ce milieu dont il souligne lui aussi le caractère « blanc » et « bourgeois ». Étant musulman, il s'est toujours tenu à dis‑ tance des fêtes alcoolisées. En 2011, il a passé un semestre aux États‑Unis, qui lui a ouvert les yeux sur certaines réalités françaises, notamment sur les manières d'accommoder la religion musulmane :
« Là‑bas, j'ai vu des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont déplu ; et quand je suis rentré en France, j'ai découvert pas mal de choses, que je n'avais pas vues avant, des choses qui tournent pas forcément très rond ; des choses qu'on comprend quand on prend du recul et ça a été, disons, la première phase où j'ai commencé à réfléchir à quitter la France. »
Lors d'un road-trip dans le Golfe, il se pose la question de partir travailler à Dubaï. On est alors en 2016. Il s'informe sur les possibilités de faire un Volontariat inter‑ national en entreprise (VIE), qu'il obtient finalement. Il y rencontre une Marocaine, elle aussi en VIE. Ensemble ils ont un enfant, et semblent épanouis à Dubaï, dont ils louent le respect multiconfessionnel, entre membres d'une élite économique multiculturelle, où il est tout à fait banal de ne pas être autochtone :
« On est 80 % de la population et de fait, quelle que soit sa culture, sa religion, etc., tout est fait pour qu'on se sente à l'aise. Il faut travailler dur, c'est vrai. Il faut s'adapter. Mais comme je l'ai dit, tout est fait pour que ça marche bien. »
Même s'il a conscience de faire partie d'une élite économique, aux conditions de travail et de rémunération radicalement différentes de celles des ouvriers pakistanais ou philippins, Redouane s'épanouit dans un environnement musulman où sa religion n'est pas stigmatisée. Cela passe par des pratiques banales de la vie de tous les jours :
« J'ai ressenti énormément de respect vis‑à‑vis de ça, le genre de choses que je n'aurais jamais imaginées en France. Par exemple, lorsque je travaillais en France, j'allais manger à la cantine. Et il y avait cinq ou six choix différents de viande pour un à deux choix de légumes, dont des frites. Malgré cette diversité, je n'ai jamais demandé à avoir de la viande halal. J'étais à des millénaires, presque, de pouvoir revendiquer ce genre de choses, juste avoir un peu plus de légumes, pour avoir un menu végan ou avoir du poisson, plus de viande et ça m'était refusé, dans les années 2010‑2015. Ici, par contre, c'est le genre de question qu'on ne se pose pas » (E42).
Un récit collectif jamais sollicité
Les vécus, ressentis, comparaisons dont font état Ilham et Redouane sont au cœur de notre enquête, qui s'est déroulée entre 2021 et 2023. Quantitative et qualitative, elle repose sur un matériau original qui permet de comprendre pourquoi des milliers de Françaises et Français décident, sans doute de façon croissante, de quitter leur pays pour, notamment, fuir le racisme. On verra qu'il ne s'agit peut‑être pas de musulmans comme les autres, la grande majorité appartenant à une élite, hautement qualifiée, ayant connu des trajectoires d'ascension sociale. Reste qu'une fuite des cerveaux à la française se produit silencieusement sous nos yeux. Ce livre ambitionne d'en rendre compte.
Jusqu'ici, que des Français et Françaises de culture ou de confession musulmane quittent le pays pour aller vivre et travailler ailleurs n'a guère suscité l'intérêt des politiques, des médias et des universitaires. Quelques articles ont été publiés sur les départs en Angleterre, en Turquie, ou bien à Dubaï[4]. L'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture s'est penchée sur la question. Enfin, deux thèses de doctorat ont été consacrées à cette thématique, en élargissant la focale à d'autres origines géographiques. Celle de Jérémy Mandin s'intéresse aux Français et aux Belges d'origine maghrébine installés à Montréal[5]. Celle de Jaafar Alloul observe les mobilités euro‑maghrébines aux Émirats arabes unis et suit la trajectoire de jeunes Hollandais, Français et Belges[6]. On notera au passage que ces thèses ont été sou‑ tenues hors de France.
Alors que la France est le pays européen comptant le plus de personnes de confession musulmane, on recense encore peu de travaux investiguant leur expérience minoritaire ordinaire, permettant aussi de comprendre les trajectoires d'exil et d'expatriation que nous avons cherché à documenter. Que notre objet soit jusqu'alors passé sous les radars médiatiques et politiques a été illustré par la publication, le 13 février 2022, d'un article du New York Times intitulé « Le départ en sourdine des musulmans de France », qui mentionne explicitement notre enquête. Par l'effet de ce que Pierre Bourdieu aurait appelé « la circulation circulaire de l'information », dès la publication de cet article, une quinzaine de médias nationaux – journaux, magazines, radios, chaînes d'info – ont contacté des membres de notre équipe pour en savoir davantage, avec un mélange de curiosité et parfois de suspicion.
La séquence des attentats de 2015‑2016 et plus tard, en 2020, celle qui a vu se succéder le discours des Mureaux d'Emmanuel Macron (2 octobre 2020) sur le « séparatisme », l'assassinat de Samuel Paty deux semaines plus tard (le 16 octobre), puis les restrictions des libertés associatives avec l'adoption de la « loi contre le séparatisme » en août 2021 ont constitué une véritable escalade dans un pays pourtant habitué aux controverses sur l'islam. Si le « problème musulman » a été construit de longue date[7], l'islamophobie (nous reviendrons sur l'usage que nous faisons de ce terme) a connu une forme d'accélération – attestée tant par les chiffres officiels des actes anti‑musulmans que par le ressenti des personnes interrogées – au cours de la dernière décennie. Ce n'est donc pas un hasard si, comme on le verra à l'aide de notre étude quantitative, la fuite des musulman·es français·es s'est accélérée depuis 2015.
Cette exacerbation des stigmatisations a été ressentie à l'université elle‑même. Pour preuve : la séquence polémique autour d'un « islamo‑gauchisme » imaginaire pourtant brandi comme une menace réelle sur « le vivre‑ensemble » par les ministres Jean‑Michel Blanquer et Frédérique Vidal[8]. La vie et le financement des associations n'ont pas été épargnés non plus.
Au‑delà des dissolutions du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), du Collectif contre le racisme et l'islamophobie (CRI) et de Baraka City, les associations musulmanes et leurs alliés ont fait l'objet d'une chasse aux sorcières, marquée par des coupes de subvention, des fermetures de mosquées jugées « séparatistes », des fermetures de comptes en banque et surtout par la disqualification de leurs membres perçus de manière indifférenciée comme « islamistes », « communautaristes » ou « séparatistes », toutes ces mesures contribuant à fragiliser les acteurs les mieux à même de prendre en charge les colères que suscitent les discriminations[9].
La stigmatisation d'un nombre croissant de personnes ou d'associations comme « ennemies de la République » illustre un rétrécissement inquiétant du pluralisme démocratique, où l'invocation mécanique de la « République » et de ses « valeurs » vaut rappel à l'ordre autoritaire et musellement des contestations[10]. Ce livre se penche sur ses conséquences, sur les trajectoires individuelles, les destins familiaux, les corps et les âmes des personnes touchées par cette violence ordinaire.
Dans ce contexte, beaucoup de personnes interrogées ont accueilli avec enthousiasme l'existence même de l'enquête, et la possibilité d'offrir des témoignages illustrant l'ampleur de ce racisme spécifique qu'est l'islamophobie. On peut jauger leur démarche à l'aide de la triade, classique dans les sciences sociales, proposée par l'économiste Albert Hirschman : exit, voice, loyalty. Selon Hirschman, quand un produit ou un service se détériore, le consommateur ou le citoyen peut choisir entre : la loyalty, où il renonce à l'action ; la prise de parole (voice) dans le but de faire connaître son mécontentement et de changer la situation ; ou enfin l'exit, c'est‑à‑dire la défection pure et simple.
On peut arguer dans notre cas qu'après l'exit, matérialisée par le départ de France, beaucoup de personnes interrogées ont eu recours à la prise de parole, voice, en répondant à nos questions, surtout quand ces individus partagent des vécus discriminatoires douloureux[11]. En voici quelques exemples :
Je veux commencer par dire que c'est assez extraordinaire qu'on nous donne la parole (Lamia, Ottawa, qui a quitté la France en 2007, E75).
Merci de faire ce travail parce que ça va aider. J'espère que ça va aider les politiques et, un petit peu, la société française à ouvrir les yeux (Mokhtar, New York, qui a quitté la France en 2012, E122).
Je trouve ça beaucoup plus impactant qu'un bulletin dans une urne. C'est beaucoup plus constructif que de mettre « Macron » pour faire barrage à « Le Pen » au deuxième tour (Sofiane, région de Birmingham, 2021, qui a quitté la France en 2016, E50)
Je trouve que c'est une super initiative de faire ce type d'étude. Les médias et les politiques sont obsédés par les musulmans, mais […] ils sont dans un monde imaginaire, avec leurs idées bien particulières sur ce que c'est les musulmans. Et ils ne comprennent pas la diversité de ce qui nous compose (Assia, Londres, qui a quitté la France en 2013, E137).
Qui sommes-nous ?
Cette attente crée une pression et pose la question de la relation entre enquêteurs et enquêtés, dont on mesure la complexité dans les pages qui suivent. Cette relation a été façonnée par les profils hautement qualifiés de la plupart des personnes interrogées : pour simplifier, des individus aux longs parcours universitaires répondaient aux questions d'autres individus aux parcours universitaires assez analogues, fût‑ce dans des disciplines différentes. Sans oublier que plusieurs membres de l'équipe ont accumulé, depuis des années, des séjours plus ou moins longs et répétés dans des pays anglophones qui sont des lieux de résidence des personnes enquêtées : Grande‑Bretagne, Canada, États‑Unis, Irlande, principalement.
Ainsi, régulièrement, selon les différences d'âge, de parcours personnel ou d'identité ethno‑raciale, les personnes interrogées basculaient spontanément d'un « vous » à un « tu »[12]. Sans que cela crée de connivences, ces similitudes facilitent la compréhension de situations vécues, des situations qui, de France, sont réifiées par des politiques et médias toujours avides de dichotomies faciles entre « les Anglo‑Saxons et nous »[13].
Encore plus centrale est la question de notre identité en tant que non‑musulmans pour coordonner cette enquête. Sans que nous ayons abordé le sujet d'emblée, il paraissait souvent préférable aux yeux des personnes rencontrées que ce travail soit mené par des non‑musulmans, condition à leurs yeux d'une plus grande légitimité des résultats produits. Car le fait est que la plupart des membres de notre équipe ne sont pas issus du groupe minoritaire faisant l'objet de cet ouvrage. Se pose donc pleinement la question de la « positionnalité », que Silyane Larcher envisage ainsi, en s'inspirant notamment d'un article important de Donna Haraway[14] sur la connaissance située (situated knowledge) :
« La positionnalité ne désigne pas le point de vue d'une identité essentialisée, sorte de posture figée, mais plutôt la perspective socialement et historiquement déterminée, donc changeante, à partir de laquelle le sujet de connaissance regarde le monde social et est en même temps façonné par lui. »[15]
L'écriture de cet ouvrage par des personnes subissant racisme et islamophobie au sein de la société française aurait peut‑être permis aux lecteurs de se faire une meilleure idée des expériences dont il sera question dans les pages qui suivent, ou de s'y retrouver plus fidèlement s'ils les partagent. Diverses raisons expliquent cette quasi‑absence de musulmans dans l'équipe à l'origine de ce livre. Tout d'abord, une présomption de partialité voire de militantisme pèse sou‑ vent sur les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur un groupe auquel on estime qu'ils et elles appartiennent[16].
Cette question avait déjà été explorée par la chercheuse Philomena Essed au début des années 1990, à travers la figure de la Black angry woman aux États‑Unis[17], une critique qui n'épargne pas le travail des universitaires issus de minorités, sur lesquels pèsent, pour citer Audrey Célestine, des « soupçons d'être “trop près de leur objet” ou “trop concernés” »[18]. De fait, la nécessaire « neutralité axiologique » à laquelle invite le sociologue Max Weber[19] est souvent mal comprise. Elle est souvent caricaturée en une injonction à une neutralité de façade qui reviendrait à prétendre, lorsqu'on est universitaire, qu'on est capable de s'extraire du social, des rapports de force qui le traversent et le structurent.
Travailler sur ce qui n'est pas soi n'abolit pas la position sociale que l'on occupe et à partir de laquelle on porte un regard sur le monde social. Il n'existe pas de regard neutre, ce qui n'empêche pas d'objectiver les phénomènes sociaux. En second lieu, et plus concrètement, l'université française demeure un espace très majoritairement blanc où les personnes racisées sont largement sous‑représentées[20]. Enfin, les coûts sont réels dans une carrière universitaire lorsqu'on s'investit dans un projet jugé politiquement inflammable et entouré de soupçons.
Des collègues au statut précaire – qui sont de plus en plus nombreux, surtout en sciences sociales – prennent un risque en s'associant à ce type de projet. Dans ce contexte, ce n'est pas un hasard si un chercheur comme Abdellali Hajjat est désormais professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles, expatriation universitaire qu'il a justifiée par les « grandes difficultés » qu'il a connues en France pour « mener un travail serein sur la question de l'islamophobie »[21].
Collectivement, nous pensons en outre que la charge raciale qui pèse sur la composante musulmane de la société française ne doit pas reposer sur ce seul groupe. Maboula Soumahoro définit cette « charge raciale », notion inspirée du pionnier de la sociologie américaine W. E. B. Du Bois (1868‑1963), comme la « tâche épuisante d'expliquer, de traduire, de rendre intelligibles les situations violentes, discriminantes ou racistes »[22] auprès du groupe majoritaire dans la société. Nous proposons modestement de partager cette charge raciale. Il nous semble également que notre ouvrage en dit au moins autant sur la France que sur les personnes interrogées, leurs trajectoires, leur identité ou leur foi. Or nous faisons partie de cette société et c'est donc aussi sur nous‑mêmes que nous avons travaillé.
Qu'on nous permette de faire un pas de côté pour mieux saisir ce qui se joue ici, en nous inspirant de l'expérience de l'historien canadien John Milloy. Auteur d'un ouvrage de référence sur les pensionnats (residential schools) imposés aux enfants des peuples autochtones jusque dans les années 1990 au Canada, et dont l'histoire tragique a suscité un traumatisme national, il insiste à la fin de son introduction sur le fait que son livre est « une histoire écrite par un non‑Aborigène, quelqu'un qui n'a jamais été envoyé de force dans un pensionnat », quelqu'un qui « n'a jamais ressenti le racisme ou dû subir le dénigrement de sa propre identité », mais que, en réalité, son ouvrage en dit davantage sur son propre pays que sur les peuples premiers du Canada.
Pour étayer son propos, Milloy précise qu'en 1965, lors d'auditions par le Bureau des affaires indiennes, un ancien élève d'un pensionnat appartenant à la nation Mohawk exprima « une vraie réticence » à témoigner, parce que, selon lui, « pour être honnête, cette histoire, ce n'est pas celle de mon peuple, mais c'est plutôt la vôtre »[23].
Islamophobie, une notion militante ?
Dans son ouvrage Why Race Still Matters (« Pourquoi la race est toujours d'actualité »), la théoricienne australienne Alana Lentin met en question la manière dont le racisme est défini, et surtout par qui. Elle note que ce sont toujours les élites politiques et médiatiques, qui dans leur majorité n'en souffrent pas, qui jouissent du pouvoir de définition officielle du racisme, tandis que ses victimes ont peu voix au chapitre dans l'espace public sur la nature des discriminations qu'elles subissent[24].
Notre enquête illustre la validité de cette thèse : alors qu'en France une bonne partie des élites politiques, au nom d'un universalisme abstrait, nie l'existence de cette forme majeure et spécifique de racisme, les premiers concernés utilisent le terme « islamophobie » de manière banale, à la mesure de la banalisation de ce racisme dans notre pays. Comme le dit Lila, qui travaille aujourd'hui dans la finance à Singapour après avoir quitté un emploi rémunérateur en France du fait d'une atmosphère devenue trop pesante :
« c'est clairement de l'islamophobie. Quand on a une discrimination envers une religion, c'est sûr, c'est du racisme. Et celui‑ci, plus particulièrement, s'appelle de l'islamophobie. Comment vous voulez appeler ça, vous ? » (E23).
On notera aussi que les rares personnes n'ayant pas fait d'études supérieures parmi notre échantillon l'utilisent tout autant que celles qui sont passées par les bancs de Sciences Po Paris ou l'École Centrale.
Nous entendons par islamophobie la stigmatisation de l'islam et des musulmans et ses conséquences concrètes : discriminations, micro‑agressions[25], violences verbales et physiques. À ce titre, et alors que le débat public s'est beaucoup concentré sur cette question ces dernières années, l'islamophobie ne relève pas de la « peur » de l'islam, et encore moins de la possibilité ou non de critiquer cette religion, pas plus que l'homophobie ne renvoie à la seule peur des homosexuels, mais à l'ensemble des actes discriminatoires ou violents qui les ciblent.
Le concept d'islamophobie est aujourd'hui reconnu par les sciences sociales à l'échelle internationale et mobilisé par de très nombreuses institutions nationales et internationales[26]. Les querelles sémantiques qu'il déchaîne en France paraissent donc exceptionnelles, et contribuent peut‑être à détourner l'attention des conséquences réelles de ce problème. Sans fétichiser le terme – au fond, « racisme anti‑musulman » est équivalent – il mérite peut‑être d'autant plus d'être conservé qu'il est attaqué et que son abandon ou son évitement reviendraient à délégitimer l'usage ordinaire dont nos entretiens témoignent.
Des mobilités internationales à part ?
D'autres concepts qu'« islamophobie » nous ont causé bien davantage de problèmes, à commencer par la manière de nommer ces musulmans français partis vivre à l'étranger. Est‑ce que ce sont des personnes émigrées, exilées, expatriées, et quel est le degré de porosité des situations auxquelles renvoient ces termes ?
La mobilisation de ces notions par les personnes interrogées est elle‑même assez hésitante. Ainsi, Monia, ingénieure installée à Düsseldorf depuis cinq ans au moment de l'entretien, est dubitative sur la pertinence du terme « expatriée » dans son propre cas. Assez politisée, elle souligne la dimension post‑coloniale du terme d'« expat » :
« Les “expats”, c'est un peu les cadres sup blancs après école d'ingé qui partent à l'étranger. […] Pour moi le mot “expat” je l'utilise de manière presque ironique. Fondamentalement, c'est de l'immigration, mais on aime bien faire une différence entre les expatriés et les immigrés » (E12).
Même hésitation sur le qualificatif d'expatrié pour Mourad, inscrit en thèse à Montréal depuis 2020 :
« Donc, quand je suis venu à Montréal, je me considérais comme… non pas un expatrié parce que j'ai l'impression qu'expatrié ça fait très référence à une migration liée à l'emploi, alors que dans notre cas, c'était plus lié aux études [réfléchit] Pour moi ce serait plus “Français de l'étranger”, mais honnêtement je n'ai pas de terme exact » (E16).
Le constat qu'aucun terme ne correspond parfaitement à sa situation est partagé par Charles, résident à Dubaï depuis 2015, converti depuis 2012 et diplômé d'une école de commerce toulousaine :
Je me dis : est‑ce que je me considère comme un expat ? Pour moi, un expat, c'est quelqu'un qui vient ici pour ramasser de l'argent et puis repartir en France. C'est pas moi, ce n'est pas mon délire. En fait, je suis plus… Est‑ce que je peux me considérer comme un immigré ici, parce que je ne pourrai jamais devenir un Émirati et je ne pourrai jamais vraiment m'intégrer à cette société ? Donc, en fait, je ne sais pas si je suis un expat. Je suis un immigré, et je n'ai pas l'intention de rentrer en France (E62).
Lamia, ingénieure d'origine syrienne installée depuis 2007 à Ottawa, récuse sans ambages le terme : « Expatriée, c'est vraiment quelqu'un qui a choisi de le faire, moi je pense que j'ai été un peu poussée à la porte » (E75). Certaines personnes, les plus attachées à leur religion, notamment des femmes coiffées d'un hijab partageant un vécu traumatique en France, se vivent d'une certaine manière comme des « réfugiées de la laïcité », en tant que celle‑ci prend la forme d'une « laïcité d'interdiction ».
La complexité des parcours personnels donc, dépendant surtout de l'importance du vécu discriminatoire en France, peut faire opter pour « exilé » plutôt qu'« expatrié ». Pour donner un exemple mentionné plus haut, Ilham nous semble correspondre à un profil d'exilée en Angleterre (Salford), alors qu'on classerait plus aisément Redouane parmi les « expatriés » à Dubaï. La frontière entre les deux, tout comme les motivations au départ, est souvent ambiguë, plusieurs raisons, professionnelles et économiques, mais aussi politiques, étant imbriquées.
Malgré les réticences exprimées dans ces extraits d'entretiens, les termes d'« expatrié » et d'« expatriation » restent les plus communément utilisés par les personnes interrogées, notamment celles qui exercent les métiers les plus rémunérateurs et paraissent les moins politisées. Ce n'est pas un hasard si le groupe Facebook des francophones musulmans au Royaume‑Uni produit un guide « du musulman expatrié » dans le pays, où l'on trouve, en 129 pages, neuf occurrences du terme « expatriation », et trois de celui « expatriés ».
D'une certaine manière, la mobilisation de ce vocabulaire est une façon de banaliser l'ascension sociale à l'étranger, d'inclure les Français et les Françaises de confession musulmane dans le groupe plus vaste des expatriés. Cela n'empêche pas que ces termes eux‑mêmes sont inappropriés, principalement d'ailleurs parce que l'expatriation présuppose un retour au pays. Or, nous le verrons, les personnes interrogées, dans leur grande majorité, ne souhaitent pas revenir en France.
Le terme de « diaspora », adopté en sous‑titre de notre livre, peut finalement s'avérer utile pour appréhender notre objet d'étude pris dans sa globalité, au‑delà des trajectoires individuelles. La littérature en sciences sociales a repris et étendu la notion de diaspora, historiquement dédiée à la dissémination du peuple juif dans le monde, pour décrire les mouvements transnationaux dans un contexte de mondialisation où se complexifient des réseaux de solidarités par‑delà les frontières nationales. « Diaspora » est également précieux puisqu'il permet à la fois de désigner un type de phénomène, une condition sociale et un processus d'affinités transnationales[27]. Ce sont des éléments sur lesquels nous reviendrons au chapitre 5.
Notre titre
Le titre de cet ouvrage et du projet de recherche dont il est l'aboutissement a fait l'objet d'âpres discussions, sur lesquelles nous souhaitons revenir brièvement. D'emblée, il peut sembler provocateur. Il reprend, pour le détourner, un slogan de la droite radicale française utilisé notamment en 2006‑2007[28], slogan lui‑même inspiré de la révolution conservatrice sous Nixon (America, you love it or leave it !)[29], mais en transformant « La France, tu l'aimes ou tu la quittes » en un « La France tu l'aimes mais tu la quittes ».
Le simple passage d'une conjonction de coordination (« ou ») à une autre (« mais ») permet au groupe stigmatisé de se réapproprier politique‑ ment une alternative perverse, dans laquelle une partie de la population française est publiquement soupçonnée de ne pas aimer assez, ou de ne pas aimer « comme il faut », son propre pays. Ce titre exprime bien le tiraillement de nombreuses personnes interrogées et leur identification paradoxale à la France, dans laquelle les sentiments de reconnaissance, de gratitude, de nostalgie vis‑à‑vis des amis et de la famille laissés derrière elles se mêlent à l'amertume, le ressentiment et l'hostilité vis‑à‑vis des élites politiques et médiatiques de leur pays.
Le sentiment paradoxal qui consiste « à aimer mais à quitter » a déjà été évoqué par Marwan Muhammad, fondateur du CCIF en conclusion de son ouvrage Nous (aussi) sommes la Nation[30], ainsi que par le journaliste Claude Askolovitch[31]. Il a aussi été souligné par un de nos enquêtés, Ali, qui habite à Alger et y travaille pour la même grande entreprise française qui l'employait en France. Dans un post intitulé « La France, elle m'aime ou je la quitte », publié sur le site LinkedIn en août 2018, il donne des détails sur sa décision de partir.
Les éléments qu'il fournit entrent en résonance avec de nombreux entretiens que nous avons menés. En outre, il rappelle le déferlement de haine dont il a été victime après sa publication, l'extrême agressivité de Génération identitaire, Riposte laïque, le Printemps républicain qui l'ont harcelé en ligne (E56). Il évoque également les nombreux soutiens qu'il a reçus de la part de personnes qui se sont reconnues dans son expérience, qu'elles envisagent ou non de quitter la France, comme lui.
Dans son texte, Ali se présente comme un jeune diplômé d'une école d'ingénieur en hautes technologies qui, « après des semaines de doutes, des mois de réflexion, des années de mal‑être, de tensions intérieures et de frustration », a pris une décision forte : « quitter mon pays, la France, pour d'autres horizons ». Puis il décrit de manière assez clinique et dépassionnée pourquoi l'atmosphère lui est devenue irrespirable :
« Ce sentiment s'est aggravé année après année jusqu'à en devenir insupportable aujourd'hui. Le sentiment de ne pas me sentir considéré comme un citoyen lambda. D'avoir droit à des traitements, des réactions, des regards, qui me mettent mal à l'aise et créent une atmosphère pesante dans laquelle j'étouffe. »
Il en veut « énormément aux médias et aux politiques de ce pays, qui jour après jour, entretiennent les divisions entre citoyens », avant de s'en prendre nommément à des figures médiatiques et politiques de l'islamophobie hexagonale. Il pose également la question :
Dois‑je avoir honte de dire que le Canada, pour y avoir vécu six mois, est le pays où je me suis le plus senti chez moi, le mieux accepté tel que j'étais ? Devant la France, pays où j'ai grandi, devant l'Algérie et l'Italie, pays de mes grands‑parents ? Que cette expérience m'a permis de prendre conscience que le mal-être que je ressentais jusque‑là en France n'était pas une fatalité, et que je pouvais probablement être plus épanoui au‑delà de ses frontières ?
Ces interrogations constituent l'essence même de notre ouvrage, dans lequel des gens comme Ali expriment leur sentiment d'injustice, leur mal‑être en France, leur sérénité (re)trouvée dans un pays dont beaucoup ne connaissaient presque rien au départ, leurs craintes également pour leurs proches restés au pays. Nous avons choisi de les suivre dans leur cheminement de façon chronologique, depuis leurs socialisations initiales en France, jusqu'à leur décision de partir, dans ses motivations immédiates et profondes, ses conditions pratiques et sa réalisation (choix du pays, premiers pas à l'arrivée, nouvel enracinement réel ou envisagé).
Nous finissons par le regard et le rapport pratique et symbolique que les personnes que nous avons rencontrées entretiennent désormais avec la France. On verra qu'elles évoquent souvent leur relation complexe d'attraction/répulsion vis‑à‑vis d'un pays où la grande majorité est née, selon qu'elles convoquent le souvenir de grandes figures nationales d'émancipation, de la littérature, de la culture populaire hexagonale dans laquelle elles ont baigné, ou, au contraire, qu'elles se souviennent du défilé d'éditorialistes sur CNews et de l'accumulation de polémiques depuis la première affaire du voile de Creil en 1989 jusqu'aux dernières sur le port de l'abaya dans les écoles en 2023, soit presque trente‑cinq ans plus tard.
*
Notes
[1] Tous les prénoms utilisés dans cette enquête ont été modifiés, en respectant leur consonance originelle. C'est pourquoi on a conservé, pour la version « pseudonymisée », soit une consonance manifestant l'appar‑ tenance confessionnelle et/ou ethnique (Mohammed, Karima), soit une consonance qui l'efface (Adam, Sofia), selon le prénom d'usage des per‑ sonnes interrogées. Ces choix de prénoms par les parents ne sont pas anodins, on le verra, ils reflètent l'intériorisation, par ces derniers, du fait que choisir certains prénoms qui sonnent « trop arabes » ou « trop musulmans » aurait des incidences négatives pour leur enfant, par exemple sur le marché du travail.
[2] Nous utilisons indifféremment « hijab », « foulard » ou « voile » dans cet ouvrage, et l'utilisons avec la voix active (« femme qui porte un foulard »), jamais à la voix passive (« femme voilée »). Ceci véhiculerait l'idée d'une absence de choix, d'une forme de soumission, qui ne corres‑ pond pas du tout à l'expérience des femmes interrogées.
[3] (E129) correspond à notre entretien n° 129. Pour une présentation succincte de chaque entretien (principales données socio‑démographiques de chaque enquêté·e), nous renvoyons à notre site Internet : https://love‑ leave.hypotheses.org/
[4] Entre autres : « “En France, j'avais le cul entre deux chaises” : Dubaï, terre promise pour les enfants d'immigrés », Le Parisien, 28 mars 2021 ; « Ces musulmanes portant le voile qui quittent la France pour trouver du travail en Angleterre », Slate, 30 novembre 2020 ; « Comment la Turquie courtise les Français musulmans », La Croix, 21 octobre 2020.
[5] Jérémy Mandin, « Leaving Europe : Emigration, aspirations and pathways of incorporation of Maghrebi French and Belgians in Montréal », CEDEM / Université de Liège, soutenue le 19 mars 2021, sous la direc‑ tion de Marco Martiniello.
[6] Jaafar Alloul, « Leaving Europe, Navigating Access : Status Migra‑ tion, Traveling Habitus, and Racial Capital in Euro‑Maghrebi Mobilities to the United Arab Emirates », soutenue le 02 juillet 2021 à l'Université de Louvain.
[7] Thomas Deltombe, L'Islam imaginaire. La construction médiatique de l'islamophobie en France, 1975-2005, Paris, La Découverte, 2007.
[8] Olivier Esteves, « Cartographier la vague réactionnaire dans les universités françaises », Médiapart, 14 février 2022 ; Michèle Zancarini‑ Fournel et Claude Gautier, De la défense des savoirs critiques. Quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche, Paris, La Découverte, 2022.
[9] Sur le sujet : Observatoire des libertés associatives, « Une nouvelle chasse aux sorcières », Enquête sur la répression des associations dans le cadre de la lutte contre l'islamisme, 2022 ; Julien Talpin, Bâillonner les quartiers. Comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, Ronchin, Les Étaques, 2020.
[10] Voir Haouès Seniguer, La République autoritaire. Islam de France et illusion républicaine (2015-2022), Bordeaux, Le Bord de l'eau, 2023.
[11] Albert Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty : Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge (Mass.), Havard University Press, 1970.
[12] Sans oublier que pour les personnes installées à Montréal, Bruxelles ou Genève, le sens du vouvoiement et du tutoiement n'est pas le même qu'en France.
[13] Sur les problèmes inhérents à l'expression « pays anglo‑saxons » : Émile Chabal, A Divided Republic. Nation, State and Citizenship in Contemporary France, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
[14] Donna Haraway, « Situated Knowledges : The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective », Feminist Studies, vol. 14, n° 3, 1988, p. 575‑599.
[15] Dossier coordonné par Silyane Larcher, « Positionnalités des cher‑ cheur.e.s minoritaires », Raisons politiques, vol. 1, n° 89, 2023, p. 5‑24 (ici, p. 13).
[16] Delphine Naudier et Maud Simonet (dir.), Des sociologues sans qualités ?, Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 2011.
[17] Philomena Essed, Understanding Everyday Racism : An Interdisciplinary Theory, Londres, Sage, 1991, p. 7.
[18] Cité dans Audrey Célestine, Une famille française. Des Antilles à Dunkerque en passant par l'Algérie, Paris, Textuel, 2018, p. 138‑139.
[19] Max Weber, Le savant et le Politique, 1919.
[20] Abdellali Hajjat, « Islamophobia and French Academia », Current Sociology, vol. 69, n° 5, 2021, p. 621‑640.
[21] Abdellali Hajjat revient sur son départ de France à l'occasion d'une controverse avec Nathalie Heinich dans l'émission Le Temps du débat (France Culture), https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le‑temps‑du‑debat/ le‑militantisme‑a‑l‑universite‑pose‑t‑il‑probleme‑9722930.
[22] Maboula Soumahoro, Le Triangle et l'Hexagone, Paris, La Découverte, 2020, p. 135.
[23] John S. Milloy, A National Crime : The Canadian Government and the residential School System, 1879 to 1986, Winnipeg, University of Manotiba Press, 2017 [1999], p. XLI, [notre traduction].
[24] Alana Lentin, Why Race Still Matters, Cambridge, Polity Press, 2020, p. 14 et p. 58‑59.
[25] Une micro‑agression peut se définir comme une parole, un geste, un comportement vécu comme hostile par un ou des membres d'un groupe minoritaire, souvent stigmatisé. D'apparence banale, la micro‑agression est perçue comme hostile même si elle ne provient pas nécessairement d'une volonté de blesser. Souvent, les micro‑agressions procèdent par accumulation : c'est leur multiplication qui est considérée comme intolérable.
[26] Sur le sujet : Houda Asal, « Islamophobie : la fabrique d'un nouveau concept. État des lieux de la recherche », Sociologie, vol. 5, n° 1, 2014, p. 13‑29.
[27] Voir Floya Anthias, « Evaluating “Diaspora” : Beyond Ethnicity ? », Sociology, vol. 32, n° 3, 1998, p. 557‑580 ; et plus généralement, Arjun Appa‑ durai, Modernity at Large : Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996.
[28] « M. Sarkozy veut ravir ses électeurs au FN et au MPF », Le Monde, 23 avril 2006.
[29] Voir Romain Huret, De l'Amérique ordinaire à l'État secret. Le cas Nixon, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
[30] Marwan Muhammad, Nous (aussi) sommes la Nation. Pourquoi il faut lutter contre l'islamophobie, Paris, La Découverte, 2017, p. 232.
[31] Claude Askolovitch, Nos mal-aimés. Ces musulmans dont la France ne veut pas, Paris, Grasset, 2013, p. 120‑121.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le tribunal sikh – Les systèmes judiciaires parallèles sont un danger pour les femmes

Les porte-paroles de la Cour sikhe la décrivent comme un mécanisme alternatif de résolution des conflits (ADR) fonctionnant dans le cadre des dispositions de la loi sur l'arbitrage de 1996. Ils s'attendent à ce qu'il traite principalement des questions familiales et des conflits liés aux gurdwara. Ils ont fait allusion à trois objectifs principaux préserver l'intégrité des mariages et des familles sikhs et réduire les taux de divorce réduire les frais de justice en facturant un montant minimal et en garantissant une résolution rapide des conflits aider les sikhs à éviter les retards dans le système judiciaire civil.
Ces actions sont présentées comme une forme de seva (service désintéressé) qui améliorera l'accès à la justice pour les Sikhs au Royaume-Uni.
Depuis plusieurs décennies, Southall Black Sisters (SBS), One Law for All et d'autres organisations au Royaume-Uni ont mis en évidence la manière dont les organismes religieux sapent et entravent activement l'accès à la justice et violent les droits des femmes minorisées, des enfants et des minorités religieuses au sein de ces communautés. C'est notamment le cas des victimes de violences domestiques et d'abus sexuels qui subissent des pressions constantes pour servir de médiateurs avec des partenaires violents et abusifs et des familles élargies, ainsi que pour céder aux demandes de droit de visite des enfants, même lorsque cela met en péril leur sécurité et le bien-être de leurs enfants. À ce jour, rien ne prouve que les institutions religieuses ont agi dans l'intérêt des plus vulnérables de nos communautés, quelque soit le nombre de femmes impliquées dans le fonctionnement de ces institutions. En revanche, il existe de nombreuses preuves qu'elles ont renforcé le pouvoir et le contrôle des maris, des membres masculins de la famille et des belles-mères, et qu'elles ont violé les droits des êtres humains.
En outre, les EIM religieux au Royaume-Uni ont été fondés par des hommes ayant une vision étroite, conservatrice et/ou fondamentaliste des femmes, du mariage et de la cellule familiale. Il s'agit de projets politico-religieux profondément investis dans l'institution du mariage et les structures familiales patriarcales et liés à des projets politiques plus vastes sur l'autonomie de la communauté. Rien ne prouve qu'il s'agisse d'agences apolitiques et bienveillantes motivées par la justice sociale et l'égalité. En effet, les exemples donnés par les porte-parole de The Sikh Court équivalent à un soutien au contrôle coercitif, à une atteinte significative à l'autonomie des femmes et au droit à la liberté de religion. Dans un exemple, la raison du divorce d'une femme sikhe est présentée comme une réaction mesquine au fait que son mari ne lavait pas ses propres sous-vêtements, alors qu'il s'avère que la femme luttait contre la présence autoritaire de sa belle-mère. Dans un autre exemple, une femme est critiquée pour avoir coupé ses cheveux et ceux de son fils, alors que les « droits religieux » de son ex-mari sont défendus.
Le SBS a présenté au gouvernement et à la Law Society des observations fondées sur des preuves. Ces soumissions citent une série d'exemples de cas (musulmans, hindous, sikhs et juifs) sur les pratiques discriminatoires des organismes d'arbitrage religieux qui instituent effectivement des systèmes juridiques parallèles sur les familles au sein des communautés minoritaires. Bien qu'il ait tenté de prendre ses distances avec le tribunal d'arbitrage musulman et les conseils de la charia en raison des critiques largement répandues à l'encontre de ces organismes, le tribunal sikh n'est pas différent dans ses objectifs.
Bien que les représentants du tribunal sikh affirment qu'ils ne sont pas un tribunal religieux parce qu'ils s'en remettent à l'Akal Takht d'Amritsar pour les jugements religieux, ils fonctionneront sur la base de « principes sikhs » instables qui sont eux-mêmes ouverts à l'interprétation et au débat. Ils revendiquent « l'égalité » et « l'intégrité » comme principes clés, mais si c'est le cas, pourquoi ne pas concentrer l'énergie sur la garantie que le système juridique britannique respecte ces principes ? Plus inquiétant encore, s'il ne s'agit pas d'un tribunal religieux, pourquoi ses membres ont-ils prêté serment d'allégeance au Panj Pyare et à l'Akal Takht, un édifice politico-religieux du Pendjab qui exerce une influence considérable sur les Pendjabis du monde entier.
Les conservateurs religieux cherchent à imposer leurs projets politiques et leur version particulière de la religion par le biais d'une série de voies juridiques, de projets éducatifs et de services d'aide sociale. Les SBS ont documenté la manière dont ils ont capitalisé sur les failles de la politique gouvernementale et sur le rétrécissement de l'État-providence, y compris les dispositions d'aide juridique sévèrement restreintes et une pression croissante sur le système judiciaire séculier, pour accroître leur propre capacité et légitimité à gouverner et à contrôler la vie des communautés minoritaires. En fait, le rapport du sommet sikh qui accompagne cette évolution présente précisément un plan d'autonomie élargie des communautés sikhes au Royaume-Uni. Les sikhs de Grande-Bretagne ne sont pas homogènes, mais une seule version du sikhisme est au cœur de ces initiatives. Cela conduira invariablement à l'institutionnalisation et au privilège de cette seule interprétation du sikhisme et donnera lieu à de nouvelles accusations de blasphème et d'apostasie contre ceux qui remettent en cause leur interprétation et leur autorité sur les sikhs du Royaume-Uni.
Nous, soussigné·es, appelons nos communautés et nos organismes publics à
* Renoncer à la nécessité d'un tribunal sikh et de tout autre tribunal religieux.
* Reconnaître que les organismes religieux pratiquent la discrimination à l'égard des femmes et des enfants.
* Exiger une loi unique pour toutes et tous.
* unir nos forces avec d'autres pour faire pression sur le gouvernement et sur les tribunaux civils et pénaux laïques existants afin de garantir que chacun ait accès à une bonne représentation et à une aide juridique et qu'il puisse faire valoir ses droits dans le cadre d'un système juridique laïque.
* Demander au gouvernement de ne pas autoriser l'utilisation de la loi sur l'arbitrage dans les affaires familiales, car cela constitue une discrimination à l'égard des femmes et des jeunes filles.
Les chefs religieux ne parlent pas en notre nom ! Une seule loi pour tous !
Signataires :
Southall Black Sisters (SBS)
One Law for All
Council of Ex-Muslims of Britain
Dr Sukhwant Dhaliwal
Professor Ravi K. Thiara
Professor Aisha K. Gill
Gurpreet Kaur Bhatti, Playwright
Professor Avtar Brah
Professor Virinder S. Kalra
Kiranjit Ahluwalia
Professor Kiran Kaur Sunar
Dr Permala Sehmar
Dr Sunny Dhillon
Baljit Banga
Yasmin Rehman
Rights of Women
Mandip Ghai, Solicitor
Juno Women's Aid
Women's Aid Federation of England
Anah Project
Advocacy After Fatal Domestic Abuse (AAFDA)
Respect
Kurdish and Middle Eastern Women's Organisation
IDAS (Independent Domestic Abuse Services)
Middle Eastern Women and Society Organisation (MEWSO)
Laïques Sans Frontières (LSF)
Professor Sundari Anitha
Professor Geetanjali Gangoli
Dr Fiona Vera-Gray
Jo Lovett, Researcher
Dr Maria Garner, Researcher
Dr Nikki Rutter
Professor Catherine Donovan
Pratibha Parmar, Filmmaker
Rana Ahmad, Atheist Refugee Relief Founder
Jayne Egerton, Broadcast Journalist
Mandana Hendessi, Author
Alice Bondi
Ibtissame Betty Lachgar, Alternative Movement for Individual Liberties (M.A.L.I.) Morocco
Annie Laurie Gaylor, Freedom From Religion Foundation Co-President
Dr Rose Rickford
Mariam Oyiza Aliyu, LETSAI NGO
Nadia El Fani, Filmmaker
Ahlam Akram, BASIRA British Arabs Supporting Universal Women's Rights
Dr Savin Bapir-Tardy
Paminder Parbha
Cinzia Sciuto, MicroMega
Maryam Namazie, Campaigner
Atieh Niknafs, Anti Theist Activist
Secularism Is A Women's Issue (SIAWI)
Marieme Helie Lucas, Campaigner
Professor Purna Sen
Dr Christophe Clesse
Professor Anna Seymour
Dr Windy Grendele
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sénégal : Gouvernance masculine, démocratie bafouée

Le remplacement du ministère de la Femme par celui de la Famille est une régression. Aucun secteur n'échappe à la compétence, l'expérience et le dévouement des femmes
Tiré de Entre les lignes et les mots
Collectif des citoyen.ne.s pour le respect et la préservation des droits des femmes
Alors que le Sénégal s'est positionné comme pionnier de l'égalité de genre en Afrique, la nomination des membres du gouvernement laisse les organisations féminines circonspectes. Seulement 4 emmes sur 34 postes, une disproportion qui appelle des mesures correctrices selon un collectif des citoyen.ne.s pour le respect et la préservation des droits des femmes dont nous publions la déclaration ci-dessous :
« De la nécessité d'inclure les femmes dans les instances de prise de décision pour une gouvernance véritablement démocratique !
Nous avons accueilli avec une grande satisfaction l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'espoir fondé en ce président est à la hauteur de la rupture prônée.
Nous tenons aussi à rappeler le combat des femmes pour la tenue d'une élection présidentielle apaisée dans le respect du calendrier républicain. C'est au nom de ce même combat, en tant qu'organisations, personnalités indépendantes, et collectif de citoyen.ne.s soucieux du respect et de la préservation des droits des femmes, que nous alertons sur la nécessité d'une gouvernance démocratique inclusive avec une représentativité substantielle des femmes aux sphères de décisions publiques. La liste des membres du premier gouvernement, parue ce 5 avril 2024, laisse très peu de place aux femmes. Sur 25 ministres, 5 secrétaires d'État, et 4 membres du cabinet du chef d'État, soit 34 postes, seules quatre femmes sont présentes. Cette inqualifiable sous-représentation induit une perte intolérable d'intelligences et de visions que seuls le pluralisme et l'inclusion permettent de garantir. Il n'y a aucun secteur dans lequel on ne trouve des femmes qui allient compétence, expérience et dévouement de premier ordre.
Cette disproportion est d'autant plus regrettable que c'est le Sénégal qui, dès 2004, a proposé à la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine, l'adoption d'une Déclaration solennelle pour l'égalité de genre en Afrique, posant ainsi les jalons vers une Commission de l'Union africaine (CUA) paritaire pour ne citer que cet exemple. De plus, l'article 7 de notre Constitution dispose : « les hommes et les femmes sont égaux en droit. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions ».
Doit-on encore rappeler qu'à chaque étape de la construction de notre Nation, nous avons été présentes et avons été actrices incontournables dans toutes les luttes pour l'indépendance, l'émancipation, la justice sociale, le bien-être de tous ? Il est important de rappeler qu'aucun pays ne s'est développé en laissant en marge les femmes.
C'est pourquoi, outre la faible représentativité des femmes, nous sommes circonspectes sur le remplacement du ministère de la Femme, de la famille et de la protection des enfants par le ministère de la Famille et des solidarités. Cette appellation est une véritable régression. L'emphase portée sur les femmes et les enfants soulignait précisément l'urgence d'élaborer des politiques publiques destinées à mettre fin aux inégalités de genre (économiques, éducatives, sanitaires, politiques, foncières, etc.) et à améliorer les conditions de vie de celles qui demeurent encore les plus vulnérables à la pauvreté et à la violence, et sur qui, reposent toujours la charge du soin des plus petits et des plus âgés. Soulignons aussi de manière définitive ceci : bien que les femmes jouent un rôle central dans la cellule familiale, elles sont des êtres à part entière qui existent en dehors de la sphère familiale. Les assimiler à cette dernière, c'est nier leur droit à exister dans leur multidimensionnalité.
Pour toutes ces raisons, nous demandons que cette erreur de départ soit rectifiée par la nomination de femmes dans les directions nationales et les instances administratives. De surcroît, nous demandons le renforcement des cellules genre déjà présentes au niveau des différents ministères pour une mise en œuvre transversale de la Stratégie Nationale d'Équité et d'Égalité de Genre (SNEEG) en collaboration avec la Direction de l'équité et l'égalité de genre (Deeg) et le Programme d'appui à la stratégie d'équité et d'égalité de genre (pasneeg).
« Poursuivre, intensifier et accélérer les efforts pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux », c'est ce à quoi l'État du Sénégal s'était engagé dans le cadre de la Déclaration Solennelle pour l'Egalité de Genre en Afrique (DSEGA) et c'est à quoi nous invitons le nouveau gouvernement qui définit son projet de société comme panafricain.
Dans notre volonté de veiller à ce que ce nouveau gouvernement, celui de tous les Sénégalais et Sénégalaises, remplisse ses missions de rupture pour plus de gouvernance démocratique, de justice sociale, d'équité, nous continuerons d'alerter et de faire des propositions constructives sur le besoin d'inclusion des femmes et de représentation égalitaire. »
Voir la liste des signataires
https://www.afriquesenlutte.org/afrique-de-l-ouest/senegal/article/senegal-gouvernance-masculine-democratie-bafouee
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Monsieur le Président de la République, votre inaction tue

Le 14 mai, des militant·es du collectif NousToutes ont déposé 940 bateaux en papier rouge sur la Seine, pour symboliser les 940 victimes de féminicides des sept dernières années. Dans cette lettre ouverte, nous rappelons au Président de la République leurs prénoms, mais aussi et surtout, que des solutions concrètes existent.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/24/monsieur-le-president-de-la-republique-votre-inaction-tue/
Le vendredi 3 mai, à Saint-Jean-de-Luz, une femme de 34 ans a été tuée à coups de marteau. Elle avait été hospitalisée 15 jours avant, après avoir « chuté » de la fenêtre d'une chambre d'hôtel. À l'époque, son compagnon avait été placé en garde à vue puis libéré alors même que cet homme était déjà connu des services de police pour violences conjugales.
Cette histoire vous choque ?
Pourtant, ce n'est qu'une parmi les 940 femmes assassinées depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Depuis début 2024, c'est près d'un féminicide ou tentative de féminicide par jour.
Mardi 14 mai 2024, 940 bateaux en papier rouge portant le prénom des femmes assassinées ont été mis à l'eau sur la Seine (papier et encre biodégradables).
Face au silence complice et meurtrier du gouvernement d'Emmanuel Macron, #NousToutes a décidé de leur rendre femmage pour ne jamais les oublier. Les militant.es ont choisi de réaliser une action symbolique forte pour dénoncer l'absence de volonté politique et de moyens financiers pour lutter efficacement contre les violences de genre.
Pour l'anniversaire de son arrivée au pouvoir, les militant.es ont également rédigé une lettre ouverte au Président de la République pour conjurer le gouvernement de, enfin, se saisir de ses responsabilités. Cette lettre énonce le prénom et l'âge des 940 femmes, jeunes filles et petites filles ainsi que les revendications du collectif.
Nous espérons que la réponse sera à la hauteur des enjeux, immenses.
Nous avons également adressé cette lettre à des député.es et sénateur.rices pour qu'iels la relaient dans leur assemblée respective.
Pour soutenir et relayer notre action, vous pouvez télécharger cette lettre
À l'attention d'Emmanuel Macron, président de la République et l'adresser sans l'affranchir à Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, Palais de l'Elysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris
***
Monsieur le Président de la République,
Depuis le début de votre mandat le 14 mai 2017, au moins 940 femmes ont été tuées par des hommes parce qu'elles étaient des femmes. Votre inaction tue.
Vous et vos gouvernements n'avez rien fait pour toutes ces femmes. Alors que des solutions existent, largement partagées :
* La mise en place d'un budget minimum de 2,6 milliards d'euros par an pour la lutte contre les violences de genre et l'adoption de politiques publiques adaptées.
* L'inscription du féminicide dans le code pénal avec une définition qui s'étend au-delà de la sphère conjugale et incluant le suicide forcé.
* La mise en place d'un décompte institutionnel par l'État qui inclut tous les féminicides, y compris par suicide forcé et hors sphère conjugale.
* La formation obligatoire, initiale et continue des professionnel·les susceptibles d'être en lien avec des personnes victimes de violence et l'application de la loi du 4 août 2014
* Concernant la formation des professionnel·les de l'éducation, de la santé, du social, de la justice, de la police, des personnels des entreprises (notamment personnel encadrant, institutions représentatives du personnel et services RH) à la détection des violences, à la prise en charge des victimes et à la prévention de toutes les violences sexistes et sexuelles dont les violences obstétricales et gynécologiques, les violences psychologiques et les violences économiques.
* Le déploiement massif du personnel accompagnant et des dispositifs de protection existants via l'augmentation du nombre de personnels en charge de l'accompagnement et de la protection des victimes dans les domaines de la justice, santé, travail social et éducation, la généralisation de l'accès aux ordonnances de protection et la création de 15 000 nouvelles places d'hébergement dédiées chaque année.
* La mise en place d'une aide financière pour assurer la sécurité et l'accompagnement des victimes de violences de genre ainsi que leur famille. Garantir la prise en charge automatique des frais médicaux (incluant l'accompagnement psychologique) et juridiques dans le cadre du parcours de sortie des violences.
* Le maintien et l'augmentation des financements pour les associations qui remplissent des missions de service public d'accueil, d'hébergement et de solidarité envers les victimes de violences.
* La mise en place d'un plan d'urgence pour la protection de l'enfance.
* L'éducation des enfants à l'égalité des genres et au consentement. Notamment par l'application de la loi de 2001 prévoyant 3 séances par an à l'éducation à la vie sexuelle et affective dès le premier cycle de scolarité et jusqu'à la terminale.
* Une modification du code pénal afin de redéfinir l'agression sexuelle et le viol pour y intégrer la notion de consentement et prendre en compte le caractère sériel des agressions sexuelles et des viols.
Cessez vos effets d'annonce ! Agissez !
Voici le prénom et l'âge des femmes qui ont été tuées. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas :
Mariame 32 ans ; Guenaelle 56 ans ; Dorothée 41 ans ; Leila 89 ans ; Aurélie 34 ans ; Odette 75 ans ; Mana 25 ans ; Nafia 59 ans ; Lou 18 ans ; Shpresa 36 ans ; Danielle 62 ans ; Fatim 25 ans ; Jocelyne 62 ans ; Zenash 27 ans ; Mauricette 70 ans ; Jacqueline 69 ans ; Muriel 40 ans ; Marie-Christine 60 ans ; Noémie 30 ans ; Chantal 55 ans ; Christine 44 ans ; Céline 47 ans ; Stéphanie 36 ans ; Annie 67 ans ; Alexia 29 ans ; Jeanine 66 ans ; Corine 42 ans ; Catherine 50 ans ; Nicole 56 ans ; Yamina 42 ans ; Linda 51 ans ; Marielle 50 ans ; Myriam 50 ans ; Marine-Sophie 24 ans ; Emmanuelle 26 ans ; Joséphine 99 ans ; Aude 34 ans ; une femme 34 ans ; Marie-Anne 24 ans ; Lauren 24 ans ; Letitia 42 ans ; Leïla 34 ans ; Carole 50 ans ; Gisèle 52 ans ; Karine ; Fatema 29 ans ; Sindy 34 ans ; Noëlle 65 ans ; Natacha 54 ans ; Laura 18 ans ; Anne-Marie 68 ans ; Geneviève 76 ans ; Thalie 36 ans ; Hülya 35 ans ; Brigitte 64 ans ; Aurélie 29 ans ; Delphine 42 ans ; Aïcha 38 ans ; Alba 35 ans ; Mounia 30 ans ; Frédérique 51 ans ; Marie 58 ans ; Dominique 52 ans ; Nadine 50 ans ; Yasmina 37 ans ; Natacha 38 ans ; Michelle 44 ans ; Florence 31 ans ;
Estelle 36 ans ; Brigitte 62 ans ; Evelyne 69 ans ; Sandra 32 ans ; Marybelle 34 ans ; Marie-Claire 67 ans ; Charlène 28 ans ; Stella 41 ans ; Maryline 45 ans ; Rhadia 46 ans ; Virginie 48 ans ; Sophie 90 ans ; Emilie 37 ans ; Colette 79 ans ; Liliya 49 ans ; Margaux 29 ans ; Karma Tsering 29 ans ; Johane 48 ans ; Sadia 47 ans ; Aurélie 32 ans ; Nora 46 ans ; Lucie-Anne 47 ans ; Vanessa 36 ans ; Céline 35 ans ; Lesline 38 ans ; Manon 24 ans ; Natacha 39 ans ; Nicoleta 26 ans ; Bernadette 67 ans ; Magali 40 ans ; Laura 32 ans ; Marianne 41 ans ; Denise 72 ans ; Patricia 62 ans ; Sylviane 60 ans ; Claire 49 ans ; Johanna 30 ans ; Lisa 22 ans ; Sylvia 42 ans ; Sandrine 41 ans ; Sophie 51 ans ; Laetitia 45 ans ; Marie 28 ans ; Une femme 51 ans ; Marie 65 ans ; Agnès 49 ans ; Audrey 35 ans ; Julie 25 ans ; Seloua quinquagénaire ; Razia 34 ans ; Lydia 53 ans ; Adelissa 21 ans ; Sylvie 55 ans ; Amélia 38 ans ; Raouiyah 39 ans ; Magali 21 ans ; Noelle 76 ans ; Louisette 85 ans ; Jasmine 64 ans ; Hélène 58 ans ; Marie-Amélie 38 ans ; Monique 68 ans ; Valérie 53 ans ; Marie-Bergerette 43 ans ; Martine 56 ans ; Michelle 84 ans ; Alvina 36 ans ; Estelle 36 ans ; Danièle 72 ans ; Fatma 58 ans ; Isabelle 50 ans ; Jessica 26 ans ; Hélène 36 ans ; Ateraita 29ans ; Antonia 56 ans ; Audrey 36 ans ; Akila 73 ans ; Charlotte 27 ans ;
Stéphanie 35 ans ; Ana, trentenaire ; Najat 78 ans ; Jacqueline 56 ans ; Marie-Thérèse, octogénaire ; Alexandrine 42 ans ; Corinne 51 ans ; Christine 53 ans ; Manuela 36 ans ; Rose quadragénaire ; Viviane 68 ans ; Agnès 54 ans ; Linda 43 ans ; Laëtitia trentenaire ; Marnia 40 ans ; Marie Thérèse 76 ans ; Marion 35 ans ; Nathalie 51 ans ; Aline 35 ans ; Marie-Géraldine 44 ans ; Marie-Claire 58 ans ; Magali 24 ans ; Lucienne 31 ans ; Graziella trentenaire ; Sonia 45 ans ; Valérie 46 ans ; Magdalena 31 ans ; Lucette octogénaire ; Marion 28 ans ; Eliane 83 ans ; Vanina 19 ans ; Réjane 70 ans ; Marie-Jo 72 ans ; Elodie 28 ans ; Maria 63 ans ; Roxanne 32 ans ; Céline 39 ans ; Alicia 14 ans ; Isabelle 38 ans ; Sevilay 40 ans ; Maria 64ans ; Vivienne 59 ans ; Linda 50 ans ; Paméla 36 ans ; Laura 39 ans ; Jacqueline 81 ans ; Christiane 80 ans ; Catherine quinquagénaire ; Delphine 34 ans ; Aline 34 ans ; Annie septuagénaire ; Nabilla 23 ans ; Danielle 70 ans ; Virginie 42 ans ; Claudine 66 ans ; Nelly 52 ans ; Estelle 34 ans ; Francine 58 ans ; Lucienne 88 ans ; Nathalie 47 ans ; Sylvie 48 ans ; Catherine 46 ans ; Candice quadragénaire ; Sylvie 43 ans ; Marie-Christine 60 ans ; Jessica 41 ans ; Georgette 75 ans ; Laurie 29 ans ; Hajer 15 ans ; Nadia 43 ans ; Séverine 32 ans ; Maxence 17 ans ; Romy ; Jocelyne sexagénaire ; Marie-Pascale 55 ans ; Lucia 58 ans ; Sylvie 45 ans ; Marie-Claude 65 ans ; Floriane 16 ans ; Jessica 29 ans ; Audrey 28 ans ; Rebecca 44 ans ; Mariette 65 ans ; Régine 92 ans ; Hélèna 54 ans ; Marie-Eliza 26 ans ; Sandrine 46 ans ; Marcelle 80 ans ; Sabrina 38 ans ;
Nicole 55 ans ; Laëtitia 34 ans ; Pascale 55 ans ; Florence 55 ans ; Priya 30 ans ; Marinette 85 ans ; Aurelia 22 ans ; Elea 24 ans ; Aminata 31 ans ; Karine 48 ans ; Sylvia 40 ans ; Aurore 34 ans ; Nathalie 53 ans ; Jacqueline 87 ans ; Monique 83 ans ; Anne-Marie 54 ans ; Shaïna 15 ans ; Safia 35 ans ; Marie-Claude 70 ans ; Naima 31 ans ; Bernadette 73 ans ; Annick 75 ans ; Valérie 51 ans ; Marie 88 ans ; Hang Rol 40 ans ; Marie-Claire 72 ans ; Delphine 33 ans ; Nathalie 53 ans ; Fadela 21 ans ; Berthe dite Natacha 38 ans ; Suzanne 69 ans ; Geonovessa 86 ans ; Janice 30 ans ; Gracieuse 39 ans ; Audrey 27 ans ; Chafia 53 ans ; Johanna 27 ans ; Monique 72 ans ; Mauricette 76 ans ; Aurélie 50 ans ; Fatima 92 ans ; Salomé 21 ans ; Céline 41 ans ; Sarah 39 ans ; Maguy 52 ans ; Clothilde 35 ans ; Eliane 26 ans ; Euphémie 49 ans ; Marianne 37 ans ; Denise 58 ans ; Irina 22 ans ; Martine 62 ans ; Antoinette 76 ans ; Jackie 71 ans ; Ophélie 28 ans ; Corinne 18 ans ; Chloé 29 ans ; Lucette 80 ans ; Mélissa 26 ans ; Stéphanie 35 ans ; Bernadette 43 ans ; Yvonne 86 ans ; Daisy 54 ans ; Yvonne 76 ans ; Samantha 43 ans ; Catherine 47 ans ; Laura 30 ans ; Christelle 32 ans ; Ermira 29 ans ; Isabelle 37 ans ; Leïla 20 ans ; Coralie 33 ans ; Michèle 62 ans ;
Chantal 72 ans ; Justine 20 ans ; Audrey 37 ans ; Mayie 81 ans ; Maïté 36 ans ; Dounia 46 ans ; Priscilla 29 ans ; Alina 31 ans ; Mariette 65 ans ; Nathalie 47 ans ; Mambu 64 ans ; Maryline 49 ans ; Pierrette 57 ans ; Gwénaelle 37 ans ; Moumna 56 ans ; Laura 22 ans ; Martine 60 ans ; Marie-Alice 53 ans ; Martine 64 ans ; Sandra 31 ans ; Chloé 33 ans ; Yaroslava 44 ans ; Danielle 74 ans ; Sandra 25 ans ; Nathalie 53 ans ; Marinette 85 ans ; Dalila 50 ans ; Chantal ; Céline 32 ans ; Stéphanie 39 ans ; Caroline 55 ans ; Marie-Josée 56 ans ; Fabienne 51 ans ; Sophie 35 ans ; Babeth 43 ans ; Dolorès 40 ans ; Georgette 84 ans ; Chantal 60 ans ; Julie 35 ans ; Maria ; Maureen 29 ans ; Hilal 30 ans ; Nicole 85 ans ; Nelly 46 ans ; Ginette 89 ans ; Gaëlle 22 ans ; Josette 66 ans ; Marie 66 ans ; Samira 29 ans ; Céline 38 ans ; Caroline 30 ans ; Simone 81 ans ; Sylvie 56 ans ; Gulçin 34ans ; Patricia 51 ans ; Cherline 40 ans ; Isabelle 48 ans ; Béatrice 51 ans ; Michèle 72 ans ; Guo 49 ans ; Christine 54 ans ; Nadine 49 ans ; Séverine 46 ans ; Félicie 90 ans ; Céline 48 ans ; Taïna 20 ans ; Pascale 56 ans ; Monica 29 ans ; Nora 44 ans ; une femme septuagénaire ; Chantal 55 ans ; Doona 19 ans ; Avril Luna 17 ans ; Jessyca 38 ans ; Sylvie 61ans ; Delphine 33 ans ; Karine 65 ans ; Nathalie 55 ans ; Kim 31 ans ; Karine 45ans ; Yvonne 81 ans ; Une femme 85 ans ; Yasemin 25 ans ; Assia 32 ans ; Cécile 44 ans ; Valérie 51 ans ; Sylvie 59 ans ; Monique 77 ans ; Gisèle 81 ans ; Eliane 59 ans ; Nathalie 51 ans ; Lucette 78 ans ; France 56 ans ; Sandy 33 ans ; Une femme 48 ans ; Nicole 79 ans ; Camille 32 ans ; Sonia 47 ans ; Une femme 76 ans ; Laetitia 38 ans ; Maelys 26 ans ; Catherine 47 ans ; Mélissa 42 ans ; Valérie quadragénaire ; Aurélie 38 ans ; Rejane 88 ans ; Nirojini ; Carine 24 ans ; Karine 51 ans ; Christine 58 ans ; Franciele 29 ans ; Aurélie 43 ans ; Séphanie 43 ans ; Alexandra 30 ans ; Khaddija 48 ans ; Aurore 40 ans ; Brigitte 59 ans ; Silvina ; Natacha 43 ans ; Korotoume 30 ans ; Lorelei 27 ans ; Manon 19 ans ; Hanane 37 ans ; Laure 52 ans ; Céline 38 ans ; Virginie 46 ans ; Déborah 29 ans ; Simone 76 ans ; Joëlle 50 ans ; Geneviève 42 ans ; Monica Andreea 51 ans ; Tiffany 22 ans ; Linda 37 ans ; Madalena 40 ans ; Emmanuelle 46 ans ; Myriam 37 ans ; Barbara 47 ans ; Bettina 53 ans ; Dialine alias Fétia 29 ans ; Karina 25 ans ; Fatiha 52 ans ; Brigitte 68 ans ; Marcelle 84 ans ; Celene 55 ans ; Anne 83 ans ; Sabrina 21 ans ; Olivia 33 ans ; Lisiane 70 ans ; Séverine 31 ans ; Grâce 22 ans ; Salma 21 ans ; Marguerite 90 ans ; Sylvie 45 ans ; Jennifer 35 ans ; Magdalena 33 ans ; Florence 49 ans ; Sylvie 50 ans ; Virginie 41 ans ; Claudette 80 ans ; Andrée 86ans ; Marie-Amélie 53ans ; Gwenaëlle 34ans ; Aissatou Billguissa (Aïcha) 25 ans ; Véronique 50 ans ; Thérèse 80 ans ; Brigitte 67 ans ; Georgette 88 ans ; Jaqueline 23 ans ; Mélanie 35 ans ; Pascaline 60 ans ; Dina 55 ans ; Valérie 47 ans ; Jeannine 88 ans ; Valérie 49 ans ; Laetitia 31 ans ; Anne-Sophie 48 ans ; Raymonde 84 ans ; Sté ; Jay 16 ans ; Sasha 22ans ; Tal 29 ans ; Paula 51 ans ; Ambre 49ans ; Ivanna 31 ans ; Erminah 28 ans ; Corinne 56 ans ; Mary quinquagénaire ; Nadine 54 ans ; Myrjana 22 ans ;
Katy 43 ans ; Elisabeth 51 ans ; Irène 59 ans ; Laurence 53 ans ; Magalie 35 ans ; Bouchra 44 ans ; Une femme 83 ans ; Marie Josiane 60 ans ; Une femme 85 ans ; Valérie 49 ans ; Lise May 55ans ; Christine 50ans ; Cindy 20ans ; Sofya 34ans ; Marie69ans ; Une femme 59ans ; Bernadette 74 ans ; Une femme septuagénaire ; Elga 47 ans ; Karine 50 ans ; Nadège 37 ans ; Jennifer 24 ans ; Adeline 30 ans ; Willinelle 23 ans ; Léa 23 ans ; Yoselis 51 ans ; Une femme 88 ans ; Une femme 66 ans ; Hamana 38 ans ; Une femme 62 ans ; Ivana 39 ans ; Carole 38 ans ; Clara 18 ans ; Lili 20 ans ; Une femme 86 ans ; Une femme 61 ans ; Une femme 83 ans ; Lauréna 33 ans ; Une femme 26 ans ; Une femme 48 ans ; Une femme 38 ans ; Sylvie 58 ans ; Bouchra 43 ans ; Lætitia 54 ans ; Delphine 36 ans ; Doriane 32 ans ; Une femme 85 ans ; Françoise sexagénaire ; Daniela 48 ans ; Augustine 26 ans ; Gabrielle 24 ans ; Sandra 31 ans ; Rachel quadragénaire ; Sarah 27 ans ; Cécilia 33 ans ; Une femme, 39 ans ; Jocelyne 55 ans ; Angélique 32 ans ; Karine 46 ans ; Une femme 46 ans ; Doris 48ans ; Jennifer 40ans ; Christiane 77 ans ; Aurélie 33 ans ; Odile 62ans ; Mezgebe 30 ans ; Stéphanie 22 ans ; Claire 34 ans ; Coralie 32 ans ; Dominique 69 ans ; Chahinez 31 ans ;
Haby 27ans ; Une femme 73 ans ; Une femme 72ans ; Meriyam 40ans ; Rose May 71 ans ; Germaine 74 ans ; Gloria 46 ans ; Céline 46 ans ; Aurélie 39 ans ; Louiza 41 ans ; Nadia 81 ans ; Jani 36 ans ; Marie-Jeanne 75 ans ; Une femme septuagénaire ; Pascale 55 ans ; Magali 42 ans ; Peggy 45 ans ; Annick 51 ans ; Amélie 34 ans ; Sandrine 23 ans ; Geneviève 78 ans ; Alisha 14 ans ; Jeannette 87 ans ; Fatima 30 ans ; Stella 46 ans ; Muriel 47 ans ; Stéphanie 31 ans ; Martine 61 ans ; Iraida 43 ans ; Laura 34 ans ; Caroline 29 ans ; Rabia 73 ans ; Saliha 24 ans ; Isabelle 27 ans ; Rosa 41 ans ; Annie septuagénaire ; Laura 21 ans ; Ashley 16 ans ; Leslie 22 ans ; Une femme 50 ans ; Une femme 23 ans ; Molka 31 ans ; Jacqueline 67 ans ; Une femme 30 ans ; Florence 48 ans ; Une femme 70 ans ; Lucienne 68 ans ; Sophie 22 ans ; Diana 40 ans ; Dominique 68 ans ; Une femme 65 ans ; Émilie 89ans ; Laetitia 12 ans ; Dominique 64 ans ; Une femme 60 ans ; Une femme 76 ans ; Laurence 56 ans ; Une femme 53 ans ; Une femme 40ans ; Sara 40 ans ; Une femme 90 ans ; Une femme 51 ans ; Bérénice 25 ans ; Brigitte 62 ans ; Une femme 60 ans ; Vanesa 14 ans ; Sabah 49 ans ; Chantal 65 ans ; Edwige 35 ans ; Véronique 59 ans ; Une femme 34 ans ; Hélana 19 ans ; Une femme 69 ans ; Charlotte 49 ans ;
Johanna 27 ans ; Une femme 60 ans ; Florence 38 ans ; Une femme 35 ans ; Une femme 40 ans ; Justine 20 ans ; Nadia 47 ans ; Kimberly 23 ans ; Une femme 78 ans ; Une femme 36 ans ; Amélie 30 ans ; Une femme 71 ans ; Une femme 60 ans ; Une femme 40 ans ; Sabine 43 ans ; Edith 60 ans ; Sasia 30 ans ; Une femme 32 ans ; Élodie 34 ans ; Charlène 36 ans ; Marie-Antoinette 70 ans ; Marion 43 ans ; Ghania 50 ans ; Une femme 74 ans ; Linda 52 ans ; Une femme 52 ans ; Sylveline 49 ans ; Clara 18 ans ; Une femme 86 ans ; Marie-Josèphe 54 ans ; Clothilde 31 ans ; Magali 42 ans ; Rianne 22 ans ; Sonia 51 ans ; Anne-Françoise 58 ans ; Tricia 29 ans ; Marie-Lise 64 ans ; Nabou 14 ans ; Une femme 80 ans ; Marie-Agnès 33 ans ; Kadia 50 ans ; Aurélie 32 ans ; Malgorzata 51 ans ; Une femme 47 ans ; Edina 31 ans ; Nina 35 ans ; Laetitia 51 ans ; Rita 44 ans ; Selen 18 ans ; Une femme 73 ans ; Une femme 62 ans ; Cristal 26 ans ; Martine 68 ans ; Monique 78 ans ; Sandrine 35 ans ; Patricia 51 ans ; Emma 13 ans ; Valéria 34 ans ; Sylvie 60 ans ; Claire 38 ans ; Sarah 32 ans ; Audrey 33 ans ; Nathalie 33 ans ; Julie 26 ans ; Liza 31 ans ; Lili 32 ans ; Sandra 40 ans ; Marie-Reine 36 ans ; Kumrije 44 ans ; Jennifer 25 ans ; Amelia 26 ans ; Kathryn 65 ans ; Véronique 45 ans ; Annick 75 ans ; Émilie 25 ans ; Anna 36 ans ; Marie 45 ans ; Mélanie 39 ans ; Une femme 77 ans ; Nathalie 47 ans ; Nadège 44 ans ; Une femme 51 ans ; Une femme 66 ans ; Farida 50 ans ; Une femme 29 ans ; Kethia 30 ans ; Dehbia 28 ans ;
Monique 75 ans ; Beatriz 38 ans ; Angélique 27 ans ; Elise 50 ans ; Nadia 62 ans ; Alessandra 46 ans ; Jocelyne 65 ans ; Lucia 49 ans ; Laura 31 ans ; Une femme 69 ans ; Une femme 95 ans ; Une femme 51 ans ; Une femme 60 ans ; Amanda 28 ans ; Une femme 45 ans ; Simone 80 ans ; Nana 22 ans ; Céline 20 ans ; Une femme 57 ans ; Amélie 21 ans ; Caroline 24 ans ; Elsa-Marie 29 ans ; Lisa 45 ans ; Muriel 56 ans ; Éléonore 27 ans ; Béatrice 35 ans ; Alison 49 ans ; Une femme 55 ans ; Doina 31 ans ; Une femme 70 ans ; Danielle 74 ans ; Zohra 38 ans ; Mélodie 34 ans ; Une femme 81 ans ; Betty 4 5ans ; Mélanie 36 ans ; Catherine 58 ans ; Danielle 26 ans ; Patricia 52 ans ; Claire 42 ans ; Une femme 38 ans ; Sophie 50 ans ; Irène 82 ans ; Jeanine 92 ans ; Madison 24 ans ; Une femme 80 ans ; Chantal 74 ans ; Jessyca 46 ans ; Giuliana 37 ans ; Jemima 29ans ; Une femme 51 ans ; Une femme 24 ans ; Maeva 28 ans ; Fabienne 68 ans ; Loana 10 ans ; Une femme 93 ans ; Une femme 61 ans ; Assunta 85 ans ; Une femme 50 ans ;
Yasmina 41 ans ; Séverine 47 ans ; Hélène 55 ans ; Édith 88 ans ; Mouna 51 ans ; Mauricette 90 ans ; Céline 42 ans ; Caroline 38 ans ; Monique 61 ans ; Agnès 78 ans ; Emmanuelle 57 ans ; Karen 42 ans ; Taghreed 57 ans ; Marie-Christine 39 ans ; Une femme 30 ans ; Nacera 53 ans ; Dana 26 ans ; Samar 63 ans ; Élodie 34 ans ; Marie-Astrid 39 ans ; Agnès 80 ans ; Jacqueline 27 ans ; Cindy 38 ans ; Hélène 57 ans ; Sylvie 58 ans ; Kugamany 85 ans ; Djeneba 38 ans ; Madouda 38 ans ; Armelle alias Deo 44 ans ; Hadjira 45 ans ; Maïté 32 ans ; Martine 60 ans ; Nouara 62 ans ; Nadine 33 ans ; Adélaïde 40 ans ; Aicha 40 ans ; Brigitte 58 ans ; Karima 47 ans ; Céline 51 ans ; Alicia 18 ans ; Julie 29 ans ; Sophie 60 ans ; Karine 54 ans ; Nelly 40 ans ; Sélina 13 ans ; Sonia 29 ans ; Nathalie 48 ans ; Aline 39 ans ; Valérie 56 ans ; Iris 24 ans ; Marie 72 ans ; Cagla 36 ans ; Eliane 95 ans ; Annick 86 ans ; Audrey 41 ans ; Laura 27 ans ; Chloé 5 ans ; Giovanna 41 ans ; Nadine 63 ans ; Manon 22 ans ; Fatima 40 ans ; Halima 26 ans ; Corinne 64 ans ; Héléna 20 ans ; Rose 5 ans ; Nisrine 25 ans ; Madalina Gabriela 26 ans ; Luna 22 ans ; Sandra 36ans ; Yamina 47 ans ; Francisca 47 ans ; Cécile 48 ans ; Mathilda 34 ans ; Isabelle 36 ans ; Nadège 48 ans ; Hadas 39 ans ; Nelly 50 ans ; Fathia/Fatiha 27 ans ; Cathy/Catherine 54 ans ; Nacera 53 ans ; Élisa 24 ans ; Marie-Antoinette 75 ans ; Assia 46 ans ;
Heide 44 ans ; Sophie 47 ans ; Laure 28 ans ; Neda/Valéria/Valéryia 51 ans ; Séverine 43 ans ; Flora 34 ans ; Marina 45 ans ; Laurence 47 ans ; Marie-Camille 37 ans ; Sihem 18 ans ; Magdalena 29 ans ; Catherine 46 ans ; Mongia 73 ans ; Eva 20 ans ; Angélique 22 ans ; Catherine 47 ans ; Valérie 52 ans ; Virginie 46 ans ; Claude 60 ans ; Shanon 13 ans ; Alexandra 36 ans ; Une femme 43 ans ; Jeannette 88 ans ; Une femme 31 ans ; Une femme 85 ans ; Une femme 55 ans ; Une femme 45 ans ; Alicia 28 ans ; Une femme 35 ans ; Gigi 44 ans ; Mailyss 18 ans ; Pauline 32 ans ; Marie-Pierre 66 ans ; Hayatte 38 ans ; Emma 24 ans ; Marie-Antoinette 86 ans ; Une femme 15 ans ; Lauren 29 ans ; Loréna 22 ans ; Cynthia 45 ans ; Une femme 95 ans ; Une femme 76 ans ; Une femme 56 ans ; Une femme 77 ans ; Édith 54 ans ; Une femme 64 ans ; Une femme 72 ans ; Christelle 29 ans ; Magali 52 ans ; Brigitte 63 ans ; Une femme 28 ans ; Michelle 60 ans ; Une femme 29 ans ; Une femme 56 ans ; Leïla 50ans ; Asmina 29 ans ; Louane 16 ans ; Ghislaine 75 ans ; Martine 62 ans ; Lucie 29 ans ; Nathalie ; Yasmin 24 ans ; Corinne 60 ans ; Auriane 22 ans ; Emeline 26 ans ; Zaouina 60 ans ; Une femme 16 ans ; une femme 75 ans…
Les militant·es #NousToutes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Affaires porno : L’électrochoc
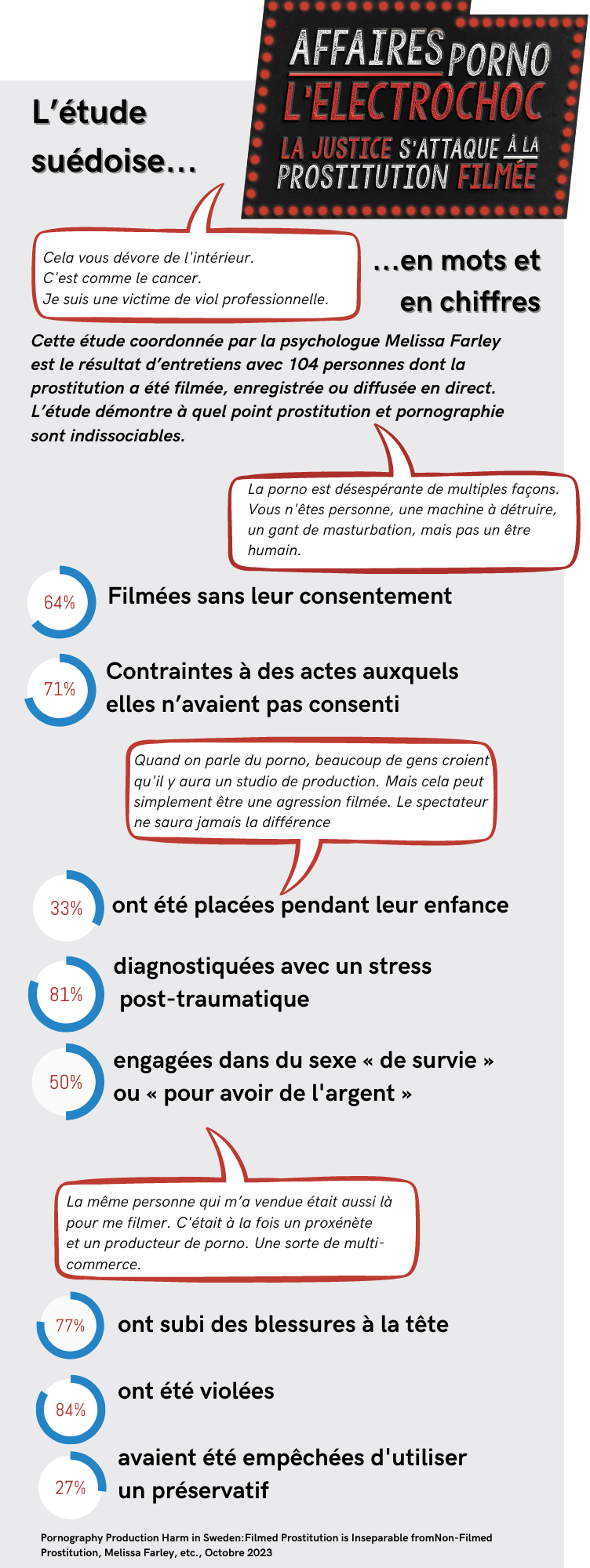
Un procès historique en termes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la pornographie devrait avoir lieu en France au début de l'année 2025. Pour la première fois, sont dénoncées à grande échelle les violences subies par les actrices sur les tournages pornographiques. Deux affaires en cours – dites French Bukkake et Jacquie et Michel – pourraient (on l'espère !) être un électrochoc dans une société incroyablement complaisante vis-à-vis d'actes sexuels tarifés, jusqu'ici blanchis par la magie de la caméra.
Tiré de Entre les lignes et les mots
La justice s'attaque à la prostitution filmée
La porosité entre les univers pornographique et prostitutionnel apparaît aujourd'hui clairement, confirmant ce que se tue à répéter le Mouvement du Nid, qui préfère au terme « pornographie » celui de « prostitution filmée » et qui soutient les nombreuses victimes qui ont eu le courage de témoigner et de se porter parties civiles dans les procès en cours. Jeunes, souvent polytraumatisées, leur parole est aujourd'hui d'une importance capitale et s'inscrit dans un contexte général plus favorable à l'écoute.
Tout indique que l'industrie du porno est intrinsèquement prostitutionnelle. C'est un système régi par un mode opératoire proxénète, dont le moteur est la violence, sexiste et sexuelle. Misogynie, racisme, incitation aux fantasmes pédocriminels, incestes, tortures, séquestrations, de pareils contenus seraient inacceptables sur tout autre support. La violence, érotisée, normalisée, constitue l'essence même de cette industrie, mais jusqu'ici en toute impunité.
LE PORNO, ENFIN À LA UNE DE L'ACTUALITÉ !
17hommes bientôt jugés au premier grand procès du porno. Le chiffre est sans précédent comme le nombre de victimes, une soixantaine, qui ont déjà eu le courage de prendre la parole pour dénoncer les atrocités dont elles ont été victimes.
* Des victimes polytraumatisées
*Reléguées en cour départementale
PROSTITUTION, PORNOGRAPHIE, DEUX FACES DE LA MÊME PIÈCE
Les procès pourraient, on l'espère, faire la lumière sur le caractère proxénète de ces sociétés pornographiques, c'est-à-dire leur enrichissement fondé sur l'exploitation de rapports sexuels tarifés, donc obtenus sous la contrainte de l'argent.
* Duproxénétisme ?
* Des faits pourtant avérés
* Des acteurs, ou des clients ?
* Les mêmes parcours fracassés
* Les mêmes dommages sur la santé
POUR EN FINIR AVEC LA PROSTITUTION FILMÉE
Dans leur rapport, les sénatrices insistent sur l'urgence d'en faire une priorité de politique pénale qui s'inscrirait dans les priorités plus larges telles que la lutte contre les violences conjugales, pour l'égalité femmes-hommes et la protection des mineur·es.
A lire également :
* Le rapport du Sénat,L'enfer du décor
* Le rapport du HCE
Télécharger le dossier Porno, l'électrochoc complet ici PS219-DOSSIER
A lire également :« le porno, ce n'est pas du cinéma »
Claudine Legardinier
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/dossiers/affaires-porno-lelectrochoc/bona
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tentative de licencier un syndicaliste malgré le refus de l’inspection du travail : défendons les droits syndicaux

Le 23 avril, Christian Porta, délégué syndical, a été notifié de son licenciement par son entreprise malgré une décision de refus très motivée de l'Inspection du travail. Un ensemble de juristes, d'avocat·es, de syndicalistes et d'inspecteurs du travail dénonce un passage en force inquiétant, tant pour les représentants du personnel que pour les Inspecteurs du travail qui voient ainsi leur prérogative anéantie.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Les atteintes à l'État de droit dont s'inquiète Amnesty International dans son dernier rapport annuel ne sont pas l'apanage des gouvernements, elles concernent aussi les entreprises, où se cumulent recul légal des droits protecteurs pour les salariés et refus de respecter la législation en vigueur pour les droits toujours existants.
Les 22 et 23 avril dernier, Christian Porta, délégué syndical central de la boulangerie industrielle Neuhauser, filiale du groupe InVivo, a été notifié coup sur coup du refus par l'inspection du travail d'autoriser son licenciement puis de son licenciement. Au lendemain de la publication d'une décision longuement motivée, invalidant l'argumentaire de l'entreprise qui accuse le syndicaliste CGT de « harcèlement » envers sa direction, InVivo a tout simplement décidé de passer outre le code du travail.
Ce choix de se placer consciemment dans l'illégalité est l'aboutissement d'un bras de fer d'une intensité rare entre la direction du groupe ayant racheté Neuhauser en 2021 et Christian Porta, représentant du personnel depuis près de 10 ans. Dans le secteur de l'agro-alimentaire, le site de Folschviller où il exerce se distingue par une importante implantation de la CGT, qui a recueilli 74% des suffrages aux dernières élections professionnelles, et par les conquêtes accumulées : 32 heures payées 35, embauches en CDI, lutte victorieuse contre la fermeture de sites et la mise en œuvre d'un PSE, réintégration de salariés injustement licenciés, etc.
Une contre-tendance au recul des droits des salariés face à laquelle la direction du groupe InVivo assume explicitement vouloir en finir avec la CGT. Pour cela, dès février dernier, à la veille d'une grève de revendication sur les salaires, elle a mis à pied son délégué syndical en l'accusant de « harcèlement » sur la base d'une pseudo-enquête interne disqualifiée par l'inspection du travail. À l'époque déjà, la décision d'interdire à Christian Porta d'entrer dans son usine y compris pour exercer son mandat avait été invalidée par le tribunal judiciaire de Sarreguemines pour « atteinte à l'exercice des droits syndicaux » et en l'absence « d'éléments probants » concernant les accusations de la direction.
Ces premières défaites judiciaires n'ont pas empêché InVivo de poursuivre son offensive. Bien que les collègues du syndicaliste lui aient exprimé une large solidarité, non seulement par la grève mais également en signant majoritairement une pétition de soutien, et alors que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement, InVivo poursuite sa politique de répression syndicale, jusqu'à violer l'article L.2411-5 du code du travail qui consacre la protection des représentants du personnel. Ce licenciement contra legem, par un géant européen de l'agroalimentaire, porte à l'extrême le mépris des droits syndicaux et du service public de l'inspection du travail et rappelle que le syndicaliste, en période de régression des droits, est à ce point vital pour l'organisation collective de la revendication qu'il reste l'homme à abattre.
Comme le rappelle la Cour de cassation depuis des décennies, la protection des élus du personnels « a été instituée non dans le seul intérêt de ces derniers mais dans celui de l'ensemble des salariés ». Par cet acte de défi, un patronat décomplexé s'affranchit de la loi et méprise ouvertement une décision administrative de l'inspection du travail pour passer outre la protection des représentants du personnel. C'est le projet assumé de la direction d'InVivo, dont le DRH n'hésite pas à affirmer publiquement vouloir « attaquer l'État » si son licenciement illégal était rendu impossible.
Alors que les inspecteurs du travail et syndicalistes font l'objet de contre-réformes constantes qui réduisent toujours plus leurs moyens et leurs prérogatives, nous, juristes, avocats et Inspecteurs du travail souhaitons rappeler l'évidence : licencier un salarié protégé sans autorisation de l'Inspection du travail est interdit. L'exercice des mandats syndicaux est protégé par le Préambule de la Constitution du 1946 qui affirme d'une part, la liberté syndicale (alinéa ) et d'autre part, le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail (alinéa 8). Le représentant du personnel est protégé car il est exposé, au service de la défense des intérêts des travailleurs.
La protection des représentants du personnel est la condition de l'exercice des droits des salariés, et sa remise en cause opère un retour vers le XIXème siècle pour déstabiliser l'ensemble de l'édifice des droits des salariés dans l'entreprise, arrachés au travers longues luttes. Plus que jamais, le droit du travail est une conquête collective que les avocats, inspecteurs du travail, syndicalistes et forces politiques doivent défendre dans le cadre du combat plus large pour s'opposer au recul des droits démocratiques dans le pays.
Signataires
Savine Bernard, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail, présidente de la commission droit social du Syndicat des Avocats de France
Sophie Binet, Secrétaire générale de la Confédération générale du Travail (CGT)
Ralph Blindaueur, avocat au barreau de Metz
CGT SNTEFP, Syndicat National Travail Emploi Formation Professionnelle CGT
Karim Chagroune, vice-président section industrie du Conseil des Prud'hommes du Havre
Marie-Laure Dufresnes-Castet, avocate au barreau de Paris
Michel Estevez, président du Conseil des Prud'hommes de Metz
Gérard Filoche, inspecteur du travail
Manuela Grévy, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Julien Huck, secrétaire Général FNAF CGT
Judith Krivine, avocate au barreau de Paris, présidente du Syndicat des Avocats de France
Reynald Kubecki, délégué syndical CGT Sidel et Vice-président section industrie du Conseil des Prud'hommes du Havre
Mornia Labssi, inspectrice du travail
Gérald Le Corre, syndicaliste CGT et inspecteur du travail
Elsa Marcel, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
Sébastien Menesplier, Secrétaire général FNME CGT
Pascal Moussy, directeur de publication de la revue Chroniques ouvrières
Fiodor Rilov, avocat au barreau de Paris
Antony Smith, inspecteur du travail
Isabelle Taraud, avocate au barreau de Paris
Cyril Wolmark, professeur de droit à l'Université Paris Nanterre
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Rassemblement de solidarité à Genève avec les syndicalistes et enseignant·e·s d’Iran, vendredi 7 juin

A l'occasion de la Conférence internationale du travail de l'OIT (Organisation internationale du travail), les organisations syndicales signataires appellent à un rassemblement devant le siège des Nations Unies à Genève, le vendredi 7 juin 2024.
Photo et article tirés de NPA 29
Elles entendent ainsi dénoncer la nouvelle campagne de répression entreprise par les autorités de la République islamique d'Iran, et notamment :
-le nombre effrayant d'exécutions capitales, dont plus de soixante rien que pendant les deux dernières semaines du mois d'avril ;
-la poursuite de la répression de femmes refusant de porter le voile.
Nous protestons également contre la venue annoncée à la Conférence internationale du travail de personnes désignées par le régime pour représenter les salarié·e·s.

La République islamique d'Iran a refusé de ratifier de nombreux textes fondamentaux de l'OIT, dont ceux concernant la liberté de constituer des syndicats, la protection du droit syndical et la négociation collective (Conventions 87 et 98 de l'OIT).
Rien ne justifie néanmoins que l'Iran agisse en contradiction avec ces normes. En effet, la Déclaration de 1998 « oblige les Etats Membres à respecter et à promouvoir » ces dispositions, « qu'ils aient ou non ratifié les conventions correspondantes ».
Et cela d'autant plus que l'Iran siège officiellement dans certaines instances de l'OIT.
L'Iran est par ailleurs signataire de deux traités internationaux protégeant notamment le droit de constituer des syndicats, de s'y affilier et de rencontrer des syndicalistes d'autres pays :
-Pacte international (ONU) relatif aux droits civils et politiques (PIDCP/ICCPR), article 22 ;
-Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC/ICESCR), article 8.
Le régime réprime néanmoins des dizaines de personnes agissant dans le cadre de ces deux textes signés par l'Etat iranien.
Nous organisons un rassemblement :
Vendredi 7 juin 2024, à partir de 12h à Genève devant le Palais des Nations – « La Chaise »
– contre la répression généralisée du régime iranien,
– pour soutenir les personnes arrêtées, dont notamment les syndicalistes et les enseignant·e·s,
– pour exiger leur libération immédiate.
Confédération française démocratique du travail (CFDT)-France,
Confédération générale du travail (CGT)-France,
Fédération syndicale unitaire (FSU)-France,
Union syndicale Solidaires-France,
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)-France,
Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS)–Suisse,
Syndicat SSP enseignement Genève –Suisse.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Qu’est-ce qu’Atlas, ce réseau climatosceptique d’extrême droite ?

Atlas, ce n'est pas seulement le nom d'un titan portant la planète sur ses épaules, ou d'un livre regroupant les cartes du monde. C'est un puissant réseau d'une centaine de groupes de réflexion ou organisations ayant un seul but : promouvoir des politiques ultralibérales et climatosceptiques dans le monde entier. « Une machine de guerre idéologique d'une nouvelle extrême droite, libertarienne et ultraconservatrice », explique Anne-Sophie Simpere, autrice d'un rapport sur Atlas publié le 22 mai par l'Observatoire des multinationales.
Tiré de Reporterre.
En France, les membres d'Atlas sont peu nombreux, mais ont des accointances avec les milieux médiatique, financier et politique, en particulier avec l'extrême droite. On compterait aujourd'hui une dizaine d'organisations, dont la plus active est la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (Ifrap), dirigée par la lobbyiste Agnès Verdier-Molinié. Son travail consiste à publier des études pour défendre les intérêts des plus fortunés. L'Ifrap critique également les réglementations environnementales, ciblant pêle-mêle la loi Climat, les éoliennes, l'interdiction de la voiture thermique et la fiscalité écologique. Elle recommande aussi de repousser la transition écologique aux calendes grecques.
Autre organisation tout aussi anti-écolo : l'Institut de recherches économiques et fiscales (Iref), qui publie des articles niant la responsabilité des activités humaines dans le changement climatique. L'association Contribuables associés, fondée en 1990, est vent debout contre les politiques environnementales, en particulier le développement des éoliennes, et a rejoint l'Association des climatoréalistes.
Enfin, l'institut économique Molinari, financé par les industriels du pétrole et du tabac, est dans le déni climatique. « Une chose est sûre : il n'y a pas de consensus sur le changement climatique parmi les scientifiques », déclarait sa directrice Cécile Philippe en 2005. Cette position étant aujourd'hui trop difficile à assumer, l'institut porte désormais des critiques plus subtiles, notamment sur les réglementations, les taxes environnementales et les énergies renouvelables. Elle s'active également à promouvoir l'énergie nucléaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Argentine : le peuple sur la défensive dans un scénario incertain

L'Argentine vit le premier semestre du gouvernement d'ultra-droite de Javier Milei, qui vise à porter un coup définitif à la classe ouvrière et à restructurer le capitalisme argentin pour relancer l'accumulation, dans un contexte de crise généralisée. S'il réussit, cela pourrait se traduire par une défaite à long terme du mouvement populaire.
Tiré de Inprecor 720 - mai 2024
22 mai 2024
Par Poder popular (Argentine)
Manifestation du 23 avril 2024.
Depuis le début de son mandat, le gouvernement n'a pas été en mesure de se stabiliser pour mener à bien les aspects structurels de son programme. Il a produit un ajustement féroce des prestations de l'État et un effondrement de 20 % des salaires réels des travailleurs enregistrés entre décembre et mars, laissant le salaire formel moyen en dessous du panier de biens de base d'une famille typique. La situation de la moitié de la classe ouvrière argentine, qui occupe des emplois non déclarés, est encore pire. La pauvreté a atteint 41,7 % en décembre, selon les données officielles, et serait passée à 51,8 % au premier trimestre 2024. Cependant, le radicalisme de son programme et l'incapacité à harmoniser les volontés des secteurs politiques qui soutiendraient certaines des réformes structurelles ont jusqu'à présent empêché qu'elles soient adoptées par le parlement. Le 1er mars, dans son discours inaugural lors de l'ouverture des sessions du Congrès, le président a exprimé son intention de changer de tactique en faveur d'une plus grande flexibilité afin de générer des accords permettant le vote des réformes, ce qui n'implique pas, en principe, l'abandon effectif de leur radicalisme.
Depuis lors, le gouvernement a tenté de parvenir à un consensus sur au moins certaines des mesures et a réussi à faire voter par la chambre des députés une version partielle du projet de loi fondateur de son mandat (un projet de loi qui n'avait pas pu être promulgué en février). Toutefois, le vote nécessaire du Sénat et sa promulgation ne sont pas encore assurés, même si l'on peut s'attendre à ce qu'ils soient atteints, moyennant quelques modifications supplémentaires.
Les résistances populaires sont réelles
D'autre part, bien que le peuple argentin ait été démobilisé ces dernières années, depuis les premières mesures gouvernementales, une série de protestations de différentes natures ont eu lieu, culminant avec l'énorme mobilisation nationale du 23 avril en défense de l'université publique (qui, en Argentine, est accessible sans restriction ni frais). Plus d'un million et demi de personnes se sont mobilisées dans tout le pays, issues de secteurs hétérogènes, tant sur le plan économique que politique, avec toutefois une forte présence des classes moyennes. Il s'agit probablement de la plus grande manifestation de la dernière décennie, et la protestation a également été légitimée par les grands médias et les secteurs politiques qui observent passivement ou même soutiennent le gouvernement.
Alors que le projet de loi comprenant une réforme régressive du travail et un régime favorisant les grands investissements sans aucun avantage pour la population était en cours d'examen au parlement, les confédérations syndicales ont appelé à une manifestation le 1er mai et à une grève nationale le 9 mai. La manifestation du 1er a été unitaire et a connu une participation massive, essentiellement syndicale. La grève du 9 a été bien suivie, bien qu'il soit difficile d'en mesurer l'ampleur et d'en tirer des conclusions. Cependant, le discrédit des directions syndicales et l'absence de manifestation dans la rue ont atténué l'impact que la grève du 9 mai aurait pu avoir sur les politiciens qui doivent voter pour ou rejeter la loi du gouvernement.
Le scénario est encore ouvert. Le gouvernement peut ou non se stabiliser et même s'il se stabilise, il n'est pas certain qu'il puisse surmonter les énormes difficultés macroéconomiques du pays, y compris en s'attaquant brutalement aux conditions de vie de la classe ouvrière. Mais aucune issue ne sera favorable pour le peuple si elle n'est pas le produit d'une vague de protestations de rue qui inverse le climat de démobilisation imposé ces dernières années.
Le 15 mai, traduction de Fabrice Thomas.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












