Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Ce que la percée ukrainienne de Koursk éclaire de la guerre

Le coup d'éclat de l'Ukraine, le 6 août, la percée de ses forces armées dans l'oblast de Koursk, produit toujours son onde de choc. Dans les limites de cet article 1, on notera, avec Michel Goya, spécialiste reconnu des questions proprement militaires, que « les gains stratégiques sont déjà considérables et d'abord politiques » 2.
18 septembre 2024 | tiré de Hebdo L'Anticapitaliste - 721
https://lanticapitaliste.org/actualite/politique/ce-que-la-percee-ukrainienne-de-koursk-eclaire-de-la-guerre
L'action de Koursk inflige un démenti cinglant aux tenants de la dynamique de la défaite, quasiment irréversible selon certains (Emmanuel Todd ou Pascal Boniface), dans laquelle seraient engagéEs des UkrainienNEs en recul, voire en débandade, sur le front. Elle vise à modifier les rapports de forces militaires, conditions mêmes de négociations.
Les Russes ne progressent pas
Les UkrainienNEs se retrouvent certes dans une difficile position défensive sur la ligne de front, et l'avancée russe dans le Donbass est réelle. Mais elle se fait au prix de pertes exponentielles, dans une logique consommatrice de chair à canon inversement proportionnelle aux gains territoriaux. Les UkrainienNEs assument, eux, une tactique maîtrisée de défense des positions jusqu'à infliger le maximum de pertes à l'ennemi, en décrochant de quelques kilomètres vers des positions tenables dès que le coût humain devient trop élevé, et ainsi de suite. Et cela dans l'attente d'avoir tous les armements de leurs alliés leur permettant de repartir à l'offensive et de se retrouver en position de récupérer du territoire.
En fait, les Russes n'ont pas progressé de façon décisive sur le champ de bataille entre novembre 2022 et août dernier : sur seulement 1 030 km2, soit 0,17 % du territoire ukrainien d'avant 2014, incluant la Crimée et les autres territoires occupés (représentant 17,78 % de ce territoire national), selon le Monde 3. La laborieuse poussée russe sur la ligne de front depuis plus de deux ans pâtit de la comparaison avec le gain de quelque 1 300 km2 obtenu par les UkrainienNEs au sud de Koursk en quatre semaines.
L'emploi d'armes et d'équipements alliés n'a pas, comme c'était prévisible, provoqué la foudre russe sur les pays fournisseurs, et ceux-ci sont obligés de suivre.
Affecter la société russe
Cette offensive prend Poutine au piège de ne pas vouloir jouer à 100 % la carte d'une guerre, dont, significativement, il ne veut pas dire le nom, qui l'obligerait, vu la résistance des UkrainienNEs, à une mobilisation générale. « Vladimir Poutine a finalement montré qu'il avait finalement plus peur des réactions internes à une mobilisation guerrière que des UkrainienNEs », selon Michel Goya.
La signification politique de l'incursion de Koursk est d'abord de chercher à produire ce que Poutine redoute, à savoir que la part protégée de la société russe soit enfin affectée par la guerre. Il s'agit aussi de remonter le moral de la population ukrainienne, cible depuis près de trois ans de crimes de guerre mais aussi de la destruction d'infrastructures essentielles face à l'hiver qui vient.
L'autre aspect important de l'opération de Koursk est le coup de force par lequel l'Ukraine a franchi ce qui est paradoxalement la seule vraie « ligne rouge » dans cette guerre. Paradoxalement, parce la ligne rouge est celle dont les alliés font profiter les Russes aux dépens des UkrainienNEs, par leur refus d'autoriser l'Ukraine à viser les sites sur sol russe où Poutine tient au chaud ses armes de destruction massive de l'Ukraine. Or, à Koursk, cette ligne rouge, sans être totalement effacée, a commencé à voler en éclats.
Bien des questions restent ouvertes : le recul et les ripostes russes diront quels seront les effets de la percée ukrainienne sur le front de Pokrovsk. Et les luttes sociales en Ukraine se poursuivent sur plusieurs fronts 4.
Antoine Rabadan
Notes
1.Pour une approche plus complète de la situation militaire, voir https://entreleslignesen…
2. Des coups et des douleurs, https://lavoiedelepee.bl…
3. https://www.lemonde.fr/l…
4. Voir les déclarations de nos camarades de Sotsialny Rukh (Mouvement social) : https://lanticapitaliste… et sur la Fête de l'indépendance fin août : https://lanticapitaliste…
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
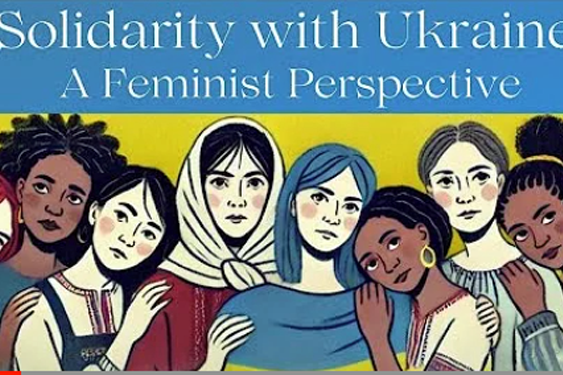
Solidarité avec l’Ukraine : Une perspective féministe
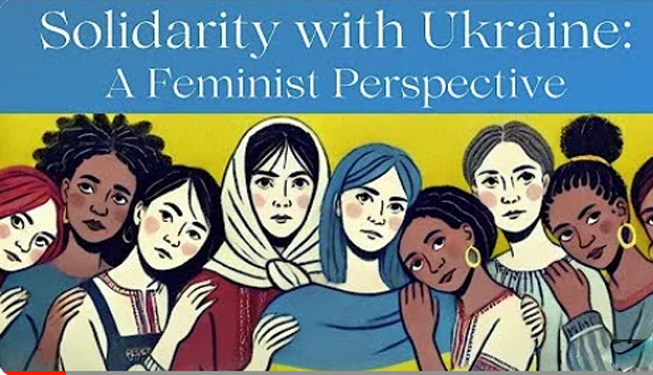
Plus de deux ans se sont écoulés depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Nous avons demandé à des féministes ukrainiennes d'expliquer pourquoi la lutte contre l'invasion impérialiste de la Russie ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais aussi l'avenir de l'humanité et devrait concerner le monde entier !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’attaque israélienne contre le Liban s’inscrit dans une longue histoire et une stratégie de ciblage des civils

La dernière attaque d'Israël contre le Liban par l'explosion de milliers de bipeurs représente une extension de la doctrine Dahiya, qui vise intentionnellement les civils pour envoyer un message politique.
Tiré de l'Agence Média Palestine
18 septembre 2024
Par Jonathan Ofir
Les décombres au sud de Beyrouth, en 2006 après des frappes aériennes israéliennes massives sur la capitale libanaise.
L'attaque massivemenée au Liban contre des appareils électroniques personnels appartenant à des membres du Hezbollah, qui a déjà tué au moins 20 personnes et en a blessé environ 3 000, ne laisse planer aucun doute sur l'action d'Israël. L'attaque qui a commencé mardi s'est poursuivie pendant une deuxième journée, avec de nouveaux rapports faisant état de l'explosion d'autres appareils de communication personnels, tuant au moins neuf personnes et en blessant des dizaines d'autres mercredi, lors des funérailles de personnes qui avaient été tuées la veille lors de la première attaque.
L'attaque en cours, que l'on ne peut que qualifier de terroriste, est sans précédent par son ampleur et sa méthode, mais la nature de cette attaque aveugle est loin d'être unique pour Israël. En fait, la doctrine israélienne consistant à infliger des dommages massifs aux civils porte le nom d'un quartier de Beyrouth, Dahiya, où cette attaque était précisément centrée. Le développement le plus récent marque une avancée choquante dans le mépris total d'Israël pour la vie humaine, mais ce n'est pas nouveau, même si vous ne l'apprendriez jamais en lisant la presse occidentale.
L'interprétation des médias occidentaux
L'équipe du New York Times, composée de Patrick Kingsley, Euan Ward, Ronen Bergman et Michael Levenson, a couvert l'attaque et, bien qu'elle ait désigné Israël comme coupable, elle s'est efforcée d'inclure l'angle de communication manifestement faux d'Israël, à savoir qu'il s'agissait d'une attaque ciblée.
Le Times rapportece qui suit :
« Selon des responsables américains et autres informés de l'attentat, Israël a dissimulé des explosifs dans une cargaison de bipeurs de fabrication taïwanaise importés au Liban. L'explosif, qui ne pèse qu'une ou deux onces, a été inséré à côté de la batterie de chaque bipeur, ont déclaré deux de ces responsables. Les bipeurs, que le Hezbollah avait commandés à la société Gold Apollo de Taïwan, avaient été trafiqués avant d'arriver au Liban, selon certains des responsables. Selon un fonctionnaire, Israël a calculé que le risque de blesser des personnes non affiliées au Hezbollah était faible, compte tenu de la taille de l'explosif ».
Le Times écrit également que « les explosions semblent être la dernière salve dans un conflit entre Israël et le Hezbollah qui s'est intensifié après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre », ce qui donne à cette affaire l'allure d'une simple activité militaire, plutôt que celle d'une attaque meurtrière et manifestement imprécise contre une population civile. Le lanceur d'alerte américain Edward Snowden, cité sur ce site hier, résume ainsi l'objectif et l'impact de l'attaque :
« Ce qu'Israël vient de faire est, quelle que soit la méthode utilisée, imprudent. Ils ont fait exploser un nombre incalculable de personnes qui conduisaient (c'est-à-dire des voitures hors de contrôle), faisaient des courses (vos enfants sont dans la poussette derrière lui dans la file d'attente de la caisse), etc. Il est impossible de les distinguer du terrorisme ».
L'analyste politique principal d'Al Jazeera, Marwan Bishara, fait ce rappel à la réalité, peut-être plus pertinent pour les téléspectateurs occidentaux :
« Pour nos téléspectateurs du monde entier, il est probablement utile de faire un jeu de rôle. Imaginez que 1 200 personnes, travaillant au Pentagone, au département d'État et à la CIA, se fassent exploser un bipeur au visage, au bras et à l'abdomen. Comment pensez-vous que les États-Unis réagiraient à cette situation ? »
Le Times souligne la « longue histoire de l'utilisation de la technologie par Israël pour mener des opérations secrètes contre l'Iran et les groupes soutenus par l'Iran », comme s'il s'agissait d'une réalisation technologique impressionnante. Mais en réalité, pour comprendre ce qu'Israël fait ici, nous devons examiner ses antécédents en matière d'attaques aveugles. En fait, cela n'est pas seulement pertinent d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue stratégique et géographique.
De l'attaque aveugle au génocide
Le nom de la doctrine Dahiya provient du quartier Dahiya de Beyrouth, qu'Israël a ciblé et rasé pendant la guerre de 2006, un quartier où vivaient de nombreuses familles affiliées au Hezbollah. En 2008, Gadi Eisenkot, alors chef israélien du commandement du Nord (plus tard chef d'état-major et ministre centriste), a inventé la doctrine qui décrit « ce qui arrivera » à tout ennemi qui oserait attaquer Israël :
« Ce qui s'est passé dans le quartier de Dahiya à Beyrouth en 2006 se produira dans tous les villages d'où Israël essuie des tirs… Nous appliquerons une force disproportionnée sur [le village] et y causerons d'importants dégâts et destructions. De notre point de vue, il ne s'agit pas de villages civils, mais de bases militaires ».
Israël a déjà appliqué cette méthode lors de l'attaque de Gaza en 2008 et 2009. Le « rapport Goldstone » des Nations unies de 2009 a conclu qu'Israël avait mené une « attaque délibérément disproportionnée, conçue pour punir, humilier et terroriser une population civile », et a noté que la doctrine Dahiya « semble avoir été précisément ce qui a été mis en pratique ». Je le répète : « Punir, humilier et terroriser ». Ce dernier mot, « terroriser », devrait nous faire réfléchir, surtout dans ce contexte particulier.
Le récent assaut de Gaza a été, à sa manière, la mise en œuvre de cette doctrine dans le cadre d'un génocide à part entière. Ce n'est pas surprenant, puisque la veine des dommages délibérés aux civils en tant que logique de « guerre » fait partie de l'ADN de cette doctrine depuis le début.
Aujourd'hui, Israël fait donc exploser des bipeurs. La probabilité que les médias occidentaux qualifient cette action d'acte de terrorisme est très faible. Cette notion est encore considérée comme radicale lorsqu'il s'agit d'Israël, car la terreur est un terme politique qui n'est réservé qu'aux ennemi·es de l'Occident. Pour les lecteur·ices du New York Times, il s'agit simplement d'une « dernière salve » et non d'une réflexion sur la nature même d'Israël.
Jonathan Ofir, rédacteur chez Mondoweiss, est un musicien, chef d'orchestre et blogueur/écrivain israélien basé au Danemark.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source :Mondoweiss
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Israël-Liban. L’escalade sur le front nord

Gilbert Achcar (professeur à la SOAS, Université de Londres), sur son blog de Mediapart, soulignait, déjà en juin 2024, à propos des « tambours de la guerre à venir à venir contre le Liban » que « les deux parties, Netanyahou et l'opposition, estiment qu'il n'y a pas de troisième option sur leur front nord : soit le Hezbollah accepte de se retirer vers le nord […], soit ils mèneront une guerre dévastatrice contre le Hezbollah à un coût élevé qu'ils jugent tous nécessaire pour rétablir la capacité de dissuasion de leur Etat, considérablement diminuée sur le front libanais depuis le 7 octobre ».
Tiré d'À l'encontre. Introduction rédaction A l'Encontre
Il soulignait le 18 septembre : « Etant donné que l'Etat sioniste ne peut pas lancer une guerre à grande échelle contre le Liban sans la pleine participation des Etats-Unis, surtout que l'administration Biden l'a averti qu'une telle guerre se transformerait en conflagration régionale, il est difficile pour Netanyahou ou Yoav Galant (ministre de la Défense) de soutenir l'initiative de lancer une agression surprise à grande échelle contre le Liban sans feu vert de Washington. Israël n'aurait même pas pu mener sa guerre génocidaire contre Gaza sans la participation des Etats-Unis, et le Hezbollah est beaucoup plus fort que le Hamas et ses alliés à l'intérieur de la bande de Gaza. »
Intégrant cette dimension, Gilbert Achcar ajoute : « Netanyahou agit donc actuellement en gardant les yeux rivés sur les élections américaines : s'il estime que Trump va gagner, il attendra que ce soit confirmé, voire que Trump revienne à la Maison Blanche, avant de lancer une guerre contre le Liban en collusion avec lui et en préambule à une agression à grande échelle contre les réacteurs nucléaires en Iran même. Si, en revanche, il estime que la victoire de Kamala Harris est la plus probable, ou si cette victoire se produit lors des élections du 5 novembre, cela l'incitera à profiter du temps restant de la présence de Biden à la Maison Blanche pour faire escalader les choses jusqu'à l'état de guerre. Il est probable qu'il cherchera alors à s'assurer que Biden est impliqué dans le soutien à l'agression en donnant au Hezbollah un ultimatum avec un délai précis et court pour se soumettre à la pression et se retirer.
»Les récentes positions de Netanyahou, y compris son rejet du cessez-le-feu à Gaza et de l'échange de prisonniers demandé par l'administration Biden, ne peuvent en effet pas être comprises sans tenir compte des élections américaines. Contrairement aux analyses qui se sont concentrées sur la seule politique intérieure israélienne, il ne fait aucun doute que le refus de Netanyahou d'accorder à l'administration Biden ce qui semblerait être un succès politique au milieu de la campagne électorale américaine actuelle est un grand service rendu à Trump, dont Netanyahou cherchera à récolter les fruits si ce dernier remporte la présidence pour la deuxième fois. »
***
L'offensive qui se déroule ce lundi 23 septembre illustre, à sa façon, ce qui est exposé ci-dessus. Le Washington Post de cet après-midi en donne une version « factuelle » euphémisée : « Le ministère libanais de la Santé a déclaré qu'au moins 274 personnes avaient été tuées et au moins 1024 blessées lors des frappes israéliennes, faisant de ce lundi la journée la plus meurtrière du conflit au Liban depuis les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah qui ont débuté en octobre. Israël a déclaré qu'il menait des frappes “étendues et précises” contre le Hezbollah, notamment dans le sud et dans la vallée de la Bekaa, à l'est, et a appelé les civils à évacuer ou à s'éloigner des zones dans lesquelles le groupe armé opère. Le Liban n'a pas fait de distinction entre les civils et les combattants, mais a indiqué que des enfants, des femmes et des membres du personnel paramédical figuraient parmi les personnes blessées ou tuées. Le Hezbollah a tiré des dizaines de projectiles sur la frontière lundi, alors que les échanges menacent de dégénérer en une véritable guerre. »
La physionomie effective des attaques israéliennes est décrite avec plus d'exactitude par le secrétaire général – Jan Egeland – du Conseil norvégien pour les réfugiés. Il a déclaré lundi que « les frappes aériennes israéliennes sur les villes et villages libanais lundi sont les plus violentes depuis 11 mois. Des zones résidentielles et des quartiers densément peuplés ont été bombardés, ce qui signifie que le bilan humain sera immense. On a dit aux familles qu'elles n'avaient que quelques heures pour quitter leur maison, et il y a maintenant de longues files de voitures alors que des familles terrifiées tentent de fuir vers Beyrouth. Plusieurs milliers de personnes seront déplacées aujourd'hui. » (Haaretz, 23 septembre)
Dans l'article d'Adam Shatz que nous publions ci-dessous, il remarque que le terme « terrorisme » ne figure pas dans les comptes rendus de cette guerre menée par Israël, le qualificatif n'est réservé qu'au Hezbollah. Dans une sorte de coïncidence chronologique, Ben Samuels, sur le site de Haaretz ce 23 septembre, écrit : « L'ancien directeur de la CIA, Leon Panetta, a qualifié de “terrorisme” l'opération de pose d'explosifs sur les pagers telle que menée au Liban la semaine dernière. Leon Panetta déclare : “Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute sur le fait qu'il s'agit d'une forme de terrorisme”. » (Rédaction A l'Encontre)
*****
« L'escalade est-elle, peut-être, précisément ce qu'Israël recherche ? »
Par Adam Shatz
Depuis le 7 octobre, l'administration Biden a donné à Israël pratiquement tout ce qu'il demandait, des avions de chasse F-15 aux bombes au phosphore blanc en passant par la complicité diplomatique dans le cadre des Nations unies. Joe Biden et Antony Blinken ont soutenu la destruction de Gaza et la « gazafication » de la Cisjordanie, où les forces israéliennes et les colons ont tué plus de 600 personnes au cours de l'année écoulée, parmi lesquels une citoyenne états-unienne de 26 ans, Ay ?enur Ezgi Eygi, abattu lors d'une manifestation pacifique près de Naplouse.[Voir à ce propos l'article de Jeffrey St. Clair publié sur ce site le10 septembre 2024.] (Les parents d'Eygi n'ont toujours pas reçu – lors de la rédaction de cet article – d'appel téléphonique de l'administration Biden, qui prétend « réunir les faits »). Avec l'apparente carte blanche de Washington, le gouvernement Netanyahou a également intensifié sa longue guerre de l'ombre avec l'Iran, en assassinant des responsables iraniens à Damas et le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran.
***
Les Américains avaient toutefois établi une « ligne rouge », à savoir une guerre israélienne contre le Liban, pour laquelle le gouvernement Netanyahou aurait demandé l'approbation dans les jours qui ont suivi le 7 octobre. Netanyahou voulait ouvrir un deuxième front dans l'espoir de détruire l'organisation chiite libanaise Hezbollah [1], alliée du Hamas, mais les Américains s'y sont opposés et les Israéliens ont donc mis leurs plans en veilleuse. La guerre frontalière de faible intensité avec le Hezbollah s'est poursuivie, mais dans des limites largement respectées par les deux parties. Le Hezbollah a lancé des roquettes sur les villes frontalières du nord d'Israël, tuant deux douzaines de civils et forçant près de cent mille personnes à évacuer leur domicile. Israël a tué des centaines de personnes dans le sud du Liban, dont de nombreux civils, et en a déplacé plus de cent mille. Mais jusqu'à cette semaine, le Hezbollah et Israël semblaient calibrer leurs réponses aux attaques de l'un et de l'autre pour éviter une guerre à grande échelle. Alors que l'assaut d'Israël sur Gaza s'éternisait, son enthousiasme pour un second front semblait s'émousser : comment son armée pourrait-elle affronter le Hezbollah si elle n'était même pas capable de vaincre le Hamas ?
Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a lui aussi de bonnes raisons d'éviter l'escalade. Il ne veut pas que se répète la guerre de 2006, qui a entraîné la dévastation d'une partie de Beyrouth, du Sud-Liban et de la vallée de la Bekaa, et la mort de plus d'un millier de civils libanais ; après cette guerre, Nasrallah a présenté des excuses extraordinaires pour avoir provoqué l'offensive d'Israël. Il sait également que l'Iran, son principal mécène et allié, ne veut pas que les missiles du Hezbollah, destinés à servir de bouclier contre une attaque israélienne sur le programme nucléaire iranien, soient gaspillés à Gaza : la solidarité avec la Palestine a ses limites, même pour le chef de « l'axe de la résistance ».
***
Pourquoi alors le Hezbollah a-t-il intensifié ses tirs de roquettes sur le nord d'Israël depuis le 7 octobre ? Les commentateurs israéliens ont affirmé que le Hezbollah était responsable de ce conflit parce qu'il ne s'est pas retiré jusqu'au fleuve Litani [qui coule au sud du Liban et se jette dans la Méditerranée] et parce que Gaza n'est, a priori, pas sa guerre. Mais Nasrallah insiste sur le fait qu'il respecte sa part de l'alliance du Hezbollah avec le Hamas, l'Iran et les Houthis (la stratégie dite de « l'unité des théâtres d'opérations »), et qu'il offre un minimum de soutien à la population assiégée de Gaza, qui a été pratiquement abandonnée par les autres régimes arabes. Il a également fait savoir que les roquettes cesseraient dès qu'un cessez-le-feu serait conclu à Gaza. Comme l'a noté Amos Harel, le correspondant militaire de Haaretz, Nasrallah a fait preuve d'une grande retenue face aux provocations répétées d'Israël, notamment l'assassinat [le 30 juillet 2024] de Fouad Chokr, l'un des principaux dirigeants du Hezbollah, à Beyrouth [dans le quartier Haret Hreik, dans la banlieue sud de la capitale].
***
Il est difficile de voir comment la prudence de Nasrallah survivra aux attentats perpétrés cette semaine à l'aide de téléavertisseurs (pagers) et de talkie-walkie (émetteur-récepteur portatif), qui ont tué au moins 37 personnes, dont quatre enfants, et en ont blessé des milliers d'autres. Avec cette opération – qui était en préparation depuis 2022, selon le New York Times, c'est-à-dire bien avant le 7 octobre – Israël a réussi, à tout le moins, à mener l'une des attaques simultanées les plus spectaculaires de l'histoire récente. Israël a frappé deux fois, en plusieurs jours consécutifs ; il n'a perdu aucun de ses hommes ; et il a forcé ses ennemis à abandonner ce que personne dans le monde moderne ne veut abandonner : leurs appareils électroniques. (Au Liban, on a vu des gens écraser leur propre téléphone). Le choc psychologique à court terme est incalculable.
***
Imaginons qu'une organisation militante, telle que le Hezbollah, ait perpétré un attentat similaire en Israël, en faisant exploser les téléphones de soldats et de réservistes et en assassinant des enfants israéliens. Les Américains n'auraient pas attendu de « réunir les faits » pour dénoncer l'attentat. La réaction d'une grande partie de la presse occidentale a également été frappante, pleine de fascination pour l'ingéniosité du Mossad. Ce que vous ne verrez pas dans ces comptes rendus, c'est le mot « terrorisme », qui est aussi tabou que le mot « génocide » lorsque l'auteur de l'attentat est Israël.
Le terrorisme, c'est-à-dire le recours à la violence contre des non-combattants pour atteindre des objectifs politiques, est une forme de propagande, un message adressé à la fois à l'ennemi et à ses propres électeurs. Quel est donc le message des attentats commis à l'aide de pagers et de talkie-walkie ? Pour le public juif israélien, encore traumatisé par le 7 octobre, et en particulier pour les Israéliens qui ont fui leurs maisons dans le nord, le message est qu'Israël rétablit la « dissuasion », le troisième pilier de l'idéologie au pouvoir (les autres étant le souvenir instrumentalisé de l'Holocauste [2] et la consolidation des colonies). Pour le Hezbollah et le peuple libanais, le message est qu'Israël peut frapper n'importe où, n'importe quand, et qu'il se soucie peu des victimes civiles (ce message est redondant, puisqu'Israël est déjà notoirement connu au Liban pour son indifférence à l'égard de la vie des Libanais).
Certains citoyens libanais hostiles au Hezbollah ont d'abord pris un plaisir indirect à ces attaques. Le Hezbollah contrôle en effet une grande partie du Liban, notamment l'aéroport de Beyrouth, et son influence est souvent mal perçue. Mais une fois qu'il est apparu clairement qu'il s'agissait d'une attaque contre le Liban et qu'elle pouvait être le prélude à une invasion israélienne – comme la destruction de l'armée de l'air égyptienne le 5 juin 1967, qui a précédé la guerre des Six Jours – les gens ont cessé de rire aux dépens du Hezbollah. Encore sous le choc de son effondrement financier et de l'explosion du port en 2020, le Liban a moins de chances de survivre à une invasion israélienne que le Hezbollah.
Nasrallah est dans l'embarras. Le système de communication du Hezbollah a été gravement endommagé et il pourrait y avoir des failles au sein de l'organisation. La reconstruction de ce système et l'éradication des « mouchards » seront ses priorités. Mais il ne peut pas répondre avec la patience des Iraniens, dont le style est de promettre des représailles et d'attendre des années avant de les mettre en œuvre, parce que le Hezbollah est en première ligne dans la bataille contre Israël. Si Nasrallah ne réagit pas, sa retenue passera pour de la lâcheté, ce qui n'est pas le message qu'il souhaite envoyer à ses partisans. Mais s'il commet une erreur de calcul ou s'il réagit d'une manière qui offre aux Israéliens un prétexte pour envahir le pays, il pourrait se retrouver avec une guerre sur les bras qui surpassera de loin la catastrophe de 2006 et mettrait en péril la position du Hezbollah au Liban.
***
Israël n'a pas assumé la responsabilité officielle des attaques, mais il pavoise. Le succès à court terme est difficilement contestable. Les attaques par bipeurs ont mis le Hezbollah et l'Iran sur la défensive. Elles ont détourné l'attention des horreurs qu'Israël continue de faire subir à Gaza et à la Cisjordanie, de l'obscénité de Sde Teiman, un centre de torture, et y compris de viol [voir le quotidien L'Orient-Le-Jour du 24 août 2024, article de Mouin Rabbani] dans le Néguev où des dizaines de prisonniers de Gaza ont été assassinés, et de l'épreuve des otages, la plus grande menace qui pèse sur le poste de premier ministre de Netanyahou. Mais quelle sera la suite ? Netanyahou parie-t-il sur une réaction démesurée du Hezbollah ? Essaie-t-il d'ouvrir un second front et d'entraîner les Iraniens – et les Américains – dans la guerre ? Les attaques font-elles partie de ses efforts pour ramener Donald Trump à la Maison Blanche, ou essaie-t-il simplement de rester au pouvoir en faisant une démonstration de force militaire ? La guerre à Gaza l'a rendu plus populaire que jamais, malgré les manifestations de masse en faveur d'un cessez-le-feu [concernant les otages civils du Hamas].
Quelles que soient ses motivations, Benyamin Netanyahou a rendu la guerre beaucoup plus probable, et ce serait une guerre beaucoup plus difficile que celle de Gaza pour les troupes israéliennes déjà épuisées et démoralisées. Le Hezbollah, qui est apparu à la suite de l'invasion israélienne du Liban en 1982, est un antagoniste redoutable, probablement la force de combat arabe la plus efficace à laquelle l'Etat juif ait été confronté depuis sa création. Ses quelque 45'000 combattants sont peut-être moins nombreux et moins bien armés que les Israéliens, mais, contrairement à ces derniers, ils ont l'avantage de se battre sur leur propre territoire. Les soldats israéliens ont passé deux décennies sous le feu du Sud-Liban avant que le Hezbollah ne les oblige à se retirer unilatéralement en 2000. L'attaque des pagers, un succès tactique à tout point de vue, apparaît à première vue comme une escalade imprudente, sans horizon stratégique.
***
Mais la ligne de démarcation entre tactique et stratégie n'est peut-être pas si utile dans le cas d'Israël, un Etat qui est en guerre depuis sa création. L'identité des ennemis change – les armées arabes, Nasser, l'OLP, l'Irak, l'Iran, le Hezbollah, le Hamas – mais la guerre ne s'arrête jamais, parce que l'existence entière d'Israël, sa quête de ce qu'il appelle aujourd'hui de manière éhontée « l'espace vital », est basée sur une guerre perpétuelle avec les Palestiniens, et avec tous ceux qui soutiennent la résistance palestinienne. L'escalade est peut-être précisément ce qu'Israël recherche, ou ce qu'il est prêt à risquer, puisqu'il considère la guerre comme son destin, voire sa raison d'être. Randolph Bourne [1886-1918] a fait remarquer un jour que « la guerre est la santé de l'Etat » [3], et c'est certainement le point de vue des dirigeants israéliens. Mais ce sont les civils, arabes et juifs, qui finissent par payer le prix de l'addiction de l'Etat à la force. La région continuera de s'embraser tant que l'intelligence et la créativité d'Israël seront consacrées à la poursuite de la guerre plutôt que de la paix. (Article publié le 19 septembre sur le blog de la London Review of Books ; traduction par la rédaction de A l'Encontre)
* Adam Shatz est le rédacteur en chef pour les Etats-Unis de la London Review of Books et un collaborateur régulier de la New York Review of Books, du New Yorker et du New York Times Magazine. Il est également professeur invité au Bard College et à l'Université de New York. Il est l'auteur d'une biographie de Frantz Fanon – intitulée Frantz Fanon. Une vie en révolutions – publiée en français par les Editions La Découverte, en mars 2024.
Notes
[1] Voir sur le Hezbollah l'ouvrage de Joseph Daher, Le Hezbollah, Ed. Syllepse, 2019. (Réd.)
[2] Voir à ce propos l'intervention d'Enzo Traverso intitulée « De l'usage politique de la mémoire » (vidéo) dans l'article daté du 19 avril 2024, sur le site alencontre.org. (Réd.)
[3] Son ouvrage le plus connu, resté inachevé à sa mort, a pour titre La santé de l'Etat, c'est la guerre. Version française publiée par les Editions Le passager clandestin, en mars 2012. (Réd.)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« S’opposer à la militarisation américaine dans la région Asie-Pacifique ne devrait pas signifier rester silencieux face à l’impérialisme émergent de la Chine »

Au Loong-Yu est un militant politique et des droits du travail de longue date à Hong Kong. Auteur de L'essor de la Chine : force et fragilité et Hong Kong en révolte : le mouvement de protestation et l'avenir de la Chine, Au vit désormais en exil. Dans cette longue interview, Au discute du statut mondial de la Chine et de ses implications pour l'activisme en faveur de la paix et de la solidarité.
Tiré de Inprecor
17 septembre 2024
Par Au Loong-Yu
L'un des plus grands défis auxquels est confrontée la gauche est de s'attaquer au statut de la Chine au sein du système capitaliste mondial. L'ascension fulgurante de la Chine a conduit de nombreuses personnes à se demander si la Chine faisait toujours partie du Sud global ou si elle était devenue un pays impérialiste. Comment comprendre le statut de la Chine aujourd'hui ?
Le problème est qu'au cours des trois dernières décennies, la Chine n'a pas été un pays à part entière du tiers monde. D'un pays largement peuplé de paysans il y a 40 ans, il est aujourd'hui urbanisé à 60 % et entièrement industrialisé. Sa fabrication déploie des produits bas et haut de gamme. En conséquence, la Chine a franchi le seuil pour devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur selon la Banque mondiale. Pourtant, dans le même temps, 600 millions de Chinois disposent d'un revenu mensuel de seulement 140 dollars américains.
La Chine contient simultanément de nombreux éléments, ce qui la rend tout à fait unique. Le simple fait de regarder le PIB par habitant ou le revenu mensuel pourrait vous amener à croire que la Chine fait partie du Sud global. Mais aucune mesure ou indicateur économique ne peut à lui seul nous fournir une réponse définitive sur le statut de la Chine. La Chine d'aujourd'hui présente encore des éléments qui rappellent ceux d'un pays du tiers monde, mais l'importance de ces éléments a diminué avec le temps. Nous ne pouvons pas les écarter, mais ils ne restent que des éléments de définition du statut de la Chine. Pour tirer une conclusion utile sur la Chine, il faut considérer le pays dans son ensemble, en prenant en considération tous ses éléments.
Mais si la Chine n'est plus un pays en développement ordinaire, cela signifie-t-il automatiquement que nous devrions la qualifier d'impérialiste ?
Le statut de la Chine est compliqué et désordonné. Il n'y a pas de réponse claire par oui ou par non ; la réponse est plutôt oui et non. Je décris la Chine comme un pays impérialiste émergent – une puissance régionale très forte avec une portée mondiale. Elle possède l'intention et le potentiel de dominer les pays de moindre importance, mais n'a pas encore consolidé sa position dans le monde.
Pourquoi cette définition ? Eh bien, commençons par les critères de base de l'impérialisme. L'analyse de [Vladimir] Lénine a besoin de nombreuses mises à jour, surtout depuis la période de décolonisation d'après-guerre. Mais si nous prenons Lénine comme point de départ, il fait référence au degré de monopole, à la fusion du capital industriel et bancaire, à la formation du capital financier et au niveau des exportations de capitaux comme des caractéristiques déterminantes de l'impérialisme. Si l'on applique ces critères à la Chine, ils sont tous présents de manière très significative.
Par exemple, nous assistons actuellement à l'éclatement de la bulle du marché immobilier chinois. On oublie souvent que ce n'est que grâce à la privatisation des terrains urbains appartenant à l'État (ou plus exactement à la vente du droit d'usage du sol) que la méga-bulle du marché immobilier existe. Le régime des « terres domaniales » détermine également les principaux acteurs du marché : les municipalités, les banques (principalement publiques) et les promoteurs. Ensemble, ils ont formé une alliance de capitaux financiers fonciers pour faciliter l'enrichissement de la bureaucratie et de ses partenaires privés.
Alors que dans d'autres parties du monde, la logique impérialiste est motivée par le capital privé avec le soutien de l'État, en Chine, l'État et le capital d'État sont les principaux acteurs. Ceci malgré le fait que le secteur privé représente plus de la moitié de l'économie. Certains pourraient répondre : « Si les sommets de l'économie sont fortement monopolisés par les entreprises d'État, alors elles relèvent de la propriété sociale ou publique, ce qui est une caractéristique du socialisme ou, au minimum, la propriété de l'État est un rempart contre la recherche du profit. capitaux privés. » C'est oublier qu'il y a longtemps, Friedrich Engels s'est moqué de ceux qui pensaient que les projets de propriété d'État de Bismarck étaient une caractéristique du socialisme. En réalité, la propriété étatique et la propriété sociale sont deux choses très différentes.
L'État chinois est un État prédateur entièrement contrôlé par une classe exploiteuse dont le noyau est constitué de bureaucrates du Parti communiste chinois (PCC). Je qualifie cette classe exploiteuse de bureaucratie d'État bourgeoisisée. Cela signifie que nous avons en Chine une sorte de capitalisme d'État, mais qui mérite son propre nom. À mon avis, le capitalisme bureaucratique est le terme le plus approprié pour désigner la Chine car il capture la caractéristique la plus importante du capitalisme chinois : le rôle central de la bureaucratie, non seulement dans la transformation de l'État (d'un État hostile à la logique capitaliste – bien qu'il n'ait jamais été véritablement engagé en faveur du socialisme) — à un capitaliste à part entière), mais aussi à s'enrichir en fusionnant le pouvoir de coercition et le pouvoir de l'argent.
Cette fusion a donné un nouvel élan à la dynamique de la bureaucratie en faveur de l'industrialisation et des investissements étatiques dans les infrastructures. C'est pourquoi la restauration capitaliste de la Chine, menée par l'État et le PCC, s'est accompagnée d'une industrialisation rapide, contrairement à la chute de l'Union soviétique. C'est aussi la raison pour laquelle les entreprises publiques chinoises sont en pratique contrôlées par la bureaucratie du parti. Par son emprise sur le pouvoir d'État, il nie continuellement à la classe ouvrière ses droits fondamentaux de s'organiser. Sur le plan opérationnel, ces entreprises sont « détenues » par différentes sections et cliques de la bureaucratie, souvent via des arrangements hautement secrets.
Il convient de rappeler deux choses. Premièrement, la Chine impériale se caractérisait également par sa bureaucratie, au point que certains sociologues considèrent la Chine comme une « société bureaucratique ». L'absolutisme de l'empire n'a été possible que parce qu'il a réussi à remplacer la classe noble par des bureaucrates loyaux dans l'administration de l'État. Lorsque des tensions surgissaient entre la bureaucratie et l'empereur, l'empereur gagnait certaines batailles mais la bureaucratie gagnait la guerre, faisant de l'empereur son chef nominal. Deuxièmement, il convient également de rappeler la longue histoire d'entreprises d'État et d'entreprises d'État de la Chine impériale. Une grande partie de la richesse générée par ces entreprises est allée dans les poches des bureaucrates qui les géraient. Cette bourgeoisification d'une partie de la bureaucratie était visible dans la Chine impériale ; il était présent sous le règne du Kuomintang (KMT) ; et réapparut sous le PCC après 1979, devenant finalement une caractéristique dominante du capitalisme chinois.
L'État chinois présente-t-il également des caractéristiques expansionnistes, caractéristiques communes aux puissances impérialistes ?
En tant qu'État capitaliste bureaucratique fort, il porte nécessairement un fort impératif expansionniste qui n'est pas seulement économique mais politique. Considérez ceci : les importantes exportations de capitaux de la Chine, qui prennent souvent la forme d'investissements à long terme, signifient que Pékin a nécessairement besoin de leviers politiques mondiaux pour protéger ses intérêts économiques. Cela encourage objectivement une logique impérialiste visant à dominer les pays de moindre importance et à rivaliser avec les principaux pays impérialistes.
Mais il existe aussi une logique politique expansionniste. L'« humiliation nationale » de la Chine sous le colonialisme entre 1840 et 1949 a conduit les élites dirigeantes du PCC à jurer de renforcer le pays à tout prix. Le rêve du [président] Xi [Jinping] pour la Chine doit être interprété à la lumière du rêve de Mao Zedong de chaoyingganmei (超英趕美, dépassant la Grande-Bretagne et rattrapant les États-Unis). Même si le slogan ne doit pas être interprété littéralement, les dirigeants ultranationalistes chinois n'accepteront pas que la Chine reste une puissance de second ordre pendant encore un siècle. Cette ambition, née de l'histoire contemporaine de la Chine et du grand nationalisme chinois Han du parti, a conduit Pékin à rechercher une influence politique mondiale. Cela les amènera également, tôt ou tard, à rechercher une puissance militaire mondiale – si la Chine parvient à consolider son statut dans la période à venir.
Toute discussion sur la Chine et l'impérialisme ne peut pas se concentrer uniquement sur les aspects économiques ; au contraire, elle doit aussi prendre en compte cet aspect politique. Les dirigeants chinois contemporains, du KMT au PCC, ont tous voulu restaurer le territoire et l'influence de la Chine impériale sous la dynastie Qing. Bien avant que Pékin ne revendique la ligne à neuf traits sur la mer de Chine méridionale, le KMT avait déjà déployé sa revendication de la « ligne à onze traits » sur la même zone. En ce sens, le PCC suit les traces impériales, sans grand succès, du KMT – mais cette fois, cela a, jusqu'à présent, fonctionné bien mieux pour lui.
En se concentrant un instant sur les aspects économiques, cela signifie-t-il que la Chine n'offre aucune alternative à l'impérialisme américain pour les pays du Sud, comme semblent le suggérer les partisans d'un monde multipolaire ?
Je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle la Chine constitue une sorte d'alternative pour le Sud. Il suffit de voir ce qu'elle a fait au Sri Lanka lorsque ce dernier n'a pas pu rembourser son prêt : la Chine a obligé le Sri Lanka à céder un plus grand contrôle de son port d'Hambantota. Les entreprises chinoises, y compris celles qui appartiennent à l'État, ne fonctionnent généralement pas mieux – ni pire – que les entreprises de tout autre pays impérialiste.
Mais il faut analyser cette question à deux niveaux. La Chine, comme les États-Unis, entretient des relations avec la plupart des pays du monde. Aucune généralisation radicale n'est capable d'expliquer chacune des relations que ces deux pays entretiennent avec les autres. C'est encore plus vrai pour la Chine car elle n'est pas encore un empire mondial. Une critique générale de l'expansionnisme chinois ne doit pas nous empêcher de procéder à une analyse concrète de chaque relation. Chaque fois que nous sommes confrontés à un cas spécifique, nous devons être sceptiques quant aux actions de la Chine – et de celles de toutes les grandes puissances – mais aussi analyser la relation spécifique, en accordant une attention particulière aux voix et aux intérêts de la population locale. Ce n'est qu'en pesant à la fois le général et le spécifique que nous pouvons, en tant qu'étrangers, juger si ce que fait la Chine est bien ou mal.
Prenons par exemple l'initiative « la Ceinture et la Route ». Il est possible que certains des investissements chinois à l'étranger via ce projet profitent à d'autres pays, ou du moins causent plus de bien que de mal. Ici, les voix des populations locales peuvent nous fournir les informations les plus pertinentes dont nous avons besoin. Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos critiques générales à l'égard de l'initiative « la Ceinture et la Route ». Quel que soit le bien qu'un projet spécifique puisse apporter, il n'en reste pas moins qu'en général, l'initiative de la Ceinture et de la Route est motivée par la logique du profit et les intérêts géopolitiques du régime monolithique du PCC. Un scénario gagnant-gagnant pourrait émerger dans des cas spécifiques, mais il est hautement improbable que ce soit le cas pour la plupart des pays hôtes, que la BRI se solde finalement par un succès ou un échec pour la Chine.
Dans l'ensemble, la stratégie de mondialisation de la Chine, dans laquelle elle s'est lancée au début du siècle, représente une nette régression de la politique étrangère chinoise : d'un tiers-mondisme relativement progressiste à une priorité accordée aux intérêts commerciaux des entreprises chinoises et à l'influence mondiale de Pékin. Même si les performances de la Chine dans les pays en développement ne sont pas aussi mauvaises que celles des pays occidentaux, ce changement qualitatif de la promotion d'un développement autonome dans le tiers monde (comme le préconise Mao) à la recherche de profit dans le tiers monde est clairement un pas en arrière. De plus, l'entrée de la Chine dans la concurrence avec l'Occident pour les marchés et les ressources accélère nécessairement le nivellement par le bas pour les droits du travail et la protection de l'environnement.
Compte tenu de tout cela, pourriez-vous résumer votre vision du statut de la Chine aujourd'hui ?
En prenant tout cela en considération et bien d'autres encore, je pense que nous pouvons dire que la Chine est un pays impérialiste émergent. Elle est loin d'être consolidée en tant que puissance impérialiste, mais elle a le potentiel d'atteindre ce statut si elle n'est pas contestée de l'intérieur et de l'extérieur pendant assez longtemps.
Selon moi, le terme d'impérialisme émergent permet d'éviter certaines erreurs. Par exemple, certains soutiennent que puisque la Chine et les États-Unis ne sont pas sur un pied d'égalité, la Chine ne peut donc pas être impérialiste et que l'étiquette de « pays en développement » continue de s'appliquer. Cet argument ne parvient pas à rendre compte de la situation en constante évolution en Chine et dans le monde. Par exemple, l'ascension spectaculaire de la Chine jusqu'à devenir une nation industrialisée en moins de 50 ans est sans précédent dans l'histoire contemporaine.
C'est pourquoi il faut être capable d'appréhender à la fois l'universel et les particularités de la Chine. Son potentiel pour devenir une puissance impérialiste est immense. C'est également le premier pays impérialiste émergent à avoir été auparavant un pays semi-colonial. En outre, la Chine doit faire face au problème de son retard. Ces facteurs ont peut-être en partie contribué à son essor, mais certains aspects continuent également de paralyser sa capacité à se développer de manière suffisamment efficace et, surtout, de manière plus équilibrée.
Le PCC devra surmonter certains obstacles fondamentaux avant de pouvoir consolider la Chine en tant que pays impérialiste stable et durable. La clique de Xi sait qu'avant que la Chine puisse réaliser son ambition impériale, elle doit surmonter le fardeau de l'héritage colonial et du retard de la Chine. C'est pourquoi Pékin considère la « reprise » de Taïwan comme un élément stratégique pour sa sécurité nationale. Le fait que Taiwan soit restée séparée de la Chine continentale depuis que le Japon en a pris possession en 1895 hante le PCC.
Ici encore, les généralisations radicales ne nous aident pas lorsqu'il s'agit de « l'héritage colonial » de la Chine. Nous avons plutôt besoin d'une analyse concrète. L'héritage colonial de la Chine ne constitue pas dans sa totalité un fardeau pour son développement. Prenons le cas de Hong Kong. L'autonomie de Hong Kong permet à la ville de préserver son système juridique britannique, qui est sans aucun doute un héritage colonial. La Chine attaque le système juridique de la ville au nom du maintien de la sécurité nationale et du « patriotisme ». Pourtant, du point de vue du peuple, aussi imparfait que soit le système juridique britannique, il reste bien meilleur que celui de la Chine. De plus, le briser nuirait à l'intérêt collectif du capitalisme bureaucratique. C'est précisément cet héritage colonial qui a permis à la ville de devenir le centre financier dont la Chine dépend encore aujourd'hui : la moitié des investissements directs étrangers de la Chine transitent par la ville. Xi ne peut pas réaliser son rêve pour la Chine sans le capitalisme autonome de Hong Kong, du moins pour la période à venir.
Cela nous amène à la contradiction la plus flagrante que connaît aujourd'hui la Chine. Xi souhaite que la Chine fasse un grand pas en avant en termes de modernisation. Mais il n'a tout simplement pas les connaissances ni assez de pragmatisme pour transformer son rêve en plans cohérents et réalisables pouvant être mis en œuvre. L'acte insensé de se tirer une balle dans le pied lorsqu'il s'agit de Hong Kong reflète le retard culturel du parti ; son incapacité à établir une succession stable du pouvoir en est un autre exemple. Si l'on prend en compte l'échec du parti à moderniser sa culture politique de loyauté personnelle et de chefs de secte, nous comprenons pourquoi la capacité de la Chine à consolider sa position à la table des puissances impérialistes se heurte à des difficultés.
Que pouvez-vous nous dire sur les actions de la Chine en mer de Chine méridionale et comment, le cas échéant, elles ont contribué à la montée des tensions et à la militarisation dans la région Asie-Pacifique ?
La revendication chinoise de la ligne en neuf traits sur la mer de Chine méridionale a constitué un tournant fondamental, car elle a représenté le début de l'expansion de la Chine à l'étranger, politiquement et militairement. D'abord parce que sa prétention est totalement illégitime. La Chine, par exemple, revendique également l'île Senkaku, ce que conteste le Japon. Là, on peut au moins dire que la Chine a des arguments plus solides pour étayer ses affirmations, alors que le Japon n'a aucun fondement, que ce soit au regard du soi-disant droit international ou d'un point de vue de gauche. Il s'agit simplement d'une revendication impérialiste du Japon, en alliance avec les États-Unis. En revanche, la Chine n'a jamais gouverné efficacement toute la zone de la ligne en neuf traits qu'elle revendique (à l'exception de certaines îles, comme l'île Paracel). Sa revendication sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale n'est pas seulement injustifiée, elle constitue également une déclaration de ses ambitions hégémoniques en Asie, qui sont parallèles à ses ambitions économiques mondiales représentées par la BRI.
Certains diront que les actions de la Chine en mer de Chine méridionale sont largement défensives et visent à créer un tampon contre la militarisation américaine dans la région. Dans quelle mesure cet argument est-il légitime ?
Je pense que c'était le cas des actions de la Chine avant sa revendication en neuf tirets. Même si nous acceptons que la Chine continue d'agir de manière défensive et se contente de répondre à l'agression américaine, vous ne le faites pas en envahissant d'immenses territoires qui n'ont jamais appartenu à la Chine et sur lesquels les pays voisins ont des revendications – y compris certains qui ont été victimes de l'agression de la Chine impériale pendant des années. des centaines d'années. Il s'agit d'une invasion des zones économiques maritimes de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Elle ne peut plus être considérée comme défensive.
Il convient également de noter qu'il n'existe pas de Grande Muraille séparant les actions défensives des actions offensives, surtout si l'on considère la rapidité avec laquelle le contexte a changé en Chine et à l'échelle internationale. Aujourd'hui, Pékin a à la fois l'intention et la capacité de lancer une compétition mondiale avec les États-Unis. Du point de vue de l'intérêt collectif de la bureaucratie, il est clair que Xi a abandonné prématurément le conseil de Deng Xiaoping de « faire profil bas et d'attendre son heure ».
Bien sûr, nous devons continuer à nous opposer à l'impérialisme américain et à la militarisation dans la région, mais cela ne doit pas signifier soutenir ou garder le silence face à l'impérialisme émergent de la Chine. La question décisive à cet égard n'est pas de savoir dans quelle mesure la Chine est sur un pied d'égalité avec l'empire américain.
Comment Taiwan s'intègre-t-elle dans les tensions américano-chinoises ?
Le problème fondamental ici est que les revendications de la Chine sur Taiwan n'ont jamais pris en compte les souhaits du peuple taïwanais. C'est le point le plus important. Il y a aussi la question secondaire des tensions entre les États-Unis et la Chine. Mais ces tensions n'ont aucune incidence directe sur la question fondamentale.
Le peuple taïwanais a un droit historique à l'autodétermination. La raison est simple : en raison de leur histoire distincte, les Taïwanais sont très différents de ceux de la Chine continentale. D'un point de vue ethnique, la plupart des Taiwanais sont chinois. Mais il existe des minorités ethniques, connues sous le nom de peuples austronésiens, qui habitent de grandes parties de l'Asie du Sud-Est, y compris Taiwan, depuis des milliers d'années. Le PCC ne mentionne jamais ce fait ; il prétend que Taiwan a toujours été occupée par la Chine. Ce n'est pas vrai : les peuples autochtones existent à Taiwan depuis bien plus longtemps et leurs droits doivent être respectés.
Quant à ceux qui sont d'origine ethnique chinoise, nous avons en réalité affaire à deux groupes distincts. Environ 15 %, une minorité absolue, ne se sont installés à Taiwan qu'en 1949, après la révolution chinoise. La majorité a des descendants qui vivent à Taiwan depuis 400 ans. C'est très différent de Hong Kong, où une grande partie de la population est composée de Chinois du continent qui ont des parents en Chine continentale et considèrent toujours les Chinois du continent comme leur patrie. À Taiwan, la plupart des Chinois n'ont pas de tels liens avec la Chine continentale – de tels liens ont été rompus il y a des centaines d'années. Taiwan est une nation distincte depuis de nombreuses années. Elle jouit donc d'un droit historique à l'autodétermination.
La situation n'est pas tout à fait comparable, mais je dirais aussi qu'il en va de même pour Hong Kong. Il ne faut pas oublier que pendant 150 ans, la trajectoire historique de Hong Kong a également été très différente de celle de la Chine continentale : personne ne peut le nier, ni notre droit à l'autodétermination. Tout gauchiste occidental qui nie cela est soit mal informé, soit sa prétention d'être socialiste est tout à fait discutable.
Bien sûr, il est vrai que tout cela est désormais lié aux tensions entre les États-Unis et la Chine. En ce sens, la situation est similaire à la situation ukrainienne. Dans ce cas aussi, il y a ceux qui soutiennent la Russie ou qui ont une position neutre. À mon avis, ils ont tort. Il ne fait aucun doute que les États-Unis constituent un empire mondial qui poursuit son programme partout. Je comprends que certains gauchistes occidentaux ne veulent pas être perçus comme s'alignant sur leurs propres gouvernements impérialistes. Mais notre soutien au droit des petites nations à l'autodétermination – pour autant que nous le menions de manière indépendante – n'a rien à voir avec les États-Unis, ni avec la Chine d'ailleurs.
Nous soutenons ces luttes sur la base de notre principe d'opposition à l'oppression nationale. Nos principes ne doivent pas être compromis simplement parce que notre position peut parfois coïncider avec l'agenda américain. S'opposer à sa propre classe dirigeante ne devrait pas signifier donner la priorité à sa haine plutôt qu'à la résistance des peuples à l'oppression étrangère dans d'autres parties du monde. Voir la politique de cette façon reflète largement l'arrogance de chacun et, en même temps, un sentiment d'impuissance par rapport à sa propre classe dirigeante.
Sur quel type de campagnes de solidarité la gauche devrait-elle se concentrer lorsqu'il s'agit de Taiwan ou de la mer de Chine méridionale ?
Toute campagne de solidarité dans ces deux domaines – auxquels j'ajouterais Hong Kong – devrait comporter au moins trois points : respecter le droit des peuples taïwanais et hongkongais à l'autodétermination ; accepter que la revendication de la Chine en neuf traits dans la mer de Chine méridionale n'a aucun fondement ; et reconnaître que la capacité de s'opposer à la position de la Chine appartient avant tout aux peuples de ces trois régions et des pays voisins. En ce qui concerne les États-Unis, nous devrions rester sceptiques quant à leurs motivations mais, encore une fois, lorsqu'il s'agit de questions particulières, nous devons peser le pour et le contre de manière concrète, et surtout prendre en considération les souhaits du peuple. .
Par exemple, la question de l'achat d'armes par Taïwan aux États-Unis : nous devons être conscients que tous les scénarios de jeux de guerre suggèrent que Taïwan ne serait pas en mesure de résister à une invasion chinoise pendant plus d'une semaine et, dans le pire des cas, pendant plus d'une semaine. quelques jours . Il est évident que Taiwan doit acheter des armes aux États-Unis. Rien de tout cela ne signifie que nous soutenons les droits des États-Unis sur Taiwan. L'action doit incomber à ceux qui sont directement touchés – les habitants de Taiwan, de Hong Kong et de la mer de Chine méridionale et alentour.
Dans le cadre de leur campagne de guerre contre la Chine, les dirigeants occidentaux ont cherché à attiser le nationalisme et le racisme anti-chinois. En réponse, certains à gauche ont cherché à taire leurs critiques à l'égard de la Chine afin de ne pas contribuer à la campagne réactionnaire de leur gouvernement. Que pensez-vous de la manière dont la gauche des pays occidentaux peut s'opposer à la propagande de leur propre gouvernement sans devenir un partisan inconditionnel de la Chine ?
Le nœud du problème est que la notion campiste d'« anti-impérialisme » est non seulement timide, dans la mesure où elle cible uniquement les vieux impérialismes tout en ignorant les impérialismes émergents, mais également centrée sur l'État. Leurs préoccupations portent toujours sur tel ou tel État. Ils oublient que nous ne devrions jamais donner la priorité aux États plutôt qu'aux travailleurs, là où doit résider l'action – et cela s'étend même aux « États travailleurs ».
Les véritables socialistes devraient être centrés sur le peuple. Si quelqu'un refuse de voir comment le PCC traite les travailleurs chinois et se contente de répéter la propagande de Pékin ou refuse d'écouter la voix des travailleurs, alors je dirais qu'il n'est pas de véritables socialistes. Ils se contentent d'admirer certains États, les considérant comme une sorte de rempart contre leur propre gouvernement impérialiste. Leur impuissance les amène à applaudir tout État étranger en contradiction avec leur classe dirigeante et à abandonner ceux qui subissent la répression, simplement pour satisfaire leurs propres aspirations psychologiques.
Mais vous ne vaincrez jamais votre propre nationalisme en soutenant ou en tolérant le nationalisme chinois Han. Nous pouvons soutenir, dans certaines limites, le nationalisme des nations opprimées. Mais aujourd'hui, les Chinois Han ne sont opprimés par aucune nation étrangère ; au contraire, ils sont opprimés par leur propre gouvernement. Le nationalisme chinois Han n'a donc aucune valeur progressiste.
De plus, la version du « patriotisme » du PCC est une sorte d'ethno-nationalisme, ce qui le rend encore plus réactionnaire. Il cherche une sorte de journée (大一統, grande unification) n'est pas sans rappeler celle pratiquée par le fascisme, dans laquelle les pensées des gens doivent être placées sous le contrôle du gouvernement et les livres ne promouvant pas les valeurs officielles doivent être interdits. Garder le silence sur cette version du nationalisme chinois Han, c'est oublier l'immense tragédie des Chinois Han – désormais opprimés par leurs propres dirigeants au point qu'ils se moquent d'eux-mêmes en les considérant comme n'étant guère plus que des « poireaux chinois » attendant d'être récoltés par le parti. sur des bases régulières – et la répression brutale des minorités.
En soutenant ou en s'abstenant de critiquer un État totalitaire comme la Chine, nous creusons nos propres tombes. C'est une trahison de l'internationalisme fondamental et cela discrédite la gauche. L'internationalisme est avant tout une solidarité avec les travailleurs des différentes nations, et non avec les États, et c'est sur cette base que nous devons juger les relations entre les États, et non l'inverse.
Propos recueillis par Federico Fuentes pour Linkshttps://links.org.au/au-loong-yu-ho... le 2 décembre 2023, traduit par ESSF.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Irak. Les débats sur le Code du statut personnel font rage

Les élites chiites, au pouvoir en Irak depuis 2003, essaient de remettre en cause le Code du statut personnel qui règle les affaires familiales pour tous les musulmans, chiites comme sunnites. Avec la nouvelle proposition, les Irakiens pourraient choisir le droit spécifique chiite qui, par exemple, accepte le mariage temporaire ou celui des enfants. Pour l'heure, une partie de la société civile s'oppose à cette fracture du droit qui fragiliserait le droit des femmes et les enfants.
Tiré d'Orient XXI.
Depuis une proposition d'amendement du Code du statut personnel soumise au Parlement au cours de l'été, des débats passionnés ont envahi la scène politique et médiatique irakienne. Adoptée en 1959, la loi 188 du statut personnel définit un ensemble de dispositions légales — distinct du Code civil — qui rassemble les droits et les devoirs des citoyens musulmans en matière de mariage, de divorce, de garde d'enfants et d'héritage. L'amendement proposé rompt avec le système actuel valable pour tous les musulmans et autorise des distinctions fondées sur les principes chiites et sunnites. Les mariages, par exemple, seraient contractés selon la jurisprudence choisie au lieu de se conformer à la loi existante.
D'un côté, plusieurs groupes islamistes chiites au pouvoir depuis l'invasion américaine de 2003 ont plaidé en faveur de l'introduction d'un code sectaire. Ils insistent sur l'importance d'aligner toutes les lois sur la charia et sur la jurisprudence Jaafari (1) pour les musulmans chiites. Ils accusent leurs opposants de remettre en cause les valeurs religieuses et culturelles fondamentales et d'être des agents de l'Occident. Récemment, ils ont également rejeté un article du Code du statut personnel qui accorde la garde des enfants à la mère, l'estimant en contradiction avec la « charia » qui l'attribue au père.
Entre-temps, des organisations de défense des femmes et des droits humains, un réseau d'intellectuels et de personnalités des médias, ainsi qu'un large éventail d'opposants politiques se sont fortement mobilisés contre cette proposition (2). Organisés autour de la coalition « Alliance 188 », ils ont fait valoir que cet amendement remettait radicalement en cause la loi 188 considérée comme équitable et unificatrice pour les musulmans chiites et sunnites : en l'état actuel, elle garantit les droits fondamentaux des femmes, tels que l'âge minimum du mariage, le droit au divorce et la garde des enfants. Autoriser des codes sectaires distincts est source de division, assurent-ils, dans un contexte déjà marqué par la prédominance des tensions entre communautés et l'augmentation, durant ces décennies des guerres, des normes misogynes et patriarcales, surtout lorsque la violence politique règne.
Les interprétations de l'école chiite dominante en Irak, la jurisprudence Jaafari, déterminent l'âge de la maturité pour les filles dès neuf ans et autorisent différents types de mariages précaires (3), avec très peu de droits pour les femmes. S'il est adopté, l'amendement proposé fournira un fondement juridique aux mariages d'enfants, un phénomène déjà répandu dans le pays, et aux unions matrimoniales qui n'offrent aucune protection juridique aux conjointes. En outre, l'Alliance 188 a souligné la faiblesse structurelle du Parlement et le recours, par les groupes politiques chiites, à des méthodes antidémocratiques telles que l'intimidation, la menace de violence et le manque de transparence, pour faire adopter l'amendement. (4)
Ces débats sont souvent présentés comme une lutte entre les forces religieuses qui tentent d'imposer les lois régressives et misogynes de la charia et les forces laïques qui s'opposent à la religion et défendent les droits des femmes. Mais il s'agit d'une caricature, qui ne permet pas de comprendre ce qui est réellement en jeu.
Un conflit entre forces laïques et religieuses ?
Le Code du statut personnel n'est pas une loi laïque : il ne place pas sous l'autorité du Code civil national les « questions personnelles » de tous les citoyens, de toutes les religions et de toutes les sectes. Il permet aux musulmans de bénéficier d'interprétations spécifiques des jurisprudences chiite et sunnite — lesquelles qui ont été négociées par plusieurs acteurs, y compris des oulémas (corps de savants musulmans) des deux écoles, au cours des décennies qui ont précédé l'établissement de la loi 88 en 1959.
En d'autres termes, ces débats se situent à l'intersection de la construction de l'État et de la nation aux époques coloniale et postcoloniale — un processus qui implique divers groupes sociaux et politiques en concurrence pour le pouvoir et la légitimité, et qui est profondément marqué par les questions de classes, de « races » et de genre.
Les mobilisations autour du Code du statut personnel ne sont pas nouvelles. Plusieurs groupes islamistes chiites ont fait des propositions similaires à celle de cet été, quasiment chaque année, depuis l'invasion et l'occupation menées par les États-Unis en 2003. Elles se heurtent toujours à une forte opposition de la part des féministes et des mouvements progressistes. Elles sont d'ailleurs largement rejetées par les Irakiens eux-mêmes, qu'ils soient chiites ou sunnites.
Cette obsession a commencé immédiatement après l'invasion, avec le décret 137 (5), à l'initiative d'Abdel Aziz Al-Hakim (1953-2009), alors chef du Conseil suprême islamique d'Irak, l'une des principales organisations islamistes chiites ayant pris le pouvoir à la suite de l'invasion américaine. Le décret 137 visait à abolir le Code du statut personnel et à le remplacer par des codes sectaires. Bien que cette tentative ait échoué, en partie en raison de la mobilisation des féministes, le décret a été réintroduit sous la forme de l'article 41 de la Constitution adoptée en 2005 : ce dernier prévoit la liberté pour les Irakiens de choisir leur « statut personnel » en fonction de leurs croyances religieuses et sectaires. Contesté à l'époque par les groupes féministes, l'article 41 est souvent cité par les partis politiques chiites comme fondement juridique de leur proposition d'amendement.
L'invasion de 2003 a engendré une dynamique ayant beaucoup de traits communs avec celle de l'établissement de l'État moderne pendant l'ère coloniale (6). Comme les Britanniques dans les années 1920, les Américains ont privilégié une version fragmentée, sectaire et tribalisée de la citoyenneté, en établissant un système politique basé sur des quotas communautaires, le système muhasasa, et en s'alliant avec les forces les plus réactionnaires.
À bien des égards, l'article 41, rédigé et voté dans le contexte d'une occupation brutale, et les propositions répétées visant à établir une loi sectaire sur le statut personnel, constituent une version « américanisée » du régime politique irakien que les groupes islamistes chiites au pouvoir se sont appropriés, tout comme son argument libéral de la « liberté de choix ».
Si la proposition d'amendement était adoptée, cela signifierait un retour à un système juridique remontant à l'époque de la monarchie et de ses tribunaux religieux, tribaux et sectaires, et l'effacement de l'héritage de la première République irakienne (1958-1968). Cet héritage a été façonné par la culture de gauche anti-impérialiste des années 1950 qui a établi l'autorité de l'État émergent sur diverses organisations politiques, y compris sur les puissances coloniales et sur les autorités religieuses.
En outre, l'établissement du Code du statut personnel a marqué la participation des groupes de femmes, représentés en 1959 par Naziha Al-Dulaimi (1923-2007) — communiste et dirigeante de la Ligue des femmes irakiennes, puis ministre —, à la négociation de leurs droits. Elle était alors considérée comme l'une des plus progressistes dans la région.
Au moment de sa rédaction, les groupes islamistes chiites, qui émergeaient lentement, ont contesté la loi, estimant qu'elle sapait leur pouvoir. Les principales organisations prônant une citoyenneté fondée sur l'égalité étaient les forces révolutionnaires de gauche. Dans les années 1940 et 1950, les plus radicales d'entre elles ont exigé que le « statut personnel » soit inscrit dans le Code civil, qui accorde des droits égaux à tous les citoyens, indépendamment de leur sexe, de leur secte ou de leur religion.
À bien des égards, on peut affirmer qu'en dépit de leur opposition affichée, les intérêts des groupes chiites islamistes coïncident avec ceux des puissances coloniales et néocoloniales d'hier et d'aujourd'hui sur un point fondamental : saper les forces politiques progressistes qui prônent une citoyenneté fondée sur l'égalité dans un État fort et souverain.
Toutefois, les partis chiites qui militent en faveur de cet amendement ne sont plus la minorité politique qu'ils étaient sous la monarchie soutenue par les Britanniques au siècle dernier. Ils sont, depuis 2003, au centre du pouvoir politique. On peut se demander ce que signifie pour eux l'affirmation de leur identité religieuse sectaire alors qu'elle est déjà hégémonique dans le pays.
Au cœur des systèmes de pouvoir
Depuis sa création, à chaque crise, à chaque tournant politique, le Code du statut personnel a fait l'objet de réformes. Le régime autoritaire du parti Baas l'a également utilisé comme outil politique à différents moments de l'histoire (7).
L'élite politique chiite portée au pouvoir en 2003, son idéologie et sa politique se sont révélées particulièrement antidémocratiques, brutales, corrompues, sectaires, misogynes et machistes. Elles ont permis la mise en place du système politique ethno-sectaire fragmenté et alimenté une violence politique à la fois sectaire et sexiste, par l'intermédiaire de ses divers groupes armés (dont beaucoup sont alliés au régime iranien). Après des décennies de guerre et de militarisation, la violence est le langage de la masculinité et du pouvoir.
Plus important encore, cette élite a également facilité le démantèlement de l'État et de ses institutions, ainsi que de tous les mécanismes de redistribution des richesses, la privatisation de tout ce qui soutient la vie urbaine, de l'accès à l'électricité, à l'eau, à la santé et à l'éducation.
Au cours de l'année écoulée, elle a lancé des attaques répétées contre les droits des femmes et l'égalité des sexes, depuis l'adoption d'une loi anti-LGBTQ jusqu'à l'interdiction de l'utilisation du mot « genre ». Les théories du complot anti-occidental et les paniques liées à la « moralité sexuelle » ont servi d'écran de fumée pour détourner l'attention de l'opinion publique et d'outil pour saper l'opposition et justifier la répression violente des manifestations comme de la dissidence.
À bien des égards, on peut considérer ces attaques comme une illustration de la perte progressive de popularité de ces groupes, perçus comme responsables des terribles réalités sociales, politiques et économiques du pays, ainsi que de la violence généralisée qui domine la vie quotidienne des Irakiens. Enfin, cette stratégie est également caractéristique de la concurrence entre chiites et chiites, chaque groupe cherchant à s'affirmer par rapport à l'autre, et de l'hégémonie de l'Iran dans les affaires politiques de l'Irak.
Ce débat montre aussi comment le pouvoir opère dans le pays et dans le monde contemporain. Les droits des femmes et les questions de genre sont au cœur des systèmes de pouvoir, un point focal sur lequel le pouvoir s'affirme, se déploie ou est confisqué. Les forces rétrogrades se présentent comme les porteurs de l'authentique culture locale et les protecteurs de la religion.
Toutefois, leur stratégie n'est qu'une version programmatique d'un discours classiquement masculiniste, néofasciste et d'extrême droite que l'on retrouve dans la région, mais aussi dans le monde — de la Hongrie au Japon en passant par les États-Unis et la France. Sans surprise, ces forces ont également en commun de supprimer toutes les protections sociales ainsi que les services publics et de priver les pauvres et les classes populaires de l'accès aux ressources et aux droits essentiels. La logique de privatisation du pouvoir, des services et des ressources est constitutive de la politique brutalement instaurée avec l'invasion américaine et mise en œuvre par ces groupes depuis 2003.
C'est ce que le soulèvement d'octobre 2019 (8) contre le régime a dénoncé avec force. Il a exigé un État démocratique, souverain, fort et fonctionnel qui traite ses citoyens sur un pied d'égalité, indépendamment de leur appartenance religieuse et de leur sexe, et qui redistribue les riches ressources du pays au profit des pauvres et des groupes marginalisés.
L'attaque systématique de l'élite politique chiite contre les mécanismes juridiques et politiques qui accordent des droits et des libertés, en particulier aux femmes et aux groupes marginalisés, a pour effet de maintenir les féministes et les groupes d'activistes progressistes dans un mode défensif : ils sont constamment obligés de se battre pour préserver les droits limités existants, au lieu de faire pression pour en obtenir davantage.
Le Code du statut personnel est patriarcal et, comme l'ont affirmé les militants dans leur campagne pour l'adoption d'une loi sanctionnant la violence domestique, les femmes et les groupes marginalisés ont besoin de plus de droits et de plus de protection. Jusqu'à présent, les efforts acharnés de l'Alliance 188 ont permis de retarder la discussion parlementaire sur la proposition d'amendement, et ainsi de travailler à son retrait pur et simple.
La mobilisation des femmes, d'un large éventail de militants et de forces intellectuelles en Irak autour de ces questions a montré que l'héritage progressiste du siècle dernier continue de resurgir contre vents et marées.
Notes
1- NDLR. Du nom de l'imam chiite Jafar Al-Sadiq (702-765), fondateur de la première école de l'islam.
2- « Iraqi women academics, writers, media professionals and artists reject proposed amendments to the Personal Status Law », Petitions.net, 14 août 2024.
3- NDLR. Les chiites reconnaissent le « mariage temporaire » dit aussi « mariage de plaisir » qui se termine sans aucune procédure au bout de la durée déterminée, théoriquement pour les deux époux mais pratiquement par les hommes.
4- Page Facebook d'Alliance 188, 3 septembre 2024, texte en arabe.
5- Zahra Ali,Women and Gender in Iraq, Cambridge University Press, 2018.
6- Lire Zahra Ali, « Genesis of the “Woman Question”.The Colonial State against Its Society and the Rise and Fall of the New Iraqi Republic (1917–1968) » in Woment and Gendrer in Iraq, op.cit.
7- Zahra Ali, « Women, Gender, Nation, and the Ba'th authoritarian regime », in Women and Gender in Iraq, op.cit.
8- Zahra Ali, « Theorising uprisings : Iraq's Thawra Teshreen », in Third WorldQuaterly, vol.45, n°10, 2023.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza : une vengeance sans limites ?

Benyamin Netanyahou l'a dit : il lui fallait encore sept mois pour terminer sa guerre contre le Hamas. Juste le temps nécessaire pour que l'élection présidentielle américaine porte au pouvoir un nouveau président, en l'occurrence Donald Trump, qui lui laisserait les mains libres pour conduire la guerre à sa façon, sans soucis de préoccupation de l'opinion de la communauté internationale et avec un soutien sans failles.
Tiré de Recherches Internationales
ÉDITORIAL
MICHEL ROGALSKI
Car l'allié américain d'aujourd'hui est certes utile car sans lui cette guerre ne pourrait être poursuivie durablement, mais en même temps c'est un allié qui fixe des limites et certaines conditions. Pas de guerre régionale ou d'embrasement du Moyen-Orient ainsi qu'une totale connivence pour poursuivre à bas bruit la colonisation de la Cisjordanie et éradiquer le Hamas au prix d'une vengeance brutale, massive et indistincte sur la population gazaouie.
Car c'est bien celle-ci qui subit depuis plus de huit mois le déluge d'un tapis de bombes détruisant tout – hôpitaux, écoles, bâtiments administratifs, infrastructures civiles, centrales électriques, habitations – et se voit obligée de subir des déplacements forcés et erratiques rendant la vie quotidienne un enfer. Et tout se décide à Washington dont l'intérêt pour le Moyen-Orient n'a jamais faibli et a survécu au pivot asiatique d'Obama ou à la bascule vers l'indopacifique de Biden. Dès les premiers jours du conflit les États-Unis ont acheminé sur place deux porte-avions dont l'USS Gerald Ford, le plus grand bâtiment de guerre au monde. Cibles menacées et prévenues : l'Iran, le Hezbollah, les milices chiites en Syrie et en Irak. Pour le reste, Israël a toujours su mieux gérer ses relations avec les régimes arabes qu'avec les Palestiniens. La présence militaire américaine a su contenir et éviter tout dérapage du conflit et le ramener à ce qui apparaît comme essentiel aux yeux des dirigeants israéliens dont l'extrémisme suprémaciste et religieux les conduisent à hésiter entre recoloniser Gaza ou à en faire fuir la population vers le Sinaï.
Car il faut bien s'interroger sur les buts de cette guerre – au-delà du langage convenu d'éradication du Hamas et du retour des otages – qui dépassent désormais la simple vengeance punitive excessive, que Tel Aviv avait pris l'habitude d'administrer. Quelques jours après le début du conflit, le ministre de la défense Yoav Gallant sous l'émotion de l'attaque du 7 octobre indiquait bien que la riposte visait la population autant que le Hamas : « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Et son collègue le nouveau chef du parti travailliste, Yaïr Golan, déclarait le 13 octobre à propos des Palestiniens habitant Gaza : « Jusqu'à ce que les [otages] soient libérés, ils peuvent crever de faim. C'est complètement légitime. » Et il l'a fait, amenant la Cour Internationale de Justice saisie par l'Afrique du Sud à évoquer un risque de génocide.
Le cadre du conflit est aujourd'hui connu et reconnu et s'est établi sur une injustice consécutive à la création de l'État israélien au détriment de Palestiniens chassés de leurs terres et privés d'État. Le terme de « fait colonial » souvent évoqué à raison dans une perspective d'histoire longue aurait pu être dépassé par les accords d'Oslo, mais comme on le sait ceux-ci n'ont jamais été appliqués et la colonisation de la Cisjordanie s'est poursuivie à un rythme accéléré. La perspective en termes de solutions est aujourd'hui totalement bloquée. Au fil des décennies le conflit, au départ deux peuples pour une même terre, mais l'un privé de ses droits pourtant reconnus pat les Nations unies, s'est trouvé peu à peu happé par des influences religieuses extrémistes qui ont gagné les deux parties et attisé les haines privilégiant préoccupations sécuritaires sur toute perspective de coopération ou de co-développement. Tant que ce conflit sera traversé par ces considérations religieuses voire messianiques moins il sera possible d'approcher de la paix.
Idéalement quatre solutions peuvent être imaginées.
Deux sont possibles mais réprouvables. Et deux autres sont souhaitables mais peu réalistes. Première solution, le Hamas arrive à chasser tous les juifs du « Jourdain à la mer » et à imposer sur ce territoire un califat islamique géré par les règles de la charia. On doute que le rapport de force le lui permette ou que la communauté internationale laisse faire ce qui se traduirait par des massacres sur une grande échelle. Des chefs pourraient tenir de tels propos, des fractions palestiniennes y adhérer, mais cette voie apparaîtrait très vite sans issue.
Deuxième solution, celle que pour l'instant semble caresser Israël : se débarrasse des Palestiniens par le grignotage colonial de la Cisjordanie et renvoyer la bande de Gaza à l'âge de pierre en y rendant toute vie digne impossible pour ses plus de deux millions d'habitants dans l'espoir de les chasser vers le Sinaï. L'Égypte ne voulant pas avoir à gérer d'immenses camps de réfugiés et craignant une contamination « frériste » a su résister à cette manœuvre en fermant sa frontière. Mais le pourra-t-elle longtemps ? Cette solution serait perçue comme une défaite par les Palestiniens et ne pourrait que créer l'accumulation des conditions d'un prochain conflit. Israël ne pourrait assurer les bases de sa sécurité en entreprenant au XXIème siècle une guerre de colonisation d'autant qu'il envisage de normaliser ses relations avec les pays arabes.
La troisième solution parfois évoquée renvoie à la naissance d'un État israélien d'un autre type, d'un État arc-en-ciel sur le modèle sud-africain. Initialement portée par une partie de la gauche ce projet d'État bi-national où juifs et arabes jouiraient de mêmes droits n'a pas le vent en poupe pour au moins trois raisons. D'abord parce que la gauche a quasiment disparu depuis une vingtaine d'années en Israël et que la majorité de l'opinion publique suit la politique du gouvernement de Netanyahou dans le contexte de la guerre en cours. Elle est de fait hors jeu dans le choix des options possibles. Ensuite parce qu'en 2018 il a été établi constitutionnellement qu'Israël était l'État du peuple juif, ce qui enlève toute perspective de droits égalitaires pour les Palestiniens. Enfin parce qu'il paraît assez peu réaliste que les deux communautés puissent faire société avant longtemps après l'épisode guerrier en cours qui laissera des traces durables.
Il ne faut dès lors pas s'étonner si la quatrième solution apparaît comme la seule dicible et rallie soudainement maints pays qui jusqu'à présent s'étaient bien gardés d'agir pour la faire avancer. C'est la solution de deux États se reconnaissant l'un l'autre, en paix, se donnant des garanties de sécurité et pourquoi pas coopérant. De longues négociations seraient nécessaires et devraient aborder parmi beaucoup de questions la souveraineté et la viabilité de l'État palestinien à naître, son périmètre géographique et le sort des 700 000 colons israéliens présents en Cisjordanie. Quel gouvernement israélien serait capable d'évacuer des centaines de milliers de colons pour libérer de l'espace pour un État palestinien en Cisjordanie ? Cet espoir, emprunt d'une approche irénique, a la faveur d'une majorité de pays – parfois opportuniste, comme la posture française qui s'en réclame tout en se refusant à reconnaître l'État de Palestine – mais se heurte à une opposition farouche réaffirmée à maintes reprises par le gouvernement israélien qui ne veut pas en entendre parler alléguant que ce serait créer un nouveau Hamas à ses frontières. Cette solution qui reste envisagée comme perspective lointaine est pour l'instant bloquée.
Ce conflit, sans fin prévisible, interroge sur ses motivations et ses véritables buts. Il est devenu évident qu'on est bien au-delà d'une vengeance punitive même excessive ou que la question des otages en ait été la préoccupation centrale tant la conduite de la guerre par tapis de bombes et rasage de quartiers ne pouvait que les ajouter aux victimes. Les manifestations répétées orchestrées par les familles concernées témoignent de l'incompréhension rencontrée par le gouvernement israélien sur ce dossier.
Les commentateurs ont souvent avancé que l'opération barbare orchestrée par le Hamas était un piège tendu à l'armée israélienne pour l'embourber dans un conflit sans fin l'isolant de l'opinion publique mondiale. Les enquêtes en cours qui commencent à remonter confirment plutôt que prévenu, le gouvernement israélien aurait laissé faire, dégarnissant même le front sud et aurait profiter de cet effet d'aubaine pour aller bien au-delà. Le problème de Gaza réglé, c'est-à-dire pouvant se ramener aujourd'hui à un quadrillage policier et une surveillance maillée de la population, la voie devenait libre pour s'atteler au front nord et porter de sévères coups au Hezbollah. La tension se déplace aujourd'hui vers cette zone où les combats risquent d'être encore plus meurtriers.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mémorandum sur le génocide en cours à Gaza et ses implications concernant Israël et la Palestine

Invité à un colloque qui se tient en ce moment même en Afrique du Sud, Etienne Balibar a rédigé ce « memorandum », exprimant, de la manière la plus synthétique possible, ses « positions » sur « Israël et la Palestine », « en tant qu'intellectuel, en tant que communiste, en tant que juif ». Avec ce texte fort, Les Temps qui restent ouvre un espace de discussion autour de cette question cruciale et douloureuse, où se mesurera la capacité de notre société à faire vivre un débat à la hauteur de la gravité des enjeux.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Ce « mémorandum », demandé par les organisateurs de la conférence « Narrative Conditions towards peace in the Middle East », constitue également ma contribution à cette conférence, organisée par le New South Institute de Johannesburg dans la série des « African Global Dialogues », du 18 au 20 Septembre 2024. Adaptation française d'Étienne Balibar.
J'exposerai mes positions de façon aussi directe que possible, en espérant que la discussion permette d'apporter les nuances et compléments nécessaires.
Je dois commencer par quelques remarques préliminaires.
Premièrement, je dois avouer que je suis terriblement pessimiste quant à l'évolution de la situation dans la « Palestine historique ». Dans une analyse publiée le 21 octobre de l'an dernier, j'exprimais la crainte que la guerre d'anéantissement lancée par Israël contre Gaza pour se venger de l'incursion sanglante du Hamas le 7 octobre n'aboutisse à une destruction totale du pays et de ses habitants. Palestine à la mort . C'est en train de se vérifier, après des mois de massacre dont le caractère génocidaire saute aux yeux. La complicité active ou passive de la communauté internationale, en dépit des appels répétés du Secrétaire Général des Nations Unies, n'a rien arrangé, à commencer par celle des Etats-Unis qui fournissent à Israël les bombes écrasant Gaza et opposent leur veto à toute résolution de cessez-le-feu effectif. Les Etats Arabes du Golfe ou l'Union Européenne ont aussi leur responsabilité. Sans doute le peuple palestinien a-t-il maintes fois démontré sa capacité de survivre et de défendre son droit, mais le pessimisme est difficile à éviter. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer d'imaginer l'impossible. C'est même une obligation.
Deuxièmement, je m'exprime ici en tant qu'intellectuel, en tant que communiste, et en tant que juif (parmi d'autres identités, aucune n'étant exclusive). Israël se présente toujours comme le « refuge » dont auraient besoin les Juifs du monde entier menacés par la persistance de l'antisémitisme, ce qui lui conférerait le droit de se « défendre » à n'importe quel prix. Mais le petit-fils d'un déporté du Vel' d'Hiv mort à Auschwitz ne peut pas accepter que la mémoire de la Shoah soit constamment invoquée pour justifier le colonialisme, l'apartheid, l'oppression et même l'extermination sous prétexte de « protéger le peuple juif ». Je concède que cette profession de foi de ma part jettera le doute sur la neutralité de mon jugement, mais dans cette affaire personne n'est neutre.
Troisièmement, je porte le deuil de toutes les victimes du conflit en cours, même celles dont on pourrait dire qu'elles ont une responsabilité dans ce qui leur arrive. C'est vrai pour le passé, pour le présent, mais aussi pour l'avenir, car je pense, hélas, que la catastrophe précipitée par cette guerre va encore s'étendre et menacer tous les habitants de la région. Il y aura d'autres victimes, les unes « innocentes », les autres « coupables ». Leurs actes ne se valent pas, mais leurs morts s'inscrivent toutes dans la même tragédie.
Enfin quatrièmement, je dois dire que je ne suis pas satisfait de la manière dont la présente conférence a été organisée et rendue publique. J'aurais préféré un différent « récit » introductif et une autre composition des tables-rondes. Je comprends donc que certains des participants initialement annoncés aient décidé de se retirer, même si pour ma part j'ai préféré rester et essayer de dire ce que je pense. Mais dans sa forme actuelle cette conférence n'est pas équilibrée. Elle aurait dû inclure les juristes qui ont préparé le dossier de l'Afrique du Sud soutenant l'accusation de génocide devant la Cour Internationale de Justice (ou un de leurs collaborateurs), des historiens antisionistes israéliens, des représentants des groupes militants, sud-africains ou autres, qui défendent la cause palestinienne, et non pas simplement des défenseurs de la politique israélienne dont certains plaident pour l'expulsion des Palestiniens hors de Palestine.
Je passe maintenant au résumé de mes positions sur trois points.
Le 7 octobre et ses suites. L'assaut meurtrier du Hamas contre des villages, des positions militaires, mais aussi une rave party rassemblant des milliers de festivaliers, accompagné d'assassinats de civils, de viols et d'autres brutalités, et d'enlèvement d'otages, prend place dans un contexte, venant après des années de répression et d'opérations de terreur menées par Israël contre la bande de Gaza et sa population. Sur le plan strictement militaire, ce qui l'a rendu possible était l'impéritie de l'armée israélienne et la longue complaisance de l'Etat hébreu envers l'organisation du Hamas, qui lui apparaissait comme l'adversaire idéal à cultiver. C'est ce que la vengeance actuellement exercée est censée faire oublier ou compenser. Mais cela ne justifie rien. L'attaque du Hamas n'était pas, comme on dit tendancieusement, un « pogrom » (c'est contre les villages palestiniens qu'il y a actuellement des pogroms en Cisjordanie). Mais c'était sans conteste une action terroriste. Historiquement, terrorisme et résistance ne sont pas des notions incompatibles, bien que le premier puisse entacher la légitimité de la seconde. Je continue de penser que le Hamas avait prévu que son assaut sanglant entrainerait une vengeance dévastatrice. Il a donc pris sciemment la responsabilité de sacrifier son propre peuple pour infliger une défaite « stratégique » à l'ennemi, et le prix à payer sera long et terrible.
Qu'en est-il cependant de l'autre côté ? Le gouvernement israélien avec son armée, de plus en plus soumis à l'influence du parti des colons (qui est un parti fasciste), mais pouvant aussi compter sur la compréhension de la grande majorité des citoyens juifs sûrs de leur bon droit, que leur nationalisme rend indifférents au sort des Palestiniens (avec des exceptions d'autant plus admirables qu'elles sont de plus en plus réprimées), a cyniquement exploité le traumatisme ressenti par la population et saisi cette « miraculeuse occasion » pour « finir le travail » (comme avait dit David Ben Gourion en 1948) : relancer la Nakba, étendre les colonies de Cisjordanie en expulsant et décimant les Palestiniens, raser les monuments qui témoignent de leur histoire et de leur culture. Surtout il a planifié et mis en œuvre l'un des plus grands massacres de civils de l'histoire récente, toujours en cours à cette heure. Il est impossible de ne pas parler ici de génocide. En janvier dernier la Cour Internationale de Justice, dans l'arrêt rendu à la demande de l'Afrique du Sud, a parlé à ce sujet de « risque grave et imminent ». Ce risque s'est concrétisé depuis, ce qui veut dire que le génocide est en cours. Les nouvelles, toujours partielles, qui nous parviennent du territoire de Gaza, interdit d'accès, sont insoutenables. Ainsi que l'a démontré l'arrêt ultérieur de la Cour Pénale Internationale demandant l'émission de mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens et les chefs du Hamas (dont l'un a été assassiné depuis), rien de tout cela n'efface les crimes du 7 octobre. Mais la guerre d'extermination conduite par Israël opère un changement qualitatif dans le niveau de violence, qui affecte irréversiblement notre perception de la nature du conflit.
Parler de « conflit » israélo-palestinien est en réalité un euphémisme. Ce sera mon second point. Car ce conflit a toujours été profondément dissymétrique, du point de vue du rapport des forces comme du point de vue moral. Un abîme sépare les adversaires. Dès avant 1948 et surtout après, les Palestiniens ont subi la colonisation, l'expropriation (par une politique systématique de rachat, puis de séquestration des terres), le nettoyage ethnique, les discriminations raciales et la réduction au statut de citoyens de seconde zone, ce qui pris ensemble mène à l'effacement de tout un peuple sur son propre sol, avec son histoire et sa civilisation. Je ne dis pas que les Palestiniens n'ont aucune responsabilité dans la façon dont ce procès s'est enclenché et déroulé. Mais il n'y a jamais eu de symétrie et le niveau de brutalité atteint est aujourd'hui sans égal. C'est pourquoi on ne peut contester le droit que les Palestiniens ont de résister à leur anéantissement, y compris par les armes, ce qui ne veut pas dire que toute stratégie soit bonne et que toute forme de contre-violence soit juste. De l'autre côté cependant, la question de la légitimité se pose en de tout autres termes. Un dramatique renversement s'est produit. Je ne considère pas du tout que l'entité israélienne telle que reconnue par les Nations Unies en 1948 (malgré l'opposition des pays arabes) ait été illégitime. Mais je pense que la légitimité de l'Etat d'Israël était conditionnelle, et que depuis lors les conditions qu'elle supposait ont été perdues. Pourquoi ? Ce qui faisait la légitimité politique et morale d'Israël n'était évidemment pas le mythe du « retour » des Juifs exilés dans leur Terre Promise (que Golda Meir avait cru pouvoir décrire comme une « terre sans peuple pour un peuple sans terre »). Ce n'était pas non plus l'ancienneté des installations de colons Juifs en Palestine, promue par le mouvement sioniste depuis le milieu du 19ème siècle. L'historien israélien Shlomo Sand l'a bien dit dans une déclaration récente : les nations européennes, avec leur antisémitisme parfois virulent et leurs persécutions, nous ont « vomis », nous les Juifs (et il est d'autant plus ironique que les sionistes se soient ensuite présentés comme chargés d'apporter la civilisation et la modernité européennes en Orient !). Il n'en résultait évidemment aucune obligation pour les autochtones de leur ouvrir les bras (même si, idéalement, l'installation de colonies juives en Palestine aurait pu conduire à leur incorporation dans une société qui avait toujours eu un caractère multiculturel et cosmopolite). Le seul et unique fondement de cette légitimité – mais il pesait très lourd – c'était la capacité de l'Etat d'Israël d'offrir un refuge et de proposer un avenir commun aux survivants de la Shoah, que le monde entier avait rejetés. Implicitement au moins, et contrairement aux tendances profondes de l'idéologie sioniste (qui de ce point de vue est un nationalisme européen pur et simple), ce fondement s'accompagnait de deux conditions à remplir sur le long terme : 1) il fallait que l'installation des colons juifs soit acceptée par leurs voisins, à travers des négociations menant à une alliance entre les peuples, au lieu que les terres historiques des Palestiniens fassent l'objet d'un accaparement par des arrivants qui croient ou prétendent avoir sur elles un « droit immémorial » ; 2) il fallait que l'Etat d'Israël se construise comme un Etat démocratique et laïque, conférant des droits égaux et une égale dignité à tous ses citoyens. Au lieu de quoi (au prix de conflits internes et profitant de diverses circonstances internationales, dont les guerres menées ou envisagées par les Etats arabes), la discrimination ethnique s'est institutionnalisée, le terrorisme d'Etat a été systématisé, et l'Etat d'Israël n'a cessé de se soustraire au droit international, comme si sa vocation messianique le plaçait au-dessus des lois. Le processus aboutit en 2018 à la proclamation d'Israël comme « Etat-nation du peuple juif », c'est-à-dire à l'adoption d'une autodéfinition raciste, qui justifie l'apartheid et préfigure les crimes contre l'humanité. Israël a perdu sa légitimité historique – je le dis avec tristesse et inquiétude quant aux conséquences. Je n'éprouve aucune Schadenfreude.
Mon troisième point est alors celui-ci : tout peuple a droit à l'existence, je dis bien tout peuple, et par voie de conséquence c'est un crime contre l'humanité que de le lui ôter ou de le lui dénier. Ce droit inclut la sécurité, la protection, l'auto-défense. Mais il ne signifie pas que le droit à l'existence s'exerce dans n'importe quelle forme constitutionnelle, sous n'importe quel nom, dans n'importe quelles frontières, et coïncide avec l'affirmation d'une souveraineté absolue, ignorante des droits des autres peuples, comme si chacun se tenait seul sous le regard de Dieu ou de l'Histoire. Or toute la question dans le cas de la Palestine, c'est qu'au cours du dernier siècle, au travers d'un enchaînement tragique de violences et d'affrontements, elle est devenue la terre de deux peuples, une terre où des hommes et des femmes appartenant à deux lignées d'ancêtres et à deux cultures différentes enterrent leurs morts et élèvent leurs enfants côte à côte. Pour qu'ils puissent cohabiter pacifiquement, partager les ressources et le droit à l'existence qui leur appartient, il faudrait en recréer les conditions : or la guerre actuelle rend cela pratiquement impensable. A nouveau, je ne dis pas que les Palestiniens n'en portent aucune responsabilité, surtout s'ils s'en remettent à la politique du jihad. Mais c'est bien l'impérialisme israélien, auquel les « institutions démocratiques » de l'Etat juif n'opposent pratiquement aucun obstacle interne, qui en a ruiné la possibilité. Briser la fatalité reviendrait à inventer une forme ou une autre de fédéralisme et à imaginer le chemin conduisant à son acceptation par les deux peuples, avec l'appui de la communauté internationale et sous la surveillance de ses institutions. De ce point de vue les notions de « solution à un Etat » ou « à deux Etats » restent des formules abstraites, qui tournent en rond, tant que la condition imprescriptible d'un règlement n'est pas remplie, telle qu'Edward Said l'avait énoncée après Oslo en toute clarté : « l'égalité ou rien ». Ce qui veut dire aussi qu'il faut commencer par réparer les injustices subies et inverser la trajectoire. On en est plus loin que jamais. Mais il ne faut pas se lasser d'en réaffirmer le principe.
A supposer qu'on s'oriente dans cette direction, les exigences immédiates ne sont pas difficiles à formuler. Elles le sont davantage à mettre en œuvre.
Il faut un cessez-le feu inconditionnel à Gaza, suivi d'un échange des otages survivants contre les prisonniers politiques, une évacuation complète de ce qui reste aujourd'hui de Gaza par les envahisseurs, et le transfert provisoire de son administration à un ensemble d'organisations humanitaires sous l'autorité des Nations Unies. Une négociation ouverte avec le Hamas et d'autres forces palestiniennes pourrait en faciliter la réalisation.
Il faut réprimer la violence des colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et engager le démantèlement progressif des colonies, qui sont contraires au droit international, même si c'est au prix d'un changement de régime en Israël, et d'une refondation de l'Autorité palestinienne.
Il faut appliquer de façon rigoureuse et complète les décisions des tribunaux internationaux, dont la Cour Internationale de Justice à la demande de l'Afrique du Sud, dont on saluera ici le rôle déterminant. Cela inclut bien entendu les sanctions pénales et l'interdiction de livrer des armes à une armée qui massacre les civils.
Enfin il faut lever l'interdit qui pèse encore, sous la pression des Etats-Unis et de leurs alliés, sur la reconnaissance de l'Etat de Palestine et sur son admission pleine et entière à l'ONU. Ce qui est un point de départ incontournable pour des négociations de paix.
A ces conditions d'une « solution du conflit » qui sont largement reconnues, sinon actuellement réalisables, je voudrais pour finir en ajouter une de plus, qui peut paraître subjective, mais qui est tout aussi politique : il faut que ceux qui se considèrent comme juifs dans le monde entier se dissocient massivement de l'idée que la « protection du peuple juif » coïncide avec le soutien au colonialisme israélien, qui est meurtrier et autodestructeur. Et qu'ils rejettent l'assimilation de la critique du sionisme avec l'antisémitisme, telle que plusieurs Etats l'ont malencontreusement officialisée. Oui, le sort de l'Etat d'Israël importe aux juifs, et les conséquences de ses politiques sont leur affaire, car leur attitude collective n'est pas sans influence sur son comportement. Mais plus généralement, ce qui est en jeu, c'est le sens que le « nom Juif » gardera dans l'histoire : honneur ou déshonneur, that is the question. Les juifs, sans doute, n'ont aucun privilège à faire valoir dans la défense des droits des Palestiniens, dont la cause est universelle ainsi que je l'avais écrit il y a très longtemps Mais en ce moment même ils ont sans doute une mission à remplir.
Etienne Balibar
Notes
– Etienne Balibar : « Palestine à la mort », Mediapart (en ligne), samedi 21 octobre 2023 : https://blogs.mediapart.fr/etienne-balibar/blog/211023/palestine-la-mort.
– Voir le site www.africanglobaldialogue.org, et pour les critiques qu'elle suscite de la part de certains mouvements de soutien à la cause palestinienne : https://www.palestinechronicle.com/genocide-washing-upcoming-liberal-zionist-conference-in-south-africa-slammed/
– Etienne Balibar : Universalité de la cause palestinienne, Le Monde Diplomatique, Mai 2004 (dossier « Voix de la résistance »).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

15 agences d’aide demandent un embargo sur les armes et la fin de l’obstruction systématique d’Israël à l’aide à Gaza

Quinze organisations humanitaires internationales se sont réunies pour appeler la communauté internationale à exercer une pression en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, d'un embargo sur les armes à destination d'Israël et de la fin de l'occupation du territoire palestinien.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Des familles font la queue pendant des heures pour un repas chaud à Deir al Balah, 16-02-24 © UNRWA
Dans une lettre publiée hier avant la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York cette semaine, les organisations humanitaires, dont Oxfam, Christian Aid, Islamic Relief et Save the Children, soulignent que « tandis que les attaques militaires israéliennes sur Gaza s'intensifient, la nourriture, les médicaments, les fournitures médicales, le carburant et les tentes qui sauvent des vies sont systématiquement bloqués depuis près d'un an ».
Quatre-vingt-trois pour cent de l'aide alimentaire nécessaire n'arrive pas à Gaza, contre 34 % en 2023, ont-ils ajouté. « Cette réduction signifie que les habitants de Gaza sont passés d'une moyenne de deux repas par jour à un seul repas tous les deux jours.
Cette « baisse drastique de l'aide (...) entraîne une catastrophe humanitaire, l'ensemble de la population de Gaza étant confrontée à la faim et à la maladie, et près d'un demi-million de personnes risquant de mourir de faim », ont-ils averti.
Avant qu'Israël ne lance sa dernière guerre contre Gaza en octobre 2023, 500 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza, « ce qui n'était déjà pas suffisant pour répondre aux besoins de la population », ont déclaré les organisations humanitaires, ajoutant : « En août 2024, une moyenne record de 69 camions d'aide par jour est entrée dans la bande de Gaza.
Pendant ce temps, Israël impose « des retards et des refus qui limitent le mouvement de l'aide autour de Gaza ; un contrôle étroitement restrictif et imprévisible des importations ».
Jolien Veldwijik, directeur de CARE en Cisjordanie et à Gaza, a déclaré : « La situation était intolérable bien avant l'escalade d'octobre dernier et elle est aujourd'hui plus que catastrophique. En 11 mois, nous avons atteint des niveaux choquants de conflit, de déplacement, de maladie et de faim. Pourtant, l'aide n'arrive toujours pas et les travailleurs humanitaires risquent leur vie pour faire leur travail alors que les attaques et les violations du droit international s'intensifient ».
Amjad Al Shawa, directeur du Réseau des ONG palestiniennes (PNGO), une organisation qui regroupe 30 ONG palestiniennes et un partenaire d'ActionAid, a déclaré :
« Il y a une pénurie de tous les articles humanitaires. Nous sommes submergés par ces besoins et ces exigences urgentes... Les gens meurent de faim en raison de la pénurie d'aide... 100 % de la population dépend de l'aide humanitaire... C'est la pire situation que nous ayons connue pendant la guerre d'Israël à Gaza (....). »
Les 15 agences ont ensuite « exigé le respect » des conclusions et recommandations de la Cour internationale de justice, la fin du siège de Gaza par le gouvernement israélien et la prise en compte de l'appel lancé par la CIJ dans son avis consultatif pour mettre fin à l'occupation du territoire palestinien.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Qui a pris des mesures en faveur des droits des Palestiniens ? La « Carte de la responsabilité mondiale » est désormais en ligne

Le Palestinian Institute for Public Diplomacy (PIPD) publie cette semaine une carte interactive qui recense les mesures de désinvestissement ou de sanctions prises à l'encontre d'Israël depuis un an à travers le monde.
Tiré d'Agence médias Palestine. La carte interactive est en ligne dès à présent
La carte interactive du Palestinian Institute for Public Diplomacy (PIPD) montre les mesures et les sanctions prises depuis octobre 2023 par les États, les parlements, les tribunaux, les entreprises, les groupes de la société civile et les organisations en réponse au génocide en cours et à la Nakba en Palestine.
167 mesures sont recensées, consultables aussi sous forme de liste, et comprenant des sanctions diplomatiques, culturelles, économiques et militaires, ainsi que des actions en justice.
La carte permet une visibilité sur ce qu'il en est de la solidarité internationale avec les Palestinien·nes, au delà des discours. En effet le PIPD explique que « Les actions incluses dans la carte se réfèrent à des actions approuvées et documentées prises par des entités reconnues de la société civile, du secteur privé et des gouvernements qui demandent des comptes aux entités et aux intérêts coloniaux israéliens. Les prises de position, les déclarations, les résolutions de l'ONU, les pétitions, les manifestations et autres appels à l'action n'ont pas été pris en compte, sauf s'ils ont abouti à la mise en œuvre de mesures concrètes. »
Pour la France, malgré une mobilisation continue de la société civile depuis octobre dernier, seule 3 mesures concrètes figurent, contre 11 en Belgique et 7 au Royaume-Uni, pour ne citer que de directs voisins. Ces trois mesures comprennent l'interdiction d'entrée sur le territoire en février 2024 par le ministère des Affaires étrangères à 28 colons israéliens en Cisjordanie occupée accusés d'avoir commis des actes violents à l'égard de Palestinien·nes ; la reconnaissance, en mars 2024, de la légalité du boycott des produits israéliens ; et enfin en août 2024 la décision du groupe d'assurance AXA de se désengager de toutes les grandes banques israéliennes et du fabricant d'armes Elbit Systems.
La plupart de ces mesures font suite à la mobilisation et aux efforts inlassables des militant·es, des Palestinien·nes et de leurs allié·es dans le monde entier, qui continuent à se mobiliser pour libérer la Palestine malgré la violence des attaques et de la répression. Le combat des militant·es du mouvement BDS France pour pousser AXA à retirer ses investissements en Israël, durait depuis plus de 8 ans.
« Le désinvestissement d'AXA est un succès important pour le mouvement BDS et les activistes qui luttent pour plus de responsabilité des entreprises », se félicitait à ce sujet en septembre dernier Fiona Ben Chekroun, coordinatrice pour l'Europe du mouvement palestinien BDS, qui a lancé la campagne. « Les banques israéliennes font partie du squelette de l'entreprise coloniale israélienne. Et la participation de ces cinq banques va au-delà du simple apport financier : elles financent la construction des colonies, de leurs bâtiments et de leurs rues, mais participent aussi à la réflexion sur leur agencement et leur mise en place dans les territoires palestiniens. »
« Les efforts visant à demander des comptes au régime colonial israélien se poursuivent depuis des années, sous l'impulsion de la lutte permanente contre la Nakba et l'oppression des Palestiniens. À l'heure actuelle, notre carte ne met en évidence que les actions entreprises depuis octobre 2023, la communauté mondiale ayant renouvelé son attention sur la Palestine en raison du génocide en cours et de la poursuite de la lutte contre le colonialisme. », précise le communiqué du PIPD.
La violence du génocide en cours, sa relative et inégale couverture médiatique, auront en effet permis à renouveler une solidarité internationale, notamment de la part de la société civile d'où a émergé un mouvement social de grande ampleur pour exiger un cessez-le-feu. Si, comme l'indique cette carte, les mesures concrètes tardent à être prises par les responsables, la pression est continue et les efforts portent leurs fruits.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












