Derniers articles
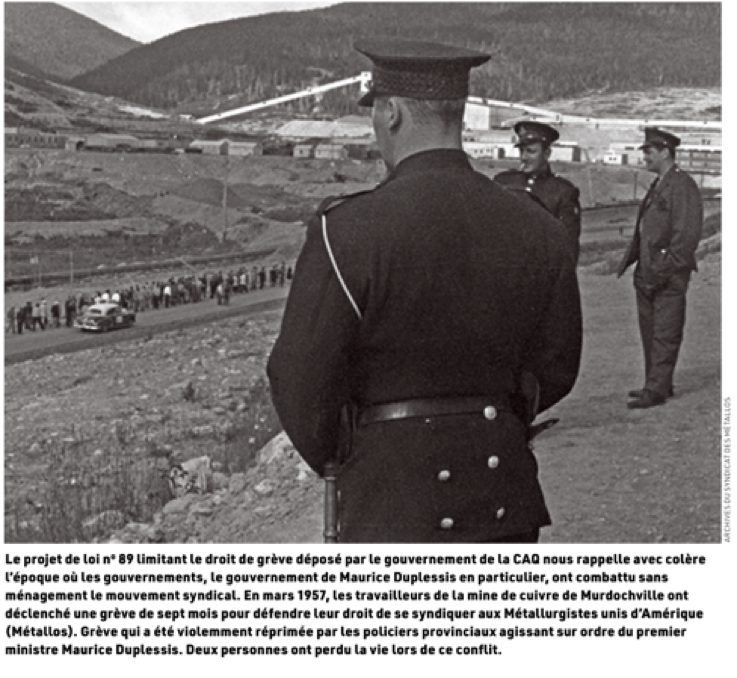
Duplessis serait fier de la CAQ
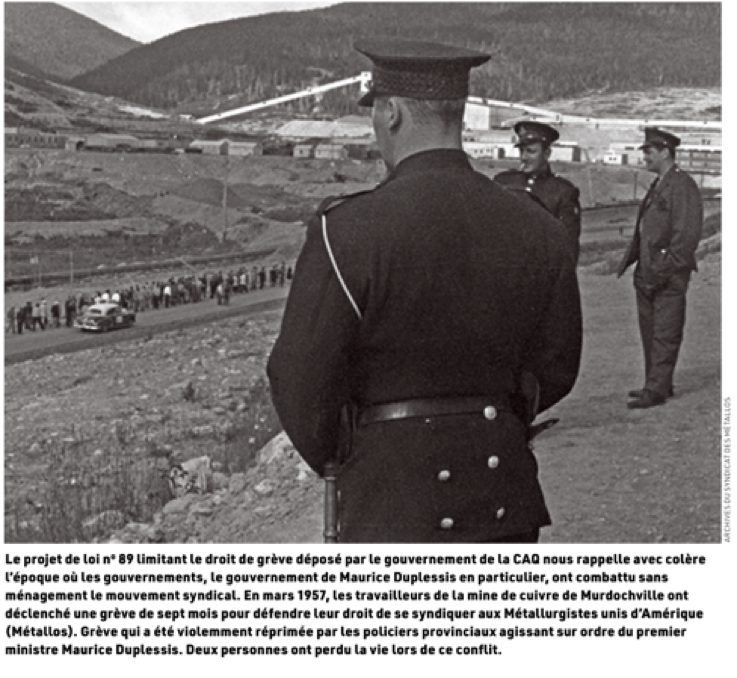
Quand un gouvernement est en chute libre, il sort la machine à diversion. François Legault, lui, a trouvé son bouc émissaire : les travailleurs et travailleuses en grève. Le projet de loi no 89, signé par le ministre du Travail, Jean Boulet, n'a qu'un but : limiter la durée des conflits de travail et affaiblir le rapport de force syndical.
Tiré du Monde ouvrier no 150
Un bon vieux truc patronal, emballé dans un joli papier PAGE 6. Enjeux féministes PAGES 11 ET 16. fleuri avec un titre qui frôle le cynisme : Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. On veut nous faire croire que le problème du Québec, ce n'est pas l'explosion du coût des loyers, ni le panier d'épicerie qui coûte une fortune, ni les familles qui se ruinent pour survivre. Non. Pour la CAQ, le danger, ce sont les personnes syndiquées qui se battent pour de meilleures conditions de travail et pour améliorer les services à la population.
La présidente de la FTQ, Magali Picard, ne se laisse pas berner : « C'est ça qui va régler les vrais problèmes du Québec ? Voyons donc ! Ce gouvernement complètement déconnecté se cherche des souffre- douleurs pour masquer un bilan désastreux. Tout ce que trouve à faire la CAQ, c'est d'inventer un problème qui n'existe pas. Ce familles qui se ruinent pour survivre. Non. Pour la CAQ, le danger, ce sont les personnes syndiquées qui se que veut faire le ministre, c'est aider les employeurs à négocier de plus bas salaires et de moins bonnes conditions de travail. »
Les grèves dérangent, et c'est normal. C'est le seul levier réel qu'ont les travailleurs et travailleuses. Sans ça, on leur passe sur le corps. Mais c'est justement ce que veut le ministre : donner les coudées franches aux patrons en les débarrassant de cette « nuisance » qu'est une grève.
« Oui, Duplessis serait fier du gouvernement de François Legault ! Brimer les droits des travailleurs et travailleuses c'était la spécialité de l'Union nationale de l'époque. C'est un retour à l'époque de la Grande Noirceur que nous propose le gouvernement de la CAQ. Ce n'est pas ça un projet de société », a réagi la présidente.
Un seul détail leur échappe : le mouvement syndical n'a pas l'intention de laisser passer ça. La FTQ sera aux consultations parlementaires et se battra bec et ongles contre cette attaque sur les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Face à la nouvelle donne géopolitique, les syndicats ne veulent pas lâcher les travailleurs ukrainiens

Alors que les forces politiques se divisent suite à l'abandon américain de l'aide à l'Ukraine, les syndicats essaient de rester unis dans le soutien aux travailleurs et travailleuses ukrainiennes, défendant tous une « paix juste et durable ». La question de l'Europe de la défense ne fait pas l'unanimité.
7 mars 2025 | tiré de Politis N° 1853 | Photo : 2025 |Rassemblement de la Fédération des syndicats ukrainiens devant le bureau du président Volodymyr Zelensky, à Kiev le 30 juin 2020, demandant l'abrogation de la loi sur le travail.
© Sergei SUPINSKY / AFP
https://www.politis.fr/articles/2025/03/monde-travail-face-a-la-nouvelle-donne-geopolitique-les-syndicats-ne-veulent-pas-lacher-les-travailleurs-ukrainiens/
« Le moment exige des décisions sans précédent depuis bien des décennies. […] C'est pourquoi […] j'invite toutes les forces politiques, économiques et syndicales du pays à faire des propositions à l'aune de ce nouveau contexte. Les solutions de demain ne pourront être les habitudes d'hier. » Dans son allocution télévisée sur la situation géopolitique, Emmanuel Macron s'est adressé directement aux organisations syndicales. Depuis trois ans et l'attaque russe sur le territoire ukrainien, tous les syndicats français sont unis en intersyndicale pour soutenir, sans faille, la résistance ukrainienne.
Ainsi, toutes les organisations syndicales étaient présentes aux mobilisations pour soutenir l'Ukraine le 23 février dernier, trois ans après le début de l'invasion russe. « L'intersyndicale est toujours unie en soutien des travailleurs et travailleuses en Ukraine. En plus de la mobilisation du 23 février, on réfléchit à un nouveau rassemblement dans les prochains jours. Dans le contexte actuel, il faut que la société civile s'exprime sur cette question. C'est trop important pour qu'on entende seulement le politique », souligne Béatrice Lestic, en charge des relations internationales au sein de la CFDT.
Le mouvement syndical ne se trompe pas en réitérant, plus que jamais, son soutien à l'Ukraine.
B. Lestic
« La situation s'est considérablement dégradée et cela nous inquiète énormément. Plus que jamais, la solidarité avec les ukrainiens est à l'ordre du jour », embraye Boris Plazzi, secrétaire confédérale en charge des relations internationales à la CGT.
Basculement
Le contexte actuel, c'est un bouleversement sans précédent du rapport de force géopolitique avec un rapprochement inquiétant des États-Unis avec la Russie. Un basculement qui, forcément, interroge les positions historiques de bon nombre d'organisations progressistes, syndicats en tête. « On ne peut pas faire comme si rien ne se passait », soutient Béatrice Lestic.
La syndicaliste accuse le modèle de société défendu par l'axe Trump-Poutine qui est dangereux selon elle, pour les travailleurs et les travailleuses. « Jamais un régime d'extrême droite n'a été favorable aux organisations syndicales. Ce à quoi on assiste n'est pas la folie d'un homme, mais bien un projet politique qui est à l'encontre de tout ce qu'on défend, sur le travail, sur les services publics. Donc le mouvement syndical ne se trompe pas en réitérant, plus que jamais, son soutien à l'Ukraine. »
De la CFDT à Solidaires, la position est partagée aux deux extrémités du spectre syndical, même si la radicalité des termes utilisés diffère d'un syndicat à l'autre. « En Ukraine, comme en Palestine, en Afrique, ou en Kanaky, partout, l'impérialisme, les régimes liberticides, l'extrême droite sont les ennemis des populations qui aspirent à la liberté, à l'émancipation sociale », peut-on lire dans un communiqué publié le 3 mars par Solidaires.
Les Ukrainiens seront transformés en esclaves.
M. Volynets
Depuis le début de la guerre, les syndicats ont ainsi envoyé plusieurs convois syndicaux selon les besoins des organisations de travailleurs ukrainiens. Le dernier en date est parti mi-2024. C'est d'ailleurs un point que tous nos interlocuteurs syndicaux soulignent. Le soutien à l'Ukraine passe, pour eux, par les organisations syndicales locales et non par Volodymyr Zelensky. « On n'est absolument pas dans une Zelenskymania, comme d'autres », explique Béatrice Lestic.
En effet, le président ukrainien profite aussi de la période de guerre pour faire passer des lois qui cassent le droit du travail et les acquis sociaux locaux. « Nous sommes en pleine bataille avec le gouvernement ukrainien depuis de nombreux mois. Car le ministère de l'Économie a décidé de réformer le code du travail sans aucune consultation en bonne et due forme. [Ce] nouveau projet protège les intérêts des employeurs et non des salariés. […] Les Ukrainiens seront transformés en esclaves », affirme, auprès de nos confrères de L'Humanité, Mykhailo Volynets, président de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine (KVPU). « On soutient aussi les ukrainiens dans leurs actions syndicales, c'est très important », glisse Boris Plazzi.
Unité ébranlée
« En 2022, le soutien de la population ukrainienne vis-à-vis de l'État et de certaines institutions comme l'armée était énorme. Zelensky était perçu comme le chef charismatique de la résistance. Cela ne veut pas dire qu'on soutenait toutes les initiatives du gouvernement, loin de là. La position des syndicats consistait par exemple à émettre des désaccords avec les actions du gouvernement, notamment avec les modifications du code du travail, sans pour autant s'engager dans une lutte sociale frontale, à la fois parce que la loi martiale interdit les grèves et les manifestations, mais aussi parсe que l'insécurité matérielle des travailleurs risquait de rendre toute grève impopulaire. Jusqu'au début 2023, il y avait cette forte unité derrière l'État mais les tensions sociales reviennent », analysait, il y a quelques jours, la philosophe Daria Saburova dans nos colonnes.
Malgré tout, la nouvelle donne géopolitique pourrait ébranler cette unité. Notamment sur la question de « l'Europe de la défense », alors que plusieurs organisations de travailleurs ont une tradition profondément pacifiste. À la CFDT, on assume défendre l'idée également voulue par Emmanuel Macron. « On a voté cela lors de notre dernier congrès, à Lyon. Mais dire qu'on veut une Europe de la défense ne veut pas dire que cela doit se faire au détriment des dépenses sociales et des acquis sociaux », martèle Béatrice Lestic.
Une posture loin d'être celle de Force Ouvrière (FO). Le troisième syndicat hexagonal dénonce dans un communiqué, « les postures va-t-en-guerre et toute escalade guerrière », et assure que, « sans être indifférente à la sécurité de la nation, FO ne veut participer ni à l'instrumentalisation, ni à l'intégration des organisations syndicales de salariés dans une économie de guerre, synonyme de renoncement et d'abandon des revendications des travailleurs ».
Inquiétudes
La CGT, elle, se tient, pour l'instant, à l'écart de ce débat. « On n'a pas pris de position sur la question », souffle Boris Plazzi qui assure, toutefois, « préférer une économie de la paix à une économie de guerre ». La CGT, comme le reste des organisations s'inquiète, notamment, de la façon dont se mettraient en place de telles hausses de dépenses dans le secteur de la défense, dans un contexte de crise des finances publiques.
Il y a une unanimité pour dire que la Russie est l'agresseur et l'Ukraine l'agressé mais, sur les moyens de se mettre en mouvement, il n'y a pas de position tranchée commune.
B. Lestic
Et ce, alors qu'Emmanuel Macron a déjà assuré – sans pouvoir le garantir, ne disposant plus de majorité – qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. « Il faudra des réformes, du choix, du courage », a-t-il ainsi soutenu. Un discours qui peut légitimement inquiéter les organisations syndicales quand on connaît l'historique des réformes menées depuis près de huit ans par feue la majorité présidentielle.
Au niveau européen c'est d'ailleurs cette question qui risque de cristalliser les tensions, alors que plusieurs pays européens – notamment du sud – pourraient augmenter drastiquement les dépenses liées à la défense. Au détriment de quoi ? Alors que la Confédération européenne des syndicats (CES), qui regroupe 88 confédérations syndicales européennes, a rapidement pris position en soutien à l'Ukraine lors de l'invasion russe. Mais une position commune sur la question des moyens à mettre en œuvre pour soutenir le peuple ukrainien n'émerge pas, malgré le contexte.
« Il y a une unanimité pour dire que la Russie est l'agresseur et l'Ukraine l'agressé mais, sur les moyens de se mettre en mouvement, il n'y a pas de position tranchée commune », souffle Béatrice Lestic. Une chose reste toutefois sûre : dans un contexte certain de montée de tensions et de course à l'armement, les syndicats devront, plus que jamais, être vigilants. Parce que la guerre est rarement – si ce n'est jamais – l'amie des avancées sociales.

Sous-traitance de chirurgies en cliniques privée : la FIQ dénonce le démantèlement du réseau public de santé au profit d’intérêts privés

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec– FIQ dénonce l'expansion incontrôlée du recours au secteur privé pour la réalisation des chirurgies. Passant de simples « projets pilotes » à une proportion alarmante de 19 % des chirurgies effectuées hors du réseau public, cette privatisation rampante ne fait qu'exacerber les problèmes systémiques du réseau de la santé.
« En réaffirmant son engagement à participer aux solutions pour améliorer l'accès aux soins, notamment par des initiatives pour réduire les listes d'attente en chirurgie, la FIQ souligne toutefois les effets pervers de l'expansion des centres médicaux spécialisés (CMS). Ces cliniques, bien qu'elles contribuent à réduire les délais pour certaines interventions, aggravent la pénurie de personnel dans le secteur public. En effet, le nombre de chirurgies en attente depuis plus d'un an reste préoccupant, démontrant l'inefficacité du recours aux CMS », exprime Julie Bouchard, présidente de la FIQ.
Le gouvernement prétend que le recours au privé est une solution pour réduire les listes d'attente. En réalité, il s'agit d'un choix politique qui affaiblit encore davantage le réseau public. Les cliniques privées attirent des professionnelles en soins qui désertent les hôpitaux en raison des conditions de travail exécrables imposées par le gouvernement. Or, c'est dans le public que ces professionnelles sont le plus essentielles, et c'est là que des investissements s'imposent.
« La proportion de travailleuses de la santé dans le privé a augmenté de 31 % entre 1987 et 2019, et en mars 2023, 16 % des chirurgies étaient réalisées en CMS. L'élargissement des interventions autorisées au privé risque d'accroître cette proportion, avec des conséquences sur les listes d'attente pour les chirurgies complexes, notamment oncologiques. La rentabilité du privé repose sur les lacunes du public, d'où l'appel de la FIQ à la vigilance pour protéger le système public de santé », souligne Mme Bouchard.
Le financement public des chirurgies réalisées dans le privé ne signifie pas pour autant l'équité d'accès aux soins. En favorisant un système à deux vitesses, le gouvernement de la CAQ crée un engrenage pernicieux : plus les ressources humaines et matérielles se concentrent dans le privé, plus le public s'affaiblit, ce qui justifie davantage encore le recours au privé. Cette spirale est dangereuse et inacceptable.
« Nous ne sommes pas les seules à le dire : ces contrats privés ne réduisent ni les coûts ni les temps d'attente. Pourtant, le ministre Christian Dubé persiste et signe, préférant ouvrir la porte à une privatisation toujours plus grande au lieu de réinvestir de manière significative dans le réseau public. Le gouvernement doit agir là où ça compte vraiment : en bonifiant les conditions de travail des professionnelles en soins et en assurant une meilleure planification des ressources humaines. La solution est connue : c'est le renforcement du réseau public, et non son démantèlement au profit d'intérêts privés », conclut la présidente de la FIQ.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Échec cuisant : l’organisme canadien censé assurer la surveillance des droits de la personne laisse les travailleuses et travailleurs du vêtement au Bangladesh croupir dans la pauvreté

Dans de nombreuses usines de vêtements du Bangladesh, les femmes et les hommes qui confectionnent les vêtements destinés à l'exportation dans le monde entier sont soumis à des horaires exténuants : six jours par semaine, 10 à 12 heures par jour. Cependant, quelles que soient la durée et l'intensité de leur travail, leurs salaires sont si bas qu'ils et elles ne peuvent échapper à la pauvreté.
Les conditions de travail et de vie déplorables de la main-d'œuvre du vêtement au Bangladesh ont poussé le Syndicat des Métallos et le Congrès du travail du Canada (CTC) à déposer une plainte conjointe auprès du Bureau de l'ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) contre le détaillant L'Équipeur et sa société mère Canadian Tire.
La plainte conjointe du Syndicat des Métallos et du CTC est l'une des premières du genre à avoir été déposée auprès de l'OCRE, fonction créée par le gouvernement fédéral pour enquêter sur les plaintes de violations des droits de la personne dans les activités d'entreprises canadiennes à l'étranger dans les secteurs du vêtement, de l'exploitation minière et de l'industrie pétrolière.
La plainte conjointe du Syndicat des Métallos et du CTC alléguait que L'Équipeur avait agi en violation des principes internationaux des droits de la personne en versant à la main-d'œuvre des usines de ses fournisseurs un salaire inférieur au minimum viable. Notre plainte trouve son origine dans notre engagement solidaire de longue date à améliorer les conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre du secteur du vêtement au Bangladesh.
Depuis plus d'une décennie, en collaboration avec des syndicats canadiens et des alliés de la société civile, le Syndicat des Métallos et le CTC s'efforcent de faire en sorte que la main-d'œuvre exploitée fasse entendre sa voix et ses préoccupations auprès des autorités, des entreprises et des consommateurs canadiens. Dans ce contexte, nos attentes étaient élevées que le Bureau de l'OCRE puisse enquêter sur les allégations de violations des droits de la personne dans la chaîne d'approvisionnement de L'Équipeur au Bangladesh.
L'Ombudsman a initialement accepté d'enquêter sur les allégations formulées dans notre plainte en mars 2024. Cependant, un changement radical s'est produit quelques mois plus tard, à la suite de la fin du mandat de la première Ombudsman, Sheri Meyerhoffer. Le 23 décembre 2024, l'Ombudsman a publié son rapport final, fermant le dossier de notre plainte sans enquêter sur les questions que nous avions soulevées, et sans recommander les mesures de suivi que L'Équipeur aurait pu prendre.
Nous sommes d'avis que le rapport de l'Ombudsman se fonde sur une approche qui mine à ce point son mandat de surveillance qu'il est difficile de concevoir une quelconque violation des droits de la personne sur laquelle il estimerait avoir la compétence pour enquêter. Par conséquent, le Syndicat des Métallos et le CTC demandent actuellement une révision judiciaire de la décision.
Le rapport final de l'Ombudsman, y compris tous nos commentaires sur ces conclusions, peut être consulté ici.
Il convient de souligner que la création du Bureau de l'OCRE est le fruit de plus d'une décennie de plaidoyer de la société civile en faveur d'une plus grande reddition de compte des entreprises, afin d'agir face aux preuves de plus en plus nombreuses d'atteintes aux droits de la personne et de dommages causés à l'environnement par des entreprises canadiennes dans le cadre de leurs activités à l'étranger.
Toutefois, le gouvernement n'a pas doté le Bureau de l'OCRE de l'indépendance et des pouvoirs essentiels nécessaires pour enquêter efficacement sur les allégations de violations commises par des sociétés canadiennes et demander qu'elles rendent des comptes. Donc, même si le Bureau avait procédé à une enquête sur la plainte déposée contre L'Équipeur, les prochaines étapes n'auraient pas été claires, puisqu'il n'avait pas le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et à fournir des documents.
Le processus qui a caractérisé notre plainte était laborieux et a exigé beaucoup de ressources, renforçant encore la position de nombreux groupes de la société civile canadienne selon laquelle le Bureau de l'OCRE a désespérément besoin d'une véritable indépendance et de pouvoirs juridiques pour remplir sa mission. L'absence continue d'action à cet égard exposera encore davantage les intentions limitées du gouvernement de garantir une véritable responsabilité des entreprises canadiennes dans l'exercice de leurs activités à l'étranger.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
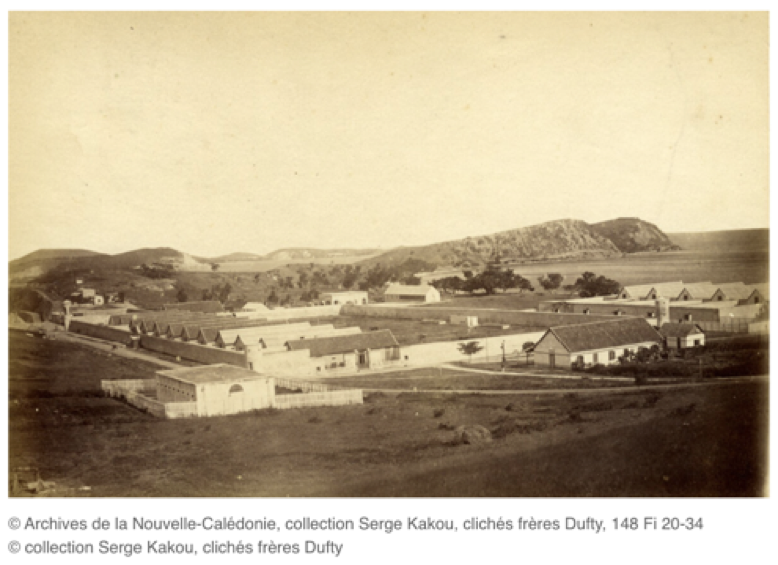
Nouvelle-Calédonie : « une terre de très grande punition »
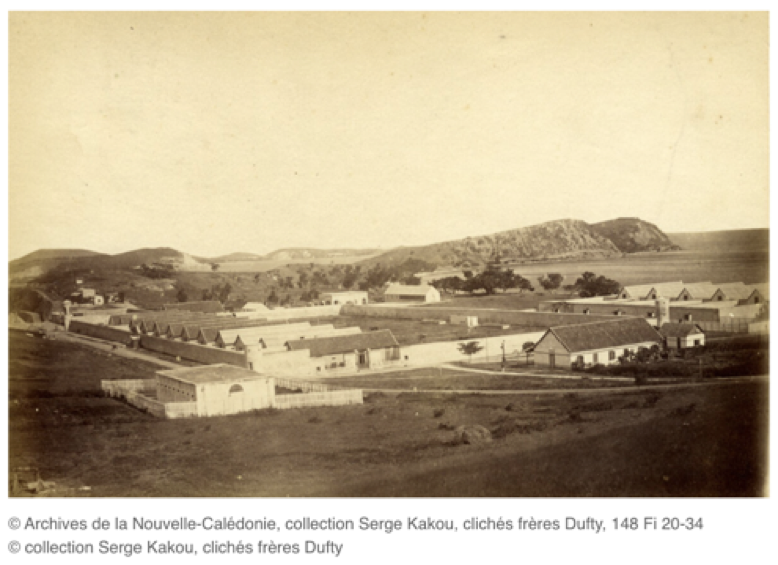
L'anthropologue Christine Salomon travaille depuis près de vingt-cinq ans sur le système judiciaire et pénal en Nouvelle-Calédonie. Dans un ouvrage à paraître co-écrit avec Marie Salaün, elle éclaire la place centrale de la prison dans l'histoire coloniale de ce territoire, à la lumière d'une comparaison avec la Polynésie française voisine.
Tiré du blogue de l'auteur.
Vos travaux montrent à quel point l'enfermement occupe une place centrale dans l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie, bien au-delà du bagne. Concrètement, comment cela se manifeste-t-il ?
Christine Salomon : Dans leur livre sur l'indigénat[1], Isabelle Merle et Adrian Muckle soulignent que dès la prise de possession du pays par les Français en 1853, chaque chef kanak « soumis » est incité à construire deux prisons, une pour les hommes et une pour les femmes. Et symboliquement, il reçoit un fanion et une « barre de justice », à laquelle fixer les fers des prisonniers enchaînés. Jusque-là, l'incarcération ne faisait pas partie des pratiques locales de contrôle social.
Comparée aux autres possessions françaises du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie apparaît vraiment comme une colonie de très « grande punition »[2]. On y crée toute une constellation de lieux d'enfermement : non seulement le bagne et ses multiples annexes, mais aussi la prison civile de Nouméa à partir de 1887, et de nombreuses chambres fortes disséminées à travers le pays – les « carabousses » ou « boîtes », qui seront intégrées aux gendarmeries. C'est là que l'on continue d'effectuer les peines de moins d'un mois jusque dans les années 1970-80. L'administration française ouvre aussi des lieux d'incarcération de ce genre en Polynésie, mais dans une bien moindre mesure.
Pourquoi cette particularité calédonienne ?
C'est surtout lié à l'instauration du code de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, en 1887. En plus de soumettre les Kanak à l'impôt et au travail forcé, il pénalise toute une série d'infractions qui leur sont propres : par exemple, se rendre dans le village européen sans autorisation, se promener « nu » – c'est-à-dire en vêtements kanak – sur le bord de la route, « débrousser » les champs par le feu, organiser des fêtes la nuit… Au total, quatre ensembles d'infractions visent clairement le mode de vie kanak. Au départ, ce cadre est présenté comme temporaire, le temps que la « mission civilisatrice » de la France fasse son œuvre. Mais en fait, il est renouvelé tous les dix ans, sans grande modification, jusqu'à l'abolition de l'indigénat dans toutes les colonies françaises en 1946. Et encore, le gouverneur de Nouvelle-Calédonie fera tout son possible pour essayer de le prolonger : ce n'est qu'en 1957 que tous les Kanak majeurs peuvent voter.
On n'a pas d'équivalent à Tahiti, où les descendants du royaume Pomare sont dès le départ citoyens français – avec des droits politiques certes très limités – et où les Marquisiens et les habitants des Îles Sous-le-Vent, bien qu'« indigènes », ne sont pas du tout soumis au même régime que les Kanak. En fait, l'extension du champ de l'indigénat et la sévérité de son application en Nouvelle-Calédonie sont exceptionnelles à l'échelle de l'Empire français, Algérie comprise.
Plus largement, la Nouvelle-Calédonie fait l'expérience d'une répression particulièrement violente. Le recours à la déportation est largement répandu et l'on compte plus de 140 exécutions capitales avant la Seconde Guerre mondiale. Quand c'est un condamné de la prison civile qui est exécuté, cela se passe en place publique, devant la population nouméenne. Et même au sein du bagne, on fait assister les bagnards à l'exécution, genou à terre… J'ai trouvé des cartes postales représentant l'échafaud, c'est dire si c'était banalisé. En Polynésie française, à l'inverse, tout le monde se souvient encore de l'exécution de 1869, l'une des deux seules à avoir été appliquées dans l'archipel. Elle a fait figure de repoussoir, et tellement marqué les esprits qu'une copie de la guillotine de fortune installée pour l'occasion a été conservée jusqu'aujourd'hui.
À quoi tiennent ces politiques répressives si différentes ?
Elles s'adossent à des représentations opposées des populations que le colonisateur cherche à contrôler. Les colons voient les Tahitiens comme de grands enfants, qui ne comprendraient pas un recours trop appuyé à la violence, alors qu'ils considèrent les Kanak comme intrinsèquement violents. Cette séparation raciste entre « Polynésiens pacifiques » et « Mélanésiens sauvages » est une vieille idée coloniale.
Mais bien sûr, ces représentations ne sont pas sui generis, elles sont le produit des interactions coloniales, et servent surtout à justifier le modèle de colonisation – et de répression – mis en œuvre. La vision du Kanak féroce est ainsi à rapprocher de la soixantaine d'insurrections qu'a connues la Nouvelle-Calédonie : au-delà des plus célèbres, en 1878 et 1917, la domination française y a toujours été contestée. Et cette idée d'une population sauvage est aussi au service de la colonisation de peuplement qui se met en place en Nouvelle-Calédonie, à la différence de Tahiti qui est au départ un protectorat – d'où un choix d'exclusion des Kanak particulièrement extrême, pour assurer la suprématie des colons. C'est le seul endroit de l'Empire où les Français placent les indigènes dans des réserves, à la britannique. On pénalise même les femmes qui s'enfuient de leur réserve pour aller vivre avec un Européen, si elles sont déjà coutumièrement mariées. Ainsi, tandis qu'en Polynésie française un groupe social métis s'est rapidement constitué, cela ne fait qu'une quinzaine d'années que le métissage est reconnu comme tel dans les recensements calédoniens !
Vous retracez l'adaptation très lente et partielle de la prison du Camp-Est, héritée du bagne, aux réformes pénitentiaires introduites dans l'Hexagone. Il semble surréaliste que le règlement interdise toujours le port de la barbe dans les années 1980…
Et ce n'est que l'aspect le plus anecdotique ! À la même époque, le régime disciplinaire se résume encore à mettre les détenus à l'eau et au pain sec deux jours par semaine… L'abandon de la Nouvelle-Calédonie comme « colonie pénitentiaire » en 1931, puis l'accès au statut de Territoire d'Outre-mer en 1946, n'ont longtemps eu que peu d'incidences sur les conditions de détention au Camp-Est. Elles demeurent proches de celles du bagne jusqu'à ce que la mort d'un détenu sous les coups de ses gardiens fasse scandale en 1966. L'incarcération reste alors gérée localement et ses modalités sont très spécifiques, inscrites dans la situation coloniale. Des détenus peuvent encore être affectés au service personnel de certains surveillants... Cette dérogation n'est définitivement abolie qu'après une importante mutinerie, en 1975, qui déclenche un certain nombre de réformes : la règle du silence est assouplie, le régime des visites et des correspondances également, un service social est institué, les détenus obtiennent le droit à l'enseignement… Mais en 1987, des prisonniers du Camp-Est sont encore privés de foot parce qu'ils refusent de couper leur barbe. Et ce n'est que dans ces années-là qu'ils obtiennent le droit d'avoir des radios individuelles.
C'est donc une transition très progressive qui se met en place jusqu'à l'étatisation de la prison, en 1989. C'est d'ailleurs très paradoxal : la pénitentiaire passe sous le contrôle direct de Paris au moment même où s'amorce la sortie de l'ordre colonial. Mais dans les années 1980, en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française, le coût des dépenses de personnel a nourri une demande de prise en charge par l'Hexagone.
Le Camp-Est semble être décrit depuis très longtemps comme vétuste et surpeuplé...
Absolument. Dans les années 1960, des rapports décrivent le Camp-Est comme trop vétuste et préconisent son abandon au profit d'une nouvelle prison… Mais on fait finalement le choix de le conserver, essentiellement parce que jusqu'en 1972, on n'y accède encore que par bateau, ce qui rend les évasions plus difficiles. Et par la suite, comme on a progressivement lancé des travaux, les dépenses déjà engagées incitent à ne pas abandonner les lieux.
La Nouvelle-Calédonie ne connaît pas le même processus de modernisation que la Polynésie française, où l'on construit une prison toute neuve en 1970. Les essais nucléaires s'y accompagnent de grands chantiers, avec des fonds d'investissement dédiés à la modernisation du territoire, et la prison fait partie du « package » au même titre que l'aéroport, l'hôpital, etc. Il n'y a pas d'équivalent de cette dynamique en Nouvelle-Calédonie, malgré le boom du nickel qui s'accompagne d'arrivées massives et d'injections d'argent, mais d'une ampleur très inférieure. Le bâti du Camp-Est reste longtemps très ressemblant à ce qu'il était auparavant, et ses abords aussi, avec un grand jardin, et même un troupeau… Ce n'est que dans les années 1980 qu'un nouveau directeur venu de métropole impulse la construction d'un nouveau bâti, qui n'aura de cesse de se développer, faisant dire aux Kanak incarcérés qu'on les met désormais en cage.
Dans quelle mesure cette évolution est-elle liée aux tensions politiques et sociales extrêmes que connaît la Nouvelle-Calédonie en 1984-1988 ?
Je n'ai pas trouvé de document établissant un lien direct, mais la mutinerie de 1975 a marqué les esprits. Elle est déclenchée par la libération d'un policier européen qui a abattu un jeune Kanak. C'est aussi le début du mouvement indépendantiste, avec de premières incarcérations qui s'accélèrent au début des années 1980. Dans ce contexte, la droite locale se préoccupe de renforcer la sécurité au Camp-Est.
En Polynésie aussi, une mutinerie éclate en 1978 à la prison de Nuutania et l'État l'attribue notamment à la montée de l'indépendantisme, liée à la lutte contre les essais nucléaires. Le procès des mutins, à Versailles, est assez retentissant. On a peu étudié les « circulations » d'un territoire à l'autre, mais plus généralement, c'est une conjoncture historique : au tournant des années 1980, il y a des inquiétudes partagées face à la montée des indépendantismes, une délinquance juvénile dépeinte comme incontrôlable… Je n'exclurais pas que cela ait pu influencer le choix d'accentuer l'enfermement, et celui de la reprise de contrôle métropolitain. Il serait intéressant d'aller voir si l'on retrouve la même volonté de serrer la vis aux Antilles, à la Réunion ou en Guyane à la même époque.
La surreprésentation des Kanak parmi les personnes détenues ne cesse d'augmenter au fil des ans. Cela peut sembler paradoxal... Avez-vous des éléments d'explication ?
En effet, c'est comme si la part des Kanak en prison augmentait à mesure que leur proportion diminuait dans la population générale. En 1956, les Kanak représentent 51 % de la population calédonienne et 65 % des personnes détenues au Camp-Est. [Leur part dans la population pénale est aujourd'hui estimée à plus de 90 % (NDLR, voir p.20)]. Faute d'étude, il est difficile d'identifier précisément les facteurs de cette évolution. Ce qui est sûr, c'est que la surreprésentation des Kanak en prison bondit lors des « événements » des années 1980. Elle monte considérablement à partir de 1985 et elle explose en 1987. Près de la moitié de l'effectif pénitentiaire est alors en détention préventive.
Les vastes manifestations indépendantistes qui ont précédé les émeutes de mai 2024 ont souvent été ponctuées de la chanson de Waan, « À bas la justice coloniale ». À quelle part d'histoire renvoie cette expression, pour celles et ceux qui la prononcent ?
Dans la mémoire récente, en Nouvelle-Calédonie, cela renvoie surtout au procès de l'embuscade de Waan Yaat, au cours de laquelle dix Kanak désarmés, dont deux frères du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, ont été abattus en 1984. Les sept tireurs, qui n'ont jamais nié leur geste et ont bénéficié d'un régime de faveur en détention, ont d'abord fait l'objet d'un non-lieu au titre d'une « légitime défense préventive », avant d'être acquittés en appel par des jurés populaires. Cette affaire a récemment fait l'objet de deux films documentaires[3], qui ont réactivé des souvenirs chez les anciens et suscité de fortes résonances émotionnelles chez les jeunes. D'autant que le dernier des sept auteurs encore en vie, qui intervient dans le film Waan Yaat, semble toujours dans le déni.
La mémoire du Camp-Est, ses conditions de détention et sa place dans le paysage calédonien jusqu'aujourd'hui jouent aussi un rôle dans cette mémoire traumatique. Pas moins de 200 jeunes militants indépendantistes y ont été emprisonnés dans les années 1980. Tout cela a fait l'objet d'une transmission familiale, qui n'est peut-être pas très élaborée mais qui résonne avec l'expérience de nombreux jeunes passés par le Camp-Est.
Certains aspects des événements actuels vous frappent-ils particulièrement, au regard de votre perspective historique sur l'histoire de l'enfermement en Nouvelle-Calédonie ?
Le plus saisissant, c'est la déportation des militants de la CCAT : c'est une vieille ficelle coloniale, depuis la déportation en France du chef rebelle haïtien Toussaint Louverture par Napoléon, jusqu'à celle du leader indépendantiste polynésien Pouvanaa dans les années 1960. On y a eu très largement recours en Nouvelle-Calédonie – et dans les deux sens : les chefs rebelles kanak étaient expédiés sous d'autres cieux, tandis que Communards et rebelles algériens étaient envoyés sur le Caillou… Par ailleurs, l'idée que des commanditaires, des « donneurs d'ordre », se cacheraient derrière l'insurrection de la jeunesse, ou plus généralement que « les parents » seraient à blâmer, me semble totalement méconnaître les normes éducatives kanak, qui laissent une très grande autonomie aux jeunes. Mais n'a-t-on pas entendu des discours assez proches, mettant en cause les familles pauvres plutôt que les inégalités sociales, lors des émeutes en banlieues de l'été 2023 ?
Propos recueillis par Johann Bihr
Cet article est paru dans la revue de l'Observatoire international des prisons - DEDANS DEHORS n°125 - Kanaky – Nouvelle-Calédonie : dans l'ombre de la prison
Notes
[1] Isabelle Merle, Adrian Muckle, L'Indigénat. Génèses dans l'Empire français. Pratiques en Nouvelle-Calédonie, CNRS éditions, 2019.
[2] Expression forgée par l'historien Michel Pierre à propos de la Guyane, dans l'ouvrage La terre de la grande punition. Histoire des bagnes de Guyane, Paris, Ramsay, 1982.
[3] Waan Yaat, sur une terre de la République française, documentaire d'Emmanuel Desbouiges et Dorothée Tromparent, Foulala Productions, 2022, 60 min, et Nouvelle-Calédonie, l'invraisemblable verdict, documentaire d'Olivier Pighetti, Piments Pourpres Productions / France Télévisions / CNC, 2023, 52 min.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Visuel de la 6e action de la Marche mondiale des femmes au Québec

Maintenant que le lancement de la Marche mondiale des femmes vient d'être effectué, nous sommes ravies de vous dévoiler le visuel qui soutiendra notre mobilisation et nos prises de paroles jusqu'au grand rassemblement de la 6e action de la Marche mondiale des femmes au Québec.
Ce visuel, portant notre thème "Encore en marche pour transformer le monde" est le résultat de nombreuses réflexions. Nous avons voulu créer une image qui non seulement représente notre thème, mais qui incarne également les valeurs et les luttes qui nous animent.
Éléments clés du Visuel
Textile :
Le visuel rappelle la courte-pointe, un symbole clé dans l'histoire de la Marche mondiale des femmes. Ce choix permet de faire un lien avec une date importante de notre calendrier, le 24 avril, journée de solidarité féministe contre les entreprises transnationales. Cette date a été choisie en mémoire de l'effondrement de l'usine textile Rana Plaza au Bangladesh, qui a coûté la vie et blessé des milliers de femmes.
Couleurs :
Les couleurs chaudes ont été privilégiées, car elles sont associées à notre organisation et aux luttes autochtones. Des notes de mauve ont été ajoutées pour faire le lien avec le réseau international de la Marche mondiale des femmes.
Symboles :
Nous avons souhaité que l'image permette à chacun de l'interpréter à sa manière, tout en mobilisant. Les symboles présents mettent l'accent sur la mobilisation et nos valeurs, notamment les thèmes de paix, d'écoféminisme et de solidarité.
Inspiration et création
L'inspiration de ce visuel puise dans l'iconographie forte des mobilisations et les 30 ans de la marche Du pain et des roses. Ce concept célèbre la solidarité en s'inspirant des arts textiles, associés à l'histoire et au travail collectif des femmes. En tissant des symboles de lutte et de paix, il reflète l'idée de construire ensemble un avenir inclusif. La symétrie représente l'harmonie et la communauté, et l'utilisation d'éléments artisanaux traditionnels rend hommage au passé tout en projetant une vision tournée vers l'avenir.
La courte-pointe nous a semblé un beau moyen de littéralement tisser ces éléments ensemble, tout en rendant hommage à notre œuvre collaborative, si inspirante et porteuse de communauté.
Nous remercions chaleureusement notre illustratrice Maia Faddoul pour son travail exceptionnel et son engagement à nos côtés. Vous pouvez la suivre sur la plateforme instagram.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Partielle de Terrebonne : les travailleurs d’Amazon dénoncent le silence complice de la CAQ et de son candidat

*13 mars 2025*—*Le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs d'Amazon Laval (STTAL-CSN) a exprimé aujourd'hui sa profonde déception face à l'inaction et l'apathie des candidats à l'élection partielle dans Terrebonne, en particulier Alex Gagné, candidat caquiste, dans le dossier de la fermeture sauvage de sept entrepôts au Québec. Plusieurs travailleurs
de l'entrepôt DXT4 de Laval habitent à Terrebonne.*
Malgré des rencontres privées avec M. Gagné et le ministre du Travail, Jean Boulet, où des promesses de soutien ont été faites, aucun engagement public concret n'a suivi. Le gouvernement continue de justifier le resserrement des achats sur Amazon par des raisons économiques et d'achat local, sans reconnaître l'injustice vécue par les 4700 travailleurs licenciés au Québec.
Le STTAL-CSN déplore cette déconnexion entre les discours privés et les actions publiques du gouvernement. Il demande que tous les partis s'engagent à soutenir les revendications des travailleurs et de la population et agissent immédiatement contre la multinationale pour obtenir une meilleure compensation pour les licenciés et l'imposition de réelles sanctions contre Amazon.
Les travailleurs d'Amazon, notamment ceux de Terrebonne et de la région de Lanaudière, poursuivront leur mobilisation pour obtenir justice et attendent que le gouvernement prenne enfin la mesure de cette crise.
Le STTAL-CSN appelle à une mobilisation massive lors du grand rassemblement prévu le 15 mars 2025 à 19h, à la Maison Théâtre à Montréal, pour dénoncer Amazon et exiger des mesures immédiates en faveur des travailleurs licenciés.
*CITATIONS :*
Félix Trudeau, président du STTAL-CSN :
- "En privé, on nous assure que le gouvernement nous appuie, mais c'est une toute autre affaire en public. Ni le candidat Alex Gagné, ni le ministre Jean Boulet n'ont pris publiquement position en faveur de nos revendications et de notre cause."
- "Il y a un abandon de la part de ces représentants de la CAQ par rapport aux travailleurs d'Amazon, notamment ceux qui habitent à Terrebonne et dans Lanaudière."
- "Les autres candidats ont été difficiles à rejoindre. Alex Gagné nous a écouté parce que nous sommes allés dans son bureau et nous lui avons dit que nous ne partirions pas tant qu'il ne nous parlerait pas."
- "Pour beaucoup de travailleurs qui ont été jetés à la rue par Amazon, les compensations sont en-dessous du minimum légal. Nous, on veut des vraies compensations, mais aussi qu'Amazon subisse les conséquences de ses
actes et soit sanctionné sévèrement."
- "On va continuer notre lutte pour obtenir justice. On veut que le gouvernement prenne la mesure de cette mobilisation-là, nous rencontre et accède à nos demandes."
*À propos du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs d'Amazon Laval (STTAL-CSN)* : Le STTAL regroupe les travailleurs et travailleuses de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, à Laval. Il a été fondé en mai 2024. Il est le premier syndicat de la multinationale au Canada.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mouloud, dans le club des puissances nucléaires

( Le téléphone sonne... La Secrétaire qui manucurait pénardement ses ongles, sursaute)
– Service après-vente, bonjour ! Je vous écoute.
– Bonjour, azoul, Madame !
- Je vous entends mal, Monsieur azoul.
– Non, Madame ! azoul, c'est pas mon nom. Cela signifie « bonjour » en kabyle. Moi, c'est Mouloud.
– Mes excuses, Monsieur Mouloud. Parlez un peu plus fort, SVP ! Que puis-je pour vous ?
– Je suis obligé de baisser la voix, Madame « Les murs ont des oreilles ».
– Dans ce cas, parlez doucement, si vous le pensez indéniablement !
– D'accord, Madame. Voilà, c'est au sujet de ma commande. Elle a été soldée, mais dans la livraison, il manquait un article d'une importance capitale. Cela m'inquiète
– Ah oui, ça me revient ! C'était une…
- Chuut, Madame, SVP ! Dites : « Champignon flamboyant » à la place de la désignation, et tout se passera dans l'anonymat absolu.
– Vous me faites marrer. Rien ne relève de la confidence de nos jours. Même le Très Secret Défense. Il vous faut une mise à jour, Monsieur. Appelons un chat, un chat ! Au point où nous en sommes…
- Vous avez raison, Madame. Appelons « Amchich, Amchich* » !
- Le monde est une dynamique de brutalités repensées qui ne s'offusque pas de déclarer les Apocalypses, et vous, vous jouez au « Peace and Love ». C'est ballot !
- Comment… ? Ballon ?
- Non ! Pas ballon ! Décidemment vous avez le foot dans le sang, vous autres. J'ai dit ballot, qui veut dire « c'est dommage, c'est bête ».
– Mes excuses, Madame. – Donc, Monsieur Mouloud, la Bombe nucléaire qu'on vous a livrée manquait d'éléments ?
- Oui, Madame ! Il y avait presque tous les modules et les composants électroniques, sauf la valise avec le bouton rouge et les équipements de protection.
– Mais il avait la tête où notre livreur ? Monsieur, soyez rassuré, je vous fais parvenir tout ça sous 48 heures.
– Génial !
- Il vous fallait autre chose ?
- Pour le moment, non.
– Etes- vous sûr ?
- Je reviendrai vers vous, si besoin est.
– Une carte de Fidélité, par exemple ?
- Ah, ça c'est pas mal.
- Il fallait y penser, Monsieur Mouloud. Cette carte vous permet de cumuler des points pour une remise sur l'achat de votre deuxième Bombe nucléaire, plus dévastatrice. Elle est renouvelable tous les 5 ans, sans frais.
– Allez ! « Qui veut la fin, veut les moyens ». Dites-moi, par rapport à Hiroshima et Nagasaki, c'est comment ?
– Le jour et la nuit.
- Tant que j'y pense. Est-ce qu'il faut le baptiser, « mon feu d'artifices » ? Comme « l'opération gerboise ».
– Ca ? C'est à vous de choisir. L'important est d'acquérir votre arme de dissuasion au plus tôt. Surtout si vos tréfonds regorgent de terres rares, d'or noir… Vous savez, on est dans le MAD MAX de la Géopolitique apocalyptique contemporaine, avec comme synopsis, la prédation « trumpo-macroniste ». Une folie de rapports de force où la paix est négociée par intérêts interposés suicidaires.
– Alors je m'estime heureux d'avoir passé commande dans les meilleurs délais.
– Monsieur, le Nouveau Club des Puissance Nucléaires (NCPN) est là pour vous servir. La prolifération sera au monde ce que les galaxies à l'espace intersidéral.
– Votre amabilité me désarme.
– Je vous en prie, Monsieur Mouloud. D'autres questions.
– J'en ai une, mais j'hésite.
- Voyons, vous êtes un client potentiel et notre confiance mutuelle n'a pas de prix.
– Au fait, j'ai 3 amis intimes, comme des frères, qui seraient ravis de faire partie du NCPN.
– Du même pays ?
- Non, du Mali, Niger et Burkina Faso.
– Pas de souci. Du moment qu'ils paient, ils seront livrés selon les modalités.
– C'est vrai ?
- Je ne plaisante pas. Le monde se réinvente dans la barbarie et les dominés s'emparent eux aussi de la Technologie. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux (es).
– Mon Dieu ! Amis africains, votre destin vous appartient ! Madame, vous permettez que j'appelle mon copain Soumaré au Mali, pour lui annoncer la nouvelle ?
- Faites donc !
( Il dégaine son téléphone… ).
– Allo, Soumaré, c'est bon ! A partir d'aujourd'hui, on joue dans la cour des Grands !
- Dis Ouallah !
- Ouallah !
- Ces fumiers d'Occidentaux vont bouser comme des vaches bretonnes.
– Eh, Mouloud ! Passe-moi la Dame !
- (…)
- Oui Monsieur Soumaré.
– Madame, Merci de tout cœur pour la prise en charge de nos commandes.
– C'est mon travail.
– Comme vous avez l'air gentil, est ce qu'il serait possible de m'accorder une petite faveur ?
- Dites toujours !
- Payer ma Bombe nucléaire en 3 fois !
Texte Omar HADDADOU Paris 2025
Lexique : *Amchich : Chat en kabyle *Dis Ouallah ! : Jure au nom d'Allah)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Vous n’êtes pas seules. L’antisémitisme n’a pas sa place dans nos luttes !

Des dizaines de milliers de femmes et d'hommes ont manifesté ce 8 mars pour les droits des femmes et la solidarité internationale avec toutes les femmes. Nous étions bien sûr présentes et présents et ce fut une belle et puissante mobilisation. Pour la majorité des manifestantes ce fut un moment de solidarité, de sororité, de joie mais aussi de gravité, au regard des menaces mondiales qui pèsent sur les droits de toutes les femmes.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/13/lettre-a-nos-soeurs-juives/
Cependant, nous avons reçu beaucoup de témoignages de personnes juives qui n'ont pu manifester avec le reste du cortège ou qui se sont senties mal à l'aise, exclues, ciblées pendant notre manifestation. Certaines ont fait l'objet de menaces et d'insultes. Ces violences sont intolérables.
Nous le rappelons avec force aucune femme ne peut être exclue de la mobilisation féministe en raison de son identité, de sa religion, de sa culture. Le féminisme est une revendication du droit de toutes les femmes à l'existence légitime, quelle que soit sa nationalité ou sa confession, en dehors de toute violence, inégalité et oppression.
Les femmes qui souhaitent porter la voix des femmes israéliennes victimes de violences sexuelles doivent pouvoir s'exprimer à nos côtés.
Nous dénonçons fermement ces agissements et appelons à la solidarité avec toutes les femmes du monde. La solidarité internationale ne se divise pas. Nos indignations ne sont pas à géométries variables. Quels que soient nos désaccords politiques, les violences, diffamations et intimidations n'ont pas leur place dans nos luttes. Ni le racisme, ni l'antisémitisme, ni la haine des musulmans ne sauraient y être tolérés. Les antisémites et les racistes ne doivent plus capturer nos espaces collectifs de mobilisation. Le 8 mars est la Journée internationale du droit des femmes, de toutes les femmes.
Les groupes minoritaires ne doivent plus abîmer nos combats et nos solidarités.
Nous sommes bien plus nombreuses, alors faisons plus de bruit.
Signataires : Fondation des femmes, Femen, le Planning familial, Femmes solidaires, l'Assemblée des femmes, Osez le féminisme, la Ligue du droit international des femmes, Alliance des femmes pour la démocratie (AFD), Réseau féministe Ruptures, les Guerrières de la paix, SOS Racisme, LDH (Ligue des droits de l'Homme), United for Ukraine, Russie libertés, We are not weapons of war, Golem, Raar, Jalons pour la paix Aubervilliers, Juives et Juifs révolutionnaires.
Paris, le 11 mars 2025
https://www.ldh-france.org/lettre-a-nos-soeurs-juives/
https://raar.info/2025/03/lettre-a-nos-soeurs-juives/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pakistan : Déclaration à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2025

Déclaration à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2025
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/17/pakistan-declaration-a-loccasion-de-la-journee-internationale-de-la-femme-le-8-mars-2025-aurat-march-karachi/
Aurat March, Karachi
C'est le 8 mars 2018 que la Marche de l'Aurat a commencé à Karachi et dans d'autres grandes villes du pays. Nous marchons depuis sept ans, nous avons ébranlé le statu quo patriarcal au Pakistan et nous sommes désormais une entité bien connue.
Cet événement annuel important n'a pas seulement pris de l'ampleur, il a également créé un mouvement, un groupe de travail réclamant la liberté et appelant à la défense des droits des femmes et de toutes les personnes et communautés opprimées. Le 8 mars 2025 marque la 8e année de la Marche de l'Aurat.
Pourquoi marchons-nous ? Nous marchons parce que nous voulons un changement socio-économique et politique du système actuel, et la fin de toutes les formes de discrimination patriarcale, de violence fondée sur le genre, d'inégalité et d'injustice.
Qui sommes-nous ? Nous sommes des féministes interclasses, interethniques et intersectionnelles – nous sommes les minorités religieuses, les minorités de genre, les travailleuses des usines et des foyers, les travailleuses agricoles et les éleveuses non rémunérées, les pêcheures – nous sommes les opprimées, mais nous sommes les rebelles et notre défiance grandit chaque jour.
Nous marquons le 8 mars, Journée internationale des femmes, en informant le public qu'aujourd'hui, nous ne marcherons pas. Cette année, notre marche Aurat aura lieu au mois de mai.
Le mois de mai est très important car c'est le mois où l'on célèbre la fête du travail (fête des travailleurs et des travailleuses) le 1er mai. Les femmes sont les premières travailleuses de toute société et de toute communauté. Sans le travail des femmes, il n'y aurait pas de société. C'est pourquoi chaque jour est la journée des femmes.
Le mois de mai célèbre également les mères dans le monde entier, y compris au Pakistan.
Nous annonçons donc que la Marche de l'Aurat 2025 aura lieu le dimanche 11 mai à Karachi. Nous espérons que tous et toutes les habitantes de Karachi et d'ailleurs se joindront à nous.
Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous sommes solidaires de toutes nos sœurs pakistanaises et internationales, en particulier des femmes courageuses du Baloutchistan et de Parachinar (Kurram), de celles dont les proches sont toujours portées disparues, et des femmes qui luttent en Palestine, en Ukraine, en Afghanistan et au Cachemire. Nous pensons que leur lutte et la nôtre sont les mêmes – contre le patriarcat, la guerre, la brutalité, la violence fondée sur le sexe, la pauvreté — en relation avec la lutte des femmes pour l'identité, la liberté, la justice et l'égalité.
Marche d'Aurat, Karachi, 2025
http://www.sacw.net/article15310.html
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

8 mars : Solidarité avec les femmes de Gaza, de la RDC et du monde entier

En cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le CADTM réaffirme son engagement aux côtés des mouvements féministes qui, partout dans le monde, se battent contre les oppressions systémiques : capitalisme patriarcal, exploitation néocoloniale, et violences militarisées.
Tiré de CADTM infolettre , le 2025-03-11
https://www.cadtm.org/8-mars-Solidarite-avec-les-femmes-de-Gaza-de-la-RDC-et-du-monde-entier
7 mars
COMITE POUR L'ABOLITION DES DETTES ILLÉGITIMES (CADTM)
Les dettes illégitimes pèsent d'abord sur les femmes
Les politiques d'austérité imposées au nom du remboursement de dettes illégitimes frappent en premier lieu les femmes*, qui au sein de nos sociétés sont surreprésentées dans les secteurs précaires et invisibilisés. Privatisation des services publics, destruction des systèmes de santé, démantèlement des protections sociales : les conséquences sont dramatiques pour les femmes (ainsi que pour les groupes les plus vulnérables de la population), qui compensent l'absence de nos États. Dans tous les pays, des Sud comme du Nord, les logiques de dette et de profit s'appuient sur l'exploitation du travail gratuit ou sous-payé des femmes.
Les femmes des Suds paient le prix fort !
Dans un contexte mondial marqué par l'aggravation des crises écologiques, économiques et sociales, les femmes des Suds paient le prix fort de l'endettement illégitime de leurs États. L'endettement alimente des politiques néolibérales imposées par les institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale), qui démantèlent les services publics et privatisent les biens publics.
Que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, ce sont elles qui compensent, par un travail invisible et non rémunéré, la destruction des systèmes de santé, d'éducation, d'accès à l'eau et à la terre. Ces violences, loin d'être isolées, s'entrelacent et s'inscrivent dans un système global de domination où patriarcat, racisme, capitalisme et colonialisme s'alimentent mutuellement.
Rappelons qu'en Belgique, il est estimé que 70 000 à 80 000 femmes sans papiers travaillent dans le secteur domestique (selon la Ligue des travailleuses domestiques). Ces milliers de femmes, privées de droits et exploitées répondent en Belgique à une pénurie de services dédiés à l'enfance et aux personnes dépendantes, un secteur abandonné par l'État belge. Transférer ce travail de care essentiel à des travailleurs.es sans papiers, invisibilisé·es et mal payé·es constitue un des symptômes de nos sociétés libérales, qui exploitent les populations les plus vulnérables et dévalorise le travail des femmes au profit des plus riches.
Gaza : les femmes face à la guerre et à la destruction
À Gaza, les femmes palestiniennes subissent dans l'indifférence une violence inouïe, combinant occupation coloniale, bombardements incessants, déplacements forcés et privation de soins élémentaires. Elles font face à l'assassinat de leurs enfants, la destruction de leurs foyers, de leurs écoles, de leurs hôpitaux. Elles doivent survivre dans des conditions où l'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments est rendu quasiment impossible. Le CADTM dénonce un génocide en cours et la violence coloniale sioniste, soutenus par les puissances occidentales. Le CADTM exprime sa solidarité inconditionnelle avec les femmes de Palestine et le peuple palestinien qui résistent. Selon les données disponibles, les femmes et les enfants représentent une part significative des victimes dans la bande de Gaza. L'ONU a indiqué que, d'octobre 2023 à octobre 2024, les femmes et les enfants constituaient « près de 70 % » des décès à Gaza. Par ailleurs, Oxfam a rapporté que plus de femmes et d'enfants ont été tué·es par l'armée israélienne en un an de guerre à Gaza que durant toute autre période équivalente au cours des vingt dernières années.
RDC : l'exploitation des ressources s'accompagne de violences extrêmes contre les femmes
En République Démocratique du Congo, le corps des femmes est en première ligne face aux violences. Dans les zones minières, où l'exploitation du cobalt, du coltan et d'autres minerais alimente les chaînes d'approvisionnement mondiales, elles subissent violences sexuelles, mutilations et déplacements forcés. Le CADTM rappelle que l'extraction prédatrice des ressources congolaises est intimement liée au système de la dette, utilisé comme un outil de domination qui soumet le pays à une dépendance structurelle.
Dans l'Est du pays, notamment au Kivu, les violences perpétrées par les groupes armés comme le M23, soutenus par des intérêts régionaux et internationaux, s'inscrivent dans une logique néocoloniale d'exploitation des richesses du sous-sol congolais (parmi d'autres facteurs interdépendants). Les violences sexuelles, utilisées comme instrument de contrôle et de soumission des femmes, tout comme les déplacements forcés, ne peuvent être réduites à de simples manifestations de violence individuelle ou à des conséquences directes des conflits armés. Elles s'inscrivent dans un système global où les logiques économiques extractivistes et les rapports de pouvoir jouent un rôle central dans la perpétuation de ces violences contre les femmes.
Le CADTM dénonce la complicité des créanciers internationaux et des multinationales dans la perpétuation de ces violences. L'endettement illégitime de la RDC depuis des décennies, n'a servi qu'à priver les populations d'infrastructures, et en particulier les femmes, de leurs droits fondamentaux d'accès à la santé, à l'éducation et à la sécurité.
Luttons pour un monde libéré de la dette, du patriarcat et du colonialisme
Face à ces violences systémiques, le 8 mars est pour nous une journée de lutte internationale pour une transformation radicale de nos sociétés et pour construire une résistance collective au modèle dominant. Nous considérons que les luttes des femmes sont indissociables de la lutte contre le capitalisme, contre les dettes illégitimes et pour la justice sociale, écologique et féministe.
Le CADTM appelle à la solidarité internationale avec les femmes de Palestine, de la RDC et de toutes les régions du monde où les violences patriarcales, racistes et économiques pèsent sur nos vies. Nous réaffirmons que l'annulation des dettes illégitimes, la fin des politiques d'austérité, la souveraineté économique et l'autodétermination des peuples sont des conditions indispensables pour un avenir féministe, juste et libéré, du Nord aux Suds.
Le 8 mars, faisons grève, descendons dans la rue pour un monde sans dettes, sans exploitation et sans guerre !
*Lorsque nous faisons référence aux femmes, il s'agit de toute personne identifiée et/ou s'identifiant comme femme.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Ces grèves illustrent bien pourquoi nous ne devons pas céder au désespoir »

Janine Jackson a interviewé Eric Blanc, de l'Université Rutger sur l'organisation syndicale comme force de résistance clé ; invité à l'émission CounterSpin du 7 mars 2025. Ceci est une transcription légèrement modifiée.
Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR), New York, le 13 mars 2025
Texte original et audio sur https://fair.org/home/these-strikes-are-a-good-example/
Traduction Google+a.c.
Réalisé par CounterSpin.
Sur Janine Jackson (auteure de cet article) : voir https://fair.org/author/janine-jackson/
Janine Jackson : La période politique difficile et inquiétante que nous traversons met en lumière certaines fissures profondes de la société américaine. Outre le choix de certains, nous découvrons les leviers de pouvoir dont disposent réellement les citoyens ordinaires et comment les utiliser. Et cela nous rappelle que l'antidote à la peur et à la confusion réside dans l'entraide, dans la communauté, y compris cette forme particulièrement puissante de communauté qu'est le syndicalisme. Mais en fait, les travailleurs peuvent exercer un pouvoir même sans recourir à un syndicat, même si ce n'est pas quelque chose que l'on entend souvent dans les grands médias.
Eric Blanc est un militant et organisateur syndical de longue date, ainsi que professeur adjoint d'études sociales à l'Université Rutgers. Il est l'auteur de « Red State Revolt : The Teacher Strike Wave and Working-Class Politics » ( Éd. Verso [1] ) et, à paraître cette année, de « We Are the Union : How Worker-to-Worker Organizing Is Revitalizing Labor and Winning Big » ( Éd. UC Press [2] ). Il rédige également l'infolettre « laborpolitics.com ». Il nous rejoint par téléphone depuis chez lui. Bienvenue sur CounterSpin, Eric Blanc.
Eric Blanc (EB) : Merci de m'avoir invité.
*JJ :* Commençons par les fonctionnaires fédéraux, qui sont, comme on le voit, une cible privilégiée de Trump et Musk, mais vous nous rappelez que les fonctionnaires fédéraux constituent également une force de résistance essentielle. Parlez-nous-en.
*EB* : Difficile d'exagérer l'enjeu actuel du combat autour des fonctionnaires fédéraux. Si Musk et Trump ont commencé par tenter de décimer les services fédéraux et les syndicats fédéraux, c'est parce qu'ils comprennent que ces obstacles entravent leur tentative d'exercer un contrôle autoritaire total sur le gouvernement et d'imposer leur programme réactionnaire au mépris de la loi. Et ils savent qu'ils doivent non seulement licencier les dirigeants de ces agences, mais aussi disposer d'un personnel tellement terrifié par l'administration qu'il s'y conformera même en cas d'infraction à la loi.
Ils doivent donc s'attaquer à ces syndicats et les briser. Les enjeux sont donc considérables pour tous les progressistes, tous les travailleurs, tous ceux qui ont un intérêt pour la démocratie, car il s'agit de la première grande bataille de la nouvelle administration. S'ils parviennent à licencier massivement des fonctionnaires fédéraux malgré les protections légales qui leur garantissent un emploi, malgré le fait que des millions d'Américains dépendent de ces services – la Sécurité sociale, Medicaid, et les protections environnementales et de sécurité de base –, s'ils parviennent à détruire ces services dont tant de personnes dépendent, cela leur permettra d'exercer une pression encore plus forte sur le reste de la société. Pensez aux immigrants, aux personnes transgenres, etc. Les implications de cette bataille sont donc considérables. Heureusement, les fonctionnaires fédéraux commencent à résister, mais il faudra faire beaucoup plus pour contrer ces tentatives de licenciements.
*JJ :* J'ai grandi près de Washington. Mes deux parents travaillaient dans des agences fédérales. Tous mes emplois d'été se sont déroulés dans des agences fédérales, et quiconque a une expérience directe le sait, sans se faire aucune illusion sur la perfection. Mais nous comprenons qu'il existe des malentendus et des mythes répandus sur le gouvernement en général, et sur les fonctionnaires fédéraux en particulier. Trump dit : « Nous sommes pléthoriques, nous sommes négligents. Beaucoup de gens ne font pas leur travail. » Comment pouvons-nous contrer ce discours ?
https://usafacts.org/articles/how-many-people-work-for-the-federal-government/
*EB :* Oui, je pense que la réponse est simple : il faut souligner l'importance de ces services et souligner que, loin d'une bureaucratie massivement développée, les services fédéraux, comme la plupart des services publics, ont été en réalité sous-alimentés au cours des cinquante dernières années. Le pourcentage de la population active travaillant pour le gouvernement fédéral n'a cessé de diminuer au cours des quatre dernières décennies. Il ne s'agit donc pas d'une bureaucratie massivement développée. Au contraire, une grande partie des inefficacités et des problèmes du secteur sont dus à un manque de ressources et à l'incapacité de faire de ces programmes les programmes robustes qu'ils peuvent et devraient être, et qu'ils étaient souvent par le passé.
Il ne s'agit donc pas d'une bureaucratie massivement développée ou de l'inutilité de ces services. La réalité est que les Américains, d'une certaine manière, ne voient pas tous ces services. Ils les tiennent pour acquis. Ils sont en quelque sorte invisibles. Si, jusqu'à récemment, les avions ne s'écrasaient pas, c'est grâce à l'existence de régulateurs fédéraux et de contrôleurs aériens fédéraux bien formés. Et donc, lorsque l'on commence à détruire ces services, la situation devient soudainement plus visible. Que se passera-t-il si l'on cesse de réglementer les entreprises en matière de pollution, par exemple ? Les entreprises peuvent revenir en arrière et faire ce qu'elles faisaient il y a un siècle : déverser systématiquement des toxines dans les sols, dans l'eau, et toutes ces autres pratiques, qui sont inacceptables, que nous tenons presque éradiquées aujourd'hui. Si les entreprises ne sont pas soumises à un système de contrôle, qui les en empêchera ?
Je pense donc qu'il est essentiel de sensibiliser les gens pour contrer ces mensonges de l'administration Trump. Par exemple, la grande majorité des fonctionnaires fédéraux ne vivent pas à Washington. L'idée selon laquelle il ne s'agit que de riches bureaucrates est répandue : pourtant plus de 80 % des fonctionnaires fédéraux vivent dans tout le pays, en dehors de Washington. D'un point de vue financier, il ne s'agit pas de personnes gagnant des centaines de milliers de dollars, mais de salaires décents pour la classe ouvrière. L'essentiel est d'examiner les données.
Il est donc essentiel, je pense, de bien comprendre l'importance de ces services, mais aussi de reconnaître que l'idée que la souffrance des travailleurs ordinaires soit imputable aux fonctionnaires fédéraux est un mythe. La masse salariale des fonctionnaires fédéraux représente une infime partie du budget fédéral. Et si l'on compare le montant des sommes versées aux fonctionnaires fédéraux à la fortune d'Elon Musk, par exemple, la comparaison est irréaliste. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, possède une fortune nette de plus de 400 milliards de dollars. C'est presque le double de ce que gagnent chaque année les 2,3 millions de fonctionnaires fédéraux. On voit donc que les inégalités ne viennent pas des fonctionnaires fédéraux, mais des plus riches de notre pays et du monde.
*JJ :* Eh bien, un de nos leviers, c'est l'organisation des travailleurs pour lutter contre cela, au-delà de notre colère à la maison et de nos tiraillements devant la télévision. Nous pouvons travailler ensemble et nous avons des modèles historiques, des modèles contemporains et des exemples de la façon dont cela peut fonctionner et se dérouler.
Je voudrais vous demander de parler des grèves des enseignants de 2018, car je vois que vous en avez fait une sorte d'analogie, qu'il y a des leçons à tirer de l'expérience d'États comme la Virginie occidentale ( /West Virginia/ ) et l'Oklahoma, des États républicains qui, en 2018, ont connu une grève d'enseignants qui, contre toute attente, étaient populaires, connectés à la communauté et, dans une certaine mesure, ont réussi. Je me demande quelles leçons tactiques, selon vous, ont été tirées de cette situation. Qu'avons-nous appris de ces grèves ?
https://jacobin.com/2018/03/west-virginia-teachers-wildcat-strike-peia
*EB :* C'est une bonne question, et je pense qu'il est important de commencer par souligner que ces grèves illustrent bien pourquoi nous ne devons pas céder au désespoir. Il règne un sentiment général de pessimisme, comme quoi rien ne peut être fait parce que Trump est au pouvoir, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je ne pense pas qu'il soit exact de dire que rien ne peut être fait. Et l'exemple des grèves dans les États républicains est un excellent indicateur que même lorsque des personnes très conservatrices sont au pouvoir, au sein du gouvernement, les travailleurs ont la capacité d'utiliser leur influence sur le lieu de travail et dans la communauté pour gagner.
C'est ainsi qu'en 2018, des centaines de milliers d'enseignants de Virginie occidentale, d'Oklahoma, d'Arizona et d'ailleurs se sont mis en grève. Même si ces grèves étaient illégales, même s'il s'agissait d'États où les syndicats étaient très faibles, des États favorables au droit au travail, et même si les électeurs de tous ces États avaient voté pour Donald Trump, ils ont néanmoins reçu un soutien massif de la population parce qu'ils avaient des revendications très simples et résonnantes, comme plus de financement pour les écoles, un salaire décent pour les enseignants, s'assurer qu'il y ait suffisamment d'argent pour que les étudiants puissent recevoir une éducation décente.
Ces actions transcendaient les clivages partisans, tout comme, je pense, la défense des services de base comme la Sécurité sociale et Medicaid aujourd'hui. Leurs tactiques consistaient à surmonter la peur, car il s'agissait de grèves illégales. Il leur fallait donc trouver des moyens de mobiliser les enseignants. Ils ont mené des actions très simples, comme demander aux gens de porter du rouge un jour donné. Ils n'ont donc pas commencé par dire : « Faisons grève. » Ils ont plutôt demandé : « Pourriez-vous faire cette action simple ensemble ? Pouvons-nous tous porter la même couleur un jour donné ? » Puis ils ont invité la communauté à se rassembler. Ils ont dit : « Mesdames et Messieurs, pouvez-vous nous retrouver après l'école ce jour-là ? Nous allons discuter de nos problèmes ensemble. Nous allons brandir des pancartes. Nous allons fournir des informations. »
Ils ont donc progressé par des actions militantes jusqu'à une grève de masse. Ils ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux, car ils ne pouvaient pas compter exclusivement sur les syndicats. Les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial pour connecter les travailleurs de ces États et créer une dynamique. Ils ont finalement pu organiser des débrayages extrêmement réussis qui, malgré leur illégalité, n'ont donné lieu à aucune représailles. Ils ont gagné et ont forcé le gouvernement à reculer et à accéder à leurs revendications. Je pense donc que c'est plus ou moins la stratégie pour gagner contre Musk et Trump. Il faut susciter une réaction violente de la part des travailleurs, mais aussi, en collaboration avec la communauté, pour que les responsables politiques soient contraints de reculer.
*JJ :* Eh bien, concernant l'organisation entre travailleurs, il semble que c'est ce dont vous parlez ici… Je pense que beaucoup d'entre nous qui ont travaillé avec des syndicats ou qui en ont la mémoire la perçoivent comme une démarche descendante. L'organisation entre travailleurs n'est donc pas seulement une lueur d'espoir, un élément à observer, mais une voie à suivre, un modèle reproductible. Vous dirigez un projet appelé « Worker to Worker Collaborative » [3]. Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que c'est cette organisation entre travailleurs, ou en quoi elle diffère d'un modèle que certains pourraient avoir en tête ?
*EB :* Oui. Le problème fondamental d'un syndicalisme plus traditionnel, qui mobilise beaucoup de personnel, c'est qu'il est tout simplement trop coûteux. Il est trop coûteux, tant en termes d'argent que de temps, de remporter de grandes victoires, de syndiquer des millions de travailleurs. Et qu'il s'agisse de luttes offensives comme la syndicalisation chez Starbucks ou Amazon, ou de luttes défensives actuelles, comme la défense des fonctionnaires fédéraux, si l'on veut syndiquer suffisamment de travailleurs pour riposter, les effectifs sont tout simplement insuffisants. Le problème avec la méthode traditionnelle, c'est qu'on ne peut pas gagner assez largement. On ne peut pas gagner assez fort.
L'organisation entre travailleurs est essentiellement une forme d'organisation où les rôles normalement assumés par le personnel sont assumés par les travailleurs eux-mêmes. Ainsi, l'élaboration de stratégies, la formation et l'encadrement d'autres travailleurs, le lancement de campagnes – autant de tâches qui deviennent ensuite la tâche et la responsabilité des travailleurs eux-mêmes, avec un encadrement et un soutien, et souvent en collaboration avec des syndicats plus importants. Mais les travailleurs assument simplement un plus grand degré de responsabilité, et cela a fait ses preuves. Les plus grands succès du mouvement syndical ces dernières années, des grèves des enseignants, dont nous avons parlé, à Starbucks, qui a désormais syndiqué plus de 560 restaurants, ont forcé l'une des plus grandes entreprises du monde à négocier. Nous avons constaté que cela fonctionne.
Il s'agit maintenant pour le reste du mouvement syndical d'investir réellement dans ce type d'organisation ascendante. Et franchement, il n'y a pas d'alternative. L'idée, partagée par tant de dirigeants syndicaux, selon laquelle nous allons simplement élire des démocrates et qu'ils renverseront la situation… eh bien, les démocrates sont en quelque sorte absents, et qui sait quand ils reviendront au pouvoir. Il incombe donc au mouvement syndical de cesser de regarder d'en haut et de commencer à regarder vers ses propres bases et de se dire : « Bon, si nous voulons nous sauver, c'est la seule voie possible. Personne ne viendra nous sauver d'en haut. »
*JJ :* Et il semble que cela se développe aussi avec une compréhension plus organique, si je puis dire, des enjeux, car ce sont les travailleurs eux-mêmes qui formulent ce message, plutôt que les dirigeants qui disent : « Nous pensons que c'est ce qui va être compris, ou ce que nous pouvons faire passer. » Cela semble plus susceptible de refléter les véritables préoccupations des travailleurs.
https://inthesetimes.com/article/whole-foods-union-philadelphia
*EB :* Oui, c'est vrai. Les travailleurs sont les mieux placés pour comprendre les problèmes des autres. Ils sont aussi les mieux placés pour convaincre les autres de se joindre à eux. Lors d'une campagne ou d'une lutte syndicale, les patrons répètent systématiquement : « Le syndicat est une tierce partie extérieure. » Et il y a parfois une part de vérité. Sans vouloir exagérer, il peut y avoir un aspect du mouvement syndical qui semble un peu déconnecté de la propriété directe et de l'expérience des travailleurs. Mais lorsque les travailleurs eux-mêmes s'organisent, souvent en collaboration avec les syndicats, mais s'ils sont réellement à l'avant-garde, il devient beaucoup plus difficile pour les patrons de se substituer au syndicat, car il est clair que le syndicat, ce sont les travailleurs.
*JJ :* D'accord. Quelle importance cela a-t-il pour ce type d'organisation ascendante, quelle que soit la situation au NLRB [Conseil national des relations de travail] ? Quel rôle ? Je ne sais même pas vraiment ce qui se passe, c'est en constante évolution, comme tout le reste. Mais vous pensez que peut-être, non pas qu'il ne faut pas s'en inquiéter, ni qu'il ne faut pas y penser, mais plutôt qu'il ne faut pas trop s'inquiéter des manigances du NLRB, n'est-ce pas ?
*EB :* Eh bien, je pense que le NLRB de Biden était très efficace et qu'il a aidé les travailleurs à se syndiquer. La disparition du NLRB est donc un coup dur pour le mouvement syndical. Il faut le reconnaître. Cela dit, il est toujours possible de se syndiquer. On n'a pas besoin du NLRB pour se syndiquer. Le mouvement syndical s'est développé et s'est battu pendant de nombreuses années avant l'adoption de la loi sur le travail. Et même aujourd'hui, la situation est très ambiguë. Le NLRB est en quelque sorte paralysé au niveau national, mais au niveau local, on peut encore organiser des élections. Il n'est donc même pas complètement obsolète. Et je pense qu'il est probablement encore possible de l'utiliser dans une certaine mesure.
Mais la réalité est que le terrain juridique est plus difficile qu'avant. D'un autre côté, l'urgence est encore plus grande, et on voit encore des travailleurs se mobiliser et s'organiser en nombre record. J'ai été très encouragé par le fait que, malgré un régime juridique plus strict, nous avons remporté d'importantes victoires syndicales ces dernières semaines sous Trump. Par exemple, à Philadelphie, les travailleurs de Whole Foods se sont syndiqués malgré Trump, malgré une intense campagne antisyndicale lancée directement par Jeff Bezos. C'était seulement la deuxième fois qu'Amazon – car Amazon est désormais propriétaire de Whole Foods – perdait une élection syndicale, et c'était il y a quelques semaines à Philadelphie.
Cela montre donc qu'il y a une réelle colère à la base. Et je pense qu'il y a quelque chose, en fait, dans l'administration Trump, qui, du fait de son lien étroit avec certaines des personnes les plus riches de la planète, de manière oligarchique, fait de la syndicalisation elle-même un moyen presque direct de contester le régime Trump. Parce que vous vous opposez à la fois à leur destruction des droits du travail et, franchement, ce sont les mêmes personnes qui sont au sommet. Les patrons et l'administration sont quasiment indissociables à ce stade.
*JJ :* J'ai l'impression que des entreprises comme Amazon et Whole Foods se sont présentées comme l'avenir du monde des affaires, l'avenir des façons de faire. Je pense donc que les actions syndicales, tout d'abord, reconnaissant que ce sont toujours des travailleurs qui agissent et que cela ne se passe pas dans un laboratoire, semblent être des lieux particulièrement importants sur lesquels il faut attirer l'attention en termes d'activité syndicale.
*EB :* Oui. Et je pense que le talon d'Achille de Trump et de tout son mouvement, c'est qu'il se prétend populiste et séduit la classe ouvrière, mais qu'en réalité, il est au service des plus riches de la planète. Le meilleur moyen de dénoncer cela est donc de mener des batailles pour la dignité économique, n'est-ce pas ? Et le mouvement ouvrier est la force numéro un pour cela et forcer les politiciens à montrer de quel côté ils se trouvent. Êtes-vous du côté de Jeff Bezos ou des travailleurs à bas salaires qui ripostent ? Mener de plus en plus de telles batailles, même si c'est plus difficile en raison du cadre juridique, sera, je pense, l'un des moyens les plus cruciaux de saper le soutien au MAGA parmi les travailleurs de tous horizons.
*JJ :* Eh bien, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres pour aller de l'avant. Enfin, à moins de vivre dans un trou noir et d'apprécier réellement ce qui se passe, il est clair que le statu quo ne suffira pas. Quel que soit votre parcours, nous devons entreprendre quelque chose de plus grand, de plus audacieux. Mais nous savons que certaines personnes, pour le dire crûment, craignent plus les perturbations que de la souffrance. Les perturbations semblent très effrayantes, mais faire les choses comme elles ne l'étaient pas hier, même si nous avons une histoire à laquelle nous pouvons nous référer, c'est cela qui est effrayant.
Et je pense que c'est ce qui rend les histoires que nous nous racontons les uns aux autres et celles que nous nous racontons si importantes, la cohérence de la vision d'avenir que nous sommes capables de diffuser est cruciale. Et bien sûr, cela me ramène aux médias. Vous avez mentionné l'importance des réseaux sociaux, des médias indépendants, simplement des histoires que nous racontons, des histoires que nous soutenons, des personnes que nous soutenons. Cela semble si important pour ce combat. Ce n'est pas un méta-phénomène. Alors je me demande enfin quel rôle vous envisagez pour les différents types de médias à l'avenir ?
https://www.federalunionists.net
EB : D'accord. Je pense que c'est absolument crucial. Si la droite a fait de telles percées, c'est notamment parce qu'elle a su mieux faire connaître son point de vue et mener des batailles d'idées dans les médias, les réseaux sociaux et les médias grand public. Et franchement, notre camp est à la traîne. C'est peut-être parce que nous ne disposons pas des mêmes ressources, mais je pense aussi qu'on sous-estime l'importance d'expliquer ce qui se passe dans le monde, de nommer les véritables ennemis et d'expliquer la véritable colère et l'anxiété des gens face à ce qui se passe. Donc oui, je pense que c'est absolument crucial. Et je pense que nous devons, en tant que mouvement syndical, progressistes et de gauche, réagir et proposer une explication alternative : tous ces problèmes trouvent leur origine dans le pouvoir des milliardaires. Ce n'est pas à cause des immigrés, des fonctionnaires fédéraux ou des jeunes transgenres.
Je dirais simplement que l'une des choses qui me donnent de l'espoir, c'est que les réseaux sociaux sont désormais utilisés de manière assez efficace par ce nouveau mouvement des fonctionnaires fédéraux. Je vous en donne un exemple : ils ont un nouveau site web, <http://savepublicservices.com/> >, sur lequel chacun peut s'inscrire pour participer aux actions locales. Ce sera un réseau d'intervention rapide pour mettre fin aux licenciements locaux, où que vous soyez, et pour préserver les services dont nous dépendons. Chacun peut donc se rendre sur ce site web, <http://savepublicservices.com/> >, et profiter de cette opportunité médiatique pour s'impliquer localement.
*JJ :* Très bien, nous allons terminer sur cette note. Nous avons discuté avec Eric Blanc. Son nouveau livre, « We Are the Union : How Worker-to-Worker Organizing Is Revitalizing Labor and Winning Big » [2], est maintenant disponible chez UC Press, et vous pouvez suivre son travail sur laborpolitics.com [4]. Merci beaucoup, Eric Blanc, de nous avoir rejoint cette semaine sur CounterSpin.
*EB :* Merci de m'avoir invité.
[1] https://www.versobooks.com/en-ca/products/912-red-state-revolt
[2] https://www.ucpress.edu/books/we-are-the-union/paper
[3] https://smlr.rutgers.edu/faculty-research-engagement/workplace-justice-labru/build-base-grow-movement/w2w#:~:text=What%20is%20W2W%3F,their%20members'%20involvement%20and%20leadership
[4] https://www.laborpolitics.com
*
*
*Une suggestion de lecture de André Cloutier, Montréal, 14 mars 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
*

L’OIT publie le rapport 2025 de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations

Le rapport indique dans quelle mesure les États Membres de l'OIT ont rempli leurs obligations en matière de normes internationales du travail.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/10/loit-publie-le-rapport-2025-de-la-commission-dexperts-pour-lapplication-des-conventions-et-recommandations/?jetpack_skip_subscription_popup
GENÈVE (OIT Infos) – Le 10 février 2025, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR), qui est une pierre angulaire du système de contrôle des normes internationales du travail de l'OIT, a publié son rapport annuel.
Ce rapport fournit une analyse indépendante de la mesure dans laquelle la législation et la pratique de chaque État membre de l'OIT donnent effet aux conventions et protocoles de l'OIT ratifiées par l'État Membre en question. Il décrit la manière dont les États membres s'acquittent des obligations qu'ils ont librement contractées en vertu de la Constitution de l'OIT en ce qui concerne les normes internationales du travail. Il fournit également un bref compte rendu de son échange interactif avec les présidents des organes des Nations Unies chargés de surveiller l'application des traités internationaux relatifs aux droits humains et des titulaires de mandats au titre de procédures spéciales, à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la Déclaration de Philadelphie de l'OIT et du 60e anniversaire de la convention (n°122) sur la politique de l'emploi, 1964, et de la recommandation n°122.
Les normes internationales du travail, qui se composent de conventions, de protocoles aux conventions et de recommandations, sont des instruments universels de droit international adoptés par des gouvernements, des employeurs et des travailleurs représentés à la Conférence internationale du Travail pour faire progresser la justice sociale. Elles reflètent des valeurs et des principes communs régissant le monde du travail. Une fois qu'un pays a ratifié une convention ou un protocole de l'OIT, il est tenu de faire régulièrement rapport sur les mesures qu'il a prises pour la mettre en œuvre.
Si les États membres de l'OIT peuvent choisir de ratifier ou non une convention ou un protocole de l'OIT, le système de contrôle de l'OIT examine aussi régulièrement l'effet donné aux recommandations et aux conventions lorsqu'elles n'ont pas été ratifiées. Fin février 2025, la commission d'experts publiera cette étude d'ensemble intitulée Atteindre une protection complète contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La CEACR est un organe indépendant composé de 20 experts juridiques nationaux et internationaux de haut niveau, chargés d'examiner l'application des conventions, protocoles et recommandations de l'OIT par les États membres de l'OIT. En 2024, la commission a maintenu la parité hommes-femmes.
Les membres de la CEACR, nommés à titre personnel, sont indépendants et impartiaux. Ils sont sélectionnés dans toutes les régions du monde, de sorte que la CEACR dispose d'une expérience de première main des différents systèmes juridiques, économiques et sociaux.
Le rapport sera soumis à la 113e session de la Conférence internationale du travail, où les gouvernements, les employeurs et les travailleurs en discuteront au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence.
ILO releases 2025 report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations
https://www.ilo.org/resource/news/ilo-releases-2025-report-committee-experts-application-conventions-and
La OIT publica el informe 2025 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
https://www.ilo.org/es/resource/news/la-oit-publica-el-informe-2025-de-la-comision-de-expertos-en-aplicacion-de
L'OIL pubblica il rapporto 2025 della Commissione di esperti per l'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni
https://www.ilo.org/it/resource/news/loil-pubblica-il-rapporto-2025-della-commissione-di-esperti-lapplicazione
******

Nouvelle publication de l'OIT : Un chemin vers la justice sociale pour les travailleurs migrants
Un ouvrage qui explore les réalités de la migration temporaire de main-d'œuvre et fournit des perspectives précieuses aux décideurs politiques, praticiens et chercheurs.
GENÈVE (OIT Infos) – Une nouvelle anthologie publiée par l'Organisation internationale du Travail (OIT), Temporary Labour Migration : Towards Social Justice ?(Migration temporaire de la main-d'œuvre : vers la justice sociale ?), explore les défis, les choix politiques et les approches novatrices qui façonnent la migration temporaire de main-d'œuvre à l'échelle mondiale.
Cet ouvrage collectif réunit des contributions de chercheurs et de praticiens de renom afin d'examiner l'évolution des programmes de migration temporaire de main-d'œuvre et leur impact sur les marchés du travail locaux ainsi que sur les travailleurs migrants.
Dans de nombreux contextes, ces programmes exposent les travailleurs à des déficits en matière de travail décent, à des droits restreints et à l'exclusion des législations du travail. Toutefois, des évolutions positives ont également été observées, notamment des améliorations permettant aux travailleurs de changer d'employeur plus facilement, ainsi que d'autres innovations politiques dignes d'intérêt.
En présentant des perspectives issues de différentes régions du monde, disciplines et périodes historiques, cet ouvrage propose des recommandations politiques concrètes pour des politiques migratoires plus justes.
Le livre est structuré autour de quatre grands thèmes :
* L'évolution des paradigmes relatifs à la migration temporaire de main-d'œuvre ;
* L'analyse des nouveaux programmes de mobilité et des facteurs influençant la gouvernance migratoire (comme le commerce international) ;
* Les outils politiques pour la protection des migrants ;
* Les leçons historiques permettant d'améliorer les politiques migratoires.
Cette publication aborde les dimensions économiques et juridiques de la migration temporaire de main-d'œuvre afin d'en offrir une analyse approfondie. Elle met en avant la nécessité d'une justice sociale dans les politiques migratoires, en appelant à un traitement équitable, au renforcement des mécanismes de protection et à une meilleure cohérence des politiques pour rendre la migration temporaire plus juste.
L'ouvrage, édité par Christiane Kuptsch et Fabiola Mieres, spécialistes de la migration et du marché du travail à l'OIT, est disponible en téléchargement sur le site web de l'OIT.
Pour plus d'informations, veuillez visiter ilo.org ou contacter
kuptsch@ilo.org ou mieres@ilo.org.
New ILO publication explores the path to social justice for migrant workers
https://www.ilo.org/resource/news/new-ilo-publication-explores-path-social-justice-migrant-workers
Una nueva publicación de la OIT explora el camino hacia la justicia social para los trabajadores migrantes
https://www.ilo.org/es/resource/news/una-nueva-publicacion-de-la-oit-explora-el-camino-hacia-la-justicia-social
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Woke : Une perspective de classe

Ces dernières années, l'extrême droite a réussi à imposer des cadres conceptuels qui ont été acceptés même par des sections de la gauche, affaiblissant ainsi ses propres positions politiques. L'utilisation péjorative du terme « woke », à l'origine associé à la conscience sociale et à la lutte pour la justice, en est un exemple clair. L'extrême droite a développé une stratégie délibérée pour délégitimer les luttes pour la justice sociale et les droits humains.
https://vientosur.info/woke-una-perspectiva-de-clase/
« Woke », qui dans sa racine signifiait et signifie toujours être éveillé et vigilant face aux discriminations raciales et aux inégalités systémiques. L'ultra-droite a tenté et a en partie réussi à vider ce mot de son contenu émancipateur et à en faire une caricature. Elle parle de guerre culturelle et concentre tous ses efforts pour opposer la lutte contre les oppressions, telles que le système patriarcal, le racisme, les droits des personnes LGBTQI, à la lutte contre l'exploitation. Leur principal objectif est de diviser la classe ouvrière entre les hommes blancs hétérosexuels et les femmes, les femmes et les femmes transgenres, les écologistes et les agriculteurs, les Noir-es et les migrant-es, les Latinos et les femmes, etc.
Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, est peut-être l'exemple le plus clair d'un champion de la guerre culturelle. Vance, issu d'une famille de base, syndicaliste et démocrate de l'est désindustrialisé des États-Unis, qu'il a magistralement dépeint politiquement dans son livre et son biopic (A Hillbilly Odyssey), a été utilisé par Trump pour gagner des voix dans les régions industrielles appauvries des États-Unis, à travers un discours contre « l'élite démocrate libérale » hypocritement soucieuse d'être politiquement correcte sur des questions telles que le racisme, le changement climatique, le sexisme et la LGBTQIphobie, entre autres. En effet, les élites du parti démocrate ont maintenu une politique impérialiste, raciste à bien des égards, totalement incohérente en matière de réduction des émissions polluantes et surtout, engagée dans la mondialisation néolibérale qui a appauvri de nombreuses sections de la classe ouvrière aux États-Unis et dans le reste du monde. Les partis politiques sociaux-libéraux du monde entier ont répété des phénomènes parallèles. Mais à gauche, au lieu d'adhérer au cadre mental de l'extrême droite, nous devrions être capables de générer une critique et une stratégie pour surmonter le social-libéralisme sans avaler les idées réactionnaires qui circulent partout et qui sont en train de devenir un nouveau sens commun, qui n'est rien d'autre qu'un mélange de la sagesse acceptée au fil des ans, de l'opinion répandue du moment et d'un mélange d'idées contradictoires. Elle peut trouver son origine dans la réalité et/ou dans l'invention que nous appelons aujourd'hui « fake news ».
Les partis sociaux-démocrates classiques, qui ont embrassé la mondialisation et n'ont pas su inverser l'accumulation des richesses par les plus riches, ont ouvert la voie à l'extrême droite. Leur incapacité à enrayer la perte de pouvoir d'achat, à améliorer les services publics ou à freiner la spéculation immobilière est flagrante. En effet, rares sont les gouvernements sociaux-démocrates qui ont cédé à l'agenda des classes dominantes, aux coupes budgétaires, aux politiques néolibérales comme les accords de libre-échange qui ont fini par détruire des secteurs entiers de l'économie dans certaines régions industrielles dont l'activité principale a été transférée dans d'autres pays. En ce sens, les principales organisations de la classe ouvrière, les syndicats, ont été incapables de proposer une stratégie locale ou globale pour stopper la mondialisation néolibérale.
Dans le même temps, les magnifiques mouvements qui luttent pour les droits des personnes LGBTQI, ou le mouvement féministe, ont réalisé de grandes avancées qui ont dû être acceptées par les partis au pouvoir. C'est là qu'apparaît l'élément central de ce que l'ultra-droite appelle la guerre culturelle, un terme utilisé pour éloigner le débat de la lutte des classes et pour pouvoir confronter différents secteurs des travailleurs. L'extrême droite s'en prend à l'incapacité des gouvernements sociaux-démocrates à réduire les inégalités sociales, non pas parce qu'ils se sont pliés aux intérêts des riches, ce qui est le cas depuis des décennies, mais parce qu'il y a trop de féminisme, trop d'immigré-es, trop de droits LGBTQI. Rédigé ainsi, cela semble absurde, mais c'est la base de l'argument. L'extrême droite, aux États-Unis et dans une partie croissante des régions du monde, a réussi à associer le mécontentement social à l'acceptation d'idées socialement conservatrices.
Trump est un milliardaire américain qui s'est fait connaître grâce à une émission de télévision dans laquelle il renvoyait des gens. Ses principaux soutiens sont certains des hommes les plus riches du monde, comme Elon Musk et Jeff Bezos ou la Heritage Foundation. Toutefois, le pouvoir d'achat moyen des électeurs de Trump est inférieur à celui des électeurs du Parti démocrate.
Les références de Trump à un passé où de nombreux secteurs de la classe ouvrière américaine vivaient mieux lui ont permis de se rapprocher d'eux. Rien de nouveau sous le soleil : la montée des nazis en Allemagne était largement due au discrédit de la social-démocratie allemande, dont le gouvernement a écrasé la révolution dans les années 1920. Les similitudes du tandem Trump-Musk avec le fascisme des années 1920 et 1930 sont multiples ; Mussolini était également associé à un gourou technologique de son époque, Guglielmo Marconi, auquel on a longtemps attribué l'invention de la radio, même si cela n'est pas tout à fait clair aujourd'hui.
Il ne s'agit pas du tout de dire que Trump essaie de gouverner pour la classe ouvrière, mais bien au contraire. Son cabinet est rempli de millionnaires qui ont l'intention de détruire ce qui reste des services publics aux États-Unis, d'attaquer les syndicats, tout cela pour augmenter les profits de leur classe. Ils savent que c'est un plan dangereux car une offensive comme celle qu'ils préparent peut rencontrer et rencontrera une résistance, c'est pourquoi ils montent certaines sections de la classe ouvrière contre d'autres. Nous ne pouvons pas oublier que l'ultra-droite est le bélier de la classe dirigeante lorsque celle-ci ne peut plus gouverner comme avant et que le parti républicain et ceux qui le financent savaient qu'ils ne pourraient pas gagner avec le programme classique de la droite, mais qu'ils devaient se jeter dans les mains de l'ultra-droite pour reconquérir la Maison Blanche. En effet, la fondation Heritage, néoconservatrice et d'extrême droite, a élaboré un programme intitulé Project 2025 qui, entre autres mesures, prévoit de dissoudre les départements du commerce et de l'éducation, de rejeter l'idée de l'avortement en tant que soin de santé et d'affecter les protections climatiques. Cela représente un danger pour l'architecture économique et industrielle des États-Unis, qui dépend d'une chaîne d'approvisionnement mondiale qui pourrait être fortement affectée par les droits de douane. Par exemple, le pétrole canadien est essentiel à l'industrie du raffinage au Texas. L'administration Trump le sait et exerce une pression militaire et économique sur différents États pour tenter de minimiser ces risques, ce qui pourrait conduire à davantage de militarisme.
Lorsque la gauche adhère à l'état d'esprit de la droite au nom d'une soi-disant lutte des classes, elle oublie une chose fondamentale. La classe ouvrière est diverse et plurielle, la moitié sont des femmes, il y a des personnes LGBTQI, des migrant-es et une myriade de combinaisons de conditions différentes. Trump et l'extrême droite tentent de dépeindre la classe ouvrière comme des Blancs appauvris afin de les opposer à d'autres sections de la classe ouvrière. En tant qu'homme de droite, c'est compréhensible. Ce qui est ridicule, c'est que les gens de gauche soient si peu perspicaces. Quelqu'un peut-il vraiment penser que nous pouvons affronter la vague néo-droitière sans les femmes ou les membres racialisés de la classe ouvrière ? C'est la voie du fascisme rouge ou communofascisme qui, tout au long de l'histoire, n'a fait que mener les classes populaires au fascisme. En Allemagne, une scission de Die Linke, l'Alliance Sahra Wagenknecht, qui porte le nom de sa dirigeante, a décidé de suivre cette voie. Le fascisme social repose sur deux idées fondamentales : être de gauche sur le plan économique et de droite sur le plan social. Comme si le patriarcat, le racisme et les autres systèmes d'oppression qui se développent sous le capitalisme n'étaient pas liés aux relations d'exploitation dans lesquelles nous vivons. Que quelqu'un de la gauche postmoderne dise cela serait critiquable, bien que compréhensible, mais que certains communistes autoproclamés dissocient le système d'oppression qui se développe au sein du capitalisme des relations de production qui y sont établies est ce qui se rapproche le plus de l'antimarxisme. Que veulent ceux qui, à partir de postulats prétendument de gauche, utilisent le mot woke pour se plaindre du féminisme, de l'immigration, des politiques LGBTQI ? Un parti communiste de révolutionnaires mâles blancs ? Il est certain qu'il existe des divergences entre les différentes sections de la gauche. Certaines d'entre elles ont rompu avec une perspective de classe à la fin des années 1960 et au début des années 1970, notamment en raison de l'orientation d'une grande partie du marxisme dominant, dominé par la vision stalinienne, qui était assez conservatrice dans certains aspects sociaux et qui considérait les mouvements qui se développaient contre les systèmes d'oppression à l'intérieur du capitalisme comme des luttes de seconde classe. C'est aussi parce que la classe ouvrière, bien qu'elle existe et occupe un rôle central dans la production et la reproduction du capital, n'apparaît pas, la plupart du temps, comme une force révolutionnaire. En effet, des idées contradictoires coexistent en son sein, des préjugés de toutes sortes existent, mais cela ne change rien au fait que tout ce qu'une personne utilise chaque jour de sa vie (à l'exception de l'air que nous respirons) provient de la transformation des ressources naturelles en produits par les travailleurs et les travailleuses. Peu importe l'argent dont dispose Elon Musk, sans les personnes qui produisent les Tesla ou entretiennent les X, ces entreprises ne fonctionneraient pas. Les capitalistes monopolisent pratiquement la propriété des moyens de production, mais sans la force de travail des travailleurs et des travailleuses, ils ne peuvent ni produire ni reproduire le capital. Le philosophe hongrois György Lukacs avait déjà analysé la contradiction entre l'existence de la classe ouvrière et l'absence de conscience collective de la classe ouvrière dans son ouvrage Histoire et conscience de classe - Études de dialectique marxiste (1923). Cette contradiction, associée à la dégénérescence des partis communistes sous le stalinisme, a conduit de nombreux mouvements apparus dans les années 1960 et 1970 à abandonner la perspective de classe et à se concentrer sur l'identité, ainsi qu'à renoncer à un horizon de révolution sociale, puisque la disparition de la classe ouvrière en tant que sujet révolutionnaire signifiait qu'il n'y avait plus de moyen de rassembler la diversité existant au sein de la société dans une action commune d'émancipation.
Certes, la classe ouvrière est comme l'air, elle existe, sans elle nous ne pourrions pas respirer, mais nous ne la voyons pas et ce n'est qu'en de rares occasions et dans des circonstances très spécifiques qu'elle se transforme en un coup de vent capable de tout renverser, de même que la plupart du temps les travailleurs et travailleuses restent fragmentés, avec une conscience collective relativement faible et ce n'est qu'à certains moments historiques qu'ils et elles ont été capables de renverser le régime d'injustice généralisée dans lequel nous vivons et qui s'appelle le capitalisme. Cependant, les élites n'oublient pas l'histoire, elles savent ce qui s'est passé en Russie en 1917, la révolution de 1936 dans de nombreuses régions d'Espagne, elles savent que c'est l'énergie colossale de la classe ouvrière consciente et en marche qui les a portées en avant. C'est pourquoi elles concentrent leur guerre culturelle sur la fragmentation et le dressage des travailleurs et des travailleuses les un-es contre les autres et c'est pourquoi c'est une très mauvaise idée d'entrer dans leur jeu.
Il est nécessaire de souligner que, pour retrouver une certaine perspective de classe, des millions de travailleurs et travailleuses doivent être considéré-es comme souffrant de racisme, de sexisme, de LGBTQIphobie et d'islamophobie. Accepter le discours de l'extrême droite, c'est céder sur le terrain de la politique. La gauche doit pouvoir faire son autocritique sans trahir ses principes fondamentaux. Il est possible de débattre des stratégies et des tactiques sans nier la nécessité de transformer des structures telles que le patriarcat, le racisme, l'islamophobie, la LGBTQIphobie (...). En fait, Trump et ses épigones mondiaux -Bolsonaro, Abascal, Meloni, Orbán-, lorsqu'ils s'adressent aux travailleurs, tentent de les réduire aux secteurs blancs des anciennes ceintures industrielles afin de les confronter au reste de la classe, qu'ils tentent de masquer avec le terme « woke ».
L'obsession de l'extrême droite pour l'immigration est un autre point clé dans sa tentative de fragmenter et d'affronter la classe, au même titre que l'antiféminisme. Avant de poursuivre, je pense qu'il est nécessaire de souligner que ce n'est pas contre toutes les personnes migrantes, mais contre celles qui sont racialisées et issues de la classe ouvrière. La majorité des migrant-es sont des travailleurs et travailleuses et, lorsqu'ils et elles arrivent dans leur pays de destination, ils et elles ont tendance à faire partie des secteurs les plus pauvres. Or ce n'est pas la migration qui génère la pauvreté, mais les taux élevés d'exploitation qu'ils et elles subissent, sous la forme de bas salaires, d'absence de droits et de lois racistes, telles que la loi sur les étrangers. Ce n'est pas un hasard si, dans les provinces espagnoles les plus dépendantes de l'exploitation des travailleurs et travailleuses racisé-es comme Almeria, Murcia ou Huelva, VOX obtient les pourcentages de voix les plus élevés. Le modèle productif dépendant d'une main-d'œuvre sans droits a besoin de justifier idéologiquement son existence. En fait, le travail des migrant-es (comme celui de tout autre travailleur), par exemple, le secteur de la viande en Catalogne a exporté à lui seul 5348 millions d'euros en 2023. Dans ce secteur, la majorité des travailleurs et travailleuses sont des migrant-es, mais la redistribution des richesses est très faible. Ceux qui thésaurisent l'argent sont les hommes d'affaires, c'est-à-dire que ce sont ces grandes entreprises agro-exportatrices qui génèrent de la pauvreté parmi leurs employé-es, sans parler des impacts environnementaux de l'agro-industrie. Il n'est pas surprenant que le parti d'extrême droite Aliança Catalana, comme la Plate-forme pour la Catalogne avant lui, bénéficie d'un soutien particulier dans les régions où les personnes racisées sont exploitées de manière particulièrement intense. Une fois de plus, l'ultra-droite parvient à relier un besoin de la classe dirigeante, à savoir le maintien de la précarité pour garantir les profits, à une idée politique selon laquelle l'immigration est un problème, afin d'émasculer son objectif.
Trump et « tutti quanti » se présentent comme anti-establishment alors qu'en réalité ils cherchent à préserver le statu quo sous couvert d'un faux bon sens. Elon Musk, Jeff Bezos, les milliardaires de la Heritage Foundation, etc. luttent pour l'absence de syndicats dans leurs entreprises avec un seul objectif : éviter à tout prix le partage de la plus-value avec les travailleurs et les travailleuses.
Trump a utilisé le machisme pour gagner des élections, il a promu le mythe de l'homme hétérosexuel persécuté, mais la solution n'est pas de construire une gauche machiste (ils ne le disent pas, ils disent qu'il y a trop de féminisme), mais de développer une perspective révolutionnaire capable de promouvoir la lutte féministe dans une perspective de libération et de fin de l'oppression de classe. Si quelqu'un en doute, il suffit de lui rappeler que le 8 mars 1917 (23 février, selon le calendrier julien utilisé en Russie), les ouvrières du textile de Petrograd se sont soulevées dans une grande manifestation pour réclamer du pain et la paix. Ce mouvement s'est étendu, avec des grèves et d'autres mobilisations, de sorte que le tsar a été contraint d'abdiquer et que le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes. Nous avons vu ici que le féminisme a fait d'énormes progrès lorsqu'il a pu utiliser l'arme par excellence de la classe ouvrière : la grève. Deux grandes grèves féministes (2018 et 2019) qui ont fait reculer les idées machistes.
L'essentiel est de défendre une pensée critique qui ne soit ni complaisante ni réactionnaire. Il ne s'agit pas d'accepter sans critique toutes les positions qui émergent des secteurs de gauche, mais de les analyser avec un sens de la camaraderie et sans perdre de vue le contexte dans lequel elles sont développées. Dans un monde où l'extrême droite cherche à s'approprier le langage pour saper la possibilité de changement, il est plus important que jamais que la gauche défende son propre cadre interprétatif et ne cède pas à la manipulation discursive de ceux qui s'opposent à la justice et à l'égalité.
La lutte de la classe ouvrière ne peut être réduite à la lutte économique de la classe ouvrière, mais elle ne peut pas non plus être oubliée. Lutter contre l'exploitation de classe sans considérer les luttes LGBTQI, féministes, antiracistes, autodéterministes, environnementalistes comme faisant partie de la lutte de la classe ouvrière pour vivre dans un monde plus juste dénote un manque de compréhension de la façon dont la conscience collective peut passer de la fragmentation à l'avancement. Les exemples sont nombreux, nous avons déjà mentionné les grèves féministes, nous ne pouvons pas non plus oublier la grève du 3 octobre 2017 où le mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de la Catalogne a pu accumuler la plus grande puissance à travers une grève générale qui a conduit au blocage du pays par des millions de personnes, de la classe ouvrière dans leur grande majorité. En ce sens, le mouvement pour le droit au logement fait progresser sa perspective de classe. Historiquement, ce mouvement a été une lutte des classes populaires en général et de la classe ouvrière en particulier contre l'accumulation et le pillage des rentiers. Aujourd'hui, des grèves des loyers ont déjà lieu à Sentmenat, Banyoles, Vilanova i la Geltrú et Sitges, mais la nécessité d'une grève générale du logement est dans l'air. En d'autres termes, utiliser le pouvoir de la classe organisée pour arrêter la production et la reproduction du capital afin de mettre un terme à la spéculation rentière.
Je donne pour la fin deux exemples de la façon dont la perspective de classe nous permet de rassembler ce que l'ultra-droite veut affronter. Deux exemples qui me semblent d'autant plus pertinents que, si le mouvement d'extrême droite actuel se caractérise par quelque chose, outre le machisme et le racisme, c'est par sa haine des personnes LGBTI et des personnes racisées (Musk est un immigré sud-africain et ils ne le détestent pas vraiment). Le premier exemple, c'est le festival « Pits and Perverts » en soutien à la lutte des mineurs contre les fermetures décrétées par Margaret Thatcher. Ce mouvement consistait en un festival de charité organisé en 1984 en soutien à la grève des mineurs britanniques. Organisé par le groupe Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM), il a permis de récolter des fonds pour les grévistes, symbolisant la solidarité entre la classe ouvrière et les mouvements LGTBQI+, et a été brillamment dépeint dans le film Pride. Le second exemple se déroule au printemps 2015, les travailleurs contractuels de Movistar se sont mis en grève et ont été soutenus par des personnes issues du mouvement révolutionnaire indépendantiste et de nombreux autres secteurs, mais l'un des faits les plus frappants est que les travailleurs, pour la plupart des hommes hétérosexuels, certains nés en Catalogne mais beaucoup originaires d'Équateur, du Pérou ou de Bolivie, ont été soutenus par le mouvement LGBTI à Barcelone et se sont rendus à la manifestation de soutien, où ils ont reçu d'énormes démonstrations de solidarité. En d'autres termes, une lutte économique d'hommes majoritairement hétérosexuels, certains racisés, d'autres non, est venue soutenir la manifestation des LGBTI et a été reçue comme ce qu'elle était, des compagnons de lutte. Ce jour-là, nous avons été férocement wokes, parce que nous nous levions et luttions contre les injustices du système.
En définitive, il ne s'agit pas d'avoir une perspective ouvrière centrée uniquement sur la tentative d'agir politiquement sur les lieux de travail, car la lutte des classes ne se réduit pas à la lutte économique, Il ne s'agit pas non plus de poser mécaniquement la nécessité de grèves générales pour avancer dans la conquête de droits non liés au travail, mais de comprendre que regrouper ce qui est dispersé et unir ce qui est différent signifie chercher à organiser le pouvoir qui nous permettra de renverser le système dans lequel nous vivons, exploités et opprimés, et cela implique inévitablement de se percevoir d'abord comme une classe, en surmontant la fragmentation à laquelle le système nous soumet. Comprendre l'autonomie des mouvements sociaux, mais en même temps faire progresser dans la conscience collective que c'est là où nous produisons et reproduisons le capital que nous pouvons être en mesure d'accumuler plus de pouvoir, et ce n'est pas le seul endroit, car nous avons de magnifiques exemples historiques de luttes populaires qui ont avancé dans leurs revendications, mais il est nécessaire de reconnaître que sans le pouvoir de la classe ouvrière, aucune révolution n'a jamais été faite.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
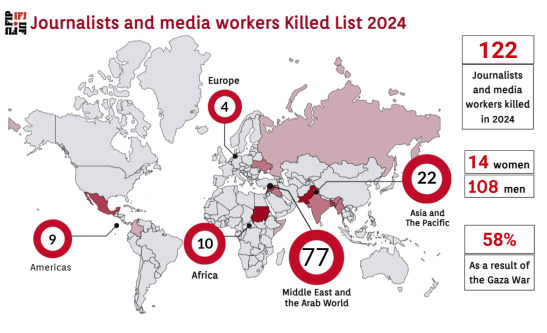
Rapport FIP 2024 : L’année la plus meurtrière pour les journalistes depuis trois décennies
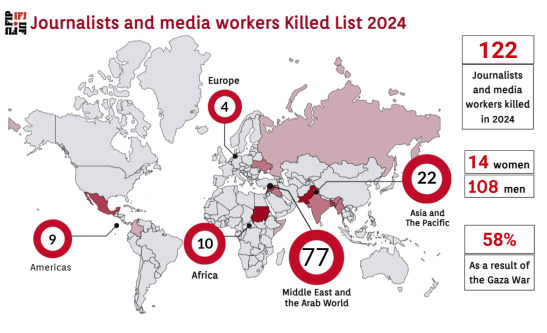
La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a publié son 34e rapport annuel sur les journalistes et les professionnels des médias tués en 2024, dont les chiffres sont choquants.
Tiré du Journal des alternatives. Photo : capture d'écran des pages 10 et 11 du rapport de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) voir lien à la fin de l'article
Au total, 122 journalistes ont été tués dans différentes parties du monde, dépassant le record de 113 morts enregistré en 2007, lorsque la guerre en Irak a ravagé la presse. Sur ce total, 14 étaient des femmes, ce qui souligne les risques supplémentaires encourus par les femmes reporters, en particulier dans les zones de conflit ou sous des régimes répressifs.
À ce scénario s'ajoute une autre statistique inquiétante : le nombre de journalistes emprisonnés a augmenté de 30 % par rapport à l'année précédente, passant de 393 en 2023 à 516 en 2024. Cette augmentation n'est pas un chiffre isolé, mais la confirmation d'une détérioration globale de la liberté de la presse, où la censure gouvernementale et la persécution des voix critiques sont devenues des pratiques systématiques.
Gaza : l'épicentre de la violence contre la presse
S'il est un endroit où le journalisme a payé un prix atroce, c'est bien à Gaza. Dans ce petit territoire de 360 km², 64 journalistes ont été tués en 2024, soit presque la moitié des journalistes assassinés cette année-là. Depuis le début de la guerre, 152 journalistes et travailleurs et travailleuses des médias ont perdu la vie à Gaza, faisant de ce conflit le plus meurtrier de l'histoire moderne pour la presse.
La FIJ a dénoncé le ciblage délibéré des journalistes par l'armée israélienne, rassemblant des preuves pour déposer des plaintes auprès de la Cour pénale internationale (CPI). En conséquence, des mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de dirigeants israéliens et du Hamas, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, pour crimes de guerre.
Asie-Pacifique : une augmentation alarmante des meurtres
La région Asie-Pacifique a également connu une augmentation inquiétante des attaques meurtrières contre les journalistes. En 2024, 22 travailleurs et travailleuse des médias ont été tués, soit une augmentation de 83 % par rapport à l'année précédente. Parmi les pays les plus touchés, citons :
· Pakistan : six des sept journalistes tués ont été pris pour cible par des tueurs à gages.
· Inde : trois journalistes ont été victimes d'attaques ciblées.
· Bangladesh : cinq journalistes ont été tués, dont trois alors qu'ils couvraient des manifestations en faveur de la démocratie.
Cette augmentation reflète le climat croissant d'hostilité à l'égard de la presse dans les pays où la démocratie et l'État de droit sont menacés.
Amérique latine : une légère baisse, mais l'impunité persiste
En Amérique latine et dans les Caraïbes, les assassinats de journalistes ont enregistré une légère baisse : neuf décès en 2024, contre onze en 2023. Cependant, le Mexique reste le pays le plus dangereux pour la pratique du journalisme, avec cinq journalistes tués au cours de l'année.
Le problème n'est pas seulement la violence, mais aussi l'impunité : 95% des crimes contre les journalistes au Mexique ne sont pas résolus. En Colombie, bien que les meurtres aient diminué, les menaces et les attaques ont augmenté, avec plus de 500 violations de la liberté de la presse documentées en 2023.
Afrique et Europe : Conflits oubliés et guerre en Ukraine
En Afrique, la situation est également grave, avec dix journalistes tués en 2024. La crise au Soudan fait de ce pays un des pires endroits pour journalistes, six d'eux ayant été tué alors qu'ils couvraient le conflit.
En Europe, la guerre en Ukraine continue d'être meurtrière pour la presse. Quatre journalistes ont été tués en 2024, victimes de bombardements ou d'exécutions lors de déplacements forcés. En outre, 43 journalistes indépendants ont été tués dans différentes parties du monde, ce qui représente plus d'un tiers de tous les décès dans le secteur. Nombre d'entre eux travaillaient sans protection, sans assurance ni réseau de soutien pour assurer leur sécurité et celle de leur famille.
L'augmentation du nombre de journalistes emprisonnés : l'autre visage de la répression
L'assassinat n'est pas la seule méthode pour réduire la presse au silence. En 2024, 516 journalistes ont été emprisonnés dans le monde, un record absolu. Et ces chiffres pourraient être bien plus élevés, car dans les pays aux régimes répressifs, les informations sur les arrestations arbitraires sont rares.
La Chine, la Turquie, l'Égypte et la Russie figurent parmi les principaux responsables de ces persécutions, soumettant les journalistes à des procédures judiciaires irrégulières et leur refusant le droit à une défense équitable.
Un appel urgent à la communauté internationale
Face à cette crise mondiale, la FIJ insiste sur la nécessité d'adopter une Convention de l'ONU pour la protection des journalistes, un mécanisme qui pourrait contribuer à endiguer la violence et à garantir la justice pour les victimes. La liberté de la presse est en état de siège, et sans mesures efficaces, le journalisme restera une profession à haut risque.
L'année 2024 a été dévastatrice pour le journalisme, mais elle nous rappelle aussi l'urgence d'agir, et de ne pas tout simplement fermer les yeux. Chaque journaliste tué est une voix réduite au silence, un droit violé, une histoire qui ne sera jamais racontée.
La communauté internationale a l'obligation morale de protéger ceux et celles qui risquent leur vie pour la vérité.
Car lorsque la presse est attaquée, c'est la société tout entière qui est perdante.
Rapport complet en anglais : https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/IFJ_Killed_List_report_2024.pdf
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

France - Médias : Attac France porte plainte contre "Le Figaro"

Dans un article publié le 22 novembre 2024, Le Figaro a qualifié Attac d'association « /communautariste/ » qui serait « /liée aux Frères musulmans/ ». Malgré plusieurs adresses au journal, l'article n'a pas été corrigé [1 <#nb1>]. Cette double affirmation grotesque et mensongère, digne du site parodique Le Gorafi, atteint gravement à la réputation de notre association. *C'est pourquoi Attac a déposé plainte pour diffamation.
Ce genre d'amalgame aux relents islamophobes est irresponsable. En ces temps de montée des idées d'extrême droite, Le Figaro contribue à attiser un climat de défiance vis-à-vis des organisations progressistes en général, et d'Attac en particulier. Cette initiative n'est pas anodine alors même que le terme « d'islamogauchisme » est brandi jusqu'à l'Assemblée nationale pour discréditer l'opposition.
Elle s'ajoute à d'autres tentatives de disqualification des mouvements sociaux et écologistes. Gérald Darmanin avait déjà qualifié d'éco-terroristes les manifestant·es contre la méga-bassine de Sainte-Soline. Attac avait même été convoquée devant une Commission d'enquête sur les « groupuscules auteurs de violences ».
Ces attaques impliquent l'augmentation de certaines dépenses (frais d'avocat, conseil juridique, paiement d'amendes). Vous pouvez nous aider financièrement à y faire face. Vous le savez, nos ressources reposent sur les adhésions et les dons : tous les soutiens, petits et grands, sont les bienvenus !
Il nous paraît important que la justice soit saisie afin de ne pas laisser ces méthodes de désinformation et de stigmatisation se propager et devenir banales. Il est désolant de voir qu'un quotidien comme Le Figaro foule au pied la déontologie journalistique la plus élémentaire, contribuant ainsi à fausser le débat public.
Nous ne laisserons rien passer dans notre combat pour un monde plus juste et solidaire !
Lou Chesné, Vincent Drezet, Youlie Yamamoto, porte-paroles d'Attac
Note de bas de page
[1 <#nh1>] « La France insoumise et les islamistes : l'histoire secrète d'une alliance politique » <http://adherez.attac.org/civicrm/ma...> , /Le Figaro/, 22/11/2024
Instagram <http://adherez.attac.org/civicrm/ma...> | Bluesky <http://adherez.attac.org/civicrm/ma...> | Telegram <http://adherez.attac.org/civicrm/ma...> | Facebook <http://adherez.attac.org/civicrm/ma...> | Mastodon <http://adherez.attac.org/civicrm/ma...>
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Vers un (dés)ordre impérial d’un nouveau type

À peine plus d'un mois s'est écoulé depuis l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, avec le techno-oligarque Musk à ses côtés, et la liste des initiatives et mesures que le tandem à la tête de la première puissance mondiale est prêt à mettre en œuvre est déjà très longue. Chacune d'entre elles témoigne de leur ferme volonté de transformer en un nouveau « sens commun » – comme ils le définissent eux-mêmes – un paradigme ultralibéral sur le plan économique, autoritaire sur le plan politique et réactionnaire sur le plan culturel, au service de leur projet MAGA, c'est-à-dire de leur ferme volonté de freiner radicalement le déclin impérial que leur pays subit depuis longtemps.
Tiré de Inprecor
11 mars 2025
Par Jaime Pastor
Diverses analyses et critiques ont déjà été publiées dans Viento Sur et d'autres publications alternatives sur la signification du début de cette nouvelle présidence à la Maison Blanche. Dans cet article, je me concentrerai sur les implications des mesures annoncées, principalement sur le plan géopolitique : à commencer par ses prétentions à s'emparer du Groenland, du Canada et du canal de Panama, pour continuer par le réaffirmation de son soutien total à Netanyahou dans la politique génocidaire qu'il mène contre le peuple palestinien et, bien sûr, par sa dédiabolisation de Poutine et sa disposition à reconnaître les territoires occupés par la Russie en Ukraine (en échange, bien sûr, de la mainmise sur une partie substantielle des terres rares…).
De toute évidence, cette stratégie est au service d'un projet néo-impérialiste qui vise à étendre son arrière-cour, à vassaliser l'Europe, à rechercher la détente avec la Russie et à s'assurer le contrôle du Moyen-Orient afin de pouvoir se concentrer sur la région indo-asiatique et, surtout, sur la concurrence géostratégique avec la Chine. Tout cela dans le cadre d'une guerre technologique, commerciale et extractiviste à l'échelle mondiale, au nom de la nécessité de faire passer la protection des Américains WASP [blancs, anglo-saxons et protestants] et de leur mode de vie impérial, désormais remis en question, avant le reste du monde. La faisabilité de l'ensemble de ce projet, en particulier au regard de ses effets sur l'économie et la société nord-américaines, mais aussi face aux résistances qui commencent à se manifester sur de nombreux fronts, n'est pas encore établie.
Malgré la confusion que cette volte-face a pu susciter sur la scène internationale, il n'est pas difficile de comprendre qu'elle s'inscrit dans un contexte général de crises de plus en plus imbriquées - dont la crise écologique est l'expression la plus extrême - et, en conséquence, de l'entrée dans un jeu à somme nulle de plus en plus compétitif dans la lutte pour les ressources dans « un monde où les élites croient que le gâteau ne peut plus grossir. À partir de là, en l'absence d'un modèle alternatif, la seule façon de préserver ou d'améliorer sa position devient la prédation. C'est l'ère dans laquelle nous entrons », conclut Arnaud Orain.
Super-oligarchie, changement de régime et nouvelle redistribution coloniale
Une nouvelle ère où la « super-oligarchie de la finance et du contrôle des communications » (Louça, 2025) entend combiner son pouvoir sur le marché avec le contrôle direct du pouvoir étatique, Elon Musk étant l'expression suprême de sa volonté d'imposer ses intérêts à l'échelle internationale.
Un bond en avant qui cherche à s'appuyer sur l'alliance avec les gouvernements et les forces politiques qui opèrent déjà sous l'impulsion de l'Internationale réactionnaire pour, comme l'a exprimé J. D. Vance lors du sommet de Munich, promouvoir un véritable « changement de régime » dans les pays où survivent encore des formes de démocratie libérale héritées du consensus antifasciste issu de la Seconde Guerre mondiale.
Ainsi, bien qu'il soit encore trop tôt pour considérer que ce programme atteindra ses principaux objectifs, il semble évident que nous passons d'un interrègne au début d'une autre phase dans laquelle la reconfiguration de l'ordre impérial par les États-Unis cherche à se présenter comme un modèle pour stabiliser et généraliser un nouveau mode de gestion, de construction de l'hégémonie et de gouvernance politique : celui des autoritarismes réactionnaires (Urbán, 2024) ou des autocraties électorales (Forti, 2025), qui aspirent à créer les meilleures conditions possibles pour trouver une issue à l'impasse déjà séculaire qui caractérise le capitalisme mondial. Cette issue implique évidemment d'imposer la logique de l'accumulation au détriment de nombreuses conquêtes sociales et politiques, remportées grâce aux mouvements d'en bas, et des limites biophysiques de la planète.
C'est pourquoi la volonté de Trump de remodeler l'ordre géopolitique en faveur des intérêts de MAGA doit être considérée comme la réponse à la fin de la mondialisation heureuse – dont la Chine a été la grande bénéficiaire – par le biais d'un ethnonationalisme protectionniste et oligarchique qui, à son tour, est en train de faire son chemin parmi les grandes puissances d'un côté comme de l'autre. Dans le cas des États-Unis, cela les amène maintenant à remettre radicalement en question la politique étrangère déployée depuis la chute du bloc soviétique par les présidents successifs des États-Unis, en particulier en ce qui concerne les relations avec l'ancien ennemi de l'Est, afin de redéfinir leur empire.
Car, comme le fait remarquer Romaric Godin (2025) : « Il s'agit maintenant de construire un véritable empire, avec un réseau de vassaux qui viendront consommer ses produits, en particulier ses biens technologiques, son pétrole ou son gaz liquéfié (…) ce qui est en jeu aujourd'hui pour une partie du capitalisme américain, c'est d'éviter la compétition, c'est-à-dire d'éviter un grand marché transatlantique et transpacifique comme à l'époque néolibérale, au profit d'un empire : un centre et des périphéries où chacun a un rôle à jouer dans sa relation avec le centre. »
Dans ce cadre, le rapprochement avec la Russie réactionnaire et nostalgique de son ancien Empire, dont témoigne sans équivoque ce récent vote commun au Conseil de sécurité de l'ONU sur le « conflit » en Ukraine, est la démonstration la plus évidente du changement radical auquel nous assistons et dans lequel les deux grandes puissances s'accordent à respecter mutuellement l'usage de la bonne vieille politique de la force dans leurs sphères d'influence respectives. Cela se reflète également dans leur contribution commune à la crise de légitimité ultime de l'ONU et de tant d'autres institutions internationales (comme l'UNRWA, l'UNESCO, l'OMS…) qui existent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ; ou, plus grave encore, dans le rejet des pourtant fort modérés Accords de Paris sur le changement climatique.
C'est par-dessus cette vieille construction internationale que passe la volonté de pratiquer une diplomatie qualifiée à tort de « transactionnelle » (alors qu'elle est en réalité subordonnée au business as usual) par le biais de négociations bilatérales avec les différentes puissances, comme nous le voyons également avec la guerre commerciale. Et, avec elle, la poursuite de la guerre culturelle mondiale sur le plan politico-idéologique à travers le discours trumpiste (Camargo, 2025), repris par l'Internationale réactionnaire. Cette dernière est désormais considérée comme le seul allié fiable pour défendre ce « qu'ils considèrent comme les valeurs les plus fondamentales » (c'est-à-dire le suprémacisme blanc et chrétien, la famille patriarcale et l'islamophobie), menacées par « l'immigration massive » et la complicité du progressisme, comme l'a dénoncé le vice-président Mike Pence dans son discours déjà évoqué lors de la Conférence de Munich sur la sécurité.
Et l'Union européenne ?
Au milieu de ce changement radical de scénario, l'Union européenne apparaît comme un bloc régional en déclin et de plus en plus divisé entre, d'une part, le choix de s'aligner sur le shérif de Washington, comme le fait déjà Orban depuis la Hongrie, et, d'autre part, la recherche d'une « autonomie stratégique » sur les plans géopolitique, énergétique, économique, technologique et de défense, comme le propose le rapport Draghi. Ceux qui défendent cette dernière option, faisant de nécessité vertu, semblent désormais prêts à accorder une priorité absolue non seulement aux crédits militaires pour leur réarmement – avec même la France de Macron qui propose déjà de partager son parapluie nucléaire –, mais même à une plus grande dérégulation économique au nom de la compétitivité, ouvrant ainsi la porte à un virage libertarien jusque dans les hautes sphères de l'UE (1). Sur cette voie, il semble bien évident que la démocratie, l'inégalité sous toutes ses formes et le réchauffement climatique en subiront les effets, ce qui ne fera qu'accroître le sentiment d'insécurité face à l'avenir au sein des classes populaires et aggraver leurs divisions internes.
Le choix de renforcer une économie de guerre ne trouve aucune justification, car, comme l'a dénoncé Mariana Mortagua, « les pays de l'UE réunis ont plus de militaires en activité que les États-Unis et la Russie, et la somme de leurs budgets de défense est plus élevée que celle de la Russie et plus proche de celle de la Chine ». À cela s'ajoute que, si l'UE a montré sa volonté de continuer à soutenir l'Ukraine face à l'invasion illégitime dont elle est victime de la part de la Russie, cette attitude contraste avec sa complicité permanente avec l'État colonial d'Israël dans le génocide qu'il commet contre le peuple palestinien et le refus de son droit légitime à l'autodétermination. Ce sont donc les intérêts géopolitiques dans un cas comme dans l'autre, et non la défense de la démocratie contre l'autoritarisme ou l'illibéralisme, qui se cachent derrière la pratique du double standard de la part de l'UE, comme l'a dénoncé très justement l'historien Ilan Pappé récemment (2). Même le projet scandaleux annoncé par Trump et Musk de transformer Gaza en un « paradis touristique » n'a pas suscité une condamnation unanime de la part de l'UE.
C'est pourquoi il ne faut pas à nouveau faire l'erreur d'idéaliser une Europe du bien-être et des valeurs démocratiques alors que chaque jour qui passe nous sommes témoins de l'évolution de partis institutionnels et de leur adaptation à l'agenda de l'extrême droite dans sa politique sécuritaire et raciste, comme nous le constatons avec sa politique migratoire et la réduction croissante des droits et libertés fondamentaux.
Et la gauche ?
Dans ce contexte général, la gauche européenne est confrontée à d'énormes défis qui l'obligent plus que jamais à faire face à la reconfiguration en cours de l'ancien ordre impérial. Le rejet des nouveaux pactes inter-impérialistes que Trump et Poutine tentent de mettre en place devrait s'accompagner d'une ferme opposition à une UE qui ne cherche qu'à freiner son déclin en tant que bloc impérialiste en revendiquant une meilleure place dans le nouveau partage colonial.
Sans perdre de vue l'énorme faiblesse de la gauche anticapitaliste, il est urgent de rassembler nos forces dans le cadre des nouvelles résistances qui se mettent en place dans différents pays pour défendre et étendre nos droits et contre-pouvoirs. Sur cette voie, il s'agira d'être capables de construire des fronts socio-politiques unitaires tant pour la lutte commune contre les différents impérialismes que pour répondre à la menace que représentent les autoritarismes réactionnaires en plein essor dans nos propres pays. Ces initiatives devraient favoriser le dépassement du cadre de subordination à la politique du moindre mal qui caractérise les différentes versions du néolibéralisme progressiste, car il a été amplement démontré que ces politiques n'ont pas permis de s'attaquer à la racine des facteurs structurels qui ont facilité l'essor actuel de la réaction (3).
Il s'agit donc de reformuler une stratégie intersectionnelle, contre-hégémonique et écosocialiste, étroitement liée à la lutte pour la dissolution de l'OTAN et à la solidarité avec tous les peuples agressés dans la défense de leur droit à décider de leur propre avenir, face à toute ingérence ou prédation coloniale de leurs ressources, que ce soit à Gaza ou en Ukraine. Dans ce sens, face à la possibilité d'un traité de paix en Ukraine conclu entre Trump et Poutine, il ne faudra pas renoncer à exiger - avec la gauche résistante en Ukraine et l'opposition anti-guerre en Russie - le retrait immédiat des forces russes du territoire occupé, l'annulation inconditionnelle de la dette contractée depuis le début de la guerre (Toussaint, 2025) et la mise en place d'un plan de reconstruction écologiquement et socialement juste.
Face à toutes les sortes de campisme ou de repli national-étatique, nous avons devant nous la difficile double tâche de continuer à défendre une Europe démilitarisée de l'Atlantique à l'Oural, en lien étroit avec la recherche d'une sécurité globale et pluridimensionnelle - qui est apparue comme une nécessité existentielle lors de la dernière crise pandémique - en opposition à la conception de la sécurité aujourd'hui dominante, militariste à l'extérieur et punitive à l'intérieur de nos propres pays.
Jaime Pastor
Traduit pourESSFpar Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro. Source : Viento Sur 1er mars 2025
Références
Camargo, Laura (2024) Trumpismo discursivo. Origen y expansión del discurso de la ola reaccionaria global. Madrid : Verbum.
Forti, Steven (2024) Democracias en extinción. Madrid : Akal.
Godin, Romaric (2025) « Un capitalisme en crise, prédateur et autoritaire », Inprecor.
Louça, Francisco (2025) « ¿Quién es el enemigo ? La superoligarquía », Viento Sur, 19/02.
Toussaint, Eric (2025) « La dette : un instrument de pression et de pillage entre les mains des créanciers », CDTM.
Urbán, Miguel (2024) Trumpismos. Neoliberales y autoritarios. Barcelone : Verso.
1. En réalité, c'est déjà en train de se produire : https://legrandcontinent.eu/es/2025/02/16/desregulacion-en-lugar-de-deuda-comun-el-giro-libertario-de-la-comision-von-der-leyen-sobre-el-informe-draghi/ et https://www.mediapart. fr/journal/international/260225/ue-la-commission-saborde-son-propre-agenda-vert
2. « C'est la grande hypocrisie européenne : soutenir la résistance de l'Ukraine tout en qualifiant de terrorisme la résistance de la Palestine », el diario.es, 25/02/25.
3. Cela s'applique également à la variante socio-libérale, clairement en déclin, comme nous avons pu le constater lors des récentes élections en Allemagne, où une nouvelle coalition gouvernementale avec la démocratie chrétienne est annoncée, ce qui pourrait aggraver sa crise. Pour le cas espagnol, je me réfère à mon article « 41e Congrès du PSOE : le resserrement des rangs autour du leader n'arrête pas la droite », à paraître dans Inprecor n°730.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump II : L’incarnation d’un Idéal-type (au sens wébérien du terme) de la quintessence abjecte et grotesque. Deuxième partie (2 de 3)

Cet effritement des perspectives progressistes a eu pour effet de créer un vide politique alimenté toujours par l'impression que les institutions de la démocratie représentative ne correspondaient qu'à des scènes formelles habitées par des spécialistes qui font quotidiennement la preuve de leur incapacité à esquisser un avenir vraisemblable. Un vide politique qui se nourrit d'un scepticisme envers un jeu politique qui ne vaut pas la peine d'être joué complètement.
Photo : Cette illustration de Donald Trump a été réalisée par Asier Sanz. Il s'agit d'un assemblage-collage qui joue sur la paréidolie, c'est-à-dire cette tendance instinctive qui existe chez l'humain et qui consiste à voir ou à reconnaître des formes familières dans des paysages, des nuages ou des images vagues. https://asiersanz.com. Consulté le 8 mars 2025.
Les illusions de la démocratie libérale
Il y a probablement eu un trop grand nombre de personnes qui ont cru (et qui continuent à croire) naïvement ou en toute sincérité dans les mensonges de la démocratie libérale qui s'est mise en place dans les pays occidentaux au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Expliquons-nous.
Commençons par mentionner que le XXe siècle a été un siècle de grands tumultes sur la scène politique et économique. Il y a eu les deux grands conflits mondiaux (1914-1918 et 1939-1945) et plusieurs crises économiques (1929 à 1939 ; 1957-1958 ; 1960-1961 ; 1970 ; 1974-1975 ; 1982-1983 ; les nombreux et fréquents ralentissements économiques des années quatre-vingt-dix qui ont été accompagnés d'une longue et interminable crise des finances publiques1). Durant la première moitié du XXe siècle, il y a eu une exacerbation des contradictions politiques et l'arrivée de partis politiques autoritaires, dans les années vingt et trente, en Italie (le fascisme) et en Allemagne (le nazisme). Il s'est produit dans certains pays européens des soulèvements ouvriers majeurs (en Autriche [Vienne la rouge], en Allemagne [la révolte spartakiste de Berlin en 1919], en Italie [occupation des usines et mise en place des conseils ouvriers en 1920], en Angleterre [la grève générale de 1926], etc.) ainsi que des révolutions prolétariennes (en Russie en 1917 et en Hongrie en 1919) annonciatrices, sur le plan du discours idéologique, de l'émancipation de l'humanité qui s'est accompagnée en URSS du Goulag et, par les membres de la nomenklatura au pouvoir, d'une lutte à finir avec la dissidence.
Au sein des pays industrialisés de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique du Nord et du Japon, la vie politique va connaître, dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de grandes mutations. Nous allons assister à l'émergence d'une démocratie libérale qu'on peut qualifier de pluraliste et de représentative. Les pays occidentaux vont entrer dans l'ère de la politique-spectacle2, alors que la vie politique va se professionnaliser et les partis politiques vont traiter l'électorat comme une clientèle à séduire. Mais la joute politique que se livrent dès lors les partis se déroule dans la logique de l'alternance gouvernementale, sans véritable alternative politique. Les citoyennes et les citoyens constatent qu'entre les grands partis traditionnels, c'est « bonnet blanc, blanc bonnet ». Ceci va avoir pour effet de contribuer grandement à développer le cynisme et l'indifférence d'une frange importante de la population envers les affaires publiques. Certes, le droit de vote, dans les démocraties occidentales, va devenir universel et être accordé aux citoyennes et aux citoyens de 18 ans et plus. Pour ce qui est de l'exercice du pouvoir, la vaste majorité n'aura pas voix au chapitre.
Bref, le modèle de la démocratie libérale représentative et pluraliste qui prend forme et qui se répand dans les pays capitalistes développés, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, s'accompagne d'une universalisation du droit de vote et de la transformation des partis politiques en organisations permanentes au sein desquelles nous retrouvons principalement des professionnelLEs de la politique. Ces deux phénomènes ont pour effet de brouiller les cartes de la représentation politique. Plus la politique se massifie et moins le peuple est souverain. Certains auteurs (Robert Michels et Moisei Ostrogorski3) ont conclu à l'impossibilité pratique d'un gouvernement par le peuple. Au mieux, le peuple peut choisir, via une élection, des représentantEs appeléEs à gouverner en son nom. Mais l'idée d'un marché libre ou libéral occasionne des difficultés. Ce qui oblige les gouvernements à envisager des règles ou des mesures pour tenter de limiter les crises économiques et les déficits commerciaux. De là est apparu le planisme, qui sert donc à planifier les budgets étatiques, les visées du marché, en plus d'orienter les politiques de façon à assurer une protection nationale — ce qui nous éloigne du marché libre.
La professionnalisation de la vie politique et parlementaire entraîne la disparition, dans le processus démocratique, de celles et ceux qui comprennent le moins la vie politique. Ceci permet aux dirigeantEs du gouvernement et des partis politiques de diriger avec le moins d'entraves possible. Le rôle du peuple se limite strictement à voter et non pas à être partie prenante du processus décisionnel.
La démocratie libérale pluraliste et représentative correspond tout au plus à une simple procédure : une méthode de sélection du personnel spécialisé dans l'art du gouvernement. La scène politique, lors d'une élection, prend la forme d'un marché dominé par les grands partis politiques en compétition pour obtenir le plus grand nombre de voix. À l'ère de la démocratie représentative pluraliste, les partis politiques traditionnels sont à la recherche des votes de la majorité silencieuse. Pour obtenir des voix, ils font des promesses mirobolantes qu'ils savent qu'ils ne pourront tenir. En politique comme dans le monde de la publicité, c'est le règne du look, du paraître et de la séduction qui l'emporte. Voilà pourquoi nous avançons que la vie politique, dans ce que nous appelons les démocraties libérales occidentales, s'est métamorphosée, à travers le temps, en politique-spectacle. Cette politique fonctionne au simulacre, à l'illusion et aux gros mensonges. La lutte entre les protagonistes et porte-parole des partis politiques s'est exacerbée avec le temps. Elle va devenir, à partir de la crise de la fin des années soixante-dix du siècle dernier, plus clivante et davantage polarisée. Attardons-nous sur quelques-unes des grandes mutations du dernier quart de siècle à aujourd'hui.
Sur les grandes mutations du dernier quart du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui
Du milieu des années soixante-dix jusqu'à aujourd'hui, nous avons assisté, dans les pays capitalistes occidentaux et les démocraties libérales, à une transformation progressive du capitalisme et du pouvoir politique. Nous avons été à partir de ce moment et jusqu'à tout récemment confrontés à des institutions qui ont permis une nouvelle forme d'autorégulation du marché mondial. Les dirigeants politiques et les acteurs privés de la Commission trilatérale — organisation créée en 1973 — ont jeté les bases de nouvelles règles de l'économie de marché dans les supposées « ingouvernables démocraties ». La classe politique, pour sa part, a adopté les règles du jeu souhaitées par les barons du capitalisme oeuvrant sur la scène mondiale. Ces nouvelles règles, qui ont été par la suite sanctionnées dans le cadre de traités dits de libre-échange et de règlements adoptés par l'Organisation mondiale du commerce et de Grands sommets des chefs (G-5, G-7, G-8, G-20 et des Sommets de Seattle en 1999 et de Québec en 2002, etc.), n'ont pas été sans conséquences économiques, sociales et politiques majeures pour la majorité de la population.
L'érosion de l'État-nation et régression de la démocratie
Les nouvelles règles du jeu issues de ces organisations à caractère économique et de ces sommets entre dirigeants politiques ont eu pour effet d'éroder certains pouvoirs de l'État. Le pouvoir politique s'est montré incapable de maîtriser la dynamique de la vie économique. Constatons-le : les organisations qui, en dernière analyse, exercent le contrôle du marché mondial sont de nature technobureaucratique et les représentantEs des grandes entreprises ont un accès direct aux décideurEUSEs de ces organisations. Nous avons toutes et tous été à même de constater que jusqu'à tout récemment, le développement du marché mondial a découlé d'une stratégie politique qui a été définie dans des institutions comme le Fonds monétaire international (le FMI), la Banque mondiale, le G7, l'accord de libre-échange nord-américain, etc.. L'État-nation a cessé de faire le poids devant ces institutions politiques internationales réunissant une simple poignée de dirigeantEs des pays les plus développés de trois continents. Nous avons assisté, au cours des cinquante dernières années, soit de 1975 à aujourd'hui, à une véritable régression démocratique qui a profité principalement aux grands acteurs de la mondialisation (les administrateurs des entreprises transnationales, les banquiers de Wall Street, les membres des groupes sélects en provenance de la Silicon Valley : GAFA(M) et NATU4).
Il importe d'ajouter que le primat du marché mondial qui entraîne l'érosion des pouvoirs de l'État national a également eu pour effet d'encourager, à partir du début des années quatre-vingt du siècle dernier, le démantèlement du Welfare State. La nouvelle figure étatique qui s'est mise en place à l'heure du néolibéralisme ou du rétrolibéralisme est maintenant attaquée frontalement par Trump II et Musk (l'agence DOGE). Des années quatre-vingt jusqu'à aujourd'hui, il a été surtout question de privatisations, de dérèglementations, d'ouverture aux capitaux étrangers. Maintenant, aux USA et ailleurs dans certains pays, une contre-révolution réactionnaire est en cours. Une contre-révolution inspirée par les super chefs autoritaires que sont les Trump (USA), Milei (Argentine), Meloni (Italie) et Orban (Hongrie). Or, il importe ici de mettre un mot sur ce qui a accompagné la néo-libéralisation occidentale, c'est-à-dire un néoconservatisme favorable à un État autoritaire. Philip Allmendinger (2002, p. 102) mentionne d'ailleurs ceci : « Les libéraux ont besoin d'un État fort pour contenir la dissidence et surveiller le marché. Les conservateurs ont besoin du potentiel de richesse matérielle offert par le marché afin de justifier un État plus autoritaire5 ». Ainsi, les USA actuels poursuivent dans cette lignée débutée par les Thatcher et Reagan de ce monde.
La transformation de la société
La vaste majorité — pour ne pas dire la quasi-totalité — des sociologues s'entendent sur le constat que nous ne vivons plus dans la société industrielle qui s'est développée à partir du milieu du XIXe siècle. Pour saisir les transformations survenues progressivement depuis la Deuxième Guerre mondiale, certains utilisent le concept de société post-industrielle, d'autres ont proposé celui de société de l'information (c'est-à-dire Hytech). Dans une société de ce type, les organisations de la classe ouvrière ont soit été démantelées, soit rendues illégales. Certaines ont été transformées en véritable caricature électoraliste — pensons ici à l'euro communisme — ou bureaucratisées et rigidement encadrées par un dispositif juridique qui restreint la portée des revendications syndicales et salariales dans un cadre limité et routinier. Dans le monde complexe d'aujourd'hui, il ne semble plus y avoir, à gauche, d'acteurs centraux capables de formuler un projet de société mobilisateur et utopique. La lutte pour le progrès social, jadis fondée sur l'utopie socialiste, est remplacée aujourd'hui par des luttes pour la reconnaissance de droits particuliers (les droits à la non-discrimination et les droits à l'égalité). Peut-être est-ce en raison des dérives communistes perçues et de la montée du totalitarisme vantant d'ailleurs des visées socialistes. Peu importe, à l'heure actuelle, il s'agit ici de constater l'impossibilité de la gauche à dégager, comme au XIXe et une partie du XXe siècle, de grandes solidarités d'inspiration progressiste visant la transformation sociale. C'est plutôt, plus récemment, à droite et chez les ultra-droitistes que l'utopie contre-révolutionnaire s'est enracinée et développée. Toujours dans cette idée de la liberté, dont le néolibéralisme semble incapable de lui donner sa véritable valeur.
La gauche socialiste, la sociale-démocratie, le syndicalisme révolutionnaire ou le syndicalisme de combat sont maintenant des forces sociales et politiques quasi absentes ou complètement absentes de l'arène sociale et de la scène politique partisane. Comment interpréter ce phénomène ? Minimalement, de deux façons : on peut, dans une perspective tautologique, le considérer comme le syndrome de l'absence d'un véritable projet politique de transformation sociale ; on peut aussi considérer ce vide comme l'expression ou le résultat d'une transformation majeure du champ politique lui-même.
Sur les transformations du champ politique dans les démocraties libérales occidentales
Pour résumer en quelques mots autour de cette transformation de la forme et du contenu de l'action politique, disons que nous avons assisté à une remise en question frontale par les forces rétrolibérales — c'est-à-dire néolibérales et maintenant ultralibérales — du modèle politique qui s'est imposé un peu partout en Occident au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale : le modèle de la démocratie sociale ou le modèle de la démocratie représentative parlementaire associée au Welfare State.
Ce modèle de démocratie sociale représentative parlementaire correspondait grosso modo aux caractéristiques suivantes :
• La scène politique est réputée être le lieu où les membres d'une société ont la possibilité de définir leur avenir à travers une dynamique de conflit.
• L'État est la figure centrale du pouvoir : sa conquête est l'enjeu fondamental de l'action politique.
• Les institutions représentatives (parlementaires) sont le théâtre où se répercutent les conflits et les oppositions relativement au changement social et politique.
• Le processus électoral est un mode d'accès privilégié à la compétition politique pour l'exercice du pouvoir d'État.
• Les groupes d'intérêts sont au cœur des pratiques de pression et de mobilisation qui expriment les revendications et les aspirations des groupes identifiés à la société civile.
• Les partis sont les agents centraux de la lutte pour le pouvoir d'État.
Dans la foulée des réformes engendrées par les exigences de la mondialisation néolibérale, c'est ce modèle politique qui a fait l'objet d'un processus d'effritement et de dépassement. Mais, n'allons pas trop vite. Du lendemain de la Deuxième Guerre jusqu'à la crise des années soixante-dix et quatre-vingt, l'action partisane politique s'est fondée sur le culte du changement. En règle générale, la quasi-totalité des partis politiques partageait la volonté de croire et de faire croire qu'ils étaient porteurs d'un projet crédible et distinct de transformation sociale et que leur action s'inscrivait dans une lutte pour le changement visant plus d'égalité.
Or, ce modèle politique construit sur la valorisation du changement est entré en crise dès lors que le projet de transformation de la société, centré sur les idéaux d'égalité sociale, a commencé à être remis en question. En effet, quelque part à partir du tournant des années soixante-dix, les thématiques du changement et du progrès social s'amenuisent. Le socialisme n'apparaît plus comme cet avenir pensable annoncé par les figures de proue du marxisme et du socialisme démocratique. On observe en même temps que les grandes réformes économiques, sociales et culturelles ont sombré dans la routine bureaucratique. Les promesses d'une participation effective des citoyennes et des citoyens à la vie collective ne sont pas réalisées. Et cela n'est pas surprenant, car exiger l'égalité suppose une plus grande intervention de l'État dans tous les rouages de l'activité du travail, en particulier. Autrement dit, il s'agit d'imposer des règles, de bureaucratiser en quelque sorte l'accès et le développement de cette activité. Plus de droits pour les uns équivaut à plus de contraintes pour les autres, d'où une perte de liberté. Cette perception suppose aussi une forme de discrimination, dans le sens où le transfert de la richesse vers l'aide aux autres reviendrait à faire des travailleuses et des travailleurs des pourvoyeuses et des pourvoyeurs au maintien de personnes qui profiteraient alors du système dit « égalitaire ».
Ici et là, des voix se sont élevées pour commencer à s'attaquer à la notion même de progrès social en dénonçant les effets destructeurs du productivisme — pensons ici au rapport intitulé Halte à la croissance —, pendant que d'autres voix ont décidé de remettre en question certaines politiques associées à « l'État-providence ». Avec la crise des années soixante-dix et quatre-vingt, nous avons assisté, à gauche, à la perte de l'espoir de transformer le monde, alors que les visions de l'avenir sont devenues de plus en plus pessimistes. Contrairement aux promesses d'une croissance continue et ininterrompue, le futur désormais allait prendre l'allure de la régression sociale, de l'austérité, du chômage et de la précarisation du travail.
Cet effritement des perspectives progressistes a eu pour effet de créer un vide politique alimenté toujours par l'impression que les institutions de la démocratie représentative ne correspondaient qu'à des scènes formelles habitées par des spécialistes qui font quotidiennement la preuve de leur incapacité à esquisser un avenir vraisemblable. Un vide politique qui se nourrit d'un scepticisme envers un jeu politique qui ne vaut pas la peine d'être joué complètement. Ce scepticisme a pris tantôt la forme d'un absentéisme lors des élections ; tantôt s'est-il manifesté, à gauche, par une chute du militantisme politique et un désinvestissement des groupes d'action collective. Justement parce que les visées communes ne sont point valorisées par ce système, parce que l'individualisme domine. Le néolibéralisme considère l'individu comme un être d'échange et non comme un être social. Ainsi, tout mouvement de revendications axé sur le collectif — militantisme, mouvement social et syndicalisme — est dépeint comme un acte improductif, irrationnel, voire même exercé par des individus chialeurs et frustrés de ne pas avoir autant de succès que les autres.
Notes
1. Mentionnons ici qu'il y a eu ensuite les crises de 2008 et celle qui a accompagné la pandémie en 2020.
2. Schwartzenberg, Roger-Gérard. 1992. L'État spectacle. Paris : Garnier-Flammarion, 318 p.
3.Michels, Robert. 2009. Les partis politiques. Bruxelles : Éditions de l'Université de Bruxelles, 271 p. ; Ostrogorski, Moisie. 1993. La démocratie et les partis politiques. Paris : Fayard, 768 p
4. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Air BNB, Tesla et Uber.
5.Traduction libre de : « Liberals need a strong state to contait dissent and police the market. Conservatives need the potential for material wealth offered through the market to justify a more authoritarian state » (Allmendinger, Philip. 2002. Planning Theory. Houdmills and New York : Palgrave, p. 102).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

RDC : le combat pour les droits humains de Caritas Bukavu en temps de guerre

Une entrevue avec Damas, le chef d'antenne de l'ONG congolaise par Charlie Wittendal, correspondant en stage au journal et chargé de communication pour le FSMI.
Tiré du Journal des alternatives.
Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre, dévastant des communautés entières. Dans ce conflit reconnu comme le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de six millions de morts, des millions de déplacés et plus d'un million de femmes victimes de violences, celles-ci et leurs filles sont particulièrement vulnérables.
Un conflit aux racines profondes
Si ce conflit est complexe et multifactoriel, marqué par le génocide rwandais de 1994, des tensions ethniques et l'implication d'une multitude de groupes armés, l'économie de guerre s'est transformée en économie de prédation des ressources naturelles.
Le chercheur et spécialiste en conflits armés, Nicolas Hubert, a expliqué que les groupes armés et les forces régulières contrôlent l'exploitation minière dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, y compris la province de l'Ituri, riches en ressources naturelles. Ces « minerais de sang » qui y sont extraits circulent avec des chaînes d'approvisionnement internationales impliquant de grandes entreprises comme Apple et Google. Les minerais extraits illégalement sont exportés vers des marchés internationaux sous des étiquettes trompeuses avec des impacts sociaux et économiques dévastateurs pour les populations locales.
Actualités dans la région du Nord-Kivu
Depuis janvier 2025, les combats se sont intensifiés dans les provinces du Nord et Sud-Kivu opposant les forces Gouvernementales de la RDC et les rebelles du M23. Le M23 a pris la ville de Goma, capitale du nord Kivu, entre le 24 et le 27 janvier, suivi par la ville voisine de Bukavu, province du Sud Kivu, le 16 février. Des combats causant des déplacements massifs de civils, des meurtres et des violences sexuelles. Simplement au cours de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025, l'Unicef remarque que le nombre de victimes de viol accueillies au sein des 42 structures de santé a quintuplé, dont parmi elles, 30 % étaient des enfants. Entre le 26 janvier et le 7 février, L'ONU estime près de 3 000 personnes tuées et 2 900 blessées. Face à ces violences des rebelles, il est urgent d'agir.
Damas est le chef d'antenne de Caritas Bukavu depuis 2018, une ONG humanitaire qui œuvre dans cette région. Il témoigne de cette réalité. « On ne sait plus sur quel pied danser. Nous sommes enfermé.es dans nos maisons, muselé.es, incapables de travailler », confie-t-il. Les activités humanitaires sont paralysées, les autorités ont fui et les membres de la société civile doivent se cacher pour survivre. « Nous plaidons pour la démocratie, la liberté d'expression, mais même notre sécurité est en danger. »
Caritas Bukavu
Caritas Bukavu s'engage pour la paix et la défense des droits humains en soutenant les survivantes de violences sexuelles, en assistant les personnes déplacées et en menant des actions de cohésion sociale et de plaidoyer local. L'organisation sensibilise sur l'égalité des genres, l'éducation pour les enfants et la protection de l'environnement, tout en répondant aux urgences avec des distributions de vivres et une aide financière.
Grâce à des partenariats tels que la Caritas Espagne, la Caritas Belgique ou le fonds de Nations Unies pour la Démocratie, elle renforce l'autonomisation des femmes et leur participation à des instances décisionnelles. Elle procure des programmes de mentorat, la création d'activités génératrices de revenus, et une assistance psychosociale et socio-économique pour les survivantes.
Violences faites aux femmes comme arme de guerre
Les femmes sont particulièrement vulnérables dans les régions de conflit. Le viol est utilisé comme arme de guerre : certaines sont agressées devant leurs familles, qui sont ensuite massacrées. D'autres sont capturées en fuyant, violées, mutilées, et abandonnées. Ces violences servent à semer la terreur : elles facilitent la prise de contrôle des territoires, provoquent des déplacements massifs et détruisent le tissu social. Les victimes contractent des infections, sans accès aux soins, leurs maisons sont détruites, leurs biens pillés. Damas raconte : « C'est plus que la guerre. Ils retirent les organes, laissent les survivantes traumatisées, sans aucun soutien ». La réparation judiciaire est inexistante, les bourreaux ont été libérés en cascade pendant la guerre : toutes les prisons sont vides et d'autres incendiées par les rebelles et les forces gouvernementales.
Pourtant, face à cette horreur, des initiatives existent. Le Dr Mukwege et son hôpital offrent des soins médicaux, psychologiques, et un soutien juridique aux survivantes. Caritas Bukavu organise des centres d'écoute, distribue des biens essentiels, et propose des programmes de réinsertion. Ces efforts se font en coordination avec des agences comme l'UNICEF et l'OMS, malgré les risques.
Responsabilité internationale
Ce conflit est aussi une responsabilité internationale : l'exploitation illégale des ressources congolaises finance ces atrocités, au bénéfice de multinationales occidentales et asiatiques. Il est impératif d'interpeller les gouvernements et les entreprises pour qu'ils cessent de soutenir, directement ou indirectement, ce cycle de violence. Les groupes humanitaires appellent le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité de l'ONU à ouvrir un couloir humanitaire sûr, malgré l'entrave des groupes armés. Ils exigent que les responsables des violences soient jugés, que l'exploitation illégale des ressources cesse, et que les populations reçoivent une protection immédiate. Il est urgent d'agir pour soulager les souffrances des victimes de ce conflit.
L'ONG Caritas Bukavu est inscrite comme entité au Forum social mondial des intersections et compte organiser une activité.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
710 millions de fonds publics gaspillés

En Tunisie, un procès aussi politique que kafkaïen

L'ouverture du procès de complot présumé contre la sûreté de l'État a débuté à Tunis mardi 4 mars 2025 en l'absence des principaux détenus politiques. Reporté au 11 avril, sa première audience a été l'occasion pour les familles des détenus et leurs avocats de rappeler toutes les incohérences de cette affaire.
Tiré d'Afrique XXI.
Je pense que depuis les procès des assassinats politiques de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi (1), nous n'avons pas connu d'affaire en justice d'une telle envergure après la révolution. Surtout qu'avant, la couleur politique [des accusés] était clairement identifiée : les islamistes, la gauche, les syndicalistes… Là, on a un peu de tout, y compris Bernard-Henri Lévy.
L'avocat et ancien juge Ahmed Souab ironise en sortant du tribunal de première instance de Tunis, et rappelle au passage la longue liste des accusés improbables de ce procès. Comme une centaine de ses confrères de la défense dans l'affaire dite du complot contre la sûreté de l'État, il s'est exprimé devant le juge, sans prendre de pincettes.
- Nous étions entassés les uns sur les autres dans une salle trop petite, à suffoquer, devant un écran d'où les principaux prévenus étaient absents. Pour moi, c'est digne d'un hammam, pas d'une salle de tribunal. Nous ne pouvons pas parler d'un procès équitable dans de telles conditions.
Les accusés absents
Ce mardi 4 mars, les plaidoiries des avocats dans une salle comble — la fameuse salle d'audience numéro 6, réservée aux présumés terroristes, les accusés étant jugés sur la base de la loi antiterroriste et du code pénal — portent plus sur la forme que sur le fond pour cette affaire hautement politique. Une position assumée de la défense qui refuse de commencer le procès sans la présence des détenus. Ces derniers sont restés dans leur cellule, refusant l'ordre de comparaître par visioconférence — une mesure héritée de la période Covid-19 et qui a été ici ordonnée par la justice pour motif de « danger ».
Sur l'écran, seulement deux prévenus : Saïd Ferjani, cadre du parti islamiste Ennahdha, emprisonné dans le cadre d'une autre affaire, celle de la société Instalingo (Lire l'encadré ci-dessous), et Hattab Slama, directeur commercial et grand inconnu de cette affaire dite du complot. La justice lui reproche d'avoir garé sa voiture dans le parking de la maison de l'un des accusés et détenus politiques, Khayem Turki, aux côtés de véhicules de diplomates étrangers en visite alors chez ce dernier. Les deux prisonniers sont restés silencieux, résignés, écoutant les avocats de la défense face à un juge stoïque qui les a laissés s'exprimer pendant les cinq heures du procès.
Pour la défense, même si cette première audience était décevante, symboliquement, elle a porté ses fruits : « Nous voulions surtout montrer à l'opinion publique locale et internationale ce qui se passe avec ce procès. L'objectif n'est pas vraiment de convaincre le juge, mais plutôt de dénoncer les conditions dans lesquelles se déroulent un tel procès », explique Dalila Ben Mbarek Msaddek, avocate et sœur de Jaouhar Ben Mbarek, autre détenu.
Les familles et les avocats attendaient depuis plus de deux ans ce moment, d'où la déception de ne pas voir les accusés présents physiquement. L'année dernière, lorsque Jaouhar Ben Mbarek avait été entendu par le juge dans une autre affaire, il avait comparu physiquement, malgré sa grève de la faim et il avait pu s'exprimer devant le juge. « C'est ce que la justice redoute, que les prisonniers s'expriment dans la salle d'audience. On les réduit donc au silence », explique Haifa Chebbi, avocate et nièce de Issam Chebbi, président du parti Al Joumhouri et également emprisonné. « Cinquante ans en arrière, lors des procès politiques de la gauche sous Bourguiba, tous avaient pris la parole face au juge », renchérit Rabâa Ben Achour, universitaire venue soutenir les familles à l'extérieur du tribunal.
Un dossier vide
L'affaire compte en tout 40 accusés. Certains d'entre eux comparaissaient librement, comme Ahmed Nejib Chebbi, ancien candidat à la présidentielle et membre de la coalition d'opposition à Kaïs Saïed, le Front du salut, ou encore Chaïma Issa, ancienne détenue politique également membre de cette coalition. Une grande partie des accusés, dont l'ancien président de l'instance électorale, Kamel Jendoubi, et la militante féministe et ancienne députée, Bochra Belhaj Hmida, vivent en exil à l'étranger. Six figures politiques de l'opposition sont emprisonnées depuis février 2023 : Khayam Turki, homme politique, Abdelhamid Jelassi, ancien membre du parti islamiste Ennahda, Ghazi Chaouachi ancien député et secrétaire général du parti de gauche Le Courant démocratique, Issam Chebbi leader du parti Al Joumhouri, Ridha Belhaj, avocat, ancien ministre et membre du parti Nidaa Tounes et Jaouhar Ben Mbarek, constitutionnaliste. Ils avaient tous préparé des plaidoiries en amont de l'audience et remis des lettres à leurs familles pour les lire à la presse. On lit dans celle de Jaouhar Ben Mbarek :
- Notre procès ne pourra donc avoir lieu que si nous assistons à l'audience, et que les portes de la salle d'audience sont ouvertes à tous les Tunisiens. Nous n'accepterons pas que ce procès se déroule dans des salles obscures et dans un secret honteux… Nous n'accepterons jamais…
Outre la liste farfelue des accusés, les noms de l'ancien ambassadeur de France, André Parant, et celui de l'Italie, Fabrizio Saggio, actuel conseiller diplomatique de Georgia Meloni et coordinateur du Plan Mattei qui définit la nouvelle politique africaine du pays, ainsi qu'une officielle américaine ont également été mêlés à ce dossier, sans qu'il n'y soit donné aucune suite. Dalila Ben Mbarek Msaddek insiste :
- L'une de nos demandes préliminaires à la tenue d'un procès équitable était que la justice les auditionne. Nous avons nous-mêmes essayé d'écrire aux ambassades citées pour leur demander leur témoignage, mais nous n'avons pas eu de réponse.
Les révélations du dossier d'instruction montre l'aspect bancal de l'enquête qui repose exclusivement sur les témoignages de trois anonymes, surnommés X, XX et XXX, recueillis qui plus est après l'arrestation des accusés. Les demandes d'une confrontation avec les accusés ont là aussi été rejetées. Pire, le juge d'instruction en charge de l'affaire a finalement quitté le pays peu après la publication du rapport d'instruction, dans des circonstances mystérieuses.
« Une situation alarmante »
Le jour J, la justice tente de calmer le jeu. À l'entrée de la salle d'audience, les policiers sont affables et enregistrent les noms des journalistes, tout en les laissant rentrer. Interdiction cependant de filmer et d'enregistrer sans l'autorisation de la cour, comme dans la majorité des procès en Tunisie, ce qui n'a toutefois pas empêché des enregistrements vidéos et audio de filtrer.
Des représentations de chancelleries étrangères étaient présentes, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la République tchèque, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, le Haut-Commissariat des droits de l'Homme de l'ONU (OHCHR), ainsi qu'une délégation de l'Union européenne. Ce procès est également scruté de près par les ONG de défense des droits humains qui ont manifesté devant le tribunal, aux côtés d'associations locales et des familles, et qui étaient aussi présentes dans la salle. L'ONG Human Rights Watch a ainsi dénoncé l'absence des détenus dans un communiqué appelant à leur libération immédiate :
- La pratique des procès à distance est par essence abusive, puisqu'elle porte atteinte au droit des détenus à être présentés physiquement devant un juge afin qu'il puisse évaluer leur état de santé ainsi que la légalité et les conditions de leur détention.
Car ce procès, en plus d'autres pratiques liberticides, vaut en effet à la Tunisie d'être de plus en plus visée pour ses « persécutions d'opposants politiques » selon les mots du communiqué de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, publié le 18 février 2025, et dénonçant une « situation alarmante » en Tunisie. Le ministère des affaires étrangères a répondu une semaine plus tard via sa page Facebook, se déclarant « stupéfait » des critiques de l'ONU et insistant sur le fait que la Tunisie « n'a pas besoin de souligner son attachement aux valeurs des droits de l'homme ». Quant aux détenus, ils auraient été arrêtés, toujours selon le ministère, « pour des crimes de droit public qui n'ont aucun lien avec leur activité partisane, politique ou médiatique, ou avec l'exercice de la liberté d'opinion et d'expression ».
Malgré la présence des chancelleries étrangères, aucune réaction européenne n'a été enregistrée à ce procès. Lors d'une conférence organisée notamment autour des accusés en exil à Paris, le lundi 3 mars, dans les locaux de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), Anne Savinel-Barras la présidente d'Amnesty France, a rappelé que « ces détentions sont arbitraires aux yeux du droit international » mais que, pour l'Europe, « la seule question qui importe avec la Tunisie, c'est l'obsession migratoire. Tout est conditionné à cela ». Si certains députés européens ont à plusieurs reprises élevé la voix contre la dérive autoritaire en Tunisie, réclamant de revoir certains soutiens financiers au regard du traitement des opposants politiques et des exilés subsahariens, aucune action concrète n'a été engagée par la Commission européenne qui, au contraire, multiplie les déclarations sur le durcissement de sa politique migratoire, en collaboration avec Tunis. Par ailleurs, l'Italie s'est plusieurs fois félicitée de la baisse des arrivées de migrants irréguliers sur les côtes italiennes entre 2024 et 2025 au départ de la Tunisie. De leur côté, les autorités tunisiennes ont annoncé que, depuis 2023, le nombre d'exilés arrivés en Italie via la Tunisie a baissé de 80 %. L'Agence Frontex parle d'une baisse de 38 % des franchissements irréguliers des frontières européennes en 2024, une chute due à la réduction de 59 % des départs depuis la Tunisie et la Libye.
« Un régime qui ne plie pas »
Aujourd'hui, la majorité des prisonniers, même ceux dont les familles étaient jusque-là discrètes, sortent de leur silence. C'est le cas de Ghalia Eltaïef, fille de Kamel Eltaïef, homme d'affaires influent, jadis proche de l'ancien dictateur Zine El-Abidine Ben Ali, emprisonné dans le cadre de cette affaire du complot. Dans la foulée de l'audience de mardi, elle a publié sur Facebook une partie du rapport d'instruction concernant son père et a dénoncé l'absence de preuves tangibles qui pourraient l'incriminer. « L'objectif est clair : règlement de comptes politiques et diffamation des opposants à travers des dossiers montés de toutes pièces, et une instrumentalisation de la justice à des fins illégitimes », écrit-elle.
La prochaine audience est prévue pour le 11 avril 2025, « des délais normaux » selon Haifa Chebbi, qui ne s'attend de toute façon pas à un procès long mais à des peines lourdes « pour donner l'exemple », ajoute-t-elle, pessimiste. Parmi les accusés, plusieurs risquent la peine capitale, sous moratoire en Tunisie. Pour la société civile qui peine à se mobiliser autour de l'affaire, seulement une centaine de personnes étaient présentes devant le tribunal mardi. « Il n'y a pas de desserrement possible », estime Rabaa Ben Achour. « Nous n'avons pas vu une seule lueur de compromis dans le bras de fer que nous avons avec le régime de Kaïs Saïed depuis trois ans. C'est un régime qui ne plie pas », conclue-t-elle.
Outre ce procès politique, sans doute l'un des plus connus et des plus attendus, il existe une quinzaine d'autres affaires dites de « complot » qui sont également en attente de procès. Cela sans compter les nombreux activistes, journalistes et militants de la société civile emprisonnés sous le coup du décret 54, qui punit la diffusion de fausses nouvelles et qui est principalement utilisé pour museler la liberté d'expression selon les ONGs de défense des droits humains, ou pour « blanchiment d'argent ». Aujourd'hui, les associations de défense des libertés recensent entre 70 et 80 prisonniers politiques ou d'opinion.
Le dernier procès en date est celui de l'affaire Instalingo — une entreprise spécialisée dans la création de contenus web et dont les chefs et employés ont été accusés d'avoir voulu déstabiliser le gouvernement en répandant de fausses informations. Il a donné lieu à des peines de réclusion criminelle qui vont de 5 à 54 ans de prison, et ce à l'encontre des 38 inculpés, dont plusieurs membres du parti islamiste Ennahda. Son président, Rached Ghannouchi, 83 ans, a par exemple écopé de 22 ans de prison. Après ce verdict qui a donné le ton sur la sévérité des peines encourues, la justice tunisienne a libéré la militante des droits humains et ancienne présidente de l'Instance vérité et dignité, en charge après la révolution de 2011 de la justice transitionnelle, Sihem Ben Sedrine, ainsi que le journaliste Mohamed Boughalleb. Un desserrement ponctuel qui, pour nombre de militants de droits humains, servirait à justifier les lourdes condamnations.
Notes
1- NDLR. Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi ont été assassinés en 2013. Le premier a été tué devant chez lui le 6 février 2013, et ce premier assassinat politique post-révolution a provoqué un séisme dans le pays. Après sa mort, il est devenu le martyr de la gauche. Moins de six mois plus tard, le 25 juillet, Mohamed Brahmi, leader du Courant populaire (nationaliste arabe) est assassiné à son tour. Un sit-in s'organise alors devant l'Assemblée nationale constituante pendant tout le mois d'août 2013, et le pays traverse une crise politique sans précédent qui débouchera sur la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Vers la fin de la paix au Soudan du sud ?

Ces dernières semaines, les tensions ont repris entre les milices partisanes du vice-président nuer Riek Machar et l'armée régulière du président dinka Salva Kiir. Le premier a accusé le second d'avoir attaqué ses troupes dans la région de Ulang (Est). En réplique, le 7 mars, l'une de ses milices a pris d'assaut un hélicoptère des Nations unies à Nasir (Est), avec à son bord douze soldats, dont un proche du président Salva Kiir, le général David Majur Dak. Tous les passagers ont péri.
Tiré d'Afrique XXI.
Ces dernières semaines ont également été marquées par l'arrestation de ministres et de hauts responsables proches de Riek Machar.
L'accord de paix signé en 2018 risque d'éclater. Deux ans après l'obtention de son indépendance en 2011, le Soudan du Sud avait sombré dans une guerre civile meurtrière, qui a fait au moins 400 000 morts et plus de 4 millions de déplacés.
L'accord de paix prévoyait l'organisation d'élections démocratiques et la fusion des deux armées au sein des Forces unifiées nécessaires (NUF). Mais sept ans après, les élections ont été continuellement repoussées, et les NUF n'ont jamais vu le jour. La reprise des affrontements ravive ainsi de vieilles querelles communautaires et politiques.
Déployée depuis 2011, l'opération des Nations unies au Soudan du Sud (Unmiss) s'inquiète dans un communiqué publié le 7 mars : « La mission appelle tous les acteurs à s'abstenir de nouvelles violences et les dirigeants du pays à intervenir d'urgence pour résoudre les tensions par le dialogue et garantir que la situation sécuritaire à Nasir, et plus largement, ne se détériore pas. » De son côté, International Crisis Group s'alarme sur l'avenir du plus jeune pays du monde : « Le Soudan du Sud est au bord d'une nouvelle guerre totale. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Maroc, pierre angulaire de la politique de Trump en Afrique et en Europe

La nouvelle administration américaine a envoyé un message codé au Maroc. L'aide publique au développement et les actions de l'USAID en particulier voient le Maroc traité comme la plupart des autres pays de la planète. Mais la coopération militaire n'est en rien interrompue et se voit au contraire accélérée.
Tiré de MondAfrique.
Plusieurs facteurs expliquent cet investissement en équipements et formation pour la guerre alors que les Etats-Unis ont freiné leur appui à l'Ukraine et aux alliés européens de l'OTAN.
En premier lieu le nouveau président américain est un vieil ami de la maison royale chérifienne. Donald Trump, désormais surnommé Trump II se voit dynastique comme son ancien ami Feu Hassan II roi du Maroc qui accueillait en 1992 le jeune américain qui deviendra 33 ans après le 47° Président des États–Unis d'Amérique. Ainsi dès le 5 mars 2025, le Général d'Armée Michael Langley, Commandant du Commandement américain pour l'Afrique US AFRICOM s'est déplacé au Maroc pour célébrer un événement spécial dans la zone sud de la méditerranée. La cérémonie s'est tenue à la 1ère Base aérienne des Forces Royales Air (BAFRA) à Salé non loin de Rabat, la capitale ; là où s'est opérée la livraison officielle du premier lot composé de 6 hélicoptères d'attaque Apache AH-64E sur une commande de 36 appareils. La chargée d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis au Maroc, Aimée Cutrona se trouvait aux cotés de Michael Langley qui a souligné l'impact de cette livraison sur la structure de défense du Maroc. « Avec l'acquisition de ces hélicoptères « Apache », le Maroc fait un grand bond en avant en termes de capacités, renforçant ainsi sa sécurité et sa position stratégique dans la région », a-t-il déclaré, rappelant le rôle clé de Rabat en tant qu'important allié non-membre de l'OTAN des États-Unis.
Les médias espagnols (voir EL INDEPIENDENTE du 06/03 et LA RAZON du07/03) proches de l'armée espagnole et des milieux conservateurs, ont vite marqué le coup considérant qu'il s'agit là d'un défi stratégique pour l'Espagne car l'acquisition des Apache AH-64E par le Maroc souligne le « talon d'Achille » de l'Espagne qui est celui de son déficit d'hélicoptères.
Pour sa part, le Général de Corps d'Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant de la Zone Sud, a préparé d'avance sa réponse à toutes les critiques en soulignant le jour de la cérémonie tenue à Salé que « La livraison officielle du premier lot d'hélicoptères d'attaque Apache AH-64 marque une avancée majeure dans le renforcement du partenariat stratégique et de la coopération militaire solide entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique ». Pour tranquilliser les inquiétudes éventuelles et clarifier la primauté de la coopération esprits malveillants, il ajoute que l'acquisition de ces hélicoptères est une « nouvelle pierre ajoutée à l'édifice de nos relations solides et profondément enracinées ».
L'Africom à Kenitra
De plus, le 1 février 2025, le journal espagnol LA RAZON a révélait que les États-Unis, dans le cadre du renforcement des relations avec le Maroc sous la présidence de Donald Trump, le commandement de l'AFRICOM, de Stuttgart, en Allemagne, pourrait être transféré dans la ville de Kénitra, au Maroc.
Les militaires américains ont en tous cas étudié la question sur le terrain. À l'époque, il était question de la base de Rota, en Espagne, mais cette possibilité a perdu de son attrait avec la nouvelle administration américaine.
Rappelons que Le Maroc accueille régulièrement des exercices militaires conjoints, tels que « African Lion », l'une des plus importantes manœuvres militaires du continent, sous la houlette des armées américaines et marocaines co-organisatrices.
Le siège de la zone Sud des Forces Armées Royales ( FAR) du Maroc à Agadir a abrité du 24 au 28 février la réunion finale de planification de la 21ème édition de l'exercice militaire « African Lion 2025 », prévue du 12 au 23 mai, se déroulera à Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Kénitra, Benguerir et Tifnit.
Une pointure comme ambassadeur américain
Par ailleurs, le magazine Politico, bien informé tient que John Peter Pham serait candidat pour devenir le prochain envoyé des États-Unis en Afrique de la nouvelle administration du président Donald Trump. Si la nomination de l'ambassadeur M. John Peter Pham au poste stratégique de Secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, se confirmait, elle pourrait marquer un tournant géopolitique dans l'approche américaine, non seulement du dossier africain, mais également celui du flanc sud de l'Europe. M. Pham est connu pour sa connaissance approfondie de cet espace à risques multiples et pour son soutien indéfectible au Maroc.
Le samedi 8 mars 2025, Donald Trump a annoncé, sur son réseau social privilégié, Truth Social, la nomination de Mr. Duke Buchan III au poste d'ambassadeur des États-Unis auprès du Royaume du Maroc. C'est une personnalité d'une loyauté remarquable à Trump, président des finances du comité national républicain, ambassadeur des États-Unis en Espagne et en Andorre, entre 2017 et 2021, qui va observer minutieusement l'attitude du Sud européen envers le pays africain le plus proche.
Est-ce un simple hasard ou une opération diplomatico-politique américaine qui aligne en ce début d'année tant d'éléments où le Maroc rivalise avec l'Europe et s'affirme comme la partenaire stratégique d'un retour de Washington dans cette partie du monde qui jouxte Méditerranée, Atlantique et bande sahélo-saharienne.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pression internationale contre les états-unis : l’appel se renforce pour levée du blocus contre cuba et son exclusion de la liste des états commanditaires du terrorisme

La récente déclaration du Groupe des Amis en Défense de la Charte de l'ONU devant le Conseil des droits humains à Genève a ravivé le débat sur l'impact du blocus économique, commercial et financier que les États-Unis imposent à Cuba. Dans une déclaration percutante, les 20 pays membres du Groupe ont exigé la levée immédiate de cette mesure coercitive ainsi que l'exclusion de l'île de la liste unilatérale des présumés États commanditaires du terrorisme.
Photo PCF.fr
Un blocus économique aux conséquences graves
Le vice-ministre des Relations extérieures de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dénonce régulièrement le caractère agressif de la politique américaine envers son pays. Dans une récente entrevue accordée à Prensa Latina, le diplomate a rappelé que la « politique étrangère mise en œuvre par le gouvernement des États-Unis est agressive. On reconnaît ouvertement que le but est d'exercer une pression économique sans relâche sur Cuba ». Fernández de Cossío a également mis en garde contre de possibles nouvelles mesures coercitives, soulignant que le blocus non seulement empêche Cuba d'accéder à financement et marchés internationaux, mais qu'il a aussi un impact direct et fort négatif sur la vie quotidienne des Cubains et Cubaines.
L'inclusion de Cuba sur la liste des États commanditaires du terrorisme : une décision arbitraire
L'un des points les plus controversés reste l'inscription de Cuba sur la liste des États commanditaires du terrorisme. Cette désignation, dépourvue de fondements objectifs, a été largement rejetée par la communauté internationale.
Le Groupe des Amis en Défense de la Charte de l'ONU a qualifié cette mesure d' « injustifiée et arbitraire », soulignant qu'elle répond davantage à une stratégie de pression politique qu'à des faits vérifiables. La déclaration a été faite lors d'un dialogue avec le Rapporteur spécial sur la défense des droits humains dans la lutte contre le terrorisme.
On ne peut ignorer le rôle historique joué par Cuba dans la médiation des conflits en Colombie et son appui au processus de paix. L'île a joué un rôle clé en tant que garant dans les négociations avec différents groupes armés et en facilitant le dialogue entre les parties en conflit. Son engagement en faveur de la stabilité régionale et de la résolution pacifique des différends est largement reconnu sur la scène internationale.
C'est pourquoi la Colombie insiste tant pour la levée du blocus américain contre Cuba et son retrait de la liste controversée des États commanditaires du terrorisme.
La rencontre récente à Bogotá entre le vice-ministre des Affaires multilatérales de Colombie, Mauricio Jaramillo, et l'ambassadeur de Cuba, Javier Caamaño Cairo, renforce la coopération diplomatique croissante entre les deux pays. Lors de cette réunion, les deux responsables ont souligné l'importance stratégique des Caraïbes dans la politique étrangère colombienne et réaffirmé leur engagement en faveur du multilatéralisme.
Un soutien international ferme et grandissant
La déclaration du Groupe des Amis en Défense de la Charte de l'ONU a été appuyée par plusieurs rapporteurs et experts indépendants de l'ONU, qui ont documenté les effets dévastateurs de ces restrictions sur les droits humains à Cuba.
Cet appel vient s'ajouter aux 32 résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU au cours des dernières décennies, où la majorité des États membres ont systématiquement voté contre le blocus. la scène internationale.
L'impact énorme du blocus sur la vie quotidienne des Cubains et Cubaines
Les sanctions imposées par Washington ont restreint l'accès de Cuba à fournitures médicales, denrées alimentaires et technologie, affectant gravement des secteurs clé de l'économie comme la santé et l'éducation.
Malgré ces défis, le gouvernement cubain a réaffirmé sa volonté d'établir une relation respectueuse et constructive avec les États-Unis, fondée sur la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et du droit international.
Un appel à la communauté internationale
Alors que de plus en plus de pays rejoignent cet appel, la légitimité de la demande cubaine se renforce et l'isolement des États-Unis sur cette question devient de plus en plus évident.
Seul l'avenir dira si la pression internationale pourra influer sur la politique américaine. En attendant, le peuple cubain continue de résister aux effets d'un blocus économique largement condamné et qualifié par des experts en droits humains de violation des principes fondamentaux du droit international.
Voici la déclaration émise par le Groupe d'Amis en Défense de la Charte des Nations Unies :
Algérie, Bélarus, Bolivie, Chine, République populaire démocratique de Corée, Cuba, Érythrée, Guinée équatoriale, Iran, Laos, Mali, Nicaragua, Palestine, Russie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Syrie, Ouganda, Venezuela et Zimbabwe.
1. Le Groupe d'Amis en Défense de la Charte des Nations Unies exprime sa condamnation ferme de la réinsertion injustifiée de Cuba dans la « Liste des États supposément commanditaires du terrorisme », une liste arbitraire, illégale et unilatérale établie par le Département d'État des États-Unis.
2. Cette action inacceptable confirme le discrédit et le manque de transparence de cette liste, et démontre l'intention d'intensifier l'assiège économique criminel contre Cuba afin de compliquer ses opérations financières et commerciales et provoquer davantage de pénuries au sein du peuple cubain.
3. L'inclusion injuste de Cuba dans cette liste renforce l'impact négatif du blocus économique, commercial et financier criminel sur la réalisation des droits humains du peuple cubain.
4. Le Groupe rappelle les appels répétés adressés au gouvernement des États-Unis par plusieurs titulaires de mandats de procédures spéciales, de nombreux États, des organisations internationales, la société civile et d'autres acteurs, afin de retirer Cuba de la liste et de lever le blocus.
5. Le Groupe rejette fermement la manipulation politique de la lutte contre le terrorisme.
6. Le Groupe réaffirme sa solidarité indéfectible avec le peuple et le gouvernement cubains, et presse le gouvernement des États-Unis de mettre fin immédiatement et sans condition au blocus, de respecter les 32 résolutions adoptées à cet égard par l'Assemblée générale de l'ONU, et d'exclure Cuba de la liste des États supposément commanditaires du terrorisme.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le labyrinthe brésilien

La politique étrangère de la troisième administration de Lula est marquée par trois priorités qui s'entrecroisent : l'intégration régionale, la refonte des équilibres géopolitiques mondiaux et la recherche de nouveaux partenaires économiques. Or, face à une situation mondiale plus confuse et plus tendue, le Brésil se retrouve aujourd'hui avec un poids politique et économique amoindri - y compris au sein des BRICS, un bloc qui subit l'influence croissante de la Chine.
9 décembre 2024 |Source : Nueva Sociedad ; Novembre - Décembre 2024 |Traduction : Adrien Sainty
article_une Gouvernement Lula 2023-2026 Les traductions d'Autres Brésils
https://www.autresbresils.net/Le-labyrinthe-bresilien
Le défi est de contribuer à construire une politique de non-alignement actif pour l'Amérique latine, à équidistance de Washington et de Beijing, en défendant les droits humains, la dénucléarisation et la protection de l'environnement.
Luiz Inácio Lula da Silva est retourné en Bolivie le mardi 9 juillet 2024, 15 ans après sa dernière visite lors de son second mandat présidentiel. Pendant toutes ces années, aucun autre président brésilien n'avait mis les pieds dans ce pays andin, qui partage plus de 3 400 kilomètres de frontières avec le Brésil et qui est son principal fournisseur de gaz naturel. Lula était là pour manifester sa solidarité avec le président progressiste Luis Arce, qui avait échappé à une tentative de coup d'État militaire quelques jours plus tôt, pour annoncer de nouveaux investissements brésiliens dans le secteur de l'énergie et du gaz ainsi que pour célébrer l'un des rares résultats concrets de la politique étrangère de son troisième gouvernement : l'entrée de la Bolivie en tant que membre à part entière du Mercosul, le marché commun du Sud affaibli. Le week-end précédent, Javier Milei, le président argentin d'extrême droite, a snobé la réunion des chefs d'État du Mercosul célébrant l'entrée de la Bolivie et a préféré assister à la réunion de la Conférence d'action politique conservatrice (CPAC) à Balneário Camboriú, dans le sud du Brésil, en compagnie de l'ancien président Jair Bolsonaro.
« Le bon fonctionnement du Mercosul, qui a désormais le plaisir d'accueillir la Bolivie comme membre à part entière, contribue à notre prospérité commune », a déclaré Lula. Le président brésilien a également annoncé qu'il avait invité la Bolivie à participer au sommet des chefs d'État du G20, les 20 plus grandes économies du monde, qui se tiendra en novembre 2024 à Rio de Janeiro, afin de se joindre à l'initiative du Brésil - qui assure la présidence tournante du groupe - pour lutter contre la faim et la pauvreté. « Le président Arce a exprimé l'intérêt de la Bolivie à rejoindre les BRICS (...) le Brésil considère l'inclusion de la Bolivie et d'autres pays de notre région comme très positive. » a ajouté Lula.
Le retour de Lula en Bolivie est un symbole révélateur. Comme lors de ses deux premiers mandats (2003-2010), la politique étrangère de sa troisième administration est marquée par trois priorités étroitement liées : le processus d'intégration régionale latino-américaine, la rediscussion des équilibres géopolitiques et des institutions de gouvernance mondiale, et la recherche de nouveaux partenaires économiques et d'investissements internationaux. Cependant, la situation mondiale est aujourd'hui beaucoup plus confuse et tendue, tandis que le poids politique et économique du Brésil a diminué - y compris au sein des BRICS, le bloc créé avec la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.
Le 20 mars 2003, au tout début du premier gouvernement Lula, une coalition militaire dirigée par les États-Unis envahit l'Irak dans le but de déposer le dictateur Saddam Hussein et de mettre en place un gouvernement allié. Le prétexte de l'invasion était la présence supposée d'« armes de destruction massive » dans le pays, avec lesquelles le régime d'Hussein pouvait menacer l'Occident. Il s'agissait d'un mensonge sans fondement que l'administration néo-conservatrice du président de l'époque, George W. Bush, a propagé auprès des ministères des affaires étrangères et des médias du monde entier. Outre les États-Unis, 40 pays ont envoyé des troupes en Irak. Il s'agissait d'une opération militaire non-sanctionnée par le Conseil de sécurité des Nations unies, donc illégale et illégitime, qui s'est terminée de manière mélancolique près de 20 ans plus tard. Après avoir détruit l'armée irakienne et abattu Hussein, les États-Unis ont été incapables de gérer le chaos qu'ils avaient créé ; les troupes ont été progressivement retirées jusqu'à ce que les dernières unités militaires cessent leurs opérations de combat en décembre 2021. Quatre mois plus tôt, les troupes américaines avaient également dû quitter précipitamment l'Afghanistan, sous la pression des attaques des talibans.
Le troisième mandat de Lula, qui a débuté en janvier 2023, a commencé dans l'ombre d'un autre conflit déclenché unilatéralement et illégalement par une puissance nucléaire : le 24 février 2022, les troupes russes ont envahi l'Ukraine et annexé la région de Donbas. L'Ukraine a réussi à résister à l'attaque initiale de la Russie et a commencé à recevoir d'énormes quantités d'aides militaires (des États-Unis et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN) et d'aides économiques (de l'Union européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale) ; près de deux ans et demi plus tard, le conflit s'est transformé en une guerre par procuration menée par les États-Unis et leurs alliés contre la Russie et ses alliés. Pendant ce temps, l'Ukraine continue d'être détruite et les civils et les soldats meurent par milliers, en attendant que l'équilibre sur le terrain impose un quelconque accord de paix. Outre les innombrables victimes et les destructions matérielles, l'agression de la Russie contre l'Ukraine a aussi accéléré le remodelage déjà en cours des équilibres géopolitiques mondiaux. En 2003, les États-Unis étaient la puissance hégémonique incontestée dans un monde essentiellement unipolaire. Vingt ans plus tard, la Chine est le premier partenaire commercial de la majeure partie de la planète, avec un PIB nominal supérieur à celui des États-Unis, et les deux puissances se disputent la suprématie économique et diplomatique mondiale - une offensive qui a été particulièrement réussie en Amérique du Sud et en Afrique. Cette nouvelle multipolarité a été explicitée par les votes de l'Assemblée générale de l'ONU, la plus démocratique des instances onusiennes, où tous les pays sont représentés et où il n'y a pas de droit de veto (mais dont les résolutions, contrairement à celles du Conseil de sécurité, n'ont pas de pouvoir contraignant). Entre le 2 mars 2022 et le 24 février 2023, l'Assemblée générale a voté différentes résolutions sur la guerre en Ukraine, qui ont eu des résultats similaires : entre 141 et 143 pays ont condamné l'invasion, entre cinq et sept ont voté contre les résolutions (outre la Russie elle-même, la Biélorussie, l'Érythrée, la Corée du Nord, la Syrie et le Mali), et entre 32 et 35 se sont abstenus ; plus d'une quinzaine de pays ont choisi de ne pas prendre part aux votes. La majorité des abstentions s'est concentrée en Asie - à commencer par la Chine, l'Inde et le Pakistan - et en Afrique. En Amérique latine, les pays qui se sont abstenus ou n'ont pas participé au vote depuis le premier tour sont ceux qui entretiennent les liens économiques, militaires et idéologiques les plus étroits avec le régime de Vladimir Poutine : la Bolivie, le Venezuela, Cuba et le Nicaragua. Les pressions des Etats-Unis et de leurs alliés occidentaux pour isoler diplomatiquement la Russie se sont définitivement effondrées après le début des représailles israéliennes contre la population palestinienne de Gaza, suivant les attaques du Hamas le 7 octobre 2023. Le soutien inconditionnel à Israël, malgré les dizaines de milliers de victimes civiles et les innombrables crimes de guerre commis par Israël, est perçu par les pays du Sud comme une démonstration de l'hypocrisie et du double standard des puissances occidentales, qui ne défendent les droits humains et le droit international que lorsque cela sert leurs intérêts géopolitiques. Cette contradiction est apparue clairement dans les réactions aux demandes d'emprisonnement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité émises par la Cour pénale internationale (CPI) à l'encontre de Poutine (en mars 2023) et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (en mai 2024 [demande déposée en mai par l'Afrique du Sud, mandat d'arrêt émis en novembre 2024, ndlr]). Dans le premier cas, la décision du procureur général de la CPI, Karim Khan, a été célébrée par l'administration américaine (il s'agit d'une « décision justifiée », selon le président Joe Biden) et critiquée par la Russie (une mesure « scandaleuse et inacceptable », selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov).
Dans le second cas, le président Biden a qualifié la décision de la CPI de « scandaleuse » et a assuré qu'elle « garantira qu'Israël dispose de tout ce dont il a besoin pour se défendre contre le Hamas et tous ses ennemis ». Tous les pays de l'UE adhèrent à la CPI, contrairement aux Etats-Unis, à Israël, à la Russie, à la Chine et à l'Inde. Néanmoins, à quelques exceptions près, les pays européens ont adopté des positions similaires à celles de Washington, soutenant le mandat d'arrêt contre Poutine et critiquant ou exprimant des réserves sur l'action contre Netanyahu. La mesure judiciaire contre Poutine a créé une situation diplomatiquement délicate pour le Brésil et l'Afrique du Sud, les deux seuls membres des BRICS originels qui adhèrent à la CPI et qui, au fil des décennies, ont généralement ratifié toutes les conventions des Nations unies sur les droits de l'Homme. Le gouvernement de Pretoria a dû faire des gestes discrets auprès de Moscou pour s'assurer que Poutine ne participe pas à la réunion des chefs d'État des BRICS organisée en Afrique du Sud en août 2023, évitant ainsi de devoir enfreindre ses obligations envers la CPI, c'est-à-dire l'exécution du mandat d'arrêt international contre le dirigeant russe (la Russie était représentée par le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov). Au Brésil, le ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira a fait une déclaration ambiguë sur le sujet, tandis que Lula a même discuté de l'autorité de la CPI et de l'adhésion du Brésil à l'organisation. « Si je suis président du Brésil et qu'il [Poutine] se rend au Brésil, il n'y a aucune raison qu'il soit arrêté, il ne sera pas arrêté », a déclaré Lula lors d'un voyage à New Delhi en septembre 2023. Deux jours plus tard, il a fait marche arrière, déclarant qu'il appartiendrait aux tribunaux brésiliens de décider de l'éventuelle arrestation de M. Poutine. Il a ajouté : « Je veux vraiment étudier la question de la Cour pénale internationale (...) Je ne dis pas que je vais quitter la Cour. Je veux juste savoir pourquoi les États-Unis ne sont pas signataires, pourquoi l'Inde n'est pas signataire, pourquoi la Chine et la Russie ne sont pas signataires et pourquoi le Brésil est signataire ». Le Brésil a officiellement adhéré au Statut de Rome, qui a donné naissance à la CPI, en septembre 2002, sous l'administration de Fernando Henrique Cardoso, quelques semaines avant que Lula ne remporte sa première élection présidentielle. Officiellement, Poutine est toujours invité à participer au prochain sommet des chefs d'État du G20, qui aura lieu en novembre 2024 à Rio de Janeiro - le Brésil assure cette année la présidence tournante du groupe. Selon les médias brésiliens, le gouvernement tente de trouver un moyen légal de permettre au dirigeant russe de venir sans courir le risque qu'un juge ordonne son arrestation. À la mi-juillet, le Kremlin n'avait pas confirmé la présence de M. Poutine à la réunion.
Au cours des 18 premiers mois de son nouveau mandat présidentiel, Lula a utilisé des tons beaucoup plus acides que par le passé pour critiquer la politique internationale des puissances occidentales, les asymétries du pouvoir mondial, la « paralysie » du Conseil de sécurité des Nations unies et la « représentation inégale et faussée au conseil d'administration du FMI et de la Banque mondiale ». Au même moment, l'articulation autour des BRICS, avec un programme élargi, a acquis une plus grande importance que lors de ses deux premiers mandats. « Les BRICS ne sont plus seulement une réunion de grands pays », a déclaré Lula lorsqu'il a rencontré un groupe d'hommes d'affaires boliviens lors de son voyage en juillet 2024. « Les BRICS représentent désormais le Sud mondial ».
Un équilibre difficile à trouver entre l'intégration régionale et un vote de confiance pour les BRICS+
Depuis que la plupart des pays d'Amérique latine sont devenus indépendants au début du XIXe siècle, ils sont restés dans la zone d'influence des États-Unis, qui ont exercé leur pouvoir par un mélange de diplomatie, de force brute (économique et, le cas échéant, militaire) et d'hégémonie culturelle. Alors que le Mexique et l'Amérique centrale, pour des raisons géographiques et historiques, continuent de pointer leur boussole presque exclusivement vers les États-Unis, l'Amérique du Sud a entamé, depuis le début du XXIe siècle, un processus de diversification de ses échanges commerciaux et de sa politique internationale. Cette nouvelle phase a commencé avec l'élection, entre 1998 et 2006, de dirigeants de gauche ou progressistes dans les principaux pays de la région. En 2005, un front mené par Lula (Brésil), Nestor Kirchner (Argentine) et Hugo Chávez (Venezuela) a définitivement rejeté la proposition américaine de créer une Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), qui aurait étendu au continent le carcan économique accepté par le Mexique lors de la signature de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en 1994. Les résultats de ce choix n'ont pas tardé à se faire sentir. Entre 2000 et 2020, les échanges commerciaux de la Chine avec l'Amérique latine et les Caraïbes ont été multipliés par 26 et, selon le Forum économique mondial, ils devraient doubler d'ici 2035 pour atteindre plus de 700 milliards de dollars américains. En 2022, les importations et exportations entre la Chine et l'Amérique centrale et du Sud (c'est-à-dire sans le Mexique) s'élevaient à 351 milliards de dollars, soit 54 milliards de dollars de plus que les flux commerciaux avec les États-Unis. Cependant, la Chine importe essentiellement des matières premières agricoles et minérales d'Amérique latine et exporte des produits industriels manufacturés : le même cercle vicieux qui condamne la région à un développement faible et fragile depuis des décennies. D'un point de vue diplomatique, le rejet de l'ALCA a également marqué le début d'une période de grande effervescence, avec la création de deux nouvelles organisations intergouvernementales : l'Union des nations sud-américaines (UNASUR), composée de 12 pays sud-américains (2008), et la Communauté des États latino-américains et caribéens (CELAC), avec la participation de 33 pays (2010). Ces deux initiatives ont été menées par le Brésil sous la présidence de Lula et réalisées grâce aux actions habiles de ses deux stratèges en politique internationale, le ministre des Affaires étrangères Celso Amorim et le conseiller spécial Marco Aurélio Garcia. Lula s'est également efforcé de relancer le Mercosul et d'augmenter le nombre de pays participants. Tous les efforts visant à approfondir l'intégration régionale ont toutefois implosé à la suite de la crise politique au Brésil (le coup d'État parlementaire contre la présidente Dilma Rousseff en 2016 et l'élection du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro en 2018) et de l'arrivée au pouvoir de présidents conservateurs en Argentine, au Paraguay, au Pérou et au Chili. L'Unasur a cessé de fonctionner en 2018 et les autres entités régionales ont été mises en veille. Depuis le début de son troisième mandat, le 1er janvier 2023, Lula et son gouvernement ont tenté de relancer l'Unasur, en vain. Après une première réunion à Brasilia, à laquelle ont participé 11 présidents de pays sud-américains, le 30 mai 2023, il a été impossible d'organiser une deuxième réunion. Non seulement il y a des présidents de droite de différentes convictions dans plusieurs pays de la région (Argentine, Uruguay, Paraguay, Équateur et Pérou), mais même dans le camp progressiste, il n'y a pas de consensus sur la façon de gérer la crise politique au Venezuela ou la guerre en Ukraine. A l'Itamaraty [ministère des Affaires étrangères du Brésil, ndlr], on admet que, pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour réactiver l'Unasur ou créer une nouvelle organisation similaire. Lula ne cache pas sa frustration face à cette situation. « Nous n'avons jamais été aussi éloignés les uns des autres que maintenant. Nous devons prendre la responsabilité de décider quelle Amérique du Sud nous voulons et quelle intégration nous voulons », a déclaré le président brésilien lors d'un voyage d'État en Colombie en avril 2024.
Malgré ses nombreuses limites et son déficit structurel de légitimité, le seul organisme régional qui continue de fonctionner sans interruption à ce jour est l'Organisation des États américains (OEA), créée en 1948 et basée à Washington, une organisation historiquement soumise aux États-Unis et à leurs intérêts stratégiques. La CELAC, qui est pertinente parce qu'elle rassemble tous les pays d'Amérique latine, est un forum dont le niveau d'institutionnalisation et d'influence politique est faible. L'Amérique latine et les Caraïbes ont une vieille tradition multilatéraliste, dans laquelle les conflits entre États ont été résolus presque exclusivement par la diplomatie et non par les armes. Une douzaine de pays de la région ont participé à la création de la Société des Nations en 1920, et 20 pays figuraient parmi les 51 nations fondatrices de l'ONU en 1945. Cependant, malgré la rhétorique usée de la grande patrie, l'intégration latino-américaine reste une chimère. Il est décourageant de constater que, dans un laps de temps beaucoup plus court et dans des conditions politiques beaucoup plus complexes, les institutions régionales africaines ont fait beaucoup plus de progrès. L'Union africaine (UA), qui compte 53 pays membres, a été créée en 2001 sur les bases de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), fondée au plus fort du processus de décolonisation, en 1963. En un peu plus de vingt ans, l'UA est devenue un acteur politique reconnu, influent et actif en Afrique, et de plus en plus indépendant des influences des anciennes puissances coloniales.
Durant les premiers mandats de Lula, le Brésil a été impliqué dans le processus de création du groupe BRICS. Le nom (initialement sans « S ») a été créé en 2001 par un analyste de Goldman Sachs, Jim O'Neill, pour désigner les principales économies émergentes (Brésil, Russie, Inde et Chine). Le groupe s'est réuni officiellement pour la première fois en marge de l'Assemblée générale des Nations unies de 2006 à New York. Le premier sommet des BRIC a eu lieu en 2009 en Russie. Deux ans plus tard, lors du troisième sommet à Sanya (Chine), l'Afrique du Sud a rejoint le bloc, ajoutant le « S » (pour « South Africa ») à l'acronyme. Le successeur de Lula, Dilma Rousseff, a cependant montré peu d'intérêt et encore moins d'aptitudes pour la politique internationale, et le Brésil a cessé de jouer un rôle de premier plan au sein du groupe. La participation du Brésil est devenue un simple protocole sous les gouvernements de Michel Temer, après le coup d'État parlementaire contre la présidente Rousseff, et de Bolsonaro. Au cours de ces années, les BRICS ont continué à organiser des sommets annuels sans coordination politique ou diplomatique significative, à l'exception de la création de la Nouvelle banque de développement (NDB) en 2015, basée à Shanghai.
Progressivement, le bloc est devenu un élément supplémentaire de l'expansion de la zone d'influence de la Chine. Lors du sommet de Johannesburg en août 2023, les Chinois ont imposé la création des BRICS+, avec l'entrée de cinq nouveaux pays membres : Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Éthiopie et Iran. L'initiative a été très mal accueillie par le Brésil, qui craignait à juste titre la dilution de son pouvoir politique dans le bloc élargi. En contrepartie, le Brésil a également exigé l'admission d'un pays allié, l'Argentine, qui a renoué depuis 2019 avec un gouvernement progressiste. « Les Chinois ne nous ont pas laissé le choix. Le seul moyen d'empêcher l'élargissement aurait été que le Brésil se sépare, et nous ne pouvions pas le faire », explique un diplomate brésilien qui a participé aux négociations tendues et qui a demandé à ne pas être identifié. « Lorsque Lula est revenu à la présidence, nous avons retrouvé les terres rasées, plus rien ne fonctionnait au sein du gouvernement, y compris à l'Itamaraty. Les Chinois ont pu profiter de ce vide ». Trois mois après la réunion, le candidat d'extrême droite Javier Milei a été élu président de l'Argentine, et le pays a ensuite annoncé qu'il ne rejoindrait pas les BRICS+. Pour Lula et le Brésil, il s'agit d'une sévère défaite diplomatique.
Sur le papier, les BRICS+ constituent un bloc encore plus puissant économiquement que le G7, le groupe des pays occidentaux les plus riches (États-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et Royaume-Uni). En utilisant les données les plus récentes de la Banque mondiale, l'économiste de l'Université de Columbia Jeffrey Sachs a calculé que les BRICS+, qui représentent 45 % de la population mondiale, sont aujourd'hui responsables de 35,2 % de la production mondiale, contre 29,3 % pour le G7. Il y a trente ans, en 1994, le G7 était responsable de 45,3 % de la production mondiale, contre seulement 18,9 % pour les dix pays BRICS+. Les choses ont changé, écrit Sachs : « Les nouvelles données mettent en évidence le passage d'une économie mondiale dirigée par les États-Unis à une économie mondiale multipolaire, une réalité que les stratèges américains n'ont jusqu'à présent pas réussi à reconnaître, accepter ou admettre ».
Les implications futures pour le Brésil et l'Amérique latine de ce déplacement du centre de gravité sont difficiles à évaluer précisément. Avec l'élargissement des BRICS+, les pays membres ayant des systèmes politiques démocratiques et des élections multipartites compétitives (Afrique du Sud, Brésil et Inde) se retrouvent nettement en minorité : trois sur dix. Tous les nouveaux membres, ainsi que la Russie et la Chine, partagent un mépris systématique pour les droits humains. Par ailleurs, on observe clairement une dilution du poids économique – et donc politique – du Brésil dans ce nouveau monde multipolaire. Au sein des BRICS+, comme le rappelle l'inventeur du nom du bloc Jim O'Neill, le Brésil et la Russie représentent approximativement la même part du PIB mondial qu'en 2001, et l'Afrique du Sud n'est même plus la plus grande économie d'Afrique (elle a été dépassée par le Nigeria).
D'un point de vue économique, la Chine et l'Inde sont les principaux acteurs du bloc, bien qu'en forte concurrence l'une avec l'autre et ayant des objectifs stratégiques divergents dans la plupart des cas (avec un différend frontalier qui a déjà conduit par le passé à un conflit armé).
Malgré l'éclat et la reconnaissance personnelle de Lula sur la scène internationale, le Brésil d'aujourd'hui est l'ombre de la puissance économique et diplomatique qu'il était devenu entre 2003 et 2010. Selon les données du FMI, le PIB brésilien est passé de 2,46 trillions de dollars en 2012 à 1,83 trillion en 2022, et sa part dans les biens et services produits dans le monde a chuté de 3,27 % à 1,76 %. En d'autres termes, une baisse de 46 %. La contraction brutale de l'économie brésilienne a également réduit le poids global de l'Amérique latine. Bien que la région concentre 8 % de la population mondiale, elle ne représentait que 5,26 % du PIB mondial en 2022, contre 7,95 % en 2012, soit une diminution de 33,85 % en dix ans. En 2023, l'année du retour de Lula à la présidence, le PIB du Brésil a augmenté de 1,6 % et celui de la région de 2,3 %.
Lors du sommet de Johannesburg, le Brésil a proposé la création d'un groupe de travail pour étudier l'adoption d'une monnaie alternative au dollar pour les échanges commerciaux entre les membres des BRICS+. Cependant, la déclaration finale n'a fait aucune mention de la création d'une monnaie commune pour le bloc, ni d'étapes concrètes vers la dédollarisation du commerce international, une idée soutenue publiquement par Lula et Poutine, qui permettrait à la Russie de réduire l'impact des sanctions internationales imposées par les États-Unis et l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine. Un an plus tard, la dédollarisation reste une aspiration rhétorique. Même les prêts de la NDB (Nouvelle Banque de Développement) continuent d'être effectués en dollars et en euros, et seulement marginalement en renminbis chinois. La « banque du Sud global », comme Lula l'a surnommée avec un certain excès d'enthousiasme, n'est pour l'instant qu'une opération relativement modeste, avec seulement huit membres (en plus des BRICS originaux, l'Égypte, le Bangladesh et les Émirats arabes unis), qui, en neuf ans d'activité, ont approuvé des prêts pour 96 projets différents – principalement dans les domaines des infrastructures et des transports – pour un montant total de 32,8 milliards de dollars. En comparaison, la Banque interaméricaine de développement (BID), créée en 1959 et basée à Washington, compte 739 projets en cours en Amérique latine, pour un total de 58 milliards de dollars. Le Brésil exerce la présidence tournante de la NDB pour la période 2020-2025. Sous le gouvernement Bolsonaro, le président de la banque était un économiste néolibéral, Marcos Troyjo, remplacé après l'investiture de Lula : l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff a été nommée à la tête de la banque en mars 2023 et y restera jusqu'en juillet 2025.
Malgré son poids économique indéniable, le bloc BRICS+ ne dispose pas d'une stratégie géopolitique claire ou unifiée. Son influence au sein des Nations Unies et du système multilatéral est également limitée par les faibles ressources mises à disposition par les pays membres. Dans la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères des BRICS+ signée le 10 juin 2024, par exemple, une grande attention est portée à « l'escalade sans précédent de la violence dans la bande de Gaza à la suite de l'opération militaire israélienne », avec des « résultats humanitaires catastrophiques », et à la nécessité de « la mise en œuvre effective de la résolution 2728 du Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat, durable et soutenable ». Parallèlement, les contributions financières des BRICS+ à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), qui soutient la population palestinienne à Gaza et dans toute la région, restent symboliques.
Le Brésil fait également partie du G20, le groupe des plus grandes économies mondiales, et exerce la présidence tournante de l'entité en 2024. L'une des initiatives les plus emblématiques défendues par la présidence brésilienne a été la création d'un impôt minimum sur la fortune des quelque 3 000 milliardaires (en dollars) dans le monde, qui contrôlent aujourd'hui environ 13 % du PIB mondial. Selon les calculs de l'économiste français Gabriel Zucman, à qui le gouvernement brésilien a demandé une étude technique pour soutenir cette proposition, cette taxe pourrait générer entre 200 et 250 milliards de dollars par an, une fois mise en œuvre. Alors que des pays du G7 comme la France et (avec des réserves) les États-Unis ont exprimé leur soutien à la proposition, le seul pays des BRICS+ à l'avoir adoptée est l'Afrique du Sud. La Chine, l'Inde, la Russie et l'Arabie saoudite, au moment de la rédaction de cet article, sont restées silencieuses.
Ayant provisoirement perdu le pari de l'intégration sud-américaine, le Brésil cherche à trouver un point d'équilibre entre le Sud global, les États-Unis et les démocraties européennes, menacées par l'essor de l'extrême droite.
« Dans le cas du Brésil, nous jouons sur deux fronts : l'alliance avec les sociaux-démocrates dans le monde et l'alliance avec les pays en développement, comme les BRICS », explique Celso Amorim, le grand stratège international du gouvernement Lula. « C'est un monde compliqué. Nous avons une organisation du pouvoir très complexe. Les menaces et les conflits ouverts sont là. En Ukraine, les superpuissances s'affrontent. Parallèlement, le conflit israélo-palestinien absorbe tout et bouleverse les politiques internes des pays. »
Amérique latine, multipolarité et non-alignement actif
Le prochain sommet des chefs d'État des BRICS+ se tiendra à Kazan, en Russie, à la fin octobre 2024. Pour le régime de Poutine, ce sera une occasion importante de montrer au monde que le pays n'est pas isolé, malgré l'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales. Selon l'ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité du pays, Dmitri Medvedev, « des dizaines de pays » aspirent à rejoindre les BRICS+, une réponse aux efforts de l'Occident pour « préserver les règles en vigueur jusqu'à présent (...), maintenir leur prédominance et continuer à tirer profit des ressources matérielles, naturelles et humaines (...) ainsi qu'à dicter leurs conditions au monde entier ». Bien que le discours de Medvedev, teinté d'anticolonialisme, soit en contradiction évidente avec les pratiques de la Russie consistant à recourir à la force pour résoudre des différends politiques ou diplomatiques, cette rhétorique semble toucher des perceptions profondes dans le Sud global.
La Chine et la Russie se retrouvent souvent alignées dans leur critique de l'ordre international dirigé par les États-Unis sur des questions de paix et de sécurité. Elles partagent une opposition farouche à tout type de supervision internationale (considérée comme une ingérence) sur des thèmes qu'elles considèrent comme internes avec en premier lieu le respect des droits humains. Cependant, il existe une différence notable entre les stratégies des deux pays.
La Chine ne conteste pas la norme de l'intangibilité des frontières territoriales suite à une agression militaire (bien qu'à ses yeux, cette norme ne s'applique pas à Taiwan). Mais au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, la Chine vote systématiquement contre toute résolution visant à surveiller ou condamner des abus, s'opposant même au concept de pression internationale. Comme l'a écrit Kenneth Roth, ancien directeur exécutif de Human Rights Watch, « selon Beijing, le Conseil devrait se limiter à un forum de discussions générales entre gouvernements, dans le respect des interprétations souveraines de chacun sur les droits humains ».
La Chine défend une vision où les droits humains se résument à l'amélioration des conditions de vie et à la croissance économique. Dans sa position officielle : « Les intérêts du peuple sont l'origine et la finalité des droits humains. Renforcer le sentiment de bonheur, de sécurité et de satisfaction des citoyens est l'objectif ultime des droits humains et de la gouvernance nationale. (...) Nous nous opposons à l'utilisation des droits humains comme prétexte pour interférer dans les affaires internes d'autres pays. »
À l'inverse, la Russie, avec son économie affaiblie, mise sur une rhétorique valorisant les « valeurs traditionnelles » de famille, patrie et religion, tout en attaquant le cosmopolitisme et la tolérance des élites occidentales. Ce discours résonne chez de nombreux leaders autoritaires d'extrême droite dans le monde, de Donald Trump à Jair Bolsonaro, de Recep Erdoğan à Viktor Orbán.
Tandis que la Chine investit dans un soft power global pour concurrencer les États-Unis, l'appareil de propagande russe se concentre sur les failles de l'Occident, niant ou déformant les faits nuisibles à l'image de la Russie.
L'Amérique latine : un rôle à réinventer
Dans la compétition pour la primauté mondiale entre la Chine et les États-Unis, l'Amérique latine reste spectatrice. Pour devenir un acteur de poids, la région devra transformer son modèle de développement, misant sur une réindustrialisation durable et des politiques de réduction des inégalités. Ni le Brésil ni le Mexique ne peuvent rivaliser seuls sur la scène mondiale.
L'intégration régionale devrait évoluer de la rhétorique vers la construction d'institutions solides et indépendantes, tout en impliquant la société civile. Des entités futures ne doivent pas dépendre des cycles électoraux nationaux, comme cela a été le cas pour l'UNASUR.
Pour le Brésil, avec ses capacités intermédiaires et sa tradition diplomatique, l'implication dans des formes variées de coopération internationale est essentielle. Rejeter la logique d'une nouvelle Guerre froide, où il faudrait choisir un camp, sera crucial. Dans ce cadre, les BRICS+ peuvent n'être qu'un outil parmi d'autres. L'Amérique latine devrait viser une politique de non-alignement actif, équidistante de Washington et Pékin, tout en renforçant ses relations avec l'Afrique et l'Asie centrale.
Comme le suggèrent Carlos Fortín, Jorge Heine et Carlos Ominami, ce non-alignement devra être proactif et élargir les opportunités au-delà du cadre occidental.
Conclusion
L'Amérique latine reste profondément ancrée dans les valeurs de la démocratie libérale et la lutte pour les droits humains. Malgré les défis posés par les inégalités, le racisme et la violence étatique, les mécanismes internationaux de défense des droits humains ont été essentiels à ses progrès. Aujourd'hui, face à l'influence croissante de la Chine et à l'autoritarisme multipolaire, il est impératif de reconstruire un multilatéralisme plus équitable.
L'investissement dans des institutions régionales et internationales devient vital, en formant de nouvelles coalitions pour promouvoir des agendas économiques, environnementaux et humains.
Voir en ligne : Article original en portugais
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Résolution Ukraine - 18ème Congrès mondial de la Quatrième Internationale

Le 18e Congrès mondial de la Quatrième Internationale s'est tenu en Belgique du 23 au 28 février. La discussion, très large, a porté sur la situation internationale sous tous ses aspects, de la polycrise structurelle dans ses dimensions environnementale, économique, sociale et politique aux mouvements de résistance, en passant par la nécessité de construire et de renforcer notre propre Internationale. Un point particulier du débat a été la manière dont nous, marxistes révolutionnaires internationalistes, exprimons notre opposition à l'invasion russe de l'Ukraine et notre solidarité avec la résistance du peuple ukrainien à cette invasion, aux politiques néolibérales du gouvernement Zelensky et à la militarisation néolibérale...
Nous publions ici la résolution présentée par la majorité du CI sortant, approuvée par le congrès par 95 voix pour, 23 contre, 3 abstentions et 5 non-votes, et la résolution alternative présentée par un certain nombre de délégations rejetée par 31 voix pour, 80 contre, 9 abstentions.
18e Congrès Mondial - 2025
https://fourth.international/fr/congres-mondiaux/874/europe/673
En février 2022, Poutine a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine dans le but de transformer le pays en satellite russe. Cette tentative a déjà fait des centaines de milliers de morts et de blessés. Mais le régime de Moscou se caractérise depuis longtemps par une idéologie impérialiste expansionniste grand-russe, qui considère que les superpuissances ont le droit d'étendre leur zone d'influence par tous les moyens possibles, en remettant en cause les normes établies du droit international et en légitimant une nouvelle ère de redistribution impérialiste. Ainsi, pour le Kremlin, l'augmentation quotidienne du coût humain de cette agression n'est pas une raison pour y mettre fin, et une nouvelle intensification est nécessaire pour terroriser le peuple ukrainien et l'obliger à se soumettre.
Ce qui devait être une « opération militaire spéciale » visant à faire tomber le gouvernement de Kiev en quelques jours s'est transformé en un enlisement de trois ans dans une guerre à grande échelle. Cette évolution était inattendue non seulement pour Poutine, mais aussi pour les puissances occidentales - Biden a même proposé d'aider Zelensky à être exfiltré. C'est précisément la détermination et la résilience de la résistance ukrainienne qui a déjoué les plans de Poutine jusqu'à aujourd'hui.
L'invasion de l'Ukraine n'était pas seulement une tentative de réaffirmer le rôle de la Russie dans la compétition capitaliste, mais aussi une tentative délibérée de renforcer le contrôle sur la société russe et d'écraser toute dissidence. Des militants anti-guerre ont été poursuivis et condamnés à de longues peines de prison sur la base d'accusations forgées de toutes pièces. Des organisations socialistes, comme celle de nos camarades du Mouvement socialiste russe, ont été contraintes de se dissoudre et leurs membres ont dû fuir. Si les féministes continuent à se mobiliser, elles le font sous une pression constante, avec des menaces d'emprisonnement pour avoir ne serait-ce que prononcé le mot « guerre ».
En tant qu'internationalistes, nous défendons le droit à l'autodétermination de l'Ukraine et son droit à résister à l'invasion. Les mouvements populaires font partie intégrante de cette résistance et mènent une lutte sur deux fronts : contre les occupants et contre le gouvernement Zelensky. Dans cette lutte inégale, nous sommes solidaires des autres forces progressistes du pays. Nous exhortons toute la gauche internationaliste à développer une solidarité politique et matérielle avec les syndicalistes, les féministes et les militant·es des organisations sociales et démocratiques en Ukraine. Comme la Quatrième Internationale le fait depuis le début de l'agression dans le cadre du « Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine » (ENSU/RESU) et avec l'organisation de gauche ukrainienne, Sotsialnyi Rukh.
Une fois de plus, nous soulignons que nous ne nous faisons aucune illusion sur la nature du régime ukrainien. Son gouvernement est de droite et néolibéral, n'hésitant pas à mobiliser la peur pour rester au pouvoir. Il tient autant à satisfaire les capitalistes nationaux qu'à rassurer les puissances occidentales sur sa capacité à s'adapter à leurs exigences. Ses politiques antisociales et antidémocratiques sont contre-productives en termes de défense de l'Ukraine, car elles s'opposent aux besoins de ses classes laborieuses, provoquent leur ressentiment, sapent la confiance sociale et, en conséquence, le gouvernement recourt à des mesures de plus en plus autoritaires. Il est donc d'autant plus important de se tenir aux côtés des travailleurs et travailleuses ukrainien·nes et de leurs organisations. Nous ne pouvons pas les abandonner alors qu'ils et elles ont désespérément besoin de solidarité, d'autant que notre vision de l'émancipation est celle d'une lutte par en bas, où le peuple se soulève pour lutter en toute indépendance du pouvoir et des grandes puissances.
L'attaque de l'Ukraine par la Russie s'inscrit dans la crise globale du capitalisme, des tensions inter-impérialistes croissantes, de la montée de l'extrême droite et du militarisme. Le régime russe est intervenu en Ukraine, en Arménie, en Géorgie et au Kazakhstan, a soutenu le régime réactionnaire de Bashar El Assad et s'implique de plus en plus en Afrique. Les États-Unis manœuvrent en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, en Europe et en Afrique, arment en permanence Israël en soutenant toutes ses agressions. La France, quant à elle, tente de se maintenir en Afrique et réprime les indépendantistes kanaks. Sans compter que la guerre d'agression de Poutine a revitalisé l'OTAN, auparavant déclarée « en mort cérébrale » et qu'elle a permis aux grandes puissances occidentales de la renforcer et de l'élargir.
En invoquant l'invasion russe, les gouvernements occidentaux font semblant d'être impuissants à soutenir ceux qui sont frappés par l'inflation et l'augmentation des coûts de l'énergie, sapant ainsi tacitement la solidarité à laquelle ils appellent. Entre-temps, les forces de droite s'en prennent de plus en plus aux réfugié·es ukrainien·nes ou les opposent à d'autres migrant·es.
Évidemment, le soutien que les États-Unis et les gouvernements occidentaux apportent à l'Ukraine n'est pas fondé sur un point de vue anticolonial, puisqu'ils permettent, notamment, au colonialisme israélien de se développer sans entrave. Les puissances impérialistes occidentales utilisent la guerre pour tenter d'affaiblir leur rival russe en même temps qu'elles utilisent le besoin d'aide de l'Ukraine pour imposer leur propre mainmise sur le pays. Cependant, ce n'est pas une raison pour que le peuple ukrainien, dans le besoin, qui mérite tous les moyens nécessaires pour se défendre, refuse ces moyens ou que nous fassions obstacle à cette aide.
Il appartient maintenant à la gauche de se mobiliser et d'exiger que le soutien au peuple ukrainien soit accordé sans condition, au lieu d'être lié à la mise en œuvre et à l'approfondissement des mesures néolibérales. C'est pourquoi nous demandons l'annulation immédiate et totale de la dette ukrainienne, le respect du droit du travail, aux études et le maintien des services publics, l'expropriation des grands capitalistes et la lutte contre la corruption pour aider le peuple ukrainien et s'opposer au pouvoir impérialiste.
L'augmentation mondiale des dépenses d'armement montre que nous devons plus que jamais faire campagne contre les programmes insensés de réarmement stratégique mutuel, notamment nucléaire, contre le commerce des armes, très souvent orienté vers les dictatures, et pour un contrôle démocratique (nationalisation) de l'industrie de l'armement - tout en soutenant le droit des peuples colonisés à se défendre, y compris par les armes.
Au moment où nous écrivons ces lignes, la Russie lance de nouvelles attaques. La destruction de villes entières, d'infrastructures et d'écosystèmes sert à imposer l'emprise de l'impérialisme grand-russe, tout comme l'enlèvement et la déportation d'enfants, la destruction de la culture ukrainienne et la suppression des libertés dans les zones occupées. Poutine ne cache pas ses exigences pour punir l'Ukraine de son entêtement : reconnaissance des acquisitions territoriales illégales, remplacement du gouvernement « illégitime et nazi » de Zelensky, réduction drastique des forces armées ukrainiennes, non-adhésion à l'OTAN.
Il est clair qu'une partie de l'extrême droite occidentale préférerait un accord avec Poutine qui renforcerait leur programme ultra-réactionnaire commun et qui laisserait l'Ukraine impuissante et divisée, réduite à une néo-colonie de la Russie. Le gouvernement chinois apporte un soutien concret au Kremlin tout en présentant les exigences de reddition de l'Ukraine comme des propositions de négociations. Une partie des classes dirigeantes européennes et américaines pourrait également être tentée, à un moment donné, par une paix qui donnerait satisfaction à Poutine, mais qui rétablirait également les relations commerciales avec la Russie et la Chine.
Trump considère désormais que les Ukrainien·nes sont responsables de la guerre. Sa posture prédatrice et mercantiliste, exigeant le « remboursement » de l'aide passée à l'Ukraine par la saisie de 50% des ressources minières et en terres rares du pays, et d'autres privilèges à venir, est une illustration particulièrement brutale et odieuse de cette logique.
Une partie de la gauche autoproclamée anti-guerre est d'accord avec cela et est prête à laisser l'Ukraine à la merci permanente du régime russe, que ce soit par campisme anti-étatsunien ou par pacifisme. Nous pensons que toute « paix » basée sur de telles conditions et imposée contre la volonté du peuple ukrainien ne sera que le prélude à davantage d'occupation et de violence à l'avenir. Il est temps pour la gauche d'élaborer sa propre stratégie en matière de sécurité, basée sur la participation populaire et le contrôle démocratique. Cela est devenu plus crucial que jamais face aux « accords » inter-impérialistes conclus entre Trump et Poutine.
La seule solution durable à cette guerre passe par :
– la non-reconnaissance des annexions et le retrait complet des troupes russes ;
– la soumission de toutes les négociations et de tous les accords au contrôle démocratique de la population ;
– la garantie de la capacité de l'Ukraine à se défendre contre tout empiètement impérialiste futur.
Une paix durable n'est possible que si elle repose :
– sur le droit du peuple ukrainien et de ses minorités constituantes à déterminer librement leur avenir et à développer leurs cultures, indépendamment des pressions extérieures, des intérêts des oligarques, des régimes néolibéraux au pouvoir ou des idéologies d'extrême droite ;
– sur le respect des droits politiques, sociaux et du travail, y compris le droit de grève, de réunion pacifique et d'élections libres ;
– sur le droit de tous les réfugié·es et des personnes déplacées par la guerre de rentrer chez eux et elles ou de s'installer dans les pays où ils et elles résident actuellement ;
– sur le démantèlement de la dictature de Poutine et la libération de tous les prisonniers et prisonnières politique et de guerre.
Nous inscrivons notre combat contre la guerre en Ukraine et pour la défaite de la Russie dans une lutte contre le militarisme et l'impérialisme. La lutte contre la guerre et pour la solidarité internationale nécessite :
le démantèlement de tous les blocs militaires de l'OTAN, de l'OTSC et de l'AUKUS ;
l'établissement d'un système de relations internationales basé sur l'égalité de toutes les nations, le contrôle par le bas, une diplomatie ouverte et la condamnation de toutes les formes d'agression impérialiste et nationaliste ;
– l'annulation de la dette ukrainienne ;
– la création, sous le contrôle des citoyen·nes ukrainien·nes, d'un fonds pour la reconstruction, la défense et l'amélioration des conditions de vie, financé par des taxes exceptionnelles sur les bénéfices des capitalistes occidentaux qui ont fait des affaires avec leurs homologues russes et sur les bénéfices des entreprises d'armement et autres profiteurs de guerre, ainsi que par l'expropriation des fortunes des oligarques russes et ukrainiens.
28 February 2025
Résolution alternative Ukraine
Afin d'avoir une orientation solidaire utile envers les travailleurs de la région et de maintenir notre tradition d'anti-impérialisme et d'indépendance de classe, la guerre en Ukraine doit être comprise dans son contexte géopolitique et historique sur la base d'une analyse matérialiste rigoureuse des faits qui y ont conduit, afin d'éviter les caractérisations erronées et les conclusions hâtives. Sur la base de ces prémisses, l'objectif de cette résolution est de développer une orientation alternative à celle de notre courant depuis 2022.
Depuis la rédaction de cette résolution, des événements dramatiques sont venus confirmer notre analyse générale. Le 12 février, Trump a eu un entretien téléphonique avec Poutine et a annoncé que des pourparlers de paix allaient commencer. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a ensuite rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en Arabie saoudite afin d'entamer le processus de partition de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien et l'UE ont tous deux été humiliés en étant exclus du processus.
Trump a incroyablement accusé Zelensky d'avoir déclenché la guerre. Il a exigé 50 % des matières premières ukrainiennes, sans même offrir de garantie de sécurité en échange. Il a refusé à plusieurs reprises de promettre la participation de l'Ukraine aux pourparlers de paix officiels qui doivent commencer. Les États-Unis, ainsi qu'Israël et la Russie, ont voté contre la condamnation de l'invasion russe en Ukraine.
C'est une image du nouvel ordre mondial envisagé par Trump - où le soi-disant « ordre international fondé sur des règles » de l'après-Seconde Guerre mondiale doit être déchiré. Trump semble être motivé par deux calculs - principalement dans le cadre d'un pivot pour se concentrer sur le rival le plus important des États-Unis, la Chine, et secondairement comme un moyen de répondre aux attentes de sa base électorale.
Si elle est conclue, ce sera une paix inter-impérialiste, tout comme l'était la guerre, ainsi qu'une lutte légitime de l'Ukraine contre l'agression, une guerre par procuration inter-impérialiste. Elle sera basée sur une importante cession de territoire à la Russie et de ressources en terres rares aux États-Unis.
Le fait qu'il soit probable que la nouvelle position de l'administration américaine ne conduise à la fin de la guerre que souligne le caractère par procuration de ce conflit. Sans le soutien actif des États-Unis, quelles que soient les préférences personnelles de Zelensky et du gouvernement, ils ne pourront pas continuer à se battre. Ils seront probablement contraints d'accepter, malgré leurs objections, une paix humiliante.
L'idée qu'en réponse à cette évolution, nous devrions exiger de l'administration Trump qu'elle continue à envoyer des armes à l'Ukraine est absurde. Cela nous alignerait sur la partie la plus belliciste de la classe capitaliste en Occident.
Au lieu de cela, tout en dénonçant le partage injuste de l'Ukraine par les États-Unis et la Russie, nous devons concentrer notre agitation sur le soutien au peuple ukrainien avec des méthodes de la classe ouvrière. Nous devons redoubler d'efforts pour obtenir l'annulation de la dette ukrainienne. Nous devons nous opposer activement aux tentatives de la Russie et des États-Unis de voler les ressources naturelles de l'Ukraine. Nous devons chercher à approfondir nos relations avec les syndicalistes, les militants de gauche et les autres Ukrainiens. Nous devons chercher à construire des mouvements contre le processus de militarisation européenne qui risque maintenant de s'accélérer davantage.
La longue dynamique de stagnation qui se prolonge depuis la Grande Récession de 2007-2008, amorcée dans les grands centres impérialistes, l'impact additionnel de la pandémie et les changements dans la corrélation internationale des forces résultant du déplacement des grands centres de production de valeur vers le Sud et l'Est, ainsi que l'épuisement de la dynamique de la financiarisation comme mécanisme de récupération des profits avec peu ou pas d'accumulation... ont ouvert deux dynamiques de base au niveau mondial :
(a) une aggravation des tensions inter-impérialistes.
b) une instabilité politique croissante résultant, en termes généraux, de l'interaction des vecteurs suivants : un renforcement de la droite radicale, une crise des forces de gestion politique et la fragmentation et l'affaiblissement global de la gauche, de la social-démocratie à la gauche révolutionnaire.
En ce qui concerne la première dynamique, il existe aujourd'hui quatre points chauds majeurs de tension inter-impérialiste (Palestine et Moyen-Orient, Ukraine et Europe de l'Est, Sahel et Afrique subsaharienne, Taïwan et Asie du Sud-Est), et deux guerres ouvertes en pleine escalade (la guerre d'Israël - avec le soutien américain et européen - contre la Palestine, le Yémen et le Liban et ses attaques contre la Syrie et, surtout, l'Iran et trois ans de guerre en Ukraine depuis son invasion par la Russie et une guerre par procuration de l'OTAN contre la Fédération de Russie). Plusieurs diplomates, analystes et activistes mettent en garde contre le risque que les escalades actuelles puissent aller dans une double direction : une convergence de conflits ouverts et le risque qu'ils puissent enflammer toutes les zones de tension, conduisant à un conflit mondial avec un risque élevé d'utilisation d'armes nucléaires.
Dans cette résolution, nous ouvrirons la focalisation dans l'espace et dans le temps pour aborder les causes, la nature et les résultats possibles de la guerre en Ukraine, tout en affirmant l'engagement anti-impérialiste, la ligne antimilitariste et la solidarité internationaliste avec les classes ouvrières ukrainiennes et russes de la Quatrième Internationale.
Ouvrir la focalisation
La tension actuelle dans le monde est liée à la tentative de l'Occident, principalement des États-Unis, d'empêcher par des moyens commerciaux, financiers, politiques et militaires le déclin de son pouvoir dans le monde. La guerre désastreuse menée par Washington depuis la fin de la guerre froide, qui a fait quelque 4 millions de morts et 40 millions de déplacés dans l'arc allant de l'Afghanistan à la Libye en passant par l'Irak et les guerres en ex-Yougoslavie, est liée à la conception néo-con, commune aux républicains et aux démocrates, de la seule domination du monde, formulée en 1992 et mise en pratique depuis lors.
La montée en puissance de la Chine, la réaction de la Russie et l'aliénation croissante du Sud, c'est-à-dire de la majorité de la population mondiale, indiquent depuis longtemps des tensions croissantes dans le monde.
La priorité américaine pour l'Europe, bien connue et documentée, était de séparer l'Allemagne de la Russie et d'empêcher l'intégration de l'Union européenne dans le conglomérat géoéconomique eurasien dont la principale force motrice est Pékin (ce concept a été clairement incorporé dans les documents adoptés par le sommet de l'OTAN à Madrid en juin 2022). La Chine est le premier partenaire commercial de l'UE. La Russie était son principal partenaire énergétique. Les États-Unis sont en train de rompre ces deux relations. Celle de la Russie est déjà acquise et la rupture ne durera au mieux que quelques décennies (l'attaque du Nord Stream en mer du Nord symbolise très bien l'enjeu). La Chine est plus difficile, mais elle progresse aussi (AUKUS, collaboration croissante entre l'OTAN et le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, l'Australie, etc.) Le résultat sera, et est déjà, une subordination croissante de l'UE aux États-Unis, une récession économique sévère en Allemagne (directement impactée par la déconnexion énergétique avec la Russie et la guerre tarifaire en cours avec la Chine), une montée de l'extrême droite et l'approfondissement de la crise politique dans l'UE ouverte il y a plus d'une décennie et demie par la crise de l'euro, la crise politique et sociale en Europe méditerranéenne, le Brexit, et les politiques criminelles de répression de l'immigration.
Caractériser le conflit
A gauche, on observe une double tendance à la simplification des causes et de la nature de la guerre en Ukraine. Certains la réduisent à une lutte de libération nationale contre une invasion « non provoquée » par un régime autoritaire. Ce point de vue n'est pas très éloigné du discours initial de quelques responsables de l'OTAN et de l'UE, qui insistent pour diaboliser Poutine et le dépeindre comme un fou déterminé à reconstruire ce que Reagan appelait « l'empire du mal » soviétique et à conquérir toute l'Europe de l'Est. D'autres parlent d'un affrontement inter-impérialiste sans autre forme de procès (le discours d'une grande partie des BRICS et des formations staliniennes ou mao-staliniennes nostalgiques de l'URSS), ignorant l'invasion russe et le droit à l'autodétermination des peuples, tentant ainsi de justifier et d'excuser la décision de Poutine.
Pour caractériser correctement le conflit en cours, il est inévitable de comprendre qu'il existe une dialectique entre les deux dynamiques (oppression nationale et affrontement inter-impérialiste). Mais la dynamique de la guerre a indubitablement imposé un changement de dosage, dans la mesure où la volonté de résistance d'une majorité de la population ukrainienne au début de l'invasion de Poutine a été progressivement subordonnée aux objectifs, aux méthodes et à la direction politico-militaire des puissances qui soutiennent Kiev contre la Russie. Dans le même temps, la stagnation de la situation militaire dans le cadre d'une longue guerre d'usure a depuis lors favorisé une désaffection croissante, une aliénation et des attitudes de plus en plus hostiles à la guerre parmi des pans de plus en plus larges de la population (comme la fuite massive
des conscrits et les désertions non moins massives des soldats ukrainiens, qui ne croient pas à la promesse illusoire de la victoire).
S'il ne fait aucun doute que la Fédération de Russie est la seule responsable d'une invasion condamnable et criminelle, comme toutes les agressions impérialistes, il est manifestement faux de prétendre qu'elle n'a pas été provoquée.
Un retour en arrière empreint de colère
Il est nécessaire de rappeler quelques faits pour situer le contexte de l'invasion du 24 février 2022 :
La guerre froide n'a jamais été complètement terminée après l'effondrement de l'ex-URSS et du bloc de l'Est il y a plus de trente ans. La conversion de fractions entières des anciennes bureaucraties à l'ethno-nationalisme pour rester au pouvoir, comme c'était déjà le cas en ex-Yougoslavie, l'intervention des grandes puissances pour opérer une restauration capitaliste néolibérale et mafieuse et favoriser les affrontements à leur profit est une constante depuis les années 1990 en Europe de l'Est.
Il est impossible de comprendre le conflit actuel sans y voir le traumatisme de la décomposition de l'Union soviétique et de l'effondrement des pays de l'Est, la dialectique des conflits armés qui se sont déroulés dans le monde depuis la fin de la guerre froide (les attaques de l'OTAN contre l'ex-Yougoslavie, l'Afghanistan et la Libye ou les deux invasions américaines de l'Irak. Dans tous les cas, sauf en Afghanistan, il s'agissait d'États traditionnellement alliés à la Russie), ainsi que l'extension de l'OTAN sans et contre la Russie et l'élargissement de l'UE vers l'Europe de l'Est, aspirant à ce supermarché capitaliste, néolibéral et de plus en plus despotique des pays de l'ancienne sphère d'influence soviétique.
La base matérielle qui explique le grand antagonisme entre une OTAN hégémonisée par les États-Unis et la Russie est la nature du capitalisme politique russe qui, depuis le début des années 2000, n'est plus perméable à la pénétration des intérêts du capitalisme transnational mondialisé, et tente de garantir les intérêts de ses propres oligarchies sur la base d'un pouvoir bonapartiste autoritaire et anti-ouvrier qui cherche à sauvegarder ses zones d'influence traditionnelles et son rentiérisme extractiviste.
La réaction impérialiste et militariste de Poutine ne se comprend pas non plus sans comprendre que ce qui a éclaté en février 2022 est la conclusion d'un conflit d'influence en Ukraine entre la Russie d'une part et les Etats-Unis et l'UE d'autre part. Dans les années 1990, sous la présidence de Bill Clinton, l'Ukraine était le troisième bénéficiaire de l'aide américaine, derrière Israël et l'Égypte. Une guerre annoncée par de nombreux analystes, non pas depuis des années, mais depuis des décennies dans certains cas.
– Il est également important de rappeler que l'invasion ordonnée par Poutine en 2022 aurait été impossible s'il n'y avait pas eu une dynamique de guerre civile en Ukraine depuis 2014, initiée après le renversement de Yanukovych et l'occupation russe de la Crimée qui s'en est suivie. Cette dynamique a sans aucun doute été amplifiée et approfondie par l'intervention secrète de la Russie et le soutien militaire (nous parlons de 3 milliards de dollars d'assistance militaire entre 2014 et 2022), financier et technique des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN à Kiev dans le conflit inter-ukrainien (pour reprendre les termes de Stephen Kotkin, « l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais l'OTAN est dans l'Ukraine »). L'absence de volonté politique de mettre en oeuvre les accords de Minsk I et Minsk II (« ils étaient destinés à gagner du temps », selon les termes d'Angela
Merkel) a également ouvert la porte à la diplomatie coercitive du Kremlin à l'automne 2021, lorsque, comme il est désormais de notoriété publique, il a exigé de l'OTAN qu'elle s'engage à ne pas y integrer l'Ukraine, ce qui a été rejeté par l'organisation militaire, pleinement consciente des conséquences d'un tel refus.
Tous les acteurs du conflit ont bafoué le droit à l'autodétermination
Si toutes les puissances impérialistes impliquées dans le conflit ukrainien invoquent, d'une manière ou d'une autre, le droit à l'autodétermination, elles l'ont toutes piétiné (il en va d'ailleurs de même avec l'« antifascisme » et l'« antinazisme » invoqués par les deux parties, alors que, comme on le sait, les gouvernements russe et ukrainien s'appuient sur des forces et des courants d'extême-droite pour stimuler le militarisme dans leurs pays respectifs).
Le néo-tzarisme de Poutine a évidemment piétiné le droit à l'autodétermination de l'Ukraine, « invention » condamnable attribuée à la malice de Lénine, même s'il organise ensuite des « référendums » peu légitimes dans des territoires comme la Crimée (même si une majorité de sa population était probablement favorable à l'annexion de 2014 en raison de l'histoire spécifique de l'enclave) ou sans aucun légitimité dans les zones qu'il occupe dans le Donbas.
Le régime nationaliste de Kiev n'a pas non plus respecté, entre 2014 et 2022, les droits culturels des russophones et leur volonté d'obtenir une autonomie politique en Ukraine (sans parler du droit à l'autodétermination des Dombas).
Mais l'impérialisme occidental n'a pas respecté l'autodétermination de Kiev, ni lorsqu'il a saboté le préaccord conclu lors des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie en Turquie en avril 2022 (parce que la guerre n'avait pas encore servi à épuiser suffisamment la Russie sur le plan militaire, comme l'affirmerait Boris Johnson), ni lorsqu'il dit à l'Ukraine quoi attaquer, quand et avec quelles armes, subordonnant totalement le processus décisionnel ukrainien à ses propres intérêts. Les gouvernements occidentaux ne se soucient pas de la ruine économique et démographique de l'Ukraine, qui a déjà perdu un tiers de sa population, toute une génération de jeunes mutilés, des centaines de milliers de morts, d'orphelins et de veuves, ainsi qu'un cinquième de son territoire national. Le seul objectif de l'impérialisme occidental a été d'épuiser la Russie.
Dynamique, implications et risques du conflit
Aucune des guerres par procuration de la guerre froide n'a été menée dans le Nord, et encore moins aux frontières (et même à l'intérieur des frontières) d'une grande puissance comme la Russie. Aujourd'hui, le débat porte sur la question de savoir s'il faut ou non attaquer une puissance nucléaire avec des armes à longue portée alors qu'il est prouvé que l'Ukraine ne peut pas gagner une guerre d'usure conventionnelle... ou bien reconnaître la réalité et les « défenseurs de l'autodétermination ukrainienne » finissent par obliger Zelensky à négocier. Pendant la guerre froide, il existait des traités de limitation des armes nucléaires. Aujourd'hui, ces traités ont été systématiquement sabotés, d'abord par les États-Unis et, plus récemment, par la Russie. Cela a conduit à un scénario probablement plus dangereux que la crise des missiles de Cuba en 1962, où la doctrine Monroe, qui interdit la présence d'intérêts, de régimes alliés ou de bases militaires d'autres grandes puissances, non pas aux frontières des États-Unis, mais dans l'ensemble du continent américain, a été appliquée.
– Il convient également de rappeler que l'enthousiasme initial des ministères des affaires étrangères occidentaux pour les perspectives ouvertes par la guerre par procuration de l'OTAN contre la Russie sur le dos de l'Ukraine a conduit nombre de leurs représentants à caresser la perspective d'un Afghanistan slave (pour reprendre l'expression d'Hilary Clinton), qui saignerait la Russie à blanc au point de forcer un changement de régime à Moscou. Biden, Von der Layen, Borrell et Stoltemberg ont répété ad nauseam que les crimes de guerre commis rendaient les négociations impossibles et qu'il fallait forcer la défaite totale de la Russie. Au regard de ce que tolerent au quotidien à Netanyahou depuis plus d'un an, l'hypocrisie de l'impérialisme occidental est proprement scandaleuse.
S'il en est ainsi depuis le début, il est de plus en plus clair que cette guerre ne peut se conclure par une victoire militaire totale de l'une ou l'autre des parties sans transformer le conflit en une guerre inter-impérialiste directe avec un risque très élevé d'utilisation d'armes nucléaires, qui, par sa nature même, ne peut évidemment être gagnée par personne. Il est donc tout à fait concluant que le fait d'alimenter le conflit avec des armes occidentales (d'abord des armes légères, puis des blindés, des bombes à fragmentation, des avions de chasse et des missiles à moyenne et longue portée) a contribué à l'escalade et à la prolongation de la guerre, à la multiplication des morts et des destructions et nous a rapprochés dangereusement d'une guerre mondiale. Le récent « plan de victoire » présenté par Zelenski dans les chancelleries occidentales est tout à fait explicite dans sa recherche de la « victoire » en engageant l'OTAN dans une guerre ouverte contre la Russie. En effet, l'un des grands dangers de cette guerre est que la dissuasion nucléaire passive s'érode et que Poutine décide de la remplacer par une dissuasion nucléaire active (c'est-à-dire l'utilisation d'une arme nucléaire tactique pour restaurer sa crédibilité), ce qui ne peut être totalement exclu (l'insistance des politiciens occidentaux sur le fait que « la menace nucléaire russe est un bluff » est très irresponsable et dangereuse, ce que pensent malheureusement aussi des gens de gauche).
Toutes les informations disponibles indiquent que la Russie est en train de gagner lentement et non sans difficulté une terrible guerre d'usure avec des pertes énormes des deux côtés, qu'elle a été capable de résister aux sanctions économiques et qu'elle a renforcé ses liens géopolitiques et géoéconomiques avec la Chine. En construisant une économie de guerre et en faisant face à l'impact des sanctions, la Russie a non seulement renforcé l'aspect répressif de son régime bonapartiste autoritaire (rappelons que Poutine est un modéré, si l'on considère que le Kremlin est rempli de personnes réclamant des frappes nucléaires sur Paris, Londres et Washington...), mais elle a été contrainte de s'engager dans un processus de réindustrialisation qui permet une croissance économique significative plutôt que l'effondrement recherché par Washington et Bruxelles. Si cette conjoncture favorable à la Russie peut très vite pâtir d'une baisse du prix du pétrole (une opération de genre de l'Arabie Saoudite pour affaiblir la Russie et l'Iran n'est pas à exclure), il semble que la guerre ait impulsé un changement structurel géopolitique et géoéconomique d'une ampleur encore inconnue.
– Des informations émergent également qui indiquent que l'Ukraine est l'auteur du sabotage du Nord Stream avec l'aide d'un ou plusieurs pays de l'OTAN dans l'action (et sans aucun doute avec l'autorisation de Washington, sinon une implication directe dans l'attaque), ce qui dissipe les accusations initiales d'une prétendue paternité russe.
Sur la militarisation de l'Europe
L'Europe de la défense, vieux projet de l'UE promu et légitimé par la guerre en Ukraine, ne traduit pas seulement sa volonté de renforcer son « hard power », notamment dans la lutte pour le contrôle des ressources en Afrique dans la logique extractiviste dominante, mais vise aussi à consolider son rôle de force vassale complémentaire des Etats-Unis dans un projet de domination impérialiste mondiale qui ne semble pas viable, compte tenu de la corrélation des forces en présence. Dans le même temps, le renforcement militaire de l'Europe est une fuite en avant qui reflète l'inquiétude générée chez ses dirigeants par la crise interne aux États-Unis.
– L'invasion poutinienne a permis à l'OTAN de s'étendre à la Finlande et à la Suède, ajoutant de nouvelles tensions avec la Russie et mettant fin à une longue histoire de neutralité pour ces pays (qui a partiellement amorti d'importantes tensions pendant la guerre froide). Tout cela à condition que la Suède accepte de faciliter l'extradition de plusieurs militants kurdes réfugiés dans le pays scandinave et que l'OTAN regarde ailleurs pendant que le régime turc d'Erdogan lance une invasion à grande échelle du Kurdistan irakien et syrien - une guerre qui, soit dit en passant, est passée totalement inaperçue dans les médias occidentaux. Comme chacun sait, l'OTAN défend aujourd'hui les valeurs démocratiques en Turquie depuis la guerre froide, tout comme elle l'a fait par le passé lorsqu'elle accueillait le Portugal de Salazar et la Grèce des colonels.
Dans ses relations avec la Russie, l'UE n'a pas de diplomatie depuis de nombreuses années. Elle a une « politique des droits de l'homme », c'est-à-dire l'utilisation politique sélective des droits de l'homme pour faire pression sur son adversaire. Elle a une politique d'image et de propagande de guerre culturelle : il suffit de voir l'abondance de russophobes auxquels elle décerne ses prix littéraires et citoyens, de la néo-con Anne Applebaum aux écrivains ukrainiens Serhij Zhadan et Andrei Kurkov, dont le principal mérite est le racisme culturel contre tout ce qui est russe, en passant par le détestable président français Emmanuel Macron, qui se vante d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Elle a également une politique de sanctions, qui se retourne actuellement contre elle, et enfin elle a une politique militaire. Le monde bruxellois a tout cela, mais il n'a pas de diplomatie. Des déclarations comme celle du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, selon laquelle « la situation se décidera sur le champ de bataille », témoignent d'une logique purement militaire.
Il existe un lien structurel entre la militarisation européenne et l'intervention militaire de l'Europe et de l'OTAN en Ukraine. D'une part, la militarisation du continent est liée aux besoins mêmes de l'intervention militaire et à l'implication croissante de l'Europe dans le conflit. D'autre part, la guerre en Ukraine sert de prétexte à l'accélération et à la réintroduction d'un programme stratégique de militarisation européenne de plus grande envergure et a créé un climat politique dans lequel il est très difficile de la combattre. Il est donc contradictoire de s'opposer formellement à la militarisation de l'Europe tout en soutenant l'intervention militaire croissante et sans fin en Ukraine, alors que l'Ukraine est le principal moteur de la militarisation sur le continent.
Une guèrre catastrophique pour les peuples de l'Ukraine et la Russie
– Cette guerre a été catastrophique à tous points de vue : par le niveau de morts et de destructions (certaines estimations parlent de près d'un million de morts), par la spirale militariste et réactionnaire qu'elle a propagée parmi les grandes puissances, par l'immense destruction de ressources qu'elle entraîne dans un monde qui doit investir massivement dans la transition énergétique et les mesures urgentes de stabilisation du climat... Bref, parce qu'elle a alimenté les dynamiques de fascisation typiques des spirales ultranationalistes, tant en Russie qu'en Ukraine, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Alimenter la guerre actuelle et soutenir l'interventionnisme de l'OTAN conduit à une escalade sans fin qui ne fait qu'accroître la spirale de la mort et de la destruction en Ukraine, sans perspective d'issue réelle, avec le risque d'une dérive de la situation et d'une extension du conflit à des pays tiers.
La seule solution pour l'autodétermination de l'Ukraine est la négociation pour mettre fin aux hostilités, le retour à la neutralité et le renoncement à l'adhésion à l'OTAN..... Si les négociations de mars-avril 2022 n'avaient pas été sabotées, près de trois ans de guerre auraient été évités et des centaines de milliers de vies sauvées... et la position de négociation de l'Ukraine aurait été beaucoup plus favorable immédiatement après que l'assaut initial de Poutine sur Kiev ait été repoussé. Aujourd'hui, alors que même l'OTAN, par la bouche de Rutte, reconnaît que la guerre ne peut se terminer qu'à la table des négociations, après l'avoir entretenue pendant des années dans le seul but d'utiliser les Ukrainiens comme chair à canon dans sa guerre par procuration contre la Russie, les négociations seront bien plus préjudiciables pour l'Ukraine. Il n'est pas non plus exclu, comme les signes commencent à le montrer, que l'OTAN négocie dans le dos de l'Ukraine lorsque l'organisation militaire arrivera à la conclusion qu'elle n'a plus besoin de ses services. Les précédents historiques ne manquent pas et c'ètait parfaitement prévisible dès le début de la guerre.
La loi martiale imposée par le gouvernement Zelensky, qui a interdit des partis, persécuté des militants et imposé à la population une thérapie de choc ultra-libérale, lui permet également de prolonger son règne sans passer par les urnes. Son sort est lié au soutien des puissances occidentales et il n'est plus évident qu'une majorité de la population ukrainienne soit favorable à la poursuite de la guerre. Un sondage réalisé par le média ukrainien ZN en juin 2024 affirmait que 44 % de la population était favorable à des négociations de paix immédiates.
Compte tenu de la situation au Moyen-Orient et de la déclaration de Zelensky selon laquelle l'Ukraine aspire à devenir « un grand Israël avec son propre visage » et que la « sécurité » sera le principal atout (en effet, les troupes ukrainiennes ont participé à presque toutes les aventures militaires de Washington depuis les années 1990, y compris en Afghanistan et en Irak) et le thème central de l'Ukraine d'après-guerre, il est important de se rappeler que l'utilisation de la souffrance des innocents a déjà servi à légitimer la création d'États gendarmes totalement soumis aux intérêts impérialistes. Tout comme « l'industrie de l'holocauste » a servi les intérêts criminels du sionisme, il n'est pas exclu que le régime de Kiev capitalise sur les souffrances actuelles du peuple ukrainien pour légitimer la création d'un nouvel Israël en Europe de l'Est, en faisant de son antagonisme avec la Russie son principal atout économique, politique et militaire. La création de l'Etat d'Israël a également désorienté dans un premier temps de larges pans de l'opinion progressiste, a servi à laver la mauvaise conscience de l'Europe vis-à-vis du judéicide et a permis d'agiter le discours de la « seule démocratie de la région » et de la « civilisation contre la barbarie »... avec les résultats que l'on connaît quatre-vingts ans plus tard.
La guerre en Ukraine a galvanisé toute une série de tendances réactionnaires qui étaient déjà présentes dans l'Union européenne, aux États-Unis et en Russie : la montée du militarisme, l'expansion de l'OTAN, l'augmentation des budgets militaires, la reconfiguration de l'industrie militaire, elle a contribué à enterrer l'agenda écologiste, elle a favorisé l'unité nationale autour du défensisme « démocratique », de l'ethno-nationalisme et a accéléré le tournant autoritaire dans tous les pays.
En ce sens, la Quatrième Internationale s'engage à promouvoir des processus d'organisation et de lutte contre ces tendances, à nourrir et à participer aux mouvements contre la guerre, la militarisation et pour la dénucléarisation. Le nouvel internationalisme doit commencer à s'organiser contre les intérêts et les politiques de la bourgeoisie dans chaque pays. Reprendre les slogans « Guerre à la guerre » et « L'ennemi principal est dans notre pays ! » est essentiel pour que la classe ouvrière prenne conscience des dangers vers lesquels la dynamique inter-impérialiste actuelle nous conduit, et reprenne ainsi les meilleures traditions du mouvement ouvrier contre le bellicisme et le militarisme. En ce sens, la IVe Internationale propagera les revendications suivantes :
•Paix immédiate sans annexions et retrait des troupes russes.
•Démilitarisation et dénucléarisation des frontières. L'arrêt des livraisons d'armes par les pays impérialistes.
•Le droit au retour de tous les réfugiés de guerre, y compris les insoumis et les déserteurs des deux pays.
•Amnistie immédiate pour les prisonniers politiques, rétablissement du droit de manifester, de se réunir et de s'organiser et fin de la législation d'urgence tant en Russie qu'en Ukraine.
•L'accueil des insoumis, des déserteurs et des réfugiés des deux camps sans obstacles bureaucratiques et juridiques dans les pays où ils décident de s'installer, si nécessaire.
•L'expropriation des oligarques russes et ukrainiens qui ont utilisé l'ethno-nationalisme pour rester au pouvoir et envoyer les prolétaires des deux pays à l'abattoir.
•L'abolition de la dette extérieure ukrainienne et la fin de la colonisation économique et financière de l'Ukraine par le capital international, ainsi que les mesures néolibérales et anti-ouvrières du gouvernement Zelensky.
•Dissolution de tous les blocs militaires (OTAN, OTSC, AUKUS, etc.).
•Avec Droit à l'autodétermination du Dombas et la Crimée.
La Quatrième Internationale est également solidaire
• Avec la lutte contre les propres bourgeoisies en Ukraine et en Russie. Non aux accords avec l'impérialisme en Ukraine, non au projet militariste en Russie. Pour la fraternisation internationaliste et la fin du conflit, sans revanchisme et sans pillage.
• Avec les organisations sociales, syndicales et politiques dissidentes persécutées et/ou directement touchées par les effets de la guerre dans les deux pays, en particulier nos camarades du Mouvement socialiste russe et de Sotsialnyi Rukh en Ukraine.
Solidarité avec la classe ouvrière ukrainienne et russe, arrêt de la guerre et de la spirale militariste suicidaire !
28 February 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Construire Die Linke après l’élection ! Par une politique de classe antifasciste et écologique, Die Linke peut devenir le parti allemande le plus fort à gauche du centre

Die Linke (La Gauche) a réalisé un retour impressionnant. Mais il est encore possible d'aller plus loin. Le parti peut devenir la force politique la plus forte à gauche du centre. Le parti a réussi grâce à une politique de classe antifasciste, une solide campagne de base, un travail médiatique incisif et un travail d'équipe extrêmement fort - mais aussi grâce aux erreurs des autres partis et à des conditions favorables. Le nouvel électorat souhaite la justice sociale, mais aussi une politique climatique et la protection de la démocratie. Si Die Linke veut continuer à gagner, il doit développer davantage sa politique de classe antifasciste et écologique et être prêt à travailler sur ses propres contradictions et faiblesses.
10 mars 2025, par GOES | tiré d'Europe solidaire sans frontières
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74010
1. Le virage à droite et le retour de la gauche
L'élection fédérale a exprimé un net virage à droite de la société [1]. Dans ce contexte, Die Linke a connu une renaissance surprenante pour beaucoup. Avec près de 9 pour cent, il a fait un retour impressionnant au Bundestag. Quelques semaines auparavant, il était crédité de 3 pour cent dans les sondages. Il a construit une nouvelle coalition d'électeurs plutôt jeunes, plus qualifiés, avec une proportion supérieure à la moyenne d'employés syndiqués et de chômeurs. Après l'élection, il a même atteint entre 10 et 12 pour cent dans les premiers sondages. Et : en environ cinq mois, Die Linke a gagné près de 60 000 membres, à la fin de l'automne il comptait environ 49 000 membres, début mars plus de 110 000. Selon une enquête post-électorale de l'institut de sondage INSA, environ un tiers des électeurs se positionnent aujourd'hui à gauche du centre. Au coude à coude avec le SPD, Die Linke trouve aujourd'hui le soutien d'environ un quart de ces électeurs de gauche, les Verts encore 20 pour cent [2]. Mais comment exactement le parti a-t-il réussi ce retour ?
La renaissance de Die Linke est le résultat d'un travail acharné, des étapes décisives de renouvellement ont été préparées à partir de janvier 2023, en été 2023 le soi-disant Plan 25 a été adopté, sans lequel Die Linke ne serait pas là où il est aujourd'hui [3] - en septembre, une grande « Conférence sur l'avenir de la gauche » a eu lieu à Berlin [4]. Il est tentant de penser qu'il y aurait une seule raison pour le succès lors de l'élection fédérale. Ce n'était ni simplement la focalisation sur les questions sociales plus intensément discutée dans le parti depuis la fin de l'été 2024, ni en soi la campagne impressionnante de porte-à-porte du parti. C'est plus compliqué. Si Die Linke veut répéter son succès et même devenir encore plus fort, il est important d'examiner précisément les différents ingrédients du succès électoral, afin de renforcer ce qui est juste et d'éliminer les obstacles. À mon avis, cela était dû à une interprétation flexible d'une stratégie presque populiste de gauche, à une politique de classe antifasciste, portée par une forte campagne de base et rendue connue par une excellente campagne sur les médias sociaux. À cela s'ajoutent des circonstances favorables et des erreurs d'autres partis qui ont préparé le terrain pour Die Linke - comme l'abandon de la question sociale par les autres partis, la polarisation extrême dans la politique d'asile, le vote commun de l'Union, du BSW et du FDP avec l'AfD, mais aussi la course pratiquement sans espoir pour la chancellerie du SPD et des Verts. Cependant, Die Linke ne peut pas compter sur ces conditions cadres favorables à l'avenir.
Une analyse approfondie nous conduit non seulement à la recette du succès, mais révèle également des faiblesses que Die Linke doit aborder s'il veut continuer à réussir et à changer durablement les rapports de force vers la gauche. Il est conseillé d'examiner plus attentivement les préoccupations et les inquiétudes de ceux qui se retrouvent dans la nouvelle coalition d'électeurs. De cette façon, on peut également trouver des indications sur la manière dont Die Linke peut devenir encore plus fort. Il est aujourd'hui tout à fait réaliste qu'il devienne le principal parti à gauche du centre - un projet visant 15% est réalisable s'il développe une politique de classe antifasciste et écologique. Die Linke devrait poursuivre cet objectif stratégiquement, également pour permettre de nouvelles majorités politiques et peut-être même des possibilités d'alliance dans le pays.
J'essaierai de rendre cette idée plausible dans ce qui suit. Je commencerai par les résultats des élections, l'électorat de gauche, l'explication du succès et les motivations des électeurs de gauche. J'accorderai une attention particulière à la campagne de base (essentiellement la campagne de porte-à-porte à l'écoute), qui a été une partie très spéciale et importante de la campagne électorale. Enfin, j'aborderai certains problèmes et défis et tirerai des conclusions stratégiques et pratiques (4) qui permettraient à Die Linke de lutter pour le leadership dans l'espace politique à gauche de l'Union.
Même si Die Linke est rentré au Bundestag avec une sécurité étonnante, il faut commencer par l'évidence : ce fut le grand succès électoral de la droite, en particulier de l'AfD post-fasciste. Le centre-gauche a subi une immense défaite politique. Le SPD et les Verts avaient ensemble réuni environ 20,03 millions de voix il y a 20 ans, lorsque le gouvernement rouge-vert de l'époque a perdu la majorité en 2005. Lors de cette élection fédérale, ils n'ont recueilli que 13,91 millions de voix. Par rapport à 2021, le SPD a perdu environ 3,75 millions de voix, soit une baisse de près de 32%. 2,48 millions d'électeurs sont allés à droite, 1,76 million à l'Union, le reste à l'AfD. Les Verts s'en sont tirés relativement bien en comparaison, ils ont perdu environ 1,1 million de voix en solde net, soit une baisse d'environ 15%. Le grand vainqueur du moment est l'AfD - sur le fond, parce qu'elle a poussé les autres partis avec sa politique xénophobe, et par conséquent aussi dans les urnes. En 2021, environ 4,81 millions de personnes avaient voté pour les post-fascistes, maintenant ils étaient 10,33 millions.
Cette élection n'a pas seulement eu lieu en raison de l'échec de la politique de la coalition feu tricolore, cette rupture de la coalition représente également l'échec d'une réforme sociale et écologique modérée du capitalisme par le haut. Il n'y avait pas seulement un manque de volonté chez les parties des classes moyennes supérieures et de la bourgeoisie organisées dans le FDP. L'orientation des partis de l'Union indique également la réticence qui existe dans d'autres parties de la classe supérieure allemande. Si l'on ajoute le grand « consensus de réarmement » qui existait entre le SPD, l'Union, les Verts et le FDP, et leur manque de volonté de s'engager de manière critique avec les violations des droits de l'homme par l'armée israélienne à Gaza, cela explique pourquoi Die Linke a pu se profiler comme une alternative politique.
Dans ce contexte, la campagne électorale de Die Linke a été un grand succès. Die Linke a obtenu, si l'on inclut l'histoire antérieure du PDS, le deuxième meilleur résultat de son histoire. Si l'on prend comme base le nombre de voix absolues exprimées pour lui, le soutien n'a été plus important qu'en 2009, à l'ombre de la plus grande crise du capitalisme depuis 1929. La participation électorale dans les différentes années électorales était différente, mais les voix absolues exprimées montrent néanmoins la force du besoin qui existe pour un parti explicitement socialiste.
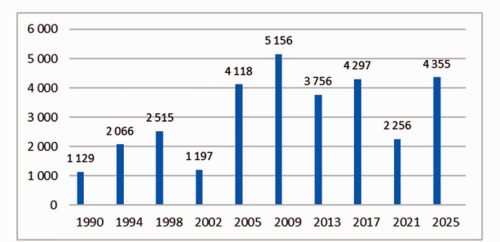
2. Tâche : devenir leader à gauche de l'Union
Selon les guides pertinents, la recette pour des campagnes électorales réussies est la suivante : vous avez besoin d'un parti qui apparaît uni vers l'extérieur, rayonnant ainsi de force, de stabilité et de vision ; une solidarité interne qui enthousiasme les membres et montre aux électeurs des personnes sympathiques ; un objectif clair de qui on veut mobiliser pour voter pour son propre parti ; un catalogue de revendications adapté à cet objectif, une vision d'une meilleure société et un récit de comment et pourquoi on atteindra réellement les préoccupations de ses propres partisans. Les candidats n'ont pas besoin d'être super charismatiques (Kohl, Merkel, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders - d'autres questions ?), mais crédibles. Cela inclut également un travail de relations publiques qui pénètre parce qu'il a un fil rouge reconnaissable, et qui peut s'appuyer non seulement sur des convictions, mais aussi sur des sentiments fondamentaux [5]. Pour un parti de gauche qui ne nage pas dans l'establishment, il est également nécessaire de pouvoir s'adresser directement aux gens : comme garantie d'entrer en conversation avec eux et comme moyen de convaincre ceux qui doutent.
Die Linke a tout fait correctement - assez fou - en 2025 [6]. Mais ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un travail acharné. Depuis le début de 2023, dans l'entourage des présidents Janine Wissler et Martin Schirdewan, encore dans les conditions de la scission du parti, le renouvellement du parti a été préparé, en juin 2023 « Notre Plan 25 : Retour d'une gauche forte » a été adopté. L'objectif était de clarifier le profil de contenu, d'unifier le parti, de régler les questions litigieuses de manière solidaire, de mettre davantage en avant l'utilité politique de Die Linke et d'ouvrir davantage le parti à la société et de recruter activement de nouveaux membres. Des ressources financières et humaines ont été mises à disposition, un « hub de renouvellement » a été créé au siège du parti. Dans la résolution du parti de l'été 2023, la phrase finale dit : « Nous rentrons souverainement au Bundestag. » C'est merveilleux quand un plan fonctionne. [7] Qu'il ait pu fonctionner était aussi dû au fait que des militants bénévoles lui ont donné vie, l'ont développé et l'ont rendu réel. La « Conférence sur l'avenir de la gauche », organisée par des membres à Berlin en septembre 2023, a également été importante à cet égard [8]. Des idées centrales pour le renouvellement du parti y ont été discutées - qu'est-ce qui fait partie du profil d'un parti socialiste moderne, que pouvons-nous apprendre, par exemple, des succès électoraux du KPÖ en Autriche ou du PTB en Belgique, quelle est l'importance de l'organisation et de la campagne électorale de porte-à-porte pour le parti, ou encore : comment fonctionne une politique de classe écologique ? Sous les cendres de l'ancien, quelque chose de nouveau a été créé.
La raison du succès aux élections fédérales est une interprétation flexible de la stratégie [9] consistant à mettre en avant les questions sociales, à s'adresser directement aux travailleurs et aux employés, et à faire de l'inégalité de classe un sujet offensif [10]. Cela a été discuté dans le parti sous « concentration thématique ». Dans l'interprétation flexible de cette stratégie, cependant, quelque chose d'autre est apparu : une sorte de politique de classe antifasciste que nous devrions développer davantage. Ou pour le dire autrement : la campagne électorale donne quelques indications sur le fait que et comment nous pouvons faire de notre parti un parti de gauche plus fort - avec l'objectif d'un parti populaire socialiste moderne [11].
Die Linke a réussi à construire une nouvelle coalition électorale composée de personnes plutôt jeunes, plus qualifiées, notamment d'employés et de chômeurs, qui vivent davantage à l'ouest qu'à l'est. Les questions sociales sont très importantes pour ces électeurs, mais les préoccupations concernant le climat/l'environnement et le développement de la démocratie préoccupent également une grande partie de cette coalition. Cette coalition d'électeurs est le résultat d'une campagne réussie et du choix stratégique fait par le parti. Mais c'est aussi la conséquence d'une situation politique exceptionnelle, de circonstances politiques particulières, qui ne resteront probablement pas les mêmes. Si Die Linke veut répéter son succès électoral, il doit développer sa stratégie - vers une politique de classe socialiste qui est antifasciste et écologique.
Die Linke doit faire avancer la reconstruction à l'est et à l'ouest de l'Allemagne, s'ancrer plus fortement à l'ouest et développer ses forces et renouveler ses fondements à l'est. L'ambition directrice doit être de briser la domination du SPD et des Verts dans l'espace politique du centre-gauche et de devenir lui-même leader. Les prochaines élections locales et régionales sont des étapes importantes à cet égard - même dans un certain nombre de villes d'Allemagne de l'ouest, compte tenu des résultats des élections fédérales, il n'est pas téméraire d'entrer sérieusement dans la course à la mairie. Tout cela est possible en raison de la situation politique et des lacunes politiques des deux partis concurrents d'une part, et de l'énorme afflux de membres depuis octobre/novembre 2024 d'autre part. Die Linke compte maintenant plus de 100 000 camarades - en quelques mois, un doublement. « Il s'agit en fait d'une refondation du parti : environ 60% (exactement : 59,9%) des membres de Die Linke ont rejoint depuis l'élection fédérale de 2021, plus de 50% depuis le départ de Wagenknecht. » [12] Die Linke a la possibilité de briser la domination du SPD et des Verts parmi les personnes socialement orientées et progressistes - mais cela ne peut réussir que si les obstacles politiques qui se dressent sur le chemin sont également abordés.
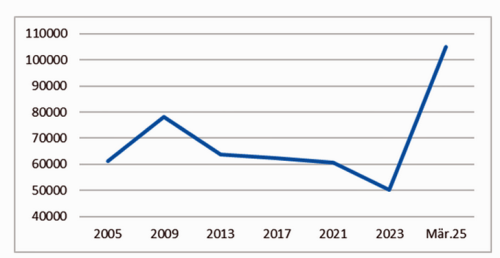
3. La composition sociale de l'électorat de gauche
Les partis n'ont jamais un électorat homogène, il s'agit généralement de coalitions d'électeurs de différentes classes, couches sociales ou milieux. Cela signifie toujours aussi : les électeurs de différentes couches n'ont pas nécessairement les mêmes préoccupations et intérêts, ils peuvent même parfois se contredire. La tâche d'un parti est toujours de construire une telle coalition, c'est-à-dire de faire de la politique au quotidien, dans les parlements et en public de manière à ce que les différentes préoccupations n'entrent pas en contradiction les unes avec les autres, mais obtiennent une perspective commune [13].
Die Linke, selon les données disponibles jusqu'à présent, a réussi à construire une coalition centre-bas composée de jeunes hautement qualifiés, de nombreux « employés » syndiqués et de chômeurs. D'un point de vue social (pas numérique), Die Linke est ainsi presque un parti populaire. Mais seulement presque. Les personnes d'âge moyen votent pour nous seulement dans la moyenne, les personnes âgées et les travailleurs (encore) en dessous de la moyenne.
L'électorat de gauche tend à être jeune [14]. 25% des 18-24 ans et 16% des 25-34 ans ont voté pour Die Linke, mais seulement 8% des 35-44 ans et 5% des 45-59 ans.

De plus, l'électorat de Die Linke est mieux qualifié et relativement également réparti sur les activités recensées dans les enquêtes électorales. 5% de ceux qui ont un certificat d'études secondaires ont voté pour Die Linke, 8% des diplômés du Realschule, 13% de ceux qui ont l'Abitur et 10% des diplômés universitaires.

Cela correspond à la direction du développement social : parmi les jeunes générations de 15-28 ans, environ 43% ont aujourd'hui l'Abitur et environ 31% un diplôme de Realschule. À l'inverse, cela signifie toutefois que Die Linke a obtenu de trop mauvais résultats parmi le groupe de jeunes qui ont socialement le plus de difficultés (en raison d'un diplôme d'études secondaires qui est de plus en plus dévalué). Il y a de la marge pour l'amélioration ici.
Parmi ceux qui se sont déclarés travailleurs, 8% lui ont donné leur voix, 9% des employés, 7% des indépendants, 5% des retraités et 13% des chômeurs. Parmi les membres des syndicats, Die Linke a légèrement mieux performé que la moyenne, 9,9% d'entre eux lui ont donné leur voix - moins que la moyenne de travailleurs syndiqués (7,8%), beaucoup plus que la moyenne d'employés syndiqués (parmi lesquels on pourrait supposer que se trouvent également des infirmières, du personnel de vente, etc.), ici c'était 12,3%.
À long terme, l'électorat s'est déplacé de l'est vers l'ouest de l'Allemagne. En 2002, environ 12% de toutes les voix que le PDS a pu gagner ont été exprimées en Allemagne de l'ouest (sans Berlin-Ouest). Des voix remportées en 2025, environ 70% ont été gagnées à l'ouest (sans Berlin-Ouest). En 2009, c'était environ 58%, en 2017 déjà environ 66%. On ne peut plus parler d'un parti de l'Est en 2025, même si proportionnellement plus de voix ont encore été gagnées à l'est qu'il n'y vivait proportionnellement (fin 2023, environ 15% de tous les Allemands vivaient en Allemagne de l'est, sans Berlin-Est). À Berlin, le PDS a gagné 11% de toutes ses voix en 2002, en 2025 c'était environ 9%. Le renouvellement du parti doit progresser à l'est comme à l'ouest. Les succès à l'ouest montrent : la chance d'un élargissement et d'un meilleur ancrage social de la base du parti à l'ouest est là.
Maintenant, il faut la saisir.
Que Die Linke ait pu construire une coalition électorale centre-bas, je voudrais enfin le montrer à l'aide de quelques impressions de la ville de Göttingen, que je connais le mieux. À Göttingen, nous avons gagné au total 17,6% des secondes voix et 13,5% des premières voix. Très provisoirement : grâce à divers moyens de campagne, mais surtout grâce à une campagne de porte-à-porte longue et intensive (plus de 10 000 portes sonnées), nous avons réussi à obtenir un très bon soutien non seulement des personnes plutôt académiquement qualifiées mais aussi des couches inférieures et moyennes-inférieures. Ceci est illustré ici uniquement à titre d'exemple à l'aide de quelques circonscriptions électorales. Pour éviter les malentendus : il s'agit simplement d'illustrer une tendance, pas d'une évaluation systématique [15].
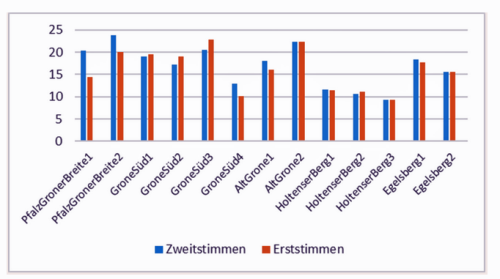
Grone Süd, par exemple, est un quartier fortement marqué par l'immigration, où il y a un local de gauche depuis l'automne de l'année dernière. Le Holtenser Berg est considéré comme un quartier relativement pauvre, où l'AfD est particulièrement forte (32-34%). Par rapport à la ville, nous avons certes moins bien performé dans ces trois circonscriptions, mais comparé au niveau fédéral, nous avons quand même fait nettement mieux que la moyenne. Dans toutes les circonscriptions représentées, nous avons mené des conversations de porte-à-porte, mais seulement une fois au Holtenser Berg. En comparaison, voici les valeurs encore plus élevées des circonscriptions avec des proportions plus élevées de personnes ayant une formation académique. Dans ces circonscriptions également, nous avons mené des conversations de porte-à-porte, mais nous avons pu aborder notamment les plus jeunes aussi par notre participation aux manifestations contre la droite.

4. Momentum pour Die Linke : qu'est-ce qui explique le succès ?
Les échecs sont toujours de la responsabilité des autres, les succès en revanche toujours de soi-même. C'est une règle empirique en politique. Les fonctionnaires responsables de Die Linke seraient bien avisés de l'oublier. En fait, une série de conditions se combinent pour expliquer pourquoi Die Linke a performé relativement bien. Certaines ont à voir avec la politique quotidienne et les décisions stratégiques (erronées) d'autres partis, mais beaucoup aussi avec les bonnes décisions et orientations au sein du parti lui-même. Et peut-être devrait-on noter à ce stade : c'était une course contre le temps perdu. Le BSW a poursuivi la destruction de Die Linke depuis l'intérieur jusqu'au dernier moment possible - ce n'est qu'en janvier 2024 que Wagenknecht et compagnie ont fondé leur propre parti, les dommages d'image pour Die Linke étaient presque totaux. La politique, c'est le temps. Et jusqu'aux élections européennes en juin, il manquait des mois précieux pour être perçu différemment dans l'opinion publique, que comme un navire échoué, comme divisé et en désaccord sur plusieurs questions politiques centrales. Cela aurait pu mal tourner - exactement comme les stratèges du BSW l'avaient calculé en vue des élections européennes et régionales.
Moins il restait de temps, plus il était difficile pour Die Linke de défendre de manière crédible des positions de gauche. Néanmoins, des orientations correctes ont été prises pendant cette période. Cela incluait l'orientation vers une campagne de renouvellement et de pré-élection de longue durée, qui a été lancée dès la fin de l'été 2023, cela incluait l'ouverture ciblée vers la gauche sociale et cela incluait le « renouvellement par le bas » dans de nombreux endroits. Et cela incluait le débat stratégique sur un nouveau récit de gauche, une conduite de campagne plus ciblée, un cadrage qui évoque le populisme de gauche et la nécessité d'élire une nouvelle direction du parti - non pas parce que l'ancienne aurait fait beaucoup d'erreurs (elle a fait beaucoup de choses correctement), mais parce que le renouveau a parfois besoin de nouveaux visages. Le fait que Janine Wissler et Martin Schirdewan aient initié cette transition fait également partie des conditions du succès actuel [16]. Die Linke est donc entré dans la course en décembre 2024 sous-estimé.
L'élection fédérale a été marquée par l'échec du gouvernement (hausses de prix/pertes de salaire réel, importance persistante des loyers élevés, échec de la transition climatique, réarmement dans le cadre de la guerre en Ukraine et de la nouvelle guerre froide-chaude), la chancellerie attendue de Friedrich Merz (pas de momentum qui aurait amené les électeurs vers le SPD et les Verts) et le soutien croissant à l'AfD (lié à des événements qui ont mis en conscience le danger de la droite : plans de « remigration » début 2024, vote commun de l'Union, du FDP et du BSW avec l'AfD). Parmi les conditions particulières figure certainement l'impopularité des candidats à la chancellerie : « Aucun n'a conquis le cœur des électeurs. Au contraire, tant les anciens que les nouveaux candidats ont dû faire face à de fortes réserves contre leur personne. » [17]
Pour Die Linke, une situation favorable s'est ainsi créée, qui a pu être utilisée grâce à une interprétation flexible de la campagne électorale. La campagne elle-même prévoyait essentiellement de traiter la question sociale et la division haut-bas, et de cette manière également en marge (« Si ton village est sous l'eau, les riches montent sur leur yacht ») d'aborder la catastrophe du réchauffement terrestre (il en était de même pour la question de la guerre et de la paix) - mais de prendre position sur d'autres questions. De cette façon, le parti a été en mesure de parler du problème de tous les problèmes dans le pays, de la répartition inégale des richesses, et de tous les déséquilibres et problèmes concrets qui en découlent pour les gens. Il est important dans ce contexte : selon l'ARD-Deutschlandtrend, début janvier, 77% des personnes interrogées voyaient dans les grandes différences entre riches et pauvres le plus grand problème pour la coexistence en Allemagne - ni les Verts ni le SPD, ni le BSW n'ont repris ce sentiment profond en intensifiant leur campagne. Ce furent des erreurs stratégiques qui ont largement laissé le champ politique à Die Linke à cet égard. Le traitement de la division sociale haut-bas a été bien complété par le récit, qui a été pratiquement soutenu par la campagne de porte-à-porte et l'action sur les coûts de chauffage, que Die Linke voulait faire de la politique différemment : en écoutant, en partant des gens et de leurs préoccupations quotidiennes : « Avec le programme qui veut sérieusement s'attaquer au capital et aux super-riches pour surmonter les crises de notre temps dans le cadre d'une transformation socio-écologique, il continue d'exister une caractéristique distinctive dans l'activité politique. » [18]
Mais cela ne rendait pas encore justice au moment politique à lui seul. Ce n'est que par le momentum antifasciste et antiraciste, qui est né avec l'élection de Trump aux États-Unis, la rupture de la coalition feu tricolore, par la domination des positions anti-migration et les projets de vote de la CDU avec l'AfD, que Die Linke est devenu en plus un projet attractif. On ne devrait pas se l'imaginer comme une connexion simple et directe (un événement → conséquence politique), mais plutôt comme l'émergence d'une atmosphère qui influençait la réflexion des gens. Les événements jouent néanmoins un rôle, car en eux et par eux quelque chose peut émerger qui était déjà né auparavant. C'est à de tels événements que s'enflamment alors les passions.
L'annonce et le vote du plan en 5 points de la CDU était un tel événement. La démarche de la CDU représente à la fois l'intensification du débat sur la migration et une frayeur antifasciste. Dans les enquêtes de l'institut de sondage Insa, Die Linke est passé lentement de 3 à 4% entre le 03.01.2025 et le 30.01. Cette bonne évolution était aussi une conséquence de la conduite de campagne sociale. Mais pas seulement. Un boost n'est venu qu'avec l'intensification de la politique migratoire et la polarisation antifasciste - avec Die Linke comme pôle le plus clair d'humanité, d'internationalisme et d'antifascisme. Le 24.01., Merz avait annoncé qu'il soumettrait les projets de la CDU au vote, le 30.01. ils ont été traités au parlement. Dans le sondage réalisé entre le 31.1 et le 03.02., Die Linke a grimpé pour la première fois à 5%, puis rapidement à 6 et 6,5% [19].

Que Die Linke soit devenu attractif dans ce contexte n'a été possible que parce que le parti ne s'est pas dérobé, mais a clairement pris position - à travers un cadrage et des récits qui n'étaient pas tout à fait réussis (car improvisés), mais néanmoins efficaces. Jan van Aken a clairement affiché sa position dans les talk-shows, Heidi Reichinnek a prononcé un excellent discours. Les deux ont été repris dans les médias sociaux et la presse et ont façonné notre impact extérieur. Die Linke était - et c'était déjà le cas dans les semaines précédentes, lorsque les intensifications dans le débat sur la migration augmentaient - dans l'opinion publique non seulement LE parti social qui attaquait les milliardaires et les millionnaires, mais aussi LE parti de l'asile et pro-migration. Cela avait aussi un côté mouvement, car dans de nombreux endroits peu après le vote Merz-AfD, le parti était une voix crédible dans les protestations locales. Qu'un positionnement clair antiraciste et en faveur des droits humains était important pour le succès électoral est au moins indiqué par les taux d'approbation élevés parmi les musulmans allemands. 29 pour cent ont voté pour Die Linke, probablement en raison de la position dans le débat polarisé sur la migration et de la critique claire des violations des droits humains et du droit international par le gouvernement israélien à Gaza [20].
Les deux doivent être considérés ensemble, la politique de distribution et sociale et l'antifascisme/antiracisme. On pourrait aussi dire : la connexion d'une politique de classe antifasciste explique le succès - d'une gauche qui a défendu son internationalisme sans complexes. Dans ce contexte, il est important de souligner comment cela s'est passé. La défense de normes minimales était au premier plan. Dans cette tempête, le parti a dû se passer de son propre concept d'immigration élaboré et d'un récit politique réfléchi.
La question climatique, en revanche, a joué un rôle un peu moindre dans le succès électoral - mais elle a joué un rôle. Cela se voit déjà lorsqu'on regarde qui sont en fait les nouveaux membres de Die Linke et ce qui leur importe. Au moins pour une bonne partie des nouveaux membres, on peut dire de manière pointue : des parties de l'aile gauche du mouvement climatique et ses partisans se sont de plus en plus approprié le parti au cours des deux dernières années - de manière explosive depuis novembre 2024. Cela devrait également représenter des orientations politiques dans les couches et milieux correspondants d'où viennent au moins une grande partie des nouveaux membres. La déception des Verts au gouvernement a permis de pénétrer dans ce spectre. Ces personnes ne resteront liées à Die Linke à long terme que s'il fait aussi une politique éco-gauche. En résumé, on peut dire : à partir de début janvier, le parti a de plus en plus représenté un populisme progressiste de gauche dans la mêlée, qui était très rouge, mais qui avait aussi un effet internationaliste vers l'extérieur - et vert sur les parties politisées de la jeune génération, qui s'informent bien, qui étaient actives dans le mouvement climatique ou le soutenaient.
5. Préoccupations et inquiétudes des électeurs de gauche
Cela s'exprime également dans les préoccupations et les inquiétudes de ceux qui ont voté pour Die Linke. Interrogés sur ce qui avait été décisif pour leur vote, 51% des électeurs de gauche ont indiqué la sécurité sociale, 18% le climat + l'environnement, 9% la sécurité intérieure et 8% la préservation de la paix. Interrogés sur leurs plus grandes préoccupations personnelles, l'image était différente :
84% se préoccupaient que la démocratie et l'État de droit soient en danger ;
82% que le changement climatique détruise notre base de vie ;
72% se préoccupaient que l'influence de la Russie sur l'Europe continue d'augmenter ;
72% se préoccupaient que « nous » soyons livrés sans défense à Poutine et Trump ;
60% étaient préoccupés par les problèmes d'argent au quotidien ;
60% par les fortes hausses de prix, rendant impossible le paiement des factures.
Ces valeurs expriment, à mon avis, l'importance de la politique climatique et de la défense de la démocratie pour l'électorat de gauche - et pour les potentiels futurs partisans de Die Linke : Car pour 91% des électeurs des Verts, la politique climatique est très importante, mais aussi pour 76% des électeurs du SPD. 64% de nos électeurs estimaient qu'on n'en faisait pas assez pour la protection du climat, ce qui était le cas pour 55% des électeurs du SPD, 80% des électeurs des Verts et même 24% des électeurs du BSW.
Les inquiétudes concernant Trump et Poutine devraient également être interprétées principalement comme l'expression d'une attitude démocratique fondamentale, les deux étant des figures proéminentes de la nouvelle internationale des droites autoritaires dans l'opinion publique. Si l'attitude démocratique antifasciste fondamentale qui s'y dessine est un point d'ancrage pour Die Linke, les inquiétudes et sentiments de menace sont un défi. Car il n'existe tout simplement pas actuellement de concept de sécurité et de défense de gauche élaboré qui pourrait être considéré comme faisant partie d'une politique de détente convaincante pour notre époque, pour répondre à ces préoccupations. Il est seulement clair que la politique d'un parti de la liberté, qu'est Die Linke, « (...) ne peut pas consister à se soumettre à un prétendu 'réalisme' apologétique qui laisse les grandes puissances géopolitiques se partager des sphères d'influence entre elles au mépris du droit international et de la souveraineté populaire. » [21] Une politique de sécurité de gauche convaincante n'en découle pas encore. Ce talon d'Achille a également été reconnu par les Verts et le SPD : une bonne partie notamment des plus jeunes a voté pour Die Linke (cela vaut déjà pour beaucoup de ses nouveaux membres) malgré les positions en matière de politique de paix et étrangère qui lui sont attribuées, pas à cause de celles-ci.
6. L'importance de la campagne de base
Le populisme de gauche de la campagne électorale de gauche était rebelle et il était - et c'est important - engageant, parce que les visages du parti semblaient chaleureux, énergiques, crédibles et intelligents. Mais cela n'a été possible que parce que d'importantes décisions politiques organisationnelles avaient été prises. Cela inclut l'amélioration du travail sur les médias sociaux - on a déjà beaucoup écrit et dit sur TikTok [22], mais cela vaut pour la stratégie de communication publique dans son ensemble, dans laquelle un récit de base (Nous contre ceux d'en haut, pour les travailleurs, etc.) a été maintenu.
Au moins aussi important est le fait que dans le cadre d'une campagne de porte-à-porte, une véritable mobilisation de base a eu lieu dans de nombreux endroits. Trois choses ont été, à mon avis, décisives. Premièrement, depuis septembre, des essaims de militants électoraux d'abord petits, puis croissants, sont effectivement allés de porte en porte dans de nombreux endroits. Ils ont pu atteindre également ceux qui voulaient se détourner par frustration, qui hésitaient ou même - cela est également arrivé à plusieurs reprises au moins à Göttingen - qui voulaient en fait voter pour le BSW ou l'AfD. L'impact de cette campagne sur les résultats électoraux globaux (pour les mandats directs, c'est clair) doit encore être systématiquement évalué. Il y avait plusieurs, même grandes, associations de district où il n'y a pas eu de campagne de porte-à-porte et où pourtant de très bons résultats électoraux ont été obtenus. Un exemple de Basse-Saxe est la ville d'Oldenburg. Mais pour Göttingen, on peut dire : là où la campagne de porte-à-porte a été menée, on a réussi à obtenir de fortes augmentations de voix même dans les quartiers où vivent des personnes à faibles revenus. Deuxièmement, en raison de la campagne de base, une dynamique s'est créée au niveau local, permettant également de mieux réaliser d'autres formes de campagne active (distribution de tracts, stands d'information, fêtes électorales...). Les conversations de porte-à-porte étaient par exemple à Göttingen l'axe central de la campagne, environ 120 personnes y ont participé - à des degrés très divers. Cela a créé une atmosphère de renouveau général. Dans ce contexte, nous avons pu distribuer nos matériels d'information dans toute la ville et aussi dans certaines parties de la grande partie rurale de notre circonscription - d'après les retours de nombreux citoyens dans la conversation (certes, une base très subjective pour l'évaluer), une incitation à s'occuper de nos positions et du parti. Cela vaut expressément pour les hésitants qui se demandaient s'ils devaient voter SPD, Verts ou Linke. Et troisièmement, grâce à la campagne de base active, les nouveaux membres ont pu se voir proposer directement une occasion de participer. Il ne faut pas sous-estimer la nouvelle image que Die Linke a donnée vers l'extérieur grâce à des milliers de membres de base actifs : un parti actif qui s'intéresse vraiment aux gens et à leurs préoccupations.
De cette manière, on a réussi à gagner des électeurs tant des deux partis du centre-gauche que du spectre des non-votants. Die Linke a surtout gagné des électeurs des Verts et du SPD. Sur les 1,45 million de voix perdues par les Verts, près de la moitié est allée à Die Linke. Cela montre aussi : Die Linke a réussi en tant que parti vert de gauche. En même temps, il a perdu vers la droite : toujours 110 000 voix à l'AfD et 350 000 au BSW social-autoritaire. Certainement une partie des partants aurait souhaité une politique étrangère moins critique envers la Russie - une autre partie a probablement été attirée par le virage à droite du BSW dans la politique sociale et environnementale. Au total, l'électorat de Die Linke en 2025 après ce petit « échange » devrait également penser de manière plus progressiste sur ces questions que par le passé.
Une stratégie visant principalement à gagner des électeurs déçus des Verts n'a jamais existé dans Die Linke au cours des dernières années. Cependant, cela a été affirmé à plusieurs reprises par des critiques de la direction du parti, notamment l'année dernière - avec l'indication que cette stratégie avait échoué, que les électeurs des Verts ne pouvaient pas ou à peine être gagnés. Lors de l'élection fédérale, c'est précisément ce que Die Linke a particulièrement bien réussi à faire. Les gains de voix sont considérables. Mais c'est seulement en combinaison avec les gains du SPD et du spectre des non-votants qu'ils ont assuré le succès.
En 2025 également, il était vrai que : la participation électorale était la plus faible là où vivent les personnes à faibles revenus et à faible niveau d'éducation formelle [23]. Sur les gains que Die Linke a pu réaliser par rapport à 2021 (seules les voix gagnées sont considérées), les gains des Verts représentaient environ 41%, ceux du SPD 33%, du spectre des non-votants 17% [24]. C'est décisif pour le futur débat stratégique. Il doit s'agir de briser la domination résiduelle du SPD et des Verts dans le camp de centre-gauche, d'une part en continuant à s'adresser à leur « électorat à tendance de gauche », d'autre part en atteignant les non-votants et en abordant les préoccupations sociales des parties non fermement de droite de l'électorat de l'AfD. Pour rappel : parmi les non-votants, on trouve une proportion supérieure à la moyenne de personnes à faibles revenus, de personnes âgées et de travailleurs qui se sentent abandonnés par la politique dominante.
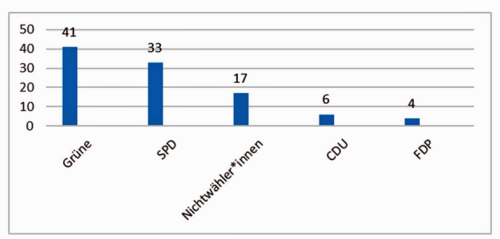
7. Conclusions stratégiques - Projet 15%
La nouvelle situation - probablement une nouvelle édition de la grande coalition (mais avec un partenaire junior SPD) - offre beaucoup d'espace à une opposition clairement de gauche. Cependant, les Verts se repositionneront également dans l'opposition, en s'ouvrant socialement vers la gauche - comme ils l'ont déjà fait par le passé. Et au vu des résultats des sondages, on peut s'attendre à un réarmement supplémentaire d'une ampleur ouverte (le frein à l'endettement ne devrait être ouvert que pour le secteur de la défense), malgré environ 50 milliards par an d'investissements dans les infrastructures (500 milliards de patrimoine spécial sur 10 ans), dans le meilleur des cas un statu quo social, plutôt des détériorations et un mécontentement accru dans ce qui reste des milieux électoraux sociaux-démocrates. Cela signifie également que les causes fondamentales des succès de l'AfD persisteront.
Dans ce contexte, il est important pour Die Linke de traiter ses propres faiblesses et contradictions, et de tirer des conclusions stratégiques qui lui permettent réellement de devenir la force dominante dans le spectre du centre-gauche. On n'est pas forcément dominant parce qu'on gagne le plus de voix - on peut aussi être dominant parce qu'on s'assure le plus fort soutien politique réel de la société civile active et qu'on fait des propositions dans les confrontations sociales auxquelles les autres doivent réagir. Nous sommes hégémoniques lorsque les autres portent nos idées sur leurs lèvres, ne serait-ce que pour les nier.
Face au SPD et aux Verts, une double stratégie est donc nécessaire : par une confrontation dure et une critique, Die Linke doit clairement faire valoir sa propre utilité politique (pourquoi soutenir Die Linke, pas le SPD et les Verts ?) et s'adresser à ceux qui ont déjà été politiquement abandonnés par les deux partis. À cet égard, une ligne de démarcation stratégique est nécessaire, qui est tracée clairement et distinctement. Mais cela seul serait insuffisant, car aucune perspective de mise en œuvre n'est ainsi ouverte pour ses propres propositions. Et parce que les points communs qui existent entre Die Linke, le SPD et les Verts, au moins sur le papier, sont occultés - et là où les sociaux-démocrates, les Verts et Die Linke travaillent ensemble dans des alliances, des syndicats et des conseils d'entreprise/de personnel, des mouvements ou des initiatives. La ligne de démarcation doit donc être complétée par des offres de coopération, qui sont sincèrement destinées à mettre en œuvre des améliorations concrètes.
Dans ce qui suit, je vais maintenant tirer quelques conclusions stratégiques pour esquisser le projet d'une politique de classe populiste de gauche, antifasciste et écologique, qui pourrait aider à faire de Die Linke le pôle fort dans la lutte entre partis. C'est la condition préalable pour arrêter également l'influence croissante de l'AfD parmi les travailleurs et les employés simples et pour reconquérir du terrain politique. Car une chose est également claire : si Die Linke veut changer les rapports de majorité dans le pays, il doit briser l'influence de l'AfD dans les couches à faibles revenus. Pour cela, une considération sobre des partisans de l'AfD est nécessaire, distinguant entre les racistes et xénophobes d'une part et les personnes d'autre part qui s'approprient une idéologie de bouc émissaire pour traiter des expériences sociales et politiques douloureuses, mais qui ne sont pas fermement de droite. La taille respective de ces deux parties est controversée. En tant que « gauche de classe sans complexes », Die Linke doit essayer d'atteindre ces derniers. À cet égard, il est particulièrement vrai que : cela ne sert à rien de cacher son propre internationalisme et ses propres convictions écologiques. Il s'agit plutôt d'aborder honnêtement les intérêts sociaux des électeurs de l'AfD et de les convaincre - véridiquement - que l'adversaire ne vient pas vers nous dans des canots pneumatiques, mais vole en jet privé. Pour pouvoir le faire, il est conseillé d'évaluer les expériences avec un travail politique organisateur et de soutien, par exemple dans les quartiers (voir ci-dessous) et de continuer, et en même temps de saisir un malaise politique répandu concernant le pouvoir des entreprises et des lobbies.
Die Linke comme moteur de la démocratisation : Une caractéristique politique fondamentale de notre époque est le double malaise concernant la démocratie. Par cela, j'entends d'une part la peur de la fascisation et du virage à droite, d'autre part la critique du pouvoir des lobbies et des entreprises, qui est largement répandue dans la population, en particulier aussi chez les non-votants. Un sentiment plus répandu est qu'on a été oublié par l'establishment politique. Die Linke a abordé les deux dans la campagne électorale, d'une part avec l'ambition de « vouloir faire de la politique différemment », d'autre part par la position clairement antifasciste. Ce double malaise politique concernant la démocratie peut être abordé par un populisme de gauche centré sur la démocratie : il s'agit pour nous de l'égalité et de la dignité égale de tous les citoyens et de la construction d'une véritable démocratie sociale, dans laquelle les revendications d'égalité sont également réalisées. Ce républicanisme de gauche comprend également - en tant que républicanisme économique - la promotion de l'extension de la décision démocratique commune aux affaires économiques. Un tel populisme de gauche est exigeant, car la peur de la fascisation peut renforcer la tendance chez les gens à « défendre la démocratie en soi » et à exiger l'union de tous les démocrates. Le récit démocratique de gauche doit être, à mon avis, antifasciste et républicain en ce sens, et en même temps attaquer la politique détachée dans l'intérêt de la classe des milliardaires et des millionnaires [25] - au nom de l'égalité sociale et de la liberté des employés dépendants. Le parti a besoin d'un récit élaboré. Celui-ci doit être organisé autour d'exemples quotidiens et ouvrir une vision démocratique : à quoi ressemblerait un pays plus démocratique ? Et surtout, un débat sérieux sur la stratégie antifasciste est nécessaire. La politique économique et sociale de gauche est importante, sans question. Mais l'antifascisme de gauche ne peut pas non plus être réduit à cela.
Politique pour les familles qui travaillent : C'est très bien que Die Linke soit devenu le parti des jeunes électeurs. Un parti socialiste qui ne peut pas gagner les jeunes a un problème. Il faut s'appuyer sur ces succès pour les développer. Mais c'est aussi un défi dans la mesure où les jeunes sont depuis longtemps minoritaires par rapport aux plus âgés en Allemagne. Les 18-24 ans ne comptaient que 6,15 millions de personnes fin 2023, y compris les non-citoyens. Cela ne représentait qu'environ 7% de toutes les personnes vivant en Allemagne. À titre de comparaison : rien que ceux qui avaient 82 ans ou plus représentaient 6% de la population fin 2023. Les 60-65 ans entiers 9%. Pour rappel : parmi les 35-44 ans, Die Linke n'a atteint « que » 8%, parmi les 45-59 ans 5% et parmi les 60+ 4%. Parmi les 25-34 ans, 14% ont voté pour Die Linke. C'est une très bonne situation de départ pour lutter en particulier dans le spectre des 25-45 ans pour du terrain politique. Pour y parvenir, Die Linke devrait davantage s'adresser aux « familles qui travaillent » et aborder de manière encore plus ciblée leurs préoccupations et leurs besoins. Il est tout à fait juste que Die Linke a toujours été en faveur d'une politique familiale sociale, la majorité de ses propositions (par exemple dans la politique éducative et sociale) permet aux familles de vivre mieux. Cela inclut par exemple le développement étendu d'offres de garde, d'éducation et de soutien [26]. Mais dans son travail public et dans ses récits politiques, les familles sont pratiquement absentes. Die Linke laisse ce paysage émotionnel aux conservateurs, aux sociaux-démocrates et à la droite. La raison est claire. D'une part, les familles sont aussi des lieux de contrainte et de non-liberté, d'autre part, Die Linke ne veut pas exclure d'autres modèles de vie. Mais les familles sont aussi des lieux d'amour, de travail de soin (partagé) et de reproduction, dans les bonnes familles d'esprit communautaire. Ce monde du soin est principalement le monde des 25-50 ans - et c'est à eux que Die Linke devrait s'adresser politiquement. « La politique pour les familles qui travaillent » permettrait en même temps de faire à nouveau plus fortement le lien avec des problèmes comme la pauvreté des personnes âgées, la politique des retraites et les soins : des problèmes sociaux qui sont particulièrement importants pour ceux qui ont le moins voté à gauche, pour les plus de 60 ans.
Mobilisation de classe et stratégie pour les non-votants : Plus les revenus et les niveaux d'éducation formelle sont bas, plus la participation électorale est faible. Les non-votants ne sont évidemment pas un groupe uniforme, il y a des raisons très différentes pour lesquelles les gens ne votent pas. Une raison est que des personnes qui ont en fait des revendications et des exigences de gauche ont été déçues à plusieurs reprises et ne se sentaient/sentent plus représentées. Cette démobilisation est un garant de succès pour les autres partis - d'autant plus que l'AfD réussit à motiver les non-votants de droite à voter. Die Linke a maintenant également gagné un soutien considérable de la part des non-votants. Cette stratégie pour les non-votants doit être développée afin de pouvoir gagner de manière encore plus ciblée des parties frustrées ou politiquement hésitantes, en particulier des classes ouvrières inférieures et moyennes. La large campagne de base et de porte-à-porte a montré comment le faire : aller vers les gens pour discuter, car la frustration et l'indécision politique ne peuvent être mieux abordées que par la conversation directe. Mais il faut plus. L'approche d'une « politique de gauche organisatrice » qui se cache derrière les conversations de porte-à-porte doit être davantage transmise et diffusée. Car d'une part, Die Linke ne voulait pas seulement enthousiasmer ses interlocuteurs pour qu'ils votent pour lui, mais aussi les inviter à participer. D'autre part, la conversation avec les citoyens n'était que la partie visible d'un iceberg. La partie invisible a toujours été le travail d'organisation, d'activation et de renforcement des capacités en arrière-plan, par lequel plus de personnes sont invitées et soutenues pour s'impliquer dans le travail actif du parti. En ce sens, Die Linke doit continuer à transmettre les connaissances d'organisation [27], il a besoin de milliers d'organisateurs de gauche dans le parti pour lutter encore plus efficacement pour ceux qui se sont détournés.
Il est important dans ce contexte que le parti, en tant que foyer, doit offrir à tous un lieu et aussi des possibilités de participation. Cela signifie que les campagnes de base et le travail de base doivent également inviter des personnes qui n'ont peut-être que 2 heures par mois à consacrer au parti. Die Linke a besoin d'organisateurs, il a besoin d'activistes et il a besoin d'une offre diversifiée de participation pour ceux qui ont moins de temps.
Politique de classe internationaliste : La campagne pour les élections fédérales a montré que Die Linke ne peut pas choisir les questions auxquelles il doit répondre en public. Cela n'aide pas non plus de cacher ses propres réponses ou de les atténuer. Les opposants politiques vont toujours et encore jeter les positions de Die Linke à la figure. À la télévision, dans les médias sociaux et dans la campagne électorale de rue. Cela vaut pour tous les sujets, mais surtout pour le thème de l'asile et de l'immigration. Pour Die Linke, qui veut être le parti des classes laborieuses, c'est un sujet important déjà parce qu'une grande partie de la classe ouvrière peut aujourd'hui se prévaloir de sa propre histoire d'immigration. Il y a des domaines de l'économie allemande - l'industrie de la viande est l'exemple le plus connu, mais cela vaut aussi pour des parties de la logistique d'entrepôt, des soins ou de la restauration rapide - où aujourd'hui rien ne fonctionne plus sans les migrants de travail et les réfugiés. La diabolisation des immigrants est une partie fixe et centrale des stratégies conservatrices et (post-)fascistes pour être majoritaires. La politique anti-migration va rester. On ne peut pas l'occulter, car la politique de classe socialiste doit essayer de surmonter la division de la classe ouvrière. La seule voie praticable est d'y faire face avec confiance et préparation. Cela signifie : pour gagner davantage de terrain politique, Die Linke doit systématiquement lier son récit de classe sociale à un récit « pro-migrant ». Il s'agirait d'un récit de classe multiculturel qui s'adresse aux personnes qui viennent en Allemagne et les rend visibles comme faisant partie des classes laborieuses, qui ne nie pas les défis qui naissent aussi de l'immigration, mais les aborde et présente ses propres propositions de solutions - et qui souligne son propre internationalisme et ne le cache pas timidement. Mais cela signifie aussi : la façon dont on parle de l'immigration et des personnes immigrées n'est pas indifférente - il s'agit d'un cadrage de classe multiculturel et pro-migrant ciblé, dont Die Linke ne dispose pas. Cela devrait être politiquement soutenu par ses propres propositions pour un concept d'immigration de gauche. C'est aussi crucial parce que l'immigration sur les marchés du travail sera un sujet important à l'avenir - simplement et simplement parce que les entreprises demandent une main-d'œuvre qualifiée appropriée. L'Agence fédérale pour l'emploi suppose que rien que jusqu'en 2025, 400 000 travailleurs supplémentaires de l'étranger seront nécessaires chaque année.
Politique de classe écologique : La crise climatique est une crise sociale, la question climatique a toujours été une question de classe. Son développement façonnera nos vies et nous devons tout faire pour empêcher le pire. Un changement fondamental de direction est nécessaire, même une rupture profonde dans les modes de production et de vie, pour laquelle nous devons gagner des majorités. Mais la « question climatique » est également décisive sur le plan électoral stratégique, car elle est très importante pour de grandes parties du spectre d'électeurs de centre-gauche. Les Verts dans l'opposition tenteront à nouveau de se positionner comme un parti climatique crédible - les électeurs que Die Linke a gagnés d'eux (tout de même 41 pour cent des gains purs) pourraient aussi changer à nouveau. Si le parti veut les garder et atteindre les parties de l'électorat du SPD (plus de 50 pour cent) qui pensent que la politique climatique actuelle n'est pas suffisante, il doit continuer à se profiler comme un parti climatique social. Cela inclut, outre de bons concepts, un récit climatopopuliste plus offensif, comme il figurait déjà dans la campagne électorale, mais qui doit être développé davantage : dans cette politique de classe-climat, il s'agit de la responsabilité des riches pour le financement de la conversion écologique, de mesures vraiment efficaces, de la participation démocratique des travailleurs aux décisions, et de la protection et la sécurité de toutes les personnes ordinaires.
Réponses au dilemme du gouvernement : Die Linke a profité cette fois d'une situation particulière. Il était clair que ni le SPD, ni les Verts n'avaient une chance de fournir le chancelier. Le changement vers un gouvernement dirigé par la CDU était certain. Dans cette situation, contrairement à 2021, aucun sentiment de changement social vers un autre gouvernement n'est apparu. Ainsi, il était « simple » pour Die Linke de se positionner comme opposition. Même ceux qui souhaitent un gouvernement progressiste avaient relativement facile à nous élire comme parti d'opposition. Cette situation confortable pourrait être terminée dès les prochaines élections fédérales. C'est pourquoi il faut trouver une réponse à la future question de savoir pourquoi les gens devraient voter à gauche si le parti n'est pas disponible pour un changement de gouvernement. Bref : Die Linke a besoin d'un récit radical-réformiste bien pensé qui puisse s'adresser à ceux qui veulent un meilleur gouvernement, et à ceux qui souhaitent l'opposition. Si Die Linke veut croître, il doit s'adresser à tous ceux qui, dans le doute, voteraient autrement pour ceux qui gouverneront (c'était en soi une attaque bien réfléchie des Verts dans la dernière semaine de campagne, qui n'a fonctionné que parce que les Verts avaient massivement déçu les électeurs, signalaient trop de disposition à la coalition avec l'Union et Habeck était loin des chances de devenir chancelier). Die Linke n'a pas et n'avait pas un tel récit. En 2021, par exemple, le slogan avancé qu'il œuvrerait pour des « majorités au-delà de la CDU » n'était pas une publicité pour Die Linke. « CDU hors du gouvernement » était traduit par de nombreux électeurs pour eux-mêmes comme : alors autant voter directement pour les Verts ou le SPD.
Politique de sécurité de gauche et une nouvelle politique de détente : Un grand talon d'Achille du succès électoral de la gauche est la politique étrangère. Dans une plus grande partie de la société, les préoccupations concernant les États autoritaires et agressifs se propagent - aussi parmi ceux dont les cœurs battent pour une république socialement juste et plus démocratique. Ce qui est donc crucial, ce n'est pas seulement quelles connaissances et justes perspectives les gauches ont sur la politique mondiale, mais comment elles réagissent de manière convaincante à ces préoccupations. Les valeurs d'Infratest-Dimap présentées ci-dessus illustrent le problème pour le nouvel électorat. Mais la situation n'est pas différente chez les partisans des Verts et du SPD. Le parti devra y faire face rapidement, car le SPD et les Verts attaquent exactement là. Il est également vrai, cependant : les peurs d'escalade militaire se propagent également - et à en juger par ce qu'on entend des politiciens de l'Union aux Verts, ce n'est pas sans raison.
Des dernières campagnes électorales (élections régionales 2022 et élections européennes 2024, ainsi que la campagne pour les élections fédérales), j'ai néanmoins eu la forte impression qu'une partie notable de l'électorat vote pour Die Linke malgré les réponses précédentes, pas à cause de ces réponses. Cela n'a pas besoin d'être le cas dans le nouveau monde multipolaire, où l'OTAN est également de facto remise en question par les États-Unis de Trump, et plusieurs États et blocs d'États autoritaires entrent en conflit les uns avec les autres [28]. Les réponses de politique de sécurité des autres partis sont à tout prix étroitement axées sur des réactions militaires et l'exploitation militaire future des espaces d'influence et des matières premières. C'est une politique offensive d'insécurité. La politique de sécurité de gauche doit d'abord et avant tout demander du sens de la réalité et insister pour réduire les insécurités et éviter les conflits violents, pour miser d'abord sur des solutions civiles - en partant d'une propre politique de défense coopérative qui est structurellement orientée vers la défense. Il est crucial d'élaborer sérieusement une telle politique de défense et d'adopter une attitude qui ne laisse aucun doute sur le fait que Die Linke défend la liberté et la démocratie dans un monde où les puissances impériales foulent aux pieds le droit international.
Pour les débats quotidiens, il faut d'abord de la confiance en soi : la valeur de la gauche est « qu'il y ait au moins une voix au Bundestag qui ne marche pas simplement au pas, mais qui remet en question la renaissance du militaire. Sans être naïve ou volontairement - comme les partis du Kremlin AfD et BSW - ignorer la menace réelle de l'ordre européen par la Russie de Poutine. » [29] C'est précisément pour cette raison que le parti doit travailler à un concept convaincant de politique de détente - ce n'est qu'alors qu'il pourra gagner plus de soutien pour le non au réarmement et à la militarisation. Il serait conseillé de partir tant des questions et préoccupations des gens du pays que des bouleversements dans le monde. Die Linke pourrait même être pionnier ici. Car les États-Unis sous Trump semblent vouloir laisser peu de la soi-disant « communauté de valeurs occidentale », les anciens systèmes d'alliance peuvent déjà sembler dépassés en très peu de temps, la fidélité dans les centres du SPD, du FDP et de l'Union envers Washington peut devenir une pose absurde. La tâche de la gauche serait de formuler une politique anti-impérialiste à la hauteur du temps - à laquelle doit également appartenir comment la sécurité et l'autodétermination démocratique peuvent être préservées face aux grandes puissances qui - qu'il s'agisse de l'Ukraine ou du Groenland - prétendent pouvoir déplacer les frontières. Le concept social-démocrate de politique de détente, auquel beaucoup dans la gauche aiment se référer, reposait toujours sur deux piliers. Il serait à développer davantage à partir d'une perspective socialiste de gauche. Un pilier était de miser sur la diplomatie et le « changement par le rapprochement », c'est-à-dire de réduire les tensions et de permettre des progrès démocratiques dans les pays partenaires de la politique de détente par plus d'échanges avec eux. Le deuxième pilier était l'idée d'une défense structurellement défensive. Les deux formaient une unité - et la question serait de savoir à quoi ressemblerait exactement une bonne défense aujourd'hui, sans participer à la course aux armements qui augmentera encore les tensions et les insécurités.
8. Pour conclure : le choix stratégique
Die Linke a réalisé un retour impressionnant qui a surpris de nombreux commentateurs et observateurs. Beaucoup ont négligé les orientations correctes qui avaient été prises dans le parti depuis le début de 2023. À l'été 2023, elles ont abouti au dit « Plan 25 ». Avec cela, Die Linke a commencé à travailler stratégiquement à son renouvellement. Par conséquent, il n'est pas entré dans la course à

Europe de la défense : qu’en pense la gauche ?

À cinq hommes et femmes politiques, nous avons posé la question suivante : que penser d'une défense européenne à l'heure de la montée du fascisme sur le continent et de la progression des pays gouvernés par l'extrême droite dans l'Union européenne ?
7 mars 2025 | ltiré de regards.fr
https://regards.fr/europe-de-la-defense-quen-pense-la-gauche/
Aurélien Saintoul, député LFI, membre de la commission de défense nationale et des forces armées : « Le projet de défense commune ne répond pas aux vrais problèmes »
La question de la défense est d'abord une question de souveraineté. La souveraineté étant liée au peuple, il faudrait se demander s'il existe une souveraineté populaire européenne. Bien sûr que non puisqu'il y a plusieurs peuples au sein de notre continent. Donc il y a déjà un problème de principe. Ensuite, il faut aussi se poser les questions concrètes qu'entrainerait cette « défense commune européenne » : qui pour la commander ? Quels États pourraient décider de l'engager ? Et au service de quels intérêts cette défense commune pourrait être utilisée ? Les dirigeants fascistes et assimilés n'ont évidemment pas les mêmes intérêts que les gouvernants démocrates. Il ne faut pas oublier cette constante : les fascistes ne respectent pas le droit. Pourquoi voudraient-ils mobiliser une défense européenne ? Pour lutter contre l'immigration ? Quels genres de relations envisagent ces forces fascistes avec les régimes autoritaires comme la Russie ou d'autres pays dirigés par l'extrême droite comme les Etats-Unis ? Giorgia Meloni n'a pas dit un mot après l'humiliation de Volodymyr Zelensky par Donald Trump et l'Italie a contracté avec Starlink pour 1,5 milliard d'euros…
Les annonces faites par Emmanuel Macron qui rêve de cette « défense commune européenne », c'est surtout un affichage. Il cherche à montrer qu'il fait encore des choses, il veut détourner l'opinion publique de son mandat national. C'est de la poudre aux yeux. Il dit vouloir un « réveil stratégique » au regard de la ligne politique conduite par Donald Trump sur le champ international. Mais comme la plupart de nos partenaires, la France est incapable d'agir en dehors de l'influence américaine. On a accepté de former des pilotes de chasse en partie aux États-Unis, on a du matériel de renseignement américain, on a des catapultes du Charles de Gaulle qui sont américaines, on est dépendant du pétrole américain qui est notre premier fournisseur. Et la France n'est pas le seul pays européen à connaître cette situation. Ce projet de « défense commune » ne répond pas aux vrais problèmes comme, par exemple, les capacités de production européenne qui sont à leur limite aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à satisfaire les demandes des Ukrainiens. Il faut donc mettre sur pied un programme de prise d'indépendance qui prendra des mois et des années. Dans quel calendrier peut-on le faire ? Et quels sont les pays européens qui voudront vraiment prendre leur essor indépendamment de la tutelle américaine ?
Ilaria Salis, eurodéputée italienne, membre de la GUE : « Il faut un contrôle collectif et démocratique des infrastructures et des ressources destinées à la défense »
Face à l'alliance qui s'est nouée entre les puissances impérialistes américaine et russe, ce qui était déjà nécessaire auparavant devient aujourd'hui une urgence. Depuis plus de deux ans maintenant, l'est du continent européen est attaqué par la Russie et ses alliés ; depuis quelques semaines, c'est le Groenland, une province danoise, qui est directement menacé par les États-Unis. Dans cette situation de montée des périls, nous ne pouvons pas céder à la logique du « deal » que Trump et ses affidés libertariens tentent d'imposer sur la scène internationale au détriment du principe d'autodétermination des peuples, comme le voudraient les partis européens d'extrême droite.
Mais nous ne devons pas non plus nous lancer dans une course aveugle aux armements qui, en l'état actuel des choses, ne ferait que nourrir une industrie militaire livrée à elle-même, et renforcer en fin de compte les logiques impérialistes déjà à l'œuvre. Il est donc temps d'imaginer à gauche et de construire d'en bas un nouvel ordre international, cohérent avec nos principes et valeurs : l'internationalisme, le multilatéralisme et la paix dans la justice. Mais cela signifie aussi œuvrer en faisant preuve d'intelligence stratégique, en étant conscients des compromis nécessaires et du caractère processuel du chemin qui peut nous mener à une paix durable.
Pour ce faire, il faut avant en premier lieu rompre le lien historique de subordination aux États-Unis et affirmer une véritable autonomie. Washington ne traite pas l'Europe comme un allié à part entière, mais comme un vassal. Rester dans l'OTAN — surtout sous la direction de Trump — signifie renoncer à sa liberté de décision et d'action, en acceptant un rôle subalterne plutôt que d'agir en tant qu'acteurs indépendants sur la scène mondiale. Nous devons pour cela prendre pour modèle des États-membres comme l'Autriche et l'Irlande, qui se sont historiquement tenus à une stricte neutralité et au refus de l'implantation de toute base étrangère sur leur territoire. Afin de conquérir notre autonomie stratégique contre les puissances impérialistes, mais aussi pour contrer les nationalismes souverainistes en Europe et les conflits continentaux qu'ils sont toujours capables de provoquer, une intégration de la défense à l'échelle communautaire est nécessaire. Cette option — comme l'existence même de toute armée — représente hélas un mal nécessaire, du moins dans la phase actuelle. La forme qu'elle doit prendre est toutefois indissociable du niveau d'intégration politique et institutionnelle que l'Europe parviendra à atteindre.
Une armée européenne à part entière serait certes la solution la plus à même d'empêcher des conflits entre États-membres ou des initiatives militaires hasardeuses en dehors du continent de la part de certains d'entre eux. Mais elle semble difficilement concevable si les quelques États-membres qui aspirent non pas à l'autonomie du continent, mais à intégrer pleinement l'alliance impérialiste USA-Russie, sont en mesure de bloquer tout processus décisif depuis l'intérieur du Conseil européen. En cela, la question rejoint une autre préoccupation : il est avant tout nécessaire d'assurer un meilleur contrôle collectif et démocratique des infrastructures et des ressources destinées à la défense, pour les soustraire aux intérêts privés et empêcher la formation d'un complexe militaro-industriel. Au niveau européen, cela doit dès maintenant passer par plus de transparence, en particulier de la part de la Commission, dont les programmes en matière de défense sont élaborés de manière particulièrement opaque, laissant craindre une forte influence du lobby de l'armement au vu des décisions prises jusque-là. À terme, cela signifie surtout une révision des traités, qui renforcerait le rôle des élus du Parlement et la responsabilité de la Commission et du Conseil devant eux.
Cyrielle Chatelain, députée, présidente du groupe Écologiste et social : « Il faut avancer avec une coalition de pays partageant les mêmes objectifs et constituant la colonne vertébrale et le moteur d'une défense européenne »
L'Europe se tient seule. Prise en étaux entre la menace Russe et le fanatisme de Donald Trump. Dans sa guerre contre l'Ukraine, Vladimir Poutine a trouvé en Donald Trump un complice idéal. En à peine un mois à la tête des États-Unis, ce dernier a trahi l'Ukraine et abandonné l'Europe. Nous sommes donc à un moment de bifurcation décisif : l'éclatement ou la coopération ; la rivalité ou la solidarité ; le repli ou le dépassement. Et disons-le clairement, la capacité des états européens à garantir séparément leur sécurité est faible, tant en terme opérationnel, économique que stratégique.
Dans ce chaos mondial, l'Europe doit s'affirmer comme une force politique, dotée d'une politique étrangère partagée et cohérente, parlant ainsi d'une seule voix au monde. Une force en capacité de garantir la sécurité de ses membres par une logique de garanties mutuelles et la construction d'une base industrielle de défense entièrement européenne, permettant l'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Une force, qui ne sera pleinement libre et autonome que grâce à une sortie des énergies fossiles rapide, ambitieuse et partagée. S'approvisionner en gaz ou en engrais Russes ou en gaz de schiste américain présente un risque existentiel, surtout en cas de conflit mondial. Notre dépendance nous affaiblit.
Enfin, la haine du progressisme, du féminisme, de l'anti-racisme et de l'humanisme est le ciment idéologique du pacte Trump-Poutine. Une haine qu'ils propagent : ingérence Russe en Roumanie, soutien de Musk à l'extrême droite allemande et diffusion de fake news sur les réseaux sociaux. Ils s'immiscent dans la gouvernance européenne grâce à leur partenaire hongrois ou en France à l'aide du Rassemblement national. Il convient donc de ne pas être naïfs.
Au niveau européen, il ne faut pas céder au blocage de Victor Orban. Il faudra avancer avec une coalition de pays partageant les mêmes objectifs et constituant la colonne vertébrale et le moteur d'une défense européenne, en capacité de coopérer avec les pays alliés non alignés. En France, il conviendra de ne pas nous laisser piéger par la rhétorique de l'union nationale, nous contraignant à une austérité accrue, à la casse sociale, aux reculs environnementaux ou à la restriction de nos libertés et des droits des étrangers. Ce serait abandonner la bataille vitale contre l'extrême droite, qui rêve de faire de la France l'un des rouages de l'axe Poutine-Trump.
Hélène Conway-Mouret, sénatrice PS, vice-présidente de la commission des affaires étrangères et de défense, ancienne ministre déléguée aux Affaires étrangères : « Le continent européen est le dernier bloc qui, globalement, résiste encore à la montée des mouvements fascistes »
La menace qui pèse sur le continent européen est à la fois extérieure, avec l'agression par la Russie d'un certain nombre de pays, et intérieure avec les tentatives de déstabilisation de nos démocraties. La défense européenne est essentielle aujourd'hui pour nous nous donner les moyens suffisants pour défendre nos territoires, alors que de nombreux services de renseignement européens signalent la possibilité d'un conflit avec la Russie dans les cinq ans.
Dans les démocraties occidentales, les extrêmes-droites profitent du principe de liberté d'expression et jouent sur les émotions négatives de peur, d'angoisse et de haine, afin de mieux marteler leur message d'un besoin d'ordre et de discipline. Elles instrumentalisent la liberté d'expression au profit de leur propagande. À l'échelle européenne, il est important que les règlements et les directives instaurent des contrôles et des filtres pour combattre cette propagande et ces fake news comme le permet le Digital Service Act adopté en 2022 par l'Union européenne, mais aussi de renforcer les échanges d'informations pour identifier les sources d'attaques cyber et les prévenir. Pour cette raison, le démantèlement par Donald Trump la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency en charge de la lutte contre la propagande et la désinformation a une incidence directe sur l'utilisation des réseaux sociaux par les Européens.
Les exemples des ingérences pendant les élections moldaves, roumaine fin 2024 et allemande début 2025 démontrent bien que L'Union européenne doit faire bloc pour protéger l'intégrité de ses processus démocratiques. Le continent européen est le dernier bloc qui, globalement, résiste encore à la montée des mouvements fascistes. Il est donc fondamental de les combattre, eux qui sont favorables à cette dérégulation et à ces ingérences tout en bénéficiant du soutien de l'administration Trump, comme l'a démontré le discours de JD Vance à la Munich Security Conference. Une réponse coordonnée, collective et européenne est la meilleure protection contre les ingérences étrangères, notamment en matière de cyber et d'influence des opinions publiques face à la levée de toutes les barrières et tous les filtres par les GAFAM. Protéger nos infrastructures, depuis les câbles sous-marins jusqu'à la modération des réseaux sociaux, se fera grâce à de nouveaux investissements et l'action collective de l'Union européenne, à laquelle il est important de rattacher la Grande-Bretagne. Enfin, la meilleure protection contre l'arrivée au pouvoir des extrêmes-droites est bien de revenir aux fondamentaux de la construction européenne : mobilité des personnes qui se connaissent, se côtoient, se comprennent et construisent un avenir en commun.
Vincent Boulet, responsable des relations internationales du PCF, vice-président du Parti de la Gauche Européenne : « Plutôt que d'encourager les tentations bellicistes qui entraînent les peuples vers la catastrophe, il faut porter en Europe une voix forte en faveur de la paix et du droit »
Une « défense européenne » est dangereuse, mais la sécurité européenne est nécessaire et urgente. Une défense européenne supposerait une armée commune ou, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, une européanisation du parapluie nucléaire français. Cela est impossible tant les forces centrifuges à l'œuvre dans l'Union européenne sont grandes, entre Meloni et Orban qui font allégeance à Trump, ou le gouvernement polonais soumis au parapluie de défense américain. Une européanisation de la force nucléaire française ne se situe absolument plus dans le domaine de la dissuasion mais elle revient à prendre le risque de la confrontation nucléaire.
Quelle crédibilité ont les discours sur « l'indépendance » d'une défense européenne provenant d'un pouvoir qui n'a cessé d‘aligner notre pays sur les choix des États-Unis et a poursuivi la politique de ses prédécesseurs qui a liquidé nos industries, à commencer par nos industries de défense ? L'économie de guerre annoncée par Macron et ses appels aux sacrifices des Français dessinent une austérité aggravée, à un moment où le pouvoir d'achat est en berne et où nos services publics manquent de l'essentiel. Elle ne servira que les marchés financiers. Trump doit se féliciter. Sa politique de transfert du fardeau d'une guerre sans issue à l'Europe fonctionne pleinement. Répondre aux exigences du moment implique au contraire de mener une politique de sécurité et d'autonomie stratégique, reposant sur deux piliers.
D'abord, une initiative pour une paix juste en Ukraine. Trois ans après l'agression injustifiable du régime de Poutine contre l'Ukraine, il n'y a aucune solution militaire. C'est une solution politique et diplomatique, avec l'Ukraine, la Russie, les États européens et sous les auspices des Nations unies, qui est à l'ordre du jour, avec pour base la souveraineté et la neutralité de l'Ukraine, sur les principes de la charte des Nations unies et de l'Acte final de la conférence d'Helsinki. Cela doit mener à une conférence de sécurité collective pour l'ensemble du continent, avec la sortie et la dissolution de l'OTAN.
Ensuite, notre pays a besoin de reconstruire un pôle public de défense, au service des besoins capacitaires de sa défense nationale, en toute indépendance de l'OTAN et des États-Unis. Elle doit aller de pair avec une grande politique de renouveau industriel de la France. Plutôt que d'encourager les tentations bellicistes qui entraînent les peuples vers la catastrophe, il faut porter en Europe une voix forte en faveur de la paix et du droit.
la Rédaction
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les rassemblements « Stand up for science » s’opposent à Trump et à Musk

Le 7 mars, dans trente villes des États-Unis, des milliers de personnes se sont jointes à des rassemblements de protestation organisés par « Stand up for science » (Debout pour la science).
Hebdo L'Anticapitaliste - 745 (13/03/2025)
Dan La Botz
traduction Henri Wilno
Elles dénonçaient les coupes budgétaires opérées par Donald Trump et Elon Musk dans de nombreuses agences gouvernementales américaines, universités et organisations à but non lucratif qui financent la recherche dans les domaines de la santé et du climat, et de nombreux autres domaines scientifiques.
Des manifestations ont eu lieu au Lincoln Monument à Washington, au centre civique de San Francisco et dans de nombreuses universités. J'ai participé à une manifestation à Washington Square à New York et j'ai rencontré des médecins et des scientifiques qui travaillent sur les vaccins, le cancer et la santé des travailleurEs. L'un d'entre eux portait une pancarte sur laquelle était écrit « Plus de science, moins de DOGE », en référence au ministère de l'efficacité gouvernementale dirigé par le milliardaire et homme de main de Trump, Elon Musk, qui a licencié des dizaines de milliers de travailleurEs.
50 000 emplois menacés
Elon Musk a licencié des centaines de travailleurEs de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) qui s'occupe de la météo et du climat, et plus d'un millier de travailleurEs des Centers for Disease Control (CDC) et des National Institutes of Health (NIH). Le CDC répond aux maladies infectieuses et aux urgences de santé publique comme le covid, tandis que les NIH financent la recherche biomédicale. Des travailleurEs de ces agences et d'autres agences scientifiques ont également été indemniséEs pour accepter de quitter leur emploi ou bien licenciéEs, d'autres subissent des pressions pour partir et certains démissionnent parce qu'ils ne voient pas d'avenir pour leur travail sous Trump.
Trump et Musk ont également réduit de dizaines de milliards de dollars les budgets des universités publiques et privées menant des recherches scientifiques et sanitaires, y compris une réduction de 400 millions de dollars du financement de la recherche à l'université de Columbia, ciblée parce qu'elle n'aurait prétendument pas protégé les étudiantEs juifs lors des manifestations propalestiniennes. Selon les estimations, ces coupes dans des dizaines d'établissements universitaires entraîneront le licenciement de près de 50 000 employéEs.
Risque vital
Un juge fédéral a forcé l'administration Trump à suspendre temporairement ses coupes dans le financement fédéral de la recherche médicale et scientifique. L'ordonnance du juge stipule ce qui suit : « Cette annonce a un impact sur des milliers de subventions existantes, totalisant des milliards de dollars dans les 50 États — un changement unilatéral au cours d'un week-end, sans tenir compte des recherches et des essais cliniques en cours. Le risque imminent d'interruption d'essais cliniques vitaux, de perturbation du développement de recherches et de traitements médicaux innovants et de fermeture d'installations de recherche, sans tenir compte des soins actuels aux patients, justifiait l'émission d'une ordonnance restrictive temporaire à l'échelle nationale pour maintenir le statu quo, jusqu'à ce que la question puisse être pleinement examinée par le tribunal ».
Antiscientifiques, antivax et loi du plus fort
Les protestations concernent principalement les réductions de financement, la fermeture de programmes et le licenciement de travailleurEs, mais il y a aussi une lutte contre la promotion antiscientifique des théories conspirationnistes par l'administration Trump.
Robert F. Kennedy Jr, aujourd'hui à la tête du ministère de la Santé et des services sociaux, est un détracteur des vaccins. Alors que l'épidémie de rougeole au Nouveau-Mexique et au Texas atteint les 200 cas, avec deux décès, un enfant et un adulte, Kennedy recommande aux gens de prendre de l'huile de foie de morue, de la vitamine A, des stéroïdes et des antibiotiques, plutôt que de préconiser des vaccinations, pourtant l'approche la plus efficace pour contrôler les épidémies de rougeole.
« La promotion de l'huile de foie de morue et des vitamines ne fait que détourner l'attention du message principal, qui est d'augmenter le taux de vaccination », a déclaré à la National Public Radio le Dr Amesh Adalja, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. La rougeole est la maladie la plus contagieuse de la planète et le fait de ne pas insister sur la vaccination ne manquera pas d'entraîner de nouveaux décès. « Stand up for science » était la troisième d'une série de manifestations nationales contre Trump.
Dan La Botz
(traduction Henri Wilno)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aux États-Unis, des manifestations contre Tesla pour affaiblir Elon Musk

Des rassemblements sont organisés aux États-Unis devant des boutiques Tesla pour s'opposer au rôle d'Elon Musk dans la politique du pays. Les manifestants cherchent à faire mal au portefeuille de l'homme le plus riche du monde.
10 mars 2025| tiré de reporterre.net
https://reporterre.net/Aux-Etats-Unis-des-manifestations-contre-Tesla-pour-affaiblir-Elon-Musk
En sortant du parking dans leur voiture Tesla, les conducteurs ont la surprise d'être accueillis par des saluts nazis. Quelque 120 personnes sont alignées sur le bord de la route, devant un concessionnaire automobile d'Elon Musk. Ces bras tendus par les manifestants dénoncent le geste que le patron automobile a fait après l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier dernier.
Si les soutiens d'Elon Musk ont pris sa défense en qualifiant son geste de « salut romain », « c'était bien un salut nazi », tranche Jessica Farmer, 26 ans, quand elle ne hue pas les clients qui sortent du magasin Tesla. Elle a suivi l'appel à manifester, le 8 mars à Decatur, dans la banlieue d'Atlanta aux États-Unis, contre les pouvoirs politiques d'Elon Musk et ses licenciements et coupes budgétaires dans l'administration étasunienne.
Sur le parking de Tesla, sont alignés les véhicules électriques et les Cybertruck aux airs de tank. « Notre objectif est de toucher Elon Musk là où ça fait mal : à son portefeuille, explique Jessica Farmer. Si, en étant ici, on peut faire honte aux personnes qui entrent et achètent un Cybertruck, ce sera plus difficile pour elles d'en acheter. »

La manifestation anti-Musk devant un magasin Tesla, à Decatur aux États-Unis, le 8 mars 2025. © Edward Maille / Reporterre
Ces initiatives citoyennes se sont multipliées ces derniers jours dans l'ensemble du pays, avec plus d'une centaine prévue le 8 mars et pour une semaine, selon le site Action Network. Si la grande partie des rassemblements est pacifique, des actions violentes ont eu lieu avec des cas de cocktails Molotov ou des tirs d'armes à feu contre des boutiques. Le 8 mars à New York, six personnes ont été arrêtées après être entrées à l'intérieur d'une boutique.
Lire aussi : « Musk est un fasciste notoire » : le siège de Tesla repeint en « brun nazi » à Paris
En voyant cette opposition prendre vie, Laura Gordon, 58 ans, a décidé d'organiser cette manifestation à Decatur, sa première, pour faire taire son « angoisse ». Sur sa pancarte, des menottes sont dessinées pour « insinuer qu'Elon Musk a une conduite criminelle ». « C'est un responsable politique qui n'a pas été élu, mais qui est en train de détruire la démocratie. Il va continuer tant qu'il le pourra. » L'enjeu est d'encourager les clients à « abandonner Tesla en vendant leurs voitures et leurs actions en bourse, et faire tout ce qu'ils peuvent pour affaiblir Elon Musk », dit Laura Gordon.
Sur le bord de la route, certaines pancartes invitent les automobilistes à klaxonner en soutien au mouvement. Et cela fonctionne plutôt bien. « On ne s'entend même plus parler ! se félicite Bridget LaMonica, âgée de 36 ans. À chaque fois qu'on fait entendre notre voix, cela fait une différence. Si on peut atteindre quelques personnes, c'est une réussite. »

Jessica Farmer : « Notre objectif est de toucher Elon Musk là où ça fait mal : à son portefeuille. » © Edward Maille / Reporterre
-45 % de ventes en Europe
Dans un premier temps, le monde de la finance a vu d'un bon œil la proximité d'Elon Musk avec Donald Trump. Les cours en bourse de Tesla ont atteint un record en décembre dernier. La fortune de l'homme le plus riche du monde a atteint 464 milliards de dollars (428 milliards d'euros). Mais depuis qu'il orchestre le démantèlement de l'administration étasunienne, les affaires vont mal.
Les actions de Tesla ont chuté de près de 45 % depuis décembre, et Elon Musk a perdu 121,2 milliards de dollars (112 milliards d'euros). Sa fortune — toujours la plus importante du monde — était estimée le 9 mars à 342,4 milliards de dollars (316 milliards d'euros),selon Forbes.

« Foutez le camp de nos affaires », lit-on sur cette pancarte. © Edward Maille / Reporterre
Le mouvement cherche à encourager cette dégringolade, en espérant copier l'exemple européen, où les ventes de Tesla ont baissé de 45 % en janvier par rapport à l'année précédente, avec -76 % en Allemagne et -26 % en France en février.
Devant la boutique, les manifestants continuent de chanter leurs slogans et de brandir leurs pancartes anti-Musk. Matt Hunter, 40 ans, n'avait pas attendu l'organisation du rassemblement pour tenter de faire une différence. Depuis trois semaines, il vient sur ce trottoir presque tous les jours, en posant des congés. Il a même obtenu une petite victoire : « L'autre jour, une femme nous a dit qu'elle n'en pouvait plus [d'Elon Musk] et qu'elle avait vendu sa Tesla pour une autre voiture. C'était très encourageant. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












