Derniers articles

Les tracteurs a brides abattues sur Paris

Bloquer Rungis, le plus important marché d'Europe, cordon ombilical des Français (es) et les axes névralgiques de l'Hexagone, telles étaient et demeurent les cibles des agriculteurs en colère pour faire plier le gouvernement. Gabriel Attal a promis de nouvelles mesures.
De Paris, Omar HADDADOU <
Direction la capitale pour taper du poing !
La réunion d'hier lundi à Matignon des Syndicats avec le Premier ministre Gabriel Attal va-t-elle porter ses fruits ou accoucher d'une souris acculant les agriculteurs des 30 départements à passer à la vitesse supérieure.
Ces derniers ne cachent pas leur détermination à investir, à bord de leurs 800 tracteurs, le fastueux Paris et ses 1000 marchés, avec comme point d'orgue la fermeture de plusieurs autoroutes et le siège de Rungis, le plus grand marché de frais en Europe. Plus de 3 millions de marchandises y transitent par an.
D'où le ton apaisé du ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin pour éviter la confrontation des 15 000 policiers et gendarmes et dans la foulée motiver la levée des 8 points de blocage. Plus de trois heures de tractations entre le chef du gouvernement Gabriel Attal, le représentant de la FNSEA et des « Jeunes Agriculteurs », en vue de désamorcer la crise.
Ce rendez-vous se voulait discret, couvant un suspens qui laissait transparaitre l'acuité du malaise et la difficulté à trouver un consensus. Ni le Premier ministre, ni ses homologues ne se prêtaient à la transparence au sortir de cette rencontre. C'est la porte-parole du gouvernement Presca Thevenot qui mettra un peu d'eau à la bouche des médias : « La mobilisation du gouvernement en faveur des agriculteurs s'inscrit dans la durée. De nouvelles mesures seront prises dès demain », assure-t-elle autour de 22 heures.
Sous pression, le locataire de Matignon est attendu à l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale. Il avait juré « d'avancer vite » dans le dossier. Son ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a du pain sur la planche.
La démonstration de force des agriculteurs, silo de la population, contrairement au combat des immigrés, a trouvé « réponse », du moins un dialogue. Le calendrier politique plaide en leur faveur. Elections européennes, Jeux Olympiques et Paralympiques. Leurs revendications méritent attention. Elles portent sur la réévaluation des prix des produits, la mise en place de mesures contre la concurrence déloyale, l'accord (décrié) de la réforme de la politique agricole commune (PAC), le green deal et sa neutralité carbone en 2050, perçu comme le cauchemar des agriculteurs.
La cause des besogneux du monde rural se veut présentement une perspective et un défi européen.
Mesurant l'impact du tollé parisien, Macron - concentré sur son agenda international - a consigné un tête à tête, jeudi prochain, avec Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne.
L'exécutif est plus que jamais au creux de la vague. Il se lance à corps perdu dans des concessions qui pourraient se révéler inassouvies. Vendredi, Attal, tout enthousiaste, dévoilait des mesures d'urgence, à savoir l'abandon de la taxe sur le gazole non routier, des indemnités gonflées pour les éleveurs sinistrés, des sanctions lourdes contres trois industriels de l'agro-alimentaire outrepassant les lois Egalim sur les prix.
Cela dissipera-t-il l'épaisse chape de normes qui étouffe l'activité agricole ?
Le politique sait ciseler le propos quand l'engrenage institutionnel grince : « Je ne vous lâcherai pas, on va se battre. Mettre l'agriculture au-dessus de tout. La France sans l'agriculture, ce n'est pas la France ! » martèle le Premier ministre.
Si le monde de la paysannerie trime, pleure de toute son âme ses pertes et ses souffrances, le spéculateur, le détaillant du coin et le véreux de la grande distribution quant à eux suffoquent en découvrant le bond de leurs profits. Pour l'heure le convoi ne décolère pas.
Sans Rungis, Paris ne tiendrait pas 72 heures.
O.H
8 heures
> 15.000 policiers et gendarmes mobilisés
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La CIJ s’est prononcée : Dites au Canada de respecter les exigences de la CIJ à l’égard d’Israël

La CIJ a rendu sa décision sur la plainte de l'Afrique du Sud pour génocide contre Israël, et il s'agit d'un acte d'accusation accablant pour les violences commises par Israël à Gaza
La CIJ a notamment exigé qu'Israël
1) prenne des mesures pour mettre fin à toute violence génocidaire à Gaza,
2) empêche et punisse l'incitation au génocide par ses dirigeants, et
3) permette l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Bien que la CIJ n'ait pas exigé de cessez-le-feu, le ministre sud-africain des affaires étrangères a affirmé que "par implication, un cessez-le-feu doit avoir lieu". Chaque mesure a été approuvée par une large majorité des juges de la CIJ, jamais moins de 15-2. Lire la déclaration de CJPME ici.
Joignez-vous à CJPMO et insistez pour que le Canada soutienne la décision juridiquement contraignante de la Cour ! Entre autres choses, le Canada devrait
1) condamner fermement la violence génocidaire d'Israël à Gaza ;
2) faire pression sur Israël pour qu'il se conforme pleinement aux dispositions d'urgence de la CIJ ;
3) mettre fin à tout commerce d'armes entre le Canada et Israël, et
4) réévaluer la position diplomatique du Canada à l'égard d'Israël.
Cliquez ici pour dire au Canadade respecter la décision monumentale de la CIJ ! Votre courriel sera envoyé au Premier ministre Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères Joly, à d'autres dirigeants fédéraux et à votre député local. Le Canada doit soutenir l'importante décision de la CIJ de mettre fin à la violence génocidaire contre les Palestiniens de Gaza !
Merci de partager cette campagne :
Retweeter le tweet de notre campagne.
Partagez la publication de notre campagne sur Facebook.
Partager notre post Instagram
Plus d'informations
Le vendredi 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a rendu un arrêt préliminaireselon lequel les actions d'Israël à Gaza pourraient plausiblement relever de la Convention sur le génocide, et a ordonné à Israël de se conformer à des mesures provisoires qui limiteraient ses actions génocidaires. La CIJ exige qu'Israël : prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher la commission d'actes de génocide (y compris le meurtre de membres du groupe et l'imposition de conditions de vie visant à détruire le groupe), qu'il veille à ce que ses forces militaires ne commettent pas d'actes de génocide, qu'il empêche et punisse l'incitation directe et publique à commettre un génocide et qu'il permette l'acheminement de l'aide humanitaire, parmi d'autres mesures.
Il s'agit de la première étape d'une procédure engagée par l'Afrique du Sud, qui a invoqué la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide ("convention sur le génocide") pour engager une procédure contre Israël, un autre État partie, sur la base de ses obligations en matière de prévention et de répression du génocide. Larequête de 84 pages déposée par l'Afrique du Sud auprès de la CIJ repose sur deux graves allégations : premièrement, Israël « n'a pas empêché le génocide et n'a pas poursuivi l'incitation directe et publique au génocide » ; deuxièmement, « Israël s'est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes génocidaires contre le peuple palestinien à Gaza ». Ces actes consistent notamment à tuer des Palestiniens de Gaza, à leur causer de graves dommages corporels et mentaux et à leur infliger des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique. Ces actes seraient « de nature génocidaire parce qu'ils visent à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien, à savoir la partie du groupe palestinien de la bande de Gaza ».
Bien qu'il faille attendre des années avant qu'un jugement définitif soit rendu sur le bien-fondé de l'accusation de génocide, l'Afrique du Sud demande, « de toute urgence », une série de mesures provisoires qui s'appliqueraient immédiatement et s'étendraient sur toute la durée du procès. Ces mesures comprennent la suspension immédiate des opérations militaires d'Israël contre Gaza, la fin des déplacements massifs de la population de Gaza par Israël et la fin de la privation par Israël de nourriture, d'eau et d'autres fournitures essentielles à cette population. Bien que la CIJ n'ait pas appelé à un cessez-le-feu total, elle a ordonné d'importantes restrictions à la campagne génocidaire d'Israël contre la population de Gaza, que CJPME estime ne pas pouvoir raisonnablement respecter sans un cessez-le-feu total et la fin de l'effusion de sang.
En tant qu'État partie à la Convention sur le génocide, le Canada peut intervenir dans la procédure en tant qu'État partie pour soutenir l'Afrique du Sud, que ce soit maintenant ou au cours d'une éventuelle procédure sur le fond. La semaine dernière, CJPMO a envoyé une lettre à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, pour demander au Canada de peser de tout son poids sur la requête de l'Afrique du Sud contre Israël et d'adresser à la CIJ une demande officielle exprimant son soutien.
CJPMO insiste sur le fait que le Canada doit maintenant prendre position en faveur de la décision de la Cour, après des semaines de déclarations confuses et contradictoires. Le soutien à la décision peut et doit prendre la forme
1) d'une condamnation publique ferme de la violence brutale d'Israël contre les Palestiniens de Gaza ;
2) de pressions sur Israël pour qu'il se conforme pleinement aux dispositions d'urgence de la CIJ ;
3) d'un arrêt de tout commerce d'armes entre le Canada et Israël et d'un examen formel de la coopération du Canada avec Israël en matière de sécurité, et
4) d'une réévaluation stricte de la position diplomatique du Canada vis-à-vis d'Israël pour s'assurer que le Canada n'est pas complice d'un génocide ou n'en permet pas l'exécution.
Canadians for Justice and Peace in the Middle East
CJPME / CJPMO · 580 Sainte-Croix Ave, Suite 060, Montreal, QC, H4L 3X5
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le verdict de la Cour internationale de justice contre l’Israël et le doute trudeausien

Le vendredi 26 janvier 2024, la Cour Internationale de Justice (CIJ), l'organe judiciaire principal de l'ONU, a rendu sa décision face à l'appel de l'Afrique du Sud concernant la question suivante : « Oui ou non, l'État d'Israël a-t-il violé la Convention des Nations unies sur le génocide ? » Israël est signataire de cette convention depuis 1948, à la suite de l'Holocauste. Il se voit ainsi obligé de respecter cette convention.
Kaveh Boveiri
La Cour Internationale de Justice, constituée de 17 juges, a été presque unanime dans la prescription de mesures conservatoires mentionnées à la fin de sa décision, à l'exclusion d'un ou deux juges.
Une des phrases clés est la suivante : Israël « doit offrir des assurances et des garanties de non-répétition des violations de la convention sur le génocide ».
La réaction d'Israël était prévisible. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, répète que les accusations de génocide sont scandaleuses. Ainsi reste-t-il en harmonie avec la position du précédent premier ministre, Nafthali Bennett, exprimée le 23 décembre dans un entretien réalisé lors du programme de HardTalk de BBC.
Sans revendiquer explicitement le cessez-le-feu immédiat, ce verdict est une étape importante visant l'instauration de mesures devant indirectement mener au cessez-le-feu. Il doit être considéré sérieusement par les pays qui demeurent des complices affirmés, malgré leur isolement grandissant, avec les États-Unis et Israël. Mais cette complicité peut se présenter également sous la forme d'hésitations et de doutes, ces dernières manifestations étant une des marques caractéristiques de Justin Trudeau.
Tandis que, pour une grande proportion de la population canadienne, le verdict de la Cour correspond simplement à leur compréhension de ce qui se passe à Gaza depuis le début, cela n'est pas le cas pour les autorités canadiennes et plus précisément pour le premier ministre Justin Trudeau. Dans son entretien du 12 janvier, il dit qu'il n'accepte pas lesprémisses suggérées par l'Afrique du Sud. Pour cette accusation, il nous dit « il faut des preuves irréfutables ».
À la suite de l'ordonnance de la Cour, la population canadienne voulait connaître la position du gouvernement sur ce verdict très puissant. Mais après l'annonce de la cour, le 26 janvier, ni Trudeau ni la ministre des Affaires Étrangères Mélanie Joly n'a attendu pour répondre aux questions.
C'est de cette façon que Trudeau a exprimé encore une fois son doute typique. Ainsi, partage-t-il davantage la complicité conjointe étasunienne-israélienne et… leur échec. La complicité de l'état canadien avec ce génocide a déjà mené à des manifestations de colère de la part du peuple canadien. Ce genre de complicité aura sans doute des conséquences dans la prise de position des gens, immigrants et non-immigrants qui reconnaissent, d'une manière ou de l'autre, cette complicité. Les élections à venir seront l'une des occasions où la population exprimera cette prise de position.
L'effort de s'harmoniser avec les États-Unis s'observe parfois dans des cas où le gouvernement canadien en vient même à dépasser, par certains aspects, le positionnement politique américain. En voici un exemple. À cause de la rupture des relations diplomatiques décrétées avec l'Iran par le gouvernement canadien sous le ministre Harper, les citoyens irano-canadiens ne peuvent pas renouveler leurs passeports au Canada. Je vous invite à prendre un moment pour vérifier ce qui leur reste comme alternatives avant de poursuivre la lecture de ces lignes. Bizarrement, ces citoyens du Canada et de l'Iran doivent envoyer leurs passeports aux États-Unis, à Washington, où se trouve une « section d'intérêts » (Interests Section) de l'Iran à l'ambassade du Pakistan ! Une telle section n'existe pas au Canada.
Une blague connue au Canada anglophone exprime ce doute et cette obéissance du gouvernement canadien : U.S. says : « Canada jump ! » Canada says : « How high ? » (Les États-Unis disent : « Canada, saute ! » Canada répond : « À quelle hauteur ? »)
À l'heure actuelle, la population canadienne en général et le mouvement ouvrier en particulier se mobilisent davantage contre cette hésitation constante et cette complicité manifestée par le gouvernement. Trudeau, même en étant un peu machiavélique et en pensant à son avenir, doit s'approcher de la population et mettre fin à son attitude de doute et sa complicité.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

CJPMO condamne la suspension du financement de l’UNRWA par le Canada comme une punition collective

Montréal, le 27 janvier 2024 - Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) est scandalisé par la décision du Canada de suspendre le financement de l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, sur la base d'allégations israéliennes non prouvées à l'encontre de quelques-uns de ses employés. L'UNRWA est la principale agence humanitaire fournissant des services à la population de Gaza. Hier, la Cour internationale de justice (CIJ) a conclu qu'il était plausible que les conditions de vie imposées par Israël à Gaza, y compris la privation de nourriture et d'eau, puissent constituer des actes de génocide. CJPMO demande instamment au Canada de revenir immédiatement sur sa décision politique contre l'UNRWA, d'augmenter son soutien financier à l'agence et d'exercer une pression concrète sur Israël pour qu'il mette fin à sa guerre génocidaire et à son siège.
« La suspension par le Canada de l'aide à l'UNRWA est un acte hypocrite de punition collective à l'encontre d'une population de réfugiés menacée de génocide », a déclaré Michael Bueckert, vice-président de CJPMO. « Le moment choisi pour l'annonce semble avoir été conçu pour détourner l'attention de l'ordre de la CIJ selon lequel Israël doit empêcher le génocide à Gaza. Au lieu d'exhorter Israël à se conformer à ces ordonnances, le Canada s'est joint à une attaque politique contre les victimes du génocide » a ajouté M. Bueckert.
CJPMO note que l'allégation d'Israël - selon laquelle 12 des 30 000 employés de l'UNRWA auraient participé à l'attaque du Hamas du 7 octobre - n'a pas été prouvée et doit être abordée avec beaucoup de prudence. Il est rapporté que les allégations d'Israël ont été obtenues par des interrogatoires, dans un contexte où Israël utilise régulièrement la torture pour obtenir des aveux forcés de la part des détenus, y compris des enfants. De plus, CJPMO note que l'UNRWA a déjà pris des mesures de précaution immédiates pour licencier les employés accusés et lancer une enquête sur les allégations, ce qui rend la suspension du financement par le Canada injustifiée et gratuite. « Il est impossible de ne pas remarquer que le Canada a agi immédiatement pour punir l'UNRWA sur la base d'allégations israéliennes, alors qu'il n'a pris aucune mesure pour censurer Israël pour des actes que la CIJ considère comme plausiblement génocidaires » a déclaré M. Bueckert. CJPMO note que sur plus de 26 000 Palestiniens tués par Israël, au moins 152 d'entre eux étaient des employés de l'UNRWA, alors qu'il y a 253 incidents documentés d'attaques israéliennes sur les écoles et les installations de l'UNRWA depuis le 7 octobre.
CJPMO estime que ce n'est pas une coïncidence si la décision du Canada de réduire son aide humanitaire à Gaza a coïncidé avec la décision initiale de la CIJ sur la requête de l'Afrique du Sud contre Israël. Dans sa décision, la CIJ a noté la situation humanitaire catastrophique à Gaza et a déterminé que les actions d'Israël pouvaient plausiblement s'apparenter à un génocide. La CIJ a ordonné à Israël de « prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour prévenir tous les actes susceptibles de tomber sous le coup de la Convention sur le génocide, notamment « le fait d'imposer délibérément au groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». La Cour a également ordonné qu'Israël « prenne des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens de la bande de Gaza ont un besoin urgent, afin de remédier aux conditions de vie difficiles auxquelles ils sont confrontés ». CJPMO a noté que la réponse du Canada à la décision de la CIJ n'a pas exprimé son soutien à cette décision, ni appelé Israël à se conformer à ses dispositions juridiquement contraignantes.
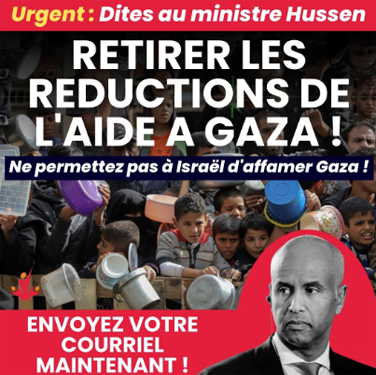
Cliquez sur ce lien pour afficher le formulaire qui vous permettre d'envoyer votre courriel :
https://fr-cjpme.nationbuilder.com/reverse_unrwa_cuts
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Plus de 250 organisations féministes demandent d’interdire les accusations d’aliénation parentale

Aux côtés de l'Association nationale Femmes et Droit, nous avons signé une lettre ouverte demandant au gouvernement canadien d'interdire les accusations d'aliénation parentale dans les affaires de droit familial. Ce concept pseudo-scientifique mène les tribunaux à forcer des enfants à vivre avec un père violent. C'est pourquoi Reem Alsalem, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes et les filles, a demandé à tous les États de « légiférer pour interdire l'utilisation de l'aliénation parentale ou de pseudo-concepts apparentés dans les affaires relevant du droit de la famille ».
Aidez à protéger les femmes, les enfants et les victimes de violence familiale en partageant cette lettre avec le mot-clic #StopAccusationsAliénation. Et pour en savoir plus sur l'aliénation parentale.
La lettre
Le très honorable Justin Trudeau,
L'honorable Arif Virani,
L'honorable Pierre Poilievre,
L'honorable Jagmeet Singh,
L'honorable Yves-François Blanchet,
Nous vous écrivons en tant qu'organisations féministes et de défense de l'égalité pour vous demander d'agir pour résoudre une crise aux proportions dramatiques dans notre système de justice familiale : l'utilisation d'accusations d'aliénation parentale contre les victimes de violence conjugale.
L'« aliénation parentale » est un concept controversé qui est utilisé pour réduire au silence les parents et les enfants qui dénoncent les violences familiales commises par le père. Trop souvent, les tribunaux et les témoins qui évaluent l'enfant considèrent que le fait de dénoncer la violence familiale ou de demander une réduction des contacts entre le père et l'enfant sont des signes d'« aliénation », c'est-à-dire de lavage de cerveau de la part de la mère pour que l'enfant rejette le père. Ce concept conduit les tribunaux à travers le pays à séparer des enfants de leur mère et à les forcer à vivre avec leur père, même lorsqu'il existe des antécédents documentés de violence familiale. Parfois, lorsque le père est jugé inapte à prendre soin de l'enfant, les tribunaux et la protection de la jeunesse vont jusqu'à placer l'enfant dans un centre jeunesse ou en famille d'accueil pour éviter la supposée « aliénation parentale » par la mère, alors que l'enfant aurait pu rester auprès de sa mère ou être confié·e à ses grands-parents maternels. Ces problèmes affectent également les membres de la communauté 2SLGBTQIA+ qui vivent des violences conjugales.
La recherche canadienne a révélé que :
– Les accusations d'« aliénation parentale » visent principalement les femmes ; les victimes de violence conjugale sont particulièrement à risque.
– En 2015, plus de la moitié des travailleuses interrogées dans des centres de femmes au Québec décrivaient les accusations d'« aliénation parentale » comme une priorité ou l'une de leurs principales préoccupations.
– La situation n'a fait que s'empirer dans les dernières années ; les accusations d'« aliénation parentale » sont en augmentation.
– Les allégations de violence familiale sont rarement prises au sérieux dans les cas où l'« aliénation parentale » est alléguée ; la violence conjugale est présentée comme pertinente à l'analyse du meilleur intérêt de l'enfant dans seulement 10% des cas où tant la violence conjugale par le père que l'« aliénation parentale » par la mère sont alléguées.
– Les accusations d'« aliénation parentale » sont fortement corrélées avec des situations de violence conjugale, même si ce n'est pas toujours apparent parce que les enjeux de violence conjugale sont souvent occultés dans les cas où l'« aliénation parentale » est alléguée.
– L'« aliénation parentale » n'a pas de définition stable en termes juridiques : c'est un concept vague qui peut être utilisé dans un large éventail de circonstances, incluant des cas où l'enfant ne rejette pas un parent et des cas où la mère n'a ni dénigré le père ni tenté de faire obstruction aux contacts père-enfant.
– La prévalence des accusations d'« aliénation parentale » mène des avocat·es à recommander aux victimes de ne pas mentionner la violence conjugale commise par le père.
– Considérer la question de l'« aliénation parentale » mène les tribunaux à perdre de vue le meilleur intérêt de l'enfant, et à se centrer plutôt sur les droits parentaux.
En outre, bien que les données canadiennes fassent défaut, les recherches menées dans d'autres pays suggèrent que les accusations d'« aliénation parentale » ont un impact disproportionné sur les femmes appartenant à des groupes minoritaires, notamment les femmes racisées, migrantes et handicapées.
En 2019, la Loi sur le divorce a été modifiée pour accorder plus d'importance à la violence familiale et ordonner aux tribunaux de prioriser la sécurité et le bien-être des enfants. En tant qu'organisations de défense des droits des femmes, prestataires de services, organisations juridiques et centres de recherche, nous constatons que le problème des accusations d'« aliénation parentale » persiste. Une nouvelle réforme est nécessaire pour interdire explicitement le recours aux accusations d'aliénation parentale dans les litiges familiaux, par le biais d'un amendement à la Loi sur le divorce. Le changement est particulièrement urgent étant donné l'augmentation des violences genrées depuis la pandémie de COVID-19, qui a conduit la Commission des pertes massives à déclarer que la violence fondée sur le sexe était une épidémie.
L'été dernier, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences, Reem Alsalem, a présenté un rapport sur la garde des enfants, la violence contre les femmes et la violence contre les enfants. Elle a sonné l'alarme sur « la manière dont les tribunaux des affaires familiales des différentes régions invoquent la notion d'“aliénation parentale” ou des pseudo-concepts similaires dans les affaires de garde d'enfants, sans tenir compte des antécédents de violence domestique, ce qui peut se traduire par une double victimisation des personnes ayant subi ce type de violence ». Sa première recommandation est « [q]ue les États légifèrent pour interdire l'invocation de l'aliénation parentale ou de pseudo-concepts du même type dans des affaires relevant du droit de la famille ».
Nous vous demandons de vous engager à suivre cette recommandation et d'adopter le plus rapidement possible un projet de loi modifiant la Loi sur le divorce. Nous vous demandons également de vous engager à consulter des organisations expertes en matière de droits des femmes, telles que l'Association nationale Femmes et Droit, lors de la rédaction du projet de loi.
Plus de 250 d'organisations ont signé cette lettre ouverte et appuient la campagne de l'Association nationale Femmes et Droit visant à interdire les accusations d'« aliénation parentale ».
Si vous voulez soutenir les femmes, les enfants et les victimes de violence familiale, nous espérons que vous verrez que cette question est une priorité.
Notre système de justice familiale est en crise. Il faut agir dès maintenant.
Tiffany Butler, Directrice exécutive
Suzanne Zaccour, Directrice des affaires juridiques
Association nationale Femmes et Droit (ANFD)
Télécharger la lettre au format PDF
Signataires
Organisations nationales
Women's Shelters Canada | Hébergement femmes Canada
Canadian Women's Foundation
Ending Violence Association of Canada | L'Association canadienne pour mettre fin à la violence
DisAbled Women's Network of Canada | Réseau d'action des femmes handicapées du Canada (DAWN-RAFH)
The Canadian Association of Elizabeth Fry Societies l L'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry
Grupo de Apoio a Mulheres Brasileiras no Exterior (GAMBE)
Centre for the Study of Social and Legal Responses to Violence
The Alliance of Canadian Research Centres on Gender-Based Violence
Feminist Alliance for International Action
Canadian Resource Centre for Victims of Crime (CRCVC) | Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes
In Their Best Interest Canada | Dans Leur Intérêt Supérieur Canada
Les Femmes Michif Otipemisiwak | Women of the Métis Nation
Women's Centre for Social Justice (WomenatthecentrE)
YWCA Canada
Canadian Research Institute for the Advancement of Women (CRIAW) | L'Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF)
Wisdom2Action
Informed Opinions | Femmes Expertes
Aura Freedom
Canadian Center for Women's Empowerment (CCFWE)
Women's Economic Council | Le Conseil économique des femmes
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) | Prochainement Co-Savoir
Abortion Rights Coalition of Canada | Coalition pour le droit à l'avortement au Canada
Alliance against Violence and Adversity (AVA)
Québec
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF)
Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM)
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ)
Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les violences à caractère sexuel (RQCALACS)
Groupe des Treize
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
L'R des centres de femmes du Québec
Association féministe d'éducation et d'action sociale (Afeas)
Fédération du Québec pour le planning des naissances
Service d'Entraide Passerelle (SEP)
Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées
Regroupement des femmes de la région de Matane
Femmes en Mouvement
Pavillon Marguerite de Champlain
Regroupement des femmes La Sentin'Elle
Le Gîte Ami
Maison La Virevolte
Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS)
Centre de femmes l'Étincelle
Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)
Centre des Femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles
Centre de prévention des agressions de Montréal CPAM
Observatoire Famille Immigration
Action Travail des Femmes (ATF)
ESPACE Mauricie
Halte-Femmes Montréal-Nord
Quartier des Femmes
Face a Face Listening and Intervention Center | Le centre d'écoute et d'intervention Face à Face
Jeunesse au Soleil | Sun Youth Organization
Centre social d'aide aux immigrants (CSAI)
Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal (CEAF)
CALACS Trêve pour Elles
Multi-Femmes Inc.
Alternative pour Elles maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Horizon pour elle
Maison le Prélude
La Clé sur la Porte
Maison de Lina
La Maison La Nacelle
Maison d'Hébergement l'Équinoxe
La Bouée Régionale
Centre de solidarité lesbienne (CSL)
La Gîtée
Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ)
La Méridienne 1990
Havre l'Éclaircie
Maison Halte-Secours
Viol-Secours, CALACS de Québec
South Asian Women's Community Centre (SAWCC), Montreal I Centre communautaire des femmes sud-asiatiques (CCFSA)
Centre des femmes Le point d'ancrage
Fédération des femmes du Québec
ESPACE Suroît
Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)
Conseil des Montréalaises
L'Autre-Toit du KRTB
Auberge de l'Amitié Roberval inc.
L'Escale de l'Estrie
Juripop
CALACS L'Ancrage
Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles
Maison des femmes des Bois-Francs
L'Écho des femmes de la Petite Patrie
Association des familles monoparentales et recomposées La Source
Centre des Femmes du Témiscouata (CFT)
Regroupement des auberges du cœur du Québec (RACQ )
Bureau de consultation jeunesse (BCJ)
La Débrouille Inc.
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
Centre des femmes RDP
Centre Actu-Elle
Centre-Femmes La Passerelle
La Collective des femmes de Nicolet et Régions
CALACS de l'Ouest-de-l'Île
Le Centre Louise-Amélie
La Maison des Femmes Sourdes de Montréal (MFSM)
Le Centre féminin du Saguenay
Centre Femmes aux 4 Vents
Centre Femmes Entre-Elles
Transit 24
Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT)
Éditions du remue-ménage
Le Centre de femmes l'Érige
Centre des femmes de Longueuil
La Marie Debout, centre d'éducation des femmes
Centre ressources pour femmes de Beauport
Centre de femmes La Moisson
Regroupement Naissances Respectées (RNR)
Le Regroupement des Femmes de la Côte-de-Gaspé
Y des femmes de Montréal | YWCA Montreal
Centre de femmes Uni-Vers-Elles
Centre de femmes l'Éclaircie
Afrique au Féminin
Centre de femmes Arc-en-ci-Elle
Centre des femmes de Longueuil
Centre de femmes l'Autonomie en soiE
Centre femmes de La Mitis
Centre femmes d'aujourd'hui
Centre-femmes Catherine-Leblond
Centre de femmes Mieux-Être de Jonquière
Centre de Femmes l'Essentielle
Centre des femmes de Forestville
L'Alliance des femmes
Centre-femmes du Grand-Portage
Le Centre des femmes de Laval (CFL)
Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement
Centre-Femmes La Jardilec
Centre de femmes les Unes et les Autres
Centre Entre-Femmes
Centre Au Cœur des Femmes
Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Mauricie-Centre-du-Québec (FROHMCQ)
Centre des femmes l'Héritage
Centre des Femmes du Ô Pays
Centre des femmes d'ici et d'ailleurs
Conseil Central Cœur du Québec CSN
Centre-Femmes de Bellechasse
Ontario
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
Barbra Schlifer Commemorative Clinic
Ontario Association of Interval & Transition Houses (OAITH)
Hope 24/7
Centre Victoria pour femmes
YWCA Hamilton
Interval House of Ottawa | Maison Interval d'Ottawa
Northwestern Ontario Women's Centre
Elizabeth Fry Society of Northeastern Ontario
YW Kitchener-Waterloo
YWCA St. Thomas-Elgin
Hiatus House
YWCA Durham
Rexdale Women's Centre
Gillian's Place
Welcome Centre Shelter for Women and Families
YWCA Muskoka
North York Women's Centre
Nellie's
YWCA Hamilton
YWCA Toronto
Muskoka Parry Sound Sexual Assault Services
Huronia Transition Homes
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)
Elliot Lake Women's Group Inc.
Armagh House
Lennox and Addington Interval House
Manitoulin Family Resources
Birchway Niagara
Parkdale Queen West Community Health Centre
YWCA Cambridge
YWCA Ontario Coalition
Alternatives for Women
Herizon House
Sexual Assault Support Centre of Waterloo Region
Women's Habitat of Etobicoke
YWCA Sudbury
Counselling and Family Service Ottawa | Service familial et counseling Ottawa
YWCA Niagara Region
Kenora Sexual Assault Centre
YWCA Peterborough Haliburton
Red Door Family Shelter
The 482 Collective
York Region Centre for Community Safety
North Bay Indigenous Hub
Conseil Scolaire Public du Nord-Est de l'Ontario (CSPNE)
Embrave : Agency to End Violence
Amelia Rising Sexual Violence Support Centre
Elspeth Heyworth Centre for Women
Planned Parenthood Toronto (PPT)
The Niagara Chapter of Native Women Inc.
Community Counselling Centre of Nipissing
Alberta
Calgary Legal Guidance Society
WINGS of Providence
Rowan House Society
RESOLVE Alberta
Fairview & District Women's Centre Association OAS Crossroads Resource Centre & Women's Shelter
Mountain Rose Women's Shelter Association
Alberta Abortion Access Network
Neepinise Family Healing Centre
Women's Centre of Calgary
Peace River Regional Women's Shelter
YWCA Edmonton
Sagesse Domestic Violence Prevention Society
Colombie-Britannique
Justice for Girls
West Coast LEAF Association
FREDA Centre on Gender-based Violence against Women and Children
Sooke Transition House Society
Omineca Safe Home Society
BC Poverty Reduction Coalition
BC Society of Transition Houses (BCSTH)
Cowichan Women Against Violence
The Cridge Centre for the Family
North Island Community Services Society
Inform'Elles
Saskatchewan
Provincial Association of Transition Houses and Services of Saskatchewan (PATHS)
Yorkton Women In Need Inc.
Regina Transition House
Choose to Change – SIGN (Society for the Involvement of Good Neighbours)
Saskatoon Interval House
Amakon Women Empowerment Inc (AWE)
Sexual Assault Services of Saskatchewan
YWCA Saskatoon
YWCA Regina Inc
YWCA Prince Albert
Regina and Area Sexual Assault Centre
Nouvelle-Écosse
The Court Said Canada
Women Centres Connect
Be the Peace Institute
Naomi Society
Tri-County Women's Centre
The Marguerite Centre Society of Nova Scotia
YWCA Halifax
Avalon Sexual Assault Centre
The Women's Place Resource Centre (WPRC)
Manitoba
Manitoba Association of Women's Shelters (MAWS)
RESOLVE Manitoba
Willow Place
S.H.A.D.E. (Safe Housing And Directed Empowerment) Inc. (SHADE Inc.)
Swan Valley Crisis Centre
Nouveau-Brunswick
Elizabeth Fry New Brunswick (EFryNB)
Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence Research | Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale
Valley Outreach
YWCA Moncton
Yukon
Yukon Status of Women Council
Dawson Women's Shelter / Dawson Shelter Society
Yukon Women's Coalition
The Victoria Faulkner Women's Centre
Terre-Neuve-et-Labrador
Newfoundland Aboriginal Women's Network (NAWN)
Nain Transition House Inc.
YWCA St. John's
Île-du-Prince-Édouard
Women's Network PEI
PEI Family Violence Prevention Services Inc.
Blooming House Women's Shelter Inc.
Territoires du Nord-Ouest
YWCA NWT
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Courtepointe…

Personne ne peut affirmer, comme l'a fait Sylvain Malette, que la grève est « un moyen de pression « brûlé » pour les 30 prochaines années ». Je ne partage pas non plus le point de vue de Jacques Létourneau selon lequel les membres de la FAE doivent effectuer un « examen de conscience » en lien avec le déclenchement de la GGI et son caractère « utopiste » ou « idéaliste ».
Pendant que des assemblées générales syndicales se tiennent dans les secteurs de la santé et de l'éducation au sujet des ententes de principe qui ont été conclues en décembre dernier ;
Pendant que les négociations se poursuivent entre d'une part le Conseil du trésor et d'autre part la FIQ, le SPGQ et le SFPQ ;
Pendant que la section Ouvriers du SFPQ demande au ministère du Travail de procéder à la nomination d'une médiatrice ou d'un médiateur ;
Pendant que plusieurs personnes attendent avec impatience ou dans la plus complète indifférence le résultat du vote à la FAE ;
il y a en parallèle à ces événements d'autres choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention.
La conférence de presse de François Legault
Nous avons appris, lors de la conférence de presse du premier ministre François Legault tenue à la fin de la réunion du caucus de la CAQ, que le cadre monétaire prévu par le ministre des Finances Éric Girard en vue de régler les conventions collectives dans les secteurs public et parapublic a été revu à la hausse. Il y a donc eu, en décembre dernier, un débat au sein du Conseil des ministres ou d'un Comité interministériel portant sur l'enveloppe monétaire à accorder aux salarié.es syndiqué.es des secteurs public et parapublic. De combien au juste cette enveloppe a-t-elle été accrue ? Ce sera lors de la présentation du prochain budget provincial que nous aurons une idée un peu plus précise là-dessus.
Les entrevues de Jacques Létourneau et de Sylvain Malette
Les ex-présidents de la CSN et de la FAE sont libres d'intervenir comme ils l'entendent durant de la présente ronde de négociation. De mon côté, je suis également libre de souscrire ou non à leurs propos. Loin de moi donc l'idée de les brimer ou de les censurer dans leur liberté d'expression, mais il me semble qu'ils rendraient service aux militantes et militants syndicaux en nous disant ce qui se passe vraiment derrière les portes closes quand arrive le moment de laisser tomber les revendications initiales et de procéder au ficelage avec le gouvernement des propositions ou des hypothèses de règlement final.
Plus spécifiquement, l'auteur des présentes lignes aimerait savoir comment Sylvain Malette a été amené à accepter le cadre salarial du gouvernement caquiste en 2022 en y ajoutant une clause remorque ? J'aimerais également qu'il nous dise si en agissant ainsi il a contribué ou non à nuire aux autres organisations syndicales et, par conséquent, à l'ensemble des salarié.es syndiqués.es qui adhèrent à une autre organisation syndicale que la FAE ?
Du côté de Jacques Létourneau maintenant j'aimerais savoir comment il a fini par accepter, en décembre 2015, avec les autres présidents d'organisations syndicales, le cadre étroit de la politique de rémunération austère du gouvernement Couillard. Comment a-t-il fait pour accepter de soumettre à ses membres une proposition de règlement qui prévoyait, pour la première année de la convention collective, une augmentation salariale de 0% ?
Conclusion
Je conclue cette courtepointe en mentionnant qu'il ne vaut pas la peine de faire dans la futurologie. Personne ne peut affirmer, comme l'a fait Sylvain Malette, que la grève est « un moyen de pression « brûlé » pour les 30 prochaines années ». Je ne partage pas non plus le point de vue de Jacques Létourneau selon lequel les membres de la FAE doivent effectuer un « examen de conscience » en lien avec le déclenchement de la GGI et son caractère « utopiste » ou « idéaliste ». Il appartient aux membres de la FAE (comme il appartient aux membres des autres organisations syndicales) de procéder, le moment venu, à l'examen critique de leur démarche collective et des moyens d'action qu'elles et qu'ils ont déployés. Pour paraphraser Marx et Engels ici, il appartient aux travailleuses et aux travailleurs d'effectuer leur propre bilan critique sans l'aide d'éclaireurs externes à leur organisation.
Comme dirait l'Autre, c'est mon opinion et - point d'ironie…- je la respecte !
Yvan Perrier
29 janvier 2024
15h35
yvan_perrier@hotmail.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les courageuses profs de la FAE sont à appuyer cent milles à l’heure

La FAE est à deux doigts de rejeter l'entente de principe non pas à cause de la partie salariale, si l'on en juge par les votes scindés de leurs consœurs de la CSQ dont quelques syndicats ont rejeté ou appuyé de peu la partie sectorielle. Tout pourrait se jouer mercredi soir à Granby. Quatre des neuf syndicats de la FAE ont rejeté l'entente à un plus fort taux que les quatre qui l'ont accepté.
On attend dans l'urgence le cri du cœur Solidaire en appui à la direction de ce syndicat qui a recommandé le rejet à cause du « "mépris apparent [du] gouvernement pour [la] profession" […et parce que] l'entente de principe "n'améliore pas de manière significative [les] conditions de travail, dont la composition de la classe" »
Ce rejet est dans l'intérêt des travailleuses syndiquées, eu égard à leurs conditions de travail. Il est dans l'intérêt de l'école publique afin de l'empêcher de sombrer, phagocytée par l'école à trois vitesses. Il est dans l'intérêt du peuple québécois dont l'éducation de la jeunesse prolétarienne est bousillée en faveur de celle élitiste. Bien sûr, le seul rejet n'y suffira pas mais il est vital pour la suite des choses. On peut se fier sur les commentaires médiatiques et les bienpensants pour frigorifier les ardeurs en affirmant péremptoirement que le retour à la grève étant exclu, la FAE n'y gagnera que des améliorations à la marge comme lors du rejet de l'entente de principe par la FSSS-CSN en 2015. Nul doute que ce serait le chemin proposé par la bureaucratie syndicale pour se dédouaner du refus de sa base d'entériner l'entente de principe d'autant plus que cette base est brûlée par un mois de grève en vain et sans indemnités.
Faut-il rappeler l'ardeur de cette grève jusqu'à et y compris un blocage du Port de Montréal ? Faut-il rappeler le soutien financier, mais non pro-actif il est vrai et sans doute insuffisant, de plusieurs syndicats du privé ? L'alternative consiste à s'appuyer sur ces acquis pour faire un saut qualitatif. À commencer par les syndicats du Front commun qui entérineront l'entente de principe, il est tout à fait à la portée du mouvement syndical québécois d'établir un vrai et authentique fonds de solidarité suffisant pour accorder aux syndiquées de la FAE, et de la FSECSQ le cas échéant, de solides indemnités. Car cette fois-ci, la question salariale étant écartée, il s'agirait d'une lutte dont l'enjeu de fond, derrière l'amélioration des conditions de travail, serait l'école publique québécoise. Une victoire significative sur ce front, impliquant un soutien non seulement monétaire mais aussi pro-actif, ouvrirait la porte d'une remise en question de l'école à trois vitesses.
Marc Bonhomme,
28 janvier 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les syndicats du Canada marquent le 29 janvier avec un appel à l’action

Les syndicats du Canada exigent des mesures immédiates de la part du gouvernement fédéral afin de mettre fin à l'alarmante augmentation de la haine et de l'islamophobie au Canada. Le gouvernement doit publier sans plus tarder son Plan d'action national de lutte contre la haine et présenter sa loi sur les contenus préjudiciables en ligne, promise et attendue depuis si longtemps, afin de lutter contre la propagation du fascisme et de l'extrémisme de droite qui contribue à la croissance rapide des groupes de haine antimusulmane et à la diffusion de propos islamophobes en ligne.
Le 29 janvier est la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec en 2017. Cet événement tragique a coûté la vie à des fidèles innocents et a frappé la nation.
« L'attaque à la mosquée de Québec en 2017 nous a tous profondément marqués. En tant que société, nous ne pouvons pas continuer à nous dire que ces attaques ne se produiront pas ici, chez nous, car elles se sont passées ici », déclare Bea Bruske, présidente du CTC. « En effet, et ce depuis plusieurs années, nous avons constaté une forte augmentation des incidents motivés par la haine au Canada. Nous devons traiter les causes profondes de cette vague croissante de haine, qu'il s'agisse de xénophobie, de racisme ou d'intolérance religieuse. Il nous appartient de nous opposer à la haine et au sectarisme, et de les dénoncer chaque fois que nous en sommes témoins, que ce soit en personne ou en ligne. »
La montée de la haine au Canada est une tendance alarmante qui exige une attention urgente et une action collective. Une augmentation inquiétante des crimes haineux a été constatée ces dernières années, y compris ceux visant des minorités religieuses, raciales et ethniques. Le Conseil national des musulmans canadiens signale* également une forte augmentation des incidents islamophobes depuis le 7 octobre 2023 en raison de l'escalade de la violence en Palestine et en Israël. Cette recrudescence des incidents haineux met en évidence la nécessité d'un engagement global et inébranlable pour contrer toutes les formes de haine et de discrimination.
« Nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie le 29 janvier 2017, et depuis lors, en nous unissant contre la discrimination et le sectarisme parmi nos membres. Pour ce faire, nous cherchons activement à régler les incidents d'islamophobie, qu'ils soient subtils ou manifestes, de même que les structures qui permettent à l'islamophobie de persister, et nous œuvrons à la création d'espaces syndicaux permettant à chaque membre d'être et de se sentir valorisé et protégé », déclare Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC. « En favorisant une culture de respect et de solidarité, les syndicats peuvent contribuer de manière significative à l'élimination des attitudes et des pratiques fondées sur des préjugés. »
Il est primordial de cultiver un environnement qui valorise et fait place aux différences dans les lieux de travail. Cela consiste notamment à proposer de la formation et de la sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes et les idées reçues sur l'islam et les musulmans. Cela signifie aussi promouvoir l'inclusivité et éliminer les obstacles dans les pratiques d'embauche, et veiller à ce que chaque personne, peu importe son origine, dispose des mêmes chances en matière d'avancement et de réussite au travail.
Afin que les inégalités cumulées dont font l'objet certaines communautés soient dûment prises en compte, le gouvernement fédéral doit mettre à jour la Loi sur l'équité en matière d'emploi. La collecte et l'analyse de données ventilées sont essentielles à l'application d'une approche intersectionnelle à la Loi actualisée.
Le gouvernement doit également prendre des mesures pour mettre en œuvre les trente recommandations présentées par le Comité permanent du patrimoine canadien dans le rapport intitulé Agir contre le racisme systémique et la discrimination religieuse, y compris l'islamophobie.
« Il est plus facile de lutter ensemble contre la haine que seul. Nous demandons à tous les Canadiens et Canadiennes de participer activement à l'élimination de la haine et de promouvoir la compréhension, l'empathie et la solidarité. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un pays où chaque individu, peu importe son origine, peut vivre sans craindre la discrimination et la violence », déclare Mme Bruske.
Agissez
– Lisez et partagez le rapport du CTC sur la lutte contre l'islamophobie dans nos milieux de travail et nos collectivités : L'islamophobie au travail : défis et occasions. Le rapport contient des recommandations pour les employeurs, les syndicats et le gouvernement quant à la façon de combattre ce problème ;
– Montrez votre solidarité en portant un carré vert et en vous joignant à la Campagne du carré vert du Conseil national des musulmans canadiens ;
– Apprenez-en davantage sur l'islamophobie au Canada et ses répercussions.
*Certains des liens ne sont disponibles qu'en anglais.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Jean-Baptiste Fressoz : « La transition énergétique n’a pas commencé »

Les discours sur la transition sont des leurres : celle-ci n'a pas été amorcée, explique l'historien Jean-Baptiste Fressoz. Au lieu de « fantasmer sur un monde zéro carbone en 2050 », il faudrait une décroissance matérielle.
Tiré de Reporterre.
Jean-Baptiste Fressoz est historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Il vient de publier Sans transition — Une nouvelle histoire de l'énergie (Seuil).
Pour écouter l'entretien.
Reporterre — La transition énergétique n'a pas lieu, selon vous. Quel est le problème ?
Jean-Baptiste Fressoz — La transition est l'idée que l'on va changer de système énergétique en 30 ou 40 ans pour faire face à la crise climatique. Mais si on l'analyse historiquement, on voit à quel point cette notion a introduit des biais scientifiques. Nous n'avons pas fait de transition du bois au charbon pendant la révolution industrielle, par exemple. La révolution industrielle, ce n'est pas du tout une transition, c'est une énorme expansion matérielle.
En 1900, l'Angleterre, un très grand pays minier, engloutissait chaque année 4,5 millions de m3 de bois pour servir d'étais dans les galeries de mines. Or, les Anglais en brûlaient 3,6 millions de m3 dans les années 1750. Donc uniquement pour extraire du charbon, les Anglais utilisaient plus de bois en 1900 qu'ils n'en brûlaient en 1750.
Le pétrole n'a pas succédé au charbon, alors ?
Non, c'est une vision erronée. Par exemple, le pétrole sert à faire rouler des voitures. Or, dans les années 1930, pour fabriquer une voiture, il fallait environ 7 tonnes de charbon, c'est-à-dire autant en poids que le pétrole qu'elle brûlait durant son existence.
Pour réduire le minerai de fer, il faut du coke, dont la production consomme énormément d'énergie, qui a longtemps été entièrement du charbon. Aujourd'hui encore, on produit 1,7 milliard de tonnes d'acier par an. Si on voulait le faire « vert », il faudrait 1,2 million d'éoliennes. Et si l'on voulait le faire par l'hydrogène, il faudrait la quantité d'électricité produite actuellement par les États-Unis.
- « Mon argument n'est pas technophobe. [...] La sobriété est la clé »
Plus qu'une addition d'énergies, il s'agit d'une expansion symbiotique. Jusque dans les années 1960, il était impossible d'extraire du charbon sans bois. Il faut retenir une chose de l'industrialisation : on a consommé une plus grande variété de matières et chacune a été consommée en quantité supérieure. Et si des matières diminuent, c'est en raison des interdictions : par exemple, l'amiante a dû diminuer entre 40 et 50 % depuis les années 1990.
Vous plaidez pour une histoire matérielle, au sens que le monde est fait par les matières...
Si l'on veut réfléchir sérieusement à la crise environnementale, il est indispensable de centrer le discours non pas sur les techniques, mais sur les quantités de matière. Le point important, c'est que toutes les matières croissent en dépit de plein d'innovations.
Tous vos prédécesseurs en matière d'histoire de l'énergie se sont-ils trompés ?
Les experts n'ont pas parlé de transition jusque dans les années 70, ils voyaient bien qu'il n'y avait pas d'éviction du charbon. Ce sont les futurologues qui ont commencé à en parler, et les historiens ont repris le vocabulaire technocratique à partir des années 80. Ils ont été influencés : vous êtes historien de la machine à vapeur, et d'un seul coup, vous vous transformez en historien de la transition. C'est beaucoup plus chic !
À l'heure actuelle, la transition n'a toujours pas lieu et malgré l'essor des énergies renouvelables, les fossiles représentent toujours 80 % de la consommation énergétique mondiale...
Oui, c'est à peu près stable depuis les années 1980. On n'a toujours pas passé le pic du charbon ni celui du pétrole. Il y a encore énormément de ressources fossiles. Pour l'instant, nous n'avons pas commencé la transition énergétique. Ce qu'on a fait grâce aux progrès technologiques, c'est réduire l'intensité carbone de l'économie : il faut deux fois moins de CO2 pour produire 1 dollar de PNB [produit national brut] que dans les années 1980. Mais en volume, les fossiles sont plus importants maintenant qu'alors.
Pourquoi l'idée de transition énergétique est-elle si populaire ?
Le discours de la transition est d'abord un discours de « l'âge » : l'âge du charbon, l'âge de la vapeur, l'âge de l'électricité, l'âge du pétrole. C'est un discours classique de promotion industrielle. Cela permet de situer une nouvelle technologie dans la grande fresque de l'humanité. Le problème est que les intellectuels ont pris ces propos au sérieux.
On s'est mis à parler de « l'âge de la vapeur » dans les années 1860, cela permettait de marginaliser la force humaine. Les ouvriers étaient présentés comme des résistants au progrès, la modernité comme la rencontre du génie avec la matière. Ensuite, à la fin du XIXᵉ siècle, au moment où l'électricité a commencé à faire parler d'elle, parler d'un âge électrique permettait de faire un geste assez classique dans le monde intellectuel, celui de la tabula rasa, de la table rase d'où l'on repart.
Comment est-on passé au concept de transition ?
Après 1945, un groupe de savants s'est mis à parler de transition : les atomistes américains du projet Manhattan [de création de la bombe atomique]. Un calcul avait été fait, montrant le rendement extraordinaire de la surgénération nucléaire. Ces savants voulaient montrer que ce qu'ils avaient inventé n'était pas simplement un outil de mort catastrophique, mais aussi la clé de la survie de l'humanité. Cela permettrait d'avoir une énergie abondante, illimitée. Ensuite, durant la décennie 1970 et les chocs pétroliers, la notion de crise énergétique s'est diffusée, ainsi que celle de transition énergétique.
Le président étasunien Jimmy Carter a joué un rôle clé dans cette diffusion, par un grand discours le 18 avril 1977. Il a dit : « Par le passé, nous avons déjà fait deux transitions énergétiques du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. Maintenant il faut faire une troisième transition. » Ce qu'il prévoyait, c'est le doublement de l'extraction de charbon aux États-Unis. Il y aura moins de pétrole, eh bien, on va sortir plus de charbon et on va le liquéfier.

Puis, quand Ronald Reagan a succédé, son équipe sur l'énergie était dirigée par un pétrolier texan dont le grand programme était de libéraliser et de forer davantage, en affirmant que le prix du pétrole allait baisser grâce au marché et à l'innovation. C'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, avec le gaz de schiste. La transition ne voulait plus dire grand-chose, sinon ce qui permet d'augmenter l'indépendance énergétique américaine.
Mais les écologistes ont commencé à reprendre ce vocabulaire qui naturalise les décisions énergétiques, qui est une invention du lobby atomiste, et qui est une antiphrase de la crise environnementale.
Le groupe 3 du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) explique dans son dernier rapport que la transition, c'est bien, et qu'on va y arriver.
Le Giec est un groupe intergouvernemental, pas international. C'est très important : cela signifie que les gouvernements désignent qui participe à cette instance. Lors de sa création, en 1988, les États-Unis — qui étaient de très loin les premiers émetteurs de CO2 — ont désigné pour le groupe 3 des représentants des ministères de l'Industrie, de l'Énergie, de l'Agriculture. Il fallait qu'ils internalisent la contrainte économique et c'est le rôle de ce groupe. Les États-Unis vont y faire miroiter la carte technologique comme moyen de la transition.
- « On pourrait arrêter pas mal d'avions sans qu'il ne se passe grand-chose »
Résultat, il a fallu attendre le sixième rapport en 2023 pour qu'il y ait un chapitre sur la sobriété. L'autre problème est qu'ils ont enfourché des options technologiques rocambolesques comme le stockage du carbone. Et là, je pense qu'il y a une influence du lobby pétrolier.
S'il n'y a pas de transition énergétique, que faire face à la catastrophe écologique ?
La première chose à faire, c'est avoir un regard réaliste sur ce qu'on peut faire technologiquement. Mon argument n'est pas technophobe. Il y a des progrès technologiques importants dans certains domaines, comme le solaire. Mais on ne saura pas décarboner certaines choses avant 2050, comme le ciment, l'acier ou le plastique. La sobriété est la clé. Il est indispensable de reconnaître qu'une des questions centrales est le niveau de production.
Le solaire va coûter très peu cher. Mais si c'est pour faire rouler des voitures électriques en masse qui, elles, ne sont pas du tout décarbonées, ça ne change pas le problème. Il faut toujours fabriquer la voiture, qui est de l'acier, et l'acier reste du carbone. Il faut juger l'énergie solaire dans un système en général, qui pose problème. Mon livre n'est pas une critique des renouvelables, mais de l'idée de transition énergétique : il faut replacer les renouvelables dans l'ensemble du système qu'elles vont alimenter.
Alors, comment aller vers la sobriété ?
Il faut arrêter de raconter des bêtises. Quand nos gouvernements martèlent l'idée que la décroissance est une idiotie, qu'il y a du découplage, qu'on va faire des avions à hydrogène zéro carbone, forcément, la population a envie de le croire. C'est très attirant comme perspective. Mais si l'on n'a pas un discours sérieux sur cette question, on ne fera jamais de sobriété.
La question va monter, c'est inévitable au fur et à mesure que le mur climatique va s'affirmer, que les chocs climatiques vont se répéter et que les objectifs de décarbonation deviendront parfaitement utopiques. La sobriété va devenir de plus en plus importante.
Une nouvelle histoire commencerait, celle de la décroissance ?
Quand je dis sobriété, je pense à la décroissance matérielle. On pourrait arrêter de construire des routes en France sans que cela soit une catastrophe. On pourrait arrêter pas mal d'avions sans qu'il ne se passe grand-chose, on l'a vu pendant le Covid, nous ne sommes pas morts de faim.
Pourquoi subsiste-t-il un tel espoir dans la technologie ?
En raison d'une focalisation inouïe du discours sur l'innovation. On a confondu l'innovation avec le phénomène technique en général, qui est beaucoup plus massif et large. De quoi a-t-on vraiment besoin ? Comment se répartit-on les bienfaits du carbone et les impacts ?
On peut dédommager massivement des populations qui ne pourront plus habiter là où elles habitent et imaginer les accueillir. C'est de cela dont il faudrait discuter et non pas fantasmer sur un monde zéro carbone en 2050.

Sans transition — Une nouvelle histoire de l'énergie, de Jean-Baptiste Fressoz aux éditions du Seuil, janvier 2024, 416 p., 24 euros.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
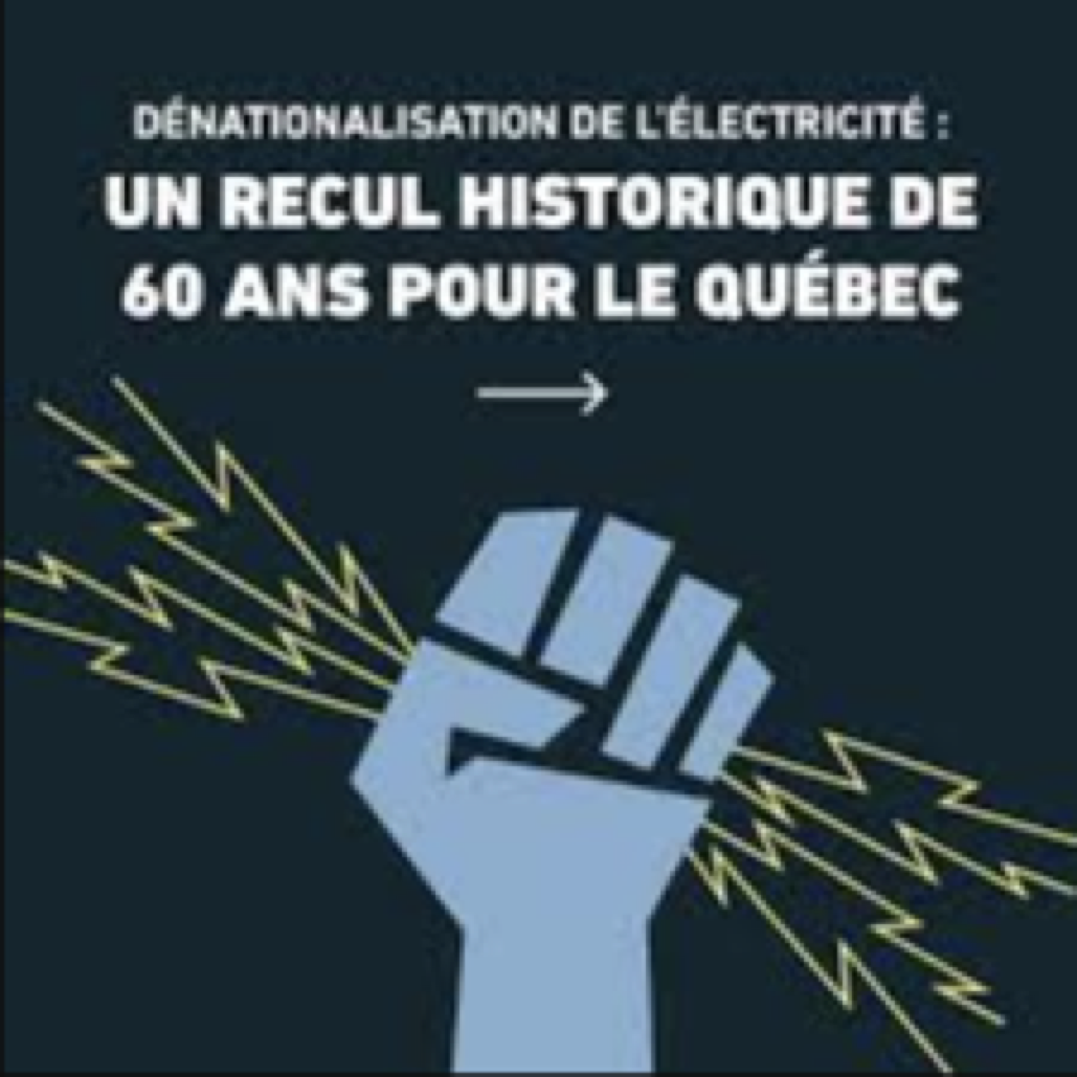
Dénationalisation de l’électricité – Des organisations dénoncent un recul historique et exigent un véritable débat public
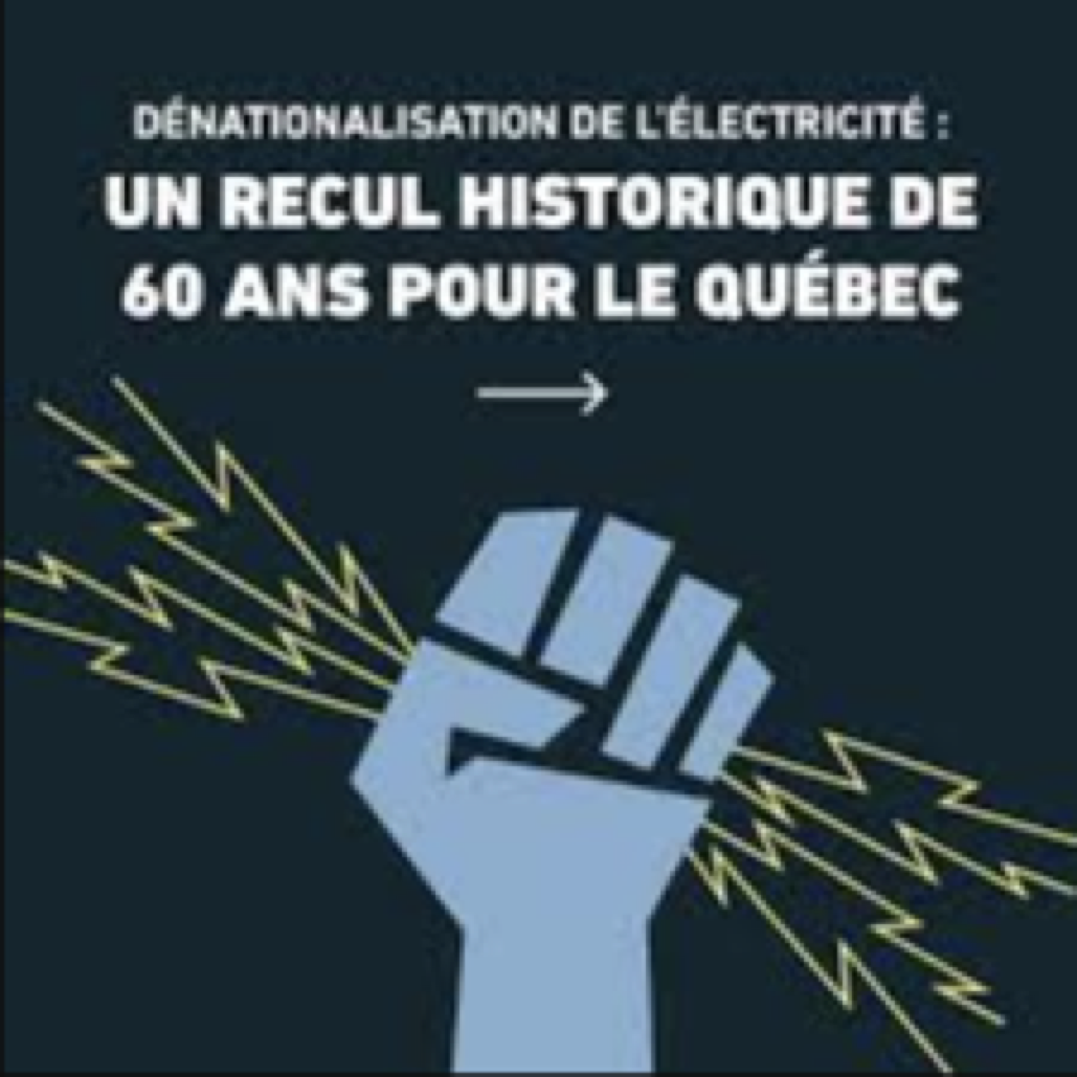
Des organisations de la société civile réagissent à l'intention du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, de déposer un projet de loi qui légaliserait la vente directe d'électricité entre entreprises privées, ce qui est actuellement interdit, et mettrait ainsi fin au monopole d'Hydro-Québec. Les organisations affirment que la proposition de dénationaliser l'électricité est un recul historique qui nous ramène 60 ans en arrière, alors que le gouvernement Legault n'a pas reçu le mandat de fragiliser ce service public essentiel qui est d'importance stratégique pour l'économie et la sécurité énergétique du Québec. L'importance des enjeux énergétiques exige qu'un véritable débat public ait lieu de manière à ce que les décisions soient prises dans l'intérêt collectif.
60 ans d'histoire et la décarbonation du Québec sont en jeu
À qui appartient la légitimité de décider de l'usage du territoire et des ressources limitées ? Selon l'approche du gouvernement, les projets industriels accapareront de façon non planifiée et non coordonnée les équipements, la main-d'œuvre, les territoires les plus économiquement avantageux et propices à la construction de nouvelles infrastructures électriques, ainsi que les retombées économiques qui y sont associées, le tout sans consultation de la population. En plus, ce manque de planification se répercuterait sur l'effort demandé et sur la facture d'électricité de l'ensemble de la population. « La population n'a jamais donné à la CAQ le mandat de renverser la décision collective prise il y a 60 ans de nationaliser l'électricité. Avant toute modification législative, il faut un plan d'ensemble et un vrai débat de société pour définir les orientations de ce plan. C'est la décarbonation du Québec, dans une perspective de transition juste, qui est en péril », soutiennent les organisations.
L'ensemble de cette situation – tout comme les pratiques douteuses employées pour soustraire d'autres dossiers comme celui de Northvolt au débat public et aux obligations environnementales – illustre dramatiquement la nécessité de tenir rapidement un exercice légitime de dialogue social sur l'avenir énergétique du Québec. Cette demande, exprimée publiquement et directement au gouvernement depuis maintenant plus d'un an par une centaine d'organisations de la société civile québécoise, reste lettre morte à ce jour. Face à ce silence, les groupes ont renouvelé leur demande, le 30 novembre dernier, en présentant à l'Assemblée nationale le Manifeste pour un avenir énergétique juste et viable, appuyé par le Parti Québécois et Québec solidaire. Plusieurs organisations ont également demandé un moratoire sur l'octroi d'électricité pour le développement industriel, le temps de se doter d'une politique énergétique et d'un plan intégré des ressources basés sur une consultation large et un débat démocratique. Cette politique et ce plan devraient être fondés sur une approche systémique incluant notamment les impacts environnementaux et sociaux.
« Une consultation en ligne, en plein été, sur un sujet restreint au développement et à l'encadrement des énergies renouvelables, ne dispense pas d'un vrai débat démocratique sur la question beaucoup plus large de l'avenir énergétique du Québec », insistent les groupes. Comme la nationalisation d'Hydro-Québec a fait l'objet d'une élection référendaire en 1962, les signataires appellent tous les groupes de la société civile à se mobiliser pour exiger que ce choix de société ne soit pas renversé arbitrairement par le gouvernement. Comme l'a synthétisé Boucar Diouf, « on n'a jamais voté pour ce qu'essaie de faire Pierre Fitzgibbon ».
*Listes des organisations signataires
Greenpeace Canada
Regroupement des organismes environnementaux en énergie
Fondation Rivières
Nature Québec
ACEF du Nord de Montréal
Mouvement écocitoyen UNEplanète
Eau Secours
Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)
Collectif Femmes pour le climat (CFC)
Solidarité Environnement Sutton
Fondation David Suzuki
Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)
Les AmiEs de la Terre de Québec
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
Collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec
Coalition Alerte à l'Enfouissement Rivière-du-Nord (CAER )
Association québécoise des médecins pour l‘environnement (AQME)
Attac Québec
Union des consommateurs
Mères au front
Regroupement vigilance hydrocarbures Québec
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À quand un plan de réduction des minéraux ? - Réaction au nouveau plan d’action 2023-2025 sur les « MCS »

Avec son deuxième Plan d'action en quatre ans publié aujourd'hui, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) du Québec vient de faire passer de 22 à 28 le nombre de minéraux qu'il considère comme « critiques et stratégiques ». Tout en soulignant les mesures liées au recyclage des résidus miniers, la Coalition Québec meilleure mine (QMM) est d'avis que seul un encadrement plus rigoureux de ce secteur pourra limiter les impacts des activités minières sur l'environnement.
La Coalition QMM déplore et dénonce l'écoblanchiment entourant les minéraux « critiques et stratégiques » en rappelant que toutes les mines entraînent des impacts nocifs et permanents sur l'environnement. Le plan annoncé devrait être financé non pas par l'argent des contribuables mais en appliquant plus sévèrement le principe pollueur-payeur dans le secteur minier. La Coalition QMM invite le gouvernement à réfléchir à un plan de réduction de l'importance accordée aux minéraux qui ne sont pas considérés critiques ou stratégiques comme l'or.
Compétition entre MCS et l'or
En alimentant depuis 2020 une rhétorique d'écoblanchiment, le gouvernement du Québec souhaite voir émerger plus de mines produisant des « MCS », mais la province a une capacité réelle limitée pour opérer plusieurs mines en même temps. Tôt ou tard, le développement des MCS risque de se buter aux autres mines.
La Coalition observe une concurrence en matière de financement et d'attractivité des travailleur-euse-s au sein de l'industrie entre les minéraux dits « d'avenir » et le secteur de l'or et des autres métaux précieux qui ne sont pas listés comme des minéraux critiques et stratégiques.
À titre d'exemple, 92% de l'or est extrait à des fins de joaillerie ou financières et n'a donc que très peu d'utilité dans la réduction des GES selon l'Accord de Paris. Les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec publiées en octobre 2023 révèlent que les métaux précieux représentaient 64,1% des sommes en travaux d'exploration et de mise en valeur en 2022, pour un total de 585 M$, soit plus de cinq fois les sommes investies par le privé pour le lithium, le graphite et les terres rares. Peu importe les substances recherchées, la Coalition Québec meilleure mine insiste sur le fait que les mesures les plus efficaces pour l'environnement reposent sur la réduction à la source de la production et de la consommation des minéraux.
Avant de chercher à pousser le développement des « MCS », le gouvernement devrait amorcer une réflexion sur l'avenir des minéraux qui nuisent non seulement directement aux efforts climatiques, énergétiques et environnementaux de la province, mais à la viabilité des projets qui pourraient avoir une contribution positive. Pour soutenir et planifier la suite de leurs économies, il est urgent d'établir un dialogue avec les communautés de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec au sein desquelles les mines d'or et de diamants s'imposent.
Meilleure utilisation des fonds publics
Avec ses multiples mesures de soutien et ses 18 millions de dollars additionnels, le gouvernement multiplie les avantages fiscaux et administratifs offerts aux minières avec l'argent des contribuables du Québec. La Coalition QMM encourage plutôt l'État à financer le plan d'action par une application plus rigoureuse du principe pollueur-payeur dans le secteur minier.
Le soutien aux minières qui prétendent faire partie de la solution environnementale devrait être financé à partir d'une tarification environnementale plus exigeante pour ce secteur industriel. La pollution de l'air et de l'eau, l'extraction de métaux précieux non classés comme « critiques ou stratégiques », la contamination des sols, le prélèvement de l'eau et l'application de sanctions plus sévères sont autant d'avenues de taxation à considérer.
Dans l'attente du plan pour encadrer l'industrie minière
La Coalition QMM demeure dans l'attente du dépôt d'un projet de loi modifiant la Loi sur les mines en rappelant que le Rapport des consultations du printemps 2023 réalisées par le MRNF est sans équivoque à l'effet que la population demande une réforme ambitieuse au bénéfice de l'environnement et des gens. Cette réforme devrait amener les parlementaires à revoir la place accordée aux secteurs de l'industrie minière qui ne font pas partie de la solution face à l'urgence climatique et environnementale.
Citation
« La solution à la crise climatique ne passe pas par plus de mines, mais par le choix d'extraire seulement les minéraux utiles dans les quantités suffisantes pour répondre aux vrais besoins dans un meilleure encadrement environnemental et social », Rodrigue Turgeon, avocat, co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine et coresponsable du programme national pour MiningWatch Canada
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bilan, analyse de la conjoncture en environnement et plan d’action

Bonjour,
Ceci est un rappel que le Réseau Militant Écologiste est de retour avec l'édition 2024 de son Assemblée Générale Annuelle ! Ce sera l'occasion de parler du plan d'action pour l'année 2024 et d'élire un nouveau comité de coordination.
Déroulement :
Accueil, tour de table
Retour sur l'année 2023
Présentation de la conjoncture
Plan d'action
Avenir énergétique (privatisation d'Hydro-Quebec)
Extractivisme (campagne sur les claims miniers)
Filière batterie (Northvolt)
Élection du COCO
Voici un lien vers la proposition sur l'avenir énergétique=AT1sCow_BjGDiwhIPp7P8Sgipybg8deYEqS9uz0aZPVBQIMNEbwT2blwrVDdaRPVkH3g7PT7_xGmO0IQnMaNgoWHh17afSS2JGMH7Gfhl6sm6t7k1CZMtx0f7pBz5_WXzLleUy2suY2GvIkSKa5YJu0NHmMU] qui a été élaborée par le RMÉ en 2023 et le manifeste du front commun pour la transition énergétique.
Un texte sur la conjoncture en matière d'environnement sera aussi présenté, accompagné du plan d'action élaboré par le COCO pour l'année 2024.
Vous pouvez lire ces documents avant la réunion, ils faciliteront notre discussion sur le plan d'action.
Lien Zoom de la réunion — mercredi 31 janvier à 19h
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Françoise Vergès : l’impossible décolonisation des musées occidentaux

Retour en vidéo sur la rencontre avec Françoise Vergès, autrice décoloniale, féministe et antiraciste pour une soirée d'échange autour de son ouvrage « Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée », au centre culturel d'Uccle (Belgique), le 15 janvier 2024. Cette soirée a réuni environ 200 personnes.
23 janvier 2023 | tiré du site du CADTM
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Black Art Exposition à Quebec

Traore Ben Sayd, en collaboration avec la Fédération des Jeunes Afro-Québécois (FJAQ) et le gouvernement du Canada, est fier d'annoncer la tenue de la deuxième édition de la Black Art Exposition Quebec. Sous le signe de la reconnaissance et de la célébration, cet événement artistique unique se tiendra le 24 février 2024, de 18h à 23h, à la Nef Saint Roch, située au 160, rue St-Joseph Est, Quebec QC G1K 3A7.
Québec, QC — 26 janvier 2024
Cette année, dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs, la Black Art Exposition mettra en lumière la femme noire et son influence déterminante dans le domaine artistique. Cette soirée exceptionnelle sera une vitrine pour le talent et la créativité des artistes noirs du Québec, offrant une plateforme d'expression et de reconnaissance de leur art.
Les visiteurs auront le privilège de découvrir une gamme diversifiée d'œuvres d'art visuel, de participer à un atelier de collage dynamique et de se laisser transporter par une performance live captivante. Cet événement gratuit est une opportunité pour les amateurs d'art et le grand public de s'engager avec la culture noire et d'en apprécier la richesse et la diversité. La réservation en ligne est obligatoire pour participer à cet événement. Les billets peuvent être réservés dès maintenant, assurant à chacun une place dans cette célébration de l'art et de la culture.
Informations supplémentaires :
• Date et Heure : 24 février 2024, de 18h à 23h
• Lieu : La Nef Saint Roch, 160, rue St-Joseph Est, Québec QC G1K 3A7
• Réservations :
https://lepointdevente.com/billets/blackartexposition2?fbclid=IwAR2778tixLRw2CWN s56207mKTsJq-vuY34z8T021QaDekZXWhX3YEd-P7m8
Nous invitons à participer à la mise en valeur de l'art noir et de la femme noire au sein de notre société. Rejoignez-nous pour une soirée où l'art est célébration, la créativité est dialogue et la femme noire est muse.
À propos de Traore Ben Sayd : Initiateur de la Black Art Exposition Quebec, Traore Ben Sayd est un acteur clé dans la promotion de l'art noir au Québec, œuvrant à mettre en avant les artistes noirs et leur contribution essentielle à la diversité culturelle de la province.
À propos de la FJAQ : La Fédération des Jeunes Afro-Québécois est une organisation dédiée à la valorisation de la jeunesse noire au Québec, soutenant l'épanouissement et la représentativité de ses membres dans tous les domaines de la société.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Art ouvrier et embourgeoisement à Chicago

“Le syndicat Union Electric (UE) de Chicago appelle à signer unepétition afin de protéger une murale réalisée dans ses locaux, en 1974, par les artistes, John Pitman Weber et José Guerrero.”
« Avec l'embourgeoisement du quartier, [Union Electric] est en train de vendre le bâtiment vieillissant, mais travaille dur pour préserver la peinture murale pour la communauté de Chicago et les générations futures. Veuillez signer cette déclaration avant le 31 janvier afin de démontrer aux bailleurs de fonds potentiels qu'il existe un large soutien en faveur de la préservation de cette partie vitale de l'histoire ! ».
Des photos d'un article du Chicago Suntime permettent d'apprécier cette fresque, réalisée gratuitement par les deux artistes autodidactes et restaurée au milieu des années 2000 à l'occasion d'une convention de l'UE à Chicago. Cette imposante œuvre d'art qui borde les escaliers intérieurs de l'immeuble du syndicat, retrace les luttes ouvrières aux États-Unis, une distribution de tracts devant une usine, un patron contraint de signer un contrat, la répression des travailleurs par un sheriff, un général, le Klu Klu Klan etc.
En août 2019, le président du Syndicat prophétisait que le plus grand danger pour la préservation de la fresque n'était pas l'usure et le temps mais la « gentrification » du quartier et avec elle la nécessité pour le syndicat de vendre l'immeuble. Il précisait cependant « nous ne sommes pas en train de solliciter des offres » d'achat.
À peine quatre ans plus tard, l'immeuble est en vente. En l'absence de mobilisation, la préservation de l'œuvre d'art semble donc désormais dépendre du bon vouloir de promoteurs immobiliers et de leurs goûts pour l'art ouvrier.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Juifs et Israéliens : deux réalités de plus en plus distinctes
L'offensive israélienne se déchaîne à Gaza et le nombre de victimes gazaouies se multiplie.
C'est le résultat de la riposte israélienne démesurée à l'offensive du Hamas réalisée le 7 octobre 2023. Il y aurait environ 24,000 victimes gazaouies selon les chiffres fournis par le Hamas contre 1,200 israéliens le 7 octobre.
Les Israéliens peuvent mener une guerre aussi meurtrière que prolongée parce qu'ils disposent d'un État appuyé par la plupart des gouvernements occidentaux et doté d'une armée puissante, équipée dans une bonne mesure par les États-Unis, indéfectible soutien de l'État hébreu.
Mais précisément, qu'observe-t-on concernant l'évolution de la société israélienne ? Plus le temps passe, et plus les différences s'accentuent entre elle et les minorités juives dispersées en Occident, particulièrement aux États-Unis. Quand une société possède un État indépendant (surtout s'il s'est édifié aux dépens d'un autre peuple) et qu'elle est entourée de gouvernements qui ne lui veulent pas de bien, elle se transforme. Ce processus relève à la fois d'une évolution interne et des relations avec les pays avoisinants. On est alors en présence d'une majorité qui doit assumer la responsabilité de la gestion d'un État souverain.
Une distance se creuse peu à peu avec les minorités occidentales dont elle est issue. D'où le contraste entre la société indépendante qu'est Israël et les minorités juives. Contrastes et ressemblances s'y côtoient. Ajoutons y la présence d'une importante minorité arabe (les Arabo-Israéliens) appelée à croître avec le temps et à gagner de l'influence politique et culturelle, ce qui va contribuer à renforcer l'évolution de la différenciation déjà évoquée.
Lorsqu'elle possède une armée puissante comme celle d'Israël et qu'elle se sent menacée, ses dirigeants et toute une large partie de son opinion publique peuvent appuyer des initiatives militaires d'envergure sans tenir compte du nombre de civils que cela provoque chez l'ennemi, peu importe le bon droit de ce dernier, dont celui à la résistance. Un virulent désir de vengeance se remarque alors.
Quand on parle de Juifs, la paranoia rôde souvent. Mais il existe une différence fondamentale entre les persécutions dont ils ont été l'objet en Europe et les manifestations de la résistance d'un peuple (les Palestiniens) dépossédé par les sionistes.
Il faut souligner ici que tous les Juifs ne sont pas sionistes et que tous les sionistes ne sont pas Juifs. Une partie de ces derniers s'oppose au sionisme pour des motifs religieux, philosophiques et moraux.
On voit souvent à priori les Juifs comme d'éternelles victimes (les pogroms l'Holocauste, les ghettos). Mais des nuances et des bémols s'imposent. En effet, il a toujours existé une violence juive. Les Juifs ont leurs propres salauds : des financiers véreux et des criminels professionnels. Il faut y joindre un fanatisme religieux chez certains (transposé sur le plan politique par plusieurs sionistes), pas plus respectable qu'aucun autre fanatisme. Il en découle chez certains Juifs un racisme anti-arabe et antimusulman, qu'on dénonce peu. Il est plus que temps de le faire.
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

J’espère

J'espère
J'espère que vous serez là, encore,
Vous qui n'acceptez pas de vous taire,
Vous qui n'avez pas renoncé,
Vous qui vous êtes battues,
Vous qui savez pourquoi,
Vous qui ne vous laissez pas berner,
Vous qui ne vous laissez pas acheter.
Vous qui pleurez de rage,
Vous qui rêvez.
J'espère
J'espère que nous trouverons,
Le chemin du changement,
Le chemin du respect,
Que de notre colère,
Ne nous grugera pas,
Mais qu'elle sera fertile,
Que les chansons semées
Sur les trottoirs gelés
Seront un jour charpente
Du monde
Qui reste à bâtir.
J'espère
Que vous serez là,
Encore,
Quand viendront d'autres temps.
Manon Ann Blanchard

Déni de réalité : pourquoi le climatoscepticisme progresse

Les discours niant le dérèglement climatique foisonnent. À force d'outils efficaces, les
climatosceptiques prospèrent et sont loin de vouloir s'arrêter, explique le chercheur Albin Wagener.
Tiré de Reporterre.net
15 janvier 2024
Par Albin Wagener
Albin Wagener est chercheur associé à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco, Plidam) et au laboratoire Prefics de l'université Rennes 2.
C'est un paradoxe de notre époque : alors que les effets du changement climatique sont de plus en plus couverts par les médias et n'ont jamais été aussi saillants pour les populations, le climatoscepticisme reprend lui des forces au gré de l'actualité climatique. D'après un sondage mené par Ipsos et le Cevipof en 2023, ce sont 43 % de Français qui refusent de « croire » au réchauffement du climat.
Plusieurs fois annoncé comme dépassé ou cantonné à des sphères complotistes, le climatoscepticisme n'en finit pas de se régénérer. Si les origines de ce courant remontent aux États-Unis, il prospère chez nous aujourd'hui via des incarnations bien françaises, comme l'a montré le récent documentaire La Fabrique du mensonge sur le sujet. Tâchons donc de revenir un peu en arrière pour comprendre le succès actuel de ces discours niant le dérèglement climatique.
Une narration efficace
Dans les années 1980, aux États-Unis, l'émergence et la propagation d'une « contre-science » du climat ont résulté de la mobilisation de think tanks liés au parti républicain et au lobbying de grandes entreprises, principalement dans le secteur de la production pétrolière, en s'inspirant par ailleurs des pratiques de l'industrie du tabac.
Le terme de « climatoscepticisme » est, à cet égard, lui-même aussi trompeur que révélateur : en liant « climat » et « scepticisme », le terme donne l'impression d'une posture philosophique vertueuse (notamment la remise en question critique et informée), et induit en erreur. Car il s'agit ici bien moins de scepticisme que de déni, voire de cécité absolue vis-à-vis de faits scientifiques et de leurs conséquences, comme le rappelle le philosophe Gilles Barroux.
Mais qu'importe : au moment de l'Accord de Paris et du consensus de plus en plus large sur le climat, le climatoscepticisme semblait réduit à portion congrue : en France, en 2019, la Convention citoyenne pour le climat montrait que le sujet pouvait être pris au sérieux tout en donnant lieu à des expérimentations démocratiques. Puis en août 2021, la loi Climat et Résilience semblait ancrer un acte politique symbolique important, bien qu'insuffisant.
« Je ne crois pas au changement climatique », a écrit l'artiste Banksy sur une façade d'un immeuble de Londres, près d'une eau stagnante rappelant une inondation. Flickr/CC BY-NC 2.0 Deed/Dunk
Pourtant, malgré ces évolutions politiques, le climatoscepticisme prospère aujourd'hui en s'éloignant de son incarnation et champ originel, puisqu'il constitue désormais une forme de discours, avec ses codes, ses représentations et ses récits. C'est précisément en cela qu'il est si dangereux : du point de vue linguistique, narratif et sémantique, il utilise des ressorts hélas efficaces, qui ont pour objectif d'instiller le doute (a minima) ou l'inaction (a maxima).
« Préserver la domination de l'Homme sur ce que l'on appelle abusivement la « Nature » »
Plus clairement, les sphères climatosceptiques vont par exemple utiliser des termes aux charges sémantiques équivoques (climatorassurisme, climatoréalisme, etc.), remettre en question la véracité des travaux du Giec [1], mettre en exergue les variations du climat à l'échelle du temps géologique (la Terre ayant toujours connu des périodes plus ou moins chaudes ou froides), ou bien encore expliquer que toute action mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique relèverait en fait de l'autoritarisme liberticide. En d'autres termes, le doute est jeté sur tous les domaines, sans distinction.
De ce point de vue, il est important de noter que le climatoscepticisme peut prendre plusieurs formes : déni de l'origine anthropique du réchauffement, mise en exergue de prétendus cycles climatiques, remise en cause du rôle du CO2 ou technosolutionnisme chevronné sont autant de variables qui donnent sa redoutable vitalité au climatoscepticisme.
Lire aussi : Christophe Cassou : « Le climatoscepticisme a la couleur de l'extrême droite »
Mais que cachent les discours climatosceptiques ? Outre les intérêts économiques, on retrouve également la préservation d'un ordre social et de systèmes de domination spécifiques : domination de l'Homme sur ce que l'on appelle abusivement la « Nature » (incluant les autres espèces, l'intégralité de la biodiversité et les ressources), exploitation des ressources nécessaires à l'activité industrielle et économique, mais aussi domination de certaines communautés sur d'autres — notamment parce que les femmes ou les populations indigènes sont plus vulnérables au changement climatique, tout en représentant également les populations les plus promptes à proposer des innovations pour contrer ses impacts.
Des cibles et intérêts marqués
Au-delà de sa pérennité, les recherches ont montré à quel point le climatoscepticisme restait efficace pour retarder l'action politique. Il ne s'agit pas ici de dire que la classe politique est climatosceptique, mais qu'un certain nombre d'acteurs climatosceptiques finissent par diffuser des discours qui font hésiter les décideurs, retardent leurs actions ou font douter quant aux solutions ou alternatives à mettre en place.
La France n'échappe pas à cette tendance : entre les coups médiatiques de Claude Allègre, l'accueil de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale ou encore les incursions de divers acteurs climatosceptiques (se désignant eux-mêmes comme climatoréalistes ou climatorassuristes), le paysage médiatique, politique et citoyen se retrouve régulièrement pollué par ce type de discours.
Doté de solides ressources financières, ce mouvement a pu contester les résultats scientifiques dans la sphère publique, afin de maintenir ses objectifs économiques et financiers.
Le Giec en a, par ailleurs, fait les frais de manière assez importante — et encore aujourd'hui ; régulièrement en effet, des scientifiques du Giec comme Jean Jouzel ou Valérie Masson-Delmotte, qui se sont engagés pour porter de manière pédagogique les travaux collectifs dans l'espace médiatique, se sont retrouvés la cible de critiques, notamment sur la véracité des données traitées, ou la raison d'être financière du groupement scientifique mondial. Cela est notamment régulièrement le cas sur les réseaux sociaux, comme le montrent les travaux de David Chavalarias.
Prôner les certitudes d'un « vieux monde inadapté »
Au-delà de ces constats informatifs, une question émerge : pourquoi sommes-nous si prompts à embrasser, de près ou de loin, certaines thèses climatosceptiques ? Pourquoi cette forme de déni, souvent mâtinée de relents complotistes, parvient-elle à se frayer un chemin dans les sphères médiatiques et politiques ?
Pour mieux comprendre cet impact, il faut prendre en considération les enjeux sociaux liés au réchauffement climatique. En effet, cette dimension sociale, voire anthropologique est capitale pour comprendre les freins de résistance au changement ; si la réaction au changement climatique n'était qu'affaire de chiffres et de solutions techniques, il y a longtemps que certaines décisions auraient été prises.
En réalité, nous avons ici affaire à une difficulté d'ordre culturel, puisque c'est toute notre vie qui doit être réorganisée : habitudes de consommation ou pratiques quotidiennes sont concernées dans leur grande diversité, qu'il s'agisse de l'utilisation du plastique, de la production de gaz à effet de serre, du transport, du logement ou de l'alimentation, pour ne citer que ces exemples.
« Il est le symptôme d'autodéfense d'un vieux monde qui refuse de mourir »
Le changement est immense, et nous n'avons pas toujours les ressources collectives pour pouvoir y répondre. De plus, comme le rappelle le philosophe Paul B. Preciado, nous sommes dans une situation d'addiction vis-à-vis du système économique et industriel qui alimente le changement climatique ; et pour faire une analogie avec l'addiction au tabac, ce ne sont jamais la conscience des chiffres qui mettent fin à une addiction, mais des expériences ou des récits qui font prendre conscience de la nécessité d'arrêter, pour aller vite. Cela étant, le problème est ici beaucoup plus structurel : s'il est aisé de se passer du tabac à titre individuel, il est beaucoup plus compliqué de faire une croix sur le pétrole, à tous les niveaux.
Paradoxalement, c'est au moment où les effets du changement climatique sont de plus en plus couverts par les médias que le climatoscepticisme reprend des forces, avec une population de plus en plus dubitative. Ce qui paraît paradoxal pourrait en réalité être assez compréhensible : c'est peut-être précisément parce que les effets sont de plus en plus visibles, et que l'ensemble paraît de plus en plus insurmontable, que le déni devient une valeur refuge de plus en plus commode. Il s'agirait alors d'une forme d'instinct de protection, qui permettrait d'éviter de regarder les choses en face et de préserver un mode de vie que l'on refuse de perdre.
Si le climatoscepticisme nous informe sur nos propres peurs et fragilités, il est aussi symptomatique du manque de récits alternatifs qui permettraient d'envisager l'avenir d'une tout autre manière. En effet, pour le moment, nous semblons penser la question du changement climatique avec le logiciel politique et économique du XXe siècle. Résultat : des récits comme le climatoscepticisme, le greenwashing, le technosolutionnisme (le fait de croire que le progrès technique règlera le problème climatique), la collapsologie ou encore le colibrisme (le fait de tout faire reposer sur l'individu) nous piègent dans un archipel narratif confus, qui repose plus sur nos croyances et notre besoin d'être rassurés, que sur un avenir à bâtir.
De fait, le climatoscepticisme prospère encore, car il est le symptôme d'autodéfense d'un vieux monde qui refuse de mourir. Sans alternative désirable ou réaliste, alors que nos sociétés et nos économies sont pieds et poings liés par la dépendance aux énergies fossiles, nos récits sont condamnés à tourner en rond entre déni, faux espoirs et évidences trompeuses.
C'est bien là tout le problème : si les chiffres sont importants pour se rendre compte de l'importance du changement et de ses conséquences (y compris pour mesurer les fameux franchissements des limites planétaires), ce n'est pas avec des chiffres seuls que l'on met en mouvement les sociétés et les politiques. Les tenants du climatoscepticisme ont parfaitement compris cette limite, en nous proposant les certitudes confortables d'un vieux monde inadapté, face aux incertitudes paralysantes d'un avenir qui sera radicalement différent du monde que nous connaissons, mais que nous avons le choix de pouvoir écrire.
Cette tribune a été initialement publiée sur le site The Conversation.
1. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un hommage à Vivian Silver

Présentation : Vivian Silver (1949-2023) était une militante israélienne pour la paix et pour les droits des femmes. Elle a passé une grande partie de sa vie à faire campagne pour la liberté des Palestiniens et la fin de l'occupation. Elle a été tuée lors du massacre de Beere par le Hamas le 7 octobre 2023. Cet hommage a été publié pour la première fois le 14 novembre. Samah Salaime est une féministe et écrivaine palestinienne.
22 janvier 2024 | tiré d'aplusoc
https://aplutsoc.org/2024/01/22/un-hommage-a-vivian-silver-par-samah-salaime/
Hommage
La dernière fois que j'ai vu Vivian, c'était à Washington, D.C., lors d'une réunion ad hoc de militants palestiniens et israéliens en marge d'une conférence. Nous nous sommes réunis pour une séance de réflexion sur la difficile question de savoir comment relancer notre camp – le camp libéral-gauche-démocrate, comprenant à la fois Juifs et Palestiniens – après les élections israéliennes catastrophiques de novembre 2022 qui ont porté au pouvoir le gouvernement le plus d'extrême droite de l'histoire du pays. Nous avons ri, plaisanté et blagué, nous moquant de notre situation, mais il y avait une grande tristesse dans cette pièce lorsque Vivian a déclaré : « Je suis trop vieille pour créer et construire un autre corps politique ; je dois rejoindre ce qui existe déjà. »
« Ce qui est bien dans le fait d'être une vieille retraitée sarcastique, c'est que je peux dire à haute voix ce que je pense et je n'ai rien à perdre », a-t-elle poursuivi. « Notre camp a perdu plusieurs fois ; nous avons reçu de nombreux coups dans la figure. Et j'ai aussi vécu beaucoup de choses dans ma propre vie. J'ai beaucoup appris, à mes dépens, sur le partenariat arabo-juif, et je sais que lorsqu'il réussit, il réussit parce que chaque partie comprend que la justice qu'elle recherche dépend fortement de la justice de l'autre partie. Combler l'écart passe par un travail collaboratif et non par une lutte les uns contre les autres. »
Rien ne m'a préparé à l'amère nouvelle d'hier concernant la fin tragique de Vivian. J'ai ressenti un profond désespoir, comme si un gouffre sans fond s'était ouvert sous les fondations de l'humanité, où des milliers de personnes sont déjà enterrées – hommes, femmes, enfants, Palestiniens et Israéliens innocents. Des gens qui avaient souhaité la paix et qui n'ont pas vécu assez longtemps pour voir ce souhait se réaliser.
Déjà 39 jours se sont écoulés depuis ce terrible samedi 7 octobre. J'ai lu les messages que Vivian et son fils se sont envoyés alors qu'elle se cachait dans un placard contre les militants palestiniens qui ont attaqué le kibboutz Beeri. C'était comme si je sentais son cœur battre plus fort que les pas des meurtriers dans son salon.
J'ai essayé mille fois de l'imaginer emmenée dans leurs voitures à Gaza. « Qu'a-t-elle ressenti pendant ces moments ? » Je me demandais. Je pensais qu'elle aurait pu regarder avec des larmes de compassion dans les yeux les dizaines d'enfants palestiniens en haillons debout sur les bords des routes de Gaza, et qu'elle aurait peut-être prié pour eux dans son cœur. Vivian savait à quoi ressemblaient leurs vies sous le siège israélien, et elle aurait su ce qui allait leur arriver lorsque l'armée israélienne a commencé son assaut sans précédent sur la bande de Gaza.
« As-tu entendu ces bombes tomber là où tu étais ? » Je me suis dit. Ces bombes que tu détestais, parce que tu savais mieux que quiconque qu'elles n'apporteraient aucune solution ni sécurité à aucun d'entre nous.
Je m'étais convaincu que tu étais dans un endroit sûr, essayant de communiquer dans un Arabe mutilé avec ceux de ton entourage et essayant d'expliquer qui tu étais et ce que tu représentais : une activiste née sans réserve. Je t'imaginais réconfortant les enfants pris en otage avec toi, les occupant et calmant les autres femmes retenues sous terre pendant que la terre tremblait sous les frappes aériennes israéliennes. Les images que j'avais en tête et le titre que je n'arrêtais pas d'imaginer – « Une militante pour la paix libéré » – ne parviendront jamais aux médias. Au lieu de cela, hier soir, nous avons lu : « Une activiste du Corps de la Paix de Beeri identifiée. »
Jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas cru un seul instant que tu n'étais plus parmi nous. J'étais sûr que tu survivrais à ce mal et que tu vivrais pour nous en parler, et même nous divertir avec des histoires sur la jalabiya qu'on t'avait donné de porter – une faite pour une femme beaucoup plus grande que ta petite silhouette. Vivian, ma chérie, nous n'aurons jamais ce moment.
Une « épée de fer » ne peut que tuer !
Vivian Silver est née à Winnipeg, au Canada, en 1949, et a immigré en Israël en 1974. Pendant des dizaines d'années, elle a été une militante sociale impliquée dans des projets promouvant les droits des femmes et plaidant pour la paix. En tant que codirectrice du Centre arabo-juif pour l'autonomisation, l'égalité et la coopération – Institut du Néguev pour les stratégies de paix et de développement économique (AJEEC-NISPED), elle a travaillé pour améliorer la vie de la communauté bédouine du Naqab/Negev, contribuer à faire progresser une société partagée. Elle était active au sein de l'organisation Women Wage Peace, membre du conseil d'administration du groupe de défense des droits humains B'Tselem et bénévole pour The Road to Recovery, qui aide à transporter les patients [palestiniens] atteints de cancer de Gaza vers les hôpitaux israéliens.
L'une des choses qu'elle répétait souvent, et qui résume, je pense, sa philosophie de vie, c'est : « Si le seul outil dont vous disposez est un marteau, alors chaque problème ressemble à un clou. » Je lui ai dit un jour : « Tu sais, le peuple palestinien n'est pas un morceau de bois, pas même un morceau de métal. Nous sommes faits de roche dure, il sera donc difficile pour un marteau entre les mains d'un idiot de nous écraser. »
Vivian croyait au pouvoir des femmes et au pouvoir de la compassion et de l'amour – dans le sens simple et complètement naïf de ces mots. Elle savait, comme beaucoup d'entre nous, Palestiniens et militants pacifistes israéliens, que l'armée ne peut pas apporter la paix et qu'une « épée de fer » – le nom que l'armée israélienne a donné à son « opération » à Gaza – ne peut que tuer. Le marteau écrase tout sur son passage. Même ceux d'entre nous, Palestiniens et Israéliens, qui survivront à cette guerre en sortiront écrasés par le chagrin.
Nous érigerons une tente de deuil par misère et par regret face à la montagne de victimes et aux destructions qui subsistent. Et aucun « déluge d'Al Aqsa » – comme le Hamas a appelé sa propre « opération » du 7 octobre – ne rendra les milliers d'enfants qui ont perdu la vie à Gaza et dans le sud ; aucun drapeau de victoire ne flottera sur les côtes de Gaza alors qu'elles sont frappées par les vagues sanglantes de l'assaut israélien.
Là-dessus, Vivian, je sais que tu rencontreras tes amis – parmi lesquels Eiman, Tofaha et Maha, partenaires militants palestiniens de Gaza. Tu seras accueillie par des milliers d'autres victimes, notamment des femmes qui n'ont jamais cessé de lutter pour la paix et des Palestiniens qui ont été assassinés par l'armée israélienne et enterrés sous les décombres alors qu'ils tenaient toujours leurs enfants pendant que nous priions pour leur sécurité.
Source : https://workersliberty.org/story/2024-01-17/tribute-vivian
Traduction par nos soins. (aplusoc)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les travailleurs exigent un cessez-le-feu : l’UAW et les syndicats des travailleurs de l’électricité et des postes appellent à la fin de l’assaut israélien contre Gaza. 1ère partie.

Introduction Aplutsoc
Il se passe des choses dans le mouvement ouvrier américain. Des secteurs comme celui de l'UAW qui a récemment mené une vague de grèves pour maintenir une convention collective digne de ce nom dans l'automobile, prennent leur distance avec la politique étrangère de Biden concernant Israël et la Palestine. Nous entamons la publication de documents issus d'interviews réalisés par la journaliste Amy Goodman sur son site Democracy Now !, un média de référence au sein de la gauche US.
18 janvier 2024 | tiré de de Democracy now | traduction aplusoc | Bill Fletcher (à gauche) et Jeff Schuhrke
Source : https://www.democracynow.org/2023/12/26/us_labor_movement_israel_palestine
Présentation par Democracy Now
Les syndicats à travers les États-Unis ont commencé à évoluer d'une longue histoire de soutien à Israël vers une condamnation de l'occupation israélienne de la Palestine, au milieu d'appels croissants pour un cessez-le-feu à Gaza où l'offensive israélienne de 80 jours a tué plus de 20 000 personnes. Alors que les demandes de cessez-le-feu, des enseignants aux travailleurs de Starbucks, sont publiées à travers le pays et qu'une grande marche menée en partie par les responsables syndicaux à New York a appelé les membres du Congrès à cesser de prendre l'argent de la campagne menée par les lobbyistes pro-israéliens, Democracy Now ! s'entretient avec le syndicaliste de longue date Bill Fletcher et l'historien du travail Jeff Schuhrke, de l'histoire des relations du mouvement syndical américain avec Israël et la Palestine, du conflit entre le sioisme de Biden et son soutien aux syndicats et de la « chute libre » du mouvement syndical sur la manière de répondre à la guerre contre Gaza.
AMY GOODMAN : Nous observons à présent la pression croissante du mouvement syndical américain sur le président Biden pour qu'il exige un cessez-le-feu dans l'attaque israélienne contre Gaza, soutenue par les États-Unis. Les syndicats ont aidé à organiser une marche vers le siège de l'AIPAC(1) ici à New York jeudi dernier pour appeler les législateurs à refuser l'argent des lobbyistes pro-israéliens pour leur campagne. Il s'agit du président de United Auto Workers, Shawn Fain, qui s'exprime aux côtés de membres progressistes du Congrès lors d'une conférence de presse jeudi à Capitol Hill.
Extraits de reportage télévisé
SHAWN FAIN : Nous ne pouvons pas bombarder notre chemin vers la paix.
REP . CORI BUSH (2) : C'est vrai !
SHAWN FAIN : La seule voie à suivre est de construire la paix et la justice sociale, par le biais d'un cessez-le-feu. … En tant que syndiqués, nous savons que nous devons nous battre pour tous les travailleurs et toutes les personnes qui souffrent dans le monde. Nous devons lutter pour l'humanité. Cela signifie que nous devons restaurer les droits fondamentaux de la population et permettre à l'eau, à la nourriture, au carburant et à l'aide humanitaire d'entrer à Gaza. »
[Fin des extraits]
AMY GOODMAN : Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par deux invités. à Washington.
A Washington Bill Fletcher, syndicaliste de longue date, co-fondateur du Réseau de solidarité avec l'Ukraine (USC), membre du comité de rédaction de The Nation , où son dernier article est intitulé « Gaza, Biden et une voie à suivre ».
Et à Chicago, nous sommes rejoints par Jeff Schuhrke. Il est historien du travail, journaliste, militant syndical et professeur adjoint à la School of Labour Studies de la SUNY Empire State University à New York. Son dernier article pour Jewish Currents est « Le problème de la machine de guerre syndicale ». Ses articles récents pour In These Times , « L' AFL-CIO a écrasé la résolution de cessez-le-feu de son Conseil. Qu'est-ce que cela dit sur le mouvement ouvrier à l'heure actuelle ? » et « L'histoire du soutien à Israël par le mouvement ouvrier – et « Le changement climatique pendant la guerre à Gaza », qui a également été publié dans le magazine Jacobin sous le titre « Le mouvement ouvrier américains devrait agir avec audace et choisir la solidarité avec la Palestine ».
Nous vous souhaitons la bienvenue à Democracy Now ! Jeff Schuhrke, commençons par vous. Si vous pouviez simplement passer en revue tous les syndicats, depuis le Syndicat des Postiers unis jusqu'au puissant UAW , United Auto Workers, et parler du militantisme pour Gaza auquel nous assistons aujourd'hui ?
JEFF SCHUHRKE : Bonjour et merci de m'avoir invité.
Oui, depuis octobre, des dizaines de syndicats et d'organisations syndicales aux niveaux local, des états, aux niveaux régional et national ont appelé à un cessez-le-feu. Il y a une déclaration, un mouvement syndical américain qui appelle à un cessez-le-feu. Cela comprend un appel au retour de l'approvisionnement en nourriture, en carburant, en eau et en électricité à Gaza et un appel à la libération de tous les otages, lancé vers le 17 octobre par le syndicat United Electrical Radio and Machine Workers (UE) qui est un syndicat relativement petit, mais historiquement très progressiste ici aux États-Unis. Ainsi, l'UE, aux côtés des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (UFCW, section locale 3000), a lancé cette pétition en appelant au cessez-le-feu et a demandé à d'autres syndicats à y adhérer. Et jusqu'à présent, comme je l'ai dit, je ne compte plus ceux qui y ont adhéré. Et d'autres syndicats ont également publié leurs propres déclarations et résolutions appelant à un cessez-le-feu. Il s'agit de syndicats d'enseignants et de travailleurs universitaires, de travailleurs de la santé, de couvreurs, de peintres, de dockers.
AMY GOODMAN : Pouvez-vous énumérer certains des syndicats ?
JEFF SCHUHRKE : Oui, oui, bien sûr. Certainement. J'ai donc mentionné le United Electrical Workers, l'American Post Workers Union, le United Auto Workers, le 1199 SEIU, qui est le plus grand syndicat de soins de santé du pays, le National Nurses United, l'International Longshore and Warehouse Union Local 10, le Chicago Teachers Union, le Boston Teachers Union, plusieurs sections locales de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, et ainsi de suite. Cela prendrait beaucoup de temps.
Mais ceux-ci représentent des millions de travailleurs à travers le pays. Et je pense que cela illustre le fait que, comme le montrent régulièrement les sondages, une majorité de personnes dans ce pays soutiennent les appels à un cessez-le-feu. Et lorsque vous parlez de la majorité de la population de ce pays, vous parlez de ceux de la classe ouvrière. Et quand ils ont des organisations, comme les syndicats, qui représentent leurs voix, qui leur donnent démocratiquement la parole, alors vous allez voir ces organisations, ces syndicats exprimer la position de la classe ouvrière, qui dans ce cas est un appel à la fin du massacre et un cessez-le-feu. Oui.
JUAN GONZÁLEZ : Mais, Jeff, nous avons évidemment encore un nombre considérable de syndicats nationaux qui ne prennent pas cette position. Et vous avez expliqué, dans des articles précédents, le rôle de l' AFL-CIO dans le soutien basique, pendant des décennies et des décennies, des projets de l'empire américain à travers le monde. Et vous avez écrit sur ce gars, Jay Lovestone, qui était un ancien communiste et qui a joué un rôle majeur dans la participation de l' AFL-CIO avec la CIA à des entreprises impérialistes. Je me demande si vous pourriez en parler à certains de nos jeunes téléspectateurs et auditeurs qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Jay Lovestone.
JEFF SCHUHRKE : Oui. Il y a une histoire vraiment malheureuse et affreuse de la bureaucratie syndicale américaine, et de l' AFL – CIO en particulier, qui a travaillé main dans la main avec l'appareil de la politique étrangère des États-Unis, spécialement pendant les décennies de la guerre froide, entre les années 1940 et 1990 environ, en collaborant avec le Département d'État, la CIA et d'autres entités du gouvernement fédéral pour tenter de saper les syndicats dans les pays étrangers, en particulier les syndicats plus à gauche, les syndicats anti-impérialistes, et diviser les mouvements ouvriers. Jay Lovestone (3) a été pendant de nombreuses années directeur du département des affaires internationales de l'AFL-CIO. Il était également un agent de la CIA . C'est une longue histoire.
Mais surtout lorsqu'il s'agit d'Israël et du sionisme, il y a aussi une longue histoire dans laquelle les directions syndicales américaines sont parmi les plus fervents partisans du mouvement sioniste aux États-Unis, remontant jusqu'en 1917, et soutiennent fortement l'État d'Israël, pas seulement d'un soutien en paroles ou politique, mais aussi un soutien matériel, avec des millions et des millions de dollars donnés par les syndicats américains, d'abord aux premières colonies sionistes, avant l'État d'Israël, puis à l'État d'Israël pour le logement, pour les cliniques, pour les centres communautaires, les stades de sports. Ainsi, tout au long des années 1950 et 1960, dans les premières décennies d'Israël, bon nombre de ces types d'établissements publics portaient les noms de célèbres dirigeants syndicaux américains, comme Walter Reuther, George Meany, Jimmy Hoffa, vous savez, des orphelinats et des stades sportifs nommés après les dirigeants syndicaux américains en raison de ce soutien matériel. Il y a aussi les obligations de l'État d'Israël, dont les syndicats américains sont parmi les plus gros acheteurs depuis de nombreuses décennies. Il s'agit de l'argent que les syndicats américains reçoivent en cotisations, en fonds de retraite ou en fonds de santé, et qui est directement investi dans l'État d'Israël pour des projets d'infrastructures.
JUAN GONZÁLEZ : Eh bien, Jeff, en ce qui concerne spécifiquement ces obligations israéliennes, je me souviens avoir participé dans les années 1980 à une collecte de fonds des syndicats de Philadelphie pour la fédération du travail israélienne. Et l'un des dirigeants s'est levé à ce moment-là et a déclaré : « Nous investissons des millions de dollars dans des obligations israéliennes provenant de notre fonds de pension, mais les membres me disent parfois qu'elles ne produisent pas un aussi bon rendement. Mais je leur dis que c'est la bonne chose à faire. Ainsi, de nombreux syndiqués ne savent pas que leurs fonds ont été investis dans des obligations israéliennes pendant des décennies.
JEFF SCHUHRKE : Oui. Mais il y a aussi eu une sorte de mouvement lent mais sûr – lentement mais sûrement, de la base, pendant plusieurs décennies, pour tenter de lutter contre cela. Il y a 50 ans, en 1973, les travailleurs arabes américains de l'automobile de Détroit, membres du syndicat United Auto Workers UAW), ont organisé une grève sauvage à l'usine d'assemblage Dodge Main, pour protester contre la décision de la direction de l'UAW d'acheter pour 785 000 $ d'obligations de l'État d'Israël et ont appelé les dirigeants de l'UAW à désinvestir.
Ainsi, au cours des 20 dernières années environ, vous savez, il y a eu le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), dirigé par des Palestiniens, y compris des syndicats palestiniens, et certains syndicats aux États-Unis ont tenté de soutenir le BDS et ont parlé de la façon dont leurs propres fonds, leurs propres cotisations et fonds de pension, sont investis en Israël.
C'est donc l'un des éléments importants, à mon avis, de l'appel récent à un cessez-le-feu lancé par l'UAW. Ils ont également créé un nouveau groupe de travail appelé Groupe de travail sur le désinvestissement et la transition juste qui va examiner les propres investissements de l'UAW en Israël pour discuter d'un éventuel désinvestissement et quand ils parlent de transition juste, ils parlent de l'industrie de l'armement, parce que l' UAW représente des milliers de travailleurs des usines d'armement américaines, des armes qui sont envoyées en Israël. Et si nous voulons parler de la fermeture de ces usines, nous devons aussi parler de ce qui arrive aux gens qui y travaillent et qui sont syndiqués. Et donc, une transition juste est proche d'une idée similaire : ce qui arrive aux travailleurs des combustibles fossiles lors de la transition vers une économie verte, en s'assurant – et cela remonte à un précédent, vous savez, dans les années 1970 et 1980, des appels à une économie de conversion, ou conversion d'une économie de temps de guerre à une économie de temps de paix. Ainsi, le fait que la nouvelle direction de l' UAW, sous la direction du président Shawn Fain, se soit engagé à œuvrer pour atteindre ces objectifs est, je pense, probablement encore plus significatif que les appels à un cessez-le-feu, car, après tout, un cessez-le-feu est en quelque sorte un strict minimum ici.
AMY GOODMAN : Bill Fletcher, je voulais vous faire entrer dans ce débat. Vous faites partie du comité de rédaction de The Nation , votre nouvel article intitulé « Gaza, Biden et une Voie à suivre ». Et vous avez écrit , pour In These Times , « La plus grande menace du mouvement fasciste : les syndicats ». Pouvez-vous parler de ce que cela signifie ?
BILL FLETCHER : Amy, Juan, merci de m'avoir invité dans ce programme.
Si je le peux, je veux juste dire une chose avant d'aborder cette question. Le mouvement syndical américain a toujours été divisé sur les affaires internationales, depuis la guerre hispano-américaine jusqu'à la guerre civile espagnole, en passant par la guerre du Vietnam, l'Amérique centrale et l'Afrique du Sud. Ce qui a été une position généralement confirmée, pour en revenir à votre point, Juan, se situe au niveau de la direction nationale de l' AFL – CIO , et la plupart des syndicats ont été largement en phase avec la politique étrangère américaine, mais pas toujours. Maintenant, ce qui est différent, c'est que lorsqu'il s'agit d'Israël et de la Palestine, jusqu'à assez récemment, au niveau national, il n'y avait presque aucune discussion sur des points de vue alternatifs par rapport au soutien à Israël. Et donc, c'est ce qui change, et il est vraiment très important de le souligner.
Et l'une des choses, Amy, en réponse à votre question, c'est qu'il existe une grande peur au sein du mouvement syndical quant à ce qui va se passer en novembre 2024 et à ce qui se passera que ce soit Biden ou qui que ce soit qui soit élu. Ainsi, avec l'attaque du 7 octobre, le Hamas et le génocide israélien qui a suivi, le mouvement syndical s'est retrouvé dans une impasse quant à la manière de réagir. Et une partie de cette réponse consiste à revenir à sa position générale de soutien à tout ce que fait Israël. Une autre position est celle du silence. Et puis une position croissante, que nous observons maintenant, et qui est représentée par l' APWU , l'UAW , le NNU et d'autres, consiste à adopter une position critique sur les points de vue ou sur la politique des États-Unis et d'Israël. Et c'est là que nous devrions avoir de l'espoir.
AMY GOODMAN : Et qu'en est-il du président Biden, Bill Fletcher ? Vous avez cette discussion vraiment intéressante en ce moment alors que nous entrons dans l'année de l'élection présidentielle. Regardez le Michigan, l'immense communauté arabo-américaine de Dearborn, vous savez, les United Auto Workers si puissants. Et il semble que, pour le moins, il ait rendue furieuse la communauté arabo-américaine- palestinienne du Michigan– bien qu'il soit l'un des plus forts supporters des syndicats si l'on regarde les présidents.
BILL FLETCHER : Eh bien, ils sont légitimement furieux. Et le reste d'entre nous devrait l'être. Comme vous l'avez dit, Biden est probablement le président le plus pro-travailleurs que nous ayons eu depuis des décennies. Mais le problème avec sa réponse à Gaza, qui est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il devrait vraiment se retirer et qu'il devrait y avoir un autre candidat à la présidence sur la liste démocrate, c'est que Biden est fondamentalement sioniste. Il y croit. Je veux dire que ce n'est pas seulement le genre d'opportunisme que nous avons vu avec Obama, en réalité, je ne pense pas qu'il était sioniste, mais pour des raisons très opportunistes, il était prêt à s'aligner sur le soutien d'Israël sur de nombreux points. Je pense que Biden lui y croit réellement.
Et sa proximité avec Netanyahu défie la politique. Cela défie la réalité. Cela défie l'humanité de ne pas pouvoir regarder ce qui se passe et, même au niveau politique pragmatique, dire : « Attendez une minute. Attendez. Attendez. Réévaluons la situation » et, au mieux, appelons à une plus grande aide humanitaire aux Palestiniens. C'est inacceptable. Et je pense que c'est pourquoi il est vraiment important de marteler l'administration avec la question de la Palestine. Nous y reviendrons en novembre.
AMY GOODMAN : Nous allons devoir en rester là, Bill, mais nous allons poursuivre la discussion et la publier en ligne sur freedomnow.org
Notes
AIPAC ou American Israël Public Affairs Committee est un lobby créé en 1963 aux États-Unis visant à soutenir Israël.
Cori Bush, née le 21 juillet 1976 à Saint-Louis (Missouri), est élue pour le Parti Démocrate lors des élections fédérales de 2020 à la Chambre des représentants des États-Unis dans le 1er district congressionnel du Missouri. Elle est membre des Democratic Socialists of America (DSA)
Jay Lovestone a été durant les années 1920s le dirigeant de la fraction des boukhariniens au sein du PC américain. Après la défaite de Nicolas Boukharine et de ses partisans au sein de l'Internationale Communiste et du PCUS, puis de la répression de tous les courants issus du bolchevisme au sein du parti communiste d'URSS durant les purges sanglantes de 1936 à 1938, Jay Lovestone changea d'allégeance et mit sa fraction au service des dirigeants syndicaux du CIO. En 1948, son fidèle lieutenant Irwing Brown fut celui qui apporta les « fameuses » valises de dollars donnés par le CIO aux fondateurs de Force Ouvrière. Le CIO sera ensuite caricaturé en « AFL-CIA » par les staliniens alors même que l'AFL-CIO ne naîtra que plus tard (1955) de la fusion de l'AFL et du CIO.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les travailleurs exigent un cessez-le-feu : l’UAW et les syndicats des travailleurs de l’électricité et des postes appellent à la fin de l’assaut israélien contre Gaza. 2ème partie

Suite de l'article qui traite de la façon dont des secteurs de gauche du syndicalisme américain réagissent au contexte international marqué par la guerre à Gaza … et en Ukraine.
23 janvier 2024 | tiré de Democracy now ! | traduction aplutsoc | Photos ; Bill Fletcher (à gauche) et Jeff Schuhrke (à droite)
AMY GOODMAN : Nous poursuivons avec la deuxième partie de notre examen de la manière dont le mouvement syndical américain augmente la pression sur le président Biden pour qu'il exige un cessez-le-feu dans l'offensive israélienne soutenue par les États-Unis, contre Gaza. Les syndicats ont aidé à organiser une marche vers le siège de l'AIPAC – l'American Israel Public Affairs Committee – ici à New York jeudi dernier, pour appeler les législateurs à cesser d'accepter les contributions financières à la campagne des lobbyistes pro-israéliens. Les syndicats ont appelé à un cessez-le-feu – parmi eux, United Auto Workers, United Electrical Workers, American Post Workers Union, 1199SEIU, les syndicats d'enseignants de Chicago et de Boston, pour n'en citer que quelques-uns.
Pour en savoir plus, nous sommes rejoints à Chicago par Jeff Schuhrke, historien du travail, journaliste et professeur adjoint à la School of Labour Studies de la SUNY Empire State University, ici à New York et à Washington, DC, par Bill Fletcher, syndicaliste de longue date, membre du Réseau de solidarité avec l'Ukraine, membre du comité de rédaction de The Nation , qui a écrit un certain nombre d'articles sur Gaza et Biden.
JUAN GONZÁLEZ : Oui, je voulais commencer par Bill Fletcher. Bill, dans la première partie de notre entretien, vous avez soulevé la question sur laquelle vous avez écrit, suggérant, étant donné la profonde impopularité du président Biden, en particulier parmi les jeunes, compte tenu de sa position sur l'attaque israélienne, la poursuite des attaques contre Gaza , que le président Biden devrait démissionner – ou accepter de ne pas se représenter. Et je voulais explorer cela un peu plus avec vous, parce que, clairement, ce n'est pas inconcevable. Pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 1960, le président Johnson a annoncé le 31 mars d'une année électorale qu'il ne se présenterait pas à la réélection, compte tenu de l'énorme échec de sa politique au Vietnam, ce qui a déclenché une course effrénée. Bobby Kennedy s'est lancé dans la course. Eugene McCarthy, bien entendu, était à l'époque le candidat anti-guerre. Et cela s'est terminé par une convention négociée, avec Hubert Humphrey comme candidat. Mais bien sûr, Humphrey a ensuite été battu par Richard Nixon aux élections générales. Je me demande ce que vous pensez du genre de scénario qui pourrait éventuellement se produire si la pression augmentait sur Biden pour qu'il se retire.
BILL FLETCHER : Merci, Juan. Donc, pour clarifier, vous avez raison : je cherche à ce que Biden ne cherche pas à être réélu, fondamentalement… une répétition de ce que nous avons eu en 1968, comme vous l'avez souligné, avec le retrait de Johnson. Et je pense que cette discussion a lieu dans tout le pays. Vous savez, avant le 7 octobre, je n'étais pas tellement préoccupé par l'impopularité de Biden. C'est très courant. Mais ce qui s'est passé après le 7 octobre est très troublant, car il perd des électeurs plus jeunes, et particulièrement des électeurs de couleur, qui sont vraiment consternés par sa position sur Israël, la Palestine et la guerre à Gaza. Et donc, c'est vraiment ma préoccupation en ce moment. Et nous devons avoir, à l'approche du mois de novembre, un front fort contre les forces MAGA , actuellement dirigées par Trump. Je ne pense pas que Biden puisse faire cela pour le moment.
Donc il y a un certain nombre de possibilités. Le plus important, je pense, est que s'il y a suffisamment de pression, il peut alors se retirer, ce qui ouvre de nombreuses discussions sur un candidat alternatif. Et cela nous amènerait probablement à la convention démocrate. Maintenant, beaucoup de gens diront : « Oui, mais regardez ce qui s'est passé en 1968. Il y avait une opposition à Johnson. Johnson se retire et Nixon gagne. Et c'est exact. Et le refus d'Humphrey de se démarquer de la politique de Johnson a tué son élection – sa possibilité d'être élu. Espérons que nous en aurons tiré une leçon.
AMY GOODMAN : Jeff Schuhrke, vous avez écrit un article sur les syndicats des industries de l'armement et la machine de guerre américaine. Pouvez-vous expliquer.
JEFF SCHUHRKE : Oui. Comme nous le savons, l'assaut contre Gaza est en réalité alimenté et financé par le gouvernement américain, à bien des égards, et les armes utilisées à Gaza, les missiles, les bombes, les avions de combat, ont été fabriqués ici aux États-Unis. . Ainsi, lorsque nous parlons de syndicats appelant à un cessez-le-feu ou de syndicats jouant un rôle pour mettre fin à la violence, nous devons évoquer le fait que de nombreux travailleurs des usines d'armement ici aux États-Unis, de nombreuses personnes qui travaillent dans le complexe militaro-industriel, sont membres de syndicats, représentés par des syndicats comme l' UAW et l'Association internationale des machinistes (IAM).
Et je dois également dire – dans un contexte important – que les syndicats palestiniens, y compris la Fédération générale palestinienne des syndicats, ont lancé un appel international à la solidarité envers les syndicats d'autres pays du monde, leur demandant de ne pas participer à la fabrication ou au transport. d'armes pour Israël. Cela crée donc une sorte de dilemme pour le mouvement syndical américain, en particulier pour les militants syndicaux anti-guerre, s'ils sont opposés à l'attaque actuelle d'Israël sur Gaza ou s'ils sont simplement opposés au militarisme, à la guerre et à l'impérialisme en général.
Si nous voulons parler de l'arrêt de la machine de guerre et du démantèlement du complexe industriel – militaro-industriel, nous devons reconnaître le fait qu'il y a environ 2 millions de travailleurs américains dans l'industrie de la défense et de l'aérospatiale, et qu'au moins des dizaines de milliers d'entre eux sont membres de syndicats. Donc …
AMY GOODMAN : Vous avez parlé du syndicalisme palestinien. Donnez-nous un peu d'histoire du militantisme syndical arabo-américain dans son ensemble et du rôle qu'il a joué.
JEFF SCHUHRKE : Oui. A la fin des années 1960 et dans les années 1970, il y a eu une vague assez importante d'immigration arabe aux États-Unis, en particulier dans la région de Détroit, où de nombreux immigrants arabes, arabes américains, y compris palestiniens, travaillaient dans l'industrie automobile. Cela inclut le père de la députée Rashida Tlaib (1), qui travaillait à l'usine d'assemblage Ford Flat Rock, près de Détroit. Et ils ont été confrontés à beaucoup de racisme et de discrimination.
C'était l'époque de la Ligue des Travailleurs Noirs Révolutionnaires, de nombreux travailleurs noirs de l'automobile de l' UAW qui étaient influencés par le mouvement Black Power et qui étaient témoins de beaucoup de racisme systématique au sein du mouvement ouvrier, au sein de l' UAW , et s'organisaient. contre cela, en s'organisant également contre le capitalisme, plus largement. Et certains d'entre eux – la Ligue des Travailleurs Noirs Révolutionnaires – ont été l'un des premiers groupes de membres de syndicats à s'exprimer en solidarité avec les Palestiniens.
Quoi qu'il en soit, en 1973, lors de la guerre d'octobre entre Israël, l'Égypte et la Syrie, des membres de la communauté arabe de Détroit, dont des milliers de travailleurs de l'automobile, ont appris que l' UAW avait financé essentiellement le gouvernement israélien. Et c'était évidemment le cas – ils n'avaient jamais eu leur mot à dire là-dessus. Ils n'en étaient pas conscients. Ils organisèrent donc une série de manifestations, y compris, en novembre 1973, une grève sauvage d'une journée, au cours de laquelle environ 2 000 travailleurs arabes de l'automobile, rejoints par certains de leurs collègues noirs, fermèrent l'usine d'assemblage de Dodge Main pour appeler les dirigeants de l'UAW à se débarrasser de leurs obligations israéliennes. Et ils ont fini par former un Caucus des travailleurs arabes au sein du syndicat qui a été actif pendant plusieurs années et a réussi à amener le syndicat à se débarrasser d'un peu de ses obligations émises par l'État d'Israël
Et au cours des dernières décennies, une partie de ce type d'actions s'est poursuivie, non seulement au sein de l' UAW , mais aussi dans d'autres syndicats, dans d'autres secteurs du mouvement syndical, avec des syndicats ou des conseils centraux du travail essayant de présenter des déclarations, des résolutions de solidarité. avec les Palestiniens, mais ils se heurtent souvent à la résistance des dirigeants syndicaux nationaux qui disent : « Ce n'est pas notre politique. Vous ne pouvez pas dire ça ». Ainsi, par exemple, en parlant encore une fois de l' UAW, entre fin 2014 et début 2016, trois sections locales de syndicats de travailleurs diplômés, qui sont toutes affiliées à l' UAW, à l'Université de Californie, à l'Université du Massachusetts et à NYU, ces syndicats de travailleurs diplômés affiliés à l'UAW ont adopté des résolutions approuvant le BDS, le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions. Et les dirigeants nationaux – ou internationaux de l'UAW – ont effectivement annulé ces résolutions. Ils ont dit : « Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas notre politique de boycotter ou de désinvestir d'Israël. » Et même s'ils ont constaté que ces résolutions avaient été votées de manière parfaitement démocratique et qu'il n'y avait rien et c'était le cas – il n'y avait eu aucun acte répréhensible, ils ont néanmoins, la direction de l'UAW , annulé ces résolutions. Et un de leurs arguments était que certaines des entreprises à boycotter ont des productions d'armement et que leurs travailleurs sont représentés par l' UAW .
Plus récemment, en 2021, après la dernière attaque israélienne contre Gaza, le Conseil du travail de San Francisco se préparait à voter une résolution, une résolution BDS, et l' AFL – CIO nationale est intervenue et a dit, « vous savez, les conseils centraux du travail, qui sont agréés par l' AFL -CIO nationale , ils doivent être en adéquation avec la politique de l'AFL -CIO nationale ». Et parce que l' AFL – CIO nationale ne boycotte pas Israël, ils leur ont dit : « Vous ne pouvez pas voter cela. Vous ne pouvez pas voter pour boycotter Israël. »
Et puis, plus récemment… en octobre de cette année, au Conseil central du travail Thurston-Lewis-Mason, qui se trouve à Olympia, Washington, les délégués de ce conseil du travail ont voté à l'unanimité pour adopter une résolution appelant à un cessez-le-feu et s'opposant à la fabrication et à l'expédition de armes à Israël. Et encore une fois, l' AFL – CIO nationale est intervenue et a dit : « Vous ne pouvez pas faire ça », ce qui leur a fait retirer la déclaration de leur site Web et des réseaux sociaux. Néanmoins, quelques autres Conseils centraux du travail, dans l'ouest du Massachusetts, à Austin au Texas, à San Antonio, ont récemment adopté leurs propres résolutions de cessez-le-feu, défiant ainsi, semble-t-il, l'AFL – CIO nationale .
Il y a donc pas mal de tension ici. Cela nous ramène à ce que Bill Fletcher a dit dans la première partie sur la division qui a toujours existé au sein du mouvement syndical sur les questions internationales. Et souvent, cela ressemble à un fossé entre certains des plus hauts responsables et des membres de syndicats locaux ou de la base ou des dirigeants locaux.
JUAN GONZÁLEZ : Jeff, je me demande si vous pourriez parler de la différence entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe dans d'autres pays, alors que le mouvement syndical palestinien demande des actions de solidarité dans d'autres pays. Que se passe-t-il en Europe ou dans les pays du Sud parmi les syndicats en réponse aux attaques israéliennes sur Gaza ?
JEFF SCHUHRKE : Oui. Dans de nombreuses autres régions du monde, les syndicats vont au-delà de simples déclarations et résolutions et prennent effectivement des mesures concrètes. Ainsi, par exemple, les dockers de Gênes, en Italie, et de Barcelone, en Espagne, ont déclaré qu'ils refuseraient de manipuler toute cargaison israélienne, je pense en particulier les armes destinées à Israël. Un syndicat des cheminots au Japon a dit la même chose. Les mineurs de charbon colombiens ont déclaré qu'ils ne voulaient pas envoyer de charbon en Israël pour alimenter la machine de guerre israélienne. La plupart des principaux syndicats indiens ont publié une déclaration appelant le gouvernement indien à ne pas fournir de soutien matériel à Israël. Et des syndicalistes du Royaume-Uni, d'Australie et du Canada ont participé et organisé des manifestations dans des usines d'armement, les bloquant, les fermant, au moins pendant quelques heures. Et c'est ce que les syndicats palestiniens ont spécifiquement demandé : faire obstacle et perturber la machine de guerre.
Ici aux États-Unis, des manifestations ont eu lieu contre certains fabricants d'armes, mais elles ont pour la plupart été menées par des membres de la communauté et pas nécessairement soutenues par les syndicats ou les membres des syndicats qui travaillent dans ces usines. Mais dans le passé, en 2010, 2014 et 2021, l'Union internationale des débardeurs et des entrepôts, la section locale 10 de l'ILWU , qui regroupe les dockers de la côte ouest, et la section locale 10 de la Bay Area, ont refusé à trois reprises de manutentionner des marchandises israéliennes sur les navires de la ZIM Lines. C'est la principale compagnie maritime israélienne. Il y avait des piquets menés par des membres de la communauté, et les dockers de l'ILWU ont refusé de franchir ces lignes de piquets et n'ont pratiquement pas déchargé ces cargos israéliens. Et puis, cette année, plus récemment, début novembre, il y a eu également des piquets dirigés par la communauté contre un navire de ravitaillement militaire américain, d'abord à Oakland, puis à Tacoma. Et je sais que lors des manifestations, des piquets de grève à Oakland, certains membres de l' ILWU l'ont soutenu. Mais à part cela, il n'y a pas eu autant d'actions directes aux États-Unis pour tenter d'arrêter la machine de guerre. Il s'agit principalement de déclarations et de résolutions appelant à un cessez-le-feu.
AMY GOODMAN : Bill Fletcher, syndicaliste, l'un des responsables du Réseau de solidarité ukrainien, membre du comité de rédaction de The Nation , a écrit « Gaza, Biden et une Voie à suivre » pour The Nation et a écrit « La plus grande menace pour le mouvement fasciste : les syndicats ? » dans In These Times. Et cela fait suite à la question précédente de Juan. Vous avez parlé de Biden et avez dit que vous pensiez qu'il devrait se retirer de la candidature à la présidence l'année prochaine. Mais si vous pouviez parler du rôle du président Trump en matière de Travail ? Il y avait le président Biden sur un piquet de grève, et le président Trump est ensuite intervenu et s'est rendu dans une entreprise non syndiquée. Parlez de ce que vous considérez comme un appel de Trump à un certain nombre de travailleurs de ce pays et des menaces qu'il représente dans ce pays.
BILL FLETCHER : Amy, c'est une menace énorme, à la fois pour les travailleurs, mais aussi si vous regardez le Moyen-Orient. Permettez-moi donc de commencer ma réponse en soulignant que ce que nous voyons à Gaza, à bien des égards, pourrait-on dire, a été dans une large mesure provoqué par Trump et par ce que Trump a fait pour cultiver ses relations avec Netanyahu, en soutenant le la poursuite de l'agression et de l'expansion israéliennes, et le développement des soi-disant Accords d'Abraham, qui visaient à étrangler le mouvement palestinien et le peuple palestinien. Il n'y a donc aucun moyen pour Trump de s'en sortir sur la question de Gaza.
En ce qui concerne les travailleurs, une des choses qui est intéressante est que… je pense qu'une bonne description de Trump à ce stade est celle d'un post-fasciste. Dans le passé, je l'ai généralement qualifié de populiste de droite, mais je pense qu'il est allé plus loin. L'une des choses qu'il s'efforce de faire est de cultiver une image différente du Parti républicain et du mouvement MAGA . C'est pourquoi ils veulent se décrire de plus en plus comme un mouvement de travailleurs. Mais ce dont ils parlent en réalité, c'est d'un mouvement blanc de travailleurs qui soutient un programme économique néolibéral, en grande partie néolibéral, mais un programme incroyablement racialisé.
Et donc, quand nous regardons Trump, rien de ce qu'il a fait pendant son administration n'a été dans l'intérêt des travailleurs ou des syndicats. Rien. Je veux dire, quand vous regardez, par exemple, sa soi-disant réduction d'impôts, qui était en réalité un cadeau fiscal, elle a été très préjudiciable aux travailleurs et a bénéficié à une très petite partie de la population.
Mais ce que fait Trump, c'est qu'il fait appel aux travailleurs, et particulièrement aux travailleurs blancs, sur la base d'un appel xénophobe ou du nativisme, vous savez, l'idée que les immigrants sont la menace majeure, que la concurrence de la Chine est la menace majeure, qu'en gros il reconstruirait les industries américaines grâce à de nouvelles mesures xénophobes –qu'il n'a certainement pas été capable de mettre en œuvre lorsqu'il était président et dont aucune ne profiterait aux travailleurs américains. Mais c'est un appel très convaincant parmi de nombreux travailleurs Blancs et pas seulement – et c'est là que cela devient vraiment intéressant, Amy. Ils parlent des travailleurs blancs. L'attrait pour MAGA , comme c'était le cas pour le mouvement Tea Party, ne s'adresse pas principalement aux travailleurs blancs. C'est principalement parmi les couches moyennes des Blancs. Et c'est ce que je pense que beaucoup de gens, y compris de bons progressistes, ont mal compris, en particulier après l'élection de Trump, que l'appel ne s'adresse pas principalement aux travailleurs blancs.
Aujourd'hui, le mouvement syndical se trouve dans une situation où, pour combattre MAGA , pour combattre les fascistes, il lui faut faire deux choses. L'un d'entre eux est évidemment un message et une pratique économique populaire et progressiste. Mais cela ne suffit pas. L'autre aspect est qu'il doit s'attaquer activement aux questions de race et de sexe. Il ne peut pas penser qu'il peut éviter ces problèmes et que cela nous rassemblera tous dans un grand kumbaya. Ça n'arrivera pas. Combattre les fascistes va nécessiter d'adopter une position avancée pour changer l'économie, changer la façon dont les travailleurs sont écrasés. Mais cela nécessitera également de s'attaquer réellement à ce qui arrive aux travailleurs de couleur, à la façon dont les immigrants sont joués – ou à la question de l'immigration et à la question du sexe. C'est l'avenir, je pense, d'un mouvement, d'un mouvement ouvrier antifasciste.
JUAN GONZÁLEZ : Bill, je voulais revenir sur ce point que vous avez soulevé, à savoir que la base Trump n'est pas vraiment une base traditionnelle de la classe ouvrière. Je partage ce point de vue depuis de nombreuses années maintenant, car, tout d'abord, la réalité est que de nombreuses personnes qui faisaient autrefois partie de la classe ouvrière ou du mouvement syndical américain ont été contraintes, essentiellement, à travailler de manière occasionnelle – des camionneurs indépendants plutôt que des travailleurs syndiqués. des camionneurs, des franchiseurs qui, au lieu d'être des employés légaux d'une entreprise, possèdent désormais leur propre franchise – créant essentiellement une aristocratie du travail beaucoup plus grande qu'elle n'existait autrefois, comprenant, en plus de cela, les syndicats des secteurs judiciaires, de l'application des lois, des syndicats de policiers, des syndicats pénitentiaires, des syndicats de patrouilles frontalières, de toute la surveillance et de la répression de l'État qui est syndiqué, que c'est là en réalité la base de Trump, plutôt que le mouvement ouvrier organisé traditionnel et les travailleurs des secteurs les plus opprimés . Mais la question devient alors : comment construire un mouvement, un mouvement d'opposition à la nouvelle forme de fascisme de Trump ?
BILL FLETCHER : Donc c'est la question à 64 000 $(2), Juan. Et je suis d'accord avec votre analyse de base. J'ajouterais seulement que ce qui se passe dans l'économie est en outre une atomisation et une fragmentation du travail et des travailleurs. Il y a donc de nombreux travailleurs indépendants qui ne sont que techniquement indépendants. En fait, ils ont des employeurs, mais ce sont des travailleurs indépendants (assujettis au formulaire fiscal 1099) Autrement dit, ils sont considérés comme des entrepreneurs, même si, en réalité, ils font tous partie de la classe ouvrière.
Je pense que la construction du front anti- MAGA est une bataille autour de la démocratie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je m'abstiens d'utiliser la notion de guerres culturelles. Je ne pense pas que nous soyons engagés dans une guerre culturelle. Je pense que nous sommes engagés dans une bataille autour de la démocratie et de la mesure dans laquelle la démocratie est soit élargie, soit réduite. Devons-nous élargir la démocratie pour s'adresser aux femmes, aux personnes opprimées par le genre, aux personnes de couleur, au fonctionnement de l'économie, ou devons-nous la restreindre ? Allons-nous étendre la démocratie pour répondre aux diverses sectes religieuses persécutées, ou la restreindre. Devons-nous développer la démocratie afin de démocratiser l'économie, de sorte qu'au lieu d'écraser les pauvres, nous ayons un système fiscal humain, démocratique, avec un petit « d » ? Je pense que c'est la base pour construire ce large front. Et donc, ce que cela ne signifie pas – et je deviens presque meurtrier à chaque fois que j'entends des démocrates dire cela – qu'il s'agit de virer davantage vers le centre. Non, non ! Danger, Will Robinson(3). Il ne s'agit pas de virer vers le centre. Il s'agit de prendre une position très ferme sur ce qui doit arriver aux masses, aux millions de travailleurs, en matière d'économie. C'est là que nous pouvons construire ce front.
Maintenant, une des choses, Juan, qui m'a vraiment étonné, c'est le niveau de lâcheté de nombreux dirigeants syndicaux lorsqu'il s'agit de s'attaquer réellement à MAGA . J'ai en fait participé à des discussions avec des dirigeants syndicaux sur la nécessité de nous attaquer à la droite. Et ils ont peur. Je veux dire, ils sont pétrifiés à l'idée – que les hommes blancs vont fuir hystériquement les locaux syndicaux – n'est-ce pas ? – criant, criant, de ne jamais revenir, s'ils commencent à s'occuper de race, de genre, de sexe et de la question du fascisme, et contrairement à cela, non, c'est comme ça que nous allons nous unir, c'est comme ça que nous allons vaincre la droite, à la fois dans nos rangs mais aussi plus généralement.
AMY GOODMAN : Bill Fletcher, je voulais vous interroger sur les questions internationales, de l'Ukraine à Israël, le lien entre le financement d'Israël, le financement de l'Ukraine et, bien sûr, le lien avec la frontière, qui a tout retardé, les Républicains veulent que des mesures extrêmement draconiennes soient prises à la frontière, et les Démocrates progressistes ripostent, même s'ils estiment que Biden fait plus de compromis avec les Républicains qu'avec eux, comme le Congressional Progressive Caucus (4). Mais je voulais vous poser des questions sur l'Ukraine et Israël, sur votre point de vue en tant que co-fondateur du Réseau de solidarité avec l'Ukraine.
BILL FLETCHER : De mon point de vue l'Ukraine et les Palestiniens partagent beaucoup de points communs, ils sont tous deux victimes d'une agression flagrante. Ils sont tous deux victimes d'un projet colonial : dans le cas de l'Ukraine, celui de la Russie ; dans le cas des Palestiniens, évidemment, ce que font les Israéliens depuis 1948, et je dirais en fait depuis 1946.
Et donc, il y a en fait une sorte de — je dirais presque, Amy, que nous sommes dans une ère de mondialisation des luttes anti-occupation — Ukraine, Palestine, Cachemire, Papouasie occidentale, Porto Rico, etc. Il existe de nombreux exemples de luttes anti-occupation en cours et ces luttes anti-occupation commencent à réapparaître, à se mondialiser et à établir des liens importants. Nous, la gauche américaine, devons soutenir cela. Et le Réseau de solidarité avec l'Ukraine [USN] en fait partie. Et contrairement à ce que Biden affirme, à savoir qu'il veut soutenir les Ukrainiens et soutenir l'agression israélienne, nous pensons qu'il y a absolument une contradiction dans les termes. Il n'y a pas de similitude.
Mais autre chose se passe. Les Républicains font tout ce bruit à propos de la frontière. Mais ce qui n'apparait pas dans tout cela c'est qu'il existe une aile pro-Poutine du Parti républicain qui se développe, il existe un segment très important du Parti républicain, et réellement implanté à la base dans le MAGA , qui considère Poutine comme un allié politique. . Et ils considèrent le régime Poutine et le projet Poutine comme quelque chose qui doit être reproduit aux États-Unis – le nationalisme chrétien de Poutine, je dirais, l'homophobie de Poutine, sa misogynie, son suprématisme blanc, son idée que la Russie défend, en fait, le monde européen et le monde occidental. C'est quelque chose qui résonne parmi les forces MAGA. Et malheureusement, il y a des segments de la gauche américaine qui semblent s'être mis du coton dans les oreilles lorsque cela se présente. Ils ne veulent pas entendre cette discussion. Ils ne veulent pas reconnaître que cela fait partie de ce qui se passe. Mais cela fait partie des motivations des Républicains qui tentent de bloquer toute aide à l'Ukraine.
Donc, en résumé, je ne suis pas du tout favorable à une quelconque forme d'aide à Israël. Coupez l'aide militaire. Arrêtez ça ! Mais le lien que Biden a établi entre l'aide à l'Ukraine et l'aide à Israël est absolument horrible.
JUAN GONZÁLEZ : Mais, dans cette optique, Bill, du point de vue des personnes souffrant des effets de la guerre, n'est-il pas une position plus cohérente pour avoir des cessez-le-feu, non seulement en Israël, mais aussi en Ukraine à cette étape ? et essayer de trouver un moyen de négocier la paix ?
BILL FLETCHER : Eh bien, vous savez, c'est une question intéressante, Juan, et elle est en débat. En fin de compte, la réponse appartiendra aux Ukrainiens. Et ils devront décider, tout comme les Coréens ont dû décider, tout comme les Vietnamiens ont dû décider, s'ils veulent ou non appeler à un cessez-le-feu, s'ils veulent diviser leur pays, s'ils pensent que les perspectives de victoire sont là ou pas. Cela ne dépend pas de nous. Et c'est l'une de ces choses où je pense que des segments de la gauche américaine prouvent à quel point ils sont américains dans leur chauvinisme, en allant dire aux Ukrainiens comment résoudre ça. Ma conviction est que dans la mesure où les Ukrainiens veulent lutter et continuer de lutter contre l'agression russe, cela doit être soutenu, de la même manière que les autres peuples qui luttent contre l'agression d'une puissance étrangère ont besoin d'être soutenus. Si, à un moment donné, le peuple ukrainien dit : « OK, nous n'allons pas gagner », ou que « nous décidons qu'une autre solution doit être adoptée », alors je pense que c'est important, au nom de l'autodétermination que les gens d'ici soutiennent cela.
AMY GOODMAN : Eh bien, je tiens à vous remercier tous les deux.
Notes
(1) Rashida Tlaib, née en 1976 à Detroit (Michigan), est membre des Democratic Socialists of America (DSA) et du Parti Démocrate. Elle a été élue en 2018 à la Chambre des représentants des États-Unis devenant, la première personnalité d'origine palestinienne élue au Congrès.
(2) La question à 64 000 $ était un jeu télévisé américain diffusé aux heures de grande écoute sur CBS-TV de 1955 à 1958, qui tient sa notoriété des scandales des quiz télévisés des années 50 .
(3) Will Robinson est le personnage principal de la série télévisée de 2018 « Perdus dans l'Espace »
(4) Le Congressional Progressive Caucus ( CPC ) est une coalition affiliée au Parti démocrate au Congrès des États-Unis. Le CPC représente le regroupement le plus à gauche du Parti démocrate. Il a été fondé en 1991 et s'est développé depuis lors, devenant le plus grand caucus démocrate à la Chambre des représentants. Le CPC est présidé par la représentante américaine Pramila Jayapal.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : Crise de l’eau, une initiative syndicale à Kryvyi Rih

Bonjour, je m'appelle Yuri Samoilov, président du syndicat indépendant des mineurs de la ville de Krivyi Rih. J'aimerais parler d'écologie. La destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka par les occupants russes a fait de l'approvisionnement en eau potable un problème majeur pour les travailleurs. L'eau potable en ville n'est en réalité pas gratuite, vous ne pouvez l'acheter que dans les magasins.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Il y avait un problème avec l'eau auparavant. À Krivy Rih, l'eau n'a toujours pas été de très bonne qualité, car on y pratique activement l'exploitation minière et l'extraction de minéraux. La profondeur des travaux actuellement en cours est d'environ deux kilomètres de profondeur, car toute l'eau restante a disparu, pompée et transformée en une sorte de composés chimiques.
Notre projet de solution
Nous voyons une solution au problème dans l'extraction de l'eau de puits profonds.
Les capitalistes et leur pouvoir ne se soucient pas beaucoup de cette question ; ils considèrent l'approvisionnement en eau à travers le prisme de leurs intérêts et de leurs profits. Ils font un business en vendant de l'eau en bouteille à ceux qui peuvent payer. C'est leur décision. Ils veulent également transformer le forage de puits et la distribution d'eau en une entreprise. Ils transformeront n'importe quel projet d'approvisionnement en eau en profits. La position de la classe ouvrière de Krivyi et l'opinion de tous les gens sont que l'eau ne doit pas être transformée en marchandise. L'eau est un bien commun.
Il est nécessaire de commencer à forer des puits, et ils doivent appartenir au peuple et non aux intérêts particuliers. Cela déterminera la nature du projet.
Il y a plusieurs composantes à ce projet.
Par exemple, le volet technique est l'achat d'équipement, à savoir la collecte de fonds pour un appareil de forage et ses composants. Pour faire fonctionner les puits, une pompe et une électricité autonome de secours sont nécessaires. Il existe de nombreux détails techniques de ce type et nous y réfléchirons tous.
Il y a aussi des problèmes d'organisation. Qui percera, comment le travail lui-même sera effectué. Nous pensons qu'il s'agira d'une équipe bénévole de forage de puits qui, grâce à sa coopération, devrait elle-même recevoir de l'eau potable en signe de gratitude.
Avec une bonne organisation avec un seul appareil de forage, il est possible de forer et d'équiper au moins un ou plusieurs puits à la fois. L'eau propre, comme l'air, ne peut être vendue.
L'eau potable doit être gratuite et accessible à tous. Le projet devrait fonctionner gratuitement.
Le problème de la conscience de masse sera également résolu : nous devons expliquer aux gens que non seulement l'air et l'eau doivent être gratuits.
Aujourd'hui, tous les produits de base sont produits en quantité suffisante pour tous. Et fournir aux gens de la nourriture, de l'eau potable, du chauffage, des produits alimentaires et des médicaments de base ne devrait pas être un problème aujourd'hui.
Non seulement l'eau, mais tous ces biens de base peuvent et doivent être gratuits, comme le droit de toute personne.
L'État, le gouvernement et les capitalistes ne veulent pas garantir cela et, de par leur nature de classe, ils ne le peuvent pas.
Ils veulent que l'eau soit une marchandise. Ils vivent en échangeant tous les avantages possibles. Si cette politique se poursuit, nos descendants devront décider où se procurer de l'oxygène, car il sera payant.
Seule la classe ouvrière organisée peut fournir à chacun les biens de première nécessité.
Il y a aussi un problème juridique à cela. Parce que la législation de la production par l'État ukrainien rend très problématique le prélèvement d'eau et le forage de puits. Mais la Constitution ukrainienne déclare que les ressources minières appartiennent au peuple et que chacun a droit à une vie décente.
Pour soutenir l'initiative syndicale, c'est ici
https://laboursolidarity.org/fr/n/3023/crise-de-l039eau-une-initiative-syndicale-a-kryvyi-rih
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Halte aux attaques contre l’IVG instrumentale !

Le décret d'application qui permet enfin aux sages femmes de pratiquer des ivg instrumentales (= par aspiration) a été publié le 16 décembre 23. Nous l'attendions depuis le 2 mars 2022, date de promulgation de la loi dite « Gaillot ». On manque de médecins, tout le monde le sait. Des centres où se pratiquent les IVG ferment car des maternités de proximité où ils sont implantés ferment.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2023/12/26/halte-aux-attaques-contre-livg-instrumentale/
La publication de ce décret était attendue avec impatience pour permettre de « fluidifier » l'accès à l'IVG et d'en réduire les inégalités d'accès sur les territoires. Les sages femmes sont formées, compétentes, elles pratiquent parfois des accouchements difficiles où la vie de la femme et de l'enfant sont menacées.
Ceci est reconnu et ne pose pas de problème. Pour l'IVG, visiblement leur compétence est mise en doute. En effet, selon le décret, pour que les sages femmes puissent pratiquer des IVG « instrumentales », il ne faut pas moins de quatre médecins prêts à intervenir en cas de problème : un médecin compétent en matière d'IVG, un gynécologue-obstétricien, un anesthésiste-réanimateur. Et de surcroît une équipe ayant la capacité de prendre en charge des embolisations artérielles dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins. Cette technique est utilisée en cas d'hémorragie utérine grave, complication parfois d'un accouchement mais exceptionnellement d'une IVG.
L'enjeu est clair ici, au décours d'un décret d'application qui devait être anodin : cela devient une bataille idéologique contre l'IVG instrumentale.
Les femmes doivent être libres de choisir leur méthode pour avorter.
En effet, bien peu de structures pratiquant les IVG possèdent les conditions requises dans ce texte.
Le but est clair : faire passer l'IVG instrumentale comme une intervention sujette à complication alors que c'est un acte simple ne nécessitant pas une mobilisation médicale totalement démesurée. Il existe de nombreuses façons de combattre l'avortement.
Aux États Unis, cela passe par la Cour Suprême qui remet en cause ce droit avec pertes et fracas. En France, c'est au décours d'un décret d'application, publié à la veille des fêtes de fin d'année, qu'on s'attaque de façon insidieuse à l'IVG instrumentale. Nous avons l'habitude, nous ne laisserons pas faire.
Nous appelons les militantes féministes à se mobiliser à la rentrée contre cette provocation. A suivre.
Association Nationale des Sages Femmes Orthogénistes, Association Nationale des Centres d'IVG et de Contraception, Collectif « Avortement en Europe, les femmes décident » Planning Familial
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le « backlash » gouvernemental dans la lutte contre les violences intrafamiliales

Après « Briser le silence », voici venu le temps de « Briser l'espoir ». Alors que la responsabilité qui nous incombe est de faire preuve de lucidité pour réformer un système générateur de violences inacceptables ; alors que le gouvernement avait commencé à ouvrir un œil sur ce système ; ce dernier a clairement décidé de faire machine arrière.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/01/09/le-backlash-gouvernemental-dans-la-lutte-contre-les-violences-intrafamiliales/
La campagne de Charlotte Caubel, qui exhorte les victimes à « briser le silence », place une fois de plus la responsabilité du côté des victimes – comme si c'était à elles d'agir – plutôt que de s'attaquer à la société des adultes, et de pointer la responsabilité de ceux à qui revient le devoir de protéger. Reconnaître la responsabilité des adultes, regarder en face les problèmes de notre société, les nommer : c'est ce qu'a fait le juge Edouard Durand. Il a été remercié et brutalement évincé de la CIIVISE le lundi 11 décembre 2023, après trois années de dévouement absolu pour les victimes d'inceste. Son éviction – largement condamnée par le monde associatif et par les membres de la Ciivise eux-mêmes, dont 11 ont déjà démissionné [1] – est l'arbre qui cache une forêt des plus inquiétantes.
L'inceste, et au-delà, toutes les formes de violences envers les enfants, est un sujet politique, une histoire plurimillénaire de domination masculine et adultiste. Seule une volonté politique pourra venir à bout de ce fléau qui n'est tabou que parce que tout est fait pour fabriquer le silence et garantir le maintien d'un système judiciaire qui protège l'impunité des agresseurs. Pourquoi est-il si difficile pour notre société d'adultes, gangrénée par des siècles de culture patriarcale, de se remettre en question ? En effet, quelle solution est apportée au parent qui recueille les dénonciations d'inceste de son enfant et cherche à le protéger ?
Dans l'écrasante majorité des cas, c'est la mère à qui revient la responsabilité de signaler les suspicions à l'institution [2]. Et contre toute attente, au lieu de protéger l'enfant, notre société se livre à une véritable « chasse aux sorcières » à l'égard des mères qui croient leurs enfants. D'autant plus lorsqu'elles dénoncent au passage les violences qu'elles ont elles-mêmes subies de la part d'un conjoint dont on continue à dire qu'il peut être un « bon père ». On les condamne, elles et leurs enfants, sur l'autel de la « présomption d'innocence ». Or personne n'a jamais demandé à condamner un père sur la seule parole d'un enfant, ni de sa mère ! Tout ce que nous demandons, c'est la mise en place d'un principe de précaution [3]. Nous exigeons du bon sens : quel parent, fut-il juge, laisserait son enfant repartir chez un parent qui lui fait peur, et dont il dénonce lui-même des actes incestueux ?
Deux rapporteurs spéciaux de l'ONU ont directement interpellé l'État français, le 27 juillet dernier, pour lui demander des explications concernant trois affaires emblématiques dans lesquelles une mère se retrouve condamnée pour n'avoir pas remis l'enfant au père malgré des signalements de professionnels, et l'enfant placé entre les mains de celui qu'il dénonce [4]. Ces cas ne sont malheureusement pas isolés. En effet, rien n'est mis en œuvre pour permettre une véritable protection des enfants victimes de violences.
Les médecins ne font des signalements qu'au péril de leur carrière. 101 professionnels du droit, de la santé et du monde associatif se sont réunis pour dénoncer la façon dont l'Ordre des Médecins fait obstruction à la lutte contre les violences faites aux enfants : « l'Ordre a condamné à de lourdes interdictions d'exercice des médecins qui n'avaient fait que signaler des enfants en danger. Ce faisant, il n'a pas respecté l'article 226-14 du Code pénal qui précise que dans ces cas la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée. »[5]
La création d'une commission « scientifique » sur la parentalité par la ministre des Solidarités et de la Famille, Aurore Bergé, aurait pu être une bonne nouvelle si elle ne s'était pas faite sous le signe de la sanction et de la stigmatisation des familles monoparentales qui sont, à 85%, portées par des femmes. Par ailleurs, l'un de ses présidents, le psychiatre Serge Hefez, défend le « syndrome d'aliénation parentale ». Syndrome qui, bien que rejeté par la communauté scientifique internationale, continue de prospérer au sein des tribunaux pour défendre les hommes accusés de pédocriminalité en rejetant la culpabilité sur les mères et en les accusant de manipuler leur enfant [6] !
La loi Santiago [7], qui propose de suspendre les droits du parent mis en cause, constitue une avancée que nous saluons, mais n'intervient qu'à partir du moment où il y a « mise en examen » et non à partir de l'enquête préliminaire, ce qui concerne seulement un cas sur quatre ! 74% des enfants doivent retourner chez leur agresseur après l'avoir dénoncé. Par ailleurs, elle fait l'impasse sur le pouvoir absolu laissé aux Juges aux affaires familiales de restituer ses droits à un parent condamné au pénal passé un délai de six mois.
Où que l'on regarde, nous ne pouvons qu'être a minima inquiet·es. Nous n'en sommes plus à discuter de mesures que nous pourrions juger trop timides ou insuffisantes : nous constatons, effrayé·es, un virage à 80° de la part du gouvernement. C'est pourquoi, nous, associations engagées dans la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes, adultes et parents concerné·es et responsables, appelons à une prise de conscience des pouvoirs publics quant au caractère alarmant de la situation et apportons notre soutien inconditionnel aux 11 membres qui ont démissionné de la Ciivise en signe de protestation.
Tribune co-écrite par la Collective des mères isolées, Justice des familles, et WeToo stop child abuse.
Associations signataires :
Reppea
La Mouette
Protéger l'enfant
SOS Inceste pour revivre
Union Nationale des Familles de Féminicides
BeBrave
Caméléon
Un Nouveau Jour
Mouv'Enfants
Protégeons les enfants
Collectif enfantiste
Fédération Nationale des Victimes de Féminicides
CDP Enfance
La génération qui parle
Pas de secret
Le déni ça suffit
Innocence en danger
Les enfants de Tamar
[1] https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/12/14/onze-membres-de-la-ciivise-demissionnent-en-signe-de-protestation-apres-le-remplacement-d-edouard-durand_6205877_3224.html
[2] Dans 96% des cas, les auteurs d'inceste sont des hommes.
https://fr.statista.com/themes/8097/la-pedocriminalite-en-France/#statisticChapter
[3] Conformément aux recommandations de la Ciivise, qui préconise la création d'une « ordonnance de sûreté » pour les enfants.
Cf. https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2023/11/VERSION-DEF-SUR-LE-SITE-1611.pdf, p.35, Préconisation n°26.
[4] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28207
[5] https://www.nouvelobs.com/opinions/20231020.OBS79768/violences-faites-aux-enfants-101-professionnels-du-droit-de-la-sante-et-du-monde-associatif-repliquent-a-l-ordre-des-medecins.html
[6] Comme l'ont encore rappelé les chercheurs Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent dans une interview parue le lundi 11 décembre, ce syndrome n'est autre qu'une invention perverse du psychiatre masculiniste américain Richard Gardner destinée à protéger les hommes accusés de pédocriminalité, et qui n'a jamais été reconnue par la communauté scientifique.
https://www.lesnouvellesnews.fr/comment-le-syndrome-dalienation-parentale-a-envahi-la-sphere-politique-et-judiciaire/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Daya Laxmi : « Les accords de libre-échange affectent et victimisent les groupes paysans »

Une militante de la MMF au Népal parle des impacts de l'ALC dans la région de l'Asie du Sud
Tiré de Capiré
https://capiremov.org/fr/entrevue/daya-laxmi-les-accords-de-libre-echange-affectent-et-victimisent-les-groupes-paysans/
18/12/2023 |
Interview réalisée par Natália Lobo
Interprétation consécutive du népalais à l'anglais par Madhab Pant
Foto : La Via Campesina 2023
Les femmes du monde entier organisent la lutte contre le capitalisme et le néolibéralisme. Dans la région de l'Asie du Sud, ces forces, sous la forme d'accords de libre-échange (ALE), jouent un rôle important dans l'appauvrissement des paysannes et des femmes dans les zones rurales et urbaines. Parmi les principaux agendas des mouvements populaires au Népalil y a des luttes pour que la Constitution puisse véritablement servircomme base pour garantir les droits fondamentaux de tous les citoyens, y compris la souveraineté alimentaire et la participation des femmes à la vie politique. Le pays a connu une immense mobilisation qui a abouti, en 2006, à l'abolition de la monarchie et à la mise en place d'un gouvernement républicain. Depuis la révolution de 2006, deux constitutions ont été rédigées : la Constitution intérimaire de 2007 et la Constitution actuelle en vigueur au Népal de 2015.
Capire a parlé avec Daya Laxmi, membre du Comité international de la Marche Mondiale des Femmes représentant la région Asie-Pacifique. L'entrée de Daya dans le comité a été approuvée lors de la 13e Rencontre internationale de la MMF, tenue en octobre à Ankara, Turquie, siège actuel du Secrétariat international de la MMF. À côté de Daya, la région est représentée par Hadina Soka, d'Indonésie, et Oriane Cingone et Marie-Hélène Trolue, de Nouvelle-Calédonie. Dans son pays, Daya est également trésorier de la Fédération des paysans népalais (All NepalPeasants' Federation – ANPF), une organisation qui intègre la Via Campesina.
Dans l'interview, Daya a parlé des impacts de l'ALC dans son pays, de la lutte paysanne et de la lutte pour faire de la souveraineté alimentaire un droit fondamental, ainsi que de la façon dont les femmes s'organisent pour lutter contre le patriarcat enchevêtré dans les traditions. Cette interview a été menée pendant la 8e Conférence de la Via Campesina, qui s'est tenue en décembre 2023 à Bogotá, en Colombie. Plus de 400 délégué.e.s du mouvement et des organisations alliées se sont réuni.e.s pendant la conférence pour construire la lutte, avec la devise « Face aux crises mondiales, nous construisons la souveraineté alimentaire pour assurer un avenir à l'humanité ! ».
Quels sont les effets des accords de libre-échange aujourd'hui au Népal et dans la région asiatique ? Existe-t-il des accords de libre-échange actifs ?
Les accords de libre-échange posent de nombreux défis à la région asiatique. Au Népal, ils détruisent l'économie rurale en créant une situation de dépendance économique. En Asie, ces accords apparaissent sous différentes formes, comme dans les accords bilatéraux de protection et de promotion des investissements (ABPPI), les accords bilatéraux et multilatéraux entre l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud. Dans les pays d'Asie du Sud, il y a l'Accord commercial Asie-Pacifique (ACAP), et à cause de ces accords, des pays comme le Sri Lanka, qui était le plus riche de la région, sont maintenant en faillite, pauvres et confrontés à une immense crise économique. Il y a aussi l'ABPPI entre le Népal et l'Inde qui provoque une crise de l'économie népalaise. Et aussi le Partenariat Économique Global Régional (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP), un accord de libre-échange entre les pays d'Asie du Sud et l'Australie, la Chine, l'Indonésie, le Japon et la Corée du Sud, qui a profondément affecté la région.
Ce grand nombre d'accords de libre-échange profondément enracinés dans la région a affecté et victimisé des groupes de petits et moyens paysans. Les personnes sans terre et les petits paysans produisent de la nourriture et toutes sortes de produits, mais ils n'ont pas de marché. Les marchés et même leurs moyens de production sont capturés par les puissances capitalistes néolibérales. Ces petits paysans n'ont pas de propriété foncière et perdent le peu de terre qu'ils ont, ce qui les appauvrit. Nous pouvons parler de divers effets de cela sur la vie de ces personnes, tels que la crise économique et l'absence de marché pour les biens qu'elles produisent. Cela conduit à la famine, aux conflits, à l'exploitation du travail, aux disparités et à la discrimination, tandis que les personnes paysannes sont privées de droits. Les impacts de ces ALC opérant dans la région se voient dans la crise climatique et économique que nous traversons. Ils violent les droits humains. Les petits paysans, les vrais paysans, ont de moins en moins de terre.
Quelles sont les conséquences effectives pour les paysannes de l'inclusion de la souveraineté alimentaire dans la construction du mouvement au Népal ? Quels sont les défis ?
Le mouvement agraire et paysan du Népal a émergé il y a 70 ans. En 2015, nous avons promulgué une nouvelle Constitution, parce que nous avons des gens qui se battent depuis 2006. Cette nouvelle Constitution garantit que la souveraineté alimentaire est un droit fondamental de notre peuple. Maintenant, nous promulguons une Loi sur l'agriculture, qui a déjà été adoptée, mais non appliquée. Les personnes paysannes ont des droits obligatoires en vertu de notre Constitution, mais cette loi définit comment ces droits seront mis en œuvre. Cette loi a été élaborée et construite par le Parlement pour les paysans, et elle indique ce qu'ils doivent faire et quels sont leurs droits. Ce que nous allons mettre en œuvre : c'est par la loi. La participation des femmes aux négociations pour la construction de la loi a été forte. Nous participons à la discussion de tous les aspects de cette constitution en relation avec l'agriculture auprès du ministère, au niveau fédéral, au niveau des provinces, et même dans les instances locales. Au Népal, la représentation des femmes est obligatoire à tous les niveaux du gouvernement. De plus, il doit toujours y avoir une représentation autochtone.
Il y a quelques défis.La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et paysannes et autres personnes travaillant dans les zones rurales(United Nations Declaration on the Rights of Peasants– UNDROP) n'a pas été pleinement mise en œuvre. Nous avons donc essayé de créer de nouvelles lois et de nouveaux dispositifs juridiques pour son implémentation. La déclaration garantit les droits et la propriété des personnes paysannes. Mais il est très difficile de transformer le secteur agricole en raison de l'intervention internationale ou étrangère sur les questions nationales. Ces divers pouvoirs étrangers, ces puissances impérialistes et capitalistes, tentent de forcer les programmes de banques foncières et les investissements directs étrangers. Ces programmes tentent, par exemple, de mettre en œuvre des pipelines dans le pays, mais l'organisation paysanne lutte contre cela, et jusqu'à présent, ils n'ont pas été mis en œuvre.
Le pouvoir étranger essaie d'attirer toutes sortes d'interventions, mais la souveraineté alimentaire est notre droit, nous avons donc rédigé une nouvelle constitution qui est en cours de mise en œuvre, mais comment protéger ces droits est un défi.
Daya Laxmi
Les paysans et paysannes — et tous les peuples — doivent être sensibilisés à leurs droits. Le Népal est un pays diversifié. Nos langues, notre culture, nos rituels montrent notre diversité. C'est un pays de nombreuses langues, cultures et traditions différentes, alors comment est-il possible de réaliser l'unité dans la diversité ? C'est un pays agricole, et la plupart des femmes du pays dépendent de cette activité, bien qu'elles n'aient ni droits ni propriété. Les femmes sont sur terre. Selon le dernier recensement, à partir de 2020, il y a 1,5 million de femmes engagées dans l'agriculture au Népal, mais seulement 21% d'entre elles possèdent des terres. Les autres sont des femmes sans terre, ou la terre est au nom des hommes de la famille. L'intervention capitaliste internationale est notre plus grand défi. Nous avons des ressources naturelles, mais elles ne sont pas accessibles aux femmes. Le patriarcat est l'obstacle à la mise en œuvre des droits des femmes.
Pouvez-vous parler davantage de la dimension patriarcale dans les traditions culturelles ? Comment les femmes construisent-elles le féminisme dans ces traditions culturelles ?
Nous vivons dans une société patriarcale et inégalitaire qui, pendant longtemps, n'a pas permis aux femmes de quitter la cuisine. En conséquence de la lutte des femmes, lors de la révolution populaire de 2006, nombre de leurs droits ont été garantis. Après la mise en œuvre de la Constitution intérimaire du Népal cette année-là, une élection pour l'Assemblée constituante a eu lieu et les femmes dirigeantes ont fait entendre leur voix pour assurer une participation de 33 % dans toutes les institutions gouvernementales et organisations de la société civile. Actuellement, au niveau fédéral, nous avons la présidence et la vice-présidence, et l'un de ces postes doit toujours être occupé par une femme. Nous construisons des lois pour assurer l'égalité entre les hommes et les femmes, avec parité et sans discrimination.
Nos défis sont de protéger nos droits et de mettre en œuvre ces réalisations. Nous pouvons diffuser, sensibiliser, organiser des formations pour les personnes, pour les femmes. Les femmes soulignent que les forces capitalistes et impérialistes augmentent la discrimination dans la société. Et pour lutter contre cela, nous devons élaborer nos lois, telles que la Loi sur l'agriculture, la Loi sur la lutte contre la violence domestique et les lois de mise en œuvre de l'UNDROP. Ces dispositions légales, ces lois soutiennent les droits établis pour les femmes dans le pays. Nous luttons pour une réforme structurelle de la société.
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
Édition par Bianca Pessoa et Helena Zelic
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Souveraineté financière et bien vivre : besoins historiques des peuples

Depuis au moins 50 ans, l'accumulation capitaliste est régie par le cadre politique et économique néolibéral en Amérique latine. Au cours de cette période, les États-nations ont subi de profondes réformes et, sous le discours de la « modernité », ont ouvert les piliers structurants de la financiarisation.
Tiré de Capiré
27/01/2024 |
Par Rosilène Wansetto, Sandra Quintela et Talita Guimarães.
Édité par Tica Moreno.
Photo : Jubileu Sul
Les pays et leurs peuples ont perdu la capacité de gérer leur propre économie et de participer à la souveraineté financière sur leur monnaie, ainsi que de définir leurs budgets nationaux et de participer aux décisions les concernant. Les politiques d'ajustement structurel imposées depuis les années 1980 ont fait des États de plus en plus un excellent payeur de dettes financières, au détriment du paiement des dettes sociales et historiques à la population appauvrie.
La reprise du pouvoir de décider de la souveraineté financière des pays va au-delà d'un débat de la banque centrale ou d'un ministère des Finances et de l'Économie : il s'agit de la récupération du pouvoir des peuples de décider où ils vont appliquer les ressources publiques et quelles sont les priorités des budgets. Ce sont les jalons de la Conférence sur la souveraineté financièreorganisée par le Jubileo Sur Brasil [Jubilé Sud Brésil] en partenariat avec le CEAAL [Conseil d'éducation populaire d'Amérique latine et Caraïbes] et le CADTM [Comité pour l'abolition de la dette illégitime], auquel ont participé des représentants de 20 pays d'Amérique latine et des Caraïbes.
Depuis les grandes révolutions industrielles du XVIIIe siècle, le capitalisme est un corps vivant en constante modification et adaptation – métamorphose –, dans le seul but de garantir un excédent plus important qu'à ses débuts, en expulsant les obstacles à la création de plus-value. Le capital, qu'il soit sous forme d'argent ou de marchandise, de capital constant, industriel ou fictif, est modifié en vue de sa valorisation. La valeur ajoutée est l'ordre, comme le rappellent Rosa Marques et Paulo Nakatani : « le mouvement du capital doit être compris comme une sorte d'esprit, ou un fantôme, qui passe d'une forme à une autre, et dans ce mouvement, le capital soumet les personnes, les choses et l'ensemble de la société à ses désirs ou à sa logique, comme s'il s'agissait d'un esprit fantomatique avec une volonté propre ».
Le système de dette publique a joué un rôle fondamental dans la genèse de ce mouvement, de l'accumulation primitive du capital à la constitution du capital fictif. Il s'agit du noyau primaire d'un marché de titres public et privé, qui s'est imposé comme l'un des principaux mécanismes de contrôle de la propriété sociale dans le capitalisme. Aujourd'hui, les systèmes d'endettement garantissent la reproduction du capital et assurent le maintien de la baisse du taux de profit. Ce système alimente la dépendance, étant un obstacle pour que les pays puissent atteindre la souveraineté financière.
La domination financière se caractérise par la centralité du capital financier dans le contrôle des relations reproductives et exprime l'escalade néolibérale mondiale des années 1990. Cette logique imprime sur les politiques économiques le modus operandi selon lequel l'austérité est la « clé de l'efficacité » et est utilisée pour justifier les coupes sociales. Au Brésil, c'est ce qui s'est passé avec les réformes des retraites et du travail, qui se sont attaquées à la sécurité sociale. Ce sont des moyens que le capital trouve pour continuer à profiter au détriment du droit des peuples à décider. Ce droit est capturé et placé sous l'égide de la financiarisation.
Parmi les nombreuses contraintes, le modèle actuel d'accumulation sous l'égide de la finance a de plus en plus exigé l'appropriation de ressources publiques sous forme de dividendes. Dans le cas du Brésil, le système de la dette publique a transféré, ou plutôt « drainé » les ressources publiques de beaucoup vers les poches de quelques rentiers, comme le dit le professeur Dowbor. C'est un transfert gratuit aux rentiers, ce ne sont que des profits. Jusqu'en 1994, la distribution des bénéfices et dividendes était taxée à 15 %, et a été exonérée jusqu'à ce jour.
Les bénéfices et les dividendes se réfèrent aux gains, presque toujours exclusifs aux 1 % les plus riches de la société. La dette est une carte de crédit illimitée des riches.
Au cours des trois dernières décennies, on estime qu'environ 5 % du PIB du Brésil a été transféré aux riches créanciers de la dette publique, soit 1,6 fois le PIB accumulé depuis les années 1990. Comme indiquent Marques et Nakatani, « l'expansion des actifs financiers dans le monde, tout en restant forte, a connu une croissance particulièrement précipitée dans les années 1990. En 2000, son stock était supérieur de 111,8 % à celui de 1990 ; en 2010, il affichait une croissance de 91,7 % par rapport à 2000, et en 2014, il avait déjà augmenté de 42 % par rapport à 2010 ».
Les dettes financières et sociales sont le résultat d'un passé d'extorsion, d'exploitation et d'anéantissement des peuples autochtones, des Noirs, des femmes et d'autres groupes qui subissent les impacts d'un mode de production qui exécute la nécropolitique, c'est-à-dire l'élimination des vies disponibles pour le capital. Dans ce système, aucun peuple n'atteindra sa souveraineté financière, car il restera dépendant.
La subordination financière, écologique et alimentaire est imposée par une manière de faire de la politique pour répondre aux besoins du marché.
La compétitivité imposée par la course technologique commande des changements dans le tissu technologique et entraîne des gains d'échelle constants. Dans le même sens sont les atouts du marché du carbone, des obligations vertes qui arrivent comme une solution, mais ne sont rien de plus qu'un moyen de financiariser la vie, la nature et le climat. Ils ne génèrent ni souveraineté ni souci de la vie.
On assiste à une aggravation des crises systémiques déclenchées par l'effondrement climatique, l'augmentation des inégalités sociales et la concentration des revenus. Le capitalisme, contrairement à ce que défendaient ses passionnés, ne s'est pas avéré être un mode de production altruiste. Les « sentiments moraux » cultivés sur les principes du marché n'offrent qu'une insécurité sociale et économique, laissant la plupart des nouvelles générations sans possibilité de rêver.
Même avec autant de tragédies, l'hégémonie du capital et son pouvoir prépondérant peuvent s'expliquer par des éléments objectifs et subjectifs qui dépassent notre réflexion. La ligne principale du concept d'hégémonie d'Antonio Gramsci contribue à la compréhension de ce présent conjoncturel. L'hégémonie se réalise par des affrontements qui portent non seulement sur des questions liées à la structure économique et à l'organisation politique, mais aussi sur l'expression éthique et culturelle de savoirs et de pratiques, sur des modes de représentation et des modèles d'autorité qui cherchent à se légitimer et à s'universaliser. Par conséquent, l'hégémonie ne doit pas être comprise dans les limites de la simple coercition, car elle inclut la direction culturelle et le consentement social à un univers de convictions, de normes morales et de règles de conduite, ainsi que la destruction et le dépassement d'autres croyances et sentiments face à la vie et le monde.
La création de l'hégémonie est un processus historiquement long, qui occupe plusieurs espaces, et ses formes varient selon les acteurs sociaux impliqués. Enfin, l'hégémonie s'exprime par une classe qui conduit à la création d'un bloc historique, qui articule et donne cohésion aux différents groupes sociaux autour de la création d'une volonté collective – définie par « la conscience opérante de la nécessité historique ».
Voies vers la souveraineté financière
Différente de la suprématie et de l'hégémonie financière actuelles, la souveraineté financière repose sur la solidarité, l'identité et la créativité des peuples originaires, les quilombolas ; sur le leadership et la fermeté des femmes sur leurs territoires, garantissant la participation populaire et référençant d'autres espaces de prise de décision qui garantissent la participation populaire.
La souveraineté financière est présente dans la lutte du peuple Awá Guarani pour la reconnaissance de son territoire à Foz do Iguaçu (centrale hydroélectrique d'Itaipu), en solidarité dans la lutte contre la militarisation subie depuis des décennies par le peuple haïtien, en solidarité avec le peuple palestinien brutalement massacré, en résistance contre l'imposition des austérités fiscales les plus variées des agences internationales.
La souveraineté financière est intrinsèquement liée à la souveraineté des peuples, à la souveraineté alimentaire, à la souveraineté hydrique et aux territoires. Comme mentionné dans la déclaration de la conférence : « Nous devons décoloniser le pouvoir et construire un contre-pouvoir ascendant des peuples et des territoires, enraciné dans le respect des processus historiques, de la mémoire, de l'ascendance et du travail politique de chaque territoire, ainsi que construire et positionner un récit contre-hégémonique basé sur la réciprocité, la complémentarité, la collectivité et la conscience d'être la nature ».
Le renforcement d'alternatives concrètes contre-hégémoniques, forgées dans la culture populaire et dans la créativité des peuples, vitalise la possibilité d'une autre forme d'organisation de la vie. Avançons dans la création de la souveraineté des peuples et dans la force des organisations populaires qui portent dans leurs corps le bouillon culturel du paradigme du bien vivre et de l'immanence ancestrale d'Abya Ayala.
___
Rosilene Wansetto, Sandra Quintela et Talita Guimarães font partie du réseau Jubilé Sud Brésil.
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
Révision par Helena Zelic
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

S’attaquer à la crise climatique en agissant sur la consommation alimentaire

Tout le monde sait aujourd'hui que nous devons transformer à la fois la façon dont nous produisons et la manière dont nous utilisons l'énergie si nous voulons infléchir la trajectoire actuelle du changement climatique.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/01/22/sattaquer-a-la-crise-climatique-en-agissant-sur-la-consommation-alimentaire/
Il ne suffit pas de passer de sources d'énergie « polluantes » à des sources « propres ». En fait, nous devons produire et utiliser moins d'énergie globalement si nous voulons garder notre planète vivable tout en luttant pour la justice et l'équité en matière d'accès à l'énergie et de consommation de l'énergie.
Certains parlent à ce sujet de « décroissance », ou de la nécessité d'abandonner une attitude qui considère la croissance économique comme la mesure de notre réussite en tant que société. La recherche montre qu'une croissance économique « verte » ne suffit pas, car il nous faudrait des centaines d'années pour obtenir l'impact dont nous avons besoin [1]. Nous devons réduire radicalement les émissions et nous devons le faire rapidement. Sur le plan politique, nous savons que la décolonisation – garantir la justice dans la répartition des ressources, du pouvoir et des richesses – doit être notre boussole [2]. C'est un petit nombre de sociétés hautement industrialisées qui sont à l'origine de la surconsommation effrénée des ressources de notre planète.
C'est également vrai en ce qui concerne l'alimentation, la deuxième source d'émissions climatiques mondiales après les combustibles fossiles. Nous devons non seulement changer la façon dont nous produisons notre alimentation, mais aussi la façon dont nous la consommons. Cela peut sembler aller de soi, mais, comme le trop évident « éléphant dans la pièce », le volet consommation de la comptabilité climatique est régulièrement ignoré ou insuffisamment pris en compte, et il devient de plus en plus urgent de s'en préoccuper. À elle seule, la consommation alimentaire mondiale pourrait ajouter près de 1°C au réchauffement planétaire d'ici 2100 et nous pourrions déjà atteindre cette année, en 2023, la limite de 1,5°C fixée par l'Accord de Paris [3]. Le temps qui nous reste pour modifier raisonnablement ce scénario est presque écoulé.
Changer le système
Le mouvement climatique actuel, né d'une prise de conscience aiguë du rôle des combustibles fossiles comme principal moteur de la déstabilisation de notre climat, appelle non seulement au déploiement des énergies renouvelables mais également à des réductions majeures dans l'exploration, la production et l'utilisation de l'énergie qui alimente les pays les plus riches. Cela nécessite des changements profonds et structurels dans la manière dont ces sociétés utilisent et consomment l'énergie. Cela signifie davantage de transports collectifs, plus de durabilité et de réparabilité des produits, et une forte réduction dans la consommation de biens non essentiels. S'attaquer à la consommation et la maîtriser signifie aussi plus généralement moins de production, moins de travail, moins de déplacements, plus de temps consacré à des activités « non productives » (et donc non destructrices). Pour ce faire, il faut prendre conscience de ce qui est rare et le réaffecter à d'autres usage. En d'autres termes, nous devons adopter une culture de la sobriété – mais pas sa version néolibérale, aussi connue sous le nom d'austérité, qui punit les pauvres.
Il en va de même pour le système alimentaire. Au cours du siècle dernier, une grande partie du système alimentaire mondial a été industrialisée par l'introduction d'intrants chimiques, de monocultures à grande échelle, d'élevages industriels, d'une mécanisation lourde et de l'irrigation. Les systèmes alimentaires locaux ont été démantelés et mondialisés, et des multinationales ont pris le contrôle de tous les aspects de la chaîne alimentaire. De ce fait, le système alimentaire industriel est désormais responsable de plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout en étant également la principale cause de la déforestation, des crises de l'eau, de l'effondrement de la biodiversité et de nombreuses maladies. La Banque mondiale, qui a joué un rôle majeur dans la promotion de ce modèle catastrophique, estime que le système alimentaire mondial nous coûte désormais 12 000 milliards de dollars par an en coûts économiques, environnementaux et sociaux cachés [4].
Les multinationales agroalimentaires qui contrôlent ce système alimentaire et en bénéficient ont tardé à proposer des solutions à la crise actuelle. Mais à mesure que les préoccupations liées à la crise climatique se sont progressivement étendues au secteur alimentaire, la situation a changé et, depuis quelques années, la plupart de ces grandes entreprises ont annoncé des plans « zéro émission nette » et se sont associées à des gouvernements et des organismes internationaux dans le cadre de programmes de réduction des émissions dans l'agriculture. Toutes ces initiatives d'entreprises tournent autour de techniques et de technologies qui peuvent, selon elles, rendre les exploitations agricoles plus performantes, et toutes supposent que la production et la consommation peuvent être maintenues. En fait, tous ces modèles d'entreprise s'appuient sur les prévisions de croissance de leurs ventes de produits à fortes émissions, et mettent en avant le message mensonger selon lequel ces produits peuvent être « neutres en carbone », « verts » et « sans déforestation » [5]. Il n'est donc pas surprenant que les engagements « zéro net » des multinationales agroalimentaires s'appuient fortement sur les compensations carbone [6].
Il est évident que cela ne fonctionnera pas. Mais ce n'est pas non plus nécessaire ni souhaitable. La réalité est que le système alimentaire industriel est organisé autour du profit des grandes entreprises, et non en fonction de l'allocation de ressources limitées (et d'émissions) pour faire en sorte que les huit milliards de personnes sur cette planète aient suffisamment d'aliments nutritifs à manger. Notre système alimentaire mondial repose sur la production massive de quelques cultures de base destinées à être transformées en viande, produits laitiers et en aliments transformés, ainsi que sur un approvisionnement régulier en articles de luxe pour les riches (par exemple chocolat, fleurs ou fraises) – qui génèrent tous d'énormes émissions sans apporter beaucoup d'éléments nutritifs en retour.
Ce système alimentaire des multinationales est également source de gaspillage. Un tiers de la nourriture produite est gaspillée. Cela signifie qu'elle finit dans des décharges où elle génère d'importantes quantités de gaz à effet de serre, en particulier du méthane. De plus, une grande partie de la nourriture produite par ces grandes entreprises est déjà de la « malbouffe » au départ. Nestlé (l'entreprise suisse qui domine les rayons des épiceries dans le monde entier et dépense chaque année des centaines de millions de dollars en publicité et en lobbying pour garantir les ventes de ses produits) a reconnu que « la valeur nutritionnelle de moins de la moitié de son portefeuille d'aliments et de boissons grand public peut être considérée comme « saine » selon une définition communément acceptée [7]. » On peut imaginer toutes les terres, l'eau et l'énergie qui pourraient être réutilisées pour la production d'aliments nutritifs si nous supprimions les Nestlé de ce monde.
La consommation est dictée par les grandes entreprises
Pour faire face à la crise climatique, nous devons, de manière équitable, réduire la consommation et la production de viande industrielle, de produits laitiers industriels et d'aliments inutiles privilégiés par les multinationales. Nous devons en revanche accorder la priorité à la production et à la consommation d'aliments locaux et sains. Les avancées de la science montrent à quel point ces aliments industriels contribuent aux ravages climatiques [8]. Nous savons désormais qu'une réduction de la consommation de viande rouge et de produits laitiers industriels chez les populations aisées ou bien nourries pourrait réduire considérablement les émissions climatiques liées à l'alimentation. Cette réduction pourrait atteindre 75%, selon une équipe de recherche de l'Université d'Oxford [9]. Et le remplacement des aliments d'origine animale par des légumineuses, des noix, des fruits et des légumes présente également d'importants avantages pour la santé : diminution du risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2, et réduction de la mortalité due aux maladies liées à l'alimentation.
Pourtant, ces changements ne doivent pas être minimisés ou réduits au comportement individuel. Nous produisons et consommons collectivement trop de nourriture et d'énergie. Les objectifs des grandes entreprises – qui vont à l'encontre de l'intérêt public par le biais du marketing, du lobbying politique et des accords commerciaux conduisent à la fois à la surproduction et à la surconsommation. (Voir l'encadré sur Jalisco.) Le système commercial mondial repose sur toujours plus de consommation, de stimulation et de croissance, et il renforce ces tendances. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale du commerce, les émissions générées par la production et le transport de biens et services exportés et importés représentent 20 à 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dans le cas des fruits et légumes, le chiffre est de 36% [10]. La manière dont la viande de bœuf parvient aux ménages chinois illustre très bien le problème .
Prenons l'exemple du sucre. Alors que les autorités climatiques britanniques ont recommandé une réduction de 20% de la consommation de viande et de produits laitiers d'ici 2030, et de 35% pour la consommation de viande d'ici 2050, c'est désormais le sucre qui retient l'attention [11]. La quantité de sucre produite par le Royaume-Uni dépasse largement les besoins de sa population. Et cette production a un coût « climatique » lié à une utilisation très importante des terres et de l'eau, à la perte de la couche arable, à l'érosion de la biodiversité et à des subventions mal ciblées. Le coût sanitaire est bien sûr tout aussi préoccupant : les deux tiers de la société britannique sont en surpoids ou obèses. Mais le pays importe près de deux fois la quantité de sucre qu'il surproduit, générant ainsi une facture climatique encore plus élevée [12]. Cette consommation excessive n'est pas motivée par la demande des consommateurs mais par la cupidité des grandes entreprises. Le sucre est un ingrédient alimentaire bon marché qui augmente les ventes, en particulier sous forme d'aliments ultra-transformés. Les importations sont intégrées dans les nombreux accords de libre-échange conclus par le Royaume-Uni pour soutenir les intérêts des grandes entreprises, et non ceux du public. Des groupes britanniques exigent désormais une restructuration complète du secteur, allant jusqu'à la réaffectation des subventions en faveur du sucre pour rendre les fruits et légumes plus abordables.
Une occasion d'agir
Comme nous l'avons déjà souligné, si l'action individuelle est importante, nous ne pouvons pas réduire le problème aux individus ni leur en faire porter la responsabilité. Il est parfaitement logique de réduire les importations dans les pays où la viande industrielle, les produits laitiers et les aliments inutiles sont consommés en excès, tout en rendant les systèmes de production plus écologiques. Et nous devons trouver les moyens d'éliminer les grandes entreprises qui sont à l'origine de tous ces dégâts.
Cela nécessite des changements politiques radicaux et une pression organisée de la part des mouvements sociaux. Heureusement, la prise de conscience de la nécessité d'opérer des changements profonds par une action collective s'est développée depuis que les populations subissent directement les impacts du dérèglement climatique.
Une série de mesures concrètes ont déjà été élaborées par des activistes et des équipes de recherche et doivent être accélérées de toute urgence :
Éliminer le gaspillage alimentaire, source majeure d'émissions.
Réduire la consommation excessive dans une minorité de pays, tant de viande et de produits laitiers industriels que d'aliments superflus (fruits et légumes hors saison, produits de luxe comme les baies et les sucreries, etc.). Les taxes, droits de douane et autres instruments fiscaux peuvent jouer un rôle, tout comme des mesures énergiques prises par le secteur de la distribution alimentaire. Les accords commerciaux qui favorisent les schémas d'offre excédentaire, comme l'accord UE-Mercosur, doivent également être stoppés ou abrogés.
Réduire la production industrielle de viande et de produits laitiers en Europe, en Amérique du Nord, au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande grâce à des mesures énergiques telles que la réduction du cheptel.
Aider les populations agricoles à abandonner les engrais chimiques et interdire les élevages en milieu confiné, qui génèrent respectivement d'énormes quantités d'oxyde nitreux et de méthane.
Repenser et réamorcer le système de distribution alimentaire. Les villes doivent réorganiser la vente au détail de produits alimentaires de façon à ce que les magasins et les marchés soient répartis de manière égale et proposent des aliments sains plutôt que des produits ultra-transformés. Nous devrions également envisager un zonage ou d'autres politiques publiques pour limiter la présence des grandes entreprises et protéger la vente et les coopératives au niveau local. Nous devons mieux socialiser la distribution alimentaire. Certains tentent déjà d'y parvenir en mettant en place des systèmes de sécurité sociale alimentaire, en se battant pour obtenir des permis locaux et des protections sociales nationales pour les commerces de rue, et en essayant de renforcer les marchés publics par le biais de contrôles des prix, de subventions et d'infrastructures publiques. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.
Supprimer les réglementations et les lois qui portent atteinte aux exploitations de production alimentaire locale et les remplacer par des politiques qui soutiennent les systèmes paysans de production et de commercialisation agroécologiques.
Enfin, nous devons mettre un terme aux accaparements des terres et de l'eau qui sont menés en silence à travers le monde afin d'accroître la production de monocultures agricoles destinées à l'exportation [13]. Nous devons également soutenir les vastes mouvements sociaux qui se mobilisent, de l'Argentine à l'Arizona et du Cameroun à la France, pour maintenir le contrôle social sur la terre et l'eau en tant que biens communs appartenant aux populations dans leurs territoires, et non comme marchandises à exploiter au profit de quelques-uns [14].
En résumé, nous devons mettre en place davantage de systèmes publics, d'actions collectives et de nouvelles économies pour parvenir à la justice à laquelle les gens aspirent. Mais nous devons agir vite. Les entreprises et les autres criminels du climat ne s'écarteront pas du chemin si nous ne faisons pas bouger les choses.
Comment les accords de libre-échange favorisent des modes de consommation qui détruisent les communautés rurales
Voyons comment cela se passe dans les communautés autour d'El Grullo, dans l'État mexicain de Jalisco, un exemple parmi tant d'autres. Avant l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), en 1994, les terres étaient gérées collectivement, les communautés paysannes pratiquant une combinaison de cultures vivrières traditionnelles et faisant paître le bétail dans les forêts à flanc de colline. Les gens avaient accès à l'eau, à la terre et à la nourriture. Les surplus de maïs, de fromage et d'autres aliments produits étaient vendus en ville pour dégager des revenus.
Puis est arrivé l'ALENA. Les populations ont perdu leurs marchés locaux pour le maïs, écrasés par des importations étatsuniennes bon marché et subventionnées. Le gouvernement mexicain a lancé une campagne pour encourager les gens à passer à la production sous contrat de pommes de terre en monoculture et à d'autres cultures pour les entreprises de restauration rapide. C'est ainsi qu'a commencé un cycle d'endettement, d'utilisation de produits chimiques, de déforestation et d'affaiblissement du contrôle collectif des populations sur les territoires.
Aujourd'hui, les communautés sont plus pauvres que jamais et les terres sont dévastées. Les terres et la production ont été accaparées par le crime organisé et les grandes entreprises, qui se concentrent sur la production à grande échelle d'agave (tequila) et de cultures d'exportation destructrices pour l'environnement et la société, comme les avocats, les baies et le raisin, qui sont principalement destinées aux supermarchés des États-Unis et du Canada. Les systèmes alimentaires florissants de Jalisco ont été détruits pour laisser la place à un système de production et de consommation organisé autour du profit des entreprises.
Cette situation ne sera pas résolue en rendant les vignes plus performantes ou plus durables. Elle ne peut l'être que si les communautés reprennent le contrôle de leurs territoires et que les consommateurs et consommatrices des États-Unis et du Canada disent adieu aux raisins importés.
(Texte basé sur un entretien avec des membres du Colectivo por la Autonomía)
[1] Jegim Vogel et Jason Hickel, « Is green growth happening ? An empirical analysis of achieved versus Paris-compliant CO2–GDP decoupling in high-income countries », The Lancet, septembre 2023 :
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(23)00174-2/fulltext
[2] À ce sujet, voir les excellentes présentations de « Beyond Growth 2023 », Bruxelles, 15-17 mai 2023 :
https://www.beyond-growth-2023.eu.
[3] Catherine Ivanovitch et al, « Future warming from global food consumption », Nature Climate Change, 6 mars 2023 :
https://www.nature.com/articles/s41558-023-01605-8. Berkeley Earth, « September 2023 temperature update » :
https://berkeleyearth.org/september-2023-temperature-update/
[4] Banque mondiale, « Food finance architecture : Financing a healthy, equitable, and sustainable food system », 23 sept. 2021 :
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/879401632342154766/food-finance-architecture-financing-a-healthy-equitable-and-sustainable-food-system
[5] Il faut noter que le terme « neutre en carbone » sera interdit sur les étiquettes des produits (mais pas sur les services comme les billets d'avion) dans l'Union européenne à partir de 2026. Voir Nikolaus Kurmayer, « EU reaches deal banning climate-neutral product claim », 21 sept. 2023
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-reaches-deal-banning-climate-neutral-product-claims/
[6] Par exemple, le géant étatsunien de la confiserie Mars Inc. admet qu'il lui faudrait compenser au moins 20% de ses émissions pour atteindre l'objectif zéro net. Mars, « Net zero road map », sept. 2023 :
https://www.mars.com/sites/g/files/jydpyr316/files/2023-09/Mars%20Net%20Zero%20Roadmap%202050_2.pdf
[7] Alistair Gray, « Nestlé says less than half of its mainstream food and drinks are considered ‘healthy' », Financial Times, 21 mars 2023 :
https://www.ft.com/content/8d42f7e8-72a6-4d85-9990-ad2a2cd0da21
[8] Voir le résumé de Physicians for Responsible Medicine, 29 octobre 2023 :
https://www.pcrm.org/good-nutrition/vegan-diet-environment
[9] Ces résultats reflètent les régimes alimentaires britanniques. Voir Damian Carrington, « Vegan diet massively cuts environmental damage, study shows. » The Guardian, 20 juillet 2023 :
https://www.theguardian.com/environment/2023/jul/20/vegan-diet-cuts-environmental-damage-climate-heating-emissions-study.
L'étude elle-même a été publiée dans Nature Food le 20 juillet 2023 :
https://www.nature.com/articles/s43016-023-00795-w.
[10] Commission européenne, DG Environnement, « Field to fork : global food miles generate nearly 20% of all CO2 emissions from food », 25 janvier 2023 :
https://environment.ec.europa.eu/news/field-fork-global-food-miles-generate-nearly-20-all-co2-emissions-food-2023-01-25_en
[11] Oliver Morrison, « Sugar : the next ingredient set to come under fire for its climate impact ? », Food Navigator, 23 avril 2021 :
https://www.foodnavigator.com/Article/2021/04/23/Sugar-the-next-ingredient-set-to-come-under-fire-for-its-climate-impact
[12] James Tapper, « Cap UK's sugar supply to fight obesity, say campaigners », The Guardian, 28 octobre 2023 :
https://www.theguardian.com/society/2023/oct/28/cap-uks-sugar-supply-to-fight-obesity-say-campaigners
[13] Voir l'outil de suivi de GRAIN :
https://farmlandgrab.org.
[14] GRAIN, « L'accaparement de l'eau par l'industrie alimentaire mondiale assoiffe les communautés locales », 21 septembre 2023 : https://grain.org/e/7041.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soudan. Neuf mois de guerre et si peu d’espoir

Depuis avril 2023, l'affrontement entre l'armée régulière d'Abdel Fattah Al-Burhan et les paramilitaires de la Force de soutien rapide (FSR) de Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemeti a mis le Soudan à feu et à sang et forcé plusieurs millions de Soudanais à fuir leur foyer, voire à se réfugier à l'étranger. La situation se détériore, dans l'indifférence de la communauté internationale.
Tiré d'Orient XXI.
Appelons-les Nassim et Ibrahim, prénoms d'emprunt pour les protéger. Avant la guerre, Nassim habitait un quartier populaire de Khartoum. Étudiant célibataire, il vivait chez ses parents, des fonctionnaires de la classe moyenne qui luttaient pour maintenir un niveau de vie à peu près correct malgré l'inflation vertigineuse. Étudiant en master, Nassim appartenait au noyau dur du comité de résistance de son quartier, organisation de base de la révolution populaire de 2018 – 2019. Mais après l'euphorie du soulèvement, il s'était un peu éloigné de la politique, déçu par le retour en force des vieux partis englués dans leurs querelles mutuelles et leurs batailles d'égos.
Âgé de quelques années de plus, Ibrahim est divorcé. Avant la guerre, il collaborait avec des organisations internationales, les agences onusiennes et les grandes ONG, auxquelles il ouvrait en quelque sorte les portes de son pays dont il connait les moindres recoins. Lui aussi a participé à la révolution et à cet élan intellectuel qui promettait de reconstruire le Soudan, d'en faire un État pour tous ses citoyens. Lui aussi bataillait contre une crise économique dévastatrice qui laissait exsangue le peuple tout entier, à l'exception de l'élite prédatrice de l'ancien régime, les Kaizan.
Fuir Khartoum
Nassim et Ibrahim ont tenu bon devant les vicissitudes de la période postrévolutionnaire. Avec des millions d'autres, ils ont risqué leur vie pour ne pas céder aux militaires et aux miliciens. Ils n'ont pas reculé face au coup d'État d'octobre 2021, durant lequel l'armée régulière (les Forces armées soudanaises ou FAS) et les paramilitaires (la Force de soutien rapide ou FSR) étaient unis pour mettre fin à l'expérience démocratique.
Pourtant ces alliés d'hier se font aujourd'hui la guerre. Depuis le 15 avril dernier, Abdel Fattah Al-Burhan, commandant en chef de l'armée, chef de facto du pays, est soutenu par les islamistes de l'ancien régime contre Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, à la tête de la FSR, des paramilitaires si puissants qu'ils sont devenus une armée bis.
Comme des millions de leurs concitoyens, le 15 avril 2023 a bouleversé les destins de Nassim et Ibrahim. Ibrahim a fait de multiples aller-retours dans sa voiture déglinguée pour évacuer sa famille d'abord, puis des amis chers, puis des connaissances. Tous ont fui les combats à Khartoum, vers la frontière égyptienne pour certains, vers l'est du pays pour d'autres. La population de la capitale a subi les pillages, les viols et les meurtres des FSR du général Hemeti, fidèles à leur ascendance : les terrifiants janjawid de la guerre au Darfour dans les années 2000, supplétifs du régime d'Omar Al-Bachir. En même temps, les habitants de Khartoum ont subi les bombardements par l'artillerie lourde et l'aviation de l'armée régulière. Ibrahim a donc fini par partir, lui aussi, en direction de Wad Madani, la capitale de l'État d'Al-Jazirah, une vaste province agricole située à 185 km au sud-est de Khartoum.
Nassim et sa famille sont restés à leur domicile pendant plusieurs semaines. Et quand leur quartier est tombé aux mains des FSR, ils se sont déplacés chez une proche, en banlieue de Khartoum. Les paramilitaires ont fini par arriver jusque-là ; Nassim est alors parti vers le sud-est. Il a traversé des barrages militaires avant de s'arrêter à Kosti, une ville de l'État d'Al-Nil Al-Abyad ("le Nil blanc"). Là-bas, il a pu trouver une maison à louer à bas prix. Un sort beaucoup plus confortable que celui des milliers de déplacés entassés dans des écoles ou sous des abris précaires.
Sept millions et demi de personnes sont déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays, selon le chiffre du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) du 14 janvier 2024, sans oublier les 12 000 morts, un bilan certainement sous-estimé. Tous traversent les mêmes affres : trouver de quoi se loger, récupérer son argent après le pillage et l'effondrement des établissements bancaires, pallier l'absence d'écoles fermées depuis avril, suppléer à la quasi-destruction des infrastructures médicales… Bref, survivre dans un pays déjà appauvri et mal doté avant la guerre.
Les « villas fantômes »
En décembre 2023, le tableau est assez clair : le Soudan est coupé en deux dans le sens est-ouest. La milice de Hemeti contrôle une grande partie de la capitale, l'armée régulière étant cantonnée dans quelques bases et quelques quartiers d'Omdourman. Les hommes de Hemeti tiennent aussi l'ouest, le Darfour, ainsi qu'une partie du Kordofan. Ce n'est guère une surprise : recrutés pour l'essentiel parmi les tribus arabes de la grande province occidentale, les FSR connaissent parfaitement le terrain et se sont emparés sans grandes difficultés des principales villes.
Des comités de paix formés de dignitaires religieux et séculiers ont bien tenté de maintenir des cessez-le-feu, mais ils ont volé en éclat les uns après les autres. La tâche des FSR a été facilitée par le peu d'appétence de l'armée régulière à les combattre. Celle-ci a préféré se retirer dans ses cantonnements.
Partout dans les zones tenues par les FSR, de très graves violations des droits humains sont rapportées, commises soit directement par les hommes de Hemeti, soit par des milices arabes locales liées aux FSR par la famille ou la tribu.
Commandée par le général Al-Burhan, l'armée régulière largement adossée aux islamistes du régime d'Omar Al-Bachir a déménagé à Port-Soudan. Ces hommes tiennent l'est et le nord du pays — la vallée du Nil d'où sont originaires les classes économiques, militaires et politiques des gouvernements successifs depuis l'indépendance du pays. Comme sous l'ancien régime, ils mènent une politique répressive contre tout opposant. Dans ce contexte, la sinistre mémoire des « villas fantômes », lieux secrets de détention, est réactivée.
« Jusqu'à mi-décembre, on semblait se diriger vers un scénario à la libyenne avec un pays scindé et dirigé par deux entités ennemies, chacune soutenue par des parrains étrangers : les FSR par les Émirats arabes unis et les FAS par l'Égypte. Mais ce scénario est caduc », affirme Kholood Khair, analyste soudanaise aujourd'hui en exil.
Le retrait suspect de l'armée régulière
Le 15 décembre à l'aube, les hommes de Hemeti attaquent les faubourgs de Wad Madani, capitale de l'État d'Al-Jazirah vers laquelle ont afflué, comme Ibrahim, des centaines de milliers d'habitants de Khartoum. Abri pour les déplacés, la ville est aussi devenue un centre de stockage d'aide alimentaire et de médicaments.
Les forces régulières se retirent sans presque combattre. Le 18 décembre, Wad Madani est aux mains des FSR. Pillages, viols, menaces, les exactions sont du même type qu'au Darfour. « Au sein des FAS, les officiers de rang moyen sont furieux, car ils ont reçu l'ordre de quitter la ville sans combattre », assure Kholood Khair.
- Les hauts gradés sont tous islamistes, car ils ont été recrutés et formés sous Omar Al-Bachir. Ils ne discutent donc pas le bien-fondé des décisions de l'état-major. Mais leurs subordonnés s'interrogent : pourquoi tous ces ordres qui semblent favoriser FSR ? Il y a des soupçons d'achat de certains officiers par Hemeti.
La chute de Wad Madani est un choc et, indéniablement, un tournant. Le verrou vers Port-Soudan à l'est ainsi que vers Sennar et Kosti au sud a sauté. Selon l'ONU, 300 000 personnes ont fui Wad Madani dans les premières heures de l'offensive des FSR, et 200 000 supplémentaires les jours suivants.
Ibrahim a été de ceux-là. Il est parti vers Sennar, plus au sud :
- Nous n'avions pas d'autre destination possible devant l'avancée des FSR, les autres routes étaient coupées. C'était complètement chaotique. Les gens étaient paniqués, tout le monde sait les atrocités commises par les FSR à Khartoum et au Darfour. Nous avons mis plus de deux jours pour atteindre Sennar, qui est à 90 km !
Ibrahim a attendu de voir si les troupes de Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti allaient poursuivre leur marche vers l'est et le sud. Celles-ci ont effectivement essayé, mais cette fois, elles ont été bombardées par l'aviation. Pour l'instant, elles restent donc sur leurs dernières positions. Ibrahim rejoint Gedaref puis Port Soudan, à la recherche d'un travail. Il n'envisage toujours pas de quitter le pays.
Supprimer toute résistance civile
Nassim, lui, a jeté l'éponge. La prise de Wad Madani a été celle de trop. En charge de ses parents âgés et traumatisés, ainsi que d'une partie de ses frères et sœurs, il a fini par se résoudre à l'exil. La famille a d'abord fait le voyage de Kosti au sud vers Dongola au nord de Khartoum :
- Nous avions trop peur que les FSR bloquent la route et que nous soyons pris au piège, pour rester à Kosti. Des milliers de personnes ont fait comme nous : remonter vers le nord tant qu'il en était encore temps.
À Dongola, il a payé des passeurs. Direction l'Égypte. La voie légale est onéreuse, plus encore que la clandestine, et aussi difficile depuis que Le Caire a décidé de restreindre considérablement le passage. « Il suffit de payer les soldats égyptiens », lui ont assuré les passeurs. Aujourd'hui, Nassim est en Égypte.
Certains restent malgré tout. Dans les zones contrôlées par les FSR comme dans celles tenues par les FAS, les organisations révolutionnaires, comités de résistance, comités de quartier, organisations de femmes, syndicats, s'efforcent de pallier l'État désormais failli. Mais partout ces organisations sont en butte à une répression féroce. C'est là le point commun entre les généraux Hemeti et Al-Burhan. Même ennemis, ils se retrouvent dans leur volonté d'en finir avec la révolution. Comme l'analyse Kholood Khair :
- Les deux sont persuadés de leur victoire. Chacun d'entre eux veut donc supprimer toute résistance civile avant de conquérir le pays. Sinon, ils savent bien que ce pouvoir qu'ils espèrent tant sera trop fragile. Alors l'un comme l'autre utilise le paravent de la guerre pour tuer ce qui reste de la révolution. Des médecins, des journalistes, des activistes sont assassinés, arrêtés, emprisonnés, torturés. Par les deux camps.
Une velléité d'accord vite balayée
Dans ce chaos, une image a surpris : celle de Hemeti serrant la main d'Abdallah Hamdok, ancien Premier ministre durant la courte parenthèse démocratique, de septembre 2019 à octobre 2021. Aujourd'hui, l'ancien chef de gouvernement est à la tête de la coalition des forces démocratiques, appelée également Taqaddom (« avancée »). Créée à Addis-Abeba en octobre 2023, cette plateforme rassemble des partis politiques, des syndicats et des organisations de la société civile qui ont été parties prenantes dans la révolution. Elle veut peser sur les acteurs du conflit pour obtenir une cessation des hostilités et, surtout, des garanties pour l'après-conflit.
Le 2 janvier, Taqaddom a donc signé un accord avec l'un des deux belligérants. Sur X (anciennement Twitter), Abdallah Hamdok s'est réjoui d'avoir obtenu la « pleine disponibilité des FSR à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, à des mesures visant à protéger les civils, à la facilitation du retour des citoyens dans leurs foyers, à l'acheminement de l'aide humanitaire et à la coopération avec la commission d'enquête. »
L'encre n'avait pas encore séché que Taqaddom se prenait une volée de bois vert de la part de certains partis, comme le Parti communiste, une faction du Baas, des personnalités du Parti unioniste ou du parti Oumma, des activistes de la révolution ou encore des comités de résistance… À l'autre bout du spectre politique, des islamistes de l'ancien régime, furieux, ont poussé le général Al-Burhan à refuser toute rencontre, avec Taqaddom comme avec Hemeti. Pour Kholood Khair, cela montre à quel point les civils sont divisés :
- Taqaddom perd sa crédibilité en signant un accord avec Hemeti malgré toutes les atrocités commises par les FSR. Non seulement elles ne sont pas mentionnées, mais elles ont même été niées par leur porte-parole ! Certains, au sein de la plateforme, pensent pouvoir contrôler Hemeti une fois qu'il aura pris le pouvoir. C'est extraordinairement naïf ! Et cela veut dire que ces hommes politiques n'ont rien appris de ces dernières années.
En attendant, aucune promesse contenue dans la déclaration d'Addis-Abeba tant vantée par Abdallah Hamdok n'a connu l'amorce d'une concrétisation. Des témoignages affirment même que la reprise de la « vie normale » vantée par les FSR à Wad Madani se fait à la pointe du fusil. Les médecins sont contraints de reprendre leur poste sous la menace et les commerçants sont rackettés.
Mais les poignées de main ont permis au général Hemeti de gagner encore un peu plus en honorabilité. Il a ainsi été reçu en interlocuteur digne de foi et d'intérêt dans plusieurs capitales africaines, lors d'une tournée qui l'a mené de Pretoria à Djibouti en passant par Nairobi, Kampala et Kigali, où il s'est recueilli au mémorial du génocide…
« Même s'il réussit à progresser vers l'est et le nord, à prendre Port-Soudan et à contrôler tout le pays, il n'aura pas gagné la guerre, prophétise Kholood Khair. Il aura à affronter des groupes armés dans toutes ces régions. » Les FAS distribuent des armes à la population de la vallée du Nil qui tient à défendre ses villes et ses villages. Et qui refusera de voir un homme du Darfour gouverner le Soudan.
Le vieux clivage entre le centre, la vallée du Nil, ancien royaume de Kouch mythifié par les élites soudanaises qui gouvernent depuis l'indépendance, et les périphéries, en particulier le Darfour, n'est pas mort dans le fracas des armes. Au contraire, il est revivifié. Et au Soudan, il n'y a pas de cuillères assez grandes pour dîner avec les trop nombreux diables.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Maroc. Manifestations populaires et silence royal

Tiraillés entre une population majoritairement acquise à la cause palestinienne qui risque de basculer dans un islamisme aux aguets, et l'accord de normalisation signé en 2020 dont ils ne sont pas près de s'affranchir, les dirigeants marocains se réfugient dans un silence de plus en plus pesant.
Tiré de Orientxxi
23 janvier 2024
Par Omar Brouksy
Manifestation en solidarité avec Gaza, le 24 décembre 2023 à Rabat/AFP
AFP
Plus de quatre mois après le déclenchement de la guerre contre Gaza, la mobilisation anti-Israël n'a pas faibli au Maroc. Des milliers de personnes manifestent quasiment chaque week-end dans les grandes villes du pays, notamment à Rabat et Casablanca. Deux revendications dominent les slogans : la fin des massacres de la population gazaouie par l'armée israélienne et, surtout, la fin de la normalisation des relations diplomatiques entre le royaume chérifien et « l'État sioniste », comme le scandent les manifestants.
Commencé en décembre 2020, le processus de normalisation entre les deux États prend la forme d'une transaction tripartie : en contrepartie de la reconnaissance de la « marocanité » du Sahara occidental par l'ancien président américain Donald Trump, le royaume « normalisera » ses relations avec Israël. Une manœuvre habile puisqu'il s'agit de monnayer une « cause sacrée » pour la majorité des Marocains (l'affaire du Sahara occidental, considéré par le Maroc comme ses « provinces du sud ») par une autre « cause sacrée » (la question palestinienne).
Depuis, la coopération, notamment militaire, entre les deux pays est devenue officielle après avoir été longtemps officieuse, même si l'État hébreu tient à la cantonner aux armes défensives et légères. L'attaque d'envergure du Hamas au cœur d'Israël, le 7 octobre 2023, ne représente pas une rupture, mais un point de basculement qui affectera profondément la lune de miel israélo-marocaine, louangée tant par les Etats-Unis que par l'Union européenne.
Manoeuvre politique
Au cœur de ce processus, le Palais royal avait eu recours à un stratagème habile et machiavélique visant à porter le coup de grâce au Parti de la justice et du développement (PJD), le parti islamiste au gouvernement à l'époque, et dont la légitimité religieuse concurrençait celle du roi, le Commandeur des croyants. Ce dernier fait alors signer l'accord de normalisation non pas par le ministre des Affaires étrangères mais par le chef du gouvernement, l'islamiste Saad Dine Elotmani (2017-2021), en même temps secrétaire général du PJD. Les conséquences sur l'identité politique et l'image du parti sont désastreuses car la lutte contre la normalisation avec « l'entité sioniste » fait partie de l'ADN des partis islamistes. Laminé électoralement un an plus tard lors des législatives de 2021 où il obtient 12 sièges au Parlement du Maroc qui en compte 395, le PJD est aujourd'hui l'ombre de lui-même, une coquille vide.
Lors des rassemblements propalestiniens qui se déploient depuis le 7 octobre dans les artères principales des grandes villes, ni les dirigeants du PJD ni ses militants n'osent se montrer ou se mêler aux foules en colère. Et pour tenter de réparer ce que l'ancien secrétaire général avait détruit en signant le traité de normalisation, le nouveau dirigeant du PJD, Abdelilah Benkirane, un populiste lui aussi ancien chef du gouvernement (2011- 2016), multiplie désespérément les sorties médiatiques. « Oui, le PJD s'est trompé en signant la normalisation, nous l'admettons. Mais le parti n'a jamais été pour cette normalisation », déclare-t-il en sanglots, le 19 novembre 2023 devant un parterre de militants. Il va même jusqu'à offrir au leader du Hamas Khaled Mechaal, en visite au Maroc, une tribune dans laquelle le responsable palestinien, devant les militants, invite les Marocains « à s'adresser aux dirigeants du pays (…) pour rompre les relations, arrêter la normalisation et chasser l'ambassadeur » – ce qui suscite une colère noire de l'entourage royal qui y voit une « ingérence intolérable et un appel à peine déguisé au soulèvement. »
Pour réhabiliter son parti, Abdelilah Benkirane ira même jusqu'à tenir des propos ouvertement antisémites : « Ils avaient des savants comme Einstein, mais ils ne voient pas loin. C'est pour cela que Dieu les a favorisés au début et maudit il y a 2 000 ans. Parce qu'en réalité, ils sont idiots. Leur idiotie leur fait croire que c'est la force qui résout le problème ». Mais ces tentatives n'ont pas d'effets marquants sur l'image de sa formation ni de ses dirigeants qui restent parmi les moins considérés sur la scène politique marocaine.
Organisation à la romaine
Toutefois, l'absence du PJD va être vite comblée par l'autre composante de l'islamisme marocain : l'association Justice et bienfaisance (Al-Adl wa Al-Ihsan). Interdit mais toléré, ce mouvement, qui ne reconnaît pas le statut religieux du roi et conteste ses larges pouvoirs politiques, est très présent dans les manifestations propalestiniennes à travers la mobilisation, à Rabat et Casablanca notamment, de l'essentiel de ses sympathisants. Connu pour son organisation à la romaine, la discipline de ses membres et les moyens utilisés pour s'assurer un maximum de visibilité dans l'espace public, Justice et bienfaisance ne pouvait pas rater l'occasion du 7 octobre pour s'affirmer comme "l'unique choix islamiste possible", après le fiasco électoral et politique du PJD.
Très présents sur les réseaux sociaux, dès lors que les médias officiels leur sont fermés, les militants n'hésitent pas à utiliser la question palestinienne et celle de la normalisation comme des vecteurs de redéploiement pour rallier ne serait-ce que les déçus du PJD, mais aussi comme des leviers pour contester le régime monarchique et sa légitimité religieuse – le roi Mohammed VI étant à la fois Commandeur des croyants et président du Comité Al-Qods pour la Palestine.
Silence de cathédrale
En ce qui concerne les autres partis politiques, le contraste reste très marqué avec la population qu'ils sont supposés, selon la Constitution, représenter et encadrer. Pour ces partis parfaitement domestiqués par la monarchie, la question palestinienne est devenue, depuis la signature de l'accord de normalisation, une ligne rouge à ne pas franchir, à l'exception du Parti socialiste unifié (PSU) et de la Voie démocratique travailliste (Al-Nahj Al-Dimokrati Al-Amili), deux organisations de gauche ultra-minoritaires.
Si certains osent, en y mettant beaucoup de gants, contester les attaques israéliennes contre Gaza et le nombre effrayant des victimes, ils évitent soigneusement de demander la fin de la normalisation. Cela se traduit sur le terrain par l'absence des partis politiques dans les manifestations propalestiniennes. S'agit-il d'une prudence stratégique et d'une volonté de leurs dirigeants de ne pas susciter l'ire du roi et de son entourage ? Aucune réponse. Un silence de cathédrale. Y compris, le 12 janvier 2024, au moment même où l'Afrique du Sud défend sa plainte pour génocide contre Israël devant la plus haute Cour de l'ONU, la Cour internationale de justice dont l'un des membres, le juriste Mohamed Bennouna, est Marocain. Au même moment, le Bureau de liaison, une délégation marocaine à Tel-Aviv, annonce la reprise de tous les services consulaires à partir du 22 janvier, après leur suspension, le 19 octobre 2023, lorsque le ministère des Affaires étrangères israélien avait décidé d'évacuer son bureau de liaison à Rabat en réponse à la forte mobilisation des Marocains.
Même silence du côté du Palais royal, à l'exception d'un communiqué laconique datant du 17 octobre, au lendemain du bombardement par l'armée israélienne de l'hôpital Al-Maamdani faisant plusieurs centaines de morts et de blessés palestiniens à Gaza : « Le Royaume du Maroc réitère son appel à ce que les civils soient protégés par toutes les parties et qu'ils ne soient pas pris pour cibles. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, président du Comité Al-Qods, souligne l'urgence de fédérer les efforts de la communauté internationale pour mettre fin, au plus vite, aux hostilités, respecter le droit international humanitaire et œuvrer pour éviter que la région ne sombre dans une nouvelle escalade et de nouvelles tensions. »
Un silence qui sera doublé d'une absence physique du roi dès le 4 décembre. Le président du comité Al-Qods entame alors un long périple mi-officiel mi-privé qui le conduit d'abord aux Émirats arabes unis, où il est reçu en grande pompes par le Cheikh Mohammed ben Zayed fraichement investi, avant de s'envoler le 17 décembre vers les Seychelles, l'archipel africain aux 115 îles paradisiaques dans l'océan Indien. Le roi part ensuite pour Singapour, où il fête le Nouvel An, avant de finalement rentrer à Rabat le 11 janvier, jour de la signature du manifeste pour l'indépendance, célébré au Maroc.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Guerre d’influence entre l’Occident et les Brics en Afrique

La présidente de l'Alliance internationale des Brics Larisa Zlenstova et son vice-président chargé des projets stratégiques, Ahoua Don Mello accompagnés des vice-présidents Brics chinois et indien ont parrainé, le jeudi 18 janvier dernier, la signature d'un accord-cadre sur le financement de plusieurs projets stratégiques au profit du gouvernement centrafricain, au moment où le Secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken préparait sa mini tournée dans l'ouest-africain.
Tiré de MondAfrique.
La guerre d'influence que se livrent de plus en plus ouvertement le bloc occidental et l'Alliance internationale des Brics a pris, ces derniers jours, l'allure d'un chassé-croisé diplomatique sur le sol africain où séjourne, depuis lundi, Anthony Blinken. Le Secrétaire d'Etat américain qui doit se rendre dans les prochains jours à Luanda, en Angola, a débuté sa mini tournée diplomatique au Cap vert avant de rejoindre Abidjan le même jour. Partout, il a promis à ses « amis » africains un soutien institutionnel et financier de son pays de nature à aider au renforcement de la démocratie.
La Côte d'Ivoire qui doit organiser une élection présidentielle en 2025, soit dans un peu plus d'un an, partage ses deux frontières nord avec le Burkina Faso et le Mali qui ont tous les deux, plus le Niger, établi des accords de coopération militaire avec Moscou.
La montée du djihadisme
Abidjan s'inquiète également des possibles infiltrations de groupes djihadistes sur son territoire et compte sur ses partenaires occidentaux compte de la guerre larvée qui l'oppose à ses voisins du Sahel. En revanche, les Brics ont le vent en poupe en Afrique où ils doivent maintenant consolider leur influence en réalisant les infrastructures d'interconnexion capables d'aider au développement de leurs partenaires du continent. C'est pourquoi au moment de signer l'accord cadre entre le patron de l'entreprise émirati, Engineering solution (ENGSOL), et le ministre des transports et de l'aviation civile Herbert Djono-Ahaba, tout l'état-major des Brics comprenant la présidente Larisa Zelenstova, le vice-président chargé des projets stratégiques et les vice-présidents chinois et indien des Brics se sont retrouvés au grand complet à Bangui, dans la capitale centrafricaine.
Tous ont donc assisté à la conclusion de l'accord de concession destiné à la construction du futur aéroport international du pays qui, pour l'heure, est le seul à avoir bénéficié d'un contrat de réalisation. A ce titre, ENGSOL finance la conception, l'ingénierie et le financement du nouvel aéroport, ainsi que la création d'une zone franche de fret régional et la mise en place de l'exploitation d'un système de gestion intégrée à l'ensemble des activités du transport aérien dans le pays.
Cette cérémonie de signature a été présidée par le président centrafricain, Faustin Touadéra, président de la République de la Centrafrique qui avait à ses côtés Mme Zlenstova et Ahoua Don Mello en tant que responsable des projets stratégiques dans l'Alliance. Reste désormais à régler les problèmes fonciers et toutes les questions liées aux sujétions coutumières avant le démarrage des travaux.
Baptisés 5G, ces projets majeurs stratégiques comprennent également la construction d'une ville nouvelle et moderne, l'ouverture d'un réseau de chemins de fer destiné à relier les côtes, tout comme divers autres projets intéressant les secteurs des mines, des télécoms et de l'énergie.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











