Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le mirage de TES Canada : une illusion coûteuse pour la Mauricie

En cet hiver, où le froid saisit autant qu'il émerveille, une menace plane toujours sur nos régions rurales : le projet TES Canada. Sous des airs de modernité et de transition énergétique, cette initiative s'apprête à transformer nos paysages en zones industrielles, bouleversant la qualité de vie, l'économie locale et l'équilibre environnemental.
Il est fascinant de constater avec quelle ferveur Michel Angers, maire de Shawinigan, compare le projet TES Canada aux grandes réalisations qui ont façonné le Québec moderne. Mais que reste-t-il de ces beaux discours lorsqu'on gratte la surface ? Un projet ancré dans des promesses illusoires, qui menace de transformer la Mauricie en une zone industrielle défigurée, sous prétexte de transition énergétique.
D'abord, rappelons que le projet TES Canada ne se limite pas à l'érection de quelque 140 méga éoliennes industrielles. Il s'agit d'une vaste entreprise de production d'hydrogène vert et de gaz naturel synthétique. Une industrie lourde qui s'implanterait en plein cœur de nos territoires et dans le parc industriel Alice-Asselin, à Shawinigan, avec un impact environnemental et social dont les promoteurs taisent l'ampleur réelle.
Les chiffres : un écran de fumée
Éric Gauthier et Jean-Benoît Courchesne, figures de proue de TES Canada, brandissent des chiffres mirobolants : 5,6 milliards de retombées économiques sur 23 ans, des milliers d'emplois, et des millions en redevances annuelles. Mais d'où viennent ces données ? Elles émanent directement des promoteurs eux-mêmes, sans audit indépendant. La firme Mallette, qui a produit l'analyse économique, l'a admis : si les données changent, les conclusions changent aussi. En d'autres termes, on demande à la population d'avaler ces chiffres sans poser de questions.
Et pendant ce temps, le maire Angers qualifie l'opposition de « minorité bruyante », balayant du revers de la main les préoccupations des citoyens et des municipalités voisines. Où est le débat démocratique lorsque les interventions citoyennes lors des conseils sont réduites à 30 minutes ?
Un coût social et environnemental inacceptable
Le véritable prix de TES Canada ne se mesure pas seulement en milliards de dollars, mais en hectares de terres agricoles sacrifiées, en écosystèmes détruits et en communautés déstabilisées. Avec 140 éoliennes géantes, des lignes de transport d'énergie, un parc solaire et une usine industrielle, la Mauricie sera méconnaissable.
Ce projet illustre parfaitement le « greenwashing » : un vernis écologique appliqué sur une entreprise qui repose en réalité sur des technologies énergivores et polluantes. Produire de l'hydrogène vert et du gaz synthétique à une échelle industrielle exige une quantité astronomique d'énergie et d'eau. Où est la durabilité dans cette équation ?
Les dangers pour nos terres et nos citoyens
En plus des impacts écologiques, TES Canada représente un risque concret pour les propriétaires et usagers des territoires avoisinants. Les projections de glace des éoliennes en hiver constituent un danger majeur pour les sentiers, les chemins de terre et les zones de circulation agricole. Ces blocs de glace projetés à grande vitesse menacent la sécurité des travailleurs, des résidents et des visiteurs des centres récréotouristiques et agrotouristiques.
De plus, la réciprocité joue en défaveur des citoyens : les propriétaires de terrains voisins aux installations éoliennes voient leur droit de jouissance de leur propriété considérablement réduit en plus du bruit, de l'ombre portée et de la nuisance visuelle. Bien qu'ils reçoivent une compensation monétaire, celle-ci est minime et sans commune mesure avec la perte d'usage réelle de leur bien ni avec l'occupation du territoire qui leur est imposée. Ils subissent ainsi les méfaits de ces infrastructures sans en retirer aucun bénéfice réel. TES Canada impose un sacrifice à plusieurs familles et exploitants, sans leur offrir de véritable contrepartie et sans qu'ils aient leur mot à dire.
Michel Angers : visionnaire ou opportuniste ?
Le maire Angers voit dans TES Canada une chance de redorer le blason d'un parc industriel qui peine à attirer des projets depuis sa création. Mais à quel prix ? Faire de la Mauricie un laboratoire d'expérimentation pour des multinationales avides de profits n'a rien d'une « pertinence sociale ».
En réalité, TES Canada n'est qu'un mirage. Derrière ses promesses attrayantes se cache une vérité bien plus sombre : l'exploitation de nos ressources naturelles au profit de quelques-uns, au détriment de notre qualité de vie, de notre territoire, de nos agriculteurs et des générations futures.
Michel Angers oublie que les grands projets qu'il évoque sont nés de la nationalisation de l'électricité, un pilier fondamental du Québec moderne. Or, TES Canada menace de plein front cet héritage en mettant nos ressources énergétiques entre les mains d'intérêts privés. René Lévesque et Adélard Godbout doivent se retourner dans leur tombe, car ce projet représente une attaque directe contre notre trésor public.
Une alternative est possible
Nous devons refuser cette vision réductrice de l'avenir de la Mauricie. Plutôt que de vendre nos terres aux multinationales, investissons dans des projets qui respectent nos écosystèmes, soutiennent nos communautés locales et favorisent une véritable transition énergétique.
Le débat sur TES Canada ne doit pas se limiter aux chiffres, mais inclure une réflexion sur ce que nous voulons pour notre région et notre planète. La Mauricie mérite mieux qu'un avenir fait de béton et de pales d'éoliennes. Elle mérite un avenir ancré dans le respect, la résilience et la durabilité.
Dany Janvier, citoyen de St-Adelphe
Contre la privatisation du vent et du soleil dans Mékinac Des Chenaux(CPVSMDC),
Toujours Maîtres Chez Nous(TMCN), RVÉQ
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Une grosse épine au pied pour Rio Tinto

En 1928, 2 ans après la fermeture des vannes du barrage d'îles Malignes à l'embouchure du Lac St-Jean qui avait élevé le niveau moyen d'une dizaine de pieds, la région connaît un printemps tardif suivi soudainement de chaleurs. Résultat, le Lac monte à un niveau jamais vu de mémoire d'humain.
À la demande de secours du maire de St-Méthode dont le village est entièrement inondé, le représentant d'Alcan répond : « Si voulez des secours, payez-vous en ! ». Pour Alcan, cette catastrophe est un « act of god". Bien sûr, il s'agissait d'un phénomène naturel mais est-ce que ce coup d'eau aurait eu le même effet sur un lac dix pieds plus bas ?
Poser la question, c'est y répondre.Quatre-vingt neuf ans plus tard au printemps 2017, la petite rivière Péribonka connaît une crue exceptionnelle. Depuis plusieurs années, les propriétaires de la Pointe Langevin a son embouchure constatent une érosion accélérée. Deux maisons ont été détruites, c'est bientôt le tour d'une autre et le reste (une vingtaine) voient une après l'autre leur valeur diminuée à 2 000$. Comme en 1928, Rio Tinto utilise le prétexte de « l'act of god" pour se déresponsabiliser de ce qui se passe.
Indépendamment de la crue exceptionnelle, comment ne pas voir que les problèmes à la Pointe Langevin sont directement liés au niveau élevé du lac (environ 10 pieds plus haut qu'avant 1926) ainsi qu'à la gestion du débit de la rivière Péribonka, particulièrement en hiver où il est environ le double d'avant la construction des barrages dans les années 60
Les problèmes autour de la Pointe sont en train de prendre des allures de gouffre sans fond, au sens propre comme au figuré. Au bout de la Pointe, la petite rivière Péribonka et la grande se rencontrent presque de plein fouet ce qui est en train de créer un gouffre au large qui, à terme va gruger l'ensemble de la Pointe. Le problème est même en train de s'étendre au village de Péribonka dont le quai a commencé à s'affaisser ainsi qu'une rue. Devant l'ampleur du problème, Rio Tinto a pris les jambes à son cou. Les autorités politiques quant à elles, regardent leurs souliers lorsque les propriétaires de la Pointe s'adressent à elles. Désespérés, ils en sont même venus à débourser 20 000$ de leurs poches pour financer une étude qui a confirmé leurs pires appréhensions.
L'ensemble du problème est éminemment politique. On a affaire à une multinationale qui jouit de la complicité active des autorités politiques et une population un peu trop habituée à se faire dire n'importe quoi.
Le monde a changé depuis 1926

Si Rio Tinto recycle les mêmes excuses imbuvables d'Alcan il y a cent ans, la conjoncture globale, elle, s'est considérablement transformée :
1- De générateur de richesse, la « puissance régnante » (entendre Alcan puis Rio Tinto) est passée au statut d'accro à l'aide publique. Les chiffres sont implacables : 12 000 emplois dans les années 60 et 2 700 aujourd'hui. Si on cumule l'avantage comparatif lié à la possession de leurs barrages, les exemptions d'impôt et le fait qu'ils sont exemptés d'amendes pour les GES, on arrive à une subvention publique de 1,2 milliard$ par année. Abusant de son pouvoir, Rio Tinto s'est même permis au cours des dernières décennies des congés de cotisation à la caisse de retraite de ses employé(e)s qui ont conduit à un manque à gagner de 2 milliards$ pour cette caisse. Aujourd'hui, les retraité(e)s syndiqué(e)s (plus de deux fois plus nombreux que les actifs) évaluent à plus de 30% leur perte de pouvoir d'achat. Plus pingre que jamais, Rio Tinto refuse de leur garantir le maintien de leur pouvoir d'achat… Accro à l'argent facile vous dites ? Rio Tinto a réalisé des profits de 11,8 milliards$ en 2023.
2- En 1926, lorsque le barrage d'îles Malignes a été inauguré, il y avait une certaine logique à utiliser le lac comme réservoir compte tenu du fait que l'électricité produite visait à alimenter des cuves d'électrolyse d'aluminium fonctionnant 24 heures sur 24 et ne souffrant aucun arrêt d'alimentation électrique. Aujourd'hui, avec 2 autres barrages sur le Saguenay et trois sur la rivière Péribonka, il n'y plus aucune raison de garder le lac à un tel niveau. Surtout que, contrairement à 1926, il ne manque pas d'alimentation électrique au Québec pouvant suppléer à un manque temporaire de production, ce qui n'était pas le cas en 1926. Et puis, comme rien ne se perd et rien ne se crée, un lac dix pieds plus bas fournira la même quantité d'eau au Saguenay.
3- C'est peu dire que le monde d'aujourd'hui est radicalement différent de celui d'autrefois. Au début du siècle passé, nous étions au début du développement industriel au Québec. Les gens voyaient la nature comme une ressource à exploiter sans limite. Au cours des dernières décennies, nous avons tou(te)s collectivement pris conscience que tout cela n'était qu'illusion et que nous devons radicalement changer notre façon de voir la nature. Plutôt que d'être une ressource qu'on exploite à l'infini, elle doit au contraire devenir une alliée qu'on respecte et conserve jalousement. Dans une telle optique, quel est le sens de maintenir un lac, de surcroît densément habité sur l'ensemble de ses rives, environ dix pieds plus haut que son niveau naturel alors que ses rives d'origine sont le résultat stable d'environ 10 000 ans d'histoire ? Là aussi, poser la question, c'est y répondre !
L'érosion accélérée de la Pointe Langevin est peut-être en train de devenir le Waterloo de Rio Tinto. Sa position est intenable parce que tout le monde sait que cette érosion est principalement liée au niveau élevé du lac et au débit élevé de la rivière Péribonka en hiver.
La base du problème est là. En se déresponsabilisant, Rio Tinto dit à la population de s'arranger avec le problème. Dans un certain sens, Rio Tinto a raison dans la mesure où la population était là avant Alcan et sera là après Rio Tinto. La souveraineté appartient au peuple ! À la population du Saguenay Lac Saint-Jean d'en tirer la conclusion en se prenant en main et en exerçant sa souveraineté.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Opposition autochtone et écologiste contre un projet de gazoduc en Colombie-Britannique

Le pipeline PRGT, autorisé il y a dix ans mais toujours pas construit, fait aujourd'hui face à des poursuites intentées par plusieurs communautés autochtones.
Plusieurs Premières Nations en Colombie-Britannique contestent le projet de gazoduc PRGT, estimant que le certificat d'évaluation environnementale et les accords qui datent de dix ans ne reflètent plus les engagements du gouvernement en matière de climat et de droits autochtones. Elles ont intenté des recours judiciaires contre le projet, ainsi que contre la Régie de l'énergie de la Colombie-Britannique, accusée d'avoir contourné ses propres exigences légales en autorisant le début des travaux.
23 janvier 2025 | tiré du site de Pivot | Illlustration : Arrière plan : Carte du tracé original du pipeline PRGT. Image : BCER et TC Energy. Montage : Pivot.
https://pivot.quebec/2025/01/23/opposition-autochtone-et-ecologiste-contre-un-projet-de-gazoduc-en-colombie-britannique/?vgo_ee=aIn3g6EcMQtgDxKewmhbPaLFZTco4tbjGl7Mpb1%2FY%2F4x%3AgwaRLNF7hWnA%2BbE60k9CgkF7vF8VUAtf
Depuis des mois, des membres de plusieurs Premières Nations dans le nord de la Colombie-Britannique, notamment les Gitanyow et les Gitxsans, ainsi que des groupes écologistes protestent fermement contre le gazoduc Prince Rupert Gas Transmission (PRGT), un pipeline de gaz naturel liquéfié de 900 kilomètres censé traverser leurs territoires, entre le nord-est de la province, lieu d'extraction du gaz, et un terminal d'exportation au nord-ouest, sur la côte.
Les communautés autochtones et les groupes écologistes soutiennent que le certificat d'évaluation environnementale du pipeline, approuvé il y a maintenant dix ans et qui arrive à échéance, ne doit pas être renouvelé. Ils ont déposé une poursuite contre PRGT et la Régie de l'énergie de la province, qui a autorisé le début des travaux de construction du gazoduc, ainsi qu'une autre poursuite contre le projet de terminal maritime qui doit accompagner le pipeline.
Ils estiment notamment que la production d'énergie fossile sous-tendue par ce projet mènerait la province à dépasser ses objectifs d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et que le terminal pose un risque pour les saumons qui migrent dans le secteur.
Les Premières Nations rappellent aussi que les obligations des gouvernements en matière de consultations des peuples autochtones se sont accrues au cours de la dernière décennie et jugent donc que les consentements obtenus autrefois ne sont plus valables.
Gazoduc caduc ?
Ce projet de pipeline a été initié par TC Energy, la même compagnie qui a construit le pipeline controversé Coastal GasLink traversant le territoire Wet'suwet'en. Au printemps 2024, le projet PRGT a été vendu au gouvernement de la Première Nation Nisga'a et à Western LNG, une compagnie basée aux États-Unis.
En 2014, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait accordé le certificat environnemental malgré la conclusion du Bureau d'évaluation environnementale selon laquelle le projet aurait des effets négatifs significatifs sur les caribous et les émissions de GES. Le certificat a ensuite été prolongé jusqu'au 25 novembre 2024.
Selon la Loi sur l'évaluation environnementale de la province, si la construction est « substantiellement démarrée » avant la date d'expiration du certificat, celui-ci peut être renouvelé indéfiniment sans nécessiter de nouvelles évaluations environnementales. Sinon, le certificat expire à la date prévue et le projet doit passer une nouvelle évaluation environnementale avant que toute activité de construction puisse reprendre.
« C'est une énorme faille qui permet de conserver le certificat indéfiniment sans jamais avoir à le mettre à jour. »
Tara Marsden, conseil des chefs héréditaires Gitanyow
En août 2024, des travaux de défrichage de l'emprise du pipeline ont débuté.
Les Gitanyow ont manifesté leur opposition en brûlant les accords qu'ils avaient signés il y a dix ans avec TC Energy et le gouvernement provincial et en installant des blocus le long de l'itinéraire prévu pour le pipeline.
Peu avant l'expiration du certificat, PRGT a soumis une demande au gouvernement de la Colombie-Britannique afin de déterminer si un « démarrage substantiel » de la construction avait eu lieu. Une décision de la ministre de l'Environnement de la province est attendue pour mars prochain.
En entrevue avec Pivot, Tara Marsden, directrice en durabilité du conseil des chefs héréditaires Gitanyow, indique qu'au cours des dix dernières années, PRGT n'a effectué que des travaux de défrichage, sur moins de 5 % de l'emprise du pipeline, pendant seulement deux mois et juste avant l'expiration du certificat d'évaluation environnementale.
Tara Marsden souligne que la détermination de démarrage substantiel « n'est pas un processus rigoureux ». En effet, « la législation à ce sujet ne précise pas la quantité de travail spécifique devant être accomplie pour qu'un démarrage soit considéré comme substantiel », explique-t-elle. « C'est très subjectif et considéré au cas par cas. Cela signifie qu'il s'agit d'une décision politique de ceux qui sont au pouvoir. »
« C'est une énorme faille qui permet de conserver le certificat indéfiniment sans jamais avoir à le mettre à jour », critique Tara Marsden.
Nouveaux défis environnementaux
« C'est très préoccupant, car nous avons un climat complètement différent en 2024 par rapport à 2014 », poursuit Tara Marsden.
« On a vu, très proches de notre communauté, des incendies de forêt majeurs », illustre-t-elle. « On a connu des sécheresses au moins quatre des dix dernières années, qui ont affecté la migration des saumons. On observe également davantage de maladies forestières causées par le changement du climat », énumère-t-elle.
De plus, PRGT a également demandé au Bureau d'évaluation environnementale de modifier le point d'aboutissement du pipeline pour qu'il débouche au terminal de Ksi Lisims. Ce projet de terminal flottant devant permettre de liquéfier et d'exporter douze millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par année est lui aussi porté par la Première Nation Nisga'a, Western LNG ainsi que Rockies LNG, et il est lui aussi contesté par plusieurs communautés.
En effet, les chefs héréditaires Gitanyow ont intenté, en octobre dernier, une action judiciaire contre Ksi Lisims devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dénonçant les menaces aux populations de saumons dans la rivière Nass, vitales pour les Gitanyow, et affirmant que leur peuple n'a pas été consulté de manière adéquate.
À cause d'une méfiance envers le processus d'évaluation environnementale mené par le gouvernement, les chefs héréditaires Gitanyow ont créé leur propre processus d'évaluation.
Les chefs ont évalué le projet de terminal en incluant des références aux émissions globales de GES du pipeline PRGT. « Nous avons constaté que l'ensemble des développements associés au pipeline, au terminal, à l'extraction de gaz et à l'hydroélectricité nécessaire pour alimenter le terminal va vraiment empêcher le gouvernement provincial d'atteindre ses objectifs de réduction des GES », affirme Tara Marsden.
Accords obsolètes
Les accords sur le pipeline PRGT ont été signés, il y a dix ans, par un mélange de conseils de bande et de chefs héréditaires des Premières Nations concernées.
Or, à l'époque, avant que la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones entre en vigueur en 2021, il n'y avait pas de reconnaissance officielle de la nécessité que les Autochtones offrent leur consentement libre, préalable et éclairé.
« Ces accords obsolètes ne reflètent pas le consentement libre, préalable et éclairé », affirme Tara Marsden. « On a dû se charger d'examiner les nouvelles informations, puis se demander si ce projet répond toujours à nos intérêts en 2024. »
« La nature de ces accords est si restrictive qu'on a dû attendre qu'ils expirent avec le certificat [d'évaluation environnementale en novembre dernier] et maintenant on est davantage en mesure de contester le projet légalement et publiquement. »
Tara Marsden déplore que l'adoption de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies n'a donné qu'une « impression de changement ».
« On ne devrait pas avoir à aller en cour ni à installer des blocus sur nos territoires pour que les gouvernements nous écoutent », dit-elle au sujet des luttes contre les pipelines PRGT et Coastal GasLink.
« C'est malheureusement ce qui se passe actuellement dans notre coin du monde. »
Le gouvernement donne le feu vert
Il ne serait pas possible pour PRGT de demander une détermination de « démarrage substantiel » des travaux si la Régie de l'énergie de la Colombie-Britannique (BCER) n'avait pas d'abord autorisé le début des travaux de défrichage.
Or, la BCER fait face, conjointement avec PRGT, à une poursuite intentée par la Skeena Watershed Conservation Coalition, Kispiox Valley Community Centre Association et la Bande de Kispiox (une communauté Gitxsan), qui l'accusent d'avoir contourné ses propres exigences légales à ce sujet.
« On ne devrait pas avoir à aller en cour ni à installer des blocus sur nos territoires pour que les gouvernements nous écoutent. »
Tara Marsden
En 2023, les permis émis par la BCER stipulaient que le titulaire ne devait pas commencer les travaux avant de recevoir une évaluation des effets cumulatifs du projet – c'est-à-dire non seulement des impacts directs du pipeline, mais aussi de la manière dont ils s'ajoutent aux impacts passés et futurs sur le territoire – réalisée par la Régie en consultation avec les nations autochtones concernées.
Le pipeline est divisé en sept sections. Cette condition était inscrite dans les permis pour chaque section.
Cependant, la BCER et PRGT ont scindé la section 5 en sections 5A et 5B. La section 5B traverse le territoire de la Première Nation Nisga'a, dont le gouvernement co-détient le pipeline. Par courriel, la BCER affirme que « cet amendement visait à répondre aux préoccupations des Nisga'as selon lesquelles certaines conditions du permis restreignaient leur droit d'utiliser leur territoire ».
Puis, la BCER a autorisé le début des travaux sur la section 5B en août 2024.
Au lieu d'effectuer sa propre évaluation des effets cumulatifs de l'ensemble du projet, en consultation avec d'autres Premières Nations situées sur l'itinéraire du pipeline, la BCER a compté sur les seules indications du gouvernement Nisga'a, qui a affirmé que l'évaluation des effets cumulatifs pour la section 5B avait déjà été réalisée à sa satisfaction dans le cadre des demandes de certificat d'évaluation environnementale pour le pipeline PRGT et pour le terminal de Ksi Lisims.
Par courriel, la BCER explique que « la condition relative aux effets cumulatifs s'applique au permis auquel elle est incluse et liée, comme toutes les autres conditions ». Autrement dit, selon la Régie, pour commencer les travaux sur la section 5B, il suffit de compléter l'évaluation pour cette section, plutôt que pour l'ensemble du projet.
La BCER ajoute que « les conditions pour les autres permis (sections), y compris l'exigence d'une évaluation des effets cumulatifs, n'ont pas été complétées pour le reste des sections ».
« Ils ont divisé le permis pour ne pas avoir à consulter les autres Premières Nations avant de commencer la construction », commente Tara Marsden. « Il s'agit d'une manœuvre très sournoise pour essayer de poursuivre leurs activités de construction, tout en étant conscients qu'il y a beaucoup d'opposition. »
Le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et la Première Nation Nisga'a n'ont pas répondu à nos demandes de commentaire au moment de publier.
Auteur·e
BIFAN SUN
Bifan Sun est journaliste spécialisée dans les enjeux de racisme et d'anti-racisme pour Pivot. Dans le cadre du projet « Différends : sur le terrain des luttes anti-racistes », soutenu par la Fondation canadienne des relations raciales, elle s'engage à faire entendre une pluralité de voix issues des communautés racisées sous-représentées dans la sphère médiatique francophone. Elle est titulaire d'une maîtrise en communication, pour laquelle elle a étudié la construction des récits de migration par un groupe de femmes migrantes marginalisées.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La FIQ plaide pour un moratoire sur la coupe de 1,5 milliard $ dans le réseau de la santé

Québec, le 30 janvier 2025 — La Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec—FIQ accueille avec soulagement le changement de position du gouvernement du Québec, reconnaissant enfin l'impact réel des compressions sur l'offre et la qualité des soins.
Cependant, la FIQ considère que cette nouvelle approche ne va pas assez loin. La Fédération appelle le gouvernement à reporter immédiatement les coupes de 1,5 milliard $ prévues dans le budget de la santé, jusqu'à ce qu'une évaluation rigoureuse et approfondie des besoins réels du réseau de la santé et des services sociaux soit réalisée.
«
Le gouvernement doit reconnaître que les compressions budgétaires actuelles sont déjà en train de miner la qualité des services directs à la population. La situation devient critique : les équipes de soins sont insuffisantes, les patient-e-s souffrent des retards d'intervention et les établissements de santé sont à bout de souffle. Il est plus que jamais nécessaire de stopper les coupes et de permettre aux professionnelles en soins de travailler dans des conditions décentes
», indique Julie Bouchard, présidente de la FIQ.
Enfin le gouvernement réalise l'impact des compressions sur les services de soins. Toutefois, il est impératif de prendre des mesures concrètes pour soutenir les équipes de santé. La FIQ recommande que le réseau annule la directive de réduction du temps supplémentaire et permette à nouveau l'ouverture de lits additionnels, afin de maintenir une prise en charge adéquate des patient-e-s en fonction de la capacité des équipes de soins. La réalité des urgences et des listes d'attente en chirurgie ne peut plus être ignorée. L'ampleur de la crise nécessite que Santé Québec assure une couverture complète des équipes, qu'il s'agisse des soins à domicile, des soins hospitaliers, ou des services d'urgence.
Par ailleurs, la FIQ estime que l'une des pistes les plus urgentes pour améliorer la situation réside dans le renforcement de la première ligne de soins. Cela comprend un soutien accru aux soins à domicile, dont la réduction continue est inacceptable. « Nos aîné-e-s, personnes en situation de handicap et citoyen-ne-s vulnérables méritent un service de qualité. Une approche sérieuse en matière de soins à domicile permettrait de désengorger les urgences et d'offrir des alternatives aux hospitalisations évitables. En réinvestissant dans ces services publics, le gouvernement pourra non seulement améliorer la qualité de vie des citoyen-ne-s, mais également alléger la pression sur nos hôpitaux et améliorer le parcours de soins des patient-e-s », ajoute Mme Bouchard.
«
Nous ne devons pas céder à l'improvisation. Santé Québec doit prendre le temps de bien évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles avant d'appliquer des coupes. Il est impératif de garantir que la trajectoire de soins ne soit pas affectée négativement. Chaque décision doit être prise en tenant compte de son impact sur la population, en particulier les plus vulnérables. Le gouvernement a un rôle crucial à jouer pour protéger le système de santé québécois. La FIQ en appelle à la responsabilité collective, notamment des décideur-euse-s politiques, afin de garantir que la santé des Québécois-e-s ne soit pas sacrifiée au nom de l'austérité. La FIQ demeure disponible pour collaborer avec Santé Québec dès maintenant
», conclut Julie Bouchard.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le gouvernement doit retirer ses exigences de compressions et protéger le financement du réseau public

Alors que les témoignages d'usager·ère·s et de personnes salariées affecté·e·s par les compressions budgétaires se multiplient, le ministre de la Santé, Christian Dubé, commençait à lever le pied aujourd'hui sur les exigences imposées à Santé Québec. Pour l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), ce revirement partiel ne suffit pas. Le gouvernement doit retirer complètement ses demandes de compressions et garantir un financement stable et prévisible pour répondre aux besoins de la population.
« Le ministre Dubé prend acte des conséquences bien réelles de ces compressions, mais il continue d'exiger des réductions budgétaires qui mettent en péril les soins et services essentiels, dénonce Robert Comeau, président de l'APTS. Si le gouvernement veut réellement protéger le réseau public, il doit cesser d'imposer des choix financiers qui nuisent aux usager·ère·s et au personnel. Un budget, ça a deux colonnes : d'un côté, les dépenses, de l'autre, les revenus. Et si on réduit sans assurer un financement adéquat, c'est la population qui en paie le prix. »
Les effets des compressions sont déjà visibles, notamment en soins à domicile, où des usager·ère·s vulnérables voient leurs services réduits, mais également en santé mentale ou encore en imagerie médicale. L'APTS craint également des impacts majeurs sur d'autres secteurs du réseau, où le personnel espérait des renforts et non de nouvelles restrictions budgétaires.
« Nous devons briser ce cercle vicieux où les compressions affaiblissent le réseau, forcent le recours au privé et justifient ensuite d'autres réductions, ajoute Robert Comeau. C'est pourquoi l'APTS propose la mise en place d'un bouclier budgétaire qui assurerait un financement minimal du réseau public, à la hauteur des besoins réels de la population, et garantirait ainsi un réseau public de santé et de services sociaux sain et efficace. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

MHN 2025 : Joignez-vous aux syndicats du Canada pour faire progresser la justice raciale et économique pour les travailleuses et travailleurs noirs

Les syndicats du Canada marquent le Mois de l'histoire des Noirs en soulignant le rôle crucial que jouent les syndicats dans la promotion de la justice raciale et économique pour les travailleuses et travailleurs noirs. Le 18 février, nous tiendrons une conversation virtuelle en compagnie de leaders syndicaux noirs sur les défis auxquels sont confrontés les travailleuses et travailleurs noirs et le rôle important que peuvent jouer les syndicats.
Selon des données récentes, les travailleuses et travailleurs noirs sont le groupe racialisé le plus susceptible d'être protégé par un contrat syndical, la syndicalisation augmentant leur revenu annuel de plus de 3 000 $. Les personnes noires syndiquées bénéficient de meilleurs salaires dans l'ensemble, d'une sécurité d'emploi accrue et de protections contre la discrimination.
Cependant, des obstacles systémiques à l'emploi persistent, dont les effets néfastes se répercutent sur les travailleuses et travailleurs noirs de génération en génération. Malgré leurs taux de syndicalisation plus élevés et les avantages qui en découlent, les travailleuses et travailleurs noirs se heurtent toujours à d'importants obstacles au travail : le rapport révèle également que les travailleuses et travailleurs noirs subissent le deuxième plus grand écart salarial des groupes racialisés en raison de leur représentation disproportionnée dans les secteurs à bas salaires et de leur accès limité ou de leur exclusion aux secteurs à salaires plus élevés.
Les travailleuses et travailleurs noirs au Canada sont confrontés à une discrimination continuelle et au racisme systémique sur le marché du travail – de graves obstacles qui nuisent à leur accès à l'équité d'emploi, à l'avancement et à un traitement équitable au travail. Les effets du racisme anti-Noirs ont une vaste portée, posant des obstacles tenaces à l'avancement économique et à l'habilitation des communautés noires.
Une enquête nationale de 2023 sur les Noirs canadiens menée par l'Institut de recherche sociale de l'Université York, en partenariat avec la Fondation canadienne des relations raciales, indique que 75 % des répondants ont subi des actes de racisme au travail considérés comme grave ou très grave, et que les travailleuses et travailleurs noirs considèrent les lieux de travail comme des épicentres de discrimination et d'injustice raciales.
Ceci est inacceptable, et les syndicats ont un rôle crucial à jouer dans l'élimination des injustices systémiques, autant au travail que dans la société en général.
« Le mouvement syndical doit continuer à respecter sa mission fondamentale qui est de lutter pour l'équité, la justice et la dignité pour tous les travailleurs et travailleuses. Cela signifie que nous devons multiplier les efforts pour éliminer le racisme et la discrimination anti-Noirs dans les milieux de travail et les syndicats, négocier pour obtenir les mêmes possibilités, éduquer les membres et les dirigeants, amplifier les voix et le leadership des travailleurs noirs et encourager les travailleurs noirs à s'organiser pour obtenir de meilleurs emplois et salaires », déclare Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC.
Les syndicats peuvent être un puissant moteur de justice raciale et économique pour les travailleuses et travailleurs noirs, que ce soit au travail, dans le syndicat ou dans la société. N'oubliez pas de vous inscrire à notre webinaire le 18 février et de consulter notre nouvelle fiche d'information sur les travailleuses et travailleurs noirs et la syndicalisation. Vous pouvez également vous joindre à nous en ce Mois de l'histoire des Noirs et par la suite en textant MHN au 55255.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La pensée libérale et l’idéologie de l’esclavage racial
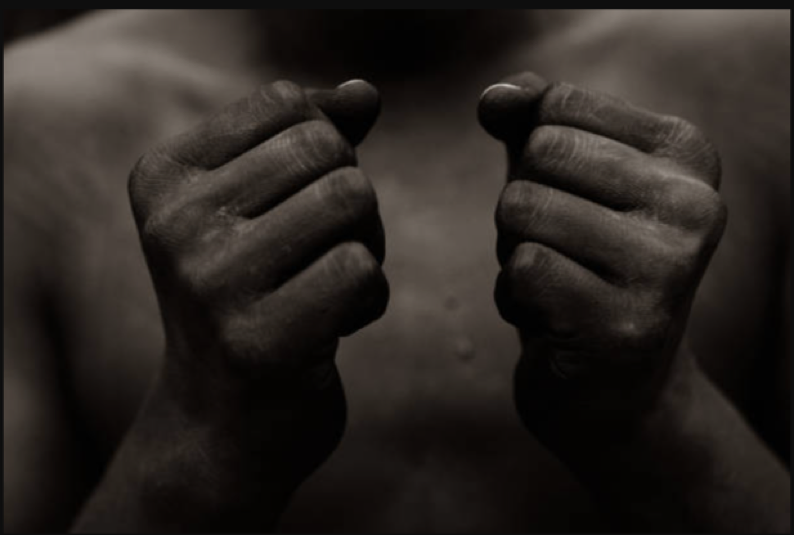
Dans une remarquable étude sur le libéralisme, le philosophe italien Domenico Losurdo (1941-2018) montre clairement le lien existant entre la montée de l'idéologie libérale et l'institutionnalisation de l'esclavage racial à la fin du XVIIe siècle. Les principes fondamentaux du libéralisme considèrent comme inaliénables la liberté de l'individu, son droit à l'épanouissement et au bonheur.
L'auteur est historien.
Pour Losurdo, ces principes, qui allaient constituer le socle idéologique des révoltions française et américaine, servaient paradoxalement à « théoriser » l'esclavage racial : « L'autogouvernement de la société civile, explique Losurdo, triomphe sous le drapeau de la liberté et de la lutte contre le despotisme, alors qu'il entraine le développement de l'esclavage-marchandise sur une base raciale et creuse, un abîme insurmontable et sans précédent entre les Blancs et les peuples de couleur (1). » John Locke (1632-1704), par exemple, considéré comme l'un des pères du libéralisme, légitimait « l'esclavage racial qui s'affirme peu à peu dans la réalité politico-sociale de l'époque (2). » Le philosophe libéral traçait une ligne de démarcation raciale entre Blancs et Noirs, que ni la conversion au christianisme ni l'affranchissement ne pouvaient remettre en question.
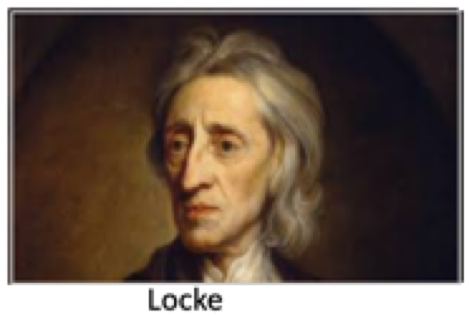
De même Montesquieu (1689-1755), qui fait partie du courant philosophique des Lumières et qui est considéré également comme l'un des plus grands penseurs de l'organisation politique libérale, voit dans l'esclavage des « Nègres », le résultat naturel qui s'explique par le climat dans lequel ils vivent. Pour Montesquieu, il faut « borner la servitude naturelle à de certains pays particuliers » et qu'il « ne faut […] pas être étonné que la lâcheté des peuples des climats chauds les ait presque toujours rendus esclaves, et que le courage des peuples des climats froids les ait maintenus libres. C'est un effet qui dérive de sa cause naturelle (3). »
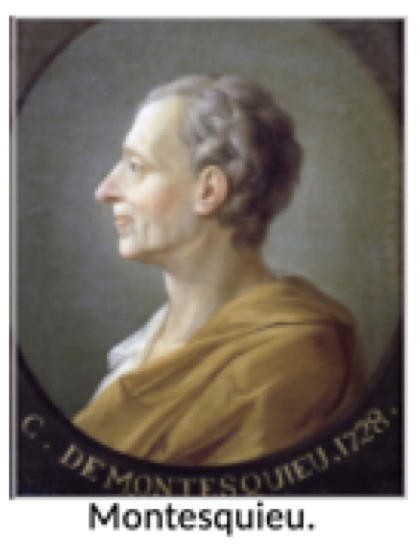
Tout au long du XVIIIe siècle, l'on ne cesse de poser des questions portant sur la place de l'homme dans la nature. Avec Buffon (1707-1788), une conception de l'homme se précise : celui-ci faisant partie de la nature est « considéré comme un tout et distinct de toutes les autres espèces par la nature de son entendement, la durée de son accroissement et de sa vie, […], par la complexité et la diversité des sociétés qu'il forme avec ses semblables (4) ». L'intention de séparer l'homme de la bête apparait comme une nécessité pour Buffon, mais cette séparation débouche aussi sur la nécessité anthropologique de différentier les humains selon des critères que le courant des Lumières prendra soin d'élaborer. Polygéniste avant la lettre, Voltaire (1694-1778) ne pouvait concevoir l'unité de l'espèce humaine, idée qu'il trouvait absurde vu les différences physiques entre les groupes d'humains, qui, à ses yeux, constituaient la preuve irréfutable de races différentes. Mais pour Voltaire, cette différence atteste également d'une hiérarchie naturelle : le Noir ne serait qu'un animal « qui a de la laine sur la tête, marchant sur deux pattes, presque aussi adroit qu'un singe, moins fort que les autres animaux de sa taille, ayant un peu plus d'idées qu'eux, et plus de facilités pour les exprimer », et, pour le philosophe, l'homme européen serait, dans cet ordre hiérarchique aussi différent des « nègres », que ces derniers « le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huitres, et aux autres animaux de cette espèce (5). »
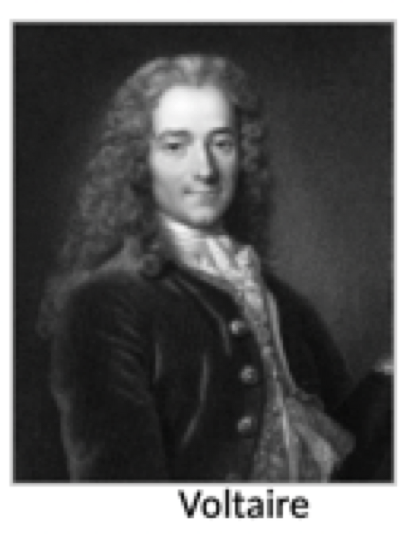
Certes on ne peut réduire toute la philosophie des Lumières à ces propos racistes de Voltaire, les écrits de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) illustrent une véritable critique de la société de son époque : pour Rousseau l'homme social occidental, héritier de son histoire, est corrompu et ne peut prétendre être supérieur au « sauvage », dont Rousseau exalte les qualités. Selon l'anthropologue et historienne Michèle Duchet, cette position de Rousseau est toutefois « loin d'être le refus de la socialité », elle en est plutôt « l'exaltation : l'homme y a véritablement vocation, à travers un procès de perversion mais aussi de perfection, à devenir ‘un être moral, un animal raisonnable, le roi des autres animaux, et l'image de Dieu sur la terre' ». Duchet en déduit que l'anthropologie de Rousseau ne consiste pas en fait à combattre la civilisation, « mais un état d'aliénation qui en est la négation même. La question qu'il invite à se poser n'est pas : comment se dé-civiliser ?, mais au contraire : qu'est-ce qu'une société civile digne de ce nom ? (6) ».
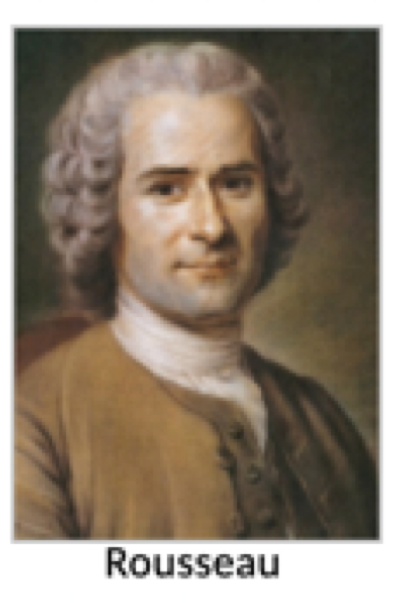
Au XVIIIe siècle, le discours ethnologique est confiné à l'intérieur de la philosophie. C'est en philosophes et non en scientifiques que les auteurs des Lumières pensent la possibilité d'un monde non européen. Et parce que le monde qui s'ouvre à eux provient de l'Histoire naturelle de Buffon qui lui-même dépend, pour élaborer son discours historique, des récits des voyageurs, marchands et aventuriers, les philosophes des Lumières ne pouvaient percevoir « la réalité du monde sauvage » qu'à travers leur propre culture. Pour eux, « l'homme sauvage » était en réalité « l'homme primitif », un être historique en qui « enfin l'homme européen peut se reconnaitre et apprendre à se connaitre (7) ».
Néanmoins, au cours du siècle des Lumières, ce « monde sauvage » n'est plus cet « objet de curiosité ou d'enquête » dont « s'émerveillaient les hommes de la Renaissance » : il devient le lieu de l'exploitation coloniale, de sorte que « les sauvages d'hier, réduits en esclavage, brutalement jetés dans le creuset des races et des civilisations, ont changé d'être et de visage (8). » Comme le montre Duchet, le courant encyclopédiste, bien que s'inscrivant dans la lutte antiesclavagiste, participe dans l'élaboration de l'idéologie justifiant l'exploitation coloniale : entre les administrateurs coloniaux, les économistes physiocrates et les philosophes il existe un « unique réseau de savoir-pouvoir » selon l'expression de l'historien des sciences Claude Blanckaert (9). Didier Diderot (1713-1784) lui-même ne prédisait-il pas la disparition des « sauvages », qui, à cause de « leur vie dure et disetteuse, la continuité de leurs guerres, les pièges sans nombre que nous ne cessons de leur tendre, on ne pourra s'empêcher de prévoir qu'avant qu'il ne soit écoulé trois siècles, ils auront disparu de la terre. […]. Les temps de l'homme sauvage ne seront-ils pas pour la postérité, ce que sont pour nous les temps fabuleux de l'Antiquité ? (10) ». Cette perception évolutionniste qui explique la disparition inéluctable du « sauvage » laisse entrevoir cette « disparition » comme une nécessité pour qu'émerge la « civilisation ».

Cette dernière, parce qu'elle est porteuse de « progrès », a le devoir de s'étendre, car en elle se trouve « l'avenir » de l'humanité. Michèle Duchet l'exprime bien dans un passage qui mérite d'être cité dans son intégralité. Elle écrit :
depuis […] le début du processus de colonisation, l'homme sauvage est objet, l'homme civilisé seul est sujet ; il est celui qui civilise, il apporte avec lui la civilisation, il la parle, il la pense, et parce qu'elle est le mode de son action, elle devient le référent de son discours. Bon gré mal gré, la pensée philosophique prend en charge la violence faite à l'homme sauvage, au nom d'une supériorité dont elle participe : elle a beau affirmer que tous les hommes sont frères, elle ne peut se défendre d'un européocentrisme, qui trouve dans l'idée de progrès son meilleur alibi. Elle a beau se défendre de consentir à l'ordre des choses, elle ne peut lui opposer, dans le meilleur des cas, qu'un réformisme humanitaire (11).
Cette pensée s'appuie également au dernier quart de XVIIIe siècle sur la théorie économique des physiocrates, doctrine selon laquelle les « lois naturelles » constituent le fondement des principes sociaux. Cette doctrine qui considère l'activité agricole comme la richesse de toute société voit également dans la propriété privée le résultat « naturel » de la richesse elle-même basée sur l'agriculture. C'est ainsi que l'un des plus grands adeptes de la physiocratie, l'économiste et théologien Nicolas Baudeau (1730-1792), perçoit dans « l'ordre naturel tout physique […] un développement nécessaire de l'ordre social physique, fondée sur la propriété foncière, qui nait de la culture, occasionnée par la nécessité physique de multiplier les objets propres à la subsistance, et au bien-être des hommes (12) ». Ce naturalisme économique que prônent les physiocrates est lié de façon constitutive à la valorisation du travail de la terre. Mais de cette conception découle également une certaine représentation de la société basée sur une perception évolutionniste. L'économiste marxiste néo-zélandais Ronald L. Meek analyse dans son ouvrage Science and the Ignoble Savage (1976), les théories socio-économiques de la fin du XVIIIe siècle comme une tentative de comprendre les sociétés à partir de leurs « modes de subsistance ». Pour lui, ces nouvelles théories perçoivent l'histoire comme universelle et constituée de quatre étapes : la chasse, le pâturage, l'agriculture et le commerce (13). Ces étapes qui se suivent de façon linéaire et évolutive représentent, dans l'esprit des économistes du XVIIIe siècle, le parcours « nécessaire » et « naturel » de toute société, et c'est ainsi « que se construit un principe explicatif qui se présente comme allant de soi ---et devant ainsi s'appliquer à tous. L'ordre dénommé « naturel » devient un « ordre pour tous » (14). » De plus, l'importance du travail, c'est-à-dire de l'être humain en tant que force productive, devient non seulement une notion consubstantielle à celle de la création de la civilisation et de son évolution, mais induit également une perception qui considère le « sauvage », empêtré dans sa « paresse », comme dépourvu d'humanité. Pour la pensée libérale, « quand la ‘paresse' devint une caractéristique ‘essentielle' des races sauvages, elle s'avéra un mode d'être imposé par la nature, et posé en contradiction avec la véritable humanité (15). » L'esclavage devient ainsi, comme d'ailleurs le percevait le philosophe Hegel, « un moment de l'éducation des peuples dégradés, ‘une sorte de participation à une vie éthique et culturelle supérieure (16)'. »
À la fin du XVIIIe siècle, l'idée de la supériorité de la civilisation occidentale et d'une perception évolutionniste des sociétés se renforcent et prennent forme dans les principaux courants intellectuels. Si le rationalisme, dans lequel se reconnaissent les Lumières, a permis de remettre en cause le dogmatisme religieux et l'absolutisme, rendre ainsi possible une certaine émancipation des idéologies de l'Ancien Régime, il est aussi à la base d'une certaine représentation du monde fondée sur l'inégalité. L'idéologie racialiste, qui se constitue au début du siècle, dénote une particularité : elle se démarque de plus en plus de la croyance religieuse pour prendre la forme d'une rationalité dont le XIXe siècle sera l'aboutissement. Le système esclavagiste, en particulier le développement des plantations sucrières, atteint son apogée au cours du XVIIIe siècle. Les questions portant sur la rentabilité et l'importance économique des colonies prennent une dimension jamais atteinte dans les métropoles, particulièrement pour les centres financiers et la bourgeoisie montante. Mais la légitimation de ce système, embryon du système-monde selon l'expression du sociologue Immanuel Wallerstein, n'allait pas de soi. Les Lumières portaient également en elles-mêmes l'exigence de l'égalité entre les êtres humains. Le mouvement abolitionniste qui naquit à la fin du siècle s'en inspira pour constituer son argumentation (17).
En somme, l'universalisme qui émerge avec les Lumières comporte une contradiction apparente qui, dans le contexte du XVIIIe siècle, semble impossible à surmonter : il incarne la raison, la morale basée sur un certain humanisme, mais il implique une rationalité réductionniste qui s'impose comme une vérité incontestée, rationalité développant une conception linéaire de l'histoire consistant à prendre l'Europe comme seul modèle paradigmatique de tout développement historique. Tout en mettant la liberté de l'individu au centre de son raisonnement, la pensée libérale, qui prend forme au cours de cette période, n'échappe pas à cette conception : pour elle, la civilisation telle qu'elle s'est développée en Europe est conçue comme universelle et doit être imposée à tous, même si cela suppose l'extermination des autres formes de civilisation. Cette pensée libérale qui remet en cause le dogmatisme religieux et l'absolutisme de l'Ancien Régime reprend à sa façon la croyance selon laquelle il existerait une hiérarchie entre les êtres humains, ou plus particulièrement entre les « races », croyance remplaçant graduellement celle du dogme religieux de la malédiction de Cham et qui allait trouver son aboutissement dans le biologisme racial du XIXe siècle, époque du rationalisme scientifique, de la deuxième phase de la Révolution industrielle et du nouveau colonialisme, inaugurant ainsi le triomphe du mode de production capitaliste.
Notes
1- Domenico Losurdo, Contre-histoire du libéralisme. Éditions La Découverte, Paris 2013, p.52
2- Ibid. p.56
3- Charles-Louis Montesquieu, De l'esprit des lois, 2 tomes, « folio », Gallimard, Paris 1995, XV,2. Cité par Domenico Lusordo, p.58
4- Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des lumières, Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvetius, Diderot, Flammarion, Paris 1977, p.185
5- Voltaire, Traité de métaphysique, p.191, cité dans Michèle Duchet, opi. cit., p.231
6- Michèle Duchet, Ibid. p.22
7- Ibid. p.18
8- Ibid. p.19
9- Voir Claude Blanckaert, Les archives du genre humain. Approches réflexives en histoire des sciences anthropologiques. Postface du livre de Michèle Duchet, Éditions Albin Michel, 1995
10- Didier Diderot, l'Histoire des Deux Indes, cité dans Michèle Duchet, Ibid. p.20
11- Michèle Duchet, opi. cit. p.20
12- Éphémérides du Citoyen, 1767, tome 1, p.112, cité dans Jacob, A. (1991). Civilisation/Sauvagerie. Le Sauvage américain et l'idée de civilisation. Anthropologie et Sociétés, 15(1), 13–35.
13- Voir : Ronald L. Meek, Social Science and the ignoble, Cambridge University Press 1976, 252 p.
14- Jacob, A. op. cit.
15- Claude Blanckaert, « La science de l'homme entre humanité et inhumanité », Des sciences contre l'homme, Volume I : Classer, hiérarchiser, exclure, Éditions Autrement, 1993 p.24
16- Ibid.
17- Voir : Olivier Pétré-Grenouilleau (sous la direction de), Abolir l'esclavage : Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal, Suisse, XVIIIe-XIXe siècles), Presses universitaires de Rennes, 2015, 430 p.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les perdants de Jenny Cartwright

À l'affiche dès le 28 février
« L'exercice de la démocratie se trouverait-il ailleurs que dans le processus électoral ? »
— Jenny Cartwright
Le 28 janvier 2025 – Montréal – Office national du film du Canada (ONF)
Le long métrage documentaire Les perdants de Jenny Cartwright arrivera en salle au Québec le vendredi 28 février. Rappelons que le documentaire sera présenté en première mondiale et en ouverture de la 43e édition des Rendez-vous Québec Cinéma le 19 février prochain, en présence de l'équipe du film.
Les perdants suit trois personnes candidates aux élections provinciales québécoises de 2022 en jetant un regard caustique sur notre système électoral et ses nombreux dysfonctionnements.
BANDE-ANNONCE
Le point commun aux trois personnes candidates (Renaud Blais, Elza Kephart et Jean-Louis Thémis) présentées dans Les perdants ? Une défaite assurée. À travers leurs campagnes respectives et les propos de Francis Dupuis-Déri et de Catherine Dorion, entre autres, le film décortique les nombreux dysfonctionnements du système électoral : difficultés supplémentaires pour les femmes et les personnes racisées, mode de scrutin déficient, financement inéquitable, poids des médias et des sondages... Car le système politique n'offre pas les mêmes chances à toutes et tous. Si la course semble perdue d'avance pour une majorité des coureurs, c'est que nous sommes les perdants du jeu électoral.
À propos de la réalisatrice
Cinéaste primée de documentaires et de créations sonores, Jenny Cartwright allie poésie et manifestes dans l'exploration de thèmes comme l'autodétermination et les inégalités, avec un parti pris pour les personnes mises à l'écart. Ses documentaires sonores Debouttes ! (2020) et Création de richesse (2022) ont été récompensés aux prix NUMIX. Son film Je me souviens d'un temps où personne ne joggait dans ce quartier a remporté en 2022 le prix RÉAL, œuvre art et essai, décerné par l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec.

Carnaval

Port-au-Prince, le 27 janvier 2025- Dans les ruelles vibrantes d'Haïti, entre les échos des coups de feu et les cris d'espoir, une réalité troublante persiste : même en pleine tourmente, la population rêve de danser le carnaval. Ce paradoxe est révélateur d'un peuple résilient, attaché à ses traditions et à sa culture, mais aussi d'une lutte intérieure entre la survie quotidienne et le désir de se libérer, ne serait-ce qu'un instant, des chaînes de la crise.
Le carnaval en Haïti n'est pas une simple fête. C'est un exutoire collectif, un espace où le peuple exprime sa joie, sa colère, ses frustrations et ses rêves à travers la musique, les costumes et les danses. Pour une société meurtrie par la violence des gangs, l'instabilité politique et une pauvreté accablante, le carnaval représente un moment suspendu, un instant où l'on peut oublier les luttes quotidiennes et se réapproprier sa dignité.
Mais ce rêve de carnaval prend une teinte particulière en période de crise. Pour beaucoup, il est un acte de résistance culturelle, une manière de dire que la vie continue malgré tout. Pourtant, il illustre aussi une réalité douloureuse : danser devient un luxe dans un pays où la sécurité, la nourriture et même l'eau potable manquent cruellement.
Les rues, autrefois remplies de chars colorés et de foules en liesse, sont aujourd'hui dominées par la peur. Les gangs armés contrôlent des quartiers entiers, kidnappant et terrorisant la population. Comment organiser un carnaval lorsque se rendre d'un point A à un point B peut être une entreprise mortelle ?
Pourtant, chaque année, des voix s'élèvent pour réclamer cette célébration. Certains y voient un moyen de résister à la terreur et de rappeler au monde qu'Haïti est bien plus qu'un pays en crise. Mais pour d'autres, danser le carnaval en pleine tourmente ressemble à une fuite en avant, une tentative désespérée de masquer des problèmes profonds qui continuent de s'aggraver.
Dans le contexte actuel, le carnaval pourrait être perçu comme un reflet de la société haïtienne elle-même : belle, forte et vibrante, mais brisée et en quête de rédemption. Les chansons carnavalesques, souvent empreintes d'humour et de critiques sociales, témoignent des défis quotidiens et des espoirs d'un peuple qui refuse de se résigner.
Cependant, la persistance du carnaval dans un environnement de chaos soulève une question essentielle : à quel prix le rêve de danser est-il maintenu ? Le carnaval, dans toute sa splendeur, peut-il réellement guérir les blessures d'un pays ou est-il simplement une distraction temporaire qui retarde l'inévitable confrontation avec la réalité ?
Le rêve de danser le carnaval, même en période de crise, est un témoignage poignant de l'esprit haïtien. Mais pour que ce rêve ne se transforme pas en illusion, il est impératif que les priorités nationales changent. La sécurité, la justice et les conditions de vie dignes doivent être placées au centre des préoccupations.
Danser le carnaval ne devrait pas être un acte de bravoure ou de défiance face à l'adversité. Cela devrait être une célébration libre et joyeuse, dans un pays où chaque citoyen peut se sentir en sécurité et espérer un avenir meilleur.
Aujourd'hui, alors que la crise s'intensifie, le rêve de danser n'est pas simplement un besoin de fête, mais un cri silencieux pour la paix, la stabilité et la dignité. Et si le carnaval est un rappel de la force d'Haïti, il doit aussi être une invitation à construire un avenir où ce rêve pourra enfin être dansé sans peur.
Smith PRINVIL
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La Fête des Pères

Coup de cœur du Mois de l'histoire des Noirs 2025, La Fête des Pères, de Ayana O'Shun (Le Mythe de la femme noire) sera présenté au Cinéma Le Clap le 5 février à 19h, en présence de la réalisatrice et en partenariat avec la Table de Concertation du Mois de l'histoire des Noirs de Québec.
La Fête des Pères traite de l'incidence de l'absence des pères dans les familles noires en Amérique du Nord, qui est près de deux fois plus élevée que dans l'ensemble de la population. Et de ses effets sur les filles (beaucoup moins étudiés que chez les garçons), les femmes qu'elles deviennent et les communautés. Les racines du phénomène pourraient remonter entre autres aux lois esclavagistes.
Dans La Fête des pères, Ayana O'Shun (Le Mythe de la femme noire) enquête sur le phénomène des pères absents dans les communautés noires, à travers son récit personnel et celui de femmes lumineuses et résilientes du Québec et de la Guadeloupe.
Nous vous invitons à suivre le film sur Facebook et sur Instagram.
https://www.facebook.com/people/La-Fete-des-Peres-Le-film/61571800530536/
https://www.instagram.com/lafetedesperes/
DISTRIBUTION ALTERNATIVE ET RECHERCHE D'IMPACT, cinéma documentaire d'auteur québécois
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.












