Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Noor Hindi, écrivaine américano-palestinienne : “Ce sol me tourmente sans que je l’aie jamais foulé”

Lettres de Palestine - La poétesse américaine d'origine palestinienne Noor Hindi signe un texte intime dans le magazine de gauche “The Nation”. Elle y confie sa difficulté à être palestinienne en Occident et son attachement à une terre qu'elle n'a pourtant jamais foulée. Un sentiment qui se transmet de génération en génération, tout comme la douleur de l'exil.
Tiré de Courrier international. L.égende de la photo : Displacement - Cette toile de 2020, signée du peintre Gazaoui Mohamed Alhaj, a été exposée à Londres dans une exposition consacrée à la Palestine. Lire l'article original.
[Cet article est extrait du dossier publié dans notre hebdomadaire daté du 7 mars 2024 (CI n° 1740). Une sélection de témoignages, de récits et d'images de poètes, d'artistes et d'intellectuels palestiniens, qui donnent à voir la vitalité et la richesse de la culture, de l'histoire et de l'identité palestinienne alors que le conflit entre Israël et le Hamas entre dans son sixième mois.]
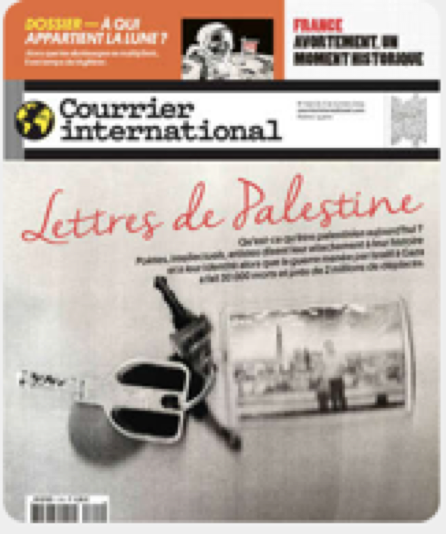
Il n'y a pas longtemps, j'ai posé une question très simple à mon père : “Y a-t-il encore de l'espoir ?” J'étais dans notre cuisine, à Dearborn, dans le Michigan, en train de couper des mangues, et je le voyais dans le salon, comme à son habitude, les yeux rivés sur son téléphone, affaissé sur le canapé, les traits tirés. Il était déjà en train de regarder les infos.
Je ne suis jamais allée en Palestine. Mais je ne connais que trop bien le chaos des informations en provenance de notre terre. Ainsi que ce passé qui nous hante. Quand j'étais enfant, je m'endormais sur les genoux de mon père au son d'Al-Jazeera. Lors des réunions de famille, j'écoutais nos histoires : celle de ma grand-mère qui a survécu à la Nakba à 5 ans, l'enfance de mon père dans le camp de réfugiés de Kalandia [village situé en Cisjordanie occupée], les arbres que mon arrière-grand-père avait plantés autour de sa maison à Al-Koubab (aujourd'hui Ramleh), l'un des 418 villages palestiniens détruits entre 1948 et 1949.
Une nuit, l'année dernière, j'ai rêvé de la Palestine. Dans mon rêve, j'étais agenouillée aux côtés de mon père, et j'avais dans la bouche une poignée de terre de Palestine. Je me suis réveillée, tourmentée par une soif brûlante, un manque qui me serrait la gorge et me vidait physiquement.
Une perte insondable
Je connais très bien ce sentiment de perte insondable, le néant du chagrin, son emprise autour de mon cou. J'ai appelé mon père un peu plus tard dans la journée. “Nous irons en Palestine, lui ai-je promis. En octobre 2024.” Il n'a exprimé qu'une seule exigence : il voulait y aller en août “pour la saison des figues”, et je pouvais l'entendre sourire à l'autre bout du fil.

Je veux pouvoir goûter l'amertume de la terre de Palestine. Depuis des années, ce sol me tourmente sans que je l'aie jamais foulé. Je veux trouver le lieu exact de ma souffrance, les coordonnées spatiales de ce manque. Je l'appelle de toutes mes forces. Et dernièrement ce besoin est devenu impérieux.
Récemment, lors d'une manifestation à Dearborn, j'ai dû m'éloigner de la foule et me mettre à l'écart sous un arbre. J'avais du mal à reprendre mon souffle. Mon corps me jouait des tours, je suppliais mes pieds de s'ancrer dans le sol, de trouver du réconfort dans ce pays pour lequel je ne suis pas faite. J'ai vu un père essayer de rattraper son fils. L'enfant était pieds nus. Il riait à gorge déployée. Il avait ramassé une feuille rouge et la lançait dans les airs. Un condensé de joie pure et de vie. J'ignore quel avenir nous allons lui laisser.
Depuis des mois, les Gazaouis s'assurent que les violences que leur inflige Israël sont indiscutables. Bien avant de faire leur deuil, de constater l'étendue de tout ce qu'ils ont perdu, avant même de prendre Allah à témoin, ils sortent leurs téléphones pour tout filmer et tout prendre en photo.
Des images indescriptibles
Je ne veux pas redonner vie à ces images ici. Et décrire l'indescriptible. Mais voilà ce que je peux dire. En octobre, des médecins de Gaza ont tenu une conférence de presse à l'hôpital baptiste Al-Ahli Arabi. Ils étaient entourés d'une mer d'enfants morts, des petits corps enveloppés dans des draps blancs. Pourtant Israël continue d'en tuer des milliers d'autres. Sous les yeux du reste du monde.
En novembre, les enfants de Gaza ont tenu leur propre conférence de presse devant l'hôpital Al-Chifa. Ils s'exprimaient en anglais. Ils nous suppliaient de les protéger. Pourtant Israël continue d'en tuer des milliers d'autres. Sous les yeux du reste du monde.
Le deuil empêché
Sur Instagram, des Gazaouis comme Motaz Azaiza [il a depuis quitté l'enclave palestinienne] et Bisan Owda, armés seulement de leur téléphone et de leurs témoignages, documentent leur propre génocide. Les bombardements incessants, les déplacements de masse, l'eau empoisonnée, la faim imposée, l'inconsolable peine. Pourtant, Israël continue d'en tuer des milliers d'autres. Sous les yeux du reste du monde. Que faut-il de plus ?
Nous, les Palestiniens, ne pouvons pas faire le deuil de nos morts. Nous devons prouver notre humanité, prouver que nos traumatismes sont bien réels, prouver encore et toujours que nous n'avons pas mérité notre sort. Cela fait soixante-quinze ans que ça dure. Telle est la genèse de ma frustration, cette anxiété personnelle qui s'invite dans le moindre de mes gestes du quotidien : nous n'avons rien d'autre que nos histoires à utiliser comme bouclier. Et ce n'est pas suffisant.
Il n'y a rien de plus éprouvant que d'assister impuissant au génocide de son peuple : sur Twitter, sur Instagram, dans les salles d'attente des médecins, à la radio et dans toutes les tâches les plus élémentaires de survie. Il n'y a rien de plus démoralisant que de voir le reste du monde nier cette violence pourtant constatée et diffusée par les gens qui la vivent au quotidien.
Malgré tout, l'espoir
Les titres des journaux m'agacent. Tout comme les “solutions”. Ou encore cette injonction de l'Occident à prendre en compte la “complexité” de la crise – une complexité qui ne vaut que pour les morts palestiniens – ou à forcément commencer toute conversation sur le sujet par le 7 octobre, alors que nous savons bien que cette date ne marque pas le début de la crise, tant s'en faut. Je refuse. Je veux qu'on me rende mon pays. Ce n'est pas compliqué.
J'écris en prévision d'un avenir dont j'ignore s'il est encore possible. Je mets mon art au service d'un avenir dont j'ignore s'il est encore possible. Je rêve d'une Palestine que je ne connaîtrai sans doute jamais. Pourtant je continue de rêver. Quand je demande à mon père s'il y a encore de l'espoir, il n'hésite pas une seconde. “Bien sûr qu'il y a de l'espoir. — Mais où ? — Je n'ai pas perdu espoir.”
C'est cela être palestinien. Dans cette vie, dans la prochaine et la suivante encore, nous choisirons toujours la Palestine. Rien ne peut nous faire renoncer à l'espoir. Face à l'inimaginable, je m'accroche à cette espérance.
Noor Hindi
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Et le massacre se poursuit pendant le Ramadhan !

Le rapport de force conforté par le soutien américain à Netanyahou, accentue le processus d'extermination des Palestiniens dans la bande de Gaza, au premier jour du Ramadhan.
Face à l'hécatombe, Jean-Luc Mélenchon a pointé du doigt « les criminels », ce samedi, Place de la République.
photo montage https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums/72177720315356715
Serge D'IGNAZIO
De Paris, Omar HADDADOU
Pas de trêve pour mettre un terme au génocide à Gaza !
Sous le siège israélien depuis le 7 octobre 2023, la bande de Gaza subit une situation humanitaire catastrophique. Outre le spectre de la mort (31 000 côté palestiniens), des déplacements (90%), des maladies, du déchirement de la cellule familiale et des troubles post-traumatiques, un autre constat fait état de 2, 2millions d'habitants de l'enclave sont menacés de famine.
Chaque jour apporte son lot de linceuls et le devoir d'actualiser la traçabilité du crime impuni sous le regard capitulard de certaines institutions qui se barricadent derrière des verbes et des épithètes pusillanimes. La déclaration, hier 11 mars, du Secrétaire général de l'ONU, traduit le rôle figuratif et ubuesque d'une grande Instance face à l'occupant. Monsieur Guterres se dit « atterré de la poursuite du conflit malgré le Ramadhan et outré que le conflit se poursuive à Gaza ». Son appel à l'arrêt des bombardements, à l'ouverture d'un corridor humanitaire et à libération les otages en ce mois sacré, reste un piteux prêche dans le désert.
Si le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh se dit « ouvert aux négociations » pour une trêve à Gaza en cette période de piété pour les Musulmans, le ministre de la Défense israélien n'a pas écarté l'obligation « de répondre à toute provocation ». En France, Macron a, depuis quelques heures, le bourrichon qui frétille de jubilation. Cela parait paradoxal, je vous l'accorde. Le drame humain offre aux Puissants une brèche, que dis-je ? une manne providentielle où l'on fait de bonnes et juteuses affaires au détriment des vulnérables.
Surclassant la Russie, il y a à peine 24 heures, l'Hexagone est devenue, pour la première fois, le deuxième exportateur d'armement dans le monde, avec une progression de ventes de 47% sur la période 2019-2023. L'avènement du conflit ukrainien le 24 février 2024, a occasionné un bond de 94% dans les importations européennes. Motus et bouche cousue !
L'obtention d'un cessez-le feu entre Israël et le Hamas est conditionné par nombre de prérequis dont l'échange de prisonniers. Conscient de l'ampleur et de l'intensité des atrocités, le Président des Etats-Unis tente une mascarade de médiation au moment où l'espace vital palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et Khan Younes, est réduit en cimetière à ciel ouvert.
Point d'intransigeance ni de condamnation à l'égard du protégé, investi dans sa besogne macabre. Joe Biden joue sur le phrasé évasif et complaisant en se fendant de communiqués dénués de toute injonction péremptoire. N'est-ce pas une manière de dire « rase-moi tout ça ! On n'a pas le choix ». D'un ton presque aphone, il déclarait : « qu'un cessez-le feu entre Israël et le Hamas s'annonce difficile ».
Ce positionnement a sorti de ses gonds ce samedi, Place de la République, la France Insoumise, menée par Jean-Luc Mélenchon qui, en tribun révolté, a cloué au pilori Netanyahou, « sa politique d'occupation et d'extermination ». La benne d'un camion en guise de tribune, le Député frondeur s'indignait des atrocités infligées au peuple palestinien en dressant un réquisitoire au Premier ministre israélien digne du procès de Nuremberg : « Crosses en l'air, crosses en l'air ! Cessez- le massacre ! Stop aux livraisons des armes ! Nous sommes le peuple humain qui regarde ses frères et sœurs assassinés et qui pensent qu'aucune représaille, aucune vengeance ne rendent le génocide acceptable ! ».
Devant 60 000 manifestants (es) arborant les symboles de la lutte palestinienne et les slogans dénonçant un « crime contre l'Humanité », le cortège progressait jusqu'à la Place de la bourse dans le 2ème Arr. La foule scandait : « Gaza, Gaza, Paris et avec toi ! ». La participation de la gent féminine est impressionnante. L'élan militant cosmopolite recèle des familles, des jeunes mamans avec leurs bébés. Ici, une famille égyptienne avec une bru palestinienne, là un comorien musulman marié à une française, devant, des étudiants toutes nationalités confondues qui crient à l'unisson : « Netanyahou casse-toi ! la Palestine n'est pas à toi ! » ou « Palestine vivra, Palestine vaincra ! ».
Circonspect sur le drame de Gaza, Macron en perte d'influence et d'ambitions expansionnistes au Sahel, tente présentement une opération séduction au Maghreb, sous couvert de réconciliation et de coopération qui cachent mal l'instinct hégémonique aux relents prédateurs.
O.H
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Pen : la torture « républicaine » en colonie et le déni pour « vérité » mémorielle « apaisée »
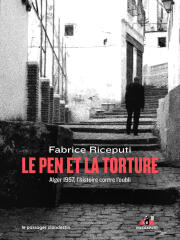
Qui n'a pas vu, lu ou entendu ? Peu de temps avant, pendant et après les commémorations du soixantième anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le cirque politico-académique et sa gueule de bois médiatique de « la guerre des mémoires » a imposé le sentimentalisme de la « réconciliation des deux Rives » comme l'unique grille de lecture du moment colonial en Algérie. A force de mettre l'histoire au service du ressentiment d'Etat français et algérien, on en est même arrivé à oublier ce qu'était la colonisation et l'après-Libération, pour se perdre dans le désastreux mirage d'une histoire antihistorique, dite « apaisée » et contre la « repentance ».
Les premiers laissés pour compte de ce cirque ? La recherche universitaire, les chercheurs, les professeurs d'université et leurs travaux. Des bibliothèques entières réduites aux cendres des manipulations politiciennes de l'extrême droite et de l'autoritarisme. D'un côté, tout ce qui va à l'encontre du « gros bon sens commun » des « bienfaits de la colonisation » est taxé d'« autoflagellation », de « haine de la France », de « soumission aux minorités revanchardes », d' « islamo- gauchisme », de « wokisme » et, dans certains cas, d' « apologie du terrorisme du FLN » ; de l'autre, la roue de l'histoire doit se contenter de ressasser les pieuses légendes de l'avant-1962. Tout ce qui va au-delà risquerait de nuire, selon une certaine « vérité » pour d'aucuns irréfutable, à l' « intégrité de la nation et sa sécurité »…
Le temps est au confusionnisme chez nombre de politiques et d'« intellectuels » de plateaux de télévision, dans les médias (privés surtout) mensonges plus généralement. Marine Le Pen est désormais la pierre angulaire de « l'arc républicain » et il ne faut pas s'étonner d'écouter sur une radio publique une certaine musique révisionniste selon laquelle Le Pen n'aurait sans doute pas torturé en Algérie.
A l'occasion de la récente parution de Le Pen et la torture. Alger 1957, l'histoire contre l'oubli, Le Matin d'Algérie s'entretient avec Fabrice Riceputi, historien et chercheur associé à l'Institut d'histoire du temps présent, autour de ce déni colonial qui va à l'encontre de la vérité solidement établie par des faits historiques depuis plusieurs décennies.
***
Le Matin d'Algérie : Pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre sur le passé tortionnaire et criminel de Le Pen ? Est-ce le manque d'études consacrées à ce sujet qui a déterminé un tel choix, leur dispersion ou le contexte politique délétère dans lequel évolue la France actuellement ?
Fabrice Riceputi : Personne n'avait jamais songé à réunir l'ensemble du dossier historique relatif au passé tortionnaire de Jean-Marie Le Pen. Jusqu'aux années 2000, lorsqu'étaient publiées les dernières révélations à ce sujet, l'affaire paraissait suffisamment entendue. Et si quelques historiens ont travaillé sur la terreur militaro-policière à laquelle il a participé, aucun n'a logiquement jugé utile de s'intéresser à son cas particulier, qui est celui d'un tortionnaire mais parmi beaucoup d'autres, même s'il était député.
Mais plus de 20 années ont passé, les années de la « dédiabolisation » des Le Pen et du lepénisme. Et en février 2023, on a pu très sérieusement affirmer sur France Inter que « le soldat Le Pen n'a sans doute pas torturé » à Alger et qu'on n'aurait en tout cas « pas de preuves ». C'est là que j'ai réalisé la nécessité de faire ce travail, qui est aussi une manière de raconter au travers du cas Le Pen les premiers mois de ce qu'on appelle « la bataille d'Alger ». Désormais, ce dossier est à la disposition de tous et je suis heureux qu'il soit aussi publié en Algérie.
Le Matin d'Algérie : A quand remontent les premières accusations et revendications de la torture par Le Pen ?
Fabrice Riceputi : Les premières accusations remontent à juin 1957, c'est-à-dire deux mois après son départ d'Alger le 31 mars. Le périodique du FLN Résistance algérienne raconte le supplice infligé par le député parachutiste Le Pen à un certain « Dahman », à la Villa Les Roses sur les hauteurs d'El Biar, où cantonnait effectivement la compagnie de Le Pen. Puis, en 1962, Pierre Vidal-Naquet rend public le rapport du commissaire principal René Gille exposant deux plaintes pour torture déposées par deux Algériens contre Le Pen. L'un des deux a été conduit par Le Pen à la Villa Sésini parce qu'il refusait de lui ouvrir le bar de l'Hôtel Albert 1er à 2 heures du matin…Ensuite, plus rien jusqu'à ce que la presse française s'intéresse au passé d'un Le Pen devenu leader d'un parti à succès : le Front National.
Durant la guerre, Le Pen a fait l'apologie de la torture et, en 1962, a fièrement confirmé avoir lui-même torturé. Mais à partir des années 1980, face à des accusations très circonstanciées de plusieurs de ses victimes directes dans la presse, il doit réagir, alors qu'il brigue les plus hautes fonctions politiques : il attaque systématiquement en diffamation, nie avoir torturé lui-même, tout en jugeant totalement justifiée la torture « anti-terroriste ». L'impunité lui étant garantie par l'amnistie depuis 1962 et les faits eux-mêmes ne pouvant être jugés, il peut gagner ses premiers procès, avant d'en perdre trois autour de 2000, dont celui contre Le Monde, avec un jugement particulièrement définitif.
Le Matin d'Algérie : Pouvez-vous revenir sur le parcours de Le Pen durant « la grande répression d'Alger » (selon la formule de Gilbert Meynier pour parler de « la bataille d'Alger) ? Durant quelle période de l'année 1957 le « lieutenant Marco » a-t-il intensifié ses pratiques inhumaines sur les corps des colonisés ?
Fabrice Riceputi : Ce jeune militant nationaliste et anticommuniste s'engage d'abord en Indochine, où il reste un an. C'est là qu'il apprend comme beaucoup d'autres militaires français les méthodes de la guerre contre-insurrectionnelle qui vont être appliquées ensuite en Algérie. Notamment, l'usage de la torture. Elu député poujadiste en 1956, il s'engage à nouveau pour l'Algérie où il arrive comme lieutenant dans le 1er Régiment Etranger Parachutiste à la fin décembre 1956. Le 7 janvier 1957, le gouvernement du socialiste Guy Mollet lance près de 10 000 parachutistes sur Alger avec le projet d'en finir avec le nationalisme algérien dans la ville-vitrine de l'Algérie française. Leur première tâche est d'écraser la grève des 8 jours appelée par le FLN, dont le succès démontrerait au monde l'audience de ce dernier. Le mode opératoire mis au point est celui qu'on appellera plus tard, en Argentine, la disparition forcée. Les militaires enlèvent, détiennent, interrogent, exécutent parfois qui leur paraît « suspect », sans rendre de comptes à quiconque. Le Pen est des officiers qui font « du renseignement ». Dans la quinzaine de témoignages de ses victimes, on le voit traquer des « suspects », la nuit, dans tout Alger, et torturer, à domicile ou dans certains des très nombreux centres de torture dont Alger et sa région sont couverts : villa Les Roses, Villa Sésini, Fort-L'Empereur notamment. Il utilise surtout les méthodes très normées et enseignées alors aux officiers de renseignement que sont la torture par ingestion forcée d'eau souillée et celle à l'électricité, la « gégène », censées ne pas laisser trop de traces sur les corps des suppliciés. Certains témoins mentionnent aussi des exécutions sommaires. L'un d'eux le relie directement à Paul Aussaresses, qui dirigeait clandestinement les escadrons de la mort de l'armée française. Il est très possible que Le Pen ait agi sous les ordres de ce dernier. Au total, plusieurs dizaines de victimes lui sont imputées, en deux mois et demi de présence effective à Alger.
Le Matin d'Algérie : Que disent les victimes de la torture à propos de Le Pen ? L'historiographie de l'Algérie coloniale, quelle légitimité accorde-t-elle aujourd'hui à leurs témoignages
Fabrice Riceputi : Dans une sorte de prolongement de l'idéologie colonialiste, on a longtemps refusé en France de prendre en compte la parole algérienne sur ces questions. C'est ce que font certains commentateurs quand ils disent qu'il n'y a pas de preuves que Le Pen a torturé. Ils s'assoient sur les témoignages. Or, dans les contextes de crimes d'Etat niés et dissimulés, qu'il s'agisse de la torture en Algérie ou par exemple du génocide des Arméniens, l'historien doit avoir recours aux témoignages des victimes, qui sont la source quasi-unique dont on dispose. Il n'y a par définition rien ou presque dans les archives et les acteurs des répressions les avouent très rarement. Il faut bien sûr soumettre ces témoignages à la critique. C'est ce que j'ai fait avec les victimes de Le Pen, fort notamment de ma connaissance du contexte algérois en 1957, sur lequel je travaille depuis plusieurs années avec Malika Rahal. Et ma conclusion est qu'ils sont parfaitement crédibles.
Le Matin d'Algérie : Quand certains médias, politiques et « intellectuels » de plateaux de télévision critiquent Le Pen en France, ils parlent souvent de collaborationnisme, de nazisme et de racisme, mais jamais de colonialisme. Selon vous, qu'est-ce qui explique le déni de la matrice coloniale du lepénisme ? Ce déni, a-t-il un rapport avec le refus de l'Etat français de reconnaître officiellement, d'abord pour ses propres citoyens, le caractère inhumain de ses différentes entreprises coloniales et de rompre définitivement avec ses ambivalences vis-à-vis du mythe des supposés « aspects positifs de la colonisation » ?
Fabrice Riceputi : En France, il n'est pas jugé particulièrement infâmant d'avoir trempé dans les crimes coloniaux. Car c'est la chose la mieux partagée par tous les courants politiques ou presque. L'extrême droite, mais aussi les socialistes et les gaullistes. Aucun n'a fait le moindre inventaire critique de ce passé honteux. Les initiatives mémorielles de Macron évitent soigneusement cette question et perpétuent en réalité le légendaire déni français des crimes commis durant l'époque coloniale.
***
Propos recueillis par Faris LOUNIS
Journaliste indépendant
Bibliographie sélective :
Ici on noya les Algériens, Lorient, Le passager clandestin, 2021.
Le Pen et la torture. Alger 1957, l'histoire contre l'oubli, Lorient, Le passager clandestin, 2023.
Fabrice Riceputi coanime le site « histoirecoloniale.net » et mène avec l'historienne Malika Rahal le projet « Mille autres » sur les enlèvements, la torture et les exécutions sommaires d'Algériens durant la grande répression d'Alger (la « bataille d'Alger »). Leurs publications sont consultables sur le site éponyme « 1000autres.org ».
Crédit : Serge d'Ignazio.
*Cet entretien a été publié pour la première fois, le 3 mars 2024, dans Le Matin d'Algérie.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis. En 2023, les grèves importantes ont augmenté de 280%. Toutefois, la protection du droit de grève est très insuffisante

L'année dernière a vu une relance de l'action collective parmi les travailleurs et travailleuses. Plus de 16,2 millions d'entre eux et elles étaient représentés par des syndicats en 2023, soit 191 000 de plus qu'en 2022. Les travailleurs ont déposé des pétitions et votes pour établir des sections syndicales en nombre record. Ils ont obtenu des gains salariaux significatifs grâce à des débrayages, grèves et arrêts de travail et grâce à des négociations contractuelles. En outre, les efforts de syndicalisation se sont poursuivis dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les organisations à but non lucratif, l'enseignement supérieur, les musées, le commerce de détail et l'industrie manufacturière (Shierholz et al. 2024).
1 mars 2024 | tiré du site alencontre.org
Les grèves ont été l'une des principales formes d'action collective en 2023. On parle de grève lorsque des travailleurs refusent de travailler pour leur employeur dans le cadre d'un conflit du travail. En refusant leur travail – travail dont les employeurs dépendent pour produire des biens et fournir des services – les travailleurs et travailleuses peuvent contrecarrer l'asymétrie de rapports de pouvoir existant entre eux et leur employeur. Les grèves constituent un moyen de pression essentiel pour les travailleurs lorsqu'ils négocient avec leurs employeurs des salaires et des conditions de travail correctes, lorsque les employeurs enfreignent le droit du travail ou lorsqu'ils refusent de reconnaître volontairement les syndicats.
Les données du Bureau of Labor Statistics (BLS) montrent que 458 900 travailleurs et travailleuses ont été impliqués dans des « arrêts de travail significatifs » en 2023. Le nombre de travailleurs impliqués dans des arrêts de travail significatifs a augmenté de 280% en 2023, retrouvant les niveaux observés avant la pandémie de Covid-19. Ces grèves ont touché des salarié·e·s de tout le pays, des ouvriers de l'automobile aux scénaristes et acteurs d'Hollywood, en passant par les infirmières et les enseignants des écoles publiques.
Un thème commun aux grèves de 2023 était la revendication d'une augmentation des salaires dans un contexte de chocs inflationnistes résultant de la relance après la pandémie, de crises mondiales, de bénéfices records pour de nombreuses entreprises et de rémunérations stratosphériques pour les PDG. Parmi les autres motifs de grève, citons des décennies de stagnation des salaires, l'érosion des soins de santé et des prestations de retraite [les deux liés à l'emploi], les longues heures de travail et les conditions de travail dangereuses (Bivens et al. 2023 ; Dickler 2023). Il n'est pas surprenant que les travailleurs et travailleuses entreprennent des actions collectives pour améliorer leurs salaires et leurs conditions de travail, mais nous devrions nous demander pourquoi cela se produit maintenant. Depuis plusieurs décennies, l'économie des Etats-Unis se caractérise par une croissance inégale des revenus et une stagnation des salaires. Les recherches montrent que les syndicats et la négociation collective sont des outils essentiels pour lutter contre l'inégalité des revenus et améliorer les salaires, les avantages et les conditions de travail des travailleurs syndiqués et non syndiqués (Bivens et al. 2023). Toutefois, l'augmentation continue de l'action collective n'est pas susceptible d'accroître sensiblement le taux de syndicalisation, à moins que des changements politiques significatifs ne soient adoptés pour garantir à tous les travailleurs et travailleuses le droit de former des syndicats, de négocier collectivement et de faire grève.
Dans cette note, nous mettons en évidence les arrêts de travail survenus en 2023 et discutons des politiques nécessaires pour renforcer le droit de grève aux Etats-Unis.
Données sur les arrêts de travail « majeurs »
Le Bureau of Labor Statistics (BLS) définit les « arrêts de travail majeurs » comme ceux qui impliquent au moins 1000 travailleurs et durent un quart de durée de travail complète entre le lundi et le vendredi, à l'exclusion des jours fériés fédéraux. Les données du BLS montrent que 458 900 travailleurs ont été impliqués dans 33 arrêts de travail majeurs qui ont débuté et pris fin en 2023 (BLS 2024c). Il s'agit d'une augmentation de plus de 280% par rapport au nombre de travailleurs impliqués dans des arrêts de travail majeurs en 2022, qui était de 120 600. En outre, elle est comparable à l'augmentation observée dans les niveaux prépandémiques en 2018 et 2019, comme le montre le graphique A.

Notes : Le Bureau of Labor Statistics ne fait pas de distinction entre les grèves et les lock-out dans ses données sur les arrêts de travail. Toutefois, les lock-out (qui sont lancés par l'employeur) sont rares par rapport aux grèves, de sorte qu'il est raisonnable de considérer les données sur les arrêts de travail majeurs comme une approximation des données sur les grèves significatives. Les données concernent les travailleurs des secteurs public et privé.
Source : Bureau of Labor Statistics : Bureau of Labor Statistics, « Work Stoppages Summary » (communiqué de presse), 21 février 2024, et tableau connexe, « Annual Work Stoppages Involving 1,000 or More Workers, 1947-Present ».
Environ 75% des arrêts de travail majeurs en 2023 (25) ont eu lieu dans le secteur privé, dont plus de la moitié (14) dans le secteur de la santé. Les administrations publiques ont été à l'origine de cinq arrêts de travail majeurs, la majorité d'entre eux concernant des collèges et des universités publics. Les collectivités locales ont été à l'origine de trois arrêts de travail importants, qui concernaient des écoles primaires publiques.
Exemples d'arrêts de travail importants (majeurs) en 2023
Les données sur les arrêts de travail du Bureau of Labor Statistics comprennent une ventilation des organisations dans lesquelles se sont produits les principaux arrêts de travail. Ces données, combinées à un examen par l'EPI (Economic Policy Institute) des sources accessibles au public, suggèrent un éventail d'activités de grève en 2023. Les thèmes récurrents des principaux arrêts de travail survenus en 2023 sont les suivants : les travailleurs et travailleuses citent des décennies de stagnation des salaires réels (corrigés de l'inflation), l'érosion de l'assurance maladie ou des prestations de retraite, les longues heures de travail et les conditions de travail dangereuses ou stressantes comme motivation pour obtenir des améliorations significatives des salaires, des prestations et des conditions de travail. Voici quelques exemples d'arrêts de travail importants couverts par les données du BLS.
Grève « Debout » des United Auto Workers (UAW)
Le 15 septembre 2023, plus de 12 000 travailleurs se sont mis en grève chez General Motors, Ford et Stellantis après l'expiration de leur contrat [par grève debout, « Stand Up », on entend le choix des secteurs entrant en grève, à l'opposé de grèves mobilisant tous les travailleurs d'une entreprise]. Les travailleurs, représentés par le syndicat United Auto Workers, se sont mis en grève pour obtenir de meilleurs salaires et avantages sociaux après les concessions contractuelles accordées à la suite de la grande récession. Entre 2013 et 2023, les trois constructeurs automobiles ont vu leurs bénéfices augmenter de 250 milliards de dollars, alors que les membres de l'UAW n'ont pas bénéficié d'un ajustement du coût de la vie depuis 2009 (Hersh 2023).
Pendant l'arrêt de travail, l'UAW a appliqué une stratégie de « grève debout ». Au lieu de mettre les 150 000 membres en grève en même temps, ils ont choisi des sites spécifiques pour faire grève, d'autres sites étant prêts à « se lever » et à rejoindre la grève à mesure que les négociations se poursuivaient avec les trois constructeurs automobiles (UAW 2024). Au total, environ 53 000 travailleurs ont participé aux arrêts de travail. C'était la première fois que l'UAW se mettait en grève simultanément chez les trois constructeurs automobiles.
La grève a pris fin au bout de deux mois, lorsque les United Auto Workers et General Motors, Ford et Stellantis ont conclu des accords prévoyant des augmentations d'au moins 33% pour tous les travailleurs, l'élimination d'un système salarial à deux vitesses [avec des salaires d'entrée pouvant durer plus bas que la moyenne], la réouverture d'une usine Stellantis précédemment fermée, un engagement en faveur d'une transition équitable avec les véhicules électriques et des primes annuelles pour les retraités (UAW 2023). En outre, les travailleurs non syndiqués ont bénéficié des retombées des avancées de l'UAW. Par exemple, Toyota, Honda, Hyundai et Tesla ont augmenté les salaires de leurs travailleurs et travailleuses aux Etats-Unis (dont aucun n'est syndiqué) peu après que l'UAW a conclu un accord de principe avec General Motors, Ford et Stellantis (Brooks 2023 ; Kolodny 2024).
Grève des travailleurs de la santé de Kaiser Permanente
En octobre 2023, plus de 75 000 travailleurs de la santé de Kaiser Permanente, représentés par une coalition de plusieurs syndicats, ont entamé la plus grande grève de l'histoire des Etats-Unis dans le secteur de la santé (Isidore et Delouya 2023). La grève de trois jours a concerné des infirmières, des techniciens médicaux et du personnel de soutien dans des centaines d'établissements Kaiser dans sept Etats et dans le district de Columbia, les plus grands groupes de salarié·e·s (agents de santé) de Kaiser étant en grève en Californie (Reuters 2023).
Comme de nombreuses grèves dans le secteur de la santé ces dernières années, la grève des employé·e·s de Kaiser a attiré l'attention sur les propositions syndicales visant à remédier aux retards de salaires et à la crise du personnel. A l'issue de la grève de trois jours, les salarié·e·s ont conclu avec Kaiser un accord de principe prévoyant une augmentation générale des salaires de 21% sur quatre ans, des primes supplémentaires et une rétribution collective des objectifs fixés, ainsi que de nouvelles initiatives en matière de formation, d'éducation et d'embauche afin d'accroître les niveaux de personnel. L'accord qui en a résulté, ratifié par plus de 98% des membres en novembre 2023, a également fixé un nouveau salaire minimum pour les salarié·e·s de la santé de Kaiser à 23 dollars (qui sera fixé à 25 dollars d'ici 2026) en Californie et à 21 dollars (qui sera fixé à 23 dollars d'ici 2026) dans tous les autres Etats couverts par le contrat (Coalition of Kaiser Permanente Unions 2023).
Grève des employés diplômés de l'Université du Michigan
En mars 2023, environ 2200 employé·e·s de l'Université du Michigan se sont mis en grève. Représentés par la section locale 3550 de la Graduate Employees' Organization (GEO), ils comprennent des étudiants assistants et des assistants de troisième cycle répartis sur trois campus. Les employés ont voté en faveur de la grève afin d'améliorer leurs salaires et leurs avantages sociaux et d'obtenir des protections contre le harcèlement et des conditions de travail plus sûres (P. Lucas 2023).
La grève a été controversée, ce qui a conduit le GEO et l'Université du Michigan à porter plainte l'un contre l'autre pour pratiques déloyales de travail. Les accusations ont finalement été réglées entre les deux parties (Anderson 2023).
La grève de cinq mois a pris fin lorsque la Graduate Employees' Organization (GEO) et l'Université du Michigan ont convenu d'un nouveau contrat de trois ans qui prévoyait d'importantes augmentations de salaire sur les trois campus, des mesures de protection contre le harcèlement, un congé maternité rémunéré, une couverture d'assurance maladie pour les soins liés à l'affirmation du genre et une prime de 1000 dollars à l'embauche (Bruckner, 2023 ; Mackay, 2023). La grève a été le plus long arrêt de travail majeur en 2023 et la plus longue grève dans l'histoire du syndicat et de l'université (Bruckner, 2023). La grève de l'Université du Michigan est un exemple de la vague croissante d'actions syndicales parmi les étudiants diplômés ces dernières années (Bivens et al. 2023).
Grèves des travailleurs de Starbucks United lors de la « Journée de la tasse rouge » (Starbucks Workers United Red Cup Day)
Le 16 novembre 2023, plus de 5000 travailleurs de Starbucks se sont mis en grève pour protester contre le refus de l'entreprise de négocier de bonne foi un premier contrat. Cette grève d'une journée a été organisée pour coïncider avec la promotion « Red Cup Day » de Starbucks, qui est historiquement l'une des journées les plus chargées de l'entreprise. La grève du Red Cup Day de 2023 a été le plus grand arrêt de travail de Starbucks Workers United à ce jour, impliquant plus de 5000 salarié·e·s dans 200 magasins (Durbin 2023).
Depuis décembre 2021, les travailleurs de 43 Etats, dans 391 des magasins appartenant à Starbucks aux Etats-Unis, ont voté en faveur de la syndicalisation (More Perfect Union 2024). Depuis plus de deux ans, Starbucks refuse de négocier de bonne foi et n'a signé aucun contrat collectif avec ses magasins syndiqués. Au cours de cette période, les fonctionnaires du National Labor Relations Board ont déposé 105 plaintes alléguant que l'entreprise avait violé le droit du travail, y compris une procédure nationale accusant Starbucks de ne pas avoir négocié avec les travailleurs syndiqués dans les magasins à travers le pays (Saxena 2023). Peu après la grève du Red Cup Day de 2023, Starbucks a annoncé qu'elle souhaitait reprendre les négociations avec Starbucks Workers United afin de conclure un premier contrat en 2024 (A. Lucas, 2023).
Les arrêts de travail qui n'apparaissent pas dans les données du BLS
Les données du Bureau of Labor Statistics sur les arrêts de travail, bien qu'utiles, présentent une limitation majeure. Elles ne comprennent que des informations sur les arrêts de travail (grèves et lock-out) impliquant au moins 1000 travailleurs et durant une durée de travail complète entre le lundi et le vendredi, à l'exclusion des jours fériés fédéraux. En restreignant ainsi les données, on passe à côté d'une énorme quantité d'informations. Selon les données du BLS sur la taille des entreprises, près des trois cinquièmes (58%) des travailleurs du secteur privé sont employés par des entreprises de moins de 1000 salariés (BLS 2024b). Pourtant, toute activité de grève de ces travailleurs ne serait pas prise en compte dans les données du Bureau of Labor Statistics sur les arrêts de travail. Par exemple, une grève de six semaines impliquant 750 étudiants diplômés de l'Université Temple (située à Philadelphie en Pennsylvanie) n'a pas été prise en compte dans les données de 2023, car elle ne répondait pas aux limites de taille du BLS (AP 2023).
Ces limites de taille et de durée signifient que les données du Bureau of Labor Statistics ne tiennent pas compte des nombreux salarié·e·s qui ont débrayé en 2023 pour réclamer des salaires équitables et des conditions de travail sûres. Alors que les données du BLS font état de 33 arrêts de travail majeurs en 2023, l'ILR Labor Action Tracker de Cornell University montre que 470 arrêts de travail – 466 grèves et 4 lock-out – ont eu lieu en 2023 (Ritchie, Kallas, Iyer 2024).
Conclusion. Une action du pouvoir fédéral et des Etats est nécessaire pour garantir le droit de grève
Les données du BLS de 2023 sur les principaux arrêts de travail montrent que plus de 450 000 travailleurs ont exercé leur droit de grève pour obtenir des augmentations de salaire, de meilleurs avantages et des conditions de travail plus sûres. Il n'en reste pas moins que le droit du travail actuel ne protège pas de manière adéquate le droit fondamental de grève des travailleurs et travailleuses. Les politiques fédérales suivantes renforceraient le droit des travailleurs à se syndiquer et à négocier collectivement.
La loi Richard L. Trumka sur la protection du droit d'organisation (PRO) comprend des réformes essentielles qui renforceraient le droit de grève des salarié·e·s du secteur privé. La loi PRO élargirait le champ d'application des grèves en supprimant l'interdiction des grèves de solidarité et en autorisant le recours aux grèves intermittentes [elles sont sans protection légale]. Elle renforcerait également le droit de grève des salarié·e·s en interdisant aux employeurs de remplacer de manière permanente les salarié·e·s en grève.
- La loi sur la protection des soins de santé des salarié·e·s en grève et subissant un lock-out empêcherait les employeurs d'interrompre la couverture médicale des travailleurs et des membres de leur famille en guise de représailles contre les grévistes.
- La loi sur la sécurité alimentaire des grévistes (Food Secure Strikers Act) permettrait aux grévistes de bénéficier des prestations du programme d'aide à l'alimentation (Supplemental Nutrition Assistance Program – SNAP).
- Le Congrès devrait également mettre en œuvre des politiques visant à étendre un droit de grève pleinement protégé aux salarié·e·s des chemins de fer, des compagnies aériennes, du secteur public, de l'agriculture et de l'économie domestique. Aucun de ces travailleurs n'a le droit fondamental de faire grève en vertu de la législation fédérale actuelle.
L'exclusion des salarié·e·s du secteur public, des employé·e·s de maison et des agriculteurs de la couverture du droit du travail fédéral signifie que les droits syndicaux fondamentaux de millions de travailleurs de ces professions sont laissés à l'appréciation des Etats. Pour remédier à une grande partie de ces exclusions, le Congrès devrait, dans un premier temps, adopter la loi sur la liberté de négociation dans la fonction publique (Public Service Freedom to Negotiate Act), établissant une norme minimale en matière de droits de négociation collective que tous les Etats et toutes les localités doivent accorder aux employés du secteur public.
En l'absence d'action du Congrès, les Etats devraient garantir les droits de négociation collective et protéger le droit de grève pour tous les travailleurs et travailleuses du secteur public, de l'agriculture et de l'économie domestique. A l'heure actuelle, seule une douzaine d'Etats accordent des droits de grève limités à certains travailleurs du secteur public. Les Etats devraient également rejoindre l'Etat de New York et du New Jersey en rendant les travailleurs et travailleuses en grève éligibles aux allocations de chômage (Perez 2024). (Article publié sur le site Economic Policy Institute le 21 février 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Références
Anderson, Miles. 2023. “UMich and GEO Reach Settlement on Unfair Labor Practices and Lawsuit.” Michigan Daily, June 8, 2023.
Associated Press (AP). 2023. “Temple Graduate Students Ratify New Pact, End 6-Week Strike.” March 13, 2023.
Bivens, Josh, Celine McNicholas, Margaret Poydock, Jennifer Sherer, and Monica Leon. 2023. What to Know About This Summer's Strike Activity : What's Spurring the Rise in Labor Actions ? Economic Policy Institute, August 2023.
Brooks, Khristopher J. 2023. “Hyundai, Honda and Toyota Have All Raised Worker Pay Since UAW Strike Ended.” CBS News, November 13, 2023.
Bruckner, Meredith. 2023. “University of Michigan Grad Student Employees Ratify New Deal After Historic Strike.” CBS News, August 25, 2023.
Bureau of Labor Statistics (BLS). 2024a. “Annual Work Stoppages Involving 1,000 or More Workers, 1947–Present” (table). Major Work Stoppages. Accessed on February 16, 2024.
Bureau of Labor Statistics (BLS). 2024b. “Table F. Distribution of Private Sector Employment by Firm Size Class : 1993/Q1 Through 2023/Q1, Not Seasonally Adjusted” (table). National Business Employment Dynamics Data by Firm Size Class. Accessed on February 7, 2024.
Bureau of Labor Statistics (BLS). 2024c. “Work Stoppages Summary” (press release). February 21, 2024.
Coalition of Kaiser Permanente Unions. 2023. “98.5% Yes Vote Ratifies 2023 National Agreement.” November 9, 2023.
Dickler, Jessica. 2023. “Why So Many Workers Are Striking in 2023 : ‘Strikes Can Often Be Contagious,' Says Expert.” CNBC, October 9, 2023.
Durbin, Dee-Ann. 2023. “Thousands of Starbucks Workers Go on a One-Day Strike on One of Chain's Busiest Days.” Associated Press, November 16, 2023.
Hersh, Adam. 2023. “UAW-Automakers Negotiations Pit Falling Wages Against Skyrocketing CEO Pay.” Working Economics Blog (Economic Policy Institute), September 12, 2023.
Isidore, Chris, and Samantha Delouya. 2023. “Union Workers Reach a Tentative Deal with Kaiser Permanente After the Largest-Ever US Health Care Strike.” CNN, October 13, 2023.
Kolodny, Lora. 2024. “Tesla Raising Factory Worker Pay in U.S. Following UAW Victories in Detroit.” CNBC, January 11, 2024.
Lucas, Amelia. 2023. “Starbucks Tells Union It Wants to Resume Contract Talks in January.” CNBC, December 8, 2023.
Lucas, Peter. 2023. “Graduate Workers at the University of Michigan Have Been on Strike for over a Month.” Jacobin, May 14, 2023.
Mackay, Hannah. 2023. “Striking UM Grad Student Instructors Begin Voting to Ratify New 3-Year Deal.” Detroit Free Press, August 22, 2023.
More Perfect Union. 2024. “Map : Where Are Starbucks Workers Unionizing ?” (web page). Last updated February 14, 2024.
Perez, Daniel. 2024. “Extending Unemployment Insurance to Striking Workers Would Cost Little and Encourage Fair Negotiations.” Working Economics Blog (Economic Policy Institute), January 29, 2024.
Reuters. 2023. “Kaiser Healthcare Workers Ratify New Contract.” November 9, 2023.
Ritchie, Kathryn, Johnnie Kallas, and Deepa Kylasam Iyer. 2024. Labor Action Tracker : Annual Report 2023. ILR School, Cornell University and School of Labor and Employment Relations, University of Illinois Urbana-Champaign, February 2024.
Saxena, Jaya. 2023. “Starbucks Workers United's Red Cup Rebellion, Explained.” Eater, November 14, 2023.
Shierholz, Heidi, Celine McNicholas, Margaret Poydock, and Jennifer Sherer. 2024. Workers Want Unions, but the Latest Data Point to Obstacles in Their Path. Economic Policy Institute, January 2024.
United Auto Workers (UAW). 2023. “UAW Members Ratify Historic Contracts at Ford, GM, and Stellantis” (press release). November 20, 2023.
United Auto Workers (UAW). 2024. “Stand Up Strike Frequently Asked Questions” (web page). Accessed on February 7, 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le huit mars a vu l’émergence de la grève féministe dans maints pays

Empêcher l'humanité de glisser sur la pente raide du déboulement vers la terre- étuve alors qu'elle marche en funambule sur son étroite bordure exige dès maintenant la mise en branle d'un mouvement de masse mondial.
La mobilisation de la journée des femmes du 8 mars à travers le monde, de par intersectionnalité, y contribue. D'autant plus que depuis quelques années, inspirées de la première grève féministe en Islande en 1975, ces manifestations se sont doublées de grèves dans maints pays, notamment en Espagne et en Argentine mais aussi en Suisse et cette année en Italie et en France. Reprenant son souffle après la Marche mondiale des femmes du tournant du siècle, « [l]a déflagration du mouvement #MeToo en 2017 (grâce aussi aux flammes courageusement allumées et entretenues par les féministes les années précédentes) a réussi à réintégrer le féminisme comme un cadre d'action acceptable dans l'espace public. »
Mais #MeToo a également eu lieu à une époque où les mouvements anti-genre gagnaient lentement et sûrement du terrain, s'attaquant souvent aux droits des femmes sous prétexte de les défendre contre ce qu'ils considéraient comme les aberrations du féminisme radical. […] [L'héritage féministe] a été réinventé et réinterprété dans ce que l'auteure américaine Susan Faludi a appelé le "fémonationalisme" pour cibler le féminisme progressiste, les droits reproductifs et les migrants. C'est ce qu'a résumé de manière frappante Giorgia Meloni [Première ministre d'Italie] lorsqu'elle s'est adressée à une foule de partisans du parti d'extrême droite espagnol Vox en 2022 : « Oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT ! Oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre ! Oui à la culture de la vie, non à l'abîme de la mort ! Oui aux valeurs universelles de la Croix, non à la violence islamiste ! Oui à la sécurité des frontières, non à l'immigration de masse ! »
L'intégration de l'activisme antiféministe et antigenre dans un mouvement conservateur plus large à travers le monde est devenue évidente pendant la présidence de Trump. […] Ces réseaux transnationaux sont puissants et efficaces. Issus de l'extrême droite, ils sont non seulement européens mais aussi mondiaux. […] Ils visent également les droits des personnes LGBTQIA+ et, dans le même ordre d'idées, la Convention d'Istanbul, l'instrument juridique le plus solide pour les droits des femmes en termes de violence sexuelle et sexiste, et en particulier de violence domestique et intrafamiliale", explique le rapport [Rapport 2023 de la Fondation Jean-Jaurès et de l'ONG Equipop].
Malgré des contextes politiques et sociétaux souvent défavorables, l'espoir continue de germer. […] L'un des principaux triomphes de ces dernières décennies a été le référendum irlandais sur l'avortement en 2018, lors duquel près de 70 % des électeurs se sont prononcés en faveur de la légalisation de l'avortement [mais contrebalancée par ladéfaite du référendum visant l'égalité des genres, NDLR] […] La force de la mobilisation féministe contre l'interdiction de l'avortement en Pologne est un autre exemple frappant. En 2016, plus de 100 000 femmes sont descendues dans la rue lors des « manifestations noires ». Le mouvement s'est transformé en grève des femmes en 2020, lorsque le gouvernement a proposé d'adopter la législation la plus restrictive d'Europe en matière d'avortement. L'impact des manifestations a ensuite atteint le parlement, le parti conservateur Droit et Justice (PiS) perdant sa majorité en octobre 2023. […]
Des changements positifs sont également intervenus au sein des gouvernements. Dans le paysage politique européen actuel, c'est l'Espagne qui place la barre très haut en matière de droits de la femme. […] La mobilisation de l'équipe espagnole de football féminin (et de la société dans son ensemble) à la suite du baiser forcé sur la bouche d'une des joueuses lors de la célébration de leur victoire à la Coupe du monde cet été montre que ces lois ont changé les termes du débat, même si les tentatives d'ignorer ces changements se sont avérées puissantes.
Les progrès réalisés dans un pays - en particulier lorsque ce pays est perçu comme catholique et conservateur, comme l'Irlande ou l'Espagne - stimulent les mouvements féministes au-delà des frontières. […] La solidarité internationale a alimenté des manifestations dans le monde entier, telles que les manifestations noires polonaises depuis 2016, les mouvements de femmes iraniennes et le mouvement argentin contre la violence fondée sur le genre Ni Una Menos, qui a débuté en 2015 et s'est depuis étendu à des pays tels que l'Espagne et l'Italie.
Les étudiantes de McGill pour la Palestine et Mères au front contre Northvolt
Cette montée de l'extrême droite qui menace les États-Unis et le Canada, si l'on en croit les sondages électoraux, est de plus en plus portée au Québec par le parti au gouvernement. Que ça soit la droite globaliste néolibérale aux ÉU, au Canada, dans l'Union européenne ou l'extrême-droite nativiste tout aussi néolibérale en Russie ou en Israël, elles deviennent des va-t'en-guerre génocidaires ou leurs complices. Tant leur sexisme militariste et répressif en découlant que la mobilisation des ressources vers la guerre désarçonnent autant le mouvement féministe que celui écologique. Dans un tel contexte il ne faut pas se surprendre que les femmes prennent à bras-le-corps la lutte contre la guerre comme cesétudiantes de McGill qui jeûnent pour la Palestine et qu'elles animent celles écologiques comme les Mères au front contre l'usine de batteries Northvolt et contre la pollution du dépotoir Stablex à Blainville sans oublier la direction femme de Mob6600 pour un parc nature dans Hochelaga-Maisonneuve. Les femmes étaient bien sûr au cœur de la grève du secteur public pour l'école publique. Cette lutte comme le disait le tract des Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique était aussi une lutte climatique par son « aspect de « prendre soin », aspect qu'on oublie trop souvent ».
Une intersectionnalité gréviste à l'origine ouvrière et inspirée du marxisme
Cette intersectionnalité de la lutte des femmes était déjà à l'origine de la journée internationale des femmes car elle fut d'abord « une histoire d'ouvrières » et même « à l'origine de la Révolution russe ». La journée internationale des femmes renaquit au Québec « le 8 mars 1971 pour l'avortement libre et gratuit » inséré en France dans la Constitution, non sans arrière-pensée électoraliste par un gouvernement carrément droitiste, et renié aux ÉU par sa réactionnaire Cour suprême. Les tentacules tous azimuts du féminisme opposent au « capital [qui] épuise les deux seules sources de toute richesse : la Terre et le travailleur », dixit Karl Marx dans le Capital, le prendre soin des gens et de la terre-mère. Comme le dit un article de The Conversation,
Cette organisation [pour la grève féministe] s'appuie aussi sur la mobilisation d'un corpus féministe-marxiste des théories de la reproduction sociale. Celles-ci reprennent les analyses de Marx, « étendues au travail reproductif des femmes et à leur rôle dans les rapports de (re)production capitaliste ». Ces théories mettent en lumière le travail reproductif principalement pris en charge par les femmes, consistant à « produire l'être humain », c'est-à-dire l'ensemble des activités nécessaires à produire le travailleur, à faire en sorte qu'il/elle soit apte au travail dit productif au quotidien (travail domestique, prise en charge des enfants, mais aussi santé publique, éducation, etc.).
Au Québec, mais aussi au Canada anglais et aux ÉU malgré la mobilisation pour le droit à l'avortement, côté grève féministe « ça gronde » mais on n'y est pas encore. Les manifestations du huit mars sont restées confidentielles. Le mouvement féministe québécois, à l'avant-garde de la Marche mondiale des femmes en 2000, n'a pas encore repris son souffle. N'en reste pas moins que dans cette conjoncture adverse, les acquis des femmes dans le monde se maintiennent même s'ils n'avancent pas. Modestement, ici et là se tissent des liens intersectoriels pour la convergence des lutte. S'en sont inspirées les jeunes femmes du mouvement Fridays for Future de Greta Thunberg qui ont tendu la main aux grévistes surtout hommes du syndicat des chauffeurs de transport collectif d'Allemagne. C'est une telle intersectionnalité mondialisée qui requinquera le mouvement climatique pour qu'il reparte à l'offensive.
Marc Bonhomme, 10 mars 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca

8 mars : Les femmes, surtout certaines, sont les premières victimes des guerres, de l’extrême droite et du système financier international. Toutes en grèves et vivent les luttes féministes intersectionnelles !

Dans le contexte de la crise multidimensionnelle du capitalisme, de la gravité de la crise écologique, de la montée en puissance de l'extrême-droite partout dans le monde et de viols et assassinats de femmes [1] au cours de guerres de plus en plus nombreuses, il est plus qu'urgent de rester mobilisé·es et d'amplifier les luttes féministes intersectionnelles.
Tiré de CADTM infolettre , le 2024-03-08
par CADTM International
Photo : Womin
25 000 femmes et enfants ont été tué·es à Gaza depuis le début de la guerre génocidaire menée par le gouvernement sioniste d'Israël le 8 octobre 2023. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, environ 3.238 femmes et filles ont été tuées et 4.872 ont été blessées, et la guerre a déplacé quelque 4 millions de personnes en Ukraine, dont 56 % sont des femmes. Médecins Sans Frontières a recensé 18 000 cas de violences sexuelles entre janvier et octobre 2023 [2] dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo (RDC). Victimes des conséquences directes des bombardements comme toute la population (la faim, manque de soins …), les femmes, leurs corps, leur dignité, sont spécifiquement ciblés par la violence patriarcale et guerrière.
De plus, la crise migratoire touche particulièrement les femmes et accroît leur oppression et leur exploitation. Cette violence n'est qu'une des nombreuses raisons derrière la migration qui, contrairement à la guerre, la destruction et les viols de masse, est criminalisée, générant elles aussi de nombreuses violences économiques, physiques, sexuelles, symboliques... Dans un contexte où de nombreux métiers dévalorisés sont toujours assignés aux femmes, l'exploitation des femmes migrantes dans ceux-ci ne fait que croître, amplifiant ainsi les oppressions croisées qu'elles subissent, y compris entre femmes.
Parallèlement, l'extrême-droite monte partout dans le monde. Avec elle, des revendications réactionnaires mettent en péril des droits qui nous semblaient inébranlables, comme celui de l'avortement. Aux États-Unis, par exemple, l'arrêt Roe v. Wade a été abrogé par la Cour suprême en juin 2022, supprimant le droit fédéral à l'avortement et laissant la liberté à chaque État de statuer individuellement sur la question. Depuis lors, 14 États ont interdit l'accès à l'avortement [3]. Autre exemple, Javier Milei, élu Président de l'Argentine en novembre 2023, s'attaque très durement aux droits des femmes. Il souhaite également abroger la loi qui légalise l'avortement.
Par ailleurs, le capitalisme néolibéral touche les femmes de manière spécifique. Les institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque mondiale imposent, au nom du remboursement de la dette publique, des politiques d'austérité et d'ajustement budgétaire dans le monde entier. Ces politiques impactent spécifiquement les femmes, surtout certaines (femmes migrantes, pauvres, mères célibataires, personne LGBTQIA+). Elles subissent la fermeture des services publics, dont elles sont les travailleuses et bénéficiaires majoritaires, pour elles (maternités, planning familiaux, centres d'accueils,…) et les personnes qu'elles ont à charge (crèches...) , et compensent le retrait de l'État providence. Leur travail gratuit (activités de soin envers leurs proches), mais aussi leurs dépenses (suppression de subsides, augmentation des prix sans augmentation de revenus, endettement…), augmentent considérablement.
Aux Suds, notamment en Afrique et en Asie du Sud, les institutions de microfinance ne cessent de se développer. Elles imposent souvent des taux d'intérêt démentiels aux femmes (jusqu'à 200% au Sri Lanka). Les débitrices subissent les pressions des créanciers qui les poussent parfois au suicide. De plus, l'influence de ces institutions donne lieu, dans certains pays comme le Sri Lanka, à l'interdiction des pratiques de prêts communautaires et solidaires entre femmes.
Les femmes sont également les principales productrices des produits de base dans les pays du Sud. Elles sont très impactées par le changement climatique et l'agrobusiness destructeur.
Les femmes sont clairement au premier plan dans de vastes mouvements de protestation de masse et dans des soulèvements populaires ces dernières années contre l'ordre établi, contre l'exploitation, les violences, le racisme et un ordre économique qui ne fait que renforcer les inégalités de genre, et ce en pleine conscience. Elles sont aussi au devant des batailles environnementales, paysannes, pour la défense de la terre et de l'eau, des droits humains et contre la répression.
Dans ce contexte d'attaques très claires sur les droits des femmes, le réseau CADTM International est plus que jamais mobilisé. Récemment, la coordination féministe du CADTM Afrique a organisé un séminaire de renforcement des capacités des femmes, à Yaoundé, au Cameroun. Parmi les revendications exprimées par les 38 participantes :
Fédérer et organiser des actions autour de la lutte pour l'annulation des dettes illégitimes et contre l'extractivisme, en insistant sur leurs impacts sur les femmes
Lutter pour la mise en place d'audits féministes de la dette et des mégaprojets financés par les institutions financières internationales
Au sein des luttes, donner la parole aux femmes des communautés et prendre en compte leurs besoins
Exiger des réparations pour les dommages causés aux populations et aux femmes en particulier, suite à l'implantation de projets de développement aux impacts négatifs sur les conditions de vie des communautés locales
Dénoncer la microfinance abusive qui accentue la pauvreté et le harcèlement des institutions de microfinance envers les femmes et développer des alternatives : Des crédits sans intérêt ou à taux très bas pour les populations marginalisées.
La lutte continue !
Notes
[1] Lorsque nous faisons référence aux femmes, il s'agit de toute personne identifiée et/ou s'identifiant comme femme. Le terme « femme » est ici utilisé comme catégorie politique pour dénoncer des rapports de domination qui ont lieu dans l'ordre genré et patriarcal dans lequel nous vivons. Les rapports de genre et les luttes qui y sont liées ne se limitent évidemment pas à deux genres ; les vécus et les identités de genre sont multiples.
[2] Bastien Massa, « RDC : à l'ombre du conflit, les femmes en proie à une hausse des viols », Mediapart, 20/02/2024, https://www.mediapart.fr/journal/international/200224/rdc-l-ombre-du-conflit-les-femmes-en-proie-une-hausse-des-viols.
[3] Fatoumata Sillah, « Etats-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l'IVG Etat par Etat », Le monde, 24 juin 2023, https://www.lemonde.fr/international/article/2023/06/24/etats-unis-un-an-apres-roe-vs-wade-le-droit-a-l-ivg-etat-par-etat_6179041_3210.html
Auteur.e
CADTM International
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Solidarité avec les femmes en lutte du monde entier

Par sa dimension internationale, la journée du 8 mars constitue une occasion pour exprimer notre solidarité avec les femmes en lutte dans le monde entier, d'autant plus dans un contexte marqué par l'émergence de nouveaux conflits inter-impérialistes et la présence insupportable de la guerre sur différents continents.
Tiré de Inprecor 718 - mars 2024
10 mars 2024
Par Commission d'intervention féministe du NPA
Photothèque Rouge / Martin Noda / Hans Lucas
photo montage manif 8 mars Paris de Serge D'ignazio
https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums/72177720315358049/
En Palestine, au Soudan, en Ukraine, au Rojava, en Iran comme au Chiapas, les femmes sont en première ligne dans la défense du droit des peuples à l'autodétermination et dans les combats contre les agressions impérialistes. Mais elles sont aussi les premières victimes des conflits armés et leurs conditions de vie peuvent atteindre un seuil dramatique.
Les femmes et la guerre
Dans les guerres contre les populations civiles, les femmes « ne sont plus des victimes occasionnelles, dont l'agression représente une sorte de sous-produit de la guerre, elles sont devenues des adversaires désignées ».
D'une façon générale, les conflits armés augmentent la violence contre les femmes et les personnes LGBTI. L'utilisation du viol comme arme de guerre s'associe à une amplification des violences sexuelles ainsi qu'à une très forte exposition des femmes aux risques de pauvreté.
C'est le cas notamment à l'est de la République démocratique du Congo, dans le contexte d'un conflit entre les différentes milices militaires. En Ukraine, selon Amnesty international, la guerre d'invasion russe a un effet néfaste sur la santé mentale, physique et reproductive des femmes.
Le contexte de la guerre entraîne partout une amplification des actions visant à contrôler les corps des femmes, soit dans le sens d'une atteinte à la production de la vie, soit dans le sens d'une injonction à engendrer de la chair à canon. Le projet de « réarmement démographique » de Macron s'inscrit dans cette logique de biopouvoir, c'est-à-dire d'un pouvoir patriarcal et capitaliste qui soumet la vie aux règles de compétition, d'optimisation et de mise en concurrence du marché.
Les guerres impérialistes apparaissent alors pour ce qu'elles sont, le stade suprême du capitalisme, la façon trouvée par les puissances du monde pour essayer de dépasser les crises d'approvisionnement et d'accumulation du capital.
En Palestine, les femmes accouchent dans des conditions inhumaines et endurent d'innombrables souffrances en raison de l'absence d'anesthésie et d'accès aux soins. Cette atteinte à la vie et à la mise au monde s'inscrit dans une volonté plus globale de destruction du peuple palestinien. La démolition des principales infrastructures de Gaza, les déplacements forcés, les maladies et l'impossibilité d'accéder aux biens essentiels pour la vie entraînent une crise humanitaire sans précédent.
En faisant face aux agressions brutales de l'armée, en préservant les enfants et les liens sociaux et familiaux dans une situation de deuil permanent, les femmes palestiniennes s'illustrent par leur courage et leur détermination dans la résistance depuis plus de 75 ans d'occupation coloniale par l'État d'Israël.
Grève féministe contre l'impérialisme et le patriarcat
Le 8 mars, nous appelons à une grève féministe internationale pour dénoncer la barbarie des guerres impérialistes entraînant une exacerbation des oppressions et des inégalités de genre. Nous construisons des actions unitaires et de solidarité envers les femmes et les minorités de genre confrontées aux privations et aux abus de la guerre, en Palestine, en Ukraine, au Soudan, au Congo et dans le monde entier.
Les femmes refusent d'être réduites au rôle de victimes collatérales de la guerre ou de cibles désignées. Nous revendiquons la place des femmes dans les prises de décision dans le cadre des conflits mondiaux. Nous réaffirmons l'importance d'un mouvement des femmes international et autonome qui s'oppose à l'ordre social capitaliste, impérialiste et patriarcal.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pourquoi le 25 novembre et le 8 mars sont-ils les deux faces d’une même médaille ?

Cette note a été rédigée par le groupe anti-sexisme d'Attac, avec la précieuse relecture de Youlie Yamamoto et Lou Chesné, autrices du Manifeste des Rosies (2024).
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/07/violences-sexistes-et-sexuelles-violences-sociales/
En ce début d'année 2024, le président Emmanuel Macron a par deux fois réaffirmé son soutien à l'ordre patriarcal. Alors qu'il prétendait en 2017 faire de l'égalité de genre la « grande cause du quinquennat », ses actions n'ont cessé de démentir ses déclarations. C'est qu'on ne lutte pas contre le patriarcat et la domination masculine par la promotion de quelques femmes dans un système socio-économique globalement inchangé. Lorsqu'on prend en compte sérieusement l'intersectionnalité, on sait qu'on ne pourra transformer profondément les rapports de pouvoir entre les genres qu'en transformant tout aussi profondément les autres rapports de pouvoir, de domination et d'exploitation : capitalisme, suprématie blanche, validisme, hétéropatriarcat…
Dans cette note, nous invitons à un double déplacement de perspective. Tout d'abord, nous suggérons d'envisager les violences faites aux femmes non seulement comme la conséquence de leur domination par les hommes mais aussi des autres oppressions qu'elles subissent. Il s'agit de prendre au sérieux l'idée selon laquelle chaque expérience sociale est spécifique en fonction des rapports sociaux à l'intersection desquels elle se situe. Toutes les femmes sont ainsi exposées à des violences sexistes et sexuelles mais pas de la même manière en fonction de la place qu'elles occupent dans l'espace social. Ensuite, nous proposons de faire des violences faites aux femmes un levier pour penser et combattre les autres violences sociales, comme nous invite à le faire le slogan suivant : « Le féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel ».
En somme, il s'agit de construire des ponts entre le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, car c'est bien parce que les femmes sont dominées à la fois dans l'ordre du genre et dans l'ordre économique que des violences s'exercent sur elles. Les violences sont toujours l'une des expressions du pouvoir (sauf quand il s'agit de la retourner contre l'oppresseur, consciemment ou inconsciemment). Exercer des violences psychologiques ou physiques sur une personne est une manière de la rappeler à l'ordre social, de lui rappeler quelle est sa place et provoquer de la sidération pour s'assurer qu'elle n'aura aucune prétention ni velléité à quitter cette place, ce qui subvertirait l'ordre social et bousculerait les rapports sociaux qui garantissent à certains de jouir de leurs privilèges.
Lire la note complète sur le site d'ATTAC
https://france.attac.org/se-mobiliser/le-8-mars-toutes-et-tous-en-greve/article/violences-sexistes-et-sexuelles-violences-sociales
Et voici la conclusion de ce texte d'Attac
Conclusion
Ces différents éléments dessinent un tableau éclairant des violences de genre et des violences faites aux femmes. Les vio-lences faites aux femmes sont une manière pour les hommes de perpétuer l'oppression patriarcale. Elles sont l'expression d'une contrainte et traduisent sur le corps des femmes toute la violence symbolique qui leur est par ailleurs faite. Dans la sphère professionnelle, la domination masculine s'appuie sur les autres rapports de pouvoir qui font des salarié·es les subor- donné·es de leurs employeurs et de leurs responsables hiérar- chiques et de la relation de service un support d'abus. Tout ceci est décuplé par la place subalterne que les femmes occupent dans le monde du travail du fait des postes qui leur sont ac-cessibles et des secteurs vers lesquels elles s'orientent. Les vio-lences de genre sanctionnent quant à elles la subversion des rapports de genre et visent à remettre les femmes à leur place.
C'est d'autant plus visible lorsqu'elles visent les femmes dans les espaces publics. Aussi, si le 25 novembre a pour vocation de lutter contre les violences faites aux femmes et les violences de genre, le 8 mars ne peut en faire abstraction puisqu'il s'at- taque à la racine du problème. Pour que cessent les violences, il faut délégitimer le pouvoir de ceux qui en usent.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

France : Pourquoi des Assises de la santé et la sécurité des travailleur⋅ses ?

Si les médias se saisissent de plus en plus de la question des dégâts du travail, force est de constater que la situation reste catastrophique. On recense pour chaque jour travaillé plus de 3 000 accidents du travail et maladies professionnelles déclarés en 2022. Le bilan que vient de publier la Caisse Accidents du travail .
– Maladies professionnelles est sans appel : 1 227 salarié⋅es sont décédées en 2022 du travail dont 738 par accident du travail, 286 durant leur trajet et 203 à la suite de maladies professionnelles. A cela se rajoutent les accidents et maladies concernant les agents de la fonction publique dont les chiffres sont toujours occultés. Ces milliers de morts au travail sont en grande partie le résultat de politiques d'entreprise sacrifiant la santé et la sécurité pour réduire les coûts !
Le bilan du Ministre du travail sortant est accablant : le nombre de morts est identique à celui de 2019. A part une vague campagne médiatique, rien n'a été fait, ne serait-ce que vis-à-vis du travail par forte chaleur !
Sur le terrain, nous sommes nombreux⋅ses à agir quotidiennement dans des conditions difficiles. Nous avons besoin de partager ces expériences, d'unifier nos luttes tant au niveau local que national pour créer un véritable rapport de force sur ces questions. Les employeurs responsables doivent être sévèrement sanctionnés personnellement au pénal pour les infractions commises et au civil dans l'objectif d'une réparation intégrale des préjudices pour les victimes. Il faut les obliger à prendre des mesures de prévention. Des instances spécifiques de protection de la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs (CHSCT renforcés) doivent être recréées partout et dotées de pouvoirs d'intervention. Il faut partout reconstruire les collectifs de travail et le rapport de force pour obtenir des mesures de prévention.
Pourquoi des Assises de la santé et la sécurité des travailleur⋅ses ?
• Pour mettre en commun ces combats divers et les rendre visibles,
• Pour aider chacun·e à s'investir davantage en s'appuyant sur les connaissances et expériences des autres, mettre en œuvre un réseau de soutien permanent,
• Pour faire converger ces luttes afin que les pouvoirs publics en fassent un sujet prioritaire.
Les 13 et 14 mars, participez aux Assises de la santé et la sécurité des travailleurs·ses !
Je m'inscris :https://www.billetweb.fr/assises-de-la-sante-et-securite-des-travailleurs-ses.
La présence aux assisses peut se faire dans le cadre de journées de formation syndicale. Contactez votre organisation qui peut aussi participer aux frais de transport et d'hébergement.
Les organisations signataires suivantes vous invitent à participer aux Assises de la Santé au Travail, premier rendez-vous d'une rencontre annuelle, et aux mobilisations qui se tiendront autour du 28 avril, journée mondiale de la santé et la sécurité au travail : CGT, FSU, Solidaires, Andeva, ASD-Pro, Association des experts intervenant en santé au travail, ATTAC, Ateliers Travail et Démocratie, Cordistes en colère, réseau féministe « Ruptures », Association-Santé-Médecine-Travail.
Pour tout contact : mobilisation28avril@gmail.com. Site : http://assises-sante-travail.ouvaton.org/
Dès maintenant, préparons les Assises de mars !
Appel à témoignages
Lors des Assises, nous souhaitons mettre en commun nos expériences, dans leurs succès et leurs échecs, pour apprendre ensemble à reconstruire du rapport de forces et mieux défendre la santé de nos collègues et l'environnement. Nos réflexions, notre élaboration commune sont d'autant plus riches qu'elles se nourrissent de récits concrets, d'expériences vécues qui parlent à chacun⋅e d'entre nous.
Vous avez sûrement mené des actions, enquêtes et mobilisations collectives pour : faire reconnaître un accident ou une maladie professionnelle, résister à une dégradation des conditions de travail, soutenir une victime d'agissements sexistes, inventer des manières de travailler autrement…
Comment résister aux ordonnances Macron, et garder le lien avec les problématiques du terrain malgré la suppression des délégué⋅es du personnel et CHSCT ? Comment utiliser au mieux nos droits pour résister et agir ?
Comment partir des souffrances mais aussi des aspirations des salarié⋅es pour reconstruire de l'action collective ?
Comment surmonter les divisions statutaires, la sous-traitance des risques, l'éparpillement des collectifs ? Comment rendre visibles les atteintes à la santé et contraindre les employeurs à vraiment agir en prévention ? etc.
Partant de vos expériences, nous vous invitons à envoyer un texte, un tract, un enregistrement audio ou vidéo, et/ou à préparer une courte intervention orale : lors des ateliers qui se tiendront tout au long des Assises, vous aurez la possibilité de présenter ce témoignage.
Vous pouvez envoyer ces témoignages à l'adresse suivante
:mobilisation28avril@gmail.com.
Comment s'organisent les Assises ? Une salle de 450 places et quatre salles de réunion nous accueillent le mercredi de 9h à 19h et le jeudi de 9h à 17h à la Bourse du travail de Paris, 29 Bd du Temple. Une large place sera laissée à vos interventions.
Les débats seront organisés autour de quatre grandes thématiques avec des ateliers en commun(programme définitif à venir sur le site http://assises-sante-travail.ouvaton.org/)
• Thème 1 : Femmes, Santé, Travail : Violences sexistes et sexuelles au travail – milieu professionnel, syndical, associatif ; Cancers des femmes au travail ; Santé invisibilisée, travail invisibilisé, salariées invisibles ; Risques invisibilisés dans les métiers du soin, le syndicalisme, etc.
• Thème 2 : Accidents du travail – Maladies professionnelles : Quelle reconnaissance des troubles psychiques dus au travail ? Statuts multiples, sous-traitance : comment agir ? Jeunes, chair à canon du capitalisme ? Vers la réparation intégrale ? Comment agir dans les services et entreprises après la disparition des CHSCT ?
• Thème 3 : Santé au travail et environnement : De l'amiante au chlordécone, lutter contre une réglementation qui autorise les industriels à tuer les travailleur⋅ses ! ; Construire des mobilisations collectives entre travailleur⋅ses/ riverains, entre expositions professionnelles et environnementales ; Construire les collaborations entre les équipes syndicales, les institutions (Inspection du travail, CARSAT, médecine du travail…), les avocat⋅es, la recherche…
• Thème 4 : Organisation du travail, souffrance au travail : des situations individuelles à la mobilisation collective ; enquêter sur le travail pour le transformer.
Les Assises se concluront par une table-ronde réunissant Sophie Binet (CGT), Murielle Guilbert (Solidaires) et Benoît Teste (FSU)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Suisse. Après le OUI à la 13e rente amplifier la mobilisation sociale et syndicale pour les retraites et l’assurance maladie !

L'initiative pour une 13e rente AVS a été largement acceptée en votation populaire le 3 mars. Elle garantit une augmentation de toutes les rentes AVS de 8,3% dès 2026. C'est la première fois depuis les années 1970 que les rentes AVS sont augmentées pour toutes et tous [1]. C'est la première fois, depuis que le droit d'initiative existe, qu'une proposition des syndicats pour un renforcement d'une assurance sociale passe la rampe. Le OUI à la 13e rente le 3 mars 2024 constitue donc réellement un succès d'importance.
Un vote socialement motivé
« Une victoire des pauvres sur les riches » (Tages Anzeiger du 4 mars 2024), « Les aînés s'offrent une 13e rente contre l'avis des jeunes » (24 heures du 4 mars 2024). Voilà les titres de deux médias, appartenant tous deux au groupe Tamedia, basés sur le même sondage « sortie des urnes » et introduisant un article censé analyser les résultats de la votation. Un bel exemple de la manière dont l'opinion est construite… et tordue.
Sans vouloir abonder la littérature « journalistique » qui ne manquera pas d'interpréter et déformer ce vote, trois constats :
selon le sondage Tamedia, le Oui est très majoritaire dans les classes de revenus inférieures à 10 000 francs par mois et il reste majoritaire jusqu'à 13 000 francs, avec un gradient social régulier : plus le revenu est bas, plus la part de Oui est élevée. Pour repère : en 2015-2017 (dernières données disponibles de l'Enquête sur le revenu des ménages de l'Office fédéral de la statistique), le revenu brut moyen des ménages était de 9 349 francs par mois ; 60% des ménages avaient un revenu mensuel inférieur à 9 288 francs, 80% un revenu inférieur à 12 855 francs. Le OUI à la 13e rente est donc socialement ancré et il a convaincu non seulement parmi les salarié·e·s, les indépendants et les retraités avec des revenus très bas, mais également parmi les familles disposant de ce qu'il est convenu d'appeler des revenus « moyens » [2]. L'idée que seuls les « pauvres » auraient « vraiment » besoin d'un « coup de pouce » n'a pas passé.
L'opposition entre « classes d'âges » est construite et alimentée depuis des années par les milieux patronaux et les partis de droite : elle constitue le bras de levier dont ils usent pour diviser les salarié·e·s sur ce thème et imposer leurs choix. Cette argumentation rencontre un écho. Et elle se retrouve, à peine la votation passée, de nouveau au cœur des argumentaires revanchards de droite. Il est probable que sa résonance médiatique est sans rapport avec son écho réel. On ne prend pas grand risque en supposant que le taux de participation aux débats politiques et aux votations, bas chez les jeunes, l'est encore davantage parmi celles et ceux faisant partie du salariat le plus exploité, et que cette différence n'est pas entièrement « corrigée » par les calages du sondage [3]. Il n'en demeure pas moins que la surreprésentation du non parmi les plus jeunes renvoie aussi à la difficulté, jusqu'à maintenant, du mouvement syndical et social à entrer en contact et en échanges avec ces couches, qui seront au cœur du salariat de demain. Un défi à relever.
Il ne faut pas se lasser de répéter qu'un tiers environ de la population active et 26% de la population résidante est de nationalité étrangère, privée de droit de vote. Ces hommes et ces femmes vivent ici, travaillent ici, contribuent à financer les assurances sociales comme l'AVS et sont directement concernés par les prestations qu'ils garantissent. Cela devrait relever de l'évidence qu'ils et elles ont aussi le droit de se prononcer sur ces questions. Il ne fait pas de doute que le OUI en serait encore plus massif. Le combat démocratique pour la reconnaissance des droits de citoyenneté à toutes les personnes résidant durablement dans le pays reste crucial. Il est important – et concret socialement – pour combattre le climat xénophobe systématiquement entretenu par l'UDC, sous l'œil souvent fort bienveillant du reste de la droite.
L'émergence d'une dynamique
Plus qu'un bilan « sociologique », un bilan politique a son intérêt. La revendication d'une 13e rente AVS et la mobilisation croissante en sa faveur trouvent leurs origines au milieu des années 2010, avec le projet de réforme des retraites PV2020 et les positionnements opposés qu'il a suscités au sein du mouvement syndical et de la gauche. La dynamique qui s'est déployée est digne d'intérêt.
Le paquet PV2020, cuisiné sous la houlette du chef Alain Berset, alors conseiller fédéral « socialiste », prévoyait, pour faire simple : une hausse de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, une baisse du taux de conversion dans le 2e pilier réduisant ainsi les rentes versées par les caisses de pension et, prétendument pour « compenser » cela, une augmentation de 70 francs par mois des rentes AVS versées aux seuls nouveaux retraités.
La majorité du mouvement syndical, de même que le PS et les Verts, soutinrent ce projet avec l'argument, grand classique de la politique helvétique, que c'était le « meilleur compromis possible ». Emportée par cette orientation et pour se justifier, cette majorité se retrouva implacablement amenée à reprendre à son compte de larges pans de l'argumentaire bourgeois et du Conseil fédéral sur le vieillissement de la population, les finances de l'AVS courant soi-disant à leur perte, etc.
La résistance à ce positionnement, emmenée en particulier par des syndicalistes féministes, fit aboutir le référendum, a contré cet argumentaire trompeur et a contribué de manière décisive au refus du paquet lors de la votation populaire en 2017. L'impact de ce combat minoritaire mais plus que justifié, par la solidité de son argumentaire et l'ampleur de l'écho social rencontré, combiné avec la défaite du projet en votation, a ouvert l'espace pour rediscuter et redéfinir les positions syndicales sur la question des retraites.
Il en a résulté la deuxième bataille contre l'élévation de l'âge de la retraite des femmes, réunissant l'ensemble du mouvement syndical cette fois mais malheureusement perdue de peu en 2022, la proposition de revaloriser les retraites avec une 13e rente, et le refus de cautionner à n'importe quel prix la baisse du taux de conversion du 2e pilier.
Tout aussi important, ce repositionnement et l'intransigeance de classe des milieux bourgeois ont conduit à remettre en valeur les fondements de l'argumentaire en faveur d'une AVS renforcée : son puissant mécanisme de solidarité, sa solidité grâce au mécanisme de la répartition, sa place centrale dans les revenus des personnes retraitées.
Cette dynamique, où se sont succédé et combinées des batailles, minoritaires s'il le fallait, pour la défense des fondements d'une retraite sociale, unitaires chaque fois que cela est possible, a joué un rôle clé pour rendre possible la victoire sur la 13e rente. L'enjeu est désormais de construire son prolongement.
Transformer l'essai
Deux enjeux majeurs pour l'avenir des assurances sociales se profilent ces prochains mois :
Cet automne, la réforme du 2e pilier, combattue par les syndicats et les partis de gauche, sera probablement soumise au vote. Elle impose la baisse du taux de conversion, qui détermine la rente obtenue à partir du capital accumulé dans la partie obligatoire du 2e pilier. Le recul de ce taux de 6,8% à 6% correspond à une diminution de plus de 12%, qui s'ajoute à l'érosion constante des rentes du 2e pilier depuis deux décennies. Elle propose également d'augmenter fortement les cotisations des très bas revenus, avec l'argument de garantir ainsi des rentes meilleures aux salarié·e·s, des femmes travaillant à temps partiel en premier lieu, qui n'ont (presque) pas de deuxième pilier pour le moment. En réalité, l'amélioration ainsi obtenue sera extrêmement réduite et elle se paiera au prix d'une forte baisse du salaire disponible pour les personnes concernées.
L'enjeu de cette votation est crucial. Un OUI équivaudrait à consolider et étendre encore le système du 2e pilier, dont les rentes ne cessent, proportionnellement, de baisser, qui est profondément inégalitaire et très rentable pour les assurances et les banques impliquées dans sa gestion, et qui sert de rempart contre l'extension de l'AVS comme assurance solidaire garantissant à toutes et à tous des retraites suffisantes.
Un NON créerait au contraire des conditions plus favorables pour poser l'exigence d'un renforcement conséquent de l'AVS et un redimensionnement progressif du 2e pilier.
En juin 2024 aura lieu la votation sur l'initiative du Parti socialiste voulant plafonner à 10% du revenu disponible les montants que les ménages doivent consacrer au paiement de leurs cotisations à l'assurance maladie, le reste étant financé par la Confédération ou les cantons. La proposition est modeste : elle n'aborde pas la question d'une caisse unique publique, ni celle d'un financement sur le modèle de l'AVS. Pour mémoire, les cotisations versées par les ménages à l'assurance maladie en 2021 (25,4 milliards de francs) correspondent à 6,3% de cotisations salariales de type AVS, c'est-à-dire 3,15% déduits du salaire et 3,15% versés « directement » par l'employeur. Malgré cela, un plafond de 10% du revenu disponible améliorerait la situation financière d'une partie de la population avec des bas et moyens revenus. Une victoire permettrait aussi de relancer la question de changements plus profonds de l'assurance maladie et de mettre en lumière le combat initié par le Syndicat des services publics (SSP) contre la réforme EFAS, qui veut donner tout le contrôle du financement du système de santé aux assurances maladie.
Une des forces de la mobilisation pour la 13e rente est qu'elle a combiné une campagne syndicale dynamique, qui a rencontré un écho chez un grand nombre de personnes ayant répondu en contribuant activement, à leur échelle, à soutenir la 13e rente, et des mobilisations militantes diverses, popularisant de manière argumentée la défense de cette revendication et, plus généralement, du mécanisme social au cœur de l'AVS. La poursuite et l'amplification de cette dynamique seront déterminantes pour transformer l'essai du 3 mars lors de ces deux prochaines votations.
La poursuite de cette mobilisation sera aussi nécessaire face à un camp bourgeois qui n'a pas encore renoncé au sujet de la 13e rente. « Une AVS plus élevée à coup sûr dès 2026 – ou finalement non ? », titre la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) du 5 mars 2024. Elle s'interroge avec intérêt sur la possibilité que la loi d'application de l'article constitutionnel accepté en votation puisse contenir des « mesures impopulaires, comme une augmentation des impôts, des cotisations ou de l'âge de la retraite ». « Il va de soi, poursuit-elle réjouie, qu'une telle réforme pourrait échouer en votation ». Le respect de la « volonté populaire », lorsqu'elle contredit les intérêts des dominants, n'a jamais étouffé la droite et le patronat. On vient encore de le voir avec le fiasco de la loi d'application de l'initiative « Jeunes sans tabac ». Le combat sur ce terrain est donc loin d'être terminé. Sans même parler des projets de suppression de la rente de veuve et d'orphelin portés par le Conseil fédéral et la droite parlementaire…
Prendre la mesure des affrontements à venir
Le 2 mars, la veille de la votation sur la 13e rente donc, la NZZ encore elle, quotidien qui se pense comme l'orienteur de larges secteurs bourgeois, titrait en une, sur toute la largeur de la page : « Plus de sécurité, moins d'Etat social ». L'argument est simple et direct. La guerre en Ukraine et le nouveau contexte géostratégique « obligent » à un effort massif de réarmement. Pour le financer, il faut réduire les dépenses sociales. L'autre option, qui serait une augmentation durable et très progressiste des impôts (entre autres sur la fortune), est « une alternative plus mauvaise ».
Cette perspective, combinée avec le mécanisme du frein à l'endettement qui corsète la politique budgétaire fédérale, annonce un affrontement de classe, avec son expression politique, au sujet des priorités d'allocation des ressources et de distribution des revenus dans les années à venir. Et aussi, par ailleurs, une pression certaine sur les droits démocratiques, à l'image des restrictions au droit de manifestation adoptées dans le canton de Zurich. On peut faire confiance à la conseillère fédérale responsable des Finances, la radicale Karin Keller-Sutter, pour porter avec brutalité cette perspective de « moins d'Etat social ».
Le frein à l'endettement et la baisse de fait des contributions fiscales des entreprises et des personnes les plus riches aux budgets des services publics comme des assurances sociales ne sont pas la résultante de « lois économiques » immuables. Ils concrétisent les intérêts bourgeois dans leur lutte constante pour s'approprier une part accrue des richesses produites par le travail. Et ce sont les mêmes milieux, qui ont fait durant des décennies d'excellentes affaires avec les oligarques soutenant le régime de Poutine – qui traînent les pieds depuis le début de la guerre d'invasion de l'Ukraine dans la mise en œuvre de sanctions qui léseraient leurs affaires ainsi que leur liberté de faire des affaires – qui voudraient aujourd'hui que la population sacrifie les assurances sociales, comme l'AVS, à une course aux armements débridée… et n'augurant rien de bon. Qu'on le veuille ou non, ces combats aussi feront partie de la bataille engagée autour de l'avenir de l'AVS et des assurances sociales en Suisse.
[1] Les rentes des femmes ont considérablement augmenté avec l'introduction du bonus éducatif dans le cadre de la 10e révision de l'AVS entrée en vigueur en 1997, mais avec l'élévation de leur âge de la retraite de deux ans.
[2] De manière réaliste, avec une formule marquée par la victoire du OUI, le correspondant parlementaire du quotidien La Liberté écrivait le 4 mars : « C'est un pays qui se redécouvre un vote de classes avec, ici, la combinaison gagnante de l'électorat populaire et de la classe moyenne. »
[3] Il faut le flair populaire d'un ancien gendarme, positionné à droite, Roger Golay du MCG/GE, pour souligner deux données d'évidence (24 heures, 5 mars 2024) : « Quand on n'a pas encore 50 ans, la retraite ça paraît lointain. Et je pense que cette génération s'est laissé entraîner dans la propagande de la droite libérale qui fait de l'alarmisme sur les finances de l'AVS. »
Benoit Blanc, 6 mars 2024
Suiza : ampliar la movilización social y sindical por las pensiones y el seguro de enfermedad
https://vientosur.info/suiza-ampliar-la-movilizacion-social-y-sindical-por-las-pensiones-y-el-seguro-de-enfermedad/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












