Derniers articles
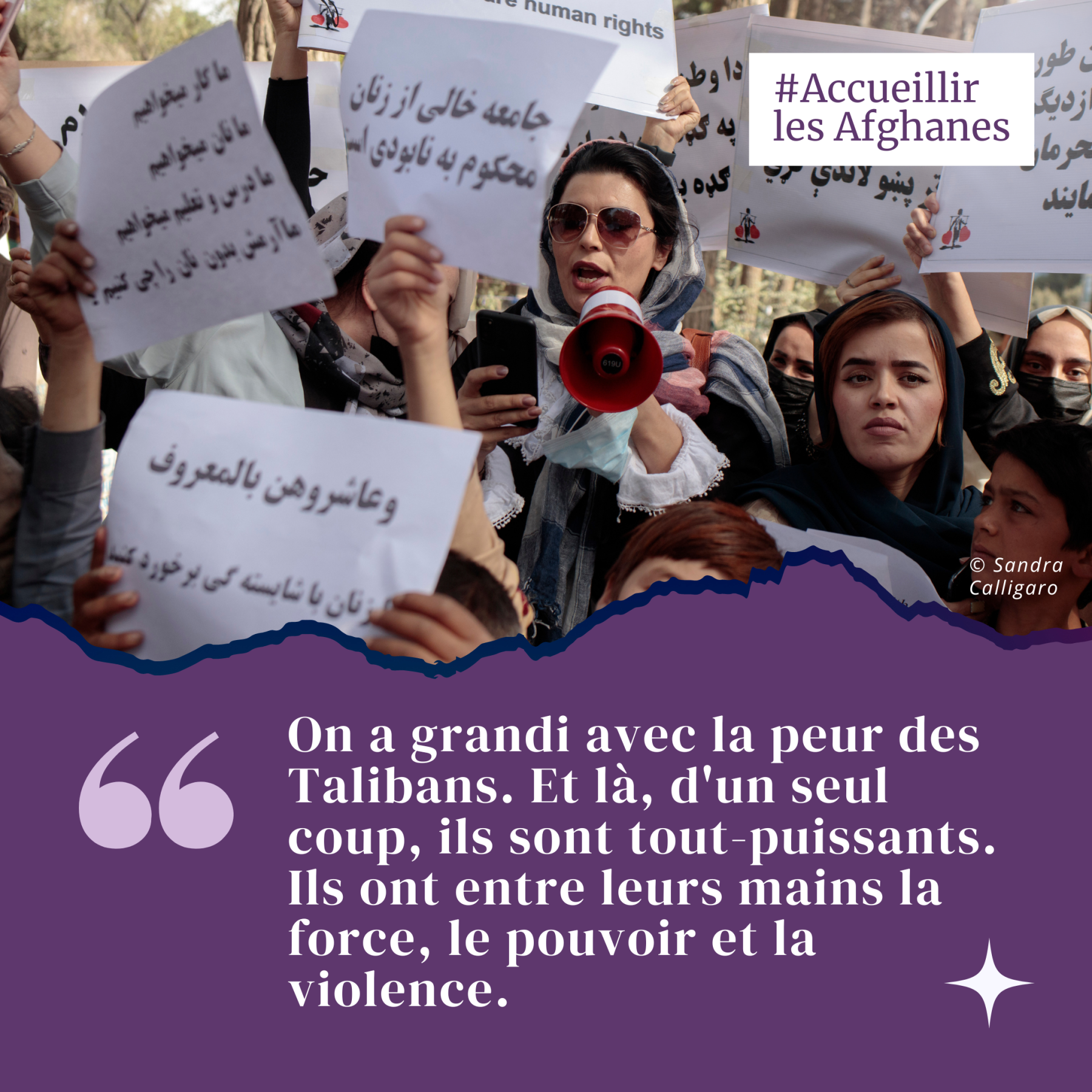
Moyen-Orient : Comment réagir à l’apartheid de genre ?
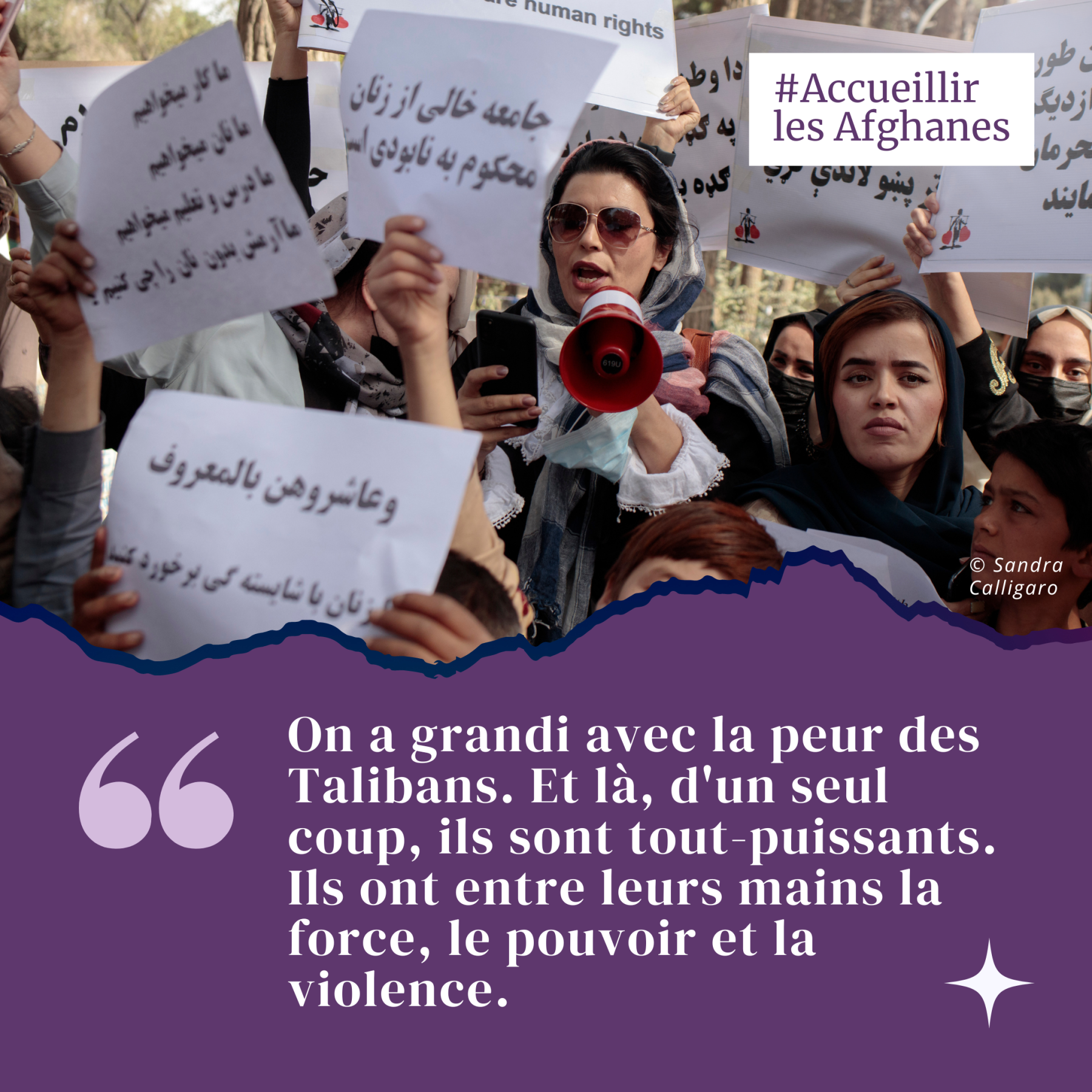
Il ne semble pas y avoir actuellement de réponse mondiale cohérente à l'Apartheid de genre grandissant que subissent les Afghanes et Iraniennes, malgré une condamnation de l'Organisation des Nations (ONU).
Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023 a rédigé en décembre dernier un appel à ONU. Incarcérée dans la prison d'Evin, à Téhéran, elle demandait au secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et aux représentants de ses États membres de criminaliser l'apartheid de genre. Le texte intitulé « L'apartheid de genre est un crime contre l'humanité » rendu public le 25 janvier a été publié en français dans des médias internationaux en mars.
Elle y donnait une vingtaine d'exemples des sévices que vivaient les femmes dans ce pays. En Iran, une femme ne peut obtenir un passeport ni voyager sans l'autorisation de son père ou son époux. Elles doivent être deux pour égaler le témoignage d'un homme en cours, et la vie d'un homme vaut le double de celle d'une femme.
La journaliste à France 2, Dorothée Olliéric, a affirmé en mars que les Afghanes subissaient aussi un apartheid de genre après s'être rendu une vingtaine de fois dans ce pays. Quelques mois plus tard, en juin, une jeune Afghane affirmait anonymement devant le Conseil des droits de l'homme à l'ONU que les femmes y étaient considérées comme des esclaves. Fin 2022, le ministère de la Propagation de la vertu et de la Prévention du vice a interdit aux Afghanes l'accès aux parcs et aux salles de sport. L'Afghanistan est le seul pays au monde où l'éducation des filles a été interdite après l'école primaire.
C'est cependant la promulgation en fin août d'une loi, de 87 pages en 35 articles pour « promouvoir la vertu et prévenir le vice », interdisant les relations amicales avec les non-musulmans, qui a mis le feu aux poudres. L'essentiel des restrictions de cette loi visait les femmes qui doivent maintenant être accompagnées d'un mâle de leur famille pour se déplacer. La ségrégation entre les sexes est exigée dans la plupart des lieux publics. La voix des femmes ne doit plus être entendue hors de leur domicile.
Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a trouvé répugnant cet apartheid de genre. Selon lui, on ne parle plus de rigorisme, mais d'une persécution systématique des femmes. Le rapporteur spécial pour l'Afghanistan du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Richard Bennett, affirme que la situation des femmes et des jeunes filles dans ce pays « était l'une des pires au monde ».
Réponses des talibans
Le chef suprême de l'Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, ne voit naturellement pas les choses de cet œil. Il affirmait en juin 2023 à l'occasion de l'Aïd al-Adha, que les femmes ont été « sauvées de l'oppression » par les talibans, que leur statut d'êtres humains libres et dignes avait été rétabli et que des mesures avaient été prises pour assurer une vie confortable et prospère aux femmes conformément à la charia. « Toutes les institutions ont été obligées d'aider les femmes à faire valoir leurs droits en matière de mariage, d'héritage et d'autres droits », commente le gouvernement afghan.
Les autorités d'Afghanistan ont aussi dénoncé en fin août l'arrogance des Occidentaux qui ont condamné cette nouvelle loi. Elle est « fermement ancrée dans les enseignements islamiques », affirme dans un communiqué le porte-parole du gouvernement, afghan Zabihullah Moujahid. « Rejeter ces lois sans chercher à les comprendre est, selon nous, une expression d'arrogance », dit-il, soulignant que le fait pour un musulman de critiquer cette loi « pouvait même conduire au déclin de sa foi » et que l'oppression et la force ne seront pas utilisées lors de l'application de ces règles, ce qui devrait être fait avec ménagement, en faisant appel à la compréhension des gens, et en les guidant.
Réactions internationales
La réaction mondiale a été importante. Pas de « réintégration » de l'Afghanistan sans évolution sur les droits des femmes, insiste l'ONU. Pour l'UE, la reconnaissance du régime des taliban par les Européens ne pourra se faire que si Kaboul respecte pleinement ses obligations internationales et envers le peuple d'Afghanistan ». Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a affirmé à la mi-août que toute amélioration des relations avec les talibans est tributaire des droits des femmes. Actuellement, aucun pays n'a reconnu le gouvernement taliban.
La réaction négative à l'Apartheid de genre vient de partout. Le CIO a contourné le gouvernement taliban lors des Jeux olympiques. En juin, il a annoncé qu'il avait pris des dispositions pour qu'une équipe spéciale de six athlètes représentant l'Afghanistan, à parité entre les hommes et les femmes, se rende aux Jeux olympiques de Paris. Ses membres ont été sélectionnés par le Comité international olympique (CIO) en consultation avec le Comité olympique afghan.
Richard Bennett a demandé en juin aux États membres de l'ONU d'examiner si l'apartheid de genre mis en place par les talibans à l'encontre des femmes pouvait constituer un crime international, tel que le crime contre l'humanité. Cette importante violation des droits humains ne serait pas reconnue par le statut de Rome de la Cour pénale internationale comme un crime international. Il demande donc aux États d'étudier cette question.
Un collectif d'associations et d'ONG demandait aussi le 10 septembre, deux ans après la mort le 16 septembre 2022 de Mahsa Amini, assassinée par la police des mœurs pour un voile mal porté, et à l'occasion du deuxième anniversaire du mouvement « Femme, vie, liberté », que la France se donner les moyens de condamner l'Iran. La République islamique s'attaque ces dernières semaines aux femmes et à la société civile, prononçant à la chaine des condamnations à mort. Il y en aurait eu 29 pour le 7 août. Sont entre autres visées la militante féministe Varisheh Moradi, la syndicaliste Sharifeh Mohammadi et la militante des droits humains kurde, Pakhshan Azizi.
Le collectif demande au gouvernement français de mettre en œuvre tous les instruments diplomatiques à sa disposition pour que l'Iran ratifie les conventions internationales abolissant la peine de mort. Il voudrait que la France subordonne au respect des droits humains la poursuite des relations diplomatiques avec l'Iran, qu'elle travaille aussi au plan international pour la reconnaissance et la criminalisation de l'apartheid de genre et que soit facilitée l'obtention des visas humanitaires pour les Iraniens qui trouvent refuge en France. Accorder une protection spéciale aux Afghans qui le demandent est mise de l'avant au niveau mondial. En désespoir de cause, couper l'aide internationale fait aussi partie des possibilités. Cela viendrait cependant avec des risques pour la population afghane, vivant à 80 % sous le seuil de pauvreté.
Michel Gourd
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Génocide sioniste à Gaza : Netanyahou bloque tout accord

Pour justifier leur soutien inconditionnel à Israël et leurs critiques adressées à la gauche, les dirigeants occidentaux n'ont de cesse d'évoquer les otages israélien-nes – dissimulant au passage la question des milliers de Palestinien-nes enfermé-es dans les prisons israéliennes depuis tant d'années et dans des conditions terrifiantes, sans droits ni procès. Mais qui est responsable de l'échec d'un retour des otages israéliens sains et saufs, par le refus de tout accord incluant un cessez-le-feu durable et un retrait des trouples israéliennes de Gaza ? Nul autre que le chef de l'État israélien : Benjamin Netanyahou.
Tiré du site de la revue Contretemps. Cet article a d'abord été publié en anglais par Jacobin. Traduction par Contretemps.
Avec la mort de six otages israéliens, dont un citoyen américain, et les manifestations israéliennes massives contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui font rage dans le pays, le débat public sur la désignation des coupables est engagé. Interrogé lundi sur la question de savoir si M. Netanyahou en faisait assez pour obtenir la libération des otages encore détenus par le Hamas, le président Joe Biden a répondu sèchement : « Non ».
Piqué au vif, Netanyahou a répliqué par sa propre déclaration publique, en lisant des déclarations récentes de responsables américains qui ont félicité Israël pour son travail constructif en vue d'un accord et qui ont mis à la charge du Hamas l'obligation d'accepter ses conditions, en insistant sur le fait que le Hamas était le véritable obstacle à un cessez-le-feu et à un accord sur la libération des otages. Qui faut-il croire ?
L'une des réponses consiste à écouter les sources haut placées dans le gouvernement ou impliquées dans les pourparlers avec des pays médiateurs comme l'Égypte, les États-Unis, voire Israël lui-même. Pendant des mois, ces voix n'ont cessé de répéter aux médias – souvent des organes de presse israéliens et des journaux de l'establishment américain extrêmement favorables à Israël – que le principal obstacle à un accord de cessez-le-feu est Netanyahou lui-même, et qu'il n'a cessé de mettre des bâtons dans les roues dans les pourparlers pour saboter les négociations afin de se maintenir au pouvoir.
« Tout faire pour empêcher un accord »
Ces derniers jours, la découverte samedi dernier des corps des six otages israéliens a déclenché la colère des Israéliens qui reprochent à M. Netanyahu de ne pas les avoir ramenés chez eux.
Alors que les représentants des pays médiateurs se sont de nouveau téléphonés pour tenter de parvenir à un accord, CNN a rapporté qu'une « source familière avec les discussions » a déclaré à la chaîne que M. Netanyahou avait « tout torpillé en un seul discours », dans lequel il a réitéré sa demande d'occupation permanente par Israël du corridor de Philadelphie, une mince bande de terre le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Cette demande est devenue le principal point d'achoppement des pourparlers au cours du dernier mois et demi. Curieusement, la citation a fait la une des principaux médias israéliens, tels que le Times of Israel, Haaretz et Yedioth Ahronoth (mieux connu sous le nom de Ynet dans son édition en ligne), mais a été enterrée au vingt-quatrième paragraphe de l'article original de CNN dont elle est tirée.
Le même jour, Ynet a publié son propre rapport sur les changements que Netanyahou a personnellement apportés à une proposition de cessez-le-feu antérieure qui, comme il l'a souligné, avait « reçu l'accord du Hamas sur la plupart des conditions ». La nouvelle proposition de M. Netanyahou, qui avait été présentée aux médiateurs le 27 juillet, comportait « des changements et des ajouts spectaculaires » qui « ont complètement changé le cours des négociations », selon le journal.
Ces propos s'inscrivent dans le prolongement d'un rapport distinct publié par le journal deux jours plus tôt. Il contenait un verdict accablant sur cette proposition modifiée d'accord de la part d'une personne décrite par Ynet comme « un haut responsable de la sécurité qui a été cité ici à de nombreuses reprises, et qui avait si sombrement et tragiquement raison dans toutes ses prédictions » :
- « L'histoire jugera un jour ce document très sévèrement… En haut du document, il est écrit qu'il s'agit d'un « document de clarification », mais à mon avis, le surnom le plus approprié pour ce document est « document sanglant » – parce que ses pages sont tachées du sang des six personnes enlevées qui ont été assassinées dans un tunnel à Rafah. S'il n'y avait pas eu le sabotage délibéré contenu dans ce document pour empêcher un accord, il y a de fortes chances qu'elles aient été libérées il y a déjà un mois et qu'elles soient ici avec nous en vie ».
La source poursuivait en qualifiant le document de « tentative de [Netanyahou] de torpiller le moment positif des négociations » et en affirmant qu'il avait été « créé spécifiquement pour empêcher » un accord de libération d'otages – une accusation, selon le journal, qui a été « renforcée de manière significative dans les conversations avec d'autres responsables liés aux négociations » et dans d'autres documents de négociation.
Sur la base de ces sources, Ynet a décrit la demande de Netanyahou sur le couloir de Philadelphie comme étant à l'origine de l'impasse actuelle des négociations, et a rapporté que les négociateurs israéliens sont extrêmement mécontents du document, « qui, à leur avis, détruit toute chance d'un accord ».
Quelques jours plus tôt, lorsque les corps des otages ont été découverts, le même haut responsable de la sécurité israélienne (d'après la description identique utilisée par le journal) a déclaré à Ynet que Netanyahu et d'autres négociaient délibérément de manière à s'assurer que la guerre ne se termine pas. Si le Hamas est évidemment le plus directement responsable de la mort des otages, a déclaré le haut fonctionnaire au journal, « en vérité ce qui conduit à la mort de nombreuses personnes enlevées . . . [c'est] le refus israélien, en pratique, il n'y a pas d'autre façon de l'appeler, de signer un accord qui ramènerait tous les survivants chez eux et mettrait fin à la guerre dans la bande de Gaza ».
L'ensemble de l'establishment militaire et sécuritaire israélien ne voyait aucun inconvénient à se retirer du corridor de Philadelphie, a déclaré la source au journal. Au lieu de cela, la source a déclaré que l'accord était entièrement entre les mains de Netanyahou, mais qu'il « ferait tout pour empêcher un accord ».
Avant cela, il y avait eu deux rapports distincts sur la réunion du cabinet de sécurité israélien du 29 août, l'un du Times of Israel, l'autre d'Axios, rédigé par le bien informé journaliste israélien Barak Ravid. Les deux rapports offraient un compte-rendu étonnamment détaillé de la réunion qui racontait la même histoire : une discussion animée entre Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui accusait Netanyahou d'avoir imposé la demande de Philadelphie à une armée qui ne pensait pas que c'était nécessaire, et qu'Israël devait choisir entre rester dans Philadelphie et récupérer les otages – une position du ministre qui sera mise en minorité par Netanyahou.
Le rapport du Times of Israel est particulièrement accablant. Par exemple, lorsque M. Gallant a demandé à M. Netanyahou ce qu'il dirait si le Hamas dans un ultimatum le sommait de choisir entre rester dans Philadelphie ou ramener les otages, le rapport notait : « M. Netanyahou a répondu que l'impératif de maintenir les [Forces de défense israéliennes] dans le corridor était d'une importance cruciale pour l'État ». En d'autres termes, comme l'indique le titre du journal, Netanyahu a explicitement indiqué qu'il « donnait la priorité à Philadelphie plutôt qu'aux otages ».
Les lecteurs attentifs qui parcourront les deux rapports ne trouveront pas le cabinet israélien en train de mentionner le Hamas, ni d'énumérer les obstacles qu'il a dressés sur la voie d'un accord – seulement une discussion sur la question de savoir si Israël doit accepter l'accord et ramener les siens chez eux, ou faire pression pour obtenir davantage de concessions de la part du groupe terroriste, cette dernière opinion l'ayant emporté.
Il n'y a tout simplement pas d'autre conclusion que l'on puisse tirer de la lecture des propos de hauts fonctionnaires contenus dans ces rapports récents : Netanyahou pourrait conclure un accord sur le retour des otages quand il le souhaite, mais fait tout ce qu'il peut pour éviter de le faire. Pourtant, la plupart de ces informations n'ont pas été rapportées dans les médias américains, et peu d'Américains consomment la presse israélienne.
« Netanyahou ne veut pas la paix »
Il serait erroné de penser que tout cela est récent. Nous pouvons revenir en arrière et voir des affirmations presque identiques de la part de sources de haut niveau dans des reportages datant de plusieurs mois également presque identiques. Prenons les travaux de cette « ancienne source de renseignement de haut niveau » qui fait partie de l'équipe de l'un des négociateurs israéliens, citée dans un rapport de Haaretz du 28 mars :
- « Il y a de plus en plus de signes que [Netanyahou] fait presque tout ce qui est possible pour repousser, retarder et ruiner les chances d'un accord de libération des otages en échange de terroristes ».
Ce rapport révélait les diverses actions entreprises par M. Netanyahou pour saper les négociations, notamment en évitant ou en retardant la convocation du cabinet de guerre, en faisant diverses déclarations publiques visant à entacher une discussion productive et en excluant les négociateurs de la participation aux pourparlers, sans compter sur le fait même que la position de M. Netanyahou s'opposait à celles des chefs militaires israéliens.
Voici ce que le New York Times rapportait le 5 mai d'une conversation entre un fonctionnaire israélien ayant requis l'anonymat et son journaliste à propos de l'insistance absurde de M. Netanyahou sur le fait que, dans le cadre de tout accord de cessez-le-feu, Israël aurait le droit de reprendre les tirs après une courte pause, ce que le journal avait alors qualifié de « principal obstacle aux pourparlers » :
- « Israël et le Hamas étaient plus proches d'un accord il y a quelques jours, mais les déclarations de M. Netanyahou sur Rafah ont contraint le Hamas à durcir ses exigences afin de s'assurer que les forces israéliennes n'entreraient pas dans la ville ».
Quant à l'ancien négociateur israélien Gershon Baskin, voilà ce qu'il déclarait un jour plus tard, lorsque M. Netanyahou a ordonné l'invasion de Rafah, dont le monde entier avait correctement prévenu qu'elle serait un désastre :
- « Il semble que Netanyahou tente de saboter l'accord avant même que le cabinet n'en reçoive les détails et ne le vote. L'opération militaire israélienne en cours (près de 23 heures, heure d'Israël) vise clairement à pousser le Hamas à revenir sur son accord de cessez-le-feu. Il semble que Netanyahou fasse une fois de plus passer ses propres intérêts politiques avant ceux du pays et des otages israéliens ».
Regardez ce que Biden lui-même disait le 4 juin lorsqu'on lui demandait si Netanyahou prolongeait la guerre pour ses propres raisons politiques – non pas dans une conversation privée qui a été divulguée par la suite, mais dans une interview de politique étrangère très médiatisée dans le magazine Time : « Il y a toutes les raisons de tirer cette conclusion ».
Regardez encore ce que divers responsables ont déclaré à propos des quatre exigences « non négociables » formulées par M. Netanyahou le 7 juillet, qui comprenaient notamment le refus de restituer ceux qu'Israël détenait comme prisonniers (une disposition qui faisait pourtant partie des versions précédentes de l'accord) et une clause qui permettrait à Israël de « reprendre le combat jusqu'à ce que ses objectifs de guerre soient atteints ».
Ces exigences ont été formulées juste au moment où les pourparlers devaient reprendre et juste après que le Hamas eut fait une concession majeure, à savoir qu'il accepterait un accord sans qu'Israël s'engage d'emblée à un « cessez-le-feu complet et permanent » au cours de la première phase de libération des otages, ce que même l'administration Biden avait qualifié d'« ajustement significatif » de la part du groupe.
Voici, par exemple, ce que rapportait le Times of Israel :
- « Un haut fonctionnaire de l'un des pays assurant la médiation entre Israël et le Hamas a également accusé M. Netanyahou d'essayer de saboter l'accord. . . . [déclarant] que la demande non négociable de reprise des combats après la première phase du cessez-le-feu et de l'accord de libération des otages rendue publique par le bureau de M. Netanyahu avait frappé à l'aspect le plus sensible des négociations en cours ».
Voici ce que rapportait Haaretz :
- « Une autre source a averti que les nouvelles exigences d'Israël devraient retarder l'achèvement des négociations, et qu'il n'était pas certain que le Hamas accède à ces nouvelles exigences. « Le Hamas a déjà accepté la dernière position présentée par Israël. Mais lors de la réunion de vendredi, Israël a présenté de nouveaux points qu'il demande au Hamas d'accepter », a déclaré une source au fait des détails ».
Voici comment une autre « source sécuritaire » décrivait la démarche de M. Netanyahou à Ynet :
- « Une conduite inappropriée qui nuira aux chances de retour des personnes enlevées chez elles. Il y a également une question de timing…Avec ce comportement, les personnes enlevées ne reviendront pas ».
Un responsable israélien de la sécurité, dont le nom n'a pas été révélé, s'était, lui exprimé à ce sujet sur la chaîne israélienne Channel 12 : « Netanyahou fait semblant de vouloir un accord mais s'efforce de le torpiller ».
Regardez également les diverses réactions à l'annonce faite par Netanyahou le 11 juillet, qui introduisait pour la première fois au cours des pourparlers l'idée qu'Israël devrait occuper de manière permanente le corridor Philadelphie dans tout accord final, qualifiée par de nombreux rapports israéliens de « durcissement » de la position d'Israël dans les pourparlers. Voilà ce que déclarait à Channel 12 une source proche des négociations :
- « Il s'agit d'une exigence qui empêchera la conclusion d'un accord. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'un obstacle qui rendra la poursuite [des pourparlers] plus difficile, et dans le pire des cas, elle vise à mettre des bâtons dans les roues des négociations et à éliminer la possibilité de parvenir à un accord…Le Premier ministre Netanyahu a ajouté des exigences qui s'écartent des accords conclus avec les médiateurs ».
Voilà ce que déclarait au Washington Post un « ancien haut fonctionnaire égyptien au fait des négociations » : « Netanyahou ne veut pas la paix. C'est tout. Il trouvera des excuses […] pour prolonger cette guerre jusqu'au 5 novembre [date de l'élection américaine] ».
Reuters en se basant sur « deux sources de sécurité égyptiennes » rapportait au même moment :
- « Selon certaines sources, la délégation israélienne approuvait plusieurs conditions en cours de discussion, mais revenait ensuite avec des amendements ou introduisait de nouvelles conditions qui risquaient de faire échouer les négociations. Ces mêmes sources ont déclaré que les médiateurs considéraient les « contradictions, les retards dans les réponses et l'introduction de nouvelles conditions contraires à ce qui avait été convenu précédemment » comme des signes que la partie israélienne considérait les pourparlers comme une formalité destinée à influencer l'opinion publique ».
Même le quotidien de droite Jerusalem Post abondait dans ce sens, rapportant que des sources anonymes lui avaient confié que « Netanyahou sabote activement la possibilité d'un accord sur les otages, afin d'éviter l'effondrement de son gouvernement », en introduisant la demande de corridor Philadelphie à la dernière minute.
Ces sources ont également « ridiculisé » ces nouvelles exigences « qui ne sont pas pertinentes du point de vue de la sécurité », estimant que le premier ministre était « confiant dans la réélection de [Donald] Trump et ressentait ainsi moins de pression » pour se conformer aux exigences de M. Biden. Elles ont également estimé que « l'énorme concession du Hamas aurait pu conduire à la conclusion de l'accord cette semaine ou la suivante, et qu'un grand nombre d'otages auraient de ce fait pu déjà rentrer chez eux ».
Ces propos ont été confirmés par un rapport publié plus tard, le 28 juillet, par le New York Times, qui a été informé par six responsables israéliens que :
- « M. Netanyahou était la principale raison du durcissement de la position d'Israël lors des négociations de Rome, et que les principaux responsables de la sécurité faisaient pression pour que le premier ministre fasse preuve d'une plus grande souplesse afin de parvenir à un accord. La marge de manœuvre de M. Netanyahou est limitée par les membres de sa coalition gouvernementale de droite ; certains d'entre eux s'opposent à une trêve qui permettrait au Hamas de survivre à la guerre et ont menacé de faire tomber le gouvernement si leurs souhaits n'étaient pas satisfaits ».
« Les obstacles viennent de Netanyahou »
Quelques jours plus tard, l'assassinat du négociateur qui se trouvait en face de lui, Ismail Haniyeh, un représentant plus modéré du Hamas, a probablement été la preuve la plus évidente du manque de sérieux de M. Netanyahou à l'égard des pourparlers.
Cet acte irréfléchi et totalement illégal a été largement dénoncé, y compris par des responsables de pays participant aux pourparlers. Le premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, s'est notamment interrogé à ce propos : « Comment la médiation peut-elle réussir lorsqu'une partie assassine le négociateur de l'autre côté ? ». Ainsi que le ministère égyptien des affaires étrangères, qui, dans un communiqué, a déclaré que :
- « La coïncidence de cette escalade régionale avec l'absence de progrès dans les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza accroît la complexité de la situation et indique l'absence de volonté politique israélienne de la calmer ».
Et même M. Biden lui-même. Selon un fonctionnaire américain dans Axios, le président américain s'est plaint auprès de Netanyahou qu'il ait procédé à l'assassinat alors qu'ils s'étaient entretenus une semaine plus tôt sur la possibilité de conclure un accord, et il lui a dit :
- « Nous sommes à un point d'inflexion : […] nous devons tout faire pour mettre fin à la guerre et parvenir à la stabilité régionale, même si l'accord n'est pas parfait. Le Hamas veut l'accord maintenant. Cela pourrait changer. »
Il n'est pas étonnant que « trois responsables de pays médiateurs » aient déclaré au Times of Israel, début août, que l'équipe de négociation israélienne avait perdu toute crédibilité. L'un des responsables, un diplomate, avait alors déclaré au journal :
- « Il est clair qu'il s'agit de tactiques dilatoires ; chaque fois que nous nous rapprochons d'un accord, d'autres attentats se produisent. Haniyeh était quelqu'un qui voulait un accord. Pour l'instant, les obstacles viennent de Netanyahou ».
Ce même diplomate déclarait également que « les négociateurs israéliens disaient une chose aux médiateurs dans la salle et que Netanyahou disait le contraire en public », ce qui retardait les pourparlers, tandis qu'un autre fonctionnaire affirmait que les négociateurs israéliens assuraient à plusieurs reprises aux médiateurs les conditions que le gouvernement israélien était prêt à accepter, pour ensuite revenir sur ces conditions après s'être entretenu avec Netanyahou. Un autre diplomate a révélé, lui, que Netanyahou avait rejeté une offre du Hamas faite quelques jours après le 7 octobre de libérer tous les otages civils en échange d'une pause d'une semaine dans les combats.
En raison de ce comportement, Channel 12 a rapporté que lorsque M. Netanyahou s'est disputé avec ses propres chefs de la sécurité, qui se sont demandé s'il voulait réellement conclure un accord et l'ont exhorté à accepter celui qui était sur la table, le premier ministre israélien leur a répondu en les traitant de « faibles » et leur intimant de faire pression sur le Hamas plutôt que sur lui-même. Cela a conduit les chefs de la sécurité à conclure que M. Netanyahou ne voulait pas d'un accord, selon Channel 12, une source anonyme ayant déclaré à la chaîne : « Il a renoncé aux otages ».
Des récits de ce type se sont poursuivis tout au long de la fin du mois d'août concernant la demande de M. Netanyahou à Philadelphie, jusqu'à la découverte, samedi dernier, des otages exécutés.
Un rapport de Haaretz du 20 août, par exemple, citait deux sources qui affirmaient que Netanyahou « sabotait une fois de plus les pourparlers » et « sapait constamment les négociations et retardait la conclusion d'un accord », rejetant même les propositions de l'establishment de la défense israélienne sur la manière de se retirer de Philadelphie. Un haut fonctionnaire américain voyageant avec le secrétaire d'État Antony Blinken s'est alors plaint « que des déclarations maximalistes comme celles-ci ne sont pas constructives pour faire passer la ligne d'arrivée à un accord de cessez-le-feu et qu'elles risquent certainement de compromettre la capacité » d'avancer dans les négociations.
La semaine dernière, le 28 août, « une source impliquée dans l'accord » a déclaré à Haaretz qu'« à moins d'une certaine flexibilité sur ces questions » – y compris l'insistance de Netanyahou sur une présence israélienne continue dans le corridor de Philadelphie – « il est peu probable que nous soyons en mesure d'obtenir la libération des otages ».
Cela s'est poursuivi jusqu'à hier, lorsque le Washington Post a rapporté que neuf actuels et anciens négociateurs des pays médiateurs étaient d'accord pour dire que la demande de Philadelphie de Netanyahou était le principal obstacle à un accord sur les otages. Un fonctionnaire israélien « se défoulant » dans le journal a ainsi déclaré :
- « Nous aurions pu les sauver. Le Hamas a commis le crime et doit être tenu pour responsable, mais mon gouvernement avait la responsabilité de faire tout ce qu'il fallait pour les sauver, et il a failli à ses devoirs envers eux et leurs familles. Nous leur devons des excuses ».
Absurdité meurtrière
Il ne s'agit pas d'un, de deux ou même de trois rapports. Il s'agit de plus de deux douzaines d'entre eux, au cours des six derniers mois, émanant de divers organes de l'establishment israélien et américain, qui disent tous la même chose : Netanyahou est le principal obstacle à un accord de cessez-le-feu. Il a systématiquement saboté toute perspective de paix et se soucie bien plus de maintenir sa coalition gouvernementale – et donc de s'accrocher au pouvoir politique – que de ramener les otages chez eux, persuadé qu'il peut simplement s'accrocher jusqu'à ce que les démocrates perdent face à Trump en novembre.
Il est difficile de dire ce qui est le plus absurde : qu'il subsiste un doute sur les raisons pour lesquelles un accord de cessez-le-feu à Gaza, que l'administration Biden appelle de ses vœux, ne peut être conclu, ou que l'administration Biden continue de soutenir et d'armer volontairement l'homme dont tout le monde sait qu'il est son principal saboteur.
*
Illustration : Wikimedia Commons.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les dynamiques de l’élection présidentielle étatsunienne

L'élection présidentielle américaine a été bouleversée cet été par une série d'événements dramatiques qui ont inversé les prévisions électorales des partis démocrate et républicain, tandis que des candidats alternatifs, dits third-party, de gauche tels que la candidate écosocialiste du Green Party USA, Jill Stein, et l'intellectuel radical Cornell West se battent pour accéder au scrutin dans de nombreux États.
Tiré de Inprecor
16 septembre 2024
Par Kay Mann
Kamala Harris et Tim Walz à la Desert Diamond Arena, à Glendale, en Arizona, le 9 août 2024. © Gage Skidmore –CC BY-SA 2.0
La prestation désastreuse de Biden lors du débat du 27 juin a soulevé des questions sur les capacités cognitives de Biden, âgé de 81 ans, et a conduit les dirigeants du Parti démocrate et les journalistes qui soutiennent ce dernier à réclamer de plus en plus fortement, et finalement avec succès, le retrait de Biden. Une tentative ratée d'assassinat contre Trump a été suivie d'une convention nationale républicaine bien orchestrée où la domination totale de l'ancien président sur le parti est apparue clairement. Puis Biden s'est retiré, faisant place à l'ascension rapide de la vice-présidente Kamala Harris en tant que candidate à la présidence au nom du Parti démocrate. Alors que selon les sondages Biden et Trump étaient tous deux impopulaires, la convention républicaine semblait avoir renforcé Trump, encourageant les Républicains dans leurs espoirs de pouvoir non seulement remporter la présidence, mais aussi d'accroître leur majorité au Sénat et même de remporter la majorité à la Chambre des représentants.
La dynamique Harris
Toutefois, lorsque Biden a cédé à la pression des poids lourds du parti – tels que Nancy Pelosi et Barack Obama – et des grands donateurs qui avaient commencé à réduire leurs contributions financières à la campagne, et qu'il a passé le flambeau à sa vice-présidente Kamala Harris, les démocrates ont bénéficié d'un regain d'énergie surprenant. Lorsque Harris a annoncé la nomination de son colistier, le gouverneur démocrate Tim Walz, un homme politique de centre gauche en mesure de séduire les électeurs du Midwest, sa campagne a bénéficié d'un regain d'enthousiasme et les dons ont afflué, avec notamment une collecte de 200 millions d'euros dans la semaine qui a suivi le retrait de Biden.
À la veille de la convention nationale du Parti démocrate qui s'est ouverte à Chicago le 19 août, les sondages montraient que Harris devançait légèrement Trump au niveau national et dans certains États clés. La convention nationale du Parti démocrate (DNC) a été l'occasion de réaliser une grande démonstration d'unité et d'énergie. L'extrémisme de Trump a permis à la DNC de présenter Harris et Walz comme un rempart contre le retour des États-Unis à la période d'avant les droits civiques et les droits des femmes, avec le slogan, répété par de nombreux orateurs, « nous ne reviendrons pas en arrière », cela sans proposer le moindre élément de rupture avec la politique de Biden.
Un programme très modéré
Les déclarations politiques de Harris sont plus populistes que progressistes. Lors de la convention, elle s'est prononcée, avec d'autres, en faveur de la défense des droits reproductifs, qui avaient subi un sérieux revers à l'été 2023 lorsque la Cour suprême des États-Unis a rendu son arrêt Dobbs v. Jackson, qui annulait la décision Roe v. Wade de 1973, qui légalisait l'avortement. Mais d'autres déclarations ont également été formulées sur la lutte contre la criminalité et le projet de mettre en place des contrôles frontaliers stricts, des projets généralement associés au Parti républicain. Harris est elle-même une ancienne procureure de San Francisco, et un gradé de la police s'est exprimé depuis la salle lors de la Convention. Alors que Trump et les experts de droite se sont emparés des appels de Harris en faveur d'un contrôle des prix pour lutter contre l'inflation afin de la qualifier de « communiste », la mesure qu'elle propose est populiste, et pas anticapitaliste. Il existe d'ailleurs un précédent : le président républicain Richard Nixon avait instauré un gel des salaires et des prix pendant 90 jours en 1971.
Trump désorienté et affaibli
Face à la dynamique du ticket Harris-Walz, Trump n'a pas réussi à changer de discours, à passer efficacement d'une campagne contre Biden, qu'il dénigrait comme trop vieux et trop faible, à une campagne contre Harris, beaucoup plus jeune avec ses 59 ans – et ses hésitations apparaissent aux yeux du plus grand nombre. Ses conseillers et divers dirigeants républicains lui ont suggéré d'adopter un ton rassembleur, de cesser les attaques ouvertement racistes et sexistes contre Harris, une femme « biraciale » dont le père est un immigrant jamaïcain et la mère une immigrante indienne, et de se concentrer sur les différences politiques. Cependant, il semble incapable de dépasser les injures et la théorie du complot, à l'image de son affirmation selon laquelle la foule du meeting de Harris aurait été gonflée par intelligence artificielle. Ses tentatives pour qualifier Harris et Walz de « communistes » tombent également à l'eau compte tenu du passé conservateur de Harris en tant que procureur, mais aussi parce que les musulman·es et les immigré·es ont depuis longtemps supplanté le communisme en tant qu'épouvantail pour les conservateurs.
Lors d'un meeting en Géorgie, Trump a également lancé une espèce de vendetta contre son gouverneur, pourtant républicain, Brian Kemp, qui n'a pas soutenu la tentative de Trump de voler les élections de 2020. Il est maintenant possible que l'impopularité croissante de Trump et la perte de soutien parmi les électeurs indécis nuisent à la campagne républicaine pour les nombreux sièges du Congrès qui seront également en jeu le 5 novembre prochain.
Le projet fasciste de Trump
S'il gagne en novembre, Trump ne va pas rester les bras croisés… Il menace de « châtiments » et a déclaré qu'il agirait en dictateur « seulement le premier jour ». Il fait régulièrement des immigrés les boucs émissaires de vagues de criminalité inexistantes et a encouragé les nationalistes chrétiens d'extrême droite. Les démocrates se sont emparés d'un document de 900 pages, le Projet 2025, préparé par un « groupe de réflexion » de droite appelé Heritage Foundation et des dizaines d'anciens collaborateurs de Trump pendant sa présidence, qui est une liste de courses rassemblant toutes sortes de propositions réactionnaires. Ceux qui ont regardé le débat national républicain à Milwaukee, dans le Wisconsin, ont vu des délégués à la convention brandir des pancartes réclamant une « déportation massive immédiate » (« Mass Deportation Now ») et les orateurs ont blâmé Biden et les immigré·es pour les décès par fentanyl de leurs proches. Aucune mention n'a été faite du changement climatique. Le projet 2025 prévoit également le remplacement de dizaines de milliers de fonctionnaires par des personnes nommées par Trump.
Le choix par Trump d'un sénateur républicain réactionnaire de l'Ohio, J.D. Vance, investisseur en capital-risque, a reflété la confiance de Trump dans sa capacité à gagner contre Biden sans établir des alliances régionales, démographiques ou politiques, ce qu'un autre candidat à la vice-présidence aurait représenté. Depuis qu'il a été nommé colistier de Trump, les médias ont accordé beaucoup d'attention aux déclarations passées de Vance attaquant les femmes sans enfant et suggérant que les citoyens avec enfants devraient avoir plus de pouvoir de vote que les personnes sans enfant, que le « but » des femmes ménopausées est de s'occuper des petits-enfants dans une sorte de natalisme fasciste réchauffé du vingtième siècle. Pendant les jeux Olympiques d'été à Paris, il a envoyé des commentaires dégradants et transphobes sur Twitter à l'encontre de la boxeuse algérienne cisgenre Imane Khelif qui a remporté une médaille d'or.
Gaza, le talon d'Achille de Harris
Les deux campagnes sont confrontées à un défi programmatique sur une question clé qui pourrait être décisive pour chacune d'entre elles. Harris est associée au soutien de Biden à l'assaut meurtrier d'Israël contre Gaza, ce qui a affaibli sa position auprès des Arabes-Américains et des jeunes, comme en témoignent les nombreuses abstentions « non engagées » lors des primaires du Parti démocrate. Confrontée à des manifestants de soutien à la Palestine lors de l'un de ses premiers événements de campagne en tant que candidate à la présidence, Harris a répondu sèchement en leur demandant s'ils souhaitaient la victoire de Trump. Quelques jours plus tard, elle a solidifié sa position, se déclarant favorable à un cessez-le-feu à Gaza et au retour des otages israéliens. Mais pendant ce temps, Joe Biden approuvait un programme d'aide militaire de 3,5 milliards de dollars à Israël pour l'achat d'armements de haute technologie.
Alors que la DNC semblait unifiée, une série de marches et d'événements pour la Palestine et en faveur des droits reproductifs et des LGBTQI ont été organisés. Mais ces manifestations ont été décevantes et peu nombreuses. Une manifestation organisée la veille de la Convention a attiré moins de 1 000 manifestant·es. Une manifestation à l'appel de la Coalition to March on the DNC, qui s'est déroulée le premier jour de la Convention, a rassemblé environ 3 000 personnes. Les organisateurs avaient espéré une participation dix fois plus forte, étant donné que la région de Chicago, la plus grande des États-Unis, compte 50 000 Américain·es d'origine palestinienne. Cette participation décevante est due notamment à la difficulté d'obtenir de la ville de Chicago les autorisations de manifester, ainsi que l'approche sectaire de Freedom Road Socialist Organization (une organisation maoïste, NDLR), qui a étroitement contrôlé l'organisation des marches.
Le mouvement pour la Palestine revendique un cessez-le-feu à Gaza et un embargo sur les armes à destination d'Israël. Bien qu'il faille un mouvement beaucoup plus large et puissant pour empêcher les États-Unis d'armer Israël, un cessez-le-feu est en revanche possible. Si un accord de cessez-le-feu était conclu, Harris pourrait regagner une partie des électeurs et électrices qui se sont détourné·es de Biden en raison de son soutien à l'assaut israélien contre Gaza. Un autre facteur dans cette équation sera la reprise des cours entre fin août et début septembre dans la centaine d'universités où les étudiant·es ont installé des campements propalestiniens au printemps dernier. Il reste cependant à voir si le ton plus sympathique de Harris et un éventuel cessez-le-feu suffiront à reconquérir certains des milliers d'électeurs et électrices démocrates « non engagé·es » qui en veulent à « Genocide Joe » Biden pour son soutien à Israël et ainsi à démobiliser les protestations sur les campus.
Trump et les droits reproductifs
Trump est confronté à un dilemme similaire en ce qui concerne les droits reproductifs. Le courant anti-avortement est très fort dans son parti, mais Trump comprend que le droit à l'avortement est soutenu par une majorité d'Américain·es, y compris des Républicain·es. Il a tenté de surmonter cette contradiction en affirmant que la question devait être tranchée au niveau des États. Cette tentative de paraître pro-vie aux yeux de l'aile anti-avortement de son parti sans aliéner les républicain·es pro-choix et les indépendant·es semble se retourner contre lui. L'aile républicaine la plus farouchement opposée à l'avortement, qui rêve d'une interdiction nationale de l'avortement, estime qu'il a abandonné sa cause. Vance, le candidat à la vice-présidence de Trump, a récemment déclaré à un journaliste que Trump opposerait son veto à une interdiction nationale de l'avortement, tandis que les républicain·es pro-choix soulignent qu'il s'est fièrement attribué le mérite de l'annulation de Roe v. Wade, l'arrêt de 1973 de la Cour suprême qui a légalisé l'avortement, grâce aux trois juges réactionnaires nommés par ses soins au sein de la Cour composée de neuf personnes.
Le champ de bataille des États
Le système électoral présidentiel américain – mis en place peu après que les colonies américaines eurent gagné leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne dans les années 1790 – est basé sur le système électoral winner-take-all. Au collège électoral, chaque État dispose d'un nombre de voix déterminé par sa population. Le candidat qui obtient la majorité simple des voix dans un État se voit attribuer toutes les voix de cet État. Le candidat qui obtient la majorité – 270 des 538 voix du collège électoral – remporte la présidence.
Au cours des dernières élections, de nombreux États sont devenus très majoritairement républicains (rouges dans le langage politique américain actuel) ou bleus (démocrates). Les États où l'écart est suffisamment faible pour qu'ils puissent pencher d'un côté ou de l'autre, parfois appelés « violets », jouent un rôle prépondérant dans les élections nationales serrées. Un facteur clé de l'élection sera la capacité des démocrates à reconquérir les électeurs de la classe ouvrière dans les États clés comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, où de nombreux travailleurs/ses ont abandonné le Parti démocrate, qui bénéficiait du soutien des syndicats jusqu'à ce qu'il démontre son incapacité à trouver des solutions aux fermetures d'usines généralisées qui ont décimé les syndicats, les communautés ouvrières et réduit drastiquement le niveau de vie à partir des années 1980. La victoire de Trump dans l'État industriel et anciennement bleu du Michigan a été décisive face à Hillary Clinton en 2016.
Les syndicats et les élections
Les syndicats américains ont été l'un des piliers de la coalition New Deal du Parti démocrate avec les organisations de défense des Black civil rights, qui s'est formée sous la présidence de Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930. Bien que les syndicats n'aient reçu grand-chose en échange de leur soutien au PD, les bureaucrates syndicaux sont restés fidèles au PD et se sont opposés aux efforts visant à rompre avec lui.
Sean O'Brien, président du syndicat des chauffeurs Teamsters, a été vivement critiqué dans les milieux syndicaux progressistes pour avoir pris la parole lors de la convention républicaine. Il n'a pas été invité à s'exprimer lors de la convention des Démocrates à Chicago.
Le président du syndicat United Auto Workers (UAW), Sean Fain, un syndicaliste très lutte des classes qui s'est imposé comme l'un des leaders de la classe ouvrière américaine, a d'abord refusé de soutenir les candidats, avant d'apporter son soutien à Harris au nom du syndicat. Fain a souligné que Biden avait participé à un piquet de grève et soutenu verbalement les grévistes lors d'une grève de l'automobile menée par l'UAW au début de l'année, alors que Trump a organisé des rassemblements avec des travailleurs non syndiqués. Fain a commencé à dénoncer publiquement Trump comme un représentant de la « classe milliardaire », hostile à la classe ouvrière.
Trump a clairement exprimé ses opinions antisyndicales lors d'un entretien avec l'entrepreneur Elon Musk sur X, anciennement Twitter, dont Musk est le propriétaire. Trump a félicité Musk pour avoir licencié des travailleurs pro-syndicats, ce qui a donné lieu à une plainte pour pratiques déloyales au travail déposée par l'UAW le lendemain. Il a bien sûr raison au sujet de Trump et du Parti républicain, même si – alors que Biden, Harris et Walz sont loin d'être eux-mêmes des milliardaires – le parti démocrate est lui aussi contrôlé par les 1 %, par les plus riches. Outre l'UAW, certains des plus grands syndicats des États-Unis, comme le Service Employees International Union (SEIU), l'American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) et l'American Federation of Teachers (AFT), ainsi que la fédération syndicale AFL-CIO, soutiennent Harris et Waltz.
L'action politique indépendante ou le « moindre mal »
Les États-Unis restent le seul pays industriel avancé à ne pas disposer d'un parti ouvrier de masse, socialiste ou communiste ayant des liens forts avec le mouvement ouvrier. La gauche débat depuis des décennies des stratégies de « moindre mal » (voter pour les démocrates comme un moindre mal). Les partisans de cette stratégie affirment que le Parti républicain, historiquement ouvertement pro-entreprise et antisyndical, est qualitativement pire pour les travailleurs/ses et les opprimé·es que le Parti démocrate. Les opposants à cette stratégie soulignent l'importance d'une politique indépendante de la classe ouvrière, c'est-à-dire en dehors du PD, en soutenant des candidats third-party de gauche qui mènent des campagnes de propagande et soutiennent les luttes actuelles des travailleurs/ses et du mouvement social, ainsi que la rupture avec les démocrates.
Pour les élections de 2024, les partisans du « moindre mal » soulignent les dangers d'une nouvelle présidence Trump. Certains à gauche ont proposé des systèmes d'échange de votes par lesquels un électeur de Harris dans un État à majorité démocrate « sûr » (non gagnable par Trump, NDLR) accepterait de voter pour Jill Stein en échange de la promesse d'un partisan de Stein dans un État « non sûr » de voter pour Harris.
La plus grande organisation socialiste des États-Unis, Democratic Socialists of America (DSA), a résisté à la dynamique du « moindre mal » et n'a pas soutenu de candidat·e. Lors de l'élection présidentielle de 2020, Solidarity, organisation sympathisante de la Quatrième Internationale, a soutenu le candidat du Parti Vert et membre de Solidarity Howie Hawkins. Cette année, il y a eu très peu de soutien au sein de Solidarity pour un vote de « moindre mal » en faveur de Biden. L'organisation socialiste révolutionnaire appelée le collectif Tempest, n'a pas soutenu de candidat, mais a publié des articles contre le choix du « moindre mal » sur son site internet.
Jill Stein, qui était également la candidate du Green Party USA en 2012 et 2020, a appelé à un cessez-le-feu à Gaza et à un embargo sur les armes contre Israël, et a gagné un soutien très important dans la communauté arabo-américaine. Un récent sondage a montré qu'un pourcentage impressionnant de 43 % des Arabes-Américains du Michigan soutiennent Stein. D'autres sondages montrent qu'elle est soutenue par 1 % des électeurs et électrices du Michigan. Stein devrait être présente sur les bulletins de vote dans 35 à 40 des 50 États. Dans plusieurs États, le Parti démocrate s'est efforcé d'exclure Stein et d'autres personnes du scrutin, tandis que les Républicains ont cyniquement déposé une pétition pour que l'intellectuel noir progressiste Cornell West soit inscrit sur le bulletin de vote. West, qui a récemment gagné une bataille pour figurer sur le bulletin de vote dans le Michigan, n'a obtenu l'accès au scrutin que dans une poignée d'États.
La crise n'est pas finie
Alors que les chances de M. Trump de reprendre la Maison Blanche semblent s'éloigner, il a commencé à préparer le terrain pour dénoncer un supposé vol des élections des 2024 par les Démocrates. Bien que toutes les actions en justice intentées par Trump pour fraude électorale en 2020 aient échoué, le risque demeure que les assemblées législatives des États contrôlées par les Républicains refusent de certifier la victoire de Harris, comme elles l'ont fait pour Biden en 2020. Toutefois, en 2020, Trump était le président en exercice, alors que cette année, c'est Biden qui tiendra les rênes du pouvoir.
Si Trump l'emporte en novembre, nous pouvons nous attendre à des attaques virulentes contre les immigrés et les personnes LGBTQI, à une tentative d'interdiction de l'avortement à l'échelle nationale, à un encouragement de la misogynie et du racisme des nationalistes chrétiens blancs, à des attaques contre les syndicats et les droits de vote des minorités, à la suppression de la sécurité des travailleurs et des protections environnementales, et à une augmentation de l'exploration des combustibles fossiles. La gauche pourra pousser un soupir de soulagement si Harris bat Trump, mais il restera le soutien des États-Unis à Israël, une grave crise du logement, d'énormes inégalités sociales et la tâche historique de construire un mouvement politique de masse de la classe ouvrière et un parti indépendant des partis des classes dominantes.
Le 28 août 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le Nouveau Parti Démocratique et le Québec : un fossé infranchissable ?
On a fait grand cas du récent "divorce" Parti libéral du Canada/Nouveau parti démocratique. Plusieurs observateurs ont alors soutenu que cette "rupture de contrat" (conclu en mars 2022) allait favoriser le Parti conservateur de Pierre Poilieve qui caracole en ce moment dans les sondages. En déchirant l'entente qui le liait à Justin Trudeau au profit d'objectifs à court terme, Jagmeet Singh faciliterait donc l'arrivée au pouvoir du plus réactionnaire des partis en présence au Parlement d'Ottawa. On pourrait ajouter que le "gagnant" pour l'instant est le Bloc québécois qui détient la balance du pouvoir. Mais il n'aspire pas à exercer le pouvoir à Ottawa pour d'évidentes raisons puisqu'il s'agit d'une formation souverainiste.
Le NPD ne peut lui non plus espérer accéder au pouvoir mais pour des causes différentes. À l'exception de l'épisode Jack Layton (2003-2011), il n'a jamais vraiment essayé de percer au Québec. Le Québec, son talon d'Achille...
Depuis l'historique performance du parti en 2011 (59 députés élus au Québec, ce qui l'a propulsé au statut d'opposition officielle à Ottawa), le parti n'a cessé d'en perdre sous Thomas Mulcair et surtout Jagmeet Singh. Il ne subsiste plus qu'Alexandre Boulerice ; un type sympathique certes, mais dépourvu de charisme et qui, à première vue s'aligne sans rechigner sur les positions de Singh et de sa garde rapprochée. Dans le comté de Rosemont-La Petite-Patrie, on le réélit à répétition depuis 2011. Mais les gens votent peut-être davantage pour l'homme que pour le parti. Une fois qu'il aura démissionné (ce qui viendra bien un jour), son successeur arrivera-t-il à se faire élire ? Ça reste à voir. Si ce n'est pas le cas, le NPD ne disposera alors plus d'aucun représentant au Québec.
De toute évidence, la direction du parti ne comprend pas l'importance de réussir une percée majeure dans "la Belle province" si elle veut conquérir un jour le pouvoir à Ottawa. Après tout, le Québec est la province la plus peuplée (un peu plus de 9 millions d'habitants) après l'Ontario (15 millions) et par conséquent, possède le plus important réservoir de comtés en second lieu après la province voisine. N'est-ce pas déjà un motif majeur pour tenter d'y faire élire le plus de députés possible ?
Avant tout, le Québec forme une nation dont la plupart des francophones tiennent à divers degrés, à assurer l'autonomie, même à l'intérieur de la fédération canadienne.
Jagmeet Singh ne paraît pas mesurer toute l'ampleur de ce sentiment. Par exemple, lorsqu'il a insisté pour que François Legault adhère au programme de soins dentaires gratuits mis sur pied par le fédéral, il a qualifié l'opposition de celui-ci comme le résultat d'un refus fondé sur des "motifs académiques", c'est-à-dire secondaires et artificiels. Or, n'en déplaise à Justin Trudeau et Jagmeet Singh, le Canada est un État fédéral avec division des pouvoirs entre le niveau central et les provinces, un partage qu'on ne peut bousculer de manière désinvolte, même avec les meilleurs intentions du monde.
Au fond, comme beaucoup de socialistes dans le monde, la plupart des néo-démocrates considèrent le nationalisme comme un discours de diversion par rapport aux "vrais problèmes" sociaux et économiques, un discours qui aurait été inventé par des classes politiques dominantes pour asseoir leur pouvoir sur une société donnée. Ils refusent de voir la réalité en face : le nationalisme constitue un mode fondamental de rassemblement de gens qui partagent une histoire et une culture spécifiques. Il voit les francophones canadiens comme un tout, à l'instar de Justin Trudeau dont il partage par ailleurs le multiculturalisme. La spécificité québécoise, très peu pour lui.
Tant que le Nouveau Parti démocratique regardera le nationalisme québécois comme un obstacle à l'établissement de politiques sociales justes "from coast to coast" et qu'il ne déploiera pas les efforts requis pour s'y tailler une place, il se coupera de toute possibilité d'accéder un jour au pouvoir à Ottawa.
Espérons que le successeur du chef actuel acceptera de comprendre cette réalité élémentaire.
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Le brise-glace doit être construit au Québec
Le fédéral vient d'attribuer aux Chantiers Davie un contrat de plusieurs millions pour la conception d'un brise-glace polaire, le plus gros jamais construit et qui aura comme fonction d'assurer la souveraineté dans l'Arctique.
Mais il n'est pas encore garanti que le bateau sera construit à Lévis. En effet la compagnie qui possède les Chantiers a aussi un chantier en Finlande. Il se pourrait donc que la construction n'ait pas les retombées qu'on lui prête au Québec.
Pourquoi les Libéraux n'exigent-ils pas que la construction, en plus de la conception, se fasse à Lévis ? Par calcul. Ils veulent en tirer un avantage politique. Et étirer la sauce pour que cela se fasse.
Alors il faut que les indépendantistes se mobilisent à nouveau comme ils l'ont fait quand a été annoncé le Plan de Construction Navale du Canada pour, non seulement avoir notre juste part, mais pour obtenir la certitude que le gouvernement fédéral mette se culottes et exige des propriétaires des Chantiers Davie que la construction du brise-gale polaire se fasse aux Chantiers à Lévis, au Québec, de manière que soient garanties les retombées, pour tout le Québec et pour Lévis.
En plus d'une résolution à l'Assemblée Nationale, le Parti Québécois et Québec Solidaire devraient ensemble revendiquer bien haut que le gouvernement fédéral exige des propriétaires des Chantiers Davie, auxquels ont été accordé le contrat de conception, mette en chantier à Lévis le futur brise-glace sans que ne soit considéré une quelconque construction en dehors du pays.
Ce serait le minimum qu'après avoir attendu pendant des années d'incertitude opportuniste des Libéraux pour réparer la grave injustice des Conservateurs que le brise-glace, dont on a fait miroiter la construction aux ouvriers de la Davie tout ce temps, soit construit à Lévis. Il n'y a pas d'hésitation a à y avoir : le tout doit se concrétiser dans les plus brefs délais par des engagements clairs et doit cesser l'insécurité des ouvriers quant à ces garantis d'emplois ainsi que les promesses douteuses des Libéraux.
Sans cet engagement du gouvernement libéral. Il n'y aura pas de justice à attribuer au Plan de Construction Navale du Canada pour le Québec. Il demeurera une tare dans la répartition des impôts dans ce pays. Nous nous retrouverons à la case départ du combat, non seulement pour notre juste part, mais pour des considérations d'équité élémentaire entre les chantiers canadiens gavés de contrats selon l'expression d'un Harper battu aux élections.
Si la part du Québec n'est pas garantie par un engagement sans équivoque des Libéraux avant qu'ils ne perdent le pouvoir, les Conservateurs pourraient trouver prétexte à laisser aller la construction dans un autre pays, en Finlande en occurrence. Et ce serait une autre belle entourloupette de la députation québécoise parmi la plus servile qu'on ait connue depuis des années.
Guy Roy, retraité
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
15 septembre 2024La fluidité du genre est...
15 septembre 2024
La fluidité du genre est l'avenir de l'humanité.
Nous sommes les pionnières et les pionniers d'une nouvelle époque de l'humanité à venir et à construire.
JéRelle
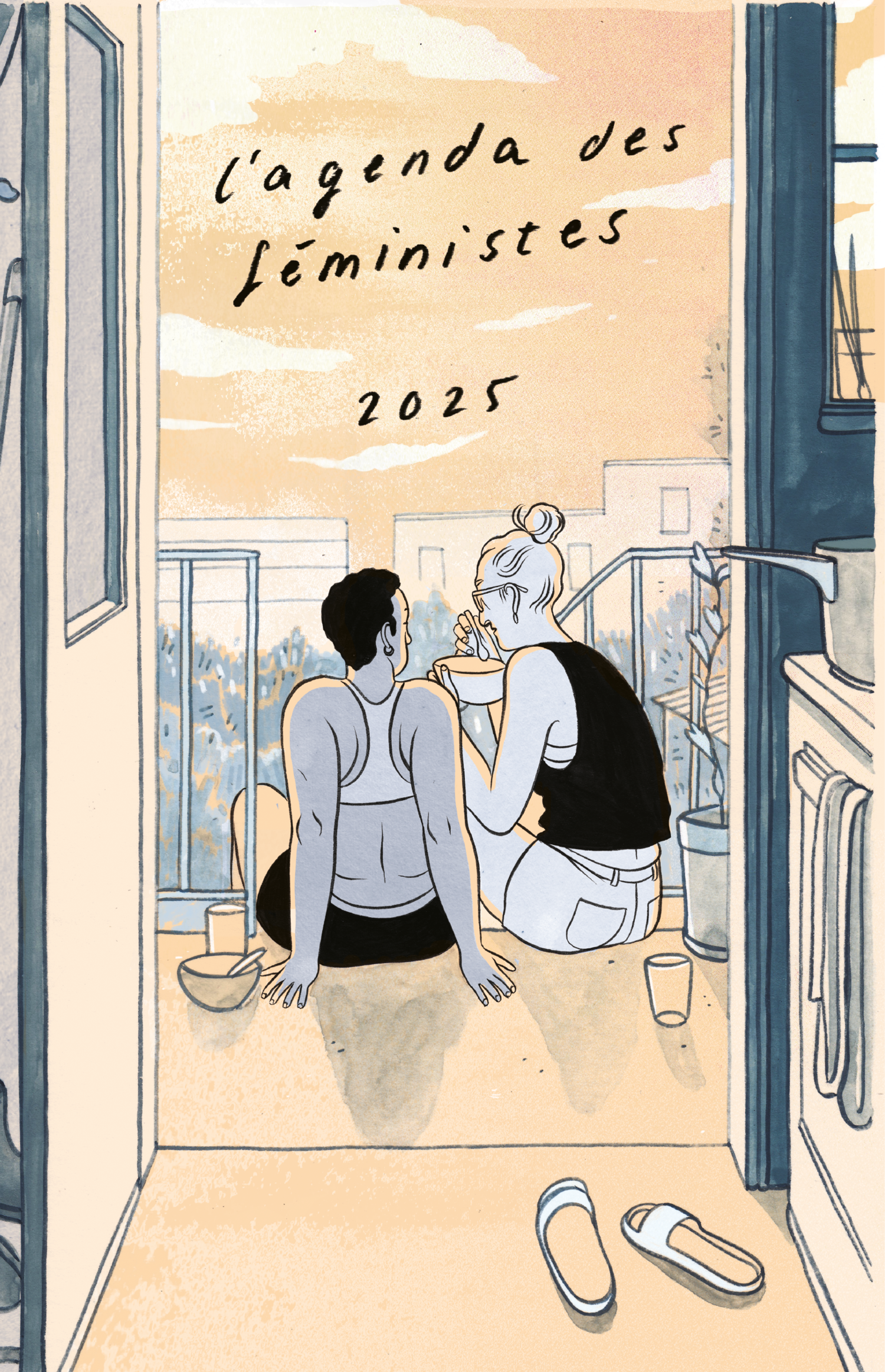
L’agenda des féministes 2025
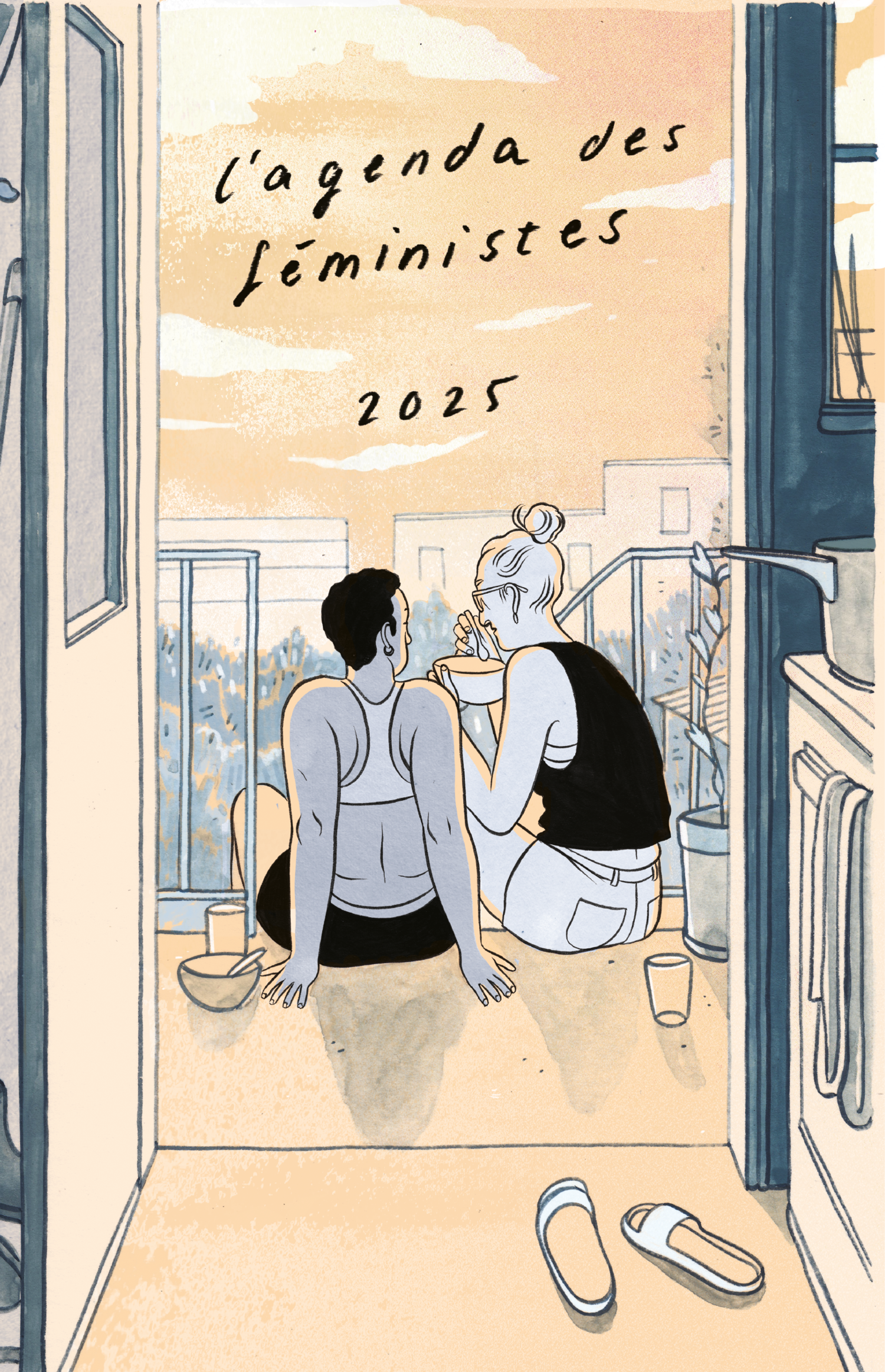
En librairie : le 3 septembre, au Québec | le 27 septembre, en Europe
Transféminismes
Rien ne rime davantage avec la rentrée que l'arrivée de L'agenda des féministes des Éditions du remue-ménage chez les libraires.
En 2025, l'agenda s'intéresse aux transféminismes. Contre les J.K. Rowling, Elon Musk et autres transphobes notoires, nous faisons le choix des solidarités qui refusent l'essentialisme, des féminismes qui permettent d'identifier et de combattre les oppressions et ne se butent pas à des préoccupations anatomiques.
Dans un climat toujours plus hostile aux communautés LGBTQ+, et aux personnes trans en particulier, l'édition 2025 de L'agenda des féministes porte sur les transféminismes, mouvements qui cherchent à dépasser les frontières de sexe, de genre et de race. À l'offensive réactionnaire, ils opposent une pensée politique dissidente et frondeuse qui refuse les catégories imposées par les dominants. Cela passe par une lutte aux côtés de toutes les personnes subissant les violences d'un système injuste et destructeur. L'agenda 2025 est un espace de célébration de la diversité des corps et des idées, et de la puissance des mouvements qui bousculent les dogmes.
Avec les textes de Mihena Alsharif, Barbada, Michaëla Danjé, Freya Dogger, Am Gagnon, Adam K., Judith Lefebvre, la Ligue des droits et libertés, Gabrielle Richard, Leïla Sofiane, Lou St-Pierre, Celeste Trianon et Tranna Wintour.
Illustration de la couverture par Lee Laï
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
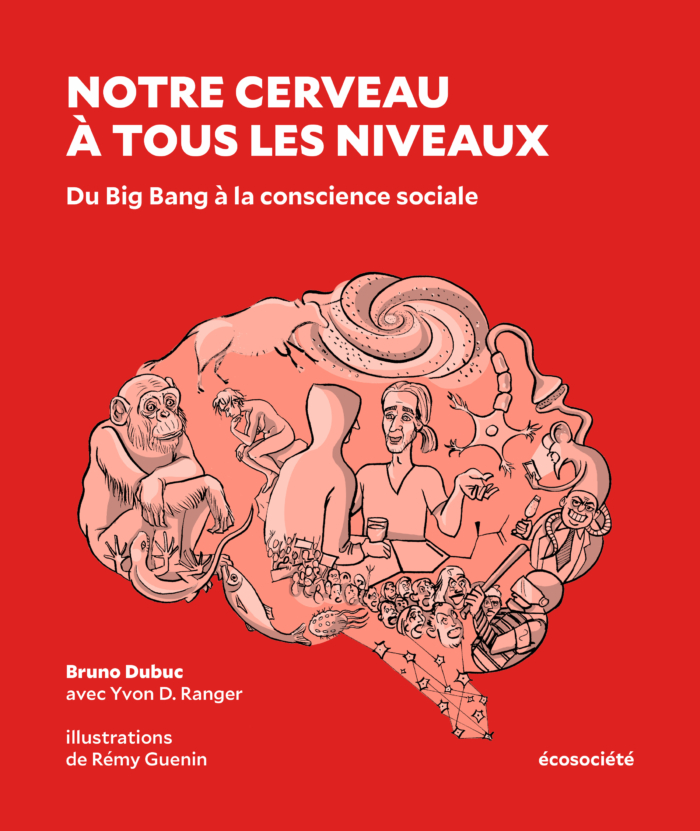
*Notre cerveau à tous les niveaux - Du Big Bang à la conscience sociale*
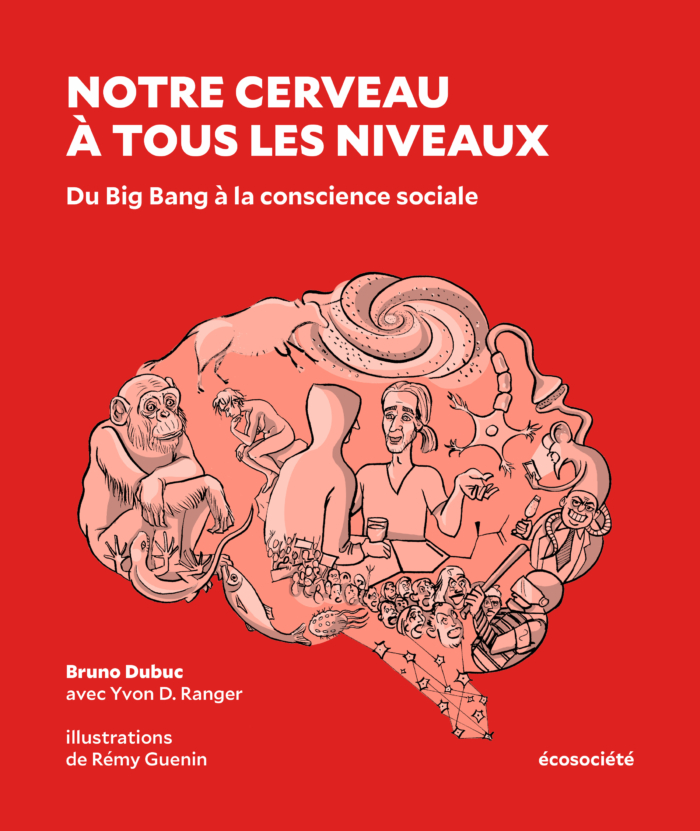
Des connaissances scientifiques aux préoccupations sociopolitiques, une odyssée fascinante dans l'objet le plus complexe de l'univers, notre cerveau.*
Le livre *Notre cerveau à tous les niveaux - Du Big Bang à la conscience
sociale*, du vulgarisateur Bruno Dubuc, va paraître *en librairie le 1er
octobre prochain.*
*En bref* : Mettant en scène un dialogue entre un vulgarisateur
scientifique et un cinéaste militant, ce livre hors norme nous plonge dans
l'objet le plus complexe de l'univers : le cerveau. Des connaissances
scientifiques aux préoccupations sociopolitiques, une odyssée fascinante à
la portée de toute personne curieuse de remonter aux origines d'Homo
sapiens pour mieux envisager son avenir.
*À propos du livre*
D'où viennent nos connaissances ? Qu'est-ce qui motive nos actions ? Ces
questions sont le point de départ d'une grande aventure visant à cerner
l'objet le plus complexe de l'univers : notre cerveau. Ouvrage de référence
pour appréhender notre corps-cerveau en constante interaction avec son
environnement, *Notre cerveau à tous les niveaux* emprunte à la « Big
History » pour raconter l'histoire des origines de la pensée humaine, du
Big Bang à la conscience de soi... et des autres.
À l'instar de Galilée qui, dans son célèbre *Dialogo sopra i due massimi
sistemi del mondo*, a fait dialoguer trois personnages pour démontrer que
la Terre tourne autour du soleil, l'auteur Bruno Dubuc a choisi de
présenter ce récit transdisciplinaire sous la forme d'une discussion entre
un vulgarisateur scientifique, c'est-à-dire lui-même, et un cinéaste
militant, son alter ego. Au fil de leurs rencontres, les deux complices
abordent autant la grammaire de base du système nerveux que les émotions et
le langage, l'auto-organisation du vivant et l'autogestion des communautés
humaines, le cerveau prédictif et les bouleversements climatiques. Avec
eux, nous comprenons peu à peu la nécessité de bâtir des ponts entre
savoirs scientifiques et préoccupations sociopolitiques.
Fruit de 20 ans de travail, cette somme exceptionnelle de connaissances
scientifiques nous convie ni plus ni moins à explorer ce que signifie,
aujourd'hui, « être humain ». Faisant le pari que la compréhension de notre
cerveau est un premier pas pour opérer un changement social, cette odyssée
fascinante est à la portée de toute personne curieuse de remonter aux
origines d'Homo sapiens pour mieux envisager son avenir.
« *Un exercice très ludique et détaillé qui met parfaitement en lumière les
conceptions actuelles de l'esprit humain en relation avec leurs différents
substrats physiologiques. Un bel équilibre.* »
– Dr. Mathieu Landry, chercheur en neuroscience cognitive, membre du
Baillet Lab [ neuroSPEED ]
« *J'ai longtemps cru pouvoir faire des sciences sociales sans m'intéresser
au cerveau humain. Non seulement le chef-d'œuvre de Bruno Dubuc m'a
convaincu que j'avais tort, mais il fournit aussi tout ce qu'il faut pour
commencer à corriger cette erreur.* »
– Yves-Marie Abraham, sociologue et auteur de *Guérir du mal de l'infini *
*À propos de l'auteur*
Détenteur d'une maîtrise en neurobiologie de l'Université de Montréal, *Bruno
Dubuc* est vulgarisateur scientifique. Après avoir œuvré une dizaine
d'années à titre de journaliste et recherchiste scientifique, tant pour
l'écrit que pour la télé, il a lancé en 2002 le site web de référence Le
cerveau à tous les niveaux (lecerveau.mcgill.ca), reconnu dans le milieu
scientifique. Depuis 2014, il fait partie du collectif derrière l'Upop
Montréal, dont les activités s'inscrivent dans le sillage des universités
populaires. Il est possible de retrouver les références du livre et du
contenu supplémentaire sur son autre site https://livre.blog-lecerveau.org/.
Habitué des manifestations et actions contre les différentes formes
d'aliénation générées par le système capitaliste, *Yvon D. Range*r est
journaliste et cinéaste. Il a coordonné de 2002 à 2014 le mensuel
indépendant satirique Le Couac tout en réalisant de manière tout aussi
indépendante une vingtaine de courts métrages, cinq longs métrages et une
série web, tous à saveur politique.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
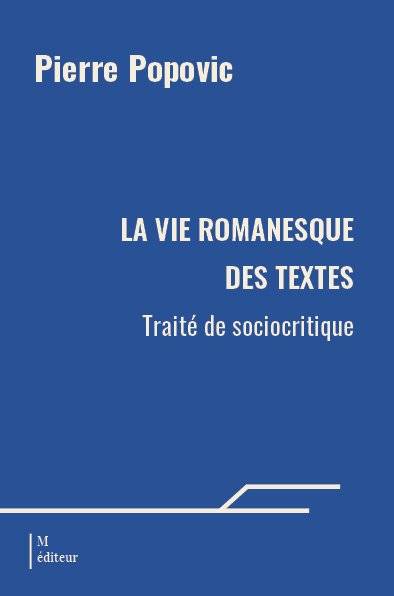
La vie romanesque des textes. Traité de sociocritique
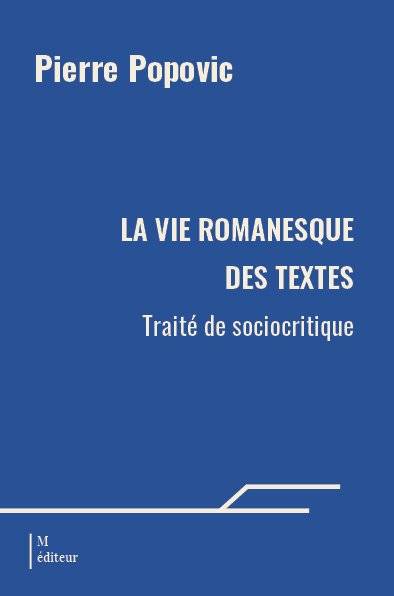
M éditeur et le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (CRIST) vous convient au lancement de La vie romanesque des textes. Traité de sociocritique, de Pierre Popovic. L'évènement aura lieu le mardi 17 septembre à 18h à la Librairie du Square, au 1061 Av. Bernard, Outremont. Vins et boissons seront offerts.
Au plaisir d'échanger avec vous !
« La sociocritique telle que la pratique Pierre Popovic est un appel à l'action, à la non-résignation. C'est une critique en acte, résolument accrochée à la parole vive qui résonne dans toute écriture digne de ce nom, nourrie par l'inventivité de la culture orale qui se mêle à la chose écrite, sensible aux imprévus de la syntaxe, aux interactions des points de vue, aux nuances des voix, à tout ce qui rend la langue présente au monde, profondément incarnée et plurielle. » (Michel Biron)
L'AUTEUR
Pierre Popovic est professeur émérite de l'Université de Montréal et auteur d'essais comme La contradiction du poème (1992), Imaginaire social et folie littéraire, Le second empire de Paulin Gagne (2008) et La mélancolie des Misérables. Spécialiste internationalement reconnu de la sociocritique, il a fondé en 2008 le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (CRIST), lequel est aujourd'hui codirigé par Geneviève Boucher (uOttawa) et Bernabé Wesley.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

C’est injuste ! | Livre à paraître le 8 octobre 2024

Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez été témoin d'une
injustice ? Deux sociologues remontent aux sources des inégalités de la
crise climatique.
« Je ne peux pas respirer » ont été les derniers mots prononcés par George
Floyd en 2020 [...] Cette phrase peut exprimer non seulement la violence
produite par les institutions policières, les politiques et les décisions
de l'État, mais aussi la disproportion de l'exposition aux pollutions des
populations racisées.
Le livre *C'est injuste, *7e livre de la collection Radar, par Amélie
Chanez et Anne-Marie Le Saux, paraîtra le *8 octobre 2024 * !
*En bref : *Deux sociologues passionnées par leur discipline décident de
l'utiliser pour explorer le cas des injustices climatiques. Permettant de
contourner le piège de la désinformation, de confronter une vision biaisée
par notre position de privilège et d'agir concrètement à travers le partage
d'initiatives et d'informations sur ces injustices, l'approche
sociologique, celle de Caroline Dawson, de Jean-Philippe Pleau, pour ne
nommer qu'eux, semble tout indiquée pour ouvrir des yeux sur un problème
mondial.
*À propos du livre*
C'est par le voyage que Amélie Chanez et Anne-Marie Le Saux ont pris
conscience de nombreuses inégalités, dont les injustices environnementales.
Leurs constats : plusieurs de nos privilèges sont des contraintes pour
d'autres humains. De plus, devant la crise climatique, les populations
pauvres ou racisées, sont davantage affectées.
Si l'indignation leur fait dire que « C'est injuste ! », les autrices se
tournent vers leur pagaie de choix : la sociologie, qu'elles enseignent au
Cégep de Maisonneuve. Dans cet essai, elles font sortir la science humaine
de la salle de classe et appliquent un regard critique et mobilisateur sur
un monde inégal, en crise.
À l'aide d'exemples poignants et d'entrevues avec des citoyen·nes engagé·es
dans leur communauté, les autrices nous invitent à décoloniser les discours
sur la crise climatique, à envisager une autre façon d'habiter le monde et
de consommer. Les jeunes ne sont pas seul·es à s'en préoccuper, des gens
réclament déjà des changements sur la place publique. *C'est injuste ! * fait
la démonstration qu'il n'est pas trop tard pour renverser la vapeur, mais
qu'il faudra le faire ensemble. Il est urgent de discuter des enjeux
environnementaux et de justice sociale !
*À propos des autrices *
Ancienne travailleuse sociale et animatrice jeunesse, *Amélie Chanez* est
professeure de sociologie au Collège de Maisonneuve. Elle s'intéresse aux
théories de l'engagement social, des mouvements sociaux, aux féminismes et
à la décolonisation.
*Anne-Marie Le Saux* enseigne la sociologie au Collège de Maisonneuve. Elle
a collaboré à la revue sociale et politique À *bâbord ! et *à quelques
ouvrages collectifs dont *L'essor de nos vies : parti pris pour la société
et la justice* (2000) et *Les femmes changent la lutte (2013)*.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un plaidoyer pour le droit des femmes

Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/11/un-plaidoyer-pour-le-droit-des-femmes/
Réédition en poche de « La force des femmes » de Denis Mukwege
La présentation du gynécologue congolais Denis Mukwege comme « l'homme qui répare les femmes » est des plus réductrices. Denis Mukwege est d'abord et avant tout un militant féministe, une cause à laquelle il consacre sa vie.
A travers son ouvrage salutaire et émouvant on partage son cheminement, de la prise en charge médicale des femmes à la critique radicale des sociétés patriarcales, qu'elles soient africaines ou occidentales.
La force de revivre
Les débuts de sa carrière médicale sont consacrés aux soins des femmes notamment lors des accouchements difficiles, puis avec la venue des conflits armés dans le pays, l'essentiel de son travail consistera à soigner les victimes des viols et violences sexuelles.
Ce n'est pas la moindre des qualités de cet ouvrage d'expliquer simplement, en quelques phrases les raisons des conflits qui secouent la République Démocratique du Congo (RDC) depuis plus de trente ans.
Avec l'auteur, à travers des portraits attachants de femmes victimes de ces violences, on comprend que les actes de soins doivent être accompagnés aussi d'un soutien psychologique, moral mais aussi d'une aide sociale et économique permettant aux victimes de pouvoir vivre décemment.
Il relate la manière dont les victimes sont soignées, comment elles sont prises en charge par les femmes de l'équipe : les « mamans chéries (…) Elles sont à la fois des infirmières, des assistantes sociales et des psychologues » et « délivrent autant de câlins et de musique que de médicaments » qui à force d'écoute, de tendresse et d'amour permettent à ces survivantes parfois des adolescentes, de reprendre vie en se débarrassant du sentiment de honte et de culpabilité.
On apprend le rôle majeur des anciennes victimes dans la réalisation du projet d'accompagnement social et économique. Pour construire la « Cité de la Joie » l'entreprise de bâtiment a eu l'obligation d'embaucher des femmes, cassant ainsi la division genrée du travail.
Un lourd tabou
L'auteur considère que le viol est rendu possible par des siècles d'oppression patriarcale. En décrivant la vie quotidienne des congolaises dans les zones rurales, on prend la mesure du degré d'oppression et d'exploitation subi.
Mukwege raconte cette anecdote terrifiante. Ayant en face de lui un combattant d'une des milices qui sévit en RDC, il lui demande pourquoi ces viols sont accompagnés en plus de sévices atroces. Sa réponse, de l'aveu de l'auteur, lui glace le sang : « Quand on tranche la gorge d'une chèvre ou d'un poulet on ne se pose pas de question. Une femme, c'est pareil. On fait ce qu'on veut avec. »
Un des mérites de ce livre est l'analyse pluridimensionnelle du viol. Dans les situations de conflit il est considéré comme une arme de guerre dont le but est d'annihiler les liens sociaux du camp ennemi ou de mener des campagnes de purification ethnique. Il permet aussi aux groupes armés comme Daech de recruter et garder leurs membres en promesse de femmes. Des témoignages de miliciens font état d'une sorte d'addiction dans ces actes de violence. En RDC les viols massifs sont aussi un moyen pour pousser des populations à partir afin de s'attribuer l'exploitation des mines.
Mais il existe un point commun à ces crimes, leur invisibilisation. Mukwege nous interroge sur l'appréhension de notre propre passé historique. Parle-t-on, lors des différentes commémorations de guerre, des victimes de viol ? Ne préfère-t-on pas passer sous silence les violences sexuelles des alliés lors de la seconde guerre mondiale ? Qui évoque les viols lors du génocide des juifs par les nazis ?
Mukwege note avec une grande satisfaction que les mouvements féministes comme #MeeToo ont permis de briser le silence sur ces crimes signifiant le début d'une remise en cause de l'impunité pour les agresseurs. Si les lois nationales et internationales ont évolué dans le bon sens, leur application reste dans la plupart des cas problématique et seules les mobilisations permettent l'effectivité de ces dispositions juridiques. Denis Mukwege nous invite à les renforcer en « transformant nos émotions en action ».
La force des femmes de Denis Mukwege
Traduction Marie Chuvin et Laetitia Devaux
Edition Gallimard
Collection Folio Actuel N° 195. 400p.
Prix 9,40€
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Genre et sexualités : l’offensive réactionnaire de l’extrême droite

Tiré de la revue Contretemps
13 septembre 2024
Par Cassandre Begous et Fanny Gallot
Les éditions Amsterdam viennent de publier le premier livre de l'institut la Boétie, intitulé Extrême droite : la résistible ascension. Coordonné par Ugo Palheta, accompagné d'une préface de l'historien Johann Chapoutot et une postface de Clément Guetté, cet ouvrage a pour ambition de fournir des armes intellectuelles, enracinées dans la recherche contemporaine sur l'extrême droite, pour comprendre et combattre la progression du FN/RN (voir le sommaire ici).
Une grande partie du succès des extrêmes droites continue de reposer sur le racisme, en particulier la xénophobie anti-immigrés et l'islamophobie, mais il est important d'analyser les nouveaux terrains qu'investissent ces forces politiques pour élargir le périmètre de leur influence. Nous publions ainsi un extrait du chapitre écrit par Cassandre Begous et Fanny Gallot, qui montre comment l'extrême droite a cherché au cours des dix dernières années à politiser les questions de genre et de sexualité, façonnant « de nouvelles logiques d'exclusion et d'altérisation » et permettant de redéployer et légitimer « un discours essentialiste et transphobe ».
Les fantômes de La Manif pour tous
Le 19 mars 2024, la sénatrice Les Républicains (LR) Jacqueline Eustache-Brinio annonce la publication d'un rapport sur la « transidentification des mineurs », ainsi qu'une proposition de loi visant à interdire à ces derniers les transitions de genre. Très vite, le Rassemblement national dit déposer une proposition de loi similaire à l'Assemblée nationale.
Cette actualité s'inscrit dans la continuité d'une offensive réactionnaire bien documentée et dans laquelle les questions de genre occupent une place importante, sinon centrale. Si l'on retrace la généalogie de cette offensive, on retrouve la même sénatrice parmi les opposant·es à la loi de 2022 qui visait à interdire les thérapies de conversion : considérant que les personnes trans ne devaient pas être couvertes par cette loi, elle mettait en garde ses collègues contre « l'idéologie du genre » et « tout ce qui nous vient des États-Unis », que voudrait imposer, à l'en croire, une « minorité agissante ».
Cette petite musique n'est pas nouvelle pour quiconque a vécu les débats autour du mariage pour tous en 2012. Soucieuse de ne pas paraître trop homophobe (malgré les débordements bien documentés de ses participants), La Manif pour tous préférait agiter le chiffon rouge du mariage homosexuel. Le mariage pour tous n'était pas une simple affaire d'égalité des droits, mais le vecteur d'une décadence de notre société, et même, selon la députée Annie Genevard (LR), « une atteinte irréversible à l'intégrité de l'espèce humaine [1] ». Il signait la fin de l'« altérité sexuelle » ontologiquement – si ce n'est théologiquement – constitutive de l'humanité et de la civilisation. En 1998, les adversaires du Pacs dénonçaient une menace pour la « différence des sexes ».
De même, en 2011, quand les stéréotypes de sexe et l'orientation sexuelle ont été mentionnés dans les nouveaux programmes de sciences de la vie et de la terre (SVT) : Christine Boutin, alors en campagne pour la présidentielle, a immédiatement dégainé une affiche montrant un bébé et portant le slogan « Tu seras une femme, mon fils » [2]. La même rhétorique a été réactivée en 2014 à propos des « ABCD de l'égalité », programme d'enseignement de l'égalité filles-garçons où ses détracteurs voyaient l'introduction de la « théorie du genre » à l'école, qui amènerait, entre autres choses, à enseigner la masturbation aux enfants.
Les questions de genre et de sexualité façonnent de nouvelles logiques d'exclusion et d'altérisation et sont également un instrument de redéploiement d'un discours essentialiste et transphobe. Sans conteste, l'extrême droite s'en sert pour construire une « panique morale », c'est-à-dire susciter une réaction politique et médiatique disproportionnée face à un fait social marginal ou minoritaire afin de l'ériger en une menace existentielle pour le corps social tout entier. Elle cherche ainsi à faire face à la lame de fond féministe qui embrase notamment la jeunesse, dans le cadre d'une nouvelle dynamique féministe mondiale à l'œuvre depuis le milieu des années 2010 [3].
Ces discours profondément réactionnaires se diffusent via les réseaux sociaux et les médias traditionnels, en particulier ceux appartenant à l'empire Bolloré, qui offrent une tribune importante à des paroles anti-trans. On a encore eu un exemple récemment, avec la promotion spectaculaire de Transmania, ouvrage anti-trans pourtant publié par une maison d'édition confidentielle d'extrême droite [4]. Ces discours infusent d'autant plus qu'ils ne sont pas fermement condamnés par la Macronie mais confortés par les politiques publiques.
En effet, si l'Église catholique et les mouvements anti-mariage pour tous ont préparé le terrain à une hostilité vis-à-vis des approches en termes de genre, l'offensive transphobe actuelle s'est dotée de nouveaux réseaux, dont fait partie la sénatrice LR mentionnée plus haut. Si elle ne comptait pas parmi les hérauts de La Manif pour tous, l'ancienne maire de Saint-Gratien s'est plutôt distinguée par une politique agressive contre la vie des quartiers populaires, par exemple en faisant détruire le stade de foot dans lequel devait se produire la « Coupe d'Afrique des nations des quartiers [5] » et en qualifiant de « racailles » les jeunes venus manifester contre sa destruction [6].
Cette répression est justifiée au nom d'une idée simple : l'étranger est un homme dangereux pour les femmes – sous-entendu, françaises et blanches en particulier. Cette contribution voudrait dessiner les contours de ces offensives réactionnaires pour mieux les affronter.
L'offensive anti-trans
En août 2022, le Planning familial fait l'objet d'attaques violentes sur les réseaux sociaux pour sa campagne présentant une personne trans. Les groupes et personnalités que l'on vient d'évoquer demandent la levée des subventions, déjà réduites à peau de chagrin, dont bénéficie cette structure qui défend historiquement les droits des femmes et le droit à l'avortement. Or, paradoxalement, les responsables de ces attaques prétendent agir au nom de la protection des femmes, ou plutôt, sous la plume de Marguerite Stern et Dora Moutot [7], au nom d'une « réalité biologique et scientifique [8] » censée protéger les femmes. En clair, inclure les femmes transgenres dans la catégorie des femmes risquerait d'effacer la condition de possibilité d'une identité féminine commune [9]. Pire, les personnes trans constitueraient un danger général envers les femmes.
La femme trans est présentée comme perverse, sexuelle et dangereuse ; elle subit une essentialisation d'une prétendue masculinité persistante, mise en avant pour justifier leur exclusion de tous les espaces de la vie sociale. Cette conception va à l'encontre de décennies de pensée féministe radicale, qui ont défini l'émancipation comme un affranchissement de la destinée biologique. Cela est vrai chez Simone de Beauvoir, pour qui « si la situation biologique de la femme constitue pour elle un handicap, c'est à cause de la perspective dans laquelle elle est saisie [10] », comme chez Christine Delphy, sociologue féministe matérialiste, qui explique que « le genre précède le sexe [11] ».
L'enchaînement de la condition féminine à la biologie est davantage l'apanage du discours de la droite. Andrea Dworkin a montré que ce camp politique circonscrit les femmes à la maternité, les considère comme vulnérables et faibles, mais aussi comme naturellement habitées par un instinct qui les pousse à nourrir et à protéger les enfants. Dès lors, elles seraient « naturellement » conservatrices [12].
Ce cadrage permet à la droite de transformer les aspirations féministes à l'émancipation en demandes de protection et, ainsi, de maintenir les femmes dépendantes de la domination masculine. Les femmes qui adhèrent à cette vision du monde entrent dans une défense perpétuelle de leur respectabilité et de leur place dans la sphère domestique, notamment contre les homosexuels. Selon Dworkin, « l'homosexualité […] rend les femmes inutiles », particulièrement l'homosexualité masculine « car elle suggère un monde entièrement sans les femmes[13] ».
Ainsi l'engagement homophobe des femmes de droite comme Anita Bryant ou Phyllis Schlafly constitue pour elles une bataille existentielle au sens strict. Défendre la respectabilité de la femme hétérosexuelle maîtresse de son foyer revient alors à défendre l'humanité et la civilisation tout entière.
La rhétorique transphobe des nouvelles femmes de droite
Les nouvelles femmes de droite [14] engagées dans le militantisme anti-trans répandent une semblable rhétorique du remplacement. Dès 1979, dans le brûlot transphobe The Transsexual Empire, Janice Raymond explique que les femmes trans sont le cheval de Troie d'un « empire » médical qui cherche à créer des femmes synthétiques et qui frappe les « vraies femmes » d'obsolescence [15]. On retrouve ce discours dans l'actuel backlash [16] anti-trans, par exemple lorsque sur le plateau de Quotidien, en 2021, Elisabeth Roudinesco s'alarme d'une « épidémie de transgenres », ou lorsque Le Figaro titre que les personnes trans « veulent l'effacement de la femme [17] ».
La transphobie est donc une actualisation du discours antiféministe de la droite à destination des femmes. Mais, en réactivant la peur du remplacement des femmes, la transphobie radicalise ce discours et constitue également un vecteur majeur de diffusion de la pensée d'extrême droite, de sa politique sexuelle normative et hiérarchique comme de sa politique xénophobe et eugéniste.
L'idée d'un remplacement des femmes par les trans (hommes comme femmes [18]) fait écho au discours raciste du « grand remplacement ». Comme l'étranger venu accaparer « nos » femmes (blanches) et supplanter « notre » civilisation, la femme trans joue le rôle d'un autre monstrueux et sexuellement dangereux contre lequel la droite promet d'ériger un cordon sanitaire. Le discours anti-trans possède souvent un fond conspirationniste et présente par exemple l'augmentation du nombre de transitions de genre comme le résultat d'un lobbying international et organisé. La vidéaste Lily Alexandre a montré que la transphobie alimentait le phénomène d'extrême-droitisation : c'est ainsi que la figure de Martine Rothblatt, femme d'affaires millionnaire, transgenre et juive, est devenue pour nombre de militant·es anti-trans une « preuve » de l'existence du lobby et de sa puissance fantasmée [19].
Les discours anti-trans comportent également une dimension eugéniste. Ils décrivent en effet les femmes trans comme des hommes aux perversions pathologiques, cherchant à transitionner par fétichisme sexuel ou dans le but de violer des femmes dans les toilettes [20]. Les hommes trans sont, eux, considérés comme des petites filles autistes, complexées ou influençables par leurs amis, victimes d'un lobby qui les pousse à l'automutilation. Bref, quel que soit leur genre, les personnes trans sont systématiquement ramenées à une forme de déséquilibre mental qui les rend soit dangereuses, soit moralement mineures.
Cette vision de la transidentité comme maladie justifie en retour une politique autoritaire visant à « corriger » le trouble, notamment au travers des thérapies de conversion ou de l'interdiction pure et simple de la transition de genre, légale ou médicale [21]. L'eugénisme s'exerce également dans le contrôle social des corps que la panique anti-trans encourage. Afin de « démasquer » des femmes qui seraient secrètement trans, nombre de forums internet s'affairent à décortiquer tous les attributs trop « masculins » qui pourraient trahir la véritable identité d'une femme trans. Cela débouche sur le harcèlement de femmes transgenres ou cisgenres considérées comme ayant des attributs hors des normes de la féminité [22]. Dans son expression la plus extrême, cette volonté de contrôle des corps s'est traduite par l'appel de la militante anti-trans Posie Parker aux hommes portant des armes à feu à utiliser les toilettes des femmes pour les « protéger », c'est-à-dire à venir y agresser des femmes considérées comme trans [23].
*
Illustration : Wikimedia Commons.
NOTES
[1] Yves Delahaie, Mariage pour tous vs Manif pour tous, ou La Bataille de l'égalité, Paris, Golias, 2015, p.308.
[2] Marie Donzel, « Pour ne pas faire du projet de loi-cadre sur l'égalité hommes/femmes la troisième mi-temps du débat sur le mariage pour tous », Ladies & Gentlemen (blog), 16 juillet 2013.
[3] P. Delage et F. Gallot (dir.), Féminismes dans le monde. 23 récits d'une révolution planétaire, Paris, Textuel, 2020.
[4] Voir Lumi et Usul, « Transphobie : la nouvelle panique des médias et de l'extrême droite », Blast, 5 mai 2024.
[5] La « Coupe d'Afrique des nations des quartiers » est une compétition de football amateur très suivie, organisée dans les quartiers populaires : s'y affrontent des équipes représentant différents pays d'Afrique.
[6] Voir Lina Rhrissi, « La sénatrice Jacqueline Eustache Brinio en croisade contre les musulmans et les quartiers populaires », StreetPress, 6 juillet 2020.
[7] Militantes anti-trans de premier plan, qui se sont distinguées en proposant à la presse (notamment à Marianne) les premières tribunes françaises visant à « dénoncer » la présence de femmes trans et d'alliées au sein d'organisations et collectifs féministes, comme les « collages contre les féminicides » ou Nous Toutes. Ce sont également les autrices de Transmania.
[8] Marguerite Stern et Dora Moutot, « Mme Élisabeth Borne, féministes, nous nous inquiétons de ce que devient le Planning familial », Marianne, 22 août 2022.
[9] « Mais nous avons un point commun : notre sexe longtemps désigné comme faible, le sexe féminin. Nous refusons que le mot qui nous relie soit effacé au profit d'étiquettes qui nous divisent » (ibid.).
[10] Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1949, chap. 2.
[11] Christine Delphy, « Le patriarcat, le féminisme et leurs intellectuelles », Nouvelles Questions féministes, no 2, 1981, p. 65.
[12] Andrea Dworkin, Right-Wing Women : The Politics of Domesticated Females, New York, Women's Press, 1983, p. 13.
[13] Ibid., p. 144.
[14] Ces “nouvelles femmes de droite” […] tentent de redéfinir le contenu de la cause des femmes. Femmes de droite parce qu'elles se positionnent contre les féminismes […]. Nouvelles parce qu'elles se distinguent de leurs prédécesseuses par leur rapport à l'égalité, leur sociologie et leur mode d'action. » (Magali Della Sudda, Les Nouvelles Femmes de droite, Marseille, Hors d'atteinte, 2022, p. 31).
[15] Caroll Riddell, « Divided Sisterhood : A Critical Review of Janice Raymond's The Transsexual Empire », in S. Stryker et S. Whittle (dir.), The Transgender Studies Reader, Londres Routledge, 2006, p. 146.
[16] En français, « retour de bâton » ou « contrecoup », il s'agit d'une campagne politique et médiatique réactionnaire visant à contrecarrer la progression du militantisme progressiste (notamment féministe). L'autrice féministe états-unienne Susan Faludi a décrit ce phénomène dans un ouvrage portant ce titre.
[17] Vincent Jolly, « Quand des transsexuels veulent l'effacement de la femme », Le Figaro, 28 octobre 2022. Notons que l'URL parle de « mort des femmes », signe qu'un titre encore plus outrancier a été corrigé depuis… Voir : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/wokisme-quand-des-transsexuels-veulent-la-mort-des-femmes-20221028
[18] Les femmes trans « remplacent » les femmes cis en devenant des femmes ; les hommes trans, eux, « remplacent » les femmes en cessant d'en être.
[19] Lily Alexandre, « The Feminist to Far-Right Pipeline », YouTube, 26 mars 2024.
[20] Julia Serrano, « Autogynephilia : A Scientific Review, Feminist Analysis, and Alternative “Embodiment Fantasies” Model », The Sociological Review, vol. 68, n° 4, 2020, p. 763-778.
[21] Voir Devin Dwyer, « Supreme Court Allows Idaho to Enforce Ban on Gender-Affirming Care for Minors », ABC News, 16 avril 2024.
[22]German Lopez, « Women Are Getting Harassed in Bathrooms Because of Anti-Transgender Hysteria », Vox, 19 mai 2016.
[23] Josh Milton, « “Gender-Critical Feminist” Posie Parker Wants Men with Guns to Start Using Women's Toilets », Pink News, 30 janvier 2021.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les émissions de méthane augmentent plus vite que jamais

Les concentrations atmosphériques de méthane n'ont jamais été aussi élevées depuis au moins 800'000 ans.
Tiré de A l'Encontre
12 septembre 2024
Par Global Carbon Project
Le budget mondial du méthane pour 2024 montre une augmentation de 20% des émissions de méthane dues aux activités humaines au cours des deux dernières décennies.
Le méthane est l'un des trois principaux gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Il ne reste dans l'atmosphère que quelques décennies, moins longtemps que le dioxyde de carbone et l'oxyde nitreux (N2O), mais son potentiel de réchauffement global à court terme est le plus élevé, car il retient davantage de chaleur dans l'atmosphère.
Le budget, établi par le Global Carbon Project, couvre 17 sources naturelles et anthropiques (induites par l'homme). Il montre que le méthane a augmenté de 61 millions de tonnes métriques par an.
« Nous avons observé des taux de croissance plus élevés pour le méthane au cours des trois dernières années, de 2020 à 2022, avec un record en 2021 », explique Pep Canadell, directeur du Global Carbon Project. « Cette augmentation signifie que les concentrations de méthane dans l'atmosphère sont 2,6 fois plus élevées que les niveaux préindustriels (1750). » Les activités humaines sont responsables d'au moins deux tiers des émissions mondiales de méthane, ajoutant environ 0,5°C au réchauffement climatique qui s'est produit jusqu'à présent. »
Le rapport conclut que l'agriculture est à l'origine de 40% des émissions mondiales de méthane d'origine anthropique. Le secteur des combustibles fossiles en produit 34%, les déchets solides et les eaux usées 19%, et la combustion de la biomasse et des biocarburants 7%.
Les cinq principaux pays émetteurs en 2020 étaient la Chine (16%), l'Inde (9%), les Etats-Unis (7%), le Brésil (6%) et la Russie (5%).
L'Union européenne (UE) et l'Australasie [Australie et Nouvelle-Zélande, intégrées à une partie de l'Océanie] ont réduit leurs émissions anthropiques de méthane au cours des deux dernières décennies. Toutefois, les tendances mondiales mettent clairement en péril les engagements internationaux visant à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici à 2030.
Pour des trajectoires d'émissions nettes nulles compatibles avec l'objectif de l'Accord de Paris [décembre 2015, COP 21] d'une augmentation maximale de la température de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, les émissions anthropiques de méthane doivent diminuer de 45% d'ici à 2050, par rapport aux niveaux de 2019. (Article publié sur le site Climate&Capitalism le 10 septembre 2024 ; traduction par la rédaction A l'Encontre)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les bombes nucléaires ne sont pas à l’abri de la crise climatique

Les liens entre les armes nucléaires et le changement climatique sont « largement ignorés », dénoncent des chercheurs. Mégafeux près de sites nucléaires, montée des eaux… Les menaces sont pourtant bien présentes.
Article tiré de NPA 9
La crise environnementale risque-t-elle de provoquer une apocalypse nucléaire ? On peut le soupçonner. Rien n'est certain, tant le déni est massif et la recherche inexistante. « Les liens entre les arsenaux nucléaires et les transformations environnementales en cours sont largement ignorés » aussi bien par la recherche que par les États, alertent Benoît Pelopidas, Thomas Fraise et Sterre van Buuren dans un article publié dans la revue Raison présente en juin dernier.
Les chercheurs au Ceri à Sciences Po dans le programme d'étude Nuclear Knowledges dénoncent ce « postulat d'indépendance réciproque ». Ils appellent à explorer ces relations d'urgence, alors que la menace climatique semble de plus en plus tangible — des mégafeux de forêt ont ainsi récemment menacé des sites nucléaires américain et russe.
Pour en arriver à ce constat, le trio a épluché toutes les études et les documents de planification militaire des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de la Russie — qui détiennent 93 % des arsenaux nucléaires mondiaux — parus entre 1990 et 2022. « On était persuadés que la question du risque environnemental était tellement importante que quelqu'un l'aurait posée et qu'il suffisait de faire une bonne revue de littérature pour y trouver une réponse satisfaisante », se souvient Benoît Pelopidas.
La récolte fut maigre : aucun article scientifique en trente-deux ans, et seulement une évocation des armes nucléaires dans le rapport Defence and Climate Change de la Chambre des communes britannique. « Les documents stratégiques étudiés ne mentionnent que rarement les transformations environnementales. Quand ils le font, c'est de manière périphérique et sans faire le lien avec les armes nucléaires », concluent les chercheurs dans leur article.
Pourtant, le secteur militaire est de plus en plus attentif au risque environnemental. « Depuis 2020, on constate une tendance à penser le lien entre le climat et la défense en général, note Sterre van Buuren. Les États-Unis, notamment, ont publié plusieurs documents assez détaillés sur le sujet. » En France, l'ex-ministre des Armées Florence Parly a de même approuvé en 2022 le projet de stratégie ministérielle Climat & Défense pour « préparer les forces armées au défi climatique » — mais le mot « nucléaire » n'y apparaît pas une seule fois. À l'inverse, en 2023, des députés du Rassemblement national ont présenté une proposition de loi visant à inscrire la possession d'armes nucléaires dans la Constitution, pour la protéger de « l'idéologie écologiste ».
Mégafeux, montée des eaux…
Pourtant, la menace se précise. En février, les activités de l'usine d'assemblage et de démontage d'armes nucléaires Pantex, au Texas,ont dû être interrompues suite à des feux de forêt autour des installations. Un tel événement s'était déjà produit en Russie à l'été 2020, durant lequel un canal de plusieurs kilomètres avait été creusé pour protéger le site de recherche sur les armes nucléaires de Sarov.
Outre les feux de forêt, d'autres phénomènes climatiques et environnementaux extrêmes, comme l'érosion des côtes, pourraient affecter les installations nucléaires militaires, estiment les chercheurs. Ils appellent ainsi à des recherches approfondies sur les risques encourus par la base navale de Fastlane, près de Glasgow en Écosse. « Dès 2001, William Barclay Walker et Malcolm Chalmers montraient dans leur livre “Uncharted Waters” que cette base était le seul endroit où le Royaume-Uni pouvait baser des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Si elle devenait inopérante, le Royaume-Uni deviendrait le seul État à devoir baser son arsenal nucléaire à l'étranger », rappelle Benoît Pelopidas.
Pour l'heure, le déni est massif, selon Sterre van Buuren : « Nous avons trouvé une évaluation de cette base. Le seul risque identifié, c'est un accroissement de la population de mouettes avec un impact sur le moral des personnels à cause du bruit », rapporte la chercheuse, incrédule. Aux États-Unis, la Fondation Carnegie pour la paix internationale s'est bien penchée sur le problème de la montée des eaux. Mais l'a minimisé et présenté comme un problème « que l'on peut résoudre en apportant beaucoup d'argent et de technologie aux structures existantes », regrette Benoît Pelopidas.
Il est d'autant plus important d'étudier la relation entre arsenal nucléaire et crise climatique que cette dernière est à double sens. « La production, le stockage et le démantèlement de systèmes d'armes nucléaires, y compris les vecteurs, ainsi que l'installation des infrastructures nécessaires, constituent des activités génératrices de gaz à effet de serre et de déchets hautement toxiques », rappellent les auteurs. Qui soulignent que cette filière représente aussi un coût important et risque de priver les États de ressources financières pour mener à bien leur transition énergétique.
Pour le trio, ce travail de recherche est crucial alors que la course à l'armement se poursuit. Les neuf États dotés de l'arme atomique dans le monde se partagent environ 12 500 têtes nucléaires. Depuis 2010, tous les États qui en sont dotés sont dans une dynamique de prolongation, voire d'augmentation de taille de leurs arsenaux. Fin août, The Guardian a révélé que les États-Unis se préparaient désormais à des attaques conjointes de la Chine — qui augmente actuellement la taille de son arsenal —, de la Russie et de la Corée du Nord. « C'est évidemment une mauvaise nouvelle, cela produit une justification pour une accélération du réarmement américain », observe Benoît Pelopidas.
En 2023, les États-Unis ont ainsi dépensé 51,5 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) rien que pour l'acquisition de nouvelles armes. Malgré la crise climatique, « l'orgie nucléariste » qu'observe le chercheur de Sciences Po est loin d'être terminée.
Émilie Massemin 10 septembre 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Paul Watson répond à Reporterre : « La prison est devenue mon navire »

Depuis la prison de Nuuk, au Groenland, le défenseur des baleines Paul Watson raconte à Reporterre sa détention, les enjeux du procès qui l'attend le 2 octobre ainsi que les racines de son engagement pour les océans.
12 septembre 2024 | tiré du site de reporterre.net | Photo : Paul Watson, alors qu'il était libre mais déjà poursuivi par le Japon, à Paris, en 2015. - © Loic Venance / AFP
https://reporterre.net/Paul-Watson-repond-a-Reporterre-La-prison-est-devenue-mon-navire?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdomadaire
Nos questions sur l'avenir de l'océan, les tactiques militantes et la meilleure manière d'obtenir des victoires écologistes, nous aurions préféré les poser à Paul Watson « en vrai ». Sûrement à Paris, sur la péniche en bois où il vivait encore il y a quelques mois.
Seulement voilà. Mercredi 4 septembre, la justice danoise a annoncé prolonger de 28 jours la détention du défenseur des baleines. Le fondateur de Sea Shepherd, qui patiente depuis près d'un mois et demi dans les geôles groenlandaises, y restera jusqu'à son procès, le 2 octobre. La Cour devra alors trancher sur son extradition — ou non — au Japon. L'activiste de 73 ans y encourt 15 ans de prison, selon sa défense.
Le pays asiatique, qui fait partie des trois derniers États à pratiquer la chasse à la baleine, poursuit le capitaine pour « conspiration d'abordage ». L'affaire remonte à une quinzaine d'années. En février 2010, l'écologiste Pete Bethune, venu prêter main forte à l'équipage de Paul Watson lors d'une mission en Antarctique, était monté sur un baleinier japonais, le Shonan Maru 2. Selon la défense de Paul Watson, Pete Bethune aurait fait cela afin de lui présenter la facture de son navire, l'Ady Gil, coulé un mois plus tôt par ledit baleinier.
D'après le Japon, un pêcheur aurait été blessé par des boules puantes lors de cet abordage. Ce à quoi les soutiens de Paul Watson rétorquent que le pêcheur en question ne se trouvait pas sur le pont au moment de l'action. Le produit utilisé aurait par ailleurs été de l'acide butyrique, un produit inoffensif utilisé pour donner une mauvaise odeur à la viande de baleine, selon la défense de Paul Watson.
Avant que la justice danoise rende son jugement, nous avons souhaité sonder le capitaine sur ses conditions d'incarcération et son ressenti. Lamya Essemlali, la présidente de Sea Shepherd France qui lui rend visite quasi-quotidiennement, a accepté de lui poser nos questions. Téléphones et ordinateurs portables étant interdits au centre de détention, elle a retranscrit ses réponses sur une feuille de papier, avant de nous les transmettre. Les voici, en exclusivité.
Reporterre —Comment se passe votre détention ? Comment allez-vous ?
Paul Watson — Je suis bien traité en prison, hormis quand ils m'ont menotté dans le dos très serré pour m'emmener au tribunal le 15 août dernier. Ils ne m'ont pas mis de ceinture de sécurité et j'étais ballotté à l'arrière, ça a blessé mon poignet et depuis j'ai beaucoup de mal à écrire.
Comme on ne m'autorise pas l'accès à la salle informatique de la prison — à laquelle d'autres prisonniers ont pourtant accès — et qu'ils ont refusé que mes amis m'amènent une machine à écrire, je suis obligé d'écrire à la main et c'est très douloureux. J'essaye de répondre aux gens qui m'écrivent mais je n'arrive pas à faire plus de trois cartes avant d'avoir trop mal. C'est frustrant…
À part ça, les conditions ici sont correctes, pour une prison. J'ai une cellule juste pour moi et les prisonniers ont accès à une cuisine collective donc je peux cuisiner mes propres repas. Depuis ma cellule j'ai vue sur le fjord et parfois il m'arrive de voir passer des baleines… J'imagine que je suis sur la passerelle d'un bateau… les baleines au milieu des icebergs… et les yeux du monde braqués sur la chasse baleinière, précisément parce que je suis ici. La prison de Nuuk est devenue mon navire.
Le 4 septembre, la justice danoise a annoncé que vous resteriez 28 jours de plus en détention. Quelle est votre réaction à cette décision ?
Je suis sidéré par la partialité de ce juge. Comment peut-il accepter de prendre en considération les preuves de l'accusation mais refuser de considérer les nôtres ?
Tout ceci est une parodie de justice, visant à satisfaire l'esprit vindicatif d'un gouvernement japonais qui s'est senti humilié par mes actions. Ils ne me pardonnent pas d'avoir exposé à la face du monde leur chasse illégale aux baleines dans l'océan Antarctique à travers la série télé « Whale Wars » [« Justiciers des mers »]. Depuis 2012, ils tentent de me le faire payer à travers un mandat d'arrêt politique. Il semble qu'ils n'aient jamais été aussi près d'y parvenir.
La Cour a une fois de plus refusé de regarder les vidéos qui prouvent, selon vous, votre innocence. Pourquoi ?
Le juge groenlandais refuse d'analyser nos preuves car elles le forceraient de facto à ordonner ma libération. Or il a bien conscience que mon affaire est politique et suivie de près par le gouvernement japonais qui pèse de tout son poids pour me mettre la main dessus. Il ne veut pas être celui qui prive le Japon de sa vengeance. Et donc, il faillit à sa mission de justice, tout comme Interpol a failli au respect de son propre règlement en publiant une notice rouge à mon encontre reposant sur un motif politique.
Vous vous trouvez désormais en prison depuis près d'un mois et demi. Vous avez trois enfants, dont deux ont moins de dix ans. Comment vivez-vous cette situation ?
Être éloigné de mes enfants est ce qu'il y a de plus dur. Savoir qu'ils s'inquiètent pour moi m'attriste, plus que d'être injustement enfermé. Mon fils de 7 ans espérait que je serais rentré pour son huitième anniversaire le 29 septembre prochain et ça ne sera sans doute pas le cas. Il a vu les images de moi menotté et ça l'a mis très en colère. J'aimerais pouvoir le consoler et le rassurer. Mais il sait pourquoi je suis emprisonné, et il est fier de moi.
Avez-vous peur d'être extradé au Japon ?
J'ai du mal à imaginer qu'un pays comme le Danemark dont le système judiciaire est respectueux des réglementations européennes et des droits de l'Homme pourrait concéder mon extradition vers un pays condamné pour violation des droits de l'Homme dans ses prisons, particulièrement à l'égard des activistes étrangers.
Lire aussi : Pour libérer Paul Watson, une campagne de soutien sans précédent
Nous avons une relation conflictuelle avec le Danemark, depuis de nombreuses années, en raison des massacres de dauphins aux îles Féroé. C'est peut-être pour cela que le Japon a émis un mandat d'arrêt contre moi ciblant spécifiquement le Danemark au mois de mars dernier. Mais j'ai toujours pensé que défendre cette planète est une cause qui vaut de risquer sa vie. Tout ce que je sais, c'est que si je suis envoyé au Japon, je n'en reviendrai pas.
Si c'est le cas, auriez-vous des regrets ? La défense des baleines en valait-elle le coup ?
Je dois ma vie à une baleine. Une baleine qui a choisi de m'épargner alors qu'elle aurait pu me tuer. C'était un cachalot qui venait de se faire harponner par un baleinier russe. Ce cachalot est venu près de nous alors que nous étions dans un petit bateau pneumatique en train d'essayer de stopper les baleiniers [en 1975], et elle était sur le point de nous écraser.
« Je n'ai aucun regret »
Mais pendant un instant, nous avons eu une connexion. J'ai regardé dans l'œil de cette baleine et j'ai su qu'elle comprenait ce qu'on essayait de faire. Et j'ai vu l'effort qu'elle a fait pour retourner dans l'océan et épargner nos vies.
Ça m'a changé pour toujours. Je serai à jamais redevable de ce cachalot et de la nation des baleines. Donc non, je n'ai aucun regret. J'ai suivi mon cœur toute ma vie.
Le Japon vous poursuit pour une histoire qui date d'il y a presque quinze ans. Comment analysez-vous l'acharnement du pays contre vous ?
Le Japon savait que je comptais les empêcher de tuer des baleines dans le Pacifique nord. En mai dernier ils ont lancé le plus grand baleinier de l'histoire, le Kangei Maru. Nous avons un lourd passif avec les missions que j'ai menées contre eux en Antarctique pendant plus de 10 ans. J'ai pu, avec toutes mes équipes, sauver plus de 5 000 baleines et j'ai exposé à des millions de gens leurs actions illégales. Ils ne me pardonnent pas cette humiliation.
Lire aussi :Le capitaine Paul Watson, une vie entre les filets de la justice
Comment expliquez-vous que le Japon consacre autant d'énergie à la défense de la chasse à la baleine, alors que la consommation de baleines n'y fait que diminuer ?
Cette chasse n'a aucun sens. Moins de 2 % des Japonais mangent de la viande de baleine et le gouvernement japonais essaye désespérément, à grand renfort de campagnes marketing, de stimuler l'appétit des Japonais pour les baleines. Ils ont même sorti le hamburger de baleine pour séduire les jeunes mais ça ne prend pas…
Lire aussi : Ce que dit l'affaire Paul Watson de notre fascination pour les baleines
Ce qu'il se passe, c'est qu'une poignée de nantis, anciens membres du gouvernement, issus de la droite ultranationaliste, bénéficient de postes extrêmement bien rémunérés avec de nombreux privilèges au sein de cette industrie qui existe sous perfusion d'argent public. Ces gens s'accrochent à cela et parce qu'ils sont influents, ils pèsent de tout leur poids pour maintenir coûte que coûte cette chasse.
Les yakuzas [la mafia japonaise] détiennent également les ports de chasse et les syndicats au sein desquels sont recrutés les marins qui embarquent sur les bateaux de chasse. Tout ceci est une affaire d'argent au profit de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre. À commencer bien sûr par les baleines.
Voyez-vous votre arrestation comme un signe de l'intensification de la répression à l'égard des écologistes ?
Les gouvernements ont le monopole de la violence légitime. Et quand ils sont des puissances économiques, ils peuvent peser de tout leur poids et traquer les activistes et les lanceurs d'alerte. Ce qui se passe avec la notice rouge d'Interpol est un bon exemple. Cet outil qui doit servir à traquer les criminels et les assassins est de plus en plus détourné de son objectif initial pour traquer les gens qui s'opposent à des gouvernements pour des raisons parfois très légitimes.
« Il n'y a pas de plus belle cause que celle de la défense du vivant »
Plus nos écosystèmes vont se dégrader du fait de nos actions cupides et stupides, plus la résistance va s'intensifier et plus la répression sera dure. L'avenir pour nos enfants va être difficile mais il n'y a pas de plus belle cause que celle de la défense du vivant. Nous allons au-devant de grands défis et il est du devoir de chacun d'y contribuer, à sa façon et selon ses moyens.
L'annonce de votre arrestation a touché énormément de monde en France et dans le reste du monde. Qu'espérez-vous voir émerger de cette vague de soutien ?
Je suis très touché par les nombreuses lettres que je reçois en prison. Énormément de dessins et de mots d'enfants qui me touchent particulièrement. D'ailleurs sur les quelque 1 200 courriers que j'ai reçus, 760 viennent de France. Le reste vient d'une vingtaine de pays différents donc quatre, très touchants, du Japon. J'ai donné toutes ces lettres à Lamya pour qu'elle les ramène en France, je souhaite en faire un livre.
J'espère que mon emprisonnement permettra de braquer les projecteurs sur ce que le Japon fait subir aux baleines. Ces milliers de baleines qu'il tue en toute impunité, en violation du moratoire sur la chasse commerciale, en violation du sanctuaire baleinier antarctique, de la Commission baleinière internationale. Le Japon a été condamné par la plus haute juridiction mondiale à la Haye en 2014 et par la Cour fédérale australienne en 2014 pour la chasse des baleines. Mais le Japon s'estime au-dessus des lois et aujourd'hui ça n'est pas lui qui rend des comptes, c'est moi qui suis emprisonné… Donc j'espère que cette situation permettra aux gens de comprendre.
Lire aussi : Soutien de Macron à Paul Watson : « C'est du greenwashing »
Comment espérez-vous voir le mouvement de défense des océans évoluer dans les prochaines années ? Comment peut-il espérer obtenir des résultats ?
C'est la diversité du mouvement qui fera sa force. Ce que je fais est un exemple et correspond à certaines personnes, mais il y a mille et une façons de s'engager. J'encourage toujours ceux qui me demandent que faire à sonder leur cœur. Ce sont eux qui ont la réponse, pas moi. Il s'agit de faire ce qu'on aime et d'utiliser son talent et sa passion pour contribuer à la défense de la planète.
Que vous soyez, artiste, avocat, enseignant, marin, photographe, écrivain, mécanicien, scientifique, cuisinier… Tout le monde peut contribuer et le fera d'autant mieux que ça sera à travers ce qu'il sait et aime faire. Si l'océan meurt, nous mourons.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des recettes réactionnaires à la crise écologique

Face aux contradictions mises en évidence par la crise écosystémique, le capital intensifie conflits, répression et exploitation. L'extrême-droite formule des propositions qui approfondissent cette dynamique.
Photo et article tirés de NPA 29
Quel est l'intérêt de dire la vérité sur le fascisme – qui est condamné – si rien n'est dit contre le capitalisme qui l'engendre ?
Bertolt Brecht
Le changement climatique est déjà une réalité qui impacte nos vies au quotidien. Il avance de pair avec les phénomènes météorologiques extrêmes qui nous accablent et se normalise par la répétition successive, inégale et combinée de ses effets.
Il n'est plus exceptionnel d'entendre parler de graves périodes de sécheresse dans la région méditerranéenne, de la raréfaction des ressources fossiles et des matières premières stratégiques dans le nord de la planète, de la perte de sols fertiles pour la production agroalimentaire ou de l'augmentation des incendies de sixième génération dans le monde entier. L'apparition quotidienne de ces éléments ne se fait pas dans l'abstrait ou de manière isolée, mais se combine et se nourrit d'autres phénomènes tels que les pénuries, l'inflation ou la spirale guerrière. Elle s'inscrit dans un contexte de crise et d'instabilité qui a son fondements dans le mode de production capitaliste.
Ce scénario nous expose à un long cycle de turbulences, de catastrophes et de changements auxquels le capital est loin d'être préparé par sa politique économique à court terme, mais qui, à son tour, ouvre sur un moment de transition par rapport à l'ordre actuel des choses. Ceci a des implications politiques claires que nous, écosocialistes, devons être en mesure d'aborder.
Nos « Années folles »
Les contradictions mises en évidence par la crise écosystémique constituent un défi pour le processus d'expansion constante de l'accumulation du capital. Confronté à un impératif de croissance et à un besoin infini de profit, celui-ci se heurte aux limites biophysiques de la planète. Dans cette contradiction, le fragile équilibre qui sous-tend les fondements du régime d'accumulation du capital est mis à nu et il devient plus clair que sa limite réside dans les sources de sa richesse. Comment en effet aspirer à une croissance infinie sur un temps, des ressources, des vies et des territoires finis ? Face à ce constat, le capital propose une restructuration de ses circuits d'extraction de la valeur.
Des exemples de ce processus de restructuration peuvent être trouvés dans l'intensification du taux d'exploitation du travail, de la nature et des forces de reproduction ; dans le renforcement des pratiques rentières, de la spoliation et de la dépossession dans les espaces clés de la reproduction sociale comme le logement, l'alimentation, les produits de base, etc. ; ou encore dans l'intensification des conflits géopolitiques et impérialistes – qui ne se produisent pas seulement avec l'arrivée des sociétés transnationales, mais aussi dans les territoires où, après les occupations, les pratiques génocidaires et la répression, les ressources sont spoliées.
Ces différents éléments qui agissent comme des mécanismes pour assurer la reproduction du capital modifient les bases sur lesquelles notre réalité sociale est construite. Cela transforme les relations de genre, les configurations raciales, les régimes sexuels et les structures qui les soutiennent et affaiblissant les pratiques démocratiques, les droits et les libertés. Ainsi, la restructuration du capital en ces temps de transition s'accompagne d'une reconfiguration des relations sociales dans le cadre d'une plus grande contestation et de contrôle à caractère réactionnaire, conservateur et libéralisateur.
Les changements que nous observons dans cette période de transition ne sont pas synchronisés, ni immédiats et ne s'expriment pas de la même manière partout, mais ils montrent une tendance croissante dans les propositions de résolution de la crise écologique. Elles avancent des recettes qui impliquent un creusement des inégalités, une intensification de la violence marchande et une montée de l'autoritarisme dans l'approche de la question écologique.
La terre et la nation
Max Ajl dans A People's Green New Deal (2021) a recensé les réponses réactionnaires face à la crise écologique. À travers une analyse critique des fondements idéologiques de diverses propositions, il souligne que, dans l'archipel de l'extrême-droite, des réponses sous forme de nationalisme vert et de racisme fossile existent. Ajl a ainsi mis en évidence un changement de comportement de l'extrême droite qui, loin de se concentrer uniquement sur la négation de la crise écologique et des impacts du changement climatique, ose formuler des propositions qui approfondissent les dynamiques impérialistes et incitent à l'ouverture de nouvelles frontières de l'accumulation.
Dans cette lignée, parmi les recettes réactionnaires, on trouve des projets et des propositions face à la crise écologique qui se focalisent sur la question de la sécurité nationale. Il s'agit de réponses qui considèrent la dégradation écologique comme une menace pour l'identité nationale, les convictions et les conditions de vie, et qui proposent donc une accélération des processus de sécurisation, de contrôle et de fermeture des frontières. Il s'agit de propositions qui reproduisent l'idée qu'il y a des corps qui comptent et d'autres qui ne comptent pas, des mort·es qui méritent d'être pleuré·es et d'autres non, des territoires qui peuvent être exploités, violés et détruits et d'autres qui doivent être sanctifiés.
Une politique écologiqueraciste, xénophobe et anti-immigration est déployée sous la maxime « si vous voulez protéger la nation, vous devez protéger la terre, l'environnement ». Le RN en France, le FPÖ en Autriche ou Aliança Catalana en Catalogne reprennent cette position dans leurs programmes et campagnes électorales, prônant la défense de la nature à partir d'un patriotisme vert.
Ce pari réactionnaire va de pair avec la promotion de propositions qui proposent la résolution de la crise écologique par l'ouverture de nouvelles frontières d'accumulation. On retrouve ici toutes les propositions qui font de l'adaptation, de l'atténuation ou de la transition de nouveaux marchés verts transnationaux dans lesquels investir, ainsi que les différents mécanismes de marché, les bulles spéculatives et les processus de financiarisation de la nature, de la biodiversité et du climat sous la forme de marchés à terme et de marchés du carbone, d'obligations vertes, de politiques compensatoires pour les services écosystémiques ou d'échanges dette-nature.
Des propositions qui reproduisent le comportement à court terme du capital et favorisent l'intensification des conflits, l'intensification des taux d'exploitation et des pratiques de recherche de rente, sans remettre en cause le fait qu'elles sont aussi à l'origine de l'aggravation de la crise écologique. Des recettes néolibérales configurées par un écologisme réductionniste qui dit que ce qui est détruit peut toujours être substitué et contenu, et agit selon la maxime que tout est commercialisable.
Le cadre qui engendre ces prescriptions face à la crise écologique dépasse les limitesde l'extrême-droite et imprègne les discours, les programmes et les propositions des forces de droite conservatrices, libérales et sociales-démocrates. Il pénètre dans les mouvements écologistes et paysans et pose un défi interne à nos collectifs : que les discours racistes, xénophobes et anti-immigration sont aussi produits dans les rangs écologistes et que les rêves hyper-individualistes et marchands du capitalisme vert sont aussi partagés dans les rangs écologistes.
Ainsi, la force des recettes réactionnaires ne dépend pas seulement de la montée de l'extrême-droite dans nos territoires – qui se développe et s'étend chaque jour – mais aussi de sa capacité à ébranler la machine infernale en période de transition et à faire croire que ce n'est qu'à l'intérieur des marges du capital que l'on pourra surmonter ce que la crise écologique nous réserve aujourd'hui.
Dans le conflit, une note d'espoir
Si l'intensification et l'avancée de la crise écologiqueconstituent un défi pour les propositions écosocialistes et de classe, la montée de l'extrême-droite mondiale et l'expansion de ses recettes réactionnaires impliquent un degré supplémentaire de complexité. La normalisation de plus en plus avérée de la barbarie dans les guerres, les génocides, les pillages et aux frontières augmente le niveau d'urgence et la nécessité de briser l'hégémonie d'un capitalisme sauvage qui vit en tournant le dos à sa propre survie. Il est donc essentiel de reconnaître que dans tout processus de reconfiguration des relations sociales médiées par le capital, ce ne sont pas seulement des réponses réactionnaires qui émergent : dans leurs ruptures, des propositions alternatives de formation de la vie émergent également.
Face à un capital qui, depuis des années, construit divers instruments politiques pour assurer à tout prix la continuité de ses objectifs, il existe unevaste généalogie de luttespour la défense de la terre, de la santé et de la vie qui font école. Le fait est que la restructuration du capital n'a jamais été exempte de conflits et que nous avons appris d'eux.
Nous savons qu'il n'y a pas de recette magique pour la crise écologique ou de moyens faciles pour retirer les griffes du système capitalistede nos corps-territoires. Mais nous savons que, dans chaque confrontation, dans chaque expérience de lutte, nous nous reconnaissons les un·es les autres et nous semons la voie de l'auto-organisation de classe comme un outil-clé de la contestation. Nous apprenons l'attention, l'affection et le soutien mutuel entre nous, et nous synthétisons de nouvelles propositions capables de briser les chaînes qui nous lient. Et nous tissons des ponts transfrontaliers en détectant un ennemi commun, ce qui nous renforce dans la certitude qu'il n'y a pas de frein d'urgence s'il n'est pas pour nous tou·tes.
C'est peut-être dans ce tou·tes que se trouve la question centrale d'une proposition qui se situe en dehors des recettes réactionnaires. La force et la radicalité d'une proposition écosocialiste et de classe sont condensées dans une politique irrévérencieuse, un engagement révolutionnaire construit sur la solidarité, l'internationalisme et l'anti-impérialisme, et qui fait de la diversité, de la pluralité et de la démocratie ouvrière un terrain fertile pour la dispute politique.
Article paru en castillan dans la revue Lab Sindikazua. Traduction : Juan Tortosa pour SolidaritéS.
8 septembre 2024 Joana Bregolat
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Travail des femmes : comment la guerre a changé le marché du travail en Ukraine

En raison de la migration massive et de la mobilisation en raison de l'invasion russe, de nombreuses entreprises ukrainiennes connaissent un manque de personnel. Une des réponses à cette situation est l'implication des femmes dans des métiers auparavant considérés comme « masculins ».
Tiré de Entre les lignes et les mots
Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays se sont livrés à des pratiques similaires. Par exemple, en Pologne, les femmes ont participé activement à la production industrielle. À partir du milieu des années 1950, elles ont été remplacées par des hommes, mais selon certaines sources, les femmes ont résisté à cette évolution parce que les emplois dans l'industrie étaient mieux payés et plus prestigieux.
En Ukraine, où l'embauche de femmes dans certaines professions a longtemps été strictement interdite, la majorité d'entre elles travaillent dans les domaines traditionnellement peu rémunérés de l'éducation, de la santé, des services et du commerce. C'est la principale raison pour laquelle les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, même si parmi elles le pourcentage de personnes ayant fait des études supérieures est plus élevé. Il est également intéressant de noter que parmi les 2 millions d'entrepreneur·es individuel·les, où les femmes et les hommes sont à peu près égaux en nombre, les domaines d'activité se reproduisent de la même manière : les femmes sont principalement dans le commerce et les services, et les hommes dans les travaux de réparation.
Cette situation est typique de la plupart des pays du monde. Cependant, l'Ukraine, qui connaît des bouleversements dus à l'agression russe et s'efforce également d'éliminer les normes discriminatoires, dispose d'une fenêtre d'opportunité pour certains changements.
Olena Tkalich a interrogé Yuliya Dmytruk sur comment la législation ukrainienne concernant l'emploi des femmes a changé ces dernières années et si l'on peut s'attendre à une participation significative des femmes dans les professions dites « masculines ».
Yuliya Dmytruk, avocate de l'organisation La Strada, s'occupe de la protection des droits des femmes. La Strada a également plaidé pour l'adoption de la Convention d'Istanbul et s'est opposée aux restrictions des droits des femmes dans certaines professions.
Comment les normes juridiques concernant le travail des femmes ont-elles changé en Ukraine ?
Jusqu'en 2017, l'Ukraine disposait de l'arrêté n°256 du ministère de la Santé, adopté en 1992, qui contenait une liste de 45 professions interdites aux femmes. Cette disposition violait les droits des femmes, car elle les plaçait dans une position inégale par rapport aux hommes. L'État estimait que le rôle principal des femmes est reproductif. Elles n'avaient donc pas besoin d'un salaire décent. Mais nous savons que toutes les femmes ne vivent pas dans des familles « complètes ». Il y a celles qui élèvent seules leurs enfants et subviennent seules aux besoins de leur famille (il y avait environ un million de familles monoparentales en Ukraine en 2021. En raison des faibles salaires des femmes et du soutien social limité, elles courent un risque élevé de chute en dessous du seuil de pauvreté). Et les emplois figurant sur la liste des professions interdites garantissaient pour la plupart un niveau de rémunération décent. Bien sûr, certaines d'entre elles impliquent un travail physique intense. On estimait que ces emplois avaient un effet néfaste sur la vie d'une femme. Bien que personne n'ait pensé au fait que cela affecte négativement la vie et la santé des hommes. L'abrogation de cette ordonnance a donc permis l'amélioration des conditions de travail pour tous et toutes.
En 2022, la Verkhovna Rada [parlement] a introduit des amendements à la loi ukrainienne « Sur l'organisation des relations de travail dans le cadre de la loi martiale ». Selon l'article 9, paragraphe 1, les femmes sont autorisées à travailler même dans les travaux souterrains (bien qu'en réalité, dans les régions industrielles, où le travail souterrain était la seule possibilité de gagner un salaire décent, les restrictions ont été contournées et s'est créée une « une zone grise »). Il existe actuellement une grave pénurie de personnel dans de nombreux domaines. Par conséquent, un travail à grande échelle est en cours pour recycler les spécialistes et des opportunités s'ouvrent aux femmes pour un emploi dans des types de travaux tels ceux qui demandent un travail « physique ». D'un autre côté, les employeurs améliorent les conditions de travail, en utilisant des mécanismes robotisés qui permettent aux femmes d'effectuer des travaux plus exigeants sur le plan physique.
L'impact de ces changements peut-il être évalué ? Combien de femmes maîtrisent des métiers dits « masculins » ?
Le Service national de l'emploi confirme la tendance de l'évolution des métiers chez les femmes. En 2023, 158 000 femmes ont trouvé un nouvel emploi et ont choisi, entre autres, les spécialités suivantes : grutière, opératrice de machine, opératrice d'installation souterraine, chargeuse, conductrice, serrurière. En outre, l'année dernière, avec l'aide du Service national de l'emploi, 1 200 femmes ont trouvé du travail dans le secteur de la construction – elles représentent désormais 38% de tous les employés du secteur. En 021, il y avait 20% de femmes dans la construction.
Actuellement, le ministère de l'Économie soulève la question de la nécessité de reconvertir les femmes pour qu'elles maîtrisent ces métiers, car la demande pour de telles travailleuses existe et augmente de plus en plus. On sait que dans de nombreux domaines différents, les femmes travaillent déjà dans des spécialités pour lesquelles les hommes étaient auparavant recherchés, par exemple :
* Dans les stations-service UPG, les femmes occupent des postes de conductrice, de pompiste, de chargeuse et d'agente de sécurité.
* Dans le commerce de détail, les femmes sont invitées à travailler comme agentes de sécurité et conductrices. Par exemple, ATB emploie plus de 900 femmes comme agentes de sécurité. Celles qui le souhaitent peuvent également suivre une formation de conductrices de chariot élévateur. Chez Fozzy Group, les femmes sont employées comme conductrices de camion.
* Chez ArcelorMittal Kryvyi Rih, de plus en plus de femmes travaillent comme concasseuses, conductrice d'excavateur à godets, mécaniciennes et opératrices de machines.
* (D'autres exemples bien connus comme l'exploitation agricole Kernel, qui a commencé pour la première fois à embaucher des femmes pour des postes d'opératrices de chaufferies et de production. Le ministère du Développement communautaire, des Territoires et des Infrastructures de l'Ukraine forme des femmes à conduire des camions. Le métro de Kyiv a également annoncé l'embauche de femmes pour des métiers dits « masculins » – ndlr). Nous étions très heureuses que la première conductrice de train soit enfin apparue dans le métro de Kyiv. Nous avons également entendu parler d'éventuelles attitudes biaisées de la part de certains managers. (L'une des candidates au poste a déclaré que le manager lors de l'entretien avait ridiculisé l'initiative d'embauche de femmes – ndlr). Mais aucun appel ni aucune plainte n'ont été déposés auprès de La Strada concernant une telle discrimination.
Comment les femmes doivent-elles réagir en cas de discrimination ?
Si une femme est confrontée à des situations similaires, elle peut, sur la base de la législation, déposer une plainte, premièrement, auprès de la direction de l'entreprise ou de l'institution concernée, et deuxièmement auprès du Service national du travail. Troisièmement, contactez le commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada d'Ukraine. En outre, la loi ukrainienne « sur la publicité » interdit la publication d'offres d'emploi indiquant le sexe, l'âge et d'autres informations similaires. Mais on peut encore tomber sur des publicités disant « Seules les femmes de moins de 30 ans sont acceptées ». Dans ce cas, les plaintes doivent être soumises au Service national du travail avec une déclaration écrite et un lien vers la ressource sur laquelle elles ont trouvé une telle annonce.
Alyona Tkalich, 9 septembre 2024
Publié par Socportal
Traduction Patrick Le Tréhondat
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tribune « La récolte ou la vie » – il est urgent de rétablir le repos hebdomadaire des saisonniers

La mort tragique de six vendangeurs et vendangeuses en 2023 (2 dans le Rhône et 4 dans la Marne), survenue dans un contexte de travail par fortes chaleurs et de dérogation au jour de repos hebdomadaire, n'a malheureusement pas pesé lourd face à la pression exercée par certains syndicats agricoles au début de l'année 2024.
Ces derniers, en rejetant non seulement les normes environnementales mais aussi, de manière implicite, les normes sociales, ont ciblé les droits des ouvrier·es agricoles. Un décret contre le droit du travail et la santé des travailleur·euses agricoles Le 9 juillet 2024, seulement deux jours après la défaite de l'ex-majorité, paraît au journal officiel le dernier décret « Attal ».
Sur reprise d'une idée du Rassemblement National et des Républicains, ce texte autorise la suppression du repos hebdomadaire obligatoire des travailleur·euses agricoles « une fois au plus sur une période de trente jours », dans le cadre des récoltes manuelles relevant d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) ou d'une Indication Géographique Protégée (IGP).
Ce coup porté à un droit fondamental inscrit dans la loi française depuis 1906, et reconnu par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que par la Convention Internationale du Travail n°106, constitue une grave mise en péril de la santé des travailleur·euses.
Déroger devient la norme ? Jusqu'à présent, la suppression du repos hebdomadaire nécessitait une dérogation spécifique accordée par l'inspection du travail. Désormais, cette décision repose uniquement sur la volonté de l'employeur•se, sans obligation de justification. Le caractère périssable des récoltes constitue un motif suffisant aux yeux des promoteurs de cette mesure.
Les risques pour la santé des travailleur·euses, eux, sont ignorés, tout comme les alternatives possibles, telles que le chevauchement d'équipes qui permettrait le repos des personnes tout en maintenant l'activité le dimanche. Jusqu'à la mort de salarié·es ?
Dans un contexte où la durée hebdomadaire de travail peut déjà atteindre 72 heures par dérogation (1), notamment en viticulture, les exploitant·es agricoles peuvent désormais légalement imposer 120 heures de travail (voire 144 dans certains secteurs) en 14 jours, au SMIC, avec seulement 20 minutes de pause par jour, sans même reconnaître le droit à une prime de précarité (bien méritée) et sans aucune mesure visant à protéger la santé des travailleur·euses. Cette situation met directement en danger la vie des saisonnier·es. L'indifférence face à la souffrance des travailleur·euses agricoles doit cesser.
Un contexte climatique aggravant la précarité
Le changement climatique exacerbe les risques pour les saisonnier•es, déjà précarisé·es par des conditions de travail et de vie difficiles. L'absence de jour de repos, qui plus est dans un contexte de températures extrêmes, rend chaque journée de travail potentiellement dangereuse. Le gouvernement persiste néanmoins à sacrifier le repos hebdomadaire sur l'autel de la rentabilité.
Nombre de saisonnier•es « professionnel•les », enchaînent les mois de contrats et les récoltes été comme hiver, sous des températures très élevées ou de fortes intempéries, augmentant les risques pour la santé. Bien trop souvent leurs conditions de vie sont déjà délétères, soient-il•les français·es ou étranger·es.
Pour ces dernier·es, nombreux·ses dans les champs et les vignes, ce sont encore plus d'obstacles pour accéder aux soins et connaître les droits sociaux basiques en France ; la barrière de la langue, la fracture numérique, l'isolement, le racisme… Se cumulent, accroissent les dangers de ce manque de repos essentiel, et empêchent la revendication de leur droit à l'intégrité.
D'autres saisonnier·es « occasionnel·les » aux profils multiples (jeunes, étudiant•es, 1 Article L.713-13 du code rural et de la pêche maritime retraité•es…), astreint·es à l'intensité et à la productivité du rendement, ne sont pour la plupart pas coutumier·es de ces conditions de travail. Ils seront donc, par manque d'habitude, plus vulnérables, surtout dans leurs 12 premiers jours de cueillette.
Blanc-seing aux employeur•ses, sur la vie des travailleur·euses ?
Par ailleurs, il n'est pas non plus possible de faire confiance au « bon sens » de nombre d'employeur•ses indifférent•es au bien-être et aux conditions de vie (voire de survie) de la main d'œuvre saisonnière, comme l'illustre parfois le défaut d'accès à l'eau potable ou sa non provision dans certaines exploitations, l'inexistence de logement digne et décent… Ou régulièrement, la réticence à aménager les horaires de travail pour éviter les fortes chaleurs. Les abus d'application de ce décret sont prévisibles, tandis que la mort au travail est en augmentation.
In fine, quelles obligations et responsabilités incomberont aux employeurs•ses et aux organismes en charge de la sécurité des travailleur•euses (Inspections du travail, MSA), si l'on considère que pourraient être commises des atteintes involontaires à la vie (art. 221-6 du CP), des atteintes à l'intégrité physique (art. 222-19 du CP) et la mise en danger des personnes en raison des risques causés à autrui (art. 223-1 du CP) ? Et quel précédent ce décret crée-t-il ?
Un appel à l'action
Il est impératif de garantir des conditions de travail sûres et dignes pour tou·tes (2) en agriculture. Le repos hebdomadaire est un droit fondamental qui ne doit pas être sacrifié au nom de la productivité. Il est possible de concilier protection des travailleur·ses et exigences économiques comme le montrent les initiatives mises en place pour les ouvrier·es du BTP lors des canicules. Il est urgent d'étendre ces mesures aux domaines agricole et viticole.
Face à cette mise en péril grave et imminente des ouvrier•es agricoles, nous, associations et organisations signataires, appelons à l'abrogation de ce décret et à l'application de mesures en faveur de la sécurité et santé au travail des travailleur·ses agricoles.
Ensemble, nous devons nous mobiliser pour la justice et la dignité de celles et ceux qui nous nourrissent !
(1) Article L.713-13 du code rural et de la pêche maritime.
Liste de signataires : El Eco Saisonnier collectif de travailleur·euses agricoles, avec Marie-Lys Bibeyran défenseuse des droits des travailleur·euses des vignes et auteure, Fabienne Goutille chercheuse intervenante en santé au travail, Tifenn Hermelin documentariste, Béatrice Mésini chercheuse.
Les organisations signataires : Association A4 accueil en agriculture et artisanat, Codetras collectif de défense des travailleur·euses saisonnier·es étranger·es, Colectivo de Saisonnières del 66 collectif de travailleur·euses des Pyrénées-Orientales, Confédération paysanne syndicat, Confédération paysanne Alpes-de-Haute-Provence, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Isère, Confédération paysanne PACA, Derechos sin fronteras permanence d'accès aux droits à Beaucaire, France Libertés Fondation Danielle Mitterrand, Forum civique européen, Halem, LDH Istres-Ouest-Provence, Médecins du monde délégation Aquitaine, RLGDV, Sud Travail Affaires Sociales syndicat, SUD Agri Tarn syndicat, Syndicat du Travail de la Terre et de l'Environnement 42 syndicat, Union départementale CGT Côtes-d'Armor syndicat, Union syndicale Solidaires…
Cette tribune a été signée par une multitude d'organisations, d'ouvrier·es agricoles, paysan·nes et employeur·ses, professionnel·les de santé, élu·es, enseignant·es et chercheur·es (CNRS, Inrae, AgroParisTech, Cirad, Inserm, IRIS, etc.).
La liste complète :
https://docs.google.com/document/d/1p7mA9oMs4C7cE5GH9w1RuTpZPqyqeBKRXSKTL5SJlpU/edit
Liste des productions concernées en plus des vendanges :
Fruits AOC
Noix de Grenoble (1938)
Chasselas de Moissac (1977)
Pomme du Limousin (1994)
Muscat du Ventoux (1997)
Noix du Périgord (2002)
Châtaigne d'Ardèche (2006)
Figue de Solliès (2006)
Abricots rouges du Roussillon (2022)
Fruits IGP
Normandie Poireau de Créances
Pays de Loire Melon du Haut Poitou
Nouvelle Aquitaine Fraise du Périgord
Nouvelle Aquitaine Asperges des sables des Landes
Nouvelle Aquitaine Melon du Quercy
Nouvelle Aquitaine Kiwi de l'Adour
Nouvelle Aquitaine Ail blanc de Lomagne
Nouvelle Aquitaine Haricot tarbais
Nouvelle Aquitaine Ail rose de Lautrec
Nouvelle Aquitaine Haricot de Castelnaudary
Hauts-de-France Lingot du Nord
Grand-Est Mirabelles de Lorraine
Auvergne-Rhône-Alpes Pommes et poires de Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes Pommes de Alpes de Haute Durance
Provence-Alpes-Côte d'Azur Cerise des côteaux du Ventoux
Provence-Alpes-Côte d'Azur Citron de Menton
Occitanie Ail de la Drôme
Occitanie Fraises de Nîmes
Occitanie Artichaut du Roussillon
Corse Clémentine de Corse
Corse Kiwi de Corse
Corse Noisette de Cervionne
Corse Pomelo de Corse
Guadeloupe Melon de Guadeloupe
AOP
Centre-Val de Loire Pomme du Limousin
Nouvelle Aquitaine Noix du Périgord
Nouvelle Aquitaine Chasselas de Moissac
Nouvelle Aquitaine Ail violet de Cadours
Auvergne-Rhône-Alpes Noix de Grenoble
Provence-Alpes-Côte d'Azur Châtaigne d'Ardèche
Provence-Alpes-Côte d'Azur Muscat du Ventoux
Provence-Alpes-Côte d'Azur Figue de Sollies
Occitanie Oignon doux des Cévennes
Occitanie Châtaignes des Cévennes
Occitanie Abricots rouges du Roussillon
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

RDC : le sort des femmes et des enfants exploité.es dans les mines

Notre soif de technologie, même censée aider à démarrer une transition énergétique de plus en plus décriée, se fait au détriment de nombreuses populations du Sud global, en premier lieu celles de la République démocratique du Congo (RDC), qui détient des ressources naturelles convoitées par la planète entière.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/08/28/rdc-le-sort-des-femmes-et-des-enfants-exploite-es-dans-les-mines/
Yousra Charifa Dandjouma, stagiaire d'Alternatives pour une ONG de la République démocratique du Congo
Cet extractivisme au service de la croissance économique et d'une planète toujours plus connectée et technocentrée est synonyme d'une violente exploitation de travailleurs et travailleuses en RDC, incluant des enfants.
La RDC est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde, abritant des gisements importants de minéraux. Par exemple, la RDC produit « 60% du cobalt dans le monde (qui a été qualifié de « diamant de sang »), et elle extrait plus d'un million de tonnes de cuivre chaque année ». Néanmoins, cette richesse n'a pas été synonyme de prospérité pour les Congolais․es, et en particulier pour les femmes qui travaillent dans les mines artisanales. L'exploitation, les conditions de travail dangereuses et une vulnérabilité extrême les maintiennent souvent dans une situation difficile.
Dans un articlepublié en septembre 2023, Amnesty International « reconnaît l'importance cruciale des batteries rechargeables dans la transition énergétique pour mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles ». Et, dans la section Transition énergétique de son site internet, elle insiste sur le fait que « la justice climatique exige une transition juste. Décarboner l'économie mondiale ne doit pas engendrer de nouvelles violations des droits humains ».
Dans le rapport de septembre 2023, on peut aussi lire que « La population de la RDC a subi une exploitation considérable et de graves atteintes aux droits humains pendant la période coloniale et postcoloniale et ses droits continuent d'être sacrifiés alors que les richesses qui l'entourent lui sont confisquées ».
Conditions de travail pénibles et inhumaines
En mars 2018, la RDC a modifié laloi minière de 2002afin de garantir une répartition équitable des revenus miniers, d'accroitre la contribution du secteur minier à l'économie nationale et de lutter contre la pauvreté dans les régions minières. Dans ces sites miniers de la République démocratique du Congo, les droits civils et sociaux sont absents. Cependant, comme le rapportait Sophie Langlois pour Radio-Canadaen 2019, environ 40 à 50% de la main-d'œuvre sont des femmes (parfois enceintes) et « 40 000, ce sont des enfants, qui travaillent dans les mines artisanales de la RDC dans des conditions extrêmement difficiles ».
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a récemment exprimé sa profonde préoccupation face à l'exploitation de plus de « 300 000 enfants dans les mines artisanales des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga en République démocratique du Congo ». L'annonce a été faite lors de la 19e Semaine minière de la RDC qui s'est déroulée à Lubumbashi.
Ces travailleuses et travailleurs sont majoritairement employé.es dans le secteur « informel », sans contrat ni protection sociale et travaillent souvent durant de très longues heures, souvent sous un soleil de plomb ou dans des galeries souterraines étouffantes. Leurs tâches incluent le tri des minerais, le transport de lourdes charges, et parfois même l'extraction directe. Ces travaux pénibles, qui mettent leur santé en péril, sont pourtant rémunérés à un taux dérisoire, ne dépassant pas 1 à 2 dollars (É.-U.) par jour.
En plus des risques physiques, ces personnes doivent faire face à des dangers environnementaux. En effet, l'absence d'équipements de protection adéquats les expose à des niveaux élevés de poussières toxiques et de produits chimiques dangereux. Les accidents sont fréquents, et l'accès aux soins médicaux est limité, aggravant encore leur situation.
En 2014, la banque mondiale et la Harvard Humanitarian Initiave ont mené une étude pour permettre aux femmes de s'exprimer sur les opportunités et les difficultés liées au travail dans les mines artisanales. Cette étude révèle que « 17% des femmes et 20% des hommes pensent que les femmes ont le droit de travailler dans les mines » et « une femme sur sept » déclare avoir été contrainte de « donner des faveurs sexuelles », tandis que « 30% des femmes affirment avoir été victimes de harcèlement » dans les mines. De plus « 1 femme sur 14 » mentionne avoir abordé le sujet du harcèlement et des discriminations avec d'autres. Enfin, 30% des répondantes dans l'étude estiment que les « associations féminines » pourraient aider à résoudre ces problèmes.
Exploitation économique et abus
Les femmes sont également victimes d'exploitation économique. Elles sont souvent payées bien en dessous du salaire minimum légal, quand elles ne sont pas payées du tout. Dans de nombreux cas, elles sont rémunérées en fonction de la quantité de minerai qu'elles parviennent à extraire ou à trier, une tâche rendue encore plus ardue par la concurrence féroce et la pression des intermédiaires et des négociants.
En outre, les abus sexuels et les violences de genre sont monnaie courante. Les femmes sont fréquemment soumises à des harcèlements et à des violences sexuelles de la part de leurs collègues masculins et même des superviseurs. Les structures de pouvoir au sein des sites miniers étant souvent dominées par les hommes, les femmes ont peu de recours pour se protéger ou dénoncer ces abus.
Selon l'Institut d'études de sécurité, environ 40 000 enfants s'épuisent dans les mines congolaises. Ils sont privés d'éducation et exposés à des dangers pour extraire du coltan, un minerai précieux utilisé dans nos appareils électroniques, surtout dans nos téléphones intelligents et nos tablettes. Issus de villages reculés du Kivu, ces enfants n'ont d'autres choix que de contribuer à la survie de leur famille dès leur plus jeune âge.
Loin des regards, l'exploitation minière clandestine fait des enfants des proies faciles, les soumettant à des conditions de travail déplorables. Privés de leur enfance, ces jeunes sont exposés à de nombreux dangers, tels que les effondrements, les intoxications et les maladies professionnelles. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les enfants employés dans les mines artisanales sont souvent issus des communautés les plus pauvres et les plus marginalisées.
Initiatives et Solutions
Malgré ces défis, plusieurs initiatives visent à améliorer la situation des femmes dans les mines de la RDC. Des organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales travaillent afin de sensibiliser les communautés et promouvoir les droits des femmes. Elles offrent des formations sur les droits du travail, l'autonomisation économique, et la santé reproductive.
La Banque mondiale et le gouvernement de la RDC soutiennent des initiatives visant à réduire le fossé entre les sexes dans le secteur minier. Leprojet Promines, par exemple, vise à renforcer la gestion du secteur minier, à améliorer les conditions d'investissement et à augmenter les retombées socioéconomiques des mines « artisanales ».
En novembre 2020, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), en collaboration avec la Global Battery Alliance (GBA), s'est fixé pour objectif de « mobiliser 21 millions de dollars américains auprès des partenaires publics et privés sur les trois prochaines années. Ces fonds financeront une série d'initiatives visant à s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants dans les communautés minières en République Démocratique du Congo (RDC) ». Le gouvernement congolais, sous la pression internationale, commence également à prendre des mesures pour réguler le secteur minier artisanal. Des efforts sont faits pour formaliser les activités minières et « intégrer les femmes dans des coopératives » qui peuvent leur offrir une meilleure protection et des conditions de travail plus équitables.
Le sort des femmes et des enfants travaillant dans les mines en RDC reste un sujet de préoccupation majeure. Bien que des efforts soient faits pour améliorer leur situation, il reste encore beaucoup à faire pour garantir des conditions de travail sûres, équitables et respectueuses de leurs droits. La communauté internationale, les gouvernements, et les entreprises doivent collaborer pour mettre fin à l'exploitation et aux abus, afin que les richesses naturelles de la RDC bénéficient enfin à tous ses habitants, y compris les femmes qui travaillent dur pour les extraire.
https://alter.quebec/rdc-le-sort-des-femmes-et-des-enfants-exploite-es-dans-les-mines/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Inde : au nom des droits des femmes

Depuis 2014, Modi promet l'égalité et la protection des femmes. Les violences continuent toutefois de croître, la participation des femmes au marché du travail est faible et les initiatives du BJP, comme les quotas parlementaires, servent davantage des objectifs politiques qu'émanciper les femmes. Au final, les inégalités et la violence de genre persistent et la culture de l'impunité règne.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Vient de paraître : Dissidences dans la « nouvelle » Inde, le dernier volume d'Alternatives Sud.
Une analyse d'Aurélie Leroy [1], chercheuse au CETRI – Centre tricontinental.
En ce printemps 2024, un huitième de la population mondiale s'est rendu aux urnes, faisant de ce scrutin, le plus grand exercice électoral de la planète. Un scrutin aux allures titanesques, qui ne fait toutefois pas de l'Inde « la plus grande démocratie du monde ». Plusieurs organisations internationales tels que V-dem (2023), Freedom House (2023) et Economist Intelligence Unit (2023) soulignent l'érosion démocratique et les dérives autoritaires. L'hindouisation du pays à marche forcée, qui cherche à établir une suprématie de la communauté majoritaire hindoue au détriment du sécularisme et des minorités, en est la première manifestation. La tendance à l'illibéralisme due à la neutralisation des institutions indépendantes et démocratiques, à la mise au pas des principaux contre-pouvoirs et à la répression des oppositions, en constitue la seconde.
Bilan du gouvernement Modi en matière de droits des femmes
Le Bharatiya Janata Party (BJP) dirigé par Narendra Modi s'est toujours dit mobilisé en faveur des femmes, déclarant que celles-ci étaient au centre de ses préoccupations. En 2014 déjà, le programme du parti [2] promettait d'œuvrer à l'« empowerment des femmes ». Il insistait sur leur sécurité et leur protection, considérées comme des conditions préalables à leur autonomisation. Le manifeste énumérait des actions à entreprendre pour lutter contre les violences commises à leur égard ainsi que des engagements en matière d'éducation, d'emplois et de participation économique et politique.
Violences de genre et impunité
Au cours de la dernière décennie cependant, les crimes contre les femmes n'ont cessé d'augmenter, alors que les taux atteignaient déjà des niveaux jugés « inacceptables » par le BJP lorsqu'il est monté au gouvernement en 2014. Selon le rapport annuel du National Crime Records Bureau, environ 4,45 millions de crimes contre les femmes ont été enregistrés en 2022 (Frontline, 2023). Une majorité d'entre eux étaient des actes de cruauté commis par des maris ou des proches (31%), des enlèvements de femmes (19%), des agressions et des attentats à la pudeur (19%) et des viols (7%).
La violence sexuelle est traitée avec complaisance en Inde et une culture de l'impunité l'entoure, en dépit des sursauts causés notamment par des mobilisations massives à la suite du viol collectif de Jyoti Singh, en 2012 (Leroy, 2013) et de la vague Me too indienne. Les statistiques officielles sont en outre peu fiables en raison de la sous-déclaration des agressions, mais aussi du fait de pratiques d'enregistrement inadaptées et d'une collusion institutionnelle. Les corps des femmes, en particulier ceux appartenant à des communautés marginalisées, sont la cible d'un continuum de violence, du ventre à la tombe, qui contribue à la perpétuation de la domination masculine et au maintien de hiérarchies fondées sur la caste, la religion, la classe sociale, la parenté, etc. (Alternatives Sud, 2021).
Aujourd'hui avec le « parti du peuple » au pouvoir, comme hier avec d'autres partis, les violences ne reçoivent pas une attention suffisante de la part des autorités. Les forces de police et de sécurité peuvent mêmes être les premières à laisser faire les bourreaux ou à brutaliser les femmes dans la rue ou dans les manifestations pacifiques. L'impunité est encore plus forte dans des régions militarisées telles que le Cachemire, le Manipur ou les États du Nord-Est. Dans ces zones de conflit, l'isolement et le manque de transparence permettent aux agressions sexuelles et aux abus de proliférer.
Les institutions façonnées par l'État concourent à la (re)production d'un ordre symbolique et social. On pourrait s'attendre à ce qu'elles participent de la solution mais elles perpétuent souvent, au contraire, des formes de violence contre les femmes. Les forces de l'ordre, tout comme la justice ne sont pas des organes « neutres », au-dessus des rapports de dominations. Elles y participent. Le système judiciaire indien échoue ainsi à rendre justice aux femmes et témoigne trop souvent d'une forme de complicité des autorités (depuis les chefs de village jusqu'au sommet de l'État) avec les auteurs de violences sexistes [3].
Participation économique des femmes
Le taux de participation des femmes à la population active, déjà bas en 2014, a quant à lui, encore baissé au cours des deux mandats de Modi. Il est l'un des plus bas de la planète (The Wire, 2023), soulignant la marginalisation croissante de la main-d'œuvre féminine dans l'économie indienne. Depuis la libéralisation des années 1990, ce taux est en chute libre, passant de près de 30%, il y a trois décennies, à environ 17% en 2018.
Depuis 4-5 ans, la tendance est à la hausse, mais cette évolution ne constitue pas de facto une bonne nouvelle. Elle est due au travail que de plus en plus de jeunes femmes réalisent à leur compte dans des zones rurales. Leur inscription sur le marché de travail est cyclique. Elle s'intensifie en période de crise pour compenser les pertes de revenus. Les femmes y acceptent alors des boulots mal payés aux conditions pénibles, qu'elles quittent aussitôt que la situation des ménages s'améliore et que l'économie rebondit.
Ces entrées et sorties soulignent le rôle d'amortisseur joué par les femmes dans les ménages pauvres durant les périodes de détresse économique (Bhandare, 2024). La contribution croissante des femmes au marché du travail incarne donc « un mode de vie difficile et un stress sur les moyens de subsistance, plutôt qu'une situation de progrès et d'abondance. Cette tendance reflète aussi le phénomène de ruralisation, à savoir la diminution de la proportion d'emplois dans les secteurs urbains de l'industrie et des services, qui se traduit par une dépendance croissante à l'égard des secteurs ruraux » (Sinha, 2023).
Les femmes sont en outre confrontées au « piège patrilocal » (« Patrilocal Trap ») (Evans, 2023) qui empêche les femmes célibataires de travailler à l'extérieur du foyer, en raison de « contacts non supervisés avec des hommes qui pourraient entacher leur réputation » (Taub, 2023). Sans moyen de gagner leur vie, faute de disponibilité d'« un travail convenable », de nombreuses femmes finissent par se marier, sous la contrainte sociale, se retrouvant du même coup attachée à une belle famille et sous l'emprise d'un mari parfois violent.
Représentation politique des femmes
Les nationalistes hindous du BJP ont aussi répété à l'envi qu'ils se différenciaient des autres partis en matière de représentation politique des femmes. Ils en voulaient pour preuves notamment, l'élection de Droupadi Murmu, première femme présidente [4] issue d'une communauté adivasi, la représentation féminine plus élevée que de coutume dans les 16e et 17e Lok Sabhas (la chambre basse du parlement) à majorité BJP, et l'adoption d'un amendement constitutionnel réservant 33% des sièges parlementaires au femmes, en septembre 2023.
Les ultranationalistes ont déployé des efforts pour pousser les femmes à intégrer le parti ou le cercle des organisations nationalistes hindoues proches du pouvoir, notamment le comité national des femmes volontaires. Des initiatives ont aussi été prises pour qu'elles soient davantage considérées comme une base électorale cruciale. La popularité de Modi et le succès de son parti ont ainsi grandi auprès des Indiennes au fil des années, au point que, lors des élections générales de 2019, le BJP est devenu le parti avec le plus grand nombre de voix féminines. Lors des élections régionales de 2022, qui se sont déroulées dans cinq états, les femmes ont voté davantage que les hommes pour le BJP (Barooah Pisharoty, 2022).
L'intérêt que le BJP porte aux femmes est indéniable, mais celui-ci ne signifie pas pour autant que ce parti œuvre à leur « libération » ou entende concrétiser l'égalité entre les sexes. Les droits des femmes ont été instrumentalisés et les questions sexuelles accaparées par les dirigeants indiens afin de légitimer leur discours, asseoir leur autorité et servir leur agenda politique.
Instrumentalisation politique des droits des femmes
Des quotas pour les femmes au parlement
L'adoption du projet de loi réservant des quotas aux femmes dans les assemblées parlementaires est un exemple édifiant des usages paradoxaux qui peuvent être fait de « la cause des femmes ». Introduit pour la première fois en 1996, le projet de loi a fait, au cours de ces trois dernières décennies, l'objet de débats acharnés sans que jamais une majorité n'en permette son adoption. En dépit de cette trajectoire longue et mouvementée, il a finalement été adopté à la quasi-unanimité, en septembre 2023, à peine deux jours après son introduction.
Ce résultat n'est pas le fait d'une subite convergence de vues sur le texte. Il relève d'un « coup » politique orchestré par le gouvernement Modi au plus grand bénéfice de ce dernier. Aucun échange ou consultation n'a pu avoir lieu anticipativement autour de cette loi en raison du manque de transparence sur l'ordre du jour des discussions à la Lok Sabha. Le dossier ne figurait pas sur le « Business bulletin », le matin même de son introduction. Cette loi est donc passée, comme beaucoup d'autres, « au bulldozer », parce que le gouvernement Modi en avait décidé ainsi, révélant l'affaiblissement du parlement et la mainmise de l'exécutif sur le législatif.
Si l'adoption de cette loi a, a priori, de quoi réjouir, elle pose plusieurs questions. Tout d'abord celle de la représentativité des femmes dans un Parlement affaibli aux marges de manœuvre réduites. Quels changements politiques espérer en faveur de l'égalité dans un contexte peu favorable au respect des droits humains et démocratiques où la direction du pays est passée maître dans l'art du parler démocratique et de l'agir autocratique. Ensuite, celle de la mise en œuvre de la loi qui n'est pas sans poser problème. L'établissement de quotas est en effet lié à l'exercice d'un recensement général dont la date n'est pas fixée et qui fait débat entre partis majoritaire et de l'opposition. Enfin, dernière question : pourquoi un tel empressement à faire adopter cette loi ?
Les raisons qui ont poussé le Premier ministre à agir de la sorte sont avant tout opportunistes et électoralistes. Des quotas en faveur des femmes sont une promesse électorale ancienne du BJP et l'adoptien du texte est survenu à la veille du scrutin de 2024. Le calendrier était donc parfait. Modi tenait également à proposer une mesure phare et rassembleuse à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment du parlement pour les 75 ans de l'indépendance. Quoi de mieux que le Women's Reservation Bill ? Cette loi est en outre emblématique de son agenda politique et de son programme « civilisationnel ». Elle alimente le récit d'une « nouvelle Inde » à l'« avenir glorieux » dans lequel les femmes ont une place. Mais quelle est-elle, cette place ? Quelles sont les représentations que le BJP a des femmes et quelle est son approche en matière d'égalité des sexes ?
Discours normatifs et ordre moral
L'homme fort du pays – qui bénéficie d'un très large soutien populaire – postule l'existence d'un modèle sexuel indien qui renvoie les femmes et les hommes à des spécificités traditionnelles et culturelles. Le nationalisme hindou défend un programme « civilisationnel » qui politise les questions sexuelles et s'appuie sur des normes de genre régressives et sur un modèle traditionnel patriarcal. Il met en avant une identité féminine hindoue « respectable », censée incarner la moralité et la pureté de la famille et de la nation.
Les femmes du groupe majoritaire ont ainsi reçu comme injonction de se conformer aux codes traditionnels et de jouer un rôle de gardiennes face à la dépravation des mœurs. Afin de préserver une identité prétendument menacée, de nombreux hommes mais aussi femmes militantes ont estimé qu'il était du « devoir divin des femmes hindoues non seulement de donner naissance à des enfants, qui serviront le Rashtra (État) hindou, mais aussi de leur donner le « samskar », ou les « valeurs sociales », qui contribueront au processus d'édification de la nation hindoue » (Dhingra, 2023).
La dépravation des mœurs et la bataille des valeurs sont des thèmes porteurs, mobilisés par le régime autoritaire indien, afin de gagner en statut et en légitimité. Elles permettent à Modi non seulement de se dresser en rempart de l'identité indienne face à la propagation de valeurs occidentales jugées « décadentes » et « néocoloniales », mais aussi de se lever contre la prétendue « menace » que représenterait l'islam pour les droits des femmes. Dans ses discours, les femmes musulmanes sont ainsi systématiquement stigmatisées comme des victimes sans défense, maltraitées par des hommes musulmans, présentés comme des êtres misogynes aux comportements prédateurs.
Prenons deux exemples d'usages détournés des droits des femmes. Tout d'abord, la loi absurde du « triple talaq » qui a criminalisé une forme de divorce chez les musulmans (Leroy, 2018). Ce texte n'a jamais eu pour but de protéger les femmes musulmanes, vu que ce procédé avait déjà été déclaré invalide et rendu juridiquement nul ! Cette initiative, soutenue par Modi, visait davantage à dénigrer la tradition islamique présentée comme opprimante et sexiste, au contraire d'une culture hindoue décrite comme vertueuse et garantissant le respect de « ses » femmes.
Ensuite, des opérations ont été menées par des groupes vigilantistes hindous d'extrême droite contre le « love jihad ». Elles reposent sur l'idée que les hommes musulmans sont des êtres perfides et hostiles qui ont l'intention de séduire des femmes hindoues pour les convertir et islamiser la société indienne. Dans cette croisade islamophobe, des hommes musulmans ont été lynchés et tués en public sans que les auteurs de ces crimes de haine ne soient jamais poursuivis.
Conclusion
Les discours dans lesquels Modi s'auto-désigne comme « sauveur des femmes » s'inscrivent dans un agenda nationaliste excluant. Les droits des femmes ne sont pas sa priorité, mais sont pris en compte tant qu'ils servent les intérêts de son parti et de son gouvernement. Agir au nom des femmes s'est ainsi souvent révélé pour le BJP, « un discours légitimateur particulièrement efficace » (Idem). Toutefois, lorsque des mouvements de femmes (de toutes religions, castes ou classes) ont contesté l'agenda politique du parti au pouvoir, les élans « protecteurs » du gouvernement se sont, sans surprise, mus en une répression féroce. Cela s'est vu à Shaheen Bagh, lorsque des femmes musulmanes ont refusé d'endosser le rôle de la « bonne victime » en luttant contre la modification de la loi sur la citoyenneté, ou lorsque des femmes du groupe majoritaire ont rejeté les normes sociales et de genre qu'on voulait leur imposer.
La réélection de Modi à un troisième mandat soulève des questions cruciales pour les droits des femmes. Alors que l'homme fort du pays va continuer à prôner le suprémacisme hindou et l'exclusion des minorités, les mouvements de femmes devront redoubler d'efforts pour faire entendre leurs voix, créer des solidarités et des dynamiques unificatrices afin de défendre leurs droits et résister aux politiques discriminatoires.
Bibliographie
Alternatives Sud (2021), « Violences de genre et résistances »
https://cetri.be/Violences-de-genre-et-resistances.
Barooah Pisharoty S. (2022), « Interview : It's Time BJP Walks the Talk on the Women's Reservation Bill », The Wire, avril
https://thewire.in/women/interview-its-time-bjp-walks-the-talk-on-the-womens-reservation-bill.
Bhandare (2024), « Women in the workforce part I and II », IDR
https://idronline.org/.
Dhingra (2023), « India's Militant Hindu Nationalist Women Leaders », New Lines Magazine, 17 avril
https://newlinesmag.com/reportage/indias-militant-hindu-nationalist-women-leaders/.
EIU (2023), « Democracy Index 2023 ».
Evans A. (2023), « The Patrilocal Trap »
https://www.ggd.world/p/the-patrilocal-trap.
Freedom House (2024), « Freedom in the World 2024 – India country report »
www.freedomhouse.org.
Frontline (2023), « Over 4.45 lakh crimes against women in 2022, one every 51 minutes : NCRB »
https://frontline.thehindu.com/.
Leroy A. (2013), « Des violences sexuelles comme stratégies de domination »
https://cetri.be/Des-violences-sexuelles-comme
Leroy A. (2018), « De l'usage du genre », Alternatives Sud, n°25/2, juin.
Leroy A. (2024), « La politique antimusulmane de la “nouvelle Inde” »,
https://www.cetri.be/La-politique-antimusulmane-de-la
The Wire (2023), « Big Talk, Small Action : Modi Govt's Work on Women's Empowerment in the Last 9 Years »
https://thewire.in/women/big-talk-small-action-modi-govts-work-on-womens-empowerment-in-the-last-9-years.
Sinha D. (2023), « Rising Female Work Participation Signals Stressed Livelihoods, Not Progress », The Wire
https://thewire.in/labour/rising-female-work-participation-signals-stressed-livelihoods-not-progress.
Taub A. (2023), « A Major Economic Challenge », NY Times
https://www.nytimes.com/2023/11/20/briefing/india-economy-gender-inequality.html
V-Dem Institute (2023), Democracy Report 2023. Defiance in the face of autocratization, University of Gothenburg.
[1] Chargée d'étude au Cetri, coordinatrice de « Dissidences dans la ‘nouvelle Inde' », Alternatives Sud, 2024, 2, Cetri-Syllepse.
[2] https://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf.
[3] Parmi de trop nombreux exemples, la libération des violeurs de Bilkis Bani, victime d'un viol collectif lors du pogrom musulman au Gujarat en 2002, le silence de Modi par rapport aux agressions sexuelles au Manipur, l'intimidation dont ont été la cible les lutteuses indiennes qui dénonçaient le harcèlement du président de la fédération indienne de lutte, par ailleurs aussi député du BJP, etc.
[4] Le pouvoir de la présidence est honorifique car son/sa titulaire est tenu·e de suivre les avis du Premier ministre, responsable devant le parlement et détenteur du pouvoir exécutif avec le gouvernement.
CETRI – Centre tricontinental
Le Centre tricontinental est un centre d'étude, de publication et de formation sur le développement, les rapports Nord-Sud, les enjeux de la mondialisation et les mouvements sociaux en Afrique, Asie et Amérique latine
https://blogs.mediapart.fr/cetri-centre-tricontinental/blog/180624/inde-au-nom-des-droits-des-femmes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La lutte pour le nom de famille des femmes mariées en Turquie

Découvrez l'histoire et le contexte actuel de la lutte pour le droit de choisir son propre nom de famille
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/06/la-lutte-pour-le-nom-de-famille-des-femmes-mariees-en-turquie/
En Turquie, la pratique consistant à changer le nom de famille d'une femme après le mariage et l'obligation d'adopter le nom de famille de son mari est une question urgente pour les féministes. Les femmes du pays ont obtenu les droits civiques, le droit de vote et le droit de se présenter et d'être élues au cours de plus de cent ans de lutte, en disant : « nous sommes égales ». Le droit des femmes mariées à choisir leur propre nom de famille a été obtenu dans le pays après 30 ans de batailles juridiques. Cependant, les femmes ne sont pas encore en mesure d'exercer pleinement ce droit. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il ne permet pas ce choix. Le combat continue. À cet égard, il est essentiel de reconnaître la résilience, la résistance et la conscience unifiée du mouvement des femmes en Turquie.
Bien que cela puisse sembler un problème mineur pour ceux qui ne considèrent pas l'aspect des droits, il s'agit en fait d'une question ayant de fortes implications politiques dans toutes les dimensions. Le nom de famille d'une femme mariée sert d'espace symbolique entouré de barbelés, conçu pour protéger le pouvoir enraciné du patriarcat. Surmonter ces barbelés par des moyens légaux pendant plus de trente ans a été une réalisation pertinente pour les femmes dans l'effort de démanteler le « mythe de la Sainte Famille ».
Le nom de famille, en tant que composante de l'espace individuel et autonome dans lequel une femme se perçoit, relève du droit à la vie privée en vertu de la législation sur les droits humains. En d'autres termes, la femme est une personne autonome avec sa propre identité et ne peut être réduite à une simple extension de l'homme, ni confinée dans les limites de la « Sainte Famille » à travers le mariage. L'imposition patriarcale à la femme mariée d'adopter le nom de famille de son mari est un outil qui vise à subordonner les femmes. Exiger des femmes qu'elles renoncent à leur identité et à leur autonomie lorsqu'elles fondent une famille, c'est se soumettre au pouvoir excessif du patriarcat. Résister à cette exigence, c'est affronter le patriarcat et contribuer à la diminution de son pouvoir – une contestation que le patriarcat n'est pas disposé à accepter.
Les institutions patriarcales ont résisté aux efforts du mouvement des femmes pour faire progresser les acquis et les droits garantis par le Code civil turc, c'est pourquoi elles refusent de reconnaître et d'appliquer la décision de la Cour constitutionnelle. Le Patriarcat perçoit toute demande d'égalité comme un « excès » qui confronte son pouvoir, en particulier en ce qui concerne la « Sainte Famille » et le « principe d'unité dans le nom de famille ».
La lutte au fil des ans
Lorsque nous examinons la trajectoire historique des mouvements luttant pour les droits humains, il est évident que les avancées ne se produisent pas de manière linéaire ou continue, et que les mouvements progressistes sont souvent confrontés à la brutalité de la répression. Le mouvement en faveur des droits humains des femmes a également progressé à travers d'intenses luttes, malgré la répression. Il y a donc des moments décisifs où les progrès deviennent irréversibles. Nous sommes actuellement à ce stade pour le mouvement des droits des femmes en Turquie. Malgré des années de répression gouvernementale et d'interventions systémiques et structurelles, la lutte qui a débuté il y a 30 ans pour modifier le Code civil en ce qui concerne le nom de famille des femmes mariées a atteint un point critique.
La Cour constitutionnelle turque a rejeté deux demandes d'annulation de l'article 187 du Code civil turc, qui oblige les femmes à adopter le nom de famille de leur mari après le mariage. La première a été déposée en 1998 au motif que la loi était inconstitutionnelle. Cependant, la Cour constitutionnelle n'a pas considéré que l'obligation violait le principe d'égalité consacré par la Constitution et a donc rejeté la demande d'annulation. Imperturbables, les femmes ont continué dans la lutte. Après un délai d'attente de dix ans requis par la Constitution, elles ont déposé une nouvelle requête auprès de la Cour constitutionnelle. En 2011, le tribunal a statué, pour la deuxième fois, que le maintien d'un nom de famille commun était obligatoire pour protéger l'intégrité de la famille et la paternité des enfants, déclarant qu'il est nécessaire d'adopter le nom de famille de l'homme, et que cette exigence ne serait pas contraire au principe d'égalité de la Constitution. Ainsi, la Cour constitutionnelle a maintenu la position constante sur cette « patate chaude » qu'elle reçoit du patriarcat à intervalles réguliers.
Encore une fois, le mouvement des femmes n'a pas abandonné. Après une autre période d'attente de dix ans, une nouvelle demande a été présentée au tribunal pour la troisième fois. En 2023, la Cour constitutionnelle a finalement annulé des décisions antérieures, car il n'était plus possible d'ignorer le caractère contraignant des conventions relatives aux droits humains dont la Turquie est signataire, telles que la Convention européenne des droits de l'Homme et la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. En outre, la lutte du mouvement des femmes, parallèlement aux avancées juridiques dans la promotion de l'égalité des sexes, a contribué à la décision du tribunal turc, aux améliorations mises en œuvre dans la Constitution, à la mise en place du droit depétition individuelle en appel, au niveau national, pour prévenir les violations des droits, et des décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme sur les violations en ce qui concerne le nom de famille adopté par les femmes mariées. La Cour constitutionnelle a éliminé le problème qui persistait depuis 30 ans, à savoir le problème du nom de famille des femmes mariées. Juridiquement, cette question n'existe plus en Turquie, puisque la loi pertinente sur cet aspect a été annulée.
En conséquence, selon la décision du 24 avril 2023, les femmes mariées devraient avoir trois options : adopter uniquement le nom de famille du mari ; adopter le nom de famille du mari avec le nom de jeune fille ; ou n'adopter que le nom de famille qu'elles avaient déjà avant le mariage.
L'inscription de cette dernière option dans la décision de la Cour constitutionnelle est une réalisation juridique d'une grande pertinence.
Le contexte actuel
L'obligation pour les femmes mariées d'adopter le nom de famille de leur mari a été légalement abolie le 28 janvier 2024, lorsque la décision de la Cour constitutionnelle turque est entrée en vigueur. Cependant, une intense dispute politique a commencé à la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui était censée être en vacances pendant la période de chaleur estivale extrême, et devrait reprendre ses activités à l'automne dans le pays. La bataille actuelle découle du refus du gouvernement de reconnaître la décision de la Cour constitutionnelle, malgré son caractère définitif, après 30 ans d'articulation des femmes. La question a dégénéré en un différend qui remet en question le maintien de l'obligation d'adoption du nom de famille du mari par la femme après le mariage, malgré la décision contraignante d'annuler la règle par la Cour constitutionnelle.
Aujourd'hui, les organes exécutifs et législatifs se sont chargés de protéger la forteresse du patriarcat en ce qui concerne le nom de famille des femmes mariées. La lutte des femmes et la victoire juridique reconnue par la Cour constitutionnelle sont ignorées. Le gouvernement a inclus le nom de famille des femmes mariées dans le 9e « paquet » judiciaire, qui est un vaste projet de loi, comme si un changement de législation était nécessaire. Selon le projet de loi, les femmes mariées ne pourront pas adopter uniquement le nom de famille qu'elles avaient déjà avant le mariage. Le texte du PL cherche à rétablir le dispositif déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle. La discussion sur le projet de loi, qui a débuté le 11 juillet 2024, a duré 20,5 heures et s'est terminée le 12 juillet. Un débat ininterrompu a eu lieu à la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui a été contrainte de reporter les vacances d'été et de reprendre ses activités. Ankara a connu l'été le plus chaud et le plus cruel en termes de droits des femmes. Malgré la discussion intense dans la Commission, la plupart n'étaient pas convaincus. Le projet n'a pas été présenté à la plénière pour le traitement final et a été reporté à la fin de la pause estivale.
Bien qu'il y ait des rapports selon lesquels le projet de loi pourrait être retiré grâce aux efforts de communication et aux luttes du mouvement des femmes, dirigé par l'Articulation des femmes pour l'égalité (Women's Platform for Equality – EŞIK), certains dirigeants du parti au pouvoir et du ministère de la Famille et des Services sociaux, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée. Dans la nouvelle législature, qui commence en octobre après la fin des vacances d'été, il reste la possibilité que le gouvernement demande l'approbation de la loi en plénière de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Il est clair qu'il y aura une bataille difficile, prolongée et persistante au Parlement. Les organisations de défense des droits de la femme et les associations d'avocats en Turquie suivent la situation de près. Ce combat est un effort unifié : protéger l'État de droit appliquant les décisions judiciaires, résister à un législatif contrôlé par les puissances dominantes qui veut saper les victoires dans le domaine juridique et affronter le patriarcat en défendant l'existence et l'identité des femmes.
Nezahat Demiray
Nezahat Doğan Demiray est titulaire d'un doctorat en droit constitutionnel et travaille sur les droits humains des femmes, la pauvreté et l'inégalité entre les sexes. Elle est membre de la Marche Mondiale des Femmes en Turquie.
Édition par Bianca Pessoa et Helena Zelic
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
Langue originale : anglais
https://capiremov.org/fr/analyse/la-lutte-pour-le-nom-de-famille-des-femmes-mariees-en-turquie/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Conférence internationale sur la prostitution au Liban avec DoubleX

En juillet, DoubleX, association féministe libanaise tout juste créée, a organisé à Beyrouth une grande conférence sur la lutte contre le système prostitutionnel, premier événement de ce type dans le monde arabe. Alexine, survivante française, y est intervenue.
Tiré de Entre les ligne et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/14/conference-internationale-sur-la-prostitution-au-liban-avec-doublex/
« Notre objectif ? Mettre fin à l'exploitation sexuelle », peut-on lire en arrivant sur le site de la toute nouvelle association féministe abolitionniste libanaise, DoubleX. Fondée par Ghada Jabbour, qui luttait contre laprostitution au sein de Kafa, association membre de CAP international, cette association est la première à centrer son action sur la lutte contre le système prostitutionnel, dans une optique féministe et abolitionniste.
En juillet, elle a organisé conjointement avec Kafa une grande conférence de deux jours, pour faire savoir en quoi la prostitution, y compris filmée est une violence contre les femmes et un obstacle à l'égalité, et comment le modèle abolitionniste est le mieux à même de le combattre.
Dans son introduction, Ghada Jabbour a rappelé que les droits des femmes devaient être reconnus comme indissociables des droits humains, et a fait part des constats de terrain sur le système prostitutionnel :
« Nous voyons bien comment la prostitution est une conséquence des violences et des discriminations mais aussi comment le système de la prostitution recouvre de nombreuses violences, en particulier les violences sexuelles. Nous sommes toutes concernées par la prostitution, directement ou indirectement, parce qu'elle déshumanise les femmes et en font des objets de plaisir pour les hommes ».
DoubleX invite survivantes, expertes, activistes
Pour en parler, DoubleX a fait venir du monde entier des intervenantes prestigieuses, et en premier lieu des survivantes. Parmi elles, Alexine Solis, survivante française et une des autrices du podcast La vie en rouge, a expliqué en quoi la prostitution était « la forme la plus flagrante de violence masculine contre les femmes », et était contraire à l'égalité, et par essence une atteinte aux droits humains.
« C'est précisément parce que vous ne voulez pas de cet acte sexuel que les prostitueurs veulent vous payer pour passer outre à votre consentement », a-t-elle expliqué. Cherie Jimenez, présidente de CAP international et elle même survivante, et Mia D Foite, survivante irlandaise, étaient également présentes.
Par ailleurs, des expertes étaient invitées, en particulier Reem Alsalem, rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'Onu, qui a publié au printemps un rapport majeur sur la prostitution qui reconnaît l'analyse abolitionniste comme la seule pertinente pour s'attaquer à cette violence patriarcale qu'est la prostitution.
Melissa Farley, psychologue et chercheuse états-unienne qui a fait de multiples études sur les « clients » prostitueurs et récemment une étude majeure sur les liens pornographie-prostitution, est venue parler de prostitution filmée, tout comme Alyssa Ahrabare pour Osez le féminisme ! Le Réseau européen des femmes migrantes était également présent, pour parler de la façon dont le système prostitueur cible toujours les plus vulnérables.
Une très belle conférence de lancement pour DoubleX, à qui l'on souhaite longue vie. L'association est déjà présente sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, sous le nom doubleXleb), et a un site Internet : https://doublex.org
A lire également :
« Ghada Jabbour, Au Liban, la prostitution doit être reconnue comme une violence faite aux femmes »
Ghada Jabbour est une des fondatrices de Kafa (enough) Violence and Exploitation, une ONG leader de la lutte contre les violences faites aux femmes au Liban, Elle a dirigé « EXIT », une précieuse recherche de terrain menée en 2019 et la commente pour nous, au regard de la situation du système prostitueur au Liban.
Kafa (enough) Violence and Exploitation est une ONG leader de la lutte contre les violences faites aux femmes au Liban, membre de la coalition abolitionniste dont le Mouvement du Nid est membre fondateur.
Sandrine Goldschmidt
Sandrine Goldschmidt est chargée de communication au Mouvement du Nid et militante féministe. Journaliste pendant 25 ans, elle a tenu un blog consacré aux questions féministes (A dire d'elles – sandrine70.wordpress.com) et organise depuis quinze ans le festival féministe de documentaires “Femmes en résistance”. Aujourd'hui elle écrit régulièrement dans Prostitution et Société.
https://mouvementdunid.org/prostitution-societe/actus/liban-doublex/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Socialiser le travail du care, transformer l’économie

Lisez le résumé du séminaire « Socialiser le travail du care : expériences et luttes féministes »
Après des décennies d'organisation, de mobilisation et de lutte, ayant récemment traversé la pandémie de covid-19, il est aujourd'hui possible d'affirmer que le travail du care est entré dans l'agenda public dans différentes parties du monde. Les horizons et perspectives mobilisé.e.s autour de ce même agenda sont divers – et même antagonistes. Les expériences de mouvement-pensée féministe nous aident à comprendre les différends autour des soins.
Ce texte est une synthèse du séminaire « Socialiser le travail du care : expériences et luttes féministes », qui s'est tenu virtuellement le 4 juin 2024, avec la participation d'Amanda Verrone, du Syndicat LAB du Pays Basque, Cecília Kitombe, d'Ondjango Feminista d'Angola, Dory Capera, de la Confédération Syndicale des Amériques, Magdalena León, du Réseau latinoaméricain des femmes pour la transformation de l'économie (Remte), d'Équateur, et Yessica Restrepo, de la Confluencia de Mujeres, de Colombie.
Points de départ
La perspective qui nous guide considère le travail du care comme un vrai travail, une pratique et des relations qui façonnent la durabilité de la vie. C'est une compréhension qui ne se limite pas aux soins directs d'une personne, mais qui implique l'ensemble des conditions de possibilité de vie, c'est-à-dire les personnes, la nourriture, les semences et les biens communs, ainsi que les différentes formes de relation économique qui vont au-delà de ce qui est acheté et vendu sur le marché. Nous situons les soins dans des relations interdépendantes, affirmant l'autonomie et l'autodétermination comme principes. Nous considérons également les soins comme faisant partie de l'écodépendance, allant au-delà de la vie humaine.
Comme partagé par le Réseau lationoaméricain des femmes pour la transformation de l'économie (Remte), le travail du care est une expérience économique et intégrale des femmes. C'est un travail féminisé et racialisé qui se déroule dans différents contextes, espaces et circonstances et qui est imprégné de contradictions. Bien qu'elle puisse mobiliser et créer des principes éthiques pour vivre ensemble (tels que la solidarité et la réciprocité), la responsabilité des soins est immergée dans des relations oppressives de genre, de race et de classe. Un défi de départ est de récupérer cette expérience comme catalyseur de transformations structurelles dans les manières de (re)produire la vie en commun.
Ce qu'on appelle maintenant le travail du care a ses racines dans ce que le féminisme socialiste a élaboré pendant des décennies en termes de reproduction et que l'économie féministe a systématisé dans le pari sur la durabilité de la vie. Cette perspective est également liée à l'élargissement de la notion de conflit capital-travail à la notion de conflit capital-vie, expliquant que la logique de l'accumulation du capital est incompatible avec la logique du soin et du maintien de la vie.
Le soin à l'ordre du jour de la construction du mouvement
Il existe plusieurs stratégies et outils pour placer le travail du care au centre de l'agenda politique. En Angola, par exemple, Ondjango Feminista a organisé une enquête auprès des femmes pour introduire ce thème dans la société. Sur les places, sur les marchés et dans les écoles, le groupe a parlé aux femmes de la façon dont elles utilisent leur temps. Avec un taux de fécondité supérieur à la moyenne mondiale (5,3 en Angola ; 2,2 dans la moyenne mondiale), les femmes ont déclaré que s'occuper de leurs enfants fait partie des responsabilités qui les accablent le plus dans leur vie quotidienne. Elles ont conclu que même sans politique de soins, il existe effectivement un système de soins soutenu par le travail non rémunéré des femmes.
En Amérique latine, le travail du care a été au centre des réponses des femmes aux offensives néolibérales visant à privatiser l'éducation publique et les services de santé, par exemple. La mémoire et l'actualité de ces luttes sont la référence pour se méfier des propositions d'organisations telles que le Fonds monétaire international (FMI) autour des soins. Les prélèvements du FMI sur les politiques économiques des pays endettés augmentent le coût de la vie et réduisent les investissements de l'État dans les services publics, ce qui implique davantage de travail non rémunéré pour les femmes. Le FMI considère que la responsabilité accrue des femmes en matière de soins constitue un obstacle à leur participation au marché du travail. Sans changer ses conditions, il encourage de fausses solutions basées sur le secteur privé et la précarité. Il s'agit d'une perspective d'inclusion des femmes dans ce système, sans transformer les structures d'oppression. Il ne convient donc pas à la majorité des femmes de la classe ouvrière.
Les luttes territorialisées pour le droit à la garderie et aux espaces collectifs pour la nourriture sont à la base des élaborations autour du droit aux soins – qui implique à la fois les droits de ceux qui sont soignés et de ceux qui soignent. Dans cette perspective, il existe un mouvement simultané de reconnaissance, de redistribution et de valorisation sociale et économique du travail du care, comme le rapportent les camarades de la Confédération Syndicale des Amériques. À ce titre, nous comprenons que le travail n'est pas seulement un travail rémunéré – ce qui a été fondamental dans les luttes des personnes qui s'occupent des autres à domicile.
La division sexuelle du travail, toujours articulée avec la division raciale du travail, constitue la base matérielle de l'oppression des femmes. En plus de séparer le travail des hommes et des femmes, la production et la reproduction, cette division hiérarchise encore ces sphères. Qu'ils soient non rémunérés ou mal rémunérés, le travail domestique et de soins et les personnes qui le font – femmes, noires, immigrées – sont dévalorisées. Lorsqu'ils sont payés, ces travaux sont effectuées en conditions de précarité et sans protection sociale.
Les camarades du Syndicat LAB ont partagé le chemin de la mobilisation d'une grève générale pour la socialisation du travail du care au Pays Basque en novembre 2023. Menée par le mouvement féministe, il s'agissait d'une construction qui impliquait différents secteurs du syndicalisme, y compris les travailleurs de l'industrie et des télécommunications. La grève a des antécédents dans un processus de recomposition de la classe ouvrière dans le syndicat. Les soins ont ainsi été mis à l'ordre du jour des luttes contre la privatisation.
Les syndicalistes féministes ont placé la lutte pour les conditions de vie et de travail des travailleuses domestiques et des soignantes au centre de leurs revendications, ainsi que la perspective de lutter pour le temps de soins pour l'ensemble de la classe ouvrière. Ces axes sont liés à la lutte pour un système de soins public-communautaire. Cela s'est fait par l'auto-organisation des femmes dans un secrétariat féministe, la consolidation d'une perspective antiraciste, la construction d'alliances et une combinaison d'outils de mobilisation et de formation.
En organisant une grève générale avec de telles revendications, il est devenu clair que toutes les travailleuses n'ont pas le droit de grève, car il y a des emplois qui ne peuvent tout simplement pas être laissés de côté, comme c'est le cas avec le travail du care. Ce processus a été historique pour le mouvement syndical et a reformulé, dans la pratique, le concept classique de grève, car il élargit la notion de travail.
Il est nécessaire d'avancer dans l'élaboration de la réalité concrète du travail du care. Une grande partie de ce qui est compris sur le travail du care est comme un miroir du travail salarié. Il y a eu des progrès dans les discussions sur la redistribution, les temps et les droits, mais on discute peu de la logique de ce travail. Cela ne peut être débattu qu'en considérant les expériences des femmes, leurs réseaux, leurs relations et aussi les technologies. Cela s'articule nécessairement avec les conditions de travail et les possibilités de socialisation, articulant les dimensions publique et communautaire. Un indice partagé était de retrouver les principes, les relations et la dynamique des soins qui sont au cœur de la durabilité de la vie – et donc de l'économie – pour la transformer.
Des politiques publiques pour réorganiser les soins et mettre la vie au centre
Différentes expériences de construction de politiques nationales de travail du care sont en cours, notamment en Amérique latine, comme c'est le cas du Brésil. Certaines d'entre elles prennent la forme de systèmes nationaux de soins. Ces constructions sont plus susceptibles de contribuer à transformer les fondements de l'inégalité lorsqu'elles sont en phase avec les politiques redistributives des gouvernements en question.
Les camarades de la Confluence des femmes de Colombie ont partagé leur expérience actuelle. Dans le pays, l'État a soutenu la création d'un système de soins qui combine des politiques pour les femmes et des expériences de politiques territorialisées. L'exemple principal est les Manzanas de Cuidado, des espaces publics de soins qui favorisent également l'autonomie des femmes. Ils créent les possibilités de collectiviser le travail et d'effectuer des tâches qui seraient réalisées dans les foyers, comme laver les vêtements. Cela contribue à ce que les femmes aient le temps de se reposer, de socialiser et d'avoir plus d'autonomie. Dans un territoire affecté par de nombreuses années de conflits armés et de forces paramilitaires et par l'avancée des sociétés minières transnationales, les femmes partagent cet engagement car elles comprennent que, à la campagne et en ville, les soins communautaires sont un travail et une pratique de leadership féminin, ce qui implique des besoins en temps et en organisation.
Effectivement, il y a les systèmes de soins idéaux et les systèmes de soins de facto, où il y a simultanément surcharge et protagonisme des femmes. Prendre soin implique du temps de travail, l'organisation de réseaux de soins et la mobilisation de diverses ressources autour du soin de la vie en commun.
Face à la limite de survie de l'humanité et de la planète, il est nécessaire de construire les conditions pour rompre avec la logique d'accumulation, transformer la reproduction mais aussi changer la production (qu'est-ce qui est produit, comment, pour quoi et pour qui ?) de la logique du soin et de la durabilité de la vie. C'est là que réside le pouvoir de transformer toute l'économie de la logique et des temps de soins.
Le webinaire a été organisé par l'organisation féministe SOF Sempreviva, la Marche mondiale des femmes du Brésil et Capire, avec le soutien du Ministère des femmes du Gouvernement fédéral du Brésil par le financement public n°954083/2023.
Écrit par Tica Moreno
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
https://capiremov.org/fr/analyse/socialiser-le-travail-du-care-transformer-leconomie/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Géopolitique du commerce des armes

La récente décision britannique de suspendre une partie de ses ventes d'armes à Israël intervient à quelques jours du dixième anniversaire de la signature du Traité des Nations unies sur le commerce des armes. L'occasion de faire le point sur la géopolitique du trafic d'armes et la législation à cet égard. Ainsi que sur la responsabilité des États.
Tiré du blogue de l'auteur.
La décision du gouvernement britannique de faire une « pause » dans la livraison d'armes à Israël, pour symbolique qu'elle soit – elle ne concerne qu'une partie des armes livrées et les exportations britanniques ne représentent qu'un pourcent des importations israéliennes –, remet au-devant de la scène la responsabilité des États ; leur incohérence et leur cynisme. Le 20 juin dernier, les experts et expertes de l'ONU réitéraient ainsi leur demande que les États et les entreprises cessent immédiatement leur transfert d'armes vers l'État israélien [1]. Cela revenait simplement à exiger que les règles et les lois soient respectées.
Le 2 avril 2013, 155 États ont adopté le Traité des Nations unies sur le commerce des armes. À l'heure actuelle, à l'exception de la Russie, les plus grands exportateurs d'armes au monde en sont signataires. Mais les États-Unis ne l'ont pas ratifié. Or les articles 6 et 7 du traité obligent à interdire la fourniture d'armes à des pays qui pourraient les utiliser pour commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou d'autres crimes de guerre, ou qui pourraient s'en servir pour commettre ou faciliter des violations graves des droits humains ou du droit humanitaire international [2].
Tout transfert vers l'État israélien – qui, à l'instar des États-Unis, a signé mais non ratifié ce Traité – est donc interdit. Une interdiction violée par ceux-là même qui ont fixé les règles. Malheureusement, au cours de la dernière décennie, les articles 6 et 7 du Traité (de même que la quinzaine d'embargos de l'ONU sur les armes vers certains pays) ont été enfreints à maintes reprises et en toute impunité [3]. La force prime et foule au pied le droit. Et la double logique du profit et de la militarisation hypothèque toute solution.
Géopolitique de l'armement
Le niveau de l'armement mondial peut être mesuré sous trois angles : dépenses militaires, import-export, part du budget militaire dans les économies nationales. Ces dix dernières années, et tout particulièrement avec les conflits armés en Ukraine et à Gaza, les dépenses militaires mondiales n'ont cessé d'augmenter. Les États-Unis en absorbent 37% et la Chine 12%, soit à eux deux quasiment la moitié du total. Dix États représentent les trois-quarts de ces dépenses au niveau du monde. La Russie, l'Inde et l'Arabie saoudite sont dans le top 5, tandis que la Grande-Bretagne est, en Europe, le pays le plus dépensier en la matière.
En 2023, par rapport à l'année précédente, les dépenses militaires d'Israël et de l'Ukraine – tous les deux engagés dans une guerre dévastatrice – ont augmenté respectivement de 24% et de 51%. Mais, la hausse la plus spectaculaire s'est produite en République démocratique du Congo qui, confrontée au conflit armé dans l'Est du pays et aux tensions grandissantes avec le Rwanda, a plus que doublé ses dépenses militaires. La Belgique, quant à elle, est classée 34ème et ses dépenses militaires représentent 0,3% du total mondial [4].
Le commerce des armes est encore plus concentré que les dépenses militaires : pour la période 2019-2023, les États-Unis ont assuré 42% des exportations mondiales d'armes [5]. Loin derrière, la France et la Russie occupent respectivement les deuxième et troisième places, avec chacune 11% des parts du marché. Avec la Chine et l'Allemagne, ces pays constituent les principaux exportateurs d'armes et concentrent ensemble plus des trois-quarts des exportations. À l'autre bout de la chaîne, du côté des importateurs, l'Inde occupe la première place, représentant près de 10% des importations mondiales de l'armement. Les tensions avec ses voisins, le Pakistan et la Chine, ainsi que des choix stratégiques, expliquent en grande partie cette position. L'Arabie saoudite, le Qatar, l'Ukraine et le Pakistan figurent parmi les cinq plus grands importateurs. Ils totalisent ensemble 35% des importations.
Plusieurs États, dont certains sont parties prenantes de conflits armés, dépendent très largement d'une ou deux sources pour leur approvisionnement en armes. Par exemple, Israël, quinzième importateur mondial d'armement, s'appuie presque exclusivement sur les États-Unis (69%) et l'Allemagne (30%) pour ses importations d'armes. De même, 75% des armes importées d'Arabie saoudite proviennent des États-Unis ; 77% de l'armement russe importé est chinois.
Une autre manière d'appréhender le poids des armes dans l'économie est de mesurer la part des dépenses militaires dans le produit intérieur brut (PIB) d'un État. Sous cet angle-là, ce ne sont pas les États-Unis qui sont en tête – avec des dépenses militaires qui représentent 3,4% du PIB, le pays est classé 9ème –, mais bien l'Ukraine, où plus d'un tiers du PIB est consacré à l'armement. Les dépenses militaires de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de la Russie, d'Oman et d'Israël dépassent les 5% du PIB.
Militarisation et « sécuritisation »
Au lendemain de l'invasion russe en Ukraine, puis, à nouveau, après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, les actions en bourse des grandes entreprises de la défense américaine ont connu une soudaine hausse. Les guerres profitent à quelques-uns… L'industrie de l'armement alimente les conflits armés qui génèrent en retour d'importants profits pour ce secteur, étroitement imbriquée aux intérêts et stratégies des États. Il est d'autant plus difficile de briser ce cercle vicieux que les États-Unis poussent à une militarisation, par le biais notamment de l'OTAN. Cette alliance internationale – qui regroupe trente-deux membres, principalement européens – s'est ainsi fixé pour objectif que chaque État partie consacre au moins 2% de son PIB aux dépenses militaires (ce qui est déjà le cas de la Grande-Bretagne, de la France, de la Pologne, de la Grèce et de la Finlande). En revanche, des pays comme La Belgique où « seulement » 1,2% du PIB est consacré aux dépenses militaires (1,5% en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas) devraient ainsi consacrer beaucoup plus d'argent à ce poste, au détriment de services sociaux tels que l'éducation et la santé, secteurs autrement plus stratégiques.
De manière plus organique, la militarisation est catalysée par un narratif et une logique, qu'elle alimente. Le terme de « sécuritisation » a été introduit pour rendre compte du « processus par lequel un problème politique est identifié et traité comme une question de sécurité », donnant une signification particulière, socialement construite, à la menace et à l'(in)sécurité [6]. Ce phénomène est particulièrement évident dans la politique européenne face à la migration, à travers notamment la militarisation des frontières.
La célèbre formule de Clausewitz, « la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens », doit dès lors être corrigée et complexifiée en ce sens que la guerre change la signification de la politique, en la réduisant à un jeu stratégique. Et ces « autres moyens » – dont l'armement – participent de cette reconfiguration des conflits en termes (uniquement) sécuritaires, tendant à hypothéquer de la sorte toute solution politique et, à terme, la perspective d'une paix juste et digne.
Notes
[1] UN, « States and companies must end arms transfers to Israel immediately or risk responsibility for human rights violations : UN experts », 20 juin 2024, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/06/states-and-companies-must-end-arms-transfers-israel-immediately-or-risk.
[2] Le texte intégral du Traité est accessible ici : https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf. Voir également NTI, Arms Trade Treaty (ATT), https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/arms-trade-treaty-att/.
[3] Amnesty International, « Le terrible bilan humain du total mépris des règles du Traité sur le commerce des armes de la part des États », 19 août 2024, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2024/08/global-governments-brazen-flouting-of-arms-trade-treaty-rules-leading-to-devastating-loss-of-life/. Lire aussi The companies arming Israel and their financiers, juin 2024, https://www.cncd.be/IMG/pdf/report_-_the_companies_arming_israel_and_their_financiers_-_june_2024-2.pdf.
[4] Sipri, Spiri fact sheet. Trends in world military expenditure, 2023, avril 2024, https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf. Sauf mentions contraires, tous les chiffres proviennent de cette étude.
[5] Sipri, Spiri fact sheet. Trends in international arms transfers, 2023, mars 2024, https://www.sipri.org/publications/2024/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2023. Sauf mentions contraires, tous les chiffres proviennent de cette étude.
[6] ENAAT, Rosa Luxembourg Stiftoung, Une Union militarisée. Comprendre et affronter la militarisation de l'Union européenne, 2021, https://rosalux.eu/en/2021/import-1981/.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
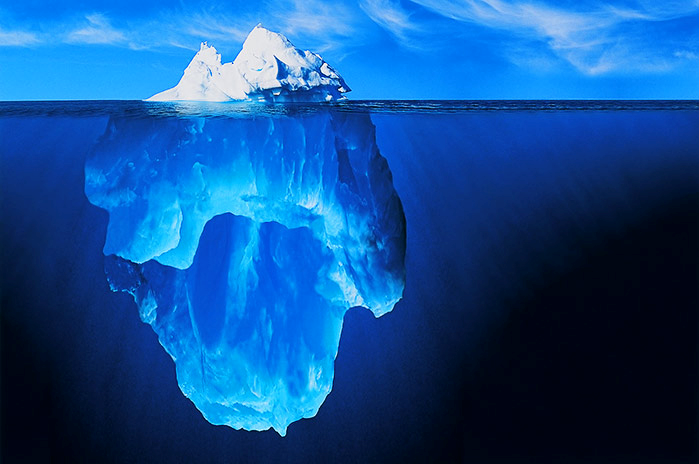
Parole politique et bloc social
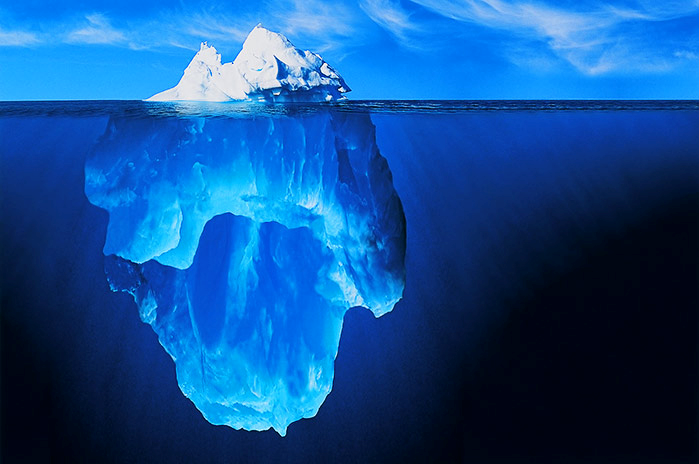
Dans cette tribune, André Prone, environnementaliste, poète et essayiste, analyse la dynamique de fascisation des droites néolibérales et sociales-libérales à l'échelle nationale et internationale.
Tiré de L'Humanité
5 septembre 2024
Des personnalités comme Le Pen, Meloni, Trump et d'autres, ainsi que leurs mouvements, ne sont que la partie émergée de l'iceberg de ce « nouveau bloc bourgeois ».
La situation politique actuelle est marquée par la montée de mouvements et de figures politiques que l'on peut qualifier de fascisantes, telles que Marine Le Pen en France, Giorgia Meloni en Italie ou Donald Trump aux États-Unis, parmi d'autres. Mais, pour comprendre ce phénomène, il importe d'analyser la dynamique de fascisation des droites néolibérales et sociales-libérales à l'échelle nationale et internationale, ainsi que ce
que cela implique pour les forces de gauche, les mouvements sociaux et
les problématiques écologiques.
Il serait naïf ou contre-productif de se concentrer uniquement sur les figures de l'extrême droite sans examiner le phénomène plus large de fascisation qui touche toutes les droites néolibérales et sociales-libérales, dont la Macronie et ses équivalents occidentaux sont parmi les principaux protagonistes.
Ce processus, théorisé par von Hayek et Milton Friedman au cours de la grande dépression des années 1930, et que l'on peut qualifier de néolibéralisme factieux, n'a d'autre but que de renflouer le capitalisme.
Des personnalités comme Le Pen, Meloni, Trump et d'autres, ainsi que leurs mouvements, ne sont que la partie émergée de l'iceberg de ce « nouveau bloc bourgeois » qui œuvre à sortir le capital décadent de sa crise systémique et environnementale.
En effet, derrière ces figures fascisantes se cache, notamment depuis la prétendue crise pétrolière des années 1970, ce bloc bourgeois incarné par les droites classiques et les courants sociaux-libéraux qui cherchent à protéger le capitalisme à tout prix, tout en faisant mine de combattre certains mouvements ouvertement fascistes. Ce soutien implicite entre l'extrême droite, la droite classique et certaines branches du social-libéralisme se manifeste principalement dans la défense du « soldat
Capital ».
Leurs objectifs communs, parfois dissimulés, sont d'autant plus importants qu'ils sont soutenus par des institutions supranationales telles que le FMI, l'OMC, l'Union européenne et l'Otan, dont le rôle crucial dans le maintien de l'ordre néolibéral factieux mondial est à souligner.
Par conséquent, attaquer les figures politiques de l'extrême droite et leurs mouvements, sans analyser l'ensemble des objectifs capitalistes qui les sous-tendent, peut conduire à une compréhension superficielle des enjeux idéologiques et géopolitiques en cours. Pour construire une riposte politique et écologique efficace, il importe de distinguer entre le bloc
électoral et le bloc social. Bien que l'importance du premier ne doive pas être négligée, la priorité doit être donnée à la construction d'un bloc social capable de mener des luttes sociales et écologiques de grande envergure, tout en travaillant à construire des solidarités de classe et des pratiques relevant de ce que nous pourrions qualifier de « quotidienneté
écomuniste ». C'est particulièrement pertinent face à une social-démocratie qui, tout en se réclamant de la gauche, est loin d'être une force de transformation et agit avant tout comme un accompagnateur du néolibéralisme.
La question centrale consiste donc à savoir comment contenir et renverser ce « nouveau bloc bourgeois fascisant », notamment avec la faiblesse des forces qui prétendent incarner un bloc électoral de rupture.
La construction d'un bloc social solide et organisé est indispensable pour contrer efficacement les dynamiques fascisantes. Cela nécessite une mobilisation intense, une éducation politique approfondie et la formation d'alliances stratégiques au sein des mouvements de gauche et progressistes, des forces syndicales, associatives, écologiques et citoyennes, sur de véritables positions de classe. Voilà pourquoi l'analyse
politique de la situation actuelle doit se situer au-delà des figures individuelles et examiner les dynamiques systémiques et idéologiques qui sous-tendent la montée des droites fascisantes.
Quant à la riposte, elle nécessite une claire distinction entre le bloc électoral et le bloc social, capable de porter une véritable transformation politique, sociale, culturelle et écologique. Le rôle du Nord global dans ce processus doit également être pris en compte, car les pays qui le composent jouent un rôle de premier plan dans la perpétuation des
politiques néolibérales factieuses du nouveau front bourgeois à l'échelle
nationale et internationale.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un changement de période historique : crise structurelle et montée de l’extrême droite

Nous vivons une période marquée par la montée des guerres et des violences. Les contradictions sociales, écologiques, politiques, idéologiques, toujours très présentes, s'approfondissent dans chaque pays et à l'échelle mondiale. L'extrême droite progresse, sous différentes formes, dans un grand nombre de régions du monde.
25 août 2024 | Source : https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article71911
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/12/un-changement-de-periode-historique/#more-85532
Les mouvements sociaux et citoyens sont toujours présents et actifs, mais ils sont à la recherche de la définition de nouvelles perspectives et de nouvelles stratégies. L'hypothèse est que nous sommes dans une crise structurelle qui nous rappelle, par certains côtés, celle des années 1930. Elle marque un changement de période au niveau de l'organisation du monde. Même si les situations ne se reproduisent jamais pareillement, la référence permet de réfléchir à certaines caractéristiques de la situation actuelle avec l'approfondissement d'une crise économique et sociale, des guerres, des alliances entre les droites et les extrêmes droites, des changements géopolitiques et idéologiques[3]. L'interrogation porte sur la définition de la situation et de la période que nous vivons. Elle rappelle une des dernières anecdotes soviétiques ; celle d'un homme hagard qui, en 1989, sur la place Rouge, interpelle les passants en demandant à chacun : quelle heure est-il ? Traduisons sa question : qu'est-ce qui se passe ? dans quelle période sommes-nous ?
Les grandes contradictions à l'œuvre sont toujours celles qui caractérisent le capitalisme contemporain même si leur caractérisation change suivant les périodes. Les changements concernent toutes les dimensions. Trois grands types de contradictions sont à l'œuvre. La première est la question sociale, les rapports entre les classes sociales, avec l'importance considérable des inégalités et des discriminations. La deuxième est un élément nouveau et déterminant, la rupture écologique, et la manière de penser le climat, la biodiversité, la Nature. La prise de conscience de cette contradiction est plus récente, la question est toujours controversée. La phase sécuritaire du néolibéralisme est accentuée par la rupture écologique qui introduit une très grande discontinuité, déjà sensible, avec la crise climatique et ses conséquences sur la biodiversité. La troisième concerne les guerres et la démocratie, locale, nationale et internationale. La démocratie interroge les rapports entre le politique et l'idéologique. La démocratie locale intègre les territoires et les différentes formes de régionalisme et de municipalisme. La démocratie nationale interroge les rapports entre les peuples, les nations et les États. La démocratie mondiale passe par la démocratie internationale qui, dans sa forme existante, se réfère à un système international qui doit être radicalement réformé et réinventé.
L'hypothèse est que la période actuelle correspond à une nouvelle crise structurelle du capitalisme. Ces crises préparent et définissent une nouvelle phase du mode de production capitaliste. Elles soulèvent aussi la question du dépassement du capitalisme. De nouveaux réaménagements des rapports de production se définissent et s'imposent. Les structures sociales se transforment et les contradictions sociales s'aiguisent et changent de nature. Dans chacune de ces périodes, les classes sociales se redéfinissent ainsi que les rapports entre elles. Nous analyserons la période actuelle à partir de la crise de 2007- 2008. Nous commencerons par rappeler deux périodes de crises antérieures, celle de la crise financière de 1873, qui va en fait de 1860 à 1880, et la crise financière de 1929, qui va de 1914 à 1945. Nous aborderons ensuite la crise des années 1970 et la domination du néolibéralisme. Ces périodes ont commencé par des périodes de montée des conservatismes et des droites extrêmes ; mais, ensuite, les contradictions sociales et politiques se sont accrues et ont conduit à des redéfinitions majeures. Ainsi, en France, la période de crise de 1873 a vu la guerre franco-allemande et Thiers, mais aussi la 1ère Internationale et la Commune. Et pour la crise de 1929, il y a eu, en France, les manifestations massives de l'extrême droite, en1934 ; mais aussi, le Front Populaire, en 1936. Ce sont des périodes de fortes luttes sociales et de guerres. C'est ce qui devrait marquer la période à venir.
Retour sur quelques leçons de deux des crises structurelles précédentes
De 1860 à 1880, la crise de la deuxième révolution industrielle et la première internationale
La période 1860 à 1880 est une période de crise structurelle du capitalisme[4]. On y retrouve des mutations structurelles du mode de production capitaliste, des guerres, des luttes sociales radicales et révolutionnaires, des bouleversements politiques, un débat idéologique et théorique intense. La période est marquée par l'arrivée au pouvoir en Europe de partis qui se rattachent au conservatisme radical et à la droite extrême, mais les contradictions sociales et politiques se traduisent aussi par des actions et une pensée révolutionnaire renouvelée qui dépasseront la période.
La période de 1860 à 1880 est celle de la deuxième révolution industrielle, celle du capitalisme industriel et du capitalisme marchand, celle des doctrines libérales. C'est une période des grandes usines et de l'urbanisation. L'innovation technologique est intense dans les nouvelles machines et les processus de production. Les secteurs en expansion sont l'électricité, le pétrole, le moteur à combustion, l'acier, les moyens de communication avec le téléphone et le télégraphe et les câbles intercontinentaux. La production de masse s'appuie sur les nouvelles chaînes de montage. Elle prépare le taylorisme à partir des années 1880. C'est aussi, avec l'urbanisation, la nouvelle classe ouvrière, le syndicalisme, les classes moyennes et l'accès à la consommation.
La période est marquée par le krach boursier de 1873, la fermeture de banques, la dépression économique et le chômage. La spéculation sur les chemins de fer accompagne la baisse des prix, les faillites d'entreprise et le chômage. Plusieurs guerres marquent cette époque. La guerre de sécession en 1861-1865 et la crise économique mondiale qui l'accompagne. L'unification de l'Italie, de 1859 à 1871, redessine les frontières de l'Europe. La guerre franco-prussienne, 1870-1871, entraîne la chute de Napoléon III et la proclamation de l'empire allemand à Versailles. L'influence ottomane baisse en Europe. La colonisation européenne s'étend en Afrique et en Asie ; elle est formalisée par la Conférence de Berlin en 1884.
En réponse à cette situation, les mouvements sociaux connaissent un essor remarquable. La Première internationale, l'AIT, Association internationale des travailleurs est créée en 1864, à Londres. Elle sera active de 1864 à 1876 et regroupera des syndicalistes et des intellectuels, dont Marx, Engels, Proudhon, Bakounine, Louise Michel. En 1871, La Commune de Paris va bouleverser la pensée révolutionnaire avec son pouvoir autogéré et ses principes démocratiques et sociaux, jusqu'à la Semaine sanglante de mai 1871. A la lumière de cette extraordinaire insurrection, Marx redéfinira sa conception de l'Etat.
Les conservateurs radicaux et la droite extrême dominent toute la période. Au début de la période, ils se partagent, et s'affrontent entre bonapartistes et royalistes légitimistes. Après la Commune, ce sera la République de Thiers et de Mac Mahon. Entre droite et extrême droite, il y a des contradictions mais un accord contre l'ennemi socialiste. À la fin de la période, se forment des petites organisations qui préfigurent les organisations de l'extrême droite du XXème siècle, comme, par exemple, l'Action française et, déjà, Charles Maurras. Malgré une hégémonie apparente des droites réactionnaires, les luttes révolutionnaires ont culminé avec la Commune ; les luttes sociales ont continué avec les Bourses du Travail qui ont préparé le syndicalisme moderne. Et la 1e internationale a jeté les bases de l'affirmation et de l'organisation de la classe ouvrière.
De 1913 à 1945, la crise du capitalisme fordiste ; le keynésianisme, le soviétisme et la décolonisation
La crise de 1929 est marquée par un krach boursier, la chute de la production, la baisse de l'investissement, la déflation et l'accroissement du chômage. Le krach boursier de 1929 bouleverse les marchés financiers à l'échelle mondiale. Il se traduit par la tendance à la surproduction et par la baisse des taux de profit. La crise financière de 1929 est la première crise du capitalisme fordiste. Le capitalisme fordiste s'est construit et s'est développé à partir du secteur de l'automobile. Il combine le travail à la chaîne, la standardisation des produits et la consommation de masse. Ford lance la première chaîne de montage en 1913 et double les salaires en 1914 pour permettre aux salariés d'acheter ses produits et stimuler la demande intérieure. Le fordisme nécessite un marché de l'emploi stable et des salaires relativement élevés. La crise fordiste accélère l'effondrement de la demande, la surproduction, des faillites d'entreprises et une crise de l'emploi. La consommation de masse repose sur le recours au crédit. L'endettement des ménages se traduit par une consommation insuffisante, le non-remboursement des dettes et des déséquilibres économiques. La crise fordiste est aggravée par les politiques monétaires et fiscales, les déséquilibres commerciaux internationaux et les spéculations financières.
Le keynésianisme, le capitalisme keynésien, est une réponse à la crise fordiste. La période du capitalisme keynésien est dominante depuis les années 1930 jusqu'aux années 1970. Le keynésianisme complète le capitalisme fordiste après la crise des années 1930. Keynes propose l'intervention de l'État pour gérer la demande et stabiliser l'économie à partir des dépenses publiques. Roosevelt fait adopter en 1934, sous le nom de New-Deal, un nouveau modèle de développement, fordiste et keynésien. Ce modèle sera surtout appliqué en 1945, après la guerre mondiale. Il implique des concessions sociales importantes, formalise le rôle de l'État et la protection sociale. Du début du 20ème jusqu'aux années 1970, le fordisme va associer la production de masse, l'amélioration des salaires, la consommation de masse et l'intervention de l'État. Le keynésianisme, à partir des années 1930, le complétera par la régulation assurée par l'État, le soutien de l'emploi et des salaires, les dépenses publiques et les investissements dans les infrastructures. La régulation passe par les accords collectifs et les négociations avec les syndicats. Plusieurs caractéristiques de cette période restent encore actuelles aujourd'hui dans la période du capitalisme mondialisé qui commence en 1970.
Le capitalisme fordiste, puis fordiste et keynésien, développe plusieurs branches industrielles ; l'automobile, l'électroménager, la sidérurgie et la métallurgie, la chimie et la pétrochimie, le textile, l'agroalimentaire, la construction. Les grandes entreprises sont les acteurs économiques et politiques dominants. La classe dominante allie les dirigeants des entreprises, surtout des grandes entreprises privées, et une bourgeoisie d'État, acquise à la préservation du capitalisme, qui gère l'État et les entreprises publiques et les transforme dans le sens des intérêts du capitalisme privé. L'État développe un secteur public composé des administrations et des entreprises publiques qui sont transformées suivant la logique des entreprises privées. Les deux classes principales du capitalisme fordiste et keynésien opposent la classe ouvrière et la classe capitaliste, avec ses deux composantes, les actionnaires et les chefs d'entreprise d'un côté, et les cadres de la bourgeoisie d'état de l'autre. Une catégorie de cadres, ingénieurs et techniciens, de plus en plus nombreuse assure la gestion du système. Une petite bourgeoisie traditionnelle prolonge les catégories sociales précapitalistes, Les paysans se partagent entre les capitalistes agricoles et les paysans travailleurs, prolétarisés. Et, déterminant, il y a toujours le travail des femmes invisibilisées et prolétarisées.
La crise financière de 1929 est significative de la crise structurelle du capitalisme. La réponse keynésienne se caractérise par une intervention de l'Etat et la régulation des marchés financiers. La période est marquée par les guerres qui caractérisent toute période de crise structurelle. Celle-ci l'a été particulièrement. La période, de 1913 à 1945, est marquée par les deux guerres mondiales[5]. La première guerre mondiale de 1914 à 1918 ; et la deuxième guerre mondiale de 1939 à 1945. Il y a eu beaucoup d'autres guerres qui marquent la scène politique mondiale. Certaines étaient liées à des révolutions. Rappelons, parmi d'autres, la guerre civile russe de 1917 à 1923, la guerre gréco-turque de 1919 à 1922, la guerre civile finlandaise en 1918, la guerre civile irlandaise en 1922, la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, la guerre sino-japonaise de 1937 à 1945, la guerre civile chinoise de 1927 à 1945, la révolution mexicaine de 1910 à 1920.
La révolution soviétique en Russie, en 1917, et la révolution chinoise de 1927 à 1949, vont complètement bouleverser l'état du monde. Le rôle de l'Union soviétique pendant la guerre de 1939 à 1945 va lui donner une place centrale dans l'ordre mondial ; on entre dans un monde à deux blocs qui va caractériser l'état de la planète jusqu'en 1989. Cette situation va déterminer les débats politiques et idéologiques qui seront intenses. Le capitalisme fordiste et keynésien ne manque pas de penseurs très actifs dans les universités et les centres de recherches occidentaux. En contrepartie, de nombreux penseurs défendent une pensée socialiste très diverse ; comme par exemple Lénine, Mao, Trotski, Gramsci et bien d'autres. Il y a des tentatives de relier le marxisme et le keynésianisme, notamment, celles de Joan Robinson et Michal Kalecki.
La période est marquée par la montée en puissance de la décolonisation. Les luttes de résistance à la colonisation n'ont jamais cessé ; les peuples ont toujours résisté et ont été très violemment réprimés. Parmi les grands mouvements qui ont marqué l'Histoire, rappelons la révolution anticolonialiste, antiesclavagiste et anti ségrégationniste à Haiti, en 1804 et la révolution paysanne mexicaine avec Zapata en 1905. En 1920, à Bakou, au Congrès des Peuples d'Orient, une alliance stratégique est passée entre les mouvements de libération nationale et les mouvements communistes de 1917. Cette alliance va permettre l'encerclement des impérialismes et l'essor des libérations nationales. En 1927, se tient à Bruxelles le premier Congrès contre le colonialisme et l'impérialisme présidé par Albert Einstein et Madame Sun Yat-Sen, autour du mot d'ordre « Liberté nationale, égalité sociale ». À partir de 1945 commence le mouvement des indépendances nationales. L'Indonésie et le Vietnam proclament leur indépendance. La Jordanie, les Philippines, la Syrie le font en 1946. En 1955, à Bandung, le président d'Indonésie, Soekarno, invite les chefs d'Etat des dix-sept premiers pays indépendants d'Afrique et d'Asie[6] et notamment Tito, Nasser, Nehru et Chou en Lai. Chou en Lai résume la situation en ces termes : « les États veulent leur indépendance, les nations veulent leur libération, les peuples veulent la révolution ». Les participants définissent une orientation, celle du non-alignement. La révolution cubaine, amorcée en 1953, est victorieuse en 1956. La conférence Tricontinentale, en 1966, à La Havane, amorce l'émergence d'un Sud par rapport aux deux blocs de l'Ouest et de l'Est.
Le mouvement des non-alignés va tenter de définir un modèle de développement[7] qui prenne à la fois en compte le modèle keynésien, sur les formes étatiques de régulation, et le modèle soviétique, notamment sur l'industrie lourde et l'agro-industrie. Il met en avant le rôle prédominant de l'Etat dans la conduite de l'économie. Ce modèle trouvera en partie son expression dans la déclaration sur le droit au développement qui sera adopté en 1986 par l'Assemblée des Nations Unies[8]. Mais depuis la fin des années 1970, une autre notion du développement s'est imposée, celle du néolibéralisme.
La droite et l'extrême droite ont joué un rôle déterminant de 1913 à 1945. Pour l'extrême droite, les fascistes en Italie, les nazis en Allemagne, les franquistes en Espagne sont suivis par des mouvements nationalistes radicaux dans toute l'Europe et sur d'autres continents. L'idéologie d'extrême droite se caractérise par un nationalisme radical, la xénophobie, l'opposition à la démocratie libérale, le soutien à l'autoritarisme et au fascisme, les références au racisme, à l'antisémitisme et au militarisme. Les partis de droite comprennent les conservateurs, les monarchistes et les libéraux économiques. Ils défendent l'ordre, l'autorité, le conservatisme social et le libre marché économique. Il est intéressant de rappeler la période de 1934 à 1936 en France, celle des affrontements violents entre extrême droite et Front populaire. Les Ligues d'extrême droite organisent les manifestations du 6 février 1934. En réponse, les partis de gauche forment le Front Populaire, une alliance électorale, qui gagne les élections en 1936.
De la crise des années 1970 au néolibéralisme
Le capitalisme a fortement évolué après 1945. De 1945 jusqu'aux années 1970, on est dans un prolongement du capitalisme fordiste et keynésien, dans un contexte géopolitique d'un monde bipolaire partagé entre l'Occident (Amérique du nord, Europe, Japon) et l'Union soviétique et ses alliés. Dans les années 1970, le capitalisme mondialisé a pris le relais du capitalisme keynésien en tant que forme dominante du capitalisme et a mis en place le capitalisme néolibéral.[9]
Les relations du capitalisme fordiste et keynésien au marché national et à la mondialisation sont complexes. Pour le capitalisme keynésien, la production de masse est orientée vers le marché domestique, ce qui justifie les augmentations de salaires et qui légitime la régulation et le protectionnisme. La mondialisation est limitée, les exportations sont sélectives et la priorité est donnée au marché national. Les investissements directs étrangers sont contrôlés. Le post-fordisme va accélérer la transition vers une mondialisation accélérée. La crise des années 1970 est marquée par les chocs pétroliers et une stagflation. La mondialisation accrue se traduit par la priorité donnée à la réduction des coûts et à la flexibilité pour s'adapter à l'environnement économique mondial, à la délocalisation vers les faibles coûts de main d'œuvre, à l'explosion du commerce mondial, à la domination des chaînes d'approvisionnement mondiales, à l'imposition de la flexibilité pour répondre à la priorité de la demande mondiale.
Un affrontement Nord-Sud, postcolonial, avait commencé, en 1953, avec la nationalisation en Iran du pétrole par Mossadegh. Il a été renversé. L'affrontement aura lieu en 1973 avec le quadruplement du prix du pétrole et en 1979, à la suite de la révolution islamique en Iran, avec un nouveau doublement du prix du pétrole. Mais les États pétroliers ne préservent pas l'unité des pays du Sud et laissent les pays occidentaux retourner la situation en leur faveur. En 1975 est créé le G5, qui deviendra le G7, qui regroupe les pays dirigeants occidentaux. Ils lancent, en organisant l'endettement des pays du Sud, une contre-offensive qui réussit et qui rallie certains pays pétroliers à l'offensive occidentale. Les institutions de Breton-Woods, FMI et Banque Mondiale, vont imposer, à partir d'une gestion inique de la dette, les Programmes d'Ajustement Structurel, les PAS. C'est une entreprise de recolonisation des pays du Sud. De nombreux mouvements contre la dette vont se développer dans les pays du sud, avec des mouvements de soutien dans des pays du nord, mais sans réussir à sortir de ce piège qui va fonctionner de 1979 jusqu'à aujourd'hui. Le capitalisme réussit une nouvelle mutation avec la mise en place du capitalisme financier et sa stratégie : marchandisation, privatisation, financiarisation.
La poussée de la droite et de l'extrême droite a commencé, pendant quarante ans, par une bataille pour l'hégémonie culturelle autour de cinq offensives. La première offensive, idéologique, a porté d'abord sur trois questions : contre les droits et particulièrement contre l'égalité, les inégalités seraient justifiées parce que « naturelles » ; contre la solidarité, le racisme et la xénophobie s'imposent ; contre l'insécurité, l'idéologie sécuritaire serait la seule réponse possible. La deuxième offensive est militaire et policière ; elle a pris la forme de la déstabilisation des territoires rétifs, de la multiplication des guerres, de l'instrumentalisation du terrorisme. La troisième offensive a porté sur le travail, avec la remise en cause de la sécurité de l'emploi et la précarisation généralisée, par la subordination de la science et de la technologie, notamment du numérique, à la logique de la financiarisation. La quatrième offensive a été menée contre l'Etat social par la financiarisation, la marchandisation et la privatisation ; elle a conduit à la corruption systématique des classes politiques. La cinquième offensive, dans le prolongement de la chute du mur de Berlin en 1989, a porté sur la disqualification des projets progressistes, socialistes ou communistes.
A partir de 1977, commence une nouvelle phase du capitalisme en réponse aux difficultés du capitalisme keynésien et au danger géopolitique de montée en puissance d'un Sud postcolonial. La réponse est à la fois économique et géopolitique. Sur le plan économique, le keynésianisme n'étant pas applicable à l'ensemble de la planète, on proposera de promouvoir une nouvelle forme d'organisation capitaliste et impérialiste, le néolibéralisme. Sur le plan géopolitique, on s'attachera à marginaliser les Nations Unies et à promouvoir les institutions de Breton-Woods (FMI, Banque Mondiale et OMC). Pour imposer cette nouvelle orientation, la stratégie est claire : l'endettement des pays du Sud.
Le capitalisme néolibéral
Le capitalisme néolibéral est précisé et expérimenté au Chili, à partir du coup d'État fomenté par Pinochet en 1973 qui a permis de mettre en place une politique, appliquée par un régime fasciste, définie à l'Université de Chicago par Milton Friedman. Le président français Giscard d'Estaing crée en 1975, le G5, qui deviendra G7, pour répondre au choc pétrolier. La stratégie est claire : endetter les pays du Tiers-monde ! Et, pour assurer le remboursement de la dette, imposer des PAS, des programmes d'ajustement structurel, organisés en fonction d'une doxa néolibérale et gérés par le FMI et la Banque Mondiale. Encore une fois, l'extrême droite est présente et active dans une période de crise du capitalisme. Le néolibéralisme est expérimenté et imposé par un régime fasciste celui de Pinochet au Chili. A partir de la nouvelle théorie des Chicago-boys ! Elle sera reprise, perfectionnée et imposée par Mme Thatcher en Grande Bretagne, Ronald Reagan aux États Unis et Giscard d'Estaing en France.
Le modèle s'impose du fait des difficultés et des échecs des politiques liées aux modèles d'indépendance nationale. La construction de l'État, au départ moyen du développement, est devenue une fin en soi. La fonctionnarisation accélérée et l'urbanisation galopante ont provoqué un déséquilibre structurel des fondamentaux économiques (budget, balance commerciale, balance des paiements). La bureaucratie et la corruption ont gangrené les sociétés. Le déni des droits fondamentaux et l'absence de libertés ont achevé de réduire fortement la crédibilité de ces régimes. La crise de la décolonisation, de sa première phase, celle de l'indépendance des États, est ouverte.
Un mouvement altermondialiste émerge en réponse à cette stratégie du capitalisme et de la financiarisation. En réponse à l'affirmation de Madame Thatcher, « il n'y a pas d'alternative », il affirme « un autre monde est possible ». La première phase de ce mouvement commence, dès 1979, avec les mouvements contre la dette et contre les programmes d'ajustement structurel. Le mouvement ATTAC, pour la taxation des transactions financières et le CADTM, Comité pour l'annulation des Dettes du Tiers-Monde, relayent et élargissent, dans le monde, les mouvements des pays du Sud contre la dette. A partir de1989, la situation évolue avec la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique et le passage à un monde unipolaire sous la direction des États Unis et du G7. Le G7 va chercher à construire un nouveau système international, conforme à son projet, en complétant les institutions de Breton-Woods, le FMI et a Banque Mondiale, par l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Des grandes manifestations internationales de 1989 à 1999, ont lieu contre ces institutions et le G7, à Paris, Madrid, Washington, Gênes et partout dans le monde autour du mot d'ordre, « le droit international ne doit pas être subordonné au droit des affaires ». La réunion de l'OMC à Seattle en 1999 qui devait confirmer l'ordre mondial se heurte à l'opposition des mouvements et aux contradictions internes entre les différents pays.
Les Forums Sociaux Mondiaux se succèdent, après Seattle, et laissent la parole aux mouvements sociaux et citoyens. Le Forum de Belém en 2009 regroupe 4500 associations, plus de cent mille personnes. Par rapport à la crise financière ouverte en 2008, il avance des propositions immédiates : le contrôle de la finance, la suppression des paradis fiscaux et judiciaires, la taxe sur les transactions financières, l'urgence climatique, la redistribution… A Belém, un ensemble de mouvements, les femmes, les paysans, les écologistes et les peuples indigènes, surtout amazoniens, ont pris la parole pour affirmer : il s'agit d'une remise en cause des rapports entre l'espèce humaine et la Nature, il ne s'agit pas d'une simple crise du néolibéralisme, ni même du capitalisme ; il s'agit d'une crise de civilisation, celle qui dès 1492 a préparé une nouvelle géopolitique et certains fondements de la science contemporaine dans l'exploitation illimitée de la Nature et de la planète. C'est depuis les forums sociaux mondiaux que date la définition d'un projet alternatif, celui de la transition sociale, écologique et démocratique. Cette transition s'appuie sur de nouvelles notions et de nouveaux concepts : les biens communs, la propriété sociale, le buen vivir, la démocratisation radicale de la démocratie.
Le mouvement de solidarité international se recompose. Il organise des manifestations contre la guerre. En 1989, à Paris, deux grandes manifestations en réponse au G7 qui se réunit à Versailles : « dette, colonies, apartheid, ça suffat comme çi » et le Sommet des sept peuples parmi les plus pauvres. Se succéderont alors, en 1994, l'affirmation des zapatistes au Mexique ; en 1995, à Madrid, le sommet contre le FMI et la Banque Mondiale, 50 ans ça suffit ; la création d'ATTAC en 1998 ; en 2001 les manifestations de Gènes. Et, à partir de 2001 la succession des Forums Sociaux Mondiaux
La crise financière de 2008 est une nouvelle crise profonde du capitalisme. La crise financière démontre la fragilité du système. Le néolibéralisme est réaménagé en adoptant une stratégie austéritaire qui combine l'austérité et le sécuritaire. Les luttes sociales se durcissent en réponse à cet austéritarisme. L'extrême droite se renforce dans de nombreux pays et revendique, dans cette situation, le nationalisme, l'identité, la sécurité et la lutte contre les migrants. La situation s'aggrave avec la pandémie de Covid. Ce n'est pas la première fois dans l'Histoire que la pandémie et le climat s'invitent pour rappeler la fragilité de la situation.[10] Cette pandémie rend plus sensible la crise climatique et l'actualité des contradictions sociales, écologiques et démocratiques.
Nous sommes dans un changement de période qui se caractérise par le durcissement des contradictions. La montée des alliances entre les droites et les extrêmes droites sont générales ; elles instrumentalisent la question des migrations et la question des identités nationales. Les mouvements sociaux, féministes, antiracistes, écologistes, des peuples premiers, sont porteurs de nouvelles radicalités mais n'ont pas encore de projet commun. Le mouvement social, ouvrier et paysan, est fortement combattu. L'autoritarisme se présente comme une solution par rapport à la méfiance sur les formes contestées de démocratie[11]. Les Forums sociaux mondiaux continuent à exister mais ils doivent être renouvelés. De nouveaux mouvements explorent de nouvelles perspectives, comme les zapatistes, les femmes du Rojava, les jeunes iraniennes. Ces mouvements mettent en avant le féminisme, l'écologie, la démocratie locale. Ils explorent les voies d'avenir.
Le coup de tonnerre de 1989, avec l'autodissolution de l'empire soviétique semble accélérer l'hégémonie du capitalisme mondialisé. Plus rien ne paraît s'y opposer. On voit fleurir les odes au capitalisme éternel ; ce serait la fin de l'Histoire ! La crise financière de 2007-2008 va interrompre l'euphorie. Il n'est pas sûr que ce soit la crise centrale de la période, comme l'a été celle de 1929 ; une autre crise centrale viendra probablement ponctuer le processus. Deux éléments nouveaux sont venus compléter les crises sociales et démocratiques ; la pandémie et la crise du covid ont bouleversé la scène mondiale, la crise climatique rappelle l'actualité et l'urgence de la crise écologique.
À partir de 2007 - 2008, une nouvelle crise structurelle du capitalisme
En fonction de l'analyse des crises précédentes, et en faisant l'hypothèse que nous sommes dans une crise structurelle du capitalisme, nous analyserons l'évolution et la crise du mode de production capitaliste, les luttes sociales, les guerres, la décolonisation, les débats idéologiques et politiques, la droite et l'extrême droite.
La crise actuelle du mode de production capitaliste
De nombreux changements se traduisent par des fortes évolutions dans les rapports de production. Retenons-en deux : la progression exponentielle du numérique, les interrogations sur l'extractivisme.
Reprenons quelques données pour apprécier l'explosion du numérique. La croissance financière des entreprises du numérique est considérable, elle se compte en milliards de dollars[12]. C'est le cas des géants technologiques : Apple, Google, Amazon, Facebook. Apple a atteint 2000 milliards de dollars en 2020. Leurs revenus ont explosé, Amazon est passé de 19 milliards de dollars en 2008 à 469 milliards de dollars en 2021. Les investissements de Recherche-développement se sont multipliés, Google est passé de 2,8 milliards de dollars en 2008 à 31,6 milliards de dollars en 2021. Les innovations technologiques se sont imposées avec l'IA, l'intelligence artificielle, le blockchain, le cloud computing. Elles ont été facilitées par la progression des start-ups. Les utilisateurs d'internet sont passés de 1,5 milliards de personnes en 2008 à plus de 5 milliards en 2023 ; les smartphones sont passés de 200 millions de personnes en 2008 à plus de 3,8 milliards en 2021 ; la fréquentation des réseaux sociaux de 1 milliard en 2008 à 4,5 milliards en 2021 ; le commerce électronique de 1 milliard d'utilisateurs en 2008 à 4,5 milliards en 2021. La part du commerce électronique dans le commerce de détail est passé de 3,6% en 2008 à 19,6% en 2021. La numérisation des services transforme les secteurs traditionnels du commerce, des finances, de la santé, des médias. L'éducation en ligne a explosé. L'impact culturel est visible dans la communication, les messageries, les cultures numériques, la multiplication des influenceurs et des créateurs de contenus.
Les industries extractives et pétrolières doivent s'adapter à un environnement en mutation rapide marqué par la transition énergétique et la volatilité des marchés. La récession économique qui a suivi la crise financière de 2008 s'est traduite par une récession économique, la chute de la demande des minéraux et du pétrole et une baisse brutale des prix des matières premières. Le prix du pétrole a chuté à 30$ en 2009, contre 150$ en 2008 ; la surproduction a provoqué une nouvelle baisse en 2014 et la pandémie du COVID, en 2020, a provoqué une chute historique des prix. Avec le pétrole de schiste, les États-Unis sont devenus un des principaux producteurs de pétrole. Les crises géopolitiques au Moyen-Orient, en Russie et en Afrique ont eu des répercussions sur les prix et les approvisionnements en pétrole. La demande mondiale en énergie et en matières premières devrait être affectée par les interrogations sur une nécessaire transition énergétique mondiale cherchant à privilégier des sources d'énergie durables, la diversification économique des pays producteurs, les enjeux environnementaux pour la réduction des émissions carbone et les investissements dans les énergies renouvelables. Cette évolution, qui correspond à des enjeux majeurs, aura des conséquences considérables.
Le capitalisme des plateformes utilise les technologies numériques pour maîtriser les transactions en connectant les utilisateurs. Les plateformes redéfinissent les relations, les modèles d'affaires et les marchés. Elles modifient les formes de régulation et de concentration des pouvoirs. Elles concentrent le pouvoir économique. Elles exacerbent les inégalités et mettent en danger la sécurité de l'emploi. Elles stimulent l'innovation et aggravent la compétition, multipliant les emplois d'indépendants et de temporaires. Les premières plateformes datent des années 1990 à 2000 avec internet. Elles sont boostées par les smartphones et les applications mobiles. L'épidémie du covid a renforcé les plateformes numériques, et leurs compléments avec les services de livraison, le commerce électronique et le télétravail. Le capitalisme de plateformes crée un nouveau modèle économique ou les plateformes numériques servent d'intermédiaires pour faciliter les interactions entre les groupes d'utilisateurs à l'exemple de Amazon, Airbnb, Facebook.
La crise du COVID a aussi accéléré l'adoption du télétravail et transformé profondément le rapport au travail pour les travailleurs et pour les entreprises. Les entreprises modifient leur organisation du travail pour s'adapter aux nouvelles formes du travail en profitant du travail à domicile et de l'individualisation des travailleurs. Le télétravail renforce la flexibilité du travail et réduit les formes d'organisation collective des travailleurs. La productivité à l'échelle mondiale est affectée par le ralentissement du temps de travail, l'impact de la crise du Covid et le ralentissement démographique dans les pays développés. Après 2008, la baisse de la croissance de la productivité a affecté l'économie mondiale et a pesé sur la croissance économique, les inégalités, la compétitivité des entreprises et les niveaux de vie. Elle s'est traduite par une croissance des salaires ralentie et une productivité réduite qui a conduit à une stagnation et à une baisse du niveau de vie pour une partie de la population. Les tensions sociales ont accompagné la stagnation des revenus et les inégalités croissantes. L'instrumentalisation de la crise a permis de renforcer les politiques de réduction des salaires et des droits collectifs
La crise de la pandémie et du climat renforce cette tendance de reprise en main par des États autoritaires. Elle bouleverse les situations et les équilibres ; elle interroge la solidarité internationale, l'internationalisme et l'altermondialisme. A une crise par définition mondiale, les réponses sont surtout nationales et étatiques. Les institutions internationales sont peu écoutées et marginalisées. Les mouvements répondent par des actions de solidarité locale et par la résistance à leurs États. Les contradictions s'accentuent. Les affrontements opposent dans beaucoup de pays des alliances sécuritaires et de droite populiste, aux mouvements qui revendiquent les libertés démocratiques, la défense des droits sociaux, l'urgence écologique. L'austéritarisme s'est imposé. Le néolibéralisme ne cherche pas à convaincre ; il revendique la conjonction de l'austérité et de l'autoritarisme. Près de vingt ans après la chute du mur de Berlin, le néolibéralisme abandonne ses références aux libertés. Il ne cherche plus à convaincre, il ne cherche plus qu'à imposer. L'austéritarisme marque les limites du néolibéralisme en tant que système stable.
Il est probable que nous vivrons le passage à une nouvelle phase du mode de production capitaliste, comme entre 1914 et 1945, la rupture avec le passage au capitalisme fordiste et keynésien, formalisé à partir de 1929, avec le New Deal. L'hypothèse du passage à une nouvelle phase du mode de production capitaliste est très probable ; elle est amorcée avec les nouvelles formes de production, notamment le numérique. Elle est aussi interpellée par les changements dans les classes principales. Nous en avons quelques éléments. Dans la classe dominante, par la contradiction entre la financiarisation de la bourgeoisie et la culture des nouveaux dirigeants, cadres et managers du numérique. Dans la classe ouvrière, par les contradictions dans l'évolution des formes du salariat et avec le précariat.
L'hypothèse n'est peut-être pas seulement celle d'un changement de phase du capitalisme. Immanuel Wallerstein avance l'hypothèse qu'il s'agit d'une crise structurelle qui met en cause les fondements du mode de production capitaliste[13]. Il considère que le mode de production capitaliste est épuisé et que dans les trente prochaines années, il ne devrait plus être dominant. Mais, cette crise du capitalisme ne déboucherait pas sur le socialisme. Un autre mode de production, inégalitaire mais différent, lui succéderait. Il estimait qu'un nouveau mode de production allait succéder au capitalisme dans les trente ou quarante prochaines années. Mais, il soulignait que, si la fin du capitalisme est historiquement certaine, cela n'entraînait pas automatiquement l'avènement d'un monde idéal. Il pensait qu'un nouveau mode de production « post-capitaliste » pourrait être inégalitaire. Il voyait la possibilité de plusieurs bifurcations : « celle débouchant sur un système non capitaliste conservant du capitalisme ses pires caractéristiques (hiérarchie, exploitation et polarisation), et celle posant les bases d'un système fondé sur une démocratisation relative et un égalitarisme relatif, c'est-à-dire un système d'un type qui n'a jamais encore existé.
Dans cette hypothèse, le capitalisme ne disparaîtrait pas, mais il ne serait plus le mode de production dominant dans les formations sociales, un peu comme l'aristocratie n'a pas disparu en laissant la première place à la bourgeoisie. De nouvelles classes sociales principales seraient en gestation dans nos sociétés. Le nouveau prolétariat viendrait du précariat et associerait les précaires et certaines formes de salariat. Les nouvelles classes dirigeantes pourraient être issues des techniciens et des cadres comme on peut le voir à travers les mutations sociales entrainées par le numérique. Les bourgeoisies, parasitaires et rentières, ne seraient plus dominantes et pourraient laisser la place à de nouvelles classes dirigeantes. Le néolibéralisme pourrait être toujours présent, mais ne serait plus dominant. Il a déjà perdu une large part de sa légitimité et il a besoin de durcir ses moyens de répression pour maintenir son pouvoir.
Quelle que soit l'hypothèse, celle du passage à une nouvelle phase du mode de production capitaliste ou celle du passage à un nouveau mode de production, les changements seront considérables et se traduiront par des années de transition marquées par des bouleversements sociaux et idéologiques. Les conséquences seront considérables au niveau de l'écologie et du changement climatique, au niveau social pour les inégalités et les discriminations, au niveau des guerres et de la nature des régimes politiques, au niveau de la définition même des démocraties.
Les luttes sociales, les guerres et la deuxième phase de la décolonisation
Les luttes sociales
Les luttes sociales, sous des formes diverses, sont toujours présentes et déterminantes. Elles sont très présentes au niveau local et elles sont plus visibles au niveau national quand elles interpellent l'État. Elles sont moins visibles au niveau international du fait des remises en cause du champ géopolitique. Elles concernent surtout les inégalités sociales de plus en plus grandes et partout présentes. Les luttes pour la démocratie sont aussi très présentes mais sont plus spécifiques en fonction des situations locales ; elles convergent très rarement au niveau des grandes régions ou au niveau mondial. Les luttes sur les questions écologiques sont très pertinentes mais se heurtent à une contre-offensive très déterminée pour éviter la jonction avec la critique radicale du néolibéralisme qui exacerbe les inégalités.
Les inégalités sociales sont considérables[14]. En France, avec un taux de pauvreté de 15%, le Smic, salaire minimum, est de 17000 euros par an et la rémunération moyenne d'un PDG du CAC 40 est de 5,5 millions d'euros par an, soit 331 fois le smic. Cette situation est accentuée par la réduction des impôts sur les revenus du capital. Au niveau mondial, les 1% les plus riches possèdent 45% de la richesse mondiale en termes de patrimoine net. Oxfam a calculé que les 1% les plus riches possèdent, en patrimoine net, plus de deux fois la richesse de 6,9 milliards de personnes les moins dotées (sur 7,8 milliards de la population mondiale). Il y a une claire conscience de l'ampleur des profits des grandes entreprises et des grands actionnaires et de l'injustice du système ; mais cette prise de conscience ne se traduit pourtant pas par une remise en cause globale du capitalisme.
Les grandes luttes sociales ont été très fortes depuis 2008. Rappelons, en France
Les luttes contre la réforme des retraites en 2010, 2019 et 2023 ; celles contre la loi travail en 2016 ; l'émergence des Gilets jaunes en 2018 ; les luttes pour le climat depuis 2018 ; contre les violences policières et le racisme en 2020. Dans le monde, après 2008, il y a eu des mouvements d'ampleur dans plus de 59 pays. Parmi eux, rappelons les Printemps arabes en 2010 et 2011 ; les Indignés en Espagne en 2011, Occupy Wall Street en 2011 ; Black lives matter, contre la violence policière et le racisme, depuis 2013 ; les mobilisations à Hong Kong, pour les libertés démocratiques en 2019 ; les grèves mondiales pour le climat, depuis 2018 ; les mouvements au Chili, en Colombie, en Bolivie, en 2019 – 2020…
Les luttes sociales dépendent de l'évolution des rapports entre les classes sociales. La classe ouvrière demeure centrale mais elle a évolué et cette évolution s'accélère. La généralisation du salariat rend moins visible les rapports sociaux capitalistes. Ce qui est accentué par la numérisation et, depuis la pandémie du COVID, par la progression du télétravail. Il faut aussi noter l'importance des classes moyennes, malgré l'affaiblissement de leur situation, et le rapprochement des conditions de vie liées à l'urbanisation. Le précariat, les travailleurs précaires, les secteurs informels, l'ubérisation, le micro-entrepreneuriat représentent de nouvelles formes d'organisation du travail ; il s'est développé dans le Sud et aussi en Europe. La scolarisation modifie aussi les rapports entre les classes[15]. Le taux de scolarisation était, en 2020, de 95% en France et de 76% dans le monde. Il y avait 2,7 millions d'étudiants dans le supérieur en 2021. Dans le monde, le taux de scolarisation dans le secondaire était, en 2020, de 70% en Chine et Corée du Sud, de 50% en Amérique Latine, au Moyen Orient et en Afrique du Nord, de 9 à 10% en Afrique. Pour se rendre compte de l'évolution et des conséquences pour une société, il y avait trois bacheliers en République démocratique du Congo, au moment de l'indépendance, en 1960, dont 2 à Bruxelles ; il y en avait 235000 en 2008 et plus de 700000 en 2023. Ce n'est plus la même société !
Les luttes sociales ont toujours été très fortes et n'ont jamais cessé. Les crises structurelles sont toujours des moments de réaménagements géopolitiques majeurs. Elles s'accompagnent des guerres et des aménagements du système international.
La géopolitique, les guerres et le système international
Les crises structurelles sont toujours des moments de réaménagements géopolitiques majeurs. Et ces réaménagements géopolitiques passent par les guerres, par des affrontements, par les nouvelles frontières et les aménagements du système international qui concrétisent les règlements des conflits.
Après 1945, il y a de nombreuses guerres pour la décolonisation qui se prolongent dans des guerres de recomposition régionale au Moyen-Orient, en Asie et par des guerres d'intervention des États-Unis et de l'Union Soviétique. Parmi les principales guerres et les confrontations, citons : la guerre d'Indochine, de 1946 à 1954 et du Vietnam de 1955 à 1975 ; la crise de Suez en 1956 ; la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962 ; les guerres entre Israël et les pays arabes en 1967 et 1973 ; la guerre civile du Liban en 1975 jusqu'en 1990 ; la guerre du Cambodge en 1970 ; l'invasion soviétique en Afghanistan en 1979 ; les Malouines en 1982 ; la guerre du Golfe en 1990 ; le génocide rwandais en 1994 ; la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988 ; la guerre de Yougoslavie de 1991 à 2001 ; la guerre d'Afghanistan de 2001 à 2021 ; les guerres en Irak de 2003 à 2011, la guerre de Lybie en 2011 et depuis 2014 ; les guerres en République démocratique du Congo depuis 1994 …
Après 2008, il y a de nombreuses guerres qui prolongent les guerres de la période récente ou qui annoncent le passage à une nouvelle période. On compte ainsi, la guerre entre la Géorgie et la Russie en 2008 ; la guerre civile syrienne depuis 2011 ; l'intervention militaire au Yémen depuis 2015 ; la guerre contre l'État islamique en 2014 ; la guerre en Ukraine depuis 2014 ; la guerre civile en Lybie depuis 2014 ; le conflit au Mali depuis 2012 ; le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en 2020 ; la guerre civile au Soudan du Sud de 2013 à 2018 ; le conflit en République Centre Africaine depuis 2012 ; la guerre au Tigré depuis 2020.
Les régions en guerre se multiplient. Mais deux guerres occupent une place centrale dans la période et sont porteuses de graves conséquences à l'échelle mondiale ; la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la guerre entre Israël et la Palestine. Le conflit au Donbass, depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, a pris une nouvelle dimension avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Dans un premier temps, l'Ukraine a réagi de manière assez efficace et a contenu l'invasion russe. Le front s'est stabilisé dans le Donbass ; l'armée russe impose une très forte pression malgré l'armement considérable, mais insuffisant, apporté par les États-Unis et l'Europe à l'Ukraine. Cette guerre interpelle l'ordre international sur plusieurs aspects : d'abord, la nécessaire réaffirmation de l'interdiction des invasions armées comme forme d'intervention dans un conflit politique. Ensuite la question du nucléaire, du point de vue de la sécurité des installations et aussi des possibilités de dérive et d'utilisation des armes nucléaires. La troisième question est celle du rôle de l'OTAN dans la recomposition géostratégique et dans la redéfinition des alliances et du système international.
La guerre israélo-palestinienne est le conflit majeur de la période. Il résume et exacerbe, d'une certaine façon, l'affrontement entre le Sud et l'Occident ; en mettant aussi en évidence la différence de positionnement entre les gouvernements des pays du Sud et les opinions publiques de ces pays. Il est marqué par la place dirigeante de l'extrême droite israélienne dans la gestion du conflit et sa capacité à imposer son point de vue aux États-Unis et à l'Europe. L'intervention du Hamas, marquée par certaines actions terroristes, a modifié le paysage. Une des questions clés va être celle de la définition d'une stratégie commune par l'ensemble des organisations palestiniennes. La reconnaissance d'un État palestinien pose une question immédiate, celle de la remise en cause de la présence des colons en Cisjordanie qui risque de conduire, comme le soulignent plusieurs Israéliens, à une guerre civile en Israël. Dans un temps futur, des solutions peuvent émerger dans la construction d'une grande région impliquant de nouvelles relations entre le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Palestine et un Israël qui ne serait plus colonial.
La géopolitique est aujourd'hui organisée autour des États-nations. L'évolution récente a renforcé cette organisation. La montée des extrêmes droites dans le monde renforce cette imposition d'un monde organisé par les seuls États-nations. Il y a toutefois une tendance à l'émergence d'un autre aménagement géopolitique avec l'organisation de grandes régions qui ne remplaceraient pas les États mais qui les intégreraient dans des ensembles plus larges. Il y a une quinzaine de grandes régions qui pourraient émerger avec la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est y compris le Japon et la Corée, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale avec le Mexique, l'Amérique du Sud avec le Brésil et l'Argentine, les Caraïbes, l'Afrique du Nord, le Moyen Orient, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'Afrique de l'Est, l'Europe, la Russie, l'Océanie.
Le système international est organisé aujourd'hui autour des Nations unies. Il comprend l'ONU et les institutions internationales qui lui sont rattachées et qui jouent un rôle considérable dans le fonctionnement du système international. L'ONU devra être réorganisée[16] ; une sortie de crise structurelle géopolitique rend nécessaire cette réorganisation. L'ouverture d'un débat sur la reconfiguration d'un système international peut faciliter la mise en avant de propositions pour un système démocratique mondial plus avancé.
La deuxième phase de la décolonisation
Avec l'évolution démographique, la décroissance démographique sur plusieurs continents et la croissance démographique en Afrique, on va vers un nouvel équilibre démographique mondial en 2050. La période peut être aussi caractérisée comme celle à la fois d'un renforcement et d'une crise des impérialismes. Elle est celle de la décolonisation qui a commencé dans les années 1920 et qui s'est traduite par les indépendances nationales, à partir de 1944. Nous avons déjà rappelé la conférence de Bandung, en 1955, et la formule sur l'indépendance des États, la libération des nations et la révolution pour les peuples. Aujourd'hui, l'évolution des nouveaux États indépendants et la domination de la scène mondiale par les États occidentaux rappelle que la décolonisation est inachevée. Les réorganisations géopolitiques sont à l'œuvre dans le monde. Elles accompagnent une revendication des peuples à une désoccidentalisation du monde.
À l'identification des peuples à l'État-nation, la période qui vient approfondira et enrichira les rapports entre les peuples, les États et les nations. On voit bien les difficultés quand on pense aux Nations Unies. La Charte, des nations, commence par « Nous les peuples », et en réalité, il s'agit d'une union d'États. Au niveau de la Ligue internationale pour les droits des peuples, nous donnons la priorité aux peuples et nous mettons en avant la définition, donnée par le juriste Charles Chaumont, « un peuple se définit par l'histoire de ses luttes ». Le rapport entre peuple et territoire ne peut pas être réduit au rapport entre nation et territoire. Elle confirme aussi que la langue et la culture caractérisent le peuple. Et que l'internationalisme relève des peuples et non des nations.
Nous entrons dans la deuxième phase de la décolonisation. La première phase est celle de l'indépendance des États colonisés. Elle a été largement entamée avec l'indépendance des colonies et la création des nouveaux États. Mais, il reste encore un certain nombre de situations coloniales, comme vient le rappeler, notamment, la Kanaky. La question de la Palestine est déterminante pour clore cette première étape des indépendances. La deuxième phase de la décolonisation concerne la possibilité pour chaque pays de définir et de maîtriser son développement et pour chaque peuple de construire des institutions lui assurant les libertés et des formes démocratiques. Elle concerne aussi la possibilité pour chaque pays de participer à l'organisation et la gestion de leur grande région et des institutions internationales.
Cette perspective est confirmée par les bouleversements géopolitiques qui sont en cours. Ils concernent directement les guerres qui accompagnent les bouleversements de l'ordre mondial et notamment la nature des régimes politiques et la démocratie. Les États-Unis sont toujours dominants économiquement et militairement, mais leur hégémonie est de plus en plus contestée. La confrontation principale se déplace vers l'Asie et oppose les États-Unis et la Chine. L'Europe est marginalisée et la guerre accroît ses divisions. Les États-Unis explorent une alliance avec l'Australie et le Japon qui inclurait la Grande-Bretagne. La Chine renforce les BRICS avec le Brésil, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud et entame son élargissement avec, notamment, les pays du Golfe, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Iran. De nouvelles puissances renforcent leurs positions régionales. L'Inde en Asie du Sud, la Thaïlande et l'Indonésie en Asie du Sud-Est, l'Australie dans le Pacifique, la Turquie et l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya en Afrique, le Brésil, le Mexique et le Canada en Amérique. Dans cette première phase des indépendances, nous pouvons distinguer trois sous-périodes : de 1944 à 1965, les luttes de libération nationale ; de 1966 à 1973, les « mai 1968 » dans le monde ; de 1973 à 1977, l'offensive pétrolière de pays du Sud.
La souveraineté est une valeur de référence de plus en plus prisée. Elle renforce les identitarismes et le poids des intégrismes dans les religions. Elle se traduit par la montée des autoritarismes[17] de différentes natures. Les libertés et la démocratie restent des valeurs de référence, mais en tant que valeurs abstraites. La méfiance par rapport aux régimes politiques est devenue générale. Elle se traduit par une grande défiance par rapport aux institutions internationales.
La situation est caractérisée par la montée en puissance de nouveaux blocs émergents. Ce sont des situations qui se traduisent historiquement par des périodes de tensions, de conflits et aussi de guerres. D'autant que cette évolution est très rapide à l'échelle historique, en quelques dizaines d'années et non en quelques siècles[18], comme dans les transitions précédentes. Le Sud global se présente à la fois comme un bloc émergent et comme une diversité des États-nations du Sud et de leurs intérêts nationaux. Depuis 2013, la Chine, l'Inde et le Brésil sont collectivement en train de dépasser les pays occidentaux en termes de commerce et de production mondiale.[19] L'affirmation politique d'un Sud global et la volonté du multilatéralisme coexistent avec le renforcement des grandes régions géoculturelles dans l'ordre mondial. Il y a un besoin urgent de réformes pour faire face à un monde en évolution rapide, pour arriver à une architecture globale. Il faut répondre aux défis principaux : le maintien de la paix ; la réduction des inégalités et des discriminations ; le défi écologique ; la redéfinition de la démocratie. L'ONU, si elle est réformée, pourrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de ces réformes nécessaires.
Les débats idéologiques et politiques et la montée de l'extrême droite
L'idéologie renvoie à un système d'idées, elle propose un idéalisme opposé au réalisme politique. Marx introduit le terme quand il rédige, avec Engels, « L'idéologie allemande », en1846 (la publication attendra 1932). Il critique une vision de classe à dépasser par la science ; de là découle une vision négative des idéologies. Cette vision est renforcée par la liaison entre les idéologies et les utopies. Cette conception part de la Révolution française qui va marquer le débat d'idées depuis le XIXème siècle ; elle intègre la science newtonienne de la Nature du XVIIème et l'idée d'un progrès historique du XVIIIème siècle.
Immanuel Wallerstein propose de définir le débat idéologique à partir de trois idéologies politiques, toujours présentes, qui suivent la Révolution française : le conservatisme, le libéralisme et le socialisme[20]. Aucune n'a trouvé de configuration définitive ; elles s'opposent et s'influencent et se recomposent avec la prééminence actuelle du libéralisme. Le conservatisme est une réaction au rejet de l'ancien par la modernité qui met en avant, depuis la révolution industrielle, le culte du changement et du progrès qu'il cherche à refuser ou à limiter. Pour cela, il s'agit de garder ou de reconquérir le pouvoir dans l'État. C'est l'objectif depuis la Restauration qui remet en cause la Révolution. Le libéralisme est certain de la vérité de la modernité ; il est universaliste et propose de moderniser les institutions, de supprimer l'irrationnel du passé et les idéologies conservatrices. Son programme politique est d'imposer le progrès. Le socialisme se veut l'héritier de la Révolution ; il se différencie des conservateurs par sa volonté d'accélérer le processus historique pour faire avancer le progrès. Il se différencie des libéraux en prônant la révolution plus que la réforme pour affronter la résistance au progrès.
L'idéologie libérale propose un sujet, un acteur politique principal ; elle soulève la question de la souveraineté. La souveraineté du peuple succède à la souveraineté du monarque. Qui est le peuple ? Pour les libéraux, le peuple est l'ensemble des individus qui sont dépositaires de tous les droits politiques, économiques et culturels. L'individu est le sujet historique de la modernité, tous les individus sont égaux. Comment prendre des décisions collectives et réconcilier les positions ? C'est la question de la démocratie politique. Le néolibéralisme introduit une rupture avec le libéralisme en se détournant des préoccupations de souveraineté et de démocratie.
La question de l'individu et de la souveraineté est moins explicite chez les conservateurs et les socialistes. Pour les conservateurs, les individus passent, le bien public, le « commonwealth », restent identiques. Le sujet politique se retrouve dans la famille, les corporations, les Églises, les ordres. Pour les socialistes, le sujet principal, c'est le peuple ; la question reste : comment reconnaître la volonté générale du peuple ? Quel sujet incarne la souveraineté du peuple ? Pour les libéraux, ce sont les individus dit libres, pour les conservateurs, ce sont les groupes traditionnels, pour les socialistes, c'est le groupe entier formant société.
Le sujet, le peuple, a une représentation privilégiée, c'est l'État. C'est par l'État que le peuple exerce sa souveraineté, qu'il est souverain. Le peuple forme une société ; quel est le rapport entre État et société ? C'est la question de la modernité. En fait, Les trois idéologies prennent le parti de la Société contre l'État mais de manière différente. Pour les libéraux, il s'agit de dissocier État et vie économique. Et, pour la plupart des libéraux, de réduire l'État au minimum ; l'État est le veilleur de nuit. Pour les conservateurs, le sujet, le peuple, a un soutien privilégié, l'État. Il s'agit de concilier individualisme et étatisme en soutenant et appuyant les groupes intermédiaires traditionnels : famille, Eglise, corporations. Pour les socialistes, la bourgeoisie s'est emparée de la souveraineté politique en s'assurant le contrôle exclusif de l'État. La position par rapport à l'évolution de l'État en grand État bureaucratique et moderne se différencie. Pour les conservateurs, l'État doit protéger les droits traditionnels ; pour les libéraux, l'État doit permettre aux droits traditionnels de s'épanouir ; pour les socialistes l'État doit réaliser la volonté générale.
Les rapports entre les trois idéologies ont évolué. De la Révolution française à 1848, les libéraux s'opposent aux conservateurs. Ils considèrent que le Progrès est inévitable et souhaitable alors que pour les conservateurs, le progrès est néfaste. Les socialistes sont, au début, alliés des libéraux. L'alliance entre socialistes et libéraux soutient la pensée libérale et égalitariste du XVIIIe contre la monarchie absolue. Les deux courants défendent la productivité, base de la politique sociale de l'État moderne. Ils défendent aussi l'utilitarisme. À partir de 1830, et plus nettement après 1848, il y a une séparation entre libéraux et socialistes. Le marxisme ne se limite pas à la pauvreté, il condamne la déshumanisation par le capitalisme. Il y a un rapprochement entre conservateurs et libéraux, il s'agit de protéger la propriété et de combattre la révolution. Un libéralisme modéré divise, chez les socialistes les modérés, qu'on appellera sociaux-démocrates, qui défendent une action politique et des réformes et les radicaux qui appellent à l'insurrection. De 1848 à 1914, ou 1917, le libéralisme domine et l'idéologie socialiste se réfère au marxisme. Le libéralisme s'impose, avec une variante libérale socialiste qui affiche sa foi dans le progrès et la productivité et une variante libérale conservatrice. On peut considérer que les totalitarismes du XXème siècle ont tenté une approche entre conservateurs et socialistes en alliant socialisation et populisme. À partir de 1917 jusqu'à 1968, ou 1989, c'est la domination du libéralisme à l'échelle mondiale, avec un moment de débat particulier avec le léninisme et avec les tentatives récurrentes de plusieurs appels à dépasser les idéologies.
Peut-on dépasser l'idéologie libérale dominante ? C'est la question posée depuis les années 1968. A partir de 1989, la version socialiste est impactée par la chute du marxisme soviétique. Les conservateurs se soumettent à la direction néolibérale. La liaison entre libéralisme et modernité est remise en cause pour la première fois ; elle s'effondr

Une gauche qui ne prend pas la tête de la lutte contre la catastrophe climatique n’a pas de raison d’exister !

Ce qui suit ne s'adresse pas à la droite et à ses soutiens (économiques, sociaux et autres) qui – malheureusement – font très bien leur travail. Ce qui suit s'adresse avant tout à la gauche qui – malheureusement – ne fait pas du tout bien le sien…
6 septembre 2024 | tiré du site entre les ligens entre les mots | Dessin de Sonia Mitralia
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/09/une-gauche-qui-ne-prend-pas-la-tete-de-la-lutte-contre-la-catastrophe-climatique-na-pas-de-raison-dexister/
Voici donc ce que nous écrivions l'an dernier à la même époque, juste après les terribles inondations de Thessalie, dans un texte resté inachevé et jamais publié :
« Le choc des deux « ouragans méditerranéens » successifs Daniel et Elias a été assez fort pour provoquer les premières fortes secousses dans les croyances climato-sceptiques des Grecs. Bien sûr, ce ne sont que les premières fissures qui ne s'élargiront que s'il y a le suivi que les circonstances exigent de la seule force politique qui peut, potentiellement, non seulement expliquer scientifiquement la catastrophe climatique mais aussi agir massivement et concrètement pour y faire face ».
Bien sûr, cette « seule force politique qui peut, potentiellement, non seulement expliquer scientifiquement la catastrophe climatique mais aussi agir massivement et concrètement pour y faire face » doit être la gauche. Pourtant, un an plus tard, alors que le spectre de la pénurie d'eau plane plus que jamais sur Athènes et ses quatre millions d'habitants, alors que de nouvelles sécheresses extrêmes, de nouveaux méga-incendies dévastateurs, de nouveaux records historiques successifs de température et de nouvelles canicules encore pires sont intervenus, cette gauche est toujours invisible, toujours absente du front de la catastrophe climatique galopante. Et le pire, c'est qu'elle continue en grand partie à dénoncer la droite néolibérale au gouvernement non pas pour son refus d'agir à temps contre ce désastre climatique, mais pour son insistance à l'invoquer pour couvrir ses péchés !
Voici donc comment que nous avons poursuivi notre texte de l'année dernière, en essayant – en vain – de convaincre qu'il est urgent de mobiliser ceux « d'en bas » car notre pays est littéralement dans l'œil du cyclone de la catastrophe climatique :
« Parlons donc de la catastrophe climatique et de notre pays, puisque l'intensité et le volume des précipitations des deux « ouragans méditerranéens » (medicanes) qui l'ont frappé consécutivement en l'espace de trois semaines (!), confirment les conclusions scientifiques, que la Méditerranée et en particulier son bassin oriental et … la Grèce constituent un hot point, c'est-à-dire un point de grande intensité et de dangerosité de crise climatique. Plus précisément, les 889 mm de pluie – au moins – reçus par Zagora et les 886 mm reçus par Portaria sur le Mont Pélion le 5 septembre, non seulement dépassent de loin tout précédent dans notre pays, mais sont 3 et 4 fois plus importants que ceux qui sont tombés en Libye le jour des inondations meurtrières quelques semaines plus tard. De même, les 1235 mm de précipitations reçus par Makrinitsa en septembre dernier constituent un record européen de précipitations mensuelles, alors que l'intensité terrifiante de l'averse du « medicane » Elias qui a ensuite frappé le nord de l'Eubée était ensemble avec les incendies gigantesques de plus en plus fréquents, les canicules et la désertification galopante, une autre indication que notre pays constitue bien un hot point de la catastrophe climatique planétaire « pour les décennies à venir ». »
Et nous concluions avec ces mots :
« Qu'est-ce que cela signifie ? Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et plusieurs autres organisations scientifiques, cela signifie que « l'augmentation de température observée en Méditerranée est supérieure à la moyenne mondiale ». En d'autres termes, « la planète se réchauffe et la Méditerranée le fait un peu plus vite » ! Les conséquences ne sont pas seulement prévisibles, elles sont déjà établies de manière empirique : parmi beaucoup d'autres choses, comme l'élévation du niveau de la mer, nous avons des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et de plus en plus intenses, des incendies de forêt de plus en plus fréquents et de plus en plus monstrueusement destructeurs, des précipitations et des inondations sans précédent, mais aussi une réduction drastique des précipitations, avec pour conséquence des pénuries d'eau croissantes, des sécheresses, la désertification galopante de zones de plus en plus étendues, une réduction de la productivité agricole, etc. En d'autres termes, nous sommes confrontés à la menace la plus grave pour la qualité de vie et l'existence même que les habitants de ce que nous appelons aujourd'hui le territoire grec aient jamais eu à affronter. Et comme il est évident, tous les autres problèmes de la population grecque mais aussi mondiale sont directement affectés et subordonnés à ce qui est leur plus grand problème existentiel… »
Et la gauche grecque ? Où sont ses manifestations, ses grèves et ses occupations contre les politiques climatiques des gouvernements grecs, de l'Union européenne et des capitalistes Où sont ses réflexions et sa production d'idées, d'analyses et de propositions programmatiques et de mesures à prendre urgemment ? Où est sa participation aux grandes mobilisations internationales de la jeunesse et autres luttes contre la catastrophe climatique et ceux qui la causent, qui passent en permanence inaperçues dans notre pays ? Où est sa lutte contre les théories obscurantistes et conspirationnistes sur la crise climatique qui font un tabac dans la population grecque ? Où est sa conception du changement radical de nos sociétés et de nos vies que nécessite la lutte effective contre la catastrophe climatique (voir Pour une décroissance écosocialiste). Et surtout, où est sa mobilisation contre la racine du mal, les multinationales du pétrole et du gaz, les constructeurs automobiles et tous ceux qui sont impliqués dans les énergies fossiles, qui sont responsables de l'écrasante majorité des émissions de gaz à effet de serre ?
Au lieu de tout cela, la gauche grecque préfère accuser Mitsotakis et son gouvernement « de simples délits comparés au véritable crime qu'il commet lorsque non seulement il ne fait rien contre la crise climatique, mais qu'il ne cesse de l'aggraver par ses politiques ». Et de temps en temps, elle préfère s'adonner à des combats chimériques contre les impérialistes qui convoitent « nos » (d'ailleurs inexistants)… gisements de pétrole, qui deviendraient comme par miracle… des combustibles fossiles propres parce que… « grecs ». Ou de se moquer et de calomnier la jeune Greta Thunberg qui inspire le mouvement international de jeunesse le plus massif et le plus radical contre la crise climatique. Ou, pire encore, d'accueillir dans ses rangs des « gens de gauche » qui continuent sans relâche à qualifier le changement climatique de … « plus grande fraude impérialiste » !
La conclusion est tragique : lorsque le très grand capital international, et par conséquent le système capitaliste, responsables de la catastrophe climatique, ont de tels ennemis de gauche, ils n'ont pas besoin d'amis ! Ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles quand ces gens de gauche – en Grèce et dans le monde – dénoncent tout et n'importe quoi sauf les vrais criminels, et avec eux leurs patrons, leurs filiales locales, leurs porte-voix, leurs représentants politiques, c'est-à-dire leur système capitaliste. Comme par exemple « Les vingt plus grandes entreprises qui ont contribué ensemble à l'émission de 480 milliards de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone et de méthane, provenant principalement de la combustion de leurs produits, ce qui équivaut à 35% de toutes les émissions de combustibles fossiles et de ciment dans le monde depuis 1965 » (voir le tableau ci-dessous) :
2024-09-06_02_pinakas-01
Conclusion : la grande tragédie de la crise climatique, c'est que huit milliards d'êtres humains sont contraints de payer cher – au prix de leur santé, de leur vie, de la santé et de la vie de leurs descendants, de la destruction de la nature et d'une planète de plus en plus dégradée – la cupidité de quelques dizaines de multinationales polluantes qui continuent à faire des profits monstrueux.
Pire encore, au moins une partie de notre gauche répète et diffuse, souvent mot pour mot (!), la propagande « climatonégationiste » produite par la véritable fabrique de propagande de ces multinationales polluantes géantes. Et, signe de l'importance que ces multinationales attachent à saper et à dénigrer les thèses scientifiques sur la crise climatique, seulement cinq d'entre elles ont dépensé au cours de la dernière décennie au moins 200 millions de dollars par an pour promouvoir leur propagande et leur désinformation en faveur des combustibles fossiles (voir le tableau correspondant pour l'année 2018).
2024-09-06_03_pinakas-spend-on-climate-lobbying-2018
Un cas typique de ce genre de propagande est l'article intitulé « Crise climatique : croyance religieuse ou vérité scientifique ? « de ancien ministre islamophobe Andreas Andrianopoulos, qui a quitté le parti de la Nouvelle Démocratie parce qu'il ne la trouvait pas assez… néolibérale. Le fait que M. Andrianopoulos ait été « conseiller » de M. Poutine et du président (à vie) de l'Azerbaïdjan, M. Aliyev, n'a évidemment rien à voir avec le contenu délirant de ses articles « climatonégationistes ». Rien à voir non plus avec les déclarations et les articles d'autres « conseillers » célèbres de M. Poutine, comme l'ancien chancelier allemand Schröder ou l'ancien Premier ministre français Fillon… mais aussi des gens de gauche moins célèbres – grecs et étrangers – connus pour leur soutien au locataire du Kremlin.
Bien entendu, ici on n'a pas affaire à des simples « coïncidences ». M. Poutine et ses amis de par le monde Trump, Orban, Bolsonaro, Milei, etc. sont tous des « climato-sceptiques » fanatiques, comme le sont d'ailleurs leurs partisans d'extrême droite et néofascistes de par le monde. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard si tous ces braves gens, aidés par le grand capital international, qui a tout intérêt à perpétuer l'économie dépendante des énergies fossiles, financent généreusement les armées de climato-négationnistes de tout genre, qui n'ont qu'un seul objectif : empêcher l'adoption et surtout la mise en œuvre de mesures pour faire face à la catastrophe climatique….
Par conséquent, puisque la crise climatique, qui – malheureusement – s'intensifiera et atteindra bientôt des points de bascule, prend désormais des dimensions existentielles pour l'humanité, et puisqu'il n'y a personne d'autre que nous pour la combattre, le conflit avec ceux et leurs intérêts qui l'ont créée et l'alimentent, en refusant obstinément de l'empêcher, ne peut être qu'un conflit de vie et de mort. Plus que jamais, c'est donc maintenant que la gauche peut justifier son existence en faisant de la lutte contre la catastrophe climatique sa priorité absolue et sa première tâche militante…
Yorgos Mitralias
Ecosocialismo e sinistra
https://andream94.wordpress.com/2024/09/09/ecosocialismo-e-sinistra/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le peuple algérien réitère son rejet du régime militaire

Malgré la confusion qui a accompagné l'annonce des résultats des récentes élections présidentielles en Algérie, une chose est claire et certaine : le peuple algérien rejette massivement le régime militaire...
11 septembre 2024
Gilbert Achcar
Professeur, SOAS, Université de Londres
Abonné·e de Mediapart
Malgré la confusion qui a accompagné l'annonce des résultats des récentes élections présidentielles en Algérie, une chose est claire et certaine : le peuple algérien rejette massivement le régime militaire, après avoir consacré son Hirak il y a cinq ans à exiger la fin de ce régime et son remplacement par un pouvoir civil démocratique. En effet, la confusion elle-même est une conséquence directe de ce fait, qui a émergé à travers le véritable enjeu de ces élections, personne n'ayant le moindre doute quant à la victoire du candidat de l'institution militaire, Abdelmadjid Tebboune. Ce qui était vraiment en jeu, c'était l'ampleur de la participation du peuple algérien à ces élections, par rapport aux précédentes organisées fin 2019, que l'institution militaire avait imposées face au rejet et au boycott du Hirak. Le résultat ne fut pas alors celui escompté par les militaires, puisque le taux de participation fut inférieur à 40% (39,51% pour être exact, avec 9 755 340 personnes ayant voté, selon les chiffres officiels, sur 24 474 161 inscrites). Ce faible taux de participation s'est produit alors que les autorités avaient permis une plus grande diversité des candidats, avec cinq candidats en lice en 2019.
Quant aux élections de samedi dernier, le taux de participation y a été inférieur à celui de 2019, qui était lui-même inférieur aux chiffres officiels des élections précédentes. Selon le décompte officiel, le nombre total de votes exprimés samedi dernier pour les trois candidats en lice n'a été que de 5 630 196, une baisse importante par rapport au total des votes exprimés il y a cinq ans, tandis que le nombre des inscrits était presque inchangé (24 351 551), de sorte que le taux de participation est tombé à 23,12% seulement ! La tentative du chef de l'Autorité nationale « indépendante » des élections, Mohamed Charfi, de camoufler la défaite du gouvernement en affirmant que le taux de participation « moyen » était de 48 %, chiffre obtenu en divisant le taux de participation par le nombre de circonscriptions électorales (comme dire que le taux de participation moyen entre 10 % dans une ville de 100 000 électeurs et 90 % dans une ville de moins de 1000 électeurs est de 50 %) a échoué au point que la propre campagne de Tebboune a dû protester contre la confusion ainsi causée.
Face à cette défaite politique désastreuse, les 94,65% des voix obtenues par Abdelmadjid Tebboune, selon les chiffres officiels, semblent bien maigres, sans parler du fait que les deux autres candidats n'ont pas tardé à accuser les autorités d'avoir falsifié les résultats. Selon le décompte officiel, Tebboune a reçu 5 329 253 voix, contre 4 947 523 en 2019, soit une légère augmentation. Mais contrairement à certains commentaires qui ont vu dans le pourcentage obtenu par Tebboune une imitation de la tradition bien connue des dictatures régionales, qui exige d'accorder au président plus de 90% des voix, le pourcentage de 94,65% aux dernières élections algériennes n'a pas été combiné avec un taux de participation élevé comme c'est généralement le cas dans les dictatures, que ce soit en falsifiant les chiffres ou en imposant la participation à la population, ou les deux.
Au contraire, la faible participation a confirmé que le Hirak de 2019 – même si le régime militaire et les services de sécurité ont pu l'écraser par la répression et les arrestations arbitraires, saisissant initialement l'opportunité offerte par la pandémie de Covid en 2020 et poursuivant la même approche jusqu'à ce jour – le Hirak est toujours vivant comme un feu sous les cendres, attendant une occasion de s'enflammer à nouveau. Il ne fait aucun doute que l'establishment militaro-sécuritaire au pouvoir considérera le résultat des élections comme une source d'inquiétude, surtout qu'il s'est produit bien que le gouvernement ait augmenté les dépenses sociales avec lesquelles il tente d'acheter l'assentiment du peuple, en profitant de la hausse des prix des hydrocarbures et de l'augmentation de ses revenus qui s'en est suivie, avec le besoin européen croissant de gaz algérien pour compenser le gaz russe. Les hydrocarbures représentent en effet plus de 90% de la valeur des exportations algériennes, un pourcentage bien plus important que tous les pourcentages électoraux, car il indique l'échec lamentable des militaires à industrialiser le pays et à développer son agriculture, un objectif qu'ils ont déclaré prioritaire depuis qu'ils ont pris le pouvoir en 1965 sous la houlette de Houari Boumediene, notamment après la nationalisation du secteur des hydrocarbures en 1971.
Il est à craindre que la réaction de l'institution au pouvoir à son échec politique évident ne se traduise par une nouvelle restriction des libertés et ne conduise le pays sur la voie traditionnelle des dictatures régionales, avec davantage de fraude électorale, au lieu de répondre au désir clair du peuple algérien de voir les militaires retourner dans leurs casernes et faire place à un gouvernement civil démocratique issu d'élections libres et équitables. Au contraire, des faits indiquent que le pays suit le modèle égyptien en élargissant le champ d'intervention de l'institution militaire dans la société civile, comme en témoigne la décision prise par la présidence au début de l'été de permettre aux officiers de l'armée d'occuper des postes dans l'administration civile sous prétexte de bénéficier de leurs qualifications.
En fin de compte, des deux vagues de soulèvements qu'a connues la région arabophone en 2011 et 2019, les régimes en place n'ont tiré que des leçons répressives en resserrant leur emprise sur les sociétés. Ce faisant, ils ne font qu'ouvrir la voie à des explosions encore plus grandes et plus dangereuses que ce que la région a connu jusqu'à présent, alors que la crise économique et sociale structurelle qui a constitué la base des deux vagues révolutionnaires précédentes continue de s'aggraver et s'aggravera inévitablement tant que les régimes de tyrannie et de corruption resteront en place.
Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 10 septembre en ligne et dans le numéro imprimé du 11 septembre. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Série Soudan (4/4), Arabie Saoudite et Émirats, ces alliés devenus adversaires

Généralement partenaires et même alliés, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis font preuve en réalité d'une rivalité très vive au Soudan, où la guerre civile fait rage. Les deux royaumes soutiennent des camps opposés.
Tiré de Mondeafrique
26 août 2024
Par la rédaction de Mondafrique
Un article de Mateo Gomez

Le chef d'État du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, qui a dégagé le dictateur Omar al-Bashir en 2019, fait face à son ancien second surnommé Hemeti, qui dirige le groupe paramilitaire Forces de Soutien Rapide (FSR). Mais ce conflit n'est pas qu'une embrouille domestique. Le Soudan, lien entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne, est riche en ressources naturelles. Du coup, ce pays attire les convoitises régionales.
Ainsi, l'Arabie Saoudite comme les Émirats Arabes Unis (EAU) voient tous deux la guerre comme une opportunité pour étendre leur influence dans la région. Les Saoudiens soutiennent le gouvernement internationalement reconnu d'Abdel Fattah, alors que les Émiratis penchent pour le chef des rebelles et ex numéro deux du régime.
Ces derniers n'espèrent pas une victoire complète des FSR, de toute façon hautement improbable au vu de la force et la légitimité de Fattah. Mais un cas probable serait une situation similaire à celle de la Libye, où divers groupes se battent pour des zones d'influences sur le territoire. Un tel cas de figure permettrait aux Émirats d'être une perpétuelle épine dans le pied Saoudien, et d'en extraire ainsi des concessions.
Généralement partenaires et même alliés, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis font preuve en réalité d'une rivalité très vive au Soudan, où la guerre civile fait rage. Les deux royaumes soutiennent des camps opposés.
Le groupe Wagner (1) dans la boucle
Ces monarchies du golfe ont joué un rôle significatif au Soudan depuis la chute de la dictature d'al-Bashir en 2019, envoyant des milliards de dollars à la junte d'Abdel Fattah en aide et investissements. Leurs intérêts étaient à l'époque alignés. Mais le rapprochement du Soudan avec le Qatar, rival des EAU, fut vu d'un mauvais œil par Abu Dhabi. Et lorsque les FSR, qui avaient déjà soutenu les intérêts émiratis au Yémen et en Libye, s'affirmèrent comme la première force d'opposition à Fattah en 2023, le patron des Émirats, MBZ, sauta sur l'occasion.
Sans manifester une hostilité trop évidente à l'égard des saoudiens, les émiratis ont collaboré avec la Russie pour soutenir le groupe Wagner, qui a offert ses services aux FSR. Les paramilitaires soudanais protègent les intérêts miniers des paramilitaires russes, qui envoient des ressources à la Russie… en passant par les Émirats. En juin 2023 la trésorerie américaine à sanctionné Al Junaid et Tradive, deux entreprises minières associées à Hemeti et basées au Soudan et aux Émirats.
Les Saoudiens, de leur côté, travaillent sans relâche pour se présenter comme un médiateur de paix crédible et comme un soutien humanitaire conséquent pour les soudanais. Mais la perspective de la paix est encore lointaine. Si elle venait à se réaliser, les saoudiens pourraient renforcer leur image de leader du monde arabe et musulman. Mais si une situation similaire à celle en Libye s'installe, les Emirats pourraient durablement fragiliser l'influence saoudienne dans la région – une victoire pour le petit royaume.
Les Américains convoités
Cette compétition entre les deux royaumes n'est pas nouvelle. Les Émirats n'hésitent pas à nouer des liens diplomatiques avec tout le monde, y compris l'Iran, l'ennemi juré des saoudiens. Au Yémen, les tensions sont palpables. Riyad soutient le gouvernement reconnu internationalement d'Abed Rabbo Mansour ; Abu Dhabi en revanche soutient le groupe rebelle du Conseil de Transition du Sud (2), qui lui offre un accès privilégié aux ports du pays mais qui bloque le développement d'infrastructures pétrolières saoudiennes.
Dernièrement, la compétition entre les deux pays pour mettre les États-Unis de leur coté a été intense. Depuis la scandale de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi par les saoudiens, les relations entre le royaume et les États-Unis se sont refroidies considérablement, ouvrant la porte aux Émiratis qui voudraient devenir le partenaire privilégié de la superpuissance dans la région à coup d'achats d'armes.
Cerise sur le gâteau, la signature des accords d'Abrahams avec les Israéliens a renforcé encore la crédibilité de MBZ, le chef tout puissant des Émiratis, auprès des Américains, alliés constants de Tel Aviv.
(1) Malgré sa rébellion ratée, le groupe Wagner est toujours présent en Ukraine, en Biélorussie et en Afrique. Il a été intégré à l'armée régulière russe et doit répondre aux ordres d'Andreï Trochev, qui a été directement nommé par Vladimir Poutine.
(2) Les autorités séparatistes du Sud accusent le gouvernement d'Abd Rabbo Hadi – appuyé par une coalition militaire conduite par l'Arabie saoudite – de ne pas avoir rempli ses obligations et d'avoir même « conspiré » contre leur cause. En principe, tous sont alliés au sein du camp « loyaliste » contre la rébellion houthi au nord. Dans la réalité, l'accord qu'ils ont signé – contraints et forcés – début novembre à Riyad ne s'est jamais traduit dans les faits.
***Source : Mohammad, Talal. “How Sudan Became a Saudi-UAE Proxy War”, Foreign Policy, Fall 2023, pp. 24-26
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’impuissance africaine face à l’immigration clandestine

Deux semaines après la tournée africaine du premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui s'est rendu au Sénégal pour tenter de décourager l'émigration vers l'Europe, une pirogue transportant 150 personnes en route pour les îles canaries a chaviré le dimanche 8 septembre à Mbour à 100 km au sud du Sénégal, créant un nouveau drame humain devant lequel les autorités du pays en particulier et les dirigeants africains en général restent encore impuissants.
Tiré de MondAfrique.
Au moins 150 personnes étaient dans cette pirogue qui a quitté la plage de Mbour, au sud du Sénégal, le dimanche 8 septembre dernier. L'embarcation a chaviré 3 kilomètres plus tard jetant à la mer tous ses passagers. Ce nouveau drame de l'émigration clandestine intervient seulement deux semaines après le passage du premier ministre espagnol Pedro Sanchez dans la capitale sénégalaise.
Le dirigeant espagnol s'était rendu à Dakar dans le cadre d'une tournée africaine destinée à décourager le flot d'émigrés qui envahissent les îles Canaries à partir des côtes mauritanienne et sénégalaise. Mais le mal est bien trop profond et devant le manque de perspective dans leur pays, rien n'arrive à entamer la détermination des jeunes africains qui tentent quotidiennement, au prix de leur vie, leur chance de vivre et travailler en Europe.
Pour retrouver les naufragés, le Sénégal a déployé des marins qui poursuivent leurs recherches à l'aide de zodiac de sauvetage. Les pêcheurs traditionnels ont été les premiers à venir à la rescousse des passagers de l'embarcation naufragé. Mais jusqu'au lendemain 9 septembre, seulement 24 personnes – dont 3 sont encore en observation à l'hôpital- ont pu être sauvées, tandis que 5 corps sont venus s'ajouter aux quatre personnes noyées retrouvées dès dimanche par les pêcheurs.
Alors avec les heures qui passent, l'espoir s'amenuise forcément. D'autant que le bilan risque de s'alourdir car, pour l'heure, il n'y a aucune certitude sur le nombre exact des passagers – 150 ou plus ? – qui étaient à bord de cette pirogue. On sait en revanche que la pirogue a quitté l'une des plages de Mbour le samedi 8 septembre en milieu d'après-midi, en direction des îles Canaries. « C'est désastreux ce qu'il se passe à Mbour. Les pertes sont énormes. On ne peut pas imaginer des jeunes, même pas 30 ans, qui sont morts », a expliqué au correspondant de RFI Cheick, un Sénégalais qui affirme connaître une vingtaine de personnes ayant pris place dans la pirogue.
Deux autres pirogues interceptées
À la morgue, le désespoir se lisait sur les visages des parents et amis venus s'informer pour certains ou débuter la procédure de retrait des corps pour d'autres. Souvent à ce chagrin se mêlait la colère de voir ces drames se répéter. L'impuissance des autorités à créer des emplois pour donner des raisons aux jeunes de rester dans leur pays est régulièrement pointée par les parents des victimes. Mais pour Mohamed Baro, conseiller municipal à Mbour, ce drame a également été alimenté par la limitation drastique des visas dans les consulats occidentaux. « C'est une catastrophe qui malheureusement va se reproduire car ces jeunes sont déterminés à partir. Il y a quelque temps, ces jeunes partaient de Gambie ou ailleurs, mais ce qui s'est passé hier, c'est qu'ils sont partis de la plage même de Mbour. En Afrique et au Sénégal particulièrement, nous avons toujours des difficultés pour obtenir des visas. Et ce ne sont pas d'habitude des badauds qui entreprennent le voyage, ce sont des enfants qui se débrouillent, qui ont un métier, qui devraient normalement voyager sans avoir besoin de vivre certaines péripéties », estime-t-il.
Signe de cette détermination, la marine sénégalaise a arraisonné deux pirogues transportant 421 passagers, dont 20 enfants alors que les recherches des corps de naufragés se poursuivait.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












