Derniers articles

Intégration du concept « Malere / malheureux » dans la pensée sociale haïtienne

Au cours de la réalisation de mon travail de mémoire de licence en sociologie, j’ai rencontré une difficulté qui m’a bouleversé pendant toute la recherche. Cette difficulté est liée à mon incapacité de nommer les participants de l’étude puisqu’il s’agit des producteurs des programmes Car Wash dans la ville de Port-au-Prince. Je me suis retrouvé dans un dilemme soit j’utilise une analyse générationnelle, c’est-à-dire de les catégoriser dans la 8e génération[1] d’Haïti soit j’utilise une analyse de classe en les catégorisant dans les classes populaires (Collectif Rosa Bonheur, 2019). Par ailleurs, au cours d’une quête de document concernant notre objet d’étude, j’ai découvert une publication sur la page de Facebook des organisateurs. Ils ont mentionné clairement le concept « Malere » pour se nommer. Compte tenu de l’ordre universitaire colonial et occidentalocentré, je suis réticent de son usage dans ma recherche.
Parallèlement, j’ai visualisé une courte vidéo sur la page Facebook du professeur Jean-Marie Théodat au cours de laquelle des intellectuels parmi les plus reconnus et éminents du pays discutent sur la façon de nommer et conceptualiser les couches sociales en Haïti. Jean Casimir qui était parmi ces intellectuels formule une question fondamentale du point de vue épistémologique et de la sociologie de la connaissance. Il demande : « qu’est-ce qu’une classe dominante sans ses moyens de sa domination ? ». Cette interrogation est une remise en question de la catégorisation et la nomination des couches sociales en général, mais le concept de classe dominante et de classe dominée en particulier dans le contexte haïtien. Elle m’a permis d’identifier automatiquement un vide qui pourrait faciliter de nouvelle conceptualisation des couches sociales.
En outre, dans un discours qu’il a prononcé, titré « Habiter le rêve » au collège de France à l’occasion de l’inauguration de la chaire de la littérature de la francophonie en 2019, Duvivier Michelle Pierre-Louis a reconnu la non utilisation du concept malheureux par la majorité des auteurs haïtiens. Même si elle n’a pas explicité le problème qui sous-tend cette non utilisation de ce concept, elle a dit clairement : « peu d’auteurs se sont penchés sur le sens des mots, malere/malerèz, utilisé par les subalternisés, (…) ». Je pourrais questionner sur le silence du concept malheureux par des penseurs haïtiens. Cependant, je n’intéresse moins aux contraintes liées à l’utilisation de ce concept qu’à son début de systématisation par le géographe Georges Anglade et le sociologue Jean Casimir, deux penseurs majeurs dans les sciences sociales haïtiennes.
Ochan pou malere de Georges Anglade
J’ai fait ma première rencontre avec le concept malheureux dans un petit ouvrage de Georges Anglade titré Éloge de la pauvreté (1983). Avec la précision de l’auteur, ce titre se traduit en créole haïtien par Ochan pou malere. Ce texte est la transcription d’un discours que le géographe haïtien a fait à l’occasion de la réception du prix pour la murale d’Hispaniola. À travers ce petit bouquin d’une densité exemplaire, Anglade initie une systématisation du concept malheureux. Il entame ce processus par un travail de traduction et conceptualisation entre pauvreté, misère, pauvre et malheureux. Pour l’auteur, ces mots ne renvoient pas à la même charge sémantique et lexicale. De ce fait, pour le penseur de l’espace haïtien, pauvre dans la langue française ne traduit pas par Malere en créole.
Lors de cette occasion de la réception du prix international pour la catégorie « Atlas et cartes » en 1983, le géographe haïtien Georges Anglade esquisse une nouvelle théorie de la pauvreté en aboutissant au concept de désenveloppement. En effet, dans ce discours il a pris distance à la façon dont traditionnellement les penseurs abordent le phénomène de la pauvreté, de la misère, de la richesse et du développement. Cette rupture lui a permis d’élucider la différence entre la misère et la pauvreté. Dans ce cas, cette dernière n’est pas synonyme de la misère. Donc la pauvreté est le point de départ pour sa théorie de la gestion de la précarité.
Pour le penseur de l’espace haïtien, la pauvreté est le point de départ et aussi l’idéal. Autrement dit, elle fait le pont entre la richesse d’un petit nombre et la misère d’une majorité. Elle occupe ainsi le juste milieu. La pauvreté désigne la satisfaction ou encore le développement du nécessaire. C’est la raison pour laquelle, Anglade entame un éloge de la pauvreté.
Son éloge de la pauvreté se tourne autour d’une préoccupation centrale, « […], comment expliquer que 80% de la population haïtienne sont encore en vie ? » En créole haïtien, nous pouvons demander « kijan malere fè viv[2] ? » C’est de cela que son travail de traduction entre « pòv » et « pauvre » paraît fondamental. Ces deux termes ne sont pas transposables d’une langue à l’autre, c’est-à-dire de la langue française à la langue créole haïtienne. Ces deux termes ne sont pas similaires. En d’autres mots, il existe une différence considérable entre « pauvre » en français et « pòv » en créole. Le « pòv » est un mendiant. Il vit dans une extrême misère. On peut supposer que sa situation miséreuse lui a enlevé sa dignité. Étiqueter l’Haïtien précaire de « pòv » est une insulte. Cette étiquette charrie un mépris pour cette personne. Du coup, Anglade fait émerger le concept de « Malheureux/ Malere ». Celui-ci désigne selon Anglade une personne qui détient un minimum de subsistance et préserve en même temps son respect, sa dignité et son honneur. D’où la traduction de l’éloge de la pauvreté par ochan pour malere. Cette tentative de systématisation fait Anglade l’un des pionniers de l’introduction du concept malheureux dans la pensée sociale haïtienne.
Jean Casimir : du captif au malheureux
En dépit des efforts remarquables de George Anglade, Jean Casimir a poussé le plus la réflexion sur le concept malheureux. Il a accordé une place de choix à cette conceptualisation dans l’un de ces derniers ouvrages, titré Une lecture décoloniale de l’histoire du peuple haïtien ; du traité de Ryswick à l’occupation américaine (1697-1915). Toutefois, le sociologue Casimir a avoué que l’usage de ce concept dans la pensée haïtienne remonte à Baron de Vastey. Ce dernier a utilisé le concept malheureux environ quatre-vingt-dix fois dans son ouvrage le système colonial dévoilé (1814). Malheureusement, il fallait attendre Anglade (1983) pour une nouvelle apparition de ce concept dans les sciences sociales.
Dans son ouvrage, Casimir a au moins deux chapitres qui ont fait mention de ce concept ; il y a le chapitre deux stipulant « Un frein à la fabrication du malheureux » (2018 : 61-107). Dans ce chapitre, le sociologue Casimir parcourt le cheminement des Haïtiens depuis leur captivité jusqu’à l’occupation américaine. Il identifie les mécanismes mis en place par des Haïtiens pour mettre un frein à la fabrication du malheureux. De ce fait, il esquisse aussi la contradiction entre l’administration publique dirigée par des oligarques bicéphales et le peuple souverain. Malgré l’importance de ce chapitre, notre travail se porte fondamentalement sur le chapitre titré « pouvoir et beauté du peuple souverain ».
C’est dans le chapitre VIII, titré « pouvoir et beauté du peuple souverain » (Casimir, 2018 : 329-376) qu’il a éternisé et a proposé en même temps une définition de ce concept. Nous devons préciser que le concept malheureux intervient à un moment tardif dans la pensée de l’auteur. Son introduction dans l’œuvre de Casimir atteste l’évolution et le progrès de sa pensée. Toutefois, l’auteur de Pa bliye 1804 (2004) garde toujours sa préoccupation de départ tout en la perfectionnant. Il s’efforce « […], d’appréhender comment des Haïtiens [malheureux] arrivent à exister, à subsister et à vivre au sein des structures politiques qui refusent toute participation de leur part. » Cette idée traverse toute son œuvre et elle en est aussi la porte d’entrée. Sa préoccupation rejoint celle de Georges Anglade esquissée ci-dessous. Ces deux auteurs majeurs de la pensée sociale haïtienne voulaient ainsi comprendre et expliquer comment des malheureux haïtiens gèrent-ils la précarité séculaire ?
Dans sa tentative de systématisation, Casimir prend la société de Saint-Domingue comme illustration bien que certaines fois il se réfère au XIXe haïtien. Le malheureux se situe dans un environnement conceptuel comme le malheur, son opérateur, ses victimes et sa réponse. D’abord, l’empire colonial est la figure du malheur. Il est consubstantiel à la société de plantation. Cette dernière est un produit de l’État français moderne coloniale. Celui-ci met en place un ensemble de dispositifs pour transformer le captif en esclave. Ce processus d’esclavagisation est concomitant à l’invisibilité du mode de vie de l’Africain réduit en esclavage. Cet ordre colonial est supporté par une partie de la population que l’on appelle Affranchi. Cette couche sociale malgré sa supposée liberté est la prisonnière de l’ordre colonial et du public blanc. Donc, l’empire colonial fabrique de toute pièce la perle des Antilles qui schématise le malheur pour les captifs. Ensuite, le maitre est l’opérateur du malheur. Les propriétaires d’esclave en dépit de la différence de l’épiderme vivent du malheur des esclaves. Ils sont la pierre angulaire de la société coloniale et esclavagiste. Les attitudes de ces couches sociales, devenant une partie de l’oligarchie traditionnelle, ne changent pas vis-à-vis de couches populaires, les malheureux. Enfin, le captif bossale est le prototype du malheureux. Il est la victime du malheur. Son malheur est injustifiable. Pendant que l’Occident s’accélère la production du malheur, le captif de son côté s’opère pour un dépassement de ce malheur en proposant des réponses. Ces dernières aboutissent à la société contre-plantation, à la création des zones de sauvetage concrétisé dans la Révolution haïtienne.
Selon Casimir, le concept malheureux nous rappelle notre passé entant que captifs venant d’Afrique sur les bateaux négriers vendus comme force de travail. Mais ce concept nous permet aussi de nous distancier du piège de l’affranchissement personnel et individuel. Il renouvelle les liens de solidarité et de réciprocité entre les autres malheureux. Communément, le malheureux désigne ceux qui vivent dans la précarité. Il englobe toutes les couches sociales populaires. Il ne renvoie pas à la résignation et au fatalisme, mais de préférence à l’imprévisibilité du malheur qui l’entoure. Dans ce cas, « (…), le captif et le malheureux contemporain se définissent comme ceux qui savent se survivre du système dominant – le manipulé- de façon à ne pas modifier leur être profond » nous a déclaré Casimir (2018 : 339).
En conclusion, cet article est un appel à la réflexion sur le concept malheureux dans le milieu intellectuel haïtien et aussi un appel à l’écoute des couches sociales populaires haïtiennes. Il ne vise pas apriori à résoudre un problème d’épistémologie et de la sociologie de la connaissance inhérent à la pensée sociale haïtienne. Ainsi, il nous vient à l’esprit de demander pourquoi et comment la majorité des penseurs haïtiens même les plus critiques font silence sur ce concept largement utilisé par les couches populaires haïtiennes ? Quelles sont les implications politiques de son usage dans les sciences sociales haïtiennes ? Quelles sont les différentes acceptations du concept malheureux ? Quelle est l’actualité de la systématisation de Jean Casimir ?
Pierre Jameson BEAUCEJOUR, sociologue
- Grille d’analyse proposée par Anglade pour étudier Haïti. La 8e génération haïtienne réfère aux personnes qui sont nées de 1990 à 2015 ↑
- Comment les malheureux vivent-ils? ↑

Entretien avec Luzia Hernández : la Colombie avance dans la dépénalisation de l’avortement

Un mois s’est écoulé depuis que la décision de la Cour constitutionnelle sur la dépénalisation de l’avortement gratuit jusqu’à vingt-quatre semaines de grossesse a été connue en Colombie. Dans cet entretien que nous avons mené avec Luzia Hernández, nous entrons dans l’histoire d’une longue lutte pour les droits sexuels et reproductifs des femmes et dans le sens de ce triomphe du mouvement féministe. Luzia est avocate et travaille pour Women’s Link Worldwide . Il enseigne également à l’Universidad del Rosario. Elle a travaillé dans des organisations de la société civile en Colombie en accompagnant des cas de violence sociopolitique et de violations des droits des femmes et des filles.
Begoña Zabala- Après vous avoir félicité pour ce succès obtenu dans le procès devant la Cour constitutionnelle et l’obtention de la dépénalisation de l’avortement jusqu’à vingt-quatre semaines, je voudrais commencer par la situation, tant juridique que pratique, avant cette modification. Je comprends que le système était le plus général, dépénalisation des trois causes : viol, santé de la femme enceinte et malformation du fœtus, le reste des cas étant illégal et constituant un délit. Est-ce bien le cas ?
Luzia Hernández- Oui, bien sûr, mais je remonterais un peu plus loin en arrière et dirais que le mouvement féministe et féministe, vers les années 1980, revendiquait déjà cette question de l’autonomie et de la capacité des femmes à décider de leur corps et à faire leur ses propres décisions, ses propres projets de vie.
Nous avons eu un processus constituant qui a donné naissance à la Constitution politique que nous avons aujourd’hui, à partir de 1991, dans laquelle, malheureusement, le mouvement constituant n’a pas écouté les voix du mouvement des femmes et cela n’y était pas stipulé, c’est-à-dire ces droits que le mouvement féministe. Donc, ces demandes viennent d’il y a longtemps.
Enfin, puisque cela n’est pas constitutionnalisé, lorsque nous structurons un nouveau Code pénal, nous recueillons les trois hypothèses du passé, et en ce sens le crime d’avortement est inclus.
Comme les féministes l’avaient articulé, en 2006, et à travers un procès mené par Women’s Link, ce qui est fait est de poursuivre la Cour constitutionnelle pour le crime d’avortement du Code pénal, mais de dire qu’une criminalisation absolue et qui comprend l’avortement comme un crime dans tous les cas, va à l’encontre des valeurs déjà contenues dans la Constitution politique. Et si on ne les prend pas au sérieux, alors il n’est pas compatible d’avoir un avortement pénalisé, dans aucune des causes, quand cela peut représenter le décès de la femme enceinte.
Tels sont les arguments qui ont été portés devant la Cour constitutionnelle en 2005 et finalement sanctionnés par l’arrêt C-355 de 2006, dans lequel l’avortement est déjà partiellement décriminalisé dans trois circonstances précises.
L’analyse faite par la Cour à l’époque est donc la suivante : il y a ici une tension entre la protection de la loi sur la grossesse et la protection des droits des femmes. Aussi, dans ce domaine des droits, nous commençons déjà à avoir un cadre international des droits de l’homme, pour dire comment ces droits sont aussi les droits des femmes. Le droit à la vie et le droit à l’intégrité personnelle sont aussi des droits des femmes, et la criminalisation absolue viole ces droits. C’est à partir de là que la Cour dit, pour l’instant il y a trois événements limites dans lesquels forcer une femme à mener une grossesse à terme peut être inconstitutionnel.
Ainsi, pour une poursuite intentée par Women’s Link, nous obtenons les trois motifs. En d’autres termes, nous obtenons que l’avortement cesse d’être un crime et devienne un droit lorsque la grossesse représente un risque pour la santé ou la vie des femmes; lorsque le fœtus est incompatible hors de l’utérus et lorsque la grossesse est le produit d’un viol.
BZ- Concrètement , comment s’est déroulée cette dépénalisation partielle de l’avortement? Pensez-vous que le système causal fonctionne dans le domaine des droits sexuels et reproductifs ?
Luzia-Alors que nous avons déjà une première conquête en matière de droits sexuels et reproductifs, que commence-t-on à voir ? La première chose que nous avons commencée et célébrée à ce moment-là a été de dire, prêts, il y aura plus d’accès, la garantie de ces droits sera encore étendue. Cependant, ce qui est allé à l’encontre de nos prévisions, c’est que les poursuites pénales, loin de diminuer, ont commencé à augmenter. Les barrières structurelles ont commencé à se consolider dans ces trois causes. Les femmes ne pouvaient pas y accéder en raison de barrières géographiques, car ici la Colombie a une géographie montagneuse, et tout le monde ne vit pas au centre de Bogotá. Nombreuses sont les femmes qui, par exemple, mettent au moins 6 heures de bateau pour quitter la maison où elles habitent en milieu rural. Il s’avère que le bateau ne fonctionne pas toute la journée. Cela commence à retarder les procédures, et lorsqu’elles arrivent au chef-lieu municipal le plus proche, il s’avère qu’elles sont dans un état de gestation avancé où on leur dit qu’il n’y a pas de prestataires spécialisés pour réaliser le service dont elles ont besoin car il est plus complexe.
D’autre part, de nombreux prestataires de services de santé dans les zones rurales ont commencé à comprendre les causes de manière restrictive. Ainsi, le fait qu’une femme ait eu des idées suicidaires à la suite d’une grossesse non désirée n’était pas considéré comme quelque chose qui menaçait la santé, mais on dit que la femme n’a pas su assumer ce nouveau processus dans sa vie, et a quelques altérations , mais c’est une question de stabilisation, et la grossesse est menée à terme.
De plus, les pratiques d’avortements étaient principalement concentrées sur des prestataires privés situés dans les principales villes. Cela finit par faire de l’accès à l’avortement sécurisé un accès très limité et inéquitable, ayant même ces trois causes ; et, d’autre part, l’augmentation des poursuites pénales contre les femmes.
Selon les données du bureau du procureur général, ce pourcentage de persécution, de criminalisation des femmes pour avoir pratiqué un avortement, a augmenté depuis 2008, de 320 %. Nous atteignons donc 400 dossiers ouverts par an, à partir de cette année.
Une autre information très significative est qu’environ 43 % des femmes enquêtées, soit près de la moitié d’entre elles, avaient également déclaré, devant le même procureur, avoir été victimes d’un autre type de violence, violences domestiques et violences sexuelles. Et cela n’était pas lié par le système judiciaire et il a commencé à les persécuter. L’un des principaux groupes de tout cet univers de femmes qui ont été persécutées criminellement était les filles et les adolescentes.
Nous avons commencé à voir que tout cela était un problème. L’exécution de cette sentence des causes n’a pas suffi. Surtout pour des groupes spécifiques. Pour les femmes rurales, pour les filles victimes de violences sexuelles, par exemple. Et, malheureusement, il y a aussi un facteur négatif qui opère dans les circonstances du conflit armé. Disons que l’accès à l’avortement en cas de viol nécessitait une plainte pénale, mais dans les territoires contrôlés par des armées irrégulières, il est difficile pour les femmes d’avoir la confiance nécessaire pour porter plainte, car c’était la loi, non ? Cela a de nouveau entravé l’accès à l’avortement sécurisé.
BZ- Dès lors , ce qui nous intéresse le plus, c’est de savoir comment s’articulent le mouvement féministe et les organisations de femmes et comment ils parviennent à se remettre dans le sens des revendications et à porter la question devant la Cour constitutionnelle
Luzia- Ces questions ont également été portées devant la Cour constitutionnelle et la Cour savait déjà qu’il existait des obstacles structurels lorsqu’il s’agissait de fournir des services sûrs. Et c’est précisément pour cette raison que nous lui avons dit : écoutez, le problème n’est pas seulement la mise en œuvre des motifs, mais le problème est que nous continuons à insister sur le fait que le crime et le droit peuvent être des partenaires ou des voisins pacifiques, puisqu’il a été démontré que cela c’est une erreur, c’est un mensonge. C’est quelque chose dont nous n’avons pas essayé de nous convaincre, mais la réalité nous l’a déjà montré.
Et c’est là que le mouvement des femmes s’articule en un mouvement large, pluriel et diversifié, dont environ 90 organisations faisaient partie.
Déjà en 2018, ils ont commencé à parler de ce problème d’avoir le crime et l’avortement comme partenaires, car ils n’étaient pas pacifiques et c’est pourquoi la santé des femmes a commencé à appeler la nécessité de dépénaliser l’avortement comme une cause juste.
À partir de là, à partir d’une lecture du contexte et de l’analyse des forces dont disposait la Cour constitutionnelle en ce moment, nous avons vu qu’il était peut-être temps de nous articuler, de nous concentrer avant tout sur ce que nous avons en commun. Le mouvement féministe en Colombie, comme dans le reste du monde, est diversifié et chacun a son propre programme. Mais concentrons-nous maintenant sur ce que nous avons en commun, et où nous voulons aller.
Quel serait notre objectif dans ce cas ? Eh bien, les droits reproductifs sexuels et l’avortement. A partir de là unissons nos forces à partir de ce que chacun sait faire de mieux. En ce sens, Women’s Links a mis son expérience, et comme avantage comparatif cette expérience en contentieux, dans l’utilisation des Tribunaux pour l’extension des droits.
En ce sens, en 2020 nous avons présenté un procès devant la Cour constitutionnelle dans lequel nous avons regroupé tous ces arguments. L’argument le plus fort, la revendication qui a été faite à la Cour était de faire tomber l’énorme barrière en matière d’accès à des avortements sûrs, en particulier pour les filles, les adolescentes et les femmes en situation de plus grande vulnérabilité, encore des paysannes et des victimes du conflit armé. En ce moment, nous sommes également confrontés à tout cet exode qui s’est produit de la part de la population vénézuélienne avec la crise humanitaire complexe qui se déroule ici. Ce sont des femmes qui migrent en quête de santé sexuelle et reproductive, mais du fait de l’absence d’une situation migratoire normalisée, là encore il y a de nouvelles violations des droits,
BZ- J’aimerais que vous nous expliquiez comment fonctionne ce processus de présentation d’un procès directement à la Cour constitutionnelle, au lieu d’aller au Congrès avec un projet de loi, pour obtenir une législation sur l’avortement sécurisé. Cet itinéraire est vraiment nouveau pour nous et, comme vous le dites, vous l’avez déjà essayé plusieurs fois et avec de bons résultats.
Luzia- En 2018, lorsque cette idée de Just Cause est apparue, il n’y avait pas une telle clarté. Just Cause surgit pour intenter une action en justice. Et nous avons vu au Congrès, ou du moins à la Table ronde pour la santé des femmes, un scénario dans lequel nous ne pouvions tout à coup pas lutter, et qui nous avait montré à d’autres occasions qu’il n’atteignait pas la représentativité des femmes nécessaire pour atteindre changements législatifs en faveur de nos droits. Lors d’occasions précédentes avec le Congrès, 33 projets de loi avaient été présentés qui tentaient de réglementer les droits sexuels et reproductifs, et tous ont été coulés et classés.
Et cela se produit aussi parce que, au Congrès en ce moment, il y a une demande de réforme en termes de représentativité. Aujourd’hui, le Congrès n’est pas le même Congrès qui a été formé en 1990. Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de population concentrée dans les villes et nous n’avons plus cette représentation au Congrès, qui continue de fonctionner comme si nous étions le pays de la fin des années 1980. Il y a un lest et une gueule de bois de représentativité très importante et, précisément pour cette raison, il serait difficile pour les revendications qui nous ont bénéficié de prospérer.
Et pourtant, dans notre système juridique, il y a aussi des juges et des tribunaux de grande instance. Pour cette raison, malgré le fait que le Congrès est chargé de légiférer et d’approuver les lois qui régiront le destin national, nous avons des juges constitutionnels, qui sont chargés d’examiner si les lois qui ont été approuvées au Congrès sont conformes à notre principes constitutionnels. Cette Cour constitutionnelle est la gardienne de la Constitution.
A cette époque, comme nous l’avons déjà vu, le Congrès ne voulait pas avancer, malgré le fait que c’est sa fonction, et il n’avait pas la volonté politique de le faire, alors nous nous sommes tournés vers la Cour constitutionnelle. Et cette fonction, en termes de lois, est de voir si elles sont conformes à la Constitution. Sans usurper les fonctions, mais à l’intérieur des fonctions de chacun, nous envisageons de demander à la Cour d’examiner si une certaine loi, telle que nous l’avons à la lumière de la réalité que nous vivons aujourd’hui, est constitutionnelle ou non. Et s’il est conforme aux postulats constitutionnels.
En outre, la Constitution n’est pas seulement le texte qu’elle contient, mais de nombreux traités relatifs aux droits de l’homme font également partie de la Constitution. Cet ensemble de droits humains a également progressé et reconnu de plus en plus de droits des femmes et des filles. Cet organe normatif international des droits humains et des droits des femmes a évolué. Notre Constitution est aussi une constitution vivante et en termes de réglementations que nous estimions auparavant cohérentes et protectrices des droits, aujourd’hui, avec le développement des droits de l’homme, elles nous ont montré qu’elles ne sont pas des garants et qu’elles peuvent affecter les droits de l’homme .
C’est ce que nous avons demandé à la Cour, d’analyser si, à la lumière de notre contexte actuel, et de tous ces obstacles à des avortements sûrs, et de ce système juridique avec lequel on dit qu’il protège les droits des femmes, maintenir le crime d’avortement, constitutionnel ou ne pas. Et c’est ce qu’il a fait. Et puis après avoir marché avec suffisamment de retard, car nous l’avions présenté en septembre 2020, ils se sont finalement résolus le 21 février 2022.
Et justement pour plus de légitimité, cette revendication a été présentée par un mouvement plus large qui a réuni 90 organisations au niveau national, dans 20 départements du pays, 130 militants, et aussi des experts dans chacune de leurs disciplines. Pas seulement des avocats, mais des gens de la médecine qui ont également déclaré à quel point cela viole le droit des professionnels de la santé à fournir un service sans coercition et en toute sécurité si cela est dans la cause.
Tout cela se traduit finalement par un élargissement de l’accès à l’avortement sécurisé, et nous espérons que les principaux bénéficiaires de cette disposition sont les femmes les plus vulnérables, celles qui n’y ont pas eu accès précisément à cause de toutes ces barrières structurelles.
BZ- Enfin, ce qui est homologué c’est 24 semaines de gestation pour réaliser une interruption volontaire de grossesse (par exemple, quatorze travaillent ici) d’où vient ce délai ?
Luzía- Ce n’était pas exactement ce que nous demandions à la Cour constitutionnelle. Nous lui disions que toute réglementation que nous édictons sur l’avortement doit être en dehors du droit pénal, car ce qui a été démontré, c’est qu’il est assez préjudiciable aux droits des femmes et des filles. Parce que cela génère une très grande menace, parce que c’est une menace de perdre sa liberté et de se retrouver avec des papiers et des désordres judiciaires pour demander la protection du service de santé. En ce sens, les expériences d’autres pays comme le Canada nous ont démontré que la réglementation sanitaire et non pénale a un meilleur impact que la réglementation pénale.
Ce n’est pas exactement ce que la Cour a accordé, mais elle a voulu arriver à un point intermédiaire et, selon ce que nous savons jusqu’à présent, ils sont partis comme par un critère arbitraire, parce que les législations, en le comparant, le montrent parce que les législations le montrent , certains de 14, 22, d’autres 24, etc.
Le raisonnement de la Cour est de rechercher un point intermédiaire. Parce qu’ils interprètent que le retirer complètement du Code pénal va générer un vide dans la protection, ce qui n’allait pas forcément être le cas, car il y a plusieurs manières de protéger qui ne passent pas par là.
Alors comment trouver un terrain d’entente ? Eh bien, c’est là qu’il y a des théories sur la protection de la loi de gestation : on peut la protéger du fait qu’il y a de la vie, et le critère est l’existence, mais l’exigence est presque dès la conception et elle finirait par dire, la terme pour avorter, il doit être de 72 heures. Ce serait inhabituel. Ce serait plus ou moins comme une blague, qu’il y aura un avortement gratuit dans les 72 premières heures. Et plus encore compte tenu de notre réalité nationale.
Et d’autre part, dit la Cour, il y a une autre notion connexe, qui est l’autonomie de gestation. Ceci, plus ou moins, a été placé à 22 ou 24 semaines, en déduisant que le fœtus, soutenu par des technologies (des technologies que nous n’avons pas en Colombie) peut survivre en dehors de l’utérus. Ainsi, le degré d’exigence a été fixé, non pas au moment où l’on dit que la vie existe, mais au moment où cette vie commence à avoir ou a une plus grande probabilité autonome. Et nous plaçons cette autonomie relative en 24 semaines. Depuis 24 semaines, nous continuons à entretenir les trois terrains. C’était le raisonnement et nous continuons d’insister sur le fait que les poursuites pénales ne sont de toute façon pas le meilleur moyen de protéger la vie ou la gestation.
BZ- Avec cette nouvelle réglementation, un très grand pas est franchi, mais pensez-vous qu’avec elle, l’avortement sécurisé est déjà garanti ? Je suppose que vous faites face à de nouveaux défis et à une vigilance particulière pour veiller au respect de la législation et, notamment, pour analyser de près la situation des femmes les plus vulnérables.
Luzia- Oui, nous célébrons la solution, mais nous savons que la disposition seule n’est pas une baguette magique qui change la réalité sociale, en particulier pour les femmes et les filles dans des contextes de plus grande vulnérabilité.
Maintenant, quels seraient les défis ? D’une part, la divulgation de cette décision. Que la sentence soit connue dans les régions rurales du pays. Qu’ils le sachent, tant les prestataires de soins que les femmes. Pour nous qui vivons dans la capitale Bogotá, c’est facile de se renseigner là-dessus, mais un prestataire de santé qui fait des brigades de santé dans les villes, qui sont périodiques, c’est plus compliqué. Ces prestataires doivent donc s’imprégner de cette résolution, la faire connaître et la transmettre aux femmes et aux filles. Qu’ils sachent que c’est un droit qu’ils ont maintenant, qui n’est pas conditionné, dans les 24 semaines.
La Cour a également appelé le Congrès à réglementer de manière exhaustive les droits sexuels et reproductifs. Pas seulement l’avortement, mais un meilleur accès aux contraceptifs, comment prévenir les grossesses non désirées, comment garantir une maternité sans risque. Aussi, dans l’autre sens, quelle couverture va être accordée aux femmes qui souhaitent exercer des contrôles de maternité, prénatals… Et que les choses se réalisent, est également un défi important.
Un autre défi en Colombie qui empêche malheureusement un meilleur accès, par exemple, aux services de santé, aux services de justice, c’est le conflit armé. Bien que nous ayons eu beaucoup d’espoir et que les accords de paix aient été signés, nous devons continuer à travailler pour la mise en œuvre de ces accords, en particulier là où il y a des territoires contrôlés par la violence armée. Inévitablement, cela passe par l’extension des accords de paix, mais aussi par la connaissance, avant tout, où se trouvent les femmes les plus vulnérables. Vous n’avez même pas besoin d’aller dans des endroits éloignés de la capitale, mais la capitale elle-même a aussi cette zone périphérique où il y a beaucoup d’inégalités sociales. Où l’accès aux services de santé est assez précaire. Nous devons donc prendre cette décision là-bas et commencer à l’appliquer.
Traduction NCS
***
Bégona Zabala est une activiste féministe basque de Emakume Internazionalistak. Membre du conseil consultatif de la revue Viento sur. Auteure d’articles sur le féminisme, avec une référence particulière à l’intervention dans le mouvement : violence masculine, droits des femmes, judiciarisation, maternité. Elle est l’auteure du livre publié pour le 40e anniversaire des événements de Sanfermines 78 : “Feminismo, transición y sanfermines del 78”.
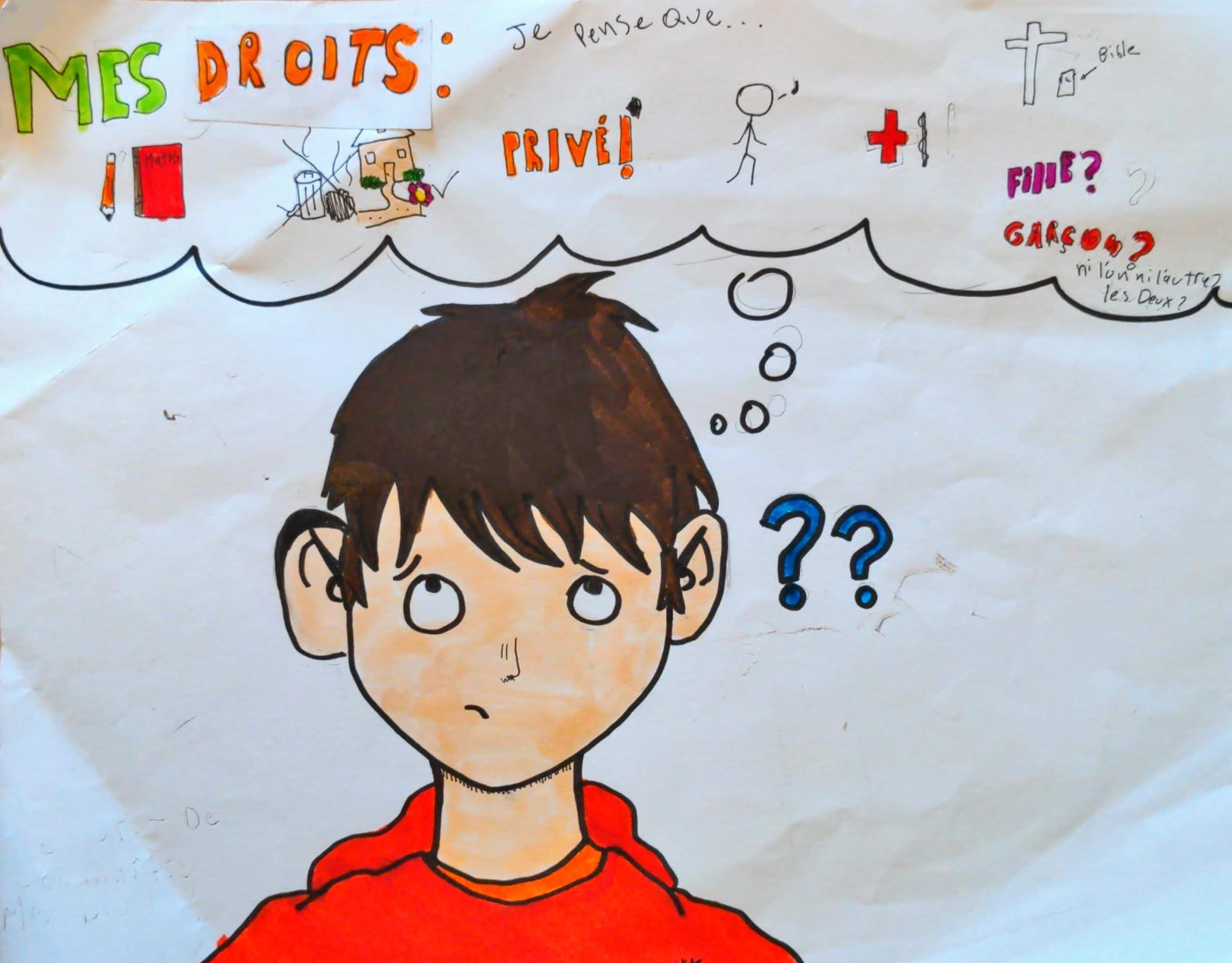
Évaluer les répercussions sur les droits de l’enfant : Une mesure importante de la Convention
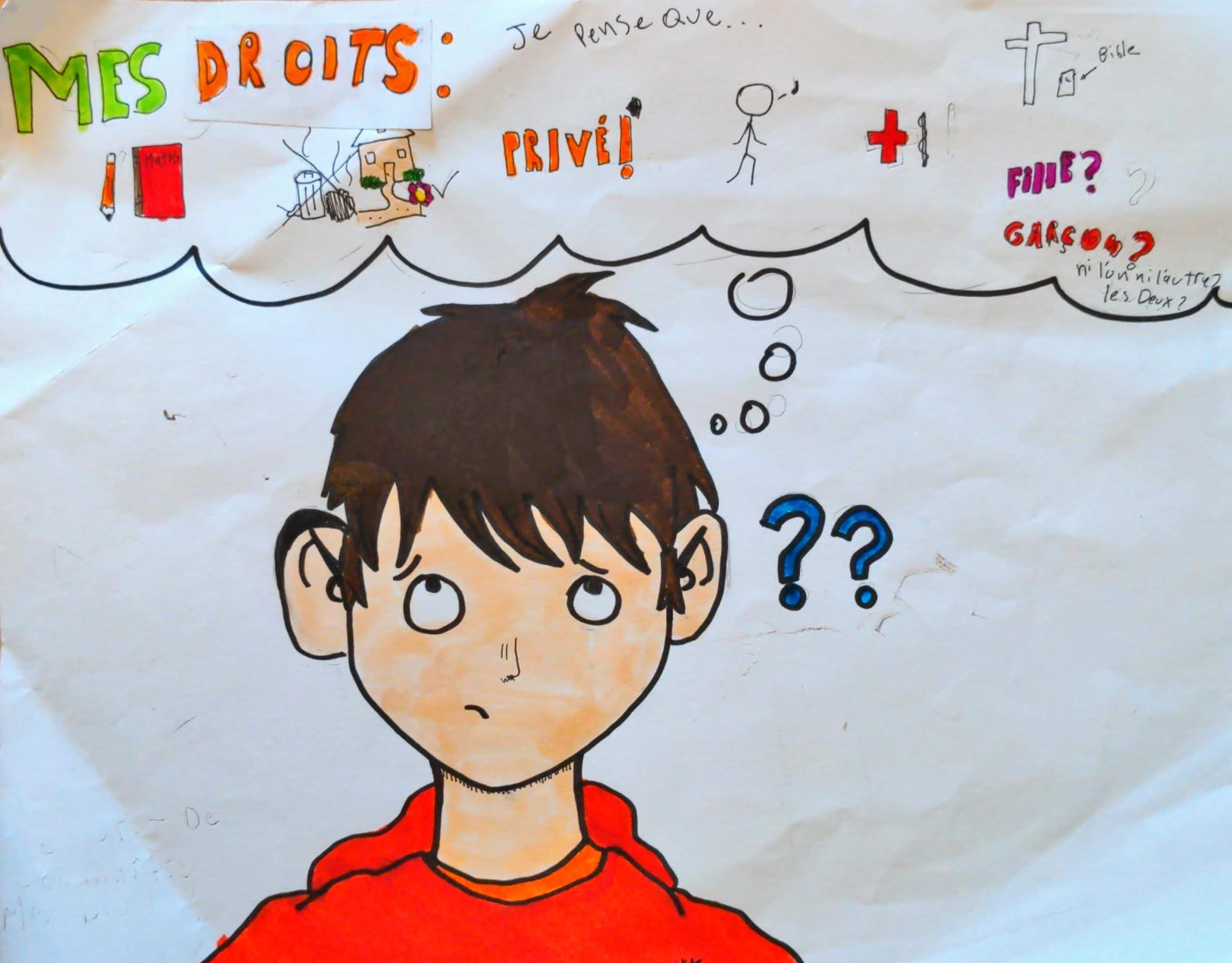
Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, aut. 2021/hiver 2022
Christian Whalen et Clara Bataller, Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) assure une protection et une promotion des droits des enfants, que les États se sont engagés à respecter. Les évaluations des répercussions sur les droits de l’enfant (ERDE) apparaissent alors indispensables, en représentant l’outil complémentaire permettant de rendre les enfants visibles dans le processus de prise de décision des gouvernements. Néanmoins, le manque de suivi et de révision de ces évaluations peut engendrer des impacts conséquents pour les enfants et leurs droits.Évaluer les impacts
La Convention relative aux droits de l’enfant a permis de reconnaitre les enfants comme des personnes ayant des droits et des besoins spéciaux à travers 42 droits fondamentaux. Adopté en 1989 par l’ONU, elle est le premier instrument à avoir apporté des changements quant à leur protection, en les considérant comme des participants actifs dans leur propre vie et dans la société. Mais proclamer ces droits est bien plus facile que de les faire respecter. Le Comité des droits de l’enfant énonce au commentaire général no 5 une série de mesures générales d’application de la Convention. Parmi ces mesures se trouve la recommandation d’adopter des évaluations des répercussions (ou des impacts) sur les droits de l’enfant (ERDE) dans les processus décisionnels d’adoption ou de modification des lois, règlements, politiques et programmes de l’État. [caption id="attachment_12514" align="aligncenter" width="458"]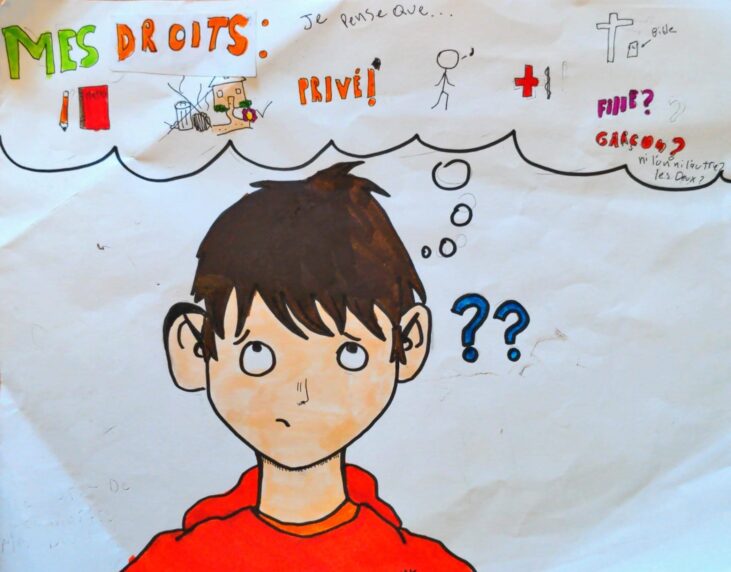 J'ai le droit de connaître mes droits, Étienne Riverin, 10 ans[/caption]
J'ai le droit de connaître mes droits, Étienne Riverin, 10 ans[/caption]
Visibiliser les enfants
Les ERDE sont des outils permettant d’évaluer les impacts potentiels d’une politique ou d’une décision particulière sur les enfants et leurs droits. Les enfants étant particulièrement vulnérables, ils peuvent être affectés de manière disproportionnée lorsque des décisions s’appliquent aux services publics dont ils disposent, tels que l’éducation et la santé. Les ERDE permettent donc de mettre en pratique la CDE, et son principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une manière concrète et structurée. L’objectif est d’améliorer leur mieux-être en complétant la qualité des informations mises à la disposition des décideurs, afin de rendre les enfants visibles dans le processus de prise de décision1.Participation des enfants
Les impacts révélés par ces évaluations peuvent être aussi bien intentionnels qu’involontaires, directs ou indirects, et à court ou à long terme. Les ERDE aident à maximiser les impacts positifs tout en réduisant ceux qui sont négatifs, y compris l’identification des conséquences négatives involontaires des propositions. Elles assurent également la transparence des décisions, tout en veillant à la responsabilité des décideurs vis-à-vis des décisions prises.Elles reconnaissent l’enfant comme titulaire actif de droits plutôt qu’en tant que bénéficiaire passif de mesures, bienveillantes ou non, prises par des adultes, et encouragent la participation des enfants à l’exercice d’évaluation.Enfin, elles prennent soin de veiller spécifiquement aux répercussions sur des sous-populations d’enfants ou de jeunes particulièrement à risque2. Selon le guide d’introduction des ERDE pour le Nouveau-Brunswick, au Canada, les évaluations correctement réalisées permettent de prévenir les décideurs des conséquences de leurs décisions, offrant la possibilité d’atténuer les torts potentiellement existants. De ce fait, l’utilisation de l’ERDE améliore la qualité des décisions de politique publique et contribue à de meilleurs résultats pour les enfants dans le cadre de la CDE.
Une pratique à implanter
Par ailleurs, le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant recommande régulièrement leur utilisation à l’ensemble des pays ayant ratifié la CDE, soit 196, afin d’évaluer les impacts de toutes les décisions relatives aux enfants dans le monde3. Ces évaluations doivent être entreprises au niveau national, régional et local, avec des changements organisationnels ou administratifs à tous les niveaux de la société.Le processus d’évaluation n’est pas récent. Il a fait ses preuves depuis ses débuts en Flandre, il y plus de vingt ans.Par la suite, le modèle a été adopté par d’autres pays du nord de l’Europe et du Commonwealth. En Amérique du Nord, les ERDE ne sont que très peu utilisées, les États-Unis étant la seule nation au monde à ne pas avoir ratifié la CDE. Parmi toutes les expériences des États, on peut déceler deux grandes tendances : i) une approche qui favorise un contrôle a priori des lois et des politiques proposées par un contrôle interne des décideurs eux-mêmes (Flandre, Pays de Galles, Nouveau-Brunswick) ; et ii) une approche qui favorise un contrôle a posteriori des lois proclamées par un organisme indépendant de défense des droits de l’enfant (Royaume Uni, Écosse, Australie).
Le modèle du Nouveau-Brunswick
Depuis 2009, le Bureau du Défenseur du Nouveau-Brunswick a plaidé en faveur de l’adoption d’un outil ERDE par le gouvernement de la province. De premières discussions ont eu lieu avec le ministre de la Justice favorable au projet, mais c’est à l’occasion d’une réforme de la Loi sur les normes d’emploi par le ministère du Travail et de ses dispositions portant sur le travail des enfants que le projet a vraiment été entamé. Des rencontres avec le Bureau du conseil exécutif ont eu lieu et le feu vert a été donné à l’établissement d’un comité interministériel avec le mandat de i) créer un outil ERDE pour les décisions du conseil des ministres ; ii) proposer un programme de formation pour l’adoption de l’outil ; et iii) identifier un mécanisme d’évaluation de l’outil. Les clés du succès de la démarche au Nouveau-Brunswick ont été : i) de faire valider le projet par le Bureau du conseil exécutif ; ii) d’avoir la codirection du projet par ce Bureau et par un expert indépendant en droits de l’enfant tel le Bureau du Défenseur ; iii) d’avoir l’appui et l’expertise technique d’UNICEF Canada, tout au long du projet ; iv) d’avoir développé un outil fonctionnel mais relativement simple ; et v) d’avoir investi suffisamment au départ dans la formation des cadres et des coordonnateurs législatifs des ministères. Le fait que le gouvernement du jour venait d’adopter un outil semblable pour les personnes handicapées à contribuer au plaidoyer en faveur des enfants. Mais l’outil ERDE a rehaussé la barre et a conduit éventuellement à l’adoption d’un meilleur outil d’analyse selon les genres et d’un nouvel outil pour les personnes handicapées. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est donc, depuis 2013, la première administration en Amérique du Nord à avoir adopté un processus obligatoire d’ERDE pour toutes les décisions du Conseil des ministres, l’organe décisionnel central du gouvernement. Ces ERDE ont largement contribué à un changement de culture naissant en faveur des droits de l’enfant et des approches fondées sur les droits. Chaque mesure générale d’application de la CDE est renforcée lorsqu’elle est opérationnalisée en complémentarité avec d’autres mesures générales d’application. C’est le constat des efforts au Nouveau-Brunswick. Depuis dix ans déjà, la province appuie les efforts de formation des cadres et de la fonction publique en droits de l’enfant. De plus, il existe une stratégie provinciale pour mettre en œuvre le droit de l’enfant d’être protégé contre toute forme de violence. Un travail plus rigoureux est fait depuis 15 ans en lien avec la collecte de données et le partage, l’analyse des données et des indicateurs d’applications des droits de l’enfant. L’outil ERDE de la province renvoie l’analyste des programmes chargé de faire l’ERDE au rapport annuel de l’état de l’enfance afin que l’évaluation des répercussions se fasse à la lumière de données probantes. Ces outils se complètent et l’approche fondée sur les droits est renforcée de façon réciproque.L’expérience néo-brunswickoise démontre que la plus-value d’une approche ERDE par un contrôle a priori interne au gouvernement permet aux décideurs de s’autoresponsabiliser face à leurs engagements envers les enfants.Mais une approche n’exclut pas l’autre. Un meilleur contrôle est possible si l’on conjugue un contrôle a priori par l’administration avec un contrôle a posteriori rigoureux par un bureau du Défenseur. Au Nouveau-Brunswick, des premiers pas prometteurs sont faits en ce sens4. Aussi la pratique sera d’autant plus renforcée lorsque l’approche ERDE sera répandue à différent paliers de gouvernements, locaux et fédéraux5, au secteur à but non lucratif ainsi que dans le monde des affaires.
La responsabilité des élu-e-s
Le premier pas pour le Nouveau-Brunswick sera de veiller à ce que les ERDE soient pleinement intégrées à la charge ministérielle et dans l’élaboration des programmes et politiques internes des agences et ministères comme cela se fait aujourd’hui en Écosse. L’amélioration continue des efforts investis dépendra en grande partie par la reprise de travaux interministériels afin de valider et parfaire le processus des ERDE et de faire progresser cette mesure générale d’application de la CDE. Les ERDE sont un puissant mécanisme pour structurer et opérationnaliser l’engagement de l’État envers les droits des enfants, il peut aussi devenir un important vecteur de cet engagement, mais il s’en faut toutefois que les élus veuillent respecter les droits des enfants.- UNICEF Canada, Évaluations d'impact sur les droits de l'enfant : les principes fondamentaux par Unicef Canada pour le Comité sénatorial permanent des droits de la personne, 3 février 2014.
- Suzanne Williams, Mary Bernstein, et al, 2015, Trousse d’outils sur les droits de l’enfant, Association du Barreau Canadien, Canadian Bar Association - Évaluations des répercussions sur les droits de l’enfant (ERDE) (org).
- Louise Sylwander, 2001, Évaluations d'impact sur les enfants : Expérience de la Suède des analyses d'impact sur les enfants en tant qu'outil de mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, par le ministère de la Santé et des Affaires sociales et le ministère des Affaires étrangères, Suède.
- Défenseur des enfants et de la Jeunesse, Évaluations des répercussions sur les droits de l’enfant : Guide d’introduction pour le Nouveau-Brunswick.
- Justice Canada élabore présentement un outil à l’usage du ministère qui sera assortie d’un guide et d’une formation en ligne disponible à tous.
L’article Évaluer les répercussions sur les droits de l’enfant : Une mesure importante de la Convention est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Recension du livre de François Moreau, Le développement international des banques canadiennes.

Enfin un livre sur l’activité extérieure des banques canadiennes. Rares sont les études qui s’intéressent à la dimension internationale de « nos banques». Certes W. Clenderning et P. Nagy ont publié des études sur l’activité internationale des banques, mais ces documents ne couvrent que la période d’après 1960 et sont très descriptifs. D’autre part Tom Naylor et Jorge Niosi ont aussi exploré ce domaine dans une dimension plus large. Leurs réflexions axées sur le concept de capital financier canadien ont porté sur une période historique plus réduite, dans le cas de Naylor, ou sur les firmes multinationales canadiennes, autres que les banques, pour Niosi. François Moreau est le premier à publier un livre sur l’histoire de l’activité internationale des banques canadiennes, de l’origine à nos jours, et à confronter ce développement aux modèles théoriques existants. La tâche était ambitieuse et non sans difficultés, surtout en si peu de pages.
L’ouvrage recouvre donc une dimension théorique et une dimension descriptive. Cette deuxième partie nous apporte des informations abondantes et pertinentes qui devraient nous permettre de tester la validité des différents modèles théoriques sur l’inter nationalisation des banques appliqués au cas canadien. L’analyse théorique est sans doute la partie qui soulève le plus d’interrogations. La présentation, sur laquelle nous reviendrons, des différents modèles expliquant le processus d’internationalisation des banques est claire et pédagogique. Là n’est pas le problème. Ce qui m’apparaît plus difficile c’est l’utilisation de l’expérience canadienne pour valider ou non les modèles, puisque tel est le but de l’auteur.
Tous les modèles présentés ici présupposent que l’internationalisation des banques doit être étudiée à partir d’entités nationales politiquement et économiquement bien définies, ayant atteint une certaine maturité dans le•.ir développement économique (saturation des marchés, concentration). Le Canada d’avant 1914 ne répondait certainement pas à cette prémisse, l’on ne peut donc pas légitimement utiliser le XIXe siècle canadien comme source empirique pour rejeter certains de ces modèles. L’utilisation de ces modèles ne devient pertinente que pour la période d’après 1945.
La première vague d’internationalisation des banques dites canadiennes ne reposait pas sur des phénomènes propres à l’économie canadienne: formation d’un· capital financier national ou saturation d’un secteur bancaire oligopolistique. La création des premières banques au Canada était d’abord destinée au financement du commerce international, pas celui du «Canada» mais de celui de la Grande-Bretagne.
Il y a sans doute pas de hasard, si les banques canadiennes furent créées aux lendemains de la bataille de Waterloo et au début des années 1820. Cette période, après la crise de «reconversion » qu’a connue la Grande-Bretagne, fut marquée par une forte expansion commerciale. L’indépendance des pays latino américains, la forte croissance des États-Unis permirent l’ouverture de nouveaux marchés d’importance. L’essor des exportations bri tanniques vers le nouveau monde, financées par des emprunts contractés à Londres, amena la création en Grande-Bretagne, de même qu’au Canada, de nombreuses sociétés financières. La Banque de Montréal, puis les autres banques furent des banques britanniques créées dans une colonie pour faciliter avant tout le commerce entre l’Angleterre et les États-Unis, accessoirement entre l’Angleterre et le Canada. Le système bancaire canadien en formation était un prolongement, une branche, du système britannique. Les « merchant banks» du Canada, comme celles de Londres, vont participer au financement du commerce mondial dès leur création. Ce financement n’est pas celui de banques coloniales, les banquiers canadiens étaient de fait des britanniques. Leurs liens avec des « maisons» anglaises le prouvent.
L’internationalisation des banques canadiennes, jusqu’au tournant du siècle, doit être analysée comme celle de banques anglaises et aussi comme celle de banques américaines et non comme l’internationalisation de banques du Canada, puissance économique en pleine maturité, même secondaire, comme le fait l’auteur. François Moreau souligne bien sûr la situation exceptionnelle de ces banques établies au Canada qui ont su tirer profit à la fois de l’Empire et des États-Unis (p. 66), mais leur internationalisation ne correspondait pas à l’évolution d’un capital financier canadien. Il n’y a pas de parallèle entre le déploiement extérieur des banques et le développement économique du Canada jusqu’aux années 1920-1930 dans le sens des prémisses des modèles. La deuxième vague après 1960 sera plus conforme.
Les modèles théoriques étudiés sont regroupés en trois familles de pensée. La première lie le développement de l’activité inter nationale des banques à la croissance du commerce mondial. Cette thèse trop mécanique n’a aucune valeur explicative et à juste titre est jugée insatisfaisante. La deuxième famille regroupe trois théories: celle des avantages oligopolistiques, celle de la réaction oligopolistique et celle du cycle du produit. Dans les trois cas il s’agit d’appliquer au secteur bancaire l’analyse de la firme sur l’investissement à l’étranger. Une des hypothèses ici est la concentration du secteur dans le pays d’origine, il s’agit donc de modèles très contemporains. Si l’on exclut les faits du siècle dernier, la critique de François Moreau n’atteint alors son but que pour la théorie du cycle du produit. Ce qui est l’essentiel car les deux autres membres de la famille ne sont pas de véritables théories, mais plutôt des «auxiliaires» utiles pour des théories plus globales. En oubliant le XIXe siècle, l’auteur nous montre bien la faiblesse de ces théories pour expliquer le processus d’internationalisation des banques, surtout que ces modèles sont «des extrapolations abusives du cas des États Unis» d’après-guerre.
La dernière famille de pensée est l’approche marxiste. Malheureusement l’auteur la limite aux auteurs «classiques» , particulièrement Hilferding et Lénine, négligeant les avancées récentes, entre autres celles de W. Andreff et O. Pastré. Pour les banques canadiennes ce modèle ce heurte aussi au problème du XIXe siècle canadien. François Moreau nous expose bien le modèle de ces auteurs classiques et souligne la nécessité de la centralisation, de la concentration et même de la cartellisation pour qu’il y ait exportation de capital industriel et bancaire (pp. 32 à 39). L’économie canadienne d’avant 1914 n’avait pas ces caractéristiques.
F. Moreau contourne la difficulté en parlant du Canada comme « impérialisme secondaire» (p. 65); vraiment c’est vouloir absolument sauver le modèle. D’ailleurs le modèle marxiste classique, contrairement aux autres, est peu confronté à l’expérience canadienne dans ce livre. L’auteur refuse de voir que le modèle d’Hilferding est difficilement applicable au Canada non pas uniquement par la non maturité de l’économie canadienne, mais surtout par la nature différente des banques canadiennes, essentiellement commerciales et non d’affaires comme les banques européennes analysées par Hilferding.
Certes l’analyse marxiste est l’instrument le plus puissant pour expliquer le processus d’internationalisation des banques, mais le modèle des auteurs classiques avec son concept de capital financier, fusion organique du capital industriel et du capital bancaire, recouvre une autre réalité que celle du Canada, du XIXe ou du xxe siècle. Il faut découvrir ou inventer un nouveau modèle, ce que ne fait pas F. Moreau.
Malgré certaines faiblesses théoriques ce livre demeure un jalon important dans l’élaboration d’un modèle théorique capable de tenir compte de l’expérience bancaire canadienne.
Bernard Elie, Université du Québec à Montréal
François Moreau, Le développement international des banques canadiennes, Montréal, éd. Saint- Martin, 1985, 159 p.
URI: http://id.erudit.org/iderudit/040541ar DOI: 10.7202/040541ar
Politique, n° 10, 1986, p. 137-141.
Note : les règles d’écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir.
Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter à l’URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d’édition numérique de documents scientifiques depuis 1998.
Pour communiquer avec les responsables d’Érudit : info@erudit.org

L’immigration à l’ombre de la pandémie

Entrevue avec John Shields[1]
Au Canada, face à la pandémie de COVID-19, les autorités publiques ont lancé toute une gamme de programmes pour soutenir différents segments de la population, l’économie, les systèmes de santé, les gouvernements locaux et beaucoup plus. Cependant, ces interventions n’ont pas eu les mêmes effets pour tout le monde. Trop d’immigrantes et d’immigrants ont été exclus des programmes de soutien, même si les populations immigrantes ont des taux de chômage plus élevés et une fragilité financière accrue en raison de la pandémie. D’autre part, il s’est avéré que les immigrants ont été plus à risque de contracter le virus vu leurs types d’emploi, leur dépendance à l’égard du transport public et leur résidence dans des quartiers densément peuplés. Enfin, la fermeture des frontières a eu de graves conséquences, notamment envers les demandeurs d’asile provenant des États-Unis, sans compter les dizaines de milliers de personnes en attente d’un visa d’entrée à titre d’immigrants ou de réfugiés.
P.B. – On dit souvent que la pandémie a révélé des défaillances structurelles dans le système canadien, notamment en ce qui concerne les populations immigrantes…
J.S. – Pour moi, la situation très pénible vécue par des immigrants et des immigrantes est la conséquence des transformations structurelles du capitalisme et de l’État au Canada, transformations qu’on associe généralement au projet néolibéral. Pendant des décennies, le système de santé, notamment, a été affaibli, privatisé en partie, comme on l’a vu pour les CHSLD[2]. La sécurité des citoyens a été érodée. Tout le monde a été affecté, mais les plus vulnérables l’ont été davantage. Les immigrants l’ont été de manière disproportionnée. À Toronto, on a établi cette situation de manière précise en comptabilisant les personnes malades et contaminées selon leur code postal. On a ainsi pu démontrer que le taux d’infection pour les populations immigrantes était deux fois supérieur à la moyenne.
P.B. – Comment expliquer ce grand écart ?
J.S. – Il y a d’abord les conditions de travail dans les créneaux d’emploi occupés par les immigrantes et les immigrants, comme la santé, les services domestiques, la restauration, les entrepôts, la transformation alimentaire, l’agriculture. Dans ces secteurs, la distanciation sociale est quasiment inapplicable. Ce sont les immigrants qui composent le gros des effectifs dans les emplois « 3-D » (dangerous, dirty, difficult). Il faut ajouter la situation du logement car beaucoup d’immigrants habitent des domiciles surpeuplés, ce qui rend la vie difficile à ceux et celles qui doivent travailler à la maison. Selon Statistique Canada, deux fois plus de personnes noires que de personnes blanches sont décédées des suites de la COVID.
P.B. – S’ajoutent la précarité et la mobilité…
J.S. – Les politiques néolibérales ont amené les employeurs, publics comme privés, à limiter l’accès à des emplois permanents et à ouvrir, au nom de la flexibilité, le travail à forfait, souvent par l’intermédiaire d’agences avec lesquelles les liens contractuels sont minimes. Les gens, on le voit, sautent d’un emploi à l’autre, d’un endroit à l’autre, dans des conditions qui ont favorisé des éclosions lors de la première phase de la pandémie. Cette situation frappe les personnes à bas revenus de toute origine, mais une majorité d’immigrantes et d’immigrants racisés se trouve dans cette catégorie.
P.B. – C’est donc moins un dispositif qui discrimine les immigrants que la surexploitation qui frappe des secteurs de la classe ouvrière…
J.S. – Il y a la discrimination qui s’exerce « naturellement », car ce sont les immigrantes et les immigrants qui sont au bas de l’échelle, mais dans les conditions actuelles, ils sont pénalisés par toutes sortes de facteurs, dont la non-reconnaissance des diplômes, l’expérience dite « canadienne » qui leur fait défaut, les difficultés d’apprentissage linguistiques. La plupart du temps, cela leur prend beaucoup de temps pour se sortir du cercle vicieux des jobs « 3-D » et de la précarité. Selon Statistique Canada, les travailleurs qui sont ici depuis cinq ans représentent environ 3 % de la main-d’œuvre totale, mais ils ont constitué 21 % de celles et ceux qui ont été licenciés. Plus de la moitié des pertes d’emploi ont frappé les bas salarié·e·s (16 dollars de l’heure et moins) dans la vague de licenciements qui a suivi la fermeture partielle de l’économie à partir de 2020.
P.B. – La COVID a aggravé tout cela…
J.S. – Plus de 500 000 immigrants et immigrantes n’ont pas eu accès aux subventions salariales ! Plusieurs n’avaient pas occupé un travail salarié assez longtemps. D’autres n’ont pas leurs documents en règle, donc pas de numéro d’assurance sociale. Les dizaines de milliers de sans-papiers évidemment n’existent pas dans ce système. Des milliers d’étudiantes et d’étudiants étrangers ayant un statut temporaire étaient également exclus de la prestation canadienne d’urgence (PCU)[3].
P.B. – Et il y a eu la fermeture des frontières…
J.S. – Les premières restrictions ont été imposées en mars 2020 par le gouvernement fédéral. Les personnes demandeuses d’asile et les réfugié·e·s se sont retrouvés dans l’impossibilité d’entrer au Canada. Des centaines de personnes ont été renvoyées aux États-Unis. Et il y a au pays plus de 30 000 personnes en attente d’une décision concernant leur statut.
P.B. – Les travailleuses et les travailleurs dits temporaires, à forfait, sont encore plus fragiles…
J.S. – Le fait que leur travail est lié officiellement à un employeur particulier et qu’ils n’ont pas le droit de changer d’emploi constitue le pilier d’un système très dur où ces travailleurs n’ont pas le choix d’accepter les conditions souvent misérables qu’on leur offre. La situation des travailleurs agricoles qui habitent des roulottes à quatre ou huit par chambre, payés au salaire minimum, est connue. Dans les usines de transformation alimentaire, la COVID a frappé très fort comme dans l’usine de Cargill High River en Alberta (qui produit 40 % de la viande consommée au pays) et où les taux d’infection ont été considérables. Personne d’autre au Canada n’accepterait cela, mais eux, ils n’ont pas le choix.
P.B. – C’est un système qui fonctionne « bien » pour le capitalisme néolibéral ?
J.S. – Les travailleurs sous étroite surveillance peuvent difficilement résister, même si certains le font. Également, la fonctionnalité de ce système consiste à garder le prix des aliments au plus bas niveau, ce qui fait rouler toute l’économie…
P.B. – Quels sont les points de friction ?
J.S. – Régulièrement, il y a des campagnes pour mobiliser les secteurs vulnérables comme les travailleurs temporaires. Les résultats sont mitigés, compte tenu des conditions qu’on a évoquées plus haut. Il faut noter également la montée d’un discours populiste de droite, qui cible davantage les immigrants racisés et qui empoisonne l’atmosphère dans certains quartiers « chauds » de la périphérie de Toronto. On entend de plus en plus dans les médias de droite un discours qui présente les immigrants et les immigrantes comme une menace qui met en péril notre « sécurité ». Ce problème a particulièrement affecté les communautés originaires de l’Asie de l’Est, pointées par les médias comme porteuses du « virus chinois ».
P.B. – Qu’est-ce qui s’en vient maintenant ?
J.S. – La pandémie et ses nombreuses séquelles vont perpétuer une situation de peur et de tensions. Il est possible que le tournant vers la droite s’accentue par des mesures austéritaires qui vont frapper davantage les plus vulnérables. D’un autre côté, beaucoup de gens ont pris conscience que l’affaiblissement des programmes sociaux pendant 20 ans de néolibéralisme n’était vraiment pas une bonne idée. Ils ont vu le gouvernement sortir des milliards de dollars alors qu’on nous disait que l’État ne pouvait pas payer. Il y a des secteurs importants de la population qui estiment que la source du problème relève du néolibéralisme, et non pas d’une « catastrophe microbienne » imprévisible.
P.B. – Qu’est-ce qui peut être fait à court terme ?
J.S. – Il est évident que les travailleuses et les travailleurs du soin (care), dont celles et ceux en première ligne dans les établissements de santé et regroupant un grand nombre de travailleurs immigrants, doivent être mieux traités. L’obtention d’un emploi stable rattaché à un employeur identifié doit remplacer le système actuel des agences. Il en va de même pour les travailleurs temporaires. Quant aux demandeurs d’asile et aux nombreuses personnes qui sont sans-papiers, la moindre chose est d’ouvrir les portes du pays et de régulariser leur statut.
Pierre Beaudet, rédacteur aux Nouveaux Cahiers du socialisme
- John Shields est professeur à l’Université Ryerson de Toronto. En 2021, il a publié avec Zainab Abu Alrob, doctorante à l’Université Ryerson, un rapport sur les migrations et le système d’immigration canadien : COVID-19, Migration and the Canadian Immigration System. Dimensions, Impact and Resilience. Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’un projet de l’Université York, Immigration et résilience en milieu urbain, IRMU, appuyé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. On retrouvera le rapport complet, en anglais, à : https://bmrc-irmu.info.yorku.ca/files/2020/07/COVID-19-and-Migration-Paper-Final-Edit-JS-July-24-1.pdf?x82641. L’entrevue a été réalisée le 2 septembre 2021. ↑
- CHSLD : centres d’hébergement de soins de longue durée. ↑
- Il y avait en 2019 plus de 640 000 étudiantes et étudiants étrangers dans les établissements d’éducation, dont près de 200 000 occupaient un emploi. ↑

Rapport de classe et obstacles économiques à l’association1

Dès sa création, le PQ, sous la direction de René Lévesque, délaisse le discours traditionnel de l’indépendance pour adopter le projet de souveraineté-association. Le tiret entre « souveraineté » et « association » n’est pas fortuit. Il reflète un projet distinct, comme l’explique une brochure du Centre de formation populaire : « Alors que l’indépendance signifie une rupture importante dans le système politique institutionnel canadien et implique une modification fondamentale des rapports de classes au Québec et au Canada, le projet de souveraineté-association vise à un réaménagement des rapports dans le cadre d’une continuité du système constitutionnel (…) Le projet implique une renégociation des rapports entre les diverses fractions de la bourgeoisie au Canada et au Québec. Les protagonistes principaux du projet, que représente le PQ, sont constitués par une alliance entre diverses fractions bourgeoisies et petites-bourgeoises (qui) désirent aménager de façon différente leur présence au sein du capitalisme nord-américain en agrandissant l’espace politique et économique qui leur est actuellement dévolu tout en permettant une harmonisation des intérêts de la bourgeoisie nord-américaine (américaine, canadienne et québécoise) dans le cadre d’un système politique stabilisé »2.
Pour autant, ce projet rencontre l’hostilité des classes dominantes au Canada (et aux États-Unis). Celles-ci, on le verra lors du référendum, se sont liguées pour vaincre le PQ, ce qui peut sembler paradoxal. En réalité expliquent Lacroix (prof de sociologie à l’UQAM) et Levasseur (prof de sciences politiques à l’Université Laval), le projet « entre en conflit avec la tendance à l’expansion internationale du grand capital canadien, en menaçant de tronçonner ses bases arrière et en visant un changement qualitatif de l’intégration économique du Québec dans l’ensemble continental ». À ce problème s’en ajoute toutefois un autre. Pour gagner, le PQ a besoin d’un large appui des couches populaires qui espèrent que le changement de statut du Québec sera un pas en avant dans l’émancipation. Or, la direction du PQ qui ne veut pas un « grand » changement » craint de susciter l’enthousiasme populaire de peur de faire part aux dominants !
***
C’est donc un pari impossible à gagner, selon les deux auteurs qui prévoient avant tout le monde que le camp du oui perdra le référendum. Autre conclusion qui se dégage de leur analyse : à terme (après le référendum), le PQ va se replier sur un autonomisme provincial, ce qui exigera « d’isoler au sein du mouvement syndical et populaire, les forces de gauche et d’extrême gauche susceptibles de transformer les inévitables déceptions des classes dominées et subalternes en une protestation d’ensemble contre l’organisation des rapports politiques ». C’est ce qui surviendra dès 1982 au cours du deuxième mandat du gouvernement du PQ. D’une part, René Lévesque adoptera la stratégie dite du « beau risque » en négociant la constitution avec le gouvernement libéral et en s’appuyant sur le Parti conservateur enclin à une politique de décentralisation. D’autre part, il s’engagera dans un duel très dur avec le mouvement syndical en adaptant à la manière québécoise le programme néolibéral qui envahit l’Amérique du Nord des années 1980.
De l’affaire Riel à la crise des conscriptions, en passant par la querelle des écoles françaises à l’extérieur du Québec et par les événements d’octobre 1970, toute l’histoire du Canada est périodiquement ponctuée de crises d’unité nationale, tantôt ouvertes tantôt feutrées. Ces tensions permanentes sont en fait profondément ancrées dans les caractéristiques mêmes du modèle d’unification nationale sous-jacent à la formation de l’État canadien. L’unification politique des colonies britanniques s’opère ici, en effet, de manière essentiellement défensive, passive, graduelle et conservatrice, c’est-à-dire par à-coups, sans mobilisation populaire et sous l’impulsion et la direction quasi exclusives d’une poignée de grands marchands, de banquiers, de promoteurs de chemins de fer et de politiciens conservateurs qui n’ont alors pour seul objectif que de réorganiser, en étroite association d’ailleurs avec le capital britannique et le gouvernement impérial, les finances publiques des colonies afin de parachever la construction des infrastructures ferroviaires requises pour relancer leurs activités extractives et commerciales3. Expressément destinée à garantir institutionnellement l’hégémonie politique de cette bourgeoisie commerciale au sein du nouvel État national canadien, l’union fédérale édifiée en 1867 s’avère cependant extrêmement instable et fragmentaire, c’est-ã-dire travaillée du dedans par un ensemble complexe de contradictions et de conflits touchant d’une part ã la répartition des juridictions et des compétences entre le fédéral et les provinces, et d’autre part ã la préservation des particularités linguistiques, culturelles et territoriales des Québécois, des Métis, des Amérindiens et Inuits, et des minorités francophones hors Québec4. Il ne faut pas oublier bien sûr de parler des contradictions et des conflits, qui dérivent dès l’origine de l’inégal développement entre les diverses régions du nouveau pays. Gérés tantôt par voie coercitive, tantôt par voie de compromis et de concessions (le plus souvent selon ces deux voies simultanément), ces multiples contradictions et conflits ne débouchèrent toutefois jamais sur une modification profonde des rapports de domination sous-jacents à la formation et au développement de l’État national canadien5.
L’arrivée au pouvoir du PQ déclenche en revanche une crise d’unité nationale autrement plus aigüe, car les conflits et les contradictions qui sont à la source de l’actuelle crise canadienne ne peuvent manifestement être gérés et résolus, de manière stable, qu’au prix d’une transformation substantiel – celui de la structure de domination nationale mise en place en 1867. Ceci ne signifie évidemment pas que le Canada soit inévitablement appelé à disparaître en tant qu’espace national distinct. Simplement, cela peut suggérer que la résolution de la présente crise de l’unité canadienne passe de façon obligée par une profonde restructuration des rapports de domination nationale articulés historiquement à la formation du Canada comme État-nation. Cette restructuration pourrait revêtir des formes extrêmement diverses, allant de l’indépendance pure et simple du Québec à l’occupation militaire prolongée de la province et à la répression systématique du mouvement indépendantiste (le tout accompagné d’une politique de centralisation autoritaire des pouvoirs au niveau du gouvernement fédéral), en passant par la souveraineté-association du Québec ou par un fédéralisme fortement décentralisé, etc. Le choix de l’une ou l’autre de ces stratégies de sortie de crise est finalement fonction de la configuration des rapports de classes et de l’évolution conjoncturelle des relations de force entre ces classes dans le champ politique.
En ce sens, l’issue de la crise actuelle ouverte par la victoire du PQ aux élections de novembre 1976 dépendra avant tout des rapports politiques entre les classes et fractions de classes constitutives de la société canadienne (étant entendu ici que le grand capital américain est directement représenté au sein du bloc au pouvoir par l’une de ces fractions). Ces relations de classes, aussi bien entre les diverses fractions de la classe dominante canadienne qu’entre celle-ci et les classes dominées/subalternes, constituant autant de réseaux d’obstacles venant peser sur l’adoption et la mise en oeuvre de ces diverses stratégies de réorganisation structurelle des rapports de domination nationale au Canada. Cependant, avant de procéder à l’analyse des obstacles qui s’opposent à la souveraineté-association comme forme spécifique de solution à la crise actuelle, un dernier mot concernant les fondements à la fois structurels et conjoncturels de celle-ci. C’est l’évidence même, le traitement de cette crise est directement fonction des contradictions structurelles et des problèmes conjoncturels qui sont à sa source. Si la présente crise de l’unité nationale
canadienne fut largement précipitée par la défaite électorale du Parti libéral et l’accession au pouvoir d’une formation politique qui n’a jamais caché son option souverainiste, elle a par contre ses racines dans un ensemble de tendances structurelles qui remontent en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale et, plus particulièrement, au début des années soixante. L’élection du 15 novembre devant être lue comme un événement particulier opérant une formidable condensation des contradictions et des conflits dérivant de ces tendances structurelles et des contre-tendances introduites pour les contrecarrer. Certes, il est impossible, dans les limites de ce texte, de rendre compte de l’ensemble des processus ayant concouru ã la genèse de l’actuelle crise. Aussi nous bornerons-nous ici ã énoncer quelques hypothèses de travail très générales qui, nous l’espérons, seront susceptibles de rendre intelligibles les coordonnées de cette crise.
Tendances structurelles à la base de la présente crise
La mise en question des rapports de domination nationale sous-jacents à la fondation de l’État canadien est, sans nul doute, liée directement à la renaissance et au développement, d’une ampleur extraordinaire, des luttes nationalistes (nationalitaires n’existe pas) au Québec depuis plus de 15 ans, c’est-à-dire de cet ensemble hétérogène de pratiques revendicatives visant à préserver la langue, la culture et le territoire d’un groupe social historiquement constitué comme nationalité distincte6. Certes, quand on a souligné l’importance de cette protestation nationaliste, l’on a dit quelque chose d’essentiel pour la compréhension de la genèse de l’actuelle crise d’unité nationale, mais il reste encore et surtout à rendre compte des conditions de formation et de développement de ces pratiques sociales conflictuelles. Ceci signifie concrètement cerner les tendances structurelles qui impulsent l’apparition, la formation, la transformation, la réactualisation et la prolifération de ces revendications nationalistes qui débouchent, à l’automne 1976, sur le ralliement de larges couches de la classe ouvrière et de la nouvelle petite bourgeoisie salariée urbaine, et de certaines fractions de la bourgeoisie, au PQ et à son projet de souveraineté-association.
Parmi ces tendances structurelles, deux nous apparaissent particulièrement décisives : l’accentuation des inégalités régionales de développement d’une part, et l’extraordinaire croissance de l’intervention des États provinciaux d’autre part. Ces deux tendances s’enracinent dans les caractéristiques du système des apports de classes défini par le nouveau modèle d’accentuation du capital graduellement mis en place après la fin de la Seconde Guerre mondiale au Canada.
Développement inégal et régionalisation de l’économie canadienne
Le développement inégal est un trait permanent du capitalisme canadien. Dès le lendemain de la formation de la Confédération, les provinces du centre (Ontario et Québec) se constituent en effet comme le pivot industriel et financier du pays et tout le système ferroviaire est d’ailleurs construit de manière à consacrer leur hégémonie économique. Cette tendance à l’inégal développement ne fera par.la suite que s’accentuer avec la mise en oeuvre, à partir de 1879, de la « National Policy » qui aura notamment pour conséquence d’institutionnaliser le fractionnement et l’éclatement du pays en plusieurs sous-champs régionaux se spécialisant tantôt dans l’extraction et l’exportation de produits naturels et de matières premières (Maritimes et provinces de l’Ouest), tantôt dans la production de biens de production et d’équipement (Ontario), tantôt enfin dans la production manufacturière de biens de consommation courante et dans l’extraction et la transformation primaire de certains produits naturels et matières premières (Québec)7.
Loin de corriger ces inégalités de développement, le nouveau modèle d’accumulation du capital mis en place après 1945 les approfondira considérablement. Défini par une croissance continue, rapide et quasi illimitée du surplus économique, ce modèle d’accumulation appelle en effet à une pénétration massive et systématique du capital américain qui va se loger dans les branches industrielles les plus productives et les plus stratégiques pour le développement économique du pays8. Cette pénétration du capital américain, sous forme d’investissements directs, débouche sur une continentalisation tendancielle de l’ensemble des processus de mise en valeur et d’accumulation du capital au Canada et elle a pour conséquence de brancher plus ou moins organiquement l’appareil productif canadien sur le champ industriel américain. À son tour, ce processus de continentalisation accélère et approfondit en fait la désarticulation du champ industriel canadien, précipite le déclin de l’axe économique est-ouest au profit d’un axe nord-sud, consolide la concentration de l’industrie lourde et technologiquement avancée dans le sud de l’Ontario et renforce la vocation traditionnelle du Québec comme aire de fabrication de biens de consommation courante et comme zone d’extraction et de transformation primaire de produits naturels et de matières premières.
Croissance et autonomisation des États provinciaux
Ce processus de fragmentation de l’espace national canadien est par ailleurs systématiquement alimenté et accentué, depuis la fin des années cinquante, par la tendance à l’autonomisation progressive des appareils d’État provinciaux par suite de l’accroissement considérable de leur champ d’intervention9. L’une des caractéristiques centrales du modèle d’accumulation intensive de capital qui émerge au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est en effet l’intervention désormais massive et permanente de l’État dans l’organisation, le programme nation et la régulation de la croissance du surplus économique, la logique étatique étant graduellement devenue la logique organisatrice dominante des rapports sociaux depuis 1945. Dans un premier temps, le gouvernement fédéral assumera l’essentiel de la responsabilité de ces nouvelles interventions étatiques, prenant notamment en charge la direction du processus de reconversion de l’économie de guerre.
Compte tenu toutefois que la plupart des domaines d’intervention en forte croissance (santé, sécurité sociale, éducation, formation/qualification de la force de travail, développement industriel, infrastructures routières, consommation collective) sont soit de juridiction exclusivement provinciale, soit de compétence partagée d’une part, et que la mise en valeur accélérée des ressources naturelles induit un fort accroissement des revenus des États provinciaux d’autre part10, ceux-ci sont progressivement amenés à jouer un rôle de plus en plus décisif, à partir de la fin des années 50, dans la régulation de l’accumulation du capital et dans la gestion/légitimation des rapports de classes qui en dérivent. Ceci ouvre la voie à une autonomisation croissante des États provinciaux à l’égard de l’État fédéral.
Ce renforcement des capacités d’interventions des États provinciaux soulèvera cependant un ensemble de nouveaux conflits touchant à la délimitation des domaines et compétences d’action de chacun des niveaux de gouvernement, et à la répartition des ressources fiscales requises pour en assurer le financement. Ces conflits sont particulièrement aigus au Québec où l’expansion quantitative et qualitative de l’action de l’État s’opère, en raison de la configuration spécifique du champ des rapports de classes et de l’organisation du système politico-administratif à la fin des années 50 et au début des années 60, avec une allure sans précédent et une stratégie unique au Canada11.
Contre-tendance à la fragmentation et conjoncture de crise économique et étatique
Ces tendances structurelles à la fragmentation et à l’éclatement économiques et politiques du pays furent cependant contrecarrées, du moins tendanciellement, par un ensemble d’initiatives politiques de l’État fédéral. Ces initiatives visaient, au nom de l’intérêt national, d’une part à corriger les inégalités régionales de développement, et d’autre part à coordonner et programmer la croissance des interventions des gouvernements
provinciaux, à amorcer la mise en place de nouveaux programmes nationaux, à redistribuer équitablement les ressources fiscales du pays entre les diverses provinces, et à associer institutionnellement les États provinciaux à la formulation ou à l’administration des grandes politiques nationales.
L’introduction par le gouvernement fédéral de ces contre-tendances destinées à s’opposer à la balkanisation du pays ne fit cependant, sur une longue période, qu’exacerber encore plus les tensions suscitées par le développement inégal des régions et l’autonomisation croissante des États provinciaux. Loin de réduire et de désamorcer la virulence des conflits politiques engendrés par ces tensions, ces contre-tendances eurent en effet pour conséquence de politiser davantage ces conflits et ces affrontements, de les systématiser, de les dramatiser et de les globaliser. Ainsi, l’actuelle crise de l’unité nationale canadienne est-elle le produit complexe de l’interaction entre ces tendances à la fragmentation économique et politique du pays, et des contre-tendances introduites pour colmater ces brèches ?
À partir des années 70, l’impact de cette interaction est considérablement accru par le développement d’une sévère crise économique se doublant d’une crise non moins profonde de l’action étatique. Ainsi, alors que les effets du développement inégal se font encore plus dramatiquement sentir que par le passé, à la suite de la progression du taux de chômage et de la fermeture de toute une série d’entreprises d’une part, et que les États provinciaux sont systématiquement appelés d’autre part à la rescousse du capital et contraints d’accroître leurs interventions de type « intégratif » afin de désamorcer les conflits sociaux au moment même où il leur faut par ailleurs rationaliser et planifier leurs actions et réduire leurs dépenses, l’État fédéral par contre est plus que jamais forcé à promulguer une politique d’ensemble de gestion de la crise et, par conséquent, contraint de renforcer la subordination institutionnelle des gouvernements provinciaux. Cette conjoncture de crise ayant pour effet d’alimenter considérablement les mouvements de revendication régionalistes et autonomiste, notamment au Québec où ils se greffent et s’articulent à un mouvement de contestation nationaliste extrêmement puissant. Ainsi, loin de constituer l’expression de la phase finale du combat séculaire d’une nation tronquée et humiliée luttant désespérément pour la reconquête de son identité perdue, l’accession au pouvoir du PQ en novembre 1976 est le résultat de la condensation d’une triple protestation (nationaliste, régionaliste et autonomiste) à la faveur d’une crise économique et étatique d’où le PQ tire sa force et sa faiblesse, sa capacité de mobilisation et ses contradictions de cette fusion à dominante de revendications nationalistes, régionalistes et autonomistes.
Souveraineté-association
À la lumière de ce que nous venons de dire du contexte dans lequel se fait l’arrivée au pouvoir du PQ nous comprenons l’importance du projet politique qu’il met de l’avant. Cependant, ce projet demeure relativement vague, du moins dans la composante association, ce qui ajoute aux hésitations, réticences et résistances qu’il rencontre. Avant de recenser et d’analyser ces obstacles, nous voulons identifier les caractéristiques spécifiques du projet souveraineté-association, ce qui permettra par la suite de mieux saisir la nature et l’interrelation des obstacles intérieurs et extérieurs au Québec que rencontre ce projet aux composantes contradictoires.
Pour faire cet essai de définition de la souveraineté-association, nous avons effectué une brève analyse de contenu du discours portant sur ce projet. Même si elle n’est pas exhaustive, cette analyse est toutefois suffisante pour nous permettre de saisir l’essentiel du projet et ainsi de pouvoir entrevoir, et ce, sans faire de spéculation indue, les obstacles se matérialisant à l’encontre de la souveraineté-association.
La souveraineté
La protestation du 15 novembre 1976 a un fondement objectif. En effet, les « performances » économiques du Québec étaient et sont encore loin d’être excellentes, tout particulièrement celles de l’industrie manufacturière12. Non seulement les perspectives n’étaient et ne sont pas brillantes dans l’immédiat, mais le futur n’était et n’est pas de meilleur augure étant dans la parfaite continuité de développement inégal des régions13 caractérisant toute l’histoire de la formation sociale canadienne, inégalité de développement jouant en faveur de l’0ntario et à propos duquel on accuse Ottawa de laisser faire ou d’accentuer le phénomène14.
Au cours des deux décennies précédentes et plus particulièrement au cours des années 1960 se développent au Québec plusieurs réactions au développement des inégalités régionales et à l’oppression nationale. Selon le PQ, le militantisme syndical, le coopératisme et la création d’entreprises d’État sont au Québec autant de réactions contre cet état de fait et manifestent: « (…) la volonté de rapatrier les centres de décision majeurs de l’économie et, en les rapatriant, d’en modifier l’organisation »15.
Du vieillissement de l’appareil de production, du morcellement de l’industrialisation, du chômage, de l’investissement non proportionnel à l’importance de la population, on accuse le gouvernement central, le gouvernement d’une nation étrangère. En somme, le PQ propose aux Québécois de « rapatrier la portion de leurs instruments collectifs de développement qui sont actuellement entre les mains d’un parlement et d’un gouvernement contrôlés majoritairement – et depuis le début par des gens différents, d’une autre nationalité »16. « Quant à la satisfaction des Canadiens vis-à-vis les structures politiques, on s’entendra sans peine pour dire qu’elle est loin d’être grande à travers le pays, mais que l’insatisfaction est surtout sentie et subie au Québec où la très grande majorité des habitants les rejettent dans leurs formes actuelles. Bien simplement, ces structures sont fondées sur deux principes : l’association des groupes humains concernés et l’inégalité entre ces groupes humains »17. Il s’agit donc, pour « corriger » la situation, de prendre le contrôle des instruments collectifs nécessaires pour pouvoir s’autogouverner, pour diriger son avenir collectif, pour organiser sa vie économique, sociale et culturelle18. Pour réaliser cet avenir collectif, il faut à cette nation un État moderne qui permettra ã ce peuple d’être enfin maître chez lui19 :
Pensons seulement à l’incroyable chantier collectif que constituera, pour des milliers de Québécois, l’organisation d’un État enfin cohérent. Cet État sera enfin doté de toutes ces compétences déterminantes qui nous échappent dans le cadre provincial alors qu’au niveau fédéral, notre place sera toujours minoritaire et en quelque sorte concédée aux coloniaux par les métropolitains de la majorité anglophone. Il jouera ce rôle de moteur central qu’un état remplit dans toute société contemporaine. Avec les charges immenses qu’il doit assumer, la puissance de ses instruments législatifs et la masse d’impôts qu’il perçoit (plus du tiers du produit national), seul un État fort de tous ces pouvoirs a les moyens de s’atteler aux tâches suprêmes de planification, d’animation et de coordination que requiert aujourd’hui le développement collectif 20.
Récupérer les centres de décisions et plus particulièrement en ce qui concerne le développement, cela veut dire récupérer la possession des moyens financiers21 et les centres de décision susceptibles de permettre de planifier, d’organiser le développement de la structure industrielle22. Cependant, cette récupération des centres de décision, cette
revendication d’autonomie n’en est pas une d’autarcie. Le PQ évoque l’impossibilité de vivre en vase clos23, et même l’impossibilité de briser la communauté d’existence avec cette nation canadienne-anglaise qui pourtant est étrangère à la nation québécoise :
Entendue comme la brisure d’une communauté d’existence, elle est d’ailleurs impossible et c’est la raison pour laquelle (…) les Québécois et les autres Canadiens doivent vivre ensemble sans qu’une séparation de corps soit possible d’aucune façon. Ils ont beau être différents, ils sont poignés pour cohabiter ensemble, pour être voisins sur le même bout de terre, entre deux océans24.
En fait, la séparation, la brisure, est impossible; l’autonomie ne peut être que relative. En fait, le projet de souveraineté, c’est l’intention du fédéral de récupérer, par et pour l’État québécois, une capacité d’intervention. Pourquoi une intervention ? Pour planifier, animer et coordonner le développement collectif25. Afin d’entrevoir les obstacles, il reste donc à savoir spécifiquement quels intérêts sont défendus et comment ils le sont par ce projet. Or, cela apparaît plus clairement dans le projet d’association, et ce, malgré le vague entourant la conception de cette partie du projet souveraineté-association.
L’association
Très peu de précisions ont été jusqu’ici apportées par le PQ à son projet d’association. Même si on affirme la nécessité de faire ces précisions26 et qu’on annonce des « révélations inédites » de M. Parizeau au prochain colloque des HEC, il reste que nous en sommes pour le moment réduits à des hypothèses. C’est forcément une limitation très importante à l’évaluation des obstacles que rencontre ou rencontrera ledit projet. Toutefois, nous pensons qu’en scrutant la conception qu’a le PQ du développement, il est possible de contourner cette limitation.
Si on se fie à certaines versions, l’association recherchée tient à l’impossible brisure, au fait qu’il est impossible de ne pas cohabiter avec les étrangers canadiens-anglais27. Cette impossibilité de couper, cette nécessité de cohabiter, c’est une nécessité économique. Non seulement l’étroitesse du marché défend au Québec l’autarcie28, mais la proximité et la domination de « Big-Brother-USA » sur l’économie canadienne et québécoise rend obligatoires certains accords politiques entre autres monétaires et douaniers29 et l’articulation de stratégies industrielles30. Certes, ce projet n’est pas uniquement un projet de résistance à l’oncle Sam, c’est aussi et surtout le projet d’une renégociation des places respectives dans la distribution des instruments de développement et donc des effets du développement.
(…) Nous proposons une nouvelle forme d’association basée sur l’égalité entre les deux nations du Canada, dans le respect des minorités. (…) En fait, le PQ propose d’organiser différemment et sur des bases solides le voisinage dans l’espace canadien. (…) en procédant à des négociations d’association pour la mise en commun d’outils de développement, sur la base de l’égalité et de la souveraineté des parties. Dans cette proposition, l’égalité et la souveraineté doivent être non négociables alors que le reste, lui, l’est et il peut prendre plusieurs formes31.
Bien sûr, les formes que peut prendre l’association sont déterminées. Toutes sont conditionnées par l’objectif central de la revendication qui, lui, est non négociable : la récupération de la capacité d’intervention de l’État, rendre négociable une modification de l’intégration dans le champ d’accumulation du capital nord-américain32. Le succès de ce projet de modification de l’insertion du Québec dépend de la conjoncture immédiate de la confiance qu’inspire aux investisseurs l’actuel gouvernement du Québec. Ce n’est pas sans raison que René Lévesque rappelait au patronat que les grandes firmes multinationales (GM, Alcan, CIL, etc.) s’étaient inscrites dans le projet de développement économique mis de l’avant par son gouvernement en investissant au Québec33.
Ce fait est d’ailleurs un indice de la stratégie de développement industriel que ce gouvernement veut mettre de l’avant. Cette stratégie s’articule autour de la volonté de planifier son développement34 et se déploie en 3 principes : 1) Maintenir une industrie domestique dans les secteurs de besoins vitaux, maintien s’accompagnant de mesures visant à consolider les éléments les plus concurrentiels de ces secteurs; 2) Assurer par des négociations commerciales la réalisation d’objectifs de spécialisation et d’exportation dans les secteurs de produits finis où le Québec a une bonne position concurrentielle ; 3) Axer le développement du Québec sur une plus grande transformation de nos ressources naturelles35.
Cette stratégie vise donc la « modernisation et la remise à jour de l’économie québécoise »36. Elle est orientée par la théorie de la spécialisation internationale – conception du développement industriel – sur la base des avantages comparés37, et caractérisée par l’intervention de l’État afin de briser les circuits enfermant le Québec dans l’approfondissement de son développement inégal38. Dans cette stratégie, certains secteurs sont définis comme devant être du ressort exclusivement québécois39, d’autres comme devant être à majorité québécoise40 et enfin d’autres sont considérés comme ouverts au contrôle étranger41. Cette stratégie se caractérise donc par l’apparente contradiction entre la récupération du contrôle de la propriété dans certains secteurs et l’ouverture dans d’autres. Ce fait « associé à la volonté d’aider (…) les PME innovatrices et à fort potentiel de croissance »42, lesquelles (PME) réalisent actuellement 48,2 % de l’emploi manufacturier québécois43; et « associé » à la volonté de récupérer le contrôle du secteur financier indique très nettement la nature de classe du projet d’association mis de l’avant par le PQ. En fait, l’analyse du projet péquiste de développement nous permet de constater que ce n’est pas un projet véritablement autonomiste au sens où il ne mène pas à une véritable indépendance économique et politique, qui nécessite : 1) « l’élimination du pouvoir des classes sociales et des formations politiques liées à l’impérialisme et qui acceptent de collaborer avec lui »44; 2) l’expropriation du grand capital étranger et une modification profonde des rapports monétaires, douaniers, financiers et commerciaux45; 3) une profonde transformation sociale aboutissant à la disparition des classes liées à l’impérialisme46. En fait une politique de véritable autonomie/indépendance nécessite l’abandon de la rentabilité capitaliste47, parce que la question fondamentale posée par le problème du développement est: le développement, pour qui? Or une politique de développement pour le peuple48 ne peut que conduire au rejet des règles de rentabilité actuelles et à une révision fondamentale des priorités dans l’allocation des ressources. En fait, le projet péquiste de souveraineté-association n’est pas véritablement un projet d’autonomie politique et économique, pour la bonne raison qu’il ne conteste en rien la logique interne du champ d’accumulation49.
C’est un projet qui se situe toujours dans la logique de la rentabilité capitaliste. Il est d’autant moins un projet d’autonomie qu’il ne repose pas principalement sur l’accumulation nationale50, mais sur le partage du contrôle des secteurs laissant au grand capital étranger de nombreux secteurs, et ce, parmi les plus productifs.
Il ne propose qu’une réorganisation du contrôle de certaines parties du champ d’accumulation. Il s’agit du projet d’une classe qui conteste l’actuelle organisation des circuits d’accumulation du capital. C’est là la caractéristique fondamentale du projet et c’est ce qui détermine la nature des obstacles qu’il rencontre. En fait, le projet péquiste de souveraineté-association n’a aucune chance de se matérialiser si la classe ouvrière au Québec remet en cause la logique du profit. De plus, ce projet rencontre un obstacle extérieur dans et par le refus de réorganiser le champ d’accumulation, refus que lui oppose la fraction de la bourgeoisie exerçant actuellement le contrôle. Il s’agit donc pour la fraction contestatrice de « renégocier » son intégration, une nouvelle insertion dans le champ d’accumulation.
Dans les années à venir, le Québec va donc devoir forcément, pour être dans la course mondiale, s’intégrer à un bloc économique puissant. La solution nord-américaine semble la plus réaliste à cause d’une multitude de facteurs (proximité, technologie, etc.). Cependant, cette intégration devra se faire d’une manière consciente et ordonnée. En effet, la situation qui prévaut actuellement ne doit plus durer, à savoir que la majorité de nos exportations nord-américaines sont constituées à 80% de produits primaires ou semi-ouvrés, alors que les produits que nous importons de cette même source sont constitués de produits finis. (…) Dans le futur, si nous options pour une intégration au marché nord-américain, il faut que nous ayons un rôle important à jouer dans le processus de transformation. Nous ne devons pas nous contenter d’être un fournisseur de matières premières, mais participer activement à l’activité commerciale profitant ainsi des économies d’échelle et de la spécialisation, tout en gardant une certaine autonomie d’action51.
Cette volonté de commander une réorganisation du champ d’accumulation du capital est, dans le secteur financier52, particulièrement significative et caractéristique de la nature de classe du projet péquiste de souveraineté-association. En effet, cette volonté a comme fondement le fait indéniable que le Québec est systématiquement exproprié, à travers le système bancaire et financier canadien, du capital formé au Québec. Le Québec est en effet exportateur net de capital, mais ce qui est fondamental, c’est que cette exportation se fait en faveur du Canada (lire : principalement l’Ontario)53. La sortie de capitaux vers le Canada atteint un record de 886 millions en 1954, soit 43% du capital formé cette année. Le taux moyen s’élève à 33% entre 1947 et l958, contre seulement 16% entre 1959 et 1971, soit la moitié moins. Les taux les plus faibles surviennent en 1964 et 1965, au plus fort de la « Révolution tranquille » (…). Dès lors, un tel mouvement ne peut guère que passer par le secteur financier; il a donc le caractère d’un investissement de portefeuille54.
La volonté de contrôler majoritairement le secteur financier veut donc dire pour la classe pilotant le projet d’association la revendication du contrôle sur les retombées (en termes d’accumulation) de la formation du capital au Québec. C’est une volonté de faire en sorte que le capital formé au Québec s’y accumule, mais dans quelles mains?
Question fondamentale, comme nous l’avons souligné plus haut, qui indique pour qui se fait le développement. Or, à la lumière du fait que le projet péquiste de développement ne met pas de l’avant la socialisation de la propriété de l’appareil de production et de ce que nous avons dit aux paragraphes précédents, il devient évident que ce projet d’association favorise le contrôle de ceux qui détiennent la propriété des moyens de production.
Plus particulièrement, il s’agira d’aider et de favoriser les PME innovatrices et à fort potentiel de croissance55; avec l’aide de la Société de réorganisation industrielle de rendre le contrôle et la propriété sur certains secteurs à des groupes privés québécois (entre autres coopératifs)56; et par une intervention planifiée sur l’amont et l’aval d’un certain nombre de filières économiques (hydro-électricité, matériel électrique, pâtes et papier, amiante, etc.) de se mettre en remorque du grand capital international : les GM, CIL, lTT, Alcan, etc., ceux-là mêmes qui, aux dires du premier ministre René Lévesque, ont voté leur confiance au Québec.
Il s’agira donc de faire en sorte que le capital formé au Québec s’y accumule, et dans une forte proportion dans des mains québécoises. Le projet d’association à ce titre, c’est celui d’une fraction de classe qui conteste le contrôle dont elle est l’objet, la volonté de se dégager de ce contrôle pour prendre, en termes de classe et non de nation, sa part du gâteau :
Ces couches sociales entendent pousser jusqu’au bout les tendances à l’autonomisation de cet appareil d’État et s’en servir comme appui pour transférer sans contrôle local, le système bancaire et financier, entreprendre un programme très agressif de concentration et de modernisation économiques et lancer un secteur d’entreprises capables d’affronter la concurrence internationale57.
Le projet de souveraineté-association du PQ constitue donc fondamentalement la recherche d’une bourgeoisie dans le marché canadien et mondial, et dans la division internationale du travail. C’est là précisément que nous devons concevoir l’obstacle extérieur fondamental au projet de la souveraineté-association.
Les obstacles à la souveraineté-association
Les obstacles externes
Ce projet ambitieux, mais en continuité avec la tendance à l’autonomisation de l’appareil d’État québécois, entre cependant en conflit avec la tendance à l’expansion internationale du grand capital canadien, en menaçant de tronçonner ses bases arrière et en visant un changement qualitatif de l’intégration économique du Québec dans l’ensemble continental, changement menaçant pour l’intégration du Canada lui-même.
Les obstacles externes que rencontre le projet de souveraineté-association tiennent, comme nous l’avons souligné, à sa nature de classe. Essentiellement, ce projet constitue celui d’une fraction de la bourgeoisie qui revendique la modification de son insertion dans le bloc au pouvoir canadien et qui vise ainsi la récupération des capacités d’intervention de l’État québécois. Or, l’obstacle que ne peut manquer de susciter un pareil projet est d’autant plus radical qu’est l’exigence du nouveau partage du gâteau. Exigence précisément que le PQ traite comme non négociable, ne considérant comme négociables que les formes d’association (lire ici la modification de l’insertion dans le champ d’accumulation). C’est donc dire que l’actuelle fraction dominante au sein du bloc au pouvoir canadien se voit placée devant l’exigence d’une fraction subordonnée de ce bloc, fraction qu’elle dépossède du capital formé dans la région où cette dernière est ancrée, de remettre en question la distribution et l’organisation des « positions» d’appropriation du capital dans le champ d’accumulation spécifique de la formation sociale canadienne.
Ainsi, le principal obstacle externe au projet péquiste tient au fait que la fraction dominante de la bourgeoisie canadienne exerçant le pouvoir d’État risque fort de refuser d’évacuer (en termes de propriété économique) des secteurs fondant matériellement son hégémonie, notamment le secteur financier où elle est omniprésente. Cette fraction hégémonique ne peut accepter le fractionnement des capacités d’intervention de l’État fédéral au profit de l’État québécois sans du coup accepter de saper son propre pouvoir. C’est à ce titre précisément que l’accession du PQ au pouvoir et la mise en oeuvre de son projet de souveraineté-association approfondissent et aggravent considérablement l’actuelle crise de l’État canadien enracinée dans la crise économique qui secoue l’ensemble des pays capitalistes avancés.
Ce refus d’une nouvelle articulation « moins centralisée » de la propriété économique dans le champ d’accumulation et d’un nouveau partage des capacités d’intervention étatique tient aussi au fait qu’un État « associé », mais souverain, pourrait éventuellement contracter des alliances extérieures au continent nord-américain58. Toute entente de ce genre aurait évidemment des conséquences importantes sur l’appareil de production, mais également sur l’organisation du circuit de réalisation du profit. Autrement dit, c’est toute l’organisation du champ d’accumulation du capital qui en serait modifiée et cette perspective est difficilement acceptable pour les fractions bourgeoises actuellement dominantes au sein du système de rapports de classes défini par ce champ d’accumulation.
Ce risque de modification du champ d’accumulation est d’autant plus grand que les rapports d’oppression ayant alimenté le développement des luttes nationalistes au Québec risquent de conduire au glissement du projet péquiste vers une véritable politique d’autonomisation de l’État québécois. Or cela, la fraction dominante du bloc au pouvoir canadien, autant que celle qui gère l’articulation du champ d’accumulation nord-américain, ne le tolérerait pas. Comme nous l’avons souligné plus haut, cette politique signifierait en effet le rejet de la logique capitaliste et impliquerait une transformation radicale des alliances. Ce serait alors toute la carte géopolitique de l’Amérique du Nord qui en serait transformée, et toute l’actuelle politique de défense de cette partie de l’hémisphère en serait par conséquent mise en question. C’est évidemment un risque que ne peut se permettre de prendre la fraction bourgeoise dominante dans le champ d’accumulation concerné, c’est-à-dire nord-américain.
Il reste cependant que le projet de souveraineté-association est objectivement porté à l’avant-scène par un ensemble de luttes dont l’ampleur ne peut que grandir tant et aussi longtemps que s’accentuent les effets du développement inégal dans le contexte actuel de crise économique. Si cette crise a largement contribué à porter le PQ au pouvoir, elle constitue simultanément un dernier obstacle extérieur de taille à la mise en oeuvre du projet péquiste de souveraineté-association. La présente crise économique, réfléchie ici dans sa dimension internationale, limite en effet considérablement la possibilité de commander avec succès une redéfinition des insertions dans le champ d’accumulation du capital, compte tenu du type de restructuration exigée par son dépassement à l’intérieur de l’actuel système des rapports de classes.
Ce système de rapports de classes commande en effet, et toute l’histoire du capitalisme l’atteste, un mode de dépassement de ses crises passant de manière obligée par une restructuration centralisée du bloc au pouvoir dans chacune des formations sociales capitalistes. Or, le projet péquiste ouvre précisément la voie à une restructuration décentralisée d’autant moins acceptable que le processus d’accumulation en Amérique du Nord donne des signes d’essoufflement et requiert ainsi une modification structurelle de l’appareil de production. Or, cette nécessité fait que la bourgeoisie dominante a un besoin accru de capitaux afin de procéder à cette transformation de l’appareil de production. En revanche, le projet péquiste exige justement que l’élément moteur de cette transformation, le capital formé, soit redistribué de manière décentralisée. C’est là une exigence à laquelle ne consentira bourgeoisie dominante que si on l’y force.
Donc les obstacles externes au projet de souveraineté-association impliquent que ce dernier est tendanciellement bloqué à son point central, c’est-à-dire l’exigence d’une modification de l’insertion et la récupération des capacités d’intervention, l’issue de la partie étant fonction du rapport des forces en présence :
(…) Il devient important et, à mesure que le temps avance, pressant non seulement de préciser la proposition de départ pour l’association recherchée, mais également de construire la solidarité nécessaire au Québec afin que les porte-paroles québécois disposent d’un pouvoir de négociation leur permettant d’établir un véritable rapport de force. Celui-ci est essentiel, car lui seul peut garantir des résultats satisfaisants pour les parties négociantes »59.
Ainsi, plus le PQ réussira à créer un soutien général à son projet, et plus le refus de renégocier représentera, pour la fraction dominant l’actuel bloc au pouvoir, un risque élevé. Plutôt que de risquer, par son refus, un glissement vers une véritable politique d’autonomie économique, le bloc au pouvoir et sa fraction hégémonique consentiront à une refonte du « pacte confédératif » , si et seulement si le PQ réussi à maîtriser, au Québec, les rapports de classes, si et seulement s’il réussit à faire avaler aux ouvriers son préjugé favorable pour les ouvriers, les amenant ainsi à se fondre et à se confondre dans l’unité nationale60. Autrement dit, si et seulement si le PQ surmonte l’obstacle le plus important, l’obstacle interne au projet de souveraineté-association, c’est-à-dire l’opposition affichée par le prolétariat québécois et l’ensemble des classes dominées. Phrase à compléter…
Obstacles internes
Le danger principal du point de vue de la stabilité économique du grand capital canadien réside probablement dans la possibilité que la direction nationaliste québécoise devienne incapable de contrôler le mouvement dont elle tire présentement sa force. Ce mouvement risque alors de prendre une dynamique autrement radicale.
Le principal obstacle au projet d’association préconisé par le PQ a tout lieu en effet de résider dans l’opposition que ne peut manquer de manifester le mouvement ouvrier québécois à une pareille stratégie d’intégration économique fondée sur la reproduction des rapports de classes de type capitaliste et des relations de dépendance à l’égard du capital étranger. Malgré sa prétention à constituer le parti de tous les Québécois quel que soit leur classe d’appartenance, le PQ tire en effet sa force de l’appui largement inorganisé61, mais enthousiaste d’une très large fraction des travailleurs salariés québécois, notamment ceux de ces travailleurs regroupés en syndicats. Pour la majorité de ces travailleurs toutefois, cet appui à un parti souverainiste procède d’abord et avant tout d’un soutien aux orientations réformistes et aux idéaux sociaux-démocrates véhiculés par le programme du PQ. Le projet de souveraineté politique du Québec n’a par conséquent de chance d’emporter l’adhésion stable du mouvement ouvrier québécois qu’à condition de se prolonger en un projet de souveraineté économique, bref qu’à condition que la souveraineté politique induise la mise en oeuvre d’un ensemble de réformes structurelles amorçant la transition à un nouveau mode de développement économique et à un type nouveau d’organisation des rapports sociaux. Il en est de même d’autre part pour une fraction non négligeable de la nouvelle petite bourgeoisie salariée urbaine (enseignants, journalistes, producteurs culturels, animateurs sociaux et culturels, professionnels à l’emploi des appareils étatiques et paraétatiques) dont l’adhésion militante au PQ est largement fondée sur l’espoir que l’accession à la souveraineté politique enclenchera notamment un processus de réappropriation collective des ressources naturelles, une réorganisation passablement radicale des rapports sociaux dans les domaines du travail et de la consommation collective et une profonde redéfinition des objectifs et des modes d’opération de l’État québécois62.
Le PQ lui-même d’ailleurs a largement contribué à susciter de tels espoirs et de telles attentes de changements structurels dans l’organisation des rapports de classes au Québec. Non seulement a-t-il calmé bien haut son préjugé favorable aux travailleurs sur son idéal social-démocrate, mais nombre de passages de son programme officiel ouvrent des perspectives de transformation radicale de la structure économique sociale. Notons simplement qu’au chapitre des objectifs généraux du parti en matière économique, il est proclamé la nécessité « de fonder la politique économique sur des objectifs humains et sociaux » et résolu à cette fin :
d’établir un système économique éliminant toute forme d’exploitation des travailleurs et répondant aux besoins réels de l’ensemble des Québécois plutôt qu’aux exigences d’une minorité économique favorisée; de subordonner les critères de rentabilité économique aux critères de rentabilité sociale63.
Compte tenu cependant que le projet d’association mis de l’avant par le PQ, aussi flou soit-il, vise essentiellement à restreindre la souveraineté du Québec aux circuits économiques canadien et nord-américain tout en renégociant certains des termes de cette intégration, et à offrir des garanties qu’un Québec souverain restera ouvert au capital étranger pourvu que les entreprises concernées respectent la souveraineté politique et les particularités linguistiques et culturelles du Québec, il est aisé de prévoir que la mise en oeuvre de ce projet d’association se heurtera à de vives oppositions de la part du mouvement ouvrier et d’une couche importante de la nouvelle petite-bourgeoisie salariée urbaine. Ces oppositions tendront à se développer aussi bien au sein du parti lui-même que dans la rue et dans les entreprises, et risquent fort de déboucher, à moyen terme, sur un projet de souveraineté autrement plus radical et sur une crise profonde des rapports politiques entre les classes. Tout cela nous porte à dire qu’on ne suscite pas impunément des espoirs de réorganisation structurelle des rapports sociaux sans que ne se profilent à l’horizon des mouvements d’opposition et de protestation qui mettent radicalement en question les politiques visant à restreindre la portée de ces changements et de ces réformes. De plus, la capacité des dirigeants du PQ à négocier une éventuelle association économique est-elle fonction, en dernière analyse, de leur capacité à réduire l’ensemble des incertitudes liées à cette opposition potentielle, fonction par conséquent de leur capacité :
• à intégrer et/ou à délégitimer les divers mouvements sociaux en formation et en développement après l’accession du Québec à la souveraineté politique, de manière à empêcher qu’ils ne s’articulent et ne se greffent à une contestation politique ouvrant sur un projet d’indépendance économique;
• à assurer la légitimation des rapports de classes actuels et des relations de dépendance qui en résultent, de façon à refroidir les espoirs de transformation suscités par le propre programme du parti;
• à ne pas enfin se laisser déborder sur leur gauche, c’est-à-dire leur capacité d’une part à maintenir une certaine distance entre le mouvement syndical et populaire et le parti lui-même, et d’autre part à isoler, au sein du mouvement syndical et populaire, les forces de gauche et d’extrême gauche susceptibles de transformer les inévitables déceptions des classes dominées et subalternes en une protestation d’ensemble contre l’organisation des rapports politiques.
Tout le dilemme du PQ réside précisément dans le fait qu’il ne peut espérer gagner un large soutien populaire à son projet de souveraineté politique sans entretenir des espoirs de grands changements sociaux et économiques, et qu’il ne peut par ailleurs espérer gagner l’assentiment des milieux capitalistes américains et canadiens à son projet d’association économique sans garantir que la souveraineté du Québec impulsera par des bouleversements importants dans la structure des rapports de classes et des relations de dépendance.
1 Cahiers du socialisme, numéro 2, automne 1978. Le texte est extrait d’une communication des auteurs présentée au colloque de l’ACSALF, Ottawa, mai 1978.
2 CFP, Le référendum, un enjeu politique pour le mouvement ouvrier, Montréal 1979.
3 Voir T. Naylor, History of Canadian Business , Lorimer Publishers, Toronto, 1975; et H.J. Aitken, “Defensive Expansionism: the State and Economic Growth in’Canada”, dans W. Easterbrook et M. Watkins, Approaches to Canadian Economic History, Mc Clelland and Stewart, Toronto, 1967.
4 Voir les articles de L. Panitch, R. Whitaker et de G. Stevenson dans le livre dirigé par L. Panitch, The Canadian State, Presses de l’Université de Toronto, 1977; et le texte de B Bernier, L’établissement de l’Etat national canadien, département d’anthropologie, Université de Montréal, 1978.
5 Sur la relation entre rapports de domination nationale et formation des Etats capitalistes modernes, voir G. Bourque, L’Etat capitaliste et la Question nationale, Presses de l’Université de Montréal, 1977; et C. Levasseur, « Mouvements nationalitaires et structure de domination nationale » , Université Laval, département de science politique, 1977, 55 pages.
6 Là-dessus voir C. Levasseur, op. cit.
7 Voir T. Naylor, op. cit., W. Clement, The Canadian Corporate Elite , Mc Clelland and Stewart, Toronto, 1975; W. Clement, Continental Corporate Power ,Mc Clelland and Stewart, Toronto, 1977 et H. Chorhey, “Regional Underdevelopment and Cultural Decay”, dans Imperialism Nationalism and Canada , New Hogtown Press, Toronto, 1977.
8 Voir W. Clement, 1975 et 1977.
9 Voir G. Stevenson, “Federalism and the Political Economy of the Canadian State”, dans L. Panitch, op. cit.
10 Idem.
11 Voir le texte de M. Renaud, « Réforme ou illusion? ». Une analyse des interventions de l’Etat québécois dans le domaine de la santé, dans Sociologie et Sociétés, vol. 9, no 1, avril 1977.
12 Document de travail, Ministère de l’Expansion économique régionale, Ottawa, « Perspectives régionales », dans « Industrie manufacturière au Canada, en Ontario et au Québec », revue Commerce, avril 1978, p. 78.
13 Rodrigue Tremblay, « Position du Québec », revue Commerce, ibid, p; 97.
14 Rodrigue Tremblay, ibid, p. 97.
15 Conseil exécutif du PQ, Quand nous serons vraiment chez nous, octobre 1972, p. 55.
16 Jean-Pierre Charbonneau (député de Verchères), « Souveraineté-Association : l’option encore la plus claire », Le Devoir 3-05 1978 p. 5
17 J.-P. Charbonneau, ibid, p. 5.
18 J.-P. Charbonneau, ibid, p. 5.
19 J.-P. Charbonneau, ibid, p. 5.
20 Conseil exécutif du PQ, op. cit., p. 22.
27 « Nous devons exporter pour prospérer. Cela implique des contraintes », Conseil exécutif du PQ, 22, op. cit., p. 56.
28 Conseil exécutif du PQ, ibid, pp. 131 à 135.
29 Rodrigue Tremblay, op. cit., p. 95.
30 J.-P. Charbonneau, op. cit., p. 5.
31 « Par exemple, si d’autres ententes analogues au pacte de l’automobile devaient être conclues, leurs effets bénéfiques devraient se faire sentir de façon plus tangible au Québec» , Rodrigue Tremblay, op. cit., p. 98.
32 (…) avec leur argent ont voté leur confiance, au Québec“, Michel Vastel, «Escalade dans la polémique entre Québec et le patronat», Le Devoir, 15-02-1978.
33 « Le Québec, tout en reconnaissant la nécessité d’une collaboration avec le gouvernement fédéral en cette matière, est convaincu qu’il lui appartient au premier chef de définir les principaux éléments de cette stratégie », Rodrigue Tremblay, p. 100
34 Rodrigue Tremblay, ibid, p. 100.
35 Conseil exécutif du PQ, op. cit., p. 105
36 Rodrigue Tremblay, op. cit., p. 98.
37 « Une fois l’opération terminée, le cartel rompu et un groupe québécois organisé, rien n’empêche la SRI (Société de Réorganisation Industrielle) de vendre le contrôle du nouveau groupe à un organisme coopératif, une partie du capital à la Caisse de Dépôt et, sa mise récupérée, de procéder au même genre d’opération dans un autre secteur », Conseil exécutif du PQ, op. cit., p. 79.
38 Equipement culturel, mass-média, distribution de l’imprimé, acier primaire, etc., Conseil exécutif du PQ, ibid, pp. 97 et 98.
39 Banques, compagnies de fiducie et d’assurances, compagnies de chemin de fer, industries de base dans le domaine des produits électriques et de l’outillage de communication, amiante, etc., Conseil exécutif du PQ, ibid, pp. 98, 99 et 100.
40 Tout le secteur minier exception faite de l’amiante, des secteurs de technologie complètement nouvelle, etc., Conseil exécutif du PQ, ibid . 100.
41 Rodrigue Tremblay, op. cit., p. 95.
42 Ministère de l’expansion économique région 1, Ottawa, op. cit., p. 80.
43 Charles Bettelheim, « La problématique du développement) » , dans Planification et-croissance accélérée, Maspero, Paris, 1975, pp. 43 et 44.
44 Samir Amin, ibid. Le développement inégal, Minuit, 9 Paris, 1973, p. 253
45 Samir Amin, ibid, p. 168.* Pourquoi une étoile ?
46 « Toute l’articulation des formations sociales à l’échelle mondiale, sur la base de la division internationale du travail en se limitant à l’économique, repose en dernière instance sur la règle capitaliste du profit et l’inégalité du développement des forces productives ici et là. La logique du profit est donc rationnelle pour le développement capitaliste des uns, ceux qui occupent historiquement une place privilégiée dans la hiérarchie mondiale, et irrationnelle pour le développement des autres », Christian Palloix, L’économie mondiale capitaliste et les firmes multinationales, Maspero, Paris, 1977, T. 1, p- 19.
47 « L’expérience et le raisonnement montrent qu’une telle politique d’investissements, si elle doit aboutir comme on le désire à une indépendance nationale croissante, doit reposer principalement sur l’accumulation nationale et non pas sur des concours financiers extérieurs qui risqueraient bien souvent de maintenir, éventuellement sous des formes nouvelles, la situation de dépendance qui prévalait jusque-là et que l’on veut faire cesser », Charles Bettelheim, « Les exigences de la lutte contre le sous-développement », dans op. cit., p. 50.
48 A. Dayan, « La structure des exportations du Quêbec », dans Prospective socioéconomique du Québec Sous-système extérieur ; l’environnement international et le rôle du Québec dans la division du travail , OPDQ, Québec 1977, p. 79.
49 Conseil exécutif du PQ, op. cit., pp. 75 à 86.
50 F, Moreau, « Les flux de capitaux Québec extérieur » dans Prospective socio-économique du Québec, op. cit., pp. 114 a 123.
51 F. Moreau, ibid., p. 119.
52 Rodrigue Tremblay, op. cit., p. 95.
53 Conseil exécutif du PQ, op. cit., pp. 78 et 79.
54 F, Moreau, op. cit., p. 122.
55 F, Moreau, op. oit., p. 123.
56 Luc-Normand Tellier, « Les scénarios possibles de l’avenir », Le Devoir, 24-10-1977.
57 J.P. Charbonneau, op. cit., p. 5.
58 F. Moreau, op, cit., p. 123.
59 Car, à la différence des partis sociaux-démocrates traditionnels, le PQ n’entretient pas de rapports organiques avec les appareils syndicaux.
60 Notamment une large participation des travailleurs et des usagers à la gestion des services publics et parapublics
61 Conseil exécutif du PQ, Quand nous serons vraiment chez nous, octobre 1972
62 CFP, Le référendum, un enjeu politique pour le mouvement ouvrier, Montréal 1979.
63 Conseil exécutif du PQ, Quand nous serons vraiment chez nous, octobre 1972

Nous avons besoin d’une solidarité des peuples avec l’Ukraine et contre la guerre

Shaun Matsheza – Quelle est la situation en Ukraine et quel est son impact sur vous, votre famille et vos amis ?
Denys Gorbach – Je suis personnellement en sécurité, car ma compagne et moi sommes loin de l’Ukraine. Bien que la situation n’aide certainement pas à vivre et à fonctionner au quotidien. Outre l’anxiété générée par les nouvelles, j’ai encore de la famille là-bas. Ma tante et mon beau-père ont passé une semaine environ à se cacher dans des caves parce qu’ils vivent dans la banlieue est de Kiev, qui a été touchée par l’une des premières frappes aériennes le 24 au matin.
Denis Pilash – Le premier jour de l’invasion, j’étais encore à Kiev. Mon plan initial était d’y rester, mais on m’a convaincu de m’installer dans un endroit plus sûr en Ukraine et ici la situation est plus ou moins bonne. C’est devenu une grande plaque tournante pour l’afflux de réfugiés d’un côté et l’afflux d’aide humanitaire de l’autre. Je suis impliqué dans un réseau de volontaires d’une université locale, qui distribue l’aide humanitaire aux personnes qui ont été relogées ici ainsi qu’aux personnes plus proches des lignes de front de la guerre. Lorsque vous essayez de suivre des centaines de vos amis pour vérifier s’ils sont en sécurité, l’angoisse est la même. Il y en a plusieurs avec lesquels je n’ai pas eu de contact depuis plusieurs jours, qui sont toujours dans les banlieues de Kiev lourdement touchées, et dont je ne sais pas comment ils vont. Vous avez donc cette anxiété et une sorte d’horreur existentielle tous les jours quand vous recevez les nouvelles. J’ai des amis d’amis qui ont déjà été tués. Et l’un des pires sentiments est de savoir que, même si nous évitons un scénario catastrophe comme la guerre nucléaire, il semble que nous nous dirigeons vers un conflit prolongé, dans lequel de nombreuses personnes seront arrachées de leurs maisons et dispersées partout. C’est un sentiment sombre.
Shaun Matsheza – C’est une situation terrible, terrible. Je comprends qu’il est très difficile pour quiconque, à l’heure actuelle, de déterminer exactement quelle pourrait être la stratégie de la Russie. Mais où pensez-vous que cela mène ?
Denys Gorbach – Eh bien, je ne suis pas un analyste militaire, mais d’après ce que je vois, nous ne devrions pas compter sur des concessions significatives de la part de Zelensky. Non pas parce qu’il est un super-héros comme le dépeint la presse occidentale aujourd’hui, mais parce qu’il n’a tout simplement pas le choix. Même s’il devait accepter une concession importante pour mettre fin à la guerre, il y a un risque énorme qu’il soit déposé par un coup d’État nationaliste. Il a visiblement fait le choix d’être déposé, si nécessaire, par une force d’occupation plutôt que par ses concitoyens ukrainiens. De même, il semble que Poutine se soit mis dans une situation où, s’il recule, son pouvoir interne sera compromis. Pour l’instant, je ne vois aucun signe de désescalade du conflit.
Shaun Matsheza – Êtes-vous d’accord, Denis ?
Denis Pilash – Eh bien, oui, je ne suis pas non plus un analyste militaire, mais d’après ce que nous avons vu cette dernière semaine, l’invasion russe a vraiment été un désastre en termes de préparation. On dirait qu’ils avaient prévu une guerre éclair en douceur, la prise des grandes villes en quelques jours et l’accueil des libérateurs. Au lieu de cela, il y a beaucoup de problèmes de logistique et ils ont été confrontés à un rejet total de la part de la population dans toutes les régions qu’ils ont saisies. Il y a de grands rassemblements contre l’occupation russe et la majorité des autorités locales refusent de collaborer avec les forces d’occupation. Elles ont donc clairement fait un mauvais calcul et ne semblent pas avoir de plan B clair. Et cela nous amène au danger d’une guerre prolongée où Poutine ne se retirera pas sans concessions significatives et où Zelensky et l’Ukraine n’ont pas d’autre option que de résister.
Les autorités ukrainiennes disent qu’elles essaient de trouver une voie vers un cessez-le-feu, mais on ne s’attend pas à grand-chose car la Russie s’en tient toujours à ses exigences initiales. Certaines nouvelles sont très confuses. Par exemple, des rumeurs affirment que la Russie va faire revenir le président déchu Ianoukovitch, qui est devenu la risée de presque tout le monde en Ukraine et qui est profondément méprisé. Si c’est le cas, la Russie n’a aucun rapport avec la réalité. C’est pourquoi il est assez difficile de faire un pronostic.
Shaun Matsheza – Alors, dans la situation actuelle, que peuvent faire les gens ? Il semble malheureusement qu’il y ait beaucoup de divisions à gauche sur la façon de réagir. A quoi ressemble la solidarité ?
Denys Gorbach – Eh bien, en termes de division, il y a par exemple ce qu’on appelle le campisme, qui trouve ses racines dans la guerre froide, lorsqu’une partie importante de la gauche occidentale soutenait l’Union soviétique. Quelle qu’ait été sa logique dans le passé, c’est une aberration aujourd’hui, alors que la Russie est clairement un pays capitaliste dont le leader, Poutine, est un anticommuniste explicite qui fulmine en disant qu’il déteste Lénine et les bolcheviks pour avoir détruit le précieux Empire russe. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, les descendants des campistes croient que les années 70 sont toujours là, ce qui nous amène à cette triste situation où une partie de la gauche mondiale soutient toute personne anti-américaine, surtout s’il s’agit de la Russie, qui est d’une manière ou d’une autre toujours associée à l’Union soviétique, au communisme et aux ours.
Je pense que c’est le bon moment pour que tous les membres de la gauche mondiale repensent leur analyse. Un bon point de départ serait de refuser tout parti pris géopolitique dans l’analyse des événements qui se déroulent en dehors de son propre pays. Trop souvent, dans l’analyse de la gauche, seuls l’OTAN ou Poutine se voient attribuer un rôle, mais les dizaines de millions de personnes vivant en Ukraine se voient refuser ce rôle. Nous devons nous rappeler que les Ukrainiens ne sont pas seulement des personnes, ils sont en fait vos camarades de classe. La plupart d’entre eux sont des hommes et des femmes qui travaillent, qui partagent beaucoup de soucis quotidiens et qui méritent d’être pris en compte lorsque vous formulez vos positions.
Denis Pilash – Oui, je suis tout à fait d’accord. Les Ukrainiens ne sont pas seulement des pions sur un échiquier géopolitique. Tout comme notre compréhension de la corruption de l’administration Abbas et de la nature d’extrême droite du mouvement Hamas ne devrait pas être un obstacle pour entendre la détresse du peuple palestinien. De même, invoquer l’extrême droite ukrainienne ou la corruption et les oligarques ukrainiens ne devrait pas être un obstacle à la solidarité des gens avec les victimes directes des bombes russes et de l’impérialisme russe, ainsi qu’avec les victimes des oligarques et de l’extrême droite.
Nous devons nous concentrer sur les besoins des populations de tous ces pays et non sur des abstractions. Toutes ces discussions sur les « préoccupations légitimes de sécurité » de la Russie, par exemple. Avons-nous parlé des préoccupations légitimes des États-Unis en matière de sécurité, concernant Cuba ou la Grenade ? Ces « préoccupations de sécurité » donnent-elles à une puissance impériale le droit d’intervenir et de procéder à cette agression ? Bien sûr que non. Vous devez donc appliquer ce même principe à l’Ukraine et à tous les autres pays touchés par l’impérialisme.
Et je dois aussi dire que c’est exaspérant de voir le retour de ce campisme. Dans les années 1990 et au début des années 2000, je pense que la grande majorité de la gauche internationale était critique à l’égard des guerres d’Eltsine et de Poutine en Tchétchénie, et ne se faisait aucune illusion sur le jeu de grande puissance de la Russie pour rétablir sa sphère d’influence. Mais miraculeusement, sans même que le Kremlin ne fasse de gros efforts, leur propagande a été acceptée par une partie de la gauche, même si le gouvernement russe travaille aussi volontiers avec l’extrême droite européenne et les forces ultra-conservatrices.
Pendant ce temps, les États d’Europe centrale et orientale sont parfois même rejetés comme n’étant pas de véritables États, traités comme des nations sans histoire, comme des peuples de seconde zone.
Shaun Matsheza – Quel type de soutien les forces progressistes peuvent-elles apporter au peuple ukrainien ? Est-il juste que la gauche s’allie aux demandes de soutien militaire ?
Denys Gorbach – C’est une question difficile pour la gauche, comment soutenir tout ce qui est lié à l’armée. Personnellement, j’aime la position de Gilbert Achcar, un chercheur de Londres, qui appelle à une position anti-impérialiste radicale, qui selon lui devrait consister à s’opposer à une zone d’exclusion aérienne et à des propositions similaires, car cela conduirait à un affrontement militaire direct entre les grandes puissances impérialistes et à une possible guerre nucléaire mondiale totale. Mais d’un autre côté, cela vaut la peine de soutenir les livraisons d’armes à un petit pays qui tente de se défendre contre une attaque impérialiste, comme cela s’est produit au Vietnam ou en Corée qui ont bénéficié d’une aide militaire importante de la part de la Chine et de l’Union soviétique.
Denis Pilash – Oui. Il y a une grande tradition historique de soutien aux guerres des peuples dans les petits pays qui sont attaqués ou opprimés par les grandes puissances impériales. Cela fait partie intégrante des projets politiques de gauche depuis le 19e siècle, depuis le soutien de la Première Internationale aux luttes polonaises et irlandaises, etc. et plus tard avec le soutien à la décolonisation de nombreux pays.
Si vous avez encore des réserves en raison de considérations ou de convictions différentes ou de croyances pacifistes strictes qui vous empêchent de soutenir l’aide militaire ou la résistance militaire, il existe encore de nombreuses façons de soutenir la population civile, notamment l’aide humanitaire et le soutien à la résistance non violente dans les villes et villages occupés. Il existe un large éventail d’actions qui peuvent être entreprises par chaque personne, organisation ou mouvement.
Shaun Matsheza – En tant que Zimbabwéen et membre de réseaux africains, je vois beaucoup de commentaires sur la façon dont le conflit ukrainien est rapporté et expliqué au monde, ce qui est très différent des autres conflits. Nous voyons également des images d’étudiants africains réfugiés traités différemment des autres réfugiés ukrainiens, des rapports sur le racisme, la discrimination pour monter dans le train, etc. Quel serait votre message aux personnes qui ne sont pas européennes, qui ne sont pas investies dans la dynamique européenne, mais qui veulent vraiment faire partie du mouvement pour la paix au niveau mondial ?
Denys Gorbach – Il y a cette expression inventée par un de nos collègues qui a appelé l’Ukraine le pays le plus au nord du Sud global. Je pense que c’est juste, surtout si vous regardez la situation macroéconomique et les tendances démographiques. Cela se traduit par une racialisation des Ukrainiens si l’on considère que le racisme est une question de rapports de force. Bien sûr, nous passons pour des Blancs en termes de couleur de peau, et nous sommes certainement Blancs en Ukraine dans nos interactions avec les personnes racialisées locales telles que les Roms ou les étudiants noirs. Mais en Europe occidentale, mon statut social chute dès que j’ouvre la bouche pour révéler mon accent slave. Cependant, à cause de la guerre, les Ukrainiens sont devenus en quelque sorte « blanchâtres » pour l’Occident et presque humains en termes de traitement.
Ce regard raciste, cette idéologie qui privilégie l’Europe et mesure la qualité des gens en fonction de leur proximité avec cette idée d’Europe occidentale est malheureusement aussi très répandue en Ukraine. Les incidents racistes à la frontière doivent être condamnés. Nous assistons à une discrimination non seulement en fonction de la couleur de la peau, mais aussi de la couleur du passeport. Par exemple, les réfugiés de Biélorussie font également l’objet de discriminations, même s’ils ont fui en Ukraine pour échapper au régime, mais ils sont accusés de faire partie du régime.
Le bon côté des choses, c’est que nous avons vu qu’il était possible d’établir des conditions plus ou moins décentes pour les réfugiés fuyant une guerre dans un pays non industrialisé. Je pense donc qu’il s’agit d’un bon précédent sur lequel nous pouvons nous appuyer pour demander que le même type de régime juridique et le même niveau de solidarité soient étendus aux réfugiés venant de toutes les autres parties du monde. Nous méritons tous le même type de traitement.
Denis Pilash – Même dans le cadre de ce traitement préférentiel des réfugiés ukrainiens, il y a déjà des rapports sur certains réfugiés qui sont exploités ou discriminés en Europe. Nous devons également mettre en avant ceux qui sont dans les positions les plus vulnérables, comme les citoyens étrangers ou les personnes sans citoyenneté ou les minorités discriminées, comme les Roms. J’espère que la situation en Ukraine sera le point de départ d’une discussion plus large sur la manière de traiter les personnes qui fuient et demandent l’asile de manière beaucoup plus humaine.
Je tiens également à dire que les gens de gauche ne doivent pas penser que si des gens sont bien traités et félicités par des personnes telles que Boris Johnson, ils ne sont pas nos amis. Que leurs amis doivent être nos ennemis. Nous devons comprendre que des personnalités telles que Johnson, Erdogan et d’autres qui se présentent comme de grands défenseurs de l’Ukraine utilisent cette situation de manière cynique et ne sont pas de véritables amis du peuple ukrainien.
Il est très symbolique que, juste avant l’invasion russe, nous ayons reçu une délégation de syndicalistes et de politiciens britanniques de gauche qui se sont entretenus avec des personnes sur le terrain – des militants des syndicats et des groupes de défense des droits de l’homme, des mouvements féministes – et ont montré leur solidarité face à une véritable agression. Vous n’avez pas eu une telle réponse de la part de la droite ou du centre libéral. Il s’agissait d’un véritable soutien de la base entre les exploités de la classe ouvrière, les opprimés et les exclus, confrontés aux mêmes systèmes d’exploitation, de discrimination et d’exclusion. C’est pourquoi nous avons besoin de cette solidarité au niveau des personnes, et pas seulement de cette fausse solidarité au niveau des gouvernements.
Shaun Matsheza – Un dernier mot ou message ?
Denys Gorbach – Je pense que ces tristes circonstances montrent qu’il est grand temps de construire une solidarité pratique qui soit anticapitaliste, anti changement climatique et anti militariste. Nous avons besoin concrètement de joindre ces trois agendas dans un mouvement qui peut se lever aujourd’hui contre la guerre, ainsi que contre l’impérialisme qui détruit notre planète.
Denis Pilash – J’espère qu’en faisant des demandes spécifiques à la situation ukrainienne, nous pouvons aussi aller vers quelque chose de plus global. Ainsi, lorsque nous parlons de soutien et d’aide aux réfugiés ukrainiens, notre demande s’étend aux réfugiés du monde entier. Si nous demandons l’annulation de la dette extérieure ukrainienne, cela inclut la question de l’endettement de la majorité des pays, en particulier des pays les plus pauvres. Si nous demandons la saisie des avoirs des oligarques russes et peut-être aussi ukrainiens pour les utiliser dans la reconstruction de l’Ukraine, nous ouvrons aussi la question des échappatoires fiscales utilisées partout par la classe capitaliste mondiale pour stocker ses avoirs. Si nous demandons l’arrêt de l’approvisionnement en pétrole et en gaz de la Russie, nous devrions également l’étendre à des États tels que l’Arabie saoudite et sa guerre criminelle au Yémen. Ce sont tous des empires de combustibles fossiles auxquels il faut mettre fin avec une reconstruction écosocialiste du système mondial.
Ainsi, chaque petit problème fait partie d’une discussion plus large. C’est pourquoi il est important d’avoir cette solidarité et cet échange entre les peuples de différentes régions, qui sont tous affectés par les mêmes problèmes, même s’ils sont confrontés à des dynamiques et des contextes spécifiques.
Traduction S. Prezioso pour Contretemps.
Texte original paru le 11 mars 2022 sur https://www.tni.org/en/article/we-need-a-peoples-solidarity-with-ukraine

La traite des personnes, conséquence systémique d’un régime déficient

En guise de présentation
J’ai eu, depuis près de dix ans, le privilège de travailler directement avec des femmes migrantes de Montréal qui ont survécu à la traite et à l’exploitation. La plupart d’entre elles sont des travailleuses domestiques migrantes, elles ont connu des conditions proches de la servitude domestique et du travail forcé. D’autres sont des étudiantes internationales, des travailleuses temporaires ou des demandeuses d’asile, qui ont été victimes d’exploitation et de sévices de la part de leur employeur, de leur famille élargie, d’une connaissance ou d’un amoureux. Ces situations les ont conduites à la perte de leur statut d’immigration. Leurs histoires et leurs expériences sont le sujet principal de cet article. En tant qu’immigrante et colonisée, je m’en voudrais de ne pas reconnaître le rôle joué par le colonialisme dans le traitement des peuples autochtones au Canada. L’absence d’exemples de leur vécu dans ce texte ne vise pas à minimiser cette réalité, mais reflète plutôt mes expériences personnelles dans le secteur communautaire des droits des migrants et migrantes et en tant que membre de la diaspora philippine à Montréal. En effet, la traite et l’exploitation des migrants – et en particulier celles des femmes migrantes racisées – font partie du projet colonial permanent du Canada et sont directement liées au traitement et aux conditions des femmes et des filles autochtones.
En accompagnant de nombreuses migrantes dans leurs efforts pour obtenir des droits fondamentaux, j’ai constaté de visu que le Canada ne parvient pas à faire respecter les droits des migrantes victimes de traite ni à leur offrir un soutien adéquat à la suite de tels sévices. Si chaque expérience de traite est unique, les conditions sociales sous-jacentes aux violations de droits qui permettent à de nombreuses femmes migrantes racisées d’être exploitées et maltraitées au Canada se ressemblent. Les survivantes de la traite ont généralement subi de multiples formes de discrimination et de violence, qui créent ensemble ce qu’on appelle fréquemment le « spectre de l’exploitation[1] ». Ce spectre renvoie à toute une série d’abus, y compris des conditions de travail dangereuses et des violations du Code criminel ainsi que des droits de la personne. Cela englobe des actes tels qu’un traitement inégal ou dégradant, des conditions de travail abusives et dangereuses, du harcèlement, de la séquestration, des agressions, de la violence sexuelle, etc., ce qui peut s’apparenter, finalement, à de la traite.
Dans cet article, je partage certaines de mes observations sur la base du principe que les violations des droits de la personne constituent à la fois une cause et une conséquence de la traite des êtres humains. Par exemple, les femmes racisées sont souvent criminalisées par les autorités policières et exclues des programmes sociaux, faute d’un statut d’immigration. Je soutiens également que nous devons avoir une compréhension plus globale de la traite au Canada dans un cadre axé sur les droits de la personne et sur le vécu des survivantes. Cela inclut le développement d’une voie directe vers le statut de résidence permanente pour les migrantes victimes de la traite. En outre, nous devons nous concentrer sur les causes profondes de la traite, liée à d’autres formes de violence et d’abus systémiques auxquels font face les communautés racialisées du pays.
Criminalisation du statut d’immigration précaire
Au Canada, la traite des personnes est d’abord et avant tout perçue comme une question de criminalité et de sécurité nationale[2]. Pour cette raison, les initiatives de « lutte contre la traite » visent principalement à sévir contre des actes criminels individuels plutôt qu’à soutenir les survivantes ou à s’attaquer aux conditions sociales qui créent des situations d’exploitation. Ce contexte est particulièrement problématique pour les femmes migrantes à statut précaire qui, même après avoir subi une exploitation et une violence très graves, sont souvent traitées comme des criminelles plutôt que comme des êtres humains ayant des droits.
Cela est illustré par le cas de Sara[3] que j’ai d’abord rencontrée dans un centre de détention pour personnes immigrées. Elle était arrivée au Canada comme étudiante internationale. Aux prises avec une grande précarité financière, elle s’était jointe à une agence d’escortes et avait été exploitée par un homme pendant un peu plus d’un an. Son expérience dans l’industrie du sexe a pris fin lorsqu’elle a été arrêtée par la police, envoyée en détention pour violation des conditions de son permis de travail, accusée de plusieurs infractions pénales liées à la prostitution et à la traite des personnes. Pendant 16 mois, Sara a été détenue soit dans un centre de détention pour migrants, soit en prison, sans faire l’objet de poursuites. Finalement, les accusations retenues contre elle ont été abandonnées lorsqu’elle a accepté de témoigner contre l’homme qui l’exploitait; ensuite, elle a été libérée dans la communauté à certaines conditions.
Importante car attendue depuis longtemps, la libération de Sara a soulevé une foule de nouveaux défis pour elle. Sans statut, elle n’avait ni le droit d’accéder à des soins de santé ni à de l’aide financière. Elle n’avait pas d’endroit où vivre, pas de documents d’identité, pas d’argent, ni de téléphone, de vêtements d’hiver, ou d’autres produits de première nécessité. Sans permis de travail, elle ne pouvait pas trouver d’emploi. Elle n’avait pas d’amis dans le pays et aucun moyen de contacter sa famille, à qui elle n’avait pas parlé depuis plus de deux ans.
En tant que migrante racisée sans statut, Sara était traitée comme une criminelle même si elle ne risquait plus de poursuites pénales. Elle n’était plus emprisonnée mais devait vivre sous surveillance et dans la crainte d’être expulsée. Elle était un témoin clé dans les poursuites pénales engagées contre son trafiquant, mais son importante contribution n’avait pas été reconnue de manière pratique ou de façon à améliorer sa qualité de vie. Au lieu de cela, elle a dû compter sur de la « charité » et de la « gentillesse » pour survivre et répondre à ses besoins. Son droit de vivre dans la dignité, en sécurité, et de faire ses propres choix était limité par des lois restrictives sur l’immigration et par des programmes sociaux qui la considéraient comme une personne sans valeur et comme une étrangère.
Des cas comme celui de Sara montrent comment, au nom de la « sécurité publique et nationale », les migrantes et migrants à statut précaire paient un prix élevé pour leur situation d’exploitation. Le Canada prétend soutenir « l’autonomisation » des survivantes de la traite dans sa Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, dont un pilier entier est consacré à la « protection des survivantes[4] ». Cependant, d’après mon expérience, on fait bien peu pour supprimer les nombreux obstacles bureaucratiques et administratifs qui empêchent les migrantes à statut précaire de satisfaire leurs besoins et de vivre dans la dignité. La perte du statut d’immigrant est l’une des conséquences les plus courantes de l’exploitation, et les trafiquants s’en servent souvent pour intimider et contraindre les migrantes. Cette tactique est efficace, puisque la criminalisation et la détention sont des risques très réels pour les migrantes racisées à statut précaire qui entrent en contact avec les forces de l’ordre.
La « victime parfaite »
La représentation répandue de la traite des personnes au Canada demeure un stéréotype centré sur le récit d’un sauvetage de la « victime parfaite[5] ». Ce stéréotype continue d’imprégner et d’influencer le discours social et politique dominant sur la traite. Il charrie un sous-texte de bienveillance et d’humanisme que le Canada ne prodigue généralement pas aux communautés migrantes ou racialisées.
En effet, une interprétation aussi étroite de ce qui constitue la traite, de ses conséquences et de ce qu’est une survivante porte gravement préjudice aux communautés migrantes. Elle crée des barrières importantes pour les migrantes racisées à statut précaire qui ne peuvent accéder à certains recours et ressources; loin d’être facilement accessibles, ces avantages exigent souvent un statut d’immigration légal. Cette vision exclut les nombreuses formes d’exploitation qui touchent les communautés vulnérables comme les travailleurs agricoles, les aides-soignantes et les autres travailleuses et travailleurs migrants ne correspondant généralement pas au moule de la « victime parfaite ». En outre, ce récit ignore le fait que de nombreuses migrantes victimes de la traite sont criminalisées en raison de leur propre exploitation. Il tend également à détourner l’attention des causes profondes de la traite des personnes, causes qui découlent des mêmes forces d’oppression et de violence systémique au cœur de nombreux autres problèmes de justice sociale.
Les causes profondes de la traite des personnes
Les moteurs de la traite se trouvent dans les inégalités structurelles. Il s’agit notamment de politiques et de lois adoptées au niveau des États, ainsi que des pratiques culturelles normatives qui empêchent certaines personnes d’exercer leurs droits et d’accéder aux ressources dont elles ont besoin et qu’elles méritent par ailleurs[6]. Les inégalités que doivent affronter les migrantes racisées à l’échelle mondiale ont été forgées par des formes contemporaines et historiques de colonialisme et de politiques économiques néolibérales, ce qui a entraîné une distribution extrêmement inégale de la richesse et des ressources. Cela permet de comprendre comment fonctionne la traite des personnes au Canada et à l’échelle internationale, particulièrement pour de nombreuses communautés autochtones et migrantes racisées du Sud.
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à migrer pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, un phénomène que l’on appelle parfois la « féminisation de la migration[7] ». La migration forcée due à de mauvaises conditions de vie ou à d’autres situations dangereuses présente également des risques pour la santé, la sécurité et le bien-être[8]. La demande mondiale de services bon marché, associée à une extrême précarité économique, pousse souvent les femmes à rechercher de meilleures conditions de subsistance à l’étranger.
Cependant, la plupart des emplois offerts aux migrantes racisées sont des emplois « sales, dangereux et dégradants[9] » ; en d’autres termes, il s’agit d’emplois qui ont peu de valeur sociale, mal rémunérés et susceptibles d’exposer les femmes migrantes à des pratiques d’exploitation ou de discrimination, comme dans le cas du travail domestique ou du travail de soignante[10].
Le spectre de l’exploitation
En outre, les femmes migrantes racisées sont souvent considérées comme des travailleuses recherchées, parce que les personnes et les institutions du Nord sont convaincues qu’elles sont « moins chères, plus travaillantes et soumises[11] ». La perception problématique comme quoi les femmes migrantes accepteraient des conditions d’emploi et de vie inférieures aux normes ouvre la voie à l’exploitation et à la traite. Cette perspective est également ancrée dans les lois canadiennes sur l’immigration, qui appliquent un programme économique néolibéral visant à répondre aux besoins à court terme du marché du travail et qui traitent les migrants comme une source de main-d’œuvre bon marché et jetable. L’exploitation est en outre facilitée par des politiques d’immigration intrinsèquement dommageables, comme le système de « permis de travail fermé » qui lie le statut d’immigration d’une personne à une tierce partie, comme un employeur ou un conjoint.
Il est bien connu que les programmes utilisant des permis de travail fermés, comme le Programme des travailleurs étrangers temporaires ou le Programme des aides familiaux résidants (aujourd’hui aboli), ont donné lieu à de nombreux abus de la part des employeurs[12]. Ce sont les membres les plus marginalisés des communautés migrantes qui font les frais de ces politiques et pratiques d’exploitation ; et les migrantes racisées sont touchées de façon disproportionnée[13]. Les nombreuses travailleuses et travailleurs domestiques migrants que j’ai côtoyés à Montréal ont été victimes de graves violations des droits de la personne et d’autres types de sévices qui s’inscrivent dans le « spectre de l’exploitation ». De plus, ces personnes passent continuellement à travers les mailles des recours juridiques et des programmes sociaux conçus pour aider les personnes vulnérables, ce qui rend leurs problèmes invisibles.
Vers une approche de la traite centrée sur les droits de la personne et le vécu des survivantes
Adopter une approche de la traite centrée sur les droits de la personne et sur les survivantes signifie prévenir l’exploitation en rendant notre société plus juste et équitable. Pour faire respecter les droits des migrantes racisées, il faut modifier les institutions et les pratiques qui maintiennent l’inégalité structurelle.
En plaçant la « sécurité nationale » au-dessus de la protection du droit individuel à la sécurité et à la justice, nous laissons sur le pavé les migrantes racisées. Cette approche basée sur « la loi et l’ordre » fait du tort aux survivantes, ne contribue guère à prévenir la traite de celles-ci et peut même les exposer à une exploitation supplémentaire si elles sont expulsées vers leur pays d’origine. Il faut en finir avec les « récits de sauvetage », ne plus mettre l’accent sur le « crime » et les « frontières violées », mais sur les conditions dans lesquelles les migrantes sont forcées d’arriver et de vivre au Canada[14].
En outre, l’absence de protections juridiques significatives en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et l’absence de voie directe vers un statut permanent constituent un obstacle important pour les personnes migrantes victimes de la traite qui cherchent à obtenir réparation ainsi qu’un moyen de stabiliser leur vie après l’exploitation. Plus précisément, le principal outil permettant à ces migrants de régulariser leur statut d’immigration – le permis de séjour temporaire pour les victimes de la traite des personnes (PST-VTP) – reste un mécanisme discrétionnaire et faible pour soutenir certaines et certains membres les plus vulnérables de notre société. L’utilisation incohérente de ce permis reflète la façon dont les migrantes victimes de la traite sont souvent traitées : avec suspicion, et comme si elles étaient des menaces potentielles à la sécurité publique, plutôt que comme des personnes ayant des droits et des motifs légitimes de rester au Canada.
Le Canada s’est engagé à reconnaître et à faire respecter les droits établis en vertu de divers traités internationaux sur les droits, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Plusieurs militants affirment que pour honorer ses engagements, le Canada doit offrir à toutes et à tous, y compris aux migrantes et migrants sans statut, un accès égal aux droits civils, politiques, économiques et socioculturels. Dans cette optique, le statut d’immigrant ne devrait pas constituer un obstacle à l’exercice, par les migrants, de leurs droits les plus fondamentaux au Canada.
Les points de départ pour l’adoption d’une approche de la traite centrée sur les droits de la personne et des survivantes comprennent l’abolition des permis de travail « fermés » qui lient les individus à un seul employeur ; la création d’une politique d’immigration équitable qui permet une immigration permanente pour les personnes de tous les horizons, y compris les survivantes de la traite ; la fin de la détention des immigrantes et immigrants ; et pour finir, des investissements conséquents dans des initiatives communautaires axées sur l’élimination des inégalités structurelles et de la violence systémique.
Il est grand temps que le Canada traite les survivantes de la traite et les communautés de migrants avec le respect et la dignité qu’elles et ils méritent. Les migrantes victimes de la traite des personnes ne sont pas des « autres ». Elles sont membres de nos communautés, et leurs droits, leur bien-être sont directement liés aux nôtres.
Leah Woolner est coordonnatrice bilingue du Réseau des femmes et chercheuse associée à l’Université McGill.
- Klara Skrivankova, Between decent work and forced labour : examining the continuum of exploitation, York (Angleterre), Fondation Joseph Rowntree, 2010. ↑
- Estibaliz Jimenez, « La criminalisation du trafic de migrants au Canada », Criminologie, vol. 46, n° 1, 2013. ↑
- Pseudonyme utilisé pour protéger l’identité de cette personne. ↑
- Sécurité publique Canada, Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2019-2024, Ottawa, Gouvernement du Canada, 2019, <www.passengerprotect-protectiondespassagers.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ntnl-strtgy-hmnn-trffc/2019-ntnl-strtgy-hmnn-trffc-fr.pdf>. ↑
- Voir Jayashri Srikantiah, « Perfect victims and real survivors. The iconic victim in domestic human trafficking law », Boston University Law Review, vol. 87, n° 1, 2007, p. 157. ↑
- Laura Barnett, La traite des personnes, Publication n° 2011-59-F, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, 2011, révisé 2016, < https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2011-59-f.pdf>. ↑
- Paulina Lucio Maymon, « The feminization of migration. Why are women moving more ? », Cornell Policy Review, 5 mai 2007, <http://www.cornellpolicyreview.com/the-feminization-of-migration-why-are-women-moving-more/>. ↑
- Cathy Zimmerman et Rosilyne Borland, Caring for Trafficked Persons. Guidance for Health Providers, Organisation internationale pour les migrations, 2009. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ct_handbook.pdf>. ↑
- En anglais, on parle des emplois « 3-D » : dangerous, dirty, degrading ou difficult. ↑
- Manolo I. Abella, « Migrant workers’ rights are not negotiable », dans Migrants Workers, Labour Education 2002/4 n° 129, Organisation internationale du travail, 2002, <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—actrav/documents/publication/wcms_111462.pdf>. ↑
- Ibid. ↑
- Fay Faraday, Made in Canada. How the Law Constructs Migrant Workers’ Insecurity, Toronto, Metcalf Foundation, septembre 2012. ↑
- Jacqueline Oxman-Martinez, Andrea Martinez et Jill Hanley, « Trafficking women : gendered impacts of canadian immigration policies », Journal of Migration and Integration, vol. 2, n° 3, 2001, p. 297-313. ↑
- Jennifer K. Lobasz, « Beyond border security : feminist approaches to human trafficking », Security Studies, vol. 18, n° 2, 2009, p. 319 – 344. ↑

Même si la Russie capture Kiev, Poutine a déjà été vaincu après avoir déclenché une guerre impossible à gagner

Les chars et l’artillerie russes se déploient pour attaquer Kiev et Kharkiv, mais, même s’ils réussissent à capturer les villes, cela ne changera rien au fait que la Russie a déjà été vaincue dans la guerre en Ukraine .
Le président Vladimir Poutine a lancé une guerre qu’il ne pourrait jamais gagner contre 44 millions d’Ukrainiens soutenus par les États-Unis et l’Europe dans l’attente folle que sa campagne militaire serait une promenade de santé. Ce faisant, il a uni le reste de l’Europe contre la Russie, forçant l’Allemagne, la France et l’Italie à s’aligner sur les États-Unis et la Grande-Bretagne, plus radicaux, à un degré jamais vu, même au plus fort de la guerre froide contre l’Union soviétique.
Mais la nature et le moment de la défaite russe restent d’une importance cruciale car la Russie reste une superpuissance nucléaire , techniquement capable de tuer une grande partie de la population de la planète. Si la guerre en Ukraine se poursuit pendant longtemps, il est trop facile de voir comment la guerre russe en Ukraine pourrait dégénérer en un conflit conventionnel contre l’OTAN, puis basculer dans un échange nucléaire.
La faiblesse même de Moscou exposée au cours de la semaine dernière rend plus probable qu’elle considérerait l’option nucléaire comme la seule carte de grande valeur qui lui reste face aux forces supérieures de l’OTAN. De plus, les erreurs de jugement paranoïaques de Poutine suggèrent que ses décisions sur le déploiement d’armes nucléaires pourraient être tout aussi irrationnelles.
La guerre nucléaire est peut-être encore une perspective lointaine, mais elle est plus proche qu’elle ne l’était il y a une semaine. Cela rend une sortie diplomatique de la crise ukrainienne particulièrement attrayante plutôt que de la laisser s’aggraver encore, même si l’issue finale ne fait aucun doute. La Chine – dernier allié important de la Russie, quoique de plus en plus éloigné – dit, après des discussions avec l’Ukraine, qu’elle est prête à aider à négocier un cessez-le-feu. Il s’est abstenu plutôt qu’il n’a opposé son veto à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU condamnant l’invasion et s’est dit « extrêmement préoccupé par les dommages causés aux civils ». La Chine semble avoir été prise par surprise par l’invasion elle-même, ridiculisant les avertissements occidentaux et n’évacuant pas les citoyens chinois.
Il y aura un élément d’autoprotection dans la position chinoise. Ils ne voudront pas être entachés par les conséquences de l’erreur directe de Poutine ou devenir la cible de sanctions.
La Russie et l’Ukraine ont eu un cycle de négociations et ont toutes deux déclaré qu’elles étaient disposées à participer à un autre mercredi. Le président Volodymyr Zelensky dit que les bombardements devront cesser avant qu’il y ait des négociations, mais la probabilité est une escalade et non une désescalade.
Non seulement les bombardements ne s’arrêtent pas, mais ils deviennent de plus en plus intenses. La Russie semble planifier des assauts militaires traditionnels sur Kiev et Kharkiv, en utilisant des chars et de l’infanterie soutenus par la puissance de feu de l’artillerie et des frappes aériennes. Les Russes diront probablement aux civils de partir avant qu’ils n’attaquent ou ne soient traités comme des combattants.
Si cela se produit, cela pourrait déclencher un exode massif qui sauvera des vies, mais en même temps paralysera les villes ukrainiennes en tant que centres politiques, administratifs, commerciaux et informationnels. C’était le schéma des sièges en Syrie, en Irak, au Liban et à Gaza au cours des 40 dernières années, quelle que soit la nationalité de l’armée assiégeante.
La Russie paiera inévitablement un lourd tribut pour ce style de guerre brutal, car chaque civil tué ou blessé dans un bombardement sera photographié sur une caméra de téléphone portable et les atrocités seront diffusées dans le monde entier. Cela renforcera encore le statut de paria de la Russie et rendra les négociations plus difficiles.
Même si les principales villes ukrainiennes tombent, la résistance se poursuivra dans le reste du pays, et il est peu probable que l’armée russe ait les effectifs nécessaires pour la réprimer.
Un problème pour accepter un cessez-le-feu est que le plan d’invasion de Poutine n’avait de sens que si les troupes russes étaient accueillies à bras ouverts par la population ukrainienne. Comme on pouvait s’y attendre, cela ne s’est pas produit, mais Poutine a fait des demandes maximalistes équivalant à la reddition inconditionnelle du gouvernement ukrainien, dénoncé par Poutine comme « néo-nazis », et pour que l’armée ukrainienne remette ses armes. Des demandes moindres auraient pu inclure une promesse de l’Ukraine de ne pas rejoindre l’OTAN et de reconnaître l’annexion de la Crimée.
Il est donc difficile pour Poutine de se retirer simplement sans atteindre aucun de ses objectifs en Ukraine et après avoir payé un lourd tribut en sanctions, qui étrangleront l’économie russe pour les années à venir. L’une des principales raisons de l’arrivée au pouvoir de Poutine était qu’il semblait garantir que la crise financière russe d’août 1998 ne se reproduirait pas, pourtant près d’un quart de siècle plus tard, c’est exactement ce qu’il a assuré.
Il sera venu à l’esprit de nombreux Russes en privé que tout accord de paix mettant fin à cette guerre serait moins préjudiciable à la Russie si Poutine ne détenait plus le pouvoir au Kremlin. Mais se débarrasser de lui après 22 ans est une autre affaire. Saddam Hussein s’est accroché en tant que dirigeant irakien pendant 13 ans après son invasion calamiteuse du Koweït en 1990, qui est l’épisode de l’histoire moderne qui ressemble le plus à la décision de Poutine d’envahir l’Ukraine.

Un premier hommage à Pierre Beaudet

Pierre était un ami, un camarade, un frère. Pierre est toujours présent et l’avenir sera marqué par ce tout qu’il a apporté. En préparant ce premier hommage, il y a tellement de souvenirs qui me remontent en mémoire ! Je vais commencer par quelques retours et j’y reviendrai dans les différentes manifestations d’hommages qui lui seront rendus.
Pierre était un roc sur lequel on pouvait s’appuyer. Un roc plein d’humour et d’humanité. Il aimait la vie et la révolution. Rêver et travailler à faire vivre la révolution n’est-ce pas le meilleur moyen d’aimer la vie en oeuvrant à construire un monde plus juste et plus fraternel ?
Dans les années 1980, Marc Mangenot nous apprend qu’un lieu de résistance, une librairie de Montréal, est interdite et va fermer. Le cedetim exprime sa solidarité. Nous faisons la connaissance d’un jeune homme engagé dans le mouvement indépendantiste radical québécois et très attentif aux revendications des peuples premiers du Canada. C’est la première rencontre avec Pierre Beaudet. Commence alors une amitié de quarante ans qui ne se démentira jamais.
Pierre rappellera son parcours dans On a raison de se révolter, une chronique des années 1970. Il raconte les deux pôles de son engagement, d’un côté la transformation radicale de la société québécoise et de l’autre les mouvements révolutionnaires dans le monde. En 1994, il participe à la création d’Alternatives avec la détermination de créer une association radicale construite à partir d’un mouvement large. Il s’agit de démontrer dans la pratique qu’on peut ne pas se laisser entraîner par certaines des dérives de l’ongéisation tout en pratiquant une ouverture qui permet d’appuyer les mouvements qui défendent des perspectives radicales en matière de défense des droits fondamentaux. C’est l’émergence des mouvements sociaux et politiques qui, sans être des partis politiques, renouvellent l’engagement politique à partir des luttes sociales, politiques et idéologiques. C’est aussi l’ouverture vers les mouvements syndicaux, ouvriers, salariés et paysans, les peuples autochtones, les mouvements des pays du Sud qui s’élargira aux nouvelles radicalités, au féminisme et aux mouvements de genre, à l’écologie et au climat, à la lutte antiraciste et contre les discriminations. C’est l’invention d’une nouvelle culture de l’émancipation.
Pierre va s’engager dans les débats sur le développement à partir d’une démarche critique. Il combinera les approches de l’engagement politique radical avec la pratique dans la conduite de programmes d’action, de la recherche théorique, de l’enseignement. Il inscrira cet engagement dans la discussion critique sur le développement en mettant en avant les grands enjeux de la solidarité et de la coopération internationale. Il analysera les effets négatifs de la mondialisation et soutiendra les pratiques d’autonomie en Afrique, en Amérique Latine et en Asie. Il appuiera directement les actions de mouvements dans de nombreux pays, en Angola, au Brésil, en Inde, au Pakistan, en Afrique du Sud, en Palestine, au Niger, … Chaque fois qu’un mouvement défend son autonomie et s’inscrit dans la défense des droits fondamentaux, il cherchera, à partir de la camaraderie avec les animateurs de ces mouvements, de réunir les moyens pour les renforcer et les faire reconnaître.
Alternatives et le cedetim s’engagent dans une longue histoire commune. D’abord dans le soutien aux mouvements des peuples des pays du Sud. Ensuite, dans l’émergence du mouvement altermondialiste avec les luttes contre la dette et les programmes d’ajustement structurel, contre les politiques des institutions internationales, le FMI, la Banque Mondiale, puis l’OMC. Nous apprendrons beaucoup de choses d’Alternatives. De la longue lutte contre la Zone de Libre échange des Amériques qui commencera dès 1994 jusqu’aux grandes mobilisations de 2001. Et de manière plus directe avec l’expérience internationaliste d’Alternatives, notamment son programme de volontaires qui nous servira à définir le lancement d’Echanges et Partenariats.
En 1998, avec Pierre, nous travaillons à Bruxelles, avec Samir Amin et François Houtard, pour lancer le Forum Mondial des Alternatives, le FMA. Le FMA participera en janvier 1999 au Contre-Sommet de Davos avec quelques organisations, notamment Attac, la KTCU de Corée du Sud, le MST Brésilien, des paysans burkinabés, des femmes québécoises. Ce Contre-Sommet précédera les manifestations contre l’OMC à Seattle en décembre 1999. Et précédera le premier FSM à Porto-Alegre en janvier 2001.
A partir de 2001, l’altermondialisme ouvre une nouvelle période de rencontres et de visibilité internationaliste. C’est le début des Forums sociaux à Porto Alegre en 2001. Dans le même temps, le mouvement québécois joue un rôle majeur dans les mobilisations qui auront raison de la Zone de libre échange des Amériques. Pierre et Alternatives Montréal jouent un rôle de premier plan dans la succession des forums sociaux, à Porto Alegre (2001, 2002, 2003, 2005), Mumbaï (2004), Bamako (2006), Caracas (2006), Karachi (2006), Nairobi (2007), Belem (2009), Dakar (2011), Tunis (2013, 2015), Montréal (2016), Salvador de Bahia (2018).
Pierre et Alternatives Montréal, avec le Cedetim-IPAM à Paris proposent de construire Alternatives International, Alterinter, avec des mouvements luttant contre les injustices sociales, le néolibéralisme, l’impérialisme et la guerre. On y retrouve Alternatives citoyens Niger à Niamey, Alternatives Asie à New Delhi, Alternatives Information Center à Jérusalem, Alternatives Terrazul à Fortaleza, le Forum des Alternatives Maroc à Rabat, Teacher Creative Center à Ramallah, Un Ponte Per à Rome.
La crise financière de 2008 interpelle le mouvement des Forums sociaux mondiaux. Il est clair qu’il s’agit d’une rupture. Le Forum de Belém est l’apogée du processus des FSM. Les mouvements porteurs de nouvelles radicalité émergent dans le Forum. Le mouvement paysan, le mouvement féministe, les peuples autochtones, les mouvements antiracistes et contre les discriminations, les migrants mettent en avant l’hypothèse d’une crise de civilisation, de la civilisation qui s’est imposée depuis 1492. La proposition d’un possible compromis, celui d’un green new deal, avancé par la commission des Nations Unies présidée par Joseph Stiglitz et Amartya Sen, fait long feu. C’est l’austéritarisme qui s’impose, une nouvelle version du néolibéralisme combinant austérité et autoritarisme. Les contradictions s’exacerbent avec les insurrections et les flambées des printemps arabes, des indignados et des occupy d’un côté et de l’autre les répressions, les dictatures et les guerres. Pierre développe dans cette période ses capacités de pessimisme actif, soucieux des échecs et des répressions et attentif à tout ce qui émerge de nouveau. Il n’anime plus Alternatives ; il se plonge dans l’enseignement et s’investit dans le mouvement social au Québec.
En 2010, nous sommes à Ramallah au Forum Mondial sur l’éducation ; Alterinter accompagne Refaat qui avec le Teacher Creative Center, est un des principaux animateurs du Forum de Ramallah. Nous discutons à trois, Pierre, Vinod et moi de la situation. Nous savons qu’il faut renouveler fondamentalement le processus des forums et nous savons qu’en attendant de dégager une nouvelle voie, il faut continuer à les assumer. Que faire alors ? Dans la discussion animée qui s’engage, nous nous retrouvons à partir d’une phrase de Gramcsi, sur la nécessité d’un intellectuel collectif international des mouvements sociaux. Nous venons de lancer intercoll. C’est le lancement d’un nouveau projet qui va bien nous occuper. C’est avec une grande tristesse que nous assistons au départ de Vinod qui nous a tant apporté.
Nous commençons par une rencontre internationale à Paris. Puis, avec le soutien de Pierre, Shenjing et Mei organisent un séminaire à Taiwan avec des intellectuels chinois engagés dans les différents courants d’opinion en Chine. Pierre fera un exposé brillant définissant intercoll ; il expliquera que le défi est d’être capable de traduire les concepts dans les différentes cultures pour construire une culture d’engagement international. Ainsi dira-t-il, il s’agit de savoir comment les différentes cultures pourront comprendre et s’approprier une nouvelle notion comme « buen vivir » qu’on ne peut réduire à « bien vivre ». Nicolas Haeringer fera évoluer intercoll vers intercoll.net, un réseau de sites internet. Et Glauber le développera dans plusieurs directions. Pierre va créer à Montréal, avec Ronald Cameron, Plateforme altermondialiste qui sera un des vecteurs d’intercoll.
Chaque fois que je retourne dans mes souvenirs, je retrouve des échanges avec Pierre, des interrogations et des réflexions. Et, à chaque fois, les discussions s’orientent vers des interrogations fondamentales, un retour sur nos sources de référence autour du marxisme et de l’internationalisme. Et à chaque fois, la discussion s’oriente vers des propositions d’initiatives innovantes, de nouveaux chemins à explorer, de nouveaux engagements, vers l’optimisme de la volonté.
Pierre aimait écrire et il écrivait beaucoup et très bien. Il aimait les livres, les revues et les journaux. On peut retrouver sur internet les 579 articles qu’il va rédiger pour Presse toi à gauche. Il lance Plateforme altermondialiste et aussi Les nouveaux cahiers du socialisme. Il prépare des livres qu’il compose, pour chaque livre, avec une équipe de trois ou quatre personnes et dans lesquels il donne la parole et il suscite des contributions multiples. C’était un magnifique éditeur internationaliste. On trouvera ci-dessous les titres de quelques un des livres qu’il a écrit et coordonné.
Pierre avait une volonté farouche et une grande force de travail. Il savait que la révolution n’était pas l’arrivée dans un monde meilleur, un genre de paradis, la résolution de toutes les contradictions. Mais il savait que chaque révolution ouvre un nouveau monde, des nouveaux possibles ; qu’elle permet un dépassement, un dépassement de soi, qu’elle crée de l’inattendu et renouvelle l’espoir. Son histoire, c’est celle de la passion et l’engagement. Avec parfois et même souvent, des déceptions et des échecs, des défaites. Mais sans jamais tomber dans la désillusion et le renoncement. Avec sa capacité de résistance, sa volonté farouche et son enthousiasme intact.
Pierre avait son Internationale formée par toutes celles et tous ceux, dans toutes les parties du monde, qu’il aimait et qui l’aimaient. Je voudrais dire toute mon affection à ses ami.e.s et camarades. En commençant par Anne, Alexandre et Victor qui ont contribué à sa force et à ce qu’il a apporté pour l’avenir d’un autre monde possible, d’un nouveau monde meilleur et juste.
Quelques livres de Pierre Beaudet
- – Pierre Beaudet, Les grandes mutations de l’apartheid, Ed L’Harmattan, 1991
- – Pierre Beaudet, On a raison de se révolter, Ed Ecosociété, 2008
- – Pierre Beaudet , Jessica Schafer , Paul Haslam, Introduction au développement international, Ed PUO, 2008
- – Pierre Beaudet, Qui aide qui ?, Ed Boréal, 2009
- – Pierre Beaudet, Raphaël Canet, Marie-José Massicotte, L’altermondialisme : Forums sociaux, résistances et nouvelle culture politique, Ed Ecosociété, 2010
- – Flavie Achard, Sébastien Bouchard, Pierre Beaulne, Pierre Beaudet, Etat : pouvoirs et contre-pouvoirs – Nouveaux cahiers sociaux, 2010, Ed Ecosociété
- – Pierre Beaudet, F. Guillaume Dufour, Andréa Lévy, Louis Marion, Sid Ahmed Soussi,
- « Du Prolétariat au précariat. Le travail à l’ombre du capitalisme contemporain »Les nouveaux cahiers du socialisme, 2012
- – Pierre Beaudet, Marc Becker, José Carlos Mariategui, Harry E. Vanden, Indianisme et paysannerie en Amérique latine: socialisme et libération, Ed Syllepse, 2013
- – Pierre Beaudet, Raphael Canet, Amélie Nguyen, Passer de la réflexion à l’action, Les grands enjeux de la coopération et de la solidarité internationale. Ed M 2013
- – Pierre Beaudet, Thierry Drapeau, L’internationale sera le genre humain, de l’Association internationale des travailleurs à aujourd’hui, Ed M, 2015
- – Pierre Beaudet, Quel socialisme? Quelle démocratie?, Ed Varia Québec, 2016
- – Pierre Beaudet, Un jour à Luanda, Ed Varia Québec, 2018

La discrimination par la porte d’en arrière

À partir des théories de la colonialité du pouvoir[2], nous proposons une lecture des effets socioéconomiques du débat et de l’adoption de la loi 21, la Loi sur la laïcité de l’État, sur les groupes ciblés, particulièrement des femmes musulmanes et racisées. Par cet article, nous voulons contribuer à mettre en lumière l’un des angles négligés dans les analyses critiques du nationalisme identitaire au Québec, à savoir les effets simultanés du racisme, du capitalisme et du patriarcat dans le vécu des personnes racisées.
De la colonialité
L’une des thèses centrales des théoriciennes et théoriciens décoloniaux est que la colonialité n’est pas un événement historique limité dans le temps, mais un processus qui a encore lieu présentement, c’est-à-dire que la structure des rapports de pouvoir que nous connaissons à l’échelle globale se base sur les rapports de pouvoir construits progressivement à partir de 1492 sur la douloureuse expérience sociohistorique du colonialisme et de l’esclavage. L’eurocentrisme chrétien imposé par les colonisateurs aux Autochtones des Amériques par la colonisation et aux Noir·e·s par l’esclavage a participé à configurer des catégories et des identités de race, de genre et de sexualité, des catégories sur lesquelles s’exerce le pouvoir aujourd’hui.
Alors que le colonialisme classique, avec siège dans la métropole, s’est transformé, donnant lieu à d’autres modalités et structures de domination (protectorats, néocolonialisme exercé par des moyens économiques, etc.), la colonialité inscrite dans les rapports de pouvoir peut se définir comme la « radicalisation et naturalisation de la non-éthique de la guerre[3] ».
Construction de la hiérarchisation
Comme l’ont montré les féministes autochtones, noires et chicanas, les catégories de race, de genre et de sexualité assignent un statut d’infériorité aux groupes racisés et ethnicisés et imposent des régimes oppressifs : capitaliste/racial/genré/hétérosexiste. Autrement dit, la colonialité constitue le lieu d’énonciation qui rend possible un système-monde basé sur de nombreuses hiérarchisations qui opèrent à la faveur de l’homme blanc européen chrétien. Ramón Grosfoguel résume ainsi ces hiérarchies : 1- hiérarchie de classe; 2- division internationale à l’ethnoraciale globale; 5- hiérarchie de genre; 6- hiérarchie sexuelle; 7- hiérarchie spirituelle à la faveur des chrétiens; 8- hiérarchie épistémique; 9- hiérarchie linguistique (langues européennes versus non européennes)[4].
La « menace musulmane »
Au Québec, les débats sur la loi 21 ont contribué à stigmatiser davantage des communautés et des individus déjà fortement affectés par le racisme et la discrimination, et plus spécifiquement les femmes musulmanes, les communautés juives et sikhes. Ces débats sont survenus dans un contexte où l’islamophobie et la violence contre les musulmans et les musulmanes ont pris une ampleur alarmante[5]. Ils s’inscrivent en continuité avec les discussions antérieures sur les accommodements raisonnables (2006-2008) et sur le projet de loi 60, souvent dénommé « charte des valeurs » (2014), des moments qui ont tous servi à ventiler des discours racistes de plus en plus ouverts[6] et qui participaient à construire une image des minorités religieuses, et plus spécifiquement des musulmans et musulmanes, comme étant une sérieuse menace pour la société québécoise. Dans ces discours, l’image des femmes voilées est construite sur une dualité contradictoire qui présente celles-ci tantôt comme les vecteurs redoutables de l’islamisme qui tendent à radicaliser les jeunes et tantôt comme des femmes soumises, et par ce fait, représentant un recul pour les droits des femmes québécoises.
Les figures d’autorité
Lors de l’étude de la loi 21, un échange qui illustre le fonctionnement contemporain de la colonialité du pouvoir a eu lieu. L’échange mettait en scène des figures d’autorité importantes : le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (l’autorité politique) d’une part, et le sociologue émérite du Québec d’autre part (l’autorité scientifique). Guy Rocher prenait le contrepoids de l’historien Gérard Bouchard, opposé à la loi 21, qui avait insisté sur le manque de preuves scientifiques concernant l’éventuel endoctrinement des élèves de la part des enseignantes portant le hijab. À la défense du ministre, Guy Rocher a avoué qu’on ne peut pas faire la preuve scientifique de la mauvaise influence des professeur·e·s qui portent des signes religieux, mais que, dans l’état d’incertitude, il fallait appliquer le « principe de précaution » contre les « risques possibles » pour protéger les élèves, les enseignantes et enseignants et les parents. Ce dialogue télévisé entre deux importantes figures d’autorité qui discutent sur la « preuve » du danger que représentent les musulmans et les musulmanes ne peut qu’encourager les propos injurieux, racistes et les actes discriminatoires et haineux, déjà à la hausse[7].
Le rituel et le langage
Les rapports coloniaux de pouvoir ainsi « performés » ont gagné en acceptabilité par la force de leur répétition, dans une sorte d’itération offensive, pour reprendre l’expression de Judith Butler[8]. La réalisation de ce rituel a été orchestrée par l’État à travers la mise en scène répétée des commissions dans un contexte où « la division entre le laïc et le religieux a, en fait, fonctionné comme une ligne de couleur qui marque la différence entre l’Occident moderne et éclairé et des musulman·e·s tribaux et religieux[9] ». La loi 21 constitue désormais la mise en acte qui rend concevable et acceptable de retirer un droit fondamental à des minorités religieuses racialisées, au nom d’un danger dont il n’est plus nécessaire de faire la preuve.
Racisme, sexisme et inégalités
La colonialité du pouvoir porte en elle une logique économique qui participe à organiser le capitalisme à l’échelle globale et la distribution mondiale du travail à la faveur de l’Europe. Elle a produit le système-monde capitaliste où la main-d’œuvre bon marché (cheap labor) se trouve dans les périphéries[10] selon une distribution racisée et genrée du travail qui opère de façon à positionner les descendantes et les descendants des sociétés colonisées et mises en esclavage en bas de l’échelle économique. La hiérarchisation des relations raciales, sexuelles, spirituelles, épistémiques et de genre sont constitutives de ce système-monde capitaliste. À l’ère néolibérale, on assiste à une accélération des inégalités entre le Sud global et le Nord global où les femmes racisées sont particulièrement affectées. Les logiques du capitalisme global créent un besoin de main-d’œuvre bon marché que les femmes issues du Sud global doivent combler. Il n’est donc pas imprudent de parler d’une surreprésentation des femmes racisées dans les emplois précaires (« femmes de ménage », services et restauration, garde d’enfants, etc.) des grandes villes du centre[11]. Les femmes de couleur se retrouvent confinées au double travail reproductif, payé et non payé, et cela est rendu possible par des mécanismes relationnels et imbriqués de race et de genre, dont l’analyse est souvent absente dans les perspectives féministes classiques. Dans les représentations dégradantes de la féminité racialisée qui découlent de l’esclavage et du colonialisme, les femmes racialisées sont considérées comme aptes à faire les tâches ingrates. Les effets structurels de la division du travail sont alimentés par des mécanismes oppressifs de racisme et de sexisme qui se cachent derrière le discours des compétences ou de l’éducation.
L’expérience québécoise
Au Québec, les stéréotypes négatifs dominants sur les femmes portant le hijab, qui ont acquis une légitimité juridique grâce à loi 21, participent à une logique raciste, patriarcale et capitaliste qui précarise les femmes musulmanes en les rendant davantage exploitables. Cela ne fera que renforcer les inégalités sociales qui affectent particulièrement les immigrantes issues d’anciennes colonies, dont les femmes musulmanes. En effet, au Québec, ces femmes immigrantes racisées sont surreprésentées dans les emplois précaires et dévalorisés comme la garde d’enfants et les soins des personnes âgées. Paradoxalement, les féministes nationalistes (que Farris[12] qualifie de fémonationalistes) se sont peu efforcées de dénoncer les conditions socioéconomiques précaires des femmes racisées et musulmanes, et ont, elles aussi, mis l’accent sur le danger du hijab.
Les résultats
Les exclusions prévues dans la loi 21 sont l’aboutissement de plusieurs tentatives de marginalisation économique des femmes musulmanes puisqu’il était déjà question pendant le débat autour de la « charte des valeurs » de leur interdire le travail dans les milieux de garde d’enfants. Or, le travail en milieu de garde offre plusieurs possibilités aux femmes racisées, ce qui leur permet de contourner les effets de la discrimination à l’embauche – en étant à leur compte ou en travaillant avec d’autres femmes racisées – et leur donne la possibilité d’un emploi à temps partiel, localisé dans les quartiers qu’elles habitent, afin de conjuguer travail et responsabilités familiales.
Une étude, dont l’objectif était d’établir le profil des femmes de l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, a démontré que le lieu de naissance à l’étranger et la langue maternelle précarisent davantage certaines femmes :
- 78,1 % des répondantes ont un revenu de moins de 30 000 dollars par année;
- le pourcentage augmente à 81,1 % lorsqu’on considère les femmes nées à l’extérieur du Canada;
- le pourcentage augmente à 89,5 % pour les femmes nées à l’extérieur du Canada et parlant l’arabe;
- malgré le fait que les répondantes de notre échantillon soient souvent plus scolarisées que la moyenne québécoise, leur revenu se loge dans les catégories les plus faibles;
- l’impact du faible revenu est d’autant plus important si l’on tient compte du fait que les logements où le nombre d’habitants est le plus élevé se situent dans les catégories de revenus les plus faibles (entre 2 et 6 personnes).
Conclusion
Même si le gouvernement québécois a présenté la Loi sur la laïcité de l’État comme une mesure progressiste et « modérée », celle-ci permet plutôt d’institutionnaliser le sexisme, le racisme et la discrimination à l’emploi. Le racisme ambiant, amplifié par le débat sur la loi 21 et les mesures concrètes établies par cette loi consolident les hiérarchies économiques et les mécanismes d’inégalité constitutifs de la colonialité. Cette loi fait partie d’un processus à travers lequel le gouvernement de la Coalition avenir Québec fait la promotion d’une société exclusive, marquée par des écarts socioéconomiques importants et stables, processus dont fait aussi partie la législation en matière d’immigration, qui, entre autres, vise à la fois à réduire le nombre d’immigrants et d’immigrantes et à augmenter la « bonne » immigration, c’est-à-dire celle des Européens et Européennes.
On assiste un peu partout à une multiplication des lois visant les musulmans et les musulmanes. Il suffit de rappeler le décret du président étatsunien Donald Trump Protéger la nation de l’entrée de terroristes étrangers (2017), la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques en France, l’interdiction de construction de minarets en Suisse ou, pire encore, la nouvelle loi sur la citoyenneté en Inde (2019). Dans tous ces cas de figure, un groupe dominant discute, statue et légifère sur les droits d’une minorité. Ce qui nous apparaît le plus inquiétant, ce sont les processus qui, non seulement ont rendu possibles ces lois, mais surtout la manière dont ces processus déplacent le curseur de l’indicible en matière d’actes et de discours sur les musulmans et les musulmanes.
Finalement, les différents débats sur les minorités religieuses menés par le groupe dominant de la société au nom des valeurs d’une société québécoise, dont l’épisode de la loi 21, participent à une subalternisation de groupes et de personnes racisées. La subalternisation en question opère en même temps que le renforcement d’une place privilégiée pour les Québécois et les Québécoises de descendance européenne. Les places contraires occupées par les subalternes et les privilégiés renvoient ici à une dynamique relationnelle qui, d’un côté, construit les aspects symboliques, où les personnes eurodescendantes sont associées aux bonnes valeurs, à la bonne religion et à la bonne culture. Dans cette construction symbolique, le déni des oppressions historiques que vivent les personnes issues des sociétés anciennement colonisées se fait au profit de la valorisation d’une certaine culture québécoise construite comme blanche et eurodescendante. L’autre aspect de la dynamique qui construit les subalternes et les privilégiés est la transformation de ce capital symbolique et social en bien-être matériel. Les discussions qui ont entouré la loi 21 confortent et consolident les préjugés racistes qui sont à la base des taux de chômage plus élevés des personnes racisées, de leur déqualification professionnelle et de leurs conditions précaires de vie. La loi 21 représente un plafond qui, loin d’être invisible, est ostentatoirement dressé contre les femmes musulmanes.
Leila Benhadjoudja, Leila Celis[1] sont Respectivement professeure adjointe à l’École d’études sociologiques et anthropologiques de l’Université d’Ottawa, professeure de sociologie à l’UQAM
- Ce texte est une version abrégée du chapitre écrit par les deux autrices, « Colonialité du pouvoir au temps de la loi 21. Pistes de réflexion », dans Leila Celis, Dia Dabby, Dominique Leydet et Vincent Romani (dir.), Modération ou extrémisme ? Regards critiques sur la loi 21, Québec, Presses de l’Université Laval, 2020. ↑
- Parmi les références sur le concept de colonialité, voir Ramón Grosfoguel, « Les implications des altérités épistémiques dans la redéfinition du capitalisme global », Multitudes, vol. 3, n° 26, 2006, p. 51-74; Walter Mignolo, « Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence coloniale », Multitudes, vol. 3, n° 6, 2001, p. 56-71; Aníbal Quijano, « “Race” et colonialité du pouvoir », Mouvements, vol. 3, n° 51, 2007, p. 111-18. ↑
- Nelson Maldonado-Torres, « On the coloniality of being », Cultural Studies, vol. 21, n° 2-3, 2007, p. 240-270. ↑
- Grosfoguel, op. cit. ↑
- Leila Benhadjoudja, « Laïcité narrative et sécularonationalisme au Québec à l’épreuve de la race, du genre et de la sexualité », Studies in Religion/Sciences Religieuses, vol. 46, n° 2, 2017, p. 72-91. ↑
- Marie-Claude Haince, Yara El-Ghadban et Leïla Benhadjoudja (dir.), Le Québec, la Charte, l’Autre. Et après ?, Montréal, Mémoire d’encrier, 2014; Benhadjoudja, ibid. ↑
- Jean-Sébastien Imbeault et Houda Asal, Les actes haineux à caractère xénophobe, notamment islamophobe : résultats d’une recherche menée à travers le Québec, Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2019. ↑
- Judith Butler, Excitable Speech. A Politics of the Performative, New York, Routledge, 1997. ↑
- Gada Mahrouse, « Minimizing and denying racial violence : insights from the Québec mosque shooting », Canadian Journal of Women and the Law, vol. 30, n° 3, 2018, p. 476. ↑
- Immanuel Wallerstein, Le système du monde, du XVe siècle à nos jours, Paris, Flammarion, 1980. ↑
- Evelyn Nakano Glenn, « De la servitude au travail de service : les continuités historiques de la division raciale du travail reproductif payé », dans Elsa Dorlin (dir.), Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Paris, Presses universitaires de France, 2009, p. 21-63. ↑
- Sara R. Farris, In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism, Durham, Duke University Press, 2017. ↑

La guerre en Ukraine pourrait déclencher une catastrophe au Moyen-Orient

Des Syriens transportent du pain jusqu’à leur maison à Raqa, l’ancienne “capitale” du groupe État islamique (EI) en Syrie. Photo par Delil Souleiman/AFP via Getty Images
Au cours des sept dernières années, dans le cadre d’une campagne militaire caractérisée par un mépris endémique de la vie civile, les bombes, les armes à sous-munitions et les missiles non guidés de Vladimir Poutine se sont abattus sur les écoles, les hôpitaux, les installations d’eau et les élevages de volaille de la Syrie. Aujourd’hui, alors que les forces russes s’inspirent des pages du manuel militaire appliqué en Syrie et répandent la terreur en Ukraine, les économies fragiles du Moyen-Orient – dont beaucoup sont meurtries par la guerre – s’affrontent à un nouveau contrecoup de l’aventurisme du président russe: une insécurité alimentaire encore plus profonde.
Dans de nombreuses économies arabes, le pain représente la majorité des calories consommées. Son coût est une question politique. A l’échelle mondiale, les prix des denrées alimentaires sont à leur plus haut niveau depuis 2011, lorsqu’une flambée du coût de la vie a contribué à déclencher le Printemps arabe. Les gouvernements donateurs ayant considérablement réduit leur aide, le moment actuel ne pourrait pas être pire.
En Egypte, le plus grand importateur de blé au monde – dont 80% provient d’Ukraine et de Russie – le pain est fortement subventionné depuis des décennies. Pour le pain plat baladi (pita), le consommateur paie environ un dixième du prix de production, ce qui le rend abordable pour le tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Si l’Egypte et ses voisins ne peuvent se permettre de maintenir cette subvention face à la hausse rapide des coûts (le blé est déjà 50% plus cher qu’avant l’invasion de l’Ukraine), les résultats politiques pourraient être explosifs.
Un consultant en transport maritime travaillant sur le dossier du Yémen a déclaré au New Statesman que l’Australie proposait désormais de vendre du blé aux entreprises yéménites au prix faramineux de 600 dollars la tonne [fin février-début mars, la tonne se situait autour de 355-360 dollars]. Le blé ukrainien aurait coûté en moyenne environ 255 dollars. De nombreux fournisseurs des Etats-Unis hésitent également à entrer sur le marché yéménite, ont-ils ajouté, en raison de la possibilité que les rebelles houthistes soient à nouveau désignés comme une organisation terroriste [en février 2021, l’administration avait renoncé officiellement à qualifier les rebelles houthistes de terroristes], ce qui aurait des répercussions sur les liens commerciaux et la distribution de l’aide humanitaire aux 17,4 millions de Yéménites en situation d’insécurité alimentaire (selon le Programme alimentaire mondial).
«Le Yémen ne peut plus se nourrir tout seul, alors quand vous avez un choc comme celui-ci sur le marché… c’est désespérément inquiétant», a déclaré Richard Stanforth d’Oxfam, ajoutant que selon ses sources, entre décembre 2021 et mars 2022, 42% des céréales du Yémen provenaient d’Ukraine.
Le Liban, déjà en proie à l’un des plus grands effondrements économiques de l’histoire, importe jusqu’à 90% de son blé et de son huile de cuisson d’Ukraine et de Russie. Face aux pénuries annoncées, il ne lui reste, au mieux, qu’un mois de réserves de blé. Même si les appels lancés par les ministres du Liban aux Etats-Unis pour qu’ils contribuent à financer les réserves d’urgence aboutissent, il n’y a plus aucun endroit où stocker du blé après que les principaux silos à grains ont été éventrés lors de l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020.
Piégé dans une crise déclenchée par des décennies de corruption rampante, le Liban s’est rendu inutilement vulnérable aux chocs du marché mondial. Selon des analystes, le pays n’a pas fait grand-chose pour réduire sa dépendance à l’égard des importations depuis que la gravité de la crise de la sécurité alimentaire s’est révélée avec force il y a deux ans.
Le pain n’est pas le seul problème, explique Richard Stanforth. Les prix des céréales et les pénuries potentielles affectent l’alimentation du bétail dans toute la région. La Russie est également l’un des plus grands exportateurs d’engrais au monde.
Alors que les prix mondiaux du pétrole s’envolent, le Liban et le Yémen sont confrontés à une grave détérioration cumulative de la valeur de leurs monnaies locales: le pouvoir d’achat s’effondre alors que le prix des produits de base nécessaires s’envole. C’est une parfaite tempête. [Dans cette tempête les opérateurs des fonds spéculatifs sur les matières premières alimentaires accentuent l’ampleur des vagues et la force des vents. Ils disposent, aujourd’hui, de données satellitaires qui leur permettent d’anticiper le potentiel de récoltes dans un contexte de crise climatique (incendies liés à la sécheresse en Argentine) et de les articuler, sur les marchés à terme, aux effets à court terme d’une guerre comme celle en cours en Ukraine, en tenant compte ainsi des modifications escomptées des diverses productions internationalisées, sur plusieurs mois. Ce qui est décidé à la Bourse de Chicago se répercute dans l’assiette à trois quarts vide d’une famille paupérisée d’Egypte. Réd.]
Dans le nord du Yémen, contrôlé par les Houthis, il faut déjà trois jours pour atteindre le bout d’une queue de ravitaillement en carburant et pour acheter 20 litres d’essence. Dès lors, beaucoup se rabattent sur le marché noir pour acheter du carburant très cher. Au Liban, les files d’attente pour le carburant commencent à s’allonger à nouveau.
«La majorité des denrées alimentaires du Yémen transitant par le port d’Al-Hodeïda [situé sur la mer Rouge], même si le prix des céréales restait le même, le coût du carburant pour les transporter à travers le pays sera toujours répercuté sur le consommateur», a déclaré Richard Stanforth. Selon l’un de ses collègues yéménites, les détaillants locaux ont été informés qu’ils devaient s’attendre à une nouvelle hausse de 30% du coût des produits à base de blé dans les jours à venir.
«Même si vous pouvez acheter le blé au double du prix, très peu de personnes au Yémen pourront réellement se le permettre», nous a déclaré un représentant de l’un des plus grands importateurs de céréales du Yémen. «Le problème, c’est qu’il n’y a pas d’importation de marchandises contrôlée par l’Etat, tout dépend du secteur privé. Cela signifie qu’il n’y a pas de subventions (comme pour de nombreux autres gouvernements arabes), ce qui laisse le peuple yéménite, déjà affamé, vulnérable à la fluctuation des prix du marché et à la concurrence du secteur privé.»
Le Yémen se prépare à une situation que le Liban ne connaît que trop bien, après un été de graves pénuries de carburant l’année dernière. L’impossibilité de se procurer du carburant peut avoir des conséquences catastrophiques sur l’approvisionnement en électricité des foyers et des hôpitaux, sur les pompes à eau et sur les services Internet.
Deux semaines après le début d’une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres, la crise du carburant et du pain s’étend déjà à tout le Moyen-Orient. L’Egypte a augmenté le prix d’une miche subventionnée pour la première fois depuis les années 1980. Au Liban, le coût de 20 litres de carburant représente plus des deux tiers du salaire minimum. La Syrie rationne le blé. Au cours de la semaine dernière au Yémen, les prix des aliments de base tels que l’huile de tournesol ont augmenté de 40%, les produits laitiers de 30% et le blé de 25%, ce qui a déclenché des achats de panique dans certaines régions à l’approche du Ramadan, qui commence le 2 avril.
Compte tenu de la détérioration de la situation monétaire au Liban, au Yémen, en Syrie et en Afghanistan, de larges pans de la population sont vulnérables aux pénuries alimentaires et aux augmentations des prix du carburant. Les taux de pauvreté, l’insécurité alimentaire et la faim augmentent de jour en jour, laissant les ONG craindre que les budgets d’aide existants – et en diminution – soient détournés vers l’Ukraine.
Au Yémen, des poches de famine sont de retour pour la première fois en deux ans; 90 % des réfugiés syriens au Liban vivent dans une pauvreté abjecte; et plus de 12 millions de Syriens sont confrontés à l’insécurité alimentaire onze ans après le début de la guerre. La crise ukrainienne a déclenché une catastrophe humanitaire de plus en plus grave au Moyen-Orient. (Article publié par The New Statesman, le 15 mars 2022; traduction rédaction A l’Encontre)

Le contentieux constitutionnel dans les années 1960 (1)

Au tournant des années 1970, la question nationale s’enlise dans ce qui est présenté comme un débat constitutionnel. Les camps sont polarisés autour de deux options. D’un côté, les partisans de la souveraineté, regroupés autour du PQ, qui estiment que le cadre canadien est un carcan empêchant la « nation » québécoise de se développer. Seule la souveraineté, affirment-ils, permettra de compléter la Révolution tranquille.
De l’autre côté, les adeptes du « fédéralisme renouvelé », proches de Pierre-E.Trudeau, qui proposent le cadre fédéral comme lieu d’épanouissement et de démocratie. Pour ce deuxième camp, le nationalisme québécois est un « mal absolu », une simple modernisation des idéologies cléricales qui ont dominé sous le duplessisme. Comme dit auparavant, la gauche canadienne et québécoise a partagé en gros cette optique, jusque dans les années 1960 2.
Pour les intellectuels de gauche, notamment ceux qui émergent autour des Cahiers du socialisme, cette polarisation est en grande partie un leurre puisque chacun des deux grands « camps » s’inscrit dans la perspective d’une modernisation capitaliste et surtout, occulte les luttes de classes qui traversent alors l’État, tant l’État fédéral que l’État québécois. Les institutions ne peuvent échapper à l’insertion dans des rapports de classe capitalistes3.
Pour Brunelle (professeur de sociologie à l’UQAM), la gauche doit démêler tout cela et éviter de tomber dans le piège « où il s’agit d’élucider la question de l’enchevêtrement des pouvoirs des bureaucraties fédérale et québécoise d’une part, et un enjeu plus proprement politique où il s’agit de consolider l’État – qu’il s’agisse de l’État fédéral ou de l’État québécois – par la marginalisation ou l’inféodation de l’État adverse selon le cas d’autre part ».
La vraie question est celle de l’État capitaliste et des intérêts de classe qui le sous-tendent, « d’autant plus importante que cette question (constitutionnelle) sert de paravent à une « indépendance » ou à une « autonomie » – qu’il s’agisse des niveaux fédéral ou provincial – qui n’est, en définitive, que la forme paradoxale que revêt dans ce contexte une dépendance économique dont les tenants et aboutissants sont extranationaux aussi bien pour le Canada que pour le Québec. (Introduction de Pierre Beaudet)
***
Nous chercherons à poursuivre dans le présent travail une réflexion amorcée où nous avions tenté de poser quelques jalons susceptibles d’aider à saisir la portée politique et sociale du contentieux constitutionnel au Canada et au Québec dans l’après-guerre. Nous avions à ce moment-là fait valoir une première mise en garde, à savoir qu’il s’agit – au départ à tout le moins – d’éviter de prétendre qu’aux contraintes du partage des pouvoirs entre deux ordres de gouvernements doivent correspondre des rapports entre fractions de classes. Il ne peut s’agir là tout au plus que d’une hypothèse de travail qui doit être vérifiée empiriquement dans un contexte sociohistorique particulier. Si une telle validation peut certes contribuer à préciser l’analyse et à raffiner notre connaissance des rapports de classes au Canada et au Québec, elle ne nous en apparaît pas moins secondaire par rapport à la prise en compte d’un phénomène majeur qui détermine en première et en dernière analyse ces rapports intérieurs et les conflits ou les coalitions qu’ils peuvent connaître. Ce facteur est bien sûr celui qu’exerce la domination américaine qui le constitue4. En effet, le réaménagement de la stratégie américaine d’approvisionnement en richesses naturelles vers le milieu des années cinquante, joint au fait que ce sont les provinces qui ont, en vertu de la Constitution, entière autorité et propriété sur leurs ressources, explique que le flux des échanges nord-sud puisse servir de base matérielle à l’établissement d’une alliance originale entre capital national et capital étranger. Or, le plus étonnant n’est pas cette situation passablement complexe en vertu de laquelle les liens économiques régionaux avec un puissant voisin tendraient à dissoudre un pays, mais bien dans ce fait complètement exceptionnel d’un pouvoir central qui, malgré son inféodation aux politiques et à l’idéologie américaines parvient à raffermir l’indépendance économique du pays et à se faire de la sorte et fort paradoxalement l’instrument même d’une éventuelle dislocation politique du pays. Bien sûr, ni le gouvernement américain, ni non plus le gouvernement canadien ne veulent cette dislocation, mais l’un et l’autre doivent composer avec les forces économiques en présence dont les lois aveugles jouent en faveur de l’extension et de l’intensification de l’interdépendance régionale dans un axe nord-sud. Il s’ensuit que les provinces canadiennes en viennent objectivement à se comporter de plus en plus comme de purs et simples états américains5 et, parallèlement, que le rôle, la place et la fonction de l’État canadien sont, objectivement, de tenter de contrer cette mainmise et d’accroître l’espace national d’accumulation.
Un exemple, emprunté à Hugh Aitken6, peut aider à comprendre la nature de ces relations : si historiquement, la construction d’un réseau de transport a pu servir de base d’accumulation pour une bourgeoisie canadienne, la construction de ce maître oeuvre qu’a été la Voie maritime du Saint-Laurent a servi cette fin d’une manière bien spécifique, en réalité, ce ne sont pas les demandes répétées du gouvernement canadien auprès du gouvernement fédéral américain depuis 1895 qui ont mené les États-Unis à signer une entente avec le Canada portant sur la construction d’une voie maritime le long du Saint-Laurent en 1954, mais bien, dans la ligne tracée par le Rapport Paley publié en 1952, les nécessités d’ouvrir de nouvelles mines de fer et, en particulier, d’exploiter les gisements du Nouveau-Québec et du Labrador à des prix comparables à ceux pratiqués dans l’exploitation du Mesabi Range au Minnesota et des gisements de Terre-Neuve.
Dans ces conditions, le parachèvement en 1959 de la Voie maritime grâce aux mises de fonds des gouvernements fédéraux, américain et canadien, allait permettre d’accélérer et d’intensifier l’exportation de richesses naturelles vers le sud, c’est-à-dire de la périphérie vers le heartland américain.
C’est sur la base de telles constatations que nous avions été amenés à prétendre qu’une des caractéristiques essentielles du capitalisme canadien dans l’après-guerre réside dans cette impossibilité pour la bourgeoisie canadienne d’assurer à ce moment-là l’expansion de secteurs capitalistes d’accumulation nationaux et à affirmer que la contrepartie de cette contrainte se fait sentir au point de vue politique, puisque l’on assiste à cette impossibilité de fait à ce moment-là pour le parti au pouvoir à Ottawa de consolider la suprématie de l’État fédéral sur toutes les provinces : à cet égard, l’incapacité de parvenir à une entente au sujet du «rapatriement» de la Constitution de Londres en constitue rétrospectivement l’illustration la plus significative.
Ainsi, les contraintes économiques de la dépendance expliqueraient qu’« après environ un demi-siècle d’efforts et d’échecs, le Canada (ait été) dans une situation unique : (d’être) le seul pays indépendant au monde qui ne puisse modifier sa propre Constitution »7. Bien sûr, cette « situation unique » s’expliquerait ici précisément par la dépendance alors que dès que le Canada atteindra effectivement une certaine « indépendance » économique, cette impossibilité ne jouera plus.
Cela étant établi, dans les pages qui suivent, nous allons tenter de cerner spécifiquement les enjeux sociopolitiques intérieurs que recouvrent les rapports constitutionnels dans le contexte canadien des années soixante. Pour ce faire, nous explorerons l’évolution des relations constitutionnelles entre les gouvernements fédéral et québécois depuis le début de la « Révolution tranquille » en tentant de dégager les rapports sociaux qui se sont noués autour de cet enjeu. Dans un deuxième temps, nous dégagerons quelques éléments d’analyse de ces enjeux.
Les antécédents : l’approche duplessiste des années 1950
Les relations entre le fédéral et la province de Québec tout au long des années cinquante s’apparentent davantage à une guerre de positions où chaque palier de gouvernement entend marquer des points contre l’autre qu’à des négociations tendant à l’établissement d’un terrain d’entente au sujet du partage des compétences législatives ou l’aménagement d’ententes fiscales8.
Lancé sur la voie d’une centralisation accélérée justifiée par le déploiement de l’effort de guerre et rendu encore plus aigu par des engagements militaires souscrits dans le cadre d’accords comme ceux de l’O.T.A.N.9 signés à Washington le 4 avril 1949, le gouvernement canadien mène une politique qui se veut plus « indépendante » sur le plan international et plus « nationale » sur le plan interne. Mackenzie-King d’abord – jusqu’à son abandon de la politique en 1948 – et Louis Stephen Saint-Laurent ensuite – jusqu’à la défaite de son parti aux élections de 1957 – prirent un ensemble d’initiatives politiques qui visaient à raffermir l’autonomie du Canada par rapport à l’Angleterre. Ainsi, en 1947, le Canada obtient la reconnaissance de la citoyenneté canadienne par la Couronne britannique : en 1949, le droit de modifier unilatéralement la Constitution dans les domaines relevant de la compétence exclusive du gouvernement fédéral et, la même année, la suppression des recours en appel au Conseil privé de Londres ; puis en 1952, la nomination d’un Canadien comme gouverneur général.
Les deux mesures adoptées en 1949 en particulier affectaient directement l’autonomie provinciale et, à ce titre, méritent qu’on s’y arrête quelque peu. En premier lieu, si l’amendement à l’A.A.N.B. (no 2) de 194910 ne touchait pas les pouvoirs dévolus aux provinces en vertu de la Constitution, il n’en créait pas moins un précédent important à deux égards : d’abord, dans la mesure où « cette modification fut obtenue sans consultation des gouvernements des provinces et sans leur assentiment »11, elle allait paver la voie à toutes ces négociations en vue d’arriver à une « formule » de rapatriement de la Constitution entre le fédéral et les provinces ; ensuite, par voie de conséquence, cette initiative enfermait ces négociations dans des discussions autour de formules de rapatriement précisément, formules d’où toute considération sociale se trouvait de la sorte évacuée au profit d’une approche à la fois toute pragmatique et stratégique à la question constitutionnelle.
Comme le soulignait Louis S. St-Laurent, il s’ensuit de cela que l’enjeu constitutionnel peut prétendre être ou affecter de n’être qu’un enjeu « administratif »12 pour les provinces, voire une simple question de « raison » comme le fera valoir plus tard Pierre-E. Trudeau13 alors qu’il en va tout autrement : cet enjeu servira vaille que vaille à jeter les fondations d’un « pacte » dont les portées sociale et politique sont considérables et incalculables.
En deuxième lieu, l’abolition des appels au Conseil privé de Londres instaurait la Cour suprême du Canada comme tribunal de dernière instance, en particulier dans tout litige constitutionnel susceptible d’opposer le fédéral aux provinces. Or, autant la Cour suprême – à cause de sa composition et de son mode de nomination – tend à favoriser le pouvoir central, autant l’on avait fait grief au Conseil privé de favoriser plutôt les provinces aux dépens du fédéral, et ce, dans l’intention de maintenir la sujétion de ce dernier à la Couronne et de prévenir l’émancipation politique internationale du Canada.
C’est d’ailleurs en ce sens que l’initiative du fédéral mettait définitivement en veilleuse une interprétation autonomiste des pouvoirs dévolus aux provinces en vertu de la Constitution.
Par ailleurs, sur le plan interne ou national, c’est-à-dire sur le plan plus proprement administratif, les gouvernements qui se succèdent à Ottawa créent toute une série d’organismes dans les domaines les plus divers comme les communications, le transport ou la construction domiciliaire. C’est ainsi que la Société Radio-Canada est créée en 1936, l’Office national du film en 1939, la Société centrale d’hypothèque et de logement en 1945, la Société des télécommunications transmarines en 1950, l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent et le Comité consultatif sur le développement de l’énergie atomique, tous deux en 195414, sans oublier, bien sûr, le Conseil des arts en 1957.
Face à ces initiatives, le gouvernement dirigé par Duplessis adoptait une attitude essentiellement défensive qui consistait ou bien à refuser purement et simplement les subventions, par exemple, ou bien à répondre aux mesures adoptées par des équivalents provinciaux sans portée sociale effective comme ce fut le cas pour l’adoption de la Loi de Radio-Québec en 194415. Néanmoins, parmi les mesures plus ou moins ponctuelles adoptées, deux méritent d’être retenues à cause de leurs effets à plus long terme sur le contentieux constitutionnel dans les années qui suivirent : il s’agit de l’institution d’une Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, la Commission Tremblay, en 1953 et l’implantation d’un régime provincial d’impôt sur le revenu en 195416. Si la première entendait définir une théorie et une stratégie autonomistes face aux recommandations du rapport Rowell-Sirois, la seconde visait à pourvoir la province de sommes indispensables à son développement.
Autant l’approche duplessiste se voulait essentiellement « nationale » et défensive, quel qu’ait été le parti au pouvoir à Ottawa, autant celle de son successeur instaurera la collaboration dans la mesure où Paul Sauvé saura imposer auprès de Diefenbaker une formule qui fera long feu après sa disparition, celle dite d’« opting-out », formule en vertu de laquelle un gouvernement provincial pouvait bénéficier de subventions fédérales sans être tenu par l’affectation proposée17. Auparavant en effet, les subventions étaient bien sûr conditionnelles, ce qui explique que la pratique même de la subvention utilisée à outrance par le fédéral ait été prise à partie par la Commission royale d’enquête instituée par Duplessis en 1953 ; la Commission Tremblay avait en effet conclu à cet égard :
L’inconvénient le plus grave d’une politique de subventions est de créer chez les gouvernements qui les reçoivent des habitudes de dépendance dont il est presque impossible de se débarrasser. Grâce aux subventions, des services sont organisés ; on doit les compléter, les perfectionner et pour cela on demande des subventions nouvelles ou plus considérables… Le total des paiements généraux faits par le gouvernement fédéral aux provinces révèle, en effet, une progression constante au cours des dernières années… il en est résulté une sujétion croissante au gouvernement central des gouvernements provinciaux qui ont accepté les subventions18.
On peut d’ailleurs prendre une mesure du degré de soumission que cette pratique avait pu instaurer en faisant état de la place que ces subventions tenaient dans les budgets des provinces, – si, en effet, toujours selon le Rapport Tremblay, en 1955, le Québec « réussissait à faire face à ses obligations au moyen de ses propres ressources », les subventions fédérales comptaient pour entre le cinquième et la moitié des revenus de toutes les autres provinces19.
Autour de la « formule Fulton-Favreau », 1960 à 1966-67
À partir du moment où le régime des subventions conditionnelles laisse place à des ententes fiscales plus souples, on peut s’attendre à un véritable rétablissement de relations entre le fédéral et les provinces ; c’est d’ailleurs ce qui faisait écrire à un journaliste à l’été 1961 :
Il devient de plus en plus évident que l’actuel gouvernement libéral à Québec fait davantage pour renforcer la Confédération qu’aucun gouvernement provincial l’avait fait depuis que cette Constitution est devenue loi en 1867 »20.
D’ailleurs, pour appuyer ce diagnostic, il faut préciser que c’était à l’instigation du premier ministre Jean Lesage que pour la première fois depuis 1926, en décembre 1960 est convoquée à Québec une conférence interprovinciale des premiers ministres.
Toutefois, si le Nouveau Journal annonce en décembre de cette année-là que « le Canada s’achemine sur la voie de la souveraineté absolue »21, quelques semaines plus tard, Paul Gérin-Lajoie rejettera la formule de rapatriement de la Constitution proposée par Fulton, ministre de la Justice dans le cabinet Diefenbaker22. En bref, cette formule prévoit trois mécanismes d’amendement d’une Constitution éventuellement rapatriée, car c’est de là, on le sait, que sourd tout le contentieux autour de cette question ; ces trois mécanismes s’appliquent à trois ordres d’amendements : 1. ceux que le fédéral peut faire seul ; 2. ceux qu’il peut opérer de concert avec quelques provinces ou la majorité d’entre elles ; 3. ceux qui ne peuvent être acquis sans l’accord de toutes les provinces.
À cet égard, on peut vraisemblablement conclure que la soumission que les divers gouvernements qui s’étaient succédé à Ottawa avaient tenté d’arracher à la province de Québec en particulier sera acquise par la collaboration et la négociation avec la conséquence suivante : la question nationale, momentanément écartée de l’enjeu constitutionnel, va traverser et éventuellement diviser le Parti libéral lui-même.
Bien sûr, cette collaboration concernant le rapatriement n’entraîne nullement une soumission administrative directe et c’est ce qui explique qu’en février 1962, Lesage refuse d’accorder son appui à un amendement de l’A.A.N.B. qui aurait eu pour effet « (d’établir) un programme contributoire de pensions de vieillesse »23, ce qui conduira plus tard à la mise sur pied de deux programmes distincts, l’un administré par le fédéral pour les neuf provinces, l’autre géré par l’État québécois. Entre-temps toutefois, à compter de ce refus, les rapports semblent se détériorer entre le fédéral et le Québec au point où, à l’hiver 1963, certains craignent que le gouvernement central ne procède sans l’accord duQuébec24. Les choses devaient cependant changer avec les élections fédérales tenues ce printemps-là25. En effet, le 8 avril 1963, les libéraux défont les progressistes-conservateurs à Ottawa et Lester B. Pearson devient premier ministre du pays26.
Or, si la « formule Fulton » avait pu être prise à partie par Paul Gérin-Lajoie, ministre de l’Éducation et spécialiste en droit constitutionnel du gouvernement, qui avait exigé le retrait de l’amendement apporté unilatéralement à la Constitution par le fédéral en 1949 (le numéro 2), la même intransigeance se concevait plus difficilement à partir du moment où la « formule » était reprise par le ministre de la Justice à Ottawa, Guy Favreau, qui se trouvait ainsi à y voir accoler son nom.
Dorénavant, la question du « rapatriement » passera par toute une série de négociations autour de la « formule Fulton-Favreau » et le gouvernement à Ottawa reprendra l’échéancier des conservateurs et tentera de parvenir à une entente pour commémorer le centenaire de la Confédération en 1967. Dans le même temps, de toute part au Québec, le « pacte colonial » est de plus en plus violemment pris à partie par des regroupements de citoyens comme la Société Saint-Jean-Baptiste, par des partis comme le Rassemblement pour l’indépendance nationale (le RIN), quand il n’est pas stigmatisé par des groupuscules révolutionnaires.
C’est donc dans un contexte social passablement survolté que l’Assemblée nationale sera saisie d’une motion de Jean-Jacques Bertrand, député unioniste de Missisquoi, favorisant la création d’un comité spécial de l’Assemblée qui aurait pour fonction de déterminer comment des « États généraux » de la nation canadienne-française pourraient être convoqués afin d’établir les objectifs que devrait viser la nouvelle constitution27.
En tout état de cause – et sans entrer dans la petite histoire de l’amendement proposé par Gérin-Lajoie qui avait pour fonction de déplacer l’enjeu social et d’ouvrir plutôt l’éventuel comité aux seuls « spécialistes », ce qui avait donné lieu à la fameuse répartie de Lesage fustigeant les « non instruits » – en tout état de cause, donc, il n’y aura pas de convocation d’États généraux sous l’égide de la coalition au pouvoir, mais plus simplement, la mise sur pied d’un Comité de la Constitution de l’Assemblée législative en mai 1963. Sortant de l’ombre après plusieurs mois d’inaction à l’automne, le Comité décidera d’entendre des « spécialistes » dont le professeur Jean Beetz, le R. P. Richard Arès, Mgr P.-É. Gosselin (du Conseil de la survivance française), Jean Marchand (de la C.S.N.) et P.-E. Trudeau qui devait présenter un mémoire au nom de « groupes populaires » en général de la C.S.N. en particulier28.
Dans son Mémoire, Trudeau développe la thèse en vertu de laquelle la pratique du fédéralisme canadien aurait en vérité entraîné une véritable décentralisation au pays. Il appuie son interprétation du fonctionnement de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique sur l’accroissement des dépenses provinciales par rapport à celles du gouvernement central dans l’après-guerre, après avoir établi que :
Les dépenses provinciales pour des biens et des services passèrent de 3 % à 4 % du produit national brut ; les mêmes dépenses par les municipalités (et on sait que celles-ci tombent sous la juridiction des provinces) se sont accrues de 5 % à 8 % ; cependant que les dépenses fédérales ont diminué de 10 % à 7 %29.
Il conclut alors à une « orientation vers la décentralisation » du fédéralisme canadien. Or, ces raisonnements sont trompeurs à deux égards. Premièrement, ce calcul de la part respective des dépenses publiques selon les niveaux de gouvernements ne démontre rien et ne peut tout au plus que servir à illustrer leur accroissement, car si l’on suivait en effet la voie tracée, il faudrait conclure que ce sont bien en définitive les gouvernements municipaux qui ont vu leurs « fonctions » croître dans l’après-guerre puisque ce sont (d’après les chiffres fournis par Trudeau lui-même) ces dépenses qui ont connu les plus forts taux de croissance en pourcentage du P.N.B. Deuxièmement, un accroissement des dépenses à un niveau local ou régional ne correspond à une décentralisation que dans la mesure où il y a effectivement pouvoir de taxation, c’est-à-dire un contrôle sur les sources de revenus ; à cet égard, le gouvernement canadien détient toujours la prérogative, de sorte que ses paiements de transferts aux provinces, loin d’en faire un « agent de la province » comme l’écrira plus tard Stevenson30, établit bien au contraire sa prééminence et sa domination, exactement de la même manière que les subsides versés par les provinces aux municipalités établissent la concentration des pouvoirs auparavant détenus par les municipalités aux mains des gouvernements provinciaux et nullement une soi-disant décentralisation, encore moins une démocratisation, au niveau municipal.
D’ailleurs, les rédacteurs du Mémoire présenté en 1964 par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal au Comité parlementaire de la Constitution faisaient valoir au contraire que :
La deuxième Grande Guerre favorisa directement cette évolution constitutionnelle (vers le centralisme fédéral, D.B.)… Il suffit de rappeler quelques mesures importantes : plan national d’assurance- chômage (1941)…, conférence fédérale-provinciale sur le rétablissement d’après-guerre au cours de laquelle le gouvernement fédéral avoua officiellement sa ferme intention de conserver ses revenus du temps de guerre (1945-1946)…, institution d’une Commission royale d’enquête présidée par Vincent Massey, sur les arts, les lettres et les sciences (1949), abolition des appels au comité judiciaire du Conseil privé (1949) auquel les partisans du centralisme fédéral reprochaient d’avoir vicié la constitution de 1867, amendement constitutionnel donnant au parlement fédéral le droit de modifier seul la constitution canadienne en ce qui concerne les pouvoirs attribués au gouvernement central (1949)31.
Comme quoi nous avons affaire de part et d’autre à un véritable dialogue de sourds, à telle enseigne que le mandat du « Comité de la Constitution » à l’effet de :
(Déterminer) des objectifs à poursuivre par le Canada français dans la révision du régime constitutionnel canadien, et des meilleurs moyens d’atteindre ces objectifs32.
Pendant ce temps, la « formule Fulton-Favreau » est battue en brèche, d’abord par Daniel Johnson qui la condamne en janvier 1965, ensuite, l’année suivante, par le premier ministre Lesage lui-même qui confirme son abandon en janvier 196633.
Toutefois, la question de la convocation des « États généraux du Canada français » n’était pas restée lettre morte ; lancé lors d’un congrès de la Fédération des Sociétés Saint-Jean- Baptiste en 1961, le projet est appuyé en 1964 par plusieurs « corps intermédiaires » parmi lesquels on peut notamment citer la Fédération des collèges classiques, la F.T.Q., la C.S.N., l’U.C.C., le Conseil de la vie française en Amérique, l’Association d’éducation du Québec, la Corporation des instituteurs et institutrices du Québec, l’Association canadienne des Éducateurs de langue française et le Conseil d’Expansion Économique34.
Enfin, les « assises nationales » des États généraux se tiendront du 23 au 26 novembre 1967, à Montréal, un mois après le congrès du Parti libéral où l’on avait assisté au départ de René Lévesque et à la fondation du Mouvement Souveraineté-Association et quatre mois après la visite du général de Gaulle au Québec. C’est dans ces conditions que la jonction entre question nationale et pouvoir politique provincial devient de nouveau possible.
Vers le rejet de la Charte de Victoria
Avec la « fin des illusions »35, le contentieux constitutionnel va se déplacer parallèlement à deux niveaux distincts, social et politique, alors que précédemment – jusqu’au rejet de la proposition de convocation des États généraux par l’Assemblée et la décision d’engager le débat autour de et entre « spécialistes » – ces niveaux étaient étroitement imbriqués. Dorénavant, la critique du système fédéral sera ébauchée en dehors des partis officiels – jusqu’à la formation du P.Q. en tout cas – tandis que ces mêmes partis établiront divers compromis en vue de former une alliance tactique contre le mouvement national naissant.
La critique de l’État unitaire
Les approches de René Lévesque et Claude Morin – entre autres – à l’analyse de la stratégie et de la pratique politiques du gouvernement central dans les années soixante en particulier convergent sur au moins un élément essentiel, à savoir l’absence d’homologie dans les relations entre le fédéral et les neuf provinces anglophones d’une part, et celles du fédéral avec le Québec d’autre part, différences qu’ils expliquent en définitive par la nature des fonctions « nationales » assumées par le Québec par opposition à celles assumées par les autres provinces et le fédéral.
Ainsi, d’entrée de jeu, dans son ouvrage intitulé : Le pouvoir québécois… en négociation, Claude Morin établit les critères qui prévaudront dans son analyse des rapports entre le fédéral et le Québec :
Notre guide d’appréciation (des dossiers qui suivent, D.B.) est la confirmation des pouvoirs du gouvernement québécois (en cas de litige avec le gouvernement fédéral) et surtout l’acquisition de pouvoirs nouveaux. En somme, pour nous, les changements dans la situation relative du Québec sont positifs et s’orientent dans la bonne direction pour autant que son gouvernement devienne plus fort juridiquement, financièrement et politiquement36.
Cette évaluation rejoint d’ailleurs la problématique définie par Jacques Parizeau et René Lévesque en 1967, au moment de leur rupture avec le Parti libéral du Québec :
La politique des gouvernements du Québec ne s’est à peu près pas démentie depuis bon nombre d’années : de plus en plus d’argent ou de pouvoirs fiscaux sans condition. Nos gouvernements ne demandaient pas de décentralisation de la politique, ils voulaient déterminer leur propre politique37.
En d’autres mots, le propre de l’approche de ces souverainistes consiste à ne pas entrer dans le débat sur les diagnostics à poser concernant la nature des rapports entre le fédéral et le Québec, mais il consiste plutôt à renvoyer dos-à-dos centralisme et décentralisation pour établir les besoins propres à l’édification d’un État québécois fort. C’est ainsi que dans Option Québec, les critiques adressées à l’endroit de la stratégie et de la pratique du fédéralisme canadien s’alimentent à même les expressions de « confusion sans pareille » (p. 90), de « décentralisation anarchique plutôt que rationnelle » (p. 101), d’« effondrement du pouvoir central » (p. 103), etc.
Nous avons affaire en définitive à deux logiques – Claude Morin dira plus tard « deux options »38 – qui s’affrontent sur deux terrains différents : d’un côté, l’adaptation du cadre fédéral aux pressions sociales du pays grâce à l’implantation de réformes visant à décentraliser ou centraliser, à accroître ou à réduire le bilinguisme, selon les impératifs de tous ordres, les pressions ou les conjonctures ; de l’autre, à la consolidation d’un État québécois centralisé dont l’émergence même implique le recul de l’État fédéral canadien : il n’est plus ici question d’adapter le cadre fédéral actuel ou l’union fédérative intervenue en 1867, mais bien d’édifier un appareil d’État « nouveau », ce qui a pour conséquence première immédiate de contraindre bien sûr l’État fédéral à un repli politique et économique en dehors des frontières du Québec c’est-à-dire, en définitive, de dissoudre
l’« unité » actuelle dans l’une ou l’autre forme d’union ou d’association. En d’autres mots, l’application d’une telle logique entraîne de facto la déstabilisation ou la désagrégation de l’État fédéral, exactement de la même manière que l’« option canadienne », au contraire, le consolide et contraint la province à l’intégration.
Posé dans ces termes, l’enjeu constitutionnel ne se laisse pas piéger par l’approche développée par Trudeau et plusieurs constitutionnalistes pour lesquels la question est plutôt posée en termes de centralisation ou de décentralisation.
La « stratégie » provinciale
Au moment où Daniel Johnson devient premier ministre, en juin 1966, la situation politique se trouve rétablie dans les termes conflictuels qui prévalaient au début des années soixante : alors que les Libéraux avaient été confrontés aux progressistes-conservateurs, ce sont maintenant les unionistes qui affrontent les Libéraux à Ottawa ; le dialogue entre libéraux aux niveaux provincial et fédéral dans l’après-guerre n’aura duré que trois ans et il ne reprendra qu’avec l’arrivée de Bourassa au pouvoir en 1970.
Or, s’il est question, tout de suite après ces élections, d’une « formule Favreau-Johnson »39, le dialogue ne sera pas repris ; pire, avec le « coup monté » de la visite du général de Gaulle et la publicité internationale que vaut au Québec un slogan séparatiste repris par le chef de l’État français et proféré du haut du balcon de l’hôtel de ville de Montréal par un après-midi de juillet, il sera rompu. Toutefois, plutôt que l’Union Nationale, ce sont les « souverainistes » qui tireront profit de cette publicité40.
Entre-temps, c’est-à-dire entre septembre 1967 et les élections fédérales tenues en juin 1968 où le Parti libéral reprendra le pouvoir avec une majorité absolue – ce qui ne s’était pas vu depuis l’exploit de Diefenbaker en mars 1958 – surviennent, coup sur coup, le départ de Diefenbaker et son remplacement par Stanfield et le départ de Pearson et son remplacement par Trudeau. Or, au cours de ces élections, Trudeau attaque davantage le « nationalisme » de Johnson que son adversaire Stanfield à tel point qu’un analyste n’exclut pas la possibilité d’une éventuelle « coalition en sous-main (des) quatre partis – entre les Libéraux fédéraux et provinciaux d’une part et les conservateurs et l’Union Nationale d’autre part – dans le but d’écraser le ferment séparatiste »41.
Or, cette prévision se réalisera quelque temps après, mais de manière quelque peu différente : c’est en effet à l’occasion des élections provinciales tenues au printemps 1970 que libéraux de tout poil et unionistes se ligueront contre le Parti Québécois, permettant alors au P.Q. de devenir dans les faits l’opposition officielle à l’Assemblée nationale et de déclasser ainsi l’Union Nationale. Il vaut peut-être de rappeler au passage, afin d’éclairer quelque peu ce réaménagement, que Daniel Johnson était disparu à l’automne 1968 et qu’il avait été remplacé par Jean-Jacques Bertrand. Par ailleurs, il importe également d’indiquer que la collusion entre l’Union Nationale et le Parti libéral du Québec avait déjà joué et qu’elle s’était une première fois exprimée à l’occasion de l’adoption du bill 63 à l’automne 1969 où les opposants libéraux au projet de loi de l’Union Nationale avaient été sommés de quitter le parti.
C’est ainsi qu’à la suite des élections provinciales de 1970, l’on semble rapidement s’acheminer vers une entente entre les deux niveaux de gouvernements au sujet du « rapatriement » de la Constitution. Interrompue depuis 1966, la question est maintenant rouverte. Néanmoins, malgré un consensus obtenu entre tous les premiers ministres à une séance de travail en février 1971, la Charte de Victoria, élaborée et discutée entre les 14 et 16 juin, sera finalement rejetée par Bourassa le 24 à cause de l’impossibilité d’obtenir une « disposition supplémentaire destinée à accroître les pouvoirs des provinces en matière sociale »42, et c’est sur cet échec que nous interrompons ce bref rappel historique pour passer maintenant à l’analyse comme telle.
La question de la démocratie et de la décentralisation
La première partie de ce travail visait à fournir quelques indications chronologiques et historiques susceptibles d’éclairer le débat plus proprement théorique que suscite l’étude du contentieux constitutionnel. De ces éléments ressortent essentiellement deux enjeux que nous voudrions aborder maintenant. Le premier de ces enjeux concerne l’opposition qui s’est nouée tout au long de ces années entre l’« ouverture » et la « fermeture » du débat autour de ces questions ; il s’agit, en d’autres mots, de la question de la démocratisation du débat lui-même. Quant au second enjeu, il porte sur la décentralisation et l’autonomie politique et il s’agira à cette occasion d’établir quelques distinctions de base entre politique et administration, entre concentration bureaucratique et autonomie politique.
Constitution et société
L’entente ou la mésentente autour de « formules » plus ou moins compliquées d’amendement d’une constitution occulte la question de fond, à savoir qu’un texte de cette importance engage moins des « spécialistes » qu’une société. Vouloir soustraire le débat à une critique sociale un tant soit peu ouverte semble être la fonction première et dernière non seulement de ces « formules » elles-mêmes, mais également de toute la stratégie politique mise en place par les deux paliers de gouvernements depuis vingt ans. Cette stratégie s’appuie sur la négociation de mécanismes juridiques qui, à leur tour, occultent la fonction sociale d’une loi fondamentale. En vérité, le droit constitutionnel ne s’embarrasse pas de l’analyse des classes et c’est sans doute la meilleure marque de son manque de pertinence sociale que cette incapacité dans laquelle se trouvent ses spécialistes de fixer papier un texte qui corresponde à autre chose qu’à des perceptions subjectives, élitistes, voire réactionnaires, du contexte social canadien43.
La « solution » aux contradictions dans lesquelles s’enferre la croissance capitaliste dans le contexte canadien ne saurait être recherchée dans le juridisme, mais elle doit plutôt être dégagée de l’analyse de la théorie et de la pratique du fonctionnement des institutions existantes. À cet égard d’ailleurs, les travaux qui émanent des partis ou regroupements de gauche sur la question ne font pas non plus le poids dans la mesure où ils sont loin d’être tous édifiants et, règle générale, s’alimentent davantage aux sources de l’idéalisme qu’ils ne puisent dans une analyse un tant soit peu exhaustive de l’histoire sociale récente44.
En effet, la question de la démocratisation de l’enjeu national au Canada est indissociable de la critique des institutions existantes et, à son tour, cette critique n’est possible que dans la mesure où le fonctionnement autocratique de ces institutions est révélé. En d’autres mots, la démocratisation n’a de sens et de portée sociale effective que si elle est alimentée par la critique. Cette première réflexion établie, il faut d’ores et déjà aller plus loin et aborder la raison fondamentale qui explique ce qui peut n’apparaître, pour le moment, que comme une simple question de stratégie.
Pour ce faire, il faut poser carrément la question suivante : pourquoi la classe au pouvoir et ses représentants politiques cherchent-ils systématiquement à soustraire le contentieux constitutionnel à une critique ? Parce que cette critique risquerait de toucher de trop près les institutions politiques existantes et leurs fonctions sociales effectives ou concrètes. C’est en ce sens que la question nationale doit demeurer enfermée dans le juridisme et que la discussion doit tourner autour de formules – de rapatriement, d’amendement, etc. – si l’on ne veut pas que la critique, en attaquant le coeur même de la légitimation par excellence de l’État capitaliste, sa Constitution, n’en vienne à dissoudre les fondements idéologiques et politiques de l’État et à soumettre l’État lui-même à la critique.
Cette possibilité est trop sérieuse, comme est trop fragile l’articulation entre la Constitution et l’État, pour que l’on ne soit pas porté à voir dans ce constant effort d’une classe dominante l’expression d’une volonté renouvelée de maintenir et de sauver « son » État. Ce n’est dès lors ni par choix, ni par souci d’efficacité, ni non plus par mauvaise foi, mais, plus fondamentalement, par nécessité, que cette classe est contrainte, pour garantir l’État, de soustraire l’État (suggestion : de le soustraire…) et à la critique et à la démocratie. Il faudrait pouvoir ici et à cette occasion reprendre le discours hégélien et la critique marxiste de Hegel et de l’État pour démontrer cette nécessité et, dans le même temps, expliquer ce que Lucio Colletti a appelé ce « processus d’hypostase réel » qu’est l’État45.
Or, en déviant sur les formules, voire sur la nation, le discours critique laisse intact l’État et, ce faisant, occulte la relation entre État et capital d’une part, la fonction concrète de l’État capitaliste dans le maintien et l’approfondissement des rapports entre classes de l’autre, alors que ce sont précisément ces relations qu’il faut pouvoir révéler dans toutes leurs articulations – et non pas uniquement dénoncer à coup de slogans – pour pouvoir isoler et transformer ces processus46.
Sous cet angle, il apparaît ainsi qu’État et démocratie sont, en théorie comme en pratique, inconciliables. Cependant, il apparaît surtout que la Constitution est en tout premier lieu (à changer pour primordiale, pour éviter la répétition de « premier lieu » ?) et le tout premier lieu de l’hypostase de l’État telle qu’elle est donnée dans un document fondamental qui est la caution à la fois théorique, juridique et idéologique de la règle de droit qui se trouve, à son tour, à tenir la légitimation de toutes les institutions publiques, qu’il s’agisse du Parlement, du bureau du premier ministre, du Sénat, etc.
Dans ces conditions, « ouvrir le débat » c’est non seulement scruter l’État en tant que légitimation suprême d’un pouvoir de classe, c’est également remettre en cause les institutions publiques qui actualisent la pratique politique et la légitimation de ces pratiques que ces institutions sont censées défendre, qu’il s’agisse de la soi-disant séparation des pouvoirs – entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire – par opposition à la structuration de ces pouvoirs – à la domination de l’exécutif, notamment sur les deux autres.
L’avantage des « formules » est que celles-ci piègent le débat dès le départ en l’enfermant dans des modalités et laissent ainsi intactes aussi bien les institutions que leurs légitimations.
En ce sens, on pourrait être porté à croire ou à laisser croire que la question du « rapatriement » est sans importance, c’est-à-dire qu’elle n’a ou n’aurait aucune portée sociale effective dans la mesure où un tel déplacement n’aurait en définitive aucun rapport avec la structuration des classes dans la société canadienne. Or, il n’en est rien, puisque le « rapatriement » soulève en même temps le problème de l’interprétation du système politique fédéral actuel et c’est bien d’ailleurs sur ces interprétations que le processus achoppe et non sur la nécessité ou l’inutilité du rapatriement comme tel. C’est ce que nous allons maintenant chercher à cerner.
Quelle autonomie ?
Une démarche courante dans l’étude des rapports entre les deux niveaux de gouvernements au Canada consiste à poser et à opposer des phases de centralisation à des phases de décentralisation. Ainsi, pour Simeon, par exemple :
Les observateurs de la scène fédérale ont été unanimes à relever l’accroissement du pouvoir fédéral dans l’immédiat après-guerre ; (alors qu’) aujourd’hui, ils sont à peu près tous aussi unanimes à relever l’affaiblissement du pouvoir fédéral »47.
Autour de ce diagnostic se rejoignent aussi bien Pierre-E. Trudeau que Garth Stevenson : le contexte canadien serait à cet égard « unique » dans l’histoire récente des pays développés48. Or, nous allons le voir immédiatement, la question touche moins l’enjeu de la décentralisation qu’elle porte sur la nature des mécanismes employés.
En effet, une des principales constantes dans le fonctionnement du fédéralisme canadien est celle en vertu de laquelle c’est à l’État fédéral que revient la responsabilité de prélever la masse des impôts par rapport à chaque province prise isolément. Ce pouvoir de taxation fonde d’ailleurs la « prééminence » du gouvernement central dans l’élaboration des politiques économiques, tout comme dans celle des politiques sociales. Néanmoins – et c’est là que réside l’originalité du système – une fois prélevées, ces ponctions sont ensuite partiellement redistribuées aux provinces. Il s’ensuit de ce fonctionnement, comme l’a fort judicieusement noté Michel Pelletier, que :
Si on essaie de dégager une caractéristique des interventions fédérales et québécoises respectivement, au cours de la décennie (c’est-à-dire, les années ‘60, D.B.), on remarque d’une part que la très grande majorité des mesures proprement dites ‑nouveaux programmes, etc., ‑furent d’origine ou d’inspiration fédérales, tandis que la plupart des interventions d’origine québécoise prirent plutôt la forme de réformes institutionnelles. En d’autres termes, le contenu des mesures sociales est fédéral, tandis que la forme – le cadre institutionnel – est d’origine québécoise49.
Ceci veut dire que, tandis que les politiques sont élaborées et définies au niveau fédéral, leur administration en est dévolue au niveau provincial – en ce qui concerne le Québec en tout cas. Si l’on est donc justifié de parler de décentralisation, il faut immédiatement ajouter que celle-ci n’est qu’administrative et nullement politique. Au contraire d’ailleurs, rien ne nous permet de conclure que ce qui se passe dans tous les pays capitalistes développés n’est pas vérifiable au Canada, à savoir que l’on assiste également ici au développement et à l’extension d’un processus de centralisation politique qui va de pair d’ailleurs avec la concentration économique.
La meilleure mesure que l’on puisse prendre de cette constante nous est fournie dans la part grandissante que prennent les subventions fédérales dans les budgets des provinces et cette part, en ce qui concerne le Québec spécifiquement, croît notablement au cours de la décennie 1962-63 à 1972-73.
En effet, en 1962-63, comme l’indique le tableau ci-après, le Québec pourvoyait dans une proportion d’un peu plus de 90% à la perception de ses revenus tandis que, dix ans plus tard, cette proportion ne s’établit plus qu’à 74%, pourcentage qui recouvre en particulier des sommes s’élevant à plus de $751 millions versées au chapitre des subventions conditionnelles en 1974-75.
C’est donc dire que le Québec, malgré des visées autonomistes défendues dans la foulée du Rapport Tremblay, se trouve financièrement de plus en plus dépendant à l’endroit des transferts effectués par le gouvernement fédéral d’une part et, corollairement, que la province se trouve progressivement intégrée aux mécanismes financiers définis et aux conditions tracées par le fédéral d’autre part. À cet égard d’ailleurs, le Québec fait de moins en moins figure de cas d’exception et en vient au contraire à ressembler de plus en plus, administrativement à tout le moins, aux autres provinces canadiennes.
Dans ces conditions, il est bien évident que les interprétations courantes du contentieux constitutionnel doivent être révisées afin de prendre en compte cette inféodation accélérée de l’économie et de la politique québécoise aux nécessités de l’accumulation du capital dans le cadre d’une économie canadienne et d’une économie continentale.
Conclusion
L’avantage de l’utilisation d’une approche fondée sur la distinction entre centralisation politique et concentration bureaucratique est qu’elle permet de déplacer l’angle d’analyse dans une étude du contentieux constitutionnel et, éventuellement, d’appréhender ce conflit sous l’angle d’une intégration des économies régionales canadiennes aux besoins de la consolidation d’une économie continentale.
À cet égard, la question de l’État est, ici comme partout ailleurs, la question-clé et elle sera d’autant plus centrale et son enjeu d’autant plus important que cette question sert de paravent à une « indépendance » ou à une « autonomie » – qu’il s’agisse des niveaux fédéral ou provincial – qui n’est, en définitive, que la forme paradoxale que revêt dans ce contexte une dépendance économique dont les tenants et aboutissants sont extranationaux aussi bien pour le Canada que pour le Québec.
Dans de telles conditions, le contentieux constitutionnel recouvre deux enjeux que ces protagonistes tendent systématiquement à confondre, à savoir un enjeu essentiellement administratif où il s’agit d’élucider la question de l’enchevêtrement des pouvoirs des bureaucraties fédérale et québécoise d’une part, et un enjeu plus proprement politique où il s’agit de consolider l’État – qu’il s’agisse de l’État fédéral ou de l’État québécois – par la marginalisation ou l’inféodation de l’État adverse selon le cas d’autre part.
Dans la confrontation qui s’annonçait entre le fédéral et le Québec avec l’arrivée au pouvoir du Parti Québécois, il n’apparaissait pas clairement lequel de ces enjeux était en cause et on louvoyait au contraire en fonction d’impératifs tactiques de l’un à l’autre, politisant ou dépolitisant ce contentieux au gré des conjonctures. Il n’en demeure pas moins que, compte tenu des implications sociales et politiques de ce contentieux et de la possibilité qui est ouverte de l’étaler au grand jour, il faut maintenant s’opposer à ce que l’on referme la question et à ce que l’on reporte ou fasse dévier le débat. Il importe au contraire de s’opposer au statu quo, condition première et dernière de l’amorce d’une critique de l’État capitaliste et de ses fonctions concrètes dans l’accumulation à l’échelle continentale.
1 Cahiers du socialisme, numéro 2, automne 1978.
2 Une grosse « exception » à cette position a été celle de Stanley Ryerson. Longtemps dirigeant du Parti communiste canadien, Ryerson finit par reconnaître à la fin des années 1950 que le Canada a été construit sur l’oppression nationale du peuple québécois. Par la suite, il quittera le PCC et deviendra indépendantiste. Voir Stanley Bréhaut-Ryerson, Le Capitalisme et la Confédération: aux sources du conflit Canada-Québec (1760- 1873). Montréal, Parti Pris, 1978.
3 Dorval Brunelle, La désillusion tranquille, Hurtubise, Montréal, 1978.
4 Voir Aitken, Hugh, G. J., American Capital and Canadian Resources, Cambridge, Harvard U. Press, 1961, pp. 84 sq.; et : « Defensive Expansionism : The State and Economic Growth in Canada », dans : Easterbrook, W. T. et Watkins, M. H. (éditeur), Approaches to Canadian Economic History, Toronto, Mc Clelland and Stewart Ltd., the Carleton Library, no 31, 1967, pp. 183-221.
5 C’est également Hugh Aitken qui a relevé que les provinces canadiennes gagneraient davantage politiquement à disposer de deux sénateurs chacune auprès du Congrès américain. Cf. American Capital Resources, op. cit., p. 178.
6 Aitken, H. G. J., « Defensive Expansionism : The State and Economic Growth in Canada », op. cit., pp. 212-217.
7 Trudeau, Pierre-E., « La position du Premier Ministre du Canada » (soumise à la Conférence de Victoria en 1971), dans : Prévost, Jean-Pierre, La crise du fédéralisme canadien, Paris, P.U.F., Coll. Dossiers Thémis, no 52, 1972, p.
8 Pour une estimation des « pertes » ainsi encourues et imputables à la politique autonomiste suivie à cette époque, voir : Bernard, André, La politique au Canada et au Québec, 2ième édition, Montréal, P.U.Q., 1977, pp. 384 sq.
9 Cf. Spaak, Paul-Henri, Why NATO ?, Londres, Penguin Books, 1959.
10 Le premier adopté cette année-là concernait, rappelons-le, l’admission de Terre-Neuve dans la Confédération.
11 Favreau, Guy, Modification de la Constitution du Canada, Ottawa, Imprimeur de la Reine, février 1965, p. 14. Par ailleurs, il est peut-être utile de rappeler que l’A.A.N.B. de 1949 (no 1) concernant l’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération a également été adopté sans consultation et ce fait, moins important sans doute que celui rapporté ici, constitue un indicateur important d’une pratique fédérale qui consiste à consulter le moins possible les provinces. Après tout, l’adjonction d’une dixième province intéressait – ou aurait dû intéresser – au plus haut point les neuf autres. (Duplessis avait réagi quant à lui en faisant valoir, à bon droit, que l’entrée de Terre-Neuve allait modifier le rapport des sièges au Parlement en faveur des provinces anglophones) Idem, p. 14.
12 Cf. Le discours prononcé par le Premier Ministre St-Laurent à l’Université Queen’s le 21 octobre 1951 et cité par : Ohearn, Peter J. T., Peace, Order and Good Government. A New Constitution for Canada, Toronto, The Macmillan Co. of Can. Ltd., 1964, p. 32.
13 Interprétation propre au Premier Ministre Trudeau, qui sera étudiée plus en détail dans la section suivante. Cf. « Fédéralisme, nationalisme et raison », dans : Trudeau, P.-E., Fédéralisme et société canadienne-française, Montréal, Éditions H.M.H., pp. 191-215.
14 Cette liste est loin d’être exhaustive et il faudrait y ajouter également : la Banque du Canada (1935), la Commission canadienne du blé (1935), la Banque de développement industriel (1945) et le Conseil national de la productivité (1960). Cf. Ashley, C.A. et Smails, R. G. H., Canadian Crown Corporations, Toronto, The Macmillan Co. of Can. Ltd., 1965.
15 Sur toute cette question et, plus particulièrement, pour une analyse autonomiste des événements en cause, on pourra se référer à : Rumilly, Robert, L’autonomie provinciale, Montréal, Éditions de l’Arbre, 1948. De surcroît, Rumilly établit clairement la tactique adoptée par le fédéral à compter des années de guerre en matière constitutionnelle qui consiste à décourager l’éventuelle formation d’une coalition de toutes les provinces et à isoler progressivement le Québec de manière à mettre constamment le gouvernement provincial sur sa défensive.
16 Respectivement les lois 1-2 Elizabeth II, ch. 4 et 3-4 El. II, ch. 17.
17 Sur cette formule et, en général, sur l’histoire du Québec entre septembre 1959 et janvier 1960, on pourra consulter : Bombardier, Denise, Les « cent jours » du gouvernement Sauvé, Thèse de M.A. (sc. po.), Université de Montréal, 1971.
18 Rapport de la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, volume 1, Québec 1956, p. 388.
19 Idem, p. 387, où les auteurs fournissent les pourcentages suivants : « Terre-Neuve, 38 % ; l’Île-du-Prince-Édouard, 47,5% ; la Nouvelle-Écosse, 38% ; le Nouveau-Brunswick, 34% ; l’Ontario, 37,5% ; le Manitoba, 45,5% ; la Saskatchewan, 27,5% ; l’Alberta, 19,5% ; la Colombie-Britannique, 23% ».
20 Cf. Rouyn-Noranda Press, du 31 août 1961.
21 Cf. Le Nouveau Journal du 2 décembre 1961.
22 Cf. Le Devoir du 15 décembre 1961. Gérin-Lajoie exige en effet le retrait de l’amendement 1949 (no 2) avant d’approuver la formule Fulton. Le journaliste relève à cette occasion le paradoxe suivant : quatre des ministres provinciaux avaient donné leur accord à une formule semblable alors qu’ils siégeaient à la Chambre des Communes à Ottawa. Il s’agit de Jean Lesage, Bona Arsenault, Lionel Bertrand (député en 1946) et de René Hamel (Bloc populaire).
23 Cf. Le Devoir, 14 février 1962.
24 Cf. Le Devoir, 22 janvier 1963, où l’on peut lire que Diefenbaker, dans un discours, fait référence au fait que « seul le Québec n’a pas encore donné son assentiment à l’amendement de l’article 94-A pour l’établissement d’un plan contributif de pensions de vieillesse… ».
25 Nous ne pouvons, dans un cadre aussi restreint, relever les causes de la défaite de Diefenbaker. Il n’en demeure pas moins que ces élections sont fort importantes à plusieurs égards et surtout du fait que la question de l’armement atomique était au coeur du débat. L’intervention d’un général américain, Lauris Norstad, sur le contentieux nucléaire et les engagements du Canada vis-à-vis de l’O.T.A.N. lors d’une conférence de presse tenue à Ottawa le 2 janvier 1963 sont à retenir parmi les causes de cette défaite. Cf. Spencer, Robert, « External Affairs and Defence », dans : Saywell, John (ed.), Canadian Annual Reuiew for 1963, Toronto, U. of T. Press, 1964, pp. 282 sq.
26 Voir : Bergeron, Gérard, Du duplessisme à Trudeau et Bourassa, Montréal, Parti-pris, 1971, p. 296. Rappelons que l’année précédente, en 1962, des élections avaient été tenues aux deux niveaux, fédéral (le 18 juin) et provincial (le 14 novembre). Ajoutons qu’au fédéral, en 1962, en 1963, puis en 1965, les élections ont porté au pouvoir des gouvernements minoritaires.
27 Cf. le Montreal Star du 9 mai 1963.
28 Cf. La Presse du 25 octobre 1963. Le Comité s’était doté d’un sous-comité directeur en juillet comprenant G.E. Lapalme, président; P. Gérin-Lajoie, René Lévesque, Daniel Johnson et J.-J. Bertrand ; Claude Morin, secrétaire et Ch. Pelletier, secrétaire -adjoint. Cf. La Presse du 18 juillet 1963. Sur la petite histoire de ce mémoire : Le Borgne, Louis, La C.S.N. et la question nationale, Montréal, Éditions Albert Saint-Martin, 1976, pp. 70 sq.
29 Trudeau, P. -E., « Le Québec et le problème constitutionnel », dans : Le fédéralisme et la société canadienne-française, op. cit., pp. 7-59, à la p. 46. Cette argumentation et la thèse de la décentralisation seront reprises près de 13 ans plus tard par Garth Stevenson. Cf. « Federalism and the Political Economy of the Canadian State », dans : Panitch, Leo (ed.), The Canadian State : Political Economy and Political Power, Toronto, U. of T. Press, 1977, pp. 71 sq. à la p. 80.
30 Stevenson, Garth, op. cit., p. 89.
31 Le fédéralisme, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et les Canadiens-français, Mémoire de la S.S.J.B. de Montréal au Comité parlementaire de la Constitution du Gouvernement du Québec, Montréal, Éditions de l’Agence Duvernay Inc., mai 1964, pp. 59-60.
32 Cité par Trudeau, P.-E., « Le Québec et le problème constitutionnel », op. cit., p. 9.
33 Cf. La Presse du 27 janvier 1965 et L’Action du 21 janvier 1966. Entre-temps, Gérard Picard, président du Conseil Central de Montréal, avait dénoncé la délégation de pouvoirs et la tendance à la constitution d’un état unitaire au Canada dans une série d’articles publiés dans le Devoir en octobre 1965. Plus tôt, en juin, la Chambre de Commerce de Montréal s’était carrément opposée à la « délégation du pouvoir législatif » prévue dans la « formule F.-F. » Cf. Le Devoir du 11 juin 1965.
34 Voir : Les États généraux du Canada français, Montréal, Éditions de l’Action nationale, 1967, pp. 22 sq. La C.S.N. est absente de l’assemblée qui devait préparer la convocation des États généraux, en mars 1966.
35 Titre du numéro spécial de Socialisme 66 consacré aux élections provinciales de juin, Montréal, oct.-déc. 1966, nos 9-10.
36 Morin, Claude, Le pouvoir québécois… en négociation, Montréal, Les Éditions du Boréal Express, 1972, p. 13.
37 Parizeau, Jacques, « Québec-Canada : en plein cul-de-sac », dans : Lévesque, René, Option Québec, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1968, pp. 97-113, à la p. 105.
38 Cf. Le combat québécois, Montréal, Les Éditions du Boréal Express, 1973, pp. 178 sq.
39 Cf. La Presse du 28 juin 1966.
40 Cf. « Éditorial : le cran d’arrêt dans les vieux partis », dans : Socialisme 68, Montréal, no 14, pp. 3-7.
41 Sur cette question, voir : Bergeron, Gérard, Du duplessisme… », op. cit., pp. 485 sq.
42 Cf. Prévost, Jean-Pierre, op. cit., pp. 74 sq.
43 En dehors des travaux de Paul Gérin-Lajoie, P.-E. Trudeau ou Claude Morin, on pourra consulter : O’Hearn, Peter, J.T., Peace, Order and Good Government. A New Constitution for Canada, Toronto, The Macmillan Co. of Can. Ltd., 1964, ainsi que les essais de Daniel Johnson (Égalité ou indépendance, Montréal, Éditions Renaissance, 1965), Jean-Guy Cardinal (L’Union (vraiment) nationale, Montréal, Éditions du Jour, 1969) ou Mario Beaulieu (La victoire du Québec, Montréal, Leméac, 1971) etc. Cette approche s’éloigne considérablement de l’effort collectif tenté par les intellectuels de la Révolution américaine et de l’analyse classique qu’ils ont produit sur la question : The Federalist Papers, (N.Y., Mentor Books, 1961).
44 Le meilleur exemple de ceci nous est encore fourni par les analyses du P.C.C. et du P.C.Q.. Cf. Desautels, Guy, William Hashtan, Bruce Magnuson, Hervé Fuyet et Samuel Walsh, Pour l’autodétermination du Québec. Plaidoyer marxiste, Montréal, Éditions Nouvelles Frontières, 1978. À l’opposé, on pourra trouver une analyse fouillée et sérieuse, malgré une sous-estimation des forces nationalistes actuelles qui conduit les rédacteurs à « prédire » que le PQ ne saurait gagner le pouvoir, dans Travailleurs québécois et lutte nationale, Montréal, Éditions Militantes, 1974.
45 Colletti, Lucio, Le marxisme et Hegel, Paris, Éditions Champ Libre, 1976, pp. 257 sq. à la p. 288.
46 Ce que ne fait pas toujours la critique, fut-elle du droit. Ainsi Michel Miaille (L’État du droit. Introduction à une critique du droit constitutionnel, Paris, Maspéro/P.U.G., 1978) reste en deçà de la possibilité d’une dissolution de l’État par la critique et pose plutôt les jalons d’une approche instrumentaliste de l’État.
47 Simeon, Richard, Federal-Provincial Diplomacy. The Making of Recent Policy in Canada, Toronto, U. of T. Press, 1972, p. 10.
48 Voir supra note 4 ; et : Stevenson, Garth op. cit. pp. 80 sq.
49 Pelletier, Michel et Yves Vaillancourt, Les politiques sociales et les travailleurs, Cahier IV : Les années ‘60, par Michel Pelletier, Montréal, 1974, p. 273.

Le concept de nation[1]

Au début des années 1960, la nouvelle gauche québécoise cherche à se réapproprier les acquis du marxisme, à la lumière d’un immense travail théorique qui se fait partout dans le monde. C’est un labeur tente de sortir des sentiers battus du socialisme « réellement existant », paralysé par les expériences désastreuses de l’Union soviétique et des partis communistes. Au Québec, le marxisme et le socialisme ont eu avant la révolution tranquille une existence ténue, confinée aux marges de la société, sans beaucoup d’influence sur les mouvements populaires. Les groupes socialistes, y compris le Parti communiste canadien (le plus gros groupe) sont en fin de compte des groupuscules, malgré des efforts ici et là de militants et de militantes comme Léa Roback, Madeleine Parent, Henri Gagnon[2]. Parmi les obstacles que la gauche ne survient pas à surmonter à l’époque figure la question nationale québécoise. Le PCC notamment connaît une importante scission en 1947, la majorité des membres québécois s’en retirant.
Plus tard dans le cadre de la revue Parti Pris, la réflexion continue et reproche à la gauche d’avoir ignoré non seulement les revendications nationales québécoises, mais aussi les enseignements de Marx sur les contradictions sociales et nationales. Tout au long des années 1960 et 1970, ce débat traverse la gauche : quelle est la place de la lutte pour l’émancipation nationale dans le cadre du projet socialiste ? Est-ce que le concept de nation est « récupérable » par la gauche, malgré ses connotations droitières ? Peut-on s’inspirer des luttes de libération nationale dans le tiers-monde et refonder une pensée révolutionnaire ?
Dès 1968 dans Parti Pris, Gilles Bourque, avec Gilles Dostaler et Luc Racine, se démarque du projet du PQ « qui ne vise qu’à donner aux Québécois que quelques morceaux de plus d’un immense casse-tête dont les pièces maîtresses demeureraient entre les mains des Américains et des Canadiens-anglais »[3]. Par ailleurs, Bourque estime que l’héritage de Marx sur la question nationale est ambigu. Il regarde davantage du côté des successeurs dont Lénine et Mao qui évitent de tomber dans des « embûches réductionnistes », l’une économiciste qui évacue l’analyse des problèmes relatifs à l’État et au domaine politique, l’autre idéaliste qui tend à « réduire l’analyse en la rabattant sur l’unique question dite ‘culturelle’ »[4].
C’est dans ce contexte que Bourque, qui est alors professeur au département de sociologie de l’UQAM, signe un texte dans le premier numéro des Cahiers du socialisme. Pour Bourque, la nation n’est rien d’autre qu’un ensemble de classes en lutte. Ce n’est une réalité désincarnée, encore moins « éternelle ». Pour la décortiquer, il faut cependant sortir du marxisme ossifié, la remettre dans son contexte historique et comprendre que la gauche doit la réapproprier. En réalité, la « vision et l’action politique de chaque classe de la société dominante et de la société dominée ne sont pas déterminées, de façon immédiate, par l’appartenance à sa nation, mais bien plutôt par sa position au sein des rapports de production »[5]. (Introduction de Pierre Beaudet)
***
La nation constitue effectivement un groupe réel, mais la très grande difficulté de la définir adéquatement résulte de deux problèmes théoriques : son rapport à la question des classes et la sous-détermination qui la constitue dans sa réalité même.
Commençons par la première difficulté. Il faut constater de façon non équivoque que l’analyse de la nation pose en son cœur même la question des rapports de classes. La nation, c’est d’abord et avant tout un ensemble de classes en lutte. C’est une forme spécifique des rapports de classes. Les nations se sont formées en Europe durant la transition au capitalisme dans la lutte de la bourgeoisie contre l’aristocratie, lutte qui s’articule dans des rapports « d’alliance » conflictuels avec la paysannerie et le prolétariat naissant. La naissance de cette nouvelle forme de rapports entre les classes (de la forme spécifique que prendront les groupes linguistiques sous le capitalisme) s’analyse à travers l’étude du développement du marché (national) sous l’effet du procès de domination des rapports de productions capitalistes, lesquels, pour s’affirmer, déterminent aussi la formation d’un nouveau type d’État (national) et l’apparition d’une nouvelle idéologie (nationaliste). On comprend ici que les nations apparaissent sous l’effet d’un mode de production spécifique qui crée la question nationale et la formation sociale nationale.
Une tentative de définition marxiste de la nation doit donc envisager directement et de façon absolument prioritaire la question des rapports de classes. Si la nation constitue une forme spécifique des rapports de classes, il est clair que l’on ne peut définir cette forme sans s’attacher d’abord et avant tout aux rapports qui la créent. Seule cette façon de procéder permettra de considérer la forme que prend la nation pour ce qu’elle est. Nous prendrons ici pour exemple la « formation psychique » et la « culture commune à la nation » retenues dans la définition de Staline. Si l’on peut à juste titre parler des caractéristiques nationales de la culture, il est clair que cette culture est d’abord et avant tout une culture de classe. Son caractère spécifique résulte précisément des rapports de classes, de la lutte des classes dont elle est issue. Il n’y a pas d’abord une culture et ensuite des classes, il y a des cultures de classes qui tirent leur spécificité de la particularité de la lutte des classes à travers laquelle elles s’élaborent. L’échec de la plupart des définitions de la nation résulte précisément du fait que l’on ne voit pas que des rapports fondamentalement antagoniques peuvent créer des spécificités (et donc des possibilités d’alliance) sans produire une homogénéité et une identité qui nieraient l’antagonisme qui les fondent.
La nation matérialise donc une forme spécifique de rapports de classes. Considérons-la provisoirement comme un ensemble de classes en lutte, ensemble historiquement déterminé. L’analyse du groupe national renvoie ainsi de façon absolument prioritaire à l’histoire et à la multiplicité des formes et des situations historiques. Aussi est-il extrêmement dangereux de tenter de produire une définition fonctionnant par addition de caractéristiques. L’histoire démontre à satiété comment les nations étant en perpétuel procès de formation ou de dissolution, il faut éviter de tomber dans une casuistique servant des intérêts plus ou moins douteux.
Parler d’un ensemble historiquement déterminé de classes en lutte, c’est déjà référer implicitement à un ensemble de critères, mais sans qu’il soit nécessaire de les additionner. On pense d’abord à celui de la langue, bien sûr : on s’imagine mal un rapport de classes sans code sémantique dominant permettant la communication. L’assimilation constitue d’ailleurs le soutien principal de la nationalisation des rapports sociaux sous l’effet du MPC. De la même façon, on ne saurait parler de nation sans la présence d’ensembles idéologiques produisant une représentation de ce rapport de classes : en clair, une idéologie nationaliste ou, à tout le moins, une idéologie posant l’existence des particularités nationales. Enfin, si l’on traite d’une lutte de classes historiquement déterminée, on prend en considération l’existence d’effets politiques pertinents. La nation doit se manifester politiquement à travers la spécificité de la lutte des classes. Au Québec, cette spécificité se matérialise dans des appareils politiques provinciaux qui permettent de reconnaître facilement la nation québécoise. Toutefois, l’inexistence de pouvoirs politiques régionaux n’empêche nullement que puisse exister une spécificité de la lutte des classes manifestant sur la scène politique l’existence d’une nation différente. Ainsi, la présence des Acadiens du Nouveau- Brunswick, minorité dans une province, se manifeste sur les scènes politiques provinciale et fédérale sous une forme et dans des luttes particulières. Les Acadiens, ensemble de classes en lutte historiquement déterminé, se différencient à la fois des Québécois et des Canadiens. Ils me semblent donc constituer une nation. Cette spécificité qui les particularise remonte d’ailleurs à la Nouvelle -France alors que les contacts réels entre l’Acadie et le Canada étaient peu fréquents.
On se rend compte que la prise en considération de la lutte des classes nous permet d’introduire la question politique au cœur même du problème de la définition de la nation. La politique est au contraire exclue dès le départ dans la définition de Staline, qui décrit la nation comme une somme d’individus.
Cet ensemble de classes est historiquement déterminé. L’analyse des nations renvoie donc à une multiplicité d’histoires concrètes, mais ces histoires s’articulent à une époque déterminée du déroulement de l’Histoire. Ces ensembles sont historiquement déterminés sous l’effet d’un mode de production spécifique : le mode de production capitaliste. Cet aspect de la définition est presque unanimement admis chez les marxistes, comme chez les non-marxistes, même si cela choque les nationalistes qui croient à l’éternité de leurs fantasmes. Il faut cependant éviter de faire une lecture simpliste de cette affirmation. La question nationale peut apparaître et les nations peuvent se former même si le capitalisme n’est pas pleinement développé au sein d’une formation sociale. Son apparition comme phénomène social se situe durant la transition alors que le capitalisme n’est pas encore dominant. De même, c’est souvent la particularité régionale de l’articulation du mode de production capitaliste avec un ou des modes de production précapitalistes qui favorise la reproduction de nations différentes au sein d’un même État : ainsi, la présence massive des francophones au sein d’une agriculture de petite production marchande a très certainement contribué à la production et à la reproduction d’une spécificité de la lutte des classes au Québec. Le capitalisme ne domine pas seulement sur le plan économique les modes de production précapitalistes : on voit comment sa dominance modèle la spécificité des luttes de classes en lui donnant une forme nationale.
La nation constitue donc un ensemble sous-déterminé. Toutefois, voilà la très grande difficulté du problème, si c’est dans la lutte des classes qu’est créée et reproduite la nation, les deux phénomènes (la classe et la nation) ne sont pas absolument réductibles l’un à l’autre dans leur matérialité historique. Ainsi, la nation ne peut être unilatéralement définie comme un groupe d’individus, puisqu’elle est créée dans sa réalité même par la lutte des classes. Le procès d’affirmation du mode de production capitaliste tend à détruire les groupes linguistiques existant avant son apparition. Il tend à les faire disparaître en les fondant littéralement dans une seule et même nation ou en provoquant la redéfinition des groupes linguistiques « récalcitrants » comme des nations dominées et des minorités nationales.
On ne peut donc définir la nation sans la rapporter directement au phénomène de la lutte des classes. C’est ce que nous avons fait jusqu’ici en la considérant d’abord et avant tout comme un ensemble historiquement déterminé de classes en lutte. On ne devrait cependant pas pour autant réduire la définition de la nation à la seule réalité des rapports de classes. Ainsi, même si en le faisant, on saisit la réalité fondamentale, on ne peut définir la nation unilatéralement comme une structure de classe, ce que j’avais fait dans Classes sociales et question nationale au Québec[6].
La nation ne s’analyse que dans son procès de formation et de reproduction, lequel est en fait un procès d’assimilation continu de différents agents appartenant ou avant appartenu à des groupes linguistiques différents. C’est donc dire qu’il n’y a pas de structure de classes nationalement pure. Toutes les classes dans la plupart, sinon dans toutes, les formations sociales capitalistes, sont marquées d’un rapport majorité-minorité. On ne peut donc produire une définition exclusivement « classiste » de la nation sans tomber dans le réductionnisme et, curieusement, dans le nationalisme lui-même. On risque, en effet, dans ce dernier cas, de produire des analyses affirmant l’existence de structures de classes
nationalement hétérogènes (surtout dans le cas des États multinationaux)[7]. Le mode de production capitaliste, dans le même procès sans cesse à reproduire, divise les agents en classes et les regroupe en nations. Il les recrute dans les classes précapitalistes et dans les rapports sociaux collectivistes (bandes, tribus…) et n’en finit plus de remodeler en nations les groupes linguistiques qui regroupaient ces agents et les différenciaient les uns des autres.
Je me risquerai donc à définir la nation comme l’ensemble spécifique des agents divisés-regroupés dans le procès de la lutte des classes déterminé par le mode de production capitaliste.
Soulignons pour terminer que le caractère de sous-détermination souligné plus haut implique que le traitement de la question nationale exige un appareil conceptuel qui dépasse largement la seule définition adéquate de la nation. Bien plus, la définition non-nationaliste de la nation, le concept même de nation ne peut être produit de façon pleinement satisfaisante que dans son rapport à d’autres concepts plus englobant : J’ai proposé ceux de question nationale, de formation sociale nationale et de groupe linguistique. C’est, semble-t-il, la lecture qui doit être faîte des textes de Lénine qui pose le politique comme lieu surdéterminant de la question nationale. En élaborant une théorie de l’État national, Lénine place l’analyse sous la primauté de la lutte des classes. Nous ne reprendrons pas ici l’exposition de ces propositions, le lecteur pouvant se référer à notre ouvrage. Qu’il nous suffise de constater que le concept de formation sociale nationale peut nous permettre de poser le problème de la sous-détermination du groupe national. Type spécifique de formation sociale dominé par le capitalisme, la formation sociale nationale réunit un ensemble de classes antagonistes et non antagonistes dont les agents peuvent être de nations différentes[8]. On peut saisir ici, à travers la création du marché national et de l’État national, l’effet d’assimilation-nationalisation des groupes linguistiques en une seule et même nation, en même temps qu’il est permis d’ouvrir l’analyse aux contre-tendances à l’assimilation et à la question de la production et de la reproduction de nations différentes au sein d’une même formation sociale. On peut ainsi penser la forme nationale des luttes de classes sans réduire l’analyse à l’opposition entre des nations. Il est aussi permis de poser la primauté de la lutte des classes dans le champ national sans surestimer la réalité nationale, mais aussi sans la nier, ce qui est tout aussi dangereux théoriquement et politiquement.
- Les Cahiers du Socialisme, numéro 1, printemps 1978. ↑
- Voir Robert Comeau et Bernard Dionne, Les communistes au Québec 1936-1956. Sur le Parti communiste du Canada / Parti ouvrier-progressiste. Montréal : Les Presses de l’Unité, 1981. ↑
- Gilles Bourque, Gilles Dostaler et Luc Racine, « Pour un mouvement socialiste et indépendantiste » », Parti Pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968, reproduit dans Parti Pris, une anthologie, 2013. ↑
- Gilles Bourque, L’État capitaliste et la question nationale, Presses de l’Université de Montréal, 1977. Page 364. ↑
- Gilles Bourque (1970), Classes sociales et question nationale au Québec 1760-1840, édition électronique réalisée à partir du livre de Gilles Bourque (1970), Classes sociales et question nationale au Québec 1760-1840. Montréal, Les Éditions Parti Pris, 1970, 352 pages. Collection Aspects. ↑
- Gilles Bourque, Classes sociales et question nationale au Québec 1760-1840, Parti Pris, Montréal, 1970. ↑
- Ainsi, l’analyse du Québec en termes de double structure de classes introduite dans mon ouvrage Classes sociales et question nationale au Québec (op. cit.), est reprise dans Bourque-Frenette : « La structure nationale québécoise» (op. cit.) et, plus récemment, dans Denis Monière : Le développement des idéologies au Québec, Éditions Québec-Amérique, Montréal, 1977. Ces trois textes flirtent à des degrés divers avec cette problématique. ↑
- Ceci n’exclut nullement la présence au sein de la formation sociale nationale d’autres ensembles sociaux qui ne sont ni des classes ni des nations : les clans et les tribus par exemple qui, même s’ils sont le plus souvent en voie de dissolution, ne sont devenus ni des classes ni des nations. Nous ne tentons de saisir ici que la tendance dominante déterminée par le MPC sur la formation sociale. ↑

Décès d’Alain Krivine : une invitation à la réflexion

Alain est salué, à juste titre, pour sa fidélité envers ses engagements. Une fidélité qu’il a pu « incarner », car il était l’une des figures les plus connues de la génération militante des années 1960. Figure reconnue bien au-delà des frontières de l’Hexagone, car nous manifestions alors de Bruxelles à Berlin et que des liens de communauté de lutte se tissaient dans le monde. Il en va évidemment de même pour Daniel Bensaïd et d’autres « figures » de l’époque, comme Jacques Sauvageot, plus rapidement passé sous les radars médiatiques.
A s’en tenir aux personnalités radicales les plus « visibles » des années 60, on pourrait craindre que les défections aient été plus nombreuses que les fidélités. Elles et ils sont pourtant très nombreu.ses à avoir, anonymement, poursuivi sous une forme ou une autre (locale, associative et syndicale, politique) leurs engagements. En témoigne la multiplication de ce que nous avons appelé les « nouveaux mouvements sociaux » dans les années 90, bien souvent impulsés avec la participation de militant.es formé.es dans les années 60-70. Nous étions des millions de jeunes révoltés et il est normal qu’une grande partie d’entre nous retourne au quotidien, sans pour autant démériter en quoi que ce soit. La « génération 68 » ne s’est pas décomposée, elle a ensemencé – puis s’est heurtée à la longue durée et à la puissance de la contre-révolution néolibérale, du refoulement généralisé des droits, aux guerres en permanences, au risque de s’épuiser.
Alain était un permanent (salarié) de nos organisations successives. C’était aussi mon cas (j’ai dû être « recruté » un peu avant lui). De fil en aiguille (ce n’était pas prévu ainsi) nous sommes tous deux devenus des permanents de très longue durée. En principe, il n’est pas bon de devenir « permanent à vie », et je le déconseille. L’être pour une période de cinq ans est plus raisonnable – avec une commission d’embauche prête à aider au retour à un emploi « normal ». Je dois néanmoins avouer que je ne regrette rien : ma vie de permanent a été très riche et variée, en particulier sur le plan international, elle m’a permis de tisser de précieux liens et solidarités, d’apprendre sans fin à apprendre. Point de regrets non plus, je pense, pour Alain.
Le permanentariat – ses richesses et ses dangers – est une facette de l’histoire d’Alain qui mérite d’être abordée à l’heure où un décès – attendu et redouté – invite à un regard rétrospectif
Métier ? « Révolutionnaire professionnel ». Cela fait drôle sur un CV et un peu mytho, mais jusqu’à la fin des années 70, on ressentait l’actualité internationale de la révolution. Une fois les années 1980 passées, nous nous sommes rendu compte que nous risquions d’être longtemps des révolutionnaires sans révolution, une épaisse brume brouillant l’horizon, ressentant intimement la tension entre le nécessaire et le possible. Comme en témoignent tant de souvenirs dans ces pages, Alain s’est dépensé sans compter dans cette période claire obscure pour soutenir – une réunion, une lutte, un combat, la fondation d’une organisation outre Hexagone… avec un engagement particulièrement profond vis-à-vis de la Russie, là où il avait vécu sa première expérience fondatrice.
Investi à partir du milieu des années 70 dans des activités internationales, je n’ai recommencé à côtoyer Alain que 20 plus tard, de retour à Paris (sans pour autant rompre mes liens et solidarités tissés en Asie), puis me retrouvant dans l’équipe au Parlement européen, après les élections de 1999 – lui comme député (tout arrive !) avec Roselyne Vachetta, moi rattaché au groupe de la GUE/NGL. Nous nous considérions toujours comme des permanents, simplement avec de nouvelles fonctions. Qu’est-ce que cela voulait concrètement dire ? Notamment que de son indemnité et de mes émoluments (très conséquents), nous ne gardions que le montant du salaire que nous recevions antérieurement, utilisant le reste pour des activités politiques diverses. Une tradition que bien peu de PC respectaient encore – avec pour notable précision que nous étions tous sur la même grille de salaires, quelles que soient les tâches assumées. Autre précision qui a son importance, j’ai effectivement travaillé pour le groupe de la GUE/NGL (en particulier ses activités internationales) avec son président de l’époque, Francis Wurtz.
Être révolutionnaire sans révolution pendant des décennies n’est pas sans conséquences sur les organisations, les collectifs de direction, et les individus concernés. Toutes les failles de fonctionnement – il y en a toujours – peuvent se payer plus cher. Nous n’en sommes pas sortis indemnes et si l’on veut apprendre de l’expérience de notre génération, il faut éclairer ses parts d’ombre, et ne pas seulement voir ses lumières. Mais ce travail autocritique, c’est plutôt à nous de (continuer à) le faire.
Puisque j’évoque l’appartenance à une génération militante, est-ce à dire qu’Alain et moi appartenions à la même ? Vu d’aujourd’hui, la réponse semble évidemment positive. Pourtant, c’est à la fois vrai et faux. Si l’on remonte à nos origines, ce n’est en effet pas entièrement le cas. Dans les années 60, quelques années pouvaient faire la différence. Nous avons certes vécu une expérience fondatrice, commune, majeure, et nous avons été lancés pour longtemps sur orbite sous l’impulsion de Mai 68. Une chance rare. Cependant, Alain avait 5 ans de plus que moi et un engagement encore plus précoce, notamment dans la solidarité clandestine avec le combat d’indépendance en Algérie. Ce ne fut pas mon cas – quand nous avons fondé la JCR, j’étais un jeune militant et lui un cadre.
Pierre Rousset est spécialiste des révolutions asiatiques et cofondateur du Front solidarité Indochine . Il a participé aux événements de Mai 681 et à la création de la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR)1 . Il fait partie de la direction de la Quatrième Internationale.

La question nationale québécoise à l’ombre du capitalisme

La collection « Regards croisés sur la gauche québécoise » L’historiographie québécoise traditionnelle a pendant longtemps ignoré la gauche, mais plus largement encore, les mouvements sociaux. Des pans entiers de l’histoire québécoise sont rayés de la carte. Cette situation commence cependant à changer dans les années 1960 avec des travaux d’avant-garde comme ceux de Stanley Ryerson et d’Alfred Dubuc, puis d’une nouvelle génération d’historiens et de sociologues, notamment à l’Université du Québec à Montréal, qui publient des essais percutants dans le cadre des revues comme Parti Pris et Révolution Québécoise. Dans les années 1970, le mouvement de « libération » de l’histoire s’accélère à travers diverses expériences politiques et intellectuelles dont celles du FRAP et des interventions des mouvements populaires pour relancer la perspective de la transformation. Après l’éclipse des années 1980, le regain d’intérêt pour une « autre histoire » suscite d’autres initiatives (notamment le Bulletin d’histoire politique du Québec), projets et publications. L’édition ou la réédition d’essais historiques, d’analyses et de mémoires connaissent une embellie depuis les dernières années, notamment avec Lux Éditeur, Écosociété et M Éditeur, ainsi que les revues Les Nouveaux Cahiers du socialisme et À Bâbord. La collection « Regards croisés sur la gauche québécoise » s’inscrit donc dans un mouvement d’idées important qui ne survient pas par hasard, mais qui, au contraire, coïncide avec l’irruption de nouvelles générations militantes. Celles-ci savent que le présent est fait du passé, selon l’expression de Marx : « Le poids des générations mortes pèse lourd dans le cerveau des vivants ». Ce qui est moins connu parfois est que le présent fabrique le passé, c’est-à-dire qu’il le relit, le réinterprète et, à la lumière des développements contemporains, nous permet de mieux comprendre les dédales de la pensée et de l’intervention des générations antérieures.
Révision des textes : Chantal Drouin
Introduction
En 1978, dans l’effervescence québécoise de l’époque naît une revue, les Cahiers du socialisme. Son but est de relire la société québécoise au prisme des classes et des luttes de classes, plus particulièrement « de faire l’analyse des « rapports entre classes sociales au Québec et au Canada, de la nature de l’État capitaliste fédéral et québécois, de la place du Canada dans le système impérialiste, des voies d’organisation et d’accession au pouvoir des classes opprimées, de la question nationale »[1]. L’« aventure » durera jusqu’en 1984 [2].
L’irruption du Parti Québécois
Les Cahiers du socialisme apparaissent au moment où le mouvement populaire se retrouve confronté à un nouveau contexte. En 1976 en effet, le Parti Québécois (PQ) remporte les élections provinciales grâce à un fort appui populaire. Bien que mis en place par des éléments dissidents du Parti Libéral et un groupe social principalement composé de professionnels et de technocrates, le PQ est de toute évidence le choix du peuple et même des éléments organisés du peuple à travers le riche tissu associatif qui prend la forme de syndicats, de groupes populaires, de mouvements étudiants et féministes, etc. D’emblée, le PQ se présente comme un parti ayant un « préjugé favorable » pour les travailleurs et travailleuses. Au début du mandat effectivement, des réformes sont mises en place, dans le domaine du travail (la loi 45 interdisant l’utilisation de scabs), de la protection des consommateurs (mise en place d’un système public d’assurance-automobile), du monde rural (zonage agricole) et bien sûr, la loi 101 dont le but est de faire du français la langue dominante. Dès la fin des années 1970, le PQ remplit sa promesse de tenir un referendum sur l’avenir du Québec, d’où le projet de « souveraineté-association », qui débouche sur le vote de 1980. Les organisations populaires sont interpellées : faut-il participer à cette stratégie ? De quelle manière ? N’y a-t-il pas un risque d’être instrumentalisés dans une lutte entre élites ?
Les divisions de la gauche
Après plusieurs années de mobilisation et d’organisation populaire, les militants et les militantes de gauche sont dans une situation précaire. Des fractures sévères éparpillent la gauche entre plusieurs tendances. Dans la lignée de Charles Gagnon, une gauche dite « marxiste-léniniste » (ou « ML ») est structurée autour du groupe En Lutte ! et plus tard, du Parti communiste ouvrier. Grands rivaux pour s’imposer comme LE parti révolutionnaire, ces formations politiques s’entendent cependant pour décrier non seulement le PQ, mais l’idée même de la souveraineté, selon En Lutte ! :
Le prolétariat du Québec doit savoir qu’il n’a rien à gagner à flirter avec le mouvement indépendantiste québécois dont les intérêts fondamentaux sont anti-ouvriers ; le prolétariat du Québec doit reconnaître pleinement que son avenir réside dans la révolution socialiste et que celle-ci n’est possible que dans l’unité des forces ouvrières et populaires du Canada tout entier[3].
Jusqu’au référendum de 1980, les groupes « ML » mènent campagne contre le projet du PQ en prônant l’abstention ou l’annulation lors du referendum :
Nous ne militons pas en faveur de la séparation du Québec parce qu’elle nuirait à la cause révolutionnaire du prolétariat en le divisant face à la bourgeoisie canadienne, notre ennemi principal, et en affaiblissant notre peuple face aux visées hégémoniques des deux superpuissances. (…) Le PQ, parti bourgeois anti-ouvrier, n’est pas le défenseur conséquent de la nation québécoise. Il doit être combattu pour ce qu’il est : un parti nationaliste bourgeois pour qui les intérêts de classe priment sur les intérêts nationaux[4].
L’influence de ces groupes est réelle auprès de segments du mouvement populaire qui cherchent un projet qu’ils espèrent « authentiquement révolutionnaire » autour d’un projet totalement défini. L’indépendance, selon cette vision, est une terrible tromperie qui risque de fragmenter le Canada et de le rendre plus vulnérable à l’influence des États-Unis. La révolution prolétarienne canadienne, par ailleurs, reconnaîtra le droit à l’autodétermination du peuple québécois.
Après la défaite du « oui » cependant, une crise larvée éclate parmi ces groupes qui entrent alors dans une période de déclin irrésistible[5]. Le PCO se dissout en 1983, précédé d’En Lutte ! en 1982. Certes, il serait simpliste d’attribuer le déclin des « ML » à leur position extrême sur la question nationale, puisque plusieurs autres éléments ont déclenché cette crise terminale (la place des femmes dans l’organisation, le style de fonctionnement quasi-militaire, une pensée caractérisée par la « ligne juste » envers et contre tout, etc.).
Socialisme et indépendance
Si les « ML » en mènent large à la fin des années 1970, ils ne constituent pas le seul courant dominant dans le mouvement populaire. Des réseaux pluralistes agissent dans les mouvements populaires et expriment la continuité de l’option « socialisme et indépendance » élaborée dès les années 1960. Cette option continue l’opération politique et intellectuelle entreprise par divers mouvements comme le Parti socialiste du Québec et le Mouvement de libération populaire, les revues Parti Pris et Révolution québécoise. L’idée est de mener une lutte de libération nationale contre le colonialisme et le capitalisme[6]. Au bout de la ligne, la majorité de cette génération militante finit par accepter l’idée que l’indépendance du Québec est une condition préalable à l’émancipation sociale et se rallie au PQ. C’est ce qu’exprime Jean-Marc Piotte à l’époque :
On peut définir le courant Lévesque comme social-démocrate, et, entre la social-démocratie et le néo-capitalisme, la marge est plus qu’étroite. Mais il faut voir aussi le progrès que marque Lévesque par rapport au parti libéral et à l’UN (…) Et, plus important, une large fraction des masses les plus politisées et les plus conscientes suivent Lévesque (…) Se situer hors du mouvement Lévesque, c’est se condamner à être marginal, sans aucune prise réelle sur les événements, sur les masses populaires. C’est se condamner à créer une autre petite secte qui éclatera au bout de quelques années[7].
Cependant, toutes les personnes impliquées dans la gauche intellectuelle et militante de l’époque ne sont pas d’accord
L’initiative du mouvement indépendantiste est momentanément passée à ces petits bourgeois qui sont motivés par des intérêts de classe immédiats. La domination économique croissante des Américains sur le Québec, les limites à leur liberté politique qu’entrainent cette domination, et le pouvoir centralisateur d’Ottawa réduisent leur rôle et leur pouvoir à presque rien. Incapable de s’attaquer à la puissance économique yankee, convaincue même de pouvoir s’en passer, la bourgeoisie indépendantiste québécoise (…) ne rêve plus qu’à se débarrasser de cet intermédiaire constitué par la bourgeoisie anglo-saxonne de Montréal et de Toronto[8].
Plus tard, cette thématique évolue sous l’influence de mouvements radicalisés voulant toujours lier l’émancipation sociale à l’émancipation nationale, avec une certaine emphase sur le premier terme de l’équation (tels le Front de libération populaire, les Comités d’action politique du FRAP, la revue Mobilisation et même une fraction du Front de libération du Québec). Même d’autres groupes continuent d’argumenter en faveur d’une indépendance par et pour les travailleurs :
Il n’y a qu’une seule solution possible : que le peuple québécois sous la direction des travailleurs organisés renverse la domination impérialiste, libère les forces productives de l’emprise du capital nord-américain et prenne collectivement le contrôle de la richesse sociale. Le nationalisme déplace les problèmes en insistant sur les aspects ethniques et culturels de la domination étrangère : « C’est la faute aux Anglais ! C’est contre Ottawa qu’il faut se battre ! ». Alors qu’en réalité les responsables étaient et sont encore avant tout capitalistes, anglais autrefois, surtout américains aujourd’hui. Pour le faire, d’abord libérer nos consciences, changer notre mentalité individualiste pour une solidarité et une conscience claire des intérêts communs de la classe ouvrière (…) Nous rendre capables de reprendre en mains nos moyens de production, notre sol, nos ressources naturelles, en somme, l’ensemble de notre richesse sociale[9].
À la veille du référendum de 1980, des centrales syndicales comme la CSN et la CEQ (l’ancêtre de la CSQ), des mouvements communautaires et étudiants, et des organisations de gauche tels le Regroupement pour la socialisme (RPS), le Groupe socialiste des travailleurs (GST) et le Groupe marxiste révolutionnaire (GMR)[10] convergent pour à la fois se distancier du PQ qui est pour eux un « parti bourgeois », tout en proclamant la nécessité d’une indépendance par et pour le peuple :
Nous sommes indépendantistes parce que l’oppression de la nation québécoise constitue un problème social majeur dont la solution ne peut être trouvée dans le cadre du système fédéral canadien (…) Dans ce contexte, les classes populaires francophones frappées à la fois par l’exploitation capitaliste, par le sous-développement régional et par l’oppression nationale se trouvent à constituer une force potentielle de changement social stratégique[11].
Pour plusieurs syndicalistes de gauche de l’époque :
Il est important de soustraire les travailleurs de l’influence du PQ. Ceci implique une lutte idéologique dans le but de dégager la portée réelle de la lutte nationale et la nécessité d’une hégémonie des travailleurs organisés dans cette lutte. Renforcer la lutte nationale, c’est s’attaquer à l’ennemi principal dans lutte nationale et à des ennemis dans la lutte anticapitaliste. C’est lier ensemble lutte de classe et lutte nationale comme condition de développement de l’organisation politique autonome des travailleurs[12].
Dans le contexte du référendum de 1980, ces courants de gauche pro-indépendance ont font campagne pour un « oui critique », ce qui veut dire oui à la question posée concernant l’accession à la souveraineté, et critique à l’endroit du PQ :
Le défi de la bourgeoisie québécoise est réaménager son espace dans le capitalisme nord-américain. Le PQ espère trouver un partenaire prêt à élaborer un fédéralisme renouvelé tout en lui donnant plus de pouvoir (…) Au contraire, l’indépendance sera le moment d’un nouveau rapport de forces, d’une brèche dans le système de domination capitaliste en Amérique du Nord (…) L’indépendance préconisée par le mouvement ouvrier québécois implique l’élaboration d’une stratégie anti-impérialiste et anticapitaliste à l’échelle continental.
Plus encore :
Notre appui à l’indépendance est un aspect de la lutte politique pour le socialisme, c’est une position de démarcation sans équivoque avec le nationalisme, car nous sommes conscients que les intérêts des travailleurs sont antagoniques à ceux de la bourgeoisie et de toute autre force sociale qui préconise une « autre voie » que le socialisme, ce qui conduirait le Québec à s’intégrer d’une nouvelle manière dans le système capitaliste mondial[13].
Par rapport au PQ, la gauche indépendantiste précise que :
Les projets qu’il véhicule tant sur la question sociale et économique que sociale, sont colorés et déterminés par sa volonté de construire un bloc social, une alliance de classe, dans lesquels la première place revient au capital, la seconde aux petites-bourgeoisies de couches supérieures et la troisième seulement aux classes populaires. Cela signifie que le gouvernement du PQ sacrifie les classes populaires chaque fois qu’il est impossible de leur faire des concessions sans heurter en même temps les capitalistes de la petite et de la moyenne entreprise[14].
Après la défaite du référendum de 1980, la tendance « indépendance et socialisme », comme les autres groupes de gauche connaîtra un déclin[15]. Ce déclin est la conséquence de plusieurs facteurs dont une certaine démobilisation temporaire des mouvements populaires, le désarroi idéologique reliée au collapse des groupes marxistes et du socialisme «réellement existant» et à d’autres facteurs importants qui méritent d’être étudiés mais qui ne sont pas l’objet de cette publication
Une revue et un projet
Face à cette évolution, de jeunes intellectuels, pour la plupart professeurs à l’UQAM, décident à la fin des années 1970 de reprendre un certain nombre de débats plus ou moins mis de côté depuis la disparition de la revue Parti Pris, dont l’influence a été importante entre 1963 et 1968. D’ailleurs, un certain nombre de rédacteurs de Parti Pris se retrouve dans les Cahiers du socialisme. D’emblée, la question nationale, dans le contexte du référendum annoncé, devient un des thèmes privilégiés. De concert avec divers secteurs du mouvement populaire et des réseaux de gauche indépendantes, la revue s’acharne à décortiquer la nature du bloc de classe qu’essaie de construire le PQ, de manière à s’en distinguer et à proposer un projet contre-hégémonique enraciné dans la société et dans ses luttes. À cette époque, plusieurs professeurs des départements de sciences sociales de l’UQAM sont engagés dans une réflexion critique et pédagogique, pour poursuivre une rigoureuse analyse théorique d’une part, et traduire celle-ci d’une manière à interpeller une partie importante de la gauche et du mouvement populaire, ce qui fait que les textes ne sont pas contraints à la forme académique en usage.
Ce qu’on retrouve dans le recueil
Le premier texte provient du numéro de lancement des Cahiers (par Gilles Bourque) et tente de mettre sur la table un certain nombre d’hypothèses concernant le fait national. Pour Bourque, la nation n’est pas une réalité intangible et éternelle, mais un processus marqué par la lutte des classes. Le tout doit être historicisé à travers les luttes traversant l’espace canadien et québécois depuis 1945 (comme l’explique Dorval Brunelle). Par la suite, les rédacteurs des Cahiers tentent d’expliquer le « phénomène » du PQ à travers les rapports de classe (Levasseur et Lacroix), la gestion du pouvoir (Niosi, Piotte et Dostaler), et la composition des groupes sociaux au coeur du projet péquiste (Bourque et Légaré). Cette analyse est poursuivie dans d’autres textes qui analysent la stratégie des dominants (le collectif du Centre de formation populaire) et la nature du projet libéral-fédéraliste (Brunelle). Le tout constitue un bon aperçu des débats, travaux et recherches en cours à cette époque de démarcation. L’échec du référendum de 1980, suivi du détournement du PQ vers la gestion néolibérale et l’abandon du projet de souveraineté (la politique dite du « beau risque » consistant à appuyer le gouvernement conservateur à Ottawa), mettra un terme temporaire à ces explorations, du moins jusque dans les années 1990, ce qui explique sans doute la dislocation du projet des Cahiers.
Aujourd’hui, la tradition des Cahiers continue sous la forme des Nouveaux Cahiers du socialisme.
- « Présentation », Les Cahiers du socialisme, numéro 1, 1978, p. 2. ↑
- Richard Poulin, « Des revues engagées, Cahiers du socialisme, Critiques socialistes et Nouveaux Cahiers du socialisme », Bulletin d’histoire politique, volume 19, numéro 2, hiver 2011. ↑
- 11 Marc Ferland et Yves Vaillancourt, Socialisme et indépendance au Québec, Éditions Albert Saint-Martin, 1981, pages 62-63.En Lutte !, Pour l’unité du prolétariat canadien, publié par En Lutte !, avril 1977, page 27. ↑
- Document d’entente politique pour la création de la Ligue communiste (marxiste-léniniste) du Canada, novembre 1975. ↑
- David Milot et al., « Histoire du mouvement marxiste-léniniste au Québec 1973-1983 », Bulletin d’histoire politique du Québec, volume 13, numéro 1, automne 2004. ↑
- Lucille Beaudry, « Le marxisme au Québec: une hégémonie intellectuelle en mutation (1960-1980). » publié dans l’ouvrage sous la direction de Lucille Beaudry, Christian Deblock et Jean-Jacques Gislain, Un siècle de marxisme. Les Presses de l’Université du Québec, 1990. ↑
- Jean-Marc Piotte, « Lettre à une militante », Partis Pris, volume 5, numéro 8, été 1968. ↑
- Charles Gagnon, « Proposition pour la révolution nord-américaine », été 1968, reproduit dans Charles Gagnon, Feu sur l’Amérique, Écrits volume un 1966-72, Lux Éditeur, 2006 ↑
- CAP Maisonneuve et Cap Saint-Jacques, La nécessité d’une organisation politique des travailleurs, avril 1972 ↑
- Ces deux derniers se réclamant de l’héritage de la Quatrième Internationale ↑
- Marc Ferland et Yves Vaillancourt, Socialisme et indépendance au Québec, Éditions Albert Saint-Martin, 1981, pages 62-63. ↑
- Bernard Normand et Victor Lapalme, Travailleurs québécois et lutte nationale, Document de travail de la CEQ, janvier 1973, p. 71. ↑
- CFP, La question nationale, un défi à relever pour le mouvement ouvrier, mai 1978. ↑
- Yves Vaillancourt avec la collaboration d’Annie Antonès, Le PQ et le social, éléments de base des politiques sociales du gouvernement du Parti Québécois, 1976-1982, Éditions Saint-Martin, 1983. ↑
- Le Regroupement pour le socialisme, le Mouvement socialiste (créé en 1980 par Marcel Pepin) et le Groupe socialiste des travailleurs seront tous dissous. Voir à ce sujet Pierre Beaudet, « La radicalisation des mouvements sociaux dans les années 1970, Bulletin d’histoire politique, « La gauche au Québec depuis 1945 », volume 19, no 2, automne 2010. Les raisons complexes de ce déclin seront développées dans un autre cahier de la collection. ↑

LES CAHIERS, LES REVUES, LA CONJONCTURE – Les Cahiers du socialisme (1981)

Les Cahiers du socialisme sont une revue publiée à Montréal de 1978 à 1984. D’abord centrée autour du nationalisme de gauche, la revue s’oriente davantage vers le socialisme à partir du numéro 7 puis vers les questions internationales et culturelles dans les derniers numéros, avant de cesser sa publication à la suite du numéro 16. La revue est animée principalement par des professeur.es du département de sociologie de l’UQAM et a le statut de revue scientifique malgré qu’elle délaisse souvent l’analyse au profit du positionnement politique. La revue se dissocie des organisations d’extrême-gauche comme des partis politiques et des syndicats, se voulant un lieu d’analyse indépendant, mais se lie de fait à des groupes socialistes. Les articles les plus pertinents de la revue restent d’ailleurs ceux de la « période socialiste » des Cahiers, qui sont les plus engagés et les plus significatifs politiquement.
Faisant le bilan de son parcours ainsi que de l’état des publications de gauche au tournant des années 1980, les Cahiers du socialisme publient dans le numéro 8 (automne 1981) un éditorial critique traitant ces questions. La revue est alors en repositionnement théorique et cherche à évaluer son rôle dans l’univers des publications radicales au Québec, cherchant notamment à être moins académique et plus attentive à la lutte des classes. Nous republions ici cet éditorial qui offre à la fois une présentation des groupes et des publications de gauche actifs dans les années 1970 ainsi que l’appréciation critique des Cahiers vis-à-vis de ceux-ci. L’éditorial offre ensuite un aperçu du projet politique défendu par la revue, à savoir un socialisme devant mener le Québec à l’indépendance.
Notons enfin que les Cahiers du socialisme ont une postérité littéraire dans la revue des Nouveaux cahiers du socialisme (publiés depuis 2009) qui se réclament directement des Cahiers des années 1980. Les idées des premiers Cahiers sont aussi reprises par Québec Solidaire, qui reconduit donc certaines apories présentes dans la revue. Le parti politique reste aux prises avec la contradiction interne du « réformisme socialisant » en régime capitaliste, avec le rôle contradictoire des syndicats – collaborant avec le patronat – dans la lutte pour le socialisme ou encore avec le problème du dépassement du nationalisme québécois puisque celui-ci se base sur une souveraineté coloniale inconciliable avec les droits des peuples autochtones. Cette convergence des idées entre Cahiers des années 1980, Nouveaux cahiers du socialisme et Québec Solidaire est très perceptible dans le présent éditorial de 1981.
Les Cahiers, les revues, la conjoncture
Par Pierre Milot et Jean-Guy Lacroix (pour le Comité de rédaction)
La problématique « indépendance et socialisme » avait, dans les années 60, regroupé les progressistes autour de la revue Parti Pris ; dans une moindre mesure la revue Socialisme (devenue par la suite Socialisme Québécois) avait joué un certain rôle dans l’élaboration et la diffusion de cette problématique.
Avec l’éclatement de Parti Pris et le passage d’une partie de ses collaborateurs au PQ, avec les « évènements d’Octobre » et leurs conséquences pour l’ensemble du mouvement ouvrier et populaire, avec le développement du courant contre-culture endigué au sein de la revue Mainmise au début des années 70, la problématique « indépendance et socialisme » s’est progressivement canalisée dans l’appareil péquiste tout en s’élaguant de ses postulats fondamentaux (et plus particulièrement ceux concernant la question du socialisme).
Ce processus devait s’accélérer avec l’arrivée de la presse marxiste-léniniste (La Forge, En Lutte !, etc.) qui mettait de l’avant le projet d’un socialisme canadien, reléguant la question nationale dans les abîmes du nationalisme bourgeois. C’est ainsi que des revues comme Mobilisation et le Bulletin populaire en vinrent à adopter la conception d’un socialisme pan-canadien, la question nationale devenant une « contradiction secondaire » selon la grille d’analyse maoïste appliquée par les « m-l » canadiens, au milieu des années 70.

Il faut se rappeler qu’en 1972, lorsque Charles Gagnon publia « Pour le Parti Prolétarien » (brochure qui donna naissance au groupe En Lutte !), il y était question de socialisme québécois : ce n’est qu’en 1974, au moment où en En Lutte ! s’ajusta à la politique extérieure chinoise des « trois mondes » que la thèse du socialisme canadien fut mise de l’avant. Puis en 1975 avec l’arrivée de la Ligue Communiste (marxiste-léniniste) du Canada (qui donnera naissance au PCO), la défense de l’indépendance nationale… du Canada sera lancée comme mot d’ordre : la Ligue ira même jusqu’à proposer l’appui des marxistes-léninistes à l’augmentation du budget militaire du gouvernement fédéral ! L’application de la « théorie des trois-mondes » au Canada avait donc produit l’équation suivante : il faut défendre l’indépendance nationale du Canada, pays du « second monde », contre l’impérialisme américain (pays du « premier monde »), et par conséquent s’opposer à toute déstabilisation de la structure canadienne par la question nationale1.
Les thèses « m-l » eurent une influence considérable parmi certaines revues socio-culturelles de cette époque. C’est ainsi qu’entre 1977 et 1978 deux revues (Stratégie et Champs d’application) se sont littéralement sabordées pour se mettre « au service du prolétariat canadien » (i.e. rallier les rangs de la Ligue ou d’En Lutte !), tandis que Chroniques s’est dissoute suite à une longue polémique avec Stratégie et Champs d’application à propos du réalisme socialiste et du marxisme-léninisme sur le front culturel.
 Documents divers de l’organisation En Lutte ! (1972-1982) et d’autres groupes marxistes-léninistes.
Documents divers de l’organisation En Lutte ! (1972-1982) et d’autres groupes marxistes-léninistes.
Bien que la revue Possibles aie publié depuis 1976 quelques numéros où soufflait la brise d’un nationalisme autogestionnaire bien éloigné de la bourrasque « m-l », il faudra attendre 1978 et la parution du Temps fou, d’Interventions critiques en économie politique et des Cahiers du socialisme pour voir réapparaître un certain type de questionnement sur les formes de transition au socialisme, la nature de classe du projet péquiste, de même qu’une redéfinition des stratégies de résistance basées sur les groupes autonomes et les alternatives régionales (dont la revue Focus du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un reflet actif).
Si Le Temps fou palliait à un manque au niveau de la « critique de la vie quotidienne », les Cahiers quant à eux répondaient à un « vide théorique » dû au rabaissement de la question nationale par le pouvoir péquiste et à la réduction dogmatique du socialisme par l’orthodoxie marxiste-léniniste.
Avec l’avènement des années 80 et « l’impasse » causée par les résultats du référendum, c’est à une restructuration des forces progressistes que l’on assiste : la problématique « indépendance et socialisme » revient en filigrane mais à partir de postulats nouveaux axés sur la critique des pratiques politiques antérieures. C’est ainsi que la publication du mensuel Presse-libre, au début de l’année dernière, est venue soulever un fond d’air frais parmi les militants syndicaux et les membres des groupes populaires.
D’autre part, bien des choses ont « évolué » dans la presse « m-l », et plus particulièrement au sein du journal En Lutte ! qui a innové en instituant dans ses pages une chronique (plus ou moins régulière) sur les « Débats au sein de la gauche ». En fait, cette chronique à surtout servi de tentative de rapprochement avec la gauche socialiste québécoise : c’est dans cette optique qu’ont été analysés les livres de Bourque-Dostaler (« Socialisme et indépendance »), de Dézy-Ferland-Lévesque-Vaillancourt (« La conjoncture au Québec… »), de même que le recueil collectif « L’impasse » (sous la direction de Laurin-Frenette et Léonard). En parallèle à cette démarche qui a toutes les allures d’une opération tactique de survie politique, le journal En Lutte ! s’est lancé dans la publication de « Documents pour la critique du révisionnisme », où l’on se pose de « sérieuses questions » sur Staline, les années 30 en URSS et sur les « erreurs » de la IIIe Internationale ! Au printemps dernier, le journal annonçait la faillite d’En Lutte ! dans sa tentative de reconstruction d’une nouvelle Internationale monolithique (programme et statuts communs, etc.), et un article récent proposait l’hypothèse qu’En Lutte ! abandonne son projet de parti prolétarien et se réorganise à la façon du groupe italien Lotta Continua. Un débat intéressant à suivre pour la gauche socialiste québécoise, mais qui laisse perplexe à bien des égards. Quant au PCO, mieux implanté dans les syndicats, il poursuit une démarche moins dogmatique qui le démarque peu à peu du maoïsme d’antan.
 Quelques numéros de la revue Le Temps fou (1978-1983).
Quelques numéros de la revue Le Temps fou (1978-1983).
C’est dans ce bouillonnement des nouvelles pratiques politiques et culturelles que les Cahiers du socialisme entendent s’inscrire dans les mois et les années à venir : déjà l’éditorial du numéro 7 (hiver-printemps 81) avait posé les balises d’une certaine relance de la revue à partir d’un socle moins académique et plus près de la mouvance des alternatives actuelles.
La « crise du marxisme » engendrée par les pratiques politiques des pays du « socialisme réel », le rejet de certaines formes organisationnelles hyper-centralisées par le mouvement féministe, ont entraîné la remise en question des relations parti-syndicats (l’exemple polonais n’a plus à être rappelé) et des rapports hiérarchiques hommes-femmes (les scissions provoquées par des femmes au sein d’organisations politiques en témoignent). La question nationale québécoise et la lutte des Autochtones ne constituent pas une problématique séparée, et c’est à ce titre que les Cahiers entendent s’interroger et débattre par des textes théoriques de fond, des analyses conjoncturelles et des dossiers thématiques.
C’est donc la conjoncture actuelle qui a déterminé l’objectif de la transformation des Cahiers, c’est-à-dire faire de la revue un instrument de réactualisation de la problématique « indépendance et socialisme » et montrer la nécessité du projet de société qui en découle. Il s’agit en somme de faire des Cahiers un outil de discussion s’inscrivant dans la convergence présente d’initiatives militantes (le Regroupement des militants pour le socialisme, le Comité des 100, le Centre de Formation Populaire, etc.), dans une ouverture à une pluralité de gauche.
Cette perspective « ouverte » vise à assurer que dans cette effervescence d’idées se développe un projet unifié de société par l’enrichissement des diverses propositions et non pas par un réductionnisme auquel conduirait une démarcation par la négative et le ralliement à un dogme, tel que nous l’a montré la « lutte pour l’unité » des « m-l » canadiens par le passé.
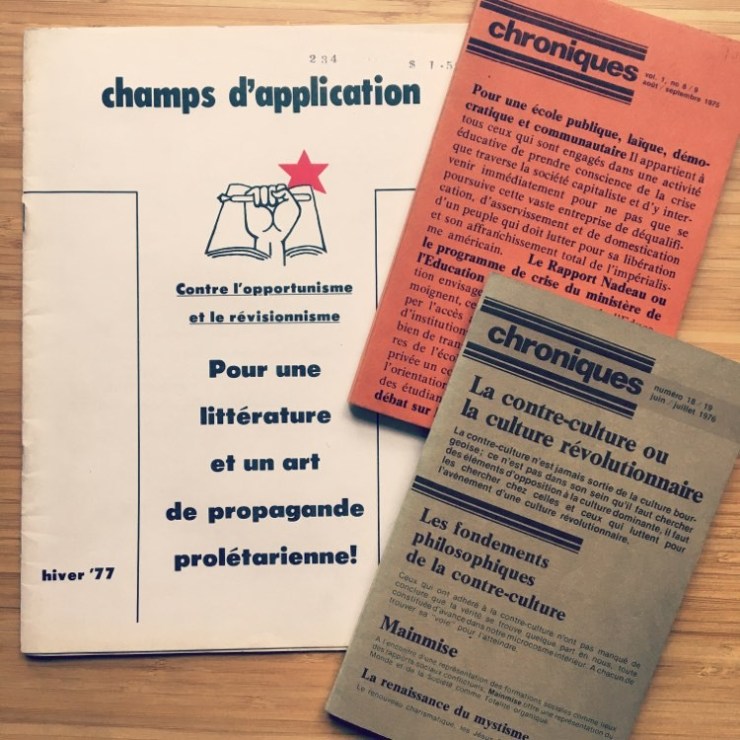 Quelques numéros des revues Champs d’application (qui se saborde au profit de l’organisation En Lutte !) et Chroniques (1975-1977).
Quelques numéros des revues Champs d’application (qui se saborde au profit de l’organisation En Lutte !) et Chroniques (1975-1977).
La conjoncture actuelle semble se caractériser par la démarcation positive, la mise en lumière des points de rapprochement. On peut même affirmer qu’émerge, sur la base des leçons tirées de l’expérience politique des pratiques militantes antérieures, un mouvement de convergence de la gauche socialiste québécoise autour du projet « socialisme et indépendance » (il faut noter qu’ici l’inversion des termes n’est pas qu’une simple nuance sémantique mais un effet politique qui postule un objectif stratégique).
L’idée que le projet alternatif de société doit intégrer conjointement socialisme ET indépendance est de plus en plus partagée, par rapport à l’ancienne tactique de l’indépendance d’abord, le socialisme ensuite.
Les dix dernières années ont été déterminantes dans l’évolution de cette analyse historique. D’une part la vague « m-l », malgré sa relative importance, n’a pas conduit à une unification populaire dans un projet de société, d’autre part la gestion sociale péquiste, avec son lot de désillusions chez les militants des syndicats et des groupes populaires, a fait en sorte que malgré son accession au pouvoir et sa réélection le PQ n’a pu imposer au peuple québécois son projet de Souveraineté-Association.
L’actuel mouvement de convergence, au sein de la gauche socialiste québécoise, cherche à lever l’obstacle historique que constituait pour le peuple québécois la traditionnelle division de l’indépendance et du socialisme, division faisant du socialisme une question séparée de l’indépendance. C’est ce postulat qui a fait que les organisations de gauche ont toutes trébuché sur la question nationale par le passé. Avec pour conséquence que ni le vieux PCC (Parti Communiste Canadien), ni le NPD (Nouveau Parti Démocratique), ni les « m-l » canadiens n’ont réussi à véritablement s’implanter au Québec et à être légitimé par les couches populaires et ouvrières québécoises. À l’inverse, le nationalisme « traditionnel » comme le nationalisme « moderne » de la Révolution tranquille et de la Souveraineté-Association n’ont jamais intégré les revendications ouvrières et populaires que pour les détourner de leurs objectifs propres, au nom de la Nation. Le peuple québécois s’est toujours tôt ou tard détaché de ces mouvements et partis politiques : c’est ce que montre la « rupture populaire » avec le duplessisme, avec la Révolution tranquille, et c’est ce qui pend au nez du PQ qui, le sachant fort bien, tente de raviver la flamme (même celle « de gauche » !) de ses adhérents par un appel à la survie de la communauté nationale.
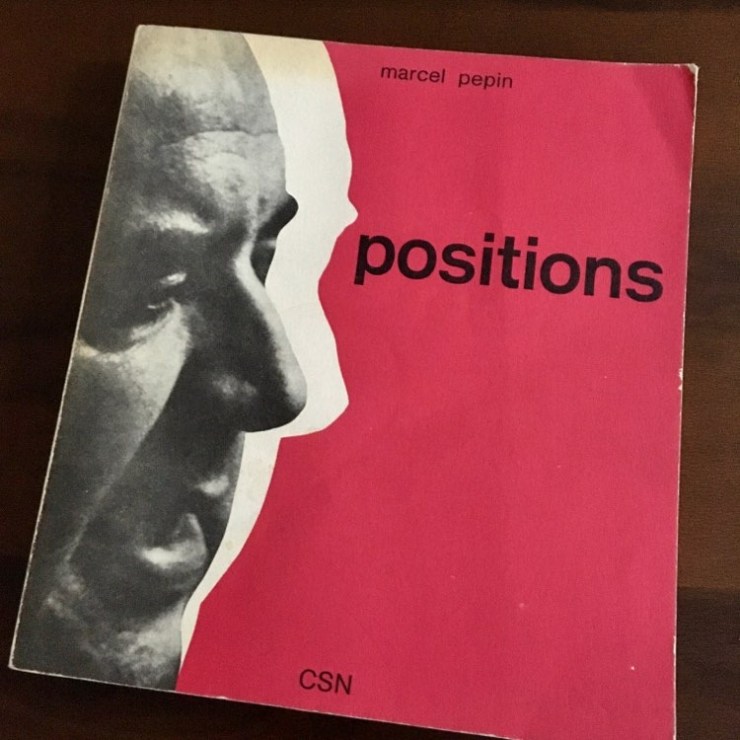 Marcel Pepin (1926-2000), président de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) de 1965 à 1976, instigateur du Comité des 100 et de leur manifeste puis fondateur du Mouvement Socialiste du Québec en 1981.
Marcel Pepin (1926-2000), président de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) de 1965 à 1976, instigateur du Comité des 100 et de leur manifeste puis fondateur du Mouvement Socialiste du Québec en 1981.
La question nationale doit être abordée nécessairement et prioritairement par le point de vue des couches ouvrières et populaires : c’est le projet socialiste qui doit donner tout son sens à la revendication d’indépendance. Cette échappée interdit donc de penser une quelconque fraction de la bourgeoisie québécoise comme un allié ou d’imaginer accorder une nouvelle « chance au coureur ». Ce projet socialiste ne pourra s’élaborer qu’en solidarité avec les peuples autochtones et les travailleurs immigrés.
Mais doit-on considérer que la problématique « socialisme et indépendance » constitue le seul axe du projet alternatif ? N’y a-t-il pas d’autres composantes de réflexion et de revendications qui doivent se fusionner dans ce projet et ainsi enrichir cette alternative de société par les solidarités multiples bien qu’autonomes ? Comme nous le mentionnions plus haut, la question des femmes constitue un élément fondamental de questionnement des pratiques politiques passées. Cette attitude témoigne d’une rupture avec l’analyse dogmatique qui centre toute sa théorisation et sa stratégie autour d’une « contradiction principale » sous laquelle sont subsumées toutes les « contradictions secondaires », au fur et à mesure qu’elles surgissent ou resurgissent dans un contexte donné.
Proposer que la revue soit un instrument de débat concerne donc en premier lieu l’interrogation sur l’identification et l’articulation des axes structuraux de socialisme comme processus de rupture du capitalisme, ce qui implique une analyse historique des sociétés dites socialistes, les pays du « socialisme réel ».
Il faudra chercher à saisir la signification des pratiques politiques nouvelles, les analyser, les critiquer, en révéler les contradictions, témoigner de leur existence. Bref, faire place à la pratique sociale tout en travaillant à la théorie de cette pratique.
Le Comité de rédaction compte annoncer à l’avance la thématique de certains numéros à venir, de sorte que des dossiers puissent être montés à partir de groupes ou d’individus œuvrant dans divers champs : ainsi le numéro 9 devrait simultanément faire appel à des témoignages provenant des différents fronts de lutte (question nationale, mouvement féministe, lutte des Autochtones et des immigrants, groupes populaires, etc.) à partir de la thèse présentée ici d’un mouvement de convergence de la gauche socialiste québécoise.
Les changements annoncés dans l’éditorial du numéro 7 sont en cours. Le présent texte en témoigne de même que l’élargissement du Comité de rédaction. D’autres transformations sont à venir au niveau d’une meilleure distribution de la revue à Montréal et dans les régions du Québec.

Notes :
[1] Sur cette thèse, voir MILOT, Pierre, « Le schisme Chine-Albanie et le mouvement marxiste-léniniste canadien », in Les Cahiers du socialisme, no. 6, automne 1980.

Crise climatique. Les données montrent que le point de basculement de la forêt amazonienne est imminent

Selon des données, l’Amazonie s’approche d’un point de basculement, après quoi la forêt tropicale disparaîtrait, ce qui aurait des conséquences «profondes» pour le climat mondial et la biodiversité.
Des modèles informatiques avaient déjà indiqué qu’un dépérissement massif de l’Amazonie était possible, mais la nouvelle analyse se fonde sur des observations satellitaires réelles effectuées au cours des trois dernières décennies.
Une nouvelle analyse statistique montre que plus de 75% de la forêt vierge a perdu sa stabilité depuis le début des années 2000, ce qui signifie qu’elle met plus de temps à se rétablir après les sécheresses et les incendies.
La perte de stabilité la plus importante se situe dans les zones proches des exploitations agricoles, des routes et des zones urbaines et dans les régions qui deviennent plus sèches, ce qui suggère que la destruction des forêts et le réchauffement climatique en sont la cause. Ces facteurs «pourraient déjà avoir poussé l’Amazonie près d’un seuil critique de dépérissement de la forêt tropicale», concluent les scientifiques.
***
L’étude ne permet pas de prédire quand le point de basculement pourrait être atteint. Mais les chercheurs ont prévenu que lorsque le déclenchement du point de basculement pourrait être détecté, il serait trop tard pour l’arrêter.
Une fois déclenchée, la forêt tropicale se transformerait en prairie en quelques décennies tout au plus, libérant d’énormes quantités de carbone et accélérant encore le réchauffement de la planète.
Les points de basculement à l’échelle planétaire font partie des plus grandes craintes des climatologues, car ils sont irréversibles à l’échelle humaine de temps. En 2021, la même technique statistique a révélé des signes avant-coureurs de l’effondrement du Gulf Stream et d’autres courants clés de l’Atlantique, avec «une perte presque totale de stabilité au cours du siècle dernier».
Un arrêt de ces courants aurait des conséquences catastrophiques dans le monde entier, perturbant les pluies de mousson et mettant en danger les calottes glaciaires de l’Antarctique.
Une autre étude récente a montré qu’une partie importante de la calotte glaciaire du Groenland est sur le point de basculer, ce qui entraînerait une hausse du niveau de la mer de 7 mètres à terme.
***
«De nombreux chercheurs avaient élaboré théoriquement qu’un point de basculement amazonien pourrait être atteint, mais notre étude fournit des preuves empiriques essentielles que nous nous approchons de ce seuil», a déclaré le professeur Niklas Boers, de l’Université technique de Munich (Technische Universität München) en Allemagne. «Voir une telle perte de résilience dans les observations est inquiétant. La forêt amazonienne stocke d’énormes quantités de carbone qui pourraient être libérées en cas de dépérissement même partiel.
Les scientifiques ont déclaré que le dépérissement de l’Amazonie avait «de profondes implications à l’échelle mondiale». Niklas Boers a ajouté: «L’Amazonie est certainement l’un des éléments les plus rapides de ces éléments de basculement dans le système climatique.»
Les recherches, publiées dans la revue Nature Climate Change, ont établi sur la base des données satellitaires un bilan de la quantité de végétation dans plus de 6 000 cellules de quadrillage à travers l’Amazonie vierge de 1991 à 2016. Ils ont constaté qu’au cours des 20 dernières années, les zones touchées par des sécheresses ou des incendies ont mis beaucoup plus de temps à se rétablir qu’auparavant. C’est un signe clé d’une instabilité croissante, car cela montre que les processus de restauration s’affaiblissent.
Les zones sèches de la forêt ont perdu plus de stabilité que les zones humides. «Ce constat est alarmant, car les modèles du GIEC [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] prévoient un assèchement général de la région amazonienne en réponse au réchauffement climatique», a déclaré Niklas Boers.
Les zones les plus proches de la destruction de la forêt par l’homme sont également devenues plus instables. Les arbres sont essentiels à la production de pluie, et leur abattage pour dégager des terres pour l’élevage et la production de soja crée un cercle vicieux de conditions plus sèches et de pertes d’arbres supplémentaires.
***
Une autre étude réalisée en 2021, fondée sur les données de centaines de vols de petits avions, a montré que l’Amazonie émet désormais plus de dioxyde de carbone qu’elle n’en absorbe, principalement à cause des incendies.
Mais Niklas Boers a déclaré que les données indiquaient que le point de basculement n’avait pas encore été franchi: «Il y a donc de l’espoir». Le professeur Tim Lenton, de l’université d’Exeter au Royaume-Uni, coauteur de l’étude, a déclaré: «Cette étude soutient les efforts visant à inverser la déforestation et la dégradation de l’Amazonie pour lui redonner une certaine résilience face au changement climatique en cours.»
Chris Jones, du Met Office Hadley Centre au Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l’équipe de l’étude, a déclaré: «Cette recherche ajoute des preuves irréfutables que le changement climatique est un risque actuel, et que ces impacts graves et irréversibles pourraient devenir une réalité. Nous disposons d’une fenêtre d’opportunité étroite pour prendre des mesures urgentes.»
***
«La conclusion inquiétante [de l’étude] correspond à d’autres recherches récentes sur l’augmentation de la mortalité des arbres, la multiplication des incendies et la réduction des puits de carbone régionaux. Le rapport du GIEC, publié la semaine dernière [voir le résumé sur ce site publié le 5 mars], estime que «les risques d’événements singuliers de grande ampleur, tels que le dépérissement de l’Amazonie, sont plus proches que jamais.»
Bernardo Flores, de l’Université fédérale de Santa Catarina au Brésil, a déclaré: «L’étude montre que même si la forêt semble aller bien, avec sa structure et sa biodiversité normales, les processus internes sont déjà en train de changer, silencieusement, réduisant la capacité du système à persister à long terme. L’approche utilisée est intéressante car elle révèle des signaux d’alerte précoces de ces changements.» Les recherches de Bernardo Flores ont révélé que les savanes s’étendaient au cœur de l’Amazonie à cause des feux de forêt.
Le gouvernement du président brésilien, Jair Bolsonaro, a été sévèrement critiqué pour avoir encouragé la déforestation, qui a augmenté de 22% au cours de l’année écoulée jusqu’en novembre 2021, soit le niveau le plus élevé depuis 2006.
Niklas Boers a déclaré: «Il est vraiment compliqué de dire ce qui arrivera en premier: atteindre un point de basculement par [perte de stabilité] du système de végétation naturelle, ou simplement l’arrivée des bulldozers qui détruisent la forêt.» (Article publié dans The Guardian, en date du 7 mars 2022; traduction rédaction de A l’Encontre)
Damian Carrington est rédacteur responsable pour la rubrique environnement.

Personnes immigrées et logement : le grand défi

S’installer dans un logement décent et abordable dans un quartier accueillant et sécuritaire constitue une étape primordiale de l’établissement des nouveaux arrivants et arrivantes au pays. Plus qu’un simple toit, le premier logement permanent permet d’organiser la vie quotidienne et d’accéder aux services d’insertion linguistique et économique. Souvent, ce premier logement répond aux exigences de base, sans plus, à cause du contexte migratoire, des ressources financières très restreintes des personnes immigrées ou de leur faible connaissance du marché. Ces personnes aspirent cependant à améliorer leur qualité de vie à moyen terme, d’où la deuxième étape qui consiste idéalement à passer de la situation de locataire à celle de propriétaire; cela revêt une importance autant symbolique que matérielle et représente un gage de réussite de l’insertion dans la société nord-américaine.
À Montréal, les immigrantes et les immigrants des années 1960 et 1970, issus principalement des pays d’Europe du Sud, accédaient à la propriété en plus grande proportion que les autres ménages, parce qu’ils cumulaient les revenus de plusieurs membres de la famille en vue de l’achat et de la remise en état d’un immeuble de type « plex » alors disponible à très bon marché dans les quartiers centraux. Or, de nos jours, les ménages qui immigrent au Québec dépendent plus souvent et plus longtemps du marché locatif. Dans le Grand Montréal, les immigré·e·s arrivés il y a 15-20 ans affichent un taux de propriété plus faible (52 %) que les non-immigré·e·s (59 %)[1]. Cela s’expliquerait par la plus grande précarité économique des cohortes récentes d’immigré·e·s ainsi que par le resserrement du marché locatif abordable qui frappe presque tous les arrondissements de la ville. Ainsi l’accès au logement constitue-t-il un enjeu de plus en plus important pour les personnes immigrées, surtout celles arrivées depuis moins de 10 ans[2].
Abordabilité du logement : la population immigrante durement touchée
Le logement social ne rejoint qu’une petite proportion des ménages québécois. La capacité de se loger convenablement sans se priver d’autres nécessités de la vie dépend de l’accessibilité du logement sur le marché privé et se mesure au pourcentage du prix du loyer par rapport au revenu. Or, les personnes immigrées, surtout celles établies depuis moins de 10 ans, sont plus susceptibles que la population en général de vivre une grande précarité financière. Un résident du Québec sur neuf (11,1 %) touche généralement un revenu en deçà du seuil de faible revenu après impôts. Or cette proportion s’élève à un sur sept (14,3 %) chez les personnes qui se sont établies au Canada entre 2001 et 2010 et atteint 22,6 % chez celles arrivées il y a moins de cinq ans (chiffres de 2016). La vaste majorité des immigrantes et immigrants au Québec relèvent, en langage administratif, de la catégorie économique. Si, pour bon nombre de ceux-ci, l’insertion économique va bon train, plusieurs se trouvent au rang des travailleurs pauvres en raison de la non-reconnaissance de leurs titres de compétences et leur expérience de travail à l’étranger. Comme on peut s’y attendre, le faible revenu est plus fréquent chez les personnes admises comme réfugiées et moins fréquent chez celles qui relèvent de la catégorie de réunification familiale car ces dernières peuvent compter sur le soutien de leurs proches[3].
La mesure des besoins en logement la plus souvent déployée à des fins de politiques publiques est l’indice des « besoins impérieux en matière de logement ». Cet indice tient compte de l’accessibilité financière (le coût du logement ne doit pas dépasser 30 % du revenu), de la taille du logement (au regard de la composition du ménage) ainsi que de la qualité du logement (besoin de réparations majeures).
Parmi les locataires du Grand Montréal, plus d’un ménage sur cinq était en situation de « besoins impérieux » en 2016. Ce taux s’élevait à 26,4 % chez les ménages dont le soutien avait immigré au Canada moins de cinq ans plus tôt. Or, à Montréal, ce taux varie beaucoup selon la catégorie d’admission au pays; il s’élève à 35 % chez les ménages admis en tant que réfugiés et à 45 % chez les réfugiés pris en charge par le gouvernement ou par un groupe de parrainage privé[4].
L’entassement : un réel défi
À Montréal, comme dans les autres grandes villes, l’abordabilité est le principal facteur qui contribue aux besoins impérieux de logement des personnes, immigrantes et non immigrantes. Toutefois, les immigrants récents sont un peu plus susceptibles que les Montréalais de vivre dans un logement qui nécessite des réparations majeures. Une enquête de 2021 confirme l’expérience de terrain des organismes communautaires œuvrant dans les quartiers d’accueil des nouveaux arrivants : le logement des néo-Montréalais est plus souvent insalubre[5].
De plus, l’entassement dû à l’exiguïté du logement par rapport à la taille et à la composition du ménage est une source plus importante de besoins impérieux chez les immigrants récents et particulièrement chez les personnes récemment réfugiées. Ainsi, le groupe des Syriens admis en 2015-2016 comprend un taux important – et inattendu – de familles nombreuses et multigénérationnelles. Selon les données canadiennes de 2016, 31 % des ménages de réfugiés récents comportent six membres et plus, comparativement à 16 % pour les immigrants récents admis selon les programmes d’immigration économique ou de réunification familiale. La pénurie de logements abordables de taille convenable jumelée à la faiblesse de la prestation mensuelle octroyée aux familles réfugiées pose un défi herculéen aux organismes communautaires et aux groupes de parrainage chargés de leur trouver un premier logement; ces familles ont d’ailleurs tendance à y demeurer plusieurs années. Les réfugié·e·s (demandeurs d’asile ou réfugiés rétablis) arrivés seuls doivent composer avec des contraintes financières encore plus importantes parce qu’ils ne sont pas admissibles à l’allocation pour enfants. Cette situation mène très souvent au partage d’un petit logement avec d’autres personnes seules. Si cette situation peut apporter un soutien social, elle peut aussi créer un sentiment d’insécurité[6].
Les personnes immigrantes vivent aussi plus souvent dans des familles multigénérationnelles : c’est le cas, en 2016, de 6,6 % des immigrants et de presque 9 % des immigrants arrivés entre 1980 et 2000, comparativement à 3,3 % des Montréalais non immigrants. Elles vivent également plus souvent dans des familles nucléaires auxquelles s’ajoutent d’autres personnes apparentées ou non : en 2016, 6,7 % des immigrants récents et 5,5 % des immigrants sont dans cette situation contre 3,7 % des Montréalais non immigrants. Ce sont là des expressions de solidarité familiale, culturelle et économique, comme on l’a observé dans des cohortes antérieures d’immigrants des pays méditerranéens. Or, en raison des plus grandes difficultés d’insertion économique et de la flambée des prix immobiliers, ces familles sont plus à risque de vivre une situation d’entassement[7].
L’impact de la pandémie
Enfin, la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence l’importance des conditions d’habitation sur la santé des résidents et résidentes. Le risque de transmission au sein du ménage s’accroît lorsque la taille du logement est insuffisante pour permettre l’isolement d’une personne atteinte du virus. L’entassement dans les logements s’est ainsi avéré un facteur de risque additionnel, surtout dans le cas des ménages dont des membres travaillent dans les secteurs des services essentiels, situation fréquente chez les personnes immigrantes et réfugiées. Et si le ménage est multigénérationnel, le risque est encore plus grand pour les aîné·e·s qui y vivent. En ce qui concerne la santé mentale, le stress associé aux cycles de confinement prolongés et répétés serait aggravé chez les personnes et les familles vivant dans des logements exigus, sans espaces extérieurs privés où se détendre et jouer. Ainsi, les inégalités relatives à la qualité de l’habitat s’associent aux inégalités sociospatiales observées lors de la pandémie qui, à Montréal comme dans d’autres grandes villes, a frappé plus durement les quartiers à forte densité d’immigrantes et immigrants récents ainsi que de minorités racisées[8].
Des obstacles particuliers, des barrières discriminatoires
Qu’il s’agisse de la recherche du premier logement ou de celle d’un logement plus convenable, de nombreuses études scientifiques, dont des enquêtes menées à Montréal, montrent que les immigrantes et immigrants récents font très souvent face à des obstacles qui ne relèvent pas de leur capacité financière ou de la pénurie de logements abordables convenant à la taille de leur famille. L’absence de références ou de cote de crédit émises au Canada est une barrière fréquente. Alors que la Société canadienne d’hypothèques et de logement a instauré un programme d’aide aux nouveaux arrivants sans antécédents de crédit qui veulent devenir propriétaires, les locataires n’ont droit à aucun programme de ce type. Souvent, les propriétaires exigent un dépôt élevé ou un garant, ce qui pose un défi majeur aux personnes sans parents ou amis déjà établis au pays. De surcroît, un nombre préoccupant de nouveaux arrivants vivent des problèmes de logement en raison de la discrimination fondée sur le statut, notamment les demandeurs d’asile, ou sur l’origine ethnique. De telles pratiques, illégales selon la Charte des droits et libertés de la personne, ont pour effet de restreindre le choix d’un logement et d’accroître le risque de se trouver dans un immeuble mal entretenu ou dans un logement insalubre[9].
Les organisations communautaires à la rescousse
Au Québec, un important réseau d’organismes communautaires de recherche de logements pour les nouveaux arrivants tente de pallier les obstacles d’accès à un logement décent et abordable. L’État et des organismes caritatifs, religieux et autres financent ces groupes communautaires et de nombreux bénévoles y œuvrent. Ces groupes collaborent avec des propriétaires plus accueillants, tiennent des inventaires de logements disponibles, expliquent aux immigrants le fonctionnement de notre système de logement, qui peut paraître opaque, et prodiguent des conseils aux personnes qui ont un problème de logement. Certains organismes offrent un soutien intensif aux réfugié·e·s pris en charge par le gouvernement afin d’assurer leur installation dans un premier logement décent, ce qui fait partie des obligations humanitaires de l’État. Malgré leur dévouement, les organismes communautaires n’arrivent pas à rejoindre toutes les personnes concernées. Ainsi, les immigrants économiques et les demandeurs d’asile recourent-ils plus souvent aux réseaux informels de leur groupe ethnoculturel pour recevoir de l’aide ou des conseils en matière de logement; or, l’information qui y circule tend à être moins fiable ou incomplète.
Que faire ?
En quoi pourraient alors consister des réponses progressistes aux enjeux et défis soulevés ? Esquissons, en conclusion, quelques éléments de politique qui tiennent compte des points de vue des intervenants clés de l’aide aux nouvelles et nouveaux arrivants consultés lors des recherches antérieures.
- En matière de politiques d’habitation, il importe de prioriser, à tous les paliers de l’État, la remise en état des immeubles locatifs détériorés. Il s’agit notamment des immeubles modestes de trois ou quatre étages sans ascenseur construits dans les années 1950 à 1970. Les personnes immigrées et à revenus faibles et modestes sont de plus en plus concentrées dans le parc locatif situé dans les premières banlieues de l’après-guerre. Il faut privilégier le transfert de ces immeubles aux bailleurs sociaux ou à but non lucratif (OBNL) afin d’éviter les « rénovictions[10] » dans les quartiers où s’amorce la gentrification[11] ou la « studentification[12] ».
- La planification des nouveaux besoins en logement, tant la réhabilitation des immeubles que la construction de maisons neuves, devrait tenir compte de la diversité croissante des modèles familiaux amenée par l’immigration : des familles de plusieurs enfants ou de plusieurs adultes, des familles multigénérationnelles.
- L’octroi d’un logement social de type HLM (habitations à loyer modique) à certains nouveaux arrivants et arrivantes à statut très précaire – dont une partie des réfugié·e·s sélectionnés à l’étranger – constituerait la solution la plus durable en matière de logement abordable et convenable. Or, au-delà de l’insuffisance globale de logements subventionnés en fonction du revenu, le Québec impose une barrière supplémentaire aux immigrantes et immigrants récents en exigeant d’eux un an de résidence pour les inscrire sur la liste d’attente d’un HLM. Pourquoi ne pas diminuer ce délai, à l’instar de l’allocation pour enfants à laquelle les familles immigrantes sont admissibles trois mois après leur arrivée ?
- Les vagues récentes d’arrivée de nombreux réfugié·e·s et demandeurs d’asile dans de courts laps de temps et dans un contexte de forte pénurie de logements abordables et convenables posent des défis majeurs aux organismes communautaires qui viennent à leur secours. Cela a fait ressortir le besoin de créer un parc de logements où les nouveaux arrivants pourraient vivre pendant environ deux ans. Gérées par des OBNL associés aux organismes communautaires d’aide à l’établissement des personnes réfugiées et immigrantes, ces résidences offriraient aussi des services sur place de façon à favoriser l’insertion sociale et économique des résidents et résidentes. Ce modèle a été bien rodé à Winnipeg[13].
Damaris Rose est professeure honoraire, Centre Urbanisation Culture Société, Institut national de la recherche scientifique.
- Un tel écart n’existe pas dans les autres métropoles de l’immigration canadienne, Toronto et Vancouver. ↑
- Michael Haan, « Do I buy with a little help from my friends ? Homeownership-relevant group characteristics and homeownership disparities among canadian immigrant groups, 1971-2001 », Housing Studies, vol. 22, n° 6, 2007; Société canadienne d’hypothèques et de logement, Caractéristiques, ménages avec besoins impérieux de logement, Canada, PT, RMR, Ottawa, SCHL 2020, <www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/household-characteristics/characteristics-households-core-housing-need-canada-pt-cmas>. ↑
- Xavier Leloup, Florence Desrochers et Damaris Rose, Les travailleurs pauvres dans la RMR de Montréal. Profil statistique et distribution spatiale, Montréal, INRS-Centre Urbanisation Culture Société et Centraide du Grand Montréal, 2016; Statistique Canada, Catégorie d’admission et type de demandeur (47), certaines caractéristiques du revenu (92), statut d’immigrant et période d’immigration (10A), âge (10B) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires et régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %). Tableau 98-400-X2016367, Ottawa, 2020, <www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016367>. ↑
- SCHL, Caractéristiques, ménages avec besoins impérieux de logement, Canada, PT, RMR, op. cit.; Rachel Shan, Conditions de logement des nouveaux réfugiés au Canada, Ottawa, SCHL, 2019. ↑
- Thomas Gulian, Monica Schlobach, Danic Ostiguy, Yanick Tadjalogue-Agoumfo et Monica Grigore-Dovlette, Baromètre Écho 2020 de la Ville de Montréal sur l’inclusion des personnes immigrantes, Montréal, Rapport de recherche de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants, 2021. ↑
- Shan, op. cit.; Damaris Rose et Alexandra Charette, « Accommodating government assisted Syrian refugee newcomers : the experiences of Resettlement Assistance Program providers », dans Leah Hamilton, Luisa Veronis et Margaret Walton-Roberts (dir.), A National Project. Syrian Refugee Resettlement in Canada, Montréal, McGill-Queens, 2020. ↑
- Statistique Canada, Catégorie d’admission et type de demandeur (47), statut d’immigrant et période d’immigration (11B), âge (7A), sexe (3) et certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la population active et de la scolarité (825) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires et régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %). Tableau 98-400-X2016203, Ottawa, 2018, <www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016203>. ↑
- Janet Cleveland, Jill Hanley, Annie Jaimes et Tamar Wolofsky, Impacts de la crise de la COVID-19 sur les « communautés culturelles » montréalaises. Enquête sur les facteurs socioculturels et structurels affectant les groupes vulnérables, Montréal, Institut universitaire SHERPA, 2020 ; Organisation de coopération et de développement économiques, What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children ?, Paris, OCDE, 2020. ↑
- Gulian et al., op. cit.; Damaris Rose et Alexandra Charette, « Housing experiences of users of settlement services for newcomers in Montréal : does immigration status matter ? », dans Kenise Murphy Kilbride (dir.), Immigrant Integration. Research Implications for Public Policy, Toronto, Canadian Scholars’ Press, 2014. ↑
- NDLR. Le terme rénoviction fait référence au processus par lequel un propriétaire évince illégalement un locataire de son immeuble sous prétexte qu’il souhaite faire des rénovations. ↑
- NDLR. Plusieurs auteurs et autrices préfèrent le terme anglais gentrification à celui d’embourgeoisement qui n’aurait pas tout à fait le même sens. ↑
- NDLR. Le phénomène d’afflux d’étudiants dans les quartiers traditionnellement occupés par des familles et les transformations engendrées par l’arrivée de cette nouvelle population a été désigné sous le terme de « studentification » par Darren Smith en Angleterre (2002). ↑
- Jill Hanley et al., S’installer : Comprendre les enjeux du parcours et de l’intégration des demandeurs d’asile au Québec. Rapport final de recherche soumis au FRQSC – Actions concertées, Montréal, Université McGill et SHERPA, 2021; Jill Bucklaschuk, They Can Live a Life Here. Current and Past Tenants’ Experiences with IRCOM’s Model of Housing and Wrap-Around Supports, Winnipeg, Centre canadien de politiques alternatives, 2019; Écobâtiment, Bâtiments résilients, logements sains et accueillants. Feuille de route, Montréal, 2021; Rose et Charette, 2020, op. cit. ↑

Discipline et droits dans les unités d’enfermement pour jeunes contrevenants

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, aut. 2021/hiver 2022
Nicolas Sallée, professeur, sociologie, Université de Montréal et directeur scientifique du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS) Ce texte s’appuie sur des observations réalisées durant l’automne 2015 entre les murs de l’une des unités de garde fermée pour jeunes contrevenants de Cité-des- Prairies, situé dans l’est de l’Île-de-Montréal. Chacune de ces unités peut accueillir jusqu’à 12 garçons placés en attente de leur jugement ou condamnés aux peines les plus sévères – dites de placement et de surveillance – prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). Ces unités côtoient, dans le même établissement, des unités réservées à des jeunes n’ayant pas été condamnés, mais qui sont placés au titre de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Au Québec, l’exécution de ces deux lois est confiée au ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans certaines régions administratives, le faible nombre de jeunes contrevenants conduit même les directions jeunesse locales à placer ces derniers au sein même des unités de protection.Le paternalisme carcéral
Ce curieux mélange des publics témoigne, au fond, de la justification paternaliste qui a historiquement entouré l’enfermement des jeunes contrevenants : si ces derniers sont privés de liberté, ce serait avant tout pour leur bien, pour les protéger et, surtout, les réhabiliter. La première Loi sur les jeunes délinquants (LPJ), adoptée en 1908, considérait ainsi les jeunes contrevenants comme des objets du droit plutôt que des sujets de droits : pourquoi en effet, se demandaient les réformateurs de l’époque, reconnaître aux jeunes des droits « qui seraient en réalité pour [eux] un moyen de se protéger contre une aide bienveillante qu’on veut [leur] apporter1 » ? Toutes les grandes réformes du droit pénal des mineurs, en particulier celles de 1984 et de 2002 au Canada, ont dès lors contribué à reconnaître des droits aux jeunes, en renforçant notamment la présence de leurs avocats à tous les stades de la procédure – de l’interpellation policière au jugement. Il y a eu, de ce point de vue, de nettes avancées, poussées notamment par les grandes conventions internationales relatives aux droits de l’enfant : au Canada, le nombre de jeunes contrevenants enfermés diminue graduellement depuis le début des années 19902. Si le paternalisme carcéral s’est tari, il serait cependant trop facile de penser qu’il a pleinement disparu. Le fonctionnement des unités de garde fermée témoigne de cette ambivalence. L’une des questions qui traversent le fonctionnement de ces unités est celle de leur proximité avec la prison. L’histoire de l’enfermement des jeunes a en effet été marquée par l’utopie de créer des lieux alternatifs à la prison et à sa violence propre. Conçu dès sa création, en 1963, comme l’un de ces lieux alternatifs, Cité-des-Prairies a pourtant été bâti avec les plans d’architecture d’une… prison à sécurité maximale. Le perfectionnement continu, dans les années 1970 et 1980, d’une structure clinique centrée sur la réhabilitation, n’a jamais pu faire oublier cette carcéralité originelle. Les euphémismes qui fleurissent le quotidien des unités – où plutôt que de cellules, de punition ou d’isolement disciplinaire, il est question de chambre, de conséquences et de mesures de retrait – n’y changent pas grand-chose : si la garde fermée n’est pas tout à fait la prison, elle n’en est jamais très loin non plus. Comme le souligne Amar, 16 ans : ici « c’est un peu la prison, mais c’est pas comme la vraie ». Cette tension est au cœur des problèmes posés aux droits des jeunes, notamment à leur droit à contester les décisions qui les concernent : puisque tout est censé être fait pour leur bien, que gagneraient-ils à s’y opposer ?La displicine
Les jeunes placés vivent dès lors une double contrainte. À la contrainte carcérale, qui comme dans toute prison, pèse sur leurs corps et leurs possibilités de se mouvoir (grillages, portes fermées, etc.), s’ajoute la contrainte spécifique de la réhabilitation, exigeant d’eux qu’ils ne se contentent pas de faire leur temps, mais qu’ils en tirent profit pour dompter leurs émotions et rectifier leurs pensées. Cette visée de transformation de soi est ambivalente. D’un côté elle permet aux jeunes de bénéficier de nombreuses activités structurantes et animées par du personnel formé et bienveillant, auxquelles ils auraient probablement plus difficilement accès dans une vraie prison. De l’autre, elle autorise le déploiement d’une discipline destinée à modeler ou au besoin à corriger, à tout moment, leurs conduites et leurs manières d’agir. Dans Surveiller et punir (1975), Michel Foucault définissait la discipline comme un contre-droit qui, du fait de l’asymétrie de pouvoir qu’elle suppose, repose toujours sur « une mise en suspens, jamais totale, mais jamais annulée non plus, du droit3 ». On ne saurait mieux dire. Dans les unités, la discipline s’actualise notamment dans une panoplie de sanctions qui, à chaque comportement jugé indiscipliné, peuvent conduire les jeunes à être mis à l’écart de leur groupe ou de leur unité.Mais parce qu’ici, le choix des mots est une matière sensible, les éducateurs sont tenus, pour dire cette mise à l’écart, de distinguer sémantiquement les mesures d’isolement des mesures de retrait.
Les mesures d’isolement
Les premières sont les plus sensibles. Si elles sont dites d’isolement, c’est parce qu’elles sont exécutées dans une salle elle-même dite d’isolement, en béton blanc, sans fenêtre et complètement vide, à l’image des salles de contention des hôpitaux psychiatriques. Dans les années 1990, ces mesures d’isolement ont été l’objet d’alertes et de scandales publicisés qui ont conduit à leur réglementation. Adopté en 1998, l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) stipule désormais que « la force [ou] l’isolement […] ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne […], que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions ». En 2008, une réforme de l’article 10 de la LPJ a permis d’ajouter que l’isolement « ne [peut] jamais être [utilisé] à titre de mesure disciplinaire ». Mes données le confirment : dans les unités de garde fermée, l’usage de cette mesure d’isolement apparait exceptionnel. Un seul jeune placé lors de ma période d’observation y a été confronté, à quatre reprises sur l’ensemble de ses 10 mois de placement. Si ces réglementations ont donc eu d’indéniables effets positifs, elles n’ont pas résolu tous les problèmes.Les mesures de retrait
Dans les faits, l’isolement ne se limite pas, en effet, à l’usage de la mesure qui en porte le nom. Les mesures de retrait consistent également, dans la majorité des cas, à isoler le jeune, en le plaçant dans sa chambre ou dans une chambre elle-même dite de retrait, située dans l’unité de sécurité de l’établissement. Ces mesures, excédant rarement quelques heures, sont cependant très fréquentes. Selon mes propres comptages, le jeune le plus sanctionné, durant ma période d’observation, recevait un retrait tous les deux jours, et le moins sanctionné un retrait tous les six jours. L’efficacité clinique de ces mesures, autrement dit leur adéquation aux besoins des jeunes, est souvent remise en question, tant on sait que l’isolement peut affecter la santé psychologique et le développement des jeunes. Mais parce que personne, à Cité-des-Prairies, n’isole un jeune par plaisir, les mesures de retrait suscitent des débats fréquents parmi le personnel des unités : a-t-on bien fait de le retirer ? Était-ce vraiment la solution ? N’a-t-on pas surréagi ? Aurait-on pu faire autrement ? [caption id="attachment_13262" align="aligncenter" width="259"] Nicolas Sallée et Alexandra Dion-Fortin[/caption]
Nicolas Sallée et Alexandra Dion-Fortin[/caption]
Politique du privilège
La direction de Cité-des-Prairies elle-même, consciente du problème, cherche des solutions. Elle essaye d’abord d’encadrer l’usage de ces mesures, en demandant à son personnel d’en justifier par écrit la pertinence clinique, en matière de réhabilitation : après avoir haussé le ton quand il lui a été demandé de retourner dans sa chambre pour une période de transition entre deux activités, Sofiane a, par exemple, été placé en retrait durant deux heures pour « [travailler] ses réflexes de pensée lorsqu’il vit de l’injustice », comme l’écrivait son éducateur dans un logiciel dédié. Mais cette contrainte est faible, toute mesure de retrait étant au fond aisément justifiable, à condition de trouver les bons mots pour le faire. La direction de Cité-des-Prairies cherche alors, parallèlement, à en limiter l’usage en incitant son personnel à préférer l’octroi de privilèges, destinés à renforcer les comportements positifs, plutôt qu’à distribuer des sanctions pour répondre aux comportements négatifs. Si cette solution n’est pas inintéressante, elle a pour limite de ne reposer, in fine, que sur le bon vouloir des équipes éducatives.Pour leur bien?
Car au fond, il paraît illusoire de penser que tout pourra être résolu par un simple appel à l’efficacité clinique. Comme le rappelait en son temps Erving Goffman, la violence des institutions totales, au premier chef desquelles les hôpitaux psychiatriques, est précisément d’imposer aux reclus leur propre conception de ce qu’il faudrait faire pour leur bien, toute contestation étant alors susceptible d’être interprétée comme une forme de résistance au traitement4. On comprend là que si les mesures de retrait font problème, c’est aussi parce qu’elles offrent trop peu de moyens aux jeunes eux-mêmes de pouvoir les contester ou, minimalement, en interroger la légitimité. De fait, l’usage de ces mesures n’est l’objet que d’un vague encadrement juridique. L’article 10 de la LPJ, déjà mentionné plus haut, stipule ainsi seulement que « toute mesure disciplinaire prise […] à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration [de l’établissement] ». La définition de ces règles internes, on s’en doute, échappe largement aux jeunes. Ces derniers se voient dès lors imposer des mesures qu’ils pourront d’autant moins contester, on l’aura compris, qu’elles pourront toujours, en dernier ressort, être justifiées par leur intérêt en matière de réhabilitation. Ces quelques observations ne visent pas à contester la bienveillance des équipes éducatives, ni à mettre en question leur professionnalisme, alors même qu’elles travaillent d’arrache-pied, dans des conditions souvent difficiles, pour tenter de sortir les jeunes de la délinquance. Elles visent à rappeler que des facteurs structurels contribuent chaque jour à fragiliser leur mandat. Parmi ces facteurs, j’ai insisté dans ce texte sur la carcéralité d’un centre qui pèse quotidiennement sur les pratiques, les interactions, les expériences. Au fond, quoi de plus logique, dans une simili-prison, que certaines pratiques se rapprochent de celles de gardiens de prison ? Si ces observations peuvent dès lors avoir une quelconque utilité, c’est d’abord pour instiller le doute quant à nos manières de faire auprès des jeunes, et nous défaire collectivement de cette évidence que, parce que l’on se donne pour objectif de les réhabiliter, l’on agit infailliblement pour leur bien.L’enfermement est, au contraire, intrinsèquement violent, même quand on le débarrasse du vocabulaire de la prison.Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont là, les jeunes placés entre les murs de nos institutions publiques devraient donc avoir toutes les garanties nécessaires à connaître, défendre et revendiquer leurs droits, à commencer par ceux qui leur permettraient de contester ces mesures, que l’on se rassure parfois bien commodément à considérer comme nécessairement et systématiquement prises pour leur bien.
- J. Trépanier, La justice des mineurs au Québec : 25 ans de transformation (1960-1985), Criminologie, 19 (1), 1986, 199.
- Webster, J. Sprott, A. Doob, « The Will to Change: Lessons from Canada’s Successful Decarceration of Youth », Law & Society Review, 53 (4), 2021, p. 1092- 1131.
- Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 224.
L’article Discipline et droits dans les unités d’enfermement pour jeunes contrevenants est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Les pays méditerranéens redoutent la pénurie de blé ukrainien

Dans un moulin à blé, à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, le 1er mars 2022. © Photo Majdi Fathi / NurPhoto via AFP
Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, l’un des plus grands exportateurs au monde de céréales, les prix explosent et les premières pénuries apparaissent. Au Liban, en Tunisie et en Égypte, très consommateurs de pain, la sécurité alimentaire est déjà menacée.
Complètement dépendants des importations de blé ukrainien, les pays du bassin méditerranéen, englués dans de profondes crises économiques et sociales, ressentent déjà les effets collatéraux de la guerre provoquée par la Russie. Les tensions sur les prix des céréales et du blé sont au plus haut. Les premières pénuries se font sentir. Les gouvernements se veulent rassurants, mais l’inquiétude est à son comble.
En Tunisie, les pénuries s’aggravent
Dans ce pays qui subit déjà une crise économique et une inflation supérieure à 6 %, les conséquences de la guerre en Ukraine se font déjà ressentir. La Tunisie importe près de 50 % des besoins de sa consommation en blé, mais elle importe aussi des céréales telles que le maïs, l’orge et le soja, nécessaires pour l’alimentation du bétail.
Pour l’année 2021-2022, les importations en céréales représentent 3,7 millions de tonnes, avec 47,7 % du blé importé qui vient d’Ukraine et 3, 97 % de Russie. Le ministre du commerce tunisien a tenté un discours rassurant, déclarant que les stocks en blé étaient suffisants pour tenir jusqu’au moins de juin 2022 mais la Tunisie doit commencer à trouver des marchés alternatifs.
La guerre en Ukraine arrive dans un contexte très tendu en Tunisie. Ces dernières semaines, le pays vivait déjà au rythme des pénuries de semoule, de farine et d’huile végétale, des produits de première nécessité subventionnés par l’État qui se font de plus en plus rares, souvent récupérés par les circuits de spéculation et le marché noir, face à l’augmentation de la demande.
Avec la hausse des prix, de nombreux Tunisiens et Tunisiennes n’arrivent plus à se permettre un panier de courses sans recourir aux produits subventionnés. Les boulangers ont aussi dû augmenter parfois le prix de la baguette, faute de trouver la farine subventionnée, et rationner la consommation.
Mais c’est la crise de l’importation des céréales nécessaires pour l’alimentation du bétail qui inquiète le plus les agriculteurs tunisiens. Bien qu’en Tunisie, le secteur agricole se soit montré résilient face aux nombreuses crises économiques, climatiques et sanitaires, il est composé à près de 80 % de petits agriculteurs qui souffrent déjà depuis plusieurs années de la hausse des coûts de production et du transport.
Outre le problème des stocks et des pénuries, ces augmentations des prix, sur le pétrole également, vont creuser le déficit en Tunisie.
Aram Belhadj, économiste
Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour les régions Afrique du Nord et Moyen-Orient, a renchéri en déclarant dans un post de blog que la Tunisie pourrait être l’une des économies les « plus durement affectées », notamment au niveau des petits agriculteurs, dont le métier représente l’unique source de revenu familial.
« Il y a une inquiétude, notamment pour tout ce qui est alimentation concentrée du bétail qui est faite d’un mélange de soja et de maïs », explique Karim Daoud, agriculteur et président du Synagri, un syndicat agricole en Tunisie. L’alimentation concentrée pour les vaches laitières est passée, en un an, de 950 dinars la tonne (292 euros) à 1 300 dinars (400 euros). « Le problème, c’est que le stock pour cette alimentation n’est viable que sur 15 jours, donc nous ne savons pas ce qu’il va se passer après », ajoute-t-il.
Du côté des importateurs, beaucoup se préparent ainsi à une année « difficile », comme le directeur général de la société Carthage Grains, spécialisée dans la transformation des graines de soja et de colza. Maher Affes achète principalement sur les marchés américain et brésilien, mais, actuellement, la pression de la demande sur ces marchés, faute de pouvoir acheter à l’Ukraine et à la Russie, a aussi entraîné une augmentation des prix.
« Les contrats que nous avions faits au mois de juin l’année dernière étaient à 1 300 dollars la tonne (400 euros). Là, sur les nouveaux contrats pour 2022, nous sommes déjà à 1 850 dollars », explique-t-il. À cela s’ajoute l’augmentation des coûts de transport avec l’emballement des prix du pétrole. Le transport qui coûtait 30 dollars la tonne revient désormais à 100 dollars. « Toutes ces augmentations se répercutent ensuite sur le prix de vente du tourteau de soja en Tunisie et donc sur les agriculteurs », confirme Maher Affes.
Quant au maïs, plusieurs commandes à l’Ukraine ont été annulées mais la Tunisie peine à trouver des marchés alternatifs. Beaucoup craignent que le pays ne soit considéré comme moins prioritaire face à d’autres, « un peu comme avec le vaccin finalement », ajoute Karim Daoud.
Il rappelle que pendant la crise alimentaire mondiale en 2007-2008, quand les cours du blé et, plus largement, des céréales avaient brusquement augmenté, « la Tunisie s’était retrouvée aussi dans une situation similaire face à ses importations ». Il rappelle que cette crise « pose plus que jamais la question de notre sécurité alimentaire et de nos modes de consommation, surtout après les deux ans de pandémie qui ont aussi mis à mal ces circuits ».
À l’approche des pics de consommation alimentaire pour le mois saint du ramadan en avril, de nombreux experts économiques appellent le gouvernement à anticiper d’éventuelles pénuries. « Nous savons qu’outre le problème des stocks et des pénuries, ces augmentations des prix, sur le pétrole également, vont creuser le déficit en Tunisie puisque cela va avoir un impact aussi sur le taux de change avec le dinar, déjà faible face au dollar et à l’euro », explique l’économiste Aram Belhadj.
Le pays en est à sa deuxième hausse des prix des carburants en un mois et les autorités sont en train de négocier un nouveau prêt avec le Fonds monétaire international (FMI), annonçant aussi une politique d’austérité. « La guerre en Ukraine arrive à un très mauvais moment pour la Tunisie sur le plan économique », conclut-il.
En Égypte, le prix du pain bondit
En quelques jours, le prix du pain a bondi dans les boulangeries. Dans le quartier populaire de Sayeda Zeinab, au Caire, la galette de pain se vend 1,5 livre, contre une livre avant le déclenchement de l’invasion russe.
Aux client·es excédé·es l’accusant de « voracité », la boulangère Iman explique que « la tonne de farine coûte 11 000 livres égyptiennes, contre 8 500 auparavant, parce qu’il y en a moins sur le marché à cause de la guerre ».
Les représentants des boulangeries auprès de l’Union des chambres du commerce au Caire accusent les marchands de blé de profiter de leur situation de monopole pour accentuer la pénurie et faire grimper les prix.
Face à l’inquiétude grandissante de la population, le gouvernement égyptien tente de rassurer. Selon le premier ministre, Mostafa Madbouly, l’Égypte a des stocks de blé pour tenir quatre mois et n’aura pas besoin de livraisons supplémentaires avant la fin de l’année, grâce aux récoltes locales du printemps.
Du fait de l’extension des exploitations agricoles sur des parcelles auparavant désertiques, le gouvernement espère récolter sur place jusqu’à 5,5 millions de tonnes de blé cette année, contre 3,5 millions en 2021. Sauf qu’en 2021, l’Égypte a importé près de 12,4 millions de tonnes pour nourrir ses 100 millions d’habitant·es.
L’optimisme affiché du gouvernement risque de ne pas suffire à combler les besoins du premier pays importateur de blé au monde. D’autant que l’Égypte se fournit à 80 % en Russie et en Ukraine.
Dès le début de l’invasion russe, le gouvernement a d’ailleurs essayé de trouver d’autres vendeurs via des appels d’offres. Fin février, une entreprise a proposé d’importer 60 000 tonnes de blé français à 399 dollars la tonne, c’est-à-dire 25 % plus cher que les précédents appels d’offres. L’État a également renoncé à acheter du blé américain, hors de son budget. Des discussions seraient en cours avec la Russie, selon le média indépendant Mada Masr.
Car les réserves de l’État risquent de vite se révéler insuffisantes. « Les stocks constitués par l’État sont réservés au pain subventionné, mais une grande partie de la population achète du pain et de la farine sur le marché privé », analyse le responsable du syndicat des agriculteurs, Saddam Abou Hussein.
Au Liban, « il ne reste plus qu’un mois et demi de réserves de blé »
Les difficultés d’approvisionnement en blé menacent la sécurité alimentaire du Liban. Le pays est en effet très dépendant des importations originaires de la mer Noire. Il a ainsi acheté 66 % de son blé à l’Ukraine et 12 % à la Russie en 2020, d’après les statistiques de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
« Le risque de pénurie est réel. Il ne reste plus qu’un mois et demi de réserves de blé », alerte Geryes Berbari, directeur général de l’Office des céréales et de la betterave sucrière. Le pays ne peut en effet plus compter sur ses réserves stratégiques en céréales depuis l’explosion mortelle du 4 août 2020 à Beyrouth qui a détruit les silos à grains installés près du port.
« Face à l’urgence, il faut trouver des alternatives au blé ukrainien, très compétitif en raison de la proximité géographique. Elles seront nécessairement plus chères, notamment dans le contexte de la flambée mondiale du cours du blé », continue-t-il.
Or, le Liban est déjà en proie à une grave crise économique depuis deux ans et demi, qui a entraîné plus des trois quarts de la population dans la pauvreté. « La hausse des prix va aussi peser sur les maigres réserves en devises de la Banque du Liban (BDL), qui subventionnent les importations de blé », dit Zeina el-Khatib, chercheuse associée au centre de recherche Triangle basé à Beyrouth.
Le gouvernement se veut cependant rassurant. Le ministre libanais de l’économie, Amine Salam, a nié mardi lors d’une conférence de presse l’imminence d’une pénurie. Il a indiqué par ailleurs avoir contacté d’autres pays producteurs de blé, tout en insistant sur la capacité de la Banque centrale de débloquer les fonds nécessaires.
Un optimisme loin d’être partagé par le président du syndicat libanais des importateurs de denrées alimentaires, Hani Bohsali. « La BDL n’a plus les devises nécessaires pour assurer les subventions sur le blé et accumule déjà les retards de paiement des importations. »
Une levée partielle des subventions, qui occasionnerait une hausse du prix du pain, est désormais crainte par une partie de la population, dans un pays où l’inflation a déjà atteint près de 240 % en janvier en glissement annuel.

Pour l’indépendance de l’Ukraine soviétique

« Malgré le pas de géant franchi par la Révolution d’Octobre dans le domaine des relations nationales, la révolution prolétarienne isolée dans un pays arriéré s’est avérée incapable de résoudre la question nationale, en particulier la question ukrainienne qui est, dans son essence même, de caractère international. La réaction thermidorienne, couronnée par la bureaucratie bonapartiste, a également relégué loin en arrière les masses laborieuses dans la sphère nationale. Les grandes masses du peuple ukrainien sont insatisfaites de leur sort national et souhaitent le changer radicalement. C’est ce fait que le politique révolutionnaire doit, contrairement au bureaucrate et au sectaire, prendre comme point de départ.
Si notre critique était capable de penser politiquement, il aurait deviné sans grande difficulté les arguments des staliniens contre le mot d’ordre d’une Ukraine indépendante : « Elle nie la position de défense de l’Union soviétique » ; « perturbe l’unité des masses révolutionnaires » ; “ne sert pas les intérêts de la révolution mais ceux de l’impérialisme.” En d’autres termes, les staliniens répéteraient les trois arguments de notre auteur. Ils le feront immanquablement le lendemain….
Le sectaire, comme cela arrive si souvent, se retrouve du côté de la police, couvrant le statu quo, c’est-à-dire la violence policière, par des spéculations stériles sur la supériorité de l’unification socialiste des nations sur leur maintien divisé. Certes, la séparation de l’Ukraine est un handicap par rapport à une fédération socialiste volontaire et égalitaire : mais elle sera un atout incontestable par rapport à l’étranglement bureaucratique du peuple ukrainien. Pour se rapprocher plus étroitement et honnêtement, il faut parfois d’abord se séparer. » [1]
L’article cité ci-dessus, « L’indépendance de l’Ukraine et les sectaires confus » de Trotsky (juillet 1939), est, à bien des égards, beaucoup plus important que son article d’avril de la même année, « La question ukrainienne ». Tout d’abord, il démasque et désarme les pseudo-marxistes sectaires qui, au nom de la défense de l’internationalisme prolétarien, le transforment en une abstraction stérile, et rejettent le mot d’ordre d’indépendance nationale d’un peuple opprimé par la bureaucratie du Kremlin. Dans cet article, Trotsky se situe dans la continuité de la lutte idéologique menée par Lénine contre la «tendance à l’économisme impérialiste», une tendance active dans les rangs du parti bolchevik comme dans l’extrême gauche de la social-démocratie internationale. Il doit être clair que l’adjectif « impérialiste » que Lénine attribue à cette forme d’économisme dans le mouvement révolutionnaire par rapport à la question nationale est justifié par les raisons théoriques évoquées par l’auteur du terme. Un examen sociologique montrerait que cette tendance est principalement basée chez les socialistes révolutionnaires appartenant aux nations dominantes et impérialistes. Les sectaires dénoncés par Trotsky ne sont qu’une nouvelle version de la même tendance contre laquelle Lénine a combattu lors de la discussion sur le droit des nations à l’autodétermination dans le contexte d’une révolution anticapitaliste. Un examen sociologique montrerait que cette tendance est principalement basée chez les socialistes révolutionnaires appartenant aux nations dominantes et impérialistes. Les sectaires dénoncés par Trotsky ne sont qu’une nouvelle version de la même tendance contre laquelle Lénine a combattu lors de la discussion sur le droit des nations à l’autodétermination dans le contexte d’une révolution anticapitaliste. Un examen sociologique montrerait que cette tendance est principalement basée chez les socialistes révolutionnaires appartenant aux nations dominantes et impérialistes. Les sectaires dénoncés par Trotsky ne sont qu’une nouvelle version de la même tendance contre laquelle Lénine a combattu lors de la discussion sur le droit des nations à l’autodétermination dans le contexte d’une révolution anticapitaliste.
Deuxièmement, l’article de Trotsky contient des considérations théoriques et politiques qui sont indispensables pour comprendre la justesse et la nécessité d’un mot d’ordre comme celui de l’indépendance de l’Ukraine soviétique ainsi que d’une révolution nationale d’un peuple opprimé comme facteur et composante de l’anti- révolution bureaucratique en Union soviétique et en Europe de l’Est. Pour apprécier pleinement la richesse de cette contribution, les lecteurs sont invités à étudier l’article eux-mêmes.
Troisièmement, Trotsky explique que dans un cas comme celui de l’Ukraine, un véritable internationalisme et une véritable recherche de l’unité internationale de la classe ouvrière sont impossibles sans un soutien clair et résolu au « séparatisme » national.
Pour rendre possible une véritable fraternité des peuples à l’avenir, les travailleurs avancés de la Grande Russie doivent dès maintenant comprendre les causes du séparatisme ukrainien ainsi que la puissance latente et la légalité historique qui le sous-tendent, et ils doivent sans aucune réserve déclarer à l’Ukraine peuple qu’il est prêt à soutenir de toutes ses forces le mot d’ordre d’une Ukraine soviétique indépendante dans une lutte commune contre la bureaucratie autocratique et contre l’impérialisme. [2]
Il va sans dire que cette tâche incombe à l’avant-garde du mouvement ouvrier international avant même d’être celle du prolétariat russe. La défense du mot d’ordre d’indépendance de l’Ukraine adopté par les Congrès mondiaux de la Quatrième Internationale en 1957 et 1979 est aujourd’hui une tâche d’une énorme importance politique. La montée des mouvements nationaux de masse des peuples opprimés de l’URSS exige que le mot d’ordre de l’indépendance nationale fasse partie de notre propagande et de notre agitation générales. Si cela n’est pas fait, l’opposition socialiste en URSS laissera le champ libre à la bureaucratie, qui espère isoler les luttes anti-bureaucratiques menées dans les républiques non russes du combat des ouvriers en Grande Russie. Ils omettent ainsi l’une des tâches transitionnelles fondamentales de la lutte anti-bureaucratique.
Quatrièmement, Trotsky apporte une clarification essentielle à la discussion historique sur le droit des nations à l’autodétermination en éliminant de ce slogan léniniste ses traits abstraits et politiquement redondants. Trotsky explique que, si l’oppression d’un peuple est un fait objectif, nous n’avons pas besoin que ce peuple soit en lutte et réclame l’indépendance pour faire avancer le mot d’ordre de l’indépendance. Au moment où Trotsky a lancé ce mot d’ordre, personne en Ukraine soviétique ne pouvait exiger une telle chose sans devoir faire face à l’exécution ou être prisonnier du Goulag. Une politique attentiste ne conduirait qu’au désarmement politique et programmatique des révolutionnaires. Un peuple opprimé a besoin d’indépendance parce qu’il est opprimé. L’indépendance, déclare Trotsky, est le cadre démocratique indispensable dans lequel un peuple opprimé devient libre de se déterminer. En d’autres termes, il n’y a pas d’autodétermination en dehors du contexte de l’indépendance nationale.
Pour déterminer librement ses relations avec les autres républiques soviétiques, pour avoir le droit de dire oui ou non, l’Ukraine doit retrouver sa pleine liberté d’action, au moins pour la durée de cette période constituante. Il n’y a pas d’autre nom pour cela que l’indépendance de l’État.
Pour exercer son autodétermination — et tout peuple opprimé a besoin et doit avoir la plus grande liberté d’action dans ce domaine — il faut qu’il y ait une assemblée constituante de la nation.
Mais un congrès « constituant » ne signifie rien d’autre que le congrès d’un État indépendant qui se prépare à nouveau à déterminer son propre régime intérieur ainsi que sa position internationale. [3]
Face à la rigueur implacable de cette explication, tout autre discours sur le droit des nations opprimées à l’autodétermination ne peut être soutenu que par un tour de passe-passe. Ce droit ne peut être défendu sans lutter pour que les peuples opprimés aient les moyens de l’exercer; c’est-à-dire sans exiger l’indépendance étatique nécessaire à la convocation d’une assemblée constituante ou d’un congrès libres.
Enfin, et c’est une question d’une importance capitale, Trotsky a reconnu que la Révolution d’Octobre n’avait pas résolu la question nationale héritée de l’Empire russe. Isolé dans un pays arriéré, il ne put le résoudre qu’à grand-peine. Mais était-il équipé pour cela ? Dans la perspective d’une nouvelle révolution anti-bureaucratique, nous devons décider si les mêmes moyens peuvent être réutilisés ou si une approche totalement nouvelle est nécessaire. Je pense que Trotsky était convaincu que la deuxième option était correcte. C’est une question de première importance qui semble n’avoir jamais été reprise par le mouvement trotskyste, bien qu’elle soit un point de départ nécessaire à toute discussion sur la pertinence du mot d’ordre de Trotsky de 1939.
La République socialiste soviétique d’Ukraine – formellement (et fictivement comme la Biélorussie) membre des Nations Unies – est la plus importante des républiques non russes de l’Union soviétique. C’est aussi le plus grand pays d’Europe après la Russie en superficie (603 700 kilomètres carrés) et l’un des plus grands en population (plus de 50 millions d’habitants, dont 74 % sont ukrainiens). Le peuple ukrainien forme la plus grande nation opprimée d’URSS et d’Europe. La classe ouvrière urbaine constitue plus de 50 % de la population totale et plus de 75 % de la population ukrainienne de la république. La libération de l’énorme potentiel que représente cette classe du double fardeau de la dictature bureaucratique et de l’oppression nationale est une tâche fondamentale et une condition pour le développement de la révolution anti-bureaucratique en URSS et en Europe de l’Est, ainsi que pour la révolution sociale sur tout le continent. Il est impossible d’imaginer une quelconque avancée dans la construction du socialisme en URSS et en Europe sans la victoire de la révolution nationale ukrainienne qui a, comme l’a expliqué Trotsky, une dimension stratégique internationale. Ce que les sectaires ignorent en abordant cette question, c’est que la révolution nationale, l’une des formes les plus importantes et les plus complexes de la lutte des classes, ne peut être évitée par de simples références à la révolution antibureaucratique en URSS dans son ensemble ou la future révolution européenne et mondiale.[4]
Le bolchevisme face à une révolution nationale inattendue
Considéré par beaucoup – dont Marx et Engels à une certaine époque – comme un « peuple sans histoire » [5] , le peuple ukrainien s’est constitué en nation de manière « historique » par excellence, c’est-à-dire héroïquement. En 1648, la communauté des hommes libres et de la démocratie militaire, connue sous le nom de cosaques, forma une armée populaire de libération et lança un immense soulèvement paysan contre l’État polonais, sa classe dirigeante et son Église. L’État-nation mis en place lors de ce soulèvement n’a pas réussi à se stabiliser mais la révolution cosaque et paysanne a cristallisé une nation historique avant même la formation des nations modernes par l’expansion du capitalisme. [6]Depuis la fin du XVIIIe siècle, la majeure partie du territoire ukrainien avait été transformée en une province de l’empire tsariste, connue sous le nom de « Petite Russie ». A la veille de la révolution russe, c’était une colonie de type «européen ». [7]Comparée au niveau général de développement socio-économique de cet empire, cette région était l’une des plus industrialisées et se caractérisait par une forte pénétration du capitalisme dans l’agriculture. «Ukrainien» était synonyme de «paysan» car environ 90% de la population vivait à la campagne. Parmi les 3,6 millions de prolétaires (12 % de la population), 0,9 million travaillaient dans l’industrie et 1,2 million dans l’agriculture. Produit d’un développement très inégal du capitalisme, la moitié du prolétariat industriel était concentrée dans l’enclave minière et sidérurgique du Donbass. En raison du développement colonial et de la « solution » tsariste à la question juive, seuls 43 % du prolétariat étaient de nationalité ukrainienne, le reste étant russe, russifié et juif.[8] La partie occidentale de l’Ukraine, la Galice, appartenait à l’empire austro-hongrois. Les deux revendications centrales du mouvement national renaissant étaient l’indépendance et l’unité ( samostiniste et soborniste ) de l’Ukraine.
La révolution de 1917 a ouvert la voie à la révolution nationale ukrainienne. Ce fut la plus puissante, la plus massive et la plus violente de toutes les révolutions des nations opprimées de l’empire. Les masses réclamaient une réforme agraire radicale, la constitution d’un gouvernement ukrainien et l’indépendance. Les partis opportunistes petits-bourgeois et ouvriers de la Rada centrale (conseil) qui dirigeaient le mouvement national s’opposèrent à la revendication d’indépendance. Ils ne l’ont proclamé qu’après la Révolution d’Octobre à laquelle ils étaient hostiles. En autorisant le passage d’unités militaires contre-révolutionnaires, la Rada centrale a provoqué une déclaration de guerre de la Russie soviétique contre la République populaire ukrainienne. Les bolcheviks étaient très mal préparés à faire face à la révolution nationale ukrainienne.
Le droit à l’autodétermination nationale mis en avant par Lénine était un mot d’ordre mal assimilé par le Parti. Il a même été contesté par un courant important, qualifié par Lénine d’«économisme impérialiste ». Cette contestation était d’autant plus dangereuse qu’elle se présentait au sein d’un parti prolétarien d’une nation traditionnellement oppressive et devenue impérialiste, dans un empire caractérisé par Lénine comme une énorme prison de peuples. En dehors des écrits de Lénine, le seul travail d’ensemble sur la question nationale dont disposait le parti bolchevik était l’étude confuse, voire largement erronée, de Staline. Rédigé en 1913, il n’abordait même pas la question nationale dans le cadre de l’impérialisme. [9]Lénine lui-même exprime des positions confuses et irréfléchies comme l’inspiration excessive qu’il tire de l’exemple du creuset américain et le rejet catégorique d’une solution fédéraliste. Il a condamné cela comme contraire à son idée d’un État centralisé et a exigé que chaque nationalité choisisse entre la séparation complète et l’autonomie nationale-territoriale au sein d’un État multinational centralisé. Il a éduqué le Parti dans cet esprit pendant plus de dix ans. Après la révolution, et sans donner aucune explication à son revirement, il a proclamé la fédération des nations comme la solution correcte et compatible avec le centralisme d’État – un virage que de nombreux dirigeants bolcheviks n’ont pas pris au sérieux. Au-delà du mot d’ordre démocratique du droit à l’autodétermination,
En Ukraine, à quelques exceptions près, le parti bolchevik (comme le parti menchevik) n’était actif qu’au sein de la section la plus concentrée et la plus moderne du prolétariat, qui n’était pas de nationalité ukrainienne. La diffusion du communisme au sein du prolétariat a suivi la dynamique de développement d’un capitalisme industriel colonial. L’action politique au sein du prolétariat national était le domaine de la social-démocratie ukrainienne qui se plaçait en dehors du clivage bolchevik/menchevik et était accusée par le premier de capituler devant le «nationalisme bourgeois » ukrainien. La bourgeoisie « nationale » existait à peine. A cette époque, la distinction entre le nationalisme des oppresseurs et celui des opprimés était déjà présente dans les écrits de Lénine mais tous deux étaient considérés comme bourgeois. La notion de nationalisme révolutionnaire n’était pas encore apparue. Le populisme social-révolutionnaire, qui devenait national et autonome par rapport à son équivalent russe, représentait une autre force politique active au sein des masses ukrainiennes. Le parti bolchevik en Ukraine n’a utilisé que le russe dans sa presse et sa propagande. Il a ignoré la question nationale et n’avait même pas de centre de direction sur le territoire. Il n’est pas surprenant que lorsque la révolution nationale a éclaté, elle ait été prise désarmée.
En Ukraine, le parti bolchevique n’a tenté de s’organiser en tant qu’entité distincte qu’après le traité de Brest-Litovsk, c’est-à-dire lors de la première retraite bolchevique et au début de l’occupation du pays par l’armée impérialiste allemande. Lors de la conférence ad hoc de Tahanrih en avril 1918, plusieurs tendances étaient présentes. A droite, les « Katerynoslavians » avec Emmanuil Kviring. A gauche, les « Kiévans » avec Yuri Piatakov, mais aussi les « Poltavans » ou « nationaux » avec Mykola Skrypnyk et Vasyl Shakhrai, renforcés par le soutien d’un groupe d’extrême gauche de la social-démocratie ukrainienne. La droite, se basant sur le prolétariat industriel russe, a proposé de former le PC(B) russe [Parti communiste (bolchevik)] en Ukraine. Les « Poltavans » et les « Kiévans » voulaient un parti bolchevik entièrement indépendant. Une partie des « Poltavans » voulait régler radicalement la question nationale par la fondation d’une Ukraine soviétique indépendante. Shakhrai, le plus radical, voulait même que le parti s’appelle le PC(B) ukrainien. Les « Kiévans » étaient pour un parti indépendant (et peut-être un État) tout en niant l’existence de la question nationale et en considérant le droit à l’autodétermination nationale comme un slogan opportuniste. Avec Piatakov, ils représentaient les partisans les plus extrêmes de « l’économisme impérialiste ». Cependant, en même temps, ils s’identifiaient au « communisme de gauche » boukharinien et étaient hostiles à la paix de Brest-Litovsk et au centralisme léniniste. Pour s’affirmer contre Lénine, il leur fallait un parti bolchevik indépendant en Ukraine. En outre, ils considéraient qu’une stratégie particulière était nécessaire en Ukraine dirigée vers les masses paysannes et basée sur leur potentiel insurrectionnel. C’est pour cette raison que les “Kievans” se sont alliés aux “Poltavans”. Et c’est la position de Skrypnyk qui l’a emporté. Rejetant l’approche de Kviring d’une part et celle de Shakhrai d’autre part, la conférence a proclamé le PC(B) en Ukraine comme la section ukrainienne, indépendante du PC(B) russe, de l’Internationale Communiste.[dix]
Skrypnyk, ami personnel de Lénine et réaliste, étudiant toujours les rapports de forces, recherchait un minimum de fédération ukrainienne avec la Russie et un maximum d’indépendance nationale. Selon lui, c’est l’extension internationale de la Révolution qui permettra de résister de la manière la plus efficace à la pression centralisatrice de la Grande Russie. A la tête du premier gouvernement bolchevique d’Ukraine, il avait vécu des expériences très amères : le comportement chauvin de Mouraviev, le commandant de l’Armée rouge qui avait pris Kiev ; et le refus de reconnaître son gouvernement et le sabotage de son travail par un autre commandant, Antonov-Ovseyenko, pour qui l’existence d’un tel gouvernement était le produit de fantasmes sur une nationalité ukrainienne. En outre, Skrypnyk a été obligé de lutter âprement pour l’unité ukrainienne contre les bolcheviks russes qui, dans plusieurs régions, ont proclamé des républiques soviétiques, fragmentant le pays. L’intégration de la Galice à l’Ukraine ne les intéressait pas non plus. L’aspiration nationale soborniste , de l’unité du pays, était ainsi ouvertement bafouée. C’est avec l’aile droite « katérynoslavienne » du parti qu’il y a eu l’affrontement le plus sérieux. [11] Il a formé une république soviétique dans la région minière et industrielle de Donetsk-Kryvyi Rih, y compris le Donbass, dans le but de l’incorporer à la Russie. Cette république, proclamaient ses dirigeants, était celle d’un prolétariat russe « qui ne veut rien entendre d’une soi-disant Ukraine et n’a rien de commun avec elle ». [12] Cette tentative de sécession pouvait compter sur un certain soutien à Moscou. Le gouvernement Skrypnyk devait lutter contre ces tendances de ses camarades russes, pour le soborniste de l’Ukraine soviétique à l’intérieur des frontières nationales fixées, par l’intermédiaire de la Rada centrale, par le mouvement national des masses.
Le premier congrès du PC(B) d’Ukraine a eu lieu à Moscou. Pour Lénine et la direction du PC(B) russe, la décision de Tahanrih avait le goût d’une déviation nationaliste. Ils n’étaient pas prêts à accepter un parti bolchevique indépendant en Ukraine ou une section ukrainienne du Komintern. Le PC(B) d’Ukraine ne pouvait être qu’une organisation régionale du PC(B) panrusse, selon la thèse « un pays, un parti ». L’Ukraine n’est-elle pas un pays ?
Skrypnyk, considéré comme responsable de la déviation, a été éliminé de la direction du Parti. Dans cette situation, Shakhrai, le plus intransigeant des « Poltavans », est passé à la dissidence ouverte. Dans deux livres au contenu incendiaire, écrits avec son camarade juif ukrainien Serhii Mazlakh, ils ont jeté les bases d’un communisme ukrainien indépendantiste. Pour eux, la révolution nationale ukrainienne était un acte d’une énorme importance pour la révolution mondiale. La tendance naturelle et légitime de cette révolution et sa transformation en révolution sociale ne pouvaient que conduire à la formation d’une Ukraine soviétique ouvrière et paysanne en tant qu’Etat indépendant. Le mot d’ordre de l’indépendance était donc crucial pour assurer ce dépassement, pour former l’alliance ouvriers-paysans, permettre au prolétariat révolutionnaire de prendre le pouvoir et d’établir une unité réelle et sincère avec le prolétariat russe. Ce n’est qu’ainsi que l’Ukraine pourrait devenir un bastion de la révolution prolétarienne internationale. La politique contraire conduirait au désastre. C’était le message du courant Shakhrai.[13]
Et ce fut effectivement une catastrophe.
Les raisons de l’échec du deuxième gouvernement bolchevique
En novembre 1918, sous l’impact de l’effondrement des pouvoirs centraux dans la guerre impérialiste et du déclenchement de la révolution en Allemagne, une insurrection nationale généralisée renversa l’Hetmanat, un faux État établi en Ukraine par l’impérialisme allemand. Les dirigeants opportunistes de l’ancienne Rada centrale de la République populaire ukrainienne qui, peu de temps auparavant, avaient conclu un compromis avec l’impérialisme allemand, prirent la tête de l’insurrection pour restaurer la République et son gouvernement, cette fois appelé le Directoire. Symon Petlyura, un ancien social-démocrate devenu un droitier jurant une haine féroce du bolchevisme, est devenu de facto le dictateur militaire. Mais cette montée sans précédent d’une révolution nationale des masses était aussi la montée d’une révolution sociale. Tout comme ils l’avaient fait auparavant, face à la Rada centrale, les masses perdirent rapidement leurs illusions sur le Directoire de Petlioura et se tournèrent de nouveau vers le programme social des bolcheviks. L’extrême gauche du Parti social-révolutionnaire ukrainien, appelé les Borotbistes, de plus en plus procommuniste, affirme son influence idéologique dans les masses.[14]
Dans une situation favorable à la possibilité d’une convergence entre la Révolution russe et la Révolution ukrainienne, l’Armée rouge entre à nouveau dans le pays, chasse le Directoire et établit le second gouvernement bolchevik. Piatakov était à la tête de ce gouvernement avant d’être rapidement rappelé à Moscou.
Tout en continuant à ignorer la question nationale — pour lui la révolution ukrainienne n’est pas une révolution nationale mais une révolution paysanne —, le gouvernement Piatokov, sensible à la réalité sociale de l’Ukraine, se veut un pouvoir d’État indépendant. Il considérait ce pouvoir comme indispensable pour assurer le passage de la révolution paysanne à la révolution prolétarienne et pour donner la direction prolétarienne à la guerre révolutionnaire populaire. Moscou a nommé Christian Rakovsky pour prendre la place de Piatakov. Arrivé depuis peu des Balkans, où la question nationale était particulièrement compliquée et aiguë, il s’est déclaré spécialiste de la question ukrainienne et a été reconnu comme tel à Moscou, y compris par Lénine. En réalité, bien qu’il ait été un militant très talentueux et totalement dévoué à la cause de la révolution mondiale, il était complètement ignorant et dangereux dans sa soi-disant spécialité. Danslzvestiya, le journal gouvernemental soviétique, il énonce les thèses suivantes : les différences ethniques entre Ukrainiens et Russes sont insignifiantes ; les paysans ukrainiens n’ont pas de conscience nationale ; ils envoient même des pétitions aux bolcheviks pour exiger d’être sujets russes ; ils refusent de lire des proclamations révolutionnaires en ukrainien tout en dévorant la même chose en russe. La conscience nationale des masses a été submergée par leur conscience de classe sociale. Le mot « Ukrainien » est pratiquement une insulte pour eux. La classe ouvrière est purement d’origine russe. La bourgeoisie industrielle et la majorité des grands propriétaires terriens sont russes, polonais ou juifs.[15]
Rakovsky comprenait parfaitement que la révolution bolchevique en Ukraine était le « nœud stratégique » et le « facteur décisif » dans l’extension de la révolution socialiste en Europe. [16] Cependant, incapable de replacer sa vision dans le contexte de la révolution nationale ukrainienne ou de reconnaître que cette dernière était une force active incontournable et indispensable, Rakovsky condamna sa propre stratégie a condamné sa propre stratégie à faire naufrage sur les rochers de la question ukrainienne. Une erreur tragique mais relative si on la compare à celle de Lénine dix-huit mois plus tard, qui plongea la révolution européenne dans le bourbier de la question nationale polonaise en donnant l’ordre d’envahir la Pologne.
Contrairement aux revendications de Piatakov, le gouvernement de Rakovsky — qui était sur le papier celui d’une « république indépendante » — se considérait comme une simple délégation régionale de pouvoir de l’Etat ouvrier russe. Mais la réalité objective est implacable. Face à la tentative de Rakovsky d’imposer un centralisme communiste de la Grande Russie, la réalité nationale, déjà expliquée par des bolcheviks comme Shakhraï, et aussi à leur manière par des bolcheviks comme Piatakov, se fait sentir. Ce centralisme a déclenché de puissantes forces centrifuges. La révolution prolétarienne n’a pas conduit la révolution nationale, pas plus qu’une direction militaire prolétarienne ne s’est imposée à la tête de l’insurrection nationale et sociale armée des masses. Pour atteindre la conscience de classe, les masses d’un peuple opprimé doivent d’abord passer par l’étape de la prise de conscience nationale. Ayant aliéné et même réprimé les porteurs de cette conscience, le recrutement dans l’administration se restreignit à la petite bourgeoisie russe, souvent réactionnaire, habituée à servir sous les ordres de celui qui était au pouvoir à Moscou. Il en va de même pour l’armée : le recrutement se fait parmi des personnes de très faible niveau de conscience, pour ne pas dire d’éléments lumpen. Le résultat fut un conglomérat de forces armées disparates, avec des commandants allant de Nestor Makhno (présenté par la presse centrale en termes élogieux comme un leader révolutionnaire naturel des paysans pauvres en révolte, ignorant entièrement ses convictions anarcho-communistes, totalement en contradiction avec le bolchevisme ) à de simples aventuriers comme Matvii Hryhoryiv.[17]
La politique agraire de gauche, celle de la commune, transplantée en Ukraine depuis la Russie sur le principe d’un seul pays et d’une seule politique agraire, aliéna inévitablement les paysans moyens. Il les a jetés dans les bras des paysans riches et a assuré leur hostilité au gouvernement Rakovsky tout en isolant et en divisant les paysans pauvres. Le pouvoir était exercé par le parti bolchevik, les comités révolutionnaires et les comités de paysans pauvres, imposés d’en haut par le Parti. Les soviets n’étaient autorisés que dans certaines grandes villes et n’avaient même alors qu’un rôle consultatif. La revendication populaire la plus largement soutenue était celle de tout le pouvoir à des soviets démocratiquement élus – une revendication d’origine bolchevique qui frappait maintenant la politique bolchevique actuelle. Sur le plan national, la politique était celle de la russification linguistique, la « dictature de la culture russe » proclamée par Rakovsky et la répression des militants de la renaissance nationale. Le grand philistin russe a su s’envelopper du drapeau rouge pour réprimer tout ce qui sentait le nationalisme ukrainien et défendre la Russie « une et indivisible » historique. Par la suite, Skrypnyk a dressé une liste de quelque 200 décrets «interdisant l’usage de la langue ukrainienne» rédigés sous le règne de Rakovsky par «une variété de pseudo-spécialistes, de bureaucrates soviétiques et de pseudo-communistes».[18] Dans une lettre à Lénine, les borotbistes devaient décrire la politique de ce gouvernement comme celle de « l’expansion d’un impérialisme “rouge” (nationalisme russe) », donnant l’impression que « le pouvoir soviétique en Ukraine était tombé en les mains de Cent Noirs endurcis préparant une contre-révolution. [19]
Au cours d’une escapade militaire, l’armée rebelle de Hryhoryiv s’empare d’Odessa et proclame avoir jeté à la mer le corps expéditionnaire de l’Entente (en fait en train d’évacuer la ville). Cet exploit fictif a été soutenu par la propagande bolchevique. Sentant un changement de vent, le «vainqueur de l’Entente », Hryhoryiv, s’est rebellé contre le pouvoir de « la commune, de la Tcheka et des commissaires » envoyés de Moscou et du pays «où ils ont crucifié Jésus-Christ». Il a donné le signal d’une vague d’insurrections pour renverser le gouvernement Rakovsky. Conscient de l’état d’esprit des masses, il les appela à établir partout des soviets d’en bas, et à ce que leurs délégués se réunissent pour élire un nouveau gouvernement. Quelques mois plus tard, Hryhoryiv a été abattu par Makhno en présence de leurs armées respectives, accusé de responsabilité dans des pogroms antisémites. Même l’extrême gauche pro-communiste de la social-démocratie a pris les armes contre le « gouvernement russe d’occupation ». Des pans entiers de l’Armée rouge ont déserté et ont rejoint l’insurrection. Les troupes d’élite des « cosaques rouges » se sont désintégrées politiquement, tentées par le banditisme, le pillage et les pogroms.[20]
Ces soulèvements ont ouvert la voie à Dénikine et isolé la Révolution hongroise. De Budapest, un Bela Kun désespéré a exigé un changement radical de la politique bolchevique en Ukraine. Le commandant du front ukrainien de l’Armée rouge, Antonov-Ovseyenko, a fait de même. Parmi les bolcheviks ukrainiens, le courant “fédéraliste”, en accord effectif avec les idées de Shakhrai et de Borotbisme, a commencé une activité fractionnelle. Les borotbistes, protecteurs de leur autonomie, bien que toujours alliés aux bolcheviks, formèrent le parti communiste ukrainien (borotbiste) et demandèrent à être reconnus comme section nationale du Komintern. Avec une grande influence parmi la paysannerie pauvre et la classe ouvrière ukrainienne dans les campagnes et les villes, ce parti se tournait vers une Ukraine soviétique indépendante.
Les révolutions hongroise et bavaroise, privées du soutien militaire bolchevique, ont été écrasées. La révolution russe elle-même était en danger de mort à cause de l’offensive de Dénikine.
La Russie « une et indivisible » ou l’indépendance de l’Ukraine ?
C’est dans ces conditions que Trotsky, au cours d’un tournant nouveau et décisif de la guerre civile — alors que l’Armée rouge passait à l’offensive contre Dénikine — prit une initiative politique d’une importance fondamentale. Le 30 novembre 1919, dans son ordre aux troupes rouges à leur entrée en Ukraine, il déclara :
« L’Ukraine est la terre des ouvriers ukrainiens et des paysans travailleurs. Eux seuls ont le droit de régner en Ukraine, de la gouverner et d’y construire une nouvelle vie…. Gardez bien ceci à l’esprit : votre tâche n’est pas de conquérir l’Ukraine mais de la libérer. Lorsque les bandes de Dénikine auront finalement été brisées, les travailleurs de l’Ukraine libérée décideront eux-mêmes des conditions dans lesquelles ils doivent vivre avec la Russie soviétique. Nous sommes tous sûrs, et nous savons, que les travailleurs d’Ukraine se déclareront pour l’union fraternelle la plus étroite avec nous…. Vive l’Ukraine soviétique libre et indépendante ! » [21]
Après deux ans de guerre civile en Ukraine, il s’agissait de la première initiative du régime bolchevique visant à attirer les forces sociales et politiques de la révolution nationale ukrainienne – c’est-à-dire les ouvriers et les paysans ukrainiens – dans les rangs de la révolution prolétarienne. Trotsky était également soucieux de contrecarrer la dynamique de plus en plus centrifuge du communisme ukrainien, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parti bolchevique.
La recherche par Trotsky d’une solution politique à la question nationale ukrainienne était soutenue par Rakovsky, qui avait pris conscience de ses erreurs, et se coordonnait étroitement avec Lénine, lui aussi désormais conscient des conséquences désastreuses de politiques qu’il avait lui-même souvent soutenues, voire promu. Au Comité central bolchevique, Lénine a appelé au vote d’une résolution qui imposait à tous les membres du parti d’utiliser tous les moyens pour aider à lever toutes les barrières au libre développement de la langue et de la culture ukrainiennes… supprimées pendant des siècles par le tsarisme russe et les classes exploiteuses…. [22]
La résolution annonçait qu’à l’avenir, tous les employés des institutions soviétiques en Ukraine devraient pouvoir s’exprimer dans la langue nationale. Mais Lénine est allé beaucoup plus loin. Dans une lettre-manifeste adressée aux ouvriers et paysans d’Ukraine, il reconnaît pour la première fois quelques faits fondamentaux :
« Nous, grands communistes russes, [avons] des divergences avec les communistes bolcheviks ukrainiens et les borotbistes et ces divergences concernent l’indépendance de l’État ukrainien, les formes de son alliance avec la Russie et la question nationale en général… Il ne doit y avoir aucune divergence sur ces questions. Ils seront décidés par le Congrès pan-ukrainien des soviets. »
Dans la même lettre ouverte, Lénine affirme pour la première fois qu’il est possible d’être à la fois militant du parti bolchevik et partisan de l’indépendance complète de l’Ukraine. C’était une réponse à l’une des questions clés posées un an plus tôt par Shakhraï, expulsé du parti avant son assassinat par les Blancs. Lénine affirmait en outre :
L’une des choses qui distinguent les borotbistes des bolcheviks est qu’ils insistent sur l’indépendance inconditionnelle de l’Ukraine. Les bolcheviks ne considéreront pas cela comme un obstacle à l’effort prolétarien concerté. [23]
L’effet était spectaculaire et avait une signification stratégique. Les insurrections des masses ukrainiennes ont contribué à la défaite de Dénikine. En mars 1920, le congrès borotbiste décida la dissolution de l’organisation et l’entrée de ses militants dans le parti bolchevik. La direction borotbiste a pris la position suivante : elle s’unirait aux bolcheviks pour contribuer à l’extension internationale de la révolution prolétarienne. Les perspectives d’une Ukraine soviétique indépendante seraient beaucoup plus prometteuses dans le cadre de la révolution mondiale qu’au niveau panrusse. Avec un grand soulagement, Lénine déclara :
« Au lieu d’une révolte des borotbistes, qui semblait inévitable, nous constatons que, grâce à la politique correcte du Comité central, qui a été menée si magnifiquement par le camarade Rakovsky, tous les meilleurs éléments parmi les borotbistes ont rejoint notre parti sous notre contrôle. …. Cette victoire valait quelques bons combats. » [24]
En 1923, un historien communiste a fait remarquer que c’est en grande partie sous l’influence des borotbistes que le bolchevisme a subi l’évolution de « le Parti communiste russe en Ukraine » pour devenir le « Parti communiste d’Ukraine ». [25] Même ainsi, il restait une organisation régionale du Parti communiste russe (bolchevique) et n’avait pas le droit d’être une section du Komintern.
La fusion des borotbistes avec les bolcheviks a eu lieu juste avant une nouvelle crise politique – l’invasion de l’Ukraine par l’armée bourgeoise polonaise accompagnée de troupes ukrainiennes sous le commandement de Petlyura, et la guerre soviéto-polonaise qui en a résulté. Cette fois, le grand chauvinisme russe des masses se déchaîna à une échelle et avec une agression qui échappèrent à toute retenue des bolcheviks.
Pour les éléments conservateurs de Russie, c’était une guerre contre un ennemi héréditaire, avec la réémergence duquel ils ne pouvaient pas se réconcilier en tant que nation indépendante – une véritable guerre russe, bien que menée par des internationalistes bolcheviks. Pour les grecs orthodoxes, c’était un combat contre le peuple incorrigible dans sa loyauté envers le catholicisme romain, une croisade chrétienne même si elle était menée par des communistes impies. [26]
Les masses ont été émues par la défense de la Russie «une et indivisible», une humeur attisée par la propagande. Izvestia a publié un poème presque incroyablement réactionnaire glorifiant l’État russe. Son message était qu'”il y a aussi longtemps, le tsar Ivan Kalita s’est réuni dans tous les pays de Russie, un par un… maintenant tous les dialectes, et tous les pays, tout le monde multinational seront réunis dans une nouvelle foi afin de “apporter leur puissance et leurs richesses aux palais du Kremlin”. [27]
L’Ukraine a été la première victime de l’explosion chauvine. Un social-démocrate ukrainien de gauche, Volodymyr Vynnychenko, qui avait été le chef de la Rada centrale et qui avait rompu avec le Directoire de Petlioura pour négocier aux côtés de Bela Kun un changement de politique bolchevique en Ukraine, se retrouve à Moscou à l’invitation du gouvernement soviétique à l’époque où de nombreux officiers blancs répondaient à l’appel de l’ancien commandant en chef de l’armée tsariste de « défendre la patrie russe » et rejoignaient l’Armée rouge. Georgy Chicherin, alors commissaire aux affaires étrangères, a expliqué à Vynnychenko que son gouvernement ne pouvait pas se rendre à Canossasur la question ukrainienne. Dans son journal, Vynnychenko écrit : « L’orientation vers le patriotisme russe de la variété « une et indivisible » exclut toute concession aux Ukrainiens… la fédération, l’autodétermination ou toute autre chose qui pourrait bouleverser la Russie « une et indivisible ». De plus, sous l’influence de la marée chauvine grand-russe qui traversait les couloirs du pouvoir soviétique, Chicherin a ressuscité l’idée que la Russie pourrait annexer directement la région ukrainienne du Donbass. [28] Dans la campagne ukrainienne, les responsables soviétiques ont demandé aux paysans : « Voulez-vous apprendre le russe ou le Pétliouriste à l’école ? Quel genre d’internationalistes êtes-vous, si vous ne parlez pas russe ?
Face à cette grande régression chauvine russe, les borotbistes devenus bolcheviks poursuivent le combat. L’un de leurs principaux dirigeants, Vasyl Ellan-Blakytny, écrivait à l’époque :
« Se fondant sur les liens ethniques de la majorité du prolétariat ukrainien avec le prolétariat, le semi-prolétariat et la petite bourgeoisie de Russie et utilisant l’argument de la faiblesse du prolétariat industriel d’Ukraine, une tendance que nous qualifions de colonialiste appelle à la construction d’un système économique dans le cadre de la République russe, qui est celle de l’ancien Empire auquel appartenait l’Ukraine. Cette tendance veut la subordination totale du Parti communiste (bolchevique) d’Ukraine au parti russe et envisage en général la dissolution de toutes les jeunes forces prolétariennes des « nations sans histoire » dans la section russe du Komintern…. En Ukraine, la force motrice naturelle d’une telle tendance est une partie du prolétariat urbain et industriel qui n’a pas accepté la réalité ukrainienne. Mais au-delà, et surtout, c’est la petite bourgeoisie urbaine russifiée qui a toujours été le principal soutien de la domination de la bourgeoisie russe en Ukraine. »
Et les bolcheviks d’origine borotbiste concluaient :
« Le projet colonialiste de grande puissance qui prévaut aujourd’hui en Ukraine nuit profondément à la révolution communiste. En ignorant les aspirations nationales naturelles et légitimes des masses laborieuses ukrainiennes précédemment opprimées, il est totalement réactionnaire et contre-révolutionnaire et est l’expression d’un chauvinisme impérialiste grand-russe ancien, mais toujours vivant. » [29]
Pendant ce temps, l’extrême gauche des sociaux-démocrates forma un nouveau parti, appelé parti ukapiste, afin de continuer à revendiquer l’indépendance nationale et d’accueillir les éléments borotbistes qui n’avaient pas rejoint les bolcheviks. Issu de la tradition théorique de la social-démocratie allemande, ce nouveau parti était bien plus fort sur le plan théorique que le borotbisme, qui avait des origines populistes et où l’art poétique était mieux compris que la science de l’économie politique. Mais ses liens avec les masses étaient plus faibles. [30]Les masses étaient, en tout cas, de plus en plus lassées de cette révolution permanente, dans un sens à la fois mondain et théorique. La conception théorique de Trotsky de la révolution permanente ne correspondait cependant pas en réalité à un dépassement, mais à une scission permanente entre une révolution nationale et une révolution sociale. L’un des pires résultats de cela a été l’incapacité de parvenir à une Ukraine unie (la demande de sobornist ). L’erreur fatale de Lénine en envahissant la Pologne a exacerbé la question nationale polonaise dans une direction anti-bolchevique et a bloqué l’extension de la révolution. Il en résulta une défaite de l’Armée rouge et la cession à l’État polonais de plus d’un cinquième du territoire national ukrainien en plus des zones absorbées par la Roumanie et la Tchécoslovaquie.
Tout historien honnête, et a fortiori tout marxiste révolutionnaire, doit reconnaître que la promesse faite par les bolcheviks lors de l’offensive contre Dénikine — de convoquer un congrès constituant des soviets en Ukraine capable de prendre position sur les trois options (indépendance complète, plus ou liens fédéraux moins étroits avec la Russie, ou fusion complète avec cette dernière) avancée par Lénine dans sa lettre de décembre 1919, n’a pas été retenue. Selon Trotsky, pendant la guerre civile, la direction bolchevique envisagea de mettre en avant un projet audacieux de démocratie ouvrière pour résoudre la question anarchiste dans la région sous le contrôle de l’armée insurrectionnelle de Makhno. Trotsky lui-même a discuté plus d’une fois avec Lénine de la possibilité d’attribuer aux anarchistes certains territoires où, avec l’accord de la population locale, ils réaliseraient leur expérience sans État.[31]
Mais il n’y a aucune trace de discussions similaires sur la question beaucoup plus importante de l’indépendance de l’Ukraine.
Ce n’est qu’après des luttes acharnées menées à la fin de sa vie par Lénine lui-même, ainsi que par des bolcheviks comme Skrypnyk et Rakovsky, par d’anciens borotbistes comme Blakytny et Oleksandr Shumsky, et par de nombreux communistes dirigeants des diverses nationalités opprimées de l’ancien empire russe, que le XIIe Congrès du parti bolchevik en 1923 a formellement reconnu l’existence dans le Parti et dans le régime soviétique d’une « tendance très dangereuse au chauvinisme impérialiste grand-russe ». Bien que cette victoire soit très partielle et fragile, elle offre aux masses ukrainiennes la possibilité d’accomplir certaines tâches de la révolution nationale et de connaître une renaissance nationale sans précédent dans les années 1920. Mais cette victoire n’a pas empêché la dégénérescence de la Révolution russe et une contre-révolution chauvine et bureaucratique qui, dans les années 1930, a été marquée par un holocauste national en Ukraine. Des millions de paysans sont morts au cours d’une famine provoquée par la politique stalinienne de pillage du pays, l’intelligentsia nationale a été presque complètement anéantie physiquement, tandis que les appareils du Parti et de l’État de la République soviétique d’Ukraine ont été détruits par la terreur policière. Le suicide de Mykola Skrypnyk en 1933, un vieux bolchevik qui tenta de concilier la révolution nationale avec l’allégeance au stalinisme, sonna le glas de cette révolution pour toute une période historique. L’intelligentsia nationale a été presque complètement anéantie physiquement, tandis que les appareils du Parti et de l’État de la République soviétique d’Ukraine ont été détruits par la terreur policière.
Erreurs tragiques à ne pas répéter
La révolution russe a eu deux effets contradictoires sur la révolution nationale ukrainienne. D’un côté, la révolution russe a été un facteur essentiel pour le renversement du pouvoir bourgeois en Ukraine. D’autre part, il a freiné le processus de différenciation de classe parmi les forces sociales et politiques de la révolution nationale. La raison en était le manque de compréhension de la question nationale. L’expérience de la Révolution de 1917-1920 a posé de façon dramatique la question des rapports entre la révolution sociale du prolétariat d’une nation dominante et une révolution nationale des masses laborieuses de la nation opprimée. Comme l’écrivait Skrypnyk en juillet 1920 :
Notre drame en Ukraine est que pour gagner la paysannerie et le prolétariat rural, une population de nationalité ukrainienne, nous devons compter sur le soutien et sur les forces d’une classe ouvrière russe ou russifiée qui était antagoniste à la moindre expression de Langue et culture ukrainiennes. [32]
Dans la même période, le Parti communiste ukrainien (Ukapiste) a tenté d’expliquer à la direction du Komintern :
Le fait que les dirigeants de la révolution prolétarienne en Ukraine puisent leur soutien dans les couches supérieures russes et russifiées du prolétariat et ignorent la dynamique de la révolution ukrainienne, signifie qu’ils ne sont pas obligés de se débarrasser du préjugé du « une et indivisible » Russie qui imprègne toute la Russie soviétique. Cette attitude a conduit à la crise de la révolution ukrainienne, coupe le pouvoir soviétique aux masses, aggrave la lutte nationale, pousse une grande partie des ouvriers dans les bras des nationalistes petits-bourgeois ukrainiens et freine la différenciation du prolétariat la petite-bourgeoisie. [33]
Ce drame aurait-il pu être évité ? La réponse est oui – si les bolcheviks avaient eu à leur disposition une stratégie adéquate avant le déclenchement de la révolution. En premier lieu, si, au lieu d’être un parti russe en Ukraine, ils avaient résolu la question de la construction d’un parti révolutionnaire du prolétariat de la nation opprimée. Deuxièmement, s’ils avaient intégré la lutte pour la libération nationale de l’Ukraine dans leur programme. Troisièmement, s’ils avaient reconnu la nécessité politique et la légitimité historique de la révolution nationale en Ukraine et du mot d’ordre de l’indépendance ukrainienne. Quatrièmement, s’ils avaient éduqué le prolétariat russe (en Russie et en Ukraine) et les rangs de leur propre parti dans l’esprit d’un soutien total à ce mot d’ordre, et combattait ainsi le chauvinisme de la nation dominante et l’idéal réactionnaire du «rassemblement des terres russes». Rien ici n’aurait empêché les bolcheviks de faire de la propagande parmi les ouvriers ukrainiens en faveur de l’unité la plus étroite avec le prolétariat russe et, pendant la Révolution, entre l’Ukraine soviétique et la Russie soviétique. Au contraire, ce n’est qu’à ces conditions qu’une telle propagande pourrait être politiquement cohérente et efficace.
Il y avait eu une occasion où Lénine avait essayé de développer une telle stratégie. C’est ce que révèle son « discours séparatiste » prononcé en octobre 1914 à Zurich. Il a ensuite dit:
« Ce que l’Irlande était pour l’Angleterre, l’Ukraine est devenue pour la Russie : exploitée à l’extrême, et sans rien en retour. Ainsi, les intérêts du prolétariat mondial en général et du prolétariat russe en particulier exigent que l’Ukraine retrouve son indépendance d’État, car seule cela permettra le développement du niveau culturel dont le prolétariat a besoin. Malheureusement, certains de nos camarades sont devenus des patriotes russes impériaux. Nous, les Moscovites, sommes réduits en esclavage non seulement parce que nous nous laissons opprimer, mais parce que notre passivité permet d’opprimer les autres, ce qui n’est pas dans notre intérêt. » [34]
Plus tard, cependant, Lénine ne s’en tient pas à ces thèses radicales. Ils réapparaissent cependant dans la pensée politique du communisme ukrainien indépendantiste, chez Shakhrai, les « fédéralistes » bolcheviks, les borotbistes et les ukapistes.
Il ne faut cependant pas s’étonner que les bolcheviks n’aient eu aucune stratégie pour les révolutions nationales des peuples opprimés de l’Empire russe. Les questions stratégiques de la Révolution étaient en général le talon d’Achille de Lénine lui-même, comme le montre sa théorie de la révolution par étapes. Quant à la théorie de la révolution permanente de Trotsky, implicitement adoptée par Lénine après la Révolution de Février, elle n’a été élaborée que par rapport à la Russie, pays capitaliste sous-développé et non pour le prolétariat des peuples opprimés par la Russie, qui était aussi un État impérialiste et une prison des nations. Les bases théoriques de la stratégie de révolution permanente pour le prolétariat d’une nation opprimée sont apparues pendant les années révolutionnaires parmi les courants indépendantistes du communisme ukrainien.
L’idée de base, d’abord esquissée par Shakhrai et Mazlakh, puis reprise par les Borotbistes avant d’être élaborée par les Ukapistes, était simple. A l’époque impérialiste, le capitalisme est bien sûr marqué par le processus d’internationalisation des forces productives, mais ce n’est qu’un côté de la médaille. Déchirée par ses contradictions, l’époque impérialiste ne produit pas une tendance sans produire aussi une contre-tendance. La tendance inverse dans ce cas est celle de la nationalisation des forces productives manifestée notamment par la formation de nouveaux organismes économiques, ceux des pays coloniaux et dépendants, tendance qui conduit à des mouvements de libération nationale.
La révolution prolétarienne mondiale n’est l’effet que d’une des tendances contradictoires du capitalisme moderne, l’impérialisme, même si c’est l’effet dominant. L’autre, inséparable de la première, ce sont les révolutions nationales des peuples opprimés. C’est pourquoi la révolution internationale est inséparable d’une vague de révolutions nationales et doit s’appuyer sur ces révolutions pour s’étendre. La tâche des révolutions nationales des peuples opprimés est de libérer le développement des forces productives entravées et déformées par l’impérialisme. Une telle libération est impossible sans la création d’États nationaux indépendants dirigés par le prolétariat. Les États ouvriers nationaux des peuples opprimés sont une ressource essentielle pour la classe ouvrière internationale si elle veut résoudre les contradictions du capitalisme et établir une gestion ouvrière de l’économie mondiale. Si le prolétariat tente de construire son pouvoir sur la base d’une seule de ces deux tendances contradictoires dans le développement des forces productives, il sera divisé contre lui-même.
Dans un mémorandum au deuxième congrès de l’Internationale communiste à l’été 1920, les ukapistes résument leur approche dans les termes suivants :
« La tâche du prolétariat international est d’entraîner vers la révolution communiste et la construction d’une nouvelle société non seulement les pays capitalistes avancés, mais aussi les peuples arriérés des colonies, en profitant de leurs révolutions nationales. Pour remplir cette tâche, elle doit participer à ces révolutions et jouer le rôle moteur dans la perspective de la révolution permanente. Il faut empêcher la bourgeoisie nationale de limiter les révolutions nationales au niveau de la libération nationale. Il est nécessaire de poursuivre la lutte jusqu’à la prise du pouvoir et l’installation de la dictature du prolétariat et de mener la révolution démocratique bourgeoise jusqu’au bout par la création d’États nationaux destinés à rejoindre le réseau international de l’union naissante des républiques soviétiques.
Ces états doivent reposer sur :
Les forces du prolétariat national et des masses laborieuses ainsi que sur l’entraide de tous les détachements de la révolution mondiale. »[35]
A la lumière de l’expérience de la première révolution prolétarienne, c’est précisément cette stratégie de révolution permanente qu’il faut adopter, pour résoudre la question des nations opprimées dans le cadre de la révolution politique anti-bureaucratique en URSS.
Comme le disait Mykola Khvylovy, militant communiste ukrainien et grand écrivain, en 1926, « l’Ukraine doit être indépendante parce que la volonté de fer et irrésistible des lois de l’histoire l’exige, parce que ce n’est qu’ainsi que nous accélérerons la différenciation des classes en Ukraine. Si une nation (comme cela a déjà été dit il y a longtemps et répété à plusieurs reprises) au cours des siècles manifeste la volonté de se manifester, son organisme, en tant qu’entité étatique, alors toutes les tentatives d’une manière ou d’une autre pour se retenir un tel processus naturel bloque d’une part la formation des forces de classe et, d’autre part, introduit un élément de chaos dans le processus historique général à l’œuvre dans le monde. » [36]
Lectures complémentaires : Le contexte historique de l’invasion de l’Ukraine par Poutine , par Rohini Hensman.
Traduction NCS à l’aide de Deepl
[1] Écrits de Léon Trotsky (1939-40) (New York : Pathfinder Press, 1977), pp. 47-48. https://www.marxists.org/archive/trotsky/1939/07/ukraine.htm
[2] Idem, p. 53.
[3] Idem, p. 52.
[4] Idem, p. 50.
[5] Voir l’un des ouvrages les plus importants sur la question nationale, celui du marxiste ukrainien R. Rosdolsky, Engels and the Nonhistoric Peoples : The National Question in the Revolution of 1848

Haïti : migration et surexploitation

L’un des phénomènes marquants de l’histoire haïtienne du début du vingtième siècle est celui de la migration. Ce phénomène prend une telle ampleur que « durant les années 1920, il y a autour de 20 % de la population active masculine haïtienne qui est employée à l’étranger, dont environ les deux-tiers à Cuba et le reste en République dominicaine[1] ».
À l’origine : spoliation, surexploitation et immigration
Précisons que durant la décennie de 1920, le pays est sous occupation étatsunienne (1915-1934) et que les déplacements de population qui s’opèrent de façon cyclique s’expliquent par le besoin criant de main-d’œuvre des usines centrales sucrières qui se trouvent surtout à Cuba, mais aussi en République dominicaine. Ces centrales sucrières sont le résultat de l’expansion du capital nord-américain qui tire d’énormes profits de la grande quantité de terres disponibles et de l’abondante main-d’œuvre haïtienne importée. En général, on comprend mal pourquoi les capitalistes étatsuniens n’ont pas autant investi dans l’industrie sucrière en Haïti qu’ils l’ont fait à Cuba et en République dominicaine. Selon une hypothèse discutable, l’une des raisons serait la difficulté pour l’occupant de prendre possession de la terre[2].
Des études démontrent cependant que des compagnies étatsuniennes ont accaparé plus de 266 000 acres de terre. Cela explique en grande partie pourquoi près de 300 000 Haïtiens et Haïtiennes, pendant l’occupation, ont dû quitter le pays vers Cuba et la République dominicaine[3]. Tout laisse croire que dans ce nouvel impérialisme mis en place par les États-Unis dans les Antilles, les travailleurs haïtiens sont utilisés comme main-d’œuvre bon marché, quasi esclave. Soulignons également que l’expropriation des terres de la paysannerie haïtienne s’est poursuivie bien après l’occupation militaire. Au cours des années 1940, en vue de ravitailler l’armée nord-américaine, la compagnie étatsunienne Société haïtiano-américaine de développement agricole (SHADA) s’approprie plusieurs dizaines de milliers d’hectares pour produire du caoutchouc et de la pite, une matière textile extraite des feuilles de l’agave[4]. Ayant perdu leur terre, des milliers de paysans sont contraints de s’expatrier, principalement vers Cuba et la République dominicaine.
Ce flux migratoire haïtien qui se poursuit de façon irrégulière constitue l’essentiel de la force de travail de l’industrie sucrière à Cuba jusqu’à la révolution et en République dominicaine jusqu’aux années 1970. Haïti devient au cours de cette période un pays pourvoyeur de main-d’œuvre à faible coût[5]. Cette migration de la force de travail ne touche pas uniquement les deux pays déjà mentionnés : « En 1970, 30 000 Haïtiens vivent aux États-Unis ; en 1973, 40 000 aux Bahamas ; de 1974 à 1985, la croissance de l’immigration haïtienne en Guyane est si élevée que le nombre d’immigrés représente 20 % de la population totale du pays en 1985. De façon générale, cette migration est constituée d’ouvriers (particulièrement aux États-Unis), d’artisans, de petits commerçants et d’agriculteurs (particulièrement aux Bahamas et en Guyane)[6] ».
Dictature, politique néolibérale et exode rural
À la fin des années 1960 et surtout durant la décennie 1970, les politiques néolibérales mises en place par l’État haïtien sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) contribuent à dégrader l’agriculture et à éliminer de nombreuses industries locales. L’exode rural s’intensifie. La population de la capitale, Port-au-Prince, augmente de façon exponentielle, de 50 000 habitants au cours de la décennie 1950 à 300 000 au milieu des années 1970[7].
Cette surpopulation allait constituer l’armée de réserve en main-d’œuvre pour les compagnies de sous-traitance installées dans la capitale. Le nombre de celles-ci croît rapidement au cours des années 1970, passant de 55 en 1971 pour atteindre 200 en 1984[8]. L’implantation des mesures néolibérales eut pour résultat non seulement la dégradation de l’agriculture, ce qui induisit un exode rural et la faillite des industries de l’État, mais aussi une augmentation importante du chômage, la sous-traitance ne pouvant absorber qu’une infirme partie de la population en âge de travailler (6 % en 1973)[9].
Cette situation sociale difficile est aggravée par la répression de la dictature des Duvalier. Depuis le début des années 1960, le régime spolie systématiquement les caisses de l’État et exproprie violemment les paysans. Toutes les formes d’organisation sociale (syndicales, paysannes, étudiantes, politiques, journalistiques, etc.) sont réprimées dans le sang. Des milliers de personnes sont assassinées ou disparaissent, beaucoup d’autres prennent le chemin de l’exil. Puisqu’aucune revendication ni critique n’est permise, la dictature ouvre la voie à l’exploitation impitoyable des ouvriers et des ouvrières particulièrement dans l’industrie du textile et, de façon générale, à l’implantation des politiques néolibérales, comme ce fut le cas au Chili sous la dictature de Pinochet.
L’exode rural devient donc le seul choix de survie de la classe paysanne qui, historiquement, nourrissait le pays. « On assiste à un changement structurel imposé par les groupes sociaux dominants et le marché mondial pour satisfaire la demande étrangère, changement qui crée les conditions non seulement d’une dégradation de l’économie paysanne traditionnelle, mais aussi d’une désertification constante du sol[10]. » Ce sont ces conditions également qui vont pousser nombre d’habitants des classes populaires et de la petite-bourgeoisie à quitter le pays au début des années 1970.
Immigration haïtienne prolétarisée au Québec
À partir de 1968, le nombre d’immigrantes et d’immigrants haïtiens s’établissant au Québec s’accroît substantiellement. En 1974, cette immigration haïtienne occupe la première place parmi les immigrants reçus dans la province. C’est une immigration caractérisée par le gouvernement canadien comme une main-d’œuvre majoritairement « non qualifiée », c’est-à-dire destinée à pourvoir des postes que les personnes du pays ne veulent pas. Cette immigration diffère de celle de la décennie 1960 qui était constituée principalement de professionnel·le·s travaillant dans le secteur tertiaire de l’économie.
À l’époque, la politique d’immigration canadienne s’oriente sur les besoins de l’industrie, en particulier de l’industrie du textile, localisée à 80 % au Québec, principalement à Montréal, et où les salaires sont parmi les moins élevés au Canada. Les Haïtiennes sont surreprésentées dans le secteur où elles constituent plus de 50 % de la main-d’œuvre[11].
Ces immigrantes, de même que d’autres femmes venues de pays comme la Grèce, le Portugal, la Colombie travaillent dans des conditions très difficiles, et le nombre d’heures de travail annuel est de 5,6 % plus élevé que la moyenne[12]. De façon générale, ces travailleurs et travailleuses qui intègrent le marché du travail au Québec au début des années 1970 se trouvent dans une situation de précarité qui rend possible leur surexploitation : statut juridicopolitique vulnérable, incompréhension de la langue, isolement, racisme.
Les dessous de la poussée migratoire haïtienne en Amérique latine
Depuis les années 2000, on observe une tendance à la hausse du nombre de migrantes et migrants haïtiens vers l’Amérique latine[13]. Cette tendance devient une grande traversée au cours de la décennie 2010[14], après le tremblement de terre qui a ravagé l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Selon les données de l’ONU de 2019, environ 1,5 million d’Haïtiens ont émigré ces dix dernières années, soit 14,26 % de la population haïtienne active. Leurs nouvelles destinations incluent le Brésil et le Chili alors que le Mexique, le Panama, l’Équateur et le Pérou servent souvent de lieu de transit[15]. Cette augmentation dans la région coïncide avec la transformation des politiques d’immigration. Le Brésil, notamment, allège sa politique de régulation de l’immigration de manière à attirer cette main-d’œuvre corvéable à merci dans le contexte des préparatifs de plusieurs compétitions sportives internationales, dont la Coupe du monde et les Jeux olympiques[16]. Le capital transnational et la bourgeoisie brésilienne en profitent pour effectuer la construction d’infrastructures. L’économie brésilienne s’intéresse à ces migrants en quête d’espoir, mais sans saisir les raisons pour lesquelles le territoire haïtien est devenu si peu désirable pour ses citoyens et citoyennes. Dans un contexte où l’armée de plusieurs pays de la région, dont le Brésil, participe à l’occupation militaire d’Haïti sous le label de l’ONU, il s’avère pertinent de s’interroger sur la cause de cette grande traversée des Haïtiens vers les pays de l’Amérique latine.
L’impensé de la grande traversée
Les trois dernières décennies constituent une période charnière dans la mise en œuvre des politiques néolibérales en Haïti. Depuis le retour à l’ordre démocratique en 1994, le pays est entré dans une seconde vague de néolibéralisation[17]. Sous la menace des soldats américains, les gouvernements successifs sont contraints de privatiser les principales entreprises d’État, de réduire au minimum les investissements sociaux et de dégraisser l’appareil d’État. Si ces troupes sont parties en 1999, après avoir été progressivement remplacées par des missions militaires et civiles de l’ONU, l’année 2004 donne lieu à une autre occupation militaire par les États-Unis. La composante militaire a par la suite fait place aux Casques bleus de l’ONU sous le commandement de l’armée de terre du Brésil[18]. Depuis lors, Haïti est sous la tutelle de l’ONU[19]. La saignée néolibérale des masses urbaines et rurales se poursuit sous la pression des chars et des mitraillettes des militaires des Nations unies.
Dans le jargon des ambassades occidentales et du Conseil de sécurité de l’ONU, l’objectif de l’occupation onusienne vise la « stabilisation des institutions haïtiennes ». Celle-ci se définit par la restauration d’un climat sûr et stable, le renforcement des institutions gouvernementales et des structures d’un État de droit, la promotion et la protection des droits humains[20]. Dans les faits, la présence militaire sert d’appui à un processus de néolibéralisation à grande échelle qui a pour résultat un accroissement de la pauvreté dans les principaux centres urbains et ruraux, ainsi que l’explosion d’un chômage de masse. Entretemps, les entreprises publiques et des pans entiers du territoire sont livrés à vil prix aux multinationales[21]. L’enjeu consiste à tenir en respect les mouvements sociaux haïtiens tout au long de ce processus dit de « stabilisation du pays ».
Le bilan de la répression est lourd, dont des milliers de morts dans les quartiers populaires de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince et des villes secondaires du pays. Des centaines de femmes et d’enfants subissent des viols commis par des Casques bleus. De surcroît, le choléra introduit par les troupes onusiennes tue plus de 10 000 personnes sur 800 000 infectées, sans le moindre dédommagement pour les victimes. Les troupes militaires d’occupation quittent Haïti en 2017, mais l’ONU maintient le pays sous tutelle à travers la Mission civile des Nations unies. Les deux décennies de tutelle génèrent une situation de chaos social et institutionnel[22], où des gangs armés sèment la terreur avec l’appui des agences gouvernementales et internationales. Ce chaos rend la majorité de la population haïtienne désireuse de quitter le territoire.
En guise de conclusion
Il ressort de tout cela que la migration haïtienne est essentiellement une migration de main-d’œuvre bon marché. Tout au long du XXe siècle, les différentes formes qu’elle a prises relèvent soit d’une situation de coercition, d’expropriation et de dépossession de la terre, comme cela a été le cas au cours de l’occupation étatsunienne ou encore au cours des années 1940, soit de l’implantation des politiques néolibérales à partir des années 1970. Cette migration touche particulièrement la paysannerie, même si la petite bourgeoisie est également concernée, constituée en bonne partie d’exilé·e·s politiques victimes de la dictature des Duvalier dans la décennie 1960. Un demi-siècle plus tard, le capitalisme mondialisé et la financiarisation de l’économie ont provoqué la fermeture et la délocalisation de nombreuses industries à forte intensité de main-d’œuvre. Les immigrantes et immigrants en tant que force de travail déqualifiée deviennent de moins en moins importants pour l’économie des pays du centre. Cependant les déplacements de population restent encore, et surtout aujourd’hui, un enjeu majeur : réfugié·e·s venant des pays du Sud, théâtres des guerres impérialistes, réfugié·e·s de la crise écologique, de la destruction des économies paysannes, de la paupérisation constante des classes moyennes. Cette nouvelle réalité de la migration explique en partie la montée de l’extrême droite occidentale et redéfinit du même coup les luttes sociales au niveau mondial pour sortir de la domination du capital.
Alain Saint-Victor est historien et militant communautaire et Renel Exentus doctorant en études urbaines à l’INRS
- Alex Bellande, La grande migration haïtienne vers Cuba. Économie et condition paysanne au début du XXe siècle, Montréal, Éditions du CIDIHCA, 2019, p. 7. ↑
- Ibid., p. 192-196. ↑
- Voir Suzy Castor, L’occupation américaine d’Haïti, version française, Imprimerie Résopresse, 1978 et Fred Doura, Haïti. Histoire et analyse d’une extraversion dépendante organisée, Boucherville, Éditions DAMI, 2011. ↑
- Voir Myrtha Gilbert, SHADA : Chronique d’une extravagante escroquerie, Port-au-Prince, L’Imprimeur, 2012. ↑
- Pour approfondir cette notion, voir : Alejandro Portes, « Migration and underdevelopment », Politics & Society, 1er mars 1978. ↑
- Alain Saint-Victor, De l’exil à la communauté. Une histoire de l’immigration haïtienne à Montréal, 1960-1990, Boucherville, Éditions DAMI, 2020, p. 59. ↑
- Georges Anglade, Atlas critique d’Haïti, Montréal, Centre de Recherches Caraïbes et E.R.C.E., 1982. ↑
- Doura, op. cit., p. 124. ↑
- Saint-Victor, op. cit., p. 58. ↑
- Ibid., p. 59. ↑
- Bernard Bernier, « Main-d’œuvre féminine et ethnicité dans trois usines de vêtement de Montréal », Anthropologie et Sociétés, vol. 3, n° 2, 1979, p. 117-139. ↑
- Micheline Labelle, Geneviève Turcotte, Marianne Kempeneers et Deidre Meintel, Histoires d’immigrées. Itinéraires d’ouvrières colombiennes, grecques, haïtiennes et portugaises de Montréal, Montréal, Boréal, 1987, p. 215. ↑
- Pierre Rigaud Dubuisson, « Politiques migratoires en Amérique Latine entre 2010 et 2020, et choix du Brésil comme pays de destination par les migrantes et migrants d’Haïti », Alterpresse.org, 14 décembre 2020. Voir également Renel Exentus, « Haïti–États-Unis, crise migratoire dans la ville Del Rio », Presse-toi à gauche, 28 septembre 2021; Nations unies, International Migration 2019, New York, 2019; Organisation internationale pour les migrations (OIM), Rapport du Directeur général sur les travaux de l’Organisation pour l’année 2014, Genève, 2015; OIM, La migration haïtienne vers le Brésil : caractéristiques, opportunités et enjeux, Cahiers migratoires n° 6, Genève, OIM, 2015.↑
- Dans son analyse des déplacements massifs des Haïtiens vers les pays de l’Amérique latine au cours des dernières années, l’historien-géographe Georges Eddy Lucien a repris l’image de « grande traversée ». Il associe cette poussée migratoire à l’histoire des grandes traversées lors des traites musulmanes et occidentales. Pour plus de précisions, voir la vidéo « L’invité du midi, Georges Eddy Lucien », Radio Télévision Caraïbes, 27 septembre 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=uAjROnI3O6Y>. ↑
- Dubuisson, op. cit. ↑
- Il s’agit de la Résolution Recommandée no 06/08 du Conseil national de l’Immigration (CNIg) du Brésil de mars 2011, qui permet l’octroi, pour des raisons humanitaires, d’une résidence permanente aux Haïtiennes et Haïtiens qui sont au Brésil ; la Résolution Normative no 97, publiée le 13 janvier 2012, qui décide d’octroyer annuellement 1 200 visas aux Haïtiennes et Haïtiens, et la Résolution Normative 102/2013, publiée le 29 avril 2013, qui révoque la limite de 1 200 visas annuels (Dubuisson, 2020, p. 2). ↑
- À côté de la privatisation des entreprises publiques, des projets de création de zones franches deviennent l’unique programme économique des pouvoirs publics. Pour avoir une vue globale des zones franches en Haïti, voir Laura Louis, « Privilèges et impacts des zones franches en Haïti », AyiboPost, 5 juin 2019, <https://ayibopost.com/privileges-et-impacts-des-zones-franches-en-haiti/>. ↑
- Les gouvernements de gauche libérale de Lula et de Dilma Vana Roussef n’ont pas hésité à diriger une force d’occupation sous l’égide de l’ONU en Haïti. Cette fonction leur a permis de développer des occasions d’affaires pour leur bourgeoisie et de se positionner pour occuper un siège au Conseil de sécurité de l’ONU. Voir Jean-Jacques Kourliandsky, « Lula et la politique étrangère brésilienne de 2003 à 2010 », Alternatives Sud, vol. 17, n° 1, 2010, <https://cetri.be/IMG/pdf/3-3.pdf>. ↑
- Voir MINUSTAH, Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti, <https://peacekeeping.un.org/fr/mission/minustah>.↑
- Ibid. ↑
- Georges Eddy Lucien, Le Nord-Est d’Haïti. La perle d’un monde fini : entre illusions et réalités (Haïti open for business), Paris, L’Harmattan, 2018. ↑
- Pour de plus amples informations sur le comportement sanguinaire de l’institution policière haïtienne (Police nationale d’Haïti, PNH), sa complicité avec les gangs armés, voir « La PNH assume le massacre à “Ravine pintade” », Gazettehaïti, 22 septembre 2021, < https://www.gazettehaiti.com/node/4882> ; Harvard Law School International Human Rights Clinic et Observatoire Haïtien des crimes contre l’humanité, Massacres cautionnés par l’État : règne de l’impunité en Haïti, avril 2021, <http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2021/04/Massacres-cautionnes-par-lEtat-2.pdf>.↑

Brésil. Avec Bolsonaro, l’extrême droite se développe

Plus que de l’inquiétude, l’humanité vit des jours de profonde angoisse à cause de ce qui se passe en Ukraine. Il est impossible de prévoir comment tout cela va se terminer. La seule chose prévisible est que, quoi qu’il arrive, cela finira mal. Le contexte ne sera plus jamais le même. Il n’y a jamais eu une telle tension depuis la crise entre Washington et Moscou en 1962, lorsque les Soviétiques ont installé des bases militaires à Cuba.
Le Brésil n’est pas à l’abri de ce qui se passe de l’autre côté de la planète. Les attitudes folles et ineptes du déséquilibré d’ultra-droite Jair Bolsonaro, le pire président de l’histoire, sur l’Ukraine [1] ne font que consolider l’isolement du pays sur la scène internationale.
Mais le fait que nous soyons désormais des parias mondiaux ne nous permet pas d’ignorer ce qui se passe dans le Brésil que Bolsonaro n’a de cesse de déchirer à chaque minute de chaque heure de sa vie.
Une étude récemment publiée par l’ONG Anti-Defamation League montre que le Brésil est actuellement le pays où le nombre de groupes d’extrême droite augmente le plus. Depuis 2018, année où Bolsonaro a été élu président, le nombre de ces groupes a augmenté de 300%, contre une croissance de 10% dans les pays d’Europe centrale et orientale.
Selon l’Observatoire de l’extrême droite, un groupe qui réunit des universitaires de dix universités brésiliennes et étrangères, ces cellules extrémistes sont concentrées dans les Etats de São Paulo, le plus riche et le plus peuplé du pays, de Rio de Janeiro, de Santa Catarina (où la popularité de Bolsonaro reste intouchable) et de Rio Grande do Sul.
Cela représente pas moins de 530 cellules. Une étude coordonnée par la professeure Adriana Dias, de la très prestigieuse Université de Campinas (Unicamp) à l’intérieur de São Paulo, a réparti ces groupes en différentes catégories, allant des hitlériens/nazis à l’ultranationalisme blanc, en passant par le catholicisme intégriste et le fascisme.
Plusieurs études menées au Brésil et à l’étranger indiquent clairement que depuis 2018, le pays est devenu la scène où l’extrême droite se développe le plus, et que le phénomène est directement lié à l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro.
A l’heure actuelle, les sondages relatifs aux élections d’octobre indiquent clairement qu’au moins 15% des personnes interrogées sont d’extrême droite, et ce non seulement pour avoir déclaré leur vote irréductible pour Bolsonaro, mais aussi pour leurs observations relatives à ce qu’elles attendent au cas où il parviendrait à se faire réélire.
La croissance de ceux qui sont sortis de leur réserve pour s’affirmer des conservateurs clairement extrémistes a commencé plus tôt, à la veille du coup d’Etat institutionnel qui a chassé la présidente Dilma Rousseff en août 2016. Mais ce mouvement était encore timide et limité.
Déjà lors de la campagne de 2018, avec des déclarations racistes, homophobes et clairement extrémistes, Bolsonaro a accordé une sorte blanc-seing à ces groupes pour sortir au grand jour. Et ces regroupements se développent à grande vitesse, principalement grâce aux médias sociaux.
Il est facile de constater cette croissance ainsi que l’expansion des contacts avec les groupes du monde entier, notamment en Pologne et en Hongrie, mais aussi en Espagne et au Portugal.
Les universitaires qui étudient le phénomène affirment que l’extrême droite se consolide au Brésil, et que la plupart d’entre eux tentent de se rallier à Bolsonaro, tout en renforçant leurs liens à l’étranger.
Même si le président actuel est battu dans les urnes en octobre, comme l’indiquent les sondages à l’unisson, rien ne permet de penser que cette extrême droite perdra du poids et de l’espace. Au contraire, elle pourrait devenir plus radicale et plus active.
A cette fin, ils utilisent largement le réseau social Telegram, qui compte environ 50 millions d’utilisateurs dans le monde et n’exerce aucun contrôle sur ce qui est publié et diffusé. Leur action a une influence particulière sur la jeunesse brésilienne.
Dans le cas spécifique de Rio de Janeiro, le scénario devient particulièrement inquiétant. Il existe des signes clairs de rapprochement entre les groupes nazis et les «milices», des bandes de tueurs à gages composées de policiers ou d’anciens policiers qui contrôlent une part importante du commerce de la drogue.
Si l’on se souvient que depuis que Jair Bolsonaro est devenu président, il a élargi l’accès aux armes d’une manière sans précédent, y compris celles qui étaient auparavant limitées aux forces armées, il y a de plus en plus de raisons de s’inquiéter sérieusement.
Et rien n’indique que ce mouvement, qui, il faut le répéter, se développe davantage au Brésil que partout ailleurs sur la planète, perd de sa force. Pauvre pays, mon pays. (Article publié sur le site du quotidien argentin Página 12, le 7 mars 2022; traduction rédaction A l’Encontre)
[1] A diverses occasions, Bolsonaro a déclaré sa «neutralité» face au «conflit» et a écarté l’idée de «condamner» l’invasion de l’Ukraine. Le 16 février 2022, Bolsonaro a tenu une «réunion exceptionnelle» avec Poutine à Moscou, qui donna suite à une conférence de presse. Il y affirma partager «des valeurs communes» avec son homologue. (Réd.)

Prendre à bras le corps le défi de l’immigration

Nous vous présentons le texte introductif au numéro 27 des Nouveaux Cahiers du Socialisme LE DÉFI DE L’IMMIGRATION AU QUÉBEC signé par Pierre Beaudet, numéro qu’il a cordonné auquel il a beaucoup participé. Sa dernière contribution aux numéros des NCS avant son décès.
L’immigration constitue au Québec et au Canada, comme dans l’ensemble des pays capitalistes, un vaste enjeu sur tous les terrains, y compris, et peut-être surtout sur le terrain politique. Pour les partis de centre droit comme celui qui gouverne le Québec depuis 2018, l’immigration est perçue comme un problème qui menace la société et qu’il faut, autant que possible, limiter. Aux États-Unis et ailleurs, les politiques étatiques consistent à bloquer l’immigration dite « illégale » et à mieux contrôler les flux migratoires passant par les voies officielles et répondant aux besoins du dispositif capitaliste et impérialiste. Tout cela n’est pas nouveau, mais prend des formes particulièrement intenses à l’ombre du capitalisme mondialisé qui est maintenant dominant partout. Devant cela, une réponse internationaliste est la seule qui puisse mettre des grains de sable dans cet engrenage. Cela devient donc un impératif incontournable pour tous ceux et celles qui se battent pour l’émancipation.
Capitalisme et flux migratoires
Les communautés humaines, on le sait, se déplacent depuis longtemps, peuplant à partir de l’Afrique le reste du monde. À l’époque des grands empires méditerranéens, des populations entières ont ainsi été bousculées par la conquête et l’esclavage. D’immenses migrations ont eu lieu à partir de l’Asie centrale vers l’est et l’ouest, provoquant une transformation profonde de la démographie planétaire.
C’est toutefois avec l’essor du capitalisme en Europe que le phénomène a pris une tout autre ampleur. Le capitalisme « moderne », pour son expansion, avait besoin d’une masse humaine considérable lui servant de « main-d’œuvre », considérée comme une marchandise destinée à réaliser du profit. Marx a bien expliqué que le capitalisme avait besoin d’une « armée industrielle de réserve » pour faire tourner la machine productive, de nouvelles couches ouvrières dont l’avantage, en plus de fournir la force de travail requise, était de créer une situation de compétition entre travailleurs et travailleuses dont il tirait aussi des gains. « Plus la richesse sociale est grande…, notait Marx, plus est grande la surpopulation relative ou l’armée de réserve industrielle. Mais plus cette armée de réserve est grande par rapport à l’armée active du travail et plus massive est la surpopulation permanente, ces couches d’ouvriers dont la misère est en proportion inverse de la peine de leur travail. […] Telle est la loi générale, absolue de l’accumulation capitaliste[1] ».
| La réflexion de Marx
Le cœur de la théorisation de Marx sur le « rapport social capitaliste » repose sur la corrélation qu’il établit entre la « loi d’accumulation » du capital et la « loi de la population » qui en forme l’envers[2], en polémique constante avec les thèses de Malthus. L’intérêt mais aussi la difficulté de cette théorie résident dans l’ajustement de deux catégories hétérogènes, que Marx réussit à présenter comme les deux aspects d’une même structure : d’un côté, l’armée industrielle de réserve, catégorie économique relative aux alternances d’emploi et de chômage correspondant aux cycles économiques et aux effets des transformations technologiques ; de l’autre, la surpopulation relative, catégorie démographique et anthropologique correspondant aux phases successives de la destruction des modes de vie « traditionnels » par l’extension du capitalisme. Comme l’expliquait Marx, la surpopulation et la formation d’une armée industrielle de réserve sont les moyens fondamentaux dont dispose le capital pour opposer les uns aux autres les porteurs de la force de travail. Il s’agit d’un déséquilibre entretenu, qui présente une dimension politique autant qu’économique. C’est pourquoi d’ailleurs l’ajustement des deux catégories importe tellement à Marx : c’est la clé d’une réflexion sur la façon dont le capitalisme décompose et fragmente tendanciellement la « classe » des producteurs salariés en même temps qu’il la reproduit, et par conséquent sur les obstacles structurels qui empêchent les prolétaires de se constituer immédiatement en classe « pour soi » (unifiée, organisée dans la lutte contre le capital), au-delà de la concurrence entre les individus et les groupes qui la composent. Il y a là certainement le fondement d’une analyse qui conserve une grande valeur, mais à condition de tenir compte en même temps des effets d’aveuglement qu’elle comporte, comme on le voit lorsque des politiciens et des théoriciens se réclament du « marxisme » pour déclarer qu’il est de l’intérêt des travailleurs de refuser ou de limiter l’entrée des migrants et des réfugiés sur le territoire national, car celle-ci alimente la formation de « l’armée industrielle de réserve » qui, à son tour, favorise la compression des salaires et menace les droits sociaux. La faiblesse relative de Marx, c’est justement de donner à penser (pour contrer le malthusianisme) que les mouvements de population (qui englobent des distributions inégales selon le genre ou la race) sont unilatéralement « au service » des fluctuations de l’armée industrielle de réserve, sans trop se poser la question de leur autonomie relative et des « contre-tendances » qu’ils impriment à la lutte des classes. Étienne Balibar[3] |
Pendant sa première phase, l’histoire du capitalisme a pris la forme de ce terrible « triangle de la mort » qui s’est façonné dans l’Europe en voie d’industrialisation, notamment en Angleterre, accompagné de la mise en esclavage d’une grande partie de l’Afrique et du génocide des populations autochtones des Amériques. Le capitalisme a parallèlement poursuivi son accumulation par la destruction de la paysannerie européenne mise au service de l’industrie dans les conditions sordides de l’époque. Comme dans le cas de la subjugation du peuple irlandais par l’Angleterre, un transfert massif de population vers les usines anglaises avait comme résultat de diviser la classe ouvrière en camps hostiles :
En raison de la concentration toujours plus grande des exploitations agricoles, l’Irlande fournit sans cesse un excédent de main-d’œuvre au marché du travail anglais et exerce, de la sorte, une pression sur les salaires dans le sens d’une dégradation des conditions matérielles et intellectuelles de la classe ouvrière anglaise.
Ce qui est primordial, c’est que chaque centre industriel et commercial d’Angleterre possède maintenant une classe ouvrière divisée en deux camps hostiles : les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais. L’ouvrier anglais moyen déteste l’ouvrier irlandais en qui il voit un concurrent qui dégrade son niveau de vie. Par rapport à l’ouvrier irlandais, il se sent membre de la nation dominante et devient ainsi un instrument que les aristocrates et capitalistes de son pays utilisent contre l’Irlande. Ce faisant, il renforce leur domination sur lui-même. Il se berce de préjugés religieux, sociaux et nationaux contre les travailleurs irlandais. Il se comporte à peu près comme les blancs pauvres vis-à-vis des nègres dans les anciens États esclavagistes des États-Unis. L’Irlandais lui rend avec intérêt la monnaie de sa pièce. Il voit dans l’ouvrier anglais à la fois un complice et un instrument stupide de la domination anglaise en Irlande[4].
Une fois ce processus arrivé à terme vers la fin du dix-neuvième siècle, le projet s’est internationalisé avec les flux migratoires immenses dirigés vers l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord. Ce processus a réussi jusqu’à un certain point à réduire la résistance ouvrière. Devant cela, des organisations ouvrières et socialistes ont adopté une posture « nationaliste », réclamant la fermeture des frontières et la mise en place de mesures discriminatoires envers les « non-nationaux ». Avec Marx et l’Association internationale des travailleurs (AIT), cependant, des mouvements se sont levés contre cette fausse solution pour construire une perspective internationaliste basée sur la solidarité et la coopération.
Un monde de migrants et de migrantes
Aujourd’hui comme hier, l’immigration est nécessaire pour les classes dominantes. Il faut laisser entrer les hommes et les femmes qui vont renouveler les couches populaires en voie de vieillissement, surtout dans les niches d’emploi dites du « 3-D » (dangerous, dirty, difficult), où les mauvaises conditions de travail et les salaires bas de gamme exigent la venue de personnes aux droits restreints qui seront en quelque sorte obligées de s’accommoder de ces conditions. Travailleurs « temporaires », domestiques, préposées dans les résidences et autres établissements de santé, ouvriers dans la construction, le transport, l’industrie alimentaire et bien d’autres sont indispensables, permettant à l’accumulation et à la hausse des profits de croître sans entraves. Le capitalisme requiert parallèlement un grand nombre de personnes techniquement qualifiées et habilitées à manipuler les circuits scientifiques et technologiques émanant du nouveau cycle de production. Ingénieurs, informaticiens et scientifiques en tout genre, formés aux frais de leur pays d’origine, viennent combler les besoins, étant souvent corvéables à volonté et mal payés.

Source : https://alencontre.org/economie/economie-mondiale-une-situation-systemique-qui-est-specifique-a-la-financiarisation-comme-phase-historique.html/attachment/carte-flux-migratoires
Diviser pour régner
Aujourd’hui la situation ressemble, sans être parfaitement identique, à celle qui a prévalu à l’époque du capitalisme mondialisé de la période coloniale.
Les flux migratoires en un coup d’œil[5]
|
Au Canada, des discriminations systémiques
L’État canadien a été bâti à partir d’un projet explicitement colonialiste. L’immigration « blanche et chrétienne » devait combler les besoins de « l’armée industrielle de réserve » tout en fournissant des contingents ouvriers qui subissaient une forme moderne d’esclavage, comme ces milliers de Chinois qui ont construit l’infrastructure de transport dans l’Ouest[7]. Les générations successives d’immigré·e·s qui ont afflué d’Europe entre les guerres ont été ainsi mises au service de l’accumulation dans l’industrie, les transports, la construction.
La gestion de l’immigration par l’État canadien et par son subalterne québécois s’est depuis inscrite dans la phase actuelle du capitalisme communément désignée sous le nom de néolibéralisme[8]. Durant cette période, la situation des immigré·e·s s’est aggravée avec la montée de discriminations extrêmes prenant la forme du racisme et de l’islamophobie. De vastes segments de la population immigrante se retrouvent stigmatisés et enfermés dans des ghettos d’emplois à bas salaires. À Montréal, qui reçoit 75 % de cette population, les immigrantes et les immigrants peuplent les quartiers délabrés. La détérioration de leur situation se produit dans un contexte où la majorité des migrants sont maintenant admis sur des bases temporaires et conditionnelles, ce qu’illustre l’expansion très importante des programmes qui concernent les migrants « temporaires » auxquels on impose des contrats très restrictifs comme l’expose bien l’article de Marie-Hélène Bonin. On verra dans le texte de Leah Woolner qu’en marge de ces flux légalisés subsiste également un important « trafic des personnes » dont les femmes sont les premières victimes.
Les migrantes et migrants au Canada
|
Aujourd’hui, l’État canadien est le principal intervenant de ce système. La politique de l’immigration vise d’abord des objectifs économiques, dans le cadre des politiques capitalistes en place. Elle est aussi inscrite dans une démarche géopolitique, en fonction des positions du Canada sur un certain nombre de grands enjeux tels qu’ils se présentent d’une région à l’autre. Au total, le gouvernement canadien de même que l’élite économique et les instituts de recherche qui leur sont associés s’avèrent fortement favorables à une augmentation contrôlée de l’immigration. Selon le ministre fédéral de l’Immigration Marco E. L. Mendicino, l’immigration comporte d’« énormes avantages pour préserver notre mode de vie et notre prospérité[9] ». Le Conference Board du Canada, un think tank parmi les plus influents auprès de l’élite canadienne, estime pour sa part que l’immigration est un des facteurs-clés de la croissance de la production et une source très importante d’investissement[10].
|
Immigration et immigration… Les personnes admises comme immigrantes peuvent obtenir la résidence permanente, puis la citoyenneté canadienne : ce sont pour une part des immigrants économiques, pour une autre part des immigrants familiaux et enfin des personnes « protégées ». En 2009, sur les 252 124 nouveaux résidents permanents, la catégorie des immigrants économiques (incluant conjoints et personnes à charge) représentait 61 % du total. Parmi les immigrants économiques, on distingue :
Enfin, il existe deux catégories de résidence temporaire : celle couverte par le programme des étudiants internationaux et celle des travailleurs étrangers temporaires (travailleurs agricoles saisonniers, aides familiales résidantes, etc.). Depuis 2002, le nombre total de travailleurs étrangers temporaires a augmenté de 148 % (de 101 259 personnes à 251 235). Ces immigrants de « deuxième classe » sont maintenant plus nombreux que les immigrants économiques. Si les travailleurs étrangers temporaires sont licenciés ou perdent leur emploi pendant la durée de leur permis de travail, ils doivent demander un nouveau permis de travail auprès d’un nouvel employeur. Source: Erika Gates-Gasse, « Two steps » Immigration. Canada’s new immigration system raises troubling issues, Ottawa, Centre canadien de politiques alternatives, octobre 2020 |
C’est ce portait d’ensemble qui est décrit dans la première partie du dossier avec des textes sur la condition immigrante vue au prisme du logement (Damaris Rose), de la discrimination dans l’emploi (Alain Saint-Victor), du genre (Chantal Ismé et Marjorie Villefranche), de la précarisation et même de la COVID-19 (entrevue de John Shields). Fait à noter, les migrations temporaires, selon les besoins à court terme de l’économie et des entreprises, de phénomène relativement marginal dans les décennies antérieures, sont aujourd’hui « normalisées » et ont crû considérablement.
Le « modèle » québécois et ses périls
La situation socioéconomique des migrantes et migrants au Québec ne diffère pas substantiellement de celle qui sévit au Canada.
Faits saillants de l’immigration au Québec[11]
|
Sous l’égide du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), le discours a changé, et le but maintes fois réaffirmé par cette formation politique est de limiter les flux de l’immigration. Pour le gouvernement et certains médias, les migrantes et les migrants représentent une « menace » contre l’identité québécoise. La loi 21, la Loi sur la laïcité de l’État, est discriminatoire envers les femmes musulmanes dans le contexte d’une flambée de violence islamophobe et fait partie, selon Leila Benhadjoudja et Leila Celis (voir leur contribution), « d’un processus à travers lequel le gouvernement de la Coalition avenir Québec fait la promotion d’une société exclusive, marquée par des écarts socioéconomiques importants et stables, processus dont fait partie aussi la législation en matière d’immigration, qui vise, entre autres, à la fois à réduire le nombre d’immigrants et d’immigrantes et à augmenter la “bonne” immigration, c’est-à-dire celle des Européens et Européennes ».
Contre-pouvoirs, stratégies et résistances
Au tournant des années 1930, le Parti communiste du Canada avait mené plusieurs grandes batailles avec et pour les immigrantes et immigrantes dont plusieurs ont joué un rôle central dans leur syndicalisation, notamment[13]. Par la suite, la montée du nationalisme de droite inspiré par l’Église catholique et géré par le régime duplessiste a stigmatisé les immigrantes et immigrants présentés comme des voleurs (surtout s’ils étaient juifs) ou des communistes (surtout s’ils étaient ouvriers). Un discours haineux animé entre autres par l’abbé Lionel Groulx s’est distillé dans la société contre les immigrants de l’époque, surtout européens. Puis, dans les années 1970, des communautés, notamment grecques et italiennes, se sont organisées pour défendre leurs droits. L’arrivée massive des migrantes et migrants d’Haïti, du Vietnam, d’Amérique latine a fait bouger l’opinion au moment où l’idée de l’émancipation sociale et nationale reprenait de la vigueur, prenant la forme d’une insertion croissante de ces populations dans les mouvements populaires, les syndicats, les groupes de gauche et même le Parti québécois qui incarnait alors l’espoir du changement. Avec le reflux du capitalisme, accompagné d’un recul des mouvements sociaux dans les années 1980, la situation de discrimination s’est reproduite à nouveau avec les flux croissants venant d’Amérique centrale, du Moyen-Orient, d’Asie et de l’Afrique subsaharienne. La lutte contre la discrimination s’est élargie et diversifiée couvrant une vaste gamme de problématiques sociales, économiques et politiques.
Aujourd’hui, les initiatives venant de la base prolifèrent, comme celles du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) et du Comité d’action de Parc-Extension (CAPE) dont les expériences sont décrites dans ce dossier. Les syndicats s’impliquent davantage tout en tentant de modifier leur culture organisationnelle pour être plus accueillants envers les immigrants comme le montrent les entrevues de Marc-Édouard Joubert et de Ramatoulaye Diallo. De grandes mobilisations ont eu lieu contre le massacre au Centre culturel islamique de Québec (rappelées dans le texte de Sébastien Bouchard) et dans le cadre de la solidarité avec les Africains-Américains. L’initiative de Québec solidaire est également porteuse à travers les contributions de certains membres et élu·e·s de cette formation qui en reconnaissent toute l’importance (comme l’illustre l’entrevue avec le député Andrés Fontecilla).
Repenser les paradigmes
Devant ces transformations, les intellectuels progressistes un peu partout dans le monde s’impliquent dans les multiples dimensions de l’immigration. La décolonisation d’une certaine tradition, jusqu’ici plutôt « autiste », est en cours à travers des travaux d’une grande qualité provenant de chercheuses et chercheurs d’origine immigrante (voir les contributions de Osna, Hernandez, Idir et Zennia, Rosso, Hanieh). Selon Saïd Bouamama (voir son texte), il faut que la gauche refasse ses devoirs, dans un contexte où « les approches idéalistes du racisme présentent celui-ci comme une réalité éternelle ayant caractérisé l’humanité de son apparition sur terre à aujourd’hui. L’intérêt d’une telle approche pour les classes dominantes est d’invisibiliser le moment historique d’apparition de cette idéologie de légitimation de la domination et, ce faisant, d’occulter ses liens avec le capitalisme comme mode de production. L’approche matérialiste souligne au contraire l’historicité du racisme et le lien de celle-ci avec l’historicité du capitalisme ».
- Karl Marx, Le Capital, Tome 3, <https://wikirouge.net/Arm%C3%A9e_de_r%C3%A9serve_industrielle>. ↑
- Karl Marx, Le Capital, VIIe section du Livre Premier, chapitre 23; pour la traduction française du Capital, Livre 1, sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Éditions sociales, 1983. ↑
- Étienne Balibar, « Sur la situation des migrants dans le capitalisme absolu », Les Possibles, n° 19, 2019. ↑
- Karl Marx, Lettre à Sigfrid Meyer et August Vogt, 9 avril 1870, <https://wikirouge.net/texts/fr/Lettre_%C3%A0_Sigfrid_Meyer_et_August_Vogt,_9_avril_1870>. ↑
- Organisation internationale pour les migrations, État de la migration dans le monde 2020, Genève, Rapport de l’OIM, 2020. ↑
- Roger Martelli, « Accueil des migrants : enjeux de civilisation », dans Claude Calame et Alain Fabart (dir.), Migrations forcées, discriminations et exclusions. Les enjeux de politiques néocoloniales, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2020. ↑
- Dans les années 1880, l’État et les entreprises qui ont construit le chemin de fer ont importé des dizaines de milliers de travailleurs chinois, dont le salaire était inférieur de 30 à 50 % à celui des autres travailleurs. Une fois ces infrastructures érigées, l’État a imposé un « droit d’entrée » de 50 dollars pour les Chinois (l’équivalent de 5000 dollars aujourd’hui) qui voulaient immigrer au Canada, ce qui a réduit énormément cette immigration jusqu’à l’annulation de cette loi discriminatoire en 1947. ↑
- Déjà, il y a 10 ans, les Nouveaux Cahiers du socialisme avaient établi un diagnostic des normes, réglementations et principes à la base de la politique de l’immigration, Migrations : stratégies, acteurs, résistances, n° 5, printemps 2011. ↑
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2020. ↑
- Conference Board du Canada, Counting on immigration, mai 2021. ↑
- Source : Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration Québec, 2019, Présence et portraits régionaux des personnes immigrantes admises au Québec de 2008 à 2017, Québec, Gouvernement du Québec, 2020. ↑
- Mathieu Forcier et Laura Handal, L’intégration des immigrants et immigrantes au Québec, Montréal, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, novembre 2012. ↑
- Évelyne Dumas, une journaliste courageuse des années 1970, avait écrit une partie de cette histoire dans un ouvrage magnifique, Dans le sommeil de nos os. Quelques grèves au Québec entre 1934 et 1944, Montréal, Leméac, 1971. ↑

MERCI Pierre Beaudet

Notre ami Pierre Beaudet est décédé aujourd’hui. Nous sommes sous le choc. Il y a quelques jours à peine, Pierre participait à des réunions avec nous et semblait déterminé à se rétablir de sa maladie. Mais le corps n’a pas tenu le coup.
Les Nouveaux Cahiers du socialisme sont en deuil. Pierre a fondé ce collectif il y a une quinzaine d’années avec d’autres camarades désireux et désireuses de participer à la création d’une nouvelle culture politique de gauche, pluraliste et critique.
Les membres des Nouveaux Cahiers du socialisme veulent offrir leurs profondes condoléances à à ses proches. Nous prendrons plus tard le temps nécessaire pour rendre hommage à Pierre, ce militant et homme de conviction depuis sa jeunesse. Sa contribution à la gauche tant québécoise qu’internationale est immense, sa feuille de route est depuis longtemps impressionnante.
Nous perdons un frère et un ami de longue date.
Repose en paix camarade.

Féminisme : Ni la guerre qui nous détruit ni la paix qui nous opprime

Image du mouvement Global Women’s Strike avec sa devise “invest in care, not kill”
Le titre de cet article correspond à la devise qui accompagne l’action féministe contre les guerres, qui a toujours été, inconditionnellement, solidaire des femmes palestiniennes, afghanes, syriennes, irakiennes, colombiennes, kurdes, sahraouies et tant d’autres que je pourrais continuer à énumérer. Aujourd’hui, écoutant avec douleur les témoignages de la population ukrainienne et voyant les images de la destruction que l’invasion russe produit, mon cœur va aux femmes ukrainiennes, à celles qui résistent dans les villes et aux milliers qui ont dû fuir avec leurs filles et leurs fils, devenant des réfugiés. Et elle est aussi du côté des pacifistes russes qui créent des réseaux de résistance contre la guerre face à la répression du régime Poutine.
A la veille des manifestations du 8 mars, nous assistons à des polémiques entre les partis de gouvernement sur la guerre et à des déclarations institutionnelles sur le sens des prochaines mobilisations féministes, c’est pourquoi, avant d’entrer dans le vif du sujet, je continuerai à défendre la l’autonomie du mouvement féministe pour fixer son propre agenda dans les manifestations qu’il organise et convoque, sans ingérence institutionnelle ou partisane. L’histoire a conduit ce mouvement à être particulièrement jaloux de son autonomie et à différencier l’espace institutionnel et sa responsabilité des politiques publiques du sien.
Le “non à la guerre” du féminisme a de profondes racines historiques et internationales et, malheureusement, un long cheminement. Ici, des groupes tels que “Dones per donas”, “Mujeres de negro” et diverses plateformes pour la paix ont toujours répondu aux guerres et ont montré l’importance de créer des réseaux de soutien et de relations avec et entre les femmes dans les pays en conflit. Ainsi, elles ont poussé au rejet des guerres et à la défense de la paix, pour avoir toujours été présentes dans l’idéologie et le travail féministes et pour faire partie de leur internationalisme, de ce qu’on appelle désormais « le cri global».
Les raisons qui nous poussent, nous les femmes, à nous soulever contre la guerre et à défendre la paix sont très diverses. On a parfois voulu associer une nature prétendument pacifique des femmes, argument aux nettes connotations essentialistes que je ne partage pas et qui ne rend pas compte des expériences diverses des femmes sur la maternité, sur les pratiques relationnelles dont nous sommes tenues pour responsables ou sur la défense de la nature. L’activiste féministe et antimilitariste Montse Cervera l’explique en en pointant la raison : “Ce n’est pas parce que les femmes sont pacifiques par nature, mais parce que nous avons opté pour la vie des gens et de la planète.”
Cet engagement à mettre les besoins et le bien-être des personnes au centre, à garantir des vies décentes au lieu des bénéfices des marchés comme le proclame le capitalisme, est ce qui explique le rejet féministe de la logique des armes, de cette industrie qui va grossir en des temps de paix jusqu’à devenir une puissante industrie de la mort générant de gros profits ; le rejet aussi des escalades militaristes qui se forgent sous la rhétorique de paix et les politiques de sécurité des États qui, d’autre part, donnent de si bons retours à l’extrême droite.
C’est le même regard qui accompagne la demande de moins de dépenses militaires et de plus de dépenses sociales dans le budget de l’État. Ce sont les dépenses sociales qui peuvent répondre aux besoins réels et à la sécurité des personnes, c’est ce que la pandémie a rendu visible comme emplois essentiels : ceux d’agents de nettoyage, des résidences, de la santé, des services de soins à la dépendance, des soins et des travaux d’accompagnement à domicile ; dans chacun d’eux, la majorité des travailleurs sont des femmes.
L’épopée belliciste mène inexorablement à la culture de la violence, et rien ne produit plus d’éloignement de la proposition féministe
Mais il y a une autre composante fondamentale dans la proposition féministe de paix et dans le « non à la guerre » : la violence. Les femmes sont bien conscientes de la logique destructrice de la violence, en l’occurrence la violence sexiste, et les guerres sont le plus grand vecteur de la violence généralisée qui vise l’assujettissement des peuples et la violence patriarcale qui l’accompagne. Malheureusement, mais heureusement, cela a été documenté à d’innombrables reprises, les femmes deviennent des butins de guerre. Il a fallu attendre que la tragédie des femmes dans la guerre des Balkans éclate, pour que le viol soit considéré comme un crime de guerre, et le fait est que l’épopée guerrière conduit inexorablement à une culture de la violence, et rien ne produit plus d’éloignement à la proposition féministe.
L’ampleur finale de cette guerre, déjà dévastatrice, n’est pas connue, ni s’il sera possible de désamorcer les armes et que les milliers de réfugiés ukrainiens pourront reprendre la vie dans leurs villes et villages avec leurs blessures. On sait, car c’est déjà annoncé, qu’il va changer les conditions de vie de tout le monde. Et c’est sans doute l’urgence mondiale. Mais si vous aspirez à la paix et « à une paix qui n’opprime pas », vous ne pouvez ignorer les problèmes posés par le féminisme antimilitariste, car c’est la garantie de répéter l’horreur et de transformer le discours de paix en pure rhétorique.
La brutalité de la guerre, et le drame humain qu’elle entraîne, peut conduire à l’installation d’une normalité qui parque ou ignore tout problème échappant à la logique de la guerre, qui pourtant fait partie de la lutte pour la vie des femmes dans d’autres régions de la planète. Mais ce ne sera pas facile, peut-être devrons-nous apprendre à le faire.
Le mouvement Black Lives Matter a souligné que toutes les vies comptent et leur combat et leur slogan sont devenus une référence. J’y recourt car face au risque d’une normalité qui s’appuie sur la logique du « chacun pour soi » ou du « nous d’abord », si fonctionnelle au néolibéralisme, face à la peur et à l’insécurité, elle me conduit à ce que le féminisme a suscité : le « nous ensemble ». L’idée qu’il n’y a pas de droits pour certains s’ils ne peuvent être étendus à tous. C’est pourquoi, répondre de toute urgence au drame humain qu’est la plus grande crise de réfugiés survenue en Europe ne peut ignorer la situation de milliers de femmes et d’hommes qui vivent dans la pauvreté dans des camps de réfugiés à travers le monde. La modification des lois sur l’asile et le refuge, l’immigration et les autres règles de sécurité de l’Union européenne ne peut pas non plus être retardée.
Parce que toutes les vies comptent, la régularisation des Ukrainiens qui vivent dans l’État espagnol est urgente et doit contribuer à garantir qu’il en soit ainsi pour les près d’un demi-million de migrants qui vivent dans l’État espagnol en situation administrative irrégulière. Comme le soulignent les travailleurs domestiques (d’ailleurs, toujours sans que le gouvernement reconnaisse leurs droits et ratifie la convention 189 de l’Organisation internationale du travail), les journaliers, les travailleurs du sexe, les soignants et les travailleurs essentiels, dont beaucoup sont des migrants, l’irrégularité de leur Cette situation les soumet à une plus grande exploitation par le travail, à une vulnérabilité juridique, à l’exclusion des services et des droits publics, et les rend plus vulnérables à la violence sexiste et institutionnelle.
Ce risque auquel j’évoquais tout à l’heure – que tout ce qui ne rentre pas dans la logique de la guerre et ses conséquences immédiates terribles disparaisse de l’attention médiatique, sociale et politique – est un énorme problème car la guerre ne fera qu’aggraver les effets dévastateurs de les crises que nous subissons et qui se superposent : celle dérivée de la guerre chevauche celle de la pandémie et celle-ci sur les crises écologique, sanitaire, économique et démocratique que le féminisme a également qualifiée de crise systémique.
Le danger que les inégalités produites par le système s’approfondissent et s’installent encore plus dans une normalité marquée par la violence, la fragilité des conditions de vie de la majorité et la fragilité de l’environnement, est réel.
Dans une récente conférence sur le féminisme syndicaliste, certaines compañeras ont dit que s’organiser, c’est commencer à résister. Organisez-vous pour transformer en un cri mondial “ni la guerre qui nous détruit, ni la paix qui nous opprime”, pour construire des vies dignes et durables pour tous, afin que l’engagement à créer une communauté rende la soumission des femmes et des peuples irréalisable.
Comme le dit le manifeste de la Commission 8M du mouvement féministe madrilène, « les féministes ont un plan, nous allons changer le système. On dessine une autre trajectoire possible, avec un pouvoir féministe qui franchit les frontières et fait tomber les murs. Et ce n’est pas de la rhétorique, il y a un féminisme inclusif, dans lequel nous nous inscrivons tous, avec des propositions qui pointent vers les causes structurelles de la situation que vivent les femmes et c’est peut-être pourquoi cela les met si mal à l’aise.
Féminisme ou barbarie.
———————
Justa Montero est une militante féministe.
Publié dans Contexte le 03/07/2022

La Russie de Vladimir Poutine : un régime bonapartiste

L’effondrement du régime soviétique s’est déroulé dans un temps si court qu’il a surpris presque tout le monde de ce côté-ci du Rideau de fer. Ce trop court délai n’a pas suffi à mobiliser la société russe autour d’un projet élaboré en toute indépendance de classe par rapport aux couches sociales dominantes. Ces dernières, fortement appuyées en cela par nos gouvernements et les institutions financières internationales tels le FMI, la Banque mondiale, la BERD, ont fait pression sur les libéraux russes pour une transition rapide au capitalisme, la fameuse thérapie de choc. Ces derniers ne se sont d’ailleurs pas fait prier. Méfiants des milieux populaires russes, la vitesse permettrait d’effectuer l’essentiel de la transition – à commencer par les privatisations – avant que la population se mobilise contre le type de société qu’on commençait à mettre en place. Les aspirations à la liberté, à la démocratie, s’étaient manifestées à une large échelle. Mais c’était beaucoup moins le cas en ce qui concerne le passage au capitalisme, lourd de menaces pour la sécurité économique des travailleurs et travailleuses et susceptible de heurter les valeurs égalitaristes profondes du peuple russe, antérieures au régime soviétique.
Les perturbations politiques qui ont accompagné l’application de la thérapie de choc ont soulevé des doutes sur la capacité d’un régime politique libéral doté d’un parlement fort – héritage des réformes de Gorbatchev et des revendications démocratiques qui ont suivi – de contrer tout menace à l’ordre établi. Après tout, des élections parlementaires auraient pu donner la victoire à des forces opposées à l’ordre capitaliste qu’on mettait en place. C’est la raison pour laquelle les confrontations entre le parlement et le pouvoir exécutif en 1992 et 1993 ont abouti à la violence et à l’imposition d’une constitution qui accorde l’essentiel des pouvoirs au président. Nos dirigeants, faut-il le rappeler, tout comme nos éditorialistes serviles, ont appuyé ce geste commis par Boris Eltsine et son entourage. Comme la thérapie de choc n’arrivait pas à elle seule à assurer l’irréversibilité de la transition, le recours à l’autoritarisme s’avérait donc également nécessaire.
En 1999, le règne de Boris Eltsine tire à sa fin et l’oligarchie cherche désespérément un candidat susceptible d’assurer la continuité de l’ordre établi. Le tandem Primakov-Loujkov fait peur avec son intention de réviser certaines privatisations et de procéder à la renationalisation de certains secteurs de l’économie. Primakov, premier ministre pendant une courte période, jouit d’un important soutien populaire et les sondages prévoient qu’il risque fort de remporter l’élection présidentielle de mars 2000. En août 1999, le clan Eltsine choisit finalement Vladimir Poutine comme candidat et lui donne l’occasion de se faire connaître en le nommant premier ministre. Issu de l’ancien KGB, il apparaît comme la meilleure garantie pour protéger le nouveau régime de tout ce qui pourrait le menacer. Nommé président par interim le 31 décembre, il remporte ensuite l’élection présidentielle.
Contrairement à Eltsine, Poutine bénéficie d’une économie en forte croissance avec la hausse des prix mondiaux du pétrole. Il a par ailleurs profité de son poste de président et du contexte de guerre en Tchétchénie pour placer les siloviki dans différentes instances stratégiques, y compris de grandes entreprises. On appelle siloviki ces personnes issues des institutions chargées d’assurer la sécurité du régime.
Le caractère bonapartiste du régime postsoviétique devient ainsi beaucoup plus affirmé. Dans un régime bonapartiste, l’État s’érige au-dessus des classes sociales, y compris la classe dominante. C’est ce qu’on observe en Russie, où l’oligarchie/bourgeoisie formée sur les décombres de l’URSS et enrichie par les privatisations effectuées de manière scandaleuse est trop faible pour prendre la tête de la société russe, qui la déteste cordialement. Un sondage réalisé en août dernier par le Centre Levada (maison de sondages et d’enquêtes sociologiques indépendante de l’État et considérée par lui comme « agent de l’étranger »), a posé une question sur le « système économique le plus juste ». La planification et la distribution par l’État a reçu l’appui de 62% des sondés contre 24% pour le système fondé sur la propriété privée et l’économie de marché. En somme : si la transition au capitalisme a abouti jusqu’à un certain point dans la sphère de l’économie, ce n’est pas le cas dans celle de l’idéologie. C’est ainsi qu’on peut comprendre la peur que ressent l’oligarchie face au peuple russe et la nécessité d’un État où le pouvoir qui la protège est concentré entre les mains de la branche exécutive.
Comme ce fut le cas pour Napoléon III, l’État russe jouit d’une autonomie sans commune mesure avec ce que l’on retrouve dans les pays capitalistes développés. Cette autonomie a permis à Poutine d’agir parfois contre les intérêts apparents de l’oligarchie, notamment avec cette guerre qu’il a déclenchée contre l’Ukraine. C’est un peu ce genre de rapport qu’on retrouvait dans l’Allemagne nazie entre l’État et la bourgeoisie. Cette dernière étant menacée par la montée communiste, elle a accepté d’être politiquement expropriée en échange du maintien des rapports sociaux capitalistes (ce qui a d’ailleurs amené Hitler à se débarrasser des SA, qui voulaient pousser plus loin la « révolution »). Lorsque la défaite de l’Allemagne ne faisait plus de doute, la bourgeoisie a cherché, sans succès, à se débarrasser d’Hitler dans le but de mettre fin à la guerre sur le front ouest et de s’entendre avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce désaccord entre la bourgeoisie et l’État nazi a culminé avec la tentative ratée d’assassinat d’Adolf Hitler en juillet 1944. Aux États-Unis ou ici, une guerre sans l’appui du capital ne serait guère possible.
Les ennuis que Poutine a causés à certains oligarques (Berëzovski, Goussinski, Khodorkovski et d’autres) ont contribué à sa popularité auprès des Russes. Napoléon III avait lui aussi, en son temps, bénéficié d’appuis populaires à l’occasion de son plébiscite. La présidence Poutine a aussi été marquée par une nette amélioration du budget de l’État et par une hausse des salaires dans la première décennie des années 2000. Une partie significative de la population a pu commencer à voyager à l’étranger, à améliorer ses conditions de logement et à jouir de quelques autres bienfaits peu accessibles auparavant. C’est pour toutes ces raisons et quelques autres que le président russe peut encore compter sur l’appui d’une grande part de l’opinion publique.
Mais la guerre contre l’Ukraine risque fort de gruger son capital de sympathie. Si les manifestations prennent de l’ampleur, il pourrait ne plus apparaître, aux yeux des élites, comme la meilleure garantie de préservation de l’ordre établi, déjà terriblement menacé de l’extérieur par les sanctions et par l’isolement international. Et pour ces élites qui ont su profiter du régime, il ne saurait être question de risquer l’émergence d’un mouvement de masse. Il a été choisi en 1999-2000 pour en empêcher la possibilité, et non l’inverse. C’est la raison pour laquelle je suis persuadé qu’on est en train de réfléchir à tout cela en haut lieu.
Michel Roche est professeur de science politique à l’Université du Québec à Chicoutimi

Zelenski, d’acteur comique à personnage principal de la tragédie ukrainienne

Photo Byron Maher
« Make Russia Great Again » est l’obsession de Poutine, reconstruire la Grande Russie d’antan, et les États-Unis, l’OTAN et l’UE, avec leur politique expansionniste agressive et irresponsable, l’ont aidé à justifier une invasion qui changera le scénario géopolitique mondial.
Dans la fiction, Volodimir Zelensky a fait face à des problèmes constants de toutes sortes il y a quelques années en tant que “président” de l’Ukraine, mais il a toujours réussi à s’en sortir avec brio. Il a mené une grande croisade contre la corruption politique endémique de son pays et a même fait face à une attaque contre le Parlement avec une mitrailleuse à la main.
Maintenant, en tant que vrai président, il doit faire face à une véritable invasion territoriale de son pays par des milliers de soldats, de chars, d’avions et de navires de guerre de l’une des forces armées les plus puissantes du monde, la Russie, et en tant que commandant en chef, il mène une résistance armée tenace malgré la grande inégalité militaire.
Après des années en tant que scénariste, producteur et acteur de cinéma, Zelensky russophone, né dans le sud-est de l’Ukraine, a été de 2015 à 2019 le scénariste et principal protagoniste de la série télévisée à succès Servant of the People .
Cela a commencé précisément peu de temps après la chute et la fuite du président Viktor Ianoukovitch, également originaire de l’Est du pays, qui a fini par s’exiler en Russie.
Membre du PCUS (Parti communiste de l’Union soviétique) durant la dernière décennie de l’URSS et devenu oligarque après son atomisation et l’indépendance de l’Ukraine, Ianoukovitch est revenu en 2013 sur son accord pour entamer le processus d’association de son pays à l’Union. Européen.
Ianoukovitch a choisi d’annuler cet engagement, optant plutôt pour une relation plus étroite avec la Russie, qui a conduit à des manifestations de rue initialement spontanées de jeunes européistes, immédiatement après encouragées de manière irresponsable par l’UE et les États-Unis, et qui ont fini par être reprises par les forces politiques. des milices d’extrême droite de plus en plus violentes.
Certaines de ces milices néonazies, composées non seulement d’Ukrainiens mais aussi de Croates et d’extrême droite d’autres pays, comme Svoboda, Pravy Sector et d’autres, ont fini par s’intégrer dans les forces de sécurité régulières ukrainiennes. Aujourd’hui, ils font partie du régiment d’opérations spéciales Azov de la garde nationale ukrainienne, sous la tutelle du ministère de l’intérieur de l’Ukraine.
Poutine fait allusion à ces forces lorsqu’il dit que leur but est de dénazifier l’Ukraine, bien qu’elles n’aient pas réellement de présence réelle au sein du haut commandement des forces armées ou au sein du gouvernement.
En utilisant le fantôme du nazisme dans le pays voisin, Poutine sait qu’il parvient à provoquer la haine et la peur dans la population russe, qui a souffert plus que tout autre pays de l’horreur nazie. Vingt-cinq millions de Soviétiques sont morts sous le nazisme.
Poutine recourt de manière tordue à la mémoire historique pour présenter le gouvernement actuel de Zelensky – fils de parents juifs et petit-fils d’un membre de l’Armée rouge – comme un héritier de cette partie des Ukrainiens qui ont activement collaboré dans les années 1940 avec l’occupation hitlérienne.
Il oublie de rappeler l’autre visage de cette occupation, que de 1941 à 1944 cinq millions d’Ukrainiens sont également morts, dont près d’un tiers de Juifs. On oublie également qu’après cette période, la république d’Ukraine a continué à faire partie de l’URSS – comme elle l’avait été depuis 1922 – jusqu’à sa désintégration en 1991.
Jusqu’en 2018, Zelensky n’a agi qu’en russe à la fois dans son pays et dans plusieurs anciennes républiques soviétiques, mais les temps nouveaux, avec la russophobie qui s’est propagée dans tout l’ouest de l’Ukraine avec la guerre déclenchée contre les régions séparatistes pro-russes de l’est de Donetsk et Lougansk, ont commencé à agir en ukrainien
Avec des membres de sa société de production, Kvartal 95, il décide de transformer sa série comique Serviteur du peuple en parti politique et de se présenter comme candidat à la présidentielle pour les élections de 2019.
L’annonce a étonné la classe politique et suscité de grandes attentes dans une grande partie de l’opinion publique, mécontente du gouvernement de Petro Porochenko, l’oligarque pro-occidental —aussi corrompu que Ianoukovitch—, qui avait triomphé de ces élections irrégulières dans la convulsive 2014 après la fuite loin de ça
Zelensky a amené son personnage de télévision dans la vraie vie; l’essentiel de son programme électoral était aussi la lutte contre la corruption, comme sur le petit écran. Il a promis de lutter pour la paix et l’unité en Ukraine et a également fait un clin d’œil aux puissants oligarques sans le feu vert desquels il semblait impossible d’accéder au pouvoir dans ce pays.
Aux élections de 2019, Zelensky a balayé le terrain ; au second tour, il a remporté 73% des voix, dont pas mal du Donbass, la région orientale frontalière de la Russie, au sein de laquelle se trouvent les républiques populaires rebelles de Donetsk et de Lougansk, avec respectivement deux millions et un million et demi d’habitants.
L’acteur-président a tenu un discours modéré devant Moscou : “Nous sommes différents, mais ce n’est pas une raison pour être ennemis”.
Zelenski a déclaré qu’il ne voulait pas que son pays ne soit ni “le petit partenaire de la Russie” ni le “partenaire corrompu de l’Occident”, mais il a aussi exprimé publiquement sa volonté de préparer l’Ukraine pour qu’en 2024 elle remplisse toutes les conditions qui sont à n’importe quel pays afin de demander à la fois l’adhésion à l’UE et à l’OTAN. Ces jours-ci, il a demandé à la Commission européenne d’accélérer le processus d’admission de son pays dans l’UE.
Cette confirmation de leurs objectifs stratégiques a conduit les séparatistes de l’est du pays, soutenus économiquement, politiquement et militairement par Poutine, à abandonner toute attente d’une solution négociée au conflit ouvert.
Les provocations des deux côtés de la ligne de front ont été constantes, un filet de morts sans fin ajouté aux 14 000 survenus au cours des deux premières années de la guerre, entre 2014 et 2015.
Le cessez-le-feu a été rompu mille fois. Poutine ne voit que les attaques militaires que subissent les républiques populaires et les qualifie de “génocide”, justifiant ainsi son “opération spéciale” pour l’empêcher.
De part et d’autre, l’Ukraine, l’UE, l’OTAN et les USA d’un côté, les séparatistes de Donetsk et Lougansk et la Russie de l’autre, s’accusent mutuellement de ne pas avoir respecté les accords de Minsk (Biélorussie), mais chaque bloc compte rien de plus que les engagements que l’autre avait pris, pas les siens.
L’Ukraine n’a pas tenu l’engagement d’organiser des élections locales et d’accepter un statut spécial d’autonomie réelle pour les régions orientales rebelles, et de démilitariser ces régions.
De leur côté, les républiques rebelles et la Russie n’ont pas respecté l’engagement de retirer les armes lourdes et de respecter le fait que c’est le gouvernement ukrainien qui contrôle ces frontières extérieures avec la Russie et qu’elles sont surveillées par l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ). .
Ni l’un ni l’autre n’ont respecté la condition du maintien d’une bande démilitarisée de 15 kilomètres de chaque côté, ni la condition du retrait immédiat de leurs forces mercenaires respectives, avec la présence de milliers de soldats des deux côtés.
Les négociations de Minsk ont été menées par le Groupe de contact trilatéral sur l’Ukraine, qui comprenait à la fois des représentants de l’Ukraine, de la Russie et de l’OSCE et une représentation de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk.
Ni l’UE, ni l’OTAN, ni les États-Unis n’ont officiellement participé à ces négociations, mais ils ont néanmoins toujours été omniprésents.
Bien que pour ces républiques rebelles l’objectif fondamental de leur lutte était et continue d’être d’obtenir l’indépendance de l’Ukraine et de parvenir à une éventuelle association ou intégration avec la Fédération de Russie, ce qui est en jeu depuis des années en Ukraine va bien au-delà de ce conflit et que certains et d’autres instrumentalisent.
Les États-Unis, l’UE et l’OTAN instrumentalisent l’Ukraine afin de fermer davantage le siège de la Fédération de Russie, un siège qui a commencé à partir du moment même où l’Union soviétique a été détruite et démembrée en de nombreux morceaux.
L’Europe avait déjà abandonné des années auparavant l’idée d’une Maison commune européenne que Mikhaïl Gorbatchev proposait depuis 1985 pour tenter de créer un espace de sécurité commun exclusivement européen, sans armes de destruction massive et avec une coordination eurasienne entre la Communauté économique européenne de l’époque ( CEE) et son homologue d’Europe de l’Est, le Conseil d’entraide (COMECON) de l’URSS et des pays de l’Est sous son orbite.
L’Europe, tout le continent européen, a ainsi perdu une occasion d’essayer une autre voie, d’avancer des années et de manière moins traumatisante la fin de la guerre froide.
Nous ne saurons jamais si relever le défi à ce moment-là aurait permis ou non le début d’un véritable nouvel ordre mondial, avec une Europe non dépendante des États-Unis, et cela nous aurait permis d’éviter les guerres dans les Balkans, la Géorgie , la Moldavie et l’actuel en Ukraine.
L’analyser maintenant relève de la science-fiction.
Le COMECON a disparu après la désintégration de l’URSS tout comme le Pacte de Varsovie, l’alliance militaire de l’URSS avec les pays d’Europe de l’Est, a été démantelé, mais l’OTAN n’a pas été dissoute malgré le fait que son principal objectif initialement déclaré était de servir de confinement pour un éventuel plan soviétique hostile et expansionniste.
C’est sous l’administration Bill Clinton qu’il a été décidé non seulement de maintenir l’OTAN, mais aussi comment et quand l’étendre, mais en même temps, le secrétaire d’État américain, Warren Christopher, a averti en 1993 : « Le gouvernement russe doit éviter la tentation de reconstituer l’URSS.
Ce moment historique de la fin de la guerre froide et de la disparition de l’une des deux superpuissances mondiales n’a pas été mis à profit pour créer un nouvel ordre mondial consensuel, bien au contraire. La faiblesse économique, politique et militaire de la Fédération de Russie après la dissolution de l’URSS a été utilisée.
Malgré les débats au sein de l’OTAN sur son avenir — qui comportaient même la possibilité de proposer l’adhésion à la Russie —, les États-Unis ont réussi à imposer leurs critères : l’OTAN doit être élargie et renforcée.
Malgré les protestations de la Russie, en quelques années et par lots différents, plusieurs pays ont été invités à adhérer, principalement ceux qui avaient précédemment adhéré au Pacte de Varsovie.
C’est ainsi qu’en 1999 la Pologne, la République tchèque et la Hongrie ont adhéré, auxquelles ont adhéré en 2004 l’Estonie, la Lituanie, l’Estonie, la Bulgarie, la Slovénie, la Slovaquie et la Roumanie ; en 2009, l’Albanie et la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et la Macédoine du Nord étant toujours candidates.
La Serbie, la Finlande et la Suède débattent toujours en interne de leur adhésion ou non. Poutine a averti ces jours-ci la Suède et la Finlande des “conséquences dures” que leur adhésion à l’OTAN entraînerait.
L’OTAN est passée de ses 12 membres initiaux en 1949 à 30 membres aujourd’hui, plus la Colombie, le seul pays d’Amérique latine qui depuis 2017 a été accepté comme “partenaire extracontinental”.
L’expansion et l’agressivité de ces élargissements successifs de l’OTAN ont de plus en plus alarmé la Russie.
Au cours des 20 dernières années, coïncidant avec les années au pouvoir de Poutine, l’OTAN a déployé une partie de son bouclier antimissile et d’importantes armes lourdes dans des bases situées dans les pays frontaliers de la Russie et membres de l’Alliance.
La Russie, pour sa part, si elle n’est pas aujourd’hui une puissance significative sur le plan économique, elle l’est sur le plan militaire. Poutine a été occupé au cours de la dernière décennie à investir massivement dans la technologie militaire – plus de 60 000 millions d’euros rien qu’en 2021 – équipant les forces armées d’un arsenal puissant qui rivalise dans plusieurs domaines avec le matériel de l’OTAN le plus avancé.
Et Poutine a non seulement réagi immédiatement à toute tentative de révolutions de couleur pro-occidentales dans les pays qu’il considère comme son “arrière-cour”, mais a également fait preuve de force militaire en Syrie et ailleurs.
Moscou, étant un pays qui a toujours réprimé brutalement les mouvements autonomistes et indépendantistes sur son propre territoire, se présente au monde comme le défenseur de la minorité russophone en Ukraine et dans d’autres pays.
La Russie, qui réprime durement toutes les oppositions politiques et médiatiques dans son pays — elle en est venue à interdire aux médias d’utiliser le terme « guerre » ou « invasion » — et persécute les minorités comme la communauté LGTBI, se pose également en défenseur des libertés démocratiques des autres pays.
L’invasion de l’Ukraine ne peut être justifiée que par ceux qui maintiennent une vision campiste, ceux qui suivent la maxime selon laquelle “l’ennemi de mon ennemi est mon ami”.
Ce sont eux qui vantent le nationalisme autoritaire néolibéral de Poutine et de sa cohorte d’oligarques russes, les présentant comme des héroïques anti-impérialistes mondiaux héritiers de la Révolution russe et des bolcheviks d’il y a un siècle.
La politique agressive et impérialiste des États-Unis et de l’OTAN et de l’UE soumise ne peut en aucun cas légitimer une autre action de nature expansionniste et impérialiste, l’invasion avec une force militaire écrasante d’un pays voisin.
Poutine a beaucoup planifié son action.
+ Il savait que poser un ultimatum aux États-Unis et à l’OTAN pour qu’ils s’engagent par écrit à ne jamais accepter l’intégration de l’Ukraine dans l’Alliance, c’était demander l’impossible. Le traité fondateur de l’OTAN, comme celui de tout organisme international, empêche d’accepter un tel chantage.
+ Il savait également que ni l’OTAN ni aucun de ses pays membres individuellement n’oseraient envoyer des troupes ou des bombardiers en Ukraine, car cela signifierait affronter les forces russes et cela équivaudrait à une déclaration de guerre à un pays doté de l’énergie nucléaire comme la Russie. Il a même menacé de “conséquences très graves” quiconque oserait venir en aide à l’Ukraine. Il a également annoncé qu’il mettait en état d’alerte les Forces de dissuasion de ses forces armées, celles chargées de contrôler et d’exploiter les armes nucléaires, n’excluant pas de les utiliser pour sentir son pays agressé.
+ Poutine savait également que peu importe la quantité d’armes que l’OTAN tentait d’envoyer en Ukraine à la dernière minute, il serait impossible pour les forces armées ukrainiennes d’arrêter une offensive de 200 000 soldats russes, avec les meilleurs chars, avions, artillerie et navires de guerre attaquant de différents flancs, aidés en outre par la Biélorussie voisine. Malgré cela, les forces de sécurité ukrainiennes et de nombreux civils font face aux troupes russes avec plus de ténacité que prévu, ce qui freine l’avancée sur Kiev.
+ Poutine savait également que les États-Unis et l’UE ne pouvaient appliquer que des sanctions économiques sévères, qui affecteraient considérablement les transactions commerciales et financières, mais limitées. Après plusieurs jours de guerre, les sanctions n’incluent même pas l’arrêt du flux de gaz et de pétrole vers l’Europe. La Russie possède d’importantes réserves d’or et compte sur le récent engagement commercial, financier et politique de la Chine pour compenser en grande partie les pertes qu’elle subira.
Poutine a beaucoup planifié tout cela et a réussi à lier les mains des États-Unis et de l’UE.
Il est vrai que lorsque cette guerre se terminera, si elle se termine bientôt et sans franchir les frontières de l’Ukraine, ce qui est encore trop tôt pour le dire, tout le scénario géopolitique aura changé.
Désormais, les pays membres de l’Otan accepteront probablement de plus en plus l’idée d’augmenter leurs budgets de défense – l’Allemagne l’a déjà annoncé – et leur contribution à l’Alliance, comme les États-Unis le réclament depuis des années.
Il est également prévisible que les pays limitrophes de la Russie accepteront d’héberger davantage de bases militaires de l’OTAN ; des plates-formes de missiles à courte et moyenne portée et de l’artillerie lourde pour empêcher de nouvelles actions russes hostiles.
L’OTAN pourrait renforcer son unité interne face à cette nouvelle situation, et les débats au sein de l’UE sur la nécessité de se doter d’un système de défense européen propre, moins dépendant des États-Unis, pourraient être mis de côté avant la mise à jour du système russe danger et considèrent comme plus nécessaire que jamais le renforcement de l’alliance avec les États-Unis pour pouvoir arrêter une puissance nucléaire comme la Russie.
Tous ces changements qui montreraient hypothétiquement que la Russie deviendrait un paria mondial après son invasion de l’Ukraine ont cependant aussi une autre facette.
Si Poutine finit par mettre l’Ukraine à genoux et que Zelensky – ou le Parlement s’il est finalement renversé – accepte de signer une sorte de traité s’engageant à ne jamais demander à rejoindre l’OTAN, il aura remporté une victoire majeure.
Il aura trouvé le moyen de réaliser ce qui était proposé depuis le début et qu’il a exigé des États-Unis et de l’OTAN et qu’il n’a pas réussi à obtenir.
Si, en plus de cette guerre, il parvenait à consolider l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et à les annexer ensuite à la Russie, ou du moins à former un corridor les reliant à la péninsule de Crimée, la victoire serait encore plus large et lui gagnerait également le soutien de la population russe, comme elle l’a obtenu en annexant la Crimée.
Poutine aurait obtenu avec cette dangereuse aventure militaire, au prix de cette tragédie, de cette horreur que vivent des millions d’Ukrainiens, la reconnaissance de la Russie comme un acteur de premier plan sur la scène mondiale, qui ne peut plus être ignoré ni acculé.
Cela satisferait son rêve de Grande Russie. Poutine, comme Trump, ne cache pas qu’il veut aussi rendre “la Russie grande à nouveau”.

Biden propose des dépenses militaires massives, pour le plus grand plaisir des entrepreneurs privés

Des soldats tirent sur le char M1A2 SEPv3 de l’armée américaine à Fort Hood, au Texas, le 18 août 2020. (Sergent Calab Franklin / US Army via Flickr)
Pour la deuxième année consécutive, Joe Biden prévoit d’augmenter le budget militaire. La demande de budget pour l’exercice 2023 que Biden enverra au Congrès ce mois-ci proposerait plus de 800 milliards de dollars de dépenses militaires ; 773 milliards de dollars pour le ministère de la Défense (Department of Defense (DOD)) et la plupart du reste pour les programmes d’armes nucléaires du ministère de l’Énergie. À l’exception de l’étendue des budgets militaires entre 2007 et 2011 qui a parrainé des augmentations consécutives de troupes – d’abord en Irak puis en Afghanistan – le plan de Biden donnerait plus d’argent au Pentagone au cours de l’exercice 2023 que n’importe quelle année depuis la Seconde Guerre mondiale.
Un budget massif du Pentagone implique une redistribution massive des richesses, et les premiers bénéficiaires ne sont pas « nos troupes » comme aiment à le dire les politiciens américains. Au lieu de cela, la majeure partie du budget du DOD va à des entreprises à but lucratif : 55 % des 14,5 billions de dollars que le Congrès a donnés au Pentagone entre l’exercice 2002 et l’exercice 2021 ont fini par aller à des entreprises du secteur privé par le biais de contrats.
La part des dépenses annuelles du DOD liées aux contrats a peu varié au cours de cette période de vingt ans; les valeurs des contrats ont largement augmenté et diminué en même temps que les budgets globaux. Le montant du financement fédéral qu’un budget du Pentagone donné peut s’attendre à privatiser peut alors plus ou moins être déduit de son chiffre principal. Cela signifie qu’une proposition de budget du DOD de 773 milliards de dollars – comme Biden le proposerait – est essentiellement une proposition de privatisation de 425 milliards de dollars de fonds publics.

Cela n’augure rien de bon pour les programmes sociaux du budget de l’exercice 2023. Le projet de loi de dépenses du DOD – bien qu’il ne soit qu’un des douze projets de loi de crédits qui composent le budget discrétionnaire fédéral – consomme généralement environ la moitié de tous les financements discrétionnaires. La première demande de budget de Biden ressemblait à ceci. Cependant, une différence clé est qu’il a été proposé peu de temps après l’ adoption du plan de sauvetage américain au Congrès et avant l’ effondrement du plan présidentiel de plusieurs milliards de dollars pour le climat, les infrastructures et la santé.
En d’autres termes, la proposition de Biden pour l’exercice 2023 ressemblera probablement au budget typique de la pandémie pré-COVID où les dépenses de «sécurité nationale» évincent les dépenses sociales. Ce n’était pas censé arriver. Même des personnalités emblématiques de l’establishment comme Hillary Clinton ont fait valoir que la pandémie entraînerait un « examen de la sécurité nationale » où les menaces non militaires seraient finalement prises aussi au sérieux que les menaces militaires – de nouvelles priorités qui seraient reflétées dans les futurs budgets.
Le président a semblé de plus en plus désintéressé par cela. Biden a fait tout son possible pour stigmatiser les dépenses sociales mais pas les dépenses militaires, même lorsque ces dernières auraient été une cible plus appropriée. Par exemple, Biden a blâmé les chèques de relance de 1 400 $ pour avoir provoqué l’inflation, même si le coût total de la provision ( 391 milliards de dollars ) était inférieur au montant que les premier et deuxième budgets militaires de Biden détourneront probablement vers des entrepreneurs militaires à but lucratif ( 405 milliards de dollars et 425 milliards de dollars, respectivement).
De plus, il existe de nombreuses preuves que la production des dépenses sociales – comme les chèques de relance – réduit les difficultés et renforce la sécurité, contrairement aux dépenses militaires. Le budget du Pentagone donne vie à une architecture impériale qui comprend 750 installations militaires à l’étranger et des opérations antiterroristes actives dans au moins quatre-vingt-cinq pays . Grâce à ses budgets et à sa politique déclarée, Biden a déjà établi qu’il ne prévoyait pas d’apporter de changements substantiels à l’empreinte mondiale de l’armée américaine, malgré des preuves empiriques indiquant que cette posture favorise l’ insécurité . Des études ont montré que le stationnement du personnel militaire américain à l’étranger augmentela probabilité d’attentats terroristes contre les États-Unis; que les États subissent davantage de terrorisme après avoir mené des interventions militaires ; et que les bases à l’étranger exacerbent souvent les tensions géopolitiques.
L’establishment de la politique étrangère décrit souvent les dépenses militaires en utilisant des expressions proches de « l’investissement dans notre sécurité nationale », comme si le simple fait de financer le Pentagone produisait d’une manière ou d’une autre la sécurité en tant que résultat politique. Biden s’appuiera probablement sur cette hypothèse – que plus de dépenses militaires signifie plus de sécurité – pour justifier sa demande de financement gargantuesque pour l’exercice 2023 au Pentagone.
Un récent sondage suggère que la plupart des Américains rejettent ce cadrage. Le Congrès devrait aussi.
Traduction NCS
Stephen Semler est cofondateur du Security Policy Reform Institute, un groupe de réflexion américain sur la politique étrangère financé par la base.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.













