Derniers articles

Pour un réaménagement du secteur Littoral Est respectueux de l’environnement, de la population locale et de leur sécurité.

Récemment, nous avons reçu une invitation de la Table citoyenne du Littoral Est (TCLE) à intervenir dans le cadre d'un « concours d'idéation » lançée par le gouvernement du Québec en novembre dernier. Ce concours conduira à des propositions sur l'avenir du secteur situé entre le secteur D'Estimauville et la chute Montmorency. Le collectif La ville que nous voulons transmet donc ses commentaires à la Commission de la Capitale nationale qui se charge de receuillir les commentaires des citoyennes et des citoyens.
Les orientations défendues par La ville que nous voulons
Le collectif La ville que nous voulons a adopté des orientations sur des enjeux que touche le réaménagement du secteur Littoral Est.
Nos propositions s'inscrivent nottamment dans le contexte mondial de la menace actuelle du réchauffement climatique qui nous a donné de nombreux événements destructeurs dans le monde au cours des dernières années, et le Québec n'a pas été épargné.
Par ailleurs, un autre enjeu majeur à notre époque est celui de la justice sociale et économique. Les situations d'injustice sociale et économique, donc d'inégalités, sont loin d'être inexistantes à Québec ; pauvreté, chômage, bas salaires, itinérances sont des réalités que la Ville doit prendre en considération plus sérieusement. Nous nous attendons à ce que le projet d'aménagement du Littoral est tienne compte des inégalités sociales et économiques afin de garantir l'accès à toutes et tous à l'ensemble du secteur.
L'habitation est l'un des droits fondamentaux tel qu'affirmé dans la Déclaration universelle des droits humains ; chaque individu doit avoir accès à un logement décent et accessible économiquement. Nous nous attendons à ce que ce droit fondamental soit respecté en donnant suite aux recommandations de la TCLE.
Nous souhaitons des aménagements accessibles et conviviaux d'une ville à échelle humaine. Depuis longtemps l'aménagement urbain à Québec est principalement influencé par les promoteurs immobiliers avec des projets d'habitation qui, très souvent, ne favorisent pas les relations sociales, qui témoignent d'une approche sans lien avec un aménagement urbain convivial et d'une vision du transport privilégiant l'automobile laissant de côté les piétons. Il suffit de circuler dans les secteurs de certains arrondissements, dont Lebourgneuf est un bel exemple, où des immeubles ont été construits récemment, ou sont en construction à l'heure actuelle, pour constater la distance qui sépare l'aménagement actuel de ce qu'il faut pour vivre dans une ville à échelle humaine.
Nous avons intérêt à remettre en question ces manières de voir et de faire afin que la ville soit aménagée au profit des citoyennes et citoyens dans le but de procurer des espaces utiles, conviviaux, sécuritaires et contribuant à la santé des humains que nous sommes ainsi que de l'environnement.
Nous avons besoin d'espaces publics aménagés à proximité des citoyennes et des citoyens, de telle sorte qu'ils favorisent les rapports humains et sociaux ; c'est essentiel pour que se développe la solidarité et l'acceptation sociale de toutes les différences qui composent notre société.
Il ne faut pas oublier que les aménagements urbains ont un impact sur la santé. Il est bien connu que la pollution de l'air provoque ou aggrave les maladies respiratoires. Pensons aussi à la pollution par le bruit et la lumière dans certains secteurs de la ville, particulièrement au centre-ville et aux centres de plusieurs arrondissements sans oublier les problèmes de stress et d'angoisse que peuvent susciter des aménagements d'abord conçus pour des motifs de rentabilité commerciale et financière. Nous devons concevoir la ville autrement.
Nous considérons que les propositions de la Table citoyenne du littoral Est vont dans le sens de nos positions et de nos espoirs.
Appuis aux propositions de la Table citoyenne du Littoral Est
Nous tenons donc à appuyer plus particulièrement les propositions suivantes :
1. Convertir l'entièreté de l'autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain. Cette conversion doit être pensée en gardant à l'esprit la présence voisine d'une artère principale, le boulevard Sainte-Anne, qui a lui aussi besoin d'être revitalisé de façon importante.
2. Rendre à la nature une partie significative du littoral est en déminéralisant un fort pourcentage du territoire adjacent. Les battures de Beauport constituent un milieu écologique d'une richesse exceptionnelle dont une part importante a été détruite par les remblaiements successifs au fil des cent dernières années ; il faut inverser cette tendance.
3. Aménager un parc linéaire sur toute la longueur du littoral est pour créer un vaste corridor de biodiversité reliant entre eux les parcs de la rivière Saint-Charles, du domaine de Maizerets et de l'arboretum, de la rivière Beauport, de la rivière et de la chute Montmorency. Outre les pistes cyclables et les sentiers pédestres, ce parc linéaire devrait comporter des zones de forêt urbaine, notamment sur le site de l'ancien dépôt à neige D'Estimauville, ainsi que des aires de jeux, de baignade, de pêche et de chasse en saison, de repos et de contemplation permettant de côtoyer le fleuve.
4. Prioriser l'aménagement de la portion située entre l'avenue D'Estimauville et le boulevard François-De Laval. C'est le territoire comportant le tronçon le plus dangereux de l'autoroute, mais il recèle aussi un potentiel important de renaturalisation et de mise en valeur des écosystèmes présents.
5. Ouvrir un accès direct vers le secteur de la plage de la baie de Beauport via l'avenue D'Estimauville pour deux principales raisons :
– fournir un accès plus direct aux installations récréotouristiques de la baie de Beauport, tout en créant un lien avec l'arboretum, le domaine de Maizerets et les quartiers résidentiels avoisinants ;
– résoudre un important enjeu de sécurité civile en fournissant un second accès à la péninsule Beauport du Port de Québec pour les secours externes en cas d'incendie ou d'autres incidents. Rappelons que ce secteur abrite un grand nombre de réservoirs de produits pétroliers et autres matières dangereuses. L'expérience vécue lors d'un incendie en 2007 a démontré que le seul accès actuel via le boulevard Henri-Bourassa ne peut garantir un accès sécuritaire en cas d'urgence.
6. Décloisonner et rendre l'accès à la plage de la baie de Beauport gratuit en tout temps et appliquer ce principe de gratuité et d'accès universel dans tous les aménagements de la phase IV de la promenade.
7. Prendre les mesures nécessaires pour éviter l'embourgeoisement des quartiers du littoral est. Il faut que les populations habitant ces quartiers puissent continuer d'y vivre à des coûts abordables en mettant un frein à l'appétit des spéculateurs. Cela implique l'acquisition, par la ville et avec l'aide des gouvernements supérieurs, d'un grand nombre de terrains et de bâtiments qui seront consacrés à la création de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif dans le secteur de l'habitation, à des coopératives d'habitation ou à d'autres initiatives permettant de mettre une part importante du parc de logements à l'abri du marché spéculatif.
Collectif La ville que nous voulons
villequenousvoulons@reseauforum.or
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Kollontaï et Lénine : pour un communisme qui libère les femmes

Les deux penseurs bolcheviques n'étaient pas d'accord, et pas qu'un peu. Mais leurs idéaux communs étaient encore plus importants.
À l'occasion du centenaire de la mort de Lénine, il convient d'examiner le rôle qu'il a joué dans les premiers débats socialistes, dont beaucoup sont encore repris aujourd'hui dans les discussions de la gauche. Ses désaccords avec l'idéologue bolchevique, diplomate et écrivaine Alexandra Kollontaï sont particulièrement révélateurs de sa pensée.
Revue L'Anticapitaliste - 152 (Janvier 2024)
27 janvier 2024
Par Liza Featherstone
Crédit Photo
Alexandra Kollontaï à la droite de Lénine lors d'une session du conseil des commissaires du peuple entre décembre 1917 et janvier 1918. Wikimedia Commons
Les deux dirigeants communistes ont entretenu une profonde camaraderie, bien qu'elle ait été marquée par des conflits et des désaccords sur de nombreuses questions. Certaines de ces discussions ont conduit à des dissensions politiques et personnelles profondes et durables. Cependant, leurs points d'accord peuvent être encore plus pertinents pour les socialistes d'aujourd'hui. Plus important encore, Kollontaï et Lénine étaient d'accord sur le caractère central de la libération des femmes pour le communisme et ont travaillé ensemble à la réalisation de ces idéaux.
Une rencontre déterminante
Née dans l'aristocratie, Alexandra Kollontaï est devenue l'une des plus importantes transfuges de classe de l'histoire après une visite dans une usine au cours de laquelle elle a vu les conditions terribles et dangereuses imposées aux travailleuses et a constaté qu'un enfant était mort dans la « pouponnière » de l'usine, sous la garde d'une « nounou » âgée de six ans. Elle écrit plus tard à propos de cette expérience : « J'ai compris au fond de mon cœur que nous ne pouvons pas vivre comme nous l'avons fait jusqu'à présent, alors qu'il existe autour de nous des conditions de vie aussi terribles et un ordre aussi inhumain ». Ailleurs, elle note : « Les femmes et leur sort m'ont occupée toute ma vie et le souci de leur sort m'a conduite au socialisme ».
Dans les années qui ont précédé la révolution russe, Kollontaï s'est imposée non seulement en tant que défenseuse des femmes travailleuses, mais aussi comme organisatrice, oratrice et penseuse. Contre les féministes bourgeoises qui prétendaient lutter pour l'égalité entre hommes et femmes au sein du système capitaliste, elle soutenait que seul le mouvement communiste des femmes, dirigé par la classe ouvrière, pouvait parvenir à l'égalité sociale. « En se battant pour changer les conditions de vie », écrit-elle à propos des travailleuses qui font grève et s'organisent dans les rues de Russie pour provoquer la révolution, « elles savent qu'elles contribuent également à transformer les relations entre les sexes ».
Pourtant Kollontaï savait que l'égalité des femmes ne viendrait pas automatiquement avec la dissolution du capitalisme, et elle a donc travaillé à la construction d'un communisme spécifiquement attentif à la libération des femmes, combattant parfois les communistes qui ne partageaient pas cet objectif.
Lénine n'était pas l'un de ces communistes patriarcaux. Il était tout à fait d'accord avec Kollontaï pour dire que les travailleuses étaient au cœur de la révolution communiste et qu'elles avaient des préoccupations spécifiques auxquelles seul le communisme pouvait répondre. En plus d'être exploitées par les patrons capitalistes, écrivait Lénine, les femmes étaient « esclaves de la chambre à coucher, de la crèche et de la cuisine ». Il était convaincu que le communisme libérerait les femmes de la subordination patriarcale et de la monotonie des tâches ménagères, et soutenait que ces dernières constituaient un gaspillage du précieux travail des femmes et contribuaient à leur oppression au sein du foyer, qu'il qualifiait d'« esclavage domestique ».
Lénine a été profondément influencé par les femmes communistes qui l'entouraient, et Kollontaï a souvent fait partie de ce cercle. Lénine a soutenu le droit à l'avortement, à la contraception et au divorce, un point particulièrement controversé parmi les socialistes, certains d'entre eux affirmant qu'à court terme cela entraînerait la misère pour les femmes et les enfants parce qu'elles seraient trop pauvres pour survivre sans les hommes. Tout en reconnaissant le problème, Lénine a insisté sur le fait que tant que les femmes ne pouvaient pas prendre de décisions concernant leur propre vie, elles ne jouiraient pas de tous les droits démocratiques.
Kollontaï et lui, ainsi que leur camarade allemande Clara Zetkin, ont joué un rôle déterminant dans la création de la Journée internationale des femmes, qui est toujours célébrée aujourd'hui (bien qu'elle jouisse d'une cooptation capitaliste considérable). Sous l'influence de Kollontaï, Lénine a écrit : « Si nous n'attirons pas les femmes dans l'activité publique, dans la milice, dans la vie politique – si nous ne les arrachons pas à l'atmosphère mortelle de la maison et de la cuisine – il sera impossible d'assurer une véritable liberté. Il sera impossible d'assurer la démocratie, sans parler du socialisme ». En effet, l'organisation des travailleuses – profondément exploitées au travail et épuisées par leur deuxième journée de travail, à la maison – a été cruciale pour le succès de la révolution bolchevique.
Il ne s'agissait pas seulement d'un accord philosophique entre les deux penseurs, mais d'un engagement institutionnel profond : après la révolution, Lénine a nommé Kollontaï Commissaire du peuple à l'Assistance publique [équivalent du ministère de la Santé, NdlR], poste dans lequel elle a contribué à légaliser l'avortement, le divorce et le contrôle des naissances. L'égalité salariale pour les femmes et les congés payés pour les nouvelles mères ont également été introduits, tandis que le mariage religieux a été remplacé par le mariage civil. Le travail sexuel est dépénalisé et le statut légal d'« illégitimité » pour les enfants de parents non mariéEs est aboli.
Kollontaï a également créé des maternités gérées par le gouvernement, où les mères pouvaient se reposer avec leur bébé après l'accouchement. L'allaitement maternel a été soutenu par une série de politiques gouvernementales, et des cuisines et des blanchisseries communes ont été créées pour soulager les femmes actives des tâches domestiques (ces initiatives n'ont pas eu beaucoup de succès, car faute d'un financement suffisant, la qualité des services s'est dégradée : la nourriture était mauvaise et les vêtements souvent déchirés dans les blanchisseries).
Au cours de cette période prometteuse, l'Union soviétique a également promulgué le droit de vote pour les femmes, quelques années avant les États-Unis. En 1919, Kollontaï et Inès Armand – une autre camarade proche de Lénine – créent le Jenotdel, un département spécial consacré aux besoins des femmes en lien avec la direction du Parti bolchévique.
Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes !
De manière moins pragmatique mais tout aussi cruciale pour l'histoire de la pensée anti-impérialiste, les deux militantEs étaient également uniEs dans la dénonciation de la Première Guerre mondiale. Alors que les socialistes européens s'alignaient sur la position de leurs gouvernements en faveur de cette effusion de sang stupidement tragique, Lénine et Kollontaï – souvent adversaires politiques dans les années précédant la révolution d'Octobre – étaient uniEs dans leur opposition à la fois à la guerre impérialiste et aux raisons qui la justifiaient.
Kollontaï a fait partie des mencheviks jusqu'en 1914, date à laquelle elle a rejoint les bolcheviks en raison de la position résolument anti-guerre de ces derniers. En 1916, elle écrit que la cause de la guerre est le capitalisme et affirme que les travailleurEs du monde entier devraient s'unir contre la classe dirigeante au lieu de s'entretuer. « Mon ennemi est dans mon propre pays », déclarait-elle, « et cela s'applique à tous les travailleurs du monde ». Lénine et elle collaborent étroitement à la rédaction d'essais et de déclarations de ce type, tentant de rallier les partis socialistes d'autres pays à cette position anti-guerre.
Les discussions entre Kollontaï et Lénine sur la manière de formuler l'opposition communiste à la guerre ont conduit Lénine à faire des distinctions importantes, rejetant ce qu'il appelle le pacifisme « petit-bourgeois » et « provincial » qui condamne « la guerre en général ». Comme il l'explique dans une lettre de 1915 à Kollontaï, dans laquelle il peaufine une déclaration marxiste internationale de gauche opposée à la Première Guerre mondiale en vue de sa présentation à la première conférence socialiste internationale : « Ce n'est pas marxiste... Je pense qu'il est erroné en théorie et nuisible en pratique de ne pas faire de distinction entre les différents types de guerres. Nous ne pouvons pas être contre les guerres de libération nationale » (par exemple, les luttes anticolonialistes de pays comme l'Inde pour se libérer de la domination britannique). Kollontaï n'était pas non plus une pacifiste et demandait instamment : « Tournons nos fusils et nos pistolets contre nos véritables ennemis communs », c'est-à-dire les capitalistes. Plus tard, les communistes transformeront cette idée en un slogan lapidaire : « Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes ! »
Divergences
Cependant, les deux penseurSEs ont eu aussi des divergences cruciales. Quelques années après la révolution, Kollontaï rejoint la tendance dite de l'Opposition ouvrière, qui critique la bureaucratie du parti et s'inquiète du fait que les travailleurEs ne sont plus représentéEs. Dans un pamphlet publié en 1921, elle plaide en faveur d'un renforcement du pouvoir des syndicats et contre ce qu'elle considère comme le pouvoir croissant des professionnels technocrates de la classe au sein du parti et du gouvernement. L'année suivante, Lénine adopte une résolution du parti interdisant le « factionnalisme », mettant ainsi fin à l'opposition ouvrière. C'est la fin de son influence sur Lénine et les bolcheviks.
Par la suite, Kollontaï a été marginalisée au sein du gouvernement et du Parti communiste, bien qu'elle ait eu une longue carrière diplomatique en tant que loyale représentante de l'Union soviétique en Norvège, au Mexique et en Suède. Après la marginalisation de Kollontaï, les dirigeants soviétiques se sont beaucoup moins engagés en faveur de l'égalité des femmes, tant par le manque de moyens attribués à cette cause que par la persistance d'attitudes patriarcales, à tel point que, après la mort de Lénine, Staline a dissous le Jenotdel et interdit à nouveau l'avortement (1).
Kollontaï et Lénine n'étaient pas non plus d'accord sur la morale sexuelle : alors que la première affirmait souvent que le communisme conduirait à un type d'amour différent et moins possessif entre les hommes et les femmes, ainsi qu'à une éthique sexuelle plus moderne, le second considérait que de telles idées étaient libertines et frivoles. Kollontaï n'était pas la seule femme proche de Lénine à ne pas être d'accord avec lui sur ces questions, puisqu'il s'est également opposé à Inès Armand et Clara Zetkin.
Compte tenu de son soutien au droit à l'avortement et même à la dépénalisation du travail sexuel, on ne peut pas dire que Lénine était socialement conservateur, mais il était parfois irrité par le radicalisme des femmes de son entourage. Et il n'était pas le seul : les idées de Kollontaï sur la moralité sexuelle étaient souvent moquées par des camarades communistes socialement très conservateurs, parfois en termes grossiers et sexistes. Comme l'a écrit Sheila Robowtham en 1971, les idées de Kollontaï sur l'amour libre étaient également parfois critiquées par les femmes de la classe ouvrière, étant donné que la contraception n'était pas répandue : « les paysannes savent très bien », plaisantait Robowtham « que si tu veux faire de la luge, il faut être prête à grimper sur la colline » (2).
Le socialisme et la famille
Les questions qui ont divisé Kollontaï et Lénine continuent de faire l'objet de débats. Aux États-Unis, par exemple, les Socialistes démocrates d'Amérique (DSA) et d'autres organisations de gauche sont souvent critiqués parce qu'une grande partie de leurs membres et de leurs dirigeants proviennent de ce que Barbara et John Ehrenreich (3) ont appelé « la classe professionnelle et managériale » [ou classe des cadres, NDLR] plutôt que de la classe ouvrière.
Faisant écho au pamphlet de Kollontaï, « Opposition ouvrière » de 1921, nombre de ces critiques affirment que le syndicalisme de base est un espace plus solide pour l'organisation socialiste que que la participation aux élections ou la construction autour de conflits ponctuels. Mais le couple Ehrenreich lui-même a soutenu que la prolétarisation des professions – et, pourrions-nous ajouter, la difficulté croissante d'atteindre le niveau de vie de la classe moyenne en raison du coût élevé des soins de santé, du logement et de l'enseignement supérieur – crée une situation dans laquelle une partie de ce que l'on appelle la « classe des cadres professionnels » souhaite réellement le socialisme et apporte son éducation et son expertise à la cause (quant au syndicalisme par rapport à l'électoralisme, les deux sont cruciaux, et il n'est pas utile de pousser aux élections : ces dernières années, les socialistes ont remporté des victoires en utilisant les deux tactiques).
La morale sexuelle peut également être un facteur de division parmi les socialistes. Alors que plus personne ne conteste que l'« amour libre » devrait être une composante de la société communiste – tant le tabou que l'éthique exubérante de la libération sexuelle sont obsolètes –, l'abolitionnisme familial fait un petit retour en force parmi les intellectuelLEs marxistes. Si certainEs accueillent favorablement le socialisme comme un moyen de renforcer la famille nucléaire, en donnant aux gens plus de temps hors de l'esclavage salarié pour élever leurs enfants et en leur permettant l'accès à des garderies et à des universités gratuites, d'autres préfèrent se réjouir du projet socialiste d'affranchissement des relations obligatoires, qui nous permet de survivre économiquement hors du mariage ou de la famille nucléaire.
En effet, le socialisme vise à améliorer la vie intime des gens de diverses manières, qui n'entrent pas nécessairement en conflit. Personnellement, je préfère opter pour la notion d'« expansionnisme familial » portée par Kristen Ghodsee (4), basée sur les idées de Kollontaï sur la collectivisation des tâches familiales, un concept qui laisse ouvert l'horizon politique quant à la manière dont les gens pourraient choisir d'organiser leur vie privée s'ils et elles disposaient d'une plus grande liberté économique.
Kollontaï elle-même, comme Engels avant elle et Simone de Beauvoir après elle, ne tranchait pas la question de savoir si la famille devrait disparaître ou non, mais elle avait la certitude – et elle insistait sur ce point – qu'elle serait transformée au terme d'une série de changements profonds dans la structure sociale et les conditions matérielles d'existence. Grâce à l'amélioration des conditions de vie des femmes, faisait-elle valoir, la vie familiale serait transformée, et cela pour le meilleur.
Aujourd'hui, la question de l'abolition de la famille ne représente plus qu'un clivage purement théorique, car touTEs les socialistes s'accordent sur le fait que les parents ont besoin de plus d'aides, et que les garderies devraient être gratuites, par exemple. Mais certaines questions sociales aujourd'hui continuent de diviser les socialistes. Au Mexique, par exemple, le président Lopez Obrador a adopté de nombreuses politiques économiques de gauche tout en développant une rhétorique anti-gay ou anti-transgenre, et il en va de même pour les dirigeants chinois. Tandis que dans les cercles intellectuels anglo-saxons, il y a des conservateurs sociaux hostiles aux droits des personnes transgenres qui ont adopté des idées économiques sociales-démocrates.
Cependant, une grande partie de la gauche mondiale soutient à juste titre les droits, la sécurité et les libertés des minorités sexuelles, à la fois par solidarité et dans le cadre d'une vision anti-patriarcale qui peut être considérée comme une continuation de l'héritage de Kollontaï et qui est probablement en contradiction avec la perspective plus conservatrice de Lénine.
L'actualité
Bien que leurs désaccords résonnent encore aujourd'hui, les moments de convergence entre Lénine et Kollontaï sont d'autant plus importants à mettre en avant que la guerre et la situation des femmes sont des préoccupations profondément ancrées dans l'actualité.
Avec le retour du fascisme patriarcal dans le monde et l'absence totale de réponses offertes par les partis centristes, il est utile de rappeler l'engagement commun de Lénine et de Kollontaï en faveur des droits des femmes, du droit à l'avortement au congé de maternité rémunéré. Ravivons aussi le souvenir de leur opposition commune à la guerre impériale, une position qui, si elle reste forte dans les pays du Sud, a été considérablement affaiblie aux États-Unis et en Europe au cours des dernières années.
Une réflexion sur ces deux penseurSEs communistes devrait nous inciter à remettre l'égalité des sexes et l'anti-impérialisme au centre de la pensée de gauche. Les questions sur lesquelles Lénine et Kollontaï étaient en désaccord sont intéressantes mais sans grande importance aujourd'hui : les socialistes, nous marquons vraiment l'histoire quand nous sommes capables de trouver des terrains communs. Bien que Lénine et Kollontaï n'aient pas créé un communisme qui ait véritablement émancipé les femmes, il et elle ont mis en œuvre de nombreuses politiques progressistes qui ont changé la vie des femmes soviétiques et qui, comme l'a expliqué Kristen Ghodsee, ont fait pression sur les gouvernements capitalistes du monde entier pour qu'ils fassent de même.
En mars 1917, quelques mois avant la révolution, Lénine écrit à Kollontaï une lettre chaleureuse et enthousiaste, pleine de promesses sur le monde qu'il et elle sont en train de construire ensemble. Il utilise des termes respectueux, mais aussi très élogieux – « Votre » et « Tous mes vœux » – et même une exclamation : « Je vous souhaite tout le succès possible ». À l'époque, Lénine réfléchissait au pouvoir qui était en train de se construire au sein de la classe ouvrière pour gagner « le pain, la paix et la liberté ». Aujourd'hui, cela ravive pour nous la puissance d'une camaraderie et d'idéaux dont le monde a encore désespérément besoin.
1. Interdit en 1936, l'avortement fut réautorisé en 1955 en URSS.
2. Sheila Rowbotham (1943) est une historienne anglaise socialiste et féministe.
3. Barbara Ehrenreich (1941-2022) était, entre autres, une figure importante des DSA. Scientifique, journaliste, auteure et femme politique, elle a écrit de nombreux essais avec son ex-mari John Ehrenreich, un psychologue clinicien et critique social américain.
4. Kristen Ghodsee (1970) est une ethnographe américaine.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Défaite syndicale sans victoire patronale faute d’unité et d’aile gauche

Côté éducation, les négociations du secteur public semblent terminées avec l'acceptation à la base de leur convention tant par le Front commun que par la FAE. Elles sont à demi achevées du côté du secteur santé en l'absence d'accord de principe avec la FIQ, syndiquant la grande majorité des infirmières, qui négocie isolée loin de l'attention médiatique et, semble-t-il, de toute perspective de mobilisation. Rappelons que le secteur santé, contrairement à celui des l'éducation, est cadenassé par la loi des services essentiels qui a mené au maintien de 70% à 100% des services de ce secteur. On en déduit qu'en l'absence de mise au défi de cette loi, ce qui entrainerait inévitablement une loi spéciale et puis Dieu-sait-quoi, la relative inefficacité de la grève dans la santé a fait du secteur de l'éducation le fer de lance du rapport de forces du secteur public.
Le vote du syndicat enseignant FSE-CSQ de l'Estrie centré sur Sherbrooke, le premier à se prononcer pour cette centrale membre du Front commun, illustrait l'état d'esprit de la base syndicale vis-à-vis l'entente conclue pour le secteur de l'enseignement. L'accord salarial a réuni 88% en faveur pendant que celle sectorielle, sur les conditions de travail dont la « composition de la classe » est le noyau, avec 50.5% franchissait à peine la ligne fatidique. Le parallèle de 50.6% avec le syndicat FAE de la région de Granby, le dernier à voter de cette centrale hors Front commun, est frappant. Est-ce la réalité de conditions d'enseignement plus difficiles dans ces deux villes industrielles de taille moyenne où le revenu total moyen est de 10% plus bas que la moyenne québécoise ? Ces milieux urbains du même type sont en grande partie la réalité de tous les syndicats de la FAE ce à quoi il faut ajouter le défi linguistique de Montréal. Comme le soulignait un militant FAE contestataire à Radio- Canada, l'école publique a des « besoins criants » qui requièrent des « investissements massifs » qui n'ont pas été au rendez-vous.
Pourtant, la détermination syndicale a d'abord été visible par des votes de grève à taux élevé puis par l'ampleur et la longueur de la grève : « Selon le Front commun, [le 23 novembre a été] la plus importante journée de grève de l'histoire du Québec, du Canada et même de l'Amérique du Nord (depuis la grève d'AT&T en 1983) [et au total] la plus longue grève du secteur public depuis 50 ans ». Faut-il rappeler l'ardeur de la grève de la FAE jusqu'à et y compris un blocage du Port de Montréal et de Québec ? Faut-il rappeler le soutien financier, de plusieurs syndicats du privé ? Quant à l'employeur gouvernemental, il était dans une mauvaise posture tant économique que politique. Le gouvernement de la CAQ faisait face à une pénurie de main-d'œuvre corroborée par un relativement haut taux d'emploi tel que jaugé depuis l'an 2000. La dégringolade dans les sondages confirmée par l'élection partielle de Jean-Talon en octobre dernier a réduit à néant le lustre charismatique du Premier ministre tant et si bien que l'appui populaire aux grévistes ne s'est jamais démenti… mais n'a jamais été organisé proactivement.
Salaire peut-être supérieur à l'inflation et composition de la classe restant catastrophique
Ce rapport de force d'emblée très favorable au grévistes, conjugué au ralentissement économique, a obligé la CAQ à remettre en question tant soit peu son cadre financier dont l'écart aux prévisions sera connu lors du dévoilement du budget ce printemps. L'augmentation salariale de 17,4 à 24,5 %, selon l'échelon, pour le corps enseignant pourra peut-être dépasser le taux d'inflation surtout en tenant compte des avancées d'échelons qui n'ont de nouveau que l'attention médiatique qui leur est portée. N'en reste pas moins que sans clause d'indexation régulée, ces gains apparemment avantageux, en plus de devoir compenser le recul du pouvoir d'achat dû à l'importante inflation des années 2021 à 2023, pourraient bien être balayés par une inflation future qui ne reviendra pas au 2% annuel en particulier pour le logement et l'alimentation qui sont au centre du budget des ménages travailleurs.
Ajoutons-y la haute probabilité de phénomènes météo extrêmes, des grandes chaleurs et des perturbations des chaînes d'approvisionnement due aux conflits géopolitiques qui pourraient changer la donne. En ce moment, ni le canal de Panama ni celui de Suez n'opèrent à plaine capacité par suite de la grande sécheresse en Amérique du Sud et de la guerre de Gaza. De constater The Economist (World in Brief, 27/01/24) sous le titre de « [l]'inflation alimentaire et la crise climatique »,
[a]u cours de l'année écoulée, les prix de nombreux produits alimentaires de base, enflammés par la guerre en Ukraine pendant une grande partie de l'année 2022, se sont calmés. En revanche, les "produits raffinés" sont de moins en moins abordables. Les prix du sucre ont augmenté de 150 % depuis 2020. Les prix de l'huile d'olive et du cacao ont atteint des sommets sur plusieurs décennies. Même le jus d'orange est devenu brûlant.
El Niño, un phénomène météorologique mondial, a provoqué des sécheresses en Australie, en Inde et en Thaïlande, trois grands exportateurs de sucre, tandis que des pluies ont inondé le Brésil, le plus grand exportateur. Une série de maladies, exacerbées par une forte humidité, a décimé les récoltes au Ghana et en Côte d'Ivoire, les deux plus grands producteurs de cacao. Malgré cela, les producteurs de cacao d'Afrique de l'Ouest vendent leur récolte à un prix fixé par le gouvernement, ce qui les dissuade de planter davantage. Entre-temps, les vagues de chaleur ont étouffé les olives d'Espagne et les oranges de Floride.
N'oublions pas, non plus, que les négociations de la table centrale, concernant aussi la question des pensions, n'ont en rien allégé la paupérisation des personnes retraitées du secteur public. Celles-ci « s'appauvrissent plus que jamais en cette période d'inflation élevée, puisque leur rente de retraite n'est pas pleinement indexée. », conséquence du coup fourré du gouvernement du PQ en 1982. Quant aux aspects non-monétaires, au cœur des revendications, qui se négociaient aux tables sectorielles, le résultat clivant des votes traduit la grande insatisfaction des grévistes. Même une partie de celles qui ont voté en faveur de l'acceptation l'ont fait par dépit, ne voyant plus de possibilité d'obtenir davantage encore moins une remise en question de l'école à trois vitesses qui marchandise l'école aux dépens des familles prolétariennes. Rien de surprenant que les enseignantes de l'école publique se butent au gouvernement de la CAQ au sujet des normes de la « composition de la classe » pour obtenir de meilleurs ratios et plus de soutien professionnel étant donné le haut taux d'élèves en difficulté rejeté par l'école privée et celle publique sélective.
Sans unité syndicale et sans gauche à l'étatsunienne, la bureaucratie avait beau jeu
Comment peut-on expliquer un si piètre aboutissement sur la base d'un rapport de forces aussi favorable ? Une armée nombreuse et motivée ayant la sympathie populaire ne peut vaincre sous la houlette d'un état-major étriqué maniaque de contrôle afin de limiter la grève aux bornes de la stabilité politique. La bureaucratie syndicale était bien consciente qu'une grève générale directement politique contre l'État par plus de 600 000 travailleuses, soit plus de 10% de la force de travail du Québec et à 75% féminine, boostée par la conscience acquise durant la pandémie d'être des « travailleuses essentielles » austérisées était grosse d'une crise politique capable de paralyser si ce n'est de renverser le gouvernement. Après tout, la grève générale publique-privée de 1972 avait à un moment donné viré en crise prérévolutionnaire que les présidents emprisonnés des centrales syndicales avaient rapidement désamorcé en négociant une sortie de crise.
Il ne fut pas facile à la caste bureaucratique de s'en tirer, écartelée qu'elle était entre une CAQ qui voulait écraser le mouvement syndical pour paver l'autoroute de la privatisation et une masse prolétarienne en colère aiguisée par le féminisme. Elle y est parvenue en jouant les rivalités syndicales entre la FAE qui représente le 40% le plus urbanisé du corps enseignant, une scission de la centrale syndicale unitaire, il y a à peine huit ans, jugée pas assez combative, et sa vis-à-vis la FSE-CSQ du Front commun. Comme l'a dit ce militant de la base FAE à Radio-Canada, pourquoi n'y a-t-il pas eu de concertation entre la FAE et la FSE, pourquoi la grève générale de la FAE a-t-elle été déclenchée si tôt alors que le Front commun n'embarquait pas ? Cette rivalité, selon lui, a permis à la CAQ de manœuvrer en faisant des offres à la FSE qu'elle ne faisait pas à la FAE en grève et sans que les deux syndicats déjouent cette combine en communiquant entre eux. La FSE, conclue-t-il, n'a pas voulu s'engager à ne pas signer avant la FAE. Il aurait pu ajouter : pourquoi la FAE n'a-t- elle pas tout simplement fait partie du Front commun dès le départ ?
Si la division syndicale fut le bras droit des machinations des appareils syndicaux, l'absence d'opposition organisée de la gauche sociale et politique en fut le bras gauche. On ne blâmera jamais assez la gauche dite anticapitaliste qui a fait semblant d'organiser une gauche syndicale depuis une dizaine d'années sinon plus, pour laisser dégénérer cette tentative en une série de conférences et table-rondes, parfois utiles, dont la dernière en date invitait une majorité de bureaucrates. Il n'y a pas au Québec l'équivalant du Labor Notes étatsunien ni d'organisation oppositionnelle à la direction bureaucratique telle les Caucus of Rank-and-File Educators (CORE) au sein du Syndicat des enseignant-e-s de Chicago, ni même de faiblards caucus de gauche lors des congrès syndicaux comme au Canada anglais.
La liaison entre l'aile parlementaire Solidaire et la bureaucratie syndicale ne se dément pas
Quant à l'aile parlementaire Solidaire, elle n'a pas manqué la facilité de se faire prendre en photos sur les lignes de piquetage au début de la grève pour ensuite s'emmurer dans le silence quand les tensions entre base syndicale et direction syndicale devinrent publiquement évidentes au moment des accords de principe et du vote subséquent de ratification à la base. On a eu droit, parmi la myriade de posts du Facebook du parti, à un blip occasionnel contenant le message édulcoré « François Legault doit négocier de bonne foi et déposer une offre sérieuse avant Noël. » On a jamais su ce que serait au moins les grandes lignes d'une offre de la direction Solidaire ni ne fut entendu le moindre commentaire sur la stratégie syndicale et encore moins le moindre encouragement aux protestataires sauf pour les remercier une fois le dossier clos.
Pendant ce temps, on souhaite mettre en évidence pour les locataires une mesure marginale de facilitation de l'accès à la propriété au lieu de plutôt souligner les revendications de la manifestation de locataires contre la loi 31, à laquelle participaient officiellement Québec solidaire, visant à empêcher les cessions de bail pour éviter les hausse de loyer et aussi pour le gel des loyer sur un an et pour leur contrôle. Quelle arrogance ! Et ensuite on appui la CAQ, au nom du nationalisme étriqué, afin de renouveler la clause dérogatoire pour la Loi sur la laïcité de l'État interdisant le voile au personnel enseignant. À ce compte, ne faudrait-il pas aussi appuyer contre les Autochtones la CAQ qui ne veut pas leur céder la gestion de leurs services de protection de l'enfance ? Quelle hypocrisie !
Et voici que pour contrer le PQ qui lui dame électoralement le pion, l'aile parlementaire lance une campagne pour l'indépendance, thématique presque complètement ignorée depuis des années, à coups de bla-bla de gauche à contenu vide et de l'une ou l'autre revendication concrète qui défonce des portes ouvertes tout en montant en épingle des personnalités historiques péquistes au vernis de gauche. S'agit-il de tendre la main au PQ néolibéral et identitaire se masquant par une couche de verbiage indépendantiste qui sera jeté par-dessus bord aussitôt la majorité parlementaire en vue ? Le but est-il de devenir l'aile gauche d'une future coalition ou bien de s'en démarquer stratégiquement ? On se le demande. Pour se dédouaner du vide réellement existant du « projet de société », on s'en remet à l'Assemblée constituante « non seulement [pour] se prononcer sur l'indépendance, mais [pour] les grandes valeurs et les lois fondamentales qui guideront ce nouveau pays du Québec. » Plus Ponce-Pilate vis-à-vis non seulement le programme de ce Québec indépendant mais même vis-à-vis l'indépendance elle-même, tu meurs.
Nouveau rendez-vous syndicat-Solidaire pour affronter un Premier ministre revanchiste
Il n'en reste pas moins que la CAQ n'a pas réussi à écraser le noyau dur du mouvement syndical québécois comme elle le souhaitait. Frustré, le Premier ministre en a assez des protestataires de tous bords. Réagissant à l'humble contestation contre l'usine suédoise de Northvolt destinée à être le navire amiral de la filière batterie, « [l]e premier ministre François Legault s'impatiente des contestations contre des grands chantiers industriels, comme celui de l'usine Northvolt. Il a plaidé jeudi qu'il ‘'faut changer d'attitude'' au Québec […]. Selon lui, avec ce genre d'attitude, ‘'on ne serait pas capable de faire la Baie-James que les gouvernements précédents ont faite''. » Quant aux victimes d'actes criminels, iels « devront aller vers la solidarité ou l'aide sociale, reconnaît Legault ». S'il n'a pas pu régler son compte aux syndicats du secteur public, il s'en promet vis-à-vis ceux de la construction, peut-être le fer de lance de ceux du secteur privé, dont il veut, serons-nous étonnés, plus de « flexibilité » et de « mobilité » pour plus de productivité. Avec le projet de loi 51 récemment déposé, y a-t-il là un prochain rendez-vous pour le mouvement syndical et la gauche ?
À moins que ça ne soit plus tôt pour qu'enfin ensemble centrales syndicales et Québec solidaire ne convoquent le peuple québécois dans la rue pour massivement exiger d'Ottawa et de Québec de cesser d'être les complices de l'État sioniste dans sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien. La discordance de politique entre les guerres de Gaza et d'Ukraine sent le suprématisme blanc et l'islamophobie à plein nez. Autant il fallait ouvrir les bras aux personnes réfugiées d'Ukraine, autant faut-il le faire pour celles de Palestine. Autant il faut armer la résistance ukrainienne, autant il faut cesser de le faire vis- à-vis Israël. Surtout il faut immédiatement mettre fin au scandale du boycott de l'UNRWA comme allié servile de l'impérialisme étatsunien qui plus que complice participe au génocide par l'utilisation de son armée au Moyen-Orient et pas sa diplomatie à l'ONU.
Marc Bonhomme, 11 février 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca

Négociation dans les secteurs public et parapublic : Trois nouvelles à vous communiquer

Voici trois brèves nouvelles en lien avec l'univers de la négociation dans les secteurs public et parapublic. Commençons, comme cela va de soi, par la mauvaise. Pour ce qui est des deux autres, vous aurez à juger par vous-même s'il s'agit d'une bonne, d'une mauvaise ou d'une nouvelle neutre...
La mauvaise nouvelle…
Une étude de l'IREC démontre que la valeur de la rente de la retraite du RREGOP a perdu 17,5% entre 2002 et 2021. C'est énorme. Curieusement, les rentes reçues de la RRQ et de la Sécurité du revenu du Canada sont quant à elles pleinement indexées. Pourquoi en est-il ainsi ?
Voici la réponse : c'est à partir de la non-négociation de 1982 dans les secteurs public et parapublic du Québec que s'effectue une première grande modification en lien avec l'indexation de la rente de retraite. Pour les années cotisées au RREGOP entre 1982 et 1999, l'indexation de la rente a été ramenée à 0% quand l'inflation se situe entre 0 et 3%. Dans un tel contexte, il est tristement normal d'avoir à constater pour la ou le retraité.e, sur le long terme, une perte de la valeur de sa rente de retraite.
Pour les années cotisées de 1999 à aujourd'hui, la formule d'indexation de la rente repose sur des calculs différents et un peu moins pénalisants pour la ou le retraité.e.
Quoi qu'il en soit, tant et aussi longtemps que la rente de retraite en provenance du RREGOP ne sera pas pleinement indexée, les conditions de vie de certain.es retraité.es sont appelées à se détériorer.
La nouvelle neutre
La négociation entre le gouvernement du Québec le SFPQ, le SPGQ et la FIQ semble plutôt stationnaire. Il est probable qu'il en soit ainsi tant et aussi longtemps que les résultats des consultations des membres du Front commun intersyndical CSN-CSQ-FTQ-APTS ne seront pas connus. Il y a au moins quatre groupes qui n'ont toujours pas finalisé leur négociation avec le gouvernement du Québec : le SFPQ, le SPGQ, la FIQ et également les policières et les policiers de la Sûreté du Québec. La grande question que nous pouvons nous poser est la suivante : le règlement négocié avec le Front commun sera-t-il le même pour toutes et tous ou certaines et certains salarié.es syndiqué.es obtiendront-elles ou obtiendront-ils plus que d'autres ? À suivre. Rappelons-nous que le premier ministre François Legault a déclaré, en décembre dernier, que la négociation avec la FIQ serait longue. De quoi cette annonce présage-t-elle ? Longue, jusqu'à quel moment et pourquoi ? Mystère…
La bonne nouvelle…
La bonne nouvelle nous est venue de la province voisine, l'Ontario. Des juges de la Cour d'appel de cette province ont ajouté leur voix majoritaire (2 contre 1) à celle du tribunal de première instance qui s'est penché sur le caractère constitutionnel ou non du projet de loi 124. Ce projet de loi, adopté en 2019, prévoyait pour les salarié.es syndiqué.es du gouvernement ontarien un plafonnement unilatéral de leur salaire à 1% par année pendant trois ans. La Cour supérieure de l'Ontario a déclaré, en novembre 2022, la mesure législative inconstitutionnelle. Le jugement de ce tribunal de première instance a été porté en appel par le gouvernement Ford. Lundi le 12 février 2024 la Cour d'appel de la même province a reconnu que la loi du gouvernement ontarien portait atteinte aux droits de négociation collective des salarié.e.s syndiqué.es.
La leçon de la bonne nouvelle
L‘État incarne dans notre société un pouvoir auquel nulle et nul n'échappe ou nulle et nul ne peut se soustraire. L'État ne se réduit pas au pouvoir politique, c'est-à-dire pouvoir exécutif + pouvoir législatif. Il y a également au sein de l'État une dualité qui permet au pouvoir judiciaire de freiner les élans autoritaires d'un gouvernement hostile aux droits des salarié.es syndiqué.es. Notre lecture de l'État ne peut pas le présenter comme un simple bloc monolithique. L'État ne se réduit pas à la seule volonté décisionnelle des membres d'un gouvernement à laquelle s'ajouterait, à l'Assemblée législative, les votes des député.es pantins. Il semble bel et bien commencer à exister au Canada, en matière de droit du travail et de négociation, une espèce d'autonomie du droit face à la volonté liberticide en provenance du pouvoir politique. Les différents paliers de tribunaux ont réellement la possibilité de se dresser en antithèse du pouvoir politique. Le tout dépend bien entendu de la lecture que font les juges de la portée des droits des individus, des personnes et des associations qui les représentent et qui les défendent.
Yvan Perrier
18 février 2024
12h30
yvan_perrier@hotmail.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Négociation avec la FIQ : La réalité derrière les déplacements obligatoires

Les déplacements obligatoires, appelés « flexibilité » par le gouvernement, sont actuellement au cœur des négociations entre les 80 000 professionnelles en soins et l'employeur.
Pour permettre aux Québécois-e-s de mieux comprendre les enjeux derrière ces changements forcés d'unité ou d'établissement, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ a rendu public le récit de deux infirmières que l'employeur a tenté de déplacer contre leur gré.
Visionner la vidéo de la conférence de presse.
« Ça ne pourra jamais être pire que de tuer quelqu'un »
En juillet dernier, alors qu'Annabelle Beaudry s'apprête à débuter son quart de travail sur l'unité psychiatrique où elle travaille depuis deux ans, un membre de la direction lui indique qu'elle doit absolument aller faire un remplacement au débordement en chirurgie, où il manque quelqu'un ce soir-là. Puisqu'elle n'a jamais travaillé en chirurgie, elle refuse poliment l'affectation, en expliquant qu'elle ne sent pas qu'elle ait l'expérience ou l'expertise requises pour ce remplacement, tel que le recommande l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). De plus, il manque déjà deux employés sur l'unité psychiatrique.
Elle subit alors de la pression de l'employeur qui lui laisse entendre que c'est sa faute si ça va mal en chirurgie. Annabelle se fait alors la réflexion à elle-même : « ça ne pourra jamais être pire que de tuer quelqu'un ».
Vers 19 h, alors qu'il manque deux travailleuses sur l'unité psychiatrique, Annabelle est renvoyée chez elle. L'employeur a tenté de l'envoyer en chirurgie à deux autres reprises, sans formation.
« Je ne veux pas avoir ça sur la conscience »
Depuis 2018, Tracey Beaudoin travaille à Plessisville. Elle va au domicile des nouvelles mamans pour vérifier leur état de santé et celui de leur nouveau-né, prodiguer des conseils et vacciner les enfants. L'an dernier, son employeur décide qu'elle devra occasionnellement aller en néonatalogie prendre à sa charge des poupons de quelques heures et des mères qui viennent tout juste d'accoucher.
« J'étais terrifiée. Je n'avais jamais travaillé en néonatalogie et je ne me jugeais pas compétente pour la tâche qu'on m'imposait. J'avais très peur de faire une erreur grave pour une mère ou un enfant. Je ne veux pas avoir sur la conscience pour le reste de ma vie », explique Tracey Beaudoin.
Les déplacements obligatoires mettent en péril la santé des patients
« Quand une professionnelle en soins refuse qu'on l'envoie de force sur une autre unité, ce n'est pas qu'elle ne veut pas soigner les patients, c'est qu'elle estime qu'elle n'a pas l'expertise et l'expérience nécessaires pour correctement prendre soins des patients. Prendre une professionnelle en soins experte sur son unité et l'envoyer ailleurs, boucher un trou, ce n'est pas un gain de soins, c'est une perte d'expertise », conclut Julie Bouchard, présidente de la FIQ.
La FIQ dénonce le manque de vision du gouvernement pour le réseau de la santé du Québec. Plutôt que de mettre en place des mesures qui vont améliorer et sécuriser les soins à la population, comme les ratios, le gouvernement propose plutôt des mesures temporaires qui vont épuiser les professionnelles en soins et les pousser davantage vers la porte de sortie.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’exploitation est une question d’actualité

Si elle peut sembler vieillie à certains, la notion d'exploitation a le mérite de nous rappeler que le capitalisme n'est pas critiquable uniquement en raison de ses dimensions écocidaires : elle peut aussi bien permettre de fonder des politiques réformistes de promotion et de défense du droit du travail que des perspectives de transformation sociale plus radicales.
12 février 2024 | tiré d'AOC.media
https://aoc.media/opinion/2024/02/11/lexploitation-est-une-question-dactualite/?loggedin=true
Il existe des sujets qui occupent la discussion publique dans la durée, comme la crise du pouvoir d'achat ou les conflits parlementaires à propos de la régulation temporaire des travailleurs dits sans papiers dans les métiers en tension.
D'autres sujets disparaissent aussitôt après s'être vus consacrer un reportage ou un article, dans un journal radiophonique ou dans la presse écrite, même lorsqu'ils sont susceptibles de frapper les esprits : par exemple le pourcentage record, 48 % ! des salariés se déclarant en détresse psychologique selon le 12e baromètre sur la santé mentale au travail réalisé par le cabinet Empreinte Humaine avec OpinionWay[1], ou encore la forte baisse de la productivité des entreprises françaises : alors qu'elle progressait en moyenne de 0,9 % par an dans la décennie 2010, elle a baissé de 4,6 % entre 2019 et 2023.
Les modalités du traitement médiatique des sujets d'actualité impliquent qu'ils se succèdent les uns aux autres et que le temps de l'interrogation sur le rapport qu'ils entretiennent les uns avec les autres ne soit pas disponible. S'engager dans une telle interrogation, par exemple sur les quatre sujets mentionnés ci-dessus, impliquerait également de réfléchir aux concepts et aux théories qui sont les mieux susceptibles de les mettre en rapport.
Mais pourquoi présupposer un rapport entre ces quatre problèmes dont les enjeux et les causes sont manifestement très différents ? La baisse du pouvoir d'achat est liée aux renchérissements de l'énergie et des denrées alimentaires de base en raison principalement de la guerre en Ukraine. Les débats concernant la régularisation des travailleurs sans papiers dans les secteurs dits en tension concernent le risque « d'appel d'air », c'est-à-dire d'accélération de l'immigration irrégulière, qu'une telle mesure impliquerait.
Quant aux 48 % des salariés qui se déclarent en situation de détresse au travail, ils s'expliqueraient principalement par les contraintes propres au télétravail[2] et par le report de la retraite, les plus de 60 ans étant les plus touchés. C'est encore d'autres facteurs que relèverait la baisse de la productivité : l'effet durable de la crise du Covid-19, les embauches trop nombreuses compte tenu de la croissance actuelle, la difficulté à recruter des personnes compétentes, le vieillissement des salariés et l'essor de l'apprentissage depuis la réforme de 2018 (les apprentis étant compatibilisés comme des salariés). Ces quatre sujets n'ont-ils rien à voir les uns avec les autres ? Il est permis d'en douter.
Les deux premiers illustrent en effet la tendance du capitalisme contemporain à produire du profit en contenant ou réduisant les rémunérations des salariés les moins qualifiés. La baisse du pouvoir d'achat touche en premier lieu celles et ceux qui sont les moins rémunérés : l'OFCE soulignait que la flambée des prix dégrade de 3,5 % le niveau de vie des 20 % des Français les plus modestes, et de 1,7 % celui des 20 % les plus aisés.
N'est-il pas évident que la crise du pouvoir d'achat prendrait d'autres formes si nous ne faisions pas aujourd'hui les frais de décennies de politiques de modération salariale, et si les inégalités entre les salaires les plus bas et les plus élevés n'avaient pas atteint des niveaux astronomiques (de 1 à 400 dans certaines entreprises) ? N'est-il pas tout aussi évident qu'une loi est jugée nécessaire pour régulariser des travailleurs sans papiers dans les secteurs en tension parce que de nombreuses entreprises voient dans ces populations vulnérables un moyen de contourner le droit du travail (en manière de rémunération minimale, de durée du temps de travail et de conditions de travail) pour augmenter le profit ?
La précédente législation, conditionnant l'accès à un titre de séjour, c'est-à-dire à une régularisation seulement temporaire, dépendait du bon vouloir de l'employeur. Or, l'attrait d'une telle « délocalisation sur place »[3] est tel que l'employeur préfère généralement ne pas s'engager dans une telle démarche[4]. Le fait que certains secteurs en tension soient occupés assez largement par des sans-papiers, notamment celui du bâtiment, n'est pas non plus sans rapport avec les niveaux de rémunération et les conditions de travail qui y sont en vigueur. Les nationaux s'en détournent. D'où l'intérêt de s'attacher des travailleurs prêts à consentir à cette forme d'exploitation parmi les plus dures, y compris lorsqu'elle s'effectue dans un cadre légal. D'où également l'intérêt de ne leur accorder qu'une régularisation temporaire, conditionnée précisément par le consentement à cette exploitation.
La modération salariale signe le retour d'un partage des gains de productivité plus défavorable aux salariés et autres travailleurs indépendants.
On peut parler d'exploitation lorsque la rémunération d'un travail est telle qu'elle enrichit ceux qui le rémunèrent au détriment de ceux qui touchent cette rémunération. Lorsqu'il a repris la notion d'exploitation au mouvement ouvrier de son temps pour en faire une théorie, Marx a souligné qu'une économie capitaliste tend à rémunérer le moins possible le travail, tout en lui faisant produire toujours davantage de profit[5]. Marx a également expliqué que ces tendances peuvent s'exprimer de deux manières distinctes, ou bien dans une stratégie consistant à augmenter autant que possible la durée et l'intensité du travail (ce qu'il appelait production de survaleur absolue), ou bien en cherchant à accroître la productivité du travail par le progrès technique (production de survaleur relative).
La première stratégie, qui a prédominé au XIXe siècle, fut conduite à l'échec car l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail se heurte à des limites physiologiques évidentes, et l'intensification du travail produit des effets d'usure qui finissent par saper le renouvellement des capacités de travail des salariés (la « reproduction de la force de travail », dans le vocabulaire de Marx). Cette première stratégie a cédé ensuite la place à la seconde, celle d'une réduction progressive du temps de travail à l'échelle de la semaine et de la vie active, celle d'un partage des gains de productivité plus favorable au salarié. Force est de constater que depuis l'émergence du capitalisme néolibéral, la première stratégie prime de nouveau. La modération salariale signe le retour d'un partage des gains de productivité plus défavorable aux salariés et autres travailleurs indépendants.
La frontière entre journée de travail et non-travail s'efface (en raison des technologies de la communication et de l'information, et plus récemment du télétravail). La durée hebdomadaire de travail a cessé de se réduire quand elle n'augmente pas, et l'âge de la retraite est repoussé. Quant à l'intensification du travail, elle constitue l'une des cibles principales des innovations organisationnelles et technologiques des entreprises. Comment un tel capitalisme, exigeant toujours plus de temps de travail et d'intensité dans l'effort ne pourrait-il pas se heurter de nouveau à des limites infranchissables ?
L'injonction au « toujours plus » ciblant non seulement le corps des salariés, comme au XIXe siècle, mais aussi leur subjectivité, il n'est pas surprenant que ces limites se présentent comme celles d'une détresse psychologique. N'est-il pas significatif que selon l'infographie du 12e baromètre du cabinet Empreinte Humaine[6], en plus des 48 % des salariés se déclarant aujourd'hui en détresse psychologique, 17 % se disent en risque de détresse psychologique élevée. On peut certes s'interroger sur le sens des notions de « détresse psychologique » et « détresse psychologique élevée », mais elles indiquent manifestement que pour toutes celles et tous ceux qui se sont décrits ainsi, les limites du supportable ont été atteintes, ou sont en passe de l'être.
Une confirmation en est fournie par un autre chiffre : 43 % des salariés sur les 2 000 salariés interrogés assurent vouloir quitter leur entreprise. D'autres données sont plus faciles encore à interpréter, comme le fait que « 32 % des salariés sont aujourd'hui en risque de burnout, dont 12 % en burnout sévère ». Tout aussi frappant est le fait qu'1/4 de ces salariés affirment « qu'il y a plus de tentatives de suicide ou de suicides dans leur organisation/entreprise ».
La stratégie d'augmentation des profits par réduction des salaires au minimum, et par allongement et intensification du travail au maximum, conduit à une impasse du point de vue même de la course aux profits.
Interrogé sur France Inter, Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d'Empreinte Humaine, précise que « la santé mentale se dégrade sur tous les indicateurs que nous étudions depuis trois ans et demi » et il rapporte cette évolution au fait que les salariés déplorent « une très grande intensification de la charge de travail ». Pour les salariés interrogés, la dimension structurelle de ce phénomène ne semble pas faire de doute puisque derrière la pression exercée par leurs n+1, ils perçoivent la stratégie de leur entreprise.
Christophe Nguyen précise en effet qu'« aujourd'hui, les salariés expriment que l'acteur qui a le plus d'impact négatif sur leur santé mentale, ce n'est pas le manager de proximité, ce ne sont pas non plus les clients, mais la direction générale ». Comment mieux décrire cette conscience d'une stratégie de production de profit à leur détriment que comme une conscience d'exploitation ? Or, comment une telle conscience ne se solderait pas par des effets de démotivation, qui, s'ajoutant aux effets d'usure générés par l'intensification du travail et l'allongement de sa durée, ne peuvent que se solder par des taux d'absentéisme et de démission accrus, qui ne peuvent à leur tour qu'agir négativement sur la productivité.
Comme dans la première phase de développement du capitalisme, la stratégie d'augmentation des profits par réduction des salaires au minimum, et par allongement et intensification du travail au maximum, conduit à une impasse du point de vue même de la course aux profits.
Les quatre questions dont nous sommes partis : la crise du pouvoir d'achat, la régularisation des travailleurs sans papiers, l'augmentation de la détresse psychologique au travail et la baisse de la productivité, sont certes partiellement irréductibles les unes aux autres, mais elles n'en comportent pas moins des caractéristiques communes. Le concept d'exploitation permet d'analyser certaines d'entre elles, tout en mettant en lumière la dimension structurelle de problèmes qui attirent l'attention publique. Elle devrait elle aussi être mise en discussion si l'on voulait vraiment réfléchir aux meilleures manières de résoudre ces problèmes. Tel est l'un des nombreux mérites du concept d'exploitation qui a également pour intérêt de nous rappeler qu'aujourd'hui, le capitalisme ne devrait pas être jugé critiquable seulement en raison de ses dimensions écocidaires.
La crise écologique concentre l'attention sur ces dernières, mais d'autres sujets de préoccupation majeure, comme ceux que nous venons de mentionner, se rattachent aux dimensions du capitalisme. La prise en compte de son caractère exploitatif permet d'ailleurs également de prendre conscience de quelques-uns des inconvénients des moyens en apparence les plus réalistes de répondre à l'urgence écologique : ceux qui relèvent de l'instauration d'un capitalisme vert. Car rendre le capitalisme plus respectueux des écosystèmes et plus économe en ressources naturelles impliquerait des baisses de rentabilité que les logiques capitalistes imposeraient de compenser par une baisse du salaire direct et indirect (assurance chômage, sécurité sociale, retraite, services publics), c'est-à-dire par une exploitation accrue des travailleurs.
La catégorie d'exploitation peut sembler vieillie, mais elle permet de poser plusieurs des questions les plus caractéristiques de notre époque. Soulignons pour finir que la critique de l'exploitation constitue l'un des rares terrains d'entente entre différentes familles de la gauche qui sont aujourd'hui devenues trop hostiles les unes aux autres pour percevoir ce qui pourrait les rapprocher.
La conscience de la nature exploitative du capitalisme peut fonder aussi bien des politiques réformistes de promotion et de défense du droit du travail, d'augmentation du salaire et de réduction du temps de travail, de redistribution des richesses ou d'instauration d'un revenu universel, que des perspectives de transformation sociale plus radicales par la grève, le sabotage ou la fuite du travail.
La critique de l'exploitation est enfin l'un des objectifs communs des luttes contre le capitalisme, le patriarcat et le racisme, car les femmes et les personnes racisées faisant généralement l'objet d'une exploitation accrue de leur travail professionnel, à quoi s'ajoute l'exploitation du travail domestique. La critique de l'exploitation ne devrait-elle donc pas jouer un rôle central dans tout projet de construction d'une hégémonie socialiste, féministe et antiraciste, qui par ailleurs devrait reconnaître la nécessité de la bifurcation écologique ?
NDLR : Emmanuel Renault a récemment publié Abolir l'exploitation. Expériences, théories, stratégies aux éditions La Découverte
Notes
[1] Voir par exemple France Inter et Les Échos.
[2] Une forte augmentation de la détresse psychologique avait été observée pendant la période de télétravail généralisé mais elle a encore augmenté.
[3] Étienne Balibar, Monique Chemillier-Gendreau, Jacqueline Costa-Lascoux, Emmanuel Terray, Sans papiers : l'archaïsme fatal, La Découverte, 1999.
[4] Gérard Darmanin lui-même, qu'on ne peut soupçonner ni d'anticapitalisme ni d'un souci tout particulier pour le droit du travail et celui des sans-papiers juge que l'accord de l'employeur relève d'une procédure « moyenâgeuse ».
[5] Nous avons analysé plus en détail l'origine, l'histoire et l'actualité du concept d'exploitation dans Abolir l'exploitation. Expériences, théories, stratégies, La Découverte, 2023.
[6] On peut regretter que l'ensemble des analyses et la méthodologies soient difficilement accessible.

Les syndicats dénoncent l’absence de considération pour la main-d’œuvre lors des tables de réflexion sur l’avenir de la forêt

Les organisations syndicales représentant les travailleuses et travailleurs de la filière forestière québécoise (la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Unifor, les Métallos et la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), expriment leur déception face aux thèmes abordés lors des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt initiées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF).
6 février 2024 - tiré du site de la Centrale des syndicats démocratiques
En novembre dernier, le MRNF a lancé une vaste réflexion sur l'avenir de la forêt, à laquelle les syndicats ont offert leur collaboration. Cependant, après avoir pris connaissance des sujets soumis à la discussion lors des 12 tables régionales à venir, ils ont constaté qu'il n'est aucunement question des enjeux cruciaux liés à la main-d'œuvre forestière.
La main-d'œuvre forestière : absente de la réflexion, mais pourtant essentielle
Les organisations syndicales considèrent que les travailleuses et travailleurs sont laissés pour compte dans cette démarche. Il est essentiel que les tables de réflexion nous permettent d'aborder les impacts imminents de même que les enjeux de transition qui découleront de la transformation des pratiques d'aménagement, de la diminution des possibilités forestières, de la volatilité climatique et de l'incertitude économique.
« Nous exigeons que la ministre revoit la liste des thèmes abordés lors de ces tables de réflexion et donne une place légitime aux enjeux liés à la main-d'œuvre forestière. Le Québec a besoin d'une vision globale et inclusive pour sa forêt, et celle-ci repose en partie sur la reconnaissance des préoccupations et de l'expertise des travailleuses et travailleurs de l'industrie » déclarent à l'unisson le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier, celui des Métallos Dominic Lemieux, le président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Luc Vachon ainsi que le président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), Louis Bégin.
La stratégie caribou devrait être liée à la consultation
De plus, les leaders syndicaux soulignent que la démarche actuelle se déroule en l'absence d'une stratégie caribou, qui ne peut qu'avoir un effet déterminant sur les positions adoptées par les participants.
Les syndicats appellent à un réexamen immédiat du processus de consultation, afin que les travailleuses et travailleurs de l'industrie occupent la place qui leur revient au cœur de ces discussions cruciales pour l'avenir de la forêt québécoise.
Conférence de presse syndicale sur la forêt

Mois de l’histoire des Noirs 2024 : Renouveler notre engagement à lutter contre le racisme

Au mois de février chaque année, les membres du Syndicat des Métallos partout au pays célèbrent le Mois de l'histoire des Noirs, ainsi que les réalisations et l'héritage des travailleur.euse.s et des militant.e.s noir.e.s.
30 janvier 2024 | tiré du site des Métallos
Au fil des ans, de nombreux métallos noirs ont gravi les rangs pour servir notre syndicat et nos membres. Ils et elles ont agi à titre de militant.e.s, de mentors et de chefs de file, et ont ouvert la voie aux générations futures afin qu'elles puissent influencer le cours des choses en s'opposant à l'inégalité dans notre syndicat, nos lieux de travail et nos localités. Nous leur en serons toujours reconnaissants, mais plus particulièrement ce mois-ci.
Les métallos se sont toujours engagé à jouer un rôle déterminant, au sein de notre syndicat et de la société élargie, dans le mouvement pour la justice raciale. Tout au long de l'année, et en particulier durant le Mois de l'histoire des Noirs, en tant que syndicat, nous prenons le temps de réfléchir à la façon dont nous représentons les travailleur.euse.s noir.e.s et racisé.e.s. Nous devons nous opposer activement au racisme et continuer à identifier les moyens de renforcer cet engagement en matière de justice dans le contexte de la lutte contre le racisme et le racisme à l'égard des Noirs.
Nous rendrons hommage aux travailleur.euse.s et aux militant.e.s noir.e.s en renouvelant notre engagement indéfectible à lutter contre le racisme, la discrimination et les obstacles systémiques dans les lieux de travail que nous représentons, aux tables de négociation, dans notre syndicat et au sein du mouvement syndical.
Le directeur national pour le Canada, Syndicat des Métallos,
Marty Warren
Le directeur du District 3 (Ouest canadien et Territoires), Syndicat des Métallos,
Scott Lunny
Le directeur du District 5 (Québec), Syndicat des Métallos,
Dominic Lemieux
Le directeur du District 6 (Ontario et Canada atlantique), Syndicat des Métallos,
Myles Sullivan

Le STTP demande au Canada d’agir en réponse à la décision de la CIJ au sujet de Gaza

Le STTP se réjouit de la décision de la Cour internationale de justice (CIJ), principal organe judiciaire de l'Organisation des Nations Unies (ONU), avertissant l'État d'Israël de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la convention sur le génocide. L'ordonnance, qui est contraignante, ordonne à Israël de prendre « toutes les mesures en son pouvoir » pour empêcher un génocide à Gaza et l'oblige à présenter un rapport dans un mois sur l'ensemble des mesures qui auront été prises pour prévenir le génocide. Cette décision fait suite aux allégations de génocide portées par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël devant la CIJ, qui règle les différends entre les États conformément au droit international.
8 février 2024 | tiré du site du STTP
https://www.cupw.ca/fr/déclaration-du-sttp-le-sttp-demande-au-canada-d'agir-en-réponse-à-la-décision-de-la-cij-au-sujet-de
Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, les attaques incessantes et sans discernement de l'État israélien contre Gaza ont fait plus de 26 000 morts chez les Palestiniens – y compris plus de 10 000 nourrissons et enfants – et plus de 65 000 blessés. Au cours du seul premier mois des hostilités, Israël a largué des centaines de bombes de 2 000 livres sur Gaza, une zone bien plus petite qu'Ottawa.
La décision de la CIJ ordonne explicitement à Israël de s'abstenir de commettre tout acte visé par la convention sur le génocide, de prévenir et de punir toute incitation publique au génocide et de garantir l'accès à l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. La situation à Gaza est désastreuse. On rapporte notamment que les Palestiniens sont contraints de boire de l'eau contaminée et de manger de l'herbe.
Le STTP, qui demande un cessez-le-feu depuis des mois, déplore que la décision du CIJ n'en ordonne pas un. De plus, il faut libérer les milliers de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, qui sont détenus par Israël en tant que prisonniers politiques. Il y a aussi un grand nombre de détenus administratifs qui n'ont fait l'objet d'aucun chef d'accusation ni procès, y compris la parlementaire élue et féministe Khalida Jarrar.
Face à la décision de la CIJ, le Canada est contraint de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le génocide israélien à Gaza. En tant que signataire de la Convention des Nations Unies sur le génocide, le Canada a l'obligation et le devoir de prévenir et de punir le crime de génocide où qu'il se produise. Le STTP a demandé aux dirigeants canadiens de prendre des mesures pour empêcher d'autres décès de Palestiniens, notamment en mettant fin au commerce d'armes entre le Canada et Israël.
La décision de la CIJ est la condamnation mondiale la plus autoritaire à ce jour des atrocités commises par Israël. Elle constitue une preuve additionnelle que le Canada doit agir maintenant pour mettre fin à sa complicité dans un génocide.
Nous demandons au gouvernement canadien :
- d'exiger un cessez-le-feu permanent ;
- d'exiger de l'État israélien qu'il se conforme pleinement aux mesures d'urgence énoncées dans la décision de la CIJ ;
- de rétablir immédiatement le financement de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA) afin qu'il puisse continuer de fournir une aide humanitaire à près de 2 millions de personnes à Gaza qui luttent pour survivre sous le siège de l'armée israélienne ;
- de mettre fin à tout commerce d'armes entre le Canada et Israël ;
- de veiller à ce que le Canada ne soit pas complice d'un génocide à Gaza, ou qu'il n'en habilite pas l'exécution, et qu'il ne soit pas non plus complice de l'occupation illégale par Israël de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est.

Mémoire coloniale « Le Code noir a une forme d’actualité »

Maître de conférence en histoire du droit et des institutions à l'université des Antilles, Jean-François Niort a publié de nombreux travaux sur le droit colonial et le Code noir. Il revient sur les origines et les conséquences de l'élaboration de ce texte.
15 février 2024 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
Comment se passe la rédaction des premiers textes du Code noir sous Colbert ?
D'abord, il faut savoir que Colbert n'est pas l'auteur de l'ordonnance de mars 1685 sur la police des îles de l'Amérique française, qu'on appellera plus tard « Code noir », il est celui qui en prend l'initiative. Cette décision s'inscrit d'ailleurs dans une volonté plus large de Colbert de codification du droit français – il a en effet fait rédiger bien d'autres codes selon la même méthode. Pour ce faire, il demande aux administrateurs des Antilles françaises de faire remonter à Versailles les règles juridiques déjà appliquées localement, puis réunit un petit groupe de juristes pour mettre toutes ces règles sous forme de loi, ce qui donnera l'ordonnance de 1685. Ce n'est donc pas lui qui a inventé ces règles, mais c'est lui, avec Louis XIV qui a promulgué le texte, qui en a fait une loi royale.
Quel était l'objectif de Colbert quand il demande la rédaction de cette ordonnance ?
L'objectif est double. Il s'agit dans un premier temps de rationaliser le droit, c'est-à-dire de réunir toutes les règles de droit applicables à une matière (en l'occurrence l'esclavage et la police religieuse des îles françaises d'Amérique) dans un seul texte. Mais il y a aussi un objectif politique, qu'on constate dès le préambule de l'ordonnance : réaffirmer l'autorité du pouvoir royal sur ses terres. En effet, dès 1674, Colbert avait fait réunir la Guadeloupe et la Martinique au domaine de la couronne, sous le contrôle direct de l'État royal, alors qu'avant ces territoires étaient possédés et administrés par des compagnies coloniales privées (même si elles étaient crées à l'initiative de l'État et que des ministres comme Richelieu en étaient actionnaires). Celles-ci avaient toutes fait faillite, car elles étaient avant tout motivées par le profit rapide, ce qui empêchait toute implantation coloniale pérenne, surtout en cas d'élément perturbateur externe (guerre, cyclone…). Colbert avait une vision de la colonie beaucoup plus structurée, à long terme, il voulait gérer les colonies de façon à en faire des sources durables de revenus pour l'État. Le but du Code noir est donc de rappeler que ces territoires sont placés sous l'administration directe du pouvoir royal. Cet objectif explique qu'il y a dans le Code noir des dispositions qu'on pourrait prendre pour des mesures protectrices (le maître doit nourrir et vêtir les esclaves, ne peut pas les torturer, les mutiler ni les tuer). L'objectif était de soumettre les esclaves, de garantir leur obéissance pour qu'ils travaillent, de ne pas trop les tuer à la tâche pour les exploiter le plus longtemps possible. Du point de vue de l'État et des autorités coloniales, il s'agissait d'éviter les révoltes et de maintenir la main d'œuvre en bon état pour que l'esclave soit apte à travailler et à produire de la richesse, ce qui n'était pas toujours l'objectif des maîtres.
Quand et pourquoi apparaît l'expression Code noir ?
L'expression Code noir apparaît quand la traite esclavagiste prend une ampleur industrielle, vers le début du XVIIIe siècle, car c'est à ce moment-là que la construction racialiste qui consiste à identifier le Noir à un esclave par nature se met en place. Il faut réfléchir en termes de justification idéologique. À l'époque de Colbert, la justification de l'entreprise coloniale est de sauver l'âme des esclaves par le baptême – c'est d'ailleurs ce qui explique que les premières dispositions du Code noir sont de nature religieuse. Mais quand il commence à y avoir de plus en plus d'esclaves par rapport aux Blancs dans les colonies, il faut imaginer une idéologie qui favorise la soumission. De plus, sous l'influence de la philosophie des Lumières, la justification religieuse est de moins en moins efficace à partir du XVIIIe siècle, ce qui va amener au XIXe siècle à l'avènement du racisme à prétention « scientifique », le racisme moderne. Celui-ci va se baser sur un discours de type biologique, anthropologique et culturel, et devenir le discours officiel de la France au moment de son second empire colonial (cf. le fameux discours de Jules Ferry de 1885 invoquant le « droit » et même le « devoir » des « races supérieures » de « civiliser » les « races inférieures »). Dans le Code noir, on a déjà les prémices de ce racisme-là, puisqu'il y est écrit qu'il ne peut y avoir d'esclave que Noir. Mais l'équation n'est pas complète au début de son élaboration : il offre d'abord une possibilité d'émancipation, car un Noir affranchi devient l'égal du Blanc, il a les mêmes droits que lui selon les derniers articles de l'ordonnance de 1685. La boucle va être cependant bouclée au XVIIIe siècle avec la mise en place d'une catégorie intermédiaire, celle des « libres de couleur ». Ce sont des affranchis ou descendants d'affranchis (souvent métis), qui sont victimes de discrimination et de ségrégation (ils n'ont pas droit d'accéder à la noblesse, de porter l'épée, d'accéder à des professions libérales ou intellectuelles…). Ce statut social inférieur est destiné à conforter l'idée d'infériorité naturelle et perpétuelle du « Noir » envers le « Blanc ». De plus, tant qu'il y a l'esclavage, cette catégorie sert de « tampon » entre la classe des Blancs et celle des esclaves, et certains libres de couleur ont participé au système esclavagiste. Une fois que l'esclavage est aboli, cette catégorie permet de maintenir la masse des anciens esclaves dans la pauvreté et l'exploitation. On l'oublie souvent : c'est la France coloniale qui invente la ségrégation raciale dans son premier empire colonial au XVIIIe siècle, ce qui va ensuite inspirer les ségrégations raciales aux États-Unis et en Afrique du Sud (apartheid).
En quoi l'ordonnance de 1685 constitue-t-elle l'avènement du droit colonial français ?
Le fait colonial est souvent caractérisé par un droit spécial, qui est un droit dérogatoire à celui de la métropole. La colonie est là pour enrichir la métropole, et donc toutes les règles juridiques qui ne vont pas dans ce sens sont tordues, pliées ou abolies pour que prime le principe d'utilité économique. Colbert lui-même, dans une lettre de 1681, quatre ans avant la sortie de l'ordonnance de 1685, reconnaît que l'esclavage est interdit en France, mais il est tout de même institué dans les colonies en contradiction avec le droit commun. C'est pour cela que je considère le Code noir comme l'acte fondateur du droit colonial français, au sens d'un droit dérogatoire, qui n'est appliqué que dans la colonie et qui sert les intérêts économiques auxquels est dédiée l'entreprise coloniale. Comme l'ont rappelé l'historien Eric Williams et l'écrivain et poète Aimé Césaire dans les années 1940 et 1950, la colonisation est une entreprise capitaliste, il faut que ça rapporte, donc toutes les terres colonisées n'ont d'autres buts que de rapporter de l'argent, à l'État comme aux investisseurs privés associés. On est tout à fait dans la logique qui est encore aujourd'hui celle de la Françafrique !
Comment cette logique de droit dérogatoire se poursuit-elle aujourd'hui ?
Le Code noir a une forme d'actualité : comme il est l'acte fondateur du droit colonial français en tant que corps de règles dérogatoires au droit commun, on peut l'investir d'une certaine postérité. Par exemple : le texte le plus monstrueux de l'histoire coloniale française à mes yeux, c'est le rétablissement de l'esclavage par l'arrêté de Bonaparte du 16 juillet 1802. Ce texte criminel, qui se permet de replacer en esclavage 80 000 personnes pour 46 années, est complètement illégal et constitue une autre dérogation au droit français : l'esclavage a été aboli par la loi du 4 février 1794, et pour abroger une loi, il faut une autre loi ! Bonaparte ne voulait pas passer par la voie législative, pour ne pas médiatiser sa décision. Il prend donc un arrêté complètement illégal, qu'il ne publie pas au journal officiel mais qui est envoyé au gouverneur de Guadeloupe et appliqué localement. C'est aussi le cas pour toutes les dérogations juridiques qui continuent à sévir dans les anciennes colonies depuis 1946, toujours pour des raisons économiques. On le voit très bien avec le scandale du chlordécone, interdit en France dès 1990 mais autorisé aux Antilles jusqu'en 1993, ainsi que celui des épandages aériens : ces derniers ont été interdits par le droit européen en 2009 (sauf exceptions circonstanciées), ce qui a été transcrit dans le droit français en 2011. Mais ces épandages ont continué à être autorisés aux Antilles jusqu'en 2015 par des arrêtés préfectoraux renouvelés automatiquement de six mois en six mois – autant dire que l'exception était devenue la règle ! Les préfets de Martinique et de Guadeloupe avaient parfaitement conscience de l'illégalité de ces arrêtés, qui étaient d'ailleurs très vite annulés par les tribunaux administratifs locaux. Ces arrêtés étaient pris sous la pression des lobbies économiques, avec l'autorisation du ministère de l'Agriculture qui est complètement noyauté par le lobby de la banane. Cette situation a continué jusqu'à ce que Ségolène Royal décide finalement d'intervenir et d'interdire cette pratique fin 2015.
Enfin, il ne faut pas oublier que Colbert a imposé une logique mercantiliste, selon laquelle la richesse d'une nation repose sur le commerce et la circulation des marchandises. Dans un État classique, l'agriculture est là pour s'assurer qu'on puisse nourrir la population et éviter les famines et les révoltes. Mais ce qui compte dans une colonie, c'est que l'agriculture soit mise au service du commerce. Voilà un autre lien avec le chlordécone : au XXe siècle, après la départementalisation des Antilles et de la Guyane, on oriente l'agriculture des anciennes colonies vers des monocultures intensives destinées à l'exportation, principalement la banane, ce qui va mener à l'utilisation massive de pesticides et explique la logique dérogatoire des épandages aériens. De l'époque de Colbert jusqu'à aujourd'hui, le but d'une colonie est et reste l'enrichissement de la métropole, au mépris du droit.
Propos recueillis par Nicolas Butor
Pour aller plus loin :
J.-F. Niort, Code Noir, Dalloz, 2012.
J.-F. Niort, Le Code Noir : Idées reçues sur un texte symbolique, Le Cavalier Bleu, 2015.
J.-F. Niort, Du Code Noir au Chlordécone, héritage colonial français aux Antilles françaises. Crimes contre l'humanité et réparations, Éditions universitaires européennes, 2016.

De la Nakba à Gaza. Poésie et résistance en Palestine

Mahmoud Darwich (1941-2008) est devenu le porte-voix de la cause palestinienne parce que sa poésie est acte de résistance à portée universelle. Mais la poésie palestinienne est multiple et a vu, depuis la Nakba de 1948 jusqu'à Gaza ces derniers mois, plusieurs générations de femmes et d'hommes écrire sur un futur de liberté et d'indépendance.
Tiré d'Orient XXI.
Dès 1948, la poésie s'est imposée en Palestine occupée face aux autres genres littéraires. Ce n'est pas seulement le signe d'un attachement des écrivains palestiniens à un mode ancien et populaire d'expression dans le monde arabe, mais l'expression d'une volonté de résister aux règles de l'occupation israélienne qui prolongeaient celles du mandat britannique en Palestine (1917-1948). Face aux mesures de répression des forces coloniales, la poésie, qui se transmet et se mémorise aisément, est mieux armée que les autres genres littéraires pour contourner la censure.
C'est d'ailleurs à travers de véritables festivals de poésie ou mahrajanat que la première génération de poètes post 1948 a pu atteindre un large public demeuré sur les terres de Palestine. Parmi les auteurs qui ont participé et se sont révélés lors de ces festivals, se trouvent les grands noms de la poésie palestinienne de cette génération : Taoufik Ziyad (1929-1994), Samih al-Qasim (1939-2014), Mahmoud Darwich (1941-2008), Salim Joubran (1941-2011) et Rashid Hussein (1936-1977). Tous avaient atteint l'âge adulte dans les années qui ont suivi la Nakba de 1948. Ils étaient généralement issus de la classe ouvrière et militaient aussi pour l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et des paysans. Ce qui fait de la poésie palestinienne un genre traditionnellement marqué à gauche.
La majorité de ces poètes ont été formés en arabe et en hébreu, en Palestine occupée ou à l'étranger. Seule la poétesse Fadwa Touqan (1917-2003), autodidacte, aurait été initiée à la poésie par son frère Ibrahim Touqan (1905-1941), lui-même poète. Beaucoup étaient des enseignants dans des écoles gérées par les autorités israéliennes. Ces institutions, tout comme les festivals de poésie et d'autres rassemblements publics comme les mariages et les fêtes religieuses, étaient surveillés de près par les services de sécurité coloniaux qui s'efforçaient de contenir le nationalisme palestinien.
À travers leur poésie, ces auteurs ont joué un rôle important dans la production et la diffusion d'idées à portée politique. Leur participation aux festivals était de fait un geste de résistance. Leurs poèmes, écrits le plus souvent dans le respect des codes de la prosodie arabe traditionnelle, étaient faciles à chanter et à retenir. Ils étaient déclamés devant un auditoire nombreux, coupé du reste du monde arabe et des Palestiniens forcés à l'exil, et traumatisé par les massacres commis par l'armée israélienne. Les poèmes exprimaient le plus souvent espoirs et rêves révolutionnaires de liberté et d'indépendance, mais ils abordaient aussi des thèmes plus graves liés au sentiment de dépossession, et aux violences physiques et symboliques subies.
C'est au cours de ces festivals que se développe le concept de résistance, de sumud ou persévérance face à l'adversité, concept qui deviendra un thème majeur de la poésie palestinienne notamment chez Taoufik Ziyad avec son célèbre poème Ici nous resterons dont cet extrait résonne comme un manifeste politique et poétique :
- Ici nous resterons
- Gardiens de l'ombre des orangers et des oliviers
- Si nous avons soif nous presserons les pierres
- Nous mangerons de la terre si nous avons faim mais nous ne partirons pas !
- Ici nous avons un passé un présent et un avenir (1)
La participation aux festivals a valu à plusieurs auteurs comme Taoufik Ziyad et Hanna Ibrahim (1927- ) d'être arrêtés puis emprisonnés ou assignés à domicile. Ils n'ont pas renoncé pour autant à composer des poèmes, et la colère et l'indignation traversent de nombreux textes. En témoigne cet extrait d'un poème du charismatique Rashid Hussein que Mahmoud Darwich surnommait Najm ou l'étoile, et auquel Edward Saïd rend un hommage appuyé dans l'introduction de son ouvrage sur la Palestine (2) :
- Sans passeport
- Je viens à vous
- et me révolte contre vous
- alors massacrez-moi
- peut-être sentirai-je alors que je meurs
- sans passeport (3)

Certains poèmes deviendront des chansons populaires, connues de tous en Palestine occupée et ailleurs, comme celui intitulé Carte d'identité, composé par Mahmoud Darwich, en 1964 :
- Inscris
- je suis arabe
- le numéro de ma carte est cinquante mille
- j'ai huit enfants
- et le neuvième viendra… après l'été
- Te mettras-tu en colère ? (4)
Si les anthologies et recueil imprimés demeurent assez rares jusqu'aux années 1970 et ne représentent, d'après le chercheur Fahd Abu Khadra, qu'une infime partie des poèmes composés et publiés entre 1948 et 1958, certains poètes auront recours aux organes de presse de partis politiques pour diffuser leurs écrits. Le Parti des travailleurs unis (Mapam) a par exemple soutenu et financé la revue Al-Fajr (l'Aube), fondée en 1958 et dont le poète Rashid Hussein était l'un des rédacteurs en chef. Subissant attaques et censure, la revue sera interdite en 1962.
Les membres du Parti communiste israélien (Rakah) ont pour leur part relancé la revue Al-Itihad (L'Union) en 1948, qui avait été fondée en 1944 à Haïfa par une branche du parti communiste. À partir de 1948, Al-Itihad ouvre ses colonnes à des poètes importants comme Rashid Hussein, Émile Habibi (1922-1996), Hanna Abou Hanna (1928-2022). Ces revues ont joué un rôle crucial pour la cause palestinienne en se faisant les porte-voix d'une poésie de combat. Longtemps regardés avec méfiance et suspectés de collaborer avec les forces coloniales par le simple fait d'être restés, c'est Ghassan Kanafani (1961-1972), auteur et homme politique palestinien qui a redonné à ces auteurs la place qu'ils méritent, en élaborant le concept de « littérature de résistance » (5) . Cette littérature est considérée par certains comme relevant davantage d'une littérature engagée que d'une littérature de combat, restreinte par le poète syrien Adonis (1930- ), à tort nous semble-t-il, au combat armé.
Cette poésie a par ailleurs souvent été critiquée pour être davantage politique que « littéraire », comme si l'un empêchait l'autre. À ce sujet, Mahmoud Darwich fait une mise au point salutaire :
- Mais je sais aussi, quand je pense à ceux qui dénigrent la « poésie politique », qu'il y a pire que cette dernière : l'excès de mépris du politique, la surdité aux questions posées par la réalité de l'Histoire, et le refus de participer implicitement à l'entreprise de l'espoir (6).
Pour finir, il est important de noter que les poèmes de cette période n'évoquent pas seulement la Palestine et son combat pour l'indépendance. Y apparaissent d'autres causes de la lutte anticoloniale, notamment celle du peuple algérien, ou des Indiens d'Amérique. Dans un poème de 1970, Salem Joubran (1941-2011) interpelle ainsi Jean-Paul Sartre qui a défendu la cause algérienne mais reste silencieux quant à la colonisation de la Palestine :
- À JEAN-PAUL SARTRE
- Si un enfant était assassiné, et que ses meurtriers jetaient son corps dans la boue,
- seriez-vous en colère ? Que diriez-vous ?
- Je suis un fils de Palestine,
- je meurs chaque année,
- je me fais assassiner chaque jour,
- chaque heure.
- Venez, contemplez les nuances de la laideur,
- toutes sortes d'images,
- dont la moins horrible est mon sang qui coule.
- Exprimez-vous :
- Qu'est-ce qui a provoqué votre soudaine indifférence ?
- Quoi donc, rien à dire ? (7)
Autre figure souvent citée, celle de Patrice Lumumba auquel on rend hommage après son assassinat par les forces coloniales belges. Rashid Hussein déclame ce poème lors d'un festival de poésie :
- L'Afrique baigne dans le sang, avec la colère qui l'envahit,
- Elle n'a pas le temps de pleurer l'assassinat d'un prophète,
- Patrice est mort... où est un feu comme lui ?...
- Il s'est éteint, puis a enflammé l'obscurité en évangile (8).
Cultiver l'espoir et renouveler le combat
Les générations de poètes qui ont suivi celle de 1948 perpétuent les thèmes de résistance et de combat en leur donnant un souffle politique nouveau. À mesure que les guerres se succèdent, que la situation des Palestiniens de 1948 se détériore, que les camps de réfugiés se multiplient et s'inscrivent dans la durée et que la colonisation de la Palestine se poursuit — en violation des résolutions de l'ONU et du droit international - les thèmes abordés renvoient à la situation intenable de tous les Palestiniens où qu'ils soient. Entre dépossession, exils forcés, conditions précaires et inhumaines dans les camps de réfugiés, emprisonnements arbitraires, massacres, faim, mort, tristesse, les textes cultivent également l'espoir comme en échos au fameux poème de Mahmoud Darwich de 1986, Nous aussi, nous aimons la vie :
- Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens.
- Nous dansons entre deux martyrs et pour le lilas entre
- eux, nous dressons un minaret ou un palmier (9).
En 2011, la poétesse Rafeef Ziadah, née en 1979, compose en réponse à un journaliste qui la somme d'expliquer pourquoi les Palestiniens apprennent à leurs enfants la haine, un poème intitulé Nous enseignons la vie, monsieur (« We teach life, Sir »), qu'elle récite à Londres et dont la vidéo sera amplement partagée :
- Aujourd'hui, mon corps a été un massacre télévisé.
- Aujourd'hui, mon corps a été un massacre télévisé qui devait tenir en quelques mots et en quelques phrases.
- Aujourd'hui, mon corps a été un massacre télévisé qui devait s'inscrire dans des phrases et des mots limités, suffisamment remplis de statistiques pour contrer une réponse mesurée.
- J'ai perfectionné mon anglais et j'ai appris les résolutions de l'ONU.
- Mais il m'a quand même demandé : "Madame Ziadah, ne pensez-vous pas que tout serait résolu si vous arrêtiez d'enseigner tant de haine à vos enfants ?
- Pause.
- Je cherche en moi la force d'être patiente, mais la patience n'est pas sur le bout de ma langue alors que les bombes tombent sur Gaza.
- La patience vient de me quitter.
- Pause. Sourire.
- Nous enseignons la vie, monsieur.
- Rafeef, n'oublie pas de sourire.
- Pause.
- Nous enseignons la vie, monsieur (10).
La poésie se montre critique aussi de l'Autorité palestinienne qui après les Accords d'Oslo se montre défaillante, gère les fonds qui lui sont alloués de manière peu transparente et ne parvient pas à juguler la montée du Hamas que plusieurs poètes palestiniens, traditionnellement de gauche, déplorent. Voici un exemple d'un poème sans concessions et à l'humour corrosif, intitulé L'État de Abbas, rédigé en 2008 par Youssef Eldik (1959-) :
- Celui qui n'a pas mal au derrière
- Ou qui ne voit pas comment le singe se promène,
- Qu'il entre dans l'État de Abbas.
- Cet état est apprivoisé –
- aucune autorité dans cette « Autorité »
- Si un voleur ne se présente pas devant le tribunal
- ils le remplacent par son voisin ou sa femme
- car le gazouillis de l'oiseau sur les fils téléphoniques
- résonnent comme « Hamas ! »
- Notre type de justice s'applique à toutes créatures
- faisant du singe le semblable de son maître
- de l'escroc ….un policier ( …)
- Dieu soit loué
- Après notre humiliation… notre labeur… sommeil,
- nous avons éternué… un Chef d'État
- Oh, peuple : sauvons l'État (11)
Mais si les thèmes se perpétuent, ils prennent aussi une nouvelle dimension, notamment au sein de la diaspora palestinienne vivant en Amérique du Nord, qui désormais écrit en anglais et se met au diapason des nouvelles luttes décoloniales et écologiques internationales. Cette poésie est assez peu connue en France. Quelques poèmes ont été traduits par l'incontournable Abdellatif Laâbi dans une anthologie publiée en 2022 et consacrée aux nouvelles voix mondiales de la poésie palestinienne (12). Laâbi avait déjà publié en 1970 une première Anthologie de la poésie palestinienne de combat, suivie vingt ans plus tard de La poésie palestinienne contemporaine.
Dans cette nouvelle poésie contemporaine, on notera les recueils de Remi Kanazi (1981-) poète et performer qui, dans une langue nerveuse et moderne, utilise souvent l'adresse, puise dans le langage moderne des hashtags et des réseaux sociaux, et s'inspire de la rythmique incisive du hip-hop, reprenant peut-être aussi inconsciemment les codes de la poésie arabe de ses prédécesseurs qui déclamaient leurs vers lors des festivals de poésie. Voici deux exemples de sa poésie percutante (13). L'un est extrait du poème intitulé Hors saison :
- mais vos proverbes ne sont pas de saison
- des anecdotes plus jouées
- que les contes d'un pays
- sans peuple (...)
- vous ne voulez pas la paix
- vous voulez des morceaux
- et ce puzzle
- ne se termine pas
- bien pour
- vous
L'autre poème est intitulé Nakba :
- Elle n'avait pas oublié
- nous n'avons pas oublié
- nous n'oublierons pas
- des veines comme des racines
- des oliviers
- nous reviendrons
- ce n'est pas une menace
- pas un souhait
- un espoir
- ou un rêve
- mais une promesse
Le thème de la terre traverse bien évidemment l'ensemble de la poésie palestinienne puisqu'elle est au cœur de la colonisation de peuplement dont ils sont victimes depuis 1948. Il est également mobilisé par des poètes de la diaspora mais sous un angle sensiblement différent. Il ne s'agit plus de revenir sur la catastrophe de 1948 pour déplorer une dépossession en des termes qui reprennent la terminologie capitaliste donc colonialiste et d'exprimer d'une volonté de réappropriation des terres. Il s'agit désormais de penser la Nakba en tant que catastrophe et lieu de rupture écologique. Cette rupture écologique a touché la Palestine en 1948 mais elle touche la Planète entière. C'est ainsi que Nathalie Handal (1969- ), dans un hommage qu'elle rend à Mahmoud Darwich, imagine ce que lui dirait le poète disparu dans une veine poétique et universelle :
- Je lui demande s'il vit maintenant près de la mer.
- Il répond : « Il n'y a pas d'eau, seulement de l'eau, pas de chanson, seulement de la chanson, pas de version de la mort qui me convienne, pas de vue sur le Carmel, seulement sur le Carmel, personne pour l'écouter » (14).
Naomi Shihab Nye (1952- ) pour sa part décentre l'humain pour redonner force et pertinence à son propos écologiste. Dans le poème Même en guerre, elle écrit :
- Dehors, les oranges dorment, les aubergines,
- les champs de sauge sauvage. Un ordre du gouvernement,
- Vous ne cueillerez plus cette sauge
- qui parfume toute votre vie.
- Et toutes les mains ont souri (15).
Elle fait le lien entre les oranges, les aubergines, la sauge et probablement des dormeurs sans méfiance, juste avant un raid de l'armée israélienne. Et si les mains sourient, c'est probablement par dépit et pour défier les autorités coloniales et leurs décisions arbitraires. Il n'y a là aucune hyperbole, les autorités israéliennes ayant en effet interdit aux Palestiniens de 1948 de cueillir plusieurs herbes, notamment le zaatar, pour en réserver l'exploitation et la vente aux colons israéliens.

Gaza, poésie et génocide
Depuis octobre 2023, la poésie palestinienne est en deuil, toutefois elle reste au combat. Si la poésie française a eu son Oradour (16), chanté et commémoré par des poètes comme Georges-Emmanuel Clancier (1914-2018), la poésie palestinienne ne compte plus le nombre de villages et localités dévastés depuis plus de trois mois auxquels il faut ajouter toutes les guerres et attaques infligées à la bande de Gaza depuis 1948. À la fin du second conflit mondial, le philosophe Theodor Adorno avait affirmé qu'il était impossible d'écrire de la poésie après Auschwitz. Si l'on a retenu cette affirmation, on oublie souvent qu'Adorno est plus tard revenu sur ses propos, considérant que face à l'inhumain, à l'impensable, la littérature se doit de résister.
Avec plus de 23 000 morts et 58 000 blessés dénombrés à ce jour, la littérature palestinienne perd elle aussi des hommes et des femmes. Refaat Alareer (1979-2023), professeur de littérature à l'Université islamique de Gaza et poète, avait fait le choix de la langue anglaise pour mieux faire connaître la cause palestinienne à l'étranger. Il a été tué lors d'une frappe israélienne dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 décembre. Le 1er novembre il a écrit un poème traduit et publié dans son intégralité par Orient XXI et dont voici un extrait :
- S‘il était écrit que je dois mourir
- Alors que ma mort apporte l'espoir
- Que ma mort devienne une histoire
Quelques semaines plus tôt, le 20 octobre 2023, c'est Hiba Abou Nada (1991-2023), poétesse et romancière de 32 ans, habitante de Gaza qui est tuée. Voici un extrait d'un poème, écrit le 10 octobre, quelques jours avant sa mort :
- Je t'accorde un refuge
- contre le mal et la souffrance.
- Avec les mots de l'écriture sacrée
- je protège les oranges de la piqûre du phosphore
- et les nuages du brouillard
- Je vous accorde un refuge en sachant
- que la poussière se dissipera,
- et que ceux qui sont tombés amoureux et sont morts ensemble
- riront un jour (17).
Poésie tragique d'une femme assiégée qui offre refuge à l'adversaire. On y retrouve le thème de la persévérance mais aussi de la générosité et de l'amour de la vie en dépit de l'adversité, des violences subies, du génocide en cours et de sa mort imminente.
Fondée en 2022 et basée à Ramallah, la revue littéraire Fikra (Idée) donne voix en arabe et en anglais aux auteurs palestiniens. Depuis le début des exactions contre la population civile de Gaza, elle a publié les poèmes de Massa Fadah et Mai Serhan. Le poème écrit par cette dernière et intitulé Tunnel met en accusation l'Occident et son hypocrisie vis-à-vis de la cause palestinienne :
- Piers Morgan ne cesse de poser la question,
- « qu'est-ce qu'une réponse proportionnée ? »
- Dites-lui que cela dépend. Si c'est une maison
- de saules et de noyers, alors c'est à l'abri des balles, un souvenir. Si c'est un mot
- c'est un vers épique, et il n'y a pas
- de mots pour l'enfant blessé, sans famille
- qui lui survit - seulement un acronyme, une anomalie
- Dites-lui que si c'est un enfant, il ne devrait
- pas hanter ses rêves, l'enfant n'était
- pas censé naître d'une mère, mais
- d'une terre. Cet enfant est une graine, rappelez-le-lui,
- la graine est sous terre, chose têtue,
- plus souterraine que le tunnel.
D'autres plateformes, comme celle de l'ONG Action for Hope, s'efforce de donner voix à des poètes palestiniens qui, sous les bombes ou forcés à fuir, continuent d'écrire et de faire parvenir des textes bouleversants de vérité et de courage. À travers l'initiative « Ici, Gaza » (« This is Gaza »), des acteurs lisent des textes en arabe sous-titrés en anglais ou en français. Un livret de poèmes a été mis en ligne en arabe et anglais pour donner à cette poésie une plus grande portée en atteignant des publics arabophones et anglophones.
La poésie refuse de se résoudre à l'horreur mais aussi à tous les diktats, ceux de la langue, de la forme, de la propagande et des discours dominants. Cela a toujours été sa force quelles que soient les époques et les latitudes. Elle a résisté aux fascismes, aux colonialismes et autoritarismes et a payé ses engagements par la mort, l'exil ou la prison. De Robert Desnos (1900-1945) mort en camp de concentration à Federico Garcia Lorca (1898-1936) exécuté par les forces franquistes, de Nâzim Hikmet (1901-1963) qui a passé 12 ans dans les prisons turques à Kateb Yacine (1929-1989) emprisonné à 16 ans par la France coloniale en Algérie, de Joy Harjo (1951- ) qui célèbre les cultures amérindiennes, à Nûdem Durak (1993- ) qui chante la cause kurde et croupit en prison depuis 2015, condamnée à y demeurer jusqu'en 2034, partout où l'obscurantisme sévit, la poésie répond et se sacrifie.
On tremble pour ce jeune poète de Gaza, Haidar Al-Ghazali qui comme ses concitoyens s'endort chaque nuit dans la peur de ne pas se réveiller le lendemain, auteur de ces lignes bouleversantes :
- Il est maintenant quatre heures et quart du matin, je vais dormir et je prépare mon corps à l'éventualité d'une roquette soudaine qui le ferait exploser, je prépare mes souvenirs, mes rêves ; pour qu'ils deviennent un flash spécial ou un numéro dans un dossier, faites que la roquette arrive alors que je dors pour que je ne ressente aucune douleur, voici notre ultime rêve en temps de guerre et une fin bien pathétique pour nos rêves les plus hauts.
- Je m'éloigne de la peur familiale vers mon lit, en me posant une question : qui a dit au Gazaoui que le dormeur ne souffre pas ? (18)
Notes
1- Cité dans The Tent Generation, Palestinian Poems, Selected, introduced and translated by Mohammed Sawaie, Banipal Books, Londres, 2022. (ma traduction).
2- Edward Said, La Question de Palestine, Actes Sud, 2010.
3- Rashid Hussein, Al-Amal al-shiriyya (Œuvres poétiques complètes), Kuli Shay', 2004. (ma traduction).
4- Mahmoud Darwich, Carte d'identité, in La poésie palestinienne contemporaine, poèmes traduits par Abdellatif Laâbi, Écrits des Forges, 1990.
5- Ghassan Kanafani, Adab al-Muqawama fi Filastin al-Muhtalla 1948-1966, (La littérature de résistance en Palestine occupée 1948-1966), Muassasat al-Abhath al-Arabiya, 1966.
6- Mahmoud Darwich, La Terre nous est étroite et autres poèmes, traduit de l'arabe par Élias Sanbar, nrf, Poésie, Gallimard, 2023.
7- Cité dans The Tent Generation, Palestinian Poems, Selected, introduced and translated by Mohammed Sawaie, Banipal Books, Londres, 2022 (ma traduction).
8- Rashid Hussein, Al- Amal al-shiriyya (Œuvres poétiques complètes), Kuli Shay', 2004 (ma traduction).
9- Mahmoud Darwich, La Terre nous est étroite et autres poèmes, p.227.
10- Le poème ainsi que d'autres a donné lieu à un album de poésie déclamé, intitulé We Teach life, Sir, 2015. https://www.rafeefziadah.net/js_albums/we-teach-life/
11- Cité dans The Tent Generation, Palestinian Poems, (ma traduction).
12- Anthologie de la poésie palestinienne d'aujourd'hui. Textes choisis et traduits de l'arabe par Abdellatif Laâbi. Points, 2022.
13- Les deux poèmes sont extraits de Remi Kanazi, Before the Next Bomb Drops. Rising Up from Brooklyn to Palestine, Haymarket Book, 2015 (ma traduction).
14- Nathalie Handal, Love and Strange Horses, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2010, p 8. (Ma traduction).
15- Naomi Shihab Nye, 19 Varieties of Gazelle Gazelle : Poems of the Middle East, Greenwillow Books, 2002, p 50 (ma traduction).
16- Oradour : le 10 juin 1944, les troupes allemandes massacrent la population entière, 642 habitants, d'Oradour-sur-Glane, village de Haute-Vienne.
17- Le poème a été publié dans son intégralité en anglais sur le site de la revue en ligne Protean Magazine
18-Texte écrit le 27 octobre 2023, après que tous les moyens de communication ont été coupés, et dont l'auteur ne pensait pas qu'il parviendrait à ses destinataires, mis en ligne par Action for Hope.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« 20 000 espèces d’abeilles » : la découverte de la transidentité chez l’enfant*

À travers le regard d'une petite fille mal dans son corps, la réalisatrice basque Estibaliz Urresola Solaguren aborde la question de la transidentité chez l'enfant. Un tour de force porté par l'interprétation poignante de sa jeune actrice.
Par Pablo Patarin
Tiré de l'Humanité, France. Mise à jour le vendredi 16 février 2024
Visionner la bande-annonce.
Aitor ne se sent pas garçon. Aitor ne se sent même pas Aitor. Aitor, qui se fait parfois appeler Cocó, est une petite fille coincée dans un corps de garçon et elle ne sait pas quoi en faire. Car elle n'a que 8 ans. Un âge où beaucoup considèrent qu'il est impossible de savoir qui l'on est, d'autant plus dans une famille basque où le catholicisme reste omniprésent. Durant les vacances, Cocó, sa mère et sa fratrie traversent la frontière franco-espagnole pour retrouver le reste de la famille dans un village charmant entouré de paysages somptueux.
Cocó y est entourée de femmes, sa grand-mère, sa mère, et surtout sa tante, dernière représentante d'une lignée d'apicultrices. C'est dans ce cadre, où langues basque et espagnole se confondent avec fluidité, que Cocó se révèle peu à peu, avec toutes les difficultés qu'une enfant de cet âge peut avoir à s'affirmer, d'autant plus lorsqu'elle est entourée d'adultes qui peinent à la comprendre. Ses longs cheveux troublent, son refus de se rendre à la piscine étonne…
*L'enfant trop souvent ignorée*
Cocó et sa solitude émeuvent. Incomprise, elle se confronte aux constructions sociales des êtres qui l'entourent. Mais Cocó va les bousculer, en même temps qu'elle apprend à être elle-même. Le film d'Estibaliz Urresola Solaguren, nourri de rencontres avec des familles ayant vécu cette situation, remue le spectateur. Par sa thématique, son choix fort de montrer la perspective de l'enfant trop souvent ignorée, mais surtout par l'interprétation bouleversante de la mère ( Patricia López Arnaiz ) et de la jeune Cocó ( Sofia Otero ). D'un naturel rare à cet âge, le jeu de Sofia Otero a été salué à la Berlinale 2023 avec le prix d'interprétation ( non genré ). Si, par sa durée et la répétition de saynètes parfois redondantes, « 20 000 espèces d'abeilles » tire en longueur, son point de vue singulier et son sujet capital en font une œuvre touchante.
« 20 000 espèces d'abeilles » d'Estibaliz Urresola Solaguren est à découvrir au cinéma dès le 14 février.
Photo © 2023 GARIZA FILMS INICIA FILMS SIRIMIRI FILMS ESPECIES DE ABEJAS AIE
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
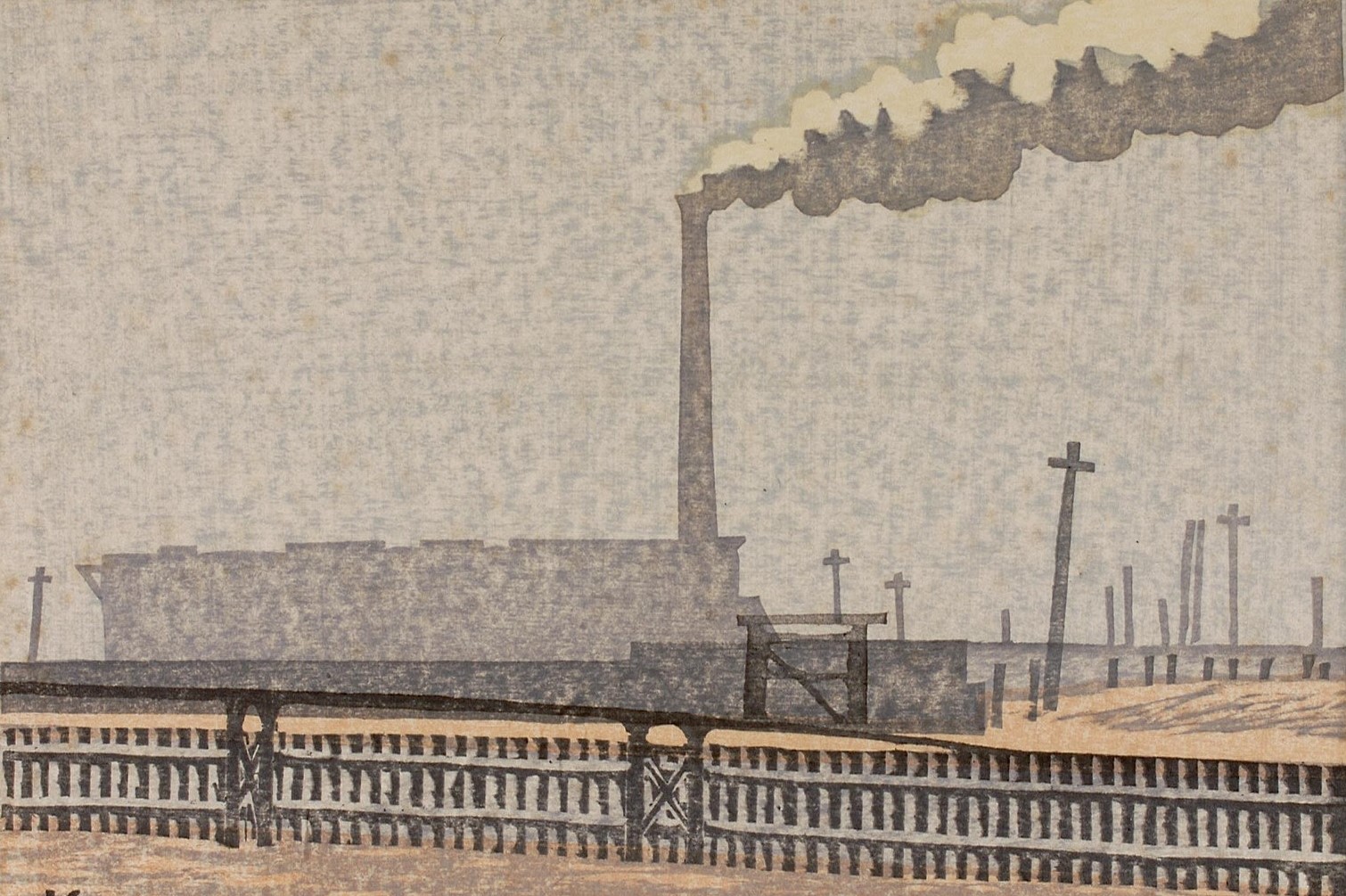
Une stratégie écosocialiste pour gagner le futur
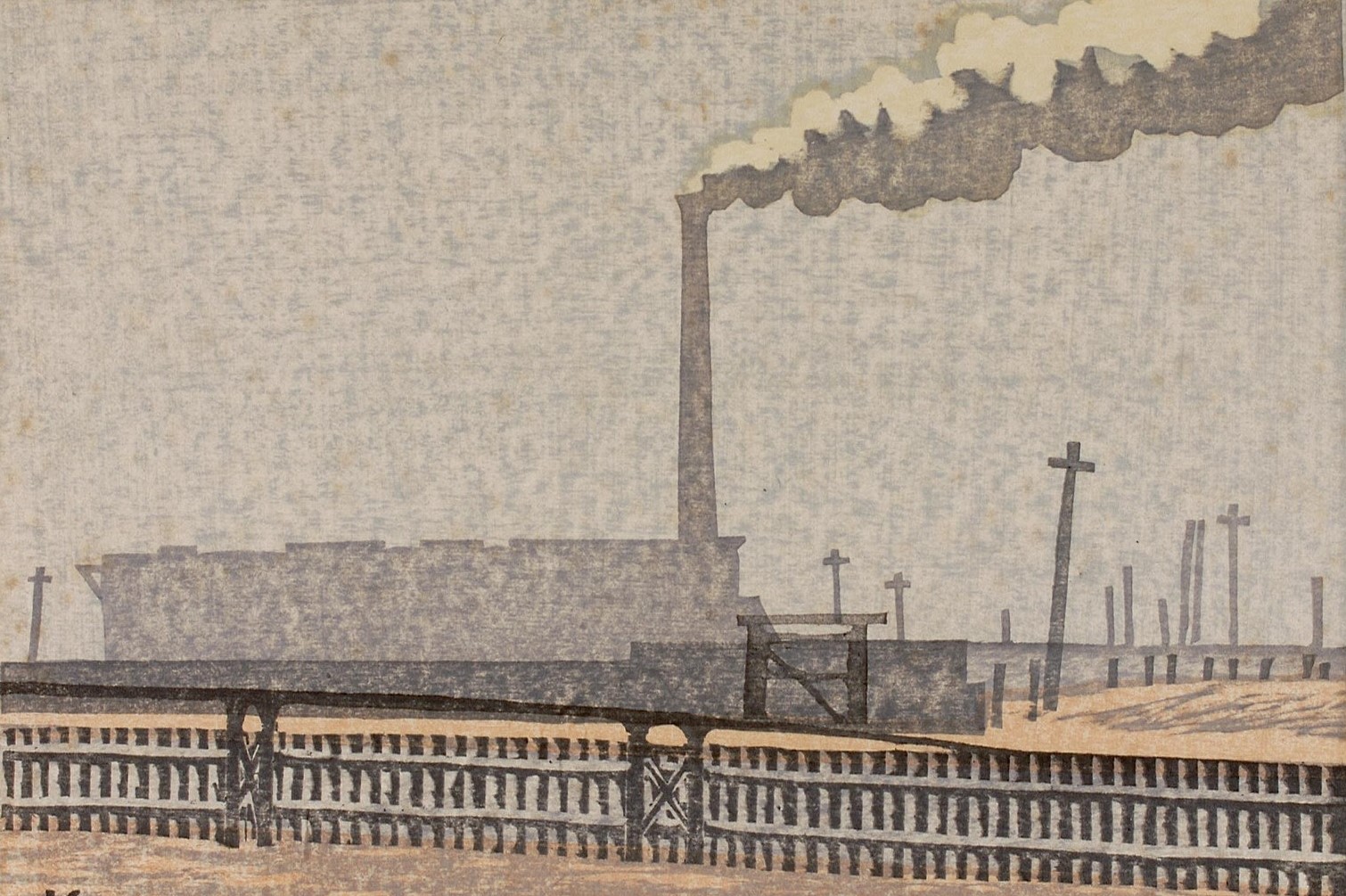
Le monde où nous vivons connaît une crise multiforme : économique, politique et écologique. Des centaines de millions de personnes ont vu leur niveau de vie se détériorer et les perspectives deviennent brumeuses, alors que d'autres centaines de millions de personnes connaissent les sécheresses, les inondations et d'autres impacts du changement climatique, qui ne se feront que s'aggraver avec le passage du temps.
Tiré de la revue Contretemps
15 février 2024
Par Sabrina Fernandes
Quand les négociations climatiques internationales stagnent et que l'activisme climatique prédominant se désespère toujours plus, la nécessité d'un modèle de société différente et d'une stratégie politique pour y parvenir n'a jamais été aussi urgente. Mais quelles seraient concrètement leurs caractéristiques ? Autrice, sociologue et militante au Brésil, Sabina Fernandes développe ici ce que pourrait être une stratégie écosocialiste permettant de stopper la marche du capitalisme vers la catastrophe.
***
Développer une stratégie effective pour un changement politique radical implique d'avoir une vision claire des antagonismes, des alternatives et des voies d'exécution. Si nous reconnaissons que les nombreuses crises actuelles sont les effets communs du projet capitaliste (et non des déviations de celui-ci), pour donner des réponses, nous devons nommer l'antagoniste d'une manière qui permette aux gens d'identifier le problème et de s'y opposer. Ce n'est pas facile, vu que l'hégémonie capitaliste est aussi liée à sa capacité à masquer la réalité, à promouvoir le consensus et à terroriser ceux qui s'avisent à mettre sur le banc des accusés ce qui est mal.
Ensuite, nous devons imaginer ce qui vient après. Il ne suffit pas de s'opposer à quelque chose si l'on n'offre pas une alternative qui soit à la fois attractive et possible. Si le capitalisme est le mal, que voulons-nous à sa place ? On a proposé de nombreuses options, dont certaines pourraient être pires que notre capitalisme actuel. Si le capitalisme détruit la planète, que dire d'une nouvelle ère de capitalisme colonial dans l'espace ? Des multimillionnaires ont utilisé cette vision pour stimuler l'imagination et susciter la foi dans des solutions technologiques comme manière de favoriser leurs propres intérêts d'entrepreneurs et attirer davantage d'investisseurs. D'autre part, des scientifiques et le mouvement de défense de l'environnement répondent en affirmant l'évidence : il n'y a pas de planète B !
Notre tâche consiste à démontrer qu'il ne suffit pas de remplacer le capitalisme, vu que ses succédanés peuvent poser problème. Ce qui vient après doit aborder les failles du système actuel et être meilleur de différentes manières, afin de démontrer que le statu quo n'a simplement plus de sens. L'alternative doit faire que le capitalisme s'avère inadéquat, inutilisable et obsolète.
Le problème avec le comment réside dans le fait que souvent il est perçu comme une simple question de choix entre des mécanismes et des instruments disponibles dans un arsenal existant. Si nous voulons aller de la ville de México à Guadalaraja, nous pouvons choisir l'automobile, l'autocar, l'avion ou même les jambes. Une vision purement instrumentale du comment dépolitise les conditions et les conséquences des méthodes employées, et nous empêche d'évaluer continuellement la compatibilité entre une tactique adoptée et la stratégie générale.
Nos instruments sont soumis à des conditions politiques : temps et espace, chaînes de production et de distribution, disponibilité des ressources, engagement des acteur.trice.s, possibilité de déviation, question des ajustements dans le cours du processus de changement social… Cela signifie qu'une fois que nous identifions le capitalisme comme le problème principal et nous proposons en effet le socialisme comme la meilleure alternative, la manière d'y arriver implique non seulement un choix entre réforme ou révolution, mais détermine essentiellement les conditions nécessaires à créer pour prendre le pouvoir tout en le transformant, et le maintenir. Nous ne pouvons pas nous contenter de désirer la fin du capitalisme et de le remplacer par le socialisme.
Faire l'histoire, aujourd'hui et dans le futur
Karl Marx écrivait que « les hommes font leur propre histoire, mais… dans des conditions directement données et héritées du passé » [1]. Cela veut dire que nous ne devons pas accepter ces circonstances, ces conditions ou ces entraves, mais que notre tâche consiste à créer des conditions différentes pour en hériter dans le futur, des conditions qui nous offriront plus de possibilités d'implanter des éléments de notre stratégie.
Quand nous proposons le socialisme comme système qui nous sauvera du capitalisme, il ne suffit pas d'affirmer simplement que la révolution socialiste est nécessaire parce que sans elle la société ne survivra pas. Pour ceux et celles qui sont déjà convaincu.e.s de l'urgente nécessité de renverser le capitalisme, ces affirmations ne sont que des lapalissades utilisées pour confirmer nos propres positions radicales. Que cette réalité nous plaise ou non, nulle part nous avons à faire à l'imminence d'un soulèvement révolutionnaire et l'établissement d'alternatives socialistes à l'échelle globale. Dire cela n'est pas de l'anticommunisme défaitiste, mais c'est reconnaître simplement les conditions concrètes que nous a léguées le passé.
Assumer de manière critique nos déficiences nous mène à aborder les contradictions relatives aux temps de la construction du socialisme dans ce monde qui se réchauffe de manière accélérée. Cela nous met face au temps : le temps que nous avons perdu, le temps que nous consacrons maintenant et le temps que nous n'avons simplement pas. Si la révolution est le frein d'urgence du train emballé de l'Anthropocène, pour employer la métaphore de Walter Benjamin, nous avons aussi besoin d'un plan d'évacuation. La transition écologique passe par la manière dont nous prenons des mesures de sécurité pour nous préparer à l'impact de la révolution et pour nous équiper afin de débarquer dans un terrain inexploré.
Plus qu'aucune crise qui nous affecte aujourd'hui, la crise écologique altère radicalement notre sens de l'urgence, parce qu'elle comporte l'effondrement des conditions matérielles qui rendent la vie possible. Cette crise, comme les autres, est en majeure partie le produit du système capitaliste. Les facteurs de la grande accélération, qui va de l'augmentation des températures globales à la perte de la biodiversité, sont associés à l'aspect insoutenable du mode de production en vigueur. Cette grande accélération ne peut pas être arrêtée par des solutions capitalistes, parce que le capital requiert toujours plus de ressources naturelles pour que son cycle d'accumulation se poursuive.
En ce sens, le capitalisme vert suppose une menace supérieure au négationnisme climatique ordinaire, vu qu'il paraît reconnaître le consensus scientifique sur le changement climatique, mais qu'il occulte le rôle du capitalisme dans la crise. Ses solutions développent quelques critiques, mais seulement dans la mesure où elles sont compatibles avec l'objectif ultime de générer des bénéfices futurs. Considérer le capitalisme comme un problème que l'on peut gérer sans changements drastiques du mode de production conduit à de fausses solutions, et rejoint par conséquent le négationnisme climatique.
Il ne suffit pas de changer la manière d'acheter des produits pour résoudre le problème. Les systèmes de compensation des émissions de carbone permettent aux grands pollueurs de maintenir leur niveau d'émissions de gaz à effet de serre, alors que d'autres entreprises s'efforcent de réduire une partie de leurs émissions. Il ne suffit pas d'envisager de nouvelles technologies, dont le développement sert surtout à faire grossir les portefeuilles d'actions de multimillionnaires du secteur de la géo-ingénierie, mais qui peuvent avoir de graves conséquences. Nous ne pouvons pas remplacer simplement la façon de fournir l'énergie à l'industrie et aux entreprises de biens et de services et de les orienter vers les renouvelables, parce que les ressources que nous avons sur la terre sont limitées. Nous devrons nous adapter qualitativement et quantitativement.
Le capitalisme doit disparaître pour que la vie puisse continuer, mais dans nos conditions politiques actuelles aucune solution ne semble être à la fois radicale et suffisamment rapide pour faire face à la crise écologique sans contradictions. Nous affrontons les menaces immédiates de la réorganisation des forces d'extrême droite et fascistes – y compris écofascistes – et la domination croissante du capitalisme vert. Pendant que nous nous organisons pour lutter contre ces menaces, notre travail consiste aussi à identifier et à nous engager dans les possibles lignes d'action qui permettent en même temps d'aborder de nombreuses choses.
Un programme de prévention qui peut commencer sous le capitalisme, comme le soutient David Schwartzman, est essentiel. Pour échapper au désastre écologique, nous devrons mettre en pratique des idées, des politiques, des microsystèmes, des réformes et d'autres accords sociopolitiques qui ralentissent le rythme de la crise tout en jetant en même temps les bases d'un pouvoir populaire capable de la dépasser et de soutenir un nouveau système.
Il s'agit d'une question de soutenabilité radicale. Nous avons besoin d'une stratégie qui opère dans deux dynamiques différentes, de manière à pouvoir rendre compte des contradictions auxquelles on doit faire face. La stratégie requiert que nous pensions simultanément à des questions à court, moyen et long terme, mais avec une flexibilité reconnaissant que l'histoire n'est pas une séquence linéaire d'événements ; de nouvelles contradictions surgissent à mesure que nous faisons l'histoire.
Jeter des bases soutenables pour une action plus radicale dans le futur, c'est créer des conditions qui poseront des problèmes auxquels nous ne sommes pas préparés ou dont nous ne sommes même pas conscients aujourd'hui. Si notre stratégie a du succès, nos problèmes ne consisteront pas simplement à différer la fin du monde, mais à s'occuper de ce que nous faisons réellement dans cette planète durant les siècles à venir, dans les millions d'années qui restent.
Identifier le sujet du changement
Qui peut appliquer cette stratégie ? Uniquement des secteurs de la population dont les intérêts réels résident dans la préservation des conditions de vie sur Terre, en désirant simultanément que cette vie mérite d'être vécue d'une manière inclusive et pacifique ; des personnes qui ont besoin de regagner le temps qui leur a été arraché par l'exploitation capitaliste afin de prolonger le temps de la société humaine sur la Terre.
Notre stratégie ne court pas le risque de rester impliquée dans le capitalisme vert, parce que notre sujet de changement est la majorité de la société exploitée par ce système : la classe travailleuse, les personnes migrantes et réfugiées, les groupes indigènes, les personnes handicapées, les majorités racisées, les femmes et les personnes LGBTQI+ marginalisées. Notre stratégie requiert la construction d'un pouvoir collectif démontrant à la majorité de la classe subalterne qu'il est possible de réorganiser la société et que les résultats de cette restructuration sont désirables.
Les objectifs désirables sont partie intégrante d'une stratégie juste. La vie doit s'améliorer dès le début de l'application d'un programme écosocialiste pour garantir l'appui soutenu à l'horizon socialiste et la viabilité de la rupture, spécialement quand celle-ci se trouve sous des menaces externes de répression, de sanctions et de guerre. Ces menaces doivent se prévoir, vu que notre stratégie défiera dès le début les foyers de l'hégémonie capitaliste et créera les conditions d'une action contre-hégémonique organisée, le plus près d'une conscience socialiste généralisée.
Les menaces augmenteront d'autant plus que nous nous transformerons aussi en une menace. Néanmoins, ces menaces ne doivent pas être utilisées pour justifier des renoncements. Les attaques limitent les lignes d'action, mais elles ne peuvent pas être une excuse pour prendre le chemin le plus facile, c'est-à-dire restreindre les libertés qui constituent le noyau du projet socialiste. Notre stratégie préparera la guerre, mais elle essaiera de l'éviter en jetant les bases de la paix.
En résumé, notre stratégie consiste en une transition écologique, qui rende possible la transition socialiste, pour passer d'une société profondément insoutenable à une société où le risque d'effondrement aura été retardé au moins pour quelques siècles.
Vu que l'effondrement planétaire est un risque réel dans ce siècle, comme l'évalue le rapport d'évaluation globale sur la réduction du risque de désastres de 2022 [2], la transition écologique devrait se produire dans un court terme, dans les 20 ou 30 prochaines années. Ainsi, en supposant que le capitalisme soit le système dominant des prochaines décennies, la transition écologique se produira dans sa plus grande partie sous le système actuel. Cela n'est pas dû au fait que nous optons pour réaliser cette transition sous le capitalisme, mais au fait que si celle-ci n'intervient pas immédiatement, il n'y a pas de possibilité d'arriver au socialisme vu l'épuisement des conditions qui soutiennent la vie. Après tout, nous continuons dans le train.
La transition écologique constitue notre réponse initiale et, si elle se fait correctement, elle nous permettra d'appliquer les meilleurs plans à long terme. Bien sûr, une fois que se produit le passage du capitalisme au socialisme, on pourra réaliser des aspects bien plus radicaux de la transition écologique au sein d'une transition écosocialiste avec différents piliers de propriété et de pouvoir.
Vu que les réformes promues par les nombreux plans et accords de la transition écologique ne sont pas suffisants pour dépasser réellement le capitalisme, notre stratégie requiert la construction de puissants mouvements qui garantissent ces réformes, mais qui créent aussi les conditions de la rupture. André Gorz parlait de « réformes non-réformistes » par leur potentiel pour aider à cultiver des « contre-pouvoirs », le contraire du réformisme qui gère le système. Ainsi, une stratégie écosocialiste requiert une période de combinaison du travail d'organisation et avec un programme solide de transition écologique sous le capitalisme, pour que les fruits de ce labeur permettent, en dernière instance, de rompre avec le système et de construire une société écosocialiste.
Deux dynamiques politiques interagissent et se soutiennent mutuellement pour former une nouvelle stratégie.
Une dynamique entraîne une transition plus rapide du point A au point B, où nous gagnons du temps et nous offrons des lueurs d'une vie meilleure tandis que nous restons sous le capitalisme. La transition écologique implique une combinaison de plans de transitions et de pactes verts qui profitent du pouvoir limité des réformes dans un premier moment, en se centrant sur des réformes structurelles qui abordent la crise immédiate, renforcent le secteur et la gestion publics, suscitent la participation politique à divers niveaux, font un usage informé des campagnes et de la propagande pour créer de la conscience, préparent les organisations socialistes à gérer les problèmes à leur niveau, nationalisent les ressources, construisent des infrastructures qui favorisent un usage efficient de ces ressources et une vie plus collective et dépassent les frontières avec une perspective d'intégration régionale, de réparations et de solidarité internationale.
L'autre dynamique consiste à construire des mouvements, grâce auxquels nous renforçons la conscience de classe et les normes socialistes démocratiques qui construisent le pouvoir collectif pour une rupture plus radicale qui pointe tous les piliers de la propriété privée, du bénéfice et de l'accumulation dans ce qui sera la transition du capitalisme au socialisme. La construction de mouvement crée le sujet de la transition écologique, mais elle va au-delà, vu qu'elle génère les conditions pour le pouvoir socialiste. Une fois sous l'écosocialisme, la construction des mouvements est essentielle pour consolider le pouvoir populaire, vu qu'une marée implique l'autre et que notre stratégie continue à être réévaluée et réajustée.
Bien au-delà du GND (Green New Deal)
La profondeur de la crise écologique implique que si certaines conditions ne sont pas remplies il n'y a pas de possibilité de construire une société socialiste, bien que la classe ouvrière soit préparée au socialisme. Ainsi, une stratégie écosocialiste efficace se situe dans la connaissance et la matérialité de l'anthropocène, mais elle prétend raccourcir cette ère par des moyens écologiques.
Cette conclusion devrait guider les discussions sur les diverses demandes d'un nouveau pacte vert (Green New Deal, GND). En général, un GND est un ensemble de réformes, d'investissements et d'ajustement liés au frein et à l'adaptation au changement climatique, mais aussi à d'autres aspects de la crise écologique, qui doivent s'appliquer à court terme. Les GND doivent faire partie de notre stratégie, mais notre stratégie ne peut se résumer aux GND, vu qu'ils se résument à un ensemble de politiques publiques et qu'ils sont vulnérables aux changements de gouvernement.
De plus, les programmes nationaux de ce type doivent aussi se coordonner à travers des programmes régionaux et suivre une orientation globale plus générale. Les débats sur un GND présentés par les mouvements sociaux et les organisations de la société civile doivent ébaucher des principes et offrir des issues pour des accords internationaux et le renforcement des alliances. Après tout, la transition écologique requiert une action forte coordonnée pour atteindre des objectifs à court et à moyen terme.
On a présenté différentes versions du GND depuis que ce débat a resurgi aux USA après 2018 [3], certaines plus capitalistes et d'autres plus radicales. Indépendamment des étiquettes utilisées, l'avantage d'intégrer des programmes similaires au GND dans une stratégie écosocialiste est double : ils incluent des changements qui peuvent s'appliquer aujourd'hui et ils peuvent être des outils de mobilisation.
Parfois, les politiciens et les moyens de communication présentent le GND seulment comme une somme d'investissements nécessaires, mais c'est beaucoup plus que cela dans une stratégie écosocialiste. Le niveau d'investissements est important, surtout si nous tenons compte des énormes changements d'infrastructure que requiert la partie climatique de la transition. La seule conversion aux énergies renouvelables coûtera entre 30 et 60 billions de dollars supplémentaires d'ici 2050, selon différentes études. Rendre les habitations plus efficientes et construire de nouveaux logements confortables et respectueux du climat nécessite entre plus de financements. Changer le réseau des transports, développer les nouvelles technologies et cultiver nos aliments de manière efficiente, mais saine et soutenable, tout cela nécessiterait beaucoup plus d'investissements.
Actuellement, le secteur financier affirme pouvoir destiner plus de 100 billions de dollars en actifs pour financer la course vers les émissions zéro net. Mais c'est toujours dans la perspective de préserver le capital fossile, de conserver le paradigme capitaliste, en faisant le choix d'une diversification énergétique plutôt qu'une transition vers autre chose.
L'argument selon lequel la transition climatique peut générer beaucoup d'autres billions de croissance capitaliste attire les investisseurs et plaît aux politiciens prêts à incorporer l'agenda climatique dans leurs programmes, mais seulement s'ils peuvent en tirer profit. Les marchés financiers investiront dans la neutralité carbone de la même manière qu'ils évaluent les actions des entreprises. Ils ne se préoccupent pas de l'essentiel des problèmes écologiques provoqués par la Grande Accélération, parce que cela exigerait de remettre en question la logique de l'accumulation capitaliste dans son ensemble.
De plus, des éléments importants de la transition finissent par être minimisés quand les propositions du GND arrivent dans les programmes politiques généraux, comme cela est arrivé avec la loi de réduction de l'inflation (2022) de Joe Biden aux USA. Quand la politique est dictée davantage par l'investissement climatique que par la justice climatique, il n'y a pas de marge pour pousser les choses vers la gauche, mais le plus probable c'est que le capital fossile lutte pour sa part du gâteau.
Dans une stratégie écosocialiste, les programmes du GND promeuvent l'investissement afin de lutter contre de multiples crises et les combinent avec des initiatives qui impliquent les gouvernements, les communautés, les mouvements et les petites entreprises pour reconfigurer des aspects de la manière dont nous produisons, nous consommons et nous vivons. Un GND peut se centrer sur des objectifs accessibles rapidement et, vu que ces changements sont désirables, ils servent de pôle d'attraction pour réunir davantage de gens, ce qui favorise le bilan et contribue à présenter des demandes plus radicales.
Par exemple, quand on offre une garantie d'emploi vert, la mobilisation peut assurer que les postes de travail créés comportent des salaires dignes, des prestations sociales, des subventions de requalification et la syndicalisation. En combinant ces mesures, une plus grande pression d'en bas, cela peut donner lieu à un GND qui préconise une réduction de la journée de travail.
Lutter pour et contre le temps
La réduction de la journée de travail avec des taux de productivité stables altère le taux d'exploitation du travail, ce qui en fait une revendication anticapitaliste radicale. De fait, on a déjà obtenu des réductions significatives dans plusieurs États capitalistes centraux, appuyées par une longue histoire d'activité syndicale autour de cette question. L'Espagne a débuté récemment une expérience avec la semaine de travail de quatre jours. La France a passé à une semaine de travail de 35 heures en 2000, et les enquêtes indiquent que le nouveau temps libre est consacré à des activités comme la vie familiale, le repos et le sport.
Quand les taux de productivité sont déjà élevés, une semaine de travail plus courte peut même signifier plus d'efficience, ce qui est désirable dans certains secteurs par l'effet positif sur le bien-être de la classe travailleuse. Plus de temps libre entraîne des bénéfices pour la santé, moins de déplacements et ouvre des opportunités pour l'organisation politique, en alimentant les deux dynamiques de notre stratégie. De plus, cela peut aussi contribuer à une charge plus équitable du travail de reproduction sociale dans le foyer.
Ralentir le rythme de vie a des implications spécialement intéressantes au moment d'effectuer les investissements du GND pour les transports publics et les infrastructures ferroviaires.
Quand les gens se voient obligés de choisir entre voyager en train ou en avion, ils tiennent compte du coût, de la durée et du confort en général. La prolifération de lignes aériennes à bas coût a rendu les voyages plus accessibles, mais elle a aussi contribué dans une grande mesure au changement climatique. Le greenwashing de certaines lignes aériennes consiste à compenser leurs émissions carbone sur le marché des bons ou à permettre aux clients d'acheter leurs propres compensations carbone. D'autre part, la recherche sur les combustibles alternatifs dans l'aviation avance. Les technologies de conversion d'énergie solaire en combustible tendent à être plus efficientes que les biocombustibles, mais elles ont d'importantes répercussions dans l'utilisation de l'eau et du réseau solaire, et elles requièrent du CO2 capturé directement ou des options de capture et de stockage du carbone.
Cela signifie que, même si nous souhaitons que certaines technologies améliorent ainsi la transition énergétique en passant directement des énergies fossiles aux énergies renouvelables, les choses ne sont pas si simples. Une chose est de souhaiter la transition du secteur de l'aviation, ce qui implique aussi des changements dans sa dimension, et une autre très différente, c'est de préconiser le simple passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables, en passant par-dessus toutes les autres pressions écologiques associées à la chaîne de production et à la quantité de vols dans le monde entier, notamment dans les sociétés les plus riches.
Notre stratégie doit susciter la recherche et l'innovation dans de meilleures technologies avec des émissions de carbone basses ou nulles, en reconnaissant simultanément que les avancées technologiques ne résoudront pas en soi nos problèmes. Les enjeux liés à l'exploitation des minerais stratégiques nous aident à comprendre qu'il existe des limites intrinsèques au développement du secteur des transports.
Thea Riofrancos a démontré comment le rôle central du lithium dans les projections sur les énergies renouvelables fait partie d'un délicat « lien sécurité-soutenabilité » influencé par les attentes de croissance, en introduisant un chapitre vert dans la longue histoire des zones sacrifiées créées par l'extractivisme, normalement concentrées dans le Sud global ou dans des territoires racialisés du Nord global. Il est simplement absurde d'espérer que nous devions ouvrir toujours plus de mines pour extraire les matériaux nécessaires à produire mille millions de véhicules électriques (VE).
Néanmoins, cette logique a été complètement normalisée par les actuels paradigmes de l'investissement vert, avec des gouvernements au Canada, en Norvège et dans d'autres pays qui optent pour concéder des subventions aux clients, aux concessionnaires et aux fabricants d'automobiles afin de développer la vente de VE aux passagers, au lieu d'étendre massivement les transports publics.
Notre stratégie doit établir des priorités claires. Une manière de le faire consiste à aligner les intérêts des personnes avec les infrastructures nécessaires. Si nous devons réduire le nombre d'avions dans le ciel, comment pouvons-nous offrir aux gens des moyens alternatifs de transport sur des longues distances, qui s'avèrent attractifs en termes de coût, de durée et de confort ? Nous pouvons, par exemple, offrir aux gens davantage de trains à grande vitesse à la place de certaines routes aériennes, profiter des gares situées dans des lieux centraux et baisser les prix, peut-être déclarer le transport gratuit !
La crise énergétique et du coût de la vie qui a frappé l'Europe en 2022 a mené l'Allemagne et l'Espagne à expérimenter des subventions temporaires pour les trains régionaux et le transport de proximité. Si l'on prend au sérieux la crise climatique, les pays et les régions peuvent investir dans des programmes similaires au GND et changer la manière dont les gens utilisent les transports. En ajoutant des infrastructures, on produit d'autres effets positifs, comme la réduction de la congestion et des accidents routiers.
Même si un train à grande vitesse n'est pas aussi rapide qu'un avion, quand nous ralentissons le rythme de vie en donnant plus de temps libre aux gens, la compensation peut ne pas paraître si mauvaise. Le confort de monter simplement dans un train au lieu de passer par le système d'enregistrement d'un aéroport, ou de prendre un autobus gratuit sans passer par des tourniquets et acheter des billets, aide à modifier les comportements et à gagner le consentement de la population.
Quand le capitalisme offre un avantage, celui-ci comporte un prix, tant pour la clientèle que pour l'environnement. Les salades pré-coupées s'avèrent commodes dans un monde où nous avons peu de temps pour les tâches domestiques, mais elles coûtent davantage et comportent un excès d'emballages en plastic. Une stratégie écosocialiste crée des avantages de nature différente, en fournissant une infrastructure publique verte rendant la vie plus facile et meilleure marché pour les travailleur.euse.s, en conciliant les besoins des personnes et de la nature dans la transition écologique.
Vu que nous devons freiner et nous adapter rapidement, la transition écologique gagnera seulement cette course contre le temps si elle génère aussi du temps par la réorganisation de la production et de l'environnement dans lequel nous vivons.
Certaines choses viennent d'abord
Notre stratégie est aussi inégale et combinée. Nous comprenons que le capitalisme a impulsé l'inégalité sur la planète et que le colonialisme continue d'influencer l'avance industrielle et la division internationale du travail. Le sous-développement du Sud global se combine avec l'avance du Nord global.
Quand le sociologue brésilien Florestan Fernandes explique ce phénomène, il souligne que la persistance du capitalisme dépendant dans les pays de la périphérie fait partie d'un calcul capitaliste : le développement du capitalisme dans les marges finit par être dissocié des structures démocratiques et favorise l'établissement d'autocraties. L'intervention impérialiste contribue à tirer profit du déficit démocratique au profit des intérêts d'États plus puissants, s'il convient d'installer des dictatures, comme cela a été la routine en Amérique latine, ainsi qu'en Afrique et au Moyen Orient.
Cette division centre-périphérie a aussi de profondes implications écologiques. Le Climate Action Tracker calcule que le monde atteindra les 2.7° de réchauffement à la fin du siècle en cas de maintien des politiques actuelles. Le pacte pour le climat (Glasgow) de 2021 a échoué une fois de plus dans ses promesses et ses coupes plus radicales. Les politiques actuelles ne sont pas seulement diluées, mais il existe aussi une brèche dans leur application qui conduira à des résultants bien pires et inégaux.
L'Anthropocène peut être considérée comme le fruit de l'intervention humaine, mais de manière asymétrique. Les pays les plus riches ont davantage de responsabilité historique dans le changement climatique que les pays moins développés. Our World in Data calcule que les USA, le Royaume Uni et les 27 membres de l'Union européenne émettent 47 % des émissions mondiales. De plus, bien que le changement climatique affecte toute la planète, les pays les plus pauvres sont moins préparés pour s'adapter à ses effets.
Raison pour laquelle les pays les plus riches devraient assumer la plus grande partie des coûts de la transition écologique. Les programmes nationaux de GND doivent se financer par des fonds publics et les plus riches devraient payer davantage d'impôts. Les menaces de licenciements, de réduction d'effectifs et de tentatives de transférer la charge sur les consommateurs doivent être combattus grâce à une alliance solide entre les organisations de travailleur.euse.s et le mouvement écologique.
De plus, les mécanismes internationaux doivent garantir aux pays les plus pauvres l'accès aux fonds, aux exemptions de brevets pour des technologies clés et l'appui technique pour leur propre ensemble de programmes. Nous devons aller au-delà du financement vert et des promesses faites à l'ONU, vu que leur caractère volontaire a donné lieu jusqu'ici à un degré d'application décevant.
Lors de la COP15 à Copenhague, les pays riches se sont engagés à fournir 100.000 millions de dollars par an pour financer des projets pour freiner et s'adapter au changement climatique dans le Sud global, mais chaque année ces financements stagnent. Pour empirer les choses, une partie significative de ces milliers de millions promis ont consisté en prêts. Le Japon et la France ont assumé plus de la moitié de leurs engagements, spécialement par rapport aux USA, mais le gros de leur contribution a consisté dans des prêts remboursables.
Cela aide à expliquer le déséquilibre du financement, où l'on privilégie souvent les initiatives de ralentissement des changements climatiques sur les projets d'adaptation qui ne génèrent pas de bénéficies, ce qui s'ajoute à l'endettement dévastateur qui étrangle les économies des nations les plus pauvres. Dans son discours d'investiture, le nouveau président (de gauche) de la Colombie, Gustavo Petro, a relevé comment la dette est un obstacle à la transition dans le Sud global.
Des auteurs comme Olúfémi O. Táiwò ont réclamé un paradigme de réparations climatiques et de remise de la dette permettant aux nations les plus pauvres d'aborder le legs négatif de l'esclavage et de la colonisation comme partie de leur transition écologique. Les réparations sont inclues dans les deux dynamiques de notre stratégie, allant bien au-delà du transfert d'argent et offrant un cadre de transition juste qui confère un caractère politique aux conditions actuelles et passées.
La forêt amazonienne s'étend sur neuf pays, et bien que ces États aient sans doute le droit d'améliorer la vie de leurs citoyen.ne.s, ils partagent aussi la responsabilité de soigner l'Amazonie comme ne l'ont pas fait les pays du Nord global pour leurs propres écosystèmes. La mentalité selon laquelle « ils l'ont fait d'abord, ainsi nous pouvons aussi le faire », imprégnant certains discours développementistes dans la région, est aussi dangereuse qu'insensée. Les organisations socialistes dans les pays de la périphérie doivent exiger des réparations, mais la crédibilité de cette action dépend du fait qu'elles assument leur propre responsabilité pour explorer des voies de développement alternatives. La stratégie écosocialiste reconnaît que les États du Sud global ont des responsabilités sur les écosystèmes, mais à moins que les pays compensent leurs responsabilités historiques, le reste du monde sera matériellement incapable de réaliser la transition.
Même aujourd'hui, un certain courant anti-impérialiste soutient que le changement climatique est une tromperie élaborée par les pays impérialistes pour retarder le développement du Sud global. Bien qu'il s'agisse d'une position marginale, certaines variantes de cet argument sont invoquées dans les propositions de gauche sur la crise climatique.
Le pétrole est un bon exemple. Le Venezuela a 300.000 millions de barils en réserves de cru, les plus grandes du monde, et beaucoup affirment que sa souveraineté en dépend. Le développement et l'exportation de pétrole garantissent une affluence massive de capital étranger pour appuyer les investissements dans les services publics et les infrastructures, comme cela se produisit dans les meilleures années de la présidence de Hugo Chávez. Néanmoins, le capitalisme dépendant fait que le Venezuela ne peut pas être un producteur de pétrole autosuffisant. Il lui manque l'infrastructure et les ressources financières nécessaires pour le raffinage, et il est en même temps l'objet d'interventions étrangères qui déstabilisent son économie et détériorent le niveau de vie, créant ainsi une crise permanente.
Néanmoins, même si les socialistes vénézuéliens faisaient tout le nécessaire pour utiliser toutes leurs réserves de pétrole, la souveraineté si désirée resterait hors de portée, vu que le niveau d'émissions que celle-ci nécessiterait rendrait inhabitable la planète, et il n'y a pas de souveraineté sans vie. Ce qui subsisterait, ce serait l'éco-apartheid et les forces éco-fascistes alignées sur les entreprises, ratissant ce qui reste de la Terre à la recherche de résidus et condamnant la majorité des humains à lutter pour la survie.
Réduire les émissions de combustibles fossiles n'est pas une option, mais une nécessité. Il faut faire différents ajustements selon les niveaux de développement pour que les pays de la périphérie ne se voient pas excessivement pénalisés. Néanmoins, l'augmentation de la production du pétrole vénézuélien dépendrait sans doute des ventes aux mêmes pays du Nord global qui doivent avant tout éliminer leur dépendance au pétrole. La nécessité de la transition écologique signifie que le Venezuela ne pourrait pas non plus dépendre du marché du Sud global.
Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que les pays restés stagnants dans les marges du développement n'ont pas besoin de passer par une étape linéaire de plus grande dépendance au pétrole, au charbon et au gaz. Fournir l'électricité aux communautés pauvres pour la première fois peut être une mesure plus propre, en passant directement de l'absence d'énergie à un réseau électrique utilisant des sources renouvelables mixtes et tenant compte des impacts écologiques et communautaires. Il n'y aura pas besoin d'une étape de combustibles fossiles alors que fait partie de notre stratégie un mécanisme de réparations centré sur la démocratie énergétique.
Un pays sous-développé ne peut pas baser sa souveraineté sur les combustibles fossiles, car cela fait du développement de ces énergies un objectif en soi. En même temps, son degré de développement n'est pas le fruit du destin, mais le résultat d'une politique économique internationale historiquement construite. Dès lors, la suppression de la dépendance aux combustibles fossiles est une tâche des pays riches comme des pays pauvres. Un traité de non-prolifération des combustibles fossiles dans un cadre de transition juste pourrait contribuer à gérer ce processus de manière équitable.
Pour un internationalisme soutenable
La stratégie écosocialiste exige un redimensionnement de la souveraineté en termes de soutenabilité radicale. La transition énergique en elle-même nous fait gagner du temps et, si elle se centre sur les nécessités basiques, elle contribue aussi à nous organiser autour des services publics, du logement, de la planification communautaire, de l'impact technologique et d'un paradigme minier post-extractiviste.
La transition écologique sera différente dans chaque pays, selon les responsabilités historiques, mais elle doit se combiner avec la planification du commerce et du développement pour optimiser la manière dont les nations abordent leurs responsabilités écosystémiques. L'histoire nous a enseigné que les pays puissants ne sacrifieront pas volontairement leurs intérêts économiques pour un bien supérieur. Ce type d'impérialisme écologique va de pair avec l'impérialisme politico-militaire et avec sa propre contribution à l'extinction et à la barbarie. Les programmes de transition écologique requièrent la participation de la classe travailleuse pour aligner ses intérêts entre les nations les plus riches et les plus pauvres et exercer une pression commune sur les gouvernements et les institutions internationales.
La consommation d'énergie des pays de l'OCDE est quasiment dix fois supérieure à celle des pays à bas revenus. Bien que les ajustements de l'efficience réduiront cette brèche, les règles de consommation et le mode de vie générale des sociétés les plus riches doivent aussi changer. Ceci dit, le monde développé est aussi déchiré par l'inégalité et de nombreux.ses travailleur.euse.s ne participent pas à ce que Ulrich Brand et Markus Wissen appellent le « mode de vie impérial ». Ce mode de vie exerce une forte pression écologique sur la Terre et il est lié à l'extractivisme industriel touchant les communautés locales du Nord et transformant des régions entières du Sud en zones sacrifiées.
Les ressources minières nécessaires pour alimenter l'appétit capitaliste et soutenir un mode de vie promettant les grandes voitures, les grandes maisons, la viande abondante et les voyages en avion bon marché seront aussi problématiques, même s'ils s'alimentent en énergies renouvelables. Par conséquent, une stratégie écosocialiste doit impliquer de même une décroissance inégale et combinée.
La décroissance sélective concerne les secteurs économiques, les frontières et le territoire. Certaines régions auront besoin de niveaux beaucoup plus élevés d'investissement pour permettre aux gens de jouir pour la première fois d'une bonne alimentation, de logements, de transports et d'emplois stables.
D'autres régions, spécialement dans les pays à hauts revenus, investiront aussi dans des secteurs stratégiques et les feront croître, en même temps qu'ils dépendront des transferts pour construire des infrastructures inclusives et convenables pour les travailleur.euse.s confronté.e.s à des coûts élevés de la vie et aux emplois précaires. Ceci requiert le contrôle populaire des ressources – un thème actuellement à l'ordre du jour au Mexique, en Bolivie, au Chili, en Colombie et dans d'autres lieux – et des alternatives au modèle extractiviste hégémonique.
La lutte de classes dans la politique climatique se produit, de fait, entre le travail et le capital, comme le soutient Matt Huber, mais cela ne devrait pas empêcher de comprendre que la classe travailleuse et le capital sont organisés de manière souvent contradictoires dans tout le Nord global et le Sud global, comme l'ont ébauché les auteurs de la décroissance, de l'écosocialisme et de la théorie marxiste de la dépendance. Les contradictions politiques et économiques confondent souvent les intérêts de la classe travailleuse de différents pays, mais les reconnaître dûment nous aide à identifier où coïncident les intérêts de classe. Notre stratégie fonctionnera seulement si nous nous consacrons à l'éducation politique critique dans le travail syndical et au sein des mouvements, de manière à ce que la pratique transformatrice contrecarre l'influence de l'idéologie capitaliste.
Il est possible de reconnaître l'existence d'un mode de vie impérial, ainsi que sa distribution inégale. Parfois, l'image d'un Nord global et d'un Sud global peut supposer un obstacle analytique, vu qu'elle implique des lignes de conflit géographiques au lieu de processus historiques de production et de distribution des ressources, y compris de main d'œuvre. Les travailleur.euse.s de l'industrie automobile d'Allemagne et du Brésil affrontent des réalités différentes en matière d'infrastructures, de salaires, de droits et de géopolitique, mais dans leurs sociétés respectives ils/elles sont sujets à des antagonismes de classe similaires et affrontent les mêmes défis.
La transition écologique doit avoir un sens pour la classe travailleuse du monde entier. L'impératif conventionnel de la croissance économique a débouché sur l'emploi précaire et les taux élevés d'exploitation. Cela signifie qu'un débat sur la décroissance inégale et combinée peut améliorer réellement les demandes d'emplois écologiques socialement nécessaires et de qualité, ainsi que le type des conditions de vie que les communautés peuvent désirer, si nous centrons notre stratégie dans des cadres alternatifs de suffisance, de solidarité et de justice, comme le suggère Bengi Akbulut.
Pour réussir la transition écologique, la classe travailleuse mondiale devra ajuster ses attentes. Nous devons rejeter le style de vie consumériste du capitalisme et tenir compte des limitations énergétiques et matérielles à l'heure de planifier une vie digne. Ces impératifs génèrent des conflits autour de qui peut utiliser une ressource et dans quelle quantité, des problèmes qui ne pourront pas toujours se résoudre avec des technologies améliorées.
De fait, ce sont parfois les technologies les plus anciennes qui peuvent nous sauver, comme le retour à l'agro-écologie, l'usage du sol le plus efficient et sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La réforme agraire et un processus juste de délimitation des terres indigènes sont les conditions nécessaires pour que la classe travailleuse rurale bénéficie de la transition écologique en dépassant la pauvreté et en changeant notre manière d'alimenter le monde.
Vu qu'il n'existe pas de transition juste sans souveraineté indigène, notre compréhension de quoi va où – que ce soit des turbines éoliennes ou des forêts repeuplées – exige d'améliorer notre approche des droits territoriaux et des formes de vie. La classe travailleuse urbaine du monde entier doit sortir gagnante et doit coordonner la demande de manière à ce que l'exploitation des ressources ne conduise pas à la création de nouvelles zones sacrifiées.
Nous devons aussi être sincères sur le fait que de nombreux emplois promis durant la transition sont temporaires, vu qu'ils sont liés à la construction de nouvelles infrastructures. Dépasser l'obsolescence programmée signifiera aussi une production plus efficiente. Certains emplois peuvent être reconvertis des secteurs sales aux secteurs propres, tandis que d'autres devront disparaître complètement, comme l'industrie d'armements. Être sincères sur ce point aidera à approfondir la dynamique organisationnelle dans les syndicats, les associations et les mouvements sociaux en général, pour ne laisser personne en arrière. Ce type de calcul se produira au sein et hors des frontières, peut-être à de nombreuses reprises au quotidien. Le succès de notre stratégie écosocialiste dépend de la qualité de la construction du mouvement internationaliste et de notre capacité à coordonner la planification.
La classe travailleuse est très diverse. Elle inclut les travailleur.euse.s industriel.le.s auprès desquel.le.s les syndicats jouent un rôle important. Elle comprend aussi la nombreuse main-d'œuvre informelle. Selon l'Organisation internationale du travail, en 2019 il y avait 2.000 millions de travailleur.euse.s informel.les dans le monde entier. Certains d'entre eux – comme ceux qui ont des emplois temporaires dans les fermes et les pêcheries – affrontent des risques spécialement élevés de perte d'emploi et des problèmes de santé à mesure qu'avance le changement climatique. Nous devrions aussi considérer ces emplois comme des emplois climatiques, et pas seulement ceux des entreprises pour la production de panneaux solaires ou de batteries de lithium.
Les femmes qui effectuent des travaux de soins sont aussi cruciales pour la transition, et pas seulement en raison du rôle stratégique du secteur des soins pour améliorer la vie des personnes avec de basses émissions de carbone. Les femmes ont tendance à être en première ligne dans la résistance aux entreprises du capital fossile, dans la revendication de la réduction du temps de travail et de leur double charge horaire, et elles peuvent aider à tendre des ponts entre les classes travailleuses du Nord et du Sud au travers du mouvement féministe.
L'organisation de tous ces secteurs est vitale pour une véritable transition juste et internationaliste, et elle peut renforcer les campagnes de pression sur les gouvernements en faveur des programmes dont nous avons besoin. Plus elles auront de succès, plus il sera probable que s'y joignent des millions de personnes, non seulement la classe travailleuse la plus conscientisée par rapport aux problèmes écologiques et les activistes engagés, mais aussi les mouvements sociaux nés des zones de sacrifices qui ont participé à des luttes séculaires pour la terre, l'eau, les forêts et une vie digne dans le monde entier. Ce mouvement internationaliste se base sur la classe travailleuse en raison de son rôle dans la critique du capitalisme, source de nos crises actuelles, mais il est peuplé des divers groupes subalternes qui peuvent tout perdre si le fascisme fossile ou écologique finit par s'en sortir.
Ainsi, la dynamique de construction des mouvements dans notre stratégie s'occupera des questions pressantes de la transition écologique, mais elle doit aussi planifier la rupture comme conséquence de la nature profondément insoutenable de la machinerie capitaliste.
Aujourd'hui, notre stratégie requiert une action audacieuse, orientée par l'utopie qui peut nous guider de ce siècle vers le suivant pour construire une société plus juste.
Notre stratégie va au-delà de la survie. Il s'agit de la vie – une vie meilleure – et cela nous différencie déjà en soi des capitalistes et des tragédies qu'ils provoquent. Le long chemin de la transition est plein de contradiction et présentera plus de défis que ceux que le mouvement socialiste a jamais affronté. Le temps est essentiel et nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à le perdre, car notre objectif final consiste à atteindre une société émancipée capable de se maintenir durant les prochains siècles.
*
Sabrina Fernandes est activiste socialiste brésilienne et présentatrice du populaire canal marxiste de YouTube, Tese Onze. Actuellement, elle est chercheuse à l'International Research Group on Antiauthoritarianism and Counter-Strategies de la Fondation Rosa Luxemburg.
Cet article a été publié initialement par la revue espagnole Viento Sur.
Traduction du castillan : Hans-Peter Renk
Illustration : Suwa Kanenori, Fukagawa Garbage Incinerator, 1930
Notes
[1] Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, chapitre 1 (1851).
[2] Du Bureau des Nations Unies pour la réduction du risque de désastres.
[3] A l'occasion de la proposition de la députée de New York à la Chambre des représentants des États-Unis, Alexandria Ocasio Cortez [NdT].
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Cour d’appel de Russie alourdit la peine de Boris Kagarlitsky à cinq ans de prison

Le sociologue russe, Boris Kagarlitsky, qui s'est prononcé contre la guerre en Ukraine et qui fut arrêté en juillet 2023 et qui fut libéré sous caution le 12 décembre dernier, a vu sa peine alourdie à cinq ans le 12 février 2024. @Nataliya Kazakovtseva/TASS
13 février 2024 | tiré d'Alter-Québec
https://alter.quebec/la-cour-dappel-de-russie-alourdit-la-peine-de-boris-kagarlitsky-a-cinq-ans-de-prison/
Plus tôt ajourd'hui, la Cour d'appel de Russie, considérant la condamnation à payer une amende comme une peine trop clémente, a revu hier la sentence initiale de Boris Kagarlitsky rendue le 12 décembre dernier. Accusé de justifier le terrorisme, le sociologue marxiste est maintenant condamné à cinq ans de prison. La décision signifie également que Kagarlitsky se verra interdire d'administrer un site Web pendant deux ans après sa libération. Dans le même temps, une amende de 609 000 roubles (plus de 9 000 $ CAN) a déjà été payée.
La sentence de culpabilité a été prononcée en décembre après avoir été reconnu coupable de « justification du terrorisme » pour des propos tenus dans une vidéo YouTube supprimée depuis et sur sa chaîne Telegram, à propos de l'attentat à la bombe contre le pont de Crimée.
La véritable raison de son emprisonnement est son opposition à la guerre en Ukraine menée par la Russie. En tant que rédacteur en chef de la plateforme de gauche en ligne Rabkor (Correspondant ouvrier), Kagarlitsky compte parmi les personnalités opposées à la guerre les plus en vue – et l'une des rares à rester en Russie.
Selon la décision, Kagarlitsky sera placé en garde à vue dans la salle d'audience et envoyé au centre de détention provisoire du Service pénitentiaire fédéral de Russie à Moscou. Boris lui-même n'est pas découragé : « Je suis sûr que tout se passera très bien. Et nous vous reverrons à la fois sur la chaîne et en liberté. Il faut juste vivre un peu et traverser cette période sombre pour notre pays ».
Le cas de Boris Kagarlitsky est une parodie de justice. C'est aussi une offense aux milliers de Russes qui ont exprimé leur solidarité avec lui : des lettres, des émissions, des affiches. Durant les cinq mois de liberté, Boris a témoigné de la manière qu'il fut arrêté et incarcéré. Nous présentons ci-dessous ce récit.
Liberté pour Boris Kagarlitsky ! Liberté pour tous les prisonniers et prisonnières politiques !
Boris Kagarlitsky
Lettre de Boris Kagarkitzky

Je me rendais à l'aéroport pour accueillir ma femme, qui revenait de l'étranger le 25 juillet l'an dernier. Mais la rencontre n'a pas eu lieu. Deux jeunes hommes polis se sont approchés de moi et, présentant leur carte d'agent du FSB (services secrets russes), m'ont informé que j'étais détenu : j'étais accusé de justifier le terrorisme. Dès le soir, j'ai été envoyé sous escorte à Syktyvkar, la capitale de la République de la population komie, où j'ai été incarcéré.
Je ne connaissais pas la République de la population komie, si ce n'est qu'à l'époque de Staline, une grande partie des institutions du Goulag s'y trouvaient, un sujet sur lequel j'ai bien sûr beaucoup lu et écrit. La raison de mon arrestation était une vidéo que j'avais publiée sur YouTube dix mois plus tôt. J'y parlais de l'actualité, mentionnant — sans plus de précision — la détérioration du pont de Crimée par des saboteurs ukrainiens. Mais j'ai également noté que la veille de cette attaque, des vœux de félicitations de Mostik le chat au président Poutine avaient été diffusés sur les réseaux sociaux russes ; comme le chat était la mascotte du pont saboté, j'ai plaisanté sur le fait qu'il avait agi comme un provocateur avec ses félicitations. Il s'agissait probablement d'une mauvaise blague, mais elle peut difficilement être considérée comme un motif suffisant d'arrestation, même si l'on tient compte des lois russes modernes. Malheureusement, le Léviathan n'a pas le sens de l'humour. J'ai dû passer quatre mois et demi dans une cellule de prison.
Le fait que l'arrestation ait eu lieu près d'un an après mes propos malheureux soulève divers soupçons quant à la signification politique de ce qui s'est passé. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais en prison. J'ai connu ma première — et plus longue — incarcération en 1982, alors que le dirigeant de l'URSS, Leonid Brejnev, était mourant. À l'époque, les agents de la sécurité de l'État ont attrapé tous les opposants connus, y compris notre groupe de jeunes socialistes, juste au cas où, à titre préventif. Quelque temps après la mort de Brejnev, j'ai été libéré sans même avoir été jugés.
Ce qui se passait dans les couloirs du pouvoir à Moscou à la fin du mois de juillet 2023 n'est pas encore tout à fait clair, même si l'on espère que tôt ou tard nous le découvrirons (je n'ai découvert les véritables raisons de ma première arrestation et de ma libération que bien plus tard, lorsque Mikhaïl Gorbatchev dirigeait le pays et qu'une partie des archives officielles sont devenues disponibles). Mais il semble que cette arrestation puisse être considérée comme un dommage collatéral dans une lutte pour le pouvoir. Imaginez que vous êtes un ballon sur un terrain de football où s'affrontent deux équipes professionnelles. Ils vous donnent des coups de pied et vous ne pouvez qu'essayer d'analyser le déroulement du match en vous basant sur vos sentiments. Malgré tout, l'expérience acquise dans la prison de Syktyvkar m'a été très utile en tant que sociologue. Après tout, j'ai eu l'occasion d'observer, de communiquer avec des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans d'autres circonstances.
Il faut donner le crédit à l'administration pénitentiaire, qui m'a placé dans une cellule avec de bonnes conditions et des voisins calmes. L'un d'entre eux s'est avéré être un prisonnier politique, assistant du député de la Douma Oleg Mikhailov, qui reste l'opposant le plus en vue de la République de Komi. Il est vrai que nous ne sommes pas restés longtemps ensemble. Les prisonniers de la cellule changeaient souvent, ce qui m'a permis de faire la connaissance d'un grand nombre de personnes et d'entendre l'histoire de leur vie.
Certain.es de mon voisinage accusé.es de meurtre et d'extorsion se sont révélés très gentils et polis dans la conversation ; un vice-maire d'une petite ville du nord, qui a déclenché une bagarre lors d'une fête locale et tué par inadvertance son collègue alors qu'il se produisait avec lui sur scène, était heureux de discuter de questions relatives aux finances municipales, au sujet desquelles il s'est révélé étonnamment mal informé. Un jour, peut-être très bientôt, je décrirai tout cela en détail.
Bien que je ne fusse pas le seul prisonnier politique à Syktyvkar, il se trouve que j'étais le plus célèbre, et c'est pourquoi l'administration et les gardiens de la prison me regardaient avec une curiosité évidente, essayant de comprendre pourquoi j'avais été amené là et ce qu'il fallait attendre de ce cas étrange. Le procès a été obstinément reporté, bien que personne ne m'ait interrogé ; pendant des mois, il ne s'est rien passé de nouveau. L'affaire pénale était censée être examinée par un tribunal militaire de Moscou, mais elle s'est perdue en cours de route et n'a refait surface dans leur bureau qu'à la toute fin du mois de novembre.
Le bureau du procureur a déclaré que la plaisanterie sur Mostik le chat avait été faite « dans le but de déstabiliser les activités des agences gouvernementales et de faire pression sur les autorités de la Fédération de Russie pour qu'elles mettent fin à l'opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine ».
Pendant que j'étais derrière les barreaux, une campagne de solidarité se déroulait à l'extérieur, à laquelle de nombreuses personnes ont participé en Russie et dans le monde entier. En outre, il semble que les dirigeants du Kremlin aient été particulièrement impressionnés par le fait qu'une grande partie des voix qui se sont élevées pour me défendre provenaient du Sud. Dans le contexte de la confrontation avec l'Occident, les dirigeants russes tentent de s'imposer comme des combattants du néocolonialisme américain et européen, de sorte que les critiques formulées à leur encontre au Brésil, en Afrique du Sud ou en Inde ont été accueillies avec vexation. L'économiste indienne Radhika Desai a même interrogé Vladimir Poutine sur mon sort lors du forum de Valdai.
Le procès a eu lieu le 12 décembre 2023. Le bureau du procureur a demandé que je sois envoyé en prison pour cinq ans et demi, mais le juge en a décidé autrement. J'ai été libéré de la salle d'audience après avoir été condamné à payer une amende de 600 000 roubles (le lendemain, cette somme a été collectée par les abonné.es de la chaîne YouTube Rabkor). Il est vrai qu'il n'a pas été facile de payer : j'ai dû déposer l'argent en personne, mais j'ai également été inscrit sur la « liste des extrémistes et des terroristes », à qui il est interdit d'effectuer des transactions financières. À l'heure actuelle, je dois demander une autorisation spéciale pour pouvoir donner à l'État l'argent qu'il me réclame. Il m'est interdit d'enseigner, ainsi que d'administrer des sites Internet et des chaînes YouTube.
Cependant, ils ne m'ont pas encore interdit de penser et d'écrire, ce que je fais pour l'instant.

Déclaration du RESU sur le deuxième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

12 février 2024 | tiré du site de la gaucheanticapitaliste.org
https://www.gaucheanticapitaliste.org/declaration-du-resu-sur-le-deuxieme-anniversaire-de-linvasion-de-lukraine-par-la-russie/
Le 24 février 2024 marque le deuxième anniversaire de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Cette invasion totalement injustifiée a déjà coûté la vie à au moins 20 000 civils ukrainiens et à plus de 100 000 soldats. Des millions de personnes ont été forcées de fuir à l'étranger, des millions d'autres sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine.
L'agresseur continue de détruire des villes entières et des infrastructures civiles (réseaux d'électricité et de chauffage, écoles, hôpitaux, chemins de fer, ports, etc.) L'armée russe a procédé à des massacres de masse d'Ukrainien·ne·s (soldats et civils). Les violences sexuelles font partie de la stratégie de l'agresseur. De nombreux citoyen·ne·s (y compris des enfants) ont été déportés de force en Russie et au Belarus.
Le président russe Vladimir Poutine, le gouvernement russe, les principales forces politiques de la Fédération de Russie, les chefs religieux et les médias promeuvent un programme impérialiste qui nie aux Ukrainiens leur droit à l'indépendance, au statut d'État et à la liberté de choisir des alliances politiques.
Le peuple ukrainien refuse d'être une victime passive de cette agression et résiste massivement à l'invasion, avec ou sans armes.
Le peuple ukrainien refuse d'être une victime passive de cette agression et résiste massivement à l'invasion, avec ou sans armes. L'auto-organisation à la base (notamment par les syndicats, les organisations féministes et les associations de défense des droits civils) joue un rôle essentiel dans la défense du pays et la lutte pour une Ukraine libre, sociale et démocratique.
Toutefois, compte tenu de la complexité de la situation politique mondiale (illustrée par le blocage de l'aide financière à l'Ukraine par le Parti républicain au Congrès américain), la mobilisation en faveur de la résistance militaire et civile des Ukrainien·ne·s est plus que jamais nécessaire.
Le gouvernement russe a augmenté de 70% les ressources de sa propre industrie de guerre, auxquelles s'ajoutent des forces mercenaires privées et diverses formes de subventions destinées à rendre la guerre acceptable pour les populations les plus pauvres de la fédération, dont les hommes sont mobilisés comme chair à canon. Poutine exploite également l'hypocrisie de la rhétorique « démocratique » des pays occidentaux pour détourner l'opinion publique de la critique de ses propres crimes en Ukraine.
Dans le même temps, la solidarité avec le peuple ukrainien est mise à mal par un discours dominant qui présente les dépenses « pour aider l'Ukraine » comme une justification des coupes dans les budgets sociaux et de l'augmentation permanente des dépenses d'armement.
L'aspiration légitime à la paix, accompagnée de demandes de réponses aux urgences sociales et écologiques, ne peut se faire au détriment des vies et des droits des Ukrainien·ne·s : elle doit au contraire se transformer en une demande de transparence sur les dépenses réelles des gouvernements, en rejetant la militarisation croissante et les politiques économiques socialement régressives, au niveau national et mondial.
L'Ukraine ne peut pas gagner sans les armes fournies par l'OTAN pour repousser l'envahisseur. Pourtant, ce que sa victoire éventuelle sur Poutine représentera le plus, ce n'est pas une victoire de l'Occident dans la lutte des grandes puissances pour la domination mondiale, mais un triomphe de la résistance inflexible du peuple ukrainien et de son droit à décider de son avenir.
Nous appelons à faire de la semaine autour du 24 février (19-25) une période d'action internationale contre l'invasion russe et en solidarité avec l'Ukraine.
En tant que tel, ce sera une victoire pour les petites nations et les principes démocratiques partout dans le monde. Nous appelons à faire de la semaine autour du 24 février (19-25) une période d'action internationale contre l'invasion russe et en solidarité avec l'Ukraine.
Paix pour l'Ukraine. Arrêtez la guerre de la Russie !
Arrêt immédiat des bombardements russes et retrait de toutes les troupes russes de l'ensemble de l'Ukraine !
Soutien et solidarité les plus larges possibles avec le peuple ukrainien dans sa résistance légitime à l'invasion russe !
10 février 2024
Pour ajouter le nom de votre organisation à cet appel, veuillez écrire à l'adresse suivante info@ukraine-solidarity.eu
Consultez le site sur RESU ukraine-solidarity.eu
Photo : Manifestation en solidarité avec le peuple ukrainien, Bruxelles, 25 février 2023. (Dominique Botte / Gauche anticapitaliste / CC BY-NC-SA 4.0)

Ne pas se taire contre le crime de guerre !

Atrocités à Gaza ! Temps béni pour les colons d'étendre l'annexion des terres palestiniennes. Netanyahou pose un ultimatum au Hamas pour la libération des otages avant le 10 mars, sous peine d'un siège à Rafah. A Paris, la mobilisation se poursuit à l'heure où la Cij donne le ton de ses audiences sur la légalité de l'occupation.
De Paris, Omar HADDADOU
« J'entrerai dans vos montagnes ; je brulerai vos villages et vos moissons ; je couperai vos arbres fruitiers et, alors, ne vous en prenez qu'à vous seuls. » Thomas Bugeaud, le Maréchal sanguinaire.
L'horreur, terreau des Démocraties modernes ! Les Etats-Unis et l'Europe se gargarisent de la méthode génocidaire en Palestine, occupée depuis 75 ans, où les bombardements, 19 semaines durant, redoublent chaque jour de férocité.
Depuis les attaques du 7 octobre 2023, les hostilités ont atteint leur paroxysme. La prétendue pression diplomatique de la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, n'a rien à envier aux niaiseries de Jocrisse à solder. Le Ministère de la Santé palestinien fait état de 28 858 martyrs et 68 677 blessés. Les enfants sont les premières victimes de cette campagne barbare des temps reculés.
La puissance de frappe israélienne sur la bande de Gaza, réduite à 80 % en poussière, a pour point d'orgue la préparation imminente d'une offensive sur la ville de Rafah, abritant 1,4 millions de Palestiniens. Les ONG et les chefs d'Etats hostiles à la campagne punitive, dont l'Afrique du Sud, ont annoncé avoir déposé un nouveau recours auprès de la Cour internationale de justice (Cij) en vue d'examiner au plus tôt l'annonce par l'Etat hébreu d'une prochaine offensive militaire sur Rafah. Ce qui constitue, selon eux, une violation des droits.
Ladite institution juridique a entamé hier les audiences sur la légitimité de l'occupation par Israël de terres destinées à un futur Etat palestinien (Cisjordanie occupée, la bande de Gaza et Jérusalem - Est annexée). D'où la colère du Ministre palestinien des Affaires étrangères Riad Al-Maliki devant la haute juridiction de l'ONU : « Les Palestiniens subissent aussi le colonialisme et l'apartheid. Et certains s'indignent de ces paroles de la réalité qui est la nôtre. Cette occupation est une annexion et une suprématie par nature » s'indigne -t-il, demandant à la Cour de confirmer le droit des Palestiniens à l'autodétermination.
La mise en garde d'Emmanuel Macron, dimanche 18 février, quant aux retombées de l'opération militaire de Tsahal à Rafah, ne fera pas reculer la machine de guerre de Netanyahou, déterminé à honorer son serment : Eradiquer le Hamas, avec un permis de tuer étasunien dans la poche ! Derrière cet engagement funeste, se cache le dessein électoral. Le Premier ministre joue sa survie et en appelle à Washington pour le coup d'éclat.
Quant à Macron, il est acculé à danser sur l'air d'une valse à 2 temps ; gardant bien ferme sa lorgnette stratégique sur le Sahel et les JO : « Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes dont le Hamas par les actions ciblées » déclare-t-il le 12 novembre 2023. Mais, versatilité oblige, hier lundi, il pointe : « Une Démocratie ne peut pas faire ce qu'Israël est en train de faire ».
Au cœur de Paris, portant la cause palestinienne à bras le corps, ils étaient nombreux (es) ce samedi sur l'esplanade des Halles à scander « Halte au massacre à Gaza » « Palestine vivra, Palestine vaincra », drapeaux et Keffieh palestiniens en évidence. Fort de la décision du Conseil constitutionnel et d'une voix unanime, les manifestants dont les militants (es) venus en solidarité d'autres pays d'Europe, réclamaient un cessez-le feu immédiat.
C'est une femme frêle à la « verve kamikaze » à s'arracher la glotte, qui galvanisera l'assistance. Pointant du doigt la politique « d'extermination » entreprise par Netanyahou, elle exhorte la foule à reprendre après elle : « Free Plestine, free Palestine ! Nous sommes tous des Palestiniens (nes). Le ton massif, elle ajoute : « Nous allons mener des actions dans différents endroits de l'Hexagone. Usines, administrations, centres commerciaux... Venez tracter avec nous contre le génocide ! Nous appelons au boycott de Carrefour et Hewlett Packard. D'autres enseignes sont dans le collimateur ».
Outre les interventions des présidents des Collectifs et la programmation de rencontres, une mise en ligne des tracts, fait partie de l'engagement collégial.
La représentation théâtrale de la Nakba (1948) exécutée par une troupe de jeunes filles de l'Association de la Jeunesse palestinienne, venue de Gaza, a été chaleureusement ovationnée. Un rendez-vous est consigné pour la prochaine journée d'action.
Je quitte la place du Châtelet le cœur prostré, hanté par les images innommables de ces enfants gazaouis ravis à la vie par les tapis de bombes, pendant que des Parisiens (es) attablés aux terrasses providentiellement ensoleillées, savourent leur glace et leur café, le cœur guilleret ! O.H











Pour voir d'autres photos de Serge D'Ignazio de la manif à Paris
https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums/72177720314869748/with/53536367835
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Le capitalisme mondialisé est vecteur de graves pénuries » - Renaud Duterme

Les vulnérabilités se multiplient et commencent à toucher tous les secteurs. Dans Pénuries, quand tout vient à manquer (Payot), Renaud Duterme, enseignant en géographie déjà auteur du Petit manuel pour une géographie de combat (2020) et de Nos mythologies écologiques (2021), dresse l'état de la raréfaction des ressources nécessaires à nos sociétés productivistes, en tire les conséquences en ce qui concerne les énergies et nos modes de vie, tout en insistant sur le danger qu'une conjonction de toutes ces fragilités pourrait constituer.
11 février 2024 | tiré du site d'Élucid
https://elucid.media/environnement/penuries-capitalisme-mondialise-vecteur-petrole-electricite-minerais-sobriete-renaud-duterme
Laurent Ottavi (Élucid) : De récents événements comme la crise Covid, la guerre en Ukraine ou encore le blocage du canal de Suez par un porte-conteneur, ont à la fois créé et révélé les grandes fragilités de la mondialisation. Pouvez-vous en donner des exemples et en évaluer la portée ?
Renaud Duterme : Jusqu'ici, les vulnérabilités de notre temps n'ont pas encore donné lieu à des pénuries majeures, davantage à des craintes, et les perturbations ont été surmontées. Cependant, la prise de conscience demeure encore très limitée. L'impression d'un système résilient – ce qu'il est effectivement dans une certaine mesure – l'emporte, alors que les vulnérabilités se multiplient et qu'elles commencent à toucher tous les secteurs.
Le fait est que l'approche interdisciplinaire manque à beaucoup d'analyses, et a fortiori dans le débat public, où on invite par exemple un économiste pour parler d'économie et un climatologue pour évoquer le réchauffement climatique. Or, les fragilités de notre temps résultent de causes très variées, des tensions géopolitiques aux perturbations climatiques en passant par la raréfaction des ressources ou les mouvements sociaux, au point que, quel que soit le fil que l'on tire, cela perturbe tous les autres.
Plus encore que d'interdisciplinarité, nous manquons d'une approche globale et systémique. Les différentes vulnérabilités auxquelles nous faisons et ferons face sont encore plus préoccupantes une fois combinées. Elles s'alimentent les unes les autres. Le château de cartes est capable de tenir debout malgré quelques cartes en moins, mais il y a de quoi nourrir des inquiétudes quant à la solidité de l'ensemble de la structure.
Élucid : Dans votre ouvrage, vous vous étonnez de la sous-estimation dont le pétrole fait l'objet, alors que celui-ci représente le « sang de nos économies » pour reprendre l'expression de Matthieu Auzanneau. Pouvez-vous rappeler l'importance du pétrole dans notre économie et les conséquences d'une raréfaction de ses stocks ?
Renaud Duterme : Beaucoup de malentendus circulent autour du pic pétrolier. Le pétrole sera présent en sous-sol pour encore très longtemps. En revanche, depuis le premier choc dans les années 1970, la raréfaction du pétrole le rend de moins en moins disponible et de plus en plus difficile à aller chercher, ce qui coûte de plus en plus cher (même en tenant compte d'éventuelles phases de baisse, l'évolution des prix n'étant pas linéaire). Aujourd'hui, nous considérons que le prix du pétrole est relativement bas lorsqu'il se situe autour des 80 dollars le baril, alors qu'un tel prix, il y a quelques années, aurait été considéré comme très élevé. Les choses vont s'intensifier à l'avenir avec des montagnes russes sur les prix du pétrole (qui sera en baisse lorsque la contraction économique générée par des prix trop élevés fera baisser la demande) et une trajectoire générale qui sera à la hausse.
De ce fait, la raréfaction du pétrole risque donc d'avoir deux conséquences majeures. La première est une remise en cause du système de délocalisation basé sur un pétrole bas marché afin d'alimenter les porte-conteneurs, les camions, les avions, etc., qui font fonctionner la mondialisation. La seconde conséquence a bien été mise en évidence par la guerre en Ukraine. Dans un contexte d'abondance pétrolière avec des gisements rentables un peu partout, la perturbation générée chez un producteur pose peu problème, car il est toujours possible de se reporter sur un autre. Si la guerre en Ukraine, par exemple, avait eu lieu il y a une ou deux décennies, les tensions auraient sans doute été moins importantes, car on aurait pu se fournir en pétrole auprès d'autres producteurs.
Aujourd'hui, la majorité des grands producteurs de pétrole ont déjà passé leur pic de production. En cas de perturbation chez l'un d'entre eux, il devient bien plus difficile de compenser par l'achat de pétrole ailleurs. Nous nous rabattons sur les États-Unis pour le gaz et sur le Moyen-Orient pour le pétrole, mais l'actualité vient nous rappeler l'instabilité du monde et en particulier de certaines régions. Un potentiel élargissement du conflit israélo-palestinien, notamment à l'Iran, aurait d'énormes conséquences, car deux des principales sources de pétrole pour le continent européen se tariraient ou deviendraient fortement perturbées.
« L'illusion est de penser qu'on pourra continuer nos modes de vie actuels et compenser uniquement par le nucléaire. »
L'électricité est une autre carte maîtresse de l'édifice mondialisé. Quel état des lieux faites-vous quant à cette énergie et quelles sont selon vous les perspectives à moyen terme ?
C'est plus ou moins la même chose. L'électricité est seulement un vecteur énergétique, alimenté par des énergies primaires. Elle est donc sujette aux tensions géopolitiques et l'on sait par exemple que des pays comme la Belgique et l'Allemagne sont fortement dépendants du gaz pour produire de l'électricité. L'impact climatique de notre production d'électricité impose, de plus, qu'elle soit de plus en plus décarbonée si l'on veut tenir les engagements internationaux et limiter les conséquences du réchauffement climatique.
D'autre part, toutes les sources d'électricité décarbonées ont un certain nombre de contraintes climatiques ou physiques. On peut penser notamment à l'intermittence des énergies éoliennes et solaires, qui doivent être compensées soit par des centrales à gaz – ce qui renvoie à la question de la dépendance géopolitique vis-à-vis d'autres producteurs – soit par des centrales à charbon, ce qui amplifie le problème climatique, soit par les centrales nucléaires. Sur ce dernier point, la question n'est pas d'être pour ou contre le nucléaire, comme il n'est pas question d'être pour ou contre telle ou telle énergie en général, mais de l'inscrire dans un contexte de contraintes physiques et climatiques beaucoup plus large.
Le nucléaire équivaut à plus ou moins 5 % des besoins énergétiques mondiaux aujourd'hui. L'illusion est de penser qu'on pourra continuer nos modes de vie actuels et compenser uniquement par le nucléaire. Même dans un pays comme la France, un des plus nucléarisés au monde, toute une série de contraintes est déjà là : l'assèchement des cours d'eau qui a déjà provoqué l'arrêt de plusieurs centrales, le désamour de la filière chez de nombreux ingénieurs, le vieillissement des centrales (donc de plus en plus souvent en panne et de plus en plus compliquées à réparer dans un contexte où la main-d'œuvre manque), les contraintes de délais dues à la construction d'une centrale, au repérage et à la faible acceptation sociale par la population locale. La seule solution sera la sobriété, voire la décroissance, c'est-à-dire la réduction drastique de nos besoins en électricité.
Après avoir analysé la question de la pénurie à l'aune du pétrole et de l'électricité, qu'en est-il en ce qui concerne les minerais ?
Ils constituent le second pilier de nos sociétés modernes, car celles-ci dépendent de flux énergétiques et des flux de matières. Or, la totalité de ces minerais est également non renouvelable. Comme pour le pétrole, l'épuisement total et soudain des ressources est un scénario illusoire. Les gisements seront de moins en moins concentrés, donc de plus en plus rares. Les prix augmenteront fortement, car, tout comme il faut plus d'énergie pour exploiter plus d'énergie, il faut plus de minerais pour exploiter plus de minerais. Les conséquences environnementales seront aussi d'autant plus importantes pour les extraire.
Le secteur de la mine est vorace en eau alors que de nombreux gisements miniers se trouvent dans des zones à fort stress hydrique : le Chili pour le cuivre, l'Amérique du Nord, la Chine. La conjonction de problèmes, à nouveau, sur fond de contraintes diverses (énergétiques, hydriques, etc.) et de moindre concentration des minerais, risque de rendre l'exploitation de certains minerais de plus en plus compliquée. Il nous faudra faire des arbitrages. Il est de ce fait fondamental de s'interroger sur la pertinence de la numérisation croissante de la société et de l'électrification promise de l'ensemble du parc automobile.
Au regard de l'ensemble des contraintes, ne serait-il pas plus judicieux d'envisager des politiques de sobriété pour ces deux secteurs, ce qui passe notamment par un débat démocratique sur la pertinence de l'utilisation accrue du numérique dans de nombreux secteurs (enseignement, santé, agriculture, objets quotidiens, etc.) ainsi que sur la pertinence de politiques visant à réduire notre dépendance à la voiture.
« Le techno-solutionnisme, dont l'objectif premier est de créer de nouveaux marchés pour relancer la machine économique, est juste intenable. »
Votre panorama signifie un retour des limites après une surexploitation irresponsable. Vous avez souligné au début de l'entretien le manque de conscience vis-à-vis des vulnérabilités de notre temps. Comment qualifieriez-vous les mesures annoncées par les gouvernements et leurs objectifs affichés sur ces questions ?
Nous mettons clairement des rustines sur des problèmes systémiques. Le cas de la voiture électrique, qui sert à relancer un marché, est significatif, sans même parler des camions, des avions ou des porte-conteneurs si essentiels au système actuel. De manière générale, l'option mise en avant est celle du solutionnisme technologique, qui cherche surtout à créer de nouveaux marchés pour relancer la machine économique. Elle est intenable à de multiples points de vue. Elle demande des délais considérables pour remplacer les infrastructures physiques.
On ne parle pas non plus des externalités sociales des solutions que l'on avance. Depuis des années déjà, nous avons délocalisé les activités polluantes dans des pays souvent pauvres et lointains. Nous proposons aujourd'hui des mesures qui aggravent les problèmes ailleurs. Je pense à l'extraction du cobalt ou à la fabrication des batteries. Je pense aussi à ce que nous allons faire des vieilles voitures. Des voitures qui ne sont plus aux normes et sont remplacées par des voitures dites « propres », mais qui ne le sont pas tant que cela au regard du cycle de production, partiraient à l'exportation, principalement pour aller polluer l'Afrique.
Enfin, les mesures et les objectifs affichés ignorent le sujet fondamental du manque de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs stratégiques, sans laquelle nos sociétés ne peuvent pas fonctionner. Je pense à l'agriculture, au transport routier et au domaine médical. Lesdites pénuries trouvent principalement leur cause dans le capitalisme mondialisé où l'économie prime sur tout le reste avec des emplois qui perdent leur sens, sont pris dans des logiques comptables, et où le fantasme de la dématérialisation laisse penser qu'il serait possible d'avoir des sociétés faites de cadres, d'influenceurs et d'intellectuels. En bref, une négation du rôle primordial de l'industrie, de l'agriculture et des classes populaires.
Les différentes pénuries que vous avez évoquées questionnent l'extraction, la production, l'accroissement des transports et de la consommation, le libre-échange, la division mondiale du travail, la spécialisation et les mouvements de capitaux. Est-ce la fin de la mondialisation ?
Je distingue le processus de mondialisation du projet politique de la mondialisation actuelle. En tant que géographe, je considère le premier comme un processus d'interconnexion du monde, un processus qui date de 1492 avec la découverte des Amériques. Il est amalgamé aujourd'hui avec le projet politique de la mondialisation actuelle, qui se confond avec le capitalisme mondialisé pour suggérer que la seule alternative serait le repli sur soi.
On a imposé, principalement par la force (via la colonisation puis via les programmes d'ajustement du FMI) à l'ensemble du monde, un système économique particulier dans lequel l'économie est autonome par rapport au reste de la société, et où elle finit toujours par prendre le pas sur la société. En un mot, notre mondialisation est un capitalisme mondialisé qui se trouve de plus en plus dans sa forme la plus pure. Les grandes forces du marché, que ce soient les capitaux, les marchandises matérialisées par les grandes entreprises transnationales, en tirent une grande puissance.
La démondialisation que j'appelle de mes vœux n'est pas un repli sur soi ou une remise en cause du processus d'interconnexion du monde. En revanche, elle sort de la logique de capitalisme pur avec des mesures de protectionnisme et de relocalisation, le contrôle des mouvements de capitaux et de marchandises, et l'abandon des accords de libre-échange. L'élargissement des chaînes de production et les nombreuses vulnérabilités que j'ai mentionnées seront résolus à la condition de retrouver une certaine autonomie, qui n'est pas une autarcie ou un système moyenâgeux où chaque territoire serait replié sur lui-même.
Cette autonomie pourrait tout à fait s'accorder avec des accords de coopérations avec de nombreux pays dans une optique de diminution des flux matériels. L'idée n'est pas de refaire produire chez nous des choses inutiles, mais de produire davantage chez nous des choses utiles. Dit autrement, il y a nécessité de refabriquer des principes actifs majoritairement produits en Inde et en Chine, mais aucune à relocaliser la fast fashion.
« La grande question est celle de la décroissance : s'interroger sur l'utilité des choses que l'on produit. »
Les mêmes raisons remettent-elles en cause l'objectif de la numérisation du monde ?
La numérisation de la société, la généralisation de la 5G, les voitures et les frigos intelligents et autres promesses de technologiques nécessitent beaucoup de minerais et d'énergies dans un contexte de raréfaction des ressources. Or, même si nos démocraties sont imparfaites, nos gouvernements peuvent difficilement, pour des raisons électorales, dire que l'on va construire ou rouvrir des mines (le secteur le plus écocidaire du monde !) à cause de la réticence des populations. Développer la 5G demande, de surcroît, de remplacer des milliards d'appareils électroniques encore fonctionnels et entraînerait un effet rebond, puisqu'en cas de connectivité rapide, les usages d'Internet se multiplieraient. C'est une fuite en avant qu'il nous faut arrêter avant d'atteindre les contraintes physiques.
J'ajoute à cela que la numérisation accroît la vulnérabilité de nos sociétés. Une école, un hôpital et un supermarché ne peuvent plus fonctionner désormais sans Internet. Si une coupure globale d'Internet, comme un blackout sur l'électricité, semble réservée à la science-fiction, car cela repose sur des réseaux décentralisés, les effets localisés constituent d'ores et déjà notre réalité. Dans la région où je vis en Belgique, différents hôpitaux piratés ont été bloqués pendant plusieurs semaines, au point d'engendrer des retards d'opérations. Les perturbations créées ont d'ailleurs des effets sur le long terme qui dépassent la durée du blocage. Aux États-Unis une panne Internet qui avait touché des compagnies aériennes avait de son côté entraîné l'arrêt net du trafic. Les choses risquent de s'aggraver, sur fond de tensions géopolitiques.
Au-delà de l'aspect purement physique et du volet géopolitique, nous devons enfin nous poser la question de l'utilité de cette numérisation qui n'a jamais fait l'objet d'un débat démocratique. J'ai fait l'expérience avec mes élèves et j'ai été surpris de voir leur unanimité contre la 5G, qui tenait notamment à l'argument selon lequel la numérisation rend dépendant sans rendre heureux. C'est la grande question, celle de s'interroger sur l'utilité des choses que l'on produit, donc de la décroissance.
« La raréfaction peut conduire à une gestion libérale de la pénurie avec une privatisation de ce qui peut l'être et la réservation des ressources à ceux qui en ont les moyens. »
La mondialisation, disiez-vous, est un capitalisme qui s'affirme dans sa forme chimiquement pure. Dans le contexte de raréfaction des ressources avec leurs multiples conséquences qui se renforcent les unes les autres, le capitalisme serait-il entré en phase terminale ?
J'entends dire dans certains débats que le tarissement des flux physiques et des flux de matière va faire s'effondrer le capitalisme. Je ne le pense pas, car il a une grande force pour rebondir sur les crises et les chocs qu'il provoque. Il est vrai que le capitalisme a un besoin constant de croissance et de construction de bâtiments, de nouvelles routes et requiert donc des minerais et du béton en quantité astronomique. Le géographe David Harvey avait d'ailleurs bien fait le lien entre cette urbanisation et le capitalisme.
La raréfaction de tous les éléments que je mentionne dans le livre va néanmoins se traduire selon moi par une gestion libérale de la pénurie, avec une privatisation de ce qui peut l'être et la réservation des différentes ressources à ceux qui en ont les moyens. Ces arbitrages, par conséquent, seront gérés par l'argent. C'est la continuation du capitalisme avec un marché qui pilote la pénurie. Il y a trois façons de gérer les pénuries dont j'ai parlé jusqu'ici. La première, libérale, est à l'œuvre quasiment partout. La seconde, autoritaire et qui peut s'associer avec la gestion libérale comme l'ont montré les exemples de Trump et de Bolsonaro, alloue les différentes ressources de façon purement verticale. La troisième voie, démocratique, horizontale, implique beaucoup d'efforts, beaucoup de conscientisation et des rapports de force considérables.
La plasticité du capitalisme face à ces difficultés implique encore une accentuation des inégalités et de plus en plus d'autoritarisme. Ne seraient-ce pas ces fragilités-là qui risquent de le faire s'écrouler malgré tout à terme ?
C'est une possibilité. J'observe néanmoins que la perte de légitimité potentielle du capitalisme ne pousse pas les gens à en demander la fin. La tendance est plutôt à pointer l'autre, l'étranger du doigt. L'orientation de la contestation dépendra beaucoup du positionnement de la gauche sociale, militante, politique sur les sujets de la lutte des classes, de la mondialisation, quand les pénuries s'aggraveront.
Cela lui demande une remise en cause et notamment une reconnexion avec les classes populaires, premières victimes du déclassement, qu'elle ne connaît plus, qui sentent de sa part de la condescendance ou du mépris. François Ruffin est l'une des seules personnalités en France à échapper à ce travers. La gauche a peur de se faire associer à l'extrême droite et abandonne des sujets comme le protectionnisme et les frontières, de même qu'elle laisse de côté le sujet de l'insécurité, certes accentué par les médias, mais qui va fatalement augmenter dans un contexte de pénuries.
De façon générale, les idées que vous avancez dans votre livre pour faire face à ce temps des pénuries se résument-elles à ces deux mots : démondialisation et décroissance ?
Oui, à condition une nouvelle fois d'entendre par démondialisation l'abandon de la mondialisation comme projet politique et d'associer à la décroissance la diminution des flux matériels et des flux physiques dans une perspective de justice sociale, de démocratie et de bien-être, soit exactement la définition de Thimothée Parrique (Ralentir ou périr). La décroissance, contrairement à ce que soutiennent les libéraux, n'est pas la baisse du PIB, elle est une économie déconnectée du PIB, de la gestion comptable et basée sur d'autres indicateurs.
Il est cependant fort peu probable que ce projet prenne forme. Nous sommes très loin de la démondialisation et le rapport de force n'est pas du tout en faveur des forces progressistes. Je ne suis pas défaitiste, mais je pense qu'il faut se préparer à un échec. Il y aura alors nécessité d'appliquer des comportements individuels ou collectifs à l'échelle locale visant une certaine autonomie. Face aux vulnérabilités, aux ruptures d'approvisionnement de plus en plus importantes dans tous les secteurs, il sera fondamental d'organiser les choses ici et maintenant à l'échelle des quartiers, des entreprises, des collectivités pour une vie déconnectée des grands flux physiques, de matières et d'énergie.
Je précise qu'il ne s'agit pas d'opposer la ville à une campagne idéalisée, une caractéristique de l'extrême droite. Le géographe Guillaume Faburel a fait un formidable travail sur la déconstruction de la métropolisation. La ville, qui plus est la grande ville, dépend de grands flux de matières, des va-et-vient de camions pour la nourrir et elle dispose de très peu d'autonomie. Par contre, les campagnes vivent maintenant à bien des égards de la même façon que les citadins. Quand bien même il y a des terres agricoles dans ma commune, située dans une zone rurale de Belgique, l'essentiel des biens alimentaires vient d'ailleurs. Nous sommes dépendants des mêmes flux physiques. Ceci étant dit, la campagne dispose quand même d'un petit atout qui tient à une plus forte résilience du fait d'espace de stockage, d'une plus grande proximité et de moins forte densité.
Propos recueillis par Laurent Ottavi.
Photo d'ouverture : Thx4Stock team - @Shutterstock

La Concertation pour Haïti (CPH) dénonce la menace grave d’une minière canadienne à la vie, à l’eau et à l’environnement en Haïti

Alors que les bandes armées continuent de consolider leur emprise sur Haïti et que la moitié de la population est confrontée à une famine aiguë, la Concertation pour Haïti<https://aqoci.qc.ca/la-concertation...> alerte le public sur le lancement imminent des opérations d'une mine d'or par une société canadienne. Cela représente une grave menace sur cette nation caribéenne pour de graves dommages environnementaux et une diminution de l'approvisionnement déjà précaire en eau du pays.
La société Unigold, cotée à la bourse de Toronto, devrait obtenir bientôt une licence pour exploiter la concession Candelones, également connue sous le nom de Neita Sur, située à Restauracion, dans la province de Dajabon, à la frontière d'Haïti. La concession contiendrait 2,25 millions d'onces d'or et le permis donnerait à Unigold le droit exclusif d'extraire des minéraux métalliques pendant 75 ans. En avril 2023, la demande avait été étudiée par la Direction dominicaine des mines et envoyée au Ministère de l'énergie et des mines avec une recommandation positive.
Barrick Gold a également annoncé qu'elle avait acquis 60 % des droits d'exploration pour une autre concession connue sous le nom de Neita Norte ; Unigold détient les 40 % restants.
Selon Unigold, les opérations minières nécessiteront le captage initial de l'équivalent de 28 piscines olympiques (70 000 mètres cubes) d'eau. En moyenne, il faut 500 000 litres d'eau pour extraire et laver un kilogramme d'or.
La CPH se solidarise avec les organisations locales qui ont exprimé leur inquiétude quant à la pollution des rivières Massacre et Artibonite, partagées sur l'île d'Hispaniola, par les opérations minières qui utiliseront du cyanure pour extraire le minerai d'or. Ces deux rivières sont d'importantes sources d'irrigation pour le riz et d'autres cultures essentielles à la sécurité alimentaire d'Haïti.
‘Le modèle minier extractiviste conduirait à la contamination de l'eau dont nous avons tous besoin pour vivre, en plus d'autres dommages causés à la population paysanne,' ont déclaré les jésuites de la République dominicaine et d'Haïti dans une déclaration datant de septembre 2023, et ont décrit la mine comme une "menace sérieuse".
Le 4 février dernier, un regroupement d'associations dominicaines de la région déclarait : « Nous nous opposerons à toute exploitation minière, même s'il nous faudra pour cela offrir notre sang à la Terre-mère, pour la vie des générations futures. »
Haïti est le pays le plus vulnérable aux impacts du changement climatique en Amérique latine. La plupart des Haïtiens vivant en milieu rural doivent parcourir de longues distances pour trouver de l'eau et seuls 43 % d'entre eux ont accès à l'eau potable. La déforestation liée à la pauvreté a dégradé les bassins versants et les écosystèmes.
Le CPH estime que les impacts des activités de la Unigold, une société canadienne qui bénéficie du soutien du gouvernement canadien, sont incompatibles avec les efforts des projets de développement canadiens pour protéger l'environnement, particulièrement les réserves d'eau, et réduire les impacts du changement climatique.
Elle réitère son appel au Canada, lancé dans son rapport de 2016 sur l'exploitation minière en Haïti[1], d'assurer la reddition de compte des entreprises canadiennes opérant à l'étranger et lever les entraves juridiques existantes afin de permettre aux populations lésées par l'action des minières canadiennes dans les pays hôtes d'entamer des poursuites en justice au Canada.
Texte préparé par Mary Durran, Marcela Escribano, Jean-Claude Icart et Amélie Nguyen, membres de la CPH.
Fondée en 1994, la Concertation pour Haïti (CPH) est un regroupement d'organisations de la société civile et de membres individuels du Québec qui participent au mouvement de solidarité avec le peuple haïtien. La CPH essaie, de son mieux, d'accompagner la société civile haïtienne dans sa recherche de mieux-être, en œuvrant au niveau de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales, de la justice sociale, du développement solidaire et de la sensibilisation du public d'ici.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’interdiction de l’avortement au Texas nuit aux soins de santé

L'interdiction de l'avortement au Texas nuit aux soins de santé, même pour les femmes qui souhaitent être enceintes
Les lois strictes contre l'interruption de grossesse dans cet État américain limitent les soins pour les patientes atteintes de cancer et les bénéficiaires de la FIV.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/02/15/linterdiction-de-lavortement-au-texas-nuit-aux-soins-de-sante-meme-pour-les-femmes-qui-souhaitent-etre-enceintes/
En 2023, une femme est entrée dans un centre de santé de Houston en traînant une perche à perfusion. Elle souffrait d'hyperémèse gravidique, c'est-à-dire d'une forme extrême de nausées matinales. Elle vomissait constamment, ne pouvait retenir ni nourriture ni liquides et était maintenue en vie grâce à une perfusion.
« Elle était allée aux urgences tellement de fois », a expliqué le médecin Bhavik Kumar à openDemocracy, « et elle était si fragile et si maigre que les urgences l'ont renvoyée chez elle avec une perche à perfusion. Je n'avais jamais vu cela auparavant ».
La patiente a demandé un avortement, qui permet de soulager rapidement l'hyperémèse gravidique. Avant la chute de l'arrêt Roe v Wade, qui protégeait constitutionnellement le droit à l'avortement, en 2022, M. Kumar aurait pu fournir ces soins dans sa clinique ambulatoire. Mais en raison de la nouvelle interdiction quasi-totale du Texas, il n'a pas pu apporter son aide.
Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il était advenu de la femme à la perche à perfusion, M. Kumar a répondu qu'il n'en savait rien. « Souvent, nous ne connaissons pas le résultat », a-t-il expliqué. « Une patiente peut venir dans ma clinique avec un certain nombre de problèmes, par exemple des saignements abondants et des antécédents d'hémorragie… Elle doit rentrer chez elle et attendre que son état devienne une urgence, puis se rendre aux urgences. Elles doivent alors se rendre aux urgences ».
Les données du département de la santé et des services sociaux du Texas confirment les propos de M. Kumar : 100% des avortements déclarés au Texas sont désormais pratiqués dans des hôpitaux. Avant la chute de l'arrêt Roe, ce chiffre était de 0,1%, l'écrasante majorité des avortements étant pratiqués dans des cliniques ambulatoires.
Trois lois principales réglementent l'avortement au Texas. L'« interdiction de déclencher », ainsi appelée parce qu'elle a été déclenchée par l'annulation de l'arrêt Roe v Wade par la Cour suprême, interdit presque totalement les avortements et prévoit des sanctions pénales et civiles ; une autre loi, promulguée avant l'arrêt Roe v Wade, criminalise la fourniture de soins liés à l'avortement ; et le SB8 (pour « Senate Bill 8 ») permet aux citoyens de poursuivre en justice toute personne qui aide et encourage un avortement.
Par conséquent, les femmes texanes qui souffrent d'une urgence obstétrique attendent que leur besoin d'avortement devienne une urgence, car c'est ce qu'exige l'« interdiction de déclencher ». Elle interdit l'avortement à tout moment de la grossesse, quelle qu'en soit la raison, à une exception près : l'avortement est autorisé s'il est, « dans l'exercice d'un jugement médical raisonnable », nécessaire pour sauver la vie de la mère ou éviter « un risque sérieux d'altération substantielle d'une fonction corporelle majeure ».
Le problème de cette exception est que les médecin·es ne savent pas exactement quand elle s'applique. Cette incertitude bouleverse les soins médicaux dans tout le Texas – pas seulement les soins liés à l'avortement, mais tous les soins de santé fournis aux personnes enceintes ou susceptibles de le devenir.
Selon Sonia Suter, professeure de droit à l'université George Washington, l'exception est si vague qu'elle est « pratiquement dénuée de sens », a déclaré Mme Suter à openDemocracy. « Quelle est l'ampleur du risque exigé par la loi ? « Quelle est la probabilité de préjudice ? » « Quelle doit être son imminence ? »
Selon la Cour suprême du Texas, il ne suffit pas qu'un·e médecin·e dise qu'un avortement est nécessaire selon son « jugement médical de bonne foi ». Au contraire, « le jugement médical impliqué doit répondre à une norme objective » – quoi que cela signifie.
« L'imprécision de ces lois est une caractéristique, a déclaré Mme Suter, et non un problème. Les exceptions vagues permettent à un profane de dire ‘oh, l'État se soucie des femmes'. Mais l'État s'en moque ».
Les médecin·es n'ont pas la formation juridique nécessaire pour interpréter les lois complexes sur l'avortement, et nombre d'entre elles et d'entre eux ont déclaré que les administrateurs de l'hôpital ou de la clinique ne leur donnaient pas de conseils à ce sujet. S'iels enfreignent les interdictions du Texas en matière d'avortement, iels s'exposent également à des sanctions sévères, notamment 99 ans de prison, des amendes d'au moins 100 000 dollars et la perte de leur licence médicale.
Dans ces circonstances, « la chose la plus facile à faire est de jouer la carte de la sécurité et de ne même pas mentionner l'avortement », a déclaré à openDemocracy un gynécologue qui a requis l'anonymat.
La crainte de se mettre en porte-à-faux avec la loi a conduit certains médecins texans non seulement à éviter de mentionner l'avortement, mais aussi à modifier leur façon de traiter des questions médicales telles que la FIV, les fausses couches, les grossesses extra-utérines et même la chimiothérapie.
Sarah*, une avocate qui travaille à Dallas, a vu de ses propres yeux comment les interdictions de l'avortement dans l'État peuvent affecter les soins médicaux de manière inattendue. Elle est tombée enceinte par FIV l'année dernière, et son médecin lui a déconseillé de tester ses embryons pour détecter des anomalies. Tous les tests effectués sur les embryons peuvent les endommager, lui a-t-il dit, et il ne voulait pas prendre ce risque.
Sarah a suivi les conseils de son médecin et est maintenant enceinte de quatre mois. Bien qu'elle soit enthousiaste à l'idée de devenir mère, elle s'inquiète de ce qui se passerait en cas de problème pendant sa grossesse. « Pour la première fois de ma vie, dit Sarah, je me suis dit : Je n'aime pas que l'État dans lequel je vis m'impose cette restriction. Et si je ne teste pas cet embryon, qu'il prend et qu'il y a un problème ? Je comprends que la vie est précieuse, mais je ne veux pas mettre au monde un enfant qui a plus de chances de souffrir qu'un enfant en bonne santé ».
L'expérience de Sarah n'est pas unique. Alex, qui travaille dans une organisation à but non lucratif à Houston et est enceinte de 15 semaines, a fait une fausse couche en 2019. Cette fausse couche s'est terminée par une dilatation et un curetage – une procédure qui retire le tissu fœtal de l'intérieur de l'utérus et constitue une partie standard des soins de fausse couche, essentielle pour prévenir les infections et les saignements abondants. Mais elle peut également être utilisée pour pratiquer un avortement. Alex craint de devoir quitter l'État si elle devait subir la même intervention aujourd'hui.
Elle a de bonnes raisons de s'inquiéter. « Le traitement est en grande partie le même pour une fausse couche et un avortement », a déclaré Mme Suter, « et il est vraiment très difficile de faire la distinction. Comment un médecin peut-il déterminer, lorsqu'une femme se présente avec des saignements, s'il s'agit d'un avortement auto-administré raté ou d'une fausse couche ? »
Kumar a ajouté : » »Les grossesses ectopiques peuvent également constituer une zone grise », a ajouté Kumar. Une grossesse extra-utérine se produit lorsqu'un ovule fécondé se développe en dehors de l'utérus, généralement dans une trompe de Fallope. Au fur et à mesure que la grossesse progresse, la trompe peut se rompre. Cette rupture peut provoquer une hémorragie interne importante, ce qui constitue une urgence médicale.
Bien que le Texas ait adopté une nouvelle disposition en septembre 2023 pour permettre le traitement des grossesses extra-utérines, ainsi que des fausses couches causées par la rupture prématurée des membranes, les médecin·es interrogé·es dans le cadre de cet article ont déclaré que la nouvelle loi n'était pas claire. De plus, un·e médecin·e peut toujours être accusé·e d'avoir fourni ce type de soins si quelqu'un prétend qu'iel a en fait pratiqué un avortement. Et s'elles ou il est inculpé, la loi de l'État prévoit que c'est la médecine ou le médecin lui-même – et non l'État, comme c'est généralement le cas dans les procédures pénales – qui a la charge de la preuve, ce qui signifie qu'elle ou il doit démontrer qu'iel a effectivement traité une grossesse extra-utérine ou une fausse couche.
En conséquence, a déclaré M. Kumar, « la façon dont nous gérons » les grossesses extra-utérines et les fausses couches « a vraiment changé ». Dans les deux cas, « nous devons attendre et surveiller beaucoup plus longtemps qu'auparavant et documenter la situation de manière beaucoup plus approfondie ». Cette approche est contraire aux meilleures pratiques médicales, a-t-il déclaré, car elle retarde les soins essentiels.
Même le traitement du cancer a été affecté par les interdictions d'avortement de l'État. Claire Hoppenot, gynécologue oncologue à Houston, a déclaré qu'elle avait récemment vu une femme enceinte atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Cette femme a finalement été traitée par une procédure cervicale localisée, qui comporte un risque de fausse couche. Mme Hoppenot a déclaré qu'elle s'était interrogée : « Si elle fait une fausse couche à cause de cette intervention, cela va-t-il me poser des problèmes, même si l'intervention n'a rien à voir avec un avortement ? » En fin de compte, la grossesse de la patiente s'est déroulée sans problème, mais Mme Hoppenot a déclaré que ce genre de préoccupations concernant la loi « a changé la façon dont je parle aux patientes ».
La Cour suprême du Texas a reconnu que le personnel médical ne comprenait pas bien la portée de l'interdiction de l'avortement dans cet État. Dans un jugement daté du 11 décembre 2023 refusant des soins d'avortement à Kate Cox (une femme dont la grossesse n'était pas viable et qui a dû fuir le Texas pour se faire avorter), elle a demandé au conseil médical du Texas de clarifier exactement ce que l'exception étroite de l'interdiction signifiait en termes pratiques.
La Cour a déclaré que le conseil pouvait normalement « évaluer diverses circonstances hypothétiques, fournir les meilleures pratiques, identifier les lignes rouges, etc. », comme il l'a fait « dans d'autres contextes, tels que son Covid-19″ » À ce jour, cependant, la commission n'a pas donné d'indications sur la portée des interdictions d'avortement au Texas, et il n'y a pas de date limite pour qu'elle le fasse.
Contacté pour commenter cet article, le conseil n'a pas répondu. Le département de la santé et des services sociaux du Texas a d'abord déclaré qu'il avait « reçu [la] demande » pour cet article « et [qu'il] la traiterait ». Mais trois jours plus tard, il a répondu par écrit : « Nous n'émettons aucun commentaire sur les lois texanes relatives à l'avortement ».
Les partisans de l'interdiction au Texas affirment que le texte de la loi est déjà clair. Le sénateur Bryan Hughes, par exemple, a écrit dans une lettre adressée en août 2022 au conseil médical du Texas que « la loi texane indique clairement que la vie et les principales fonctions corporelles d'une mère doivent être protégées. Toute déviation, telle que des soins retardés pour des grossesses extra-utérines ou des fausses couches, devrait faire l'objet d'une enquête en tant que faute professionnelle potentielle ».
Même si la loi est claire pour les sénateurs de l'État, les preuves recueillies pour cet article indiquent qu'elle n'est pas claire pour les professionnel·les de la santé du Texas. Il en va de même dans d'autres États appliquant des interdictions d'avortement similaires. Par exemple, dans l'Oklahoma – qui interdit l'avortement sauf lorsqu'il est nécessaire pour préserver la vie de la mère – la plupart des hôpitaux n'ont pas pu expliquer quand et comment la décision serait prise d'interrompre une grossesse pour sauver la vie de la mère, selon une étude réalisée en 2023.
En d'autres termes, les problèmes causés par les lois floues sur l'avortement au Texas se posent également dans d'autres États américains : outre l'Oklahoma, l'Alabama, l'Arkansas, l'Idaho, l'Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Tennessee et la Virginie-Occidentale interdisent largement l'avortement, sauf lorsqu'il est nécessaire pour préserver la vie et/ou la santé de la mère (et, dans certains États, en cas d'inceste ou de viol).
Le « préjudice médical global » causé par ces interdictions signifie que les femmes « doivent attendre plus longtemps pour obtenir des soins en cas d'avortement ou de fausse couche » – c'est-à-dire jusqu'à ce que leur besoin de soins soit une urgence. Les retards dans les soins entraînent « une augmentation de la morbidité et de la mortalité maternelles », a expliqué M. Kumar.
L'Amérique a déjà le taux de mortalité maternelle le plus élevé des pays riches, et les personnes de couleur – en particulier les femmes noires – sont touchées de manière disproportionnée.
Les récentes interdictions d'avortement risquent d'aggraver ces problèmes, selon M. Kumar. En d'autres termes, ces interdictions sont mauvaises pour la santé des femmes. Cela semble clair, même si beaucoup d'autres aspects de ces lois restent flous.
*Le nom a été modifié
Kendall Turner, 5 février 2024
Kendall Turner est une écrivaine indépendante et une professeure qui a été stagiaire à la Cour suprême des États-Unis et a participé à des procès concernant l'avortement au Texas et dans d'autres États.
https://www.opendemocracy.net/en/5050/texas-abortion-ban-roe-v-wade-cancer-ivf-law/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mouvements féministes au Pakistan : défis et luttes

Asma Aamir écrit sur la trajectoire et les pratiques actuelles des mouvements féministes pakistanais, leurs défis et leurs voies à suivre
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/02/16/mouvements-feministes-au-pakistan-defis-et-luttes/
Je voudrais parler du Pakistan, un pays qui n'a pas d'État laïc, comme la Turquie et d'autres. Son nom officiel est la République islamique du Pakistan, et le pays est gouverné par les gouvernements fédéral et provinciaux, conformément à la Constitution de 1973. Le système judiciaire est divisé en tribunaux civils, tribunaux pénaux et tribunal de charia, qui examine les lois du pays conformément à la loi et au droit islamique.
La Cour fédérale de la Charia est la seule autorité dotée du pouvoir constitutionnel d'interdire et d'empêcher la promulgation de lois par le Parlement pakistanais lorsqu'elles sont jugées contraires aux préceptes islamiques. La cour se concentre principalement sur l'analyse des lois nouvelles ou existantes dans le pays. Si une loi viole le Coran, la Sunna ou les hadiths, le Tribunal de la Charia interdira sa promulgation.
La Constitution de 1973 garantit, dans son article 16, la liberté de réunion ; à l'article 17, la liberté d'association ; et à l'article 19, la liberté d'expression. Tout cela devrait renforcer l'exercice des droits fondamentaux par chaque citoyen, sans discrimination. L'absence de ces droits est le plus grand obstacle à la croissance d'une société. Les violations croissantes des droits humains constituent une menace ouverte pour la démocratie et le travail des défenseurs des droits humains. La Constitution garantit ces droits, mais ils ne sont pas exercés dans la vie pratique. Le viol est principalement contre les droits des femmes. Plus précisément, la liberté d'expression et de réunion des femmes et des filles est limitée. Il est nécessaire d'assurer la mise en œuvre de leurs droits dans le pays.
Pendant et après la pandémie, l'inflation a accru la pauvreté et les multiples défis sociaux, politiques et économiques du tissu social diversifié du Pakistan. La croissance démographique rapide et les impacts négatifs sur les minorités ethniques et religieuses entraînent des divisions croissantes entre les espaces urbains et ruraux et entre les grandes et les petites villes. Tous ces facteurs contribuent à la transformation continue du comportement social des masses. Le contexte de la pandémie a réduit la main-d'œuvre dans tous les secteurs économiques et causé la perte de nombreux emplois. Les travailleuses, en particulier celles de la classe ouvrière, qui travaillent dans les usines et dans le contexte domestique, ont le plus souffert. Les enseignantes ont été immédiatement démises de leurs fonctions. Et la violence à l'égard des femmes et des filles a augmenté pendant la pandémie.
« L'intolérance ethnique et religieuse est courante et des cas sont occasionnellement signalés » Asma Aamir
Le féminisme dans l'histoire pakistanaise
Face à tous ces défis, l'insécurité des minorités pakistanaises s'est accrue au fil du temps. Dans les années 1980, pendant le régime dictatorial et anti-femmes de Zia-ul-Haq, il y a eu un rétrécissement des espaces civils pour les femmes. Au cours de cette période, l'État a effectivement utilisé les forces politiques religieuses pour accéder au pouvoir. Il a réduit au silence les partis politiques, réprimé la presse et le monde universitaire par la censure et interdit les mouvements étudiants et syndicaux.
C'est à ce moment politique des années 1980 que le premier mouvement féministe, le Forum d'action des femmes, a gagné du terrain. Les femmes se sont réunies et ont renversé les ordonnances Hudud, promulguées en 1979, qui étaient discriminatoires à l'égard des femmes non musulmanes en ce qui concerne les témoignages dans les affaires de viol et de viol collectif. Ce mouvement a organisé l'événement pour protester contre la Loi des preuves (qui forçait la femme violée à présenter quatre témoins pour prouver le crime), les lois de Hudud et d'autres lois discriminatoires à l'égard des femmes. La manifestation a eu lieu sur l'avenue The Mall, à Lahore, ma ville natale. Bien qu'il s'agisse d'un acte pacifique, l'utilisation de gaz lacrymogène pour disperser la foule et arrêter des personnes n'était pas rare. Le Forum d'action des femmes a été ]– et continue d'être – une voix contre toutes sortes d'injustices, en particulier contre les femmes et les minorités. Plus tard, en 2006, les lois ont été mises à jour et n'exigent plus la présentation de quatre témoins.
Le deuxième mouvement féministe populaire du Pakistan a vu le jour en 2000, sous le nom d'Alliance contre le harcèlement sexuel [Alliance Against SexualHarassment – AASHA] et la devise pour mettre fin au harcèlement sexuel au travail. La militante et experte sur les questions de genre Fouzia Saeed, ainsi que d'autres compagnes, telles que la membre de la Marche Mondiale des Femmes Bushra Khaliq, ont engagé des personnalités importantes, telles que des femmes des mouvements populaires, des médias, des parlementaires et des partis politiques. Grâce à ces efforts, en 2010, elles ont eu la chance de faire adopter la loi sur la protection contre le harcèlement des femmes sur le lieu de travail.
Le mouvement populaire actuel, qui s'appelle Marche Aurat [La marche des femmes, en français], s'est renforcée il y a cinq ans, en 2018, avec la devise de la fin du patriarcat. La Marche Aurat est le mouvement des jeunes féministes, avec une approche plus inclusive et intergénérationnelle. Chaque année, la Marche Aurat a lieu le 8 mars, et tout au long de l'année des activités telles que des communiqués de presse, de petites manifestations et des œuvres artistiques sont également organisées.
Défis Contemporains
Les jeunes féministes sont confrontées à la mort, au viol et aux menaces d'attaque à l'acide alors qu'elles exercent leur droit constitutionnel de se réunir et leur droit à la liberté d'expression. Lever un drapeau dérange et irrite la mentalité patriarcale au Pakistan.
La structure, les pratiques et le tissu social sont contre les femmes. Le pouvoir du gouvernement est faible pour protéger les femmes. Les femmes font face à l'opposition à la maison, dans la rue et au travail, mais nous continuons à marcher dans les rues, en lien avec la Journée internationale de lutte des femmes et d'autres agendas.
Les attaques par commentaires et messages privés sur Internet ont apporté de l'insécurité aux jeunes filles. En conséquence, elles ont dû arrêter de publier du contenu sur leur participation dans les espaces publics ou ont commencé à ignorer ces commentaires, faisant face à la peur et à l'insécurité par elles-mêmes. Les médias et les tactiques néfastes de Youtubeurs ont détérioré la cause des filles et des femmes sans enquêter sur la source. Les médias imprimés et électroniques ont publié des affiches manipulées avec des images de filles et de femmes qui ont participé à des actes et à des marches, y compris la mienne.
Les réseaux sociaux affectent la sociologie et la psychologie de ce qui est communiqué, à l'aide de la technologie. Le populisme croissant expose comment la société n'est pas encore prête à donner et à offrir des droits sur le corps aux filles et aux femmes. La devise « merajismmerimarzi » (« mon corps, mon choix ») est devenue une expression osée et audacieuse utilisée par les jeunes féministes pour nier le contrôle du corps des femmes sous la forme de viol conjugal et de non-choix d'avoir des enfants. Beaucoup de gens répudient cette devise et peu l'admettent.
L'espace de divergence se réduit rapidement dans la région Asie-Pacifique. De même, les espaces civils et les mouvements de jeunes féministes au Pakistan sont également en échec.
Les menaces contre la vie des manifestantes se sont multipliées. Les femmes sont confrontées au harcèlement sur Internet, au harcèlement sexuel dans les espaces publics et à la stigmatisation, en raison des fondamentalismes, des secteurs de droite et de l'absence de laïcité. Tous ces défis se posent et demandent beaucoup à l'État et aux communautés de trouver des solutions, de considérer les femmes comme des citoyennes égales dans ce pays, de concevoir des politiques en faveur des femmes et de garantir des espaces civils pour les femmes et les filles.
Notre voie à suivre est de mobiliser et de renforcer les capacités de centaines de jeunes à construire le mouvement, sous la bannière de la Marche Mondiale des Femmes au Pakistan. Avec ce militantisme quotidien, nous continuerons à nous battre pour les droits des femmes et pour des changements structurels. C'est pourquoi nous disons que « nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer ».
*-*
Asma Aamir est membre de la Marche Mondiale des Femmes au Pakistan et membre suppléante du Comité international du mouvement, représentant la région Asie. Cet article est une version éditée de son discours à la 13e Rencontre internationale de la Marche Mondiale des Femmes, qui s'est tenue en octobre 2023 à Ankara, en Turquie.
Langue originale : anglais
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
Édition par Helena Zelic
https://capiremov.org/fr/analyse/mouvements-feministes-au-pakistan-defis-et-luttes/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

M. Seguin, ou comment de toutes jeunes filles sont punies de vouloir vivre…

La morale est très claire : il faut savoir rester à sa place, et quand on est une mignonne petite chèvre innocente et naïve, on ne peut impunément avoir le désir de gambader découvrir la montagne si belle. On est alors châtiée par « la nature », car il n'est pas dans l'ordre des choses que les mignonnes petites chèvres aient un désir de liberté.
Tiré de Entre les lignes et les mots
« La Chèvre de M. Seguin », ou comment les toutes jeunes filles sont punies de vouloir vivre par de « vieux messieurs ».
« Ah qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin… »
Nous connaissons toutes et tous cette histoire d'Alphonse Daudet qui nous raconte comment une mignonne petite chèvre blanche finit, emportée par sa curiosité et son désir de découvrir le monde, dévorée par un loup. La morale est très claire : il faut savoir rester à sa place, et quand on est une mignonne petite chèvre innocente et naïve, on ne peut impunément avoir le désir de gambader découvrir la montagne si belle. On est alors châtiée par « la nature », car il n'est pas dans l'ordre des choses que les mignonnes petites chèvres aient un désir de liberté.
Il a toujours été évident pour moi que Daudet envoyait ici un avertissement (certes pas par bienveillance) aux jeunes filles, ces petites chèvres blanches si mignonnes, qui voulaient découvrir le monde.
En 1989, J.- Cl. Brisseau réalise Noces Blanches. Une très jeune, très gracile, très frêle et très solaire Vanessa Paradis y incarne remarquablement la jeune Mathilde (dont la caractéristique la plus forte passe totalement inaperçue vu le film mais est pourtant centrale dans l'histoire : Mathilde est une jeune surdouée de la philosophie). Vanessa Paradis, pas encore dévorée par le loup du monde malgré son énorme succès dans la chanson, crève littéralement l'écran, face à Bruno Cremer, un vieux monsieur de 60 ans en prof de philo très distingué qui « vit une histoire » (sic) avec elle. Histoire dont on comprend bien que c'est la jeune Mathilde, cette Messaline, qui la pousse, la force, finalement, c'est elle qui le dévoie.
Elle sera punie Mathilde. Un peu comme Lolita de Nabokov d'ailleurs (même si les histoires sont différentes). Enfin, c'est ce qu'on nous laisse entendre. Elle finira suicidée, donc, socialement, « punie ». Et non « victime ». Alors que c'en est bien une, de victime, « Mathilde ». Ce message là aussi il est reçu : les jeunes filles trop brillantes et trop curieuses, trop avides de vouloir « vivre leur vie », comme la chèvre de Monsieur Seguin, seront « punies ».
Qui les punit ? Les vieux messieurs bien-sûr. La société également.
Difficile de ne pas refaire ce lien en entendant Judith Godrèche, en lisant Isild Le Besco ou Vahina Giocante. Difficile aussi de ne pas repenser à Adèle Haenel et à son quasi-slam/manifeste chez Mediapart…
Ces histoires, nous sommes des milliers je pense à les avoir vécues, avec des inconnus, en étant inconnues, dans ma génération. Celle des femmes qui ont aujourd'hui cinquante ans.
A quelques exceptions, elles se ressemblent toutes, ces histoires, elles ressemblent au désastre, elles ressemblent à une mort, elles laissent le goût du sang.
On met longtemps à s'en relever (s'en relève-t-on d'ailleurs vraiment tout à fait ?).
Comment une mignonne petite chèvre se fait piéger par un vieux loup dégueulasse qui se sert de son talent, de son expérience, de sa maturité, de sa position… mais qui se sert surtout de son iridescence à elle, de son désir de vivre, de son envie de liberté, de sa curiosité pour la vie, bref, des désirs romantiques de son âge (on n'est évidemment pas sérieuse quand on a entre 14 et 17 ans), qui se sert aussi souvent, de ce décalage fréquent entre des appétits intellectuels et une maturité affective, pour s'immiscer, séduire, détourner.
On ne disait pas « détournement de mineure » pour rien, c'est parce-que précisément, pendant cette minorité-là, ces trois ans d'immense vulnérabilité, il y a, dans notre société, un piège quotidien, où il suffit à un malin d'un peu d'expérience et d'une bonne dose de saloperie pour juste, tranquillement, te détourner, comme on détourne un cours d'eau avec quelques cailloux posés au bon endroit.
Ce serait presque une métaphore que tant de détournements aient eu lieu à la faveur de tournages. On tourne, on détourne, « ça tourne » et à la fin la tête vous tourne, vous êtes perdue, vous ne savez plus où vous habitez, qui vous êtes, ni dans quelle vie vous évoluez mais en tout cas, ce n'est plus « votre vie ». Avec ces réalisateurs qui sont d'abord là, on l'a bien compris ça y est, pour réaliser, rendre réels, leurs fantasmes dégoûtants, finalement. Le cinéma ne mérite pas cela, mais le cinéma est aussi un moment de duplicité, un monde de vérité renversée, inversée.
Si nombreuses à avoir commis cette erreur fatale de vouloir découvrir la belle montagne, avec nos petits sabots, nos petites cornes luisantes ! Ah comme c'est agréable de ne plus avoir cette corde autour du cou, de pouvoir folâtrer dans le thym et le serpolet, au milieu des trèfles mauves…
C'est très facile de jeter la pierre aux parents. Bien-sûr, parfois, on se dit, « ouhla, ils sont fous eux ». Mais pour les parents qui ont essayé, à l'époque, de protéger leurs enfants, comme Monsieur Seguin avec sa chèvre ? Que pouvaient-ils faire ? Leur passer une chaîne au pied ? Retour au couvent ? Vous croyez que les prédateurs ne savent pas à qui ils s'attaquent ? Ne voient pas très vite, d'abord, la situation de vulnérabilité ? Tiens, ses parents ne sont pas sur le tournage. Tiens, personne ne me demande de comptes. Tiens, la mère est seule à devoir trimer pour élever ses enfants avec un père aux abonnés absents. Tiens la mère est déjà elle-même massacrée par le patriarcat et fait trois tentatives de suicide par an (la mère de la Mathilde de Noces Blanches…) …
Quelle aide leur apportait-on à ces parents à l'époque ? Si la mère était « célibataire », elle risquait d'abord surtout de sérieux ennuis car voyons, tout le monde le sait, « chez les gens bien » ce « genre de choses » ça n'arrive pas, clamait « la bonne société ».
C'est un gros mensonge bien-sûr. C'est juste que les idées dominantes sont les idées de la classe dominante et que « les vieux messieurs » qui raptent les jeunes filles, qui les « séduisent » comme on disait parfois pudiquement, c'est très chic à Saint-Germain-des-Près (ça fait des livres) et dégueulasse chez les ouvriers de Tourcoing. Mais je vous garantis que depuis toujours il y en a partout, dans toutes les couches de la société.
A elles, si elles avaient plus de quinze ans, on venait leur expliquer qu'elles étaient « consentantes » (c'est, je pense, le sens profond du titre du livre de Vanessa Springora. C'est cela, que l'on nous disait : tu étais consentante). Mais consentante pourquoi ? Pour « tomber amoureuse » ? Peut-être. Mais qu'est-ce-que cela signifie à cet âge ? On a brodé sur le « désir » de la Messaline, de la très jeune fille « déjà très ‘en demande' pour son âge ». Mais en demande de quoi ? Certainement pas de pratiques sexuelles, encore moins de pratiques sexuelles violentes, bestiales, dégradantes. Certainement pas d'humiliation, de « correction », de « punition », d'« exhibition »… avec ces « vieux messieurs ».
Ce dont on rêvait à seize ans, c'était de grands espaces, de rencontres, de découvertes, bref, du monde. Alors c'est vrai, cela aussi, cela arrivait. Évidemment, il y a des « portes qui s'ouvrent » et elles ne sont pas tous les jours, toutes, celles de l'armoire de Barbe Bleue. C'est aussi comme cela que l'on se fait piéger et que rapidement, on ne trouve plus « la clef »…
Évidemment on n'est pas « la maîtresse » (sic) la proie d'un homme de vingt-cinq ou trente ans votre aîné à cet âge sans en retirer un « supplément » de « connaissances ». Cela fait « partie du jeu » : on se retrouve remplie à son corps défendant, d'une vie qui n'est pas la nôtre mais la sienne et on « apprend ». Mais Pygmalion, et on le comprend trop tard, c'est d'abord et surtout un « pig* ».
Cela vous laisse d'ailleurs particulièrement abattue, amoindrie, honteuse, vous vous sentez particulièrement bête et stupide quand rétrospectivement vous comprenez, vous « ouvrez les yeux » (comme la Belle au bois dormant). Mais comment, comment a-t-on pu ne pas voir, ne pas comprendre ? On se sent encore plus comme « une chèvre », voire, comme « une dinde ». On se sent punie et donc, on se sent en faute. Car rien de tel qu'une bonne punition pour vous faire sentir coupable.
Au mieux, on parlait de « malentendu » : « Ah c'est un malentendu, elle voulait de l'amour, il voulait du sexe » ! Pardon, je n'appelle pas cela un « malentendu ». La vérité c'est « il voulait du sexe, il voulait de la domination et elle ne le savait pas ».
Il n'y a aucun consentement possible dans une telle situation. Ce n'est pas un malentendu : c'est une arnaque, c'est un piège, c'est un rapt, c'est un détournement, c'est un enlèvement. Ce qu'elle comprend, ce qu'elle peut comprendre, ce qu'elle croit, on s'en fout ou plutôt, fort bien, qu'elle continue à le croire, « le vieux monsieur » a un tout autre objectif.
La vie que vous auriez du avoir si vous n'aviez pas croisé le chemin de ce « vieux monsieur », vous ne la connaîtrez jamais. Vous ne saurez jamais, quelle aurait du être votre vie « sans cela » si au lieu d'une vieille langue avinée et déjà tannée par le vice, c'est celle d'un jeune garçon (n'idéalisons pas, pas forcément plus gentil, mais certainement moins pervers et moins vicieux en tout cas, nécessairement moins expérimenté) que vous aviez connue. Quelle aurait été votre vie sans cette collision frontale qui en une fraction de seconde a fait durablement dévier votre existence de son axe, de sa course, souvent pour un long moment ?
Votre existence est un puzzle à trous, il manque des pièces que vous ne retrouverez jamais.
Ce type d'histoire n'est pour moi qu'une énième façon de punir les femmes, à tous les âges de notre vie, de vouloir devenir des êtres, des êtres libres, des égales. Un épisode de l'éternelle guerre contre les femmes. Rencontrer un Jacquot ou un Monsieur X comparable, c'est la plupart du temps d'abord te faire casser en mille morceaux, à tous points de vue, physiquement, mentalement, sexuellement, psychologiquement… C'est d'abord une punition.
* un cochon, in english.
Elodie Tuaillon-Hibon, Avocate au Barreau de Paris
https://blogs.mediapart.fr/elodie-tuaillonhibon/blog/080224/m-seguin-ou-comment-de-toutes-jeunes-filles-sont-punies-de-vouloir-vivre
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Faut le dire si on vous oestrogêne ! Les tabous féminins

Sans chichi, les tabous auxquels les femmes doivent faire face :
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/02/14/faut-le-dire-si-on-vous-oestrogene-les-tabous-feminins/
Sans chichi, les tabous auxquels les femmes doivent faire face :
Le tabou des règles, et son lot de tabous subsidiaires : le tabou de la tache de sang, des odeurs, du bruit de la protection périodique déballée, de la visibilité des protections périodiques sous les vêtements
Le tabou du Syndrome Pré-Menstruel (SPM) : toutes les joyeusetés avant les règles que vous devez cacher
Le tabou de l'ovulation : c'est déjà une période de vulnérabilité lorsque ce n'est ni le moment ni l'homme choisi pour faire des enfants. Mais quand le président désigne les femmes comme des cibles en garantissant l'impunité aux hommes, et qu'en même temps il veut réarmer la France d'une jeunesse forte, mieux vaut planquer vos ovules féconds. En temps de guerre, le viol des femmes, en espérant qu'elles soient fécondes, est une arme, notamment pour éradiquer la descendance de l'ennemi et la faire sienne.
Le tabou de l'infertilité : toujours plus prégnant sur les femmes et qui les oblige à de nombreux rendez-vous médicaux, prises hormonales et leurs effets, à cacher à tout le monde
Le tabou des 3 premiers mois de grossesse, au cas où… ;
Le tabou des interruptions de grossesse (dont on rappelle que, si certaines sont spontanées, aucune n'est volontaire, celles dites volontaires sont toujours le résultat d'un problème de contraception ou de relation sexuelle au mieux concédée à l'aide de la pression sociale mais jamais consentie) ;
Le tabou des effets négatifs des grossesses et accouchements sur le corps et le psychisme des femmes : post-partum, dyspareunies, fuites urinaires, relâchement musculaire, prise de poids, dépression,mortalité maternelle (augmentation des décès maternelsde 17% en Europe entre 2016 et 2020) ;
Le tabou de l'allaitement et ses effets ;
Le tabou des maladies spécifiquement féminines (cancer des seins, des ovaires, du col de l'utérus, PPV, SOPK, fibrome, etc) ;
Le tabou des chirurgies des parties féminines pour tenter d'atténuer leurs problèmes : hystérectomie, ovariectomie, masectomie ;
Le tabou des sécheresses vaginales et dyspareunies (non, le vagin n'est pas un espace vide, c'est un espace fermé, pour une bonne raison) ;
Le tabou de la ménopause (pré,péri à postménopause) ;
Le tabou des fuites urinaires ;
Le tabou des violences sexistes, des violences intrafamiliales et des violences sexuelles ;
Le tabou des mutilations sexuelles (qui prouvent que ça fait bien longtemps que les hommes ont compris le rôle du clitoris dans l'orgasme féminin, n'en déplaise à Freud et au patriarcat) ;
Le tabou des relations sexuelles insatisfaisantes des femmes et de leur difficulté d'accès à l'orgasme dans les relations hétéro ;
Le tabou des poils, du gras, des rides, des cheveux blancs, des seins (trop gros, trop petits, trop tombants, mais pourtant toujours suffisamment tentants pour qu'on soit obligées de les cacher), etc.
Y'a un moment dans notre vie où on ne vous oestrogène pas ?
Vous comprenez pourquoi on commence timidement à parler de l'éventualité de concéder un pauv' congé menstruel pour règles affreusement incapacitantes Pour mieux occulter l'ensemble de ces pénibilités du quotidien et du travail, qui vont bien au-delà des seules règles incapacitantes prévues dans les 3 propositions de loi « Congés menstruels » PS et Écologistes.
Si ça ce n'est pas du cumul de pénibilités, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?
Je mets au défi n'importe quel homme de mener sa vie professionnelle et personnelle en supportant l'ensemble de ces tabous et leurs effets.
Le tout en situation de dissonance cognitive et d'injonctions contradictoires permanentes, qui sont des facteurs majeurs de risques psycho-sociaux (RPS) :
Une forte sexualisation du corps des femmes : les femmes ne peuvent pas montrer un bout de téton en public mais les pubs et l'art crasse peuvent exposer et humilier sans vergogne le corps des femmes(Rapport Le Sexisme dans la publicité de RAP)
Une exposition du corps des femmes bourrée d'injonctions à la beauté, au bien-être, au positivisme, et à la performance à l'égal des hommes alors que tout est réuni pour les faire échouer. Un exemple récent : Elisabeth Borne nous enjoint de mériter notre petite place : « Je veux dire à toutes les femmes, tenez bon, l'avenir vous appartient. Il reste du chemin pour que chacun (sic) ait toutes ses chances par son mérite et son talent. »
Et après, on regarde les chiffres genrés des troubles psychiques, dépressions, anxiétés, et, non seulement on s'étonne que les femmes fassent plus d'épuisements mais en prime, on vient les culpabiliser parce qu'elles sont dans un état psychique déplorable : Voyez comme vous coûtez cher et comme vous n'êtes pas assez fortes, c'est normal que vous soyez dominées.
Vous allez me dire, c'est le but, épuiser les femmes par tous les moyens pour entraver leur indépendance et préserver leur dépendance économique, donc sexuelle, au patriarcat.
Vous voulez agir ? Rejoignez le collectif informel du Congé Superflux (congesuperflux at proton.me) pour exiger :
un congé hormonal, menstruel et reproductif tout au long de la vie : c'est une pénibilité au même titre que d'autres pénibilités de métiers masculins bien mieux reconnues et qui, pour certaines, donnent lieu à des congés pénibilité.
Une évaluation des pénibilités et risques que vivent les femmes dans leur quotidien et au travail pour faire face à ces tabous et difficultés (L'article Adapter le travail aux cycles des femmes présente quelques exemples de prises de risques au travail du fait de la vie hormonale).
des mesures de prévention primaire, c'est-à-dire une suppression de l'exposition aux risques et non des mesurettes de prévention secondaire et tertiaire (qui feront l'objet d'un prochain article).
La prévention tertiaire, par exemple, c'est l'injonction à renvoyer les femmes chez le docteur. Merci, on y a pensé. Mais, soit notre état est normal, soit ce n'est pas une maladie, soit les docteurs nous collent la pression pour prendre des hormones. Ou alors, on insiste vraiment et c'est partie pour 7 à 10 ans d'errance médicale. « Errance médicale », ça veut dire en claire, suspicion permanente de la parole des femmes qui aggrave, bien entendu leur état de santé (Article sur Les discriminations de sexe et d'ethnie dans la médecine)
Annabel B – ergonome (https://blogs.mediapart.fr)
Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté – N° 427 – 4 février 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au Sénégal, Macky Sall fossoyeur de la démocratie

Incapable de gagner les prochaines élections, le président sortant tente une énième manœuvre pour s'assurer que l'opposition radicale ne remporte pas le scrutin présidentiel.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Fidèle à la devise des potentats africains : « On n'organise pas une élection pour la perdre », le président de la République Macky Sall a entrepris un véritable coup constitutionnel en repoussant le scrutin à décembre 2024 à quelques heures de l'ouverture électorale officielle.
Le plan A échoue
Après la révision de la Constitution en 2016, le président Sall avait bien tenté de briguer un troisième mandat mais en vain, au vu des oppositions tant à l'intérieur du pays qu'à l'international. Il a donc désigné son dauphin, l'actuel Premier ministre Amadou Ba. Cette décision solitaire a suscité mécontentements et oppositions. Ainsi le camp présidentiel s'est divisé et affaibli avec l'apparition de candidatures dissidentes.
Bien que le président sortant ait préparé le terrain en écartant du jeu électoral son principal concurrent Ousmane Sonko, en dissolvant son parti le PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité), en emprisonnant des dizaines d'opposantEs et en muselant la presse libre, la candidature de son protégé ne fait pas recette. Et le candidat Bassirou Diomaye Faye lui-même emprisonné, qui remplace Sonko, a des grandes chances d'emporter le scrutin.
Un véritable cauchemar pour les élites sénégalaises, car le programme du PASTEF vise à rompre les amarres avec l'ancienne puissance coloniale, se traduisant notamment par la sortie du franc CFA, la fermeture de la base militaire française et l'adoption d'une politique indépendante de l'hexagone.
Le plan B s'écroule
Devant une telle situation, bon gré mal gré, Macky Sall se doit d'intégrer dans son plan la candidature de Karim Wade, le fils de l'ancien président. Il a dû s'exiler pendant de longues années à la suite des affaires de corruption. Mais si un temps Sall et Wade s'opposaient, nécessité faisant loi, leur union contre les partisans de Sonko se scelle. Mais coup de théâtre, la presse révèle la double nationalité française et sénégalaise de Wade, entraînant l'annulation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Les députés de son parti contre-attaquent et exigent une commission d'enquête sur des allégations de corruption de deux juges de cette juridiction. Second coup théâtre, les députés du camp présidentiel votent pour. Ainsi, Macky Sall profite de cette situation, que ses partisans ont créée, pour parler de crise institutionnelle et repousser les élections.
Après avoir fait virer les députés de l'opposition par la gendarmerie, la majorité de l'Assemblée nationale valide la nouvelle date du scrutin au 15 décembre et le prolongement présidentiel d'autant. Soit dix mois, un délai suffisamment long pour permettre à Macky Sall de rebattre les cartes afin que les résultats électoraux soient conformes à ses desiderata. Tel un joueur annulant la partie au motif qu'il n'a plus d'atout dans son jeu ! Désormais, tout est possible y compris que la rue renverse la table.
Paul Martial
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les pays africains les plus endettés face à la Chine

L'Afrique toute entière a vu sa dette multipliée par cinq au cours des vingt dernières années, soit 700 milliards de dollars et les prêteurs chinois représentent 12% de ce total, selon Chatham House, le London Policy Institute.
Tiré de MondAfrique.
Les États-Unis et d'autres pays occidentaux, ont fait pression sur la Chine pour lui demander de jouer le jeu de la restructuration de dettes, c'est-à-dire d'accepter de perdre de l'argent. Mais depuis deux ans, Pékin bloque le système en exigeant que les institutions financières multilatérales (Banque mondiale, FMI) soient intégrées dans les négociations sur la restructuration de la dette.
Cette demande a été rejetée par les autres pays créanciers dans la mesure ou elle bouleverse une règle vieille de plusieurs décennies : les institutions multilatérales sont exemptées de participation aux processus d'allègement de la dette, en raison de leur statut de bailleurs de fonds de dernier recours et des taux d'intérêt très bas qu'elles pratiquent.
Sauf changement d'attitude de Pékin, des millions de personnes qui résident dans des pays vulnérables quitteront la pauvreté pour plonger dans l'extrême pauvreté. Concernant la Zambie, le Sri Lanka et le Ghana, des cotes mal taillées ont été trouvées qui ne permettent pas à ces pays de souffler.
La Zambie a fait défaut en 2020 et tente de restructurer une dette de 8,4 milliards de dollars dont 6 milliards de dollars dus aux prêteurs chinois. La dette totale de la Zambie approche les 20 milliards de dollars. Faute d'accord de restructuration, la Zambie devient un paria sur les marchés financiers internationaux.
Idem pour le Ghana qui a besoin d'un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, mais qui ne peut obtenir cet argent tant que Pékin bloque la restructuration d'une dette de 30 milliards de dollars, dont 2 milliards de dollars dus à la Chine. Le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, a affirmé que 33 pays africains payaient en intérêts des sommes supérieures aux budgets santé et éducation de chacun de ces pays.
Un assouplissement de l'attitude chinoise sur le cas du Sri Lanka amène les observateurs à généraliser : la Chine va changer d'attitude. Mais en réalité, nul ne sait le niveau de pertes que la Chine a les moyens ou l'envie d'encaisser.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Centrafrique va accueillir la première base militaire russe en Afrique

Bien que jusqu'à présent la Russie se soit distinguée en tant que grande puissance militaire sans présence officielle sur le continent africain, cette situation est sur le point d'évoluer radicalement. En effet, Moscou s'apprête à rompre avec cette tradition en rejoignant le cortège des nations extra-africaines qui ont déjà implanté leurs bases sur le sol africain, souvent sans définir clairement leurs objectifs ultimes.
Tiré de Mondafrique
8 février 2024
Par Jocksy Andrew Ondo-Louemba
Un article de notre partenaire The North Africa Journal
Depuis que la Russie a commencé sa guerre contre l'Ukraine, on nous a dit que Moscou se dirigeait vers le désastre. En écho aux points de vue des gouvernements occidentaux, des groupes de réflexion et de leurs analystes, de nombreux médias nous ont dit que la Russie n'aurait pas l'endurance nécessaire pour soutenir une campagne prolongée alors que l'Occident finançait et armait l'Ukraine. Mais si les actions de la Russie en Afrique sont des indicateurs de son niveau actuel d'endurance, Moscou semble plus revigorée que jamais. Ses actions se font sentir partout sur le continent, laissant entendre que sa campagne en Ukraine ne perd pas de son élan, comme certains voudraient nous le faire croire.
La Russie rejoint le club des pays ayant des bases en Afrique
Fait intéressant, la Russie est peut-être la seule grande puissance militaire à ne pas avoir de base militaire en Afrique. Mais cela est sur le point de changer. La Russie va rejoindre une longue liste de pays non africains qui ont déjà établi des bases sur le continent, la plupart sans objectif final clair.
Rien qu'à Djibouti, nous constatons la présence de bases militaires accueillant des troupes des États-Unis, de la France, de la Chine, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne et de la Turquie. Même le Japon a une présence à Djibouti, la seule empreinte étrangère japonaise en dehors du Japon. Ironiquement, ces troupes étrangères à Djibouti, situées exactement là où les Houthis créent toutes sortes de problèmes et perturbent le commerce maritime mondial, semblent être totalement impuissantes à empêcher les attaques des Houthis contre les navires dans le détroit de Bab el-Mandeb. Toute cette puissance de feu et pour quoi ?
Base Saoudienne à Djibouti
Voici une autre découverte amusante : l'Arabie saoudite, qui est située presque en face de Djibouti, a également une base militaire là-bas. Pourtant, la distance entre la région saoudienne d'Abha et Djibouti n'est que d'environ 450 miles. Et pourtant, les Saoudiens ont jugé important de dépenser des sommes énormes pour avoir une base de l'autre côté du détroit. Pour quoi exactement ? Plus stratégique, cependant, les Émirats arabes unis ont également une base opérationnelle avancée à l'aéroport d'Al-Khadim près de Marj en Libye. De là, nous savons que les Émirats arabes unis fournissent un soutien réel au seigneur de guerre libyen de l'est, Khalifa Haftar, dans sa guerre contre son propre peuple.
Le continent avec le plus grand nombre de troupes étrangères
De toute évidence, l'Afrique est le continent avec le plus grand nombre de troupes étrangères, et pourtant il abrite les nations les plus instables du monde. Pourquoi autant de bases ? De toute évidence, leurs missions ne semblent pas se concentrer sur la protection des routes commerciales, comme on nous l'a dit, étant donné ce que nous voyons dans le détroit de Bab el-Mandeb. Est-ce de la fierté nationale ? Une façon de montrer que les nations riches peuvent « projeter » leur influence ? Les mots clés ici sont « projeter l'influence » car comme on dit en marketing, l'image est souvent ce qui importe le plus pour construire une perception. La France avait de nombreuses bases dans le Sahel et nous avons vu comment les choses se sont terminées.
Devrions-nous donc être surpris qu'une autre puissance aussi importante que la Russie, qui travaille sans relâche pour influencer les nations non occidentales alors qu'elle mène des guerres militaires, économiques et diplomatiques avec l'Occident, veuille se joindre à la fête ? Au cours des derniers mois, il y a eu des rumeurs folles selon lesquelles la Russie s'intéressait à la construction d'une base militaire en Afrique, la première du genre. Mais alors que nous entrons dans l'année 2024, ce qui n'était que spéculation devient rapidement une réalité.
La Centrafrique, un pays instable
Une base militaire russe en République centrafricaine (RCA) est désormais plus susceptible de se concrétiser que jamais. Les autorités de Bangui ont même désigné des terrains à Berengo, à environ 80 kilomètres de la capitale Bangui, pour que les Russes y stationnent jusqu'à 10 000 soldats. La nouvelle est très importante, car comme on insiste souvent dans l'immobilier, tout dépend de « l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement », et l'emplacement de l'Afrique centrale ne peut pas être plus central. Les troupes russes auront la capacité de surveiller ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, à l'est, au nord et au sud à peu près à égale distance entre le nord et le sud et plus rapidement d'est en ouest.
Mais pour la Russie, la République centrafricaine (RCA) ne sera pas une promenade de santé. Le pays est parmi les nations les plus instables du monde. C'est mortel, avec des groupes politiques, régionaux et ethniques utilisant la force et la violence pour régler des comptes et des différends. Alors que la Russie voudrait utiliser la base de Bangui pour soutenir ses opérations à travers l'Afrique et même au-delà, elle devra d'abord faire face à la situation explosive et à l'instabilité totale en RCA.
Bangui le meilleur choix pour Moscou
Premièrement, pourquoi la RCA ? Le président de la RCA, Faustin-Archange Touadera, est un fervent partisan de la Russie. Sa sécurité personnelle est assurée par des officiers du groupe Wagner. Les Russes ont été critiqués dans la protection de Touadera. Il a même déclaré en juillet 2023 que « la Russie avait aidé à sauver la démocratie de la RCA et à éviter une guerre civile ». Outre le fait que la Russie ait pu facilement convaincre Touadera de stationner ses troupes là-bas, la situation géographique de la RCA en fait un emplacement idéal pour une base avec une ambition continentale. La distance entre Bangui et Johannesburg est de moins de 2 200 miles. La distance géographique (route aérienne) entre Bangui et Tripoli en Libye est d'environ 2 000 miles. La distance entre Bangui et Djibouti à l'est est de 1 757 miles. Partout, c'est encore plus proche. Ainsi, l'armée russe aura un accès rapide aux points chauds de l'Afrique et de la péninsule arabique, étant donné que les avions de chasse supersoniques peuvent voler à plus de 1 000 miles par heure. Faites le calcul !
Une base chez Bokassa
Cela fait des mois que la création d'une base militaire russe en RCA a été annoncée par diverses sources médiatiques. Le média russe Sputnik a récemment révélé que les autorités centrafricaines ont réservé un site dédié à la Russie près de Bangui. Barengo, le futur site de la base russe, est là où se trouve un aéroport international, mais le site dispose déjà d'un ensemble de casernes qui pourraient être transformées en partie de la base. C'est aussi à Berengo que se trouvait la cour de l'éphémère Empire Centrafricain crée par Jean Bedel Bokassa dit Bokassa 1er. En plus du groupe Wagner, la Russie compte environ 1 900 instructeurs en RCA, aidant l'armée et d'autres services de sécurité et protégeant le président.
Plaidant en faveur de l'accord, les autorités centrafricaines affirment que cette base bénéficiera à l'armée centrafricaine, qui devrait recevoir une formation supplémentaire de la part des instructeurs russes. En plus de la formation militaire, les autorités de Bangui comptent sur les soldats russes pour des tâches de sécurité étendues telles que « renforcer la sécurité territoriale », une expression qui signifie probablement que les soldats russes sont impliqués dans les conflits internes. Pour un pays confronté à des rébellions armées partout, les Russes devraient aider le gouvernement centrafricain à survivre et à reprendre une partie du territoire perdu aux divers groupes insurgés.
Accords militaro-sécuritaires avec l'Afrique
Outre la RCA, la forte présence de forces étrangères d'Amérique du Nord et d'Europe et de plus en plus d'Asie et même de nations du Golfe en Afrique, a incité la Russie à conclure des accords militaires et des accords de coopération sécuritaire avec de nombreux pays africains, tout en soulignant la nécessité d'établir des bases militaires sur le continent. Selon un rapport du ministère allemand des Affaires étrangères, Moscou souhaite avoir six bases militaires sur le continent, ciblant l'Égypte, l'Érythrée, Madagascar, la République centrafricaine, le Soudan et la Libye. Jusqu'à présent, la présence russe sur le continent s'est faite par le biais du groupe de mercenaires Wagner opérant en République centrafricaine, au Mali, au Soudan et en Libye.
Difficultés en perspectives
Mais à quoi la Russie est-elle confrontée en RCA ? Le nombre croissant de groupes rebelles armés en RCA a intensifié leurs attaques sur le territoire centrafricain et continue de menacer le rétablissement d'une vie politique normale dans ce pays. Des affrontements avec les forces gouvernementales ou des milices affiliées sont susceptibles d'augmenter dans les mois à venir.
Un aperçu de ces groupes rebelles nous permet de mieux évaluer les forces actives dans l'insurrection.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En Égypte, la militarisation croissante de la justice et du maintien de l’ordre

Une nouvelle loi, promulguée début février, étend les compétences des tribunaux militaires aux “atteintes aux besoins fondamentaux” en matière alimentaire, et confère à l'armée une partie des tâches jusqu'alors réservées à la police. Le régime veut ainsi prendre les devants pour parer au risque d'une explosion sociale, estiment les médias indépendants ou étrangers.
Tiré de Courrier international.
La promulgation d'une “nouvelle loi pour la protection des infrastructures publiques” a été annoncée le 8 février par tous les journaux égyptiens, à l'instar du quotidien Al-Shorouk, qui en précise les contours.
Elle va renforcer le rôle de l'armée dans le maintien de l'ordre, et étendre la compétence des tribunaux militaires à de nouveaux domaines, purement civils.
“Mafias du marché noir”
Au nom de la sécurité nationale, c'est donc l'armée qui assurera “la sécurisation et la protection” des “infrastructures vitales” du pays, avec une liste non exhaustive allant des champs de pétrole aux “grands réseaux routiers”. Autre volet de cette loi : ce sont les tribunaux miliaires qui traiteront “les atteintes aux besoins fondamentaux de la société en matière de biens et de produits alimentaires”.
Désormais, “l'épée de la loi plane sur les mafias du marché noir”, titre le quotidien égyptien Al-Yom Al-Sabee, qui vante “les mesures sages” du gouvernement pour lutter contre les “manipulations des prix” par des malfaiteurs. Selon le journal, la nouvelle législation permettra d'alléger les difficultés économiques de la population.
C'est bien la crise économique qui explique l'adoption de cette loi, estime de son côté le journal panarabe financé par les États-Unis Al-Hurra. Pourtant, ce n'est pas pour venir en aide à la population, mais pour se prémunir contre d'éventuelles révoltes populaires que le régime en a pris l'initiative.
Un outil pour réprimer toute contestation
“L'Égypte fait face à l'une des pires crises économiques de son histoire, avec une inflation annuelle qui a atteint un niveau record de 35,2 % ”, explique le journal. Ce qui fait craindre que “les gens ne descendent dans la rue pour protester contre les hausses de prix. Le gouvernement veut pouvoir recourir aux forces armées pour y faire face.”
“Selon des milieux politiques, le recours croissant à l'armée montre que le régime a le sentiment que la colère économique pourrait être exploitée par des forces ennemies”, écrit le quotidien panarabe Al-Arab.
Le site égyptien indépendant Mada Masr dénonce pour sa part la tendance récurrente à la “militarisation de l'État”, rappelant notamment une réforme constitutionnelle de 2019 qui donne à l'armée le rôle de garant de l'ordre constitutionnel.
Il s'agit d'une “extension sans précédent de la possibilité de traduire des civils devant la justice militaire”, avec un champ d'application défini dans des termes délibérément vagues, estime encore Mada Masr.
Cette réforme est “la plus dangereuse” de toutes les réformes constitutionnelles et légales ayant conféré à l'armée des pouvoirs civils, estime un “vice-président de la Cour d'appel”, cité anonymement par Mada Masr. “Elle donne au président ou à celui qu'il mandatera la possibilité de dire ce qu'il veut pour définir un crime” et d'en dicter la peine, au détriment de la justice ordinaire.
Courrier international
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au Chili, la terrible répression des indigènes en lutte contre l’industrie forestière

Au Chili, la terrible répression des indigènes en lutte contre l'industrie forestière
Dans une prison du sud du Chili, 4 militants politiques mapuches en lutte contre l'industrie forestière mènent depuis 3 mois une grève de la faim. Voilà longtemps que l'État criminalise les revendications de ce peuple indigène.
9 février 2024 | tiré de reporoterre.net
https://reporterre.net/Au-Chili-la-terrible-repression-des-indigenes-en-lutte-contre-l-industrie-forestiere
Concepción (Chili), reportage
Autour d'une petite table ronde, un maté circule de main en main. Les traits sont tirés et les regards graves, mais l'atmosphère, chaleureuse, aide à oublier un instant le vacarme des poids lourds. Ils vont et viennent le long de la route qui borde le centre pénitentiaire de Concepción, dans le sud du Chili. Face à la prison, sous la passerelle de béton qui enjambe l'autoroute, les familles de quatre prisonniers mapuches ont installé un modeste campement.
Pamela Pezoas, les yeux rougis par l'épuisement et l'angoisse, a attendu toute la journée du 2 février des nouvelles de son fils. Ernesto, 28 ans, a été hospitalisé en urgence le matin même, à la suite d'une décompensation cardiaque. Lui et trois de ses camarades ont été condamnés le 16 novembre 2023 à quinze ans de réclusion pour le sabotage de camions de l'industrie forestière.
Cette industrie est omniprésente sur les terres revendiquées de haute lutte par les Mapuches, première population indigène du Chili qui compte 1,7 million de personnes. Pour protester contre ce qu'ils considèrent être un jugement politique, les quatre détenus ont engagé une grève de la faim, qui dure depuis 12 semaines, déterminés à résister « jusqu'aux ultimes conséquences ».

Le centre pénitentiaire de Concepción, dans le sud du Chili. © Cristóbal Olivares / Reporterre
« Populisme pénal »
Josefa Ainardi, l'avocate des militants, l'affirme : les quatre Mapuches ont été condamnés pour leur appartenance à la Coordinación Arauco-Malleco (CAM). Ce groupe politique nationaliste mapuche organise depuis la fin des années 1990 des opérations de sabotage contre les intérêts des multinationales du bois. Selon les termes mêmes de la sentence, en l'absence de preuve formelle, la justice les a condamnés pour avoir incendié ces camions en se fondant sur un « faisceau d'indices », dont le fait d'appartenir à la CAM.
L'avocate considère que pour alourdir la peine, le délit « d'homicide frustré » (une tentative d'homicide non aboutie) a été ajouté à la condamnation. Elle dénonce cette pratique récurrente de la justice chilienne consistant « à condamner sans preuve et souvent sans crime ». Contacté, le ministère de la Justice n'a pas répondu à nos sollicitations.

En 2014, le Chili a été condamné par la Cour interaméricaine des droits de l'Homme pour avoir violé un certain nombre de droits fondamentaux lors des procédures judiciaires à l'encontre de prévenus mapuches, notamment via la mobilisation d'un arsenal juridique antiterroriste.
Pour Pablo Barnier, docteur associé au Ceri (Sciences Po), spécialiste du droit à l'autodétermination au Chili, les gouvernements de gauche comme de droite prennent « des mesures exceptionnelles pour répondre à des actes avant tout politiques ». Il est bien question, selon lui, « d'une criminalisation et d'une judiciarisation dangereuse » de la lutte pour l'autonomie des Mapuches.
Josefa Ainardi, l'avocate des militants, dénonce de son côté un « populisme pénal », qui témoigne de la criminalisation des revendications indigènes par l'État. Pour elle, « c'est une vision du monde divergente que l'on condamne avant tout ». La défense a déposé un recours devant la Cour suprême pour faire annuler le verdict au motif de l'absence de preuves. Le résultat du recours sera rendu le 9 février.
Terres ancestrales
Sur les murs de béton qui bordent le campement, des doigts errants ont peint les visages des jeunes hommes emprisonnés, les cheveux noués du bandeau traditionnel des combattants mapuches. Pamela balaie la fresque du regard : « En tant que mère, c'est douloureux. Je souhaiterais qu'il existe d'autres voies que la grève de la faim pour résoudre le problème des droits de notre peuple. » Pour s'opposer à ce qu'elle considère comme une « nouvelle colonisation » par l'industrie forestière, Pamela invoque un droit collectif à se défendre, prôné par la CAM, à travers la méthode dite du « contrôle territorial ».
Cette stratégie consiste à récupérer les terres ancestrales des Mapuches dont les titres de propriété ont été spoliés par les puissants acteurs du bois — notamment pendant la dictature de Pinochet. La population autochtone était alors exsangue depuis la conquête au XIXᵉ siècle du sud du pays par la toute nouvelle République chilienne. Ce sont plus de 3 millions d'hectares qui auraient été usurpés dans la région de l'Araucanie, dont plus 2,3 millions appartiennent aujourd'hui à l'industrie du bois. En 2019, ce sont 45,3 millions de m3 qui ont été coupés au Chili pour un secteur qui représente selon les années entre 2 et 3 % du PIB du pays.

La mère d'Esteban montre son fils, faible et attaché à son lit d'hopîtal. © Cristóbal Olivares / Reporterre
Une fois récupérées, par le sabotage, notamment, des moyens de production de l'industrie forestière, par les militants de la CAM aux latifundistes — les grands propriétaires —, les terres sont redistribuées à la communauté, ensemencées et travaillées pour vivre en autonomie. Pour Pamela, la recomposition du tissu politique et social mapuche passe par le travail de cette terre ancestrale.
Pour Pamela, les communautés Mapuche reconstituent une organisation traditionnelle de la société grâce à ce retour à leur terre ancestrale dont ils avaient été expropriés. Celle-ci a été éreintée et asséchée par les monocultures d'eucalyptus et de pin, extrêmement gourmandes en eau et polluantes. Au Chili, l'industrie forestière consomme en moyenne 59 % des ressources en eau du pays.
Dans les territoires où vivent les Mapuches, les populations sont très souvent contraintes de se faire livrer l'eau potable par camion-citerne. Par ailleurs, en remplaçant les espèces sylvestres endémiques et indigènes par la monoculture, la production de bois participe à la destruction de la biodiversité, réduisant à peau de chagrin la possibilité pour les Mapuches de récolter les plantes essentielles à leurs cérémonies.
Aspirations autonomes
Cette aspiration à l'autonomie des Mapuches, écologiste et radicalement anticapitaliste, entre en contradiction avec les intérêts de l'agro-industrie et « trouve sur son chemin la puissance de l'État », regrette Pamela.
Le 1ᵉʳ février, le président de la République, Gabriel Boric, a annoncé l'envoi de troupes supplémentaires dans les régions du sud pour soutenir des effectifs militaires toujours plus nombreux. Le territoire est soumis à l'état d'urgence depuis mai 2022, après la multiplication de coupures de routes attribuées à la CAM. Ces mesures sécuritaires viennent renforcer la nouvelle loi relative à l'usurpation des terres de novembre 2023, qui allonge les peines de prison pour l'occupation illégale et vise les communautés mapuches, de l'avis même des députés qui l'ont rédigée.
Fresia Narin, guérisseuse, travaille à tisser un lien entre médecine occidentale et ancestrale. © Cristóbal Olivares / Reporterre
Pamela Pezoas, lasse, décrit les humiliations quotidiennes de la militarisation du Wallmapu, le nom du territoire ancestral mapuche : « Le survol à basse altitude des hélicoptères de combat, les blindés qui patrouillent dans nos champs pour protéger les industriels du bois et les soldats qui se permettent des fouilles intempestives de nos maisons. »
Herbes médicinales
À 3 km de la prison se dressent les bâtiments délavés de l'hôpital de Concepción. Fresia Narin, guérisseuse, reçoit vêtue de sa blouse traditionnelle aux motifs bleu nuit. Depuis 2011, elle travaille à tisser un lien entre médecine occidentale et ancestrale. Elle est ce jour-là toute dévouée à veiller au chevet d'Ernesto, qui a rejoint son codétenu Esteban, hospitalisé quelques jours plus tôt à la suite de l'aggravation de son état de santé.
Ils sont surveillés jour et nuit par des policiers, pieds et poing liés, leur fenêtre barrée d'une grille au cas où l'envie leur prendrait de s'échapper. Fresia a convaincu les gardes de la laisser adresser aux quatre prisonniers des prières pour les accompagner dans leur lutte contre la mort.

Graffiti en soutien aux prisonniers politiques. Quatre Mapuches ont été condamnés en novembre 2023 à quinze ans de réclusion pour le sabotage de camions. © Cristóbal Olivares / Reporterre
L'administration pénitentiaire a jusque-là refusé que soit mis en place entre ses murs un espace réservé aux Mapuches, au sein duquel peuvent être organisées des cérémonies religieuses. Les familles sont interdites de visite lorsqu'elles sont vêtues des tenues d'apparat ou lorsqu'elles apportent le « lawen », une boisson à base d'herbes médicinales dont les propriétés allègent les contraintes du jeûne.
Ces vexations discriminantes entrent en porte-à-faux avec la convention 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ratifiée en 2008 par le Chili et qui reconnaît des droits propres aux détenus membres des communautés indigènes.
Pour l'avocate Josefa Ainardi, la grève de la faim est l'ultime recours pour contraindre l'administration à respecter les engagements internationaux du Chili : « La situation est ubuesque, ils sont condamnés pour être Mapuches, avant qu'on leur retire cette qualité une fois en prison. »
Une veillée s'organise dans le campement sous le pont. C'est ici, parmi les mères et les compagnes des prisonniers, que se décide la suite de la mobilisation, à la lumière crue des lampadaires et des gyrophares qui zèbrent la nuit et illuminent le béton. Une nouvelle nuit de peu de sommeil se dessine.
Pamela, convaincue que les autorités peuvent mettre un terme à tout moment au supplice de son fils, laisse échapper un vœu : « Puisse cette nuit être la dernière ici. »

Nicaragua : La révolution confisquée

Révolution nicaraguayenne Sandinistes / FSLN (Nicaragua) ORTEGA Daniel Contre-révolution
La « révolution sandiniste » est le nom de la décennie révolutionnaire qui s'est déroulée au Nicaragua, à la suite du renversement de la dictature de Somoza par le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) en juillet 1979.
8 février 2024 | tiré d'Europe solidaire sans frontièresNPA (Commission Amérique latine)
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article69765
Cette révolution a permis des campagnes massives d'alphabétisation, des avancées dans les domaines de la culture et de la santé, les réformes agraires (malgré leurs contradictions) et le formidable élan démocratique qui a traversé le pays (dans la pluralité politique).
Mais la guerre « civile », ouvertement financée par les États-Unis, la dégradation de la situation économique (elle aussi largement orchestrée par les USA) ainsi que des contradictions internes à la révolution (centralisme du FSLN, pas de débat de congrès en dix ans, le nombre de morts d'appelés au service militaire) ont eu raison du souffle révolutionnaire. Et les sandinistes ont été défaits aux élections de 1990.
Retour au pouvoir de Daniel Ortega
Quatorze années plus tard, l'ancien dirigeant sandiniste Daniel Ortega a remporté les élections. Mais il ne se réclame plus de la révolution qu'à des fins de propagande. C'est dans un climat de concentration extrême du pouvoir que le Nicaragua a connu une véritable insurrection civique en 2018. Le déclencheur en a été une contre-réforme des retraites imposée par le FMI : la répression qui s'est abattue sur les retraitéEs qui manifestaient a entraîné une réponse immédiate des étudiantEs. Eux-mêmes répriméEs. C'est alors toute la société qui s'est mobilisée.
Bien au-delà de la question des retraites, la contestation s'est attaquée à la corruption et au pouvoir absolu du couple présidentiel. La population exigeait le départ d'Ortega et la restauration de l'État de droit.
Répression et combat contre la dérive dictatoriale
Au prix de plusieurs centaines de morts, de milliers d'arrestations et de centaines de milliers d'exiléEs, le pouvoir a obtenu une apparence de retour à l'ordre. Et il s'est employé, depuis l'automne 2018, à renforcer son pouvoir coercitif et à annihiler toute forme d'opposition.
Actuellement, il n'existe plus de journaux ni de médias indépendants. La prison ou l'exil sont les seuls choix proposés par la dictature d'Ortega. La prison « el Chipote », tristement célèbre sous Somoza, n'a jamais cessé d'emprisonner et de torturer. La population est surveillée par des paramilitaires. Les fonctionnaires sont obligéEs de participer aux manifestations de soutien au régime sous peine de perdre leur emploi. Ortega n'est en rien l'héritier de la révolution sandiniste : il en est le fossoyeur. Pour faire chuter la dictature, l'opposition en exil essaie de se reconstruire (y compris avec les dirigeantEs sandinistes ayant refusé la dérive dictatoriale) et en renouant les liens entre les opposantEs restés dans le pays.
Commission Amérique latine du NPA

Haïti : La nécessité de la lutte organisée

Depuis plus trois semaines, les classes populaires se mobilisent contre l'ordre de la terreur instauré dans le pays depuis 16 novembre 2018. Au cours de la journée du 7 février de cette année, des centaines de milliers de personnes ont investi les rues de plusieurs villes du pays pour demander le départ du Premier ministre de facto Ariel Henry. Cette date est emblématique parce qu'elle marque le trente-huitième anniversaire de la chute de la dictature des Duvalier.
Rappelons que la lutte pour renverser la dictature visait également à changer l'État haïtien qui, pendant plus de 200 ans, reproduit la misère, l'exclusion et l'oppression. Un État qui, depuis 1915, est totalement assujetti aux seuls intérêts de l'impérialisme étatsunien. C'est cet État, aujourd'hui en pleine décomposition, qui s'est transformé en un État-voyou, dirigé par un régime dont l'appui aux gangs criminalisés n'est plus à démontrer. Cet État, malgré sa déliquescence, est maintenu en vie grâce au soutien inconditionnel de l'impérialisme étatsunien et de l'oligarchie.
Cet État-voyou est donc nécessaire à la continuation de la domination et au pillage des ressources du pays. C'est pourquoi la répression est essentielle pour que l'impérialisme étatsunien et l'oligarchie puissent continuer à préserver leurs intérêts. Et c'est dans ce sens que l'on doit comprendre le rôle joué par les gangs aujourd'hui.
Les classes populaires sont conscientes que la montée en puissance de ces gangs criminels fédérés est objectivement liée aux intérêts de l'oligarchie et de l'impérialisme. En facilitant et finançant le développement des gangs dans les principaux centres urbains du pays, les oligarques et le gouvernement de facto souhaitent neutraliser toutes mobilisations contre la misère, l'absence de services publics, de santé, d'éducation, etc.
De jour en jour, la répression par le truchement des gangs atteint de nouveaux sommets. Pour l'année 2023, plus de 8000 personnes sont assassinées ou kidnappés. À l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, suite aux attaques des gangs, au moins 100 000 personnes sont contraintes de fuir leur maison. Au mois de janvier 2024 uniquement, plus de 1800 personnes sont assassinées dont la moitié sont des enfants (Selon l'UNICEF).
Aujourd'hui, une évidence s'impose à nous : le gouvernement de facto restera au pouvoir aussi longtemps que ses tuteurs étrangers et de l'oligarchie lui intimeront l'ordre d'y rester. Une autre réalité nous semble également évidente : les propositions soumises par des groupes de la société civile de trouver « une solution haïtienne pacifique » à la crise ont atteint les limites objectives qui étaient inscrites dans la démarche de ces groupes dès le début. L'impérialisme n'entend négocier avec personne et n'entend faire aucun compromis touchant sa domination et ses intérêts. Et, il est important de le répéter : la forme de la domination impériale aujourd'hui exclut toutes formes de démocratie représentative formelle, d'institutions d'un État souverain et démocratique. Pour l'impérialisme, la domination doit être totale.
Mais pour qu'elle soit totale, cette domination doit s'appuyer sur une violence totale. Voilà pourquoi il est impératif que les classes populaires s'organisent pour construire une résistance totale face à cette violence. Le temps des manifestations spontanées de masse uniquement nous semble révolu.
Aujourd'hui, le temps est à la construction de la lutte organisée à court, à moyen et à long termes !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Pour vaincre l’extrême droite, nous avons besoin d’une gauche plus radicale ! » Alvaro Garcia Linera

Entrevue avec Alvaro Garcia Linera, ex-vice-président de la Bolivie, par Tamara Ospina Posse pour Jacobin Amérique latine.
12 février 2024 | tiré d'Alter-Québec | Photo : Álvaro García Linera, ex-vice-président bolivien, Buenos Aires, 2020. crédit photo Ariel Feldman.
https://alter.quebec/pour-vaincre-lextreme-droite-nous-avons-besoin-dune-gauche-plus-radicale/
A la suite de son voyage en Colombie pour inaugurer le cycle de réflexion « Imaginer l'avenir depuis le Sud », organisé par le ministère de la Culture de Colombie et dirigé par la philosophe Luciana Cadahia, l'ancien vice-président bolivien Álvaro García Linera a commenté le paysage politique et social que traverse l'Amérique latine en ce « temps liminal » ou interrègne que nous devrons traverser au cours des 10 ou 15 prochaines années, jusqu'à la consolidation d'un nouvel ordre mondial. 1.
Il est clair que cette obscurité instable est le moment propice à l'entrée en scène des droites ultra-droitières les plus monstrueuses qui, dans une certaine mesure, sont la conséquence des limites du progressisme. Dans cette nouvelle étape, Linera soutient que le progressisme doit miser sur une plus grande audace pour, d'une part, répondre avec responsabilité historique aux demandes profondes qui se trouvent à la base de l'adhésion populaire, et d'autre part, neutraliser les chants de sirène des nouvelles droites. Cela implique de progresser dans des réformes profondes concernant la propriété, les impôts, la justice sociale, la distribution de la richesse et la récupération des ressources communes au profit de la société. Ce n'est qu'ainsi, en commençant par résoudre les demandes économiques les plus fondamentales de la société et en avançant vers une démocratisation réelle, que l'on pourra confiner à nouveau les ultradroites dans leurs niches, soutient Linera.
Tamara Ospina Posse – TOP : Dans la région, le XXIe siècle a commencé avec une vague de gouvernements progressistes qui ont réorienté le cours de l'Amérique latine, mais cette dynamique a commencé à s'enliser après la victoire de Mauricio Macri en Argentine en 2015, ce qui a conduit beaucoup à prédire la fin du progressisme régional. Ainsi, une vague de gouvernements conservateurs a commencé, mais, à contre-courant, dans des pays comme le Brésil, le Honduras ou la Bolivie, le progressisme est revenu. Et dans d'autres pays, comme le Mexique et la Colombie, il a réussi à accéder au pouvoir pour la première fois. Comment lisez-vous cette tension actuelle entre les gouvernements populaires ou progressistes et d'autres conservateurs ou oligarchiques ?
Alvaro Garcia Linera – AGL : Ce qui caractérise l'époque historique qui va de 10 ou 15 ans en arrière jusqu'aux 10 ou 15 prochaines années est le déclin lent, angoissant et contradictoire d'un modèle d'organisation de l'économie et de légitimation du capitalisme contemporain, ainsi que l'absence d'un nouveau modèle solide et stable qui reprenne la croissance économique, la stabilité économique et la légitimation politique. C'est une longue période, nous parlons de 20 ou 30 ans, à l'intérieur de laquelle réside ce que nous avons appelé « temps liminal » — ce que Gramsci appelait « interrègne » — où se succèdent des vagues et des contre-vagues de multiples tentatives pour résoudre cette impasse. L'Amérique latine — et maintenant le monde, car l'Amérique latine a devancé ce qui s'est ensuite produit partout — a vécu une vague progressiste intense et profonde, qui n'a pas réussi à se consolider, suivie d'une contre-vague régressive conservatrice et ensuite d'une nouvelle vague progressiste. Nous verrons probablement encore au cours des 5 ou 10 prochaines années ces vagues et contre-vagues de victoires courtes et de défaites courtes, de courtes hégémonies, jusqu'à ce que le monde redéfinisse le nouveau modèle d'accumulation et de légitimation qui lui redonnera au monde et à l'Amérique latine un cycle de stabilité pour les 30 années suivantes. Tant que cela n'arrivera pas, nous assisterons à cette tourmente propre au temps liminal. Et, comme je le disais, on assiste à des vagues progressistes, à leur épuisement, à des contre-réformes conservatrices qui échouent également, à une nouvelle vague progressiste… Et chaque contre-réforme et chaque vague progressiste est différente de l'autre. Milei est différent de Macri, bien qu'il en reprenne une partie. Alberto Fernández, Gustavo Petro et Andrés Manuel López Obrador sont différents des référents de la première vague, bien qu'ils en reprennent une partie de l'héritage. Et je pense que nous continuerons à assister à une troisième vague et à une troisième contre-vague jusqu'à ce que, à un moment donné, l'ordre du monde se définisse, car cette instabilité et cette angoisse ne peuvent être perpétuelles. Au fond, comme cela s'est passé dans les années 30 et 80 du XXe siècle, ce que nous voyons est le déclin cyclique d'un régime d'accumulation économique (libéral entre 1870 et 1920, capitalisme d'État entre 1940 et 1980, néolibéral entre 1980 et 2010), le chaos que génère ce déclin historique, et la lutte pour instaurer un nouveau et durable modèle d'accumulation-domination qui reprenne la croissance économique et l'adhésion sociale.
TOP : Nous pouvons observer que la droite recommence à mettre en œuvre des pratiques que nous pensions dépassées, y compris les coups d'État, la persécution politique et les tentatives d'assassinat… Vous-même avez même été victime d'un coup d'État. Comment pensez-vous que ces pratiques continueront à évoluer ? Et comment pouvons-nous y résister à partir des projets populaires ?
AGL : Une caractéristique du temps liminal, de l'interrègne, est la divergence des élites politiques. Lorsque les choses vont bien — comme jusqu'aux années 2000 —, les élites convergent autour d'un seul modèle d'accumulation et de légitimation et tout le monde devient centriste. Les gauches elles-mêmes s'atténuent et se néolibéralisent, bien qu'il y ait toujours une gauche radicale, mais marginale, sans audience. Les droites se disputent aussi entre elles, mais seulement pour des remplacements et des ajustements circonstanciels. Lorsque tout cela entre dans son déclin historique inévitable, les divergences commencent et les droites se scindent en droites extrêmes. L'extrême droite commence à dévorer la droite modérée. Et les gauches les plus radicalisées sortent de leur marginalité et de leur insignifiance politique, commencent à acquérir de la résonance et de l'audience, à croître. Dans l'interrègne, la divergence des projets politiques est la norme, car il y a des recherches, des dissidences les unes des autres, pour résoudre la crise de l'ancien ordre, au milieu d'une société mécontente, qui ne fait plus confiance, qui ne croit plus aux anciens « dieux », aux anciennes recettes, aux anciennes propositions qui ont garanti la tolérance morale envers les gouvernants. Et donc, les extrêmes commencent à se renforcer.
C'est ce que nous verrons avec les droites. La droite centriste, qui a gouverné le continent et le monde pendant 30 ou 40 ans, n'a plus de réponses aux échecs économiques évidents du libéralisme mondial et, face aux doutes et aux angoisses des gens, une extrême droite émerge qui continue de défendre le capital, mais qui pense que les bonnes manières de l'ancien temps ne suffisent plus et qu'il faut maintenant imposer les règles du marché par la force. Cela implique de domestiquer les gens, si nécessaire à coups de bâton, pour revenir à un libre marché pur et magique, sans concessions ni ambiguïtés, car — selon eux — c'est cela qui a causé l'échec. Alors, cette extrême droite tend à se consolider et à gagner plus d'adeptes en parlant d'« autorité », de « choc de libre marché » et de « réduction de l'État ». Et s'il y a des soulèvements sociaux, il convient d'utiliser la force et la coercition, et si nécessaire le coup d'État ou le massacre, pour discipliner les dissidents qui s'opposent à ce retour moral aux « bonnes mœurs » de l'entreprise libre et de la vie civilisée : avec les femmes qui cuisinent, les hommes qui commandent, les patrons qui décident et les ouvriers qui travaillent en silence. Un autre symptôme du déclin libéral se manifeste lorsque l'on ne peut plus convaincre ni séduire et que l'on doit imposer ; ce qui signifie qu'ils sont déjà dans leur crépuscule. Mais cela ne les rend pas moins dangereux, en raison de la radicalité autoritaire de leurs impositions.
Face à cela, le progressisme et les gauches ne peuvent pas adopter une attitude condescendante, en essayant de contenter toutes les factions et tous les secteurs sociaux. Les gauches sortent de leur marginalité dans le temps liminal parce qu'elles se présentent comme une alternative populaire au désastre économique causé par le néolibéralisme entrepreneurial ; et leur fonction ne peut pas être de mettre en œuvre un néolibéralisme avec un « visage humain », « vert » ou « progressiste ». Les gens ne descendent pas dans la rue et ne votent pas pour la gauche pour décorer le néolibéralisme. Ils se mobilisent et changent radicalement leurs anciennes adhésions politiques parce qu'ils en ont marre de ce néolibéralisme, parce qu'ils veulent s'en débarrasser, car il n'a enrichi que quelques familles et quelques entreprises. Et si la gauche ne répond pas à cela, et coexiste avec un régime qui appauvrit le peuple, il est inévitable que les gens tournent radicalement leurs préférences politiques vers des issues d'extrême droite qui offrent une sortie (illusoire) au grand malaise collectif. Les gauches, si elles veulent se consolider, doivent répondre aux demandes pour lesquelles elles sont apparues et, si elles veulent vraiment vaincre les extrêmes droites, elles doivent résoudre de manière structurelle la pauvreté de la société, l'inégalité, la précarité des services, l'éducation, la santé et le logement. Et pour pouvoir réaliser cela matériellement, elles doivent être radicales dans leurs réformes sur la propriété, les impôts, la justice sociale, la distribution de la richesse, la récupération des ressources communes au profit de la société. S'arrêter à cette œuvre va alimenter la loi des crises sociales : toute attitude modérée face à la gravité de la crise encourage et alimente les extrêmes. Si les droites font cela, elles alimentent les gauches, si les gauches le font, elles alimentent les extrêmes droites.
Ainsi, la manière de vaincre les extrêmes droites, en les réduisant à un ghetto — qui continuera d'exister, mais sans irradiation sociale — réside dans l'expansion des réformes économiques et politiques qui se traduisent par des améliorations matérielles visibles et soutenues dans les conditions de vie des grandes majorités populaires de la société ; dans une plus grande démocratisation des décisions, dans une plus grande démocratisation de la richesse et de la propriété, de sorte que la contention des extrêmes droites ne soit pas simplement un discours, mais qu'elle soit appuyée par toute une série d'actions pratiques de distribution de la richesse qui résolvent les principales angoisses et demandes populaires (pauvreté, inflation, précarité, insécurité, injustice, etc.). Car, il ne faut pas oublier, que les extrêmes droites sont une réponse, pervertie, à ces angoisses. Plus vous distribuez la richesse, certes plus vous affectez les privilèges des puissants, mais eux vont devenir une minorité autour de la défense acharnée de leurs privilèges, tandis que les gauches se consolideront comme celles qui se préoccupent et résolvent les besoins de base du peuple. Mais, plus ces gauches ou progressismes se comportent de manière peureuse, timorée et ambiguë dans la résolution des principaux problèmes de la société, plus les droites extrêmes vont croître et le progressisme restera isolé dans l'impuissance de la déception. Ainsi, en ces temps, les extrêmes droites sont vaincues par plus de démocratie et par une plus grande distribution de la richesse ; pas par la modération ni par la conciliation.
TOP : Y a-t-il des éléments nouveaux dans les nouvelles droites ? Est-il correct de les appeler fascistes ou devrions-nous les nommer autrement ? Les droites mettent-elles en place un laboratoire post-démocratique pour le continent (y compris les États-Unis)
AGL : Sans aucun doute, la démocratie libérale, en tant que simple remplacement des élites qui décident pour le peuple, tend inévitablement vers des formes autoritaires. Si, à certains moments, elle a pu produire des fruits de démocratisation sociale, c'était grâce à l'impulsion d'autres formes démocratiques populaires qui se sont déployées simultanément — la forme syndicale, la forme communautaire agraire, la forme populaire de la foule urbaine. Ce sont ces actions collectives multiples et multiformes de démocratie qui ont donné à la démocratie libérale une irradiation universaliste. Cela a pu se produire, car elle était toujours dépassée et poussée de l'avant. Mais si on laisse la démocratie libérale telle quelle, en tant que simple sélection des gouvernants, elle tend inévitablement vers la concentration des décisions, vers sa conversion en ce que Schumpeter appelait la démocratie comme simple élection compétitive de ceux qui vont décider de la société, ce qui est une forme autoritaire de concentration des décisions. Et, ce monopole décisionnel par des moyens autoritaires et, le cas échéant, au-dessus même du propre processus de sélection des élites, c'est ce qui caractérise les extrêmes droites. C'est pourquoi il n'y a pas d'antagonisme entre les extrêmes droites et la démocratie libérale. Il y a collusion de fond. Les extrêmes droites peuvent coexister avec ce type de démocratisation simplement élitiste qui alimente la démocratie libérale. C'est pourquoi il n'est pas rare qu'elles arrivent au pouvoir par le biais d'élections. Mais ce que la démocratie libérale tolère marginalement et à contrecœur, et que les extrêmes droites rejettent ouvertement, ce sont d'autres formes de démocratisation, qui ont à voir avec les présences de démocraties de bas en haut (syndicats, communautés agraires, assemblées de quartier, actions collectives…). Ils s'y opposent, les rejettent et les considèrent comme un obstacle. En ce sens, les extrêmes droites actuelles sont antidémocratiques. Ils acceptent seulement d'être élus pour gouverner, mais ils rejettent d'autres formes de participation et de démocratisation de la richesse, ce qui leur semble une insulte, un affront ou un absurde qui doit être combattu avec la force de l'ordre et de la discipline coercitive.
Maintenant, est-ce du fascisme ? Difficile à décider. Il y a tout un débat académique et politique sur quel nom cela prendra et s'il vaut la peine d'évoquer les terribles actions du fascisme des années 30 et 40. Sur le plan académique, ces digressions valent peut-être la peine, mais elles ont très peu d'effet politique. En Amérique latine, les personnes de plus de 60 ans peuvent avoir des souvenirs des dictatures militaires fascistes et la définition peut avoir un effet sur elles, mais pour les nouvelles générations, parler de fascisme ne signifie pas grand-chose. Je ne m'oppose pas à ce débat, mais je ne vois pas qu'il est si utile. En fin de compte, l'adhésion ou le rejet social des positions des extrêmes droites ne viendra pas du côté des anciens symboles et images qu'ils évoquent, mais de l'efficacité à répondre aux angoisses sociales actuelles que les gauches sont impuissantes à résoudre. Peut-être que la meilleure façon de qualifier ces extrêmes droites, au-delà de l'étiquette, est de comprendre à quel type de demande elles répondent, ce qui bien sûr, sont des demandes différentes de celles des années 30 et 40, bien qu'avec certaines similitudes en raison de la crise économique dans les deux périodes. Personnellement, je préfère parler d'extrêmes droites ou de droites autoritaires ; mais si quelqu'un utilise le concept de fascisme, je ne m'y oppose pas, bien que cela ne m'enthousiasme pas non plus beaucoup.
Le problème peut survenir si, dès le départ, elles sont qualifiées de fascistes et si on met de côté la question de savoir à quel type de demande collective elles répondent ou face à quel type d'échec elles émergent. C'est pourquoi, avant d'étiqueter et d'avoir des réponses sans questions, il vaut mieux se demander quelles sont les conditions sociales de leur émergence, quel type de solutions elles proposent et, sur ces réponses, on peut alors choisir le qualificatif approprié : fasciste, néo-fasciste, autoritaire… Par exemple, est-il juste de dire que Milei est fasciste ? Peut-être, mais il faut d'abord se demander pourquoi il a gagné, avec le vote de qui, en répondant à quelles sortes d'angoisses. C'est ce qui est important. Et aussi se demander ce que vous avez fait pour que cela arrive.
Aujourd'hui, il est plus utile de se poser cette question que de lui coller une étiquette facile qui résout le problème du rejet moral, mais qui n'aide pas à comprendre la réalité ni à la transformer. Parce que si vous répondez que Milei a convoqué l'angoisse d'une société appauvrie, alors il est clair que le problème est la pauvreté. Si Milei s'est adressé à une jeunesse qui n'a pas de droits, alors il y a une génération de personnes qui n'ont pas accédé aux droits des années 50, ni des années 60, ni des années 2000. C'est là que se situe le problème que le progressisme et la gauche doivent aborder pour arrêter les extrêmes droites et le fascisme. Il faut identifier les problèmes auxquels les extrêmes droites interpellent la société, car leur croissance est aussi un symptôme de l'échec des gauches et du progressisme. Elles ne surgissent pas de nulle part, mais après que le progressisme n'a pas osé, n'a pas pu, n'a pas voulu, n'a pas vu, n'a pas compris la classe et la jeunesse précaires, n'a pas saisi la signification de la pauvreté et de l'économie au-dessus des droits d'identité. Voilà le noyau du présent. Cela ne signifie pas que l'on ne parle pas d'identité, mais que l'on hiérarchise, en comprenant que le problème fondamental est l'économie, l'inflation, l'argent qui vous échappe des poches. Et il ne faut pas oublier que l'identité elle-même a une dimension de pouvoir économique et politique, qui est-ce qui ancre la subalternité. Dans le cas de la Bolivie, par exemple, l'identité indigène a conquis sa reconnaissance en assumant le pouvoir politique, d'abord, et progressivement, le pouvoir économique au sein de la société. La relation sociale fondamentale du monde moderne est l'argent, aliénée, mais encore relation sociale fondamentale, qui vous échappe, qui dilue toutes vos croyances et loyautés. C'est là le problème à résoudre par les gauches et le progressisme. Je pense que la gauche doit apprendre de ses échecs et qu'elle doit avoir une pédagogie sur elle-même pour ensuite trouver les qualificatifs pour dénoncer ou étiqueter un phénomène politique, comme c'est le cas ici avec l'extrême droite.
TOP : Revenant aux projets populaires, quels sont les principaux défis du progressisme pour surmonter ces crises, ces échecs dont vous parliez ? Est-ce simplement parce qu'ils n'ont pas pu comprendre ou interpréter suffisamment les besoins et les demandes des citoyens que les extrêmes droites les reprennent maintenant ?
AGL : L'argent est aujourd'hui le problème économique et politique élémentaire, fondamental, classique et traditionnel du présent. En temps de crise, c'est l'économie qui commande, point final. Résolvez d'abord ce premier problème et ensuite le reste. Nous sommes dans une période historique où émergent le progressisme et les extrêmes droites, et où le centre droit classique néolibéral, traditionnel et universaliste décline. Pourquoi ? Pour l'économie.
C'est l'économie, qui occupe le centre de commande de la réalité. Le progressisme, les gauches et les propositions qui viennent du côté populaire doivent d'abord résoudre ce problème. Mais la société à laquelle l'ancienne gauche des années 50 et 60, ou le progressisme dans la première vague dans certains pays, a résolu le problème économique est différente de l'actuelle. Les gauches ont toujours travaillé sur le secteur de la classe ouvrière salariée formelle, et aujourd'hui la classe ouvrière informelle est une énigme pour le progressisme.
Le monde de l'informalité regroupé sous le concept d'« économie populaire » est un trou noir pour les gauches qui ne le connaissent pas, ne le comprennent pas et n'ont pas de propositions productives pour lui, à part de simples palliatifs d'assistance. En Amérique latine, ce secteur représente 60 % de la population. Et il ne s'agit pas d'une présence transitoire qui disparaîtra ensuite dans la formalité. Non, l'avenir social sera avec l'informalité, avec ce petit travailleur et travailleuse, petit paysan (ne), petit entrepreneur, salarié informel, traversé par des relations familiales et des liens de loyauté locaux ou régionaux très curieux, subsumé dans des instances où les relations capital-travail ne sont pas aussi transparentes que dans une entreprise formelle. Ce monde existera pour les 50 prochaines années et implique la majorité de la population latino-américaine.
Que dites-vous à ces personnes ? Comment vous souciez-vous de leur vie, de leurs revenus, de leur salaire, de leurs conditions de vie, de leur consommation ? Ces deux sujets sont la clé du progressisme et de la gauche latino-américaine contemporains : résoudre la crise économique en tenant compte de ce secteur informel qui représente la majorité de la population active d'Amérique latine. Que signifie cela ? Avec quels outils le faites-vous ?
Bien sûr, avec des expropriations, des nationalisations, la redistribution de la richesse, l'élargissement des droits, etc. Ce sont des outils, mais l'objectif est d'améliorer les conditions de vie et le tissu productif de ces 80 % de la population, syndiquée et non syndiquée, formelle et informelle, qui constituent la population populaire latino-américaine. Et aussi avec une plus grande participation de la société à la prise de décision. Les gens veulent être entendus, ils veulent participer. Le quatrième sujet est l'environnemental, une justice environnementale avec justice sociale et économique, jamais séparée ni jamais en tête.
Cet Article a été traduit par Deepl et revisé par Mario Gil. Nous remercions à la revue Jacobin — Amérique latine pour la permission de traduire et reproduire cet article.
Politologue, féministe et activiste au sein de Colombia Humana et du Centro de Pensamiento Colombia Humana – CPCH
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












