Derniers articles

Les médias à l’épreuve de la guerre à Gaza

La communication est une arme de guerre et la déontologie journalistique implique donc de soumettre à un examen rigoureux les faits allégués par chacun. Pendant la guerre à Gaza, la plupart des médias occidentaux dits mainstream ont cependant privilégié la perspective israélienne, ignoré les voix palestiniennes, occulté le contexte historique et manifesté une compassion sélective. Didier Fassin
Tiré du blogue de l'auteur.
La guerre ne se gagne pas seulement par les armes, elle se gagne aussi par la communication. Les Israéliens l'ont compris depuis longtemps. Ils ont même théorisé une politique de relations publiques connue sous le nom hébreu hasbara, généralement traduit par le terme « propagande ». Cette politique a pour but à la fois d'améliorer l'image du pays et de ses gouvernants, de justifier leurs actions même contraires au droit international, de discréditer les critiques en les assimilant à de l'antisémitisme et de jeter l'opprobre sur leurs ennemis pour légitimer la répression qu'ils dirigent contre eux.
La communication comme arme de guerre
C'est ce que les autorités ont tenté de faire après l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre. Elles ont occulté leur responsabilité dans les graves défaillances de la protection de leur population. Elles ont affirmé que leurs représailles devaient s'abattre sur l'ensemble des civils palestiniens car leur nation tout entière était comptable. Elles ont qualifié d'antisémites les condamnations des violations du droit humanitaire par l'armée israélienne. Elles ont diffusé de fausses informations sur les exactions commises ce jour-là au risque de compromettre la reconnaissance des véritables violences perpétrées.
Se servir de la communication comme arme dans un conflit est, si l'on ose dire, « de bonne guerre ». Il revient alors aux journalistes de faire leur métier, c'est-à-dire de soumettre les discours à un examen rigoureux, de vérifier les faits allégués, de donner la parole aux différentes parties, de proposer des analyses indépendantes de la propagande des protagonistes. C'est ce que n'ont pas fait nombre de médias occidentaux, particulièrement dans le domaine audio-visuel, mais la presse écrite n'a pas été épargnée, comme l'ont montré plusieurs enquêtes. Ils ont largement repris, notamment pendant les premiers mois de la guerre, les récits des autorités israéliennes, eux-mêmes souvent adoptés par les gouvernements occidentaux qui, presque immédiatement, ont donné les éléments de langage qui devaient être employés et mis en œuvre une politique prohibant la critique des opérations menées à Gaza.
Le conflit a été systématiquement désigné par l'expression « guerre Israël-Hamas », et ce, alors même que les responsables politiques et militaires israéliens ont annoncé dès le départ qu'il s'agissait de détruire Gaza et de punir toute sa population. Cette formulation permettait de justifier les représailles israéliennes puisqu'il s'agissait d'en finir avec un groupe qualifié de terroriste. De la même manière, toute évocation du conflit par les médias devait en faire la conséquence de l'attaque du 7 octobre, souvent qualifiée de pogrom, sans jamais évoquer ce qui s'était passé avant cette date. L'incursion sanglante était bien sûr l'événement déclencheur, mais elle était elle-même la réponse à trois quarts de siècle de dépossession des terres palestiniennes, de plus de sept décennies d'occupation, d'oppression et d'humiliation, et pour la bande de Gaza, de seize années d'un blocus asphyxiant les habitants dont les protestations pacifiques avaient été réprimées en faisant des centaines de morts et des milliers de mutilés. La rhétorique de ces médias effaçait ainsi l'histoire de la Palestine.
Des différences flagrantes de traitement
Mais elle manifestait également un manque d'empathie à l'égard des Palestiniens. Un différentiel d'humanisation s'est opéré entre les victimes de part et d'autre du conflit. Les journalistes étrangers s'attardaient, par des témoignages émouvants, sur le traumatisme vécu par les Israéliens, les protestations des familles d'otages, le désarroi des habitants du nord du pays devant se réfugier dans des abris anti-aériens ou même quitter leur logement pour éviter les tirs de roquettes. À l'inverse, des deuils des familles décimées dans les bombardements, des souffrances des mères dénutries ne pouvant allaiter leurs nouveau-nés, des douleurs des blessés par des tirs amputés sans anesthésie, des tourments des enfants spectateurs de la mort de leurs proches, on ne savait presque rien, car on ne recueillait pas leurs récits. La raison donnée pour expliquer cette compassion sélective était l'impossibilité de se rendre à Gaza. Mais des médias indépendants, eux, parvenaient à entrer en contact avec des journalistes palestiniens qui risquaient leur vie pour faire leur travail, donner à entendre la voix des habitants et révéler le tragique de leur quotidien entre cadavres et décombres.
Il ne fallait donc pas exposer les épreuves extrêmes vécues par les Palestiniens, le dénuement absolu, la famine provoquée, le désespoir indescriptible face à la mort omniprésente et à la destruction massive, car le risque était de susciter une sympathie pour leur cause. Il ne fallait pas non plus montrer les tanks tirant sur les foules affamées se précipitant vers des lieux d'approvisionnement, les vidéos montrant les soldats se réjouissant des sévices qu'ils font subir aux civils et des explosions qu'ils provoquent dans les quartiers résidentiels, les reportages sur les tortures subies par les prisonniers palestiniens diffusés sur les chaînes de télévision israéliennes pour satisfaire le désir de vengeance de leur public. Il ne le fallait pas car la cruauté manifestée aurait risqué de nuire à l'image de la société israélienne.
Un fait est à cet égard révélateur. Lors de l'opération menée par l'armée israélienne pour libérer quatre otages dans un camp de réfugiés, la presse internationale a longuement commenté l'heureux événement, en oubliant souvent de mentionner que l'intervention avait causé la mort de 274 hommes, femmes et enfants et fait 700 blessés, presque tous des civils, et était connue en Palestine comme le massacre de Nuseirat.
Le travail des rédactions
En réalité, ce traitement inégal de l'information résultait de politiques éditoriales. Dans la plupart des médias qu'on appelle mainstream, le langage utilisé par les journalistes a fait l'objet d'une surveillance stricte et d'une censure rigide. Aux États-Unis, une enquête menée durant les six premières semaines de la guerre dans les trois plus importants quotidiens du pays montre que, rapporté au nombre de décès de chaque côté, il était seize fois plus souvent question des Israéliens que des Palestiniens, et que le mot « horrible » était employé neuf fois plus souvent pour évoquer la mort des premiers que celle des seconds, le mot « massacre » trente fois plus et le mot « tuerie » soixante fois plus. Des consignes étaient d'ailleurs données par les rédactions, et dans l'un de ces grands journaux, une note de service demandait aux reporters d'éviter les expressions « territoires occupés » et « camps de réfugiés », qui rappelaient une histoire qu'il s'agissait d'occulter, de ne pas évoquer un « génocide » ou un « nettoyage ethnique », termes proscrits, et même de réserver le mot « Palestine » à de très rares occurrences.
En France, des journalistes m'ont confié les pressions qu'ils subissaient de leur rédaction, les multiples relectures et réécritures qu'on leur imposait, les chartes qu'ils devaient respecter, l'ajout dans les chapeaux des articles du mot « terroriste » pour qualifier le Hamas, l'évitement des termes « génocide », « apartheid » et « colonial », l'exclusion des voix « critiques » de la politique israélienne. Par souci de ce qu'on qualifiait de « neutralité », tout entretien ou commentaire rappelant le droit international devait avoir en regard un point de vue justifiant la politique israélienne, comme si l'un et l'autre avaient la même légitimité. Des phénomènes similaires, et souvent même des biais plus marqués encore, ont été rapportés en Allemagne, en Grande-Bretagne, et dans d'autres pays européens.
Police de la pensée
Comment expliquer la police de la pensée qui a ainsi été imposée à travers la prescription d'un lexique et d'une interprétation officiels et la réduction de la critique au silence par le double jeu de la censure et de l'auto-censure ? Les raisons en sont multiples. Il y a d'abord une crainte, ouvertement exprimée en interne, de l'accusation d'antisémitisme par des institutions communautaires, voire par le gouvernement lui-même, alors que la mémoire du génocide des Juifs d'Europe continue d'être fortement mobilisée. Il y a ensuite une sympathie répandue à l'égard de l'État d'Israël, identifié au destin d'un monde longtemps qualifié de judéo-chrétien, dont il est présenté comme le bastion dans un Moyen-Orient imprédictible. Il y a enfin, à l'inverse, une méfiance héritée des temps coloniaux à l'encontre des Palestiniens dans un contexte global de racisme anti-musulman et anti-arabe qui se double dans leur cas d'une association à l'image du terrorisme. La partialité des médias en faveur d'Israël n'est, du reste, pas nouvelle.
Les journalistes ont une forte propension à porter un regard réflexif sur leur métier. Avec le recul du temps, ils ne manqueront pas d'engager un travail critique – et certains l'ont déjà fait – sur leurs partis pris après le 7 octobre. Ils comprendront alors que les médias ont activement contribué à la légitimation de la destruction de Gaza et de sa population.
Didier Fassin, Professeur au Collège de France et à l'Institute for Advanced Study de Princeton, auteur de Une étrange défaite. Sur le consentement à l'écrasement de Gaza (La Découverte), pour Carta Academica
Les points de vue exprimés dans les chroniques de Carta Academica sont ceux de leur(s) auteur(s) et/ou autrice(s) ; ils n'engagent en rien les membres de Carta Academica, qui, entre eux d'ailleurs, ne pensent pas forcément la même chose. En parrainant la publication de ces chroniques, Carta Academica considère qu'elles contribuent à des débats sociétaux utiles. Des chroniques pourraient dès lors être publiées en réponse à d'autres. Carta Academica veille essentiellement à ce que les chroniques éditées reposent sur une démarche scientifique.

Les maladies et la malnutrition frappent l’Afghanistan, pays en proie à la pénurie d’eau

Trois années de sécheresse, un régime paria et la perte de travailleurs qualifiés ont paralysé l'infrastructure hydraulique de l'Afghanistan, entraînant une augmentation du prix de l'eau et une propagation des maladies.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière. Source.
Chaque soir, Abdullah Achakzai, directeur du Réseau des volontaires pour l'environnement (EVN), est confronté à la même triste réalité lorsqu'il rentre chez lui après son travail à Kaboul. Des files d'attente, composées essentiellement d'enfants, se succèdent pendant des heures pour aller chercher de l'eau dans des camions-citernes privés. En raison de la pénurie d'eau courante, de nombreuses et nombreux Afghans dépendent de ces camions-citernes pour satisfaire les besoins essentiels de leur foyer.
Ces dernières années, le nombre de personnes faisant la queue n'a cessé d'augmenter, explique M. Achakzai. « La situation est pire que l'année dernière », a-t-il déclaré à Dialogue Earth. « Nous prévoyons que les années à venir seront encore plus critiques, le niveau des eaux souterraines continuant à baisser ».
La plupart des ménages afghans dépendent de puits personnels pour boire, cuisiner et cultiver. Selon un rapport d'août 2024 de la Direction nationale des statistiques, le pays compte environ 310 000 puits forés. Mais M. Achakzai explique qu'une enquête menée par EVN en juillet et partagée avec Dialogue Earth a révélé que la sécheresse a rendu ces puits moins fiables. « Les puits forés les années précédentes à une profondeur de 200 mètres sont maintenant à sec, ce qui oblige de nombreuses et nombreux habitants, en particulier ceux des immeubles de grande hauteur, à forer des puits à une profondeur de 300 mètres ou plus pour accéder à l'eau », a-t-il déclaré.
Cependant, M. Achakzai a prévenu que « les niveaux des eaux souterraines diminuent rapidement » et que même ces puits profonds n'offriraient probablement pas de solution à long terme. Un rapport de l'ONU datant de 2023 confirme que « 49% des puits de forage évalués dans la province de Kaboul sont à sec, et que les puits de forage restants ne fonctionnent qu'à 60% de leur efficacité ».
Augmentation des chocs climatiques
« Le changement climatique perturbe les schémas météorologiques [de manière sans précédent] », a déclaré Mohammad Daud Hamidi, un expert afghan de l'eau qui a passé des années à étudier l'insécurité de l'eau dans le pays. L'Afghanistan, déjà éprouvé par les conflits et l'instabilité, a connu trois années consécutives de grave sécheresse depuis 2021.
L'approvisionnement en eau de l'Afghanistan dépend en grande partie de la fonte saisonnière des neiges dans les montagnes, qui alimente les principaux cours d'eau. « Toutefois, l'évolution des chutes de neige modifie la disponibilité des eaux de surface, ce qui entraîne une dépendance accrue à l'égard des eaux souterraines, tant pour l'usage domestique que pour l'irrigation », a déclaré M. Hamidi. « Ces ressources s'épuisent plus vite qu'elles ne se reconstituent ».
Dans les zones rurales de l'Afghanistan, les effets de la sécheresse sont particulièrement prononcés, entraînant une augmentation des migrations vers les villes, ce qui accroît la pression sur les réserves d'eau urbaines. Les activités industrielles exercent également une pression supplémentaire. M. Hamidi a cité en particulier l'industrie minière, où l'on a assisté à une « récente prolifération de contrats sans évaluation appropriée de l'impact sur l'environnement ».
Les sécheresses ne sont pas les seules catastrophes liées au climat auxquelles l'Afghanistan est confronté. Elles sont souvent suivies de crues soudaines. Depuis le mois de mai, plus de 250 personnes sont mortes et près de 120 000 ont été touchées par des crues soudaines dans le nord et l'est de l'Afghanistan, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies [OCHA].
« Avec une augmentation de la température [due au changement climatique], l'air peut retenir plus d'eau », a expliqué Najibullah Sadid, un expert afghan en gestion de l'eau à l'université de Stuttgart. « Même un degré d'augmentation de la température de l'air permet à l'air de retenir 7% d'eau en plus, ce qui forme des nuages plus lourds, qui peuvent à leur tour provoquer des orages, de fortes pluies localisées et des inondations », a-t-il ajouté. Selon lui, la plupart des inondations les plus graves qu'a connues l'Afghanistan ces dernières années se sont produites pendant des périodes de forte chaleur, notamment les inondations de 2022 à Khoshi, dans le Logar, et celles de 2020 à Charikar, dans le Parwan, qui ont coûté la vie à plus d'une centaine de personnes.
L'impact humain
Depuis la prise du pouvoir par les talibans en 2021, l'Afghanistan est confronté à un isolement diplomatique, les organisations internationales se retirant, ce qui rend difficile la collecte de données complètes sur l'impact de ces crises environnementales. « Il est difficile de suivre [l'étendue du problème] », a déclaré Ahmad Kassas, directeur national de l'ONG International Medical Corp (IMC). Cependant, il a déclaré que l'impact pouvait être mesuré d'autres façons, notamment par « l'augmentation du nombre de cas de maladies liées à l'eau dans nos établissements de santé ».
L'eau insalubre est également liée à l'augmentation des taux de malnutrition. « Un rapport suggère que plus de 3,2 millions d'enfants et 840 000 femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition », a déclaré M. Kassas. Il a relaté le cas de la province de Saripul, où les communautés dépendent d'une eau salée et non potable. « Les gens viennent souvent dans nos centres médicaux simplement pour boire de l'eau », a-t-il déclaré, notant que cette demande inattendue d'eau propre a incité l'IMC à inclure la distribution d'eau dans ses services.
Pour répondre à certains des défis posés par la pénurie d'eau, M. Kassas a expliqué que l'IMC avait également contribué à la construction de systèmes d'alimentation en eau fonctionnant à l'énergie solaire, de pompes manuelles et de canaux d'irrigation, afin d'atténuer les crises immédiates, mais l'ampleur des besoins est écrasante.
Les femmes parmi les plus touchées
Selon Shogofa Sultani, directrice générale de Step to Brightness of Afghanistan Organisation (SBAO), une organisation de la société civile, le fardeau de la pénurie d'eau pèse de manière disproportionnée sur les femmes. « Les hommes travaillent à l'extérieur et peuvent donc chercher d'autres sources d'eau potable. Mais la plupart des femmes afghanes, qui sont confinées à la maison, ont besoin d'un accès à l'eau pour toutes les tâches ménagères », explique-t-elle.
Si nous allons chez quelqu'un ou si nous recevons des invité·es, la première chose que nous demandons à l'autre est : « Avez-vous de l'eau ? » Shogofa Sultani, directrice générale de l'organisation Step to Brightness of Afghanistan
L'organisation de Mme Sultani, qui s'occupait autrefois de diverses questions civiques, oriente de plus en plus ses efforts vers la recherche et la sensibilisation aux défis climatiques croissants de l'Afghanistan. « Avec un accès réduit à l'eau publique, il faut dépenser plus d'argent pour acheter des récipients d'eau – qui peuvent coûter entre 20 et 50 AFN [0,30-0,70 USD] pour 20 litres », a déclaré M. Sultani à Dialogue Earth. Les familles nombreuses ont de plus en plus besoin d'acheter plus d'eau pour satisfaire leurs besoins quotidiens. « Cela met la pression sur de nombreuses familles, en particulier celles qui ont des difficultés financières », a-t-elle ajouté.
La pauvreté touche plus de 90% des Afghan·es, et au moins 23,7 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, auront besoin d'une aide humanitaire en 2024. « Toutes les familles que je connais ont des conversations quotidiennes entre elles et avec leurs communautés au sujet de l'eau. Si nous allons chez quelqu'un ou si nous recevons des invité·es, la première chose que nous nous demandons est : « Avez-vous de l'eau ? Tout le monde s'inquiète de savoir comment il obtiendra de l'eau le lendemain », a déclaré M. Sultani.
Des ressources humaines et financières qui s'épuisent
Malgré la fréquence des inondations, Sadid voit une opportunité potentielle. « Si nous pouvons stocker [l'eau des inondations], cela pourrait contribuer à recharger nos nappes phréatiques et à améliorer l'humidité du sol et la couverture végétale », a-t-il suggéré.
Commentant le projet de canal Qosh Tepa, que le régime actuel a poursuivi et qui serait à moitié achevé, M. Sadid a expliqué qu'une fois achevé, il pourrait tripler la prise d'eau de l'Afghanistan dans le bassin de l'Amu Darya. Cela améliorerait considérablement l'accès à l'eau dans le nord de l'Afghanistan, où l'eau est particulièrement rare et où l'agriculture dépend des pluies de printemps. Le projet, a-t-il ajouté, a le potentiel de « transformer des terres agricoles fertiles alimentées par la pluie en terres arables permanentes », ce qui permettrait d'augmenter la production alimentaire et de créer des emplois dont le pays a grand besoin.
Toutefois, une telle entreprise nécessite des ressources financières et des investissements continus, qui se font rares depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. M. Sadid a prévenu que la construction du canal devenait de plus en plus coûteuse, la majeure partie des travaux réalisés à ce jour étant axée sur l'excavation. « Je ne suis pas sûr que les talibans puissent obtenir les ressources financières nécessaires [pour continuer] », a-t-il déclaré, soulignant les défis posés par l'isolement international des talibans et les sanctions qui leur sont imposées.
M. Hamidi s'est fait l'écho de ces préoccupations, ajoutant que les infrastructures hydrauliques de l'Afghanistan ont longtemps été négligées. « En raison de la guerre prolongée et d'autres problèmes critiques, l'infrastructure de l'eau en Afghanistan n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait ».
L'exode des cerveaux qui a suivi la prise du pouvoir, lorsque les gens ont fui les talibans, a également exacerbé la situation, a déclaré M. Hamidi, « laissant des défis importants en matière de gouvernance, d'expertise technique et de renforcement des capacités pour résoudre efficacement les problèmes ». Même les systèmes traditionnels comme le Karez, un réseau séculaire de canaux entretenus par la communauté, sont tombés en ruine. « Les systèmes traditionnels de Karez et les sources d'eau naturelles ne fournissent plus d'eau, en grande partie à cause de l'utilisation généralisée de puits forés pour l'agriculture », a déclaré M. Achakzai.
Exclus du débat sur le climat
Face à ces crises en cascade, l'Afghanistan reste largement exclu des discussions internationales sur le climat et privé des fonds qui pourraient l'aider à renforcer sa résistance aux chocs climatiques. Bien qu'il soit classé au sixième rang des pays les plus touchés par les effets du climat selon l'indice mondial des risques climatiques en 2019, l'Afghanistan n'avait aucune représentation officielle à la COP27, la conférence annuelle des Nations unies sur le climat. M. Achakzai a participé à l'événement en tant qu'unique représentant non officiel de l'Afghanistan.
En 2019, les émissions de carbone de l'Afghanistan se sont élevées à 0,3 tonne métrique, contre une moyenne mondiale de 4,6 tonnes métriques. Pourtant, le pays est affecté de manière disproportionnée par le changement climatique, et son exclusion des fonds climatiques internationaux et des programmes d'adaptation le rend dangereusement vulnérable aux chocs futurs.
M. Hamidi a prévenu que si des mesures immédiates n'étaient pas prises, la crise de l'eau en Afghanistan pourrait facilement s'étendre au-delà de ses frontières, les populations devant faire face à des catastrophes répétées. Si la gestion de l'insécurité hydrique est une tâche complexe, « il est essentiel de relever les défis immédiats liés à l'eau, tels que [la construction de] barrages et [leur] entretien », a-t-il déclaré.
« Il est essentiel de faire revivre et d'entretenir les systèmes traditionnels d'approvisionnement en eau, tels que les Karez, qui ont toujours fourni une eau fiable. Ces canaux souterrains minimisent l'évaporation et peuvent aider à soutenir les communautés, en particulier dans les zones rurales », a déclaré M. Achakzai. « Une stratégie à long terme impliquerait une collaboration avec les communautés locales ».
Et d'ajouter : « Cela permettrait non seulement de gérer l'aide limitée fournie à l'Afghanistan, mais aussi de sensibiliser la population aux problèmes de l'eau afin de la préparer aux chocs futurs. »
Ruchi Kumar est une journaliste indépendante qui travaille sur l'Asie du Sud. Elle a été publiée dans Foreign Policy, The Guardian, NPR, The National, Al Jazeera et The Washington Post, entre autres. Suivez-la sur Twitter @RuchiKumar

Trump et le Moyen-Orient : que nous réserve l’avenir ?

Benjamin Netanyahu espérait la victoire de Trump avec impatience et a fait tout ce qu'il pouvait pour y contribuer. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant que le retour de Trump à la Maison Blanche est confirmé ?
13 novembre 2024
Gilbert Achcar
Professeur, SOAS, Université de Londres
tiré de Mediapart
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/131124/trump-et-le-moyen-orient-que-nous-reserve-l-avenir
photo Serge d'Ignazio
La victoire de Trump dans la course à la présidence des États-Unis est une catastrophe majeure pour les peuples de la région, en plus de l'énorme Nakba qui fait rage depuis le « déluge d'Al-Aqsa » dirigé par le Hamas. Benjamin Netanyahu espérait cette victoire avec impatience et a fait tout ce qu'il pouvait pour y contribuer, que ce soit en incitant ses alliés de droite aux États-Unis ou en refusant d'accorder à Joe Biden et à la campagne présidentielle démocrate la trêve à Gaza qu'ils espéraient afin de leur fournir un argument électoral dont ils avaient désespérément besoin. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant que le retour de Trump à la Maison Blanche est confirmé ?
Les informations disponibles – compte tenu du comportement de Trump au cours de son premier mandat présidentiel, des positions qu'il a exprimées lors de sa récente campagne et de ce qui a fuité dans ses cercles – indiquent qu'il est désireux d'apparaître comme un leader qui réalise la « paix », contrairement à Biden décrit comme un perpétuateur de guerre, incapable de résoudre les conflits. Alors que Trump cherche à mettre fin aux guerres dans lesquelles il ne voit pas l'intérêt de l'Amérique, il reste désireux d'atteindre ses objectifs dans les cas où il voit un intérêt certain. Ainsi, alors qu'il négociait avec les talibans au cours de son précédent mandat en vue du retrait des forces américaines d'Afghanistan et qu'il souhaitait retirer la couverture militaire américaine pour les Kurdes en Syrie à la demande du président turc Erdogan, il soutenait la présence continue des forces de son pays en Irak, exprimant effrontément son intérêt pour la richesse pétrolière de ce pays.
Et bien qu'il ait exprimé son ambition de conclure « l'accord du siècle » sur la Palestine, la « paix » qu'il a proposée était si inique que Mahmoud Abbas lui-même l'a rejetée, tandis que Netanyahou l'a chaleureusement approuvée, étant convaincu qu'aucune partie palestinienne ne pourrait accepter les termes d'un tel « accord ». Netanyahou espérait ainsi que le rejet palestinien de cette offre « généreuse » légitimerait l'accaparement par l'État sioniste de la terre de Palestine à l'ouest du Jourdain. Cela s'ajoutait au fait que Trump a abandonné en faveur d'Israël les positions politiques officielles qui ont longtemps été celles des États-Unis au sujet du conflit régional, que ce soit par son approbation officielle de l'annexion par Israël du plateau du Golan syrien occupé ou par le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et la fermeture du consulat américain pour les territoires occupés de 1967, le tout indiquant un soutien à l'expansionnisme sioniste. Sans oublier l'adhésion de Trump à la position d'Israël envers l'Iran, son retrait de l'accord nucléaire que l'administration de son prédécesseur Barack Obama avait conclu avec Téhéran après de longues et difficiles négociations, et son escalade de la provocation militaire en assassinant le commandant de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution iraniens, Qassem Soleimani, etc.
Trump n'a aucun intérêt à soutenir l'Ukraine et préférerait parvenir à un accord avec Vladimir Poutine qui satisferait le président russe, qu'il admire pour sa personnalité réactionnaire tout en désirant investir dans son pays. Il ne voit pas d'intérêt à l'alliance avec les pays européens à moins qu'ils ne fassent plus de concessions économiques aux États-Unis et n'augmentent leurs efforts militaires pour s'impliquer de plus en plus dans la confrontation américaine avec la Chine, que Trump considère comme le principal concurrent de l'Amérique (alors que l'hostilité envers la Chine est un pilier fondamental de l'idéologie de la droite impérialiste américaine qu'il dirige). En même temps, ce n'est un secret pour personne que Trump considère le pétrole et l'argent du pétrole des monarchies arabes du Golfe comme un intérêt suprême des États-Unis et l'État sioniste comme un allié inestimable pour son rôle de chien de garde de cet intérêt suprême. C'est parce que l'intérêt dans son sens le plus grossier – dans lequel l'intérêt personnel et familial prévaut sur toute autre considération, et dans lequel « l'intérêt de l'Amérique » est conçu dans son sens le plus étroit et le plus immédiat, en sus du désir de flatter les instincts les plus primitifs du public (un comportement généralement qualifié de « populiste » ou de « démagogique ») – cet intérêt est ce qui régit le comportement de Donald Trump, et rien d'autre.
On peut donc s'attendre que, sur le Liban, il adopte la position de l'administration Biden cherchant à mettre fin à la guerre en cours à des conditions qui satisfassent Israël, sur la base du retrait des forces du Hezbollah au nord de la zone stipulée dans la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2006, et du remplacement progressif des forces du parti dans cette zone ainsi que des forces d'occupation israéliennes par l'armée régulière libanaise, à condition que des garanties soient fournies sous supervision des États-Unis quant au non-retour du parti dans la zone susmentionnée et le non-réapprovisionnement de son arsenal de missiles par l'Iran à travers le territoire syrien. Cela s'accompagnerait d'un renforcement de l'armée libanaise tel que l'équilibre des forces au Liban puisse changer, de façon à permettre à l'État dominé par les États-Unis de l'emporter sur le parti dominé par l'Iran. Toutefois, la conclusion de cet accord est actuellement soumise à l'approbation de l'Iran, qui le refuse toujours, car Téhéran préfère que le Hezbollah reste dans la mêlée plutôt que de le laisser en sortir et être ainsi empêché de prendre part à la confrontation à venir entre l'Iran et l'alliance américano-israélienne.
Netanyahu est convaincu que Trump sera plus disposé que Biden à s'engager dans cette confrontation. Il a déjà envoyé un représentant pour négocier avec le président élu sur les prochaines mesures envers l'Iran. Trump consultera également ses amis du Golfe, qui espèrent que l'Iran recevra un coup décisif, en dépit de la bienveillance envers Téhéran et de l'empathie pour le peuple de Gaza qu'ils expriment. Par de telles positions, ils essaient de contrer la surenchère iranienne concernant la Palestine et de convaincre Téhéran d'épargner leurs installations pétrolières, que Téhéran a menacé de frapper si ses installations nucléaires étaient attaquées. La probabilité d'une attaque conjointe américano-israélienne contre l'Iran est devenue très élevée avec le retour de Trump à la Maison Blanche. Il cherchera certainement à rétablir l'hégémonie ferme des États-Unis sur la région du Golfe, affaiblie pendant les ères Obama et Biden.
En ce qui concerne la Palestine, Trump est susceptible de soutenir l'annexion officielle par Israël d'une partie importante de la Cisjordanie et de Gaza (la partie nord de la bande de Gaza en particulier, où un « nettoyage ethnique » est actuellement mené par l'armée sioniste) en vue de l'expansion de ses colonies en Cisjordanie et la reprise de leur établissement à Gaza. Israël gardera aussi les couloirs stratégiques qui lui permettent de contrôler les concentrations restantes de population palestinienne dans les deux territoires occupés. Comme dans « l'accord du siècle » élaboré par le gendre de Trump, Jared Kushner, et annoncé au début de 2020, la transaction comprendra probablement une « compensation » offerte aux Palestiniens en échange de ce qui leur est pris et officiellement annexé au territoire israélien, consistant en des zones dans le désert du Néguev. Il y a huit mois, Kushner exprimait l'opinion qu'Israël devrait s'emparer de la partie nord de la bande de Gaza et investir dans le développement de son « front de mer », tout en transférant ses résidents palestiniens dans le désert du Néguev. Une fois de plus, cet « accord » qui prend le peuple palestinien pour des imbéciles ne trouvera aucun acteur palestinien, ayant la moindre crédibilité, prêt à l'accepter. Israël se sentira ainsi autorisé à l'imposer unilatéralement par la force, tandis que l'extrême droite sioniste continuera d'accentuer sa pression pour l'achèvement de la Nakba de 1948 par l'annexion de tout le territoire palestinien entre le fleuve et la mer et le déracinement de la plupart de ses habitants.
Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 12 novembre en ligne et dans le numéro imprimé du 13 novembre. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Israël-Palestine. Accroître la colonisation par refoulement, à l’heure de Trump

Bezalel Smotrich est « invité à Paris, le 13 novembre, par l'organisation Israel Is Forever, pour un gala de mobilisation des “forces sionistes francophones au service de la puissance et de l'histoire d'Israël”. Une organisation proche des colons extrémistes israéliens, dirigée par l'avocate franco-israélienne Nili Kupfer-Naouri, laquelle affirme qu'il n'existe pas de population civile innocente à Gaza tout en prônant l'entrave de l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne bombardée et privée de tout. » C'est ainsi que les signataires d'une tribune collective publiée dans le quotidien Le Monde, le 10 novembre, présentent l'invitation faite au ministre des Finances de l'Etat hébreu.
Tiré d'À l'encontre.
La qualification fondée de Bezalel Smotrich par les signataires de la tribune – « il se veut raciste, arabophobe, suprémaciste, colonialiste, annexionniste, révisionniste » – renvoie à la phase actuelle de l'expansion coloniale du gouvernement de Netanyahou et sa guerre génocidaire.
***
Le 11 novembre, OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU) déclarait en termes mesurés :
« OCHA s'inquiète du sort des Palestiniens qui restent dans le nord de Gaza, alors que le siège se poursuit, et demande d'urgence à Israël d'ouvrir la zone aux opérations humanitaires à l'échelle nécessaire, compte tenu des besoins massifs.
»Dans un nouveau rapport publié aujourd'hui [11 novembre], les organisations humanitaires ont soumis en octobre 50 demandes d'accès au gouvernorat de Gaza Nord aux autorités israéliennes. Trente-trois de ces demandes ont été rejetées d'emblée, et huit ont été acceptées dans un premier temps, mais se sont heurtées à des obstacles en cours de route.
»Les tentatives de coordination de l'évacuation d'un membre du personnel de l'ONU blessé dans la zone de Jabalia ont également été refusées, les autorités israéliennes suggérant que cette personne pourrait tenter d'être transportée à pied par des proches agitant des drapeaux blancs pour s'identifier. »
***
Le Washington Post du 12 novembre écrivait :
« Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a salué lundi 11 novembre la victoire électorale du président Donald Trump, estimant que “le temps est venu” d'étendre la pleine souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée.
»“La victoire de Donald Trump offre une occasion importante à l'Etat d'Israël”, a déclaré Bezalel Smotrich à ses partisans lors d'une conférence de son parti, selon des commentaires diffusés par son porte-parole. Pendant le premier mandat de Trump, a-t-il dit, “nous étions sur le point d'appliquer la souveraineté sur les colonies” en Cisjordanie, “et maintenant le temps est venu d'en faire une réalité”.
»Bezalel Smotrich a déclaré qu'il avait demandé à la direction de l'administration des colonies du ministère de la Défense, ainsi qu'à l'administration civile de l'armée israélienne en Cisjordanie (COGAT), de préparer des plans en conséquence, selon un compte rendu transmis par son porte-parole.
»Depuis la fin de l'année 2022, le gouvernement de coalition du Premier ministre Benyamin Netanyahou a considérablement étendu la présence d'Israël en Cisjordanie occupée, où l'on estime que 3 millions de Palestiniens “vivent aux côtés” de plus de 500 000 colons.
»L'administration de Netanyahou a approuvé des saisies stratégiques de terres et d'importantes constructions de colonies. Elle a intensifié les démolitions de propriétés palestiniennes. Elle a augmenté le soutien de l'Etat aux avant-postes de colons construits illégalement. Les violences des colons juifs visant des résidents palestiniens sont devenues monnaie courante et se déroulent souvent en présence de soldats ou de policiers israéliens.
»L'annonce faite lundi semble indiquer qu'Israël s'apprête à consolider les mesures annoncées fin mai, lorsque l'armée a réattribué d'importants pouvoirs de gestion sur la Cisjordanie à un poste nouvellement créé de “chef adjoint” au sein de l'administration civile, l'organe gouvernemental d'Israël dans cette région. Le même jour, ce poste a été confié à Hillel Roth, un proche collaborateur de Smotrich, qui est lui-même un défenseur de longue date des colons.
»“Pour aller de l'avant, j'ai [Smotrich] l'intention de prendre la tête d'une initiative gouvernementale déclarant que le gouvernement israélien travaillera avec la nouvelle administration du président Trump et la communauté internationale pour appliquer la souveraineté [israélienne] et en demander la reconnaissance américaine.” […] Dans ses commentaires de lundi, Smotrich a explicitement établi un lien entre l'élection de Trump et la voie qu'il propose d'emprunter. “Après des années au cours desquelles, malheureusement, l'administration actuelle a choisi d'interférer dans la démocratie israélienne et a personnellement refusé de coopérer avec moi en tant que ministre des Finances d'Israël, la victoire de Trump apporte également une opportunité importante”, a déclaré Smotrich, ajoutant que “2025 est l'année de la souveraineté en Judée et en Samarie”, en utilisant le nom biblique de la Cisjordanie. »
Dans Haaretz du 12 novembre, Noa Shpigel en la complétant donne tout son sens à la citation de Smotrich : « 2025 est l'année de la souveraineté en Judée et en Samarie. Les nouveaux nazis [autrement dit les Palestiniens tels que qualifiés par le noyau du gouvernement Netanyahou depuis le 7 octobre 2023] doivent en payer le prix par la confiscation définitive des terres, tant à Gaza qu'en Judée et Samarie. »
***
Le 10 novembre, Haaretz dans un nouvel éditorial prolongeait ainsi celui du 29 octobre : « L'armée israélienne mène une opération de nettoyage ethnique dans le nord de la bande de Gaza. Les quelques Palestiniens qui restent dans la région sont évacués de force, les maisons et les infrastructures ont été détruites, et de larges routes sont construites dans la région, achevant de séparer les communautés du nord de la bande de Gaza du centre de la ville de Gaza. “La zone semble avoir été frappée par une catastrophe naturelle”, a conclu le correspondant militaire du Haaretz, Yaniv Kubovich, après une visite organisée par les FDI des forces israéliennes sur place la semaine dernière.
»Ce que Kubovich a vu, cependant, n'était pas une catastrophe naturelle mais plutôt un acte prémédité de destruction humaine. Un officier supérieur des FDI, identifié par le journal londonien The Guardian comme étant le général de brigade Itzik Cohen, commandant de la 162e division, a expliqué aux journalistes : “Il n'est pas question de permettre aux habitants du nord de la bande de Gaza de rentrer chez eux.”
»L'officier a déclaré que la grande majorité des habitants des communautés de la zone de Beit Hanoun, Beit Lahia, Al-Attatra, Jabalia (nord de Gaza) ont déjà été évacués. “Nous avons reçu des ordres très clairs”, a déclaré l'officier. “Ma tâche consiste à créer un espace nettoyé. Nous déplaçons la population pour la protéger, afin de créer une liberté d'action pour nos forces.”
»On a demandé à l'officier si l'armée mettait en œuvre le “plan des généraux” conçu par le général de division (à la retraite) Giora Eiland et quelques-uns de ses collègues commandants à la retraite pour expulser les Palestiniens du nord de la bande de Gaza tout en refusant l'aide humanitaire et en affamant ceux qui restent, qui seraient considérés comme des militants du Hamas et donc comme des cibles militaires légitimes. “Je ne sais pas ce qu'est le plan des généraux, je n'en ai aucune idée”, a répondu le commandant. “Nous agissons selon les instructions du commandement sud et du chef d'état-major de l'armée israélienne.”
»Il a précisé que sa division acheminait l'aide humanitaire “vers le sud”, en dehors de la “zone nettoyée” du nord de la bande de Gaza, où Israël interdit l'acheminement de nourriture, d'eau et de médicaments. “L'armée israélienne est une armée morale et éthique”, a conclu l'officier. “Nous opérons dans cette zone […] pour permettre à la population de se déplacer vers le sud, tout en mettant parfois nos propres vies en danger.”
»Il est important d'appeler les choses par leur nom : Eiland a peut-être vendu ces idées au public, mais le “nettoyage de l'espace” dans le nord de Gaza est effectué par les FDI sous la direction de leurs commandants, à commencer par le chef d'état-major, le lieutenant-général Herzl Halevi, et le chef du commandement sud, le général de division Yaron Finkelman, qui sont subordonnés aux directives de la direction politique : le Premier ministre Benyamin Netanyahou, le ministre de la défense Yoav Gallant, récemment limogé, et son successeur, Israel Katz.
»Au lieu de parler du plan des généraux, nous devrions parler des “ordres de Netanyahou”. C'est lui qui dirige et qui est responsable des crimes de guerre commis par les FDI dans le nord de la bande de Gaza au nom de la “guerre de Renaissance” : l'expulsion des Palestiniens, la destruction de leurs maisons et les préparatifs sur le terrain d'une occupation et d'une colonisation juive prolongées. »
Il serait temps que ceux qui se réclament dans les milieux politiques de l'autoproclamé « cercle de la raison » fassent leur la probité de tels simples reportages, pour ne pas dire de telles analyses.

Gaza. Une Autorité palestinienne impuissante

Devant l'ampleur de la destruction humaine et matérielle de Gaza, rendue pratiquement inhabitable, la nécessité d'une solution politique brandie par de nombreux États contraste avec l'enfermement israélien dans une guerre sans fin. Parmi les pistes mises en avant, outre la relance d'un processus de négociations, revient fréquemment le principe d'un retour de l'Autorité palestinienne à Gaza, un territoire qui lui échappe depuis 2007. Cette solution n'a pourtant rien d'évident.
Tiré d'Orient XXI.
L'Autorité palestinienne (AP) est créée en mai 1994 par l'accord dit « Gaza-Jéricho » ou « Oslo I ». Ses compétences y sont définies afin de concrétiser le concept de gouvernement autonome et intérimaire. La période ainsi définie est de cinq ans — jusqu'au 4 mai 1999 — et doit alors permettre aux parties d'avancer sur les négociations sur le statut final. Mais l'ensemble des questions sensibles (création d'un État, statut de Jérusalem, délimitation des frontières, droit au retour des réfugiés, colonies, partage des ressources naturelles, etc.) est volontairement repoussé. En l'absence d'accord, ce gouvernement autonome et intérimaire est devenu pérenne, sans pour autant déboucher sur l'établissement d'un État de Palestine souverain et indépendant.
Cinq ans, devenus trente pour une Autorité sans souveraineté, et quatre ans devenus bientôt vingt pour un président, Mahmoud Abbas, sans légitimité. Élu en janvier 2005 pour un quadriennat, l'ancien premier ministre de Yasser Arafat et membre du Fatah a vu son mandat prolongé indéfiniment — jusqu'à la mise en place de nouvelles élections constamment repoussées. Bien avant le 7 octobre 2023, les Palestiniens des Territoires occupés vivaient une succession de crises politiques : division interpalestinienne depuis 2007, annulation des élections, poussée autoritaire, permanence et renforcement de la colonisation et du blocus sur Gaza, et enfin marginalisation régionale. Dès lors, comment envisager que l'un des problèmes majeurs de la vie politique des Territoires — la permanence de l'Autorité palestinienne dans ses contours actuels — puisse incarner la solution adéquate quand la destruction de Gaza cessera enfin ?
De quelle autorité parle t-on ?
Ce qu'on a coutume d'appeler « Accords d'Oslo » constitue en réalité une série d'accords qui n'ont jamais envisagé la création d'un État palestinien. Loin de se substituer à l'administration militaire israélienne des Territoires, elle vient s'y ajouter. Dans les faits, l'autonomie n'est pas l'antichambre de la souveraineté, mais son pis-aller. D'un côté, l'AP a obtenu de créer des corps de fonctionnaires et d'exercer un pouvoir sur les habitants des Territoires occupés. De l'autre, Israël contribue depuis trois décennies à maintenir en place une administration palestinienne qui ne peut contrecarrer ses ambitions coloniales.
Au-delà du morcellement des Territoires, les Accords d'Oslo posent les bases de la relation entre Israël et l'Autorité qui perdure jusqu'aujourd'hui. Elle repose principalement sur deux piliers : la coopération sécuritaire et la dépendance économique. Depuis l'occupation des territoires en 1967, Israël contrôle l'activité économique palestinienne. Les territoires sont maintenus dans un rôle de sous-traitants et absorbent le surplus de la production israélienne.
La coopération sécuritaire est une expression qui a occupé une place importante dans le débat public, tant l'Autorité palestinienne menace régulièrement, sans effet, de la suspendre pour exprimer son désaveu de la politique israélienne. Les services de sécurité palestiniens, dédoublés après la division entre Gaza et Cisjordanie, sont certes nombreux, mais dépendent, en Cisjordanie, du bon vouloir israélien. Oslo interdit en effet à l'Autorité palestinienne de constituer une armée, mais rend possible la mise en place d'une police aux compétences et pouvoirs étendus.
Comptant pour un tiers du budget de l'Autorité palestinienne, les forces de sécurité palestiniennes emploient plus de 85 000 personnes à la fin des années 2010 (on compte un agent de sécurité pour 48 Palestiniens, contre un agent pour 384 Américains). Cette croissance a non seulement permis l'emploi des anciens combattants palestiniens, mais aussi la mise en œuvre d'une surveillance étroite de la population et des opposants. Israël bénéficie de la protection d'un corps supplétif palestinien à moindre coût et l'Autorité palestinienne consolide son pouvoir en s'appuyant sur les renseignements fournis par Israël.
Vers une poussée contestataire
Après la crise de 2006-2007, qui a conduit à la division institutionnelle des Territoires avec un gouvernement dominé par le Hamas dans la bande de Gaza et un gouvernement issu du Fatah à Ramallah, celle de 2021 est la plus grave qu'a connue l'Autorité depuis son existence. Début 2021, les Territoires occupés se préparaient à la tenue d'élections législatives et présidentielle. Les seules élections qui ont pu se dérouler entre-temps sont des élections municipales (2012, 2017, 2019 et 2021) qui ont été un fiasco démocratique. Faible participation, fraude électorale, manœuvres dans la présentation des résultats : tout a été fait pour rendre invisible la perte de popularité du Fatah en Cisjordanie.
La réconciliation interpalestinienne et la tenue d'élections, pour redynamiser la vie politique et disposer d'une classe dirigeante légitime, sont au cœur des demandes populaires. Lorsque Mahmoud Abbas annonce en mai 2021 le report (euphémisme pour parler de l'annulation) des élections, une vague de contestation envahit les rues de Cisjordanie et de Gaza. La répression contre les manifestants s'intensifie, de nombreux opposants sont arrêtés et certains, comme Nizar Banat, mourront dans des circonstances volontairement laissées obscures.
En parallèle, le gouvernement israélien mène une offensive d'ampleur à Jérusalem, cherchant l'éviction des habitants de plusieurs quartiers palestiniens de Jérusalem-Est (Silwan, Sheikh Jarrah) et multipliant les provocations et les agressions sur l'Esplanade des mosquées. En annulant les élections, Abbas a aggravé la contestation en Cisjordanie, qui se traduit notamment par la résurgence d'un activisme armé, d'abord dans le nord (Naplouse, Jénine) et ensuite dans presque toute la Cisjordanie. Au même moment, le Hamas lance l'opération Épée de Jérusalem (sayf al-quds) et se pose en contre-modèle de l'Autorité palestinienne de Ramallah. L'émergence d'une contestation, civile ou armée, contre ce pouvoir palestinien traduit une volonté partagée de remettre la question de la lutte contre l'occupation et la colonisation au centre du jeu politique, plutôt que de s'évertuer à construire un État sans souveraineté.
Le mythe d'une « solution politique » a minima
C'est dans ce cadre politique que doit être jaugée la faisabilité d'un déploiement de l'Autorité palestinienne comme solution politique au drame de Gaza. À la suite des attaques du Hamas contre des bases militaires et des kibboutz en Israël le 7 octobre 2023 puis le bombardement de Gaza par l'armée israélienne, le président palestinien est resté pratiquement silencieux. Sa mise en retrait souligne que Gaza, où il ne s'est pas rendu depuis 2006, lui est devenue comme un territoire étranger.
Dans un geste, à peine commenté en Cisjordanie tant il paraissait dérisoire, il a annoncé un changement de gouvernement fin mars 2024. Mahmoud Abbas prétendait ainsi apporter une réponse, quoique tardive et plutôt timide aux demandes de 2021, sans passer par les urnes et sans saisir l'ampleur du drame en cours depuis octobre 2023. Le gouvernement, technocratique, tente certes d'accorder une place privilégiée à des personnalités gazaouies, mais ne représente pas l'ensemble des courants palestiniens. Le gouvernement de Mohammed Moustafa s'est donné comme tâche d'agir pour un cessez-le-feu à Gaza sur lequel il n'a aucun poids, et de penser la reconstruction de ce territoire dont l'ampleur de la destruction reste à déterminer.
En Cisjordanie, ce nouveau gouvernement, pas plus que le précédent, n'a les moyens de lutter contre la poussée contestataire et l'augmentation drastique des violences des colons et de l'armée israélienne. Pour Gaza, il est cantonné à un rôle d'observateur des pourparlers menés sous l'égide du Qatar et de l'Égypte. Indépendamment de la bonne volonté de ses ministres, ce gouvernement impuissant fait l'objet de critiques sévères, puisque ses opposants voient dans l'établissement de plans successifs pour s'établir à Gaza un moyen pour le Fatah de prendre sa revanche sur le Hamas, qui l'en a chassé en 2007. Surtout, ses dirigeants feignent d'ignorer que la solution politique qu'ils espèrent incarner requiert un abandon de la logique d'Oslo, qui a remplacé la demande d'indépendance par une autonomie sous forte contrainte.
Les défis de la division
Le 18 juillet 2024, le parlement israélien a voté dans sa très grande majorité (68 voix contre 9) son opposition à l'établissement d'un État palestinien, même provenant d'une solution négociée. Ce vote traduit un consensus transpartisan israélien et n'augure rien de favorable pour les ambitions prêtées à l'Autorité palestinienne. Le premier obstacle à l'établissement d'une Autorité sur l'ensemble des Territoires occupés est en effet la volonté israélienne de dissiper tout espoir que l'indépendance palestinienne puisse constituer une solution viable. Ce vote israélien se double d'une campagne soutenue par certains ministres et de mouvements de colons, pour recoloniser Gaza. Leur idée est d'accentuer le déplacement forcé de la population palestinienne déjà en cours pour annexer de nouveaux territoires.
Au-delà, l'Autorité doit réussir à s'opposer à la création d'un statut d'exception pour la bande de Gaza. Après le retrait unilatéral des colonies en 2005 (et dans un contexte d'une occupation indirecte, par le contrôle total des accès au territoire), puis la division interpalestinienne en 2007, Israël a consolidé une vision exclusivement sécuritaire de ce territoire. Quand bien même le 7 octobre a souligné toutes les apories d'une telle approche, cette même doctrine demeure au centre des ambitions israéliennes : diviser la bande de Gaza en y établissant une zone militaire sur environ un tiers du territoire et maintenir une force non palestinienne pour assurer la sécurité des deux tiers restants, en collaboration avec certains alliés régionaux. C'est dans ce cadre que le nom de Mohammed Dahlan est évoqué, bien qu'il ne s'exprime pas en son nom propre sur le sujet. Ancien directeur de la Sécurité préventive à Gaza, il a mené une lutte implacable contre le Hamas. Suite à des accusations de corruption, le Fatah l'exclut et il est poussé à l'exil en 2011. Devenu conseiller de Mohammed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis, il entretient de bonnes relations avec les autorités israéliennes, égyptiennes et américaines, ce qui justifie pour certains d'en faire le nouvel homme fort d'une bande de Gaza réduite à sa dimension sécuritaire. Un tel plan aggraverait la division palestinienne qui constitue, au côté de la coopération sécuritaire, l'autre fondement de la contestation palestinienne depuis près de deux décennies.
S'ajoute également la question du financement de la reconstruction pour laquelle certaines estimations de l'ONU évaluent les besoins à 100 milliards de dollars (94 milliards d'euros) sur deux décennies. En dépit de son intérêt pour piloter ce processus, l'Autorité palestinienne ne dispose pas des ressources nécessaires et s'appuierait sur des bailleurs extérieurs. Les plans de la reconstruction de Gaza sont systématiquement bâtis sur l'idée que les monarchies du Golfe, Arabie saoudite en tête, accepteront d'y contribuer de façon significative. Or, ces pays ne cessent de répéter que l'ère de ces financements sans contrepartie (au Liban comme en Palestine) est terminée. À moins que la reconstruction ne soit inscrite dans un processus politique qui viserait à établir un État de Palestine indépendant, ces pays déclarent déjà leur désengagement.
Gouverner, représenter, résister
Enfin, depuis des décennies, la scène politique palestinienne dans les Territoires occupés et en exil est traversée par une hétérogénéité des préoccupations, qui s'est exprimée de façon plus visible après le 7 octobre. Coexistent ici trois mots d'ordre, dont la fusion est essentielle pour tout projet palestinien : gouverner, représenter et résister. La question du gouvernement est intrinsèquement liée à celle de sa légitimité, qu'elle soit l'expression d'un accord national autour de figures politiques consensuelles ou issues des urnes. Celle de la représentation s'incarne depuis deux décennies dans la réconciliation entre les deux partis ennemis — Fatah et Hamas — et l'inclusion au sein de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) du Hamas et du Jihad islamique palestinien, qui n'en sont pas membres. L'affichage à Moscou et Pékin en 2024 de discussions interpalestiniennes sur l'avenir de l'OLP n'ont, pour l'instant, pas abouti. Sans avancée tangible sur ce sujet, des initiatives concurrentes pour incarner une voix palestinienne renouvelée pourraient prendre corps, à l'instar de l'ambition portée par l'ancien député israélien Azmi Bichara, de former une alternative à l'OLP regroupant quelques centaines de nouvelles figures palestiniennes des Territoires occupés et de la diaspora pour porter la cause palestinienne hors des frontières et sans être soumis au bon vouloir du pouvoir de Ramallah.
Ces discussions sur l'avenir de l'Autorité se déroulent par ailleurs comme si la question de la succession de Mahmoud Abbas (bientôt 89 ans, deuxième chef d'État le plus âgé derrière Paul Biya) n'était plus posée. Or, celle-ci est au cœur des enjeux des élections comme des réarticulations du pouvoir à Ramallah tant qu'Abbas cumule les casquettes de dirigeant du Fatah, de l'OLP et de la présidence de l'Autorité. Les différentes nominations des dernières années — Hussein Al-Cheikh au secrétariat général de l'OLP, Mahmoud Al-Aloul à la vice-présidence du Fatah — indiquent qu'Abbas ne souhaite pas nommer un seul candidat ayant toutes les responsabilités pour lui succéder, mais préfère les répartir entre plusieurs individus. Une succession précipitée et mal préparée, ainsi que l'engagement de secteurs du Fatah jusqu'ici écartés (autour notamment de Marwan Barghouthi et Mohammed Dahlan), pourrait faire naître une concurrence entre eux qui fragiliseraient de l'intérieur l'Autorité, au moment où le pari de sa consolidation est fait.
Reste l'épineuse question de la résistance à l'occupation israélienne et la contestation en cours de l'Autorité. La transformation du Hamas ces dernières années et les choix opérés le 7 octobre sont à l'exact opposé de la politique répressive de l'Autorité. Répondre à l'attente de la fin de l'occupation, à la protection de ses citoyens, à leurs demandes de réforme et aux respects de ses engagements internationaux est un défi insurmontable. Pour ce faire, un accord avec le Hamas et les composantes armées de la bande de Gaza s'impose. Même si le Hamas ne participe pas au futur gouvernement, il ne pourra être complètement mis à l'écart des négociations concernant sa composition et son mandat. Un an après le début de la guerre, le Hamas s'impose encore sur la scène politique palestinienne comme une force incontournable pour tout projet lié à Gaza. Son exclusion risque d'éveiller les spectres de l'affrontement interpalestinien de 2007. Au-delà de la rivalité entre les différents partis politiques, la volonté populaire palestinienne, rarement abordée, ne devrait idéalement pas être exclue. Ce projet de l'établissement de l'Autorité palestinienne à Gaza devrait être conçu non seulement comme une solution politique à la suite d'un cessez-le-feu, mais avant tout comme un projet national reformulé et capable de répondre aux aspirations des Palestiniens.

« Ce pays, ce n’est pas un pays… »

« c'est une base militaire ». C'est ainsi que Noam Chomsky finit la phrase du titre ; et il n'en est pas seul. Dans une présentationà Boston en 2003, Chomsky dépeint les similarités entre le régime d'apartheid africain et l'État d'Israël. Il en souligne aussi une différence : ce dernier est, en principe, une base militaire.
À l'année de cette présentation, la caractéristique militaire de ce pays a été moins explicite que ce que nous témoignons sous nos yeux. Connu pour posséder une centaine d'armes nucléaires, selon les statistiques reconnues comme objectives, en 2024, l'Israël est le 17e puissant militaire au monde. Et sa place dans la population mondiale ? 98e !
Que l'Israël soit absolument en fonction d'aide multifacette des États-Unis est très bien connu. Ce qui est moins connu est le rôle d'autres pays. Selon un article publié par la BBC en septembre de cette année, en 2023, les pays européens ont vendu 361 $ m d'armes en Israël : 10 fois plus que l'année précédente !
Le soutien pratiquement inconditionnel d'un pays sous Biden, qui se considère explicitement comme sioniste, et ses alliés l'amène la situation à l'état actuel :
— selon un rapport des Nations unies publié par The New York Times en mai 2024, la reconstruction des maisons de Gaza dure 80 ans !
— Selon un article publié par The Guardian en juin cette année, 80 % des écoles à Gaza ont été déjà détruits au moment de la publication de cet article.
— Selon un rapport publié la semaine passée, le 8 novembre, par Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, seulement 12 hôpitaux d'ensemble de 32 hôpitaux de Gaza sont partiellement fonctionnels !
De plus, nous ne témoignons que des signes de la détermination de l'aggravation de statu quo de la part d'État d'Israël.
Si le militarisme est un ingrédient incontournable de l'ère actuel de l'impérialisme américain, l'Israël comme une base doit continuer son rôle autant que nécessaire. À cet égard, un rappel de l'existence des moments où les alliés sont mis à côtés dans le passé est clarifiant. Les talibans, munis et soutenus par l'occident avec la direction des États-Unis contre Union soviétique, pour un, Saddam contre le gouvernement iranien, pour l'autre – et la liste n'y arrête pas. D'une manière ironique, tous ces alliés sont considérés des ennemis et même détruits une fois que leur date d'échéance est arrivée. Est-ce que cela peut être également le cas pour l'État d'Israël ? Entre autres, à côté d'aide matérielle, le soutien englobant des États-Unis, le sens de culpabilité de l'Allemagne et l'incertitude de la France, continuent à nourrir cette base militaire. Mais plus que ça.
C'est maintenant vastement connu et reconnu que cet état acrééet financièrement soutenu Hamas jusqu'à deux ans à peu près avant l'octobre 2022, pour diviser les Palestiniens. À long terme, selon cette lecture, l'état génocidaire, a eu besoin de cette guerre et ce massacre pourcréer un Israël encore plus grand ! Pour cet objectif, il a besoin de nouvelles formes d'antisémitisme.
Pour nourrir son élan du militantisme et de l'expansionnisme, l'état israélien a réussi à transformer les menaces quasi symboliques en menaces véritables. Grâce au soutien inconditionnel du parrainage des États-Unis et de leurs alliés, les missiles de Hamas pratiquement toujours inefficaces sont transformés en menaces qui nuisent au peuple israélien. C'est aussi le cas pour Hezbollah. Mais la cible véritable, selon les autorités israéliennes, est l'Iran. La réaction de l'Iran à cet égard ne semble pas un facteur déterminant de plan de cette base militaire.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Médicide » : la destruction systématique et délibérée par Israël de la santé des Palestiniens

Le 1er octobre 2024, l'organisation Medical Aid for Palestinians dénoncait dans un communiqué qu'un « schéma clair d'attaques répétées, directes et apparemment illégales, ainsi que les effets du siège, amènent la MAP à conclure que le système de santé de Gaza est en train d'être systématiquement démantelé ». L'agence Média Palestine revient aujourd'hui sur le crime de médicide perpétué depuis un an par Israël à Gaza.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Depuis le 28 octobre 2024 et le raid brutal israélien qui a mené à l'arrestation de la quasi totalité des soignant·es qui s'y trouvaient, il n'y a à l'hôpital Kamal Adwan plus qu'un seul médecin et une seule infirmière. L'établissement est le dernier en fonctionnement dans le nord de Gaza. Dans une déclaration vidéo, le Dr Khalil Daqran exhortait les organisations internationales à envoyer du personnel médical à l'hôpital situé dans le nord de la bande de Gaza, dénonçant que des patients s'y vidaient de leur sang faute de soins appropriés, alors que les camions d'aide humanitaire et de matériel médical sont empêchés de pénétrer la zone.
Cette situation catastrophique n'est qu'une nouvelle étape dans la destruction systématique menée Israël depuis maintenant plus d'un an de tout le système de santé de Gaza. L'agence Média Palestine propose un bref tour d'horizon de ces attaques répétées, qui soulignent l'intention génocidaire d'Israël d'éradiquer le peuple palestinien dans son ensemble : « Lorsque les hôpitaux sont attaqués, que leurs infrastructures sont détruites et que l'électricité est coupée, la vie des patient·es et du personnel médical est menacée, il s'agit purement et simplement d'une punition collective imposée aux Palestinien·nes de Gaza », explique Anna Halford, coordinatrice d'urgence de MSF à Gaza.
Le soin à Gaza détruit
Fin octobre, 20 des 36 hôpitaux de Gaza étaient hors service, tandis que 16 ne fonctionnaient que partiellement. Sur les 11 hôpitaux de campagne, la moitié n'est que partiellement fonctionnelle. Le nombre de lits d'hôpitaux dans la bande de Gaza a chuté de 75 % (d'environ 3 400 au début de la guerre à environ 1 200 fin septembre). Sur les 16 hôpitaux en activité, seuls quatre disposent d'un approvisionnement complet en eau et de services d'égouts, et deux seulement d'un approvisionnement régulier en électricité.
Dans les hôpitaux surchargés, les médecins sont contraint·es de faire des choix impossibles entre leurs patient·es en raison du manque de matériel et de personnel, comme le raconte le Dr Odeh : « Un bébé très, très malade devait être placé sous respirateur. Après le décès du bébé, que faire du respirateur ? Il n'y a aucun moyen de désinfecter le respirateur et de le débarrasser des bactéries multirésistantes. Nous n'avons pas non plus de tuyaux de rechange lorsque nous utilisons le respirateur pour un autre bébé. Il y a donc de très fortes chances de transmettre l'infection à d'autres bébés : soit le bébé meurt parce qu'il n'y a pas de respirateur, soit il meurt à cause de l'infection bactérienne. Les options sont tragiquement limitées. »
Selon les Nations unies, 1 047 membres du personnel médical palestinien ont été assassiné-es et 310 ont été arrêté-es au cours de la guerre – une réalité qui met encore plus à rude épreuve les équipes médicales locales. Les professionnel·les du soin palestiniens-nes considèrent que leur travail de soignant les désignent comme des cibles, nombre d'entre elles et eux ont été arrêté·es, maltraité·es et emmené·es dans des centres de détention en Israël, avant d'être renvoyé·es à Gaza par l'armée. Beaucoup déclarent s'attendre à mourir.
De nombreux·ses membres du personnel médical n'ont pas reçu leur salaire depuis des mois. Un grand nombre d'entre elles et eux ont perdu des membres de leur famille, mais continuent à venir travailler. Beaucoup vivent dans des tentes près des hôpitaux, ou marchent chaque jour – parfois pendant des heures – de la tente familiale à l'hôpital.
Les Gazaoui·es en danger
Avec le système de soin, c'est bien sûr la santé des Palestinien·nes qui est détruite. Outre les bombardements aériens et raids terrestres de l'armé israélienne, les conditions de vie précaires, les déplacements forcés et répétés, la famine et les épidémies développées en raison de l'insalubrité des camps sont autant de risques mortels auxquels est confrontée quotidiennement la population gazaouie.
Dans une lettre ouverte à la maison blanche publiée en octobre 2024, 99 professionnel·les de la santé états-unien·nes en mission à Gaza estiment à 62 413 le nombre de décès dus à la malnutrition et à la maladie, dont la plupart étaient des enfants. Les patient·es sous dialyse, les cancéreux·ses et les femmes enceintes n'ont nulle part où aller, et il est estimé à environ 5 000 le nombre de décès dus à des maladies chroniques qui n'ont pas pu être soignées correctement. De plus, les blessé·es sont souvent incapables d'atteindre les hôpitaux qui fonctionnent encore, car les services d'ambulance ont été pratiquement réduits à néant.
À quelques exceptions près, les soignants estiment que toute la population de Gaza est malade et/ou blessée, et presque tous les enfants de moins de 5 ans souffrent de toux ou de diarrhée. En outre, les soignant·es décrivent une détresse mentale quasi générale chez les jeunes enfants, précisant que certain·es qui étaient suicidaires ou espéraient mourir. L'une des infirmières témoigne que de nombreux enfants ne réagissent plus à la douleur.
Ces morts viennent alourdir dramatiquement le bilan des victimes palestiniennes du génocide israélien : « Avec les morts violentes connues, les quelque dix mille personnes ensevelies sous les décombres et certainement mortes, une estimation prudente de 62 413 décès dus à la malnutrition et à la maladie, et une estimation prudente de 5 000 décès chez les patient·es souffrant de maladies chroniques, nous estimons que le nombre actuel de morts est d'au moins 118 908. »
Crime contre l'humanité
La destruction du système de santé donne une image sombre du présent de Gaza, sans parler de son avenir. Une guerre qui détruit les hôpitaux et ne permet pas la mise en place d'une alternative viable est une guerre contre une population civile, aujourd'hui en proie à la maladie et à la famine.
Dans sa requête à la Cour internationale de justice demandant l'application de la Convention sur le génocide à la guerre d'Israël contre Gaza, la République d'Afrique du Sud affirmait que les « attaques incessantes d'Israël contre le système de santé palestinien à Gaza infligent délibérément aux Palestinien·nes de Gaza des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction ».
Une commission d'enquête indépendante des Nations unies sur les dommages causés aux infrastructures sanitaires de la bande de Gaza, publiée en septembre, a conclu que les actions d'Israël s'inscrivent dans une politique délibérée qui constitue un crime contre l'humanité, y compris sous la forme d'extermination et de torture. Les auteur·ices du rapport n'ont trouvé aucun fondement à la plupart des affirmations d'Israël concernant l'utilisation militaire des hôpitaux par le Hamas.
Ce document réfute donc les justifications d'israël et déclare que les attaques ne respectent pas le principe de distinction et de protection : « Les attaques contre les établissements de santé sont un élément intrinsèque de l'assaut plus large des forces de sécurité israéliennes contre les Palestinien·nes de Gaza et l'infrastructure physique et démographique de Gaza, ainsi que des efforts visant à étendre l'occupation. Les actions d'Israël violent le droit international humanitaire et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, et elles sont en contradiction flagrante avec l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de juillet 2024. »
« La Commission constate qu'Israël a mis en œuvre une politique concertée visant à détruire le système de santé de Gaza. Les forces de sécurité israéliennes ont délibérément tué, blessé, arrêté, détenu, maltraité et torturé le personnel médical et pris pour cible des véhicules médicaux, ce qui constitue le crime de guerre d'homicide volontaire et de maltraitance et le crime contre l'humanité d'extermination. »
« La Commission estime que ces mesures ont été prises à titre de punition collective contre les Palestiniens de Gaza et qu'elles s'inscrivent dans le cadre de l'attaque israélienne contre le peuple palestinien qui a débuté le 7 octobre. »
Médicide
Vendredi 26 octobre 2023, la rapporteure spéciale des Nations unies sur la santé Tlaleng Mofokeng a utilisé dans un appel d'urgence pour Gaza à la communauté internationale le terme de « médicide », qui désigne la destruction totale ou partielle d'un système de soins dans le but de supprimer ou d'endommager les conditions nécessaires pour sauver et maintenir la vie des malades et des blessé·es.
La destruction massive par Israël des infrastructures médicales à Gaza n'est pourtant pas nouvelle et fait partie intégrante des stratégies de guerre qu'il déploie contre les Palestinien·nes. Au cours des cinq cycles d'éruption de violence entre 2008 et 2023, l'armée israélienne a porté des coups dévastateurs aux services de santé palestiniens déjà gravement affaiblis par diverses formes de violence structurelle remontant à plusieurs décennies. Au total entre décembre 2008 et mai 2021, Israël a mené 180 frappes contre des hôpitaux, des cliniques médicales et des ambulances dans la bande de Gaza. Ces attaques ont eu lieu alors que des centaines, voire des milliers de blessé·es palestiniens cherchaient un traitement médical urgent dans les hôpitaux et les cliniques ou un refuge dans leurs bâtiments.
Au cours de l'attaque de 2008-9 contre Gaza, l'armée israélienne a endommagé ou détruit 58 hôpitaux et cliniques, ainsi que 29 ambulances, tout en tuant 16 travailleurs médicaux et en en blessant 25 autres. Lors de la campagne militaire de 2012, les destructions ont été plus limitées, avec 16 hôpitaux et cliniques, ainsi que 6 ambulances, endommagés ou détruits, et trois travailleurs médicaux blessés. Deux ans plus tard, cependant, 73 hôpitaux et cliniques et 45 ambulances ont été endommagés ou détruits, 23 travailleurs médicaux ont été tués et 76 autres blessés. Lors de la campagne militaire de 2014, l'armée israélienne a eu recours à des « frappes multiples consécutives » sur un même site, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de victimes civiles mais aussi des meurtres et des blessures parmi les intervenant·es des premiers secours. En mai 2021, des frappes aériennes israéliennes ont endommagé 33 centres de soins, dont le principal laboratoire COVID-19 de Gaza, et au moins deux médecins éminents ont été tués.
Chacune de ces formes d'attaques contre les sytème de santé a été reproduite dans l'année écoulée à Gaza, dans une ampleur et une intensité sans précédent.
Chronologie de la destruction du système de santé à Gaza
L'Agence Média Palestine propose ci-dessous une chronologie des attaques sur les hôpitaux de Gaza. Celle-ci est non-exhaustive et ne concerne que des assauts directs sur les bâtiments hospitaliers, elle ne prend pas en compte les frappes indirectes, les tirs ciblants les personnels de premiers secours et d'autres attaques envers les soins des Palestinien·nes.
Octobre
Dès le 7 octobre 2023, Médecins Sans Frontières (MSF) rapporte que des tirs des forces israéliennes ont frappé l'hôpital indonésien de Beit Lahia et une ambulance devant l'hôpital Nasser de Khan Younis, tuant une infirmière et un chauffeur d'ambulance et blessant plusieurs autres personnes.
Le même jour, Israël coupe toute fourniture d'éléctricité à Gaza, et de nombreuses organisations alertent aussitôt sur l'impact dramatique que cette décision aura sur les hôpitaux et sur la survie des centaines de blessé·es qui y affluent suite aux bombardements massifs et aveugles des zones densément peuplées de l'enclave Palestinienne. Des médecins gazaoui·es alertent le 10 octobre 2023 que leurs générateurs ne disposent plus que de 3 jours de réserve d'énergie. Le blocage de l'arrivée de convois humanitaires conduit rapidement à des pénuries d'eau, de médicaments et de matériel médical qui n'ont fait que s'aggraver depuis lors. Le 16 octobre, le président de MSF alerte sur son compte X que les médecins de l'hôpital Al-Shifa opèrent désormais sans analgésiques.
Dans les semaines qui suivent, de nombreuses frappes israéliennes endommagent les bâtiments médicaux de Gaza, tuant et blessant leur personnel. Si ceux-ci ne sont à priori pas toujours la cible directe des attaques, de nombreuses voix s'élèvent pour rappeler que le droit international impose que les hôpitaux soient protégés et accusent Israël de ne pas prendre de mesures pour éviter de les impacter : le droit des conflits armés (DCA), l'article 12 du protocole additionnel I, qui stipule que « les unités médicales doivent être respectées et protégées en tout temps et ne doivent pas être l'objet d'attaques ».
Le 25 octobre, le ministère de la santé de Gaza annonce que le système de santé est « complètement hors service » et qu'au moins 7 000 patient·es malades ou blessé·es risquent de mourir. Les blackouts ou coupures de communications, récurrents à partir de la mi-octobre, empêchent les survivant·es des bombardements d'appeler les secours et d'obtenir de l'aide à temps.
Novembre
L'hôpital AL-Shifa, situé en plein centre de la ville de Gaza, est progressivement encerclé par l'armée israélienne à partir de 11 novembre. Le ministère de la santé de Gaza dénonce que les 15 000 Palestinien·nes qui s'y étaient réfugié·es sont mis en danger par cette opération, de même que les 1 500 patient·es et 1 500 membres du personnel médical. MSF rapporte que des médecins et des patient·es ont été ciblé·es par des tirs de précision, et que des familles qui tentaient de quitter l'enceinte de l'hôpital ont été tuées par l'armée israélienne.
Le 15 novembre commence le premier assaut terrestre israélien sur l'hôpital Al-Shifa, qui durera trois jours et est aussitôt qualifié d'« inacceptable » par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le 17 novembre, des membres du personnel médical affirment que 50 patient·es sont mort·es, dont des enfants, en raison du manque d'électricité et d'oxygène. Le 18 novembre, une partie des patient·es et des réfugié·es est évacuée de force.
Le 20 novembre, un tir d'obus israélien frappe le deuxième étage de l'Hôpital Indonésien à Beit Lahia au nord de Gaza, tuant 12 personnes. L'hôpital est ensuite encerclé, et une partie des civil·es qui s'y abritaient est évacuée de force, sur le même schéma que ce qui était observé à Al-Shifa quelques jours plus tôt.
Le 21 novembre, quatre médecins sont assassinés dans le bombardement de l'hôpital Al-Awda au nord de Gaza, alors que l'OMS annonce préparer l'évacuation des 3 seuls hôpitaux fonctionnels du nord de l'enclave. Des nombreux incidents surviendront pendant ses évacuations, lors desquels des patient·es et du personnel médical sont tué·es ou arrêté·es et emprisonné·es par Israël.
Décembre
Quelques heures après la fin de la trêve mise en place du 24 au 30 novembre, MSF rapporte que l'hôpital Al-Awda a été endommagé par une explosion et dénonce les bombardements indiscriminés de l'armée israélienne sur la zone. Al-Awda est ensuite assiégé, et au moins deux médecins Palestiniens sont tués par des tireurs d'élite israéliens dans les jours qui suivent. Les patient·es et réfugié·es assiégés doivent vivent sans eau potable et avec un seul repas par jour.
L'hôpital Kamal Adwan est touché par des bombardements aériens les 3 et 5 décembre, tuant au moins 4 personnes dont des enfants. Plus de 10 000 Palestinien·nes déplacé·es y sont réfugié·es et des témoins racontent que des dizaines de corps y attendent de pouvoir être enterrés en raison des intenses bombardements.
Le 8 décembre, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres annonce que 286 travailleur·ses de la santé ont été assassiné·es par Israël depuis le 7 octobre. Le 10 décembre, le ministère de la santé indique que 50 000 personnes ont été blessé·es par Israël pendant cette même période. Les hôpitaux encore fonctionnels sont submergé·es, des médecins rapportent devoir traiter leurs patient·es à même le sol, faute de lits à leur fournir.
Après 5 jours de siège, un raid y est lancé par l'armée israélienne sur l'hôpital Kamal Adwan le 12 décembre, qui conduira à l'arrestation de 70 personnes le lendemain, sans indication du motif ni du lieu de leur détention. Le 14 décembre, le ministère de la santé de Gaza rapporte que 2 500 réfugié·es de Kamal Adwan ont été évacué·es de force et que les soldat·es israélien·nes ont empêché le personnel médical de continuer à soigner 12 bébés en soins intensifs et 10 patient·es du service des urgences, ce qui a entraîné deux décès.
Le 17 décembre, l'armée israélienne prend le contrôle de l'hôpital Al Adwan, qui est décrit comme « en ruine ». Les hommes de plus de 16 ans sont emmenés, déshabillés et interrogés avant d'être pour la plupart renvoyés vers l'hôpital avec l'ordre de ne pas le quitter. Des témoins rapportent que l'armée israélienne a profané des corps en roulant dessus avec des bulldozers. Le même jour, la maternité de l'hôpital Nasser à Khan Younis est touchée par des tirs et une enfant de 12 ans est tuée.
Le 18 décembre, l'hôpital Al-Ahli, également appelé l'hôpital baptiste, est attaqué par l'armée israélienne, qui force les réfugié·es qui s'y trouvent à sortir et arrêtent deux médecins. L'hôpital est partiellement détruit et est décrit comme « hors service » par ses médecins. Quatre blessé·es lors de cette attaque meurent de leurs blessures le lendemain.
Le 25 décembre, le ministère de la santé de Gaza déclare que 23 hôpitaux sont hors service et que le système de santé est au « stade final » de l'effondrement, avec 800 000 personnes dans le nord de Gaza qui n'ont pas accès aux soins de santé.
Janvier
Le 2 janvier, le Croissant-Rouge palestinien déclare que les forces israéliennes ont pris pour cible le huitième étage de son siège à Khan Younis, causant la mort d'au moins quatre personnes déplacées, dont un bébé.
Le 6 janvier, MSF annonce évacuer son personnel de l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa à Deir Al-Balah, redoutant un futur siège de l'hôpital en raison des intenses bombardements depuis plusieurs jours dans toutes les zones environnantes. Le 7 janvier en effet, l'armée israélienne lâche par voie aérienne des tracts désignant toute la zone environnant l'hôpital Al-Aqsa comme une « zone rouge ». Le ministère de la santé de Gaza affirme que des drones israéliens « tirent sur tout ce qui bouge », empêchant l'accès comme la fuite de l'hôpital. Le 10 janvier, au moins 40 personnes sont tuées dans un bombardement à l'entrée de l'enceinte du bâtiment. Le 12 janvier, l'hôpital est plongé dans la pénombre et ses respirateurs et couveuses sont coupées, n'ayant plus de carburant nécessaire à faire fonctionner les générateurs d'électricité. L'hôpital Al-Aqsa fonctionne avec seulement 10% de son équipe médicale.
Le 15 janvier, l'organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que l'hôpital Nasser fait face à un afflux de blessé·es et doit accueillir plus du double de ses capacités. Des intenses bombardements se rapprochent du complexe hospitalier tout au long du mois de janvier, faisant craindre un nouveau siège et entrainant des mouvements de panique parmi les réfugié·es.
Le 23 janvier, des ordres d'évacuations concernant des zones incluant l'hôpital Nasser sont délivrés par l'armée israélienne. Une partie de l'équipe médicale et des réfugié·es sont contraint·es de fuir, l'hôpital fonctionne désormais avec moins de 20% de son personnel. Les attaques israéliennes s'étendent à Khan Younis et menacent également l'hôpital Al-Amal.
Le 24 janvier, le Croissant-Rouge palestinien (PRCS) déclare que les forces israéliennes assiègent son siège et l'hôpital Al-Amal à Khan Younis et imposent un couvre-feu dans le périmètre. Le ministère de la santé de Gaza indique que l'hôpital Nasser est isolé et qu'environ 400 patients diabétiques ne peuvent pas recevoir leur traitement. Des témoignages rapportent que personnes fuyant Nasser sont tuées par des chars et des drones israéliens.
Le 27 janvier, le ministère de la santé de Gaza affirme que les réservoirs d'eau du complexe médical Nasser ont été endommagés par des éclats d'obus et des tirs de drones israéliens. Ces dégâts entrainent des fuites d'eau dans les bâtiments et dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, ainsi qu'une pénurie d'eau dans le centre de dialyse. L'hôpital assiégé n'est plus en mesure d'évacuer ses déchets médicaux et non-médicaux, et est contraint d'enterrer des dizaines de corps d'enfants dans une fosse commune, faute de pouvoir atteindre les cimetières.
Le 30 janvier, des tanks israéliens pénètrent dans la cour de l'hôpital Al-Amal et forcent les palestinien·nes qui y étaient réfugié·es à partir en brûlant leur tentes. Tous les bâtiments de l'hôpital subissent des tirs et des blessé·es succombent faute de personnel et de matériel médical. Les deux hôpitaux de Khan Younis annoncent ne plus être en mesure de fournir de la nourriture à leurs patient·es comme à leurs équipe.
Février
Le 2 février, les hôpitaux de Khan Younis Al-Amal et Nasser annoncent faire face à de sérieuses pénuries en oxygène et en médicaments. Le 5 février, un corridor est mis en place pour évacuer 8 000 palestinien·nes de l'hôpital Al-Amal en direction de Rafah. Le 9 février, l'armée israélienne lance un assaut terrestre sur Al-Amal.
Le 13 février, le bombardement d'une école à proximité de l'hôpital Nasser provoque un incendie qui détruit 80% des fournitures médicale dont disposait le centre. L'hôpital est toujours assiégé et fait face à une situation sanitaire catastrophique.
Mars
Le 18 mars, l'armée israélienne entame un nouveau raid sur l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, déjà attaqué et partiellement détruit en novembre. L'attaque dure deux semaines et fait de nombreuses victimes, sans qu'on puisse en déterminer le nombre exact. Plusieurs charniers communes seront découverts les mois suivants dans la cour de l'hôpital, dans lesquels certains corps sont enterrés encore attachés à un cathéter.
Avril
Le 1er avril, après une opération de 14 jours menée par les forces israéliennes à l'intérieur et autour de l'hôpital Al-Shifa, l'hôpital est laissé en ruines et hors service. Une clinique de MSF située à proximité de l'hôpital a également été gravement endommagée. Des centaines de personnes ont été tuées, y compris des membres du personnel médical, et des arrestations massives de membres du personnel médical et d'autres personnes ont eu lieu à l'intérieur et autour de l'hôpital.
Mai
Le 7 mai, au lendemain du début de l'offensive israélienne à Rafah, MSF déclare transférer son personnel à l'hôpital Nasser. L'UNOCHA indique que le plus grand hôpital de Rafah, l'hôpital Abu Youssef An Najjar, a été contraint d'évacuer. La principale maternité de Rafah annonce ne plus pouvoir accepter de nouvelles patientes. Le 10 mai, des témoignages rapportent que les hôpitaux de Rafah sont désertés par les patient·es et le personnel médical qui fuient les intenses bombardements. Celles et ceux qui ne peuvent se déplacer risquent de mourir faute de soin. La fermeture du point de passage de Rafah bloque également le transfer de nombreux·ses malades et blessé·es nécessitant des soins en Égypte. Les 25 et 28 mai, les hôpitaux de campagne de Rafah sont contraints d'être évacués lorsque les combats se rapprochent du centre-ville.
Juillet
Le 2 juillet, une zone de Khan Younis comprenant l'hôpital européen de Gaza, l'un des dernier hôpital fonctionnel de l'enclave, est contrainte à évacuer par l'armée israélienne. Malgré la parution d'une seconde déclaration israélienne affirmant que l'hôpital n'est pas concerné par l'ordre d'évacuation, la majorité des patient·es et du personnel fuient vers les hôpitaux Nasser et Al-Amal, qui sont très vite saturés.
Août
Le 19 août 2024, un premier cas de polio est détecté à Gaza. Une campagne de vaccination sera déployée par la suite, principalement prise en charge par l'UNRWA.
Octobre
Le 19 octobre, l'hôpital indonésien et l'hôpital Al-Awda sont directement visés par des tirs, alors que le siège israélien du nord de Gaza dure depuis deux semaines, que l'arrivée d'aide humanitaire et de fournitures médicales est bloquée et que de nombreux·ses blessé·es affluent. Il est estimé que plus de 350 patient·es sont assiégé·es, dont des femmes enceintes ou des patient·es en convalescence ne pouvant se déplacer.
Le 22 octobre, le directeur de l'hôpital al-Awda, Bakr Abu Safiyeh, déclare que des quadcoptères israéliens ont ouvert le feu directement sur l'hôpital. Il affirme également que les drones prennent pour cible toute personne aux alentours de l'hôpital, y compris des ambulances.
Le 23 octobre, des drones israéliens larguent des tracts et diffusent des messages vocaux à l'attention des Palestinien·nes se trouvant aux alentours de l'hôpital Kamal Adwan (le dernier hôpital fonctionnel du nord de Gaza, ou des centaines de personnes sont réfuigiées) et à l'intérieur de ses locaux, leur ordonnant de partir. Après plusieurs jours de siège ponctué de plusieurs tirs ciblés, un raid israélien est déclenché le 28 octobre sur l'hôpital Kamal Adwan, qui conduit à l'arrestation de l'entièreté de son personnel, à l'exception de son directeur et d'une infirmière.

Le rôle de l’Intelligence artificielle dans la campagne génocidaire israélienne

Israël utilise des technologies d'intelligence artificielle dans sa campagne génocidaire à Gaza pour assassiner des Palestiniens, employant pour ce faire des entreprises technologiques israéliennes et américaines. Cependant, il existe une longue histoire de pratiques de surveillance en Palestine occupée qui nous a conduits jusqu'à aujourd'hui.
Tiré de France Palestine solidarité. Source : Palestine Studies. Photo : Simulation finale de l'unité Yahalom, 2022 © Armée israélienne. Traduction : Chronique de Palestine
L'intelligence artificielle (IA) est définie de manière générale comme des machines capables d'effectuer des tâches qui requièrent généralement l'intelligence humaine. Des décisions peuvent être prises et des algorithmes peuvent analyser des données de surveillance beaucoup plus rapidement qu'il n'est humainement possible de le faire.
Antony Lowenstein, auteur de The Palestine Laboratory, a déclaré lors du forum annuel Palestine Digital Activism au début du mois de juin : « Je crains que dans les années à venir, c'est [l'intelligence artificielle] qui sera dénoncée. ‘Ce n'était pas nous, c'était la machine.' Non… ce n'est pas une machine qui a pris la décision d'appuyer sur le bouton pour bombarder une maison. C'est un humain qui a pris cette décision. Un Israélien ».
Gaza
Des rapports sur les systèmes de traitement de données basés sur l'IA « Lavender », « Gospel » et « Where's Daddy », développés et utilisés par les forces d'occupation israéliennes [IOF] dans leur campagne génocidaire contre Gaza, ont attiré l'attention du plus grand nombre, incitant les journalistes à qualifier Gaza de site du premier génocide basé sur l'IA.
La technologie de l'IA aurait été utilisée pour la première fois à Gaza lors de l'assaut israélien de 11 jours en 2021. Pendant le génocide en cours, elle est utilisée pour la première fois pour tuer des Palestiniens à un niveau sans précédent et à un rythme beaucoup plus rapide.
Ces trois systèmes connus identifient des « cibles » pour les frappes aériennes en se basant sur les enregistrements de surveillance de masse des Palestiniens de Gaza, collectés depuis des années par l'OIF dans le cadre raciste de la surveillance de ce qu'ils considèrent comme des « menaces » pour le régime israélien.
Le système « Gospel » « recommande » des bâtiments et des structures à frapper, tandis que les systèmes « Lavender » et « Where's Daddy » « recommandent » des personnes à tuer et suivent leur localisation pour déterminer le moment où une frappe doit être effectuée.
Ces « recommandations » sont approuvées par l'armée israélienne pour des frappes aériennes sur des zones urbaines civiles densément peuplées, sans pratiquement aucun examen.
Quelques agents des services de renseignement israéliens ont déclaré au magazine +972 qu'ils ne prenaient « personnellement » que 20 secondes pour examiner et approuver la recommandation de frappe aérienne, et qu'ils n'utilisaient ce temps que pour confirmer que la « cible » est un homme.
Il n'est pas certain qu'il s'agisse là d'une politique réelle. En août, cependant, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a publié une déclaration révélant que la majorité des personnes tuées à Gaza sont des femmes et des enfants.
Israël n'essaie pas de procéder à un nettoyage ethnique d'un sexe ou d'un groupe d'âge particulier : il vise tous les Palestiniens. Les mensonges et les justifications entourant la fonctionnalité et la « précision » de ces technologies militaires basées sur l'IA sont destinés à rassurer et à « épater » le monde occidental colonialiste.
C'est ce qui est apparu clairement lorsque les attaques terroristes israéliennes par téléavertisseur ont mutilé, rendu aveugles et tué des milliers de personnes au Liban, alors que d'innombrables journalistes d'organes occidentaux ayant pignon sur rue, louaient les prétendues prouesses technologiques d'Israël.
Ces systèmes d'IA collectent, recherchent et traitent les données acquises par les outils de la surveillance israélienne des Palestiniens à grande échelle.
La reconnaissance faciale de Google Photos, l'appartenance à des groupes WhatsApp, les connexions aux médias sociaux, les contacts téléphoniques et les données cellulaires, entre autres, sont analysés par le système d'IA pour créer une liste de personnes à abattre.
Les soldats israéliens choisissent ensuite de l'approuver pour bombarder des familles et des quartiers entiers. Ils recommencent encore et encore, à un rythme beaucoup plus rapide qu'auparavant.
Grâce aux progrès de la technologie des armes, ces outils sont censés être extrêmement « précis », en ce sens que l'OIF sait exactement qui elle désigne pour le meurtre. Dans la pratique, cependant, ils ciblent délibérément le peuple palestinien dans son ensemble en vue d'un meurtre de masse.
Le système d'intelligence artificielle peut désigner des cibles beaucoup plus rapidement que les humains et l'armée israélienne dispose de tellement de munitions (fournies principalement par les États-Unis) qu'elle s'est lancée dans une folie meurtrière contre les Palestiniens de Gaza.
L'armée israélienne choisit exactement qui tuer, sachant que des quartiers entiers seront réduits en poussière.
Depuis des décennies, Israël contrôle les infrastructures de télécommunications utilisées par les Palestiniens de Gaza (et de toute la Palestine occupée), notamment les lignes téléphoniques et les réseaux de téléphonie mobile et d'Internet.
Helga Tawil-Souri, spécialiste palestinienne des médias, qualifie ce contrôle d'« occupation numérique », car les télécommunications palestiniennes sont surveillées, ralenties et coupées par Israël, à des fins coloniales et génocidaires.
En 2021, une source israélienne de l'unité de renseignement israélienne 8200 a déclaré à Middle East Eye qu'Israël pouvait écouter toutes les conversations téléphoniques ayant lieu en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Ces informations alimentent très certainement les machines à tuer dotées d'une intelligence artificielle qui sont utilisées pour le génocide à Gaza.
Selon des agents anonymes des services de renseignement israéliens qui ont parlé au magazine +972, « rien n'arrive par hasard… Nous savons exactement combien de dommages collatéraux il y a dans chaque maison ». La surveillance israélienne calcule et estime le nombre de civils qui seront tués pour assassiner un membre présumé du Hamas ou du Jihad islamique palestinien avant d'approuver les « cibles » des frappes aériennes.
Comme l'a déclaré un soldat israélien au magazine +972, « les FDI les ont bombardés dans les maisons sans hésitation, comme première option. Il est beaucoup plus facile de bombarder la maison d'une famille. Le système est conçu pour les rechercher dans ces situations. »
Sophia Goodfriend, spécialiste de l'IA et de la surveillance, souligne la responsabilité israélienne dans ces décisions dans +972 Magazine, en écrivant : « Israël ne s'appuie pas sur des armes entièrement autonomes dans la guerre actuelle contre Gaza ; les unités de renseignement utilisent plutôt des systèmes de ciblage alimentés par l'IA pour classer les civils et les infrastructures civiles en fonction de leur probabilité d'être affiliés à des organisations militantes. Cela accélère et élargit rapidement le processus par lequel l'armée choisit qui tuer, générant plus de cibles en un jour que le personnel humain ne peut en produire en une année entière ».
En décrivant le système « Where's Daddy », une source anonyme a déclaré à +972 Magazine : « Vous mettez des centaines [de personnes] dans le système et vous attendez de voir qui vous pouvez tuer ».
Il est confirmé qu'Amazon Web Services fournit des services en cloud et des serveurs qui sont utilisés pour stocker des quantités massives de données de surveillance sur les Palestiniens de Gaza. Ces données de surveillance servent à alimenter les systèmes de « recommandation » de meurtre par l'IA décrits ci-dessus.
En avril 2021, Amazon et Google ont signé avec le gouvernement israélien un contrat de 1,2 milliard de dollars portant sur la technologie de l'informatique en cloud dans le cadre du « Projet Nimbus », qui est mis à profit dans le génocide en cours à Gaza, avec une augmentation significative des achats de services de stockage de données et d'IA auprès de ces entreprises dans le cadre du contrat Nimbus.
Un commandant militaire israélien a également partagé publiquement en juillet 2024 que l'armée utilise actuellement l'infrastructure cloud civile des entreprises Amazon, Google et Microsoft pour étendre ses capacités militaires génocidaires à Gaza.
La société américaine Palantir, spécialisée dans l'exploration de données, est également utilisée pour exploiter des systèmes d'intelligence artificielle pour l'armée israélienne, comme l'a rapporté The Nation.
En janvier 2024, la société a conclu un nouveau « partenariat stratégique » pour fournir au régime israélien des systèmes d'intelligence artificielle afin de traiter les données de surveillance sur les Palestiniens et de les cibler dans les « missions liées à la guerre » actuelle, ce qui inclut sans aucun doute la campagne militaire génocidaire à Gaza.
En janvier, le conseil d'administration de Palantir a également tenu sa première réunion de l'année en Israël, où Alex Karpe, cofondateur et PDG de l'entreprise, a signé dans la foulée l'accord réactualisé avec le ministère israélien de la défense, dans son quartier général militaire.
Palantir est une entreprise américaine qui entretient des liens étroits avec le « contre-terrorisme », les services de police et les opérations militaires des États-Unis.
Son PDG se targue d'être « très bien connu en Israël. Israël apprécie notre produit… Je suis l'un des rares PDG à être publiquement pro-israélien ».
La surveillance n'est pas une nouveauté
La surveillance, un terme qui est entré dans le lexique public aujourd'hui avec ses manifestations numériques expliquées ci-dessus, n'a rien de nouveau. Il s'agit d'un système conçu pour surveiller, contrôler et déposséder les personnes, avec ou sans technologie numérique.
Sous l'occupation britannique de la Palestine avant la Nakba, puis sous l'occupation israélienne, les Palestiniens ont subi une surveillance « low-tech » par le biais de cartes d'identité obligatoires, de registres de population, de points de contrôle, de couvre-feux, de miradors, de frontières artificielles, d'emprisonnements, de murs, et bien d'autres choses encore.
La surveillance a ses racines dans les entreprises coloniales : dans le monde entier, les colonisés savent très bien qu'ils sont surveillés à des fins de contrôle et de dépossession, et de nombreuses pratiques de surveillance biométrique ont été développées et utilisées dans des contextes coloniaux.
Comme l'a écrit le chercheur palestinien Fayez Saygeh en 1965, « pour l'État colonisateur sioniste, exister, c'est préparer et s'efforcer d'étendre son territoire ».
Les technologies de surveillance contribuent à cette expansion en opprimant les Palestiniens et en élargissant la portée de ce qu'Elia Zureik, éminent spécialiste palestinien de la surveillance, a appelé le « regard israélien » sur la vie des Palestiniens.
La surveillance est rarement une simple observation : c'est un outil qui permet le contrôle des mouvements, la violence physique, les déplacements forcés et le génocide.
Zureik a souligné que la surveillance est un outil de pouvoir « intimement lié au processus d'altérisation, par lequel l'affirmation de soi et la construction de l'identité du colonisateur sont configurées sur la base de la stigmatisation et du dénigrement de l'identité de l'autre, le colonisé ».
Les Palestiniens sont censés se sentir constamment observés et surveillés en tant qu'outil du colonialisme sioniste. Il s'agit d'un phénomène de racialisation, ce qui signifie que les Palestiniens se voient attribuer des identités raciales inférieures à celles des colons israéliens, qui sont censés les opprimer et les coloniser par la pratique de la surveillance.
Aujourd'hui, le régime de surveillance high-tech basé sur l'intelligence artificielle poursuit les mêmes objectifs, mais avec encore plus de données collectées abusivement et une capacité technologique accrue à exercer la violence contre davantage de Palestiniens, plus rapidement, grâce à des outils d'intelligence artificielle.
La surveillance actuelle repose sur l'écosystème du « big data », c'est-à-dire la collecte de vastes quantités d'informations sur les Palestiniens occupés à des fins coloniales génocidaires de dépossession.
Ces énormes systèmes de traitement de données basés sur l'IA, tels que « Lavender », sont le reflet direct de l'ère actuelle du « big data ». Les gouvernements, aidés par des entreprises technologiques privées, cherchent à extraire et à exploiter autant de données que possible sur une population afin de l'opprimer.
Mira Yaseen, chercheuse palestinienne en études de surveillance, relie le paradigme du big data à son histoire coloniale. Elle explique à Palestine Square que « les études sur la surveillance négligent souvent les racines coloniales de la surveillance, et lorsqu'elles les reconnaissent, elles semblent ne pas accorder beaucoup d'attention au paradigme du big data, qui reconfigure la surveillance aujourd'hui. »
Elle note que le régime israélien « incorpore de plus en plus de technologies de big data locales dans la gestion de la population », ce qui ne pourrait être plus clair à travers l'utilisation de « Lavender », « Where's Daddy », « Gospel », et de nombreuses autres technologies basées sur l'IA utilisées à travers la Palestine occupée.
Avec un accès illimité à d'énormes quantités de données de surveillance et la capacité rapidement élargie de les analyser à des fins oppressives, Israël a une capacité sans précédent de commettre des génocides et des déplacements forcés en Palestine, ce dont nous sommes témoins en ce moment même à Gaza.
Lors d'une table ronde intitulée « AI in Times of War : Gaza, Automated Warfare, Surveillance, and the Battle of Narratives » (L'IA en temps de guerre : Gaza, la guerre automatisée, la surveillance et la bataille des récits) au Palestine Digital Activism Forum, l'universitaire Matt Mahmoudi a expliqué comment les Palestiniens étaient soumis à leur insu à la technologie de reconnaissance faciale par l'armée israélienne aux points de contrôle situés le long de la route de Salah Al-Din à Gaza.
Cette route a été désignée comme un « itinéraire sûr » par l'armée israélienne dans les premiers mois du génocide pour que les Palestiniens puissent voyager avec tout ce qu'ils pouvaient transporter, parfois pieds nus, avec des corps martyrisés le long de la route, dans un processus de déplacement forcé du nord au sud de la bande de Gaza.
Cette technologie de reconnaissance faciale – créée par la célèbre unité 8200 du cyberespionnage israélien – est exploitée en partie grâce à la technologie d'une société privée israélienne appelée Corsight et de la société américaine Alphabet via Google Photos.
Ces outils permettent d'analyser les visages à partir de photos granuleuses et dans des espaces bondés. Les hommes et les jeunes garçons palestiniens déplacés qui ont été « identifiés » et désignés comme militants du Hamas par cette technologie sont ensuite pris en otage par les Israéliens et détenus dans des lieux secrets à Gaza et dans le désert d'Al-Naqab (Néguev), où ils sont soumis à d'horribles tortures, notamment des violences sexuelles, des tortures médicales puis des meurtres.
Les essais d'armes expérimentales se font à foison dans ce contexte colonial. De nombreuses technologies de surveillance israéliennes sont d'abord utilisées à Gaza et en Cisjordanie, où le régime militaire israélien et le mépris génocidaire pour la vie des Palestiniens permettent aux entreprises privées de créer des prototypes et d'affiner leurs produits dans le cadre de contrats avec les forces armées israéliennes, avant de les exporter à l'étranger.
La juriste palestinienne Samera Esmeir a commenté l'attaque israélienne meurtrière de huit jours contre Gaza en 2012, qui a tué plus de 165 Palestiniens, dont 42 enfants, tout en rendant le siège – en vigueur depuis 2006 – encore plus contraignant.
Elle avait établi que « la transformation de Gaza en un laboratoire pour l'hégémonie coloniale et impériale dans la région est faite en Israël ».
Cet assaut avait vu la première utilisation documentée de la technologie anti-missile Iron Dome, fournie par les États-Unis.
Elias Zureik a beaucoup écrit sur la nature expérimentale de la surveillance des Palestiniens, s'appuyant sur l'idée d'Aimé Césaire de « l'effet boomerang » pour affirmer que « au-delà de la circulation des technologies et des stratégies de surveillance d'un espace colonial à l'autre, les méthodes adoptées pour surveiller les groupes marginaux et minoritaires perçus comme une menace pour l'État, sont finalement étendues à la majorité, et celles développées dans les colonies font leur retour dans la métropole. »
C'est ce que montrent les outils de surveillance coloniale tels que Pegasus, créé par le groupe israélien NSO, qui est aujourd'hui utilisé dans le monde entier pour pirater les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les militants.
Cisjordanie
Dans la ville occupée d'al-Khalil (Hébron) en Cisjordanie occupée, où les colons israéliens ont pris le contrôle de certaines parties de la ville – en particulier la vieille ville et ses environs, qui sont sous le contrôle total de l'armée israélienne – la surveillance de masse des Palestiniens au moyen de l'IA est omniprésent.
Des caméras de télévision en circuit fermé – dotées d'une technologie de reconnaissance faciale – font face aux maisons des Palestiniens à Al-Khalil, tandis que d'autres sont installées de force sur les toits des maisons palestiniennes.
Ces technologies d'intelligence artificielle élargissent la portée et la violence des infrastructures de surveillance déjà existantes, telles que les postes de contrôle israéliens, les tours de surveillance, les cartes d'identité et les permis, ainsi que les routes séparées.
Selon le Washington Post, en 2020, l'armée israélienne a mis en place un nouveau programme de surveillance dans le cadre duquel les soldats israéliens ont reçu l'ordre et ont été incités à collecter de force le plus grand nombre possible d'images de Palestiniens dans la zone occupée d'Al-Khalil, afin de constituer une base de données sur les Palestiniens qu'un ancien soldat a qualifiée de « Facebook pour les Palestiniens ».
Une technologie de smartphone gérée par l'armée, appelée Blue Wolf, est utilisée pour effectuer cette surveillance, et les photos capturées sont ensuite comparées à une base de données d'images.
L'application indique si la personne doit être autorisée à passer, détenue ou arrêtée immédiatement, en utilisant les couleurs rouge, jaune ou verte, ce qui permet aux soldats israéliens de terroriser les Palestiniens en toute impunité.
Blue Wolf serait une version compatible avec les smartphones, d'une base de données militaire plus importante appelée Wolf Pack qui stocke les images, les antécédents familiaux, les indices de sécurité, les informations sur les plaques d'immatriculation, les informations sur les permis et le niveau d'éducation des Palestiniens dans l'ensemble de la Cisjordanie.
L'objectif de ces outils militaires est de collecter et de gérer des informations sur chaque Palestinien de Cisjordanie, afin de maintenir et d'étendre le contrôle colonial.
En 2023, Amnesty International a publié un rapport intitulé « Automated Apartheid » (Apartheid automatisé) qui s'appuyait sur les connaissances antérieures concernant ces technologies basées sur l'IA pour documenter une technologie de surveillance appelée Red Wolf utilisée à Al-Khalil et à Jérusalem. Elle serait liée à Blue Wolf et Wolf Pack.
Red Wolf opère aux points de contrôle de l'IOF dans la zone occupée d'al-Khalil (Hébron), où il scanne et enregistre les visages des Palestiniens à l'aide de la technologie de reconnaissance faciale, incorporant les visages dans de vastes bases de données de surveillance à leur insu ou sans leur consentement, ce qui n'est pas possible avec l'application pour smartphone Blue Wolf.
Red Wolf, qui utilise des mécanismes de reconnaissance faciale, est déployé aux points de contrôle militaires. Les visages des Palestiniens qui traversent sont enregistrés automatiquement sans qu'ils le sachent ou y consentent, alors qu'un soldat de l'OIF prend leur photo pour la faire passer dans une base de données.
Ce programme est utilisé pour déterminer si un Palestinien doit se voir refuser le passage ou être détenu au poste de contrôle.
Des chercheurs tels que Rema Hammami ont beaucoup écrit sur la façon dont les points de contrôle israéliens – qui contrôlent les mouvements des Palestiniens dans toute la Palestine occupée – fonctionnent comme des « technologies coloniales » pour faciliter la « gestion biopolitique des populations autochtones [qui] est fondamentalement motivée par les logiques nécropolitiques d'élimination ».
À Jérusalem occupée, la surveillance par l'IA est omniprésente.
Amnesty International a recueilli des informations sur des milliers de caméras de télévision en circuit fermé utilisées dans la vieille ville et faisant partie d'un système de vidéosurveillance appelé « Mabat 2000 », contrôlé par l'OIF, équipé d'une technologie de reconnaissance faciale et opérationnel dans la partie occupée de Jérusalem-Est.
Ce système a été mis en place en 2000 et a été amélioré en 2018 pour inclure des capacités de surveillance biométrique, telles que la reconnaissance d'objets et de visages.
Amnesty International a constaté qu'il y avait une à deux caméras de vidéosurveillance tous les cinq mètres dans la géographie de Jérusalem-Est occupée, et Euro-Med Monitor rapporte que les caméras de vidéosurveillance couvrent 95 % de cette zone.
Dans les quartiers de Sheikh Jarrah et de Silwan, le nombre de caméras de vidéosurveillance a augmenté rapidement au cours des trois dernières années, le gouvernement israélien cherchant à expulser de force les Palestiniens de leurs maisons pour permettre aux colons de s'emparer de leurs propriétés.
Un rapport publié en 2021 par l'organisation palestinienne de défense des droits numériques 7amleh, comprend des entretiens avec des Palestiniens de Jérusalem occupée et fait état d'un sentiment commun d'être constamment surveillés, même à l'intérieur de son domicile.
Ils ont indiqué que cette surveillance était assurée par des caméras de vidéosurveillance ainsi que par le contrôle des médias sociaux par l'armée israélienne, en particulier par la cyberunité israélienne, créée en 2015. Elle travaille avec les entreprises de médias sociaux pour supprimer les contenus palestiniens.
En 2021, un jeune Palestinien de Silwan a déclaré à 7amleh qu'en plus du siège physique et de la surveillance, « nous sommes également soumis ici à un siège électronique ». Ce siège électronique n'a fait que se renforcer pendant le génocide en cours à Gaza, qui a conduit à une escalade des arrestations de Palestiniens dans toute la Palestine occupée pour avoir publié des messages sur les médias sociaux au sujet du génocide.
Les algorithmes de « modération » de contenu automatisés et alimentés par l'IA suppriment de manière démesurée le contenu palestinien à l'échelle mondiale, des algorithmes que Jillian York a qualifiés de « boîte noire » lors de son intervention au PDAF organisé par 7amleh au début du mois de juin 2024.
L'experte palestinienne en droits numériques Mona Shtaya documente le fait que, pendant le génocide en cours à Gaza, Meta « supprime activement le contenu palestinien qui cherche à documenter les violations des droits de l'homme en Palestine, comme les preuves enregistrées relatives à l'attentat à la bombe de l'hôpital arabe al-Ahli » et interdit de manière flagrante et disproportionnée le contenu sur la Palestine.
L'IA générative – une technologie qui émerge et se développe rapidement et qui utilise des données d'apprentissage pour générer des résultats tels que des images, des textes, des conversations et autres – a également été discriminatoire à l'égard des contenus palestiniens.
Lors d'une table ronde intitulée « Generative AI : Dehumanization & Bias Against Palestinians & Marginalized Communities » (IA générative : déshumanisation et partialité à l'égard des Palestiniens et des communautés marginalisées) au PDAF, M. Shtaya a expliqué que les résultats générés par l'IA des chatbots – tels que ChatGPT ou les autocollants WhatsApp générés par l'IA – « manipulent l'opinion publique » avec des contenus négatifs sur les Palestiniens, alimentant ainsi des campagnes de désinformation qui favorisent le génocide.
Shtaya a insisté sur le fait que « les médias sociaux et les plateformes technologiques n'investissent pas suffisamment de ressources pour lutter contre la désinformation […] afin de limiter ou d'interdire les préjudices technologiques causés par le contenu généré par l'IA ».
Shahd Qannam et Jamal Abu Eisheh écrivent dans le Jerusalem Quarterly sur la façon dont la surveillance israélienne des Palestiniens à Jérusalem en particulier, est essentielle à la vision coloniale d'éliminer les Palestiniens de l'ensemble de Jérusalem et de la Palestine colonisée.
Ils écrivent : « Les domaines numériques et en ligne sont des espaces qui deviennent des sites de lutte entre la logique coloniale éliminatoire et la résistance indigène à l'effacement. Après tout, c'est le territoire qui est au cœur du colonialisme de peuplement, et dans la mesure où l'espace numérique est un territoire, il est essentiel d'examiner les pratiques de domination d'Israël sur cet espace ».
En éliminant les voix palestiniennes des espaces en ligne, Israël cherche à éliminer complètement les Palestiniens.
Des entreprises israéliennes ont même créé un algorithme utilisé par l'OIF pour surveiller et détenir des Palestiniens sur la base de leurs publications sur Facebook.
Il s'agit d'un algorithme prédictif, c'est-à-dire qu'il recherche les messages censés « inciter à la violence », ce qui inclut les photos de martyrs ou de Palestiniens emprisonnés.
Qannam et Abu Eisheh expliquent également comment Israël a mis en place le « Projet biométrique israélien » en 2009, une initiative visant à imposer des cartes d'identité numériques pour créer une base de données contenant les informations biométriques des résidents d'Israël, y compris les résidents palestiniens de Jérusalem occupée.
Ces cartes d'identité numériques doivent être renouvelées auprès du ministère israélien de l'intérieur et peuvent être révoquées pour priver les Palestiniens de leur droit de résidence à Jérusalem.
En résumé, la collecte massive de données est un moyen de surveillance et de contrôle utilisé pour intensifier l'élimination des Palestiniens par les colons.
L'échange mortel de technologies
Le système automatique ShotSpotter de détection acoustique des coups de feu par IA – une « technologie de police de précision » – de la société américaine du même nom, a bénéficié d'un contrat avec la police israélienne en 2021, révélant une volonté coloniale transnationale d'automatiser l'oppression.
Ce système permet d'étendre la portée du contrôle carcéral et colonial contre les Palestiniens, à la fois depuis la terre et le ciel. Créé à l'origine pour surveiller et contrôler les Noirs américains, cet outil a également été jugé utile pour opprimer les Palestiniens.
Le communiqué de presse de ShotSpotter du 16 décembre 2021 concernant le contrat se lit comme suit : « ShotSpotter est ravi de s'associer à Airobotics pour développer un nouveau marché et aider les forces de l'ordre israéliennes à répondre plus rapidement et plus précisément aux incidents de tirs », a déclaré Ralph A. Clark, président et directeur général de ShotSpotter.
Dans ce contexte hautement militarisé, l'ajout de drones – par le biais de son partenariat avec la société Airobotics – pour fournir des « informations visuelles critiques aux premiers intervenants qui sont en route » vers les lieux des coups de feu déterminés par les capteurs acoustiques au sol est remarquable, en raison de la façon dont il exacerbe la militarisation de l'espace par le biais de la surveillance visuelle.
Le régime israélien est le premier au monde à autoriser le vol de grands véhicules aériens sans pilote dans l'espace aérien civil. Cette décision a été approuvée en 2022 par le ministère israélien des transports lorsqu'un drone créé par le fabricant d'armes israélien Elbit Systems a été autorisé à voler dans l'espace aérien civil.
Cette décision met en évidence la nature hyper-militarisée et paranoïaque de la société coloniale israélienne. Airobotics se présente comme la première entreprise au monde à développer une « solution de drone sans pilote » qui ne nécessite pas de pilote humain ou de surveillance manuelle, ce qui est particulièrement utile en Palestine occupée.
ShotSpotter est destiné à être déployé dans les « zones urbaines israéliennes », un terme vague qui banalise la colonisation israélienne en cours et l'expansion des colonies sur les décombres des quartiers palestiniens de la Cisjordanie occupée. Il n'existe aucune information publique sur les villes dans lesquelles ShotSpotter est utilisé.
L'économie coloniale d'Israël est liée à la violence de l'IA
Ruha Benjamin, spécialiste du racisme et de la technologie, écrit que le confinement des groupes racialisés et colonisés permet l'innovation technologique.
Gaza est totalement assiégée depuis 2006, ce qui a transformé la bande de 40 kilomètres de long en un immense camp de concentration.
La Cisjordanie est sous occupation militaire depuis des décennies, et la surveillance, le contrôle et le meurtre systématique des Palestiniens occupés ont considérablement augmenté au cours de l'année écoulée.
Dans le même temps, depuis 2016, Israël détient le plus grand nombre d'entreprises de surveillance par habitant dans le monde, avec plus de 27 entreprises dédiées, dont le tristement célèbre groupe NSO qui a créé le logiciel invasif Pegasus et a exporté pour plus de 6 milliards de dollars de produits et de services depuis 2014.
Parce qu'Israël est un régime colonialiste hautement militarisé, la surveillance est un investissement clé à la fois pour l'État et pour le secteur privé. Contrairement à de nombreux autres pays, le secteur israélien de la surveillance repose à la fois sur la demande locale et sur les exportations.
Au début des années 2000, pendant le boom des télécommunications et la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis, les services de renseignement israéliens ont consulté des experts en sécurité et des PDG du secteur technologique des États-Unis afin d'étendre et de privatiser de manière significative l'appareil de renseignement israélien en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza.
L'unité 8200 a mis au point le « système Lavender », le programme de reconnaissance faciale utilisé aux points de contrôle de Gaza, et probablement de nombreux autres outils et algorithmes d'intelligence artificielle.
Il existe également des exemples d'échange de pratiques carcérales entre les États-Unis et Israël, avec des policiers, des militaires et des patrouilleurs frontaliers américains qui s'entraînent en Israël. C'est ce que l'on appelle « l'échange mortel ».
À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les systèmes de surveillance d'Elbit sont en cours de déploiement.
Les Émirats arabes unis ont également investi des milliards de dollars dans des entreprises israéliennes de technologies de sécurité et de systèmes d'armement avancés, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Selon l'universitaire Sophia Goodfriend, il y a toujours eu une relation inextricable entre le secteur technologique privé et l'OIF, ce qui est très bénéfique pour les objectifs coloniaux du régime israélien.
De nombreuses technologies de surveillance israéliennes sont d'abord utilisées à Gaza et en Cisjordanie, où l'occupation militaire israélienne et le mépris de la vie des Palestiniens permettent aux entreprises privées de prototyper et d'affiner leurs produits par le biais de contrats avec l'IOF, avant de les exporter à l'étranger.
Certaines entreprises américaines sont également directement impliquées dans l'oppression des Palestiniens (comme indiqué dans cet article), ce qui les rend complices de la dépossession des Palestiniens.
Cependant, il existe très peu de rapports sur ces outils d'intelligence artificielle et sur la manière dont ils sont utilisés contre les Palestiniens, en particulier à des fins génocidaires.
Le développement et le déploiement de ces outils dans le cadre d'un génocide contre les Palestiniens, sont les résultats logiques d'un projet sioniste de colonisation. Nous devons les dénoncer comme tels.

Ne désespérez pas : Trump n’est pas invincible

La réélection de Donald Trump est une terrible nouvelle pour les classes populaires aux États-Unis, en particulier pour les minorités et les immigré-es. Mais, comme l'indique Eric Blanc dans cet article, succomber au désespoir profite nécessairement à l'extrême droite et risque de gâcher les occasions pour la gauche de stopper Trump.
Tiré de la revue Contretemps
15 novembre 2024
Par Eric Blanc
Après avoir passé quelques jours en état de choc, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à ce qui n'a pas fonctionné mardi et à la manière dont nous pouvons vaincre le trumpisme. J'écris ce texte pour insister sur le fait que les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises.
1.
Blâmerles élites du Parti Démocrate. La défaite de mardi dernier est ce qui arrive lorsque vous laissez les travailleurs de côté pendant des décennies, de l'ALENA de Bill Clinton à l'austérité de Barack Obama, en passant par le tournant de Chuck Schumer vers les professionnels des banlieues aisées et l'offensive contre le mouvement de Bernie Sanders en 2016 et 2020.
Incapables d'examiner sérieusement les défauts du Parti Démocrate, de nombreux libéraux élitistes accusent déjà les gens ordinaires, affirmant que la plupart des Américains sont irrémédiablement victimes d'un lavage de cerveau ou de préjugés. Mais si c'était vrai, il est difficile d'expliquer pourquoi les Américains ont élu Barack Hussein Obama en 2008.
Les Démocrates prétendent également qu'ils doivent revenir au « centre » parce que les politiques intérieures et les nominations relativement progressistes de Joe Biden n'ont pas porté leurs fruits sur le plan électoral. Mais après des décennies d'abandon des travailleurs par les démocrates, ces mesures étaient trop peu et trop tard.
Si les sénateurs Joe Manchin et Kyrsten Sinema n'avaient pas bloqué un ambitieux programme « Build Back Better » capable d'apporter des améliorations visibles dans la vie de la plupart des gens, et si Biden avait été capable d'enchaîner des phrases cohérentes, il n'est pas inconcevable que la trajectoire politique récente de notre pays aurait pu être différente.
Il était suicidaire de lancer la candidature de Biden malgré sa démence sénile et son impopularité. Les experts ont félicité Nancy Pelosi et ses collègues de l'avoir finalement écarté, mais il est inexcusable qu'ils ne l'aient pas fait un an plus tôt et qu'ils n'aient pas permis l'organisation d'une véritable primaire.
La seule chance que les Démocrates avaient de gagner en 2024 était de présenter une personne extérieure à l'administration Biden, probablement quelqu'un comme Gretchen Whitmer. Et même si Bernie Sanders était trop vieux cette fois-ci, il convient de se rappeler qu'il a conquis exactement les personnes dont Harris a eu le plus grand mal à obtenir le vote : les travailleurs à travers le pays, les Latinos et les adeptes de Joe Rogan.
2.
L'inflation a gravement nui auxgouvernements en place dans le monde entier. Mais leur défaite électorale n'est pas une loi d'airain. Malgré l'inflation généralisée, le Mexique a par exemple réélu son gouvernement de gauche parce que celui-ci a fait beaucoup en faveur des travailleurs (et bien communiqué en ce sens).
3.
La triste vérité est que les dirigeants syndicaux – à quelques exceptions notables près – n'ont pas su saisir l'occasion exceptionnellement favorable à la syndicalisation de masse créée par un marché du travail tendu, un Conseil national des relations professionnelles (National Labor Relations Board) favorable aux travailleurs et une revitalisation de la base menée par de jeunes travailleurs radicalisés.
Les dirigeants syndicaux, peu enclins à prendre des risques, ont pour la plupart continué à faire comme si de rien n'était, s'asseyant sur des milliards de dollars qui auraient pu être utilisés pour lancer et soutenir des initiatives de syndicalisation interprofessionnelleà grande échelle.
Si la plupart des syndicats avaient massivement investi dans la syndicalisation après 2020, la carte politique aurait pu s'en trouver considérablement modifiée. Non seulement les syndiqués continuent de voter davantage pour les Démocrates, mais les campagnes et les grèves syndicales très médiatisées polarisent l'ensemble du pays autour du conflit de classe (au lieu des guerres culturelles prisées par la droite), permettant de dévoiler le populisme fallacieux des Républicains.
Faire l'expérience directe de la solidarité et du pouvoir collectif est le meilleur antidote à la recherche de boucs émissaires. Il n'est pas possible de vaincre l'extrême droite sans travailler à élargir et transformer le mouvement ouvrier.
4.
Il sera plus difficile pour les travailleurs de s'organiser dans leurs entreprises sous Trump, mais ce sera loin d'être impossible. Nous devrions nous rappeler que l'essor actuel du mouvement ouvrier a commencé avec les grèves des enseignants des États républicainsen 2018, qui ont permis d'obtenir des gains importants contre les gouvernements républicains de ces États.
5.
Le financement du génocide par l'administration Biden-Harris n'a pas fait perdre cette élection à l'échelle nationale, mais c'est une raison essentielle pour laquelle elle a perdu une course extrêmement serrée dans le Michigan. Pour amener un grand nombre d'hommes politiques à soutenir un embargo sur les armes à destination d'Israël, nous devons organiser beaucoup plus de manifestationssur cette question, et ne pas nous contenter de mobiliser les personnes déjà convaincues.
6.
L'élection de Trump est un coup dur pour la démocratie et les travailleurs aux États-Unis et dans le monde, en particulier pour les plus marginalisés. Mais nous ne devons pas désespérer. Il y a de bonnes raisons de penser que cela pourrait ressemblerà l'élection de George W. Bush en 2004 – qui a rapidement suscité des réactions négatives menant à la victoire d'Obama – plutôt qu'à l'élection de Ronald Reagan en 1980, qui a inauguré une longue ère de politiques conservatrices.
D'un point de vue historique, Trump n'a pas gagné cette élection avec beaucoup d'avance. Il a obtenu à peu près le même nombre de voix que la dernière fois, tandis que Mme Harris a perdu parce qu'elle a obtenu environ 14 millions de voix de moins que M. Biden en 2020. En outre, les électeurs qui ont voté pour Trump espéraient pour la plupart qu'il leur apporterait la prospérité, un scénario peu probable compte tenu des politiques soutenues par les milliardaires soutenant Trump et de la volatilité d'un ordre néolibéral mondial en train de s'effondrer.
7.
En temps de crise, les gens recherchent des récits convaincants qui expliquent pourquoi ils sont en difficulté. La droite fait un excellent travail pour rassembler des personnes autour de sa vision réactionnaire du monde tout au long de l'année (et pas seulement pendant la saison électorale), en particulier grâce à une propagande concertée dans les médias et les réseaux sociaux. Parce que les élites démocrates n'ont aucun intérêt à promouvoir le seul contre-récit convaincant – blâmer les milliardaires – la gauche doit trouver des moyens de mieux (et plus largement) développer notre vision du monde en direction de millions de personnes, en ligne et au-delà.
8.
Même si les deux candidats étaient assez impopulaires, et malgré les horreurs soutenues par Biden à Gaza et au Liban, la marginalité totale des candidats du troisième parti en 2024 confirme qu'il y a peu d'espace pour construire un troisième parti de gauche dans notre régime électoral actuel. Mais la campagne sénatoriale de Dan Osborn dans le Nebraska suggère que des campagnes indépendantes, sur la ligne d'un populisme économique (1), devraient être tentées à nouveau dans les régions républicaines profondes et dans d'autres arènes, sans être accusées de prendre des voix favorisant l'élection d'un candidat réactionnaire.
9.
La plus grande erreur commise par la gauche au cours de ce cycle a été, et de loin, de ne pas présenter de candidat viable lors des primaires présidentielles. Nous avons oublié la principale leçon de Bernie 2016 et 2020. En l'absence d'une tribune de gauche dans la compétition politique la plus importante de notre pays, nous avons été condamnés à être soit des critiques marginaux extérieurs, soit des partenaires subalternes et acritiques de Biden-Harris.
Cette abstention a laissé plus d'espace aux élites démocrates pour marginaliser le populisme économique (et pour ignorer le sentiment anti-guerre largement répandu). Nous ne pouvons pas refaire cette erreur en 2028.
10.
Il est inquiétant que de nombreux libéraux hostiles à Trump semblent se résigner cette fois-ci – mais il est bon que la gauche socialiste soit toujours prête à se battre et que nous soyons mieux organisés aujourd'hui qu'en 2016. Le plus urgent, c'est que nous avons un rôle clé à jouer en aidant à lancer de grandes manifestations de masse dans le cadre d'un front uni, capables de rassembler tous ceux et toutes celles qui s'opposent aux horreurs de Trump.
L'échec du Parti Démocrate est une opportunité majeure pour recruter des centaines de milliers de personnes au sein du mouvement socialiste démocratique. Mais pour ce faire, nous devons rapidement nous détourner des débats internes et de la tendance à trop s'inquiéter de savoir si nous sommes suffisamment radicaux. En lieu et place, nous devrions davantage chercher à nous faire entendre de nos collègues, voisins et amis, de nous connecter à elles et eux, et de recruter. La campagne de Zohran Mamdani pour la mairie de NewYork est une occasion importante et, espérons-le, inspirera d'autres campagnes électorales socialistes dans tout le pays.
Nous surmonterons tout cela collectivement, et non en tant qu'individus isolés. J'avais mal au ventre et j'étais désespérée jusqu'à ce que je me rende à une réunion du Comité d'organisation d'urgence sur le lieu de travail (EWOC) mercredi, qui m'a donné une bouffée d'espoir dont j'avais bien besoin.Rejoindre les Socialistes Démocratiques d'Amérique (DSA) et organiser les gens sur votre lieu de travail avec l'aide de l'EWOC vous donnera ce même sentiment. A luta continua.
Références
1. Cette ligne consiste pour l'essentiel dans la critique des riches et l'appel à modifier la répartition des richesses en faveur de la classe travailleuse.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump prend le commandement et la résistance a commencé

Le président élu Donald Trump a déclaré dans son discours de victoire que « l'Amérique nous a donné un mandat puissant et sans précédent ». Bien que cela ne soit pas vrai. Obama avait remporté en 2008 une victoire bien plus importante avec 53 % du vote populaire et 365 mandats de grands électeurs.
Hebdo L'Anticapitaliste - 729 (14/11/2024)
Par Dan La Botz
Crédit Photo
Wikimedia Commons
Trump va tenter néanmoins de gouverner en autocrate, en imposant sa volonté à la nation. Il reste à voir si ses projets autoritaires déboucheront sur le fascisme, mais la gauche commence à résister.
Nous pouvons nous attendre à ce qu'il commence par tenir les promesses qu'il a faites à sa base ouvrière et de la classe moyenne, ainsi qu'à ses partenaires milliardaires, tels que le magnat de la technologie Elon Musk et le chef d'Amazon Jeff Bezos.
Fermeture des frontières annoncées
Il a promis aux travailleurEs de fermer la frontière et de procéder à une déportation massive des immigréEs sans-papiers qui, selon lui, prennent les emplois des AméricainEs et font régner la violence dans leurs communautés. Il y a aujourd'hui 22 000 agents de la USBP (US Border Patrol). Pour sceller la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui s'étend sur 3 145 kilomètres, il faudra davantage que les 22 000 agents actuels de la BP. Trump affirme qu'il mobilisera la Garde nationale pour compléter les effectifs de la BP, mais il aura besoin de l'autorisation des gouverneurs des États et tous ne la donneront pas.
Trump a promis d'expulser les quelque 12 millions d'immigréEs sans-papiers, mais les rassembler et les expulser serait un travail énorme qui coûterait des millions et nécessiterait bien plus que les 21 000 agents de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) existants. Les familles seront déracinées et brisées et il y aura de la résistance. Ces politiques auraient un impact énorme et désastreux sur l'économie américaine, car de nombreux immigrantEs travaillent dans la construction, l'hôtellerie et la restauration, les soins aux personnes âgées et aux enfants, le nettoyage, le jardinage, l'agriculture et d'autres secteurs.
Libéralisation, protectionnisme et carbo-capitalisme
Trump prévoit de prendre davantage le contrôle du gouvernement américain, en commençant par mettre fin aux protections de la fonction publique pour des centaines de milliers d'employéEs fédéraux, qui deviendraient des employéEs de contrat privé, susceptibles d'être licenciéEs à tout moment. Il affirme qu'il réorganisera le ministère de la Justice et l'utilisera pour poursuivre ses ennemis politiques.
Sur le plan économique, Trump a promis de nouvelles réductions d'impôts comme il l'a fait en 2017, et il ne fait aucun doute que ce sont les riches qui en bénéficieront le plus. S'il le fait, cela coûtera au gouvernement 4 000 milliards de dollars de recettes au cours de la prochaine décennie. Il a également déclaré qu'il réduirait les impôts sur les prestations de sécurité sociale (retraite) des travailleurEs et les taxes sur les pourboires des travailleurEs.
Trump propose des droits de douane de 10 % sur la plupart des marchandises, mais de 60 % sur les produits chinois et même de 200 % sur les voitures chinoises. Ces tarifs augmenteraient les prix pour les AméricainEs et perturberaient le commerce et les investissements mondiaux.
Trump annulera les politiques climatiques du président Joe Biden en réduisant les subventions aux énergies vertes et en incitant les compagnies pétrolières à forer pour trouver du pétrole. Il annulera également les politiques pro-travail de Joe Biden.
Résistance et répression possible
La résistance à Trump, qui s'est manifestée pour la première fois lors de la Marche des femmes à l'occasion de son investiture en 2016, s'est ravivée. Des manifestations de centaines de personnes dirigées par la gauche ont eu lieu après son élection à Seattle, Portland, Berkeley, Milwaukee, Chicago et Philadelphie. Le 9 novembre, plus d'un millier de personnes d'organisations syndicales, environnementales, féministes et d'immigréEs ont défilé à New York.
Une nouvelle coalition nationale de plus de 200 organisations s'est formée sous l'impulsion du Working Families Party, de Seed the Vote, du Movement for Black Lives et de Showing up for Racial Justice. Le groupe a organisé un appel de masse/livestream intitulé « Making Meaning in the Moment » (« Donner un sens au moment présent »), auquel 140 000 personnes ont participé sur internet.
Comme l'a écrit un participant, « l'opinion dominante était la résistance totale à l'administration Trump et le recentrage des progressistes dans la classe ouvrière multiraciale et inclusive du point de vue du genre ».
Si le mouvement de protestation devient massif dans les rues, Trump s'est dit prêt à invoquer la loi sur l'insurrection de 1792, qui autorise le président à utiliser l'armée américaine sur le territoire des États-Unis pour réprimer une rébellion ou des violences.
Trump est un autoritaire. Va-t-il créer un parti et un État fascistes ? Nous ferons tout pour l'en empêcher.
Dan La Botz, traduit par la rédaction
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les démocrates ont délaissé les travailleurs.euse pauvres

Le Révérend William Barber parle des soins de santé, de salaire décent et des droits de vote
Democracy Now, 8 novembre 2024,
Traduction, Alexandra Cyr
Amy Goodman : Donald Trump et ses alliés.es ont célébré leur victoire électorale et appelé à la mise en place de la politique d'extrême droite qui va couvrir tout le gouvernement fédéral et connue sous le nom de Project 2025. Les Républicains.nes ont aussi gagné la majorité au Sénat et probablement à la Chambre des représentants.
(…) Nous commençons à examiner les erreurs des Démocrates avec Monseigneur William Baber 11, vice-président national de la Poor People Campaign. Elle a travaillé à faire sortir le vote chez les résidents.es à bas revenus qui sont souvent ignorés.es mais constituent un bloc impressionnant. Mgr Barber est aussi un conférencier à Repairers of the Breach et le fondateur et directeur du Center for Public Theology and Public Policy à la Yale Divinity School. Il est le co-auteur d'un dernier livre : White Poverty : How Exposing Myths About Race and Class Can Reconstruct American Democracy.
Mgr Barber soyez à nouveau le bienvenu sur Democracy Now. Parlez-nous d'abord de ce que vous pensez est arrivé dans cette élection. Que répondez-vous à la Présidence de D. Trump ? Et qu'elles ont été les erreurs des Démocrates selon vous ?
Mgr William Barver 11 : Merci Amy. Je me suis levé ce matin en étant capable de dire « Democracy Now » !
Nous sommes face à de nombreuses questions sur lesquelles nous devons nous acharner en profondeur. Nous ne pouvons être désinvoltes ou ne faire que réagir spontanément en ce moment. Nous devons faire face au fait que les États-Unis ont souvent fait de mauvais choix qu'ils payent plus tard. Nous devons faire face au fait que ce sont 71 millions, 72 millions de personnes qui ont choisi de renvoyer D. Trump à la Maison blanche en dépit de son langage vitriolique, de sa haine, de son retour en arrière, de ses outrances racistes et d'une tendance vers le fascisme. Nous ne savons probablement pas ce qu'il va faire exactement mais il peut le faire à un point tel que même ses partisans.es en seront plus offensés.es et si terriblement qu'ils et elles demanderont : « Qu'avons-nous fait » ?
Nikole Hannah-Jones (journaliste américaine qui s'intéresse aux droits civiques et a gagné un prix Pullitzer. N.d.t.) a dit quelque chose l'autre jour que j'ai partagé avec ma vice-présidente, Lez Theoharis. Elle nous a rappelé que 60 ans après la première tentative des États-Unis en faveur de la reconstruction en 1920, juste après l'élection de 1918, excusez-moi, de 1865-1866 environ, la majorité des Américains.es se sont retournés.es et ont embrassé la suprématie blanche. Et si vous y réfléchissez, nous somme en ce moment, 60 ans après les années 1960, après la White Southern Strategy (stratégie républicaine pour s'attacher le vote de la population blanche du sud en instant sur le racisme contre les Noirs.es. n.d.t.).
Qu'avons-nous vu il y a deux jours ? Il faut nous poser une profonde question. Nous avons vu la plupart des Américains.es voter, mais beaucoup ne l'ont pas fait. D. Trump a gagné 2 à 3 millions de voix de moins qu'en 2020. Mme Harris a récolté 13, 14 millions de voix de moins que J. Biden ne l'avait fait en 2020. Ils ont ramassé 81 millions de votes. Beaucoup de gens n'ont pas voté.
Et pourquoi ? Nous savons qu'en 2020, J. Biden et K. Harris ont mis l'accent sur le salaire minimum et sur le droit de vote. Ils ont récolté 56% des voix de ceux et celles qui gagnent moins de 50,000$ pour une famille de quatre. Cette année, les sondages à la sortie des urnes montrent que c'était 49% contre 49%. Le score de D. Trump a augmenté, celui des Démocrates a diminué. Et voilà la question : pourquoi ? Nous sommes-nous suffisamment centrés sur les 30 millions de pauvres, ceux et celles qui vivent avec de bas salaires, ceux et celles qui ne votent pas souvent mais qui tiennent les clés du plus grand vote pivot du pays ? Ces personnes sont environ 12 millions dans le pays.
Nous devons nous confronter à de sérieuses questions. Par exemple, est-ce que les femmes blanches qui sont en faveur de l'avortement auraient aussi voté pour D. Trump, choisi D.Trump ? Elles sont avec K. Harris sur les questions d'avortement mais pas pour la Présidence. Où les hommes hispanophones sont-ils allés ? Nous avons beaucoup à faire. Pourquoi les enjeux les plus endossés par le public, ceux relatifs aux soins de santé, au salaire décent, aux droits de vote, à la démocratie, n'ont-ils pas été plus à l'avant plan ? Et pourquoi des personnes choisiraient de voter contre, contre ce pourquoi un pourcentage significatif d'autres disent être en accord ? Ce sont des enjeux sérieux.
Ce que nous ne pouvons pas faire en ce moment, c'est de baisser les bras. Je pense que les médias portent aussi une certaine responsabilité. Je n'ai vu dans aucun débat, la pauvreté et les bas salaires être au centre des discussions. Et cela même si 800 personnes décèdent tous les jours à cause de la pauvreté et que plus de 32 millions de personnes travaillent à des salaires qui ne permettent pas de vivre. Le salaire minimum n'a pas été augmenté depuis 2009. Rien dans les débats les plus importants à ce sujet au Congrès. Pourquoi les Démocrates n'ont-ils pas amené l'augmentation du salaire minimum au Sénat avant l'élection et ainsi forcer un vote qui aurait rendu visible la position des Républicains.nes à ce sujet crucial ? Mais partout où cette augmentation du salaire minimum et des congés payés pour les familles étaient mis aux voix, ils ont gagné ; au Missouri, en Alaska et d'autres endroits semblables. Nous avons de sérieuses questions à nous poser.
Aussi, finalement, je voudrais soulever quelque chose. Quelqu'un a dit que D. Trump avait un mandat. Personne n'a de mandat pour renverser la Constitution. Personne n'a de mandat pour aller de l'avant avec quelque chose comme le Project 2025, pour essayer de nous pousser vers l'arrière et de détruire le progrès. Personne n'a de mandat pour nous empêcher de nous adresser aux personnes qui meurent littéralement à cause des ravages de la pauvreté. Personne n'a de mandat pour dire que nous allons retirer à des gens les soins de santé.
Nous devons nous lever chaque matin à partir de maintenant et jusqu'à … avec chaque outil non violent à notre disposition et nous opposer à n'importe quelle régression peu importe qui est au pouvoir. J'ai réfléchi à ça. Quand l'arrêt Plessy c. Ferguson (où la Cour suprême décrétait que la ségrégation raciale n'était pas illégale. N.d.t.) a été décrété en 1896, les militants.es ont choisi le slogan : séparés mais égaux ». La bataille a duré 58 ans jusqu'à la victoire. Ils et elles se sont levés.es et ont continué la bataille. Donc, quand nous nous levons le matin nous devons aller dans ce sens, avoir la même sorte de force que celle que les gens de 1877 ont eue. Il y avait une élection qui pouvait virer les États-Unis à l'envers ; que ce soit en 1896 ou en 1914 quand un suprémaciste blanc est arrivé à la Maison blanche et qu'on a joué Birth of a Nation (référence à un film qui met en vedette des soldats confédérés des États du sud. N.d.t.) dans le bureau ovale ; en 1955 quand le réveil s'est fait avec l'annonce de l'assassinat d'Emmett Till (jeune noir capturé et lynché au Mississipi) ; en 1963, quand quatre petites filles ont été assassinées dans l'église de Birmingham ; en 1963 quand un Président a été assassiné ; en 1968 quand Martin L. King a été assassiné. Les gens ont dû ravaler leurs larmes, garder leur peine à l'intérieur comme leurs frustrations mais, se relever et déclarer que nous devons nous battre pour cette démocratie. Nous n'allons pas partir et disparaitre dans le noir.
A.G. : Je voulais revoir le message du Sénateur B. Sanders : « Nous ne devrions pas être si surpris.es, le Parti démocrate a abandonné la classe ouvrière, pas étonnant qu'elle abandonne ce Parti à son tour. Pendant que la direction démocrate défends le statut quo la population américaine est en colère et veut du changement. Et elle a raison ».
Jaime Harrison, le président du Comité central démocrate a qualifié la déclaration de B. Sander de : « pur B. Sanders » et il a ajouté : « Biden a été le Président les plus en faveur des travailleurs.euses que j'ai vu de ma vie ».
Je voulais aussi que nous nous arrêtions sur le commentaire de David Brooks, le chroniqueur bien connu du New York Times. Son article est intitulé : Les électeurs.trices aux élites. Il écrit : « Me voyez-vous maintenant ? Je suis un modéré. J'aime les candidats.es démocrates qui font campagne au centre. Mais je dois dire que même si K. Harris l'a fait plutôt efficacement, ça na pas donné le résultat voulu. Peut-être qu'il leur faudrait embrasser le style dérangeant de Bernie Sanders, quelque chose qui rende les gens comme moi, inconfortables ».
Pourriez-vous répondre à ça et nous mettre au fait du nombre de personnes dont nous parlons dans ce pays (à ce sujet) ? Bien sûr pas que les nombres. C'est au sujet de ce avec quoi les gens doivent se débattre, des millions de gens partout dans le pays et qui ont pu voter.
B.W.B.11 : D'accord. Amy, nous devons sortir de nos émotions. Nous pouvons critiquer nos politiques, dire que nous avons aidé les gens et que cela ait été cohérant ou non, que la population l'a entendu. Par exemple nous avons besoin de soins de santé, de crédits d'impôts, de crédits d'impôts pour les enfants et nous soutenons tout ça. Et oui nous avons besoin de soins de santé, d'argent pour le logement, pour de nouveaux logements. Nous sommes clairs.es à ce sujet, nous soutenons cela. Mais de dire : « Minute ! Nous devons prendre le temps de voir où nous en étions et où nous allons. Est-ce que c'est un message ? Qu'est-ce que c'est » ? Parce que nous savons que partout dans le pays, par exemple augmenter le salaire minimum, affecterait 32 millions de personnes qui vivent tous les jours sans salaire décent. Par exemple il faut faire face à des prix qui vous mettent dans le trou mais les gens ont besoin d'argent pour acheter des biens, de l'essence, et toutes autres choses. Nous n'avons pas augmenté le salaire minimum, ni les Démocrates ni les Républicains.nes (ne l'ont fait). Nous trainons cet enjeu depuis 15 ans. Nous parlons de 140 millions de pauvres et de personnes qui sont à faibles salaires. Nous parlons d'environ 43% de la population de notre pays qui est pauvre et/ou à faible revenu. Nous parlons d'adultes, de gens qui sont peu ou prou à 500$ de la ruine économique. Nous parlons de 800 personnes qui meurent tous les jours. Ce n'est pas une exagération, nous devons être capables d'en parler.
Et en parler ne veut pas dire qu'un.e candidat.e était de mauvaise foi. L'exercice vise à évaluer ce qui se passe et comment nous allons nous positionner. Par exemple, pourquoi n'avons-nous pas fait un effort déterminant chaque fois que nous avons ouvert la bouche pour dire : « Écoutez, si vous élisez les Démocrates de la Présidence jusqu'à la totalité du Congrès, au cours des 50 premiers jours, nous allons augmenter le salaire minimum à 15$ ou un peu plus ». Nous avons les données. Trois économistes détenteurs du Prix Nobel d'économie ont prouvé qu'augmenter le salaire minimum ne jouerait pas négativement sur l'emploi, ne ferait pas augmenter les taxes et les impôts et ne ferait pas augmenter les prix. Il faut que nous prenions cela au sérieux.
Je connais des gens … nous sommes tous dans nos émotions et c'est normal. Mais ce n'est pas le seul problème. Je serais d'accord avec Jaime sur ça. Ce n'est pas le seul problème. Il y a beaucoup de problèmes. Et nous devons creuser celui-ci. Quel rôle a joué la « race » (dans cette élection) ? Quel rôle y ont joué la sexualité et le genre ? Nous devons prendre au sérieux des enjeux fondamentaux. Même au Mississipi 66% des Républicains.es disent vouloir des soins de santé, et soutiennent l'Affordable Care Act appelé Obamacare. Nous devons voir sérieusement les autres États où, quand le salaire décent figurait sur les bulletins de vote, ce fut approuvé. Nous devons nous assurer que partout dans le pays, ces enjeux soient mis aux voix. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est nous en écarter.
Nous avons une introspection à faire. Nous devons comprendre pourquoi le taux de votes a baissé. Je me souviens, en 2020, quand Biden et Harris étaient en campagne, ils disaient toujours : « Si vous nous élisez, nous allons introduire des salaires décents, l'assurance santé et (consolider) les droits de vote ». 56% des gens gagnant moins de 50,000$ par année les ont soutenus. Et nous devons intégrer le fait qu'une partie de la situation n'est la faute de J. Biden ou de K. Harris. Cela a commencé quand les Démocrates ont mis aux voix (au Congrès), la hausse du salaire minimum à 15$ de l'heure et que 8 de leurs membres se sont joint aux Réublicains.es et ont bloqué cette proposition de loi qui avait été acceptée par la Chambre des représentants. Nous devons prendre conscience qu'il peut y avoir des Démocrates voyous avec leur pouvoir et voter contre quelque chose qui va affecter 55 millions de personnes. Et ce serait encore ce nombre si l'administration Biden-Harris n'avait relevé le salaire minimum des fonctionnaires fédéraux. Alors, vous devenez voyou quand vous êtes au pouvoir et ensuite vous vous présentez devant la population lors des élections en disant : « Nous sommes avec vous ». C'est blessant, des gens meurent ici. Tant que nous ne pourrons pas faire face à la pauvreté et aux bas salaires dans ce pays, cela affectera 66 millions de gens de race blanche. Il est question de 60% de Noirs.es, de 30% de Blancs.hes, de 68% de Latinos.as et de 68% d'Autochtones. Nous ne pouvons faire fi de cet enjeu.
Finalement, nous ne pouvons laisser dire que cet enjeu en est un d'extrême gauche. C'est un enjeu américain, moral. Le niveau de pauvreté et des bas salaires dans ce pays, est une violation de ce que nous reconnaissons dans la Constitution comme l'appel à la justice et à la promotion du bien-être général. C'est dégoutant et condamnable que nous n'en ayons pas eu de suivi dans les médias, dans les couloirs du Congrès et au cours de l'élection. Durant les débats entre les candidats.es, personne ne leur a demandé : « Quelle est votre position sur les enjeux de la pauvreté et des bas salaires ? Quel est votre plan à cet égard ? Et comment allez-vous diriger ce pays » ? Et ce sont des enjeux qui concernent presque 50% de la population. Nous devons y faire face.
Amy, je veux dire une chose : Venice Williams a dit quelque chose dans un poème, je vais vous le lire.
You are awakening to the
same country you fell asleep to.
The very same country.
Pull yourself together
And,
when you see me,
do not ask me
« What do we do now ? Or
« How do we get through the next four
Years ?
Some of my Ancestors dealt with
at least 400 years
under worse conditions ».
Elle a dit :
« Continue to do the good work.
Continue to build bridges and not walls.
Continue to lead with compassion.
Continue to demand
the liberation of all ».
J'ajouterais, continue à sérieusement te battre pour des salaires décents, des soins de santé accessibles et la fin des génocides autour du monde et à Gaza. Continue, continue la lutte pour les droits des femmes, des enfants et pour l'extension des droits de votes.
Quelle portion de cette baisse du vote peut être attribuée au retrait d'électeurs.trices des listes ? Pourquoi est-ce que dans un État comme la Caroline du nord par exemple, les Démocrates candidats.es à des postes divers ont, sans exception, gagné leurs élections mais la candidate à la Présidence a perdu ? Nous devons nous attaquer à de sérieuses questions. Nous ne pouvons nous en remettre à nos émotions. Et il nous faut nous poser ces questions parce qu'il y a de la souffrance ici, les gens sont meurtris, des millions n'ont pas voté du tout. Ils n'ont pas voté. Je veux que ça se sache. Il y a eu une baisse du vote au total. Et nous devons prendre ça très sérieusement.
A.G. : Mgr Barber, je veux vous remercier d'avoir été avec nous. (…)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Élections US – Les chiffres.

Les chiffres de Wikipedia (Page en langue anglaise) donnent une idée exacte des élections US. Ci-dessous, je les arrondis (d'autant que ceux de 2024 ne sont pas complets à 100% à cette heure).
11 novembre 2024 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale
https://aplutsoc.org/2024/11/11/elections-us-les-chiffres-par-vp/
En 2016, il y a presque 109 millions d'abstentions – comme d'habitude jusque là. Du fait du caractère confédéral du pays Trump est élu avec moins de voix que Clinton : près de 63 millions contre 66,85. Jill Stein est à 1,45 million (1,07%).
En 2020, participation historiquement élevée : Biden fait 81,2 millions, Trump 74,2 millions (Howie Hawkins du Green Party 0,4 million). Les abstentions sont tombées à 80,8 millions.
En 2024, il n'y a pas de progression numérique significative de Trump – le fait politique étant bien entendu qu'après avoir tenté un putsch, il est toujours là et que le Parti républicain s'est livré à lui : il fait 74,7 millions (on peut y ajouter les 0,5 million de Robert Kennedy Junior).
C'est le vote démocrate qui baisse : Harris ne fait que près de 71 millions, soit 10 millions de voix de moins que Biden en 2020. Les abstentions remontent à 98 millions et quelques. Stein a 0,64 million (près de 0,4%).
Trump est bien sûr à un niveau élevé mais ce n'est pas un fait nouveau : il n'y a PAS eu de « vague » supplémentaire. Je ne dis pas cela pour que l'on se rassure, mais pour que l'on ne joue pas à se faire peur : il faut partir du réel.
C'est le recul démocrate la clef, que je n'expliquerai pas par les faiblesses de leur campagne car elles sont consubstantielles à la nature, capitaliste et institutionnelle de ce parti, mais par :
1°) le recul du niveau de vie réel depuis 2020,
2°) l'absence d'une mobilisation comparable à Black Lives Matter de 2020, le « mouvement pro-palestinien des campus » y ayant fait obstacle. Numériquement, les abstentions ou votes gauchistes « pour punir Genocide Joe » sont difficiles à évaluer, mais politiquement leur impact électoral global est décisif car il a interdit une mobilisation indépendante pour barrer la route à Trump.
Les courants gauchistes ou liberals (au sens US du terme) qui ont roulé contre « Genocide Joe » ne sont pas ceux d'où peut sortir une alternative ouvrière indépendante : ils sont alliés au capital sous la forme de l'impérialisme multipolaire.
L'alternative indépendante se trouve du côté des forces qui ont appelé au vote Harris malgré tout pour barrer la route à Trump, y compris dans les syndicats où la campagne UAW n'a pas été une campagne pro-démocrate traditionnelle, mais de fait un début de campagne indépendante, se prolongeant maintenant par l'appel à former un pôle ouvrier.
VP, le 11/11/2024.

États-Unis - Une victoire décisive pour les républicains

Donald Trump a remporté une victoire décisive pour lui-même et pour le parti républicain, en prenant la présidence, le Sénat et, semble-t-il, la Chambre des représentants, tandis qu'au cours de son premier mandat, les nominations de Trump ont remodelé la Cour suprême, qui le soutient pleinement.
Hebdo L'Anticapitaliste - 729 (14/11/2024)
Par Dan La Botz
Trump et le parti républicain contrôlent donc les trois branches du gouvernement, ce qui lui donne le pouvoir de mettre en œuvre son programme de droite et de transformer les États-Unis, voire de démanteler leur système démocratique et de supprimer les libertés civiles.
Un vote populaire pour les républicains
Trump a non seulement remporté le collège électoral par 312 voix contre 226, mais il a aussi, pour la première fois, remporté le vote populaire, avec plus de 74,6 millions de voix contre 70,9 millions pour les démocrates. Les républicains ont gagné trois sièges au Sénat américain — Virginie occidentale, Ohio et Montana —, ce qui leur donne la majorité et met fin à quatre années de contrôle par le parti démocrate. Le décompte des voix à la Chambre des représentantEs n'est pas encore terminé, mais les républicains semblent en mesure de l'emporter également.
Le total des voix de Trump n'a pas été écrasant, mais il a continué à bénéficier du soutien de sa base d'électeurEs blancs plus âgés et plus aisés, des électeurEs des banlieues et des zones rurales, et a également trouvé de nouveaux soutiens parmi les électeurEs de la classe ouvrière, les NoirEs, les Latino-AméricainEs et les femmes. Il a obtenu le vote de 56 % des personnes n'ayant pas fait d'études supérieures, de 13 % des électeurEs noirEs et de 46 % des électeurEs latinos. Il a obtenu 45 % des votes des ménages syndiqués. La candidate du parti démocrate Kamala Harris a obtenu moins de voix que le président Joe Biden lors de l'élection de 2020, y compris moins de voix de la part des femmes et des électeurEs noirs. De nombreuses personnes ont estimé que les prix du logement et de la nourriture étaient trop élevés, tandis que d'autres ont été motivées par le message raciste, sexiste et xénophobe de Trump. Des centaines de milliers d'électeurEs du parti démocrate ne se sont tout simplement pas présentés dans plusieurs États, comme l'Ohio. Trump a bénéficié d'un soutien plus important dans 9 comtés sur 10 dans l'ensemble du pays. Bien qu'il n'y ait pas eu de réalignement général, il y a eu un glissement vers la droite dans tout le pays.
Comme l'ont noté les experts, Trump a désormais créé une base ouvrière multiraciale pour le parti républicain. Pendant des décennies, les démocrates ont prétendu être le parti de la classe ouvrière ; aujourd'hui, les républicains leur ont ravi ce titre.
Les démocrates ont abandonné les travailleurEs
Pourquoi les démocrates ont-ils perdu ? Comme l'a écrit Bernie Sanders immédiatement après l'élection, « il ne faut pas s'étonner qu'un parti démocrate qui a abandonné la classe ouvrière s'aperçoive que la classe ouvrière l'a abandonné ». D'abord, c'était la classe ouvrière blanche, et maintenant ce sont les travailleurEs latinos et noirs. Alors que les dirigeantEs démocrates défendent le statu quo, le peuple américain est en colère et veut du changement. Et ils ont raison.
Après avoir perdu les élections, les démocrates sont confrontés à une crise d'identité et d'idéologie. Bernie Sanders a demandé : « Les grands intérêts financiers et les consultants bien payés qui contrôlent le parti démocrate tireront-ils de véritables leçons de cette campagne désastreuse ? » Probablement pas.
La direction du parti reste centriste, mais nombreux sont ceux qui souhaitent que le parti prenne un virage à gauche, vers la classe ouvrière.
La plupart des progressistes ont voté pour les démocrates, à leur grande déception. D'autres ont voté pour des partis de gauche, en vain. La physicienne Jill Stein, candidate à la présidence du parti vert, n'a obtenu que 685 149 voix (0,5 %), tandis que le théologien noir Cornel West en a obtenu encore moins. La gauche devra elle aussi réévaluer sa stratégie électorale.
Dan La Botz, traduit par la rédaction
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Étincelles Écosocialistes de Michael Löwy paraitra au Québec le 21 janvier 2025

Il n'y a pas de solution à la crise écologique dans le cadre du capitalisme. Ce qui s'y présente comme un progrès est toujours marqué du sceau de la destruction, et contribue à accentuer la rupture entre les sociétés humaines et la nature. Renverser cette dynamique implique une réorganisation d'ensemble des modes de production et de consommation de nos sociétés – autrement dit, une véritable rupture civilisationnelle. Le projet écosocialiste est l'utopie concrète qui porte cette rupture. Adossé à une vision exigeante de la planification démocratique, il entend concilier la satisfaction des véritables besoins des populations et le respect des équilibres de la planète.
Dans cet ouvrage, Michael Löwy propose une vue d'ensemble de la genèse, des enjeux et des manifestations de ce projet. Présentant ce que l'écosocialisme doit tant à la pensée de Karl Marx qu'à celle de Walter Benjamin, il en déplie les implications à la fois politiques et éthiques – au premier rang desquelles se trouve l'existence d'un lien intime entre lutte contre la marchandisation du monde et défense de l'environnement, résistance à la dictature des multinationales et combat pour l'écologie.
Michael Löwy
Philosophe et sociologue franco-brésilien, Michael Löwy est directeur de recherche émérite au CNRS.
Couverture © Juliette Maroni
ISBN 9782354803049
218 pages
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
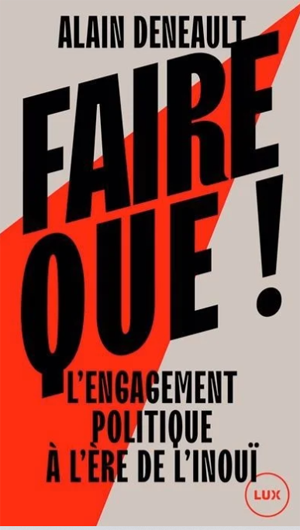
Faire que ! L’engagement politique à l’ère de l’inouï d’Alain Denault
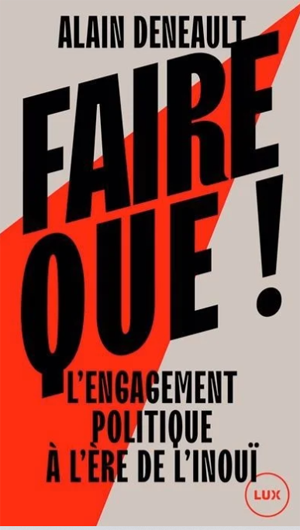
Alain Deneault est un philosophe québécois et docteur en philosophie de l'Université Paris-VIII. Il a été directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris de 2016 à 2022. Il enseigne au campus de Shippagan de l'Université de Moncton dans la Péninsule acadienne.
Il est auteur d'essais critiques, notamment sur l'idéologie managériale, la souveraineté des pouvoirs privés et l'histoire de la notion polysémique d'économie.
https://alaindeneault.net/faire-que-alain-deneault-veut-changer-le-climat/
Son plus récent essai Faire que ! L'engagement politique à l'ère de l'inouï est publié chez Lux Éditeur qui a également publié la réédition en format poche des trois essais classiques : La médiocratie, Politique de l'extrême centre et « Gouvernance » dans sa collection Pollux.
Comment s'orienter dans une époque marquée par des bouleversements écologiques sans précédent, auxquels, manifestement, ni les États ni le capital ne remédieront ? Comment agir politiquement à l'ère de l'inouï, quand on ne dispose d'aucun pendant historique pour appréhender les catastrophes annoncées ? Comment s'engager quand l'extrême droite sème la confusion et détourne la colère des objets réels ? Comment s'y prendre quand le libéralisme dissout tous nos repères dans la gouvernance technocratique ?
Que faire ? Cette question obnubile la pensée politique depuis plus d'un siècle. Alain Deneault nous convie à en penser les prémisses et les incidences pour l'ancrer dans les temps présents. Hors de toute programmatique serrée, mais avec la lucidité qu'on lui connaît, il invite notamment à explorer un nouveau mode d'engagement politique, la biorégion.
Alors que faire ? Livrer la guerre à la médiocratie. Évoquer les enjeux qui fâchent. Penser à l'échelle collective. Mal faire les choses, faire mal. Cesser de se poser la question et sortir de la sidération de l'écoanxiété.
Le moment est venu de faire que !
Entrevue d'Alain Denault sur son livre par Blast
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Les sceptiques sont confondus
Certains observateurs et commentateurs espéraient (sans trop y croire peut-être) que Donald Trump n'irait pas au bout de sa logique une fois élu et qu'il mettrait l'eau du réalisme dans le vin de ses principes tranchants et de ses projets intransigeants.
Hélas, ce n'est pas ce qu'on remarque en ce moment. Bien au contraire, Trump, fort de sa conquête d'une majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants, est pressé de les appliquer. Il tente sans vergogne de mettre l'appareil d'État à sa botte (y compris l'armée). Il promet aussi des lendemains cruels à ses opposants. Je n'aborderai pas ici la question de ces initiatives dont les médias font abondamment état ces jours-ci. Le problème qui se pose est celui-ci : l'administration Trump a-t-elle vraiment les moyens de ses ambitions ? Il ne suffit pas de la volonté forcenée d'un homme, même à la tête de la puissance hégémonique mondiale pour faire plier ses rivaux et adversaires. Examinons cela de plus près.
Tout d'abord, abordons la question des relations américano-chinoises. Le Chine est devenue une puissance d'envergure mondiale, en mesure désormais de disputer aux États-Unis la suprématie internationale, même s'il lui reste encore un peu de chemin à parcourir pour en acquérir la couronne. Afin de se protéger de la concurrence commerciale chinoise, Trump envisage sérieusement d'imposer des droits de douane prohibitifs sur les produits de l'Empire du milieu qui entrent sur le territoire américain, ce qui nuirait incontestablement à l'économie chinoise. Sauf qu'il s'agit là d'un petit jeu qui peut être réciproque. Beijing peut rendre la pareille aux produits américains que la Chine achète présentement. Il s'ensuivrait alors une guerre commerciale qui léserait non seulement le commerce américain mais aussi à celui des pays occidentaux, vu l'étendue des échanges Chine-Occident ; à moins que certains de ces pays ne tentent de profiter de cette situation en se dissociant de Washington dans ce dossier pour accroître leurs échanges avec l'Empire du milieu, lequel essaierait sans doute de toute façon de compenser la relative fermeture du marché américain vis-à-vis de ses produits. Des marchés de remplacement pour Beijing.
Il est donc loin d'être certain que des mesures brutales de rétorsion suffiraient à faire plier la Chine. On assisterait plutôt à un "retour du boomerang" des mesures protectionniste américaines dans le front des États-Unis eux-mêmes et donc indirectement, du Canada, le principal partenaire de ceux-ci et lui aussi grand acheteur de produits chinois. Soixante-quinze pour cent de son commerce se fait toutefois avec "les States".
Précisément, Trump a évoqué la possibilité (sinon la probabilité) d'imposer des tarifs douaniers élevés sur les produits canadiens vendus aux États-Unis (on parle de droits variant de vingt à cinquante pour cent). Le Canada est beaucoup plus vulnérable que la Chine aux pressions commerciales et économiques américaines. Il suffit de penser à la disproportion de leurs marchés respectifs : trois cent quarante millions d'Américains d'un côté, quarante millions de Canadiens de l'autre, dont neuf millions de Québécois.
Dans quelle mesure l'administration Trump est-elle prête à pousser ce dossier délicat des relations commerciales canado-américaines ? Difficile à dire pour l'instant. Mais a-t-elle même intérêt à affaiblir son plus proche vassal ? Là aussi, elle s'expose à des mesures défensives comme avec la Chine, mais évidemment à un niveau bien plus modeste. Cependant, l'économie de certains États américains dépend pour une part plus ou moins considérable du commerce avec le Canada. Le gouvernement d'Ottawa, qu'il soit dirigé par les libéraux de Justin Trudeau ou éventuellement les conservateurs de Pierre Poilievre ferait sûrement pression sur ces États pour les convaincre de continuer à acquérir les biens canadiens et aussi sur la Maison-Blanche pour qu'au moins Trump assouplisse sa position sur cette question-clé. Ottawa pourrait aussi rendre la pareille à Washington en imposant des droits plus élevés sur certains produits américains.
Mais il résulterait de ce chassé-croisé de mesures et de contre-mesures protectionnistes un relatif fractionnement économique et commercial nord-américain, ce qui desservirait à sa cohésion et par ricochet, constituerait une entrave économique pour les États-Unis eux-mêmes.
La faiblesse du Canada réside dans sa dépendance économique et commerciale à l'endroit des États-Unis. Mais elle comporte aussi quelques avantages, puisque le gouvernement américain ne peut aller trop loin dans une éventuelle guerre commerciale avec Ottawa sans affaiblir les États-Unis eux-mêmes, d'autant plus que l'Union européenne semble dans la mire des néo-conservateurs américains. En dépit de sa puissance, la république américaine ne peut combattre sur tous les fronts à la fois.
Sur le plan intérieur, les républicains trumpistes on remporté la victoire par une faible majorité de voix (cinquante et un pour cent pour Trump contre quarante-huit pour cent en faveur de Harris). Ses divers projets sociaux sont donc loin de faire l'unanimité chez les électeurs et électrices américains. Il risque donc de devoir affronter en cours de mandat bien des oppositions de la part de plusieurs de ces gens. Ses menaces de recourir à l'armée pour réprimer les mouvements de dissidence ont peu de chances d'aboutir. Une certaine anarchie sociale peut donc s'installer. Il devrait alors affronter une crise de légitimité grave. Il se peut également qu'au scrutin de mi-mandat, les démocrates reconquièrent une majorité à la Chambre des représentants, ce qui briderait alors les ambitions trumpistes de refaçonner la société américaine dans un sens réactionnaire.
L'appui d'une légère majorité de l'électorat à Trump et surtout à ce qu'il représente illustre bien le déclin de l'empire américain. Coups de gueule et mesures brutales ne pourront l'enrayer, ils peuvent même l'accélérer en éloignant des États-Unis plusieurs de leurs alliés.
Le Canada en est à la fois le spectateur et l'acteur. Comment réagira-t-il ?
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
𝑷𝒐𝒖𝒓𝒒𝒖𝒐𝒊 𝒍𝒆 𝑱𝒖𝒈𝒆 𝑱𝒆𝒂𝒏 𝑾𝒊𝒍𝒏𝒆𝒓 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒏 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒕𝒆̂𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑳’𝑶𝑷𝑪 𝒂𝒖 𝒍𝒊𝒆𝒖 𝒅’𝒖𝒏 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒖 𝒔𝒆𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕𝒔 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒊𝒏𝒔
Comme responsable d'organisation, Défenseur et Éducateur aux Droits Humains, on se questionne sur le choix du Juge Jean Wilner Morin comme nouveau Protecteur du Citoyen ai au sein de l'Office de Protection de Citoyen (OPC) au lieu le choix d'un membre ou d'une personnalité crédible du secteur des droits humains.
Étant responsable d'organisation et citoyen avisé, on a pas la prétention de mettre en doute, la compétence, l'intégrité, la personnalité et la crédibilité du Juge Morin. Mais il est juge et juge d'instruction depuis des années au sein du système judiciaire Haitien. Les pratiques du Juge et Juge d'instruction sont différentes de celles de promouvoir les droits humains.
La fonction du Protecteur du Citoyen est de faire le plaidoyer, renforcer les liens entre les droits et le citoyen, dénoncer les dérives et les violations des droits humains, recadrer les politiques publiques de l'état en faveur des droits humains. Entre autres c'est d'assurer le respect des droits des citoyens et citoyennes dans leurs relations avec les services publics Haïtiennes. Veiller à l'intégrité et à l'amélioration des services publics. Or Monsieur Jean Wilner Morin avait comme la pratique de Poursuivre, d'instruire, d'arrêter entre procéder à des actes d'instructions.
On croit que c'est un non-respect pour les personnalités du secteur des droits humains. c'est un non-respect pour les organisations sérieuses du secteur et c'est aussi un gifle contre toutes celles et ceux qui se battent pour que l'Office de Protection du Citoyen (OPC) redevienne la première instance de promotion des droits humains et qui défend ses citoyens.
On estime que le choix du Juge Morin à la tête de l'Office de Protection du Citoyen (OPC) est très précipité et laisser dernière des zones d'ombres en termes de questionnement. De plus, ce serait une décision unilatéralement prise par le Conseil Présidentiel de Transition (CPT).
En fait, l'Homme qu'il faut à la place qu'il faut n'est en aucun cas considéré par le Conseil et du coup, on doit s'inquiéter sur les vagues de nomination de ce dernier.
L'Office de Protection du Citoyen (OPC) comme institution nationale de Promotion et de Protection des droits humains ayant pour mission de veiller au respect par l'État de ses engagements en matière des droits humains, doit obligatoirement diriger par une personnalité du secteur qui connait les pratiques et techniques adéquates pour adresser les problèmes liés aux violations systématiques des droits humains.
Vive une Haïti Juste !
Vive le respect des Droits Humains !
Me. Louimann MACEUS, Av.Sec. Gl. ECCREDHHDefenseur et Educateur aux Droits Humains.Formation Spécialisée en Droits Humains et en Droit International Humanitaire CUHD/GENÈVE.Membre Amnesty International.Formation Spécialisée en Politique Publique des Droits de l'Homme à IPPDH/CIDH/ Mercosur.Ex-Point Focal OSI-HAÏTI (objectif Sciences international).Ethnojuriste@gmail.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Nouvelles de la RD Congo
Bonjour !
Merci beaucoup pour les nouvelles de Presse-toi à gauche
Oui ! Une nouvelle du bulletin a retenu notre attention ; mettre fin aux
guerres !!!
J'illustre ici le cas de la République Démocratique du Congo ! où dans sa
partie Est une guerre oubliée fait des milliers des morts pendant plus de
25 ans !!!! durant lesquels des populations ont été massacrées !!! des femmes
et filles violées !!!! violentées !!!
Sincèrement nous sommes épuisées d'assister à des massacres de nos
parents !!!, de nos frères et soeurs !!! de nos enfants !!! de nos
grands-parents !!! ....
Les guerres nous exterminent !! nous rendent malheureux et misérables !!!!
nous ne jouissons plus de nos richesses !!! de notre propre pays et sommes
devenues des prisons à ciel ouvert !!! chacun dans son coin !!! pas moyens de
se déplacer librement dans ce si beau pays !!! à causes des insécurités
généralisées
Nous voulons vraiment que les guerres finissent dans notre pays !!! dans le
Monde !!!
Solidarité !
Jacqueline,
Pour l'équipe IFESIDDI en RD CONGO
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les syndicats palestiniens appellent à intensifier la pression du BDS pour mettre fin à la complicité avec le #GazaGenocide et l’apartheid israéliens

27 octobre 2024
Plus d'un an après le génocide diffusé en direct contre 2,3 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza occupée et assiégée, les Palestiniens sont unis dans la résistance au génocide israélien et au régime de colonialisme, d'occupation et d'apartheid en place depuis des décennies. Nous appelons les syndicats et les travailleurs du monde entier à intensifier la pression du BDS pour mettre fin à la complicité des États, des entreprises et des institutions dans les crimes d'Israël contre l'ensemble du peuple palestinien, ainsi que contre le peuple frère du Liban, entre autres.
La solidarité internationale des travailleurs commence par la fin de la complicité. Il ne s'agit pas seulement d'une question morale, mais aussi d'une obligation légale. Les arrêts de la Cour internationale de justice contre le génocide, l'occupation et l'apartheid israéliens, l'appel du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en faveur d'un embargo militaire sur Israël et les appels de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de sanctions montrent que les mesures BDS ne sont pas seulement un droit, mais aussi une obligation légale.
Voici quelques-unes des mesures les plus inspirantes prises par les syndicats du monde entier au cours de la seule année dernière pour soutenir la lutte de libération palestinienne :
– IndustriALL Global Union, une fédération syndicale mondiale qui représente 50 millions de travailleurs dans 140 pays dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie et de l'industrie manufacturière, a approuvé le BDS, devenant ainsi de loin la plus grande organisation syndicale à soutenir le BDS.
– La fédération syndicale norvégienne LO, forte d'un million de membres, a joué un rôle important dans le désinvestissement du fonds souverain norvégien, le plus important au monde, de l'ensemble des obligations israéliennes qu'il détenait pour un montant d'environ 500 millions de dollars.
– Les principaux syndicats indiens, qui représentent des dizaines de millions de travailleurs, ont demandé au gouvernement indien d'annuler un accord visant à « exporter » des travailleurs indiens en Israël pour remplacer les travailleurs palestiniens, en exhortant les travailleurs à boycotter les produits israéliens et à ne pas manipuler les marchandises israéliennes.
– Les syndicats de dockers de Belgique, d'Inde, de Catalogne, d'Italie, de Grèce, de Turquie, de Californie et d'Afrique du Sud ont mené des actions contre des navires israéliens ou des livraisons d'armes à Israël.
– Le Trades Union Congress (TUC) du Royaume-Uni, qui représente 5,5 millions de travailleurs et 48 syndicats, a appelé à l'unanimité à un embargo total sur les armes contre le système d'occupation et d'apartheid d'Israël, rappelant au gouvernement ses obligations en matière de prévention des génocides.
– L'IAATW, une alliance internationale de syndicats de travailleurs du transport basés sur des applications et comptant 100 000 membres dans plus de 27 pays et sur 6 continents, a décidé de boycotter les stations-service Chevron.
– USS, l'un des plus grands fonds de pension du Royaume-Uni, a désinvesti les 100 millions de dollars d'obligations israéliennes qu'il détenait, sous la pression de l'University and College Union (UCU).
– Pour la première fois, sept grands syndicats américains, représentant près de la moitié de l'ensemble des syndiqués, ont appelé à « mettre fin à l'aide militaire américaine à Israël ».
– L'Union générale des travailleurs de l'Équateur (UGTE) a approuvé le BDS, y compris le boycott culturel d'Israël, en se déclarant zone exempte d'apartheid israélien (AFZ).
– Le Syndicat national de l'enseignement tertiaire d'Australie, qui représente 27 000 travailleurs universitaires, a approuvé le boycott de toutes les universités israéliennes complices et a appelé les universités australiennes à mettre fin à leurs liens avec l'armée israélienne et ses fournisseurs.
– En France, la CGT Thalès (syndicat représentant les travailleurs de cette entreprise d'armement) a appelé à « suspendre toute collaboration avec Israël en raison de ce qui se passe à Gaza ». Plus récemment, la section parisienne de la fédération syndicale CGT a soutenu le BDS.
– 700 membres du syndicat hollywoodien SAG-AFTRA, dont des lauréats d'Oscars, ont condamné le génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens de Gaza et l'assassinat de journalistes palestiniens.
– Le syndicat argentin ATE Córdoba a approuvé le BDS, se déclarant zone libre de l'apartheid israélien.
– L'Union des artistes écossais et l'Union des artistes irlandais (Praxis) ont toutes deux approuvé le BDS, y compris le boycott culturel d'Israël, cette dernière se déclarant zone exempte d'apartheid israélien (AFZ).
La Fédération palestinienne des syndicats de professeurs et d'employés d'université (PFUUPE) et l'Académie palestinienne pour la science et la technologie (PalAST), qui représentent près de 10 000 travailleurs universitaires, ont salué les mesures prises par les universités du monde entier pour « revoir, suspendre et rompre les accords de collaboration avec les universités et les centres de recherche israéliens qui sont complices des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide perpétrés par Israël ».
La pression exercée par le BDS est la forme la plus efficace de solidarité internationale avec la lutte des Palestiniens pour la libération, la justice et le retour de nos réfugiés, car elle renforce le pouvoir des peuples pour mettre fin à la complicité. En conséquence, et en harmonie avec notre appel d'octobre 2023, nous vous demandons à tous d'intensifier la pression BDS :
– Désinvestissez et excluez des contrats et des investissements, le cas échéant, les entreprises complices comme Intel, Chevron, Amazon, Google, HP, Caterpillar, HD Hyundai, Carrefour, McDonald's, FANUC, Siemens, AXA, et d'autres. Faites pression sur votre institution (conseil municipal, université, etc.) ou votre employeur pour qu'il fasse de même. Associez-vous également à des mouvements stratégiques pour la justice (y compris des groupes dirigés par des étudiants) afin de faire pression sur les institutions, comme les universités et les conseils municipaux, pour qu'elles désinvestissent et mettent fin aux liens avec les entreprises militaires, technologiques et autres qui arment ou soutiennent le génocide, l'apartheid et l'occupation militaire d'Israël. Cela a été fait avec succès à l'Union Theological Seminary, affilié à l'université de Columbia, à l'université d'État de San Francisco, aux conseils municipaux de Richmond (Californie), de Liège (Belgique), d'Oslo (Norvège) et de Belem (Brésil), entre autres.
– Mettre fin au commerce d'armes avec les génocidaires : Refuser de construire, de manipuler ou de transporter tout article militaire ou à double usage destiné à l'État génocidaire d'Israël. Arrêter les navires et les cargaisons militaires à destination d'Israël, y compris en fournissant des « pavillons de complaisance », par des manifestations, des piquets, des actions de lobbying auprès des gouvernements, des actions en justice, des mesures « bureaucratiques » et des campagnes dans les médias.
– Pas de technologie pour le génocide ou l'apartheid ! Travailleurs de la technologie et syndicats : s'organiser au sein du secteur de la technologie pour renforcer le pouvoir afin de mettre fin à la complicité d'entreprises telles qu'Amazon, Google, Microsoft, HP, Intel, Palantir et Cisco qui permettent le génocide d'Israël et/ou l'automatisation de son apartheid.
– Faites pression sur les gouvernements pour qu'ils mettent fin à leur complicité et imposent un embargo militaire et des sanctions ! Continuez à suivre les orientations politiques et les demandes de la société civile palestinienne ici.
– Pas de liens avec l'Union de l'Apartheid : Coupez les liens avec la Histadrout d'Israël, pilier du colonialisme et de l'apartheid.
Signé :
Fédération générale palestinienne des syndicats (PGFTU) - Gaza
Syndicat général des travailleurs palestiniens (GUPW)
Syndicat palestinien des travailleurs des postes, de l'informatique et des télécommunications
Fédération des syndicats indépendants
Syndicat général des enseignants palestiniens (GUPT)
Union générale des femmes palestiniennes
La nouvelle fédération palestinienne des syndicats
Association du barreau palestinien
Association dentaire palestinienne - Centre de Jérusalem
Association des pharmaciens palestiniens - Centre de Jérusalem
Association médicale - Centre de Jérusalem
Association des ingénieurs - Centre de Jérusalem
Association des ingénieurs agronomes - Centre de Jérusalem
Syndicat des vétérinaires - Centre de Jérusalem
Syndicat des journalistes palestiniens (PJS)
Union des travailleurs des organes locaux - Hébron
Syndicat des employés de la compagnie d'électricité du sud
Association des employés du secteur financier
Association des employés des services de santé
Syndicat des électriciens de Palestine
Association des employés de Jawwal
Syndicat national de la banque et de l'assurance
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Publié sur : https://bdsmovement.net/news/palestinian-trade-unions-professional-syndicates-call-for-escalating-bds-pressure
Traduit avec Deepl.com
Jour 407 de la guerre — comment raconter la guerre ? L’absence de réactions !

Nommer et combattre un système d’immigration colonialiste et raciste

Outre la régularisation des personnes sans papiers, il faut obtenir une refonte du système d’immigration : au lieu de produire vulnérabilités et discriminations, il s’agit d’accueillir les personnes migrantes et immigrantes comme des êtres humains et comme des citoyennes à part entière, de quelque région du monde qu’elles proviennent[2].
Depuis quelques mois, l’attention médiatique et politique sur les personnes immigrantes et migrantes, aiguisée par de petites phrases « assassines » qui les rendent responsables de tous nos maux[3], et en particulier de la crise du logement, de celle de l’éducation[4] et du déclin du français, s’est focalisée sur les travailleuses et travailleurs temporaires, dont le nombre atteint les 2,2 millions au Canada dont 528 000 au Québec selon Statistique Canada, au 4e trimestre de 2023. Les chiffres auraient fait sursauter l’automne dernier Christine Fréchette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, qui présentait sa planification des seuils d’immigration qui tient compte uniquement des entrées au pays avec la résidence permanente (ce qu’on appelle couramment l’immigration économique). Cependant, comme le souligne en février la journaliste du Devoir Sarah Champagne[5], Québec a une responsabilité indéniable dans la situation car, quoi qu’en dise le gouvernement caquiste de François Legault, il a ouvert largement la porte : c’est lui en effet qui a demandé au fédéral que les employeurs du Québec qui voulaient recourir au programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) obtiennent un « traitement simplifié » de leur demande, ce qui veut dire que ces employeurs n’ont plus à « faire la démonstration qu’ils ont cherché à recruter quelqu’un localement[6] ». Le résultat est qu’en 2023, le nombre d’entrées par le PTET (58 885) a dépassé au Québec le nombre d’entrées avec un statut de résident permanent (52 790)[7]. Or, les travailleuses et travailleurs du PTET disposent seulement d’un permis temporaire qui, pour les emplois peu qualifiés (en dessous de 26 $/h) ne leur donne pas de voie d’accès à la résidence permanente[8]. En outre, ce permis temporaire de travail est « fermé », c’est-à-dire attaché à un employeur unique : si celui-ci décide de ne pas les garder, ils ou elles doivent rentrer dans leur pays ou se trouver un autre employeur, ce qui, en filigrane, veut dire vivre sans statut, sans papiers, dans une situation extrêmement difficile. Sara Champagne rapporte des témoignages de travailleurs licenciés à peine arrivés au Québec avec leur famille, alors qu’ils ont tout vendu dans leur pays d’origine (La Tunisie et le Maroc en l’occurrence) pour venir y travailler : « Je voudrais que personne ne fasse l’erreur de quitter son pays avec un permis fermé », indique l’un d’eux. Un autre travailleur déplore : « Juridiquement, tout est bien propre, on fait un contrat. Mais on n’a pas sensibilisé les gens aux risques qu’ils vont prendre », et un troisième souligne : « Le gouvernement sait ce qui arrive avec les permis fermés et il ferme les yeux[9] ».
Les batailles de chiffres sur les seuils d’immigration permanente que se sont livrés les partis politiques l’automne dernier semblent bien anecdotiques devant ces témoignages qui renvoient à des enjeux structurels du système d’immigration canadien. Au-delà des chiffres, on ne peut pas comprendre l’emballement pour le recrutement sur permis temporaire sans resituer le phénomène : d’abord dans l’héritage colonialiste-raciste dans lequel sont ancrées ces mesures ; puis dans le changement de paradigme intervenu depuis les années 2000 en matière de politiques d’accès à la résidence permanente, lequel a mis l’accent sur l’utilité économique de l’immigration et a réactualisé la colonialité du pouvoir et le racisme systémique.
Pour éclairer ce fondement colonialiste-raciste, il est nécessaire de croiser des connaissances portant sur les principales lois régissant l’accès à la citoyenneté pour les personnes immigrantes ainsi que sur les principaux statuts d’immigration. Grosso modo, au Canada, la gestion et le contrôle des flux de main-d’œuvre internationale reposent d’un côté sur une voie d’accès vers la résidence permanente et donc vers une forme de citoyenneté, surtout utilisée jusqu’il y a trente à quarante ans par des Européens ou des francophones recherchés par le Québec (comme le montrent les données des recensements de Statistique Canada) et, d’un autre côté, sur des programmes de permis temporaires.
Les permis temporaires structurés par les rapports Nord-Sud
Outre les permis pour les étudiantes et étudiants venant faire leurs études ou profitant du permis vacances-travail (réservé aux pays du Nord[10]), les programmes de permis temporaires se divisent en deux principaux volets : 1) le Programme de mobilité internationale qui inclut différents cas de figure dont le déplacement de salarié·e·s entre filiales, les jeunes de certains pays signataires d’accords avec le Canada ou des situations spécifiques qui sont utilisées, dans bien des cas, pour des emplois considérés comme hautement qualifiés et principalement pourvus par des travailleurs du Nord; 2) les programmes des travailleurs étrangers temporaires (PTET, programme des travailleurs agricoles saisonniers, PTAS, et programme des aides familiaux résidants, PAFR) qui s’adressent essentiellement aux populations du Sud, car ces programmes dépendent d’accords bilatéraux entre le Canada et certains pays comme les Philippines, le Mexique et le Guatemala. Comme déjà mentionné, les permis sont particulièrement restrictifs, ou dits « fermés », parce qu’ils sont émis pour un employeur unique, qui a le pouvoir de le rompre unilatéralement et donc de faire perdre le statut migratoire. Jusqu’en 2002, ces programmes restrictifs de travail temporaire étaient principalement destinés à apporter de la main-d’œuvre saisonnière dans l’agriculture ou à fournir des aides familiales ; celles-ci, car il s’agit majoritairement de femmes, étaient les seules à avoir accès à la résidence permanente, mais devaient cependant attendre avant de pouvoir faire la demande et se faisaient (se font) entretemps durement exploiter, d’autant plus que jusqu’en 2014, elles étaient obligées de vivre chez le particulier employeur qui abusait fréquemment de la situation.
Ce système de migration peut être qualifié d’héritage colonial. Il a en effet été construit après l’abolition en 1962 de l’Acte d’immigration adopté en 1910 par le Canada et qui interdisait l’immigration aux personnes « déclarées comme “inadaptées au climat ou aux besoins du Canada”, bloquant dans les faits la plupart des immigrants non blancs[11] ». Deux mesures significatives ont été prises après cette abolition.
D’une part, en 1966, le Canada adopte un programme pilote destiné à faire venir en Ontario de la main-d’œuvre jamaïcaine de Porto Rico pour répondre aux besoins des fermiers, tout en s’assurant que ces personnes ne resteraient pas au pays. Depuis, la démarche s’est élargie pour déboucher sur les PTAS, PTET et PAFR. De tels programmes ne sont pas spécifiques au Canada. D’autres pays du Nord recourent à la main-d’œuvre du Sud selon le même schéma. Ces programmes bilatéraux ont été dénoncés à maintes reprises à l’issue de travaux de recherche pour leur sexisme et racisme, car ils servent à mettre à la disposition des employeurs une force de travail (physique, émotionnel, etc.) choisie selon son sexe et sa nationalité, ces critères servant à attribuer des « compétences » auxquelles la main-d’œuvre doit se conformer. Au Canada, cette forme d’exploitation genrée et racisée a connu un essor particulièrement important à partir de 2002, lorsque le PTET, d’abord réservé aux emplois qualifiés ou à certains emplois marqués par la rareté de la main-d’œuvre, a été élargi aux emplois dits peu spécialisés, ceux qui connaissent la croissance la plus importante depuis.
Dès 2008, si on inclut les étudiantes et étudiants étrangers qui sont de plus en plus nombreux à venir des pays du Sud global, mais qui appartiennent dès lors à des classes sociales ayant les moyens de payer les frais d’inscription, le nombre d’entrées au Canada de personnes migrantes ayant un statut temporaire a dépassé le nombre d’entrées par la résidence permanente. Depuis, la croissance des entrées de travailleuses et travailleurs temporaires ne s’est pas démentie, et ce, malgré différentes interventions dont celle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, qui a clairement exprimé dès 2012[12] que les programmes délivrant un permis fermé entretiennent la discrimination systémique à l’égard des populations migrantes en raison de leur sexe, de leur langue, de leur condition sociale, de leur origine et de leur « race » – la majorité des personnes occupant des emplois dits peu spécialisés proviennent du Guatemala, du Mexique et des Philippines. Le recours à ces programmes, destinés à exploiter mais aussi à contrôler les flux de main-d’œuvre venant des pays du Sud global, a été facilité dans l’ensemble du Canada depuis le gouvernement Harper, qui a simplifié les démarches des employeurs pour obtenir des autorisations à procéder à de tels recrutements ou qui les en a dispensés dans certaines conditions. Au Québec, le gouvernement Legault a continué dans cette lignée[13].
La dénaturation de la voie d’accès à la résidence permanente
D’autre part, en 1967, le système de points a été introduit comme voie d’accès à la résidence permanente. Selon Dufour et Forcier[14], la création de ce système de points s’inscrit dans la volonté de réduire le regroupement familial introduisant des travailleurs peu qualifiés et d’augmenter la part d’immigration économique et qualifiée. Ce caractère potentiellement discriminatoire à l’égard des personnes provenant du Sud global, moins massivement qualifiées à l’époque, sera accentué à partir de l’ère Harper; les gouvernements suivants vont en effet renforcer l’immigration économique qualifiée au détriment du regroupement familial – processus qui sera même gelé pendant deux ans – et au détriment des personnes réfugiées et demandeuses d’asile, dont la figure sera en quelque sorte criminalisée soit parce qu’elles seront considérées comme des personnes cherchant à profiter du système de protection sociale, soit comme de « faux » réfugié·e·s « menaçant la sécurité nationale[15]». Parallèlement, alors que les personnes issues des pays du Sud global vont progressivement constituer, après les réformes des années 1960, la majorité des candidats (par rapport aux Européens) empruntant la voie de la résidence permanente, le système de points connait deux modifications majeures. Celles-ci restreignent l’accès aux personnes dont la déclaration d’intérêt (c.-à-d. les postes pour lesquels elles se présentent) correspond aux besoins à court terme des employeurs, qui deviennent en quelque sorte les maitres d’œuvre d’un processus d’immigration qui se privatise[16].
Il s’agit là d’un changement de paradigme amorcé au début des années 2000, qui dénature la voie d’accès à la citoyenneté en réduisant l’être humain, jusqu’alors considéré dans sa globalité, à son intérêt économique, c’est-à-dire à son utilité en termes de main-d’œuvre. Cette utilité économique consiste le plus souvent – au-delà des discours sur la recherche d’une main-d’œuvre qualifiée – à combler à moindre coût les postes délaissés en raison de leur salaire insuffisant et de leurs difficiles conditions de travail. À titre d’exemple, environ la moitié des permis temporaires le sont en réalité pour des emplois peu spécialisés.
Le permis « fermé », forme moderne d’esclavage
Tandis que se déploient les discours qui transforment l’immigration sous ses différentes formes en bouc émissaire, on comprend mieux l’accent mis sur le travail temporaire et en particulier sur les programmes de travail temporaire délivrant un permis fermé. Objet de toutes les attentions pour les employeurs, ces programmes sont profondément rejetés par nombre d’organisations communautaires et syndicales qui demandent la suppression du permis de travail « fermé » au profit d’un permis ouvert et d’un statut permanent. Elles dénoncent ce système d’immigration à deux vitesses, source d’abus, de sous-salaires et d’heures supplémentaires non payées, de violence et de harcèlement psychologique et sexuel, et d’accidents du travail. Un rapporteur spécial de l’ONU, Tomoya Obokata, venu au Canada en septembre dernier pour enquêter à ce sujet a clairement conclu que le « permis fermé » ouvrait la porte à des formes d’« esclavage moderne[17] ». Et pour cause : le statut migratoire dégradé agit auprès des employeurs, qu’on le veuille ou non, comme un signal stigmatisant celles et ceux qui les occupent, les épinglant comme des sous-citoyennes et sous-citoyens.
Un système qui produit vulnérabilités et pertes de statut
Depuis la visite du rapporteur de l’ONU, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes s’est saisi de ce sujet ainsi que de celui des personnes sans papiers, très nombreuses au Canada (entre 500 000 et 600 000 selon les estimations) en raison de ces politiques. Car ce système d’immigration produit à grande échelle des pertes de statut. Si la vie des employeurs a été simplifiée, celle des détenteurs de permis temporaires fermés ne l’a été en aucun cas, malgré l’ouverture, formellement, de l’accès à la résidence permanente. En pratique, les obstacles sont si nombreux que très peu de personnes titulaires du permis fermé arrivent à obtenir le statut de résident permanent (1 sur 14 entre 2015 et 2022 au Canada). Cette proportion n’est qu’une moyenne : au Québec, comme mentionné, les personnes occupant des emplois peu spécialisés continuent à quelques exceptions près de se voir interdire l’accès à la résidence permanente ou se heurtent à l’insuffisance des moyens disponibles pour la francisation et à la difficulté des tests de français, ce que le gouvernement québécois a fini par reconnaitre. Par ailleurs, nombre de personnes fuyant des employeurs abusifs ne réussissent pas à obtenir ce « permis ouvert pour personnes vulnérables » prévu par Ottawa dans les cas d’abus, car les démarches sont extrêmement lourdes, ou elles n’arrivent pas à obtenir de nouveau un permis « fermé » à l’issue de la durée d’un an accordé avec ce permis ouvert.
Outre la perte de statut en raison de la nature même des politiques d’immigration, qui institutionnalisent la précarité comme moyen de gérer les flux de main-d’œuvre en provenance du Sud global, on peut aussi se retrouver sans papiers quoique dans une moindre mesure, malgré ce que laisse croire la large couverture médiatique du « chemin Roxham », à cause de la non-effectivité ou de l’insuffisance des politiques humanitaires qui accordent trop souvent au compte-gouttes la résidence permanente et qui la refusent pour des raisons aberrantes : on peut voir à cet effet le documentaire L’audience[18], où le juge refuse le statut de réfugié à un couple avec enfants considérant qu’il « magasine » le pays dans lequel il veut vivre ! C’est sans compter les restrictions apportées à des programmes comme le parrainage collectif, victime de son engouement auprès d’une population prête à accompagner financièrement, pendant un an après leur arrivée au Canada, des personnes qui ont auparavant obtenu le statut de réfugié. Il faut aussi rajouter au tableau les quotas annuels imposés par Québec, qui restreint même les entrées par regroupement familial et retarde du coup la réunion des familles des années durant – des conséquences guères différentes de celles résultant de la politique « tolérance zéro » édictée par Trump aux États-Unis envers les demandeurs d’asile provenant du Mexique et qui avait mené à séparer près de 4 000 enfants de leurs parents.
Les annonces début novembre des gouvernements fédéral et québécois sur la planification de l’immigration n’ont pas montré de volonté de corriger ces politiques qui perpétuent la domination envers les travailleuses et travailleurs du Sud global. Cependant, la ministre de l’Immigration du Québec n’a pu éviter de parler de ces travailleurs temporaires et de l’ampleur du phénomène qui avait été révélée par des médias quelques semaines avant l’annonce de la planification. Elle a ainsi indiqué vouloir mettre une condition de maitrise minimale du français à l’oral pour obtenir un renouvellement au bout de trois ans d’un permis temporaire, ce qui a paru totalement indécent aux yeux des organisations syndicales et communautaires œuvrant avec les personnes migrantes, ou pour faire respecter leurs droits humains, puisqu’on ne leur donne même pas la possibilité de s’installer au Québec avec un statut permanent ! Cela semble également ingérable par les employeurs, qui devraient assurer des heures de français sur les lieux de travail alors que bon nombre d’entre eux ne respectent même pas le droit du travail.
Le 14 décembre dernier, Marc Miller, ministre fédéral de l’Immigration, a donné une entrevue au Globe and Mail où il rappelait la promesse faite par Trudeau, il y a déjà deux ans, concernant l’adoption d’un programme de régularisation de grande ampleur. Cependant, l’entrevue montre que les objectifs seraient restreints là encore aux secteurs d’activité pour lesquels les immigrantes et immigrants sont économiquement utiles, comme la construction et la santé, où ils sont jugés « indispensables », et le processus serait très long (s’étirant jusqu’en 2026) pour des raisons explicitées dans l’entrevue, qui se réfèrent à la montée d’un sentiment anti-immigrant parmi la population – un sentiment que les dirigeants politiques sont en réalité en train d’amplifier si ce n’est de créer. Or, les organisations communautaires ou syndicales qui se mobilisent pour obtenir la régularisation des personnes sans papiers demandent de leur côté un programme complet et véritablement inclusif.
Longtemps, face aux politiques discriminatoires d’immigration et à leurs conséquences parfois lourdes sur l’état physique et mental des personnes, des organismes comme le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec ont œuvré de façon assez isolée durant leurs premières années, ne recevant un soutien que d’autres organismes communautaires, puis, petit à petit, d’organisations syndicales. Mais avec la pandémie, qui a jeté une lumière crue sur toutes ces personnes migrantes, précaires ou sans papiers qui ont dû continuer à travailler en s’exposant à l’épidémie, y perdant parfois la vie, ces organisations de travailleuses et travailleurs migrants ont acquis une visibilité et une reconnaissance indéniables, tandis que le sort de ces personnes alors qualifiées d’essentielles n’a pu rester dans l’ombre, et ce, d’autant moins qu’elles ont été les premières à se mobiliser pour faire reconnaitre leurs droits.
À présent, au Québec en particulier, les organisations syndicales sont impliquées dans la campagne pour la régularisation des personnes sans papiers, qui rassemble une trentaine d’organismes communautaires d’envergure provinciale et même internationale[19]. Cette coalition qui a élargi ses objectifs a tenu le 15 février dernier une rencontre stratégique pour déterminer ses priorités et stratégies afin de ne plus être seulement réactive. Au cœur des discussions, il y a la nécessité de déconstruire les discours anti-immigrants et de mettre fin à ce système d’immigration discriminatoire et raciste tout en continuant à réclamer haut et fort un programme de régularisation complet et inclusif.
Un tournant dans la mobilisation pour la régularisation
La mobilisation se trouve en effet à un tournant. Un bras de fer s’est véritablement engagé avec les classes dirigeantes qui cherchent sans pudeur à travers les responsables politiques et la montée des discours anti-immigrants des appuis ou des voix jusqu’à l’extrême droite. Ce n’est pas pour rien que le patronat se montre quasi inflexible à maintenir le système du permis fermé. C’est tout un modèle économique qu’il s’agit de préserver et qui repose sur une main-d’œuvre flexible et à bas salaires permettant, par exemple, de vendre les fruits et légumes cultivés au Québec moins cher ou de faire de la province un espace d’entreprises logistiques à moindre coût. Si tant le gouvernement fédéral que celui du Québec se défendent de poursuivre des objectifs racistes ou inconsidérés, il n’en reste pas moins que transformer les personnes migrantes et immigrantes en boucs émissaires est un moyen de tenter de les isoler, de leur faire perdre un pouvoir de négociation qu’elles ont durement acquis ces dernières années.
L’issue du bras de fer dépendra des mobilisations en cours, et donc aussi de l’engagement des syndicats, notamment au Québec mais pas seulement. Feront-ils de ces enjeux une campagne prioritaire, en se donnant les moyens d’informer et de former les syndicats locaux à connaitre et à faire valoir les droits des travailleuses et travailleurs migrants qu’ils retrouvent de plus en plus souvent dans leur entreprise ?
À l’heure des petites et grandes phrases transformant les personnes migrantes et immigrantes en boucs émissaires de toutes les faillites des responsables politiques en matière d’inflation et de coût de la vie, de logement et d’accroissement des inégalités, l’enjeu dépasse celui de négocier quelques avancées ou de limiter les reculs; il est d’opposer une autre vision du monde, un autre récit qui favorise de larges alliances entre les différents mouvements sociaux et organismes communautaires luttant pour le logement social, contre la pauvreté, contre le racisme, etc. Et pour ce faire, il est fondamental de mettre à nu les ressorts colonialistes et racistes sur lesquels reposent les politiques d’immigration, comme il est nécessaire de montrer en quoi la crise du logement et la spéculation immobilière représentent, comme l’accroissement des inégalités, un des moteurs du processus d’accumulation capitaliste.
Par Carole Yerochewski, sociologue
Carole Yerochewski remercie le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, notamment Cheolki Yoon, Nina Gonzalez, Noémie Beauvais, Ryan Faulkner, pour leur apport à la mise en lumière et à l’analyse de ces réalités. ↑
- Sur la question de l’immigration, on pourra aussi se référer au dossier du n° 27 des Nouveaux Cahiers du socialisme, Le défi de l’immigration au Québec : dignité, solidarité et résistances, 2022. ↑
- Rappelons, entre autres, la déclaration de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, comme quoi une « crise sociale sans précédent » menace le Québec à cause du nombre d’immigrants, celle du ministre Jean Boulet qui avait lancé une fausse information à l’automne 2022, en disant que « 80 % des immigrants ne travaillent pas, ne parlent pas français, ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise » et plus récemment, le 22 février, le premier ministre déclarant lors d’un point de presse que « les demandeurs d’asile menacent la langue française » (titre de l’article de Lisa-Marie Gervais, dans Le Devoir du 23 février 2024). Le plus virulent dans les discours anti-immigrants est sans doute le chef conservateur Pierre Poilievre, mais pratiquement aucun parti politique n’évite de reprendre ce type de discours. ↑
- Le gouvernement Legault met sur le dos des demandeurs d’asile les surcharges dans les garderies et les classes. Débouté par la Cour d’appel, il annonce vouloir porter en Cour suprême sa volonté de maintenir l’exclusion des enfants des demandeurs d’asile de l’accès aux garderies subventionnées – une mesure qualifiée de discriminatoire en raison du sexe par la Cour d’appel. ↑
- Sarah Champagne. « Un programme des travailleurs temporaires “totalement dénaturé”, tonne un leader syndical », Le Devoir, 23 février 2024. ↑
- Ibid. ↑
- Le nombre de demandeurs d’asile entrés au Québec, notamment par le chemin Roxham, était près de 59 000 en 2022, mais 27 % d’entre eux, soit environ 16 000 personnes, se sont installés ailleurs au Canada dans l’année même de leur demande d’asile selon les informations collectées par Lisa-Marie Gervais dans son article « La proportion de demandeurs d’asile au Québec ne serait pas aussi élevée que le dit le gouvernement Legault », Le Devoir, du 5 février 2024. ↑
- Contrairement à ce qui est en vigueur dans le reste du Canada depuis la deuxième moitié des années 2010. Le gouvernement Legault, utilisant les prérogatives du Québec en matière d’immigration, a en effet fermé cette possibilité d’accéder à la résidence permanente pour les personnes occupant des emplois peu qualifiés, et ce, y compris pour les aides familiales, alors que ce programme, contrairement au programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) et au PTET, avait toujours donné accès à la résidence permanente. ↑
- Sarah Champagne. « Congédiés sur des permis fermés, des travailleurs temporaires se retrouvent dans l’impasse », Le Devoir, 23 février 2024. ↑
- Sur les 35 pays participants, cinq appartiennent au Sud global : Costa Rica, Mexique, Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan. Voir Vivez au Canada. ↑
- Extrait de la Fiche d’information du gouvernement du Canada à l’occasion du Mois de l’histoire des personnes noires au Canada : <https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/scjn-cbjs/fait2-fact2.html>. ↑
- <https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-positions/enjeux/travailleurs-migrants>. ↑
- On peut se référer en particulier à l’article de Marie-Hélène Bonin, « Le Québec, de terre d’accueil à club privé », dans le n° 27 des Nouveaux Cahiers du socialisme, qui décrit la façon dont le gouvernement Legault a négocié dès 2018 une « flexibilisation » du PTET au profit des employeurs. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le nombre de travailleurs et travailleuses temporaires ait cru beaucoup plus vite ces dernières années au Québec que dans le reste du Canada. ↑
- Frédérick Guillaume Dufour et Mathieu Forcier, « Immigration, néoconservatisme et néolibéralisme après la crise de 2008 : le nouveau régime de citoyenneté canadien à la lumière des trajectoires européennes », Revue Interventions économiques, n° 52, 2015. ↑
- Ibid., para. 24. ↑
- Ibid. ↑
- Mélanie Marquis, « Un danger d’esclavage moderne, s’alarme un représentant de l’ONU », La Presse, 6 septembre 2023. ↑
- Émilie B. Guérette et Peggy Nkunga Ndona, L’audience, documentaire, 93 min., Québec, 2023. ↑
- Voir par exemple la lettre ouverte de Nina Gonzalez du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et de 28 organisations, « Cessez les expulsions, régularisez les sans-papiers ! », La Presse, 18 décembre 2023. ↑
La CAQ impose l’austérité aux étudiants et travailleurs des écoles
L’Antifascisme de Mark Bray : une plongée dans l’histoire et les idéaux du mouvement antifasciste

Quand le temps devient fou

L'expression « temps fou » désigne d'abord une revue culturelle et politique ayant connu deux moments : une première existence couvrant les années 1978-1983, suivie d'une seconde, un rebondissement dix ans plus tard de 1993 à 1998. Véronique Dassas, auteure de Chronique d'un temps fou [1], a participé aux deux périodes de cette aventure, dirigeant la deuxième mouture de la revue avec enthousiasme et brio.
Le temps fou désigne également une atmosphère plus englobante, qualifiant notre époque depuis, en gros, les années 1980, qui serait caractérisée par un temps déréglé, sorti de ses gonds, dont les guerres récentes seraient un des principaux symptômes, un retour de la barbarie sous des formes sophistiquées. C'est cet air du temps qu'évoque l'auteure dans la première partie de son livre, tandis que la seconde est constituée « d'exercices d'admiration », constituant autant de célébrations d'écrivain·es et d'artistes particulièrement affectionné·es.
Bifurquer
Si les sujets abordés sont nombreux, ils relèvent toutefois d'une approche générale que Dassas qualifie de bifurcation, dans laquelle il s'agit non seulement de critiquer les productions culturelles et les pratiques politiques d'aujourd'hui, mais d'en imaginer, d'en inventer de nouvelles dans une période où l'utopie d'une révolution globale, qui avait inspiré les militant·es des années 1960-1980, est disparue, sauf dans quelques groupes ultraminoritaires.
L'effervescence culturelle remplace depuis les années 1980 la désaffection politique. Les nouveaux créateurs et les nouvelles créatrices sont souvent, dans cette perspective, des militant·es reconverti·es qui deviennent acteur·rices dans les milieux de l'art et de la communication ou qui se professionnalisent : d'étudiant·es contestataires, ils et elles deviennent par exemple des professeur·es bien intégré·es dans les institutions qu'ils et elles critiquaient naguère.
Dassas, pour sa part, se tient à la fois à l'intérieur et en dehors de cette transformation générale par son approche oblique caractérisée par une lucidité qui ne laisse guère de place aux illusions lyriques.
Guerre à la guerre
Son invention d'un « abécéguerre » pour désigner les véritables motifs des guerres contre l'Irak témoigne de cette prise de conscience de la réalité concrète de ces affrontements, très différente de la rhétorique « démocratique » qui les légitime. La guerre soi-disant « juste » pour la « libération » du Koweït en 1991 s'avérera dans les faits un véritable massacre, dont les victimes se compteront à quelques centaines pour les Américains et leurs alliés et à plus de 100 000 du côté irakien. Il en ira de même pour la seconde guerre du Golfe en 2003, justifiée par la présence présumée d'armes de destruction massive dont l'existence ne sera jamais prouvée et qui ne « fut, note Dassas, qu'une vaste mise en scène indigne d'Hollywood ». On pourrait en dire autant pour l'Afghanistan tenu pour responsable de la destruction des tours de New York en septembre 2001, dont l'invasion sera considérée comme nécessaire et juste sous prétexte qu'al-Qaïda y avait son QG.
Cette lucidité et cette vigilance sont également présentes dans l'analyse que propose l'auteure de la guerre entre la Russie de Poutine et l'Ukraine. Dans ce conflit, elle donne tort à Poutine et, dans une moindre mesure, à Zelensky pour son nationalisme guerrier, guère porté, comme son adversaire, à des compromis et elle prône une « trêve », afin de comprendre un peu mieux les fondements historiques et politiques de cette guerre qui apparaît absurde et impensable à première vue. Cela permettrait de s'interroger notamment sur le rôle de l'OTAN dans cet affrontement, engagement qui implique une généralisation de la guerre, un accroissement des armes et, du coup, du nombre de morts. Cela permettrait également de réfléchir sur la russophobie qui s'est emparée de l'Occident au point de s'en prendre à la culture russe, autrefois louangée, et devenue objet de suspicion dont il convient de se méfier. Bref, elle propose des nuances qui s'opposent à la seule logique guerrière au nom de la complexité et de la nécessité de savoir sans donner raison pour autant à Poutine et à sa volonté impériale.
Sur un autre plan, bien que féministe convaincue, Dassas s'interroge sur la nécessité de la présence des femmes dans les armées revendiquée au nom du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. S'adressant à ses amies féministes, elle affirme que cela ne justifie pas « qu'il nous faille passer par toutes les institutions que les hommes ont taillées à leur image en nous conformant à leurs règles, à leurs perversions, à leurs barbaries ». Et elle conclut : « je pense que l'armée, comme la police, ne sont pas faites pour les femmes », car ce sont des « institutions massacreuses ».
Féministe inorthodoxe ?
Cette conception souple du féminisme sous-tend son analyse de la critique féministe du film célèbre de Denys Arcand, Le déclin de l'empire américain, qui fut l'objet de controverses passionnées au moment de sa sortie en 1986. Succès de salle, note Dassas, le film devient bientôt « succès de salon » qui fait beaucoup jaser dans les chaumières du Québec, y compris dans le camp des féministes. On lui reprochera entre autres de reprendre à son compte des représentations sexistes et éculées de la femme qui sont une caricature de sa condition réelle dans la vie sociale. En cela, le film constituerait une sorte de mensonge, sinon une trahison, des femmes et de leurs combats pour l'émancipation et du coup son auteur est considéré comme conservateur, sinon réactionnaire, et profondément machiste.
Cette critique contient une part de vérité, bien entendu, mais elle est limitée, remarque Dassas, par les « simplifications de l'idéologisme » qui s'en tient aux représentations explicites des femmes sans tenir compte du regard et de la vision du monde du cinéaste, essentiellement pessimiste et qui n'épargne pas davantage les hommes, relevant plutôt d'un cynisme généralisé en ce qui a trait à la condition humaine et à l'avenir d'un monde voué au déclin. « Les choses sont plus complexes », note l'auteure, que ce que met en relief une certaine critique féministe qui insiste davantage sur la justesse (ou non) des représentations des femmes que sur le fondement qui la soutient : une vision profondément satirique et critique de la décadence non seulement de l'empire américain, mais du type de civilisation mortifère qu'il répand sur l'ensemble de la planète.
La venue à l'indépendantisme
On retrouve cette attitude nuancée dans le traitement que réserve Dassas au nationalisme qu'elle associe d'emblée à la xénophobie, voire au racisme, et qu'elle perçoit sur le mode de la tragédie, sous la forme du fascisme ou du national-socialisme davantage que sous celle des luttes pour la décolonisation.
C'est la situation du Québec où elle arrive dans les années 1970 qui lui fera connaître la dimension positive de l'indépendantisme dans sa phase progressiste que lui présentent des amis de gauche : « Et moi qui n'aimais ni le peuple, ni les nations, ni les élections, écrit-elle, je devins indépendantiste par sympathie. » L'adhésion à l'indépendantisme, favorisée par la contagion amicale, vaut toutefois dans la mesure où elle est une composante d'une lutte plus générale pour l'émancipation qu'elle retrouve dans le PQ des débuts, dont elle prendra ses distances lorsqu'il paraîtra s'engager dans le nationalisme identitaire qui émerge déjà au début des années 1980 et qui s'imposera au premier plan dans les années récentes. Elle s'inscrit donc dans le courant indépendance-socialisme prôné par Parti pris, revue phare des années 1960 et qui innerve le RIN et le PQ dans sa période d'émergence.
Sur tous les sujets qu'elle aborde, Dassas propose une analyse fine et pénétrante reposant sur un fond de scepticisme qui favorise un questionnement critique qui s'exprime toutefois sur le mode empathique. Les exemples évoqués ici, prélevés sur un large corpus, en témoignent de même que les « exercices d'admiration » qui constituent la deuxième partie de son livre.
Éloge des singularités
Les personnages évoqués dans cette partie se distinguent par leur profonde humanité ou leur destin original et parfois fantasque. J'en retiens ici deux à titre d'exemples parmi une dizaine décrits par l'auteure.
Primo Levi, auteur de Si c'est un homme [2], incarne le premier cas de figure. Détenu durant la dernière année d'existence d'Auschwitz, il a décrit la condition effroyable des prisonnier·ères dans un enfer qui n'a d'autres lois et d'autres règles que celles de la survie à tout prix, y compris au détriment des autres incarcéré·es. Dans cet univers insensé, il n'y a que deux sortes d'individus : ceux que l'on considérerait dans la vie ordinaire comme des profiteurs qui recourent à tous les moyens pour demeurer vivants, y compris au détriment des autres qui, pour leur part, en raison de leur vulnérabilité et de leur faiblesse, sont voués à devenir des « musulmans », c'est-à-dire des morts-vivants condamnés à une mort aussi indigne que certaine.
Dans le camp, il n'y a pas de troisième voie, de conduite qui permettrait de vivre dans la décence. On survit dans l'infamie et grâce à la chance davantage que par le courage et le mérite. Du moins c'est la conclusion que Levi tire de son expérience à Auschwitz et qui la rend particulièrement éclairante pour Dassas.
Le personnage de Patrick Straram pourrait apparaître comme l'envers, le négatif du portrait de Levi, endossant plutôt celui de l'intellectuel excentrique et irresponsable. Français et parisien, issu d'une grande famille bourgeoise, il déserte l'école et la famille au profit de la vie de bohème dans les clubs et les bars de Saint-Germain-des-Prés dès l'adolescence. En 1958, il s'installe à Montréal où il se fait rapidement connaître dans le milieu culturel, se liant d'amitié avec tout ce qui compte dans cet univers en ébullition. Il s'implique à la revue Parti pris dans laquelle il tient une chronique significativement intitulée « Interprétations de la vie quotidienne ». Ce sont surtout des textes autobiographiques dans lesquels il s'explique sur sa quête de l'absolu à travers des conduites extrêmes comme ses fameuses « dérives », déambulations accompagnées de beuveries, qui lui donnent une image de délinquant intellectuel qui fascine certain·es et qui en rebute d'autres.
Il est ensuite attiré par la contre-culture. Il aime le mode de vie de ses adeptes axé sur l'importance de la vie quotidienne et la place qu'elle accorde au sexe, aux drogues et autres pratiques de la marge. Et il vit de petits contrats et d'expédients, devenant de plus en plus pauvre et malade au fil des années, sombrant dans le désespoir et mourant de ses excès en tous genres qui comportent une dimension suicidaire.
Par sa trajectoire, Straram incarne à sa manière la figure de l'écrivain maudit. Il est admiré par Dassas parce qu'il fait partie des rares individus qui agissent selon leurs convictions, sans compromis, quitte à payer un lourd tribut. C'est cette détermination qu'elle met en relief et qui n'est pas le moindre mérite d'un personnage haut en couleur, dans son œuvre comme dans sa vie.
* * *
Le livre de Véronique Dassas s'offre comme un témoignage passionnant, autant dans sa dimension critique que dans son éloge de ceux et celles qui se proposent toujours de transformer le monde dans les périodes favorables comme dans celles rongées par le doute et le désespoir. Il évoque à sa manière fine, souple et nuancée la transition qui s'opère entre la période des grandes espérances des années 1960-1980 et celle des grandes déceptions que nous connaissons aujourd'hui à travers les événements et les acteurs qui l'ont marquée pour le meilleur et pour le pire. En quoi, elle offre, de manière pointilliste, une fresque historique qu'on a tout intérêt à connaître pour mieux saisir les enjeux auxquels nous sommes actuellement confronté·es.
[1] Véronique Dassas, Chronique d'un temps fou, Montréal, Lux éditeur, 2023.
[2] Primo Levi, Si c'est un homme, Paris, Robert Laffont, 1996. Publié en italien en 1947.
Illustration : Elisabeth Doyon

Les déchirures. Essais sur le Québec contemporain

Alex Gagnon, Les déchirures. Essais sur le Québec contemporain, Del Busso, 2023, 350 pages.
Dans Les déchirures, le docteur en littérature Alex Gagnon propose quatre « essais sur le Québec contemporain », qui sont en fait des analyses de discours assez techniques portant sur quatre objets de polémique des dernières années : les chroniqueurs de droite du Journal de Montréal, l'ouvrage L'empire du politiquement correct, de Mathieu Bock-Côté, le « Manifeste contre le dogmatisme universitaire » paru dans le Devoir en 2020, et l'affaire Lieutenant-Duval. Gagnon affirme d'emblée qu'« avoir des opinions [… l']'intéresse peu » (p. 10). Il préconise plutôt une approche « descriptive » (p. 11) surtout fondée sur les théories discursives de Marc Angenot et sur la sociologie des champs de Pierre Bourdieu.
L'auteur applique plus ou moins la même méthode à ses quatre sujets. Pour chacun, il identifie deux camps, et cherche à faire ressortir les similarités et les différences dans le style argumentatif. Son travail n'est pas strictement descriptif ; il se permet des critiques, surtout envers le côté « droit » des polémiques (Richard Martineau, Bock-Côté, et le Manifeste), et dans l'affaire VLD, il prend clairement le parti de la liberté académique. Mais il trouve le moyen d'y adosser le côté « gauche » et parfois, cela donne des incongruités, comme le rapprochement des styles de Bock-Côté et de Francis Dupuis-Déri (p. 106-8), ou l'acharnement sur une pétition de gauche radicale somme toute insignifiante comme principal interlocuteur des pro-VLD, alors que pourtant, la plupart des interventions publiques contre l'usage sans retenue du « mot en N » furent modérées et constructives.
Il y a une forte intention chez Gagnon de se placer au-dessus de la mêlée, mais comme il ne s'intéresse pas vraiment au contexte sociopolitique (sauf pour l'affaire VLD, qu'il décrit assez bien), cela nous donne un portrait de la polémique au Québec où les antagonistes ne valent pas mieux l'un que l'autre. Il termine l'ouvrage avec une présentation plutôt intelligente des théories de Bourdieu, mais il surestime gravement l'« effet de classement ». Pour lui, « les membres d'une société prennent les positions idéologiques qu'ils “choisissent” […], non pas pour elles-mêmes, parce qu'ils les trouvent vraies ou justes, mais pour l'identité sociale qui s'y rattache » (p. 342). Gagnon insiste là-dessus : les « polémistes » de tous côtés ne croient pas vraiment ce qu'ils disent, tout cela ne serait qu'un jeu sémantique de classement et de déclassement (p. 344-345). Qu'en est-il alors de son propre travail ? Il affirme à la toute fin qu'on peut faire de la « science » en valorisant « l'usage idéal de la raison » comme marqueur identitaire (p. 346). Il croyait s'en sortir, mais tout le monde dans le champ polémique affirme faire usage de raison contrairement à leurs adversaires obnubilés par les idéologies…

Monocultures de l’esprit

Vandana Shiva, Monocultures de l'esprit, Éditions Wildproject, 2022, 196 pages.
Au départ, je me disais qu'il s'agissait certainement d'un livre sur la culture au sens de musique, écriture, images, etc. Même si cette analogie y trouve tout autant des pistes critiques et résistantes, il s'agit d'un recueil de cinq essais acérés concernant l'agriculture au sens large comme, seuls, selon cette autrice physicienne de renom, militante écologiste et écoféministe indienne d'influence mondiale, les savoirs traditionnels la conçoivent. La question du « développement », supportée par les vérités colportées par une science occidentale vouée aux diktats économiques – plus particulièrement capitalistes –, fausse lamentablement notre rapport macroscopique à la terre et à la Terre, en instillant nombre de biais mortifères et, finalement, non seulement contreproductifs, mais également délétères au point de rendre stériles les meilleures terres agricoles. Un de ces biais consiste à considérer en silo l'agriculture et la foresterie qui, dans les faits, sont intimement interreliées. La culture du sapin de Noël, comme on cultive les laitues, peut faire rigoler, mais rappelons qu'il s'agit là d'une énième variante de cette pensée scientifique frelatée… Évidemment, de marginaliser, voire d'éjecter les savoirs ancestraux « véritablement durables » plonge des millions de personnes dans la pauvreté. Incidemment, dans ce livre tonique et limpide, l'autrice appelle nommément à une « insurrection des connaissances subjuguées par la démocratisation des savoirs légitimant la diversité ».

Le privilège de dénoncer

Kharoll-Ann Souffrant, Le privilège de dénoncer, Remue-ménage, 2022, 120 pages.
Dans ce petit essai percutant né aux Éditions du Remue-ménage, l'autrice féministe Kharoll-Ann Souffrant, collaboratrice d'À bâbord ! dont les travaux de recherche et les interventions publiques portent sur les croisements entre racisme anti-noir, genre et violences sexuelles, s'adresse à ses consœurs survivantes de violences sexuelles.
Le privilège de dénoncer nous initie au concept de « misogynoire », encore peu utilisé au Québec : cette misogynie raciste pratiquée envers les femmes et les filles noires. En se basant sur ce concept, Kharoll-Ann Souffrant décortique pourquoi et comment les femmes et les filles noires sont invisibilisées dans l'espace public lorsqu'on parle de violences sexuelles : elle nous entretient des impacts actuels de l'esclavage et du colonialisme, du sexisme, des graves carences du système de justice quand il est question de violences sexuelles, des stéréotypes liés à la sexualité des femmes et des filles noires, etc.
Kharoll-Ann Souffrant démontre que les femmes et les filles noires sont invisibilisées en tant que survivantes de violences sexuelles, mais qu'elles sont aussi invisibilisées au sein de la lutte contre les violences sexuelles et au sein du mouvement féministe dominant en nous rappelant (ou nous apprenant, c'est selon) que le mot/mouvement #MeToo a été originalement lancé en 2007 par une femme noire, Tarana Burke, pour dénoncer les violences sexuelles perpétrées envers les femmes racisées. Mais qui sait cela aujourd'hui ?
D'entrée de jeu, Kharoll-Ann Souffrant nous fait aussi connaitre son choix juste et assumé de ne pas faire sienne la honte que les agresseurs et le système veulent imposer aux victimes de violences sexuelles, le premier chapitre de l'ouvrage étant une dénonciation de tous ceux – institutions et individus – qui n'ont pas agi pour l'appuyer et contre son agresseur alors qu'elle était jeune adolescente.
La honte doit changer de camp, on ne le dira jamais assez. Et pour ce faire, il faut absolument élargir la compréhension sociale des violences sexuelles en prenant en compte l'intersectionnalité des oppressions, ce concept honni par le gouvernement Legault. Cet ouvrage nous presse de le faire.

La rébellion est-elle passée à droite ?

Pablo Stefanoni, La rébellion est-elle passée à droite ?, La Découverte, 2023, 220 pages.
Ne prenons pas quatre chemins : La rébellion est-elle passée à droite ? est un livre nécessaire qui doit se retrouver sur le chevet des forces militantes progressistes. Dans cet essai remarquablement bien appuyé par une recherche de grande qualité, Pablo Stefanoni, historien et journaliste au Monde diplomatique et à la revue Nueva Sociedad, propose un portrait des diverses forces, idées et discours actuels de l'extrême droite. L'originalité de son approche réside dans le fait que Stefanoni prend acte de la grande diversité des idées, groupes et discours qui composent la nébuleuse de la nouvelle droite « dure » (nationalisme radical, paléolibertarinisme, misogynie violente, écofascisme, suprémacisme blanc, islamophobie, pour n'en nommer que quelques-uns) pour montrer comment ces divers « topoï » (p. 278), bien qu'en apparence distincts, se rejoignent pour former des alliances surprenantes.
Ainsi, si Stefanoni montre comment le libertarianisme classique s'est rapproché des classes moyennes et prolétaires américaines, sous l'impulsion de Myrray Rothbard, en devenant un « paléolibertarianisme », soit une défense du tout au marché couplé avec des valeurs conservatrices dures (famille, Église), sa démonstration se complète en montrant comment les idées paléolibertariennes percent d'autres sociétés que celles des États-Unis, comme l'Argentine, grâce aux efforts de diffusion de Javier Milei, ou le Brésil et l'Espagne, par l'entremise de Agustin Laje. Et grâce aux efforts de ces derniers, les idées paléolibertariennes auront même fini par ensemencer les politiques de Jair Bolsonaro ou du parti d'extrême droite espagnol Vox (p. 186), où on devine que le tout au marché libertarien finit par défendre un nationalisme dangereux aux implications autoritaires.
Ces rencontres et liens, Stefanoni les multiplie : des nouvelles formes de nationalisme à la peur paranoïaque du « marxisme culturel », le « politiquement incorrect » comme manière à la fois de dénoncer les prétentions à l'égalité et de choquer pour polariser à outrance les débats, de la normalisation des droits LGBT à l'islamophobie ou du nationalisme grincheux à l'écologie et les idéologies new age, le livre de Stefanoni permet à une gauche confuse de mieux saisir l'adversaire qui lui fait face.
Le livre de Stefanoni s'inscrit en effet dans un bilan pessimiste et négatif de la gauche. Force est de le constater, ce qu'on nomme la gauche s'est rangé, souvent bien malgré elle, à défendre le « capitalisme tel qu'il est contre le capitalisme tel qu'il menace de devenir » (p. 30-31). La capacité de s'indigner et de canaliser les forces vives de la colère serait passée de la gauche, devenue partisane de l'establishment néolibéral, aux mouvances réactionnaires, qui dénoncent l'alliance du pouvoir traditionnel avec les forces progressistes et réformistes.
Que faire alors ? En proposant une exploration des articulations des différents discours de la nouvelle droite, on comprend finalement que le moyen ne réside peut-être pas à établir un « populisme de gauche », reflet progressiste du populisme réactionnaire (p. 278). Cette stratégie a échoué notamment parce qu'elle ignorait les articulations propres à la nouvelle droite réactionnaire. Toutefois, l'exploration de Stefanoni révèle justement ces articulations, et comment elles sont fragiles : peut-être est-il temps de se moquer des nouveaux thuriféraires de la droite (p. 280), d'opposer le rire cinglant à leur venin, plutôt que l'indignation qu'ils attendent déjà. Loin d'être une simple soupape esthétique, cette stratégie permettrait de dé-polariser le débat et de montrer la droite dure pour ce qu'elle est : une opération de manipulation (p. 34).
À voir comment réagissent nos propres bonzes québécois de la réaction, les Martineau, Bock-Côté ou Rioux, dès qu'on élève un peu la voix contre eux, cette proposition rieuse mérite d'être considérée bien sérieusement.

La fin du néolibéralisme. Regard sur un virage discret

Claude Vaillancourt, La fin du néolibéralisme. Regard sur un virage discret, Écosociété, 2023, 197 pages.
Va-t-on enfin voir la fin du néolibéralisme ? Au regard des crises récentes, le crash financier de 2007, le réchauffement climatique et la COVID-19, on ne peut que l'espérer. Malgré son titre choc, le dernier livre de Claude Vaillancourt décrit plutôt un virage discret dans notre monde actuel, avec ses opportunités et ses dangers.
Le propos est convaincant. Le cadre idéologique qu'offrait le néolibéralisme depuis les années 1980 a perdu de son attrait. On ne peut plus aujourd'hui affirmer sans ombrage que des politiques de libre-échange, de laissez-faire, de privatisation ou d'austérité vont engendrer, de façon automatique, un avenir meilleur. De plus en plus de personnes se rendent compte, en effet, que de telles politiques accentuent les inégalités, ne garantissent pas l'accès à des produits essentiels et sont nuisibles pour la planète. Aussi, les grandes firmes transnationales, comme les GAFAM, les entreprises pétrolières ou les grands groupes financiers sont régulièrement critiqués pour leurs manquements à l'éthique, leurs fraudes fiscales et leurs contributions aux problèmes écologiques.
Malgré ces critiques, les changements substantiels se font cependant attendre, affirme Claude Vaillancourt. Le monde d'hier était surtout polarisé entre la vision néolibérale du développement et celle, plus minoritaire, des altermondialistes. Pour l'auteur, deux tendances se dessinent actuellement : la croissance d'un discours progressiste timoré dans la majorité des partis, de centre droit et de centre gauche, et la montée des partis d'extrême droite, décomplexés. Signe des incertitudes actuelles, les votes aux dernières élections dans de nombreux pays se sont répartis entre quatre ou cinq partis. C'est le cas au Québec, malgré la victoire de la CAQ surtout pour des raisons de mode de scrutin, et en France. Aux États-Unis, les deux grands partis se sont partagés entre les partisans de Trump et les autres républicains, et entre les partisans de Bernie Sanders et les démocrates de Joe Biden.
Après cette analyse politique, l'auteur se livre à une lecture sociologique de notre société. En six courts chapitres, il couvre la dangereuse montée de l'extrême droite dans de nombreux pays, l'ouverture à la diversité parfois pour des raisons mercantiles, l'hystérisation de la communication et l'hypermultiplication des médias, la place grandissante que certaines entreprises multinationales prennent dans nos vies, l'hégémonie culturelle des États-Unis malgré ses excès, et le péril bien réel du réchauffement climatique après des décennies de mensonge et de lobbyisme.
Sortir du virage discret et entrer dans l'ère « post-néolibérale », propose Claude Vaillancourt, demandera de nouvelles stratégies de militantisme. Si la fin du néolibéralisme apporte son lot d'incertitudes et de dangers, elle libère aussi les esprits et les actions potentielles. L'auteur conseille aux mouvements sociaux de ne pas tomber dans le piège des divisions internes, mais de rallumer l'élan commun, éteint par la pandémie. Il suggère aussi d'inventer des stratégies différentes pour contrer l'extrême droite. Venant d'un militant avec plus de 20 ans d'expérience, membre du conseil du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ), président d'Attac-Québec et membre du collectif d'À bâbord, ce livre offre des analyses et des conseils précieux.
Le plan de Ford pour enrichir les plus grands promoteurs de l’Ontario
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











