Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Jean-Baptiste Fressoz : « La transition énergétique n’a pas commencé »

Les discours sur la transition sont des leurres : celle-ci n'a pas été amorcée, explique l'historien Jean-Baptiste Fressoz. Au lieu de « fantasmer sur un monde zéro carbone en 2050 », il faudrait une décroissance matérielle.
Tiré de Reporterre.
Jean-Baptiste Fressoz est historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Il vient de publier Sans transition — Une nouvelle histoire de l'énergie (Seuil).
Pour écouter l'entretien.
Reporterre — La transition énergétique n'a pas lieu, selon vous. Quel est le problème ?
Jean-Baptiste Fressoz — La transition est l'idée que l'on va changer de système énergétique en 30 ou 40 ans pour faire face à la crise climatique. Mais si on l'analyse historiquement, on voit à quel point cette notion a introduit des biais scientifiques. Nous n'avons pas fait de transition du bois au charbon pendant la révolution industrielle, par exemple. La révolution industrielle, ce n'est pas du tout une transition, c'est une énorme expansion matérielle.
En 1900, l'Angleterre, un très grand pays minier, engloutissait chaque année 4,5 millions de m3 de bois pour servir d'étais dans les galeries de mines. Or, les Anglais en brûlaient 3,6 millions de m3 dans les années 1750. Donc uniquement pour extraire du charbon, les Anglais utilisaient plus de bois en 1900 qu'ils n'en brûlaient en 1750.
Le pétrole n'a pas succédé au charbon, alors ?
Non, c'est une vision erronée. Par exemple, le pétrole sert à faire rouler des voitures. Or, dans les années 1930, pour fabriquer une voiture, il fallait environ 7 tonnes de charbon, c'est-à-dire autant en poids que le pétrole qu'elle brûlait durant son existence.
Pour réduire le minerai de fer, il faut du coke, dont la production consomme énormément d'énergie, qui a longtemps été entièrement du charbon. Aujourd'hui encore, on produit 1,7 milliard de tonnes d'acier par an. Si on voulait le faire « vert », il faudrait 1,2 million d'éoliennes. Et si l'on voulait le faire par l'hydrogène, il faudrait la quantité d'électricité produite actuellement par les États-Unis.
- « Mon argument n'est pas technophobe. [...] La sobriété est la clé »
Plus qu'une addition d'énergies, il s'agit d'une expansion symbiotique. Jusque dans les années 1960, il était impossible d'extraire du charbon sans bois. Il faut retenir une chose de l'industrialisation : on a consommé une plus grande variété de matières et chacune a été consommée en quantité supérieure. Et si des matières diminuent, c'est en raison des interdictions : par exemple, l'amiante a dû diminuer entre 40 et 50 % depuis les années 1990.
Vous plaidez pour une histoire matérielle, au sens que le monde est fait par les matières...
Si l'on veut réfléchir sérieusement à la crise environnementale, il est indispensable de centrer le discours non pas sur les techniques, mais sur les quantités de matière. Le point important, c'est que toutes les matières croissent en dépit de plein d'innovations.
Tous vos prédécesseurs en matière d'histoire de l'énergie se sont-ils trompés ?
Les experts n'ont pas parlé de transition jusque dans les années 70, ils voyaient bien qu'il n'y avait pas d'éviction du charbon. Ce sont les futurologues qui ont commencé à en parler, et les historiens ont repris le vocabulaire technocratique à partir des années 80. Ils ont été influencés : vous êtes historien de la machine à vapeur, et d'un seul coup, vous vous transformez en historien de la transition. C'est beaucoup plus chic !
À l'heure actuelle, la transition n'a toujours pas lieu et malgré l'essor des énergies renouvelables, les fossiles représentent toujours 80 % de la consommation énergétique mondiale...
Oui, c'est à peu près stable depuis les années 1980. On n'a toujours pas passé le pic du charbon ni celui du pétrole. Il y a encore énormément de ressources fossiles. Pour l'instant, nous n'avons pas commencé la transition énergétique. Ce qu'on a fait grâce aux progrès technologiques, c'est réduire l'intensité carbone de l'économie : il faut deux fois moins de CO2 pour produire 1 dollar de PNB [produit national brut] que dans les années 1980. Mais en volume, les fossiles sont plus importants maintenant qu'alors.
Pourquoi l'idée de transition énergétique est-elle si populaire ?
Le discours de la transition est d'abord un discours de « l'âge » : l'âge du charbon, l'âge de la vapeur, l'âge de l'électricité, l'âge du pétrole. C'est un discours classique de promotion industrielle. Cela permet de situer une nouvelle technologie dans la grande fresque de l'humanité. Le problème est que les intellectuels ont pris ces propos au sérieux.
On s'est mis à parler de « l'âge de la vapeur » dans les années 1860, cela permettait de marginaliser la force humaine. Les ouvriers étaient présentés comme des résistants au progrès, la modernité comme la rencontre du génie avec la matière. Ensuite, à la fin du XIXᵉ siècle, au moment où l'électricité a commencé à faire parler d'elle, parler d'un âge électrique permettait de faire un geste assez classique dans le monde intellectuel, celui de la tabula rasa, de la table rase d'où l'on repart.
Comment est-on passé au concept de transition ?
Après 1945, un groupe de savants s'est mis à parler de transition : les atomistes américains du projet Manhattan [de création de la bombe atomique]. Un calcul avait été fait, montrant le rendement extraordinaire de la surgénération nucléaire. Ces savants voulaient montrer que ce qu'ils avaient inventé n'était pas simplement un outil de mort catastrophique, mais aussi la clé de la survie de l'humanité. Cela permettrait d'avoir une énergie abondante, illimitée. Ensuite, durant la décennie 1970 et les chocs pétroliers, la notion de crise énergétique s'est diffusée, ainsi que celle de transition énergétique.
Le président étasunien Jimmy Carter a joué un rôle clé dans cette diffusion, par un grand discours le 18 avril 1977. Il a dit : « Par le passé, nous avons déjà fait deux transitions énergétiques du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. Maintenant il faut faire une troisième transition. » Ce qu'il prévoyait, c'est le doublement de l'extraction de charbon aux États-Unis. Il y aura moins de pétrole, eh bien, on va sortir plus de charbon et on va le liquéfier.

Puis, quand Ronald Reagan a succédé, son équipe sur l'énergie était dirigée par un pétrolier texan dont le grand programme était de libéraliser et de forer davantage, en affirmant que le prix du pétrole allait baisser grâce au marché et à l'innovation. C'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, avec le gaz de schiste. La transition ne voulait plus dire grand-chose, sinon ce qui permet d'augmenter l'indépendance énergétique américaine.
Mais les écologistes ont commencé à reprendre ce vocabulaire qui naturalise les décisions énergétiques, qui est une invention du lobby atomiste, et qui est une antiphrase de la crise environnementale.
Le groupe 3 du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) explique dans son dernier rapport que la transition, c'est bien, et qu'on va y arriver.
Le Giec est un groupe intergouvernemental, pas international. C'est très important : cela signifie que les gouvernements désignent qui participe à cette instance. Lors de sa création, en 1988, les États-Unis — qui étaient de très loin les premiers émetteurs de CO2 — ont désigné pour le groupe 3 des représentants des ministères de l'Industrie, de l'Énergie, de l'Agriculture. Il fallait qu'ils internalisent la contrainte économique et c'est le rôle de ce groupe. Les États-Unis vont y faire miroiter la carte technologique comme moyen de la transition.
- « On pourrait arrêter pas mal d'avions sans qu'il ne se passe grand-chose »
Résultat, il a fallu attendre le sixième rapport en 2023 pour qu'il y ait un chapitre sur la sobriété. L'autre problème est qu'ils ont enfourché des options technologiques rocambolesques comme le stockage du carbone. Et là, je pense qu'il y a une influence du lobby pétrolier.
S'il n'y a pas de transition énergétique, que faire face à la catastrophe écologique ?
La première chose à faire, c'est avoir un regard réaliste sur ce qu'on peut faire technologiquement. Mon argument n'est pas technophobe. Il y a des progrès technologiques importants dans certains domaines, comme le solaire. Mais on ne saura pas décarboner certaines choses avant 2050, comme le ciment, l'acier ou le plastique. La sobriété est la clé. Il est indispensable de reconnaître qu'une des questions centrales est le niveau de production.
Le solaire va coûter très peu cher. Mais si c'est pour faire rouler des voitures électriques en masse qui, elles, ne sont pas du tout décarbonées, ça ne change pas le problème. Il faut toujours fabriquer la voiture, qui est de l'acier, et l'acier reste du carbone. Il faut juger l'énergie solaire dans un système en général, qui pose problème. Mon livre n'est pas une critique des renouvelables, mais de l'idée de transition énergétique : il faut replacer les renouvelables dans l'ensemble du système qu'elles vont alimenter.
Alors, comment aller vers la sobriété ?
Il faut arrêter de raconter des bêtises. Quand nos gouvernements martèlent l'idée que la décroissance est une idiotie, qu'il y a du découplage, qu'on va faire des avions à hydrogène zéro carbone, forcément, la population a envie de le croire. C'est très attirant comme perspective. Mais si l'on n'a pas un discours sérieux sur cette question, on ne fera jamais de sobriété.
La question va monter, c'est inévitable au fur et à mesure que le mur climatique va s'affirmer, que les chocs climatiques vont se répéter et que les objectifs de décarbonation deviendront parfaitement utopiques. La sobriété va devenir de plus en plus importante.
Une nouvelle histoire commencerait, celle de la décroissance ?
Quand je dis sobriété, je pense à la décroissance matérielle. On pourrait arrêter de construire des routes en France sans que cela soit une catastrophe. On pourrait arrêter pas mal d'avions sans qu'il ne se passe grand-chose, on l'a vu pendant le Covid, nous ne sommes pas morts de faim.
Pourquoi subsiste-t-il un tel espoir dans la technologie ?
En raison d'une focalisation inouïe du discours sur l'innovation. On a confondu l'innovation avec le phénomène technique en général, qui est beaucoup plus massif et large. De quoi a-t-on vraiment besoin ? Comment se répartit-on les bienfaits du carbone et les impacts ?
On peut dédommager massivement des populations qui ne pourront plus habiter là où elles habitent et imaginer les accueillir. C'est de cela dont il faudrait discuter et non pas fantasmer sur un monde zéro carbone en 2050.

Sans transition — Une nouvelle histoire de l'énergie, de Jean-Baptiste Fressoz aux éditions du Seuil, janvier 2024, 416 p., 24 euros.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Dénationalisation de l’électricité – Des organisations dénoncent un recul historique et exigent un véritable débat public
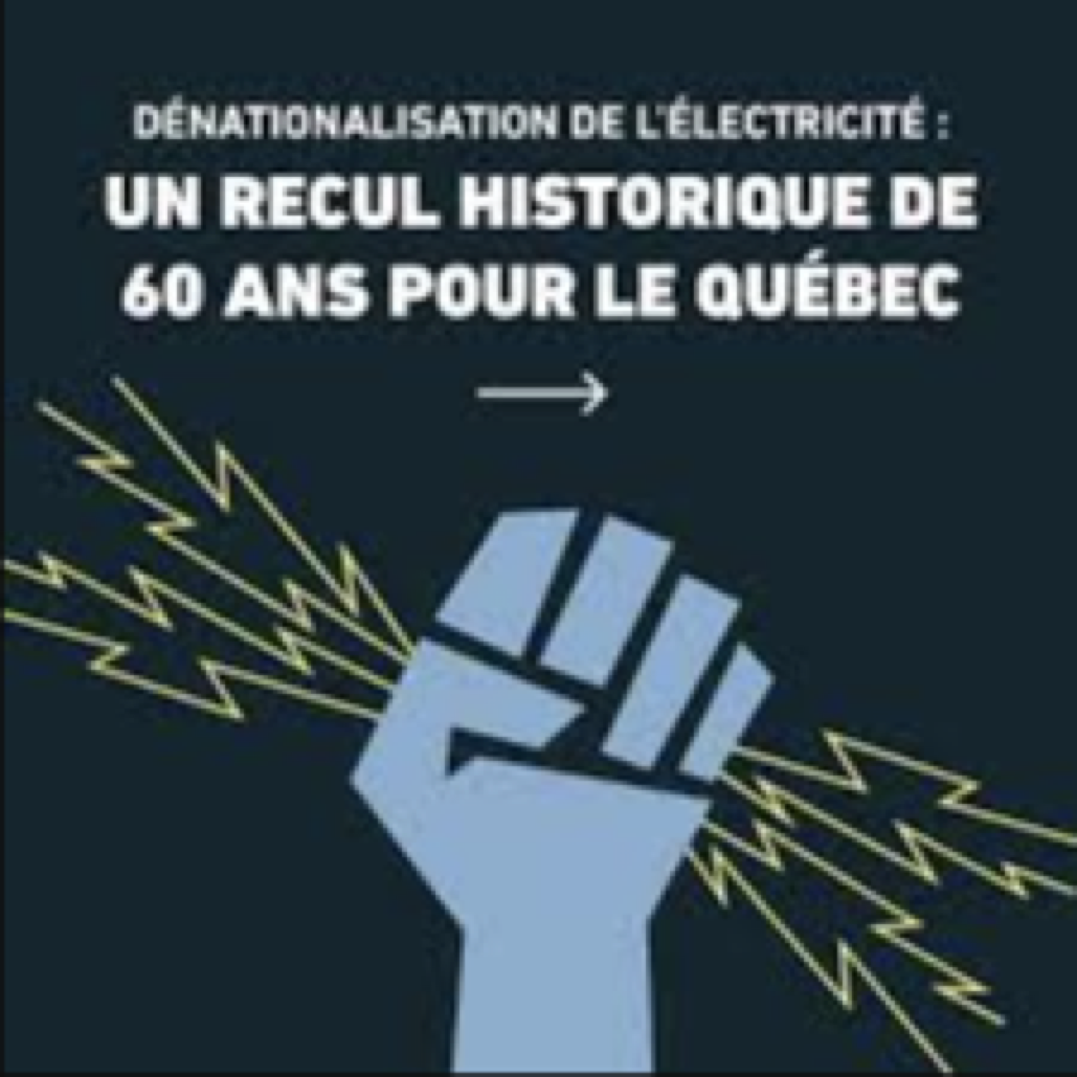
Des organisations de la société civile réagissent à l'intention du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, de déposer un projet de loi qui légaliserait la vente directe d'électricité entre entreprises privées, ce qui est actuellement interdit, et mettrait ainsi fin au monopole d'Hydro-Québec. Les organisations affirment que la proposition de dénationaliser l'électricité est un recul historique qui nous ramène 60 ans en arrière, alors que le gouvernement Legault n'a pas reçu le mandat de fragiliser ce service public essentiel qui est d'importance stratégique pour l'économie et la sécurité énergétique du Québec. L'importance des enjeux énergétiques exige qu'un véritable débat public ait lieu de manière à ce que les décisions soient prises dans l'intérêt collectif.
60 ans d'histoire et la décarbonation du Québec sont en jeu
À qui appartient la légitimité de décider de l'usage du territoire et des ressources limitées ? Selon l'approche du gouvernement, les projets industriels accapareront de façon non planifiée et non coordonnée les équipements, la main-d'œuvre, les territoires les plus économiquement avantageux et propices à la construction de nouvelles infrastructures électriques, ainsi que les retombées économiques qui y sont associées, le tout sans consultation de la population. En plus, ce manque de planification se répercuterait sur l'effort demandé et sur la facture d'électricité de l'ensemble de la population. « La population n'a jamais donné à la CAQ le mandat de renverser la décision collective prise il y a 60 ans de nationaliser l'électricité. Avant toute modification législative, il faut un plan d'ensemble et un vrai débat de société pour définir les orientations de ce plan. C'est la décarbonation du Québec, dans une perspective de transition juste, qui est en péril », soutiennent les organisations.
L'ensemble de cette situation – tout comme les pratiques douteuses employées pour soustraire d'autres dossiers comme celui de Northvolt au débat public et aux obligations environnementales – illustre dramatiquement la nécessité de tenir rapidement un exercice légitime de dialogue social sur l'avenir énergétique du Québec. Cette demande, exprimée publiquement et directement au gouvernement depuis maintenant plus d'un an par une centaine d'organisations de la société civile québécoise, reste lettre morte à ce jour. Face à ce silence, les groupes ont renouvelé leur demande, le 30 novembre dernier, en présentant à l'Assemblée nationale le Manifeste pour un avenir énergétique juste et viable, appuyé par le Parti Québécois et Québec solidaire. Plusieurs organisations ont également demandé un moratoire sur l'octroi d'électricité pour le développement industriel, le temps de se doter d'une politique énergétique et d'un plan intégré des ressources basés sur une consultation large et un débat démocratique. Cette politique et ce plan devraient être fondés sur une approche systémique incluant notamment les impacts environnementaux et sociaux.
« Une consultation en ligne, en plein été, sur un sujet restreint au développement et à l'encadrement des énergies renouvelables, ne dispense pas d'un vrai débat démocratique sur la question beaucoup plus large de l'avenir énergétique du Québec », insistent les groupes. Comme la nationalisation d'Hydro-Québec a fait l'objet d'une élection référendaire en 1962, les signataires appellent tous les groupes de la société civile à se mobiliser pour exiger que ce choix de société ne soit pas renversé arbitrairement par le gouvernement. Comme l'a synthétisé Boucar Diouf, « on n'a jamais voté pour ce qu'essaie de faire Pierre Fitzgibbon ».
*Listes des organisations signataires
Greenpeace Canada
Regroupement des organismes environnementaux en énergie
Fondation Rivières
Nature Québec
ACEF du Nord de Montréal
Mouvement écocitoyen UNEplanète
Eau Secours
Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)
Collectif Femmes pour le climat (CFC)
Solidarité Environnement Sutton
Fondation David Suzuki
Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)
Les AmiEs de la Terre de Québec
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
Collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec
Coalition Alerte à l'Enfouissement Rivière-du-Nord (CAER )
Association québécoise des médecins pour l‘environnement (AQME)
Attac Québec
Union des consommateurs
Mères au front
Regroupement vigilance hydrocarbures Québec
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À quand un plan de réduction des minéraux ? - Réaction au nouveau plan d’action 2023-2025 sur les « MCS »

Avec son deuxième Plan d'action en quatre ans publié aujourd'hui, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) du Québec vient de faire passer de 22 à 28 le nombre de minéraux qu'il considère comme « critiques et stratégiques ». Tout en soulignant les mesures liées au recyclage des résidus miniers, la Coalition Québec meilleure mine (QMM) est d'avis que seul un encadrement plus rigoureux de ce secteur pourra limiter les impacts des activités minières sur l'environnement.
La Coalition QMM déplore et dénonce l'écoblanchiment entourant les minéraux « critiques et stratégiques » en rappelant que toutes les mines entraînent des impacts nocifs et permanents sur l'environnement. Le plan annoncé devrait être financé non pas par l'argent des contribuables mais en appliquant plus sévèrement le principe pollueur-payeur dans le secteur minier. La Coalition QMM invite le gouvernement à réfléchir à un plan de réduction de l'importance accordée aux minéraux qui ne sont pas considérés critiques ou stratégiques comme l'or.
Compétition entre MCS et l'or
En alimentant depuis 2020 une rhétorique d'écoblanchiment, le gouvernement du Québec souhaite voir émerger plus de mines produisant des « MCS », mais la province a une capacité réelle limitée pour opérer plusieurs mines en même temps. Tôt ou tard, le développement des MCS risque de se buter aux autres mines.
La Coalition observe une concurrence en matière de financement et d'attractivité des travailleur-euse-s au sein de l'industrie entre les minéraux dits « d'avenir » et le secteur de l'or et des autres métaux précieux qui ne sont pas listés comme des minéraux critiques et stratégiques.
À titre d'exemple, 92% de l'or est extrait à des fins de joaillerie ou financières et n'a donc que très peu d'utilité dans la réduction des GES selon l'Accord de Paris. Les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec publiées en octobre 2023 révèlent que les métaux précieux représentaient 64,1% des sommes en travaux d'exploration et de mise en valeur en 2022, pour un total de 585 M$, soit plus de cinq fois les sommes investies par le privé pour le lithium, le graphite et les terres rares. Peu importe les substances recherchées, la Coalition Québec meilleure mine insiste sur le fait que les mesures les plus efficaces pour l'environnement reposent sur la réduction à la source de la production et de la consommation des minéraux.
Avant de chercher à pousser le développement des « MCS », le gouvernement devrait amorcer une réflexion sur l'avenir des minéraux qui nuisent non seulement directement aux efforts climatiques, énergétiques et environnementaux de la province, mais à la viabilité des projets qui pourraient avoir une contribution positive. Pour soutenir et planifier la suite de leurs économies, il est urgent d'établir un dialogue avec les communautés de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec au sein desquelles les mines d'or et de diamants s'imposent.
Meilleure utilisation des fonds publics
Avec ses multiples mesures de soutien et ses 18 millions de dollars additionnels, le gouvernement multiplie les avantages fiscaux et administratifs offerts aux minières avec l'argent des contribuables du Québec. La Coalition QMM encourage plutôt l'État à financer le plan d'action par une application plus rigoureuse du principe pollueur-payeur dans le secteur minier.
Le soutien aux minières qui prétendent faire partie de la solution environnementale devrait être financé à partir d'une tarification environnementale plus exigeante pour ce secteur industriel. La pollution de l'air et de l'eau, l'extraction de métaux précieux non classés comme « critiques ou stratégiques », la contamination des sols, le prélèvement de l'eau et l'application de sanctions plus sévères sont autant d'avenues de taxation à considérer.
Dans l'attente du plan pour encadrer l'industrie minière
La Coalition QMM demeure dans l'attente du dépôt d'un projet de loi modifiant la Loi sur les mines en rappelant que le Rapport des consultations du printemps 2023 réalisées par le MRNF est sans équivoque à l'effet que la population demande une réforme ambitieuse au bénéfice de l'environnement et des gens. Cette réforme devrait amener les parlementaires à revoir la place accordée aux secteurs de l'industrie minière qui ne font pas partie de la solution face à l'urgence climatique et environnementale.
Citation
« La solution à la crise climatique ne passe pas par plus de mines, mais par le choix d'extraire seulement les minéraux utiles dans les quantités suffisantes pour répondre aux vrais besoins dans un meilleure encadrement environnemental et social », Rodrigue Turgeon, avocat, co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine et coresponsable du programme national pour MiningWatch Canada
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bilan, analyse de la conjoncture en environnement et plan d’action

Bonjour,
Ceci est un rappel que le Réseau Militant Écologiste est de retour avec l'édition 2024 de son Assemblée Générale Annuelle ! Ce sera l'occasion de parler du plan d'action pour l'année 2024 et d'élire un nouveau comité de coordination.
Déroulement :
Accueil, tour de table
Retour sur l'année 2023
Présentation de la conjoncture
Plan d'action
Avenir énergétique (privatisation d'Hydro-Quebec)
Extractivisme (campagne sur les claims miniers)
Filière batterie (Northvolt)
Élection du COCO
Voici un lien vers la proposition sur l'avenir énergétique=AT1sCow_BjGDiwhIPp7P8Sgipybg8deYEqS9uz0aZPVBQIMNEbwT2blwrVDdaRPVkH3g7PT7_xGmO0IQnMaNgoWHh17afSS2JGMH7Gfhl6sm6t7k1CZMtx0f7pBz5_WXzLleUy2suY2GvIkSKa5YJu0NHmMU] qui a été élaborée par le RMÉ en 2023 et le manifeste du front commun pour la transition énergétique.
Un texte sur la conjoncture en matière d'environnement sera aussi présenté, accompagné du plan d'action élaboré par le COCO pour l'année 2024.
Vous pouvez lire ces documents avant la réunion, ils faciliteront notre discussion sur le plan d'action.
Lien Zoom de la réunion — mercredi 31 janvier à 19h
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Françoise Vergès : l’impossible décolonisation des musées occidentaux

Retour en vidéo sur la rencontre avec Françoise Vergès, autrice décoloniale, féministe et antiraciste pour une soirée d'échange autour de son ouvrage « Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée », au centre culturel d'Uccle (Belgique), le 15 janvier 2024. Cette soirée a réuni environ 200 personnes.
23 janvier 2023 | tiré du site du CADTM
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Black Art Exposition à Quebec

Traore Ben Sayd, en collaboration avec la Fédération des Jeunes Afro-Québécois (FJAQ) et le gouvernement du Canada, est fier d'annoncer la tenue de la deuxième édition de la Black Art Exposition Quebec. Sous le signe de la reconnaissance et de la célébration, cet événement artistique unique se tiendra le 24 février 2024, de 18h à 23h, à la Nef Saint Roch, située au 160, rue St-Joseph Est, Quebec QC G1K 3A7.
Québec, QC — 26 janvier 2024
Cette année, dans le cadre du Mois de l'Histoire des Noirs, la Black Art Exposition mettra en lumière la femme noire et son influence déterminante dans le domaine artistique. Cette soirée exceptionnelle sera une vitrine pour le talent et la créativité des artistes noirs du Québec, offrant une plateforme d'expression et de reconnaissance de leur art.
Les visiteurs auront le privilège de découvrir une gamme diversifiée d'œuvres d'art visuel, de participer à un atelier de collage dynamique et de se laisser transporter par une performance live captivante. Cet événement gratuit est une opportunité pour les amateurs d'art et le grand public de s'engager avec la culture noire et d'en apprécier la richesse et la diversité. La réservation en ligne est obligatoire pour participer à cet événement. Les billets peuvent être réservés dès maintenant, assurant à chacun une place dans cette célébration de l'art et de la culture.
Informations supplémentaires :
• Date et Heure : 24 février 2024, de 18h à 23h
• Lieu : La Nef Saint Roch, 160, rue St-Joseph Est, Québec QC G1K 3A7
• Réservations :
https://lepointdevente.com/billets/blackartexposition2?fbclid=IwAR2778tixLRw2CWN s56207mKTsJq-vuY34z8T021QaDekZXWhX3YEd-P7m8
Nous invitons à participer à la mise en valeur de l'art noir et de la femme noire au sein de notre société. Rejoignez-nous pour une soirée où l'art est célébration, la créativité est dialogue et la femme noire est muse.
À propos de Traore Ben Sayd : Initiateur de la Black Art Exposition Quebec, Traore Ben Sayd est un acteur clé dans la promotion de l'art noir au Québec, œuvrant à mettre en avant les artistes noirs et leur contribution essentielle à la diversité culturelle de la province.
À propos de la FJAQ : La Fédération des Jeunes Afro-Québécois est une organisation dédiée à la valorisation de la jeunesse noire au Québec, soutenant l'épanouissement et la représentativité de ses membres dans tous les domaines de la société.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Art ouvrier et embourgeoisement à Chicago

“Le syndicat Union Electric (UE) de Chicago appelle à signer unepétition afin de protéger une murale réalisée dans ses locaux, en 1974, par les artistes, John Pitman Weber et José Guerrero.”
« Avec l'embourgeoisement du quartier, [Union Electric] est en train de vendre le bâtiment vieillissant, mais travaille dur pour préserver la peinture murale pour la communauté de Chicago et les générations futures. Veuillez signer cette déclaration avant le 31 janvier afin de démontrer aux bailleurs de fonds potentiels qu'il existe un large soutien en faveur de la préservation de cette partie vitale de l'histoire ! ».
Des photos d'un article du Chicago Suntime permettent d'apprécier cette fresque, réalisée gratuitement par les deux artistes autodidactes et restaurée au milieu des années 2000 à l'occasion d'une convention de l'UE à Chicago. Cette imposante œuvre d'art qui borde les escaliers intérieurs de l'immeuble du syndicat, retrace les luttes ouvrières aux États-Unis, une distribution de tracts devant une usine, un patron contraint de signer un contrat, la répression des travailleurs par un sheriff, un général, le Klu Klu Klan etc.
En août 2019, le président du Syndicat prophétisait que le plus grand danger pour la préservation de la fresque n'était pas l'usure et le temps mais la « gentrification » du quartier et avec elle la nécessité pour le syndicat de vendre l'immeuble. Il précisait cependant « nous ne sommes pas en train de solliciter des offres » d'achat.
À peine quatre ans plus tard, l'immeuble est en vente. En l'absence de mobilisation, la préservation de l'œuvre d'art semble donc désormais dépendre du bon vouloir de promoteurs immobiliers et de leurs goûts pour l'art ouvrier.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Juifs et Israéliens : deux réalités de plus en plus distinctes
L'offensive israélienne se déchaîne à Gaza et le nombre de victimes gazaouies se multiplie.
C'est le résultat de la riposte israélienne démesurée à l'offensive du Hamas réalisée le 7 octobre 2023. Il y aurait environ 24,000 victimes gazaouies selon les chiffres fournis par le Hamas contre 1,200 israéliens le 7 octobre.
Les Israéliens peuvent mener une guerre aussi meurtrière que prolongée parce qu'ils disposent d'un État appuyé par la plupart des gouvernements occidentaux et doté d'une armée puissante, équipée dans une bonne mesure par les États-Unis, indéfectible soutien de l'État hébreu.
Mais précisément, qu'observe-t-on concernant l'évolution de la société israélienne ? Plus le temps passe, et plus les différences s'accentuent entre elle et les minorités juives dispersées en Occident, particulièrement aux États-Unis. Quand une société possède un État indépendant (surtout s'il s'est édifié aux dépens d'un autre peuple) et qu'elle est entourée de gouvernements qui ne lui veulent pas de bien, elle se transforme. Ce processus relève à la fois d'une évolution interne et des relations avec les pays avoisinants. On est alors en présence d'une majorité qui doit assumer la responsabilité de la gestion d'un État souverain.
Une distance se creuse peu à peu avec les minorités occidentales dont elle est issue. D'où le contraste entre la société indépendante qu'est Israël et les minorités juives. Contrastes et ressemblances s'y côtoient. Ajoutons y la présence d'une importante minorité arabe (les Arabo-Israéliens) appelée à croître avec le temps et à gagner de l'influence politique et culturelle, ce qui va contribuer à renforcer l'évolution de la différenciation déjà évoquée.
Lorsqu'elle possède une armée puissante comme celle d'Israël et qu'elle se sent menacée, ses dirigeants et toute une large partie de son opinion publique peuvent appuyer des initiatives militaires d'envergure sans tenir compte du nombre de civils que cela provoque chez l'ennemi, peu importe le bon droit de ce dernier, dont celui à la résistance. Un virulent désir de vengeance se remarque alors.
Quand on parle de Juifs, la paranoia rôde souvent. Mais il existe une différence fondamentale entre les persécutions dont ils ont été l'objet en Europe et les manifestations de la résistance d'un peuple (les Palestiniens) dépossédé par les sionistes.
Il faut souligner ici que tous les Juifs ne sont pas sionistes et que tous les sionistes ne sont pas Juifs. Une partie de ces derniers s'oppose au sionisme pour des motifs religieux, philosophiques et moraux.
On voit souvent à priori les Juifs comme d'éternelles victimes (les pogroms l'Holocauste, les ghettos). Mais des nuances et des bémols s'imposent. En effet, il a toujours existé une violence juive. Les Juifs ont leurs propres salauds : des financiers véreux et des criminels professionnels. Il faut y joindre un fanatisme religieux chez certains (transposé sur le plan politique par plusieurs sionistes), pas plus respectable qu'aucun autre fanatisme. Il en découle chez certains Juifs un racisme anti-arabe et antimusulman, qu'on dénonce peu. Il est plus que temps de le faire.
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

J’espère

J'espère
J'espère que vous serez là, encore,
Vous qui n'acceptez pas de vous taire,
Vous qui n'avez pas renoncé,
Vous qui vous êtes battues,
Vous qui savez pourquoi,
Vous qui ne vous laissez pas berner,
Vous qui ne vous laissez pas acheter.
Vous qui pleurez de rage,
Vous qui rêvez.
J'espère
J'espère que nous trouverons,
Le chemin du changement,
Le chemin du respect,
Que de notre colère,
Ne nous grugera pas,
Mais qu'elle sera fertile,
Que les chansons semées
Sur les trottoirs gelés
Seront un jour charpente
Du monde
Qui reste à bâtir.
J'espère
Que vous serez là,
Encore,
Quand viendront d'autres temps.
Manon Ann Blanchard

Déni de réalité : pourquoi le climatoscepticisme progresse

Les discours niant le dérèglement climatique foisonnent. À force d'outils efficaces, les
climatosceptiques prospèrent et sont loin de vouloir s'arrêter, explique le chercheur Albin Wagener.
Tiré de Reporterre.net
15 janvier 2024
Par Albin Wagener
Albin Wagener est chercheur associé à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco, Plidam) et au laboratoire Prefics de l'université Rennes 2.
C'est un paradoxe de notre époque : alors que les effets du changement climatique sont de plus en plus couverts par les médias et n'ont jamais été aussi saillants pour les populations, le climatoscepticisme reprend lui des forces au gré de l'actualité climatique. D'après un sondage mené par Ipsos et le Cevipof en 2023, ce sont 43 % de Français qui refusent de « croire » au réchauffement du climat.
Plusieurs fois annoncé comme dépassé ou cantonné à des sphères complotistes, le climatoscepticisme n'en finit pas de se régénérer. Si les origines de ce courant remontent aux États-Unis, il prospère chez nous aujourd'hui via des incarnations bien françaises, comme l'a montré le récent documentaire La Fabrique du mensonge sur le sujet. Tâchons donc de revenir un peu en arrière pour comprendre le succès actuel de ces discours niant le dérèglement climatique.
Une narration efficace
Dans les années 1980, aux États-Unis, l'émergence et la propagation d'une « contre-science » du climat ont résulté de la mobilisation de think tanks liés au parti républicain et au lobbying de grandes entreprises, principalement dans le secteur de la production pétrolière, en s'inspirant par ailleurs des pratiques de l'industrie du tabac.
Le terme de « climatoscepticisme » est, à cet égard, lui-même aussi trompeur que révélateur : en liant « climat » et « scepticisme », le terme donne l'impression d'une posture philosophique vertueuse (notamment la remise en question critique et informée), et induit en erreur. Car il s'agit ici bien moins de scepticisme que de déni, voire de cécité absolue vis-à-vis de faits scientifiques et de leurs conséquences, comme le rappelle le philosophe Gilles Barroux.
Mais qu'importe : au moment de l'Accord de Paris et du consensus de plus en plus large sur le climat, le climatoscepticisme semblait réduit à portion congrue : en France, en 2019, la Convention citoyenne pour le climat montrait que le sujet pouvait être pris au sérieux tout en donnant lieu à des expérimentations démocratiques. Puis en août 2021, la loi Climat et Résilience semblait ancrer un acte politique symbolique important, bien qu'insuffisant.
« Je ne crois pas au changement climatique », a écrit l'artiste Banksy sur une façade d'un immeuble de Londres, près d'une eau stagnante rappelant une inondation. Flickr/CC BY-NC 2.0 Deed/Dunk
Pourtant, malgré ces évolutions politiques, le climatoscepticisme prospère aujourd'hui en s'éloignant de son incarnation et champ originel, puisqu'il constitue désormais une forme de discours, avec ses codes, ses représentations et ses récits. C'est précisément en cela qu'il est si dangereux : du point de vue linguistique, narratif et sémantique, il utilise des ressorts hélas efficaces, qui ont pour objectif d'instiller le doute (a minima) ou l'inaction (a maxima).
« Préserver la domination de l'Homme sur ce que l'on appelle abusivement la « Nature » »
Plus clairement, les sphères climatosceptiques vont par exemple utiliser des termes aux charges sémantiques équivoques (climatorassurisme, climatoréalisme, etc.), remettre en question la véracité des travaux du Giec [1], mettre en exergue les variations du climat à l'échelle du temps géologique (la Terre ayant toujours connu des périodes plus ou moins chaudes ou froides), ou bien encore expliquer que toute action mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique relèverait en fait de l'autoritarisme liberticide. En d'autres termes, le doute est jeté sur tous les domaines, sans distinction.
De ce point de vue, il est important de noter que le climatoscepticisme peut prendre plusieurs formes : déni de l'origine anthropique du réchauffement, mise en exergue de prétendus cycles climatiques, remise en cause du rôle du CO2 ou technosolutionnisme chevronné sont autant de variables qui donnent sa redoutable vitalité au climatoscepticisme.
Lire aussi : Christophe Cassou : « Le climatoscepticisme a la couleur de l'extrême droite »
Mais que cachent les discours climatosceptiques ? Outre les intérêts économiques, on retrouve également la préservation d'un ordre social et de systèmes de domination spécifiques : domination de l'Homme sur ce que l'on appelle abusivement la « Nature » (incluant les autres espèces, l'intégralité de la biodiversité et les ressources), exploitation des ressources nécessaires à l'activité industrielle et économique, mais aussi domination de certaines communautés sur d'autres — notamment parce que les femmes ou les populations indigènes sont plus vulnérables au changement climatique, tout en représentant également les populations les plus promptes à proposer des innovations pour contrer ses impacts.
Des cibles et intérêts marqués
Au-delà de sa pérennité, les recherches ont montré à quel point le climatoscepticisme restait efficace pour retarder l'action politique. Il ne s'agit pas ici de dire que la classe politique est climatosceptique, mais qu'un certain nombre d'acteurs climatosceptiques finissent par diffuser des discours qui font hésiter les décideurs, retardent leurs actions ou font douter quant aux solutions ou alternatives à mettre en place.
La France n'échappe pas à cette tendance : entre les coups médiatiques de Claude Allègre, l'accueil de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale ou encore les incursions de divers acteurs climatosceptiques (se désignant eux-mêmes comme climatoréalistes ou climatorassuristes), le paysage médiatique, politique et citoyen se retrouve régulièrement pollué par ce type de discours.
Doté de solides ressources financières, ce mouvement a pu contester les résultats scientifiques dans la sphère publique, afin de maintenir ses objectifs économiques et financiers.
Le Giec en a, par ailleurs, fait les frais de manière assez importante — et encore aujourd'hui ; régulièrement en effet, des scientifiques du Giec comme Jean Jouzel ou Valérie Masson-Delmotte, qui se sont engagés pour porter de manière pédagogique les travaux collectifs dans l'espace médiatique, se sont retrouvés la cible de critiques, notamment sur la véracité des données traitées, ou la raison d'être financière du groupement scientifique mondial. Cela est notamment régulièrement le cas sur les réseaux sociaux, comme le montrent les travaux de David Chavalarias.
Prôner les certitudes d'un « vieux monde inadapté »
Au-delà de ces constats informatifs, une question émerge : pourquoi sommes-nous si prompts à embrasser, de près ou de loin, certaines thèses climatosceptiques ? Pourquoi cette forme de déni, souvent mâtinée de relents complotistes, parvient-elle à se frayer un chemin dans les sphères médiatiques et politiques ?
Pour mieux comprendre cet impact, il faut prendre en considération les enjeux sociaux liés au réchauffement climatique. En effet, cette dimension sociale, voire anthropologique est capitale pour comprendre les freins de résistance au changement ; si la réaction au changement climatique n'était qu'affaire de chiffres et de solutions techniques, il y a longtemps que certaines décisions auraient été prises.
En réalité, nous avons ici affaire à une difficulté d'ordre culturel, puisque c'est toute notre vie qui doit être réorganisée : habitudes de consommation ou pratiques quotidiennes sont concernées dans leur grande diversité, qu'il s'agisse de l'utilisation du plastique, de la production de gaz à effet de serre, du transport, du logement ou de l'alimentation, pour ne citer que ces exemples.
« Il est le symptôme d'autodéfense d'un vieux monde qui refuse de mourir »
Le changement est immense, et nous n'avons pas toujours les ressources collectives pour pouvoir y répondre. De plus, comme le rappelle le philosophe Paul B. Preciado, nous sommes dans une situation d'addiction vis-à-vis du système économique et industriel qui alimente le changement climatique ; et pour faire une analogie avec l'addiction au tabac, ce ne sont jamais la conscience des chiffres qui mettent fin à une addiction, mais des expériences ou des récits qui font prendre conscience de la nécessité d'arrêter, pour aller vite. Cela étant, le problème est ici beaucoup plus structurel : s'il est aisé de se passer du tabac à titre individuel, il est beaucoup plus compliqué de faire une croix sur le pétrole, à tous les niveaux.
Paradoxalement, c'est au moment où les effets du changement climatique sont de plus en plus couverts par les médias que le climatoscepticisme reprend des forces, avec une population de plus en plus dubitative. Ce qui paraît paradoxal pourrait en réalité être assez compréhensible : c'est peut-être précisément parce que les effets sont de plus en plus visibles, et que l'ensemble paraît de plus en plus insurmontable, que le déni devient une valeur refuge de plus en plus commode. Il s'agirait alors d'une forme d'instinct de protection, qui permettrait d'éviter de regarder les choses en face et de préserver un mode de vie que l'on refuse de perdre.
Si le climatoscepticisme nous informe sur nos propres peurs et fragilités, il est aussi symptomatique du manque de récits alternatifs qui permettraient d'envisager l'avenir d'une tout autre manière. En effet, pour le moment, nous semblons penser la question du changement climatique avec le logiciel politique et économique du XXe siècle. Résultat : des récits comme le climatoscepticisme, le greenwashing, le technosolutionnisme (le fait de croire que le progrès technique règlera le problème climatique), la collapsologie ou encore le colibrisme (le fait de tout faire reposer sur l'individu) nous piègent dans un archipel narratif confus, qui repose plus sur nos croyances et notre besoin d'être rassurés, que sur un avenir à bâtir.
De fait, le climatoscepticisme prospère encore, car il est le symptôme d'autodéfense d'un vieux monde qui refuse de mourir. Sans alternative désirable ou réaliste, alors que nos sociétés et nos économies sont pieds et poings liés par la dépendance aux énergies fossiles, nos récits sont condamnés à tourner en rond entre déni, faux espoirs et évidences trompeuses.
C'est bien là tout le problème : si les chiffres sont importants pour se rendre compte de l'importance du changement et de ses conséquences (y compris pour mesurer les fameux franchissements des limites planétaires), ce n'est pas avec des chiffres seuls que l'on met en mouvement les sociétés et les politiques. Les tenants du climatoscepticisme ont parfaitement compris cette limite, en nous proposant les certitudes confortables d'un vieux monde inadapté, face aux incertitudes paralysantes d'un avenir qui sera radicalement différent du monde que nous connaissons, mais que nous avons le choix de pouvoir écrire.
Cette tribune a été initialement publiée sur le site The Conversation.
1. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












