Derniers articles

Le génocide israélien à Gaza et « l’effondrement moral et éthique » selon le professeur Omer Bartov

Le professeur Bartov est un spécialiste des génocides et de l'holocauste. Il enseigne à l'Université Brown aux États-Unis. Il est un enseignant israélo-américain que le Musée du Mémorial de l'holocauste a décrit comme le leader des spécialistes mondiaux sur les génocides.
Democracy Now, 30 décembre 2024
Traduction, Alexandra Cyr
photo Serge d'Ignazio
Nermeen Shaikh : Pendant que 2024 va vers la fin, nous recevons plus de détails d'information de la part du ministère de la santé de Gaza. Il confirme que depuis le 7 octobre 2023, 108,000 Palestiniens.nes ont été blessés.es dans des attaques israéliennes. Plus de 45,500 ont été tués.es mais en réalité cest beaucoup plus que cela. Pendant ce temps, les représentants.es de Gaza continuent à accuser Israël de bloquer délibérément l'aide et l'UNRWA a avisé que la « famine approche » à Gaza où la population fait face à une grande insécurité alimentaire.
Cela se passe alors que des milliers de protestataires israéliens.nes demandent au gouvernement Netanyahu de mettre fin à cette guerre, de déclarer une cessez-le-feu et de ramener les otages encore aux mains du Hamas, au pays.
Notre prochaine invité, le professeur Omer Bartov, soutien qu'Israël mène une combinaison « d'actions génocidaires, de nettoyage ethnique et d'annexion de la bande de Gaza ». (…) Il est allé récemment en Israël et en est revenu ce mois-ci.
Professeur Bartov, soyez à nouveau le bienvenu sur Democracy Now. Pouvez-vous commencer par nous expliquer pourquoi vous pensez qu'un génocide est en marche à Gaza ?
Omer Bartov : Merci de votre invitation. (…) Comme vous devez le savoir, déjà en novembre 2023, j'ai publié une opinion dans le New York Times où j'écrivais que je croyais que les Forces de défense israéliennes (FDI) menaient des actions qui s'apparentaient à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais, je n'étais pas convaincu que les preuves étaient suffisantes pour parler de génocide. J'ai changé d'avis aux environs de mai 2024, quand la FDI a décidé, malgré l'opposition des États-Unis, d'envahir Rafa, la seule portion de la Bande de Gaza qui ne l'avait pas été. Il y avait là, environ un million de Palestiniens.nes qui avaient été déplacés.es plusieurs fois antérieurement. La FDI les a déplacés.es une fois de plus vers la plage, vers la zone de Mawasi où il n'y avait pas d'infrastructures adéquates du tout, seulement un camp de tentes le long de la plage et elle a procédé à la démolition de l'essentiel de Rafa.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à examiner toute l'opération en commençant par les déclarations faites par des dirigeants.es politiques et militaires israéliens.nes détenant une autorité d'exécution dès le début de la guerre les 7-8-9 octobre 2023. Ces déclarations affirmaient la volonté d'éliminer Gaza, de la détruire et que personne ne pouvait échapper à cette décision etc. etc. Il est devenu évident à ce moment-là, qu'il y avait une tentative systématique de rendre Gaza invivable et d'y détruire toutes les institutions qui rendent possibles la résistance d'un groupe non seulement physiquement mais aussi culturellement avec son identité et sa mémoire collective. Cela veut dire la destruction systématique des universités, des écoles, des mosquées, des musées et bien sûr des maisons et des infrastructures. Donc, ce qu'on pouvait voir alors c'était ce qu'on peut qualifier de destruction totale du milieu urbain, une tentative de détruire les centres urbains, de les détruire matériellement, de tuer les membres des institutions d'enseignement, des écoles, des professeurs.es d'université etc. Alors, la population qui a été déplacée tant de fois comme je vous l'ai dit plus tôt, dont un grand nombre a été soit tué, blessé ou affaibli ne pourra jamais se rétablir comme groupe dans cet endroit. C'est la dérive généralisée.
Mais, en octobre de cette année, un an après le début de la guerre, l'armée israélienne a commencé une opération dans le nord de Gaza, au nord de ce qu'on nomme le Corridor Nerzarim. En fait ce n'est pas un corridor, c'est une espèce de boite d'environ 5 milles de large sur 5 milles de long. Il s'agit de vider tout ce qui est au nord de ce corridor de sa population. C'est un plan qui a été mis de l'avant par un général retraité, M. Giora Eiland à la télévision israélienne quelques mois au paravent. Il s'agit de forcer toute la population à s'en aller par l'action militaire, par la famine en la privant de nourriture et d'eau. De fait, la majorité de cette population a été déplacée. Cette dernière attaque contre l'hôpital dont vous parliez plus tôt (dans l'émission), n'est qu'un pas de plus pour arriver à rendre cette zone libre de toute population.
Un ancien chef de cabinet du ministre de la défense, lui-même faucon en cette matière, a qualifié ce genre d'opération de nettoyage ethnique dans les médias israéliens. Mais, le nettoyage ethnique implique que vous déplacez une population, un groupe ethnique particulier d'un endroit où vous ne voulez pas qu'elle soit, vers un autre où elle sera au moins protégée de ces attaques. Mais, évidemment à Gaza, quand vous déplacez des gens d'un endroit à un autre prétendument sécurisé … il n'y a pas de ces dites zones sécurisées, ces personnes ne sont pas en sécurité et sont constamment soumises à des attaques. C'est ce qui fait que ces soit disant nettoyages ethniques font partie d'opérations génocidaires.
En ce moment, les médias israéliens traitent avec une certaine insistance la situation dans la portion nord de Gaza. Comme elle a été rasée et vidée de sa population, des groupes de colons attendent de l'autre côté de la clôture pour y entrer et démarrer une aire de colonisation avec le projet de l'occuper totalement. Et lorsqu'ils en seront là, après que l'armée les aura autorisés à entrer, je ne vois aucun mécanisme en Israël proprement dit, et même internationalement bien franchement, qui pourrait les en faire sortir. Ce serait donc le commencement d'une annexion rampante et de recolonisation puisque la zone aurait été vidée complètement de sa population palestinienne.
N.S. : Professeur Bartov je veux que vous nous parliez des facilitateurs de cette situation que vous appelé » génocide ». La semaine dernière la chroniqueuse Nesrine Malik publiait dans le Guardian sa chronique intitulée : Un consensus émerge : Israël commet en ce moment un génocide à Gaza. Que faisons-nous ? Elle condamne ce qu'elle appelle la complicité de l'Occident dans ce qui se passe actuellement à Gaza. Elle souligne : « Actuellement, les Palestiniens.nes sont en danger de mourir deux fois. Physiquement, et ensuite moralement parce les puissants.es restreignent les règles qui définissent le monde tel que nous le connaissons. En refusant la désignation de génocide et de nettoyage ethnique, en ne s'en occupant pas, les alliés d'Israël imposent au monde une adaptation après laquelle il sera possible de simplement accepter que les droits ne sont plus consacrés par l'humanité mais sont laissés aux mains de ceux et celles qui décident qui est humain ou non ». Professeur Bartov pouvez-vous répondre à cette opinion ? Comme vous dites qu'un génocide est en cours à Gaza, il ne serait pas possible sans la complicité et l'implication directe des pouvoirs occidentaux en particulier celui des États-Unis. Donc, en ce sens, mais aussi par association, ils sont aussi coupables de génocide ?
O.B. : (…) Je vais commencer par dire premièrement et par-dessus tout, que la population qui est la plus responsable de ce que fait Israël en ce moment, est la population israélienne. Il y a une profonde complicité entre cette population dont les partis d'opposition, avec ce que fait son gouvernement en le soutenant. Nous pouvons donc en parler.
Mais, bien sûr, Israël ne pourrait pas poursuivre son programme envers Gaza sans le soutien total particulièrement américain mais aussi européen dont l'Allemagne au premier chef mais aussi de beaucoup d'autres dont la France et le Royaume Uni. L'administration Biden aurait pu mettre fin à cette guerre aussi tôt qu'en novembre ou décembre 2023. Israël est incapable mener de telles opérations à cette échelle, sans l'aide constante des États-Unis qui lui fournit une énorme quantité de munitions sur une base quotidienne ; des tanks, des obus, et des intercepteurs de roquettes. Tout cela arrive en masse depuis les États-Unis au prix actuel d'environ 20 mille milliards de dollars des impôts des Américains.es. Si l'administration américaine avait dit à B. Netanyahu en décembre 2023 : « Vous arrêtez ça ou vous aller vous retrouver seul », il se serait arrêté parce que c'était simplement impossible qu'il continue seul. Mais ça n'a pas été fait.
Évidemment nous en voyons le résultat : premièrement, une destruction massive de Gaza. Ensuite c'est tout l'édifice des lois internationales mises en place dans la foulée de la deuxième guerre mondiale et l'holocauste, avec le Tribunal de Nuremberg en 1948 et les accords de Genève de 1949 et maintenant le Statut de Rome, en vue de prévenir la commission de génocides. Tout cet appareil est privé de son sens si un pays comme Israël, soutenu par ses alliés occidentaux, peut agir en toute impunité. Donc, des pays voyous dans le monde pourront conclure que si Israël le fait pourquoi-pas eux ? En ce sens, nous sommes face à un effondrement moral et éthique total dans les pays précis qui se disent protecteurs des droits civiques, de la démocratie, des droits humains dans le monde. Et une partie de cette catastrophe qui se passe maintenant va avoir de bien plus importantes ramifications dans le futur.
N.S. : Professeur, vous étiez en Israël le mois dernier. Vous avez parlé à bon nombre de personnes. Quelle est leur perception de Gaza selon vous ? Est-ce qu'il y a des critiques en ce moment ? Est-ce qu'elles sont plus vastes, évidentes par rapport aux actions d'Israël à Gaza qu'elles n'étaient plus tôt cette année, à l'été quand vous y étiez ou l'an dernier ?
O.B. : Oui, j'étais en Israël en juin 2024. Quand je parlais avec les gens à ce moment-là, pour la plupart des libéraux conventionnels ou de la gauche et que je mentionnais ce qui se passait à Gaza, je faisais face à une énorme réticence à juste en parler. Ces personnes étaient complètement envahies par le traumatisme et la peine suite à l'attaque du Hamas le 7 octobre précédent. 900 civils.es et plusieurs centaines de soldats.es y ont été tués.es.
Cette fois, quand j'étais en Israël le mois dernier, j'ai senti que plus de gens étaient au fait de ce qui se passe à Gaza même si la télévision israélienne, qui est encore totalement bloquée, ne donne volontairement aucune information sur Gaza. Tous ses reportages sont construits sur ce que lui transmet l'armée. Mais il y a eu des reportages dans les journaux et beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc plus de gens je pense, sont au courant de ce qui se passe là-bas.
Mais quelle est leur réaction à cela ? Je crois comprendre que le sentiment de résignation, de désespoir et de découragement sont grandissants dans ce cercle mais qu'on pourrait espérer qu'il devienne l'opposition principale aux politiques du gouvernement d'extrême droite.
N.S. : Professeur Bartov, je suis désolée mais nous devons nous arrêter maintenant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Palestine. En Cisjordanie, la brutalité des colons en roue libre

Si Gaza reprend sa respiration au lendemain du cessez-le-feu, le cauchemar continue dans les campagnes et les bourgs de Cisjordanie : des centaines de morts, des milliers d'agressions, des pillages sévères. Le harcèlement de colons grisés par l'impunité est terrible. Rencontres, en ce début 2025, en compagnie d'une délégation de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), avec des Palestiniens victimes de la volonté israélienne d'annexion. Mais qui refusent de s'avouer vaincus.
Tiré d'Orient XXI.
Orient XXI remercie ici la FIDH pour nous avoir proposé de l'accompagner en Palestine, et pour le travail d'information et de terrain qu'elle mène sur les sujets de droit international et humain. De notre envoyé spécial en Palestine.
En ces premiers jours de 2025, je parcours les routes de Palestine au pas de charge. Enfin, certaines routes. À côté du réseau traditionnel aux tracés antiques, comme souvent au Proche-Orient, les routes réservées aux colons transpercent le paysage, surélevées, grillagées, vidéosurveillées. Menaçantes, nombreuses et rapides, ces voies prioritaires rendent l'apartheid pratique, comme une application de transport. Ce paysage palestinien fragmenté, gravement altéré par la colonisation, les blocs de béton, les tourbillons de poussière, les traces de destructions, je le connais, je l'ai parcouru maintes fois ces dernières années. Pourquoi la Palestine semble plus moche, sale, triste qu'au printemps dernier. L'injustice y crève les yeux, étouffe comme le souffle de l'enfer. Ces voies de la discrimination sont laides. Elles sont un des signes qu'en Palestine tout s'enfonce dans l'inacceptable. L'indifférence du monde devrait donner à pleurer, si cela servait à soulager ma colère.
Les faits ne laissent aucun répit. Exécutions sommaires, passages à tabac, incendies de maison, destructions de fermes, saccages de terre, arrestations arbitraires… Responsables de cette rengaine quotidienne : des colons organisés en milices armées par le gouvernement et des soldats acteurs de la répression, complices des horreurs des dits-colons. Ce qui se déroule dans les profondeurs de la Palestine est « de pire en pire ». Tout le monde me le dit.
Pour la délégation de la FIDH que j'accompagne, la diplomatie de l'accolade est le signe de partage et de solidarité. Celles et ceux que l'on rencontre se forcent à sourire mais ont envie de hurler. « Comment vous-dites déjà ? Pénible [en français] », tente de plaisanter un homme dont le regard a perdu toute confiance, tandis qu'il étreint nos mains.
Cinq attaques par jour en moyenne
Les colons israéliens partagent les idéaux de l'extrême droite suprémaciste et religieuse mondiale. Ils combattent les Arabes, ce qui revient à chasser les Palestiniens (musulmans et chrétiens) de Cisjordanie. Pauvres, riches, paysans, bourgeois, citadins, ruraux. Les milices des colons ne font « plus de quartier », c'est leur mot d'ordre général. Ils auraient tort de se gêner, puisqu'ils sont encouragés par deux des plus puissants ministres de Benyamin Nétanyahou, Itamar Ben Gvir — qui a quitté la coalition gouvernementale suite à l'accord de cessez-le-feu à Gaza — et Bezalel Smotrich, eux-mêmes colons, comme onze des 29 ministres de l'actuel gouvernement. Un permis de massacrer délivré par des ministres, rabbins et généraux, dans une Sainte Trinité mortifère.
Entre le 7 octobre 2023 et le 7 octobre 2024, 1 654 attaques contre des civils palestiniens, perpétrées par des colons, ont été répertoriées dans les territoires palestiniens, soit presque cinq par jour, selon l'OCHA, le bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires. Résultat : 722 Palestiniens ont été tués « dans le contexte de l'occupation » sur la même période à Jérusalem-Est et dans les territoires, précise l'organisme onusien (1).
Certains Palestiniens, notamment à Jénine, ont quant à eux été tués par la police palestinienne, gangrenée par une complicité sécuritaire avec Israël qui écœure les Palestiniens. « Aidez-nous à nous débarrasser du Hamas et du Fatah », supplie un bourgeois de Ramallah. Des Palestiniens les jugent comme des pions dans les mains d'Israël, prêts à les sacrifier pour leurs intérêts idéologiques et économiques. « Et nous, on compte les disparus, on n'arrive même plus à dresser les listes de nos morts, déplore un Palestinien. On est des parias, les oubliés de l'humanité. » Un homme, croisé à Bethléem, n'a pas envie de parler de ses 18 ans passés en prison. Il y a plus de 5 000 prisonniers politiques palestiniens détenus par Israël. Selon l'ONG Addameer, on comptait 3 376 détenus administratifs au 7 janvier 2025 contre « seulement » 1 264 en septembre 2023.
Les Palestiniens tout le temps observés
En outre, les territoires sont quasi bouclés. L'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés, a été mise hors circuit par Israël. Un scandale politique et humanitaire de plus. Sa petite permanence à l'entrée du camp Ayda, à Bethléem, est fermée pour une durée indéterminée. Non loin de là, l'hôtel de Banksy prend la poussière. Seuls le hall et le petit musée de l'Occupation sont ouverts, mais personne n'y passe plus, les bobos australiens se sont évanouis. Ils débarquaient couverts de lin en Uber Berline et descendaient des cocktails sur la terrasse face au mur. Mais au moins ils venaient. Comme les pèlerins, totalement absents ces temps-ci, après le long coup d'arrêt du Covid. Bethléem se meure en sourdine et des malheureux vendent de misérables souvenirs aux rares étrangers de passage.

Un homme du camp d'Ayda, très sympathique, affable, d'une courtoisie répandue en Palestine, sourit tristement. Pour lui, la Palestine ne répond pas à la brutalité de l'occupant. « Depuis le début de la guerre à Gaza, on est bien obligés de se poser des questions sur notre mobilisation. On est trop faibles face à l'armée israélienne. Jeter des pierres sur des soldats n'est pas suffisant. » Il pense que les jeunes de Naplouse et de Jénine ont eu raison, les gens du Hamas aussi. Le temps des armes est venu. De plus en plus de Palestiniens s'interrogent.
Les colons, eux, ne doutent pas. Ils ont les armes, et s'en servent. Tous comme les soldats.
L'homme raconte la mort d'un enfant palestinien le 10 novembre 2023, dans la rue, devant tout le monde, transpercé par la balle d'un sniper. Les soldats ont embarqué le cadavre du garçon et l'ont rendu le lendemain à son père. Un peu plus loin, dans un repli du mur de séparation qui longe le camp, une base militaire israélienne, avec en permanence une vingtaine de soldats, nous observe. Ici, les Palestiniens sont tout le temps observés. Le jour venu d'un nouveau départ, qu'exigent les colons messianiques et leurs ministres, d'une nouvelle Nakba qui semble presque écrite, l'armée saura où trouver les valises pour accélérer le mouvement.
Nuits de barbarie
Malgré ses multiples fronts, cette armée a renforcé sa présence dans les territoires. Elle n'a nulle intention de « cesser-le-feu » en Cisjordanie. Elle reprend en main les checkpoints et multiplient les patrouilles, et laisse circuler les vendredis des hordes d'adolescents colons de 16 ans et moins. Ils disposent de cocktails Molotov et de gourdins. Les plus âgés qui les encadrent ont des armes. Ils boivent de l'alcool et attaquent dans l'ivresse, hurlant à la mort dans leurs nuits de barbarie. Ces instants effrayants sont saisis par les caméras de surveillance installées par l'ONG B'tselem et d'autres organisations des droits humains, comme Al-Haq.
Une victime, un bédouin, montre ses plaies encore purulentes infligées par des colons quatre jours plus tôt, vendredi 4 janvier 2025. Khaled Najjar, 71 ans, a l'allure épuisée d'un vieillard mais le regard pétillant. Il dénude son ventre, dévoilant une énorme boule noire. Il vit dans un hameau de Masafer Yatta, là même où a été tourné No Other Land. Au milieu de la nuit, les colons l'ont arraché à sa maison, qui avait été démolie par l'armée à plusieurs reprises. « Ils étaient trois au quatre, ils m'ont jeté au sol et ont commencé à me battre. » Ils avaient au préalable détruit la caméra d'observation installée par B'tselem.

Khaled a passé deux jours à l'hôpital, et ce n'est pas la première fois. « Je ne compte plus les fois où j'ai été blessé, j'ai passé des mois à l'hôpital. » Non loin, Bassel Adra, l'un des coréalisateurs de No Other Land, soupire. « Cela n'a pas commencé avec le 7 octobre, mais le harcèlement des colons est de pis en pis. Les autorités ne font rien pour le faire cesser. » Il est beau, triste, sympathique : ses combats sont là, sous nos yeux.
Face à nous, à quelques centaines de mètres, se trouve la colonie, anciennement « poste avancé », de Regavim. Et sur une autre hauteur, tout près de la maison de Khaled Najjar, un kiosque à musique a été édifié. Sur cette position dominante, les colons se retrouvent avant de passer à l'attaque, mettent la musique à fond, boivent, chantent et dansent.
À Jérusalem, les mêmes colons et leurs amis dansent parfois dans la rue, devant la gare Centrale, accompagnés de leur musique pop biblique et guerrière. Un passant, hors de lui, les traite de « fascistes ». Sa colère glisse sur la foule. Le tramway, un autre symbole de la colonisation (2), file dans la nuit. Il est à peine 23h, il ne transporte que de jeunes hommes pieux, farfadets farouches d'un autre temps, des gens parfois patibulaires, parfois juste fatigués, mais tous armés. Il y a aussi des soldat.e.s en armes qui soupirent les yeux au ciel. Rien ne va pour eux. Tout messianique qu'il soit, le bidasse israélien n'ignore pas que son destin est de finir en chair à canon. Des généraux et des rabbins nationaux-religieux hystériques lui disent toute la journée « Meurs pour Dieu et la patrie ! ». Le malheur des Palestiniens ne compte pas. Ou, pour être plus près de la vérité, ils s'en félicitent.
Ben Gvir et Smotrich ont la haute main sur les affaires militaires, civiles et financières des territoires occupés palestiniens (3). Ces proconsuls ricanent de leurs volontés meurtrières sur des télévisions de propagande, ébahis de voir à quel point les « alliés » d'Israël les laissent tranquilles. En outre, des rabbins les bénissent. Le « plus de quartier », c'est eux, repris par des milliers de personnes armées par Ben Gvir et Smotrich. Ils méritent l'un et l'autre la Cour pénale internationale (CPI) pour leurs appels répétés aux meurtres et aux pillages. Ces gens suivent leurs méfaits depuis leurs limousines blindées et climatisées, sillonnant des routes réservées. Leur vision du monde est en train d'anéantir la Palestine, sa douceur un peu brumeuse, les vapeurs de la Mer morte.
« On reconstruira »
Tous les Palestiniens ne vivent pas dans le dénuement des bédouins du sud. Turmus Ayya, un gros bourg de 3 000 résidents environ, au nord de Ramallah, a la caractéristique d'être peuplé à 80 % de Palestiniens ayant la nationalité américaine. Fortune faite aux États-Unis, ils reviennent et se bâtissent de gigantesques maisons entourées de précieux jardins tirés au cordeau. Parfois, ils financent une mosquée aussi chic qu'une synagogue de Beverly Hills. L'un d'eux, très élégant avec son blouson en daim et son pantalon à plis, a travaillé comme avocat en Californie. « Je suis revenu pour m'installer mais aussi pour résister », affirme-t-il avec sa courtoisie old fashion.
Il nous entraîne sur les hauteurs de la localité. On grimpe au cœur de la Palestine ancestrale, faite de champs d'oliviers tortueux et d'herbes folles incrustées entre les pierres. Deux jours avant notre passage, le 6 janvier 2025, un pavillon d'été construit au sommet d'une colline était incendié par les colons. Jouissant d'une vue magnifique, cette bâtisse récente de vastes dimensions faisait face à la colonie de Shilo, établie en 1979 sur des terres confisquées à Turmus Ayya, et qui compte 5 000 habitants. « On se retrouvait dans cette maison pour des occasions spéciales, avec de quoi s'amuser pour tout le monde », raconte le Palestino-américain. Il n'a pas besoin de grands discours pour afficher sa détermination : « On reconstruira. »
Cela ne sera pas forcément simple. Il n'ignore pas qu'en contrebas, dans la vallée, les bâtiments de Shilo s'étendent, s'approchent des merveilleux petits palais de Turmus Ayya. Plus de quarante maisons y ont été attaquées et parfois incendiées ces derniers mois.
Beita, convoitée par les colons
Sur la route de Naplouse, je retrouve Beita, où je me suis déjà rendu au printemps 2022. La population s'opposait frontalement aux colons qui, chaque vendredi, venaient les harceler. Quand une nouvelle colonie, Eyvatar, sur le mont Sabih, avait commencé à s'implanter près de Beita en 2021, les habitants s'étaient soulevés. Il y avait eu dix morts au cours de manifestations. Les colons d'Eyvatar avaient été évacués, mais sont revenus en 2022.

Avec 12 500 habitants, Beita est une commune aux contours compliqués, avec de nombreux vallons fertiles comptant des points d'eau qui attisent les convoitises des colons. Une dizaine de colonies, de tailles diverses, entourent Beita. Et depuis le 7 octobre, les affrontements sont incessants, et ont fait plus d'une dizaine de victimes. Sur une hauteur de Beita, Aysenur Ezgi Eygi, militante américano-turque, a été tuée par un sniper de l'armée le 6 septembre 2024. La jeune femme de 26 ans manifestait contre les colons. Ici aussi, « tout s'est aggravé depuis le 7 octobre », dit un habitant. Les morts, les destructions, le harcèlement.
Mosad Soufan a le malheur d'avoir sa ferme de Beita située à flanc de coteau, en contrebas de la colonie en pleine expansion de Yitzhar. À quelques mètres de ses fenêtres, une route neuve monte à la colonie, impeccable trait de velours presque fictionnel dans ce rude paysage. Pour aller à sa rencontre, on a dû monter un chemin pierreux, déplacer de lourdes pierres que les colons venaient de déposer pour isoler Mosad et sa famille. « Ils étaient là il y a deux heures, et ils nous observent », explique-t-il. Mosad raconte ensuite les nombreuses avanies subies par sa famille depuis des années. Il montre sur son téléphone les captures d'écran d'un groupe de colons qui se qualifient de « chasseurs de nazis ». Ils ont mis une cible sur son visage. Son chien, sympathique bâtard aux fines jambes, arrive en se traînant, abattu. « Les colons ont tenté de l'empoisonner, il y a deux jours », dit Mosad, s'excusant presque de tant de brutalité. Sur l'horizon orangé du crépuscule, nombre de lumières sont autant de promesses que de menaces. Mosad les connaît. C'est bientôt l'heure de se boucler pour la nuit. Jusqu'à la prochaine alerte.

Notes
1- De nombreuses données sont disponibles sur le site de la plateforme des ONG pour la Palestine, qui a collecté des données pour cet article.
2- NDLR. Le réseau de tramway construit à Jérusalem par Israël relie de manière illégale Jérusalem-Ouest aux colonies israéliennes implantées sur les terres palestiniennes de Jérusalem-Est. Deux entreprises françaises sont impliquées dans son développement : Alstom et Engis rail.
3- Lire à ce propos cet article qui pointe le coût des hausses des ressources des colonies : Pascal Brunel, « Israël : le financement des colonies de Cisjordanie déclenche une polémique », Les Échos, 28 novembre 2023.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Medine Mamedoğlu : Le journalisme au milieu de la violence étatiquo-masculine

TURQUIE / KURDISTAN – Les nombreux défis que pose le fait d'être kurde, femme et journaliste – que mes collègues femmes comprendront très bien – n'ont pas diminué au cours des dix dernières années.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Depuis de nombreuses années, la profession de journaliste est en proie à d'intenses violations des droits de l'homme et à des pressions, tant en Turquie qu'au Kurdistan. En période de troubles politiques, de crises économiques et de guerre, des dizaines de journalistes qui ont embrassé le rôle et la mission que la profession implique ont été assassinés, emprisonnés ou soumis à la torture. Ces pressions, qui ont atteint leur apogée dans les années 1990, perdurent encore aujourd'hui, même après 30 ans.
Des milliers de journalistes qui continuent leur travail en ajoutant l'éthique et la conscience aux principes traditionnels de QQOQCCP* subissent encore aujourd'hui ces pressions. La presse libre est en première ligne de cette lutte. Tout en essayant de porter à l'attention du public les violations et les tortures subies par la population, les travailleurs de la presse libre, qui ont été systématiquement pris pour cible par les pouvoirs en place à l'époque, ont été soit soumis à un harcèlement judiciaire, soit contraints de quitter le terrain sous la menace lorsqu'ils ont révélé la vérité au public. Des journalistes comme Ape Musa (Musa Anter), Hafız Akdemir et bien d'autres ont été assassinés simplement parce qu'ils exerçaient cette profession. Quand on regarde en arrière, on constate que les méthodes utilisées pour réprimer les journalistes aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 30 ans. Malgré le passage du temps, rien n'a changé dans ce pays. Comme les journalistes dont nous avons hérité, nous continuons à nous battre. Dans cette lutte, nous avançons sur le chemin en donnant la priorité à la vérité sans discrimination fondée sur la race, la langue, la religion ou le sexe. Les paroles et le travail de ceux qui ont payé le prix pour que ces vérités ne restent pas dans l'ombre continuent de guider notre chemin aujourd'hui.
Il n'est pas surprenant que nous ayons vécu une histoire semblable à celle que j'ai décrite en lisant, en écoutant ou en regardant. En fonction du climat politique du pays, les politiques du gouvernement envers les journalistes et la presse libre changent constamment. Alors que ces cycles se répètent depuis des années, les journalistes ciblés par la censure et le harcèlement judiciaire continuent d'écrire et de documenter malgré tout. Je suis l'une des femmes journalistes qui perpétuent cette tradition aux côtés de centaines de mes collègues dans mon domaine. J'ai commencé à travailler chez JINHA, la première agence de presse féminine au monde, en novembre 2015, alors que j'étais étudiante à l'université, à l'âge de 18 ans. Comme j'ai commencé pendant une période d'intense activité, je n'ai pratiquement pas passé de temps au bureau. Pendant cette période, j'ai suivi de près les processus de conflit à Sur et les mouvements sociaux à Amed. Lorsque j'ai commencé ma carrière, j'ai vécu, vu et écrit sur des choses que je n'aurais jamais pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Chaque reportage que j'ai écrit, chaque photo que j'ai prise et chaque personne dont j'ai écouté l'histoire m'accompagnent désormais comme une partie de mon expérience.
Être une femme journaliste sur le terrain
En plus des défis que représente le métier de journaliste, les pressions auxquelles nous sommes confrontées en tant que femmes journalistes kurdes au Kurdistan sont bien plus intenses. Les nombreuses difficultés qui accompagnent le fait d'être kurde, d'être une femme et d'être journaliste – que mes collègues femmes ne comprendront que trop bien – n'ont pas diminué, même après dix ans. Les politiques oppressives visant à la fois les femmes et le peuple kurde dans ce pays nous affectent à chaque étape de notre travail sur le terrain. Cette réalité n'est pas différente pour des milliers de femmes journalistes comme moi qui travaillent sur le terrain. Au début de ma carrière de journaliste de terrain, j'ai été témoin et victime directe de la violence des hommes, de l'État et du système judiciaire.
Pour donner un exemple récent, après la nomination d'un administrateur à la municipalité de Batman, notre collègue Pelşin Çetinkaya, qui couvrait les événements de la ville, a été arrêtée alors qu'elle avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle était journaliste. Elle a été agressée et insultée. Le même jour, nous avons également été empêchées de faire notre travail et menacées par la police.
Ce mois de novembre marquera mes neuf ans de carrière. Malgré toutes les pressions, les violences et les menaces auxquelles nous avons été confrontées pendant cette période, nous avons continué à écrire. Nous avons documenté et rapporté les violations et les injustices auxquelles est confronté le peuple kurde, dont le sort a été largement ignoré par l'opinion publique, dans toutes les régions où nous avons été présents.
Dans cette ère de politique répétitive, les politiques visant le public n'ont malheureusement pas changé, tout comme les pressions exercées sur la presse n'ont pas changé. Les mêmes personnes dont les villages ont été incendiés hier (…) sont aujourd'hui confrontées à des politiques d'écocide et de dépeuplement. Les journalistes qui ont été assassinés hier pour avoir écrit la vérité sont aujourd'hui emprisonnés pour les informations qu'ils écrivent.
Grandir à une époque où ces politiques demeurent inchangées et assumer la responsabilité de la vérité est pour nous une expérience honorable. Dans les moments où nous nous sentons mis au défi, épuisés ou désespérés, nous puisons une force renouvelée dans les luttes du passé. Car nous savons tous très bien que si nous n'écrivons pas, personne ne le fera. C'est pourquoi écouter et documenter les expériences de chaque femme, enfant, prisonnier et arbre – chaque être vivant – dans cette région est devenu pour nous plus qu'un simple métier. C'est parce que nous ne vivons pas dans une région normale et que nous ne traversons pas une période normale.
Impunité
Le prix à payer pour écrire la vérité et dénoncer la torture à notre époque est l'emprisonnement et un harcèlement judiciaire sans fin. Cependant, avant d'aborder le sujet des procédures judiciaires, j'aimerais partager quelques exemples de violences d'État masculines auxquelles j'ai été confrontée en travaillant sur le terrain, comme je l'ai déjà souligné. Alors que j'avais un appareil photo à la main et une carte de presse autour du cou, j'ai été agressée par des agents des forces de l'ordre lors de nombreuses manifestations et événements auxquels j'ai participé. Quelle coïncidence (!), ma première rencontre avec cette violence a eu lieu lors des célébrations de la Journée internationale des femmes en 2016. J'ai été agressée par deux policiers, puis j'ai failli être arrêtée pour avoir pris des photos de deux jeunes femmes qui étaient torturées et détenues de force.
Durant cette période, à un poste de contrôle de police dans le district de Sur où des affrontements faisaient rage, j'ai été soumise au harcèlement et à une fouille corporelle par une policière. À Sur encore, malgré un contrôle d'identité (GBT), j'ai été soumise à des violences verbales et physiques de la part de quatre policiers. Aujourd'hui, les femmes de cette région sont confrontées à de telles violences presque quotidiennement. Pour ceux qui lisent ces récits, ce que j'ai vécu peut paraître anormal ; au début, cela m'a semblé aussi anormal. Mais ces pratiques de torture, normalisées et systématisées par l'impunité, n'ont jamais cessé un instant. Le 8 mars 2017, j'ai de nouveau été confrontée à la même violence lors du tournage. Ce processus s'est ensuite poursuivi avec des enquêtes.
Au lendemain du tremblement de terre du 6 février 2023, qui a provoqué des dégâts considérables, j'ai travaillé dans des dizaines de villes. En particulier à Maraş et à Malatya, nos interviews ont souvent été entravées par la police. À Maraş, par exemple, alors que nous enregistrions avec deux collègues journalistes les réactions des citoyens qui disaient : « L'État n'était pas là », un policier a d'abord réprimandé les citoyens, puis a tenté de soulever une foule contre nous.
Violence numérique systématique
Pendant cette période, j'ai été la cible d'insultes et de menaces intenses sur les réseaux sociaux pour avoir dénoncé la négligence entourant ces événements. La violence des médias numériques a ajouté aux pressions auxquelles je faisais face sur le terrain. Pour les reportages que j'ai préparés pendant mes trois mois environ dans la zone du tremblement de terre, une enquête a été ouverte contre moi en février pour « diffusion publique d'informations trompeuses ». Je n'ai pas été informée de cette enquête, ni convoqué pour faire une déclaration. Je n'ai appris l'existence du mandat de comparution forcée que lorsque je me suis rendu dans un commissariat de police pour une plainte pour disparition, après quoi j'ai fait une déclaration au bureau du procureur.
Environ un an après cette enquête, après les élections locales du 31 mars, les mêmes menaces et tortures ont refait surface à Van, où un administrateur devait être nommé. J'ai reçu de violentes menaces de mort sur les réseaux sociaux pour avoir partagé des images d'un jeune homme de Hakkâri torturé par les forces de l'ordre pour avoir protesté contre ces actions. Le lendemain de ces menaces, alors que je couvrais une manifestation d'avocats à Van contre la confiscation des mandats des élus, j'ai été torturée et arrêtée alors que je tenais une caméra et portais une carte de presse autour du cou. Bien que j'aie déclaré à plusieurs reprises que j'étais journaliste, les forces de l'ordre ont essayé de briser ma caméra pour effacer les images de torture que j'avais enregistrées. Lorsque j'ai refusé de remettre ma caméra, j'ai été soumis à la fois à des violences physiques et à des insultes. Après avoir arraché ma carte de presse de mon cou, ils m'ont menottée dans le dos et m'ont arrêtée. L'enquête que nous avions ouverte concernant cet incident a été classée sans suite au motif que l'« intervention était proportionnée ».
Plusieurs mois après cet événement, un reportage que j'avais publié sur un incendie dans les districts de Mazıdağı et Çınar, qui avait fait 15 morts, a fait l'objet d'une autre enquête à la suite d'une dénonciation anonyme. Dans ce reportage, où je n'ai ni commenté ni modifié quoi que ce soit, je me suis contentée de partager une vidéo dans laquelle un citoyen disait la vérité. Néanmoins, une enquête a été ouverte contre moi le mois dernier. Les allégations dans les trois enquêtes étaient liées aux reportages et aux vidéos d'actualité que j'avais préparés. Si certaines ont été lancées sur la base de dénonciations, d'autres découlent de rapports de la Division de la cybercriminalité. Deux de ces enquêtes ont finalement été classées sans suite.
Bien que je dise que les contenus que je partage relèvent de mes activités professionnelles, je continue à subir le même harcèlement dans de nombreux reportages qui concernent le public. Sur les réseaux sociaux en particulier, une vague systématique de violence numérique se poursuit sans relâche, de la part d'un groupe incapable de digérer la vérité. Cette violence, qui commence dès que nous prononçons les mots « kurde », « femme » ou « droits », reste incontrôlée car elle est renforcée par l'impunité. De nombreuses plaintes pénales que nous avons déposées auprès de nos avocats contre des individus qui ont ouvertement proféré des menaces de mort, des insultes et partagé des images d'armes sur des comptes publics ont été rejetées au motif qu'« il n'y a pas de preuve concrète ». La justice, qui considère nos reportages comme une menace et ouvre des enquêtes contre nous, ne parvient pas à trouver de preuves concrètes contre des individus qui nous menacent ouvertement de mort sous leur vrai nom.
Il est évident que la seule enquête restante aboutira au même résultat. Un journaliste est contraint de faire une déclaration et d'être jugé simplement pour avoir rapporté l'actualité. Au-delà de ces harcèlements judiciaires, les obstacles auxquels nous sommes confrontés sur le terrain restent les mêmes pour les journalistes de Diyarbakır et de la région. Lors des interventions ou des détentions, les forces de l'ordre empêchent les journalistes d'enregistrer des images en utilisant des boucliers. Si les journalistes s'y opposent, on leur dit : « C'est l'ordre reçu ». Pourtant, aucun document n'est fourni pour clarifier qui a donné cet ordre. Les forces de l'ordre, agissant de manière éhontée, non seulement nous empêchent de faire notre travail, mais prennent également des mesures contre nous ou font usage de la force si nous résistons à cette obstruction.
Être la voix de ceux qui ne sont pas entendus…
Dans cette région, je me concentre souvent sur des sujets liés aux femmes, aux questions de genre, à l'écologie et aux droits des enfants. Dans les reportages sur les violences faites aux femmes et les féminicides, je suis fréquemment victime d'insultes et de menaces de la part des hommes auteurs ou de leurs proches. Cette violence se poursuit souvent lors des procès pour féminicides que je suis. De même, les hommes auteurs de ces actes dénoncés dans nos reportages sur le terrain tirent leur force de la politique d'impunité et persistent à menacer les femmes journalistes.
Cette situation ne fait pas exception dans les cas où les auteurs ne sont pas des hommes mais des entreprises. Les entreprises responsables de la destruction écologique nous empêchent parfois de filmer ou nous empêchent d'atteindre les communautés qui protestent contre elles. En bref, que ce soit sur le terrain ou sur les plateformes numériques, la violence de l'État masculin nous confronte dans tous les espaces où nous accordons la priorité aux intérêts publics et nous efforçons d'amplifier la voix des citoyens. Nous savons bien pourquoi cette pression est exercée. Elle est le produit d'un système qui cherche à intimider, à réduire au silence et à construire ses propres médias, dans le but de supprimer la dénonciation des violations et des crises. Ils tentent d'atteindre cet objectif en réduisant au silence les journalistes.
Malgré toutes ces pressions, ma foi dans l'écriture et le journalisme reste inébranlable. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à être sur le terrain pour les droits des femmes et des enfants, pour les droits des prisonniers torturés et pour les droits de tous les êtres vivants – et surtout pour être la voix de ceux qui ne sont pas entendus. Malgré les accusations simplistes et les tactiques d'intimidation, nous resterons ici aux côtés de nos collègues femmes et de toutes les femmes qui luttent pour la justice dans tous les domaines de la vie.
Par Medine Mamedoğlu, journaliste travaillant à l'agence de presse des femmes du Moyen-Orient (NuJINHA). Elle a débuté sa carrière à l'agence de presse Jin (JINHA) en novembre 2015. Elle a travaillé chez Gazete Şûjin et Jinnews après la fermeture de l'agence par un décret.
*QQOQCCP (pour « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi »), concept notamment utilisé en journalisme
Cet article a été produit avec le soutien financier du Centre de journalisme et des médias internationaux (OsloMet-JMIC) de l'Université métropolitaine d'Oslo.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Au cinéma—« Mon ami le terroriste », ou l’humanisation des ennemis politiques
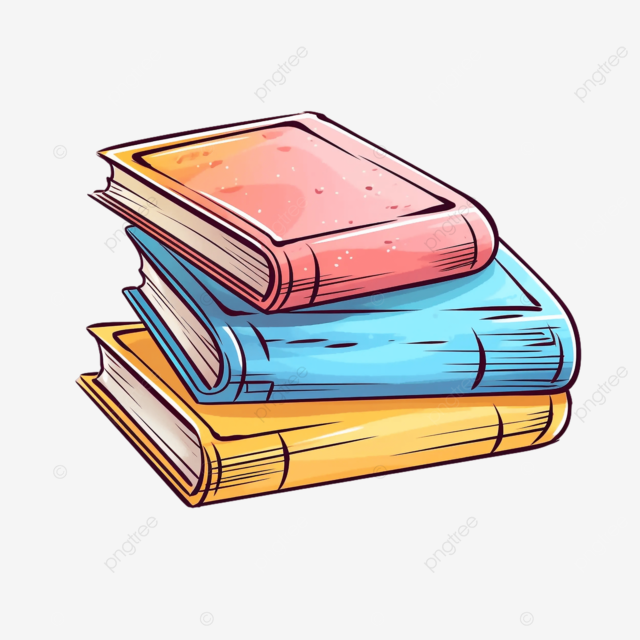
Comptes rendus de lecture du mardi 21 janvier 2025
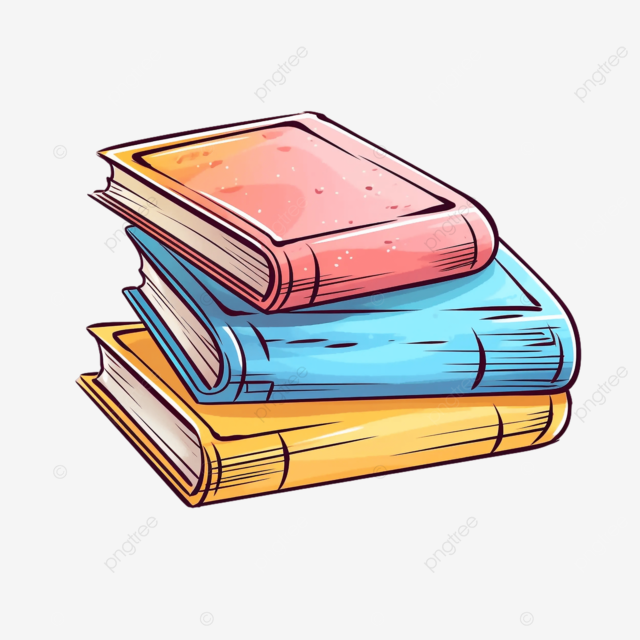
Faire que !
Alain Deneault
Mes nombreuses critiques des livres d'Alain Deneault ont toujours été élogieuses, mais soulevaient l'idée qu'ils gagneraient à être vulgarisés. Je m'en repens aujourd'hui : nous y perdrions beaucoup – et pour quels gains illusoires ? - quant à la profondeur et la sagacité de ses analyses et de ses vues. Dans « Faire que ! », essai sur « l'engagement à l'ère de l'inouï », l'auteur aborde la question « quoi faire ? », que nous nous posons tous devant l'étendue des défis en présence en matière d'environnement, mais il le fait en déplaçant progressivement la question vers un mode d'action - « faire que » - quant à ce que nous devons faire et que nous serons d'ailleurs amenés à faire pour changer la donne… en cette ère de l'inouï. Un bouquin, à mon sens, d'un grand intérêt, qui nous fait découvrir et redécouvrir encore une fois une foule d'idées et d'auteurs, et qui se termine sur une note, je dois le dire, plutôt stimulante.
Extrait :
La vie deviendra plus dure, mais plus significative. On se découvrira des talents qu'on ignorait, et les mettra à des fins plus pertinentes que celles d'un influenceur sur internet. On appellera « biorégion » l'ensemble qui naîtra de la nécessité, dans un moment où il faudra réapprendre à s'organiser à une échelle sensible. Dans les villes, appelées tendanciellement à se dépeupler, les bio quartiers pourront en être le pendant, avec leurs politiques d'agriculture urbaine et de concentrations de services. La biorégion n'est pas un projet, mais le lieu à partir duquel des projets émergent, la suite à donner à une situation - la contraction de la pensée politique à l'échelle régionale - qui sera, elle, impérative.

Les Thibault
Roger Martin du Gard
« Les Thibault » est une œuvre magistrale, en huit volumes, qui couvre l'époque de 1904 à 1940. C'est l'un des meilleurs romans de la première moitié du dernier siècle et l'un des plus beaux qu'il m'ait été donné de lire. Il tourne autour de deux familles, les familles Thibault et Fontanin, et de deux frères que tout oppose, Antoine et Jacques Thibault. Le premier, l'aîné, est un médecin sûr de lui, à l'esprit rationnel et conformiste ; le second, son cadet de neuf ans, est un idéaliste, en révolte contre les valeurs de la société bourgeoise, qui deviendra militant socialiste et tentera d'empêcher la guerre. Une œuvre d'une grande valeur historique et sociale et une œuvre prémonitoire à bien des égards.
Extrait :
C'était vrai. Contre toute attente, cette nuit de voyage avait été mieux que bonne : libératrice. Seul dans son compartiment, il avait pu s'allonger, s'endormir presque aussitôt ; et il ne s'était éveillé qu'à Culoz, reposé, plein d'ardeur, exceptionnellement heureux même, comme délivré d'il ne savait quoi. A la portière, en respirant à larges traits l'air matinal, tandis que le premier soleil achevait de dissiper au fond des vallées les ouates laissées par la nuit, il s'était penché sur lui-même, cherchant à s'expliquer cette joie intérieure, dont, ce matin, il se trouvait comblé. « Fini, s'était-il dit, de se débattre dans la confusion des idées, des doctrines ; un but précis s'offre enfin l'action directe contre la guerre ! » Certes, l'heure était grave ; décisive, sans doute. Mais, lorsqu'il faisait le bilan des impressions qu'il rapportait de Paris, la fermeté de la position du socialisme français, l'accord des chefs, réalisé autour de Jaurès et soutenu par sa combativité optimiste, la soudure qui semblait se faire entre l'activité des syndicats et celle du Parti, tout contribuait à accroître sa confiance dans la force invincible de l'Internationale.

Dissident - Pierre Vallières (1938-1998)
Daniel Samson-Legault
Nous sommes redevables à Daniel Samson-Legault d'avoir écrit une biographie aussi fouillée de ce brillant intellectuel que fut Pierre Vallières près de vingt ans après sa mort. Même si l'auteur de « Nègres blancs d'Amérique » a beaucoup écrit, qu'il a été une figure marquante de notre histoire dans les années 1960 et 1970 et qu'il s'est investi dans une foule de projets au cours de sa vie, nombre de ses proches étaient disparus aussi – dont Charles Gagnon et Michel Chartrand – lorsque l'auteur a repris son projet de biographie. Mais le travail de moine de Samson-Legault, ses recherches et ses très nombreuses rencontres et entrevues avec des personnes de l'entourage de Vallières lui ont permis de pallier ce passage du temps et de nous livrer une très belle et bonne biographie de Vallières. La préface d'Amir Kadhir, qu'on dirait écrite sur un coin de table, hâtivement, est probablement le seul aspect décevant du livre.
Extrait :
Pour les deux représentations, ce soir, la salle est comble avec 700 personnes, et on doit en refuser au moins une centaine d'autres, qui repartent piteuses. Les journalistes ont été invités pour la deuxième, prévue pour 21 h 30, mais qui commence à 22 heures pour se terminer vers minuit et demi. Les télévisions de Radio-Canada et de CBC filment. Le spectacle a commencé par la lecture, par le « juge » Lionel Villeneuve, d'un extrait du compte rendu du procès de Pierre Vallières, personnifié par Robert Gadouas, suivi d'un appel de chacun des prisonniers politiques. C'est un succès éclatant.

Odyssée Lumpen
Alberto Prunetti
Traduit de l'italien
« Odyssée Lumpen » est un beau roman qui nous fait redécouvrir la face cachée du monde, celle de l'exploitation sans scrupule d'une partie de la population. Le narrateur a quitté sa Toscane natale, diplôme à la main, dans l'espoir de trouver mieux en Angleterre. Mais il déchante assez vite, passant à Bristol d'un boulot mal payé à un autre, comme pizzaiolo et nettoyeur de toilettes dans un centre commercial, avec des conditions de travail exécrables, exploité et sans cesse surveillé et harcelé par ses patrons. Un récit sur le lumpenprolétariat, sur les déclassés et les exploités des temps modernes, qui nous fait sourire par moment, mais jamais d'un sourire de mépris. Ce qu'il nous fait plutôt haïr, c'est ce mode d'exploitation capitaliste profondément méprisant et inhumain.
Extrait :
Depuis des siècles les chercheurs et les critiques essaient de déchiffrer les secrets de Shakespeare. Il suffirait d'entrer dans un pub ouvrier le vendredi soir et le mystère serait élucidé. Orgueil, Peur, Vengeance, Jalousie. Entre le comptoir et les chiottes de n'importe quel pub anglais, on trouve bien plus que tout ce dont rêve votre philosophie.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Où va la gauche française ?

Pour la révolution mondiale – 10 affiches de l’OSPAAAL (1968-1976)
L’Organisation de la solidarité des peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine (OSPAAAL) est une organisation anti-impérialiste cubaine, fondée le 12 janvier 1966 suite à la Conférence tricontinentale. Pendant plus d’un demi-siècle, jusqu’à la fermeture de ses locaux en 2019, l’OSPAAAL a joué un rôle de liaison entre les mouvements de libération sur trois continents, dans une perspective anti-impérialiste et socialiste.
La Conférence tricontinentale se tient du 3 au 15 janvier 1966 à La Havane (Cuba). Elle rassemble 500 représentants issus de divers mouvements de libération provenant de 82 nations distinctes. Elle se situe dans le prolongement de la Conférence de Bandung (1955) et de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (1966), deux événements clés qui ont contribué à l’émergence du mouvement des non-alignés, c’est-à-dire des pays qui ne soutiennent ni les États-Unis ni l’URSS. La Tricontinentale vise à unir les mouvements de libération africains, asiatiques et latino-américains afin d’établir une structure de solidarité internationale orientée vers la révolution communiste mondiale. Il s’agit alors d’un des plus importants rassemblements anti-impérialistes à travers le monde. Contrairement à la conférence de Bandung, la Tricontinentale est plus claire dans son intention de s’opposer au capitalisme et soutient ouvertement le socialisme. Durant cette conférence, les délégués adoptent diverses résolutions, comme soutenir la révolution cubaine, demander la fermeture des bases militaires étrangères, promouvoir le désarmement nucléaire et militer contre l’apartheid en Afrique du Sud. Une résolution commune identifie l’impérialisme américain comme l’ennemi commun des peuples en lutte. La conférence aboutit également à une condamnation de l’impérialisme, du colonialisme et du néo-colonialisme, ainsi qu’à la création de l’OSPAAAL.
Entre les années 1960 et 1980, dans un climat de tensions croissantes dû à la guerre froide, l’OSPAAAL s’impose rapidement comme un foyer d’idées révolutionnaires. L’organisation devient la voix des mouvements de résistance contre la domination coloniale à l’échelle mondiale. Grâce à la coopération au sein de l’OSPAAAL, les nouveaux États indépendants peuvent sortir de leur isolement, développer des stratégies économiques et soutenir activement les luttes, qu’elles soient violentes ou pacifiques, sur trois continents.
Pour faire passer son message anti-capitaliste et anti-impérialiste, l’OSPAAAL mise sur son magazine Tricontinental, imprimé à près de 30 000 exemplaires et diffusé dans plus de 80 pays. Elle utilise aussi l’art, notamment à travers des films, mais surtout par la création d’affiches. Les artistes associés à l’OSPAAAL conçoivent des œuvres en soutien aux luttes de libération dans le monde entier, qui se distinguent par leur style visuel audacieux.
Sur le site web de l’OSPAAAL, on peut découvrir une collection d’affiches originales réalisées par divers artistes depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui. Nous mettons en avant ici dix affiches de solidarité internationale.
Semaine internationale de solidarité avec le Viêt Nam (13 au 19 mars)
René Mederos, 1970

Semaine internationale de solidarité avec l’Amérique latine (19 au 25 avril)
Asela M. Pérez Bolondo, 1970

Journée de Solidarité Mondiale avec la Lutte du Peuple de Palestine (15 mai)
Gladys Acosta, vers 1975

Journée de solidarité avec le peuple d’Afrique du Sud (26 juin)
Berta Abelénda, 1968

Journée de solidarité mondiale avec la Révolution cubaine (26 juillet)
Alberto Ortiz de Zarate, 1975

Solidarité avec le peuple afro-américain (18 août 1968)
Lázaro Abreu / Illustration par Emory Douglas, 1968

Journée de solidarité avec les peuples de Guinée-Bissau et du Cap-Vert (3 août)
Berta Abelénda Fernández, 1968

Journée de solidarité mondiale avec la lutte du peuple portoricain (23 septembre)
Rolando Córdova Cabeza, 1976

Journée de solidarité avec le peuple du Laos (12 octobre)
Rafael Zarza, 1969

Journée de Solidarité avec le peuple du Venezuela (21 novembre)
Faustino Pérez, 1969

Une propriétaire harcèle ses locataires âgés pour les expulser
Les libéraux choisissent un nouveau tête
Les libéraux choisissent un nouveau chef
2024 au Québec—Accélération marquée de l’effritement du filet social
Finalement un cessez-le-feu à Gaza, mais tiendra-t-il ?
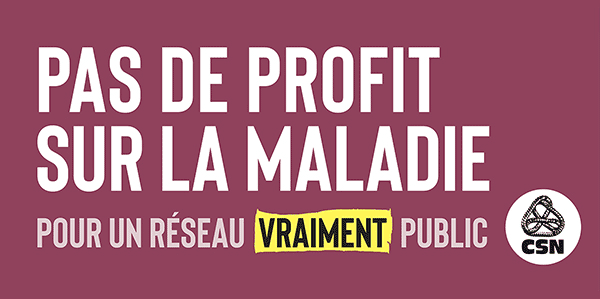
Plan d’urgence contre le privé en santé et services sociaux
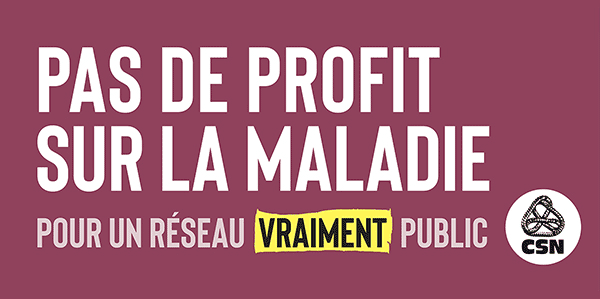
Pétition
Un réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) gratuit est central dans notre conception d'une société équitable et qui prend soin de tout le monde. Nous vivons actuellement au Québec, un vaste processus de privatisation de notre RSSS, accéléré par le gouvernement caquiste de François Legault et du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé. La CSN, par l'entremise de sa campagne Pour un réseau Vraiment public demande un RSSS plus démocratique, décentralisé, déprivatisé et qui met au centre de ses préoccupations des réponses adéquates aux problèmes reliés aux principaux déterminants de la santé.
Lors de son rassemblement, qui a regroupé près de 4000 personnes à Trois-Rivières, le 23 novembre dernier, la CSN a présenté trois mesures rapides que le gouvernement doit prendre afin de freiner l'érosion du RSSS :
– Mettre fin à l'exode des médecins vers le secteur privé ;
– Cesser d'octroyer des permis de cliniques privées à but lucratif ;
– Décréter un moratoire sur tous les projets de privatisation du travail et des tâches effectués par le personnel du réseau public.
Ces trois mesures peuvent se réaliser dès maintenant si la volonté politique est au rendez-vous. La CSN donne au gouvernement jusqu'au 1er mai 2025, soit la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, pour mettre en place ce plan d'urgence.
La présente pétition vise à envoyer un message clair au gouvernement du Québec en lui rappelant que la population exige des engagements concrets et immédiats pour notre RSSS public.
Pour chaque signature, la CSN fera suivre une carte postale au ministre de la Santé et des Services sociaux. Des activités régionales seront aussi organisées pour livrer le message à d'autres élu-es de la CAQ.
En signant cette pétition, vous acceptez de recevoir de l'information de la CSN et de ses organisations affiliées.
Voici le lien pour passer à l'action : https://urls.fr/a19nBT
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
FElon Musk
PLC : Incohérence et échec d'une politique climatique
Le CISO fête ses 50 ans

Toutes les vies se valent-elles vraiment ?

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025
Toutes les vies se valent-elles vraiment ?
CHRISTIAN DJOKO KAMGAIN, PhD, Chargé de cours à l’ÉNAP, Membre du CA de la Ligue des droits et libertés - section de Québec
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce cri, « Plus jamais ça », s’est élevé dans le ciel brûlé de l’humanité comme une prière adressée aux abysses de notre propre cruauté. Ce slogan, simple en apparence, portait l’espoir fragile d’un renouveau, le désir universel de panser les plaies d’un monde défiguré. Mais plus de 70 ans se sont écoulés, et l’on peut se demander si ces fleurs d’idéaux ont produit autre chose que des fruits amers. Les promesses n’ont-elles été que de pâles fleurs sur le sol aride de nos illusions ? L’a-t-on nourrie de mots, cette terre, ou a-t-on simplement replanté les racines des mêmes divisions empoisonnées ? En scrutant le regard que porte cette communauté sur l’Ukraine d’un côté, et sur les cicatrices ouvertes du Moyen-Orient ou de l’Afrique de l’autre, n’assistons-nous pas plus que jamais à l’effritement du pacte fondateur ? J’emploie le nous, mais est-ce vraiment Nous ? Ne sommes-nous pas conduits à soupçonner que ce « Plus jamais ça » pourrait en réalité signifier : « Plus jamais ça pour ceux et celles dont la peau est blanche » ? Les édifices juridiques internationaux, ces architectures imposantes d’un droit façonné par les leçons de l’horreur, se dressent encore, mais que valent-ils vraiment ? Ne sont-ils que des statues d’argile élevées au nom d’une justice que l’on ne sert que par intermittence ? Derrière le vernis des conventions et des lois, derrière les mots qui se veulent universels, la promesse s’effrite : toutes les vies se valent-elles vraiment, ou avons-nous, en silence, désigné des vies plus précieuses que d’autres ? Ce pacte tacite nous entraîne-t-il sur la pente d’un nouvel oubli, où les vies humaines ne sont que des pions, repliés au gré des intérêts du jour, dans un jeu sans fin où seuls les souvenirs de l’horreur retentissent, mais sans jamais arrêter la main de ceux qui rejouent l’échiquier du monde ?Se dissocier de son époque, c’est avoir le courage de nommer ces vies marginalisées et tuables [...]
Humanisme à géométrie variable
Lutter pour que toutes les vies comptent, c’est avoir le courage de nommer et de défendre en particulier celles qui, dans la hiérarchie implicite des valeurs humaines, comptent objectivement le moins. Derrière les déclarations humanistes universelles se dissimulent bien souvent des structures d’injustice qui, loin de les combattre, les perpétuent sous couvert de neutralité bienveillante. Comme une horloge brisée qui échoue à indiquer l’heure juste, ces discours d’égalité universelle masquent les déséquilibres profonds qui organisent le monde. Certains lieux, comme l’est du Congo ou la bande de Gaza, fonctionnent comme des hétérotopies au sens foucaldien : des espaces qui, bien qu’ancrés dans le monde réel, incarnent des contradictions intenses et une vérité parallèle sur la conscience occidentale. Ces lieux de « marginalité violente », où les vies, piégées dans une cage de fer et de feu, semblent peser moins que d’autres sur l’échelle de la valeur humaine universelle. Ils se dressent comme des miroirs inversés de l’humanisme occidental : ce qu’il condamne avec véhémence dans un contexte, il le facilite ou l’ignore dans un autre. Dans ces espaces autres, où l’horreur et l’indifférence coexistent, la promesse d’égalité se fissure, exposant des hiérarchies tacites. En fait, derrière la force apparente de ses principes, l’occident tergiverse, hésite, et parfois recule, incapable de surmonter ses propres contradictions morales et politiques. Plus largement, l’inaction coupable de nombreux pays occidentaux devant le crâne éclaté d’un enfant palestinien1, leur silence devant les injonctions de la Cour internationale de justice ou les avertissements de la Cour pénale internationale, indiquent plus que jamais que leur prétendu humanisme universel multiséculaire n’est très souvent qu’un voile pudique qui, lorsqu’il n’occulte pas l’autre (Enrique Dussel), dissimule une indifférence sélective.Ces discours d’égalité universelle masquent les déséquilibres profonds qui organisent le monde.
Exemplifions cette triste réalité par un autre cas : les réactions mondiales aux crises des réfugiés. Quand des millions de personnes fuient des conflits au Moyen-Orient ou en Afrique, elles se heurtent aux murs de l’indifférence ou à la xénophobie institutionnelle des pays occidentaux, et la Méditerranée devient le symbole d’une honte collective et d’une frontière mortifère. En revanche, l’accueil réservé aux réfugiés d’Ukraine illustre une empathie différenciée qui traduit une hiérarchisation implicite des vies. Au cœur de cette logique, disais-je plus haut, les vies racisées se voient accorder une valeur inférieure. Elles sont réduites au rang de murmures, étouffés par le vacarme des priorités géopolitiques et économiques, où la xénophobie et le racisme les relèguent à des notes de bas de page dans l’histoire humaine. Ce contraste n’est pas le fruit du hasard, mais le symptôme d’une xénophobie structurelle et de la « violence atmosphérique du racisme » dont parlait Frantz Fanon : une violence imperceptible, mais présente, qui se déploie dans les imaginaires collectifs façonnés par des siècles de colonialisme et de suprématie blanche.S’en dissocier
« On n’est pas responsable de son temps, mais de ne pas s’en dissocier », affirmait Guy Hocquenghem en 1986. Se dissocier de son époque, c’est avoir le courage de nommer ces vies marginalisées et tuables, de désigner cette part du monde où, selon les mots poignants de Sony Labou Tansi, « la vie et la mort racontent la même histoire sans serrure, [avec] un trousseau de morts mêlés aux vivants ». C’est lever le voile sur une vérité inconfortable, mais nécessaire : derrière le masque de l’humanisme se dresse une hiérarchie invisible, mais omniprésente, qui dicte silencieusement quelles souffrances méritent notre compassion et quelles morts peuvent être ignorées. Cette hiérarchie secrète, soutenue par un égalitarisme de façade aux accents kantiens, trahit la promesse fondamentale de l’humanité : reconnaître et défendre chaque vie, surtout celles systématiquement rejetées dans l’ombre, dévalorisées ou tuées dans l’indifférence. Se dissocier de cette fausse neutralité, c’est également s’engager. Dans le contexte actuel, l’engagement des forces progressistes doit se transformer en une flamme ardente qui éclaire les zones d’ombre de notre conscience collective et consume les illusions de l’égalitarisme superficiel. Tel un jardinier qui prend soin des plantes les plus fragiles pour assurer la prospérité de tout le jardin, nous devons orienter notre attention et nos efforts vers ceux et celles qui incarnent la vulnérabilité et portent le fardeau des injustices historiques. Cet engagement implique de reconnaître et de contester les hétérotopies modernes de l’oppression – ces espaces où l’existence même semble soumise à un statut précaire, où l’indifférence coloniale persiste, transformant certaines vies en objets du déni collectif. Il ne s’agit pas simplement de tolérer l’existence de ces espaces autres, mais de se mobiliser sans relâche pour les faire émerger au cœur de notre conscience sociale et politique. Ce n’est qu’en prenant en charge cette responsabilité que nous pourrons espérer bâtir un monde où chaque vie compte réellement, et où l’égalité entre toutes les vies n’est plus un idéal distant, mais une réalité tangible et vécue.1 Selon une étude d’OXFAM, entre 2023 et 2024, « plus de 6 000 femmes et 11 000 enfants ont été tués à Gaza par l’armée israélienne ». En ligne : https://oxfam.qc.ca/un-an-conflit-gaza/
L’article Toutes les vies se valent-elles vraiment ? est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.
Veganwashing : L’instrumentalisation politique du véganisme
Les profits avant les besoins dans le futur quartier Molson à Montréal ?

Après cinq jours qui ont changé son visage, où va le Liban ?

Les événements qui se sont déroulés au Liban entre l'élection d'un nouveau président de la République jeudi 9 janvier et la nomination d'un nouveau premier ministre lundi 13, constituent un bouleversement majeur de la situation politique du pays. Ces événements sont eux-mêmes principalement le résultat d'un bouleversement majeur dans l'équilibre réel des forces qui détermine la situation politique du Liban.
tiré de Médiapart
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/150125/apres-cinq-jours-qui-ont-change-son-visage-ou-va-le-liban
Gilbert Achcar
En effet, dans les étapes clés de l'histoire du pays depuis son indépendance en 1943, le gouvernement du Liban a fait l'objet d'un accord entre deux puissances extérieures rivales, et chaque fois que cet accord et l'équilibre qui l'accompagnait ont été perturbés, la situation est devenue tendue au point d'exploser lorsque la tension atteignait son paroxysme.
Au début de la trajectoire de l'État libanais, un équilibre fut établi entre les influences concurrentes des colonialismes britannique et français. Il fut perturbé avec l'affaiblissement de l'influence de ces deux anciens colonialismes et la montée de l'impérialisme américain à l'échelle mondiale et celle du mouvement nationaliste arabe dirigé par l'Égypte de Nasser à l'échelle régionale. La situation explosa alors, jusqu'à ce qu'un accord entre les deux influences ascendantes fût réalisé sur la présidence du commandant de l'armée de l'époque, le général Fouad Chéhab. Cet équilibre fut de nouveau rompu après que l'Égypte nassérienne eut reçu un coup décisif de la part d'Israël en 1967, avec la fraction gauche du parti Baas au pouvoir en Syrie et la Jordanie. Soleimane Frangié devint président du Liban en 1970, à une époque de prépondérance américaine. Cela coïncida avec le coup fatal porté à la résistance palestinienne en Jordanie, la mort de Gamal Abdel Nasser et le coup d'État de Hafez el-Assad contre l'aile gauche du Baas syrien. Avec le transfert du centre de gravité de la résistance palestinienne de Jordanie au Liban, les tensions s'intensifièrent à nouveau jusqu'à ce que la guerre du Liban éclatât en 1975.
Le régime d'Assad intervint au Liban l'année suivante avec les feux verts des États-Unis et d'Israël. Cela aboutit à l'élection d'un président à l'intersection des deux influences, Elias Sarkis. Cependant, le consensus s'effrita rapidement après l'arrivée au pouvoir du Likoud en Israël et le début du processus qui conduisit aux accords de Camp David entre Anouar el-Sadate en Égypte et Menahem Begin en Israël. Les tensions reprirent jusqu'à ce que l'État sioniste envahisse le Liban en 1982. Il tenta d'imposer comme président Bashir Gemayel, le chef de l'extrême droite chrétienne libanaise, mais la tentative échoua avant l'investiture de Gemayel en raison de son assassinat, attribué à Damas. Il fut remplacé par son frère, qui tenta d'entraîner le Liban sur la voie de la normalisation avec Israël, à la suite de l'Égypte, mais une rébellion des forces libanaises soutenues par Damas contrecarra son projet. Après une période de chaos armé, un nouveau consensus entre le régime de Hafez el-Assad et le royaume saoudien aboutit à la fin de la guerre civile libanaise, quinze ans après son début. Le consensus syro-saoudien fut béni par les États-Unis à la suite de la participation du régime syrien à la coalition qui allait mener la guerre contre l'Irak en 1991 sous commandement américano-saoudien.
Le Liban entrait alors dans une phase de « reconstruction » sous tutelle saoudo-syrienne incarnée par le Premier ministre Rafic Hariri et le haut-commissaire syrien au Liban, Ghazi Kanaan. Ce consensus dura jusqu'à ce que les relations entre Damas et Washington se détériorent en raison de la décision des Etats-Unis d'envahir l'Irak et de renverser le régime du parti Baas à Bagdad. La tension revint, l'un de ses signes les plus marquants étant les assassinats orchestrés par le régime syrien, qui culminèrent avec celui de Rafic Hariri en 2005. Cela déclencha un soulèvement populaire qui, combiné à la pression internationale, força Damas à retirer ses forces du Liban. L'équilibre restait fragile, cependant, surtout après la mutation complète de Michel Aoun, de champion autoproclamé de l'opposition au régime syrien au Liban en allié des forces libanaises sous influence syrienne et iranienne.
Le Liban entra une fois de plus dans une phase de troubles résultant de la fragilité de l'équilibre politique entre les deux coalitions, d'autant plus que l'échec de l'assaut sioniste contre le Hezbollah en 2006 avait renforcé l'influence de ce dernier. La région connut une forte expansion de l'influence iranienne, bénéficiant d'abord de l'occupation américaine de l'Irak, qui ouvrit la voie à Téhéran pour imposer sa tutelle sur ce pays, puis de la guerre civile syrienne, en particulier après que le régime syrien eut recours à l'aide iranienne, principalement incarnée par le Hezbollah lui-même, à partir de 2013. La balance s'inversa donc de nouveau, l'influence de l'Iran devenant écrasante dans la région et l'influence du Hezbollah écrasante au Liban. Ce dernier put imposer son allié Michel Aoun à la présidence libanaise en 2016, après une décennie d'alliance entre eux.
Mécontent de l'évolution du Liban et de l'influence croissante de l'Iran sur le pays, le royaume saoudien retira son soutien au Liban, ce qui entraîna l'effondrement de son économie à partir de 2019. La situation du pays resta fort turbulente en raison de l'absence d'accord entre ses composantes de base, jusqu'à la guerre de Gaza et la décision de l'Iran d'y intervenir de manière limitée. Cela se retourna contre le Hezbollah lorsqu'Israël décida de lancer son attaque contre lui et réussit à le décapiter et à détruire la majeure partie de sa capacité militaire. Cette situation a été exacerbée par l'effondrement du régime d'Assad survenu il y a un peu plus d'un mois, et avec lui l'effondrement de la principale voie d'approvisionnement entre l'Iran et ses supplétifs libanais.
C'est dans le contexte de ce nouveau basculement des rapports de force qui a fait pencher la balance en faveur des États-Unis au Liban, que l'homme que Washington avait soutenu pour devenir président du Liban depuis la fin du mandat de Michel Aoun a été élu, à savoir le commandant de l'armée Joseph Aoun (qui n'est pas un parent du premier). Washington avait parié pendant des années sur le renforcement de l'armée libanaise pour lui permettre de mettre fin à la dualité du pouvoir au Liban, représentée par l'existence de l'État du Hezbollah au sein de l'État libanais, et surtout par la coexistence des forces armées du parti avec l'armée officielle du pays. La balance penchant à présent en faveur de l'influence américaine, le royaume saoudien a renouvelé son intérêt pour la situation libanaise, soutenant les efforts de Washington.
Le Hezbollah a participé au vote en faveur de Joseph Aoun lors d'un second tour des élections au parlement libanais, après s'être abstenu de le soutenir au premier tour pour bien marquer la dette du nouveau président à son égard. Il a accepté ce compromis sous la pression de son allié confessionnel Nabih Berri, qui était auparavant dépendant du régime syrien d'Assad. Les deux alliés ont cependant été choqués par la nomination au poste de Premier ministre de Nawaf Salam, dont ils s'étaient précédemment opposés à l'accession à ce poste, le Hezbollah en particulier, tout comme ils s'étaient opposés à l'accession de Joseph Aoun à la présidence.
Le résultat de tout cela est que le consensus qui a présidé aux années de stabilité au Liban, qui sont presque égales aux années de tension, sinon moins nombreuses, n'a pas été renouvelé. Cela laisse présager que le pays entrera dans une nouvelle phase de tension et de conflit, surtout si le nouveau gouvernement tente d'imposer le monopole de l'État sur les armes au Liban, ce qu'Aoun a promis dans son discours de victoire, au lieu de prendre la voie consensuelle qu'il a également promise. Le sort de la situation libanaise dépendra en grande partie de ce qui se passera entre Israël, soutenu par Donald Trump, derechef président des États-Unis, d'une part, et l'Iran d'autre part. Il sera également affecté par les développements en Syrie, où il ne fait aucun doute que l'Iran a l'intention d'étendre à nouveau son influence d'une manière ou d'une autre, ce qui, si Hay'at Tahrir al-Cham (HTC) continue d'essayer de monopoliser toutes les rênes du pouvoir, pourrait faire sombre la Syrie de nouveau dans la guerre civile.
Traduit de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 14 janvier. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Encore des millions pour des consultants privés, cette fois à Santé-Québec

La conquête de l’Amérique à la manière trumpiste

Dans une rhétorique répétitive (est-ce à titre d'avertissement et de persuasion ?), le président étasunien élu cible une nouvelle fois des alliés à des fins hégémoniques. Le Canada, le canal de Panama et le Groenland font l'objet d'une desiderata ouverte qui ne fait qu'animer les tensions.
Expansion des États-Unis vers le nord et vers le sud fait écho aux époques (soi-disant) révolues où les conquêtes visaient la prise de possession de territoires par la guerre. Or, une telle intention n'a rien de surprenant dans le contexte actuel. Des conflits ici ouverts et là larvés se manifestent un peu partout dans le monde, des conflits animés par des dirigeants convertis à la tyrannie qui mérite d'être définie.
Une définition
Dérivé du grec turannos, la tyrannie est associée à un « pouvoir cruel », voire « despotique » et aussi « injuste » au point où elle s'accompagne « d'un jugement de valeur », étant donné qu'on la compare à l'une des formes du mal (Guineret, 2014, p. 765). Il s'agit en plus d'une façon de traiter les personnes en leur usurpant des libertés, afin de les contraindre au sein d'un régime dit totalitaire. Ici s'érige un culte de la personnalité, celle du tyran, qui prédomine sur tout genre d'individualité. Conquérir, rayonner, atteindre le prestige et autres ambitions d'extase supposent à l'inverse une insatisfaction constante, des envies non rassasiées, une humeur variable, y compris la recherche d'un idéal presque impossible (sinon l'étant [1]).
La voie du Nord
Insinuer la conquête du Canada pour en faire le cinquante-et-unième état fédéré des États-Unis va bien au-delà des arguments entendus sur la diminution des impôts, l'élimination des règles tarifaires et le bénéfice d'une meilleure défense armée pour les Canadiennes et les Canadiens. Cela suppose de s'intéresser aux ressources du pays, à ses terres encore vierges, à son sous-sol, mais aussi à la voie du Nord lorgnée par d'autres, dont la Russie et la Chine. Voilà une interprétation similaire en ce qui concerne le Groenland, qui perd d'année en année des masses de glace au point de le rendre attrayant à l'exploration. Mettre la main sur ces territoires souverains accroîtrait la force des États-Unis en Arctique, jusqu'ici soulignée par l'Alaska. Mais pourquoi ne pas chercher plutôt à renforcer l'alliance États-Unis-Canada-Groenland (Danemark), voire même en ajoutant l'Union européenne ? Parce qu'il faudrait séparer le gâteau, négocier avec des alliés (pouvant aussi être jugés de compétiteurs) en plus des adversaires. Viser la totalité suppose une volonté de tyran. Celui-ci aime l'attaque et appréhende les revers, dans le sens où il limite sa confiance à des personnes proches, très proches ; voire des fidèles adorateurs, soit de lui, soit de son idéologie. Ainsi, les alliés, sur lesquels il n'a point de contrôle, peuvent agir contre ses desseins. Ils représentent alors des menaces latentes et imprévisibles, contrairement aux ennemis supposément plus faciles à analyser (même si leurs actions peuvent aussi s'inscrire dans l'imprévisibilité). Limiter le nombre d'alliés et d'adversaires revient à simplifier les communications et à réduire les dissensions ; cela revient à gagner une plus grande part du magot.
La voie du Sud
La conquête du canal de Panama offre cette fois-ci une mainmise sur le trafic de l'hémisphère sud de l'Amérique. Il s'agit alors d'une position stratégique déjà bien identifiée et facile à saisir, comparativement à la voie du Nord qui impose une configuration à élaborer. Par ailleurs, la voie du Sud est entourée de pays jugés plus faibles, accroissant ainsi le succès d'une manoeuvre rapide. On envisage même un « achat » du canal plutôt qu'une manoeuvre armée. Dans la tête d'un tyran, il n'a même pas lieu de se demander qui est allié ou ennemi, puisqu'un préjugé lui sert à n'y voir qu'une victoire inéluctable. Cette interprétation diffère-t-elle dans le cas de la voie du Nord ? Le Groenland et le Canada sont militairement plus faibles, mais leur alliance avec l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) accroît leur force tout de même. Mais les États-Unis font aussi partie de l'OTAN, étant en plus un grand contributeur. En exprimant un souhait tyrannique contre des membres d'une organisation dont il fait partie, le tyran revendique alors un droit extraordinaire, à défaut de quoi l'alliance sera rompue. Il s'agit également d'une stratégie visant à réviser des ententes jugées désormais défavorables. Cela ne vient-il pas donner un coup de pouce à un pays jugé ennemi, en songeant à un conflit toujours d'actualité ? Pourquoi alors prendre ce risque ? Voilà le complexe du tyran : les alliés véritables n'existent pas dans son esprit, même si quelquefois il s'avère opportun d'en avoir afin d'atteindre le but espéré.
Après l'Ukraine, la Palestine et Taïwan
Le contexte actuel sert bien l'attitude étasunienne de la présidence nouvellement élue. Au-delà d'une raison de grandeur et de retour aux empires, le conflit en Ukraine et les tensions dans la mer de Chine exposent surtout des raisons idéologiques et économiques dans l'accroissement d'un pouvoir sur le Monde. Semblablement, mais aussi avec d'autres raisons, s'explique la dynamique conflictuelle entre Israël et Gaza, en supposant une conquête éventuelle de la Palestine de jadis. Voilà des actions de tyrans qui en font réagir d'autres, le tout exprimé au nom de la nation. En effet, le tyran voudra exposer sa sollicitude aux besoins de sa population, justifiant ainsi ses faits et gestes sur cette base. Des valeurs servent à la propagande : la grandeur, la force, le pouvoir, la richesse, la préservation de la nation, de la famille, du travail, etc. ; sans oublier de parler au nom de la liberté. Toujours, les tyrans lorgneront les territoires de proximité, puisqu'un empire ne peut se constituer et se maintenir si les conquêtes sont trop éloignées de la métropole. Une logique centrifuge fait donc gagner l'étendue, à moins de juger d'une résistance quasi nulle permettant de remporter des positions stratégiques. Cela dit, rien n'est encore précisé au sujet du Mexique, pourtant limitrophe aux États-Unis. Pour éviter la contradiction, en raison de la construction d'un mur entre les deux pays, mieux vaut s'en remettre à renommer le golfe. Donner un nom ou changer le nom d'un lieu ou d'un territoire suppose aussi une forme d'appropriation, de conquête (dans une certaine mesure, du moins d'ordre symbolique ou idéologique).
Conclusion
S'agit-il de phantasmes irréalistes d'un politicien qui se prend pour Ubu roi ou d'aspirations démoniaques d'un politicien populiste et démagogue qui aurait de graves problèmes mentaux échappant à l'expertise de l'analyste politique ? Nous avons plutôt décidé d'examiner ces déclarations qui détonnent sous un angle de géographie stratégique en lien avec des aspirations impérialistes.
Il est facile de taxer Donald Trump de « perversité diabolique » ou de personnalité atteinte par la « folie des grandeurs ». Nous avons voulu, de notre côté, nous éloigner de cette interprétation simpliste qui semble avoir actuellement moult adeptes chez les commentateurs et les commentatrices de l'actualité politique. Nous avons préféré l'exposé de certains scénarios qui relèvent de la supposée « Raison d'État ». Cette raison qui autorise toutes les dérogations. En un mot, une approche analytique qui examine la voie selon laquelle « la fin justifie les moyens ». La politique n'a rien à voir avec le parcours d'un long fleuve tranquille. La politique évolue avec l'histoire et l'Histoire (avec un grand H), jusqu'à maintenant, montre à voir trop d'exemples qui s'inscrivent dans une suite ininterrompue de convulsions, à première vue, irrationnelles. Il est peut-être temps de rappeler que tout empire cache un secret désir, soit celui de vouloir étendre, par divers moyens, sa domination sur d'autres pays.
Héraclite, à son époque, avait déjà remarqué que « Tout bouge, tout change ». Machiavel précisait de son côté, dans son célèbre ouvrage intitulé Le prince, que les dirigeantEs politiques doivent cultiver l'art de la guerre, pire, qu'elles et qu'ils doivent en faire leur principale pensée. C'est ce que Donald Trump semble prêt à faire et ce, au nom même de son slogan Make America Great Again. Le changement est, faut-il le rappeler, un processus paradoxal. La paix et la guerre ne s'excluent pas. Ces deux phénomènes sont tristement liés l'un à l'autre, en ce sens ils sont consubstantiels.
Au-delà du constat de la stratégie d'attaque pour placer la partie négociante sur le qui-vive, exprimer ouvertement ses désirs de conquête à l'endroit d'une nation souveraine doit être interprété comme un acte de tyrannie. Capitalisant sur le contexte mondial du moment, les propos entendus de la part de la présidence étasunienne élue expose un changement de ton où le slogan American Great Again rejoint soudainement l'esprit de conquête britannique des siècles passés et remplace le protectionnisme ou plutôt le déplace dans ce nouvel esprit. Il ne suffit plus de conquérir des marchés, synonyme de territoires symboliques, mais de véritablement les faire siens. Car tout posséder revient à tirer profit de tous les revenus et avantages possibles. Mais il existe encore un large fossé entre acquérir des voies de communication et d'échange et des territoires entiers dans lesquels se trouvent ces trajectoires. Est-ce seulement au nom de l'économie et de l'idéologie que s'avancent ainsi les tyrans contemporains ? L'histoire nous montre pourtant des motifs et des mobiles souvent dichotomiques aux aspirations communes, c'est-à-dire à la fois des populations qu'ils disent représenter et du reste de l'humanité.
Guylain Bernier
Yvan Perrier
12 janvier 2025
9h
Note
[1] Étant : dans le sens de son impossibilité à se matérialiser ou à devenir.
Référence
Guineret, Hervé (2014). Tyrannie. Dans Jean-Pierre Zarader (Dir.), Dictionnaire de philosophie (pp.765-766). Paris, France : Ellipses.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Du pouvoir des cravates au règne des casquettes
Tarifs de Trump : la solution des pétrolières
Noël sans revenus : « Un beau cadeau de la part de Béton Provincial »
Réplique à Trump : Taxer les barbares numériques
Chili : lutter contre l’impunité de l’État en payant la dette historique envers le peuple
Nouveautés à la Fête des semences de La Pocatière : une édition 2025 sous le signe du patrimoine et de la diversité
Les collèges de l’Ontario cèdent face aux exigences des syndicats

Nouveaux visages de l’itinérance… issus de l’immigration

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025
Une version abrégée est parue dans l'édition du 14 janvier 2025 du journal Le Devoir.Nouveaux visages de l’itinérance… issus de l’immigration
Maryse Poisson, Directrice des initiatives sociales au Collectif Bienvenue, chargée de cours en travail social, UQAM, et membre du comité Droits des personnes migrantes de la LDL
Mauricio Trujillo Pena, Co-coordonnateur, Regroupement des organismes en hébergement pour les personnes migrantesFlorence Bourdeau, Co-coordonnatrice, Regroupement des organismes en hébergement pour les personnes migrantes
En avril 2023, l’élargissement de l’entente des tiers pays sûrs, annoncée à l’improviste et sans consultation, a fermé la dernière porte qui permettait aux personnes en quête de refuge dans des situations précaires d’avoir accès au système canadien de protection. En effet, avant cette date, l’entente ne s’appliquait pas aux points d’entrée irréguliers, ce qui permettait aux personnes les plus vulnérables de se présenter pour demander l’asile à des points comme le chemin Roxham, et ce, sans visa. Désormais, seules les personnes ayant un visa d’étudiant, de travail, ou autre, peuvent demander l’asile à leur arrivée à l’aéroport canadien ou à un point d’entrée terrestre, avec seule exception les personnes ayant un membre de leur famille proche au Canada. Évidemment, l’obtention de ce visa est difficile et réservée aux plus nantis.Quel climat pour les demandeurs d’asile ?
En plus de ce resserrement qui a eu un impact évident, les derniers mois ont été le théâtre au Québec d’une montée très importante des idées et du discours anti-immigration, principalement contre les immigrants à statut temporaire. Cette catégorie large est composée de multiples groupes, dont les demandeurs d’asile. Alors que les demandeurs d’asile et les personnes à statut précaire s’installent en majorité dans les villes, les municipalités n’ont pas de pouvoir sur le processus de l’octroi de statut (compétence fédérale), ou sur l’accès aux services sociaux (santé, éducation, aide sociale, etc.). Les municipalités se retrouvent davantage à devoir agir et réagir devant la précarisation de cette population, dont l’augmentation de l’itinérance. Ainsi, on a vu tout récemment un resserrement du processus pour deux groupes autres que les demandeurs d’asile : les personnes obtenant un permis de travail temporaire à bas salaire et les personnes en sol canadien avec un visa de tourisme ou autre, entamant sur place les démarches pour obtenir un visa de travail fermé. Or, d’autres changements de politiques plus subtils affectent également les demandeurs d’asile. Par exemple, dans les dernières semaines, des médias canadiens ont rapporté une hausse préoccupante de personnes se présentant avec un visa canadien valide empêchées d’entrer au Canada, car suspectées de vouloir y demander l’asile, et aussi un resserrement dans le processus d’octroi de visa. Il semble que ces politiques officieuses soient une réponse positive de la part de l’administration Trudeau aux demandes du premier ministre François Legault. En octobre 2024, le discours de François Legault a pris une tangente encore jamais vue en matière d’atteinte aux droits des demandeurs d’asile. Il a ouvertement suggéré de les déplacer de force hors Québec, ou de créer des zones d’attente comme en France, alors que cette pratique ne respecte manifestement pas les droits humains.Alors que les demandeurs d’asile et les personnes à statut précaire s’installent en majorité dans les villes, les municipalités n’ont pas de pouvoir sur le processus de l’octroi de statut (compétence fédérale), ou sur l’accès aux services sociaux (santé, éducation, aide sociale, etc.).
Se retrouver à la rue
L’ensemble des changements semble avoir créé un terreau fertile pour une hausse des demandes internes, observée autant sur le terrain que dans les statistiques de l’Association des services frontaliers du Canada (ASFC) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). De plus en plus de personnes ne déposent pas une demande d’asile à leur arrivée à l’aéroport ou à la frontière terrestre, par peur ou méconnaissance, et se retrouvent dans une situation beaucoup plus complexe, appelée le processus de demande d’asile à l’interne. La différence semble technique, mais elle transforme le visage de l’itinérance à Montréal. Présentement, une personne ne déposant pas une demande d’asile auprès d’un agent frontalier quitte l’aéroport sans avoir de droits associés au statut du demandeur d’asile. Elle n’a pas droit aux hébergements prévus par le gouvernement provincial ni fédéral ni à l’aide sociale. Si elle n’a pas de famille ou d’amis à Montréal, elle se retrouve en itinérance, jusqu’à ce qu’elle ait réussi à déposer une demande d’asile complète. L’itinérance engendre à son tour un obstacle majeur à l’exercice de plusieurs droits, mettant en péril la santé et la sécurité notamment. Comme organisme de première ligne, nous observons quotidiennement les impacts de l’itinérance sur ces personnes. Les demandeurs d’asile vivent souvent plusieurs difficultés cumulées (traumatisme ou symptômes de santé mentale, barrière de la langue, absence totale de réseau de soutien ou de connaissance du milieu, etc.). Les hébergements pour personnes en situation d’itinérance, bien qu’ils fassent de leur mieux, ne sont souvent pas adaptés à ces personnes. La cohabitation avec des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie s’avère un obstacle de plus à l’intégration. De plus, la situation d’itinérance complexifie le processus de régularisation de leur statut : de nombreuses personnes sans adresse fixe ne reçoivent pas leur courrier essentiel de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (CISR), et omettent ainsi de se présenter à leur audience.Ce contexte changeant rend plus urgent de créer des partenariats innovants entre les municipalités et les organismes communautaires pour répondre aux besoins des migrants à statut précaire tout en optimisant les ressources locales disponibles.
Déposer une demande d’asile est complexe et doit inclure un narratif de persécution détaillée, une étape qui requiert normalement les services d’un-e avocat-e ou d’un-e consultant-e. Ces personnes migrantes n’ayant bien souvent pas d’argent pour payer un représentant légal, elles se retrouvent à vivoter dans les sites d’hébergement pour personnes en situation d’itinérance. Une chose est sûre : les reculs dans l’accès à l’asile dans la dernière année contribuent à transformer le visage de l’itinérance à Montréal. Bien que non officiellement comptabilisés, pour ne pas en rajouter en matière de stigmatisation, les échos du terrain font état d’une nette augmentation des personnes immigrantes dans différents refuges. Que ce soit dans des organismes œuvrant en hébergement temporaire pour les femmes, les jeunes, les hommes seuls, de nombreux intervenant-e-s terrain composent maintenant avec des situations complexes des parcours migratoires.Unir nos forces
[caption id="attachment_20826" align="alignright" width="299"] Crédit : Julien Cadena[/caption]
C’est dans ce contexte que plusieurs organismes communautaires en hébergement de personnes migrantes ont pris la décision de se regrouper, en créant le regroupement des organismes en hébergement pour les personnes migrantes (ROHMI). L’objectif est à la fois de faire reconnaître ces organismes, pour l’instant pas financés par le gouvernement, mais également de créer des liens et d’échanger aux intersections de la prévention de l’itinérance et de la défense des droits des personnes à statut précaire.
À l’initiative de ce regroupement, le Pont-APPI et Foyer du Monde proposent des hébergements de première ou deuxième étape pour les personnes seules et les familles. Au-delà d’un toit, ces organismes offrent une approche intégrée incluant des services psychosociaux, juridiques, des ateliers de francisation, l’accompagnement dans les premières démarches et jusqu’à la recherche d’un logement permanent. L’accueil dans la dignité prend ici tout son sens.
Avec la création du ROHMI, ils visent à étendre ces modèles pour élargir la gamme des options d’hébergement temporaire, tout en favorisant une approche multisectorielle et concertée, impliquant les organisations communautaires, les agences publiques, les institutions académiques, les partenaires des services sociaux et de santé, les acteurs privés et les municipalités.
En s’appuyant sur les dispositions de la Loi sur les compétences municipales1, le ROHMI cherche à développer des modèles d’hébergement temporaire avec les villes. L’article 84.1 permet à une municipalité de louer des immeubles qu’elle possède à des fins d’habitation et de déléguer leur gestion à des organismes comme le ROHMI, facilitant ainsi l’utilisation de bâtiments municipaux pour des projets de logement transitoire. Ce contexte changeant rend plus urgent de créer des partenariats innovants entre les municipalités et les organismes communautaires pour répondre aux besoins des migrants à statut précaire tout en optimisant les ressources locales disponibles.
Le ROHMI travaille aussi à bâtir des alliances stratégiques, qui permettront la mise en place de modèles innovants au-delà des modèles des maisons d’hébergement temporaire. Les membres du regroupement ont déjà d’autres modèles qui ouvrent la participation aux propriétaires privés, comme le modèle de sous-location à court et à long terme, qui peut s’avérer primordial pour permettre l’accès et le maintien du logement pour les personnes à statut précaire. Les hébergements spécialisés pour demandeurs d’asile se concentrent présentement à Montréal et une vraie expertise s’y développe. Il serait très intéressant de voir les municipalités s’engager davantage, en offrant des lieux ou des incitatifs pour leur multiplication.
Le ROHMI renforce ses collaborations avec des organismes nationaux pour encourager l’analyse et l’action autour de l’intersection entre immigration et logement. Ces espaces de partage visent à échanger sur les meilleures pratiques et à souligner l’importance de briser les silos entre les différents secteurs. Il est crucial de reconnaître le rôle central des villes dans le développement de projets et d’initiatives concertées. Leur implication active est essentielle pour garantir une intégration stable, équitable et durable des personnes migrantes à statut précaire à la société dans le respect de leurs droits humains.
Crédit : Julien Cadena[/caption]
C’est dans ce contexte que plusieurs organismes communautaires en hébergement de personnes migrantes ont pris la décision de se regrouper, en créant le regroupement des organismes en hébergement pour les personnes migrantes (ROHMI). L’objectif est à la fois de faire reconnaître ces organismes, pour l’instant pas financés par le gouvernement, mais également de créer des liens et d’échanger aux intersections de la prévention de l’itinérance et de la défense des droits des personnes à statut précaire.
À l’initiative de ce regroupement, le Pont-APPI et Foyer du Monde proposent des hébergements de première ou deuxième étape pour les personnes seules et les familles. Au-delà d’un toit, ces organismes offrent une approche intégrée incluant des services psychosociaux, juridiques, des ateliers de francisation, l’accompagnement dans les premières démarches et jusqu’à la recherche d’un logement permanent. L’accueil dans la dignité prend ici tout son sens.
Avec la création du ROHMI, ils visent à étendre ces modèles pour élargir la gamme des options d’hébergement temporaire, tout en favorisant une approche multisectorielle et concertée, impliquant les organisations communautaires, les agences publiques, les institutions académiques, les partenaires des services sociaux et de santé, les acteurs privés et les municipalités.
En s’appuyant sur les dispositions de la Loi sur les compétences municipales1, le ROHMI cherche à développer des modèles d’hébergement temporaire avec les villes. L’article 84.1 permet à une municipalité de louer des immeubles qu’elle possède à des fins d’habitation et de déléguer leur gestion à des organismes comme le ROHMI, facilitant ainsi l’utilisation de bâtiments municipaux pour des projets de logement transitoire. Ce contexte changeant rend plus urgent de créer des partenariats innovants entre les municipalités et les organismes communautaires pour répondre aux besoins des migrants à statut précaire tout en optimisant les ressources locales disponibles.
Le ROHMI travaille aussi à bâtir des alliances stratégiques, qui permettront la mise en place de modèles innovants au-delà des modèles des maisons d’hébergement temporaire. Les membres du regroupement ont déjà d’autres modèles qui ouvrent la participation aux propriétaires privés, comme le modèle de sous-location à court et à long terme, qui peut s’avérer primordial pour permettre l’accès et le maintien du logement pour les personnes à statut précaire. Les hébergements spécialisés pour demandeurs d’asile se concentrent présentement à Montréal et une vraie expertise s’y développe. Il serait très intéressant de voir les municipalités s’engager davantage, en offrant des lieux ou des incitatifs pour leur multiplication.
Le ROHMI renforce ses collaborations avec des organismes nationaux pour encourager l’analyse et l’action autour de l’intersection entre immigration et logement. Ces espaces de partage visent à échanger sur les meilleures pratiques et à souligner l’importance de briser les silos entre les différents secteurs. Il est crucial de reconnaître le rôle central des villes dans le développement de projets et d’initiatives concertées. Leur implication active est essentielle pour garantir une intégration stable, équitable et durable des personnes migrantes à statut précaire à la société dans le respect de leurs droits humains.
1 En ligne : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-47.1?&cible=
L’article Nouveaux visages de l’itinérance… issus de l’immigration est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












